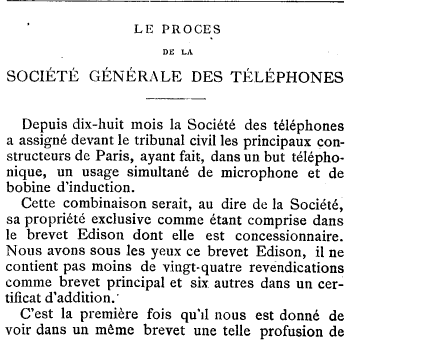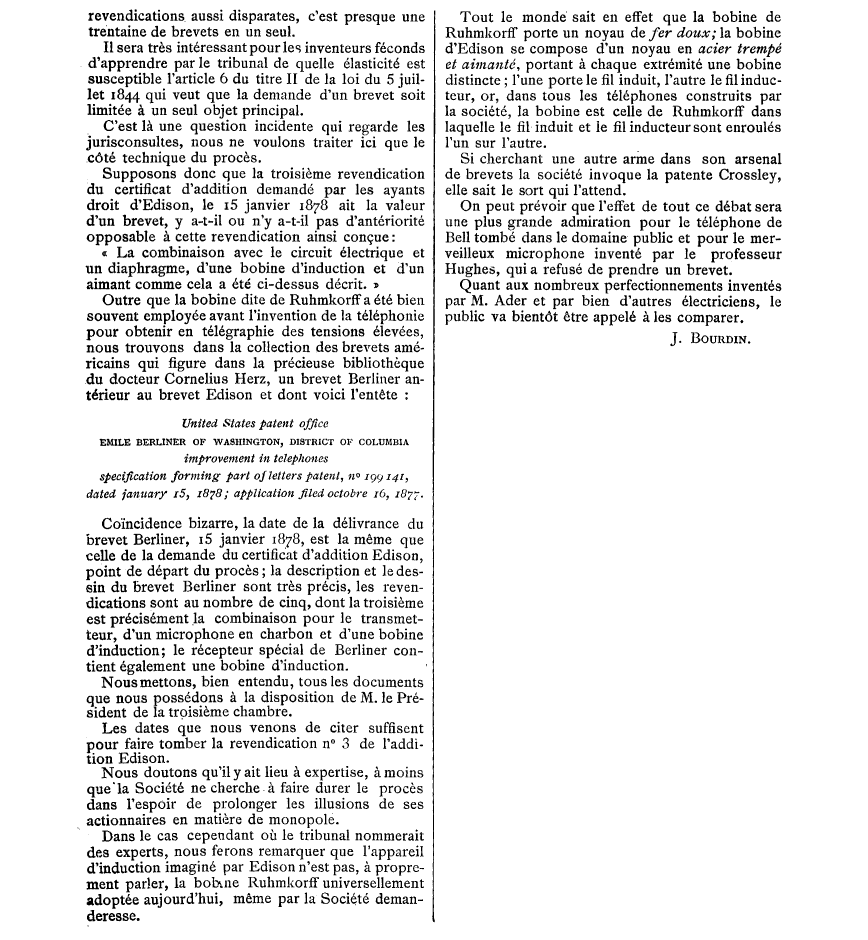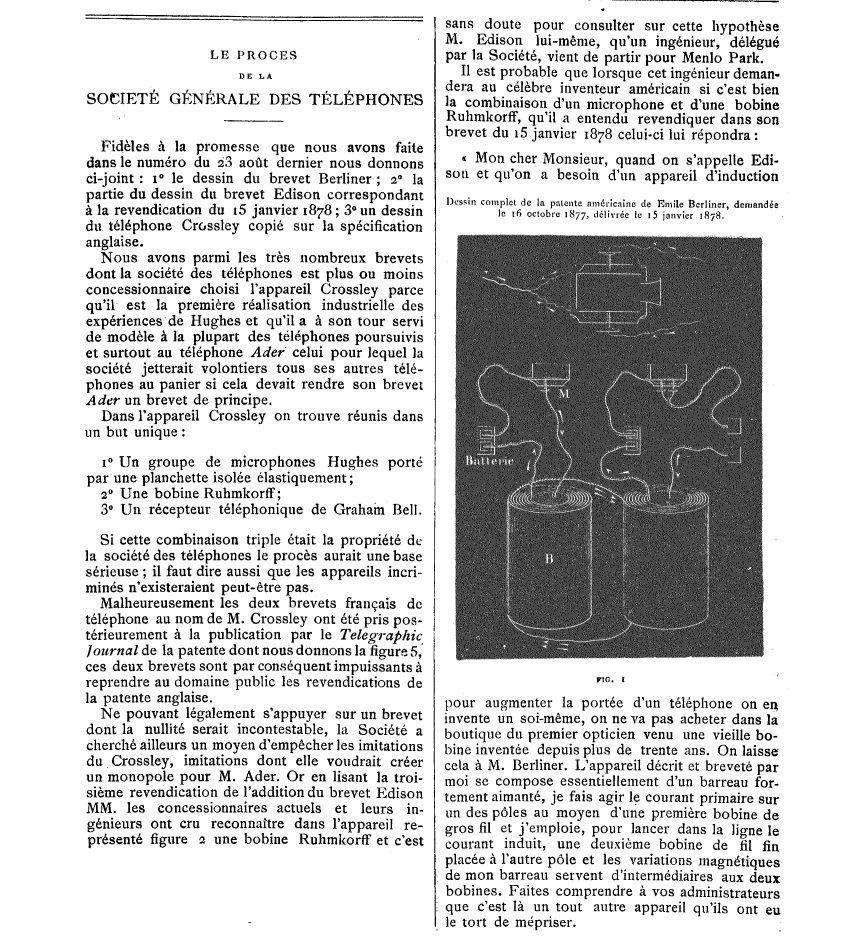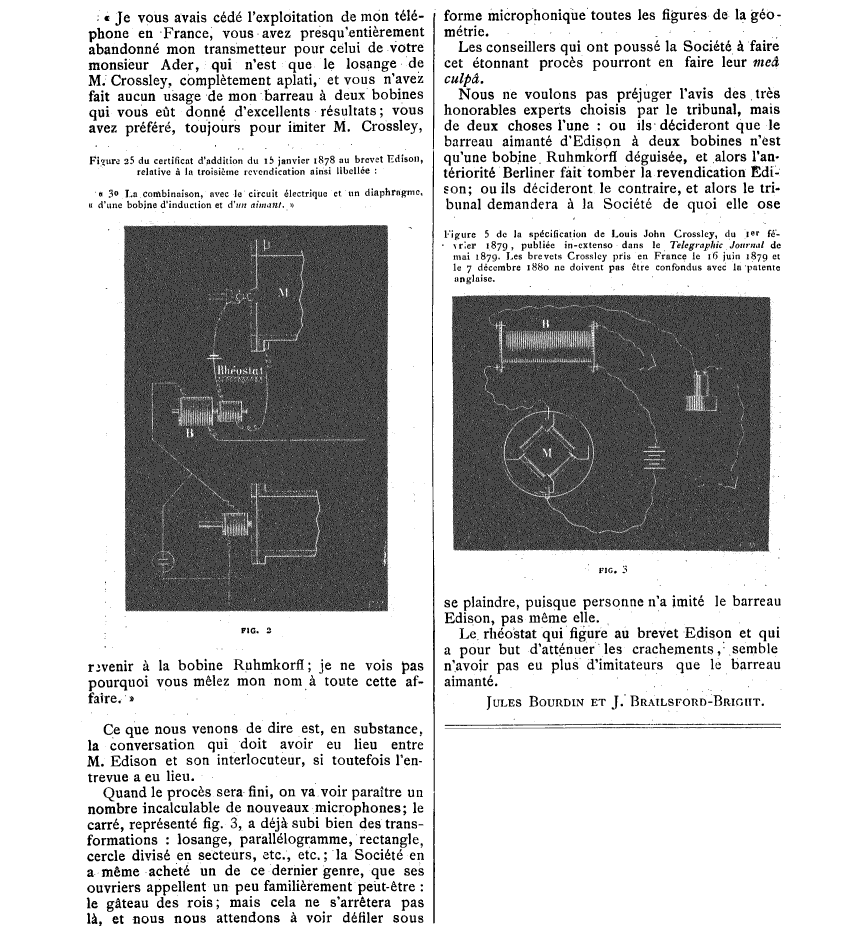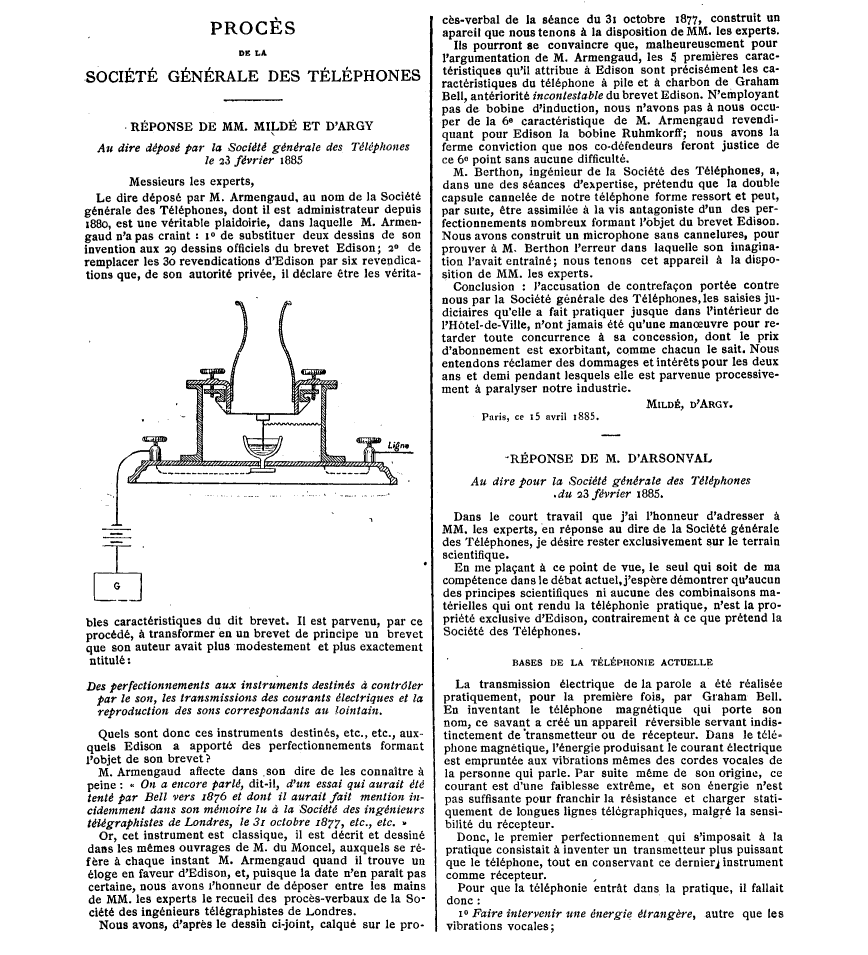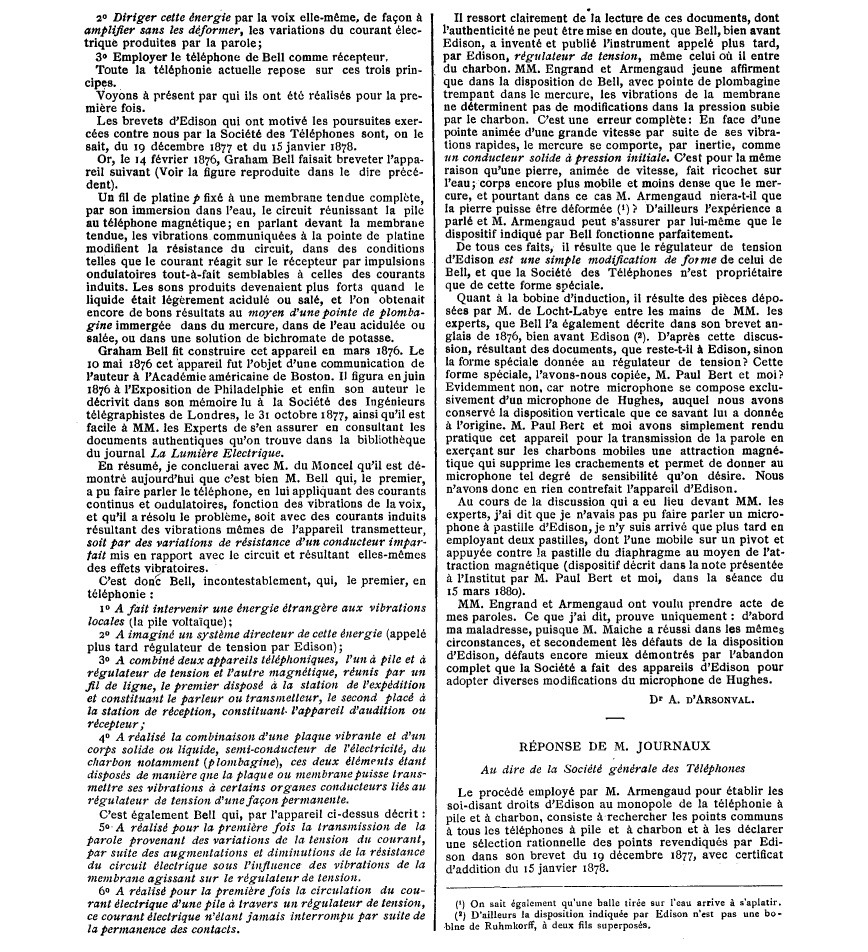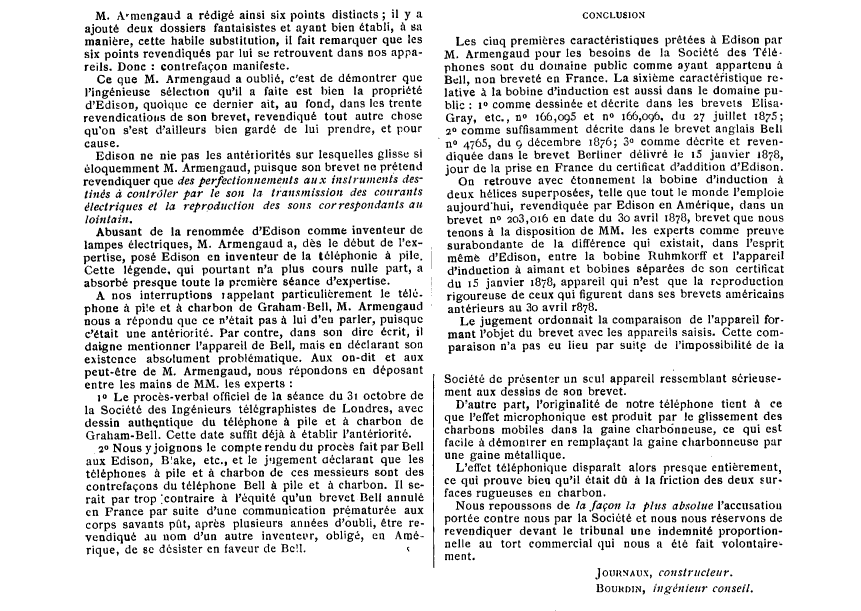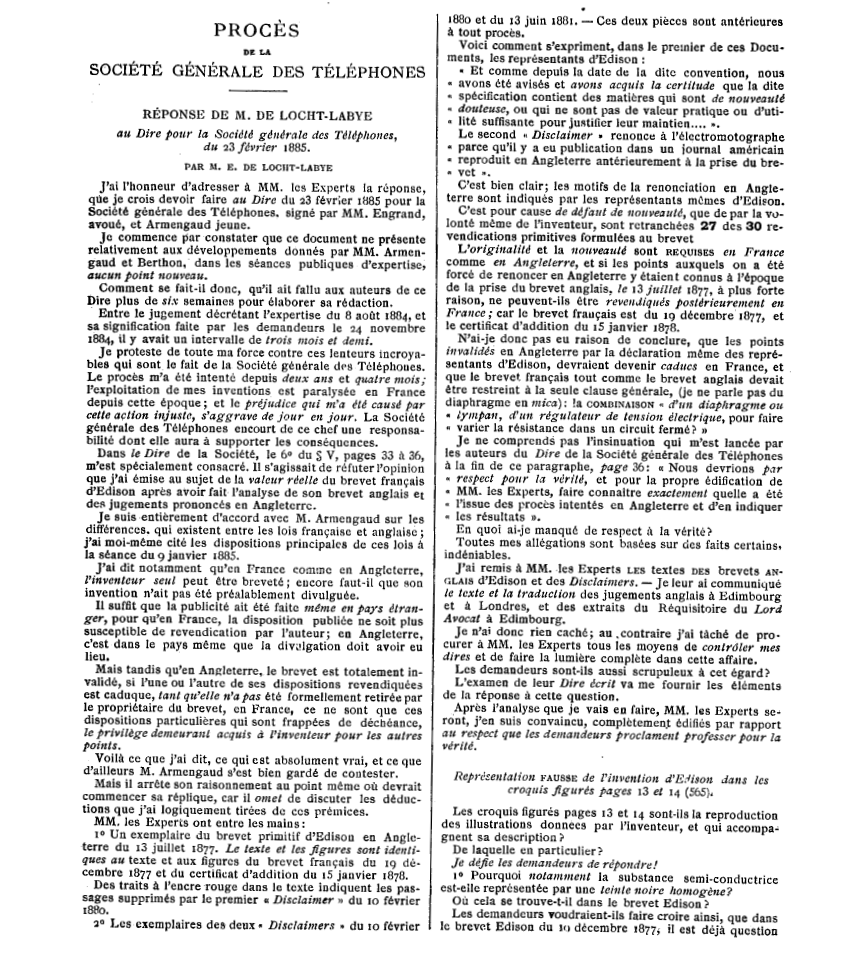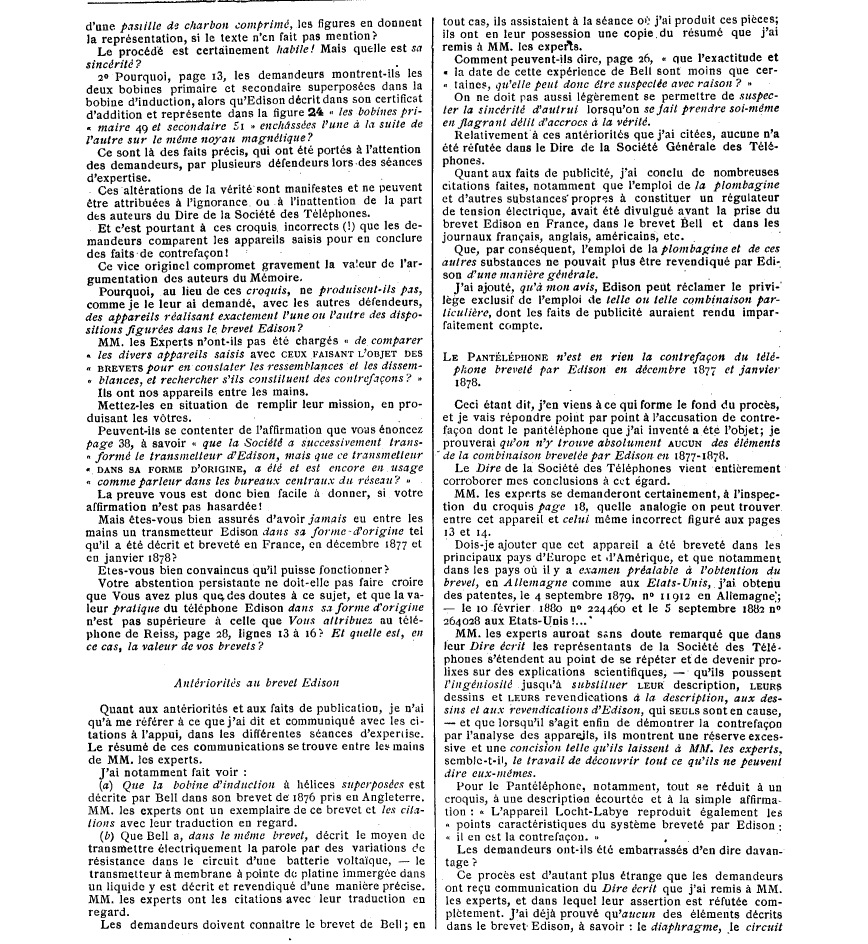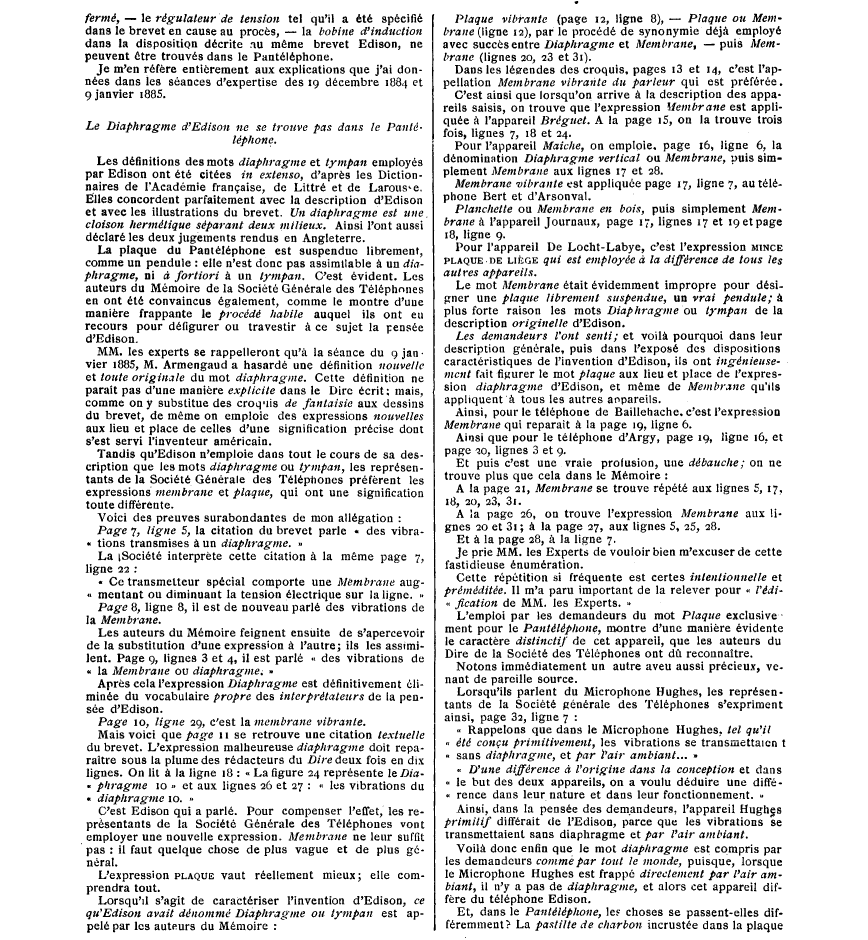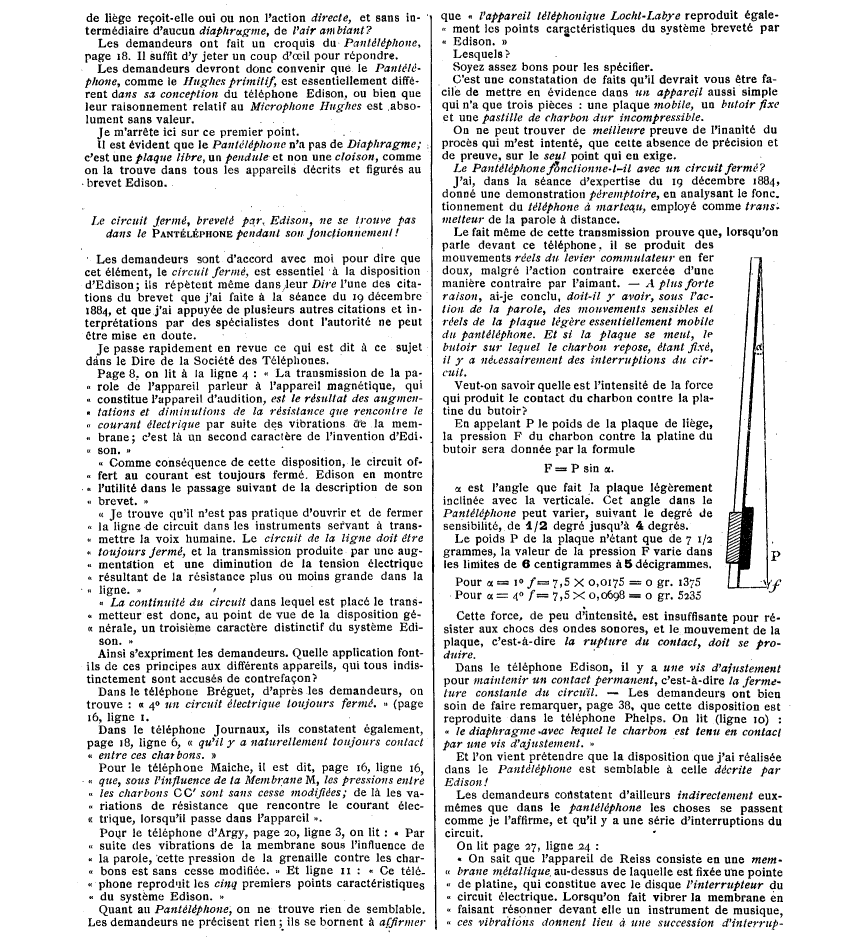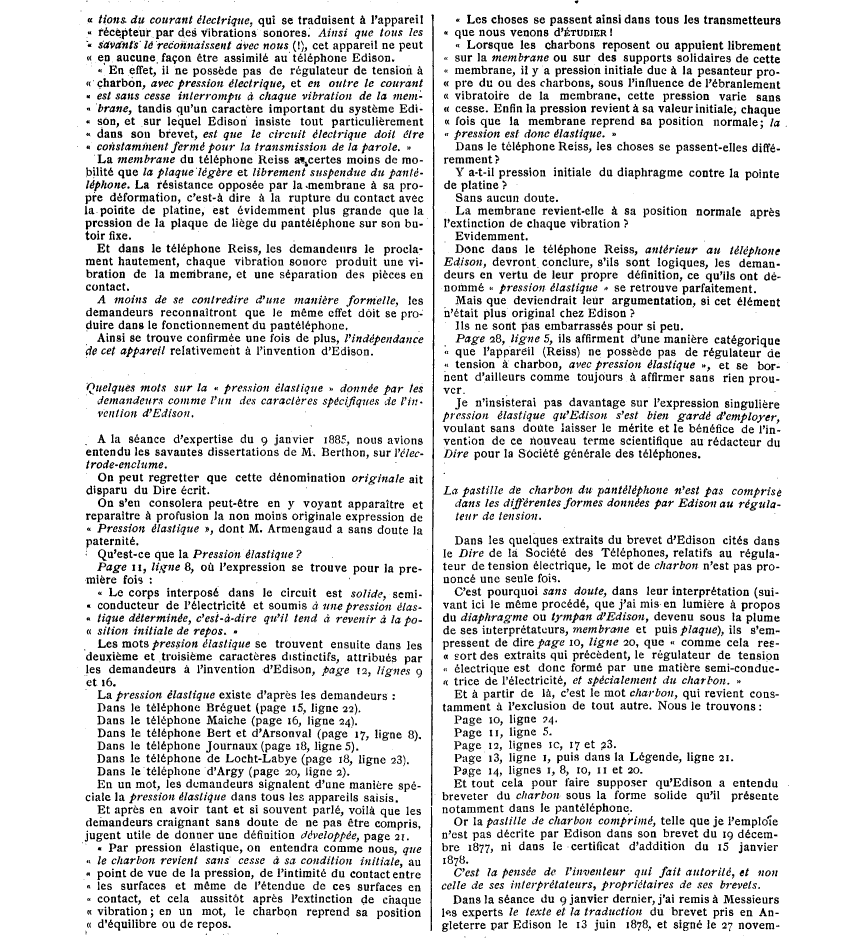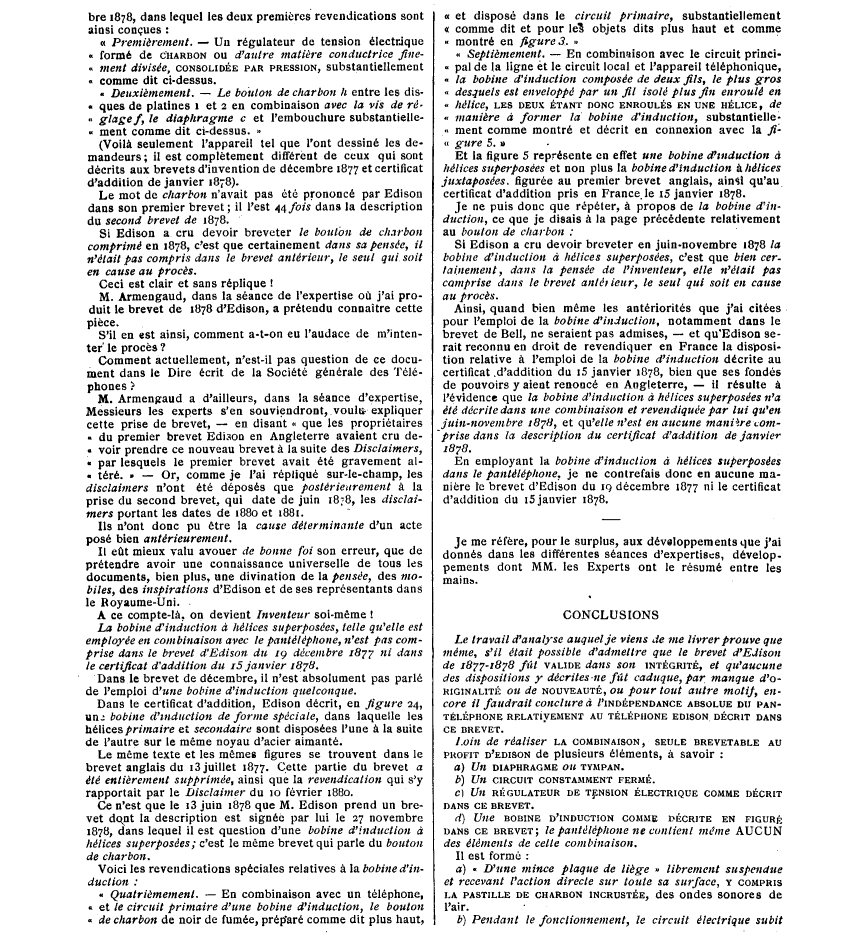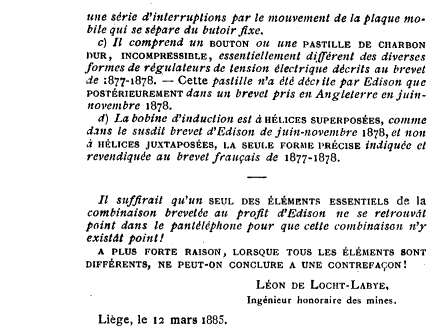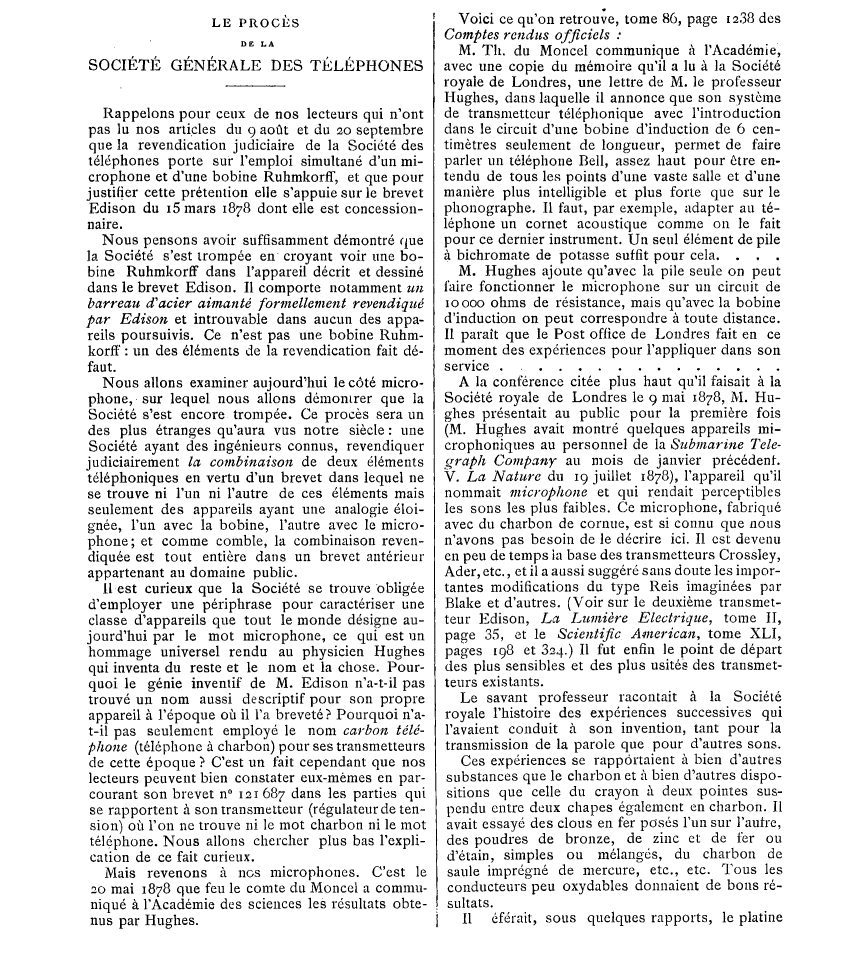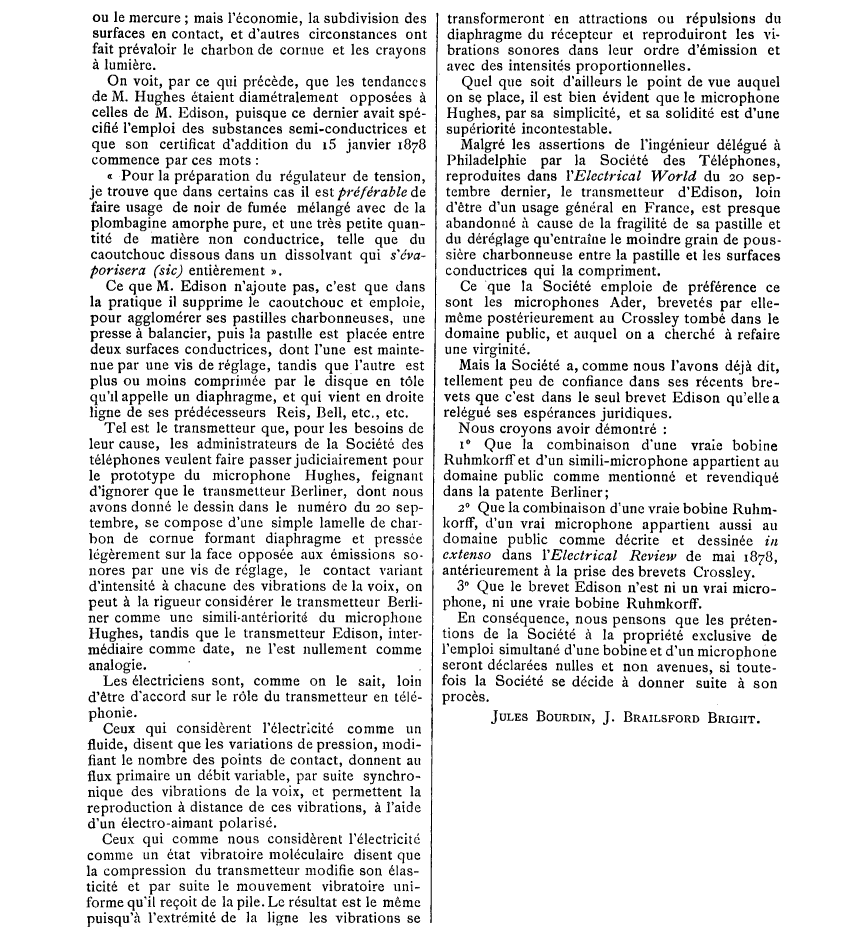BREVET
D'INVENTION :
1° et 2° DÉCHÉANCE, DÉFAUT D'EXPLOITATION,
OBJET BREVETÉ, OBJET EXPLOITÉ, DIFFÉRENCES,
CARACTÈRE, POUVOIR DU JUGE; 3° et 4° APPLICATION
NOUVELLE, MOYENS CONNUS, RÉSULTAT INDUSTRIEL, POUVOIR DU
JUGE ; 5U et 6° CONTREFAÇON, OBJETS CONTREFAITS, ACHAT,
DÉTENTION EMPLOI COMMERCIAL, BONNE FOI, DOMMAGES-INTÉRÊTS,
CONFISCATION ; 7° OBJETS CONTREFAITS, CONFISCATION, SAISIE,
CONSIGNATALRE, MISE EN CAUSE. 8° MOTIFS DES JUGEMENTS, MOYEN,
MANQUE DE PRÉCISION.
Le breveté, qui exploite un objet différent
de celui qui a fait l'objet du brevet, n'est pas déchu
de ses droits pour défaut d'exploitation de son brevet,
s'il est constaté par les juges du fond que les différences
entre l'appareil employé et celui décrit ou brevet
ne sont pas assez importantes pour impliquer l'abandon de l'invention
primitive (L. 5 juill. 1844, art. 32; 1" espèce,
1" et 2" ; arrêts; 2" espèce) (1);
Et les constatations du juge du fond à cet égard
sont souveraines et échappent au contrôle de la
cour de cassation (lre espèce, 1er et 2e arrêts;
(2) espèce) .
(1 et 2) L'art. 32 de la loi du 5 juill. 1844 déclare
l'inventeur déchu de son brevet et par voie de conséquence
du certificat qui s'y rattache, lorsque pendant deux ans il
a négligé de l'exploiter en France. Mais, pour
échapper à cette déchéance, est-il
nécessaire que l'inventeur exploite l'invention même
telle qu'elle a été décrite dansle mémoire
annexé au brevet? Si, depuis la prise de son brevet,
il a apporté certaines modifications à sa découverte,
de sorte que celle qu'il exploite n'est pas identiquement celle
qu'il a fait breveter, devra-t-on le considérer comme
ayant encouru la déchéance? A cet égard,
la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour décider
qu'une solution absolue ne saurait être donnée.
La question ne comporte pas une réponse unique; tout
dépend de l'importance ou du caractère des différences
existant entre l'objet exploité et celui du brevet. Si
les différences sont légères, insensibles,
si elles laissent subsister les éléments essentiels
du brevet, le breveté ne perd pas son droit. Mais, au
contraire, si les modifications sont tellement profondes que
l'invention primitive se trouve complètement transformée,
il faut dire que le brevet n'est pas exploité et que
l'inventeur doit, en conséquence, être déclaré
déchu. Au surplus, c'est aux juges du fait à apprécier
si les différences sont assez faibles pour que les deux
objets soient considérés comme semblables ou si
elles sont essentielles (V. Pouillet, Traité théorique
et pratique des brevets d'invention, 3» édit.,
n°s 518 et suiv.; Rendu, Code de la propriété
industrielle, t. 1er, n° 246 ; Ruben de Couder, Dictionnaire
de droit commercial, v» Brevet d'invention, n" 622
: Allart, Traité des brevets d'invention, t. 2, n°
346 ; Jur. gén., v° Brevet d'invention, n° 263;
Supplément, eod. v<>, n" 230. V. aussi Crim.
rej. 23 mai 1857, Annales de la propriété industrielle,
1857, p. 181 ; 30 avr. 1869, D. P. 70. 1. 236 ; Montpellier,
20 mai 1852, Annales de laproprieté industrielle, 1873,
p. 347 ; Req. 18 nov. 1872, D. P. 73. 1. 109; Civ. rej. 8 avr.
1879, D. P. 79. 1. 205 ; Paris, 5 juill. 1884, Annales de la
propriété industrielle, 1885, p. 289)
Le fait d'appliquer à la transmission de la parole
articulée un procédé qui, jusque-là,
n'avait été appliqué qu'à des transmetteurs
de sons musicaux, constitue une application nouvelle de moyens
connus pour l'obtention d'un résultat industriel et peut,
dès lors, faire l'objet d'un brevet ou d'un certificat
d'addition (L. 5 juill. 1844, art. 2; lre espèce,
1" et 2° arrêts; 2e espèce) (3).
(3) V. conf. Jur. gén., v° cit., n° 45 ; Supplément,
eod. v° n° 31, et les arrêts cités; Pouillet,
op. cit., n°» 31 et suiv. ; Allart, op. cit., t. 1,
n°" 23 et suiv. V. notamment Civ. rej. 24 mars 1875
(D. P. 75. 1. 294); Paris, 19 juin 1890 (D. P. 92. 1. 417);
Req. 17 janv. 1893 (D. P. 93. 1. 88).
Les juges du fond sont souverains pour décider qu'il
y a dans un cas donné application nouvelle de moyens
connus pour l'obtention d'un résultat industriel (1"
espèce, 1" et 2" arrêts ; 2e espèce)
(4)
(4) V. Pouillet, op. cit., n» 36 ; Crim. rej. H mai
1883, Annales de la propriété industrielle, 1883,
p. 160.
L'achat et la détention d'un objet contrefait constituent
l'emploi délictueux prévu par l'art. 40 de la
loi du 5 juill. 1844 et rendent ainsi le détenteur, même
de bonne foi, punissable comme contrefacteur et, par suite,
passible de dommagesintérêts envers le propriétaire
du brevet, quand il se sert dudit objet non pour son usage personnel,
mais dans un intérêt commercial ou industriel (1™
espèce, 2e arrêt) ; (5)
Et, en pareil cas, la confiscation de l'objet saisi doit également
être ordonnée (L. 5 juill. 1844, art. 40 et 49;
1" espèce, 2" arrêt). (6)
(5 et 6) Aux termes de l'art. 40 de la loi du 5 juill. 1844,
il y a délit de contrefaçon non seulement dans
la fabrication de produits brevetés, mais encore dans
l'emploi de ces produits. De quelle nature doit être cet
emploi? La majorité des auteurs et la jurisprudence sont
d'accord pour décider que l'emploi constitutif du délit
de contrefaçon est celui qui est fait par un industriel
et un commerçant se servant des objets contrefaits comme
initruments de son commerce ou de son industrie, et sans qu'il
y ait à distinguer si le commerçant est ou non
de bonne foi. Celui qui, dans l'exercice de sa profession, fait
usage d'objets contrefaits, spécule sur l'emploi de ces
objets :il en retire un profit, puisque c'est grâce à
cet emploi qu'il peut s'adonner, dans des conditions plus faciles
ou plus avantageuses, à la profession lucrative qu'il
exerce. Il est donc de toute justice qu'il supporte les conséquences
de cet usage illicite (V. Pouillet, op. cit., nos 679 et suiv.;
Blanc, Traité de la contrefaçon, p. 618 ; Picard
et Olin, Brevets d'invention, nos 451 et suiv.; Jur. gén.,
V cit., noa 307 et suiv.; Supplément, eod. va, n°»
294 et suiv. V. également Crim. rej. 27 févr.
1858, D. P. 58. 1. 337; 22 nov. 1872, D. P. 72. 1. 477; Crim.
cass. 7 févr. 1873, D. P. 73. 5. 45; Crim. rej. 5 févr.
1876, D. P. 77. 1. 96). Et il peut, par suite, être condamné
à des dommages-intérêts envers le propriétaire
du brevet. Les dommages-intérêts sont, en effet,
le mode de réparation le plus ordinaire du préjudice
que la contrefaçon fait éprouver au breveté
(Pouillet, op. cit., n" 991). Mais les dommages-intérêts
ne sont pas la seule réparation du préjudice subi.
Suivant l'art. 49 de la loi du 5 juill. 1844, la confiscation
des objets contrefaits peut être ordonnée contre
le contrefacteur, le vendeur, l'introducteur ou le débitant,
même en cas d'acquittement, et il est admis que la bonne
foi n'est pas exclusive de la confiscation (Pouillet, op. cit.,
n" 985; Blanc, op. cit., p. 677 ; Jur. gén., v°
cit., n° 372; Supplément, eod. v°, n" 367;
Crim. cass. 9 déc. 1848, D. P. 51. 5. 55; Poitiers, 17
févr. 1855, D. P. 55. 2. 110 ; Angers, 29 juin 1870,
D. P. 70. 2. 210).
Le propriétaire des objets saisis comme
contrefaits ne peut pas se plaindre que la confiscation desdits
objets ait été ordonnée sans que la personne
chez qui la saisie a été pratiquée eût
été appelée à l'instance, alors
que cette personne était un simple consignataire du propriétaire
et, par suite, n'avait aucun intérêt dans le débat
(L. 5 juill. 1844, art. 49; 2e espèce) (7) . (7) Comp.
Pouillet, op. cit., n» 984.
L'acheteur d'objets contrefaits qui, dans ses conclusions, s'est
borné, pour le cas où la confiscation des objets
serait prononcée, à réclamer la restitution,
avec intérêts, des sommes payées au vendeur,
ne peut se faire un grief de ce que les juges ne lui ont pas
accordé un recours contre son vendeur pour les dommages-intérêts
auxquels il avait été condamné envers lepropriétaire
du brevet, alors que ce recours n'a pas été demandé
par lui (ire espèce, 2e arrêt). (8)
(8) Les juges ne sont tenus de répondre qu'aux chefs
précis des conclusions des parties. (V. Jur. gén.,
v° Jugement, nos 969 et suiv.; Supplément, eod. N°,
n° 3 702 et suiv.; Table des vingtdeux années, V
Motifs des jugements, nos 19 et suiv. ; Table des dix années,
eod. N°6 et suiv. ; Nouvelle table des dix années,
tod. N°, n°" 6 et suiv. Comp. Civ. rej. 13 mars
1894, D. P. 94.1.351) de la fabrication du sieur de Locht-Labye,
ingénieur à Liège, et, le 8 juin 1883,
dans les bureaux de la Société du Gaz de Nice,
des appareils du même type. Ces saisies furent suivies
d'instance en contrefaçon, et, le 8 août 1884,
le tribunal civil de la Seine, devant qui la Société
générale des téléphones s'était
pourvue, commit trois experts à l'effet d'examiner le
brevet et le certificat d'addition d'Edison, pour dire s'ils
étaient valables ou, au contraire, nuls ou frappés
de déchéance par suite d'antériorité
ou de divulgation antérieure, et spécialement,
quant au certificat d'addition, s'il était nul comme
ne se rattachant pas au brevet principal. Il ordonna, en outre,
qu'ils compareraient les divers appareils saisis avec ceux faisant
l'objet du brevet pour en constater les ressemblances et dissemblances,
et rechercher s'ils constituaient des contrefaçons. Les
experts déposèrent leur rapport le 27 mars 1886.
Avant de taire connaître leurs conclusions, il est indispensable
de préciser, d'après ce rapport d'ailleurs, quelques
points
1° (De Locht-Labye C. Société générale
des téléphones.)—
2° (Société du gaz de Nice C. Société
générale des téléphones.) —
3° (Journaux C. Société générale
des téléphones.)
Nous croyons devoir emprunter au rapport de
M. le conseiller Durand l'exposé de faits qu'il a consacré
aux affaires reproduites ci-dessous :
Par actes des 16 et 17 août 1880 et du 16 nov. 1881, la
Société générale des téléphones
est devenue propriétaire d'un brevet d'invention pris
en France par l'Américain Edison, le 19 déc. 1878,
et d'un certificat d'addition délivré à
cet inventeur le 15 janvier suivant.
En 1882 et 1883, elle a fait pratiquer, à divers domiciles,
plusieurs saisies d'appareils téléphoniques qu'elle
prétendait contrefaits, notamment, le 28 oct. 1882, chez
le sieur Journaux, manufacturier à Paris, un appareil
du type dit « le Pantéléphone »,
de la fabrication du sieur de Locht-Labye, ingénieur
à Liège, et, le 8 juin 1883, dans les bureaux
de la Société du Gaz de Nice, des appareils du
même type. Ces saisies furent suivies d'instance en contrefaçon,
et, le 8 août 1884, le tribunal civil de la Seine, devant
qui la Société générale des téléphones
s'était pourvue, commit trois experts à l'effet
d'examiner le brevet et le certificat d'addition d'Edison, pour
dire s'ils étaient valables ou, au contraire, nuls ou
frappés de déchéance par suite d'antériorité
ou de divulgation antérieure, et spécialement,
quant au certificat d'addition, s'il était nul comme
ne se rattachant pas au brevet principal. Il ordonna, en outre,
qu'ils compareraient les divers appareils saisis avec ceux faisant
l'objet du brevet pour en constater les ressemblances et dissemblances,
et rechercher s'ils constituaient des contrefaçons. Les
experts déposèrent leur rapport le 27 mars 1886.
Avant de faire connaître leurs conclusions, il est indispensable
de préciser, d'après ce rapport d'ailleurs, quelques
points
Après des essais et des découvertes
qu'il n'est pas nécessaire de rappeler pour la solution
des questions soumises à la cour, deux Américains,
Gray (brevet français du 27 juill. 1874) et Graham Bell
(patente anglaise du 9 déc. 1876), avaient réalisé
le téléphone harmonique transmettant à
de grandes distances les sons musicaux, et, pour augmenter la
force de leur appareil, ils avaient fait emploi de la bobine
de Rhumkorff ou bobine d'induction. A l'aide d'un transmetteur
liquide composé, selon la formule de Gray, d'eau acidulée
dans laquelle plongeait une pointe en platine, et, selon celle
de Bell, d'un bain de mercure en contact avec une pointe de
plombagine, ils étaient ensuite arrivés à
résoudre le problème de la transmission de la
parole à distance, mais théoriquement seulement;
car, au dire des experts, l'altération du liquide et
l'action du gaz qui s'en dégageait produisaient dans
l'appareil une perturbation telle qu'il resta un simple instrument
d'expériences et de laboratoire. Aux liquides employés
de cette façon par Bell et Graham, Edison substitua,
sous le nom de régulateur d'intensité, un corps
solide semi-conducteur de l'électricité formé
de fibres de soie enduites de plombagine dont la résistance
au passage du fluide diminuait à mesure qu'augmentait
la pression exercée par le diaphragme vibrant sous l'influence
de la voix. Il parvint ainsi à construire un téléphone
pratique qui se composait de la combinaison de deux organes,
le transmetteur et le récepteur; le transmetteur comprenant
essentiellement un diaphragme, une substance solide semi-conductrice
et un fil venant d'une pile produisant un courant ininterrompu,
le récepteur consistant en une plaque métallique
placée devant un aimant, et, en conséquence, magnétique.
Ce fut pour cet appareil qu'il prit le brevet d'invention du
19 déc. 1877; mais il ne tarda pas à le perfectionner.
Pour transmettre la parole à de plus grandes distances
et éviter l'emploi ae piles nombreuses d'intensité
variable, il combina avec l'appareil transmetteur à pile
et à régulateur de tension une bobine d'induction,
le circuit primaire de la bobine contenant le transmetteur,
tandis que le circuit secondaire était en rapport avec
la ligne et le récepteur. C'est ce perfectionnement qui
a été l'objet du certificat d'addition du 14 janv.
1878.
Les experts conclurent à la validité
du brevet du 19 déc. 1877, mais déclarèrent
que les appareils fabriqués par de Locht-Labye
ne présentaient aucun des caractères propres à
ce brevet, et. par suite, que, quant à ce, ils ne constituaient
pas une contrefaçon. Pour le certificat d'addition, leur
avis fut qu'il était également valable, et qu'en
ce qui le concernait il y avait eu, au contraire, contrefaçon
par l'emploi de la bobine d'induction. Ils déclarèrent
encore que si les appareils employés par la Société
générale des téléphones dans son
bureau central étaient différents des appareils
d'Edison et semblables à ceux décrits dans une
patente accordée à l'Américain Phelps,
ces différences n'avaient pas une importance telle qu'on
pût considérer comme encourue la déchéance
prononcée par l'art. 32 de la loi du 5 juill. 1844 pour
non-exploitation de brevet.
Un an après le dépôt de
leur rapport, le 25 juin 1887,1a Société des Téléphones
fit encore saisir quatre autres appareils du type de Locht-Labye,
remis en consignation par Journaux à un sieur Mora, chez
qui ils avaient été trouvés, et conclut
également à ce qu'ils fussent déclarés
contrefaits.
Le tribunal civil de la Seine statua le 5 janv.
1889. En ce qui concernait le brevet du 19 déc. 1877,
il approuva entièrement le rapport des experts. Quant
au certificat d'addition, il repoussa, au contraire, les conclusions
du rapport et déclara que ce certificat n'était
pas valable en droit parce que l'emploi Je la bobine, tel qu'il
avait été fait par Edison, ne constituait pas
l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un
résultat industriel susceptible d'être breveté
aux termes de l'art. 2 de la loi du 5 juill. 1844. Sur la question
de déchéance tirée de la non exploitation
du brevet, il se rangea enfin à l'avis des experts, et
statua dans les termes suivants :
« Attendu qu'enfin on oppose au brevet la déchéance
prévue par l'art. 32 de la loi de 1844, pour non-usage
pendant deux ans; qu'en effet, les experts ont constaté
que les appareils, employés par la Société
générale des téléphones, étaient
différents de celui breveté par Edison et semblables
à ceux décrits dans une patente Phelps, mais qu'il
n'est pas démontré que les appareils d'Edison
n'aient pas été exécutés après
le brevet; que la déchéance n'est pas suffisamment
établie. »
A la suite et par application de ces solutions, la Société
générale des téléphones fut déclarée
mal fondée en ses demandes et conclusions, et le tribunal
l'en débouta. Mais elle interjeta appel de sa décision
contre Journaux, de Locht-Labye, la Société du
gaz de Nice, et, devant la cour d'appel de Paris, elle prit
des conclusions tendant aux mêmes fins que devant les
premiers juges. De son côté, la Compagnie du Gaz
de Nice se porta éventuellement appelante, et pour le
cas où le jugement du 5 janv. 1889 serait infirmé
sur l'appel de la Société des téléphones,
et où la cour de Paris prononcerait la confiscation des
appareils saisis sur elle, elle conclut à ce que de Locht-Labye
fût condamné à lui payer la somme de 36,371
fr. 95 cent, pour prix desdits appareils, plus 12,133 fr. 45
cent, pour intérêts au 1er mars 1880, ainsi que
les intérêts à 6 pour 100 de ces deux sommes
à partir de cette dernière date à titre
de supplément de dommages-intérêts.
l re Espèce :— (1° De Locht-Labye
C. Société générale des téléphones.
— 2° Société du gaz de Nice C. Société
générale des téléphones.)
La cour d'appel de Paris a rendu, le 19 févr. 1891, un
arrêt ainsi conçu :
Sur l'appel principal :
— Considérant qu'à l'appui de sa demande
en contrefaçon, la Compagnie générale des
téléphones invoque les dispositions et revendications
formulées dans le brevet d'Edison aux droits duquel elle
se trouve, en date du 19 déc. 1877 et dans son certificat,
d'addition, en date du 14 janv. 1878 ;
En ce qui concerne le brevet, sa validité,
son étendue, la déchéance qui lui est opposée,
et la contrefaçon qui résulterait à la
charge de l'intimé de la violation de la loi du brevet
:
— Considérant qu'il résulte de l'étude
approfondie que les experts ont faite, dans leur rapport, de
la téléphonie et de ses progrès jusqu'à
la fin de 1877, qu'à celte date le problème de
la transmission de la parole à l'aide de l'électricité
n'avait pas encore été pratiquement résolu;
que si le Français Charles Bourseul peut, à juste
titre, revendiquer l'honneur d'avoir le premier, et dès
1854, conçu l'idée de la transmission à
l'aide d'un instrument approprié, sa conception n'est
point sortie du domaine théorique et n'a point été
par lui réalisée; — Qu'en 1861, Reiss parvint
à construire un appareil téléphonique auquel
il donna la forme d'un électroaimant, transmettant à
distance et reproduisant dans l'organe récepteur le nombre
des vibrations, c'est-à-dire la hauteur du son initial,
ayant mis en mouvement la plaque vibrante d'un transmetteur,
mais que cet appareil était impuissant à transmettre,
en raison même des courants intermittents fournis par
la pile avec une intensité constante, les ondulations
électriques de même forme que les ondes sonores
engendrées par la parole et qui ne pouvaient être
produites que par des courants permanents, d'intensité
variable, dans un circuit toujours fermé; — Que
ce résultat fut à peu près obtenu en 1876
et simultanément par Elisha Gray et Graham Bell, à
l'aide du transmetteur à liquide, composé, selon
la formule de Gray, d'eau acidulée dans laquelle plongeait
une pointe en platine et, selon celle de Bell, d'un bain de
mercure en contact avec une pointe de plombagine dont était
armé le diaphragme du transmetteur; — Considérant
que, par cetle double et précieuse découverte,
le problème de la transmission de la parole à
distance était résolu, mais théoriquement
seulement, car, au dire des experts, l'altération du
liquide, l'action du gaz qui s'en dégageait, produisaient
dans l'appareil téléphonique une perturbation
telle, qu'il est resté un simple instrument d'expérience
et de laboratoire; —Considérant, au contraire, qu'Edison,
en substituant aux liquides employés par Gray et par
Bell, pour former dans son appareil un régulateur d'intensité
électrique, un corps solide semi-conducteur de l'électricité,
dont la résistance, au passage de ce fluide, diminue
à mesure que la pression exercée par le diaphragme
augmente, a produit un téléphone véritablement
pratique, et que son invention, quoique devant être circonscrite,
en ce qui concerne l'emploi des corps a employer pour la construction
du régulateur d'intensité, dans les limites fixées
par les experts, a pu être valablement brevetée;
— Adoptant, au surplus, sur toutes les questions ci-dessus
indiquées, relatives au brevet du 19 déc. 1877,
les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire
aux considérations qui précèdent ; Et homologuant
sur les mêmes points le rapport des experts nommés
par le tribunal, rapport éclairant suffisamment la religion
de la cour et rendant inutile toute expertise nouvelle;
En ce qui concerne le certilicat d'addition
du 15 janv. 1878 : — Considérant que la Compagnie
des téléphones exerçant encore les droits
d'Edison, revendique comme sa propriété légitime,
protégée par le certificat d'addition ci-dessus
indiqué, la combinaison de la bobine d'induction à
son télégraphe à piles constituant, selon
elle, une application nouvelle de moyens connus, pour la production
d'un résultat industriel dans le sens du dernier paragraphe
de l'art. 2 de la loi du 5 juill. 1844 ; — Considérant,
tout d'abord, qu'il est certain, ainsi que le constatent les
experts dans leur rapport, que le résultat industriel
obtenu par cette combinaison est considérable ; —
Que c'est grâce à l'application de la bobine d'induction
au téléphone à piles qu'ont pu être
établis les réseaux téléphoniques
indispensables à la transmission à grande distance
de la parole articulée, par suite des obstacles nombreux
qu'elle rencontre, et dispensant de l'emploi coûteux des
piles nombreuses, d'intensité variable suivant la distance
à parcourir par le courant électrique ; —
Considérant, d'autre part, que cette combinaison constitue
en droit une application nouvelle d'un procédé
déjà connu; — Qu'en effet, si Elisha Gray
et Graham Bell avaient, ayant Edison et dans les mêmes
conditions, employé la bobine d'induction, tombée
depuis longtemps dans le domaine public, l'un et l'autre n'en
ont fait emploi « qu'en conneiion avec des transmetteurs
de sons musicaux, le circuit de la bobine étant périodiquement
ouvert et fermé par des vibrations d'un diapason ou d'une
lame, tandis qu'Edison a combiné la bobine avec un transmetteur
parlant » (Rapport, p. 32); — Que si, dans les deux
cas, le rôle de la bobine est le même, le but poursuivi,
le résultat industriel obtenu sont différents;
que la bobine d'induction a donc été transportée
par Edison dans sa combinaison à une chose autre que
celles auxquelles elle avait été employée
précédemment et a produit ainsi un résultat
nouveau utile à l'industrie ;
Considérant qu'il s'agit maintenant d'examiner
les moyens de nullité du certificat d'addition invoqués
par l'intimé ; en ce qui concerne le moyen de nullité
tiré de ce que ce certificat d'addition ne se référait
pas au brevet du 19 déc. 1877 : — Considérant
que les experts observent que l'objet principal du brevet dont
il s'agit est la reproduction, au loin, du son par l'emploi
du transmetteur à piles ; qu'il y a lieu d'ajouter qu'il
a spécialement pour objet, ce en quoi il a été,
dans la première partie du présent arrêt,
déclaré valable, la reproduction par un transmetteur
à piles de la parole articulée; — Que l'emploi
de la bobine avec ce transmetteur à piles se rattache
donc intimement au brevet lui-même;
Sur le moyen tiré de ce que Edison aurait,
en Angleterre, renoncé, par les disclains, à réclamer,
comme lui appartenant, l'emploi de la bobine d'induction mentionnée
dans ses patentes anglaises des 30 juill. 1877 et 15 juin 1878
; — Considérant que cette renonciation qui aurait
eu pour résultat de faire tomber le certificat d'addition,
en même temps que les patentes anglaises susvisées,
n'est point justifiée; — Que les termes peu précis
dans lesquels sont conçus les disclains invoqués
ne permettent pas d'affirmer que telle avait été,
en, les formulant, la pensée d'Edison ; — Que ce
qui démontre, au contraire, que telle n'a point été
sa volonté et la portée de ces disclains aux yeux
de l'autorité anglaise chargée de les recevoir,
c'est que la revendication de la bobine d'induction avec un
transmetteur à piles, n'a point été, sur
les minutes des patentes, rayée à l'encre rouge
ainsi qu'il est d'usage de le pratiquer en Angleterre pour toutes
les revendications qui ont été l'objet d'un disclain,
pas plus que ne l'ont été les revendications relatives
au phonographe et à l'électro-mototélégraphe
dont la propriété ne lui a jamais été
contestée et qui sont indiqués sous le même
numéro dans ladite patente ; sur le moyen tiré
de l'absence de nouveauté, résultant de la patente
Berliner déposée le 16 oct. 1877, et qui n'a pu,
suivant les prescriptions de la loi américaine, être
rendue publique que le 15 janvier suivant, c'est-à-dire
le jour même du dépôt à Paris du certificat
d'Edison : — Considérant, en premier lieu, qu'il
n'est point justifié qu'en vertu de la loi américaine
la délivrance de la patente remonte au jour du dépôt
de la demande et non pas seulement au jour où cette patente
est délivrée; — Qu'on ne saurait utilement,
dans la cause, invoquer les dispositions de l'art. 29 de la
loi de 1844, supprimer complètement les brevets d'importation;
— Considérant, en second lieu, ainsi
que l'ont, au surplus, reconnu les experts et les premiers juges,
que la patente Berliner n'ayant été rendue publique
que le 15 janv. 1878,c'est-à-dire le jour même
du dépôt, à Paris, du certificat d'addition
Edison, ce dépôt, l'heure de Washington étant
en retard de cinq heures sur l'heure de Paris, a été
de toute nécessité effectué avant qu'on
ait pu connaître dans cette ville l'invention de Berliner
; — Qu'en outre, les divers documents invoqués par
l'intimé, pour justifier que, dès les mois de
septembre et d'octobre 1877, l'invention de Berliner aurait
été divulguée en Amérique, en admettant
qu'ils soient assez précis et assez clairs pour permettre
la reproduction de cette invention, sont loin de porter en eux-mêmes
la preuve de l'authenticité de la date assignée
à leur publication ; — Considérant enfin
que l'invention de Berliner, faisant l'objet de la patente publiée
le 15 janv. 1878 et comprenant la combinaison d'un transmetteur
à piles et à charbon, non pas avec une seule bobine
d'induction, mais avec deux bobines réagissant l'une
sur l'autre, devait nécessairement présenter des
différences notables avec la combinaison revendiquée
par Edison dans son certificat d'addition, puisque les autorités
américaines dont la mission ne se borne pas, comme en
France, à recevoir purement et simplement la demande
du brevet qui leur est déposée, mais à
vérifier, préalablement à la délivrance,
si l'invention dont on revendique la propriété
présente bien le caractère d'une invention, ont
délivré à Edison, à la date du 30
avr. 1878, une patente ayant le même objet que son certificat
d'addition, alors que la patente de Berliner lui avait été
délivrée le 15 janvier précédent;
— Qu'on peut, au surplus et en fait, si peu soutenir que
Edison s'est inspiré de la découverte de Berliner
pour revendiquer la combinaison décrite dans son brevet
d'addition du 15 janv. 1878, qu'il l'avait déjà
revendiquée dans sa patente anglaise du 30 juill. 1877,
c'est-à-dire près de six mois avant la publication
de la patente Berliner, et plus de trois mois avant la divulgation
qui, contre toute vraisemblance, aurait été faite
de son invention dont il voulait pourtant s'assurer la propriété
;
Qu'il résulte donc de tout ce qui précède
que le certificat d'addition du 15 janv. 1878 est régulier
et valable, qu'il n'a encouru aucune déchéance
et qu'il assure à Edison ou à ses représentants,
la propriété exclusive de la combinaison d'un
téléphone parlant avec la bobine d'induction;
— Qu'il y a lieu, dès lors, de réformer sur
ce point, le jugement dont est appel, d'entériner, dans
toutes les parties qui s'y réfèrent, le rapport
des experts et de déclarer contrefaits les appareils
saisis comme renfermant la combinaison d'un transmetteur à
piles et d'une bobine d'induction dont le circuit secondaire
contient le récepteur ; — Qu'il y a lieu également
d'allouer à la Compagnie des téléphones
des dommages-intérêts en réparation du préjudice
certain par elle souffert, mais que la cour ne peut, à
défaut de justification de l'importance de ce préjudice,
fixer dès à présent le montant de ces dommages-intérêts
; Par ces motifs, etc.
Cet arrêt a été frappé
d'un double pourvoi en cassation par le sieur de Locht-Labye
et par la Société du gaz de Nice.
POURVOI du sieur de Locht-Labye : —
1° Violation des art. 1 et 32, § 2, de la loi du 5
juill. 1844, 7 de la loi du 20 avr. 1810, et des règles
en matière de preuve, en ce que l'arrêt attaqué,tout
en reconnaissant que l'appareil en usage diffère de l'appareil
breveté, a refusé de prononcer la déchéance
des brevets et certificats d'addition sous prétexte que
l'inexécution absolue du brevet ne serait pas démontrée.
2° Violation des art. 1, 2, 16 de la loi du 5 juill. 1844,
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
valable un certificat d'addition ayant pour objet un perfectionnement
déjà connu et employé de la même
manière dans d'autres industries ou d'autres appareils
analogues aux appareils prétendus contrefaits.
ARRÊT (après délib. en la
ch. du cons.).
LA COUR; —
Sur le premier moyen : — Attendu que, par homologation
du rapport des experts commis parles premiers juges, l'arrêt
attaqué adéclaré que, s'il y avait des
différences entre l'appareil employé par la Société
générale des Téléphones dans son
bureau central, sous le nom de transmetteur Edison, et les appareils
décrits dans le brevet du 19 déc. 1877, ces différences
n'avaient pas une importance telle qu'on pût considérer
l'art. 32 de la loi du 5 juill. 1844, qui déclare le
breveté déchu de ses droits pour défaut
d'exploitation, comme applicable dans l'espèce; —
Qu'en statuant ainsi, par appréciation souveraine des
documents delà cause, il a suffisamment répondu
aux conclusions de Locht-Labye et justifié son refus
de prononcer la déchéance dudit brevet et du certificat
d'addition y afférent;
Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'il est déclaré
par l'arrêt attaqué, d'une part, que c'est grâce
à l'application de la bobine d'induction au téléphone
à pile qu'ont pu être établis les réseaux
téléphoniques indispensables à la transmission
à grande distance de la parole articulée, d'autre
part, que si Gray et Bell avaient déjà, et dans
les mêmes conditions, employé cette bobine tombée
depuis longtemps dans le domaine public, l'un et l'autre n'en
avaient fait usage ainsi qu'en connexion avec des transmetteurs
de sons musicaux, tandis qu'Edison Ta combinée avec un
transmetteur parlant; — Qu'en jugeant, en l'état
de ces constatations qui rentraient dans ses pouvoirs souverains,
qu'il y avait, dans l'espèce, une application nouvelle
de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel,
et par suite, que le certificat d'addition pris par Edison le
15 janv. 1878 était valable, la cour de Paris n'a violé
ni l'art. 2 de la loi du 5 juill. 1844, ni les autres articles
invoqués par le pourvoi ;
Par ces motifs, rejette.
Du 8 mai 1894.-Ch. civ.-MM. Mazeau, 1er pr.-Duiand, rap.-Rau,
av. gén., c. conf.- Georges Devin et Mornard, av.
POURVOI de la Société du gaz de Nice : —
1° et 2° Moyens identiques à ceux du pourvoi
du sieur de Locht-Labye; 3° Fausse application des art.
1382 c. civ., 40, 41, 49 de la loi du 5 juill. 1844, violation
des art. 1641 et suiv. c. civ. et des principes en matière
de garantie, en ce que l'arrêt attaqué, tout en
reconnaissant la détention de bonne foi de la partie
saisie, l'a condamnée à des dommages-intérêts
sans recours contre son vendeur et à la confiscation
de l'objet prétendu contrefait.
M. le conseiller Durand a présenté
sur le 3° moyen les observations suivantes :
Suivant le pourvoi, la contrefaçon constitue
un vice de la chose vendue. Quand l'acheteur l'ignorait, garantie
lui est donc due par le vendeur dans les termes de l'art. 1641
c. civ., puisqu'il s'agit, en définitive, d'un vice qui
rend la chose impropre à l'usage auquel il la destinait.
D'autre part, ce n'est que contre le contrefacteur et son complice
que la confiscation est édictée par la loi. Telle
est du moins la solution à laquelle conduisent les art.
40, 41 et 49 de la loi du 5 iuill. 1844, qui est enseignée
par la majorité des auteurs (Duve"rgier, 1844, p.
616; Renouard, Brevets d'invention, n0 23; Nouguier, Brevets
d'invention, n» 27), et qui a été consacrée
par votre jurisprudence (Crim. cass. 25 mars 1848, D. P. 49.1.
24 ; Crim. rej. 12 juill. 1851, D. P. 51. 5. 56 ; Civ. rej.
1" févr. 1892, D. P. 92. 1. 417). Or, si aux termes
de vos arrêts (arrêt précité du 12
juill. 1851 et Crim. rej. 5 févr. 1876, D. P. 77. 1.
96), on ne peut considérer comme complice du délit
de contrefaçon celui qui a commandé ou acheté
des objets contrefaits non dans le but de faire un trafic, mais
seulement pour s'en servir à son usage personnel ou même
pour les employer dans l'exercice d'une profession étrangère
à l'industrie du breveté, à plus forte
raison ne peut-on appliquer les peines de la contrefaçon,
et, par suite, ordonner la confiscation et prononcer des dommages-intérêts
au profit du propriétaire du brevet, contre le détenteur
de bonne foi d'objets contrefaits qui n'en fait pas commerce
(Crim. rej. 27 févr. 1858,D.P. 58. 1.337; Civ. rej. 25
juill. 1866, D. P. 66. 1. 309; Civ. cass.21 févr.l870,D.P.70.1.111;Req.
5 mars 1872.D.P 72.1.318; Civ. cass. 1« juin 1874, D.
P. 74.1.388; 22 déc. 1880, D. P. 81.1.63). Qu'a fait
cependant l'arrêt attaqué? Par application souveraine
des fans de la cause, il a constaté que la Compagnie
du gaz de Nice était détenteur de bonne foi, et
malgré cela, il l'a, d'une part, condamnée envers
la Société des téléphones à
des dommagesintérêts à fixer par état,
sans lui accorder aucun recours de ce chef contre de Locht-Labye,
son vendeur, et, d'autre part, il a ordonné contre elle
la confiscation des appareils qu'elle avait achetés,
en condamnant de Locht-Labye à lui en rembourser le prix
avec intérêts. En statuant ainsi, il a donc méconnu
et violé les articles de loi ci-dessus rappelés.
Dans ce moyen, la défense distingue deux branches. Au
principal, dit-elle, la Société du gaz de Nice
soutient que c'est à tort qu'elle a été
condamnée envers la Société des téléphones
à des dommages-intérêts et à la confiscation,
et subsidiairement elle fait grief à la cour de Paris
d'avoir prononcé contre elle condamnation auxdits dommages-intérêts
sans lui accorder recouis contre son vendeur. La seconde branche,
d'ailleurs, est étrangère à la Société
des téléphones, et, en conséquence, la
défense ne s'occupera que de la première. Est-il
donc vrai, comme le prétend le pourvoi, que les condamnations
prononcées contre la Société du gaz de
Nice au profit de la Société des téléphones
ne soient pas justifiées? La défende maintient
qu'elles le sont l'une et l'autre.
En ce qui concerne d'abord les dommages-intérêts,
que déclare, en effet, l'art. 40 de la loi du 5 juill.
1844? Qu'il y a délit de contrefaçon, non seulement
dans la fabrication de produits brevetés, mais encore
dans l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet. Et comment
la doctrine (en majorité du moins) et la jurisprudence
entendent-elles cette disposition ? En ce sens que l'emploi
constitutif du délit est celui qui est fait par un industriel
ou un commerçant se servant des objets contrefaits comme
instruments de son commerce ou de son industrie, et sans qu'il
y ait à distinguer si le commerçant est ou non
de bonne foi. C'est ce qu'enseignent notamment MM. Pouillet,
Traité théorique et pratique des brevets d'invention,
noa 679 et suiv. ; Blanc, Traité de la contrefaçon,
p. 618; Allart, Brevets d'invention, n°« 212 et suiv.
; Picard et Olin, Brevets d'invention, n 08 451 et suiv. C'est
ce que vous avez décidé aussi lorsque, le 22 nov.
1872 et le 7 févr. 1873 (D. P. 72. 1. 477 et 73. 5. 45)
notamment, vous avez dit que l'individu qui, même de bonne
foi, a acheté et employé un appareil contrefait,
si c'est pour l'utilité de son commerce, doit être
considéré comme contrefacteur, qu'il est en faute
de n'avoir pas usé des moyens de se renseigner sur l'existence
du brevet (Junge Crim. rej. 12 juill. 1851, D. P. 51. 5. 56
; 27 févr.1858, D. P. 58. 1. 337; 5 févr. 1876,
D. P. 77. 1. 96). Or, dans l'espèce, c'était incontestablement
pour l'exercice de son industrie que la Société
du gaz de Nice faisait usage des 248 appareils qui ont été
saisis dans ses bureaux. Ce point, il est vrai, n'est pas formellement
spécifié par l'arrêt attaqué comme
il l'est dans les arrêts des 27 févr. 1858 et 5
févr. 1876 ; mais qu'importe? La nature de l'emploi ne
résulte-t-elle pas nécessairement ici de la qualité
même du possesseur de l'appareil contrefait et du nombre
des appareils saisis? Quel autre usage, en effet, qu'un usage
commercial pourrait faire du téléphone une personne
morale comme la Société du gaz de Nice qui n'a
précisément d'existence juridique que pour le
commerce ? Et, dun autre côté, quel est le particulier
qui, pour son usage privé,aurait besoin de 248 téléphones
reDrésentant, d'après la cour de Paris, une somme
supérieure à 36,000 fr. ? Dans ces conditions,
la condamnation aux dommages-intérêts prononcée
contre la Compagnie du gaz de Nice est donc à l'abri
de toute critique.
Quant à la confiscation, c'est par l'art.
49 de la loi de 1844 qu'elle est prescrite. Or, comment cet
article est-il généralement interprété?
En ce sens qu'il est applicable en toute hypothèse, que
le détenteur de l'appareil contrefait soit ou non de
bonne foi, qu'il ait fait servir l'appareil à l'exercice
de son industrie ou qu'il 1 ait, au contraire, employé
à un usage personnel : « L'usage personnel, dit
notamment M. Pouillet (op. cit., n» 985), dans le cas
où il est exclusif de la contrefaçon, est-il en
même temps exclusif de la confiscation? Nous ne le croyons
pas, et il nous semble que les raisons qui ont déterminé
le législateur à prononcer la confiscation même
en cas de bonne foi, existent ici avec plus de force encore
s'il est possible. » M. Blanc s'exprime dans des termes
identiques, et c'est aussi la doctrine qu'ont consacrée
plusieurs cours d'appel. Si on l'admet, rien n'est donc plus
régulier que la confiscation prononcée contre
la Société du gaz de Nice. Le pourvoi maintient,
à la vérité, que vous attribuez à
l'art. 49 un sens plus restrictif. Mais, en définitive,
ceux de vos arrêts qu'il invoque sont tous rendus au profit
de détenteurs d'objets contrefaits qui, non seulement
étaient de bonne foi, mais encore ne faisaient emploi
de ces objets que pour leur usage personnel. Or ce n'était
pas à un usage individuel que la Société
du gaz de Nice faisait servir les appareils saisis; c'était
manifestement pour les besoins de son industrie qu'elle s'en
servait. La thèse du pourvoi est donc ici sans application,
et, dès lors, le moyen doit être rejeté.
ARRÊT (après délib. en la
ch. du cons.).
LA COUR; — Sur le premier moyen : — Attendu (motifs
identiques à ceux de l'arrêt de Locht-Labye);
Sur le deuxième moyen : — Attendu (motifs identiques
à ceux de l'arrêt de Locht-Labye);
Sur le troisième moyen : — Attendu, d'une part,
que l'achat et la détention d'un objet contrefait constituent
l'emploi délictueux prévu par l'art. 40 de la
loi du 5 juill. 1844, et rendent ainsi le détenteur,
même de bonne foi, punissable comme contrefacteur et,
par suite, passible de dommagesintérêts envers
le propriétaire du brevet, quand il se sert dudit objet
non pour son usage personnel, mais dans un intérêt
commercial ou industriel; — Attendu, d'autre part, que
l'art. 49 de la même loi ordonne la confiscation des objets
déclarés contrefaits contre le contrefacteur,
le receleur, l'introducteur ou le débitant; — Attendu
que, dans l'espèce, il résulte des circonstances
relevées par le juge du fait, du procès-verbal
de saisie et des conclusions des parties que les appareils contrefaits
étaient employés dans l'intérêt de
l'exploitation commerciale de la Société du Gaz
de Nice; que, dès lors, en condamnant cette Société,
pour réparation du préjudice résultant
de la contrefaçon à payer à la Société
Générale des Téléphones des dommages-intérêts
à fixer par état, et en prononçant la confiscation
des appareils saisis, la cour de Paris n'a violé aucune
loi; — Et attendu que, dans ses conclusions sur l'appel
qu'elle avait formé éventuellement contre de Locht-Labye,
la Société du gaz de Nice s'est bornée,
pour le cas où la confiscation des appareils susmentionnés
serait prononcée, à réclamer la restitution,
avec intérêts, des sommes qu'elle avait payées
à son vendeur; que dès lors, elle ne peut faire
grief à l'arrêt attaqué de ne pas lui avoir
accordé contre de Locht-Labye, pour les dommages-intérêts
auxquels elle a été condamnée envers la
Société du Téléphone, un recours
qu'elle n'a pas demandé ;
Par ces motifs, rejette.
Du 8 mai 1894.-Ch. civ.-MM. Mazeau, 1er pr.-Durand, rap.-Rau,
av. gén., c. conf.-Bickart-Sée et Mornard, av.
2e Espèce: — (Journaux. Société
générale des téléphones.)
La cour de Paris a rendu, le 19 févr. 1891, un arrêt
dont les motifs sont identiques à ceux de la décision
relative à l'affaire de Locht-Labye et Société
du gaz de Nice, en tant du moins qu'elle concerne le sieur de
Locht-Labye, mais dont le dispositif contient un chef spécial
ainsi conçu :
Déclare contrefaits les appareils saisis chez Mora, le
25 juin 1887 ; — Ordonne la confiscation desdits appareils,
etc.
POURVOI en cassation par le sieur Journaux : — 1° et
2° (Moyens identiques à ceux du pourvoi du sieur
de LochtLabye) ;
3° Violation de l'art. 49 de la loi du 5
juill. 1844, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé
la confiscation des appareils saisis, bien que le détenteur
ne fût pas en cause.
ARRÊT (après délib. en la
ch. du cons.).
LA COUR ; — Sur le premier moyen
: — Attendu (motifs identiques à ceux de l'arrêt
de Locht-Labye) ;
Sur le deuxième moyen : —
Attendu (motifs identiques à ceux de l'arrêt de
Locht-Labye) ;
Sur le troisième moyen : —
Attendu que, d'après la déclaration de Journaux
lui-même, telle qu'elle est relatée dans ses conclusions
rapportées aux qualités de l'arrêt attaqué,
les appareils saisis chez Mora avaient été par
lui remis en consignation à ce dernier ; — Qu'il
en était donc resté propriétaire, et que,
dès lors, la confiscation a pu en être valablement
ordonnée, sans que Mora, qui, au fond, était sans
intérêt dans le débat, eût été
appelé à l'instance ;
Par ces motifs, rejette.
Du 8 mai 1894.-Ch. civ.-MM.
Mazeau, 1er pr.-Durand, rap.- Rau, av. gén., c. conf.-Georges
Devin et Mornard, av.
|