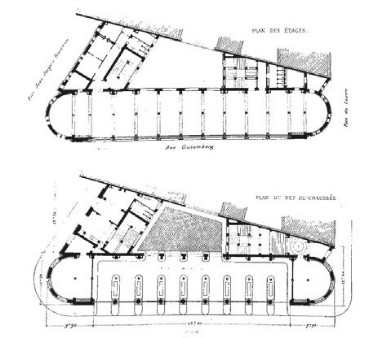Jean
Marie Boussard
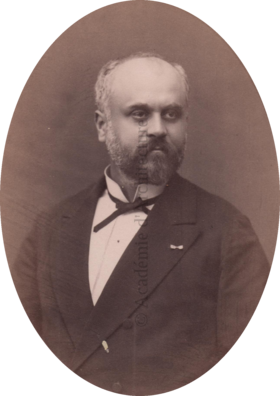
Jean Boussard
(1844-1923) |
Jean Marie Boussard,
né à Cry (Yonne) le 7 septembre 1844, fils
de Marie Louis Gabriel Boussard 31 ans docteur en médecine,
et de Anne Joséphine Élisabeth Benoit 23 ans,
Après avoir passé sa jeune
scolarité dans le département, il monte à
Paris, grâce aux relations de son père, médecin
à Saint-Florentin et investi en politique (il était
proche de Paul Bert). Jean Boussard pousse alors les portes
de l’atelier d’Alexis Paccard à l’École
des Beaux-Arts ou il admis en 2è
classe le 26 octobre 1867, son dossier d'élève
est vide (architecte à Paris 5è [entre 1875
et 1882], et Paris 16è [38, puis 41, rue Ribera,
entre 1888 et 1923]; architecte du Ministère des
Postes et Télégraphes, inspecteur des travaux
le 5 septembre 1872.
Architecte titulaire (février 1878), il procède
notamment à la réinstallation des bureaux
de Paris à la fusion avec le Service télégraphique;
hôtels des postes à Angers, Fontainebleau,
Bordeaux; postes et caisses d'épargne; installation
du Congrès Postal au Palais Bourbon en 1878, installation
du Congrès Télégraphique dans la salle
du Manège du Louvre en 1890; nombreux immeubles et
hôtels particuliers dans Paris et ses environs (Asnières,
Boulogne-Billancourt, Gennevilliers, Levallois-Perret, Meudon),
tombeaux pour les cimetières parisiens et de province;
expert près le Tribunal civil de la Seine; nombreuses
publications sur l'architecture, comme Concours de l'École
des beaux-arts, 1874-1875, Recueil des tombeaux les plus
remarquables, ou Petites habitations françaises,
1881, Constructions et décorations pour jardins,
1881, coll. à la Revue générale de
l'architecture, et au Moniteur des architectes, collaborateur
de la Revue générale de l'architecture et
des travaux publics; membre de la Société
centrale des architectes en 1878, et de l'Union syndicale
des architectes français; officier d'Académie
le 1er août 1878, officier de l'Instruction publique
le 1er janvier 1884, chevalier de la Légion d'honneur,
décret du 12 juillet 1890,
En 1923 Jean Boussard revient dans le département
à sa retraite. Il s’investit à Cry en
restaurant une vieille bâtisse pour en faire sa résidence
secondaire et réalise également des travaux
pour le compte de la commune : "Il se propose de dessiner
le monument aux morts après la Première Guerre
mondiale, en se présentant comme l’enfant du
pays". L’architecte meurt finalement chez lui,
à Paris, dans le XVIe arrondissement, le 14 juin
1923 à 78 ans. |
Un architecte ambitieux face à un
nouveau programme
Lorsque lui est confié
le projet de l’hôtel des Téléphones
de Paris, Jean Boussard vient tout récemment d’être
nommé architecte auprès de la direction générale
des Postes et télégraphes. La formation initiale
de Boussard, tout comme ses années passées entre
les murs de l’école des beaux-arts de Paris sont
assez mal documentées. Nous savons néanmoins qu’il
fréquente l’atelier d’Alexis Paccard au milieu
des années 1860 et qu’il n’a jamais concouru
au traditionnel Grand Prix de Rome. Doté d’une personnalité
bouillonnante, l’architecte conduit de front une carrière
de constructeur et de théoricien. En effet, il ne s’illustre
pas seulement dans le domaine de la construction mais également
dans celui de l’édition. Il publie ainsi plusieurs
ouvrages, dont le premier – et certainement l’un des
plus importants au vu de sa diffusion – est un recueil
de tombeaux, paru en 1870. Ce recueil, constitué d’une
cinquantaine de planches gravées, s’inscrit dans
une tradition éditoriale lancée au début
du XIXe siècle.
Au-delà de ses recueils d’architecture
dans lesquels il esquisse brièvement ses théories
en matière de construction, Boussard publie un important
ouvrage intitulé L’Art de bâtir sa maison
(1887) où il consigne les règles à suivre
pour l’édification de la demeure idéale,
à la fois rationnelle, économique et hygiénique,
qu’il imagine calquée sur le modèle de villas
gallo-romaines du IIIe siècle. De cet ouvrage et des
théories qu’il renferme naîtront plusieurs
habitations réparties sur l’ensemble du territoire
français.
D’emblée, l’ambitieux Boussard cherche à
s’imposer parmi les plus grands architectes de son temps.
|
sommaire
Boussard parvient à accéder à
la commande publique lorsqu’il intègre l’administration
des Postes et Télégraphes, d’abord au grade d’inspecteur
des travaux, puis à celui d’architecte en chef. Pour cette
administration, il va d’abord construire plusieurs hôtels
des postes en province, notamment dans cette liste, les hôtels
des postes d’Angers dès 1887, Bordeaux,
Fontainebleau, ...
avant de concevoir les plans du premiers central téléphoniques
parisiens Gutemberg en 1892.
Suivirent d'autres centres parisiens comme Roquette en 1893, Chaudron
en 1896 , Gobelins en 1896, Wagram en 1897, et Ségur en 1900.
A
Fontainebleau l'architecte
de l’administration des Postes et Télégraphes
JM Boussard fut choisi pour édifier l'Hôtel des Postes.

Fin 1892, Conseil municipal du 2 décembre
: La lettre de M. le directeur général des postes et télégraphes,
informant que les plans et devis dressés en vue de la construction
d'un hôtel des Postes à Fontainebleau, on. été approuvé par le
conseil général des bâtiments civils. ... Le budget sera voté
en 1893. Les Plan
sont dressés en 1891 par l'architecte Louis Botte approuvé
en 1892 par l'inspecteur des domaines et le receveur des Postes
et Télégraphes. |
A Bordeaux 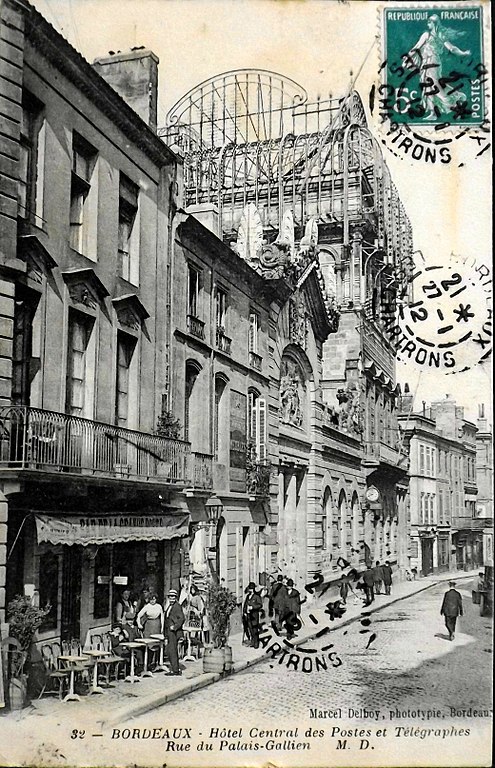
Dans le « goût romain », l'architecte parisien
Jean Boussard établit en 1892 plan et façade du
nouvel hôtel des postes : de grandes palmes installées
à l'origine sur le fronton principal ainsi que deux énormes
sphinx en console évoquaient la lointaine civilisation
mésopotamienne. Un bas-relief, représentant un empereur
romain sur son char, ornait le fronton de cette entrée
traitée en serlienne. Étranges ornements pour un
bâtiment destiné à abriter un service des
postes et télégraphes. Son « éclectisme
exotique » tranchait avec le classicisme architectural du
quartier. Aussi l'étrangeté de son style ne tarda-t-elle
pas à soulever de vives critiques.
Au-dessus du bâtiment principal s'élevait
« une herse » téléphonique aux proportions
gigantesques, « véritable édifice de fer constellé
de godets isolateurs en émail blanc » où convergeait
tout le réseau des abonnés de Bordeaux. Le poids
de cette énorme structure métallique nécessita
le scellement de contreforts métalliques qui, au fil du
temps, ébranlèrent la maçonnerie. En 1924,
elle disparut et le bâtiment fut exhaussé d'un étage.
Justin Tussau, architecte de l'administration des P.T.T.
nommé par le ministère, réaménagea
le bâtiment et simplifia sa façade. Dans le style
Art déco, la coupole en béton percée d'oculi
à pans coupés est construite sur l'ancienne cour.
C'est un des plus remarquables endroits de ce bâtiment |
A Angers
L'hôtel des postes prend sa forme définitive en 1887,
après l’inauguration du Grand théâtre
(1871). Pensé par Jean Boussard, architecte des Postes
et télégraphes, le bâtiment abrite désormais
l’hôtel des postes.
 
En 1937, l’hôtel des postes déménage
dans la rue Franklin-Roosevelt et l’édifice devient
l’hôtel des impôts ... puis à nos jours
un restaurant.Avec une capacité proche
de 500 couverts, la brasserie du Théâtre est aujourd’hui
l’un des plus grands restaurants des Pays de la Loire. |
Ancien Hôtel des Postes à
Orléans 
Le 19 novembre 1900, la place Marché-Porte-Renard, sur
laquelle en 1899-1901 fut élevé l'Hôtel
des Postes et Télégraphes d'Orléans, sera
renommée place Adolphe Cochery. Le pavillon du Marché-Porte-Renard
sera démonté et déplacé rue Eugène
Vignat pour abriter les pompes des réservoirs de la ville
situés dans cette rue.
Le bâtiment est inauguré le 17 juin 1901. Une frise
de panneaux sculptés repésentant des timbres de
toutes nations, œuvre de Ernest Lanson, décore le
deuxième étage. Les statues du fronton sont de Caillot.
Mis en service en 1903 (avec seulement une centaine d'abonnés
au téléphone à Orléans) et ayant échappé
aux bombardements de 1940, le bâtiment, surmonté
de sa grande coiffe de fils téléphoniques, restera
en service jusqu'en 1963. Imposant et moderne, le grand hall au
plafond décoré accueillait les clients pour le courrier
et le télégraphe. Une fois détruit, un nouveau
bâtiment sera construit juste en face, sur la désormais
Place De Gaulle. C'est la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
qui sera installée sur l'emplacement de l'ancien Hôtel
des Postes.
|
|
Central
téléphonique Chaudron 22, rue Chaudron à
Paris (1896).

Bâtiment construit en 1896 par l'architecte Jean-Marie
Boussard. 22 rue Chaudron (Paris-10e).
Cet édifice, typique de l'ancienne architecture industrielle,
fut désaffecté par suite de la mise en service du
central "Villette". |
Central téléphonique
Wagram ex Desrenaudes - Paris 17e, Bâti en 1897
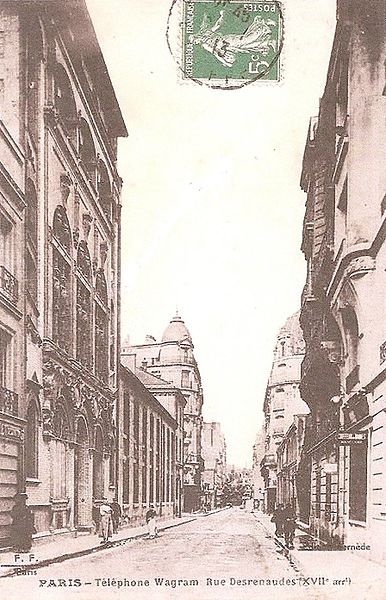
Cet édifice, situé 29 rue des Renaudes (Paris-17e),
est aujourd'hui détruit. Il abrita jusqu'à 400 demoiselles
des téléphones.
Ancien central Desrenaudes (nom de rue rectifié en des
Renaudes en 1897), renommé Wagram puis transféré
au central Carnot. |
Parmi ces derniers, l’hôtel des téléphones
de Paris fait figure d’exception, d’abord par la place qu’il
ambitionne d’occuper dans le maillage du réseau téléphonique,
ensuite par sa typologie.
sommaire
Aux origines du réseau téléphonique
parisien
Rappelons le contexte en 1879, à l’époque,
au sein du ministère des postes et télégraphes,
personne ne paraît soupçonner l’importance future
qui sera accordée au nouveau moyen de communication qu'est
le Téléphone. L’État choisit alors de remettre
l’exploitation du téléphone entre les mains de
compagnies privées. Cependant, il est nécessaire de
préciser que cette concession – éphémère
– prévoit un partage des tâches bien défini
entre l’administration et les compagnies privées. À
ces dernières reviennent l’installation des centraux et
le raccordement des abonnés au réseau téléphonique.
À l’administration revient la pose des câbles nécessaires
au développement du réseau.
À Paris, comme dans d’autres villes
en France, c’est la Société
générale des téléphones (S.G.T.)
qui détient le monopole.
Au milieu des années 1880, la S.G.T. – méfiante
vis-à-vis de l’État qui souhaite reprendre la main
sur l’exploitation du téléphone – cesse d’investir
dans l’entretien et l’extension du réseau téléphonique.
À la même époque, la notion de service public
qui émerge timidement au sein du gouvernement entraîne
le non-renouvellement des concessions accordées aux sociétés
privées.
Finalement, l’ensemble des infrastructures nécessaires
au fonctionnement des réseaux téléphoniques est
nationalisé en 1889.
À Paris, la situation est critique : le nombre d’abonnés
croît de manière exponentielle tandis que les centraux
téléphoniques saturent.
Nombreux sont les Parisiens qui se retrouvent sur liste d’attente,
espérant être un jour raccordés au réseau
téléphonique de la capitale. L’administration des
Postes et télégraphes, à laquelle est adjointe
le Téléphone pour former ce qu’il convient d’appeler
les P.T.T. (Postes, Téléphones et Télégraphes),
décide alors la mise en place d’une commission consultative
dont le but est de réfléchir à la transformation
du réseau téléphonique de Paris.
Dans son rapport daté du 20 novembre 1889, la commission préconise
notamment la création de quatre bureaux centraux en remplacement
des douze bureaux existants, hérités de la S.G.T.
L’acceptation de cette proposition conduit l’administration
à construire de nouveaux bâtiments, vastes et bien éclairés,
à l’instar des centraux téléphoniques que
le rapporteur a pu observer à Berlin. Le premier de ces édifices
à être construit est l’hôtel principal des
Téléphones, que le ministère choisit d’implanter
rue Gutenberg, à proximité de l’hôtel des
Postes L’architecte Jean Boussard est alors désigné
pour diriger les travaux.
Après la fusion des Postes et Télégraphes
avec les Téléphones en 1889, c’est toute une administration
qui se réorganise et une architecture qu’il faut (ré)inventer.
A Paris, le nombre d’abonnés du Téléphone
croit de manière exponentielle et il incombe à l’Etat
de concevoir un édifice capable de répondre à
un programme nouveau et aux besoins futurs.
sommaire
C’est ainsi que Jean Boussard, architecte de l’administration
des Postes et Télégraphes, se voit confier la lourde
tâche de construire le premier Hôtel des Téléphones
français en 1892.


1892 L’Hôtel des Téléphones et une
vue actuelle
On connait la Poste de la rue du Louvre et la
polémique qu’elle a engendrée au cours de ces années.
En revanche, peu connaissent l’Hôtel des Téléphones
qui la jouxte. Pourtant, cette construction à l’allure
de forteresse émaillée constitue un jalon essentiel
dans l’histoire de l’architecture publique En effet, il
s’agit là du premier bâtiment construit par l’État
pour répondre à un programme nouveau : celui des centraux
téléphoniques.
Paradoxalement aussi ostensible que méconnu,
l’Hôtel des Téléphones – souvent désigné
sous l’appellation de central Gutenberg – mérite
que l’on s’intéresse à lui d’un peu plus
près. Dans cet article, nous examinerons sa genèse en
rappelant le développement notable du réseau téléphonique
français à la fin du XIXe siècle, avant de nous
arrêter quelques instants sur la formation et la carrière
de son auteur. Puis, nous étudierons son architecture et son
évolution avant de réfléchir à sa patrimonialisation.
La construction de l’hôtel des téléphones
de Paris
L’autorisation de bâtir obtenue en janvier
1891, la construction débute en avril de la même année
et se poursuit jusqu’à l’automne 1892, lorsque
le monument est livré à l’État. La presse
se hâte alors de couvrir l’événement .
Boussard fait appel à des illustrateurs et graveurs, tels
Georges Garen qui fut son élève.
À l’instar de l’Hôtel des postes
qu’il jouxte, l’édification de l’hôtel
des téléphones a produit une abondante littérature,
qu’il s’agisse de la presse à grand tirage ou des
revues spécialisées d’architecture. Cette construction
est donc exceptionnellement bien documentée. Fort heureusement,
les Archives de Paris conservent le permis de construire de ce central
téléphonique. Le dossier qui le compose nous renseigne
sur la date et les modalités de dépôt des plans
de la nouvelle bâtisse. On apprend que la demande de permis
de construire est déposée par Boussard lui-même
au nom de l’État le 9 octobre 1890. Dans le dossier, il
est précisé que l’architecte cherche à obtenir
« la permission de construire un monument public destiné
à contenir le « Poste principal téléphonique
», conformément aux plans produits, lequel sera élevé
« d’un rez-de-chaussée et de 3 étages sous
comble ». Malheureusement, les originaux des plans, établis
sur papier calque, sont en trop mauvais état pour pouvoir être
consultés. Nous ignorons donc la date à laquelle Boussard
a pu établir les plans définitifs de son bâtiment.
Néanmoins, force est de constater que l’architecte a bénéficié
d’assez peu de temps pour la réalisation de ses plans.
En effet, entre la nationalisation du réseau téléphonique
et le dépôt du permis de construire il ne s’écoule
qu’un peu plus d’un an. Sans doute Boussard s’est-il
efforcé de respecter au mieux les préconisations établies
par le rapport de la commission évoquée précédemment.
Plans des différents niveaux de l’Hôtel
des Téléphones Gutenberg
 Cliquez sur un étage pour voir en détail
Cliquez sur un étage pour voir en détail
|
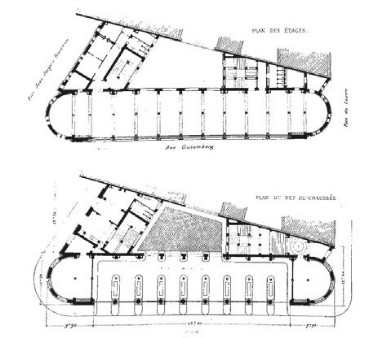
Gravure d'affectation des divers étages.
Un immense hall de 60 métres de long recevra 90 employés
pour les chaque étage 1,2 et 3. |
Situé au 55 rue Jean-Jacques-Rousseau
(Paris 1er), ce bel immeuble en briques bleues s’appelait
autrefois le “Central Gutenberg“.
C’était le tout premier bâtiment téléphonique
du service public : 1 400 opératrices y mettaient en
relation 18 000 abonnés… manuellement ! Ici, Jean
Boussard a proposé une forteresse médiévalo-industrielle,
dotée de verrières, qui a impressionné
les parisiens lors de son inauguration en 1892.
Ces salles mesurent 60
mètres en longueur et 10 en largeur; leur hauteur de
plafond est d'au moins 5 mètres.
Chacune d'elles a la forme d'un rectangle allongé, terminé
à ses deux bouts par des demi-cercles. De vastes baies
distribuent la lumière. Dans le sous-sol, les trois foyers
d'un grand calorifère fournissent la chaleur à
tous les étages. Au-dessus des chambres de chauffe, un
ventilateur puissant répartit dans la tuyauterie une
forte colonne d'air comprimé, provenant de la distributionde
la compagnie Popp. C'est cette colonne d'air qui répandune
douce chaleur dans les différentes salles. L'été,
au contraire, lorsque le calorifère reste inactif, le
même ventilateur sert à l'aération de l'immeuble,
et maintient la fraîcheur si nécessaire au nombreux
personnel groupé autour des appareils...
|
Sur une parcelle étroite de près de
1200 mètres carrés, l’architecte prévoit
l’installation d’un long bâtiment formé de
deux ailes.
L’articulation de celles-ci génère une petite cour
intérieure dont l’usage est réservé à
l’Hôtel des Postes qui y trouve l’espace idéal
pour le remisage de ses voitures hippomobiles. La première
aile, longue d’une soixantaine de mètres, borde la rue
Gutenberg. Elle est flanquée de deux tours réalisées
en maçonnerie de pierres et de briques émaillées
qui confèrent à l’édifice un aspect de forteresse
médiévale.
Cette partie du bâtiment étant destinée à
accueillir, superposées, les salles des multiples où
s’affaireront les « demoiselles du téléphone»,
l’architecte cherche à y apporter un maximum de lumière.
Il conçoit alors une façade toute de fer et de verre
à l’instar de celles qui garniront, près d’une
dizaine d’années plus tard, les sous-stations électriques
de la Compagnie générale du Métropolitain. La
rue Gutenberg étant trop étroite pour pouvoir apprécier
avec suffisamment de recul la façade du central téléphonique,
seules les vues d’artistes insérées dans les revues
de l’époque nous permettent de considérer l’effet
que pouvait produire cette construction sur le promeneur. On y constate
que la façade de verre et de fer revêt un aspect de légèreté,
souligné par la série d’arcades du premier niveau.
Elle vient alors contrebalancer la lourdeur et la massivité
de la seconde aile, érigée le long de la rue Jean-Jacques
Rousseau. De dimensions beaucoup plus modestes, celle-ci accueille
les bureaux et une partie des espaces de circulation du central téléphonique
à l’instar du grand escalier de service. Ce dernier, construit
en béton, est largement ouvert sur l’extérieur
par une série de fenêtres à arcs rampants dont
la silhouette ne va pas sans évoquer celle des cages d’escaliers
des châteaux de la Renaissance.
Cette dénomination de monument d’un genre
nouveau confirme l’aspect inédit que revêt la construction
d’un central téléphonique. L’auteur, anonyme,
souligne également que « l'originalité de la construction
consiste principalement dans l'emploi de la céramique pour
les façades ». Ces céramiques, qui incluent les
briques émaillées employées pour l’appareil
des murs donnant sur les rues du Louvre et Jean-Jacques Rousseau ainsi
que les encadrements de terre cuite installés autour des différentes
baies, proviennent d’une entreprise chère à Boussard
: les usines Perrusson d’Ecuisses, en Saône-et-Loire. Résistantes
aux effets néfastes de la pollution (elles ne se couvrent pas
de croûte noire comme la pierre calcaire en raison de leur émail)
ces céramiques ont assuré à l’Hôtel
des Téléphones des façades colorées et
rutilantes tout le long du XXe siècle. Étonnamment,
aucun journal à l’époque ne semble avoir condamné
ce parti pris esthétique, en rupture totale avec les autres
immeubles du quartier.
Si les choix de Boussard peuvent
surprendre, il faut néanmoins souligner la cohérence
du programme et de la construction. D’abord, le recours aux matériaux
industriels tels que le fer et le verre convient parfaitement à
la nature du lieu et répond aux besoins de luminosité
que nécessite cette « usine » téléphonique.
En outre, sa volonté de rupture et de modernité s’inscrit
également dans la maçonnerie : par le recours à
une brique émaillée de couleur claire qui tranche avec
la pierre des immeubles contigus ; mais également par la présence
des deux rostres qui flanquent la façade vitrée, à
hauteur du troisième étage. Celles-ci pourraient vouloir
signifier aux passants de la rue du Louvre que le bâtiment qui
se dresse devant eux, constitue le vaisseau amiral d’une flotte
conquérante, allégorie de l’administration des
P.T.T. Ajoutons que le rationalisme de l’édifice est maintes
fois souligné dans les revues spécialisées de
l’époque, à l’instar de La Semaine du constructeur
qui déclare à ce sujet : « le principe d’accusation
au dehors de la distribution intérieure se trouve rigoureusement
appliqué». Ce rationalisme, visible en élévation,
s’exprime également dans les volumes intérieurs
où de vastes espaces sont conçus pour l’installation
du matériel téléphonique.
L’édifice, dont la construction débute
en 1912, se situe à l’angle de deux voies : la rue Bergère,
(...)
Enfin, le plan en équerre de l’Hôtel
des Téléphones, que nous évoquions plus haut,
jouit d’une descendance exceptionnelle. Ainsi, l’architecte
François Le Cœur (1872-1934), qui travailla également
au service des P.T.T., employa à son tour cette formule pour
plusieurs de ses édifices dont le central téléphonique
Bergère situé rue du faubourg Poissonnière. De
même, Paul Guadet (1873-1931) conserva cette formule lors de
l’édification de ses centraux téléphoniques
parisiens.
Un édifice rescapé et remanié
Malgré ses qualités,
l’Hôtel des Téléphones de la rue du Louvre
a pourtant bien failli disparaître. Le 20 septembre 1908 au
soir, un incendie ravage le bâtiment. Là encore, la presse
s’empare du sujet et les articles qui en découlent se
comptent par dizaines. Fait remarquable, Boussard livre son point
de vue sur l’évènement dans une interview qu’il
accorde au journal Le Rappel. L’architecte fait part de son incompréhension
et précise : « Les salles n'avaient d'autre communication
entre elles que la cheminée qui servait au passage des câbles.
Il était donc facile d'isoler une salle dans laquelle un incendie
se déclarait. Pour moi, c'est une chose inconcevable que la
destruction totale de l'hôtel des téléphones.
» Boussard ajoute qu’à l’époque où
il a conçu son bâtiment, « l’administration
ne voulait pas entendre parler du ciment armé. […] On
était donc obligé d'employer, pour soutenir le plancher
d'aussi vastes salles, des colonnes de fer. Ces colonnes auront sans
doute, sous l'action d'un incendie qui a duré plusieurs heures,
rougi et se seront déformées sous le poids. Dans ce
cas tout l'édifice est compromis. » Et l’architecte
est loin de se méprendre. En effet, les photographies prises
au lendemain de l’incendie attestent du ploiement des planchers
et de l’éclatement de plusieurs colonnes.
De plus, si les propos que l’on prête
à Boussard se révèlent exacts, il est nécessaire
de souligner le fait que l’architecte se montre novateur sur
le plan technique. Ainsi exprime-t-il sa volonté, très
précoce, d’employer le ciment armé en lieu et place
du fer et de la fonte dans la construction des planchers et la structure
du bâtiment. Malheureusement, force est de constater que Boussard
n’utilisera le ciment armé qu’à de très
rares occasions dans ses constructions ultérieures.
Malgré l’importance des dégâts
matériels, la décision est prise par l’administration
de ne pas reconstruire l’intégralité du bâtiment.
Les raisons qui ont amené cette décision sont de différents
ordres : à la fois pratiques et financiers. Par chance, l’incendie
a épargné une partie des installations techniques situées
au premier étage du bâtiment. Aussi, le central téléphonique
provisoire installé dans la cour qui sépare l’ancien
Hôtel des Téléphones de l’Hôtel des
Postes peut-il être raccordé rapidement au matériel
épargné afin de léser le moins possible les abonnés.
La conservation d’une partie du bâtiment incendié
s’est alors imposée à l’Administration. De
surcroit, la reconstruction intégrale d’un pareil édifice
aurait fortement obéré les finances de l’État.
La solution d’une reconstruction partielle – donc, à
moindre coût – est d’autant plus souhaitable.
C’est l’architecte Charles Giroud (1871-1955) qui est chargé
de la reconstruction du central téléphonique.
La demande de permis de construire est déposée le 22
novembre 1909 par M. Le Directeur des services téléphoniques.
Le dossier vise à obtenir la permission de reconstruire l’Hôtel
des Téléphones « en conservant une partie du bâtiment
sinistré ». Les plans, datés du 11 novembre 1909,
attestent que l’aspect général du bâtiment
original est conservé à ceci près que le nouvel
édifice est surélevé d’un étage installé
en encorbellement et que les planchers métalliques laissent
place à des planchers en béton armé. Finalement,
le nouvel édifice, inauguré en 1912, conserve le souvenir
prégnant de Jean Boussard. Outre quelques aménagements
intérieurs nécessaires compte tenu de l’évolution
des technologies et de la miniaturisation du matériel électrique,
le central téléphonique Gutenberg tel que l’on
peut l’observer aujourd’hui, a dans l’ensemble conservé
ses dispositions d’origine, tant en plan qu’en élévation.
Quel avenir pour ce « monument » ?
L’Hôtel des téléphones
érigé par Jean Boussard constitue, nous l’avons
vu, un édifice important dans l’histoire de l’architecture
publique. Pourtant, l’édifice demeure absent des manuels
d’histoire de l’art spécialisés, à
de rares exceptions près. Seul le chercheur américain
Frances H. Steiner a vu dans l’Hôtel des Téléphones
« l’un des plus brillants exemples de fonctionnalisme au
XIXe siècle». Par l’intermédiaire de cette
étude, nous souhaitions donc rendre à ce bâtiment
et à son auteur les honneurs qu’ils méritent.
Lorsque Jean Boussard meurt le 14 juin 1923 dans son
appartement de la rue Ribera (Paris, XVIe arrondissement), il ne laisse
aucun héritier. Ses archives, dispersées ou bien détruites,
ne sont pas parvenues jusqu’à nous. Aussi, rares sont
les historiens de l’art qui ont pris le temps de s’intéresser
à cet architecte et à son œuvre. Aucune monographie,
ni même aucun article scientifique ne lui ont jamais été
dédiés.
Face à la pression immobilière,
l’Hôtel des téléphones – propriété
de l’entreprise Orange – paraît voué à
la vente et à la reconversion à l’instar d’un
grand nombre d’anciens centraux téléphoniques.
Ce contexte doit nous inciter à faire preuve d’une extrême
vigilance, laquelle est d’autant plus justifiée que l’immeuble
n’est protégé que par le plan local d’urbanisme
(P.L.U.) de la Ville de Paris. Or, l’édifice nous parvient
dans un état historique intéressant, offrant encore
à l’œil du visiteur quelques reliquats du premier
central téléphonique tels que la cage d’escalier,
les colonnes en fonte du premier niveau, les façades de briques
émaillées, etc., ainsi que des aménagements postérieurs
hérités des travaux de Charles Giroud. Ne bénéficiant
d’aucune protection au titre des Monuments historiques, l’Hôtel
des Téléphones pourrait être aux prises avec toutes
sortes de déprédations visant à retirer les derniers
éléments décoratifs qu’il renferme et qui
témoignent de son glorieux passé. Aussi interrogeons-nous
: la protection au titre du PLU26 est-elle suffisante et pérenne
? Rien n’est moins sûr…
sommaire
Les Réalisations de Jean BOUSSARD
50, rue des Bernardins à Paris (1879), Sur
le pan coupé de la rue des Écoles, médaillon
de Gaspard Monge (1746-1818).
66, avenue Kléber à Paris (1880), au coin du 2, rue
Cimarosa. Immeuble de cinq étages à sept et six fenêtres.
La double porte semble postérieure. Non signé. Médaillon
de Cimarosa au coin.
93, avenue Kléber à Paris (1880). Signé et daté.
6 étages et 7 fenêtres. Grand balcon filant au cinquième.
7 mansardes.
24, boulevard Saint-Germain à Paris (1881),
7-9, place des Ternes (La cité mondaine) à Paris (1881-1882),
signé et daté. Grand immeuble dont les entrées
se rejoignent sur une cour circulaire à 25 fenêtres.
Fenêtres au coin et sur l'avenue de Wagram. 13 + 3 + 5. Le sol
des entrées est signé Corbassière, entreprise
toujours en activité (comme les 30-28, rue Michel-Ange de Louis
Salvan (1891) et le 5, rue Benjamin-Franklin). Balcon filant en pierre
au 5e étage sur 6. Le sixième a 16 + 6 vasistas.
21, boulevard Saint-Germain à Paris (1881-1882, gravé).
Remarquable fronton. Grand vestibule de classe. Signé J. Boussard.
8 fenêtres par étages tous différents. Belle pierre,
comme toujours. De part et d'autre de la double porte d'entrée,
deux cariatides, sans bras ni jambes, se font face.
21, rue Greneta à Paris (1885). Immeuble de six étages
à neuf fenêtres. JEAN BOUSSARD ANNO 1885, gravé
dans la pierre.
Hôtel des Postes d'Angers (1887),
Caisse nationale d'épargne, rue Saint-Romain à Paris,
(actuel siège de La Banque postale) (1890),
Caisse d'épargne à Saint-Florentin (actuel hôtel
de ville) (1890),
Hôtel des Téléphones (Central Gutenberg), rue
du Louvre (46 bis) et rue Jean-Jacques-Rousseau (55) à Paris
(1890). Partiellement incendié en 1908. Remanié par
Charles Giroud.
17, rue des Bernardins à Paris (1890),
Maison romaine d’Épinal (1892),
Grande Poste de Bordeaux (1892),
Hôtel des Postes de Fontainebleau (1893),
4, rue Jean-Goujon à Paris (1894),
41 et 45, rue Ribera à Paris (1894),
40 et 42, rue Ribera et 5, rue Dangeau (1894),
Central téléphonique Chaudron 22, rue Chaudron à
Paris (1896). Désaffecté. Remplacé par La Villette.
76 et 78, avenue Mozart, 2, rue de l'Yvette et 13-15, rue de la Cure
(arrière), (1896),
37, rue Ribera, Paris (1898) : hôtel particulier de trois étages,
aujourd'hui démoli, construit par l'architecte pour lui-même5,
Hôtel des Postes d'Orléans (1898),
Château des Hautes-Montées (Château de la Chênaie)
à Orléans (1898),
4 (et 1, rue de l'Yvette) et 6, rue Jasmin, à Paris (1911 et
1914-1916).
Auxerre, hôtel particulier, 3 boulevard du 11-Novembre
sommaire
Les Publications
Études sur l'art funéraire moderne,
Paris, Librairie polytechnique de J. Baudry, 1870, 200 pl.
Recueil des tombeaux les plus remarquables exécutés
de nos jours et représentés en perspective, Paris, Librairie
polytechniques de J. Baudry, s.d., 52 pl.
Concours de l'École des Beaux-Arts (médailles et mentions),
Paris, 1874-1875
Constructions et décorations pour jardins, 1881
Petites habitations françaises, 1881
Choix de fontaines décoratives, 1883
Conseils pratiques de construction. La Maison française, ce
qu'elle est, ce qu'elle devrait être, 1883
L'Art de bâtir sa maison, Paris, 1887
sommaire
|
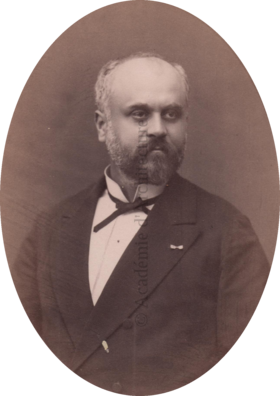

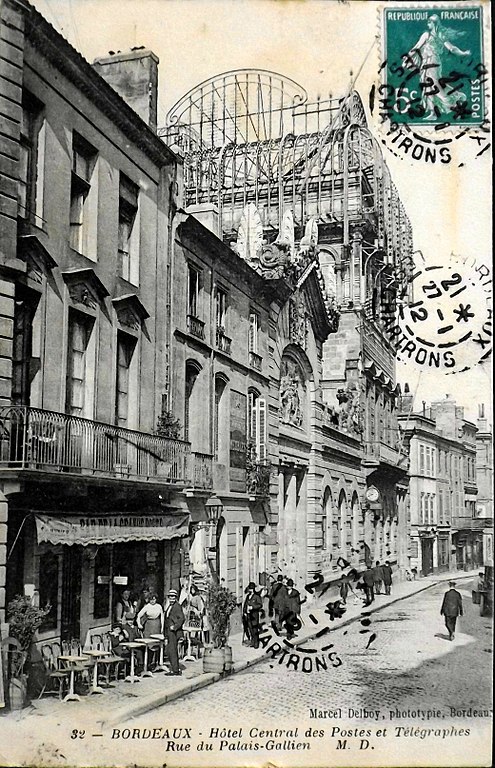




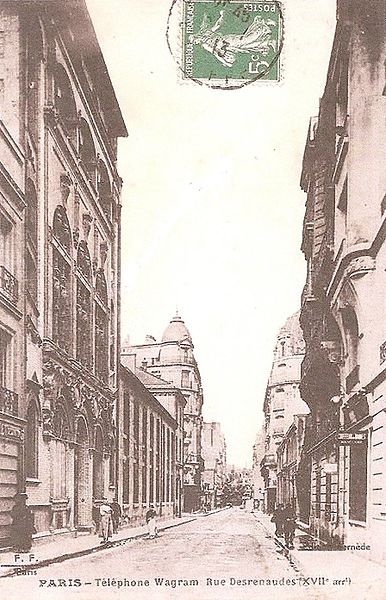


 Cliquez sur un étage pour voir en détail
Cliquez sur un étage pour voir en détail