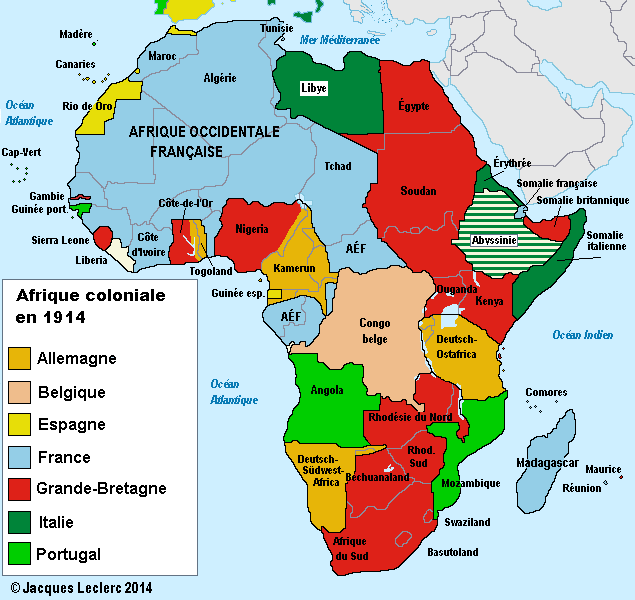Colonies Potuguaises en Afrique
Au XIXeme siècle, la présence du Portugal
en Afrique remonte à plus de trois siècles, mais cette présence
se circonscrit aux côtes et à quelques îles.
A partir du milieu du XIXème siècle, à l’ère
de la course lancée par les principales puissances européennes
qui, après avoir compris que l’Afrique était un vaste
continent « vide », se sont lancées dans une vraie
compétition de conquêtes), le Portugal comprend qu’il
a son mot à dire, et se lance lui aussi dans la curée. Sa
grande ambition est de réaliser le « Mapa-cor-de-rosa »,
c’est-à-dire, de faire la jonction entre l’Angola et
le Mozambique, autrement dit, entre l’océan Indien et l’Atlantique.
Mais cette ambition se heurtera à l’Angleterre qui entend
elle réunir l’Egypte à ses possessions de l’Afrique
du Sud. Le Portugal doit se plier aux exigences de l’Angleterre (
il n’a guère eu le choix) et en profite par des traités
de fixer les frontières de ses possessions ( très convoitées
par les autres puissances ). Mais prétendre n’est pas dominé,
la pacification des territoires portugais a été difficile
et longue. Il faut attendre les années 1930 pour que la Guinée
portugaise par exemple soit totalement pacifiée.
En octobre 1910, le roi Manuel II est renversé, la République
est proclamée, la monarchie portugaise passe aux oubliettes.
Le nouveau régime peut se targuer d’un empire africain de
plus de 2 millions de km2 ! 20 fois plus grand que le Portugal lui-même
(92 000 km2) ! ! Un empire qui contient plus de 2 millions d’habitants
!
En 1914, le Portugal est la 4eme puissance coloniale du monde (loin il
est vrai de la France ou de l’Angleterre dont les empires sont 5
fois plus grands).
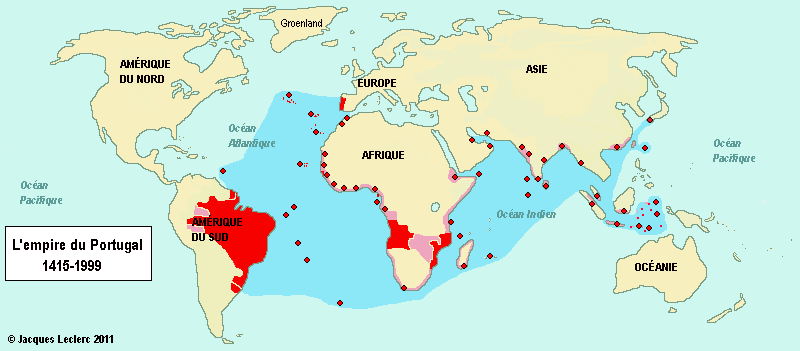
L'Afrique portugaise désigne l'ensemble
des colonies africaines ayant appartenu au Portugal. Elle regroupe :
En Afrique du Nord:
Des territoires marocains (entre 1471 et 1660): Ceuta, Mogador (Essaouira),
Safi, Agadir, Tanger, etc.
En Afrique sub-saharienne:
L'Angola (1575-1975), le Cap-Vert (1642-1975), la Guinée-Bissau
(1879-1974), le Mozambique (1501-1975), le São Tomé e Príncipe
(1753-1975), sans compter un grand nombre de comptoirs commerciaux au
Ghana, au Kenya, en Tanzanie, au Sénégal et au Yémen.
En Afrique occidentale:
Le Bahreïn (1521-1602) et les comptoirs (entre 1506 et 1650) d'Ormuz
et de Bandar Abvbas (Iran), de Mascate (Oman) et de Socotora (Yémen).
L'Empire colonial portugais provoqua d'innombrables catastrophes
sur les peuples autochtones tels l'esclavage, la guerre, le dérèglement
des réseaux commerciaux, la fin des activités culturelles
traditionnelles, la déforestation et les maladies, etc. Parmi les
autres conséquences, il faut mentionner la prédominance
de la langue portugaise et de la religion catholique dans de nombreuses
régions du monde.
L'Angola et le Mozambique sont des territoires vastes et potentiellement
riches, et la Guinée-Bissao une petite enclave, très pauvre,
dans l'Ouest-Africain indépendant. Les trois territoires sont officiellement
considérés par le Portugal comme des provinces d'outre-mer,
et par conséquent juridiquement intégrés à
la métropole. On retrouve cependant dans les institutions politiques,
économiques et sociales de ces territoires, de même que dans
leurs relations avec la métropole, des schémas coloniaux
traditionnels.
La réalité,
en Angola et au Mozambique, était celle d'un colonialisme économique
sous-développé et d'une domination coloniale archaïque.
Subsistaient par exemple le régime du travail forcé et l'envoi
de travailleurs du Mozambique dans les mines sud-africaines .
sommaire
La politique portugaise durant plusieurs décades a visé
à faire en sorte que ses territoires s'autofinancent, à
réaliser des profits et à tirer pour les industries de la
métropole des matières premières et des marchés
privilégiés. Il fallait éviter que les produits des
colonies fassent compétition à ceux de la métropole,
et les investissements publics dans les colonies visaient essentiellement
à favoriser les intérêts des Portugais qui y faisaient
affaires. La philosophie sociale qui se dégageait des politiques
à l'égard des populations africaines ressemble à
celle d'autres États européens - elle était paternaliste
- avec cette caractéristique additionnelle que, dans le cas du
Portugal, le citoyen de la métropole était lui aussi pauvre,
pieux - voire dévot - et illettré, le «travail ardu»
était pour lui aussi une «obligation morale et civique».
Dès le début XXe siècle, plusieurs
colonies portugaises disparurent en raison des puissances rivales tels
le Royaume-Uni et la France ou des guerres internes. Parmi les colonies
restantes, Madère et les Açores devinrent des régions
autonomes du Portugal, et Goa une partie de l'Inde en 1962.Sous la dictature
militaire d'António de Oliveira Salazar (1932-1968), le gouvernement
s'entêta à ne pas reconnaître les mouvements indépendantistes
africains; il s'ensuivit des guerres sanglantes, notamment en Angola et
au Mozambique.
Alors que s'achève la décolonisation en Asie à la
fin des années 1940, le mouvement se déplace en Afrique,
tout spécialement au Maghreb, en pleine ébullition. Il existe
pourtant déjà un pays d'Afrique du Nord qui a obtenu son
indépendance : la Libye. C'
En Guinée fut fondé, dès 1956, le
Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap
Vert, le P.A.I.G.C.V. Son chef, Amilcar Cabral, lança, en 1963,
la lutte armée qui réussit à contrôler, en
1969, les deux tiers du pays.
C’est dans la plus petite de ses possessions, la Guinée-Bissau,
que le Portugal fut confronté en 1973 à l’inexorable
avancée du mouvement de décolonisation du continent.
En Angola, ce fut après l'indépendance
du Congo belge que certaines organisations politiques, comme le Mouvement
populaire de libération de l'Angola (M.P.L.A.), puis l'Union des
peuples angolais (U.P.A.), déclenchèrent, en 1961, des soulèvements
indépendantistes. Au Mozambique, le Front de libération
(Frelimo), constitué en 1962, entama dès 1964 une lutte
armée qui se généralise après 1972. Le poids
de ces conflits coloniaux, où combattirent quelque 200 000 soldats
portugais, convainquit finalement le Portugal qu'il devrait lui aussi
céder face à des Africains soutenus par la Chine et l'U.R.S.S.
Mais la décolonisation ne put être admise qu'après
la chute du régime dictatorial de Salazar, la « révolution
des œillets » du 25 avril 1974. L'indépendance
de la Guinée-Bissau fut négociée de mai à
septembre 1974. Le mouvement se poursuivit, non sans difficultés,
avec l'indépendance du Mozambique, reconnue le 25 juin 1975,
celle des îles du Cap-Vert le 5 juillet et de São
Tomé le 12 juillet, enfin celle de l'Angola le 11
novembre 1975.
Ces décolonisations en chaîne étaient en réalité
le résultat de longues années de guérilla : quatorze
ans en Angola, dix ans en Guinée et au Mozambique. De coûteuses
guerres civiles entre Africains, l'intervention de troupes étrangères,
l'adhésion à des idéologies opposées, le départ
des colons portugais achevèrent de ruiner ces territoires. Ces
guerres coûtèrent la vie à 14 000 Portugais, sans
compter les 20 000 soldats qui revinrent handicapés ou mutilés.
Du côté de la population africaine, le bilan fut encore plus
considérable : 100 000 morts, majoritairement des civils.
La décolonisation n'a pas été pourtant
la loi générale de la seconde moitié du xxe siècle.
Elle n'est pas achevée, puisque certains territoires contestent
toujours leur statut et que certains peuples combattent encore la domination
russe (Tchétchènes) ou rejettent les colonisations chinoise
(Tibet) ou, jusqu'en 1999, indonésienne (Timor). La naissance d'un
État juif à partir d'une colonisation du peuplement de la
Palestine arabe a déjà provoqué plusieurs guerres
entre Israël et le monde arabe.
L'Afrique coloniale