POSTE
D'APPEL DIRECT , POSTE MOBILE, APPEL DIRECT sur un seul fil
1- POSTE D’APPEL DIRECT système Berthon
Le 10 décembre 1880, la Société
Générale des Téléphones se
constitue, elle décide d'exploiter le système Bell-Grower
amélioré par Ader et M. Berthon. Le 28
février 1883, elle dépose un brevet pour perfectionnements
dans la disposition des bureaux centraux et des postes téléphoniques,
en vue de permettre l'appel direct entre abonnés (système
Berthon) Grâce à ce système, la société
installe le réseau téléphonique de Paris dont les
appareils restent en service jusqu'en 1920. Il s’agit
ici d’un appareil très ingénieux et dont l’usage
se répand beaucoup en France.
Brevet de quinze ans 154,019. du 28 février 1883 ; société
générale des téléphones (réseaux téléphoniques
et constructions électriques ) , représentée par
Armengaud jeune , à Paris , boulevard de Strasbourg , n° 23.
-
Perfectionnements dans la disposition des bureaux centraux et des postes
téléphoniques , en vue de permettre l'appel direct entre
abonnés , système Berthon.
Suivra ; Société générale des téléphones,
le 22 mai 1883 , brevet 154,019 . Perfectionnements dans la distribution
des bureaux centraux et des postes téléphoniques , en
vue de permettre l'appel direct entre abonnés , système
Berthon.
Article lu dans "Les téléphones Usuels"
de Ch. Mourlon 1887
Il est dû à M. Berthon, le directeur de la Société
Générale des Téléphones, dont nous
avons eu l’occasion de décrire le nouveau transmetteur, lequel
est généralement combiné avec l’appareil d’appel
.
Pour faire bien comprendre à nos lecteurs le perfectionnement réalisé
par cet appareil qui rend les communications plus faciles et plus rapides,
nous ne saurions mieux faire que d’en reproduire ici la description.
Cet ensemble d’appareils est décrit dans La Nature
par l’un des collaborateurs les plus savants et les plus sympathiques
de cette revue, M. l’ingénieur E. Hospitalier :
| Le fonctionnement général
du réseau a été décrit ici autrefois en
détail, aussi n’y reviendrons-nous pas; mais il s’est
introduit dans les appareils des perfectionnements importants, de
nature à rendre les communications plus faciles, plus rapides
et plus commodes, et sur lesquels nous croyons utile d’appeler
l’attention de nos lecteurs. Nous signalerons aujourd’hui, en particulier, l’appel direct, les postes mobiles, et le système permettant de desservir plusieurs abonnés habitant le même immeuble par un seul et même fil. |
 |
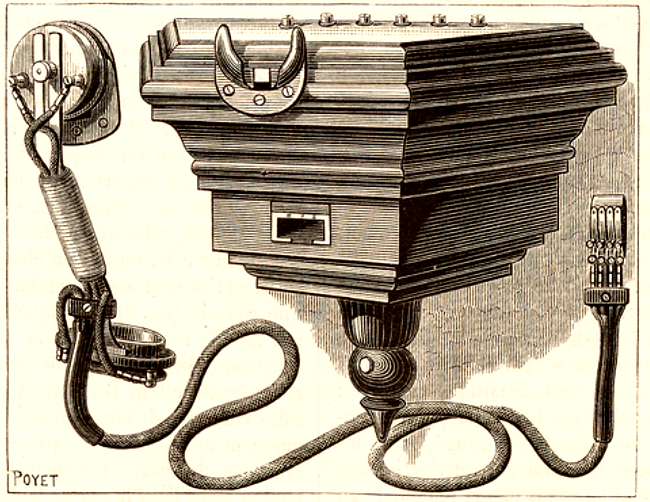 Fig 2 Console et poste mobile |
Fig 1 Poste d'appel direct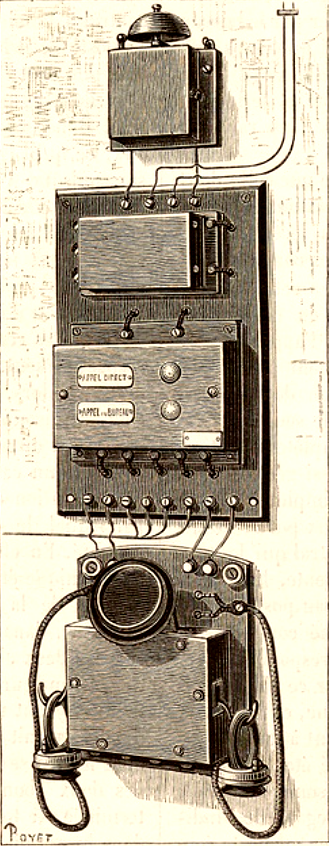 |
« Supposons, par exemple,
pour fixer les idées, un industriel ayant sa maison de vente
située au centre de Paris, et son usine un peu plus loin de
ce centre, mais dépendant d’un même bureau central.
La maison de vente et l’usine ont entre elles des communications
très fréquentes, mais elles doivent aussi pouvoir communiquer
individuellement avec tous les autres abonnés du réseau.
Avec des postes téléphoniques ordinaires, il faudrait passer chaque fois par le bureau central pour demander la communication entre la maison de vente et l’usine, ce qui amènerait chaque fois une certaine perte de temps. Avec l’appel direct, cet inconvénient disparait. Au lieu d’établir des postes ordinaires, on dispose des postes d’appel direct, et le bureau central établit une communication permanente entre ces deux postes, sans pour cela perdre la possibilité d’être appelé par l’un ou l’autre de ces postes, ou d’appeler aussi à volonté l’un ou l’autre, sans déranger celui qui n’est pas interpellé. Les communications d’appel direct, c’est-à-dire de la maison de vente à l’usine, ou de l’usine à la maison de vente, s’établissent alors directement, sans que le bureau central ait à intervenir, combinaison qui présente le double avantage de réduire le nombre de communications à effectuer par le bureau central, et de faire gagner à l’abonné un temps précieux qui serait perdu chaque fois qu’il s’agit d'établir une communication entre l’usine et le bureau de vente, dont, dans notre hypothèse, les rapports sont très fréquents.» Il faudrait beaucoup plus de place que celle dont nous pouvons disposer, et des explications dont la longueur dépasserait la patience du lecteur, pour exposer par le menu les ingénieuses combinaisons du circuit qui permettent de réaliser cet appel direct; mais nous espérons pouvoir en faire comprendre aisément le principe. Dans l’appel direct, M. Berthon a su mettre fort habilement à profit ce fait que tout le réseau téléphonique de Paris est établi sur le principe du double fil, le seul qui, jusqu’ici, permette de supprimer complètement tous les bruits d’induction et de friture, si gênants et si désagréables dans les systèmes à simple fil. Appelons, pour simplifier, A et B les deux postes munis de l’appel direct, et C le bureau central qui les réunit. Dans la position ordinaire d’attente, le double fil qui réunit les deux postes A et B au poste central C forme un circuit métallique fermé complet. Au poste central, les annonciateurs correspondants à A et B sont montés en dérivation sur ce double fil. Aux extrémités de ce circuit métallique, en A et en B, sont placés deux relais communiquant à la terre par une des extrémités, l’autre extrémité étant reliée au circuit métallique. Si A veut appeler son conjugué B, il appuie sur le bouton placé en regard de l’indication appel direct; s’il veut appeler au poste central, pour demander la communication avec un autre abonné du réseau, il appuie sur le bouton correspondant à appel au bureau. Dans le premier cas, il envoie, par les deux fils à la fois, un courant d’une pile reliée à la terre qui arrive chez B et actionne la sonnerie de B par l’intermédiaire du relais, mais sans faire tomber les annonciateurs du poste C, qui, se trouvant branchés entre deux points du circuit où la force électromotrice est la même, ne sont traversés par aucun courant. Le poste A a donc appelé le poste B directement, sans l’intervention du bureau central. Le reste des communications entre ces deux postes s’établit alors à la manière ordinaire. |
|
Si, au contraire, le poste A appuie sur le bouton
appel au bureau, il intercale, par cette manœuvre, une pile
isolée dans le circuit métallique complet : le relais
placé en B n’est pas influencé par ce courant,
le poste B n’est donc pas dérangé, mais les annonciateurs
du poste C, branché en dérivation sur des points qui
ne sont plus au même potentiel, au même niveau électrique,
sont aussitôt traversés par un courant qui actionne
les guichets et les fait tomber. Le bureau central prévenu
établit aussitôt les communications nécessaires,
à la manière ordinaire. Ce que nous venons de dire pour les appels faits
par A, s’applique également, par simple raison de symétrie,
aux appels faits par B. Lorsque le bureau central a besoin d’appeler
à son tour le poste A ou le poste B, il le fait à
l’aide du courant fourni par une pile dont l’un des pôles
est à la terre, en ayant soin de s’assurer, au préalable,
que les deux postes A et B ne sont pas déjà en communication
entre eux, ce qu’il ignore, d’ailleurs, avant de faire
l’essai, puisque A et B peuvent s’interpeller à
volonté sans prévenir le bureau central. |
2 - LES POSTES MOBILES
MM. Berthon et Ader ont imaginé un système
de postes mobiles, dont les applications sont nombreuses à Paris.
Le but poursuivi par les inventeurs était d’imaginer un système
permettant de correspondre de plusieurs points d’une maison, en n’établissant
qu'une seule communication.
On place aux différents points d’une maison, une console renfermant
un téléphone magnétique récepteur et un transmetteur
Berthon du type que nous avons décrit. A chaque console correspond
une sonnerie ordinaire qui est actionnée du moment que l’on
accroche le poste téléphonique portatif .
L’appel se fait en poussant sur un petit bouton placé au bas
de la console (Fig 2). Dès que la personne qu’on a
appelée a répondu, on décroche le dit poste téléphonique
portatif et l’on place le bout du cordon de celui-ci, muni d’une
sorte de jack-knife (ordinairement un conjoncteur à 4 contacts),
dans une ouverture correspondante pratiquée dans le milieu de la
console.
De cette façon, la communication étant sur téléphone,
on peut correspondre.
3 - ABONNÉS MULTIPLES SUR UN MEME FIL
Ces mêmes inventeurs ont aussi combiné un
système permettant à plusieurs abonnés d’un
même immeuble de correspondre, au moyen d’un seul fil, avec
le bureau central.
Certains abonnés d’un même immeuble qui ne font pas
un usage très fréquent du téléphone peuvent
s’associer pour placer plusieurs postes sur un même fil. Ce
système ne permet, il est vrai, la communication que pour un seul
abonné à la fois, mais, en pratique, il est très
rare que les communications soient urgentes en même
temps, et le petit inconvénient résultant
de rares coïncidences est bien compensé par l’économie
résultant de la combinaison. Sans entrer dans les détails
techniques du système combiné par MM. Berthon et Ader, disons
qu’ils sont établis pour deux, quatre ou six abonnés.
Des dispositions fort ingénieuses font que le poste central ne
dérange jamais d’autre abonné que celui qui lui est
demandé par un correspondant ; de même, un abonné
quelconque peut appeler le poste central sans déranger aucun de
ses coabonnés ; enfin, dès que la ligne est occupée
par un des abonnés, tous les autres en sont aussitôt prévenus
par un signal optique qui indique la mise en liberté de la ligne,
dès que la conversation est terminée. On voit, par ces quelques
exemples, les efforts faits par la Société générale
des téléphones pour donner satisfaction, dans la mesure
du possible, aux exigences des abonnés, et résoudre les
problèmes souvent difficiles que lui imposent les circonstances.
Sans prétendre, comme Pangloss, que tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes, on peut dire cependant que la Société
sait mettre habilement à profit les enseignements d’une longue
expérience, et vaincre des difficultés devant lesquelles
reculerait la Société nouvelle et inexpérimentée
dont on nous a récemment menacés, dans le but de protester
contre un monopole de fait, monopole plus que justifié, dans
l’espèce, par la nature du service qui en est l’objet.
| Le système Ader
est adapté au circuit métallique de Paris, et
permet de placer quatre postes d'abonnés indépendants
sur un double circuit. Au repos, la ligne de boucle est complétée à la station centrale, mais est mise à la terre à mi-chemin entre les quatre abonnés. Lorsque l'opératrice du poste central veut appeler l'un ou l'autre des quatre abonnés, il débranche l'un des deux fils et envoie dans l'autre un courant positif ou négatif qui, selon la ligne choisie et le sens du courant, agit sur un des quatre relais Lorsqu'un abonné décroche son téléphone, la boucle devient complète, la terre est déconnectée et la conversation téléphonique peut suivre son cours régulier. Tout cela sera mieux compris au moyen des figures 260 et 261 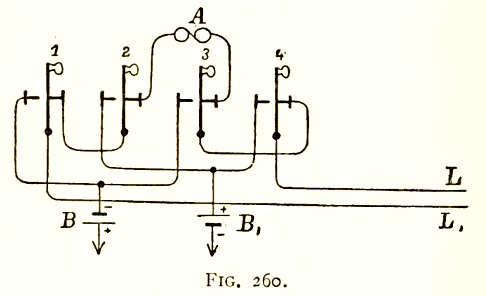  La figure 260 représente les quatre boutons d'appel, i à 4, au poste central : A est l'annonciateur, qui entre en action lorsque l'un des quatre postes appelle, et après qu'un tel appel a été reçu, l'opérateur place son téléphone en circuit ; L et L' sont les deux fils de la boucle ou du circuit métallique ; B et B^ deux batteries d'appel Un courant arrivant par L traverse les boutons d'appel 4, 3, l'annonciateur A, les boutons d'appel 2 et I, et revient par l'orsque l'opérateur du poste central appuie sur le bouton d'appel i, un courant négatif est envoyé dans la ligne L' et L est déconnectée. En appuyant sur le bouton d'appel 2, un courant positif est envoyé dans L'. De la même manière des courants négatifs et positifs sont envoyés dans la ligne L par les boutons d'appel 3 et 4 respectivement. La figure 261 montre la combinaison des quatre postes d'abonnés, I à IV, dans le circuit métallique L l'. Chacune de ces stations est constituée d'un appareil microtéléphonique, signalé par le téléphone F, d'un interrupteur automatique u, d'un bouton-poussoir T, d'un annonciateur S, d'un relais polarisé R, d'une sonnerie d'appel W et d'une batterie locale d. Les quatre stations ont en outre un relais R' et une batterie B en commun. L'appel du poste central parcourt le circuit suivant : En appuyant sur le bouton i un courant négatif traverse L', et traverse d'abord tous les interrupteurs automatiques U et appuie sur les boutons T des quatre postes d'abonnés par le fil d, puis il passe par les relais R des deux Stations I et II, puis, par l'intermédiaire de Q et de l'armature du relais R', il va à la masse. Des relais R des deux postes I et II, celui du poste I répond aux courants négatifs, l'autre aux courants positifs ; à la station I le circuit de la batterie locale b est donc fermé, et la station est appelée. Lorsque l'opérateur de la centrale appuie sur le bouton 2, le courant parcourt exactement le même chemin ; mais il est positif, et actionne par conséquent le relais de la station II, et non l'autre. En appuyant sur les boutons 3 et 4 du poste central, des courants négatifs ou positifs sont envoyés dans la ligne L, traversent les relais des postes des abonnés III et IV et reviennent par Q à la terre. Le courant négatif actionne le relais du poste III, le courant positif celui du poste IV. Lorsqu'un de ces abonnés, disons III, est appelé, il décroche son téléphone et modifie ainsi complètement les connexions. Tout d'abord, un contact est établi entre le pôle positif de la batterie B et la plaque inférieure de l'interrupteur automatique, et par ce contact un courant provenant de la batterie traverse les quatre indicateurs S. Un double objectif est atteint par ce courant : D'une part l'armature R' est attirée, et la mise à la terre du système est interrompue ; par contre tous les annonciateurs qui montraient à l'origine un disque avec l'inscription « libre » (désengagé), exhibent maintenant un disque avec l'inscription « occupe » (engagé). Le bouclage est complet sans terre de chaque côté. Le courant arrivant du poste central par L passe par les quatre relais, les interrupteurs automatiques U, et le fil v des postes T et II , téléphone F du poste III , fil d entre III et IV , bouton T et interrupteur U du poste IV , et renvoie 'Arough l' à la gare centrale Il est impossible d'entendre la conversation, car si un autre abonné, par exemple II, décrochait son téléphone, le circuit serait rompu entre T et U de la station III. Lorsque la conversation est terminée et que le téléphone est de nouveau suspendu, tous reviennent à l'état de repos. Les annonciateurs affichent à nouveau le disque marqué « libre », et Q est de nouveau connecté à la terre. Lorsqu'un des abonnés appuie sur son bouton d'appel T, le courant positif de la batterie B passe par les fils d, et les boutons T et fait passer u dans L', et revient directement par S au pôle négatif de B. Les relais R et les avertisseurs s sont polarisés, mais ils n'ont pas d'électro-aimant ; une bobine très plate se déplaçant entre les pôles d'un aimant très puissant remplace l'électro-aimant. Selon le sens du courant cette bobine est attirée par l'un ou l'autre pôle, et ferme le circuit de la pile b, ou change le disque de l'annonciateur S Cette bobine sans noyau de fer présente de grands avantages par rapport à un électro-aimant polarisé, d'autant qu'il n'y a pas à craindre d'inversion de polarité, ni des courants trop forts, ni des décharges atmosphériques. Le fonctionnement du système Ader est des plus simples : chaque abonné effectue sa communication comme s'il était le seul dans le circuit ; à la gare centrale également, aucune complication ne survient et une conversation secrète est assurée. Par contre, quelques inconvénients doivent être mentionnés : les abonnés restants d'une même ligne ne peuvent pas converser ensemble lorsqu'un abonné converse avec la station centrale ou un autre abonné au-delà de celle-ci ; et les autres abonnés peuvent perturber la conversation en appuyant sur leurs boutons ou en décrochant leur téléphone. Enfin, la communication entre les quatre abonnés nécessite de six à huit fils ; l'application du système doit donc, par souci d'économie, être limitée au cas où les quatre abonnés se trouvent dans le même bâtiment. M. Elsasser a réussi à surmonter le deuxième inconvénient, mais en sacrifiant la simplicité des connexions, et comme cet inconvénient n'a pas une très grande importance pratique, il semble douteux que ces modifications remplacent la disposition originale d'Ader. |