Le répondeur téléphonique
Un répondeur téléphonique est un
serveur vocal interactif dont le but principal est de répondre
de façon automatique à un appel téléphonique
à la place d'un utilisateur. Un répondeur s'enclenche
automatiquement lorsqu'un correspondant est indisponible ou ne souhaite
pas répondre à l'appel entrant.
À la différence des systèmes de messagerie vocale,
qui sont aujourd'hui intégrés dans les services des opérateurs
de réseaux mobiles ou des FAI (voix sur IP) et qui l'ont peu
à peu remplacé, le répondeur est physiquement installé
dans les locaux de l'utilisateur, habituellement branché ou intégré
à un terminal téléphonique.
Bien que les anciens systèmes de messagerie vocale soient devenus
obsolètes et que le service de messagerie vocale par ligne fixe
ne soit plus très utilisé, la messagerie vocale n'a pas
perdu de sa pertinence. La messagerie vocale continue aujourd'hui d'être
utilisée dans des applications populaires telles que Whatsapp,
Facebook, Skype, etc.
La fonction principale d'un répondeur est évidemment de
répondre aux appels téléphoniques. Les répondeurs
les plus simples ne font que répondre et diffuser aux correspondants
un message pré-enregistré (l'annonce). On parle alors
de « répondeur simple ». Les plus évolués
peuvent enregistrer les messages des correspondants après la
diffusion de l'annonce. On parle dans ce cas de « répondeur-enregistreur
».
Avant l'invetion du répondeur, débute l'enregistrement
de la voix.
Le gramophone, sorte de phonographe amélioré créé
en 1887 par Emile Berliner, a été le premier appareil
à rendre possible l’utilisation d’enregistrements sonores
pour communiquer à longue distance. Les sons étaient enregistrés
et écoutés sur des disques faciles à stocker, à
reproduire et à envoyer.
En 1898, le Danois Valdemar Poulsen invente le télégraphone.
Poulsen dépose, en décembre 1898, le brevet d'un système
complet d'enregistrement et de restitution qu'il baptise télégraphone.
Le brevet US Patent
661,619 

L'appareil offre une durée d'enregistrement d'environ 3 minutes.
Cet appareil utilise pour la première fois le principe de l'enregistrement
magnétique, en magnétisant un support se déplaçant
devant une tête d'enregistrement.
Avant l'invention des répondeurs, les messages vocaux sont souvent entegistré sur un disque puis envoyés par la poste.
C'est au début des années 1920,
que les enregistrements réalisés à la maison à
l’aide d’un gramophone se faisaient sur des disques métalliques
pré-rainurés. Les deux méthodes d’enregistrement
possibles sont expliquées sur la pochette en papier : la première,
à droite, nécessite l’utilisation d’un mégaphone
pour hurler directement dans le pavillon du phonographe ; la seconde,
à gauche, se fait à l’aide d’un pavillon externe
Kodisk et d’un stylet d’enregistrement, lequel est fixé
à un gramophone identique à celui présenté
un peu plus haut (Princeton Phono-Post Archive).
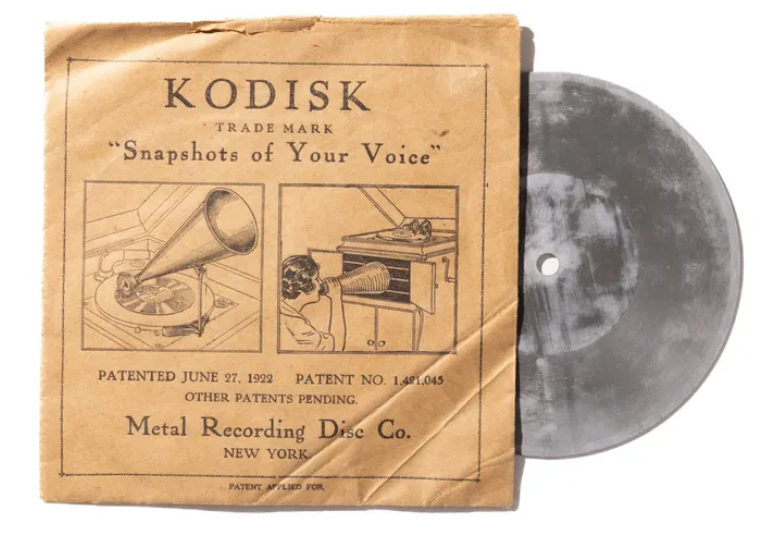
Le Voice-O-Graph
C’est au début des années 1940 que
l’entreprise américaine Mutoscope a sorti
son Voice-O-Graph, une grande cabine en bois semblable à nos
photomatons actuels, qui a largement démocratisé l’envoi
de messages vocaux aux États-Unis. Véritable innovation,
cette cabine d’enregistrement a commencé à faire
son apparition aux quatre coins du pays : on en trouvait dans les parcs
d’attractions, sur les promenades, aux abords des attractions touristiques,
dans les gares et aéroports, dans les bases militaires ainsi
qu’aux évènements de l’USO (United Service Organizations,
une organisation à but lucratif fournissant des services de loisirs
et de soutien moral aux militaires américains). Il y avait également
un Voice-O-Graph au sommet de l’Empire State Building, sur la jetée
de San Francisco et au bord du fleuve Mississippi à La Nouvelle-Orléans.
Une fois dans le Voice-O-Graph et après avoir inséré
quelques pièces, les utilisateurs disposaient de quelques minutes
pour enregistrer leur message. Celui-ci était retranscrit sur
un disque de la taille d’un 45 tours à récupérer
à l’extérieur de la cabine, suffisamment durable
pour être écouté plusieurs fois, mais également
assez léger pour être envoyé par la poste à
un tarif à peine supérieur à celui d’une lettre
classique. Les enveloppes étaient même parfois fournies.
Si le premier enregistrement connu utilisé comme moyen de correspondance
aurait été envoyé par la poste au début
des années 1920, c’est dans les années 1930 et 1940
que la pratique de l’envoi de messages vocaux s’est répandue
dans le monde.
Cette technologie rendait les communications plus personnelles et était
abordable si les clients avaient accès à un appareil ou
une cabine d’enregistrement.


A gauche, Ce « message vocal » de l’ère soviétique
souhaite un « Joyeux anniversaire ! » à son destinataire.
(Princeton Phono-Post Archive)
A droite, Un soldat souhaite un joyeux Noël à sa mère
vivant à Chicago. Sur l’enveloppe, fournie avec le disque,
figure une illustration représentant un soldat inquiet à
l’idée que sa femme soit tombée amoureuse d’un
autre homme pendant son absence (Princeton Phono-Post Archive).
Ce son, en grande partie oublié, est celui d’un des premiers
« messages vocaux » au monde.
Au cours de la première moitié du 20e siècle, ces
lettres audio et autres messages étaient majoritairement enregistrés
dans des cabines sur des disques métalliques ou des vinyles,
avant d’être envoyés par la poste aux quatre coins
du monde.
« Bonjour Maman, Papa et Blanche », salue une voix
douce que l’on distingue parmi les crépitements d’un
vieux vinyle. À l’évidence, le disque a été
écouté à de nombreuses reprises. « J’espère
que tout va bien à la maison. J’enregistre ce message depuis
Dallas, dans ce minuscule endroit rempli de flippers et autres jeux…
»
Le disque est petit, à peine 18 cm de diamètre, et est
daté d’octobre 1954. D’après l’étiquette
verte ternie, c’est « Gene » qui s’adresse à
ses « parents ». Dans son message d’une minute, le
jeune homme raconte qu’il voyage, « voit du pays »
et demande à sa famille de ne pas se faire de souci pour lui.
« Mon voyage devrait se terminer aux alentours de Thanksgiving
», poursuit Gene dans un second enregistrement effectué
à Hot Springs, au Texas, peu de temps après le premier.
« J’espère que vous avez reçu ma lettre
et que j’en recevrai également quelques-unes que vous m’avez
envoyées. Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas
écrit. J’ai vraiment hâte de vous lire. »
 Sur ce cliché pris en 1958, deux femmes prennent la pose avec
un disque dans un Voice-O-Graph.
Sur ce cliché pris en 1958, deux femmes prennent la pose avec
un disque dans un Voice-O-Graph.
À l’époque, les gens enregistraient des « messages
vocaux » à l’aide d’appareils domestiques et
dans des cabines d’enregistrement publiques.
Enregistreur personnel
 Graveur
de disques vinyle / 78T Meissner 9-1065, système P-A et enregistreur
phonographique, était un appareil d’enregistrement à
la maison haut de gamme à destination des amateurs d’audio
qui souhaitaient enregistrer et réécouter des émissions
radio, des spectacles, des discours et bien plus encore (Princeton Phono-Post
Archive).
Graveur
de disques vinyle / 78T Meissner 9-1065, système P-A et enregistreur
phonographique, était un appareil d’enregistrement à
la maison haut de gamme à destination des amateurs d’audio
qui souhaitaient enregistrer et réécouter des émissions
radio, des spectacles, des discours et bien plus encore (Princeton Phono-Post
Archive).
L'invention de l'enregistrement de la voix à
l'aide de phénomènes magnétiques et son application
au téléphone : ce que l'on appelle aujourd'hui le répondeur-enregistreur,
montre, de façon convaincante, que l'American Telephone and Telegraph
refuse de commercialiser pendant plus de vingt ans la machine mise au
point par son laboratoire de recherche, les Bells Labs, au milieu des
années 30.
L'innovation étouffée Analyse de M. Clark
Les premières recherches sur l'enregistrement à l'aide
de phénomènes magnétiques de la voix remontent
à 1878, soit quelques mois après la visite du laboratoire
de Menlo Park par O. Smith, qui lui permet de découvrir le tout
nouveau phonographe de Thomas Edison. Critiquant l'utilisation d'aiguille,
source de bruit, dans le phonographe, Smith a l'idée d'un enregistrement
sans contact (magnétique). Diverses raisons (professionnelles
,finacières) l'éloignent d'une éventuelle réalisation
concrète. D'autres tentatives, sans lien avec les articles de
Smith, voient le jour au début du XXe siècle, dont celle
de Valdemar Poulsen, l'inventeur danois qui commercialise quelques centaines
d'exemplaires de son télégraphone en Europe et aux Etats-Unis
(en commun avec Bell System) avant 1914. Cette ébauche de filière
technique semble se perdre après la Première Guerre mondiale,
malgré quelques recherches en Allemagne et en Angleterre dans
les années 20 et le dépôt de plusieurs brevets.
Ce n'est donc pas dans le cadre d'une compétition industrielle
entre opérateurs-fabricants que les Bell Labs reprennent la question
de l'enregistrement magnétique au début des années
30, mais sous l'effet d'une demande externe.
En effet, plusieurs industriels demandent aux Bell Labs d'évaluer
leurs dispositifs de « répondeur » ou proposent de
vendre au Bell System leurs brevets concernant des équipements
permettant d'enregistrer une conversation téléphonique
(notamment Dictaphone Corporation).
Si A T & T rejette toutes ces propositions, Frank B. Jewett, le
directeur des Bell Labs, décide, en 1929, d'explorer deux pistes.
Un petit budget est confié à Clarence Hickman afin d'étudier
l'enregistrement en général et des fonds plus importants
sont affectés à une recherche concernant l'enregistrement
téléphonique basée sur l'utilisation d'un dispositif
phonographique.
Faute de résultats considérés comme probants, cette
dernière piste est abandonnée en 1935. En revanche les
travaux de Hickman et d'autres ingénieurs des Bell Labs apportent
de nombreuses petites modifications et améliorations à
des prototypes basés sur l'ancien télégraphone.
Il ne s'agit donc pas de l'invention d'un dispositif radicalement nouveau,
mais de la mise au point, par essais et erreurs, de prototypes offrant
un accroissement net de la qualité du son enregistré.
En 1935, Hickman est en mesure de présenter un dispositif capable
de diffuser un message préenregistré et d'enregistrer
la réponse de l'appelant. « En dépit de l'intérêt
des Bell Labs pour l'enregistrement du son, de la production d'un répondeur
qui fonctionne et du désir démontré de commercialiser
les produits de son laboratoire de recherches », le Bell System
différera son offre de répondeur jusqu'au début
des années 50.
Afin de trouver une explication à ce constat, M. Clark explore
diverses hypothèses. Il a été montré que
les dirigeants d'A T & T n'ignoraient pas la demande de tels produits
; - que la qualité des dispositifs obtenus les rendait tout à
fait commercialisables ; - que la supériorité technologique
des Bell Labs sur cette question ne semblait pas contestable. Ecartant
encore d'autres « raisons » possibles (manque à gagner
possible dû à l'introduction d'enregistreurs de qualité),
Clark en vient à ce qui lui paraît la raison majeure :
« The corporate culture of the Bell System. »
Tolérant l'utilisation d'enregistreurs dans ses propres bureaux
à la fin des années 30, la direction d'A T & T en
interdit toutes les autres applications. Deux raisons essentielles semblent
présider à cette attitude :
- de tels dispositifs risquent de changer la nature du téléphone,
de le rendre moins utile et donc de restreindre son usage. Ce qui est
en complète contradiction avec la politique du « service
universel » adoptée depuis plusieurs années ;
- le fait que les conversations puissent être enregistrées
touche à l'intimité de la conversation privée,
et c'est une part importante du trafic qui risque de disparaître
(certains dirigeants d'AT & T estimaient alors que les communications
de nature « illégale » ou « immorale »
représentaient un tiers des appels).
Enfin, conclut Clark, cette attitude doit être également
replacée dans le cadre des débats sur l'interdiction des
« écoutes téléphoniques « qui se développent
aux Etats- Unis dans les années 30. Ainsi, la culture de l'entreprise,
tisée sous la formule de « service
universel », conduit la direction de A T & T à mettre
au placard un dispositif qui sera introduit dans le réseau américain
après la Seconde Guerre mondiale par d'autres entreprises.
sommaire
1935 l'inventeur suisse Willy Müller
inventé le premier répondeur automatique. Ce répondeur
était populaire auprès des juifs orthodoxes à qui
il était interdit de répondre au téléphone
le jour du sabbat. Même si cette invention posait des problèmes
de portabilité en raison de sa hauteur d'un mètre et de
sa structure complexe.
Dans les années 50 le modèle de répondeur développé
par Müller a subi plusieurs modifications.
Albiphone Modèle 1956 

Equipé de 2 têtes, une d'enregistrement et une d'effaçement,
Il sauvegardait sur disque magnétique. .
À peu près à la même époque,
notamment en 1936, une société suisse avait présenté
sa première version du répondeur » Isophone
« , qui était employé parmi les bureaux d’affaires
et les industries des télécommunications. Il n’a
pas duré beaucoup en raison de sa grande taille et de son prix
élevé.
Le 1er juillet 1950, Bell Labs et Western Electric produisent
le premier répondeur téléphonique électronique.
– Invention du répondeur téléphonique par
devon-ritchie First Commercially Successful Answering Machine –
MZTV
Les premiers modèles ne pouvaient être utilisés
qu’à la maison contrairement à la messagerie vocale
contemporaine.
Pendant longtemps, il s'agit d'un appareil indépendant
du téléphone, qui enregistre les messages sur une cassette
audio.
En 1949, Joseph Zimmerman et George W. Danner ont inventé
le secrétaire électronique , qui s'est avéré
être le premier répondeur à succès commercial.
Le Répondeur téléphonique et
combiné Ipsophone, c. 1952
Introduit en 1951, le "Ipsophone" de fabrication suisse
a été le premier répondeur automatique à
enregistrement et réponse introduit au Royaume-Uni et a été
décrit comme "l'appareil téléphonique robot
avec un cerveau".
À cette époque, la plupart des équipements téléphoniques
domestiques au Royaume-Uni étaient fournis par le General Post
Office (GPO), mais l'Ipsophone était un «accessoire approuvé»
fourni par la société Ansafone.
Le GPO a introduit son répondeur en 1958, initialement nommé
« Answering Machine No. 1. "
L'Ipsophone a été fabriqué par Oerlikon Buhrle
& Co et a été introduit au Royaume-Uni par Southern
Instruments Ltd, Londres.
Un répondeur composé d'une unité
de commande avec un combiné et un enregistreur vocal. Trois bobines
de fil, dont une annonce et deux bobines d'enregistrement (5 et 25 minutes).
Interrogation à distance codée (trois chiffres, contrôle
acoustique).
Vendu par Ipsophon-Vertriebs GmbH Zurich.
Les dimensions de l'appareil sont de 710 x 820 x 420 mm.



Dans la revue Mechanix Illustrated Mar, 1950, un article plutôt
amusant a été publié. Il est également intéressant
de noter qu'il était possible d'écouter des messages à
partir de n'importe quel téléphone n'importe où
dans le monde, ainsi que de savoir comment la fonction de «chiffrement»
de l'enregistrement à partir de l'écoute par des personnes
aléatoires a été implémentée dans
cet appareil. Si vous souhaitez garder votre message privé et
vous assurer que personne d'autre ne le reçoit, vous pouvez activer
la touche de code acoustique. Il s'agit d'une combinaison secrète
de chiffres que vous pouvez définir sur votre Ipsophone,
ce qui rend votre message aussi sécurisé que si vous le
mettiez dans un coffre-fort inviolable. Vous ne pouvez l'obtenir vous-même
que si vous vous souvenez du code secret.Voici comment procéder.
Si vous appelez votre Ipsophone après avoir saisi la clé
d'accès, la voix commencera à répéter une
série de chiffres commençant par zéro. Après
chaque numéro, la voix s'arrête pendant quatre secondes.
Pour utiliser votre clé de code pour percer les secrets de votre
cerveau, vous répétez le mot «bonjour» deux
fois après chaque numéro que vous choisissez.
Les premiers répondeurs téléphoniques
stockaient les annonces émises et les messages reçus sur
des disques et des tambours magnétiques.
C'est par exemple le cas sur le modèle Alibicord de la
marque allemande Alois Zettler gmbh.


Ils présentaient l'avantage d'offrir un accès rapide aux
messages enregistrés par le simple déplacement d'un index
sur le tambour.
Ils furent remplacés par la suite par des bandes magnétiques.
Rapidement ces bandes ont été miniaturisées sous
la forme de cassettes audio puis de microcassette.
 Répondeur Panasonic à cassettes.
Répondeur Panasonic à cassettes.
Ces supports avaient l'avantage d'une relative bonne qualité audio et d'un faible coût. Cependant, ils étaient affectés par des problèmes de mauvaise fiabilité et par un long temps d'accès (lié au temps de rembobinage).
L’Ansafone, créé par l’inventeur
Dr. Kazuo Hashimoto pour Phonetel, a été le premier répondeur
vendu aux États-Unis, à partir de 1960.

Selon Casio TAD History (Telephone Answering Devices), Casio
Communications a créé l'industrie des répondeurs
téléphoniques modernes (TAD) en présentant
le premier répondeur commercialement viable.
En 1971, PhoneMate a présenté l'un des premiers
répondeurs commercialement viables, le modèle 400.
L'unité pèse 10 livres, filtre les appels et contient
20 messages sur une bande bobine à bobine. Un écouteur
permet de récupérer des messages privés.
En 1983 Le premier TAD numérique a été
inventé par le Dr Kazuo Hashimoto du Japon au milieu de 1983.
Brevet américain 4,616,110 intitulé Automatic Digital
Telephone Answering.
Le brevet américain n ° 4 371 752 est le brevet pionnier
de ce qui a évolué vers la messagerie vocale, et ce brevet
appartient à Gordon Matthews. Gordon Matthews détenait
plus de trente-trois brevets. Gordon Matthews était le fondateur
de la société VMX à Dallas, au Texas, qui a produit
le premier système commercial de messagerie vocale, il est devenu
le "père de la messagerie vocale".
En 1979, Gordon Matthews a formé sa société,
VMX, de Dallas (Voice Message Express). Il a demandé un brevet
en 1979 pour son invention de messagerie vocale et a vendu le premier
système à 3M. "Quand j'appelle une entreprise,
j'aime parler à un humain" - Gordon Matthews.
Dans les années 1970, les répondeurs téléphoniques
étaient devenus suffisamment petits et abordables pour un usage
domestique et ils ont rapidement gagné en popularité dans
les foyers américains, même si les systèmes de messagerie
vocale commerciaux nouvellement inventés étaient trop
chers pour que quiconque, à l'exception des grandes entreprises,
soit intéressé à les acheter.
Au début des années 1980, vingt heures de capacité
de stockage coûtaient environ 180 000 dollars, mais ce prix était
tombé à 13 000 dollars en 1992.
Les systèmes de messagerie vocale ont révolutionné
le domaine de l'enregistrement vocal numérique. Il s'agissait
d'un appareil avancé qui offrait une meilleure qualité
sonore et davantage de fonctionnalités que les répondeurs
traditionnels, mais en raison de son coût élevé,
le système de messagerie vocale était bien hors de portée
du grand public.
Les règles du jeu ont été uniformisées avec
l'introduction des cartes de traitement de la voix sur PC, développées
pour la première fois en 1982 par le fabricant de produits technologiques
Dialogic Corporation. Les nouvelles cartes PC ont permis aux développeurs
d'ordinateurs d'installer des logiciels de messagerie vocale sur des
ordinateurs de bureau. Cette évolution a considérablement
réduit le coût des systèmes de messagerie vocale
et ils ont rapidement conquis le secteur des communications.
Outre les grandes entreprises, la messagerie vocale est désormais
utilisée par les petites entreprises et les ménages ordinaires.
Il s'agit d'un système d'enregistrement convivial, sécurisé
et multifonctionnel qui offre une grande commodité aux appelants.
Une étude a révélé qu'en 2004, 78 % des Américains disposaient d'une messagerie vocale. À la fin des années 1990, cette dernière a complètement remplacé les répondeurs traditionnels et est devenue le nouveau système de réponse numérique du début du 21e siècle
Au fil du temps, un certain nombre de fonctions complémentaires
ont été intégrées, de façon à
rendre l'utilisation des répondeurs plus agréable.
Interrogation distante : permet au propriétaire du répondeur
d'en prendre le contrôle hors de chez lui, de façon à
pouvoir consulter les messages reçus ou configurer le système.
Le contrôle se fait généralement après avoir
saisi un code secret, et à l'aide du clavier du téléphone
distant sous forme de commandes DTMF.
Filtrage : permet à un utilisateur d'écouter en local
le message en cours de dépôt, pour identifier l'appelant
et éventuellement répondre à l'appel en cours.
Horodatage : permet de connaître la date et l'heure à laquelle
le message a été déposé.
Configurations diverses du système (délai de réponse,
etc.)
sommaire
LE REPONDEUR TELEPHONIQUE : UN EXEMPLE SIGNIFICATIF
DE L'USAGE DU TELEPHONE
Par Laurence BARDIN 1985
En 1979, nous avons réalisé une première
investigation, sur les représentations et les pratiques du téléphone
en France (1), par une enquête qualitative. Soumis aux techniques
d'analyse de contenu, les entretiens nous ont apporté des informations
relatives aux domaines suivants :
- images du téléphone
- motivations d'usage
- spécificité de l'instrument comme médiation de
communication
- concurrence téléphone / courrier
- dimension psychologiques mises en ieu : lien, séparation, écoute,
plaisir, intrusion, protection, évasion protégée,
"bulle" téléphonique ... etc
- les partenaires et les types de communication.
(1) Recherche pour la DGT (SPAF) Rapport "Images et usages du
téléphone", 174 pages , 1979, Compte-rendus dans
LE MONDE Dimanche (30-12-79), Revue Française des Télécommunications
(? 41, oct. 1981)
Par ailleurs, et à l'issue de cette recherche
empirique, il nous avait paru constructif d'élaborer l'hypothèse
d 'un modèle évolutif d'adaptation a la communication
par téléphone . En effet, la grande disparité d'accès
et d'acculturation téléphonique des personnes de notre
échantillon, à ce moment-là, nous faisait supposer
que les individus, ou les groupes sociaux, suivraient une trajectoire
similaire quant à l'intégration du téléphone
dans leur vie quotidienne et leurs pratiques de communication. Courbe
quantitative d'usage, mais aussi, et surtout, qualitative, selon un
cheminement typique que l'on pourrait décrire à l'aide
des termes suivants :
Distance --> rapprochement ---> dépendance ---> saturation
conduites sélectives de maîtrise.
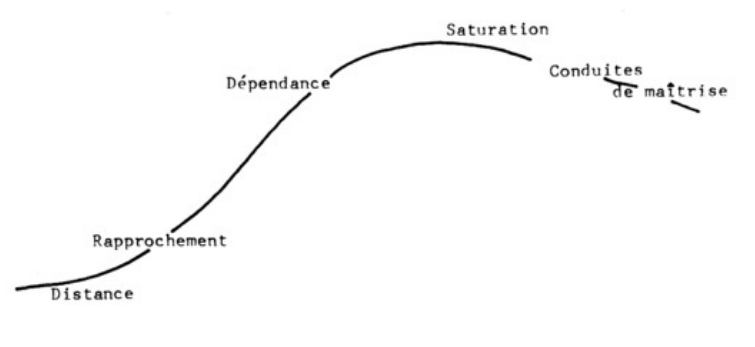
Ainsi, à un moment donné, on pouvait observer - et des
interviews approfondis nous permettaient de le faire pour quelques personnes
- la position précise d'un individu , ou d'un groupe d'individus
en fonction d'indicateurs extérieurs du type :
- usage quantitatif : nombre d'appels, temps des appels, coût
des appels
-proximité spatiale : abonnement ou non, situation d'accès
dans le logement , nombre de prises de raccordement ...
- intégration temporelle : heures d'appels et de réception,
activités interrompues ou menées conjointement...
- registre des partenaires : nombre et diversité des locuteurs
- contenus des communications : extension et diversité des buts
- image de l'instrument téléphonique et position dans
la chaîne des biens et services domestiques
- interpénétration de la communication par téléphone
et des autres moyens. ( face à face, courrier ...)
A l'origine de la courbe, il y a la vieille dame dont le hameau a été récemment doté d'une cabine neuve, et qui pourra ainsi se servir, une fois l'an, du téléphone, pour une urgence, "Pour les deuils" dit-elle, mais, elle croit toujours, que comme pour le télégramme on n'a droit qu'à un nombre limité de mots. A l'autre bout, il y a le parisien, de classe supérieure, de moins de quarante ans, capable de débrancher son téléphone, de différer poliment un appel reçu ou de le renvoyer à un autre lieu, de grouper pour efficacité des appels, mais aussi de consacrer une heure a une conversation, privée ou professionnelle, approfondie. En outre, il est prêt à utiliser des améliorations péritéléphoniques ou un. filtre comme le répondeur téléphonique.
Depuis 1979 (Le téléphone fêtait alors son premier siècle d'existence.) les choses ont déjà beaucoup changé, en raison de la "téléphonisation" accélérée des français ( 7 millions d'abonnés en 1975, 18 millions en 1981, 22 millions aujourd'hui, soit 85 7o des ménages équipés) . Si la précédente était celle de l'accès à l'automobile, la décade actuelle est bien celle de l'apprivoisement du téléphone. Le sociologue de la communication voit à court terme défiler devant ses yeux une adaptation rapide , qui se traduit par une extension et une familiarisation des pratiques téléphoniques, mais aussi par la prise de conscience des contraintes inhérentes à ce type de communication, et donc, par le développement des codes implicites d'usages et pir l'émergence de tactiques de maîtrise.
Le répondeur téléphonique , à
propos duquel nous avons mené une étude en 1984 , présente
un intérêt a plusieurs titres :
- en lui-même, ses usages sociaux étant en France encore
quasi inconnus.
- comme adjuvant sophistiqué d'une pratique téléphonique
correspondant à la phase Mmùre" de notre hypothèse
évolutive, phase de conduite^ sélectives de maîtrise,
- comme instrument de communication privilégié d'une catégorie
de personnes à temps, lieu et activités éclatée,
marqués par une mobilité forte, une interpénétration
privé/ public et une tendance a l'individualisme, caractéristiques
qui ont tendance a se généraliser dans notre société.
Or, chercher à saisir les mécanismes de sociabilité médiatisée d'un instrument tel que le téléphone ou à fortiori le répondeur téléphonique, revient pour le psycho-sociologue de la communication de travailler en situation proche, au moins partiellement, de conditions expérimentales. En effet, le canal se resserre, se simplifie, les limites de l'appareil introduisant des contraintes auxquelles l'individu est oblige de se soumettre. Certaines variables de la communication "naturelle" sont éliminées. Ainsi, avec le téléphone, les caractéristiques techniques spécifiques limitent les cinq sens à la voix seule, et, le nombre d'intervenants (sauf cas particuliers) a deux personnes. Quant au répondeur téléphonique, il supprime la variable réciprocité. D'où l'intérêt, pour une science balbutiante comme celle de la communication interpersonnelle, qui tâtonne à l'heure actuelle dans l'élaboration théorique, de partir de l'observation d'actes empiriques de communication sous contraintes techniques.
Cette enquête sur le répondeur-enregistreur,
de type exploratoire, a été mené sur deux échantillons
appariés de 30 interviews chacun : l'un de possesseurs de répondeurs
téléphoniques (RT), l'autre de non-possesseurs. La technique
d'investigation administrée aux 60 personnes était du
type entretien avec questionnaire guide.
Nous présenterons ici, en fonction des problèmes théoriques
soulevés précédemment, quelques uns des résultats,
II n'y a pas une image du répondeur téléphonique, mais, une diversité d'images fragmentées, en fonction du degré de familiarité avec cet instrument encore rare. Ce sont les plus jeunes, ceux qui ont été en contact avec lui par le travail et/ou ceux dont l'entourage proche a un répondeur téléphonique qui le connaissent le mieux. Si le téléphone existe sur la scène symbolique sociale (il y a tout un imaginaire du téléphone véhiculé par la littérature, le cinéma, la publicité), la mise en scène du RT est pratiquement inexistante. De plus, l'apprentissage de son maniement, comme appelant d'abord, se fait solitairement et au coup par coup.
La fonction la plus évidente du répondeur pour ses possesseurs est de "pallier l'absence". Le répondeur fait office de supertéléphone en ce sens, une sorte de téléphone total permettant de rester en lien constant avec les autres, un fil qui ne serait jamais coupé, un cordon ombilical toujours branché, "Ne rien perdre " de la communication potentielle, même en cas d'absence.
Concernant les possesseurs de RT, il faut tirer plusieurs
conclusions :
- ils sont souvent absents de chez eux ou autre point d'arrivée
de leur téléphone (lieu de travail), ce qui signifie qu'ils
sont très mobiles pour des raisons diverses.
- la communication ou sa potentialité constante apparaît
vitale pour eux. Ils ne peuvent exister, respirer, sans cet oxygène:
"C'est comme un poumon qui rééquilibre ma vie"
dit un interviewé à propos de son répondeur.
- ils n'ont pas de personnes relais -contrairement à leurs semblables
du groupe apparié - pour les remplacer lors de leur absence.
Ils vivent et/ou travaillent plutôt seuls et lorsqu'ils répètent
"pallier l'absence" c'est non seulement de la leur au lieu
d'ancrage mais aussi celle des autres dont ils souffrent.
Pas d'entourage humain mais une machine, rançon pratique de l'individualisme.
Le feu du foyer, entretenu par une vestale ne brûle peut-être
pas chez eux mais en rentrant : "Voir là lampe rouge (du
répondeur) allumée, cela prouve qu'on a pensé à
moi ..."
En d'autres termes , le partage - pour des personnes par ailleurs assez
semblables - se fait nettement entre ceux qui sont facilement "joignable"
et, ceux qu'il est difficile de joindre. Ceux qui n'ont pas besoin d'un
répondeur ont ;
- soit une moindre mobilité ( "Je suis beaucoup à
la maison") ou des références spatiales précises
("Je donne différents numéros de téléphone");
- soit une temporalité de vie quotidienne facilement lisible
par autrui ("On connaît mes heures", "On peut m'
appeler le soir",
"Je donne mon emploi du temps").;
- soit un entourage qui peut faire office de relais ( secrétaire,
gardienne du bébé, conjoint, enfants...).
Par comparaison, le possesseur de RT est un nomade,
solitaire et fuyant. Mais, néanmoins et tout son paradoxe - communicationnel
est là - anxieux de recevoir le moindre message téléphonique
en provenance d'autrui.
Cependant, son désir spécifique du téléphone
("Ne rien perdre") n'existe pas forcément chez ses
semblables même difficiles à joindre. En effet, on peut
être un grand "téléphoneur" ( téléphoner
abondemment, aimer le téléphone ...) mais sans souhaiter
pour cela être relié en permanence ("Si les gens ne
me trouvent pas cela n'a pas d'importance", "Le répondeur
permet d'être joint 24 heures sur 24 mais je n'ai pas envie de
cette image qui dit : je suis là tout le temps pour vous".»
De façon générale, la communication
par téléphone présente des caractéristiques
dont certaines sont intéressantes à rappeler ici :
- Le téléphone court-circuite l'espace et le temps : abolition
soudaine et peremptoire de la distance ; irruption instantanée
dans le temps d'autrui. Je sonne, tu réponds, où que tu
sois, quoi que tu fasses.
- Mais une fois la communication embrayée, chacun est sur le
même pied. Rien de plus égalitaire que le coup de fil :
deux voix , sans décor, chacune pouvant librement choisir de
parler ou se taire.
Or, passé la période d'euphorie consécxitive à
l'accès à cet instrument merveilleux, les usagers les
plus à l'aise, mettent au point, consciemment ou non , des tactiques
d'évitement.
Le répondeur est une réponse ( parmi d'autres),
de nature technique, en vue d'une maîtrise accrue d autrui pour
le bien-être personnel de son possesseur.
En effet, il permet de se détacher physiquement d'un point d'ancrage
obligé. Si l'attente des coups de fil d autrui m'impose de rester
"cloué" près de ma ligne d'arrivée du
téléphone, le RT sera mon serviteur.
Celui-ci rend possible la maîtrise de sa propre temporalité
individuelle en refusant l'interférence du temps de l'autre.
Si je reçois dix -appels dans la journée, dix fois dix
temps différents vont venir croiser, perturber le fil de mon
propre temps. "Coup de fil" dit-on, oui, coup qui coupe le
fil.
Le répondeur téléphonique est une
parade qui met en boîte le temps de l'autre, pour le servir ,
réchauffé, en fonction du désir du sujet.
Par suite, le rapport égalitaire de la communication téléphonique
classique s'évanouit. Confronté a une cassette, sommé
de parler par une voix dont le propriétaire se prétend
absent, l'interlocuteur s'exécute, bafouille, ou raccroche humilié.
Subtile emprise de celui qui ne peut, ou ne veut, établir une
communication avec l'autre, mais ne peut ou ne veut s'en passer. Etre
appelé sans être dérangé : suprême
confort. Le laquais d'antan faisait attendre le visiteurau salon, le
répondeur fait patienter une trace verbale sur une bande magnétique.
L'enregistrement de sa propre voix sur la bande-annonce
de son répondeur flatte le narcissisme .du possesseur : enseigne
de son Moi, moderne emblème qu'il fignole avec un plaisir de
maître.
Par contre appeler et devoir laisser un message sur le répondeur
d'autrui est une experience beaucoup moins agréable. Elle ne
l'est pour personne, semblet-il ("Personne n'aime ça en
fait',' comme le dit un interviewé), même pas pour ceux
qui possèdent eux-mêmes un de ces engins. Confronté
à celui-ci, la première réaction s'avère
spontanément négative, mais "on" fait généralement
un effort pour s'adapter. Apprentissage sur le tas, selon la bonne volonté
de chacun, plus ou moins réussi d'ailleurs aux dires de ceux
qui vont recevoir, avec décalage, les messages enregistrés
(ou non enregistrés !)
Pour certains, l'adaptation est impossible (l'âge joue), pour
d'autres, l'acceptation est limitée à des fonctions précises.
Si l'usage professionnel n'est pas remis en cause , le refus est général
de la part de l'entourage familiale du possesseur de RT. Parents, frères,
soeurs, enfants,., ils "n'aiment pas du tout", "paniquent",
"raccrochent" ...etc. Le possesseur s'en plaint, avec parfois
une certaine mauvaise foi qui permet de supposer que la fonction avouée
(ne perdre aucun appel) masque aussi une fonction moins apparente de
protection. Protection vis-à-vis des communications interpersonnelles
au profit de messages informatifs sans réciprocité immédiate.
Protection de sa sphère d'activités ou de repos.
Le répondeur téléphonique, par
la catégorie de personnes à laquelle il s'adresse, par
le type de communication qu'il permet, a fonctionné dans le cadre
de nos recherches sur la communication par téléphone,
comme un cas "pathologique", ou tout au moins marginal, permettant
de mieux comprendre le fonctionnement du "normal".
Il nous semble qu'à l'heure actuelle d'autres "micro-lieux"
des pratiques téléphoniques pourraient être abordés,
avec un intérêt heuristique équivalent. Citons en
vrac :
- Les communications téléphoniques privées sur
le lieu de travail, ( Ettide en cours ASP "Espaces sociaux Communication"
CNRS- CNET 1985).
- Le poste téléphoniaue dans 1'automobile. Prospective
d'avenir sur l'ancrage dans la mobilité.
- La fantasmatique téléphonique. (Données de pré-enquête
en cours sur le "coup de fil imaginaire" par technique dérivée
du rêve éveillé.) La mise en scène du téléphone
dans le discours social ( ex. littérature, cinéma; publicité).
- Le combiné téléphonique avec amplificateur. Observation
du passage de la communication exclusive (notion de "bulle téléphonique")
à un autre territoire de communication par la présence
de tiers.
- Les standarts téléphoniques. Recherche-action sur l'accueil
en milieu professionnel. Objectif : "théoriser" l'apprentissage
des techniques téléphoniques.
- L'adaptation de 1 'enfant au téléphone. Enquête
sur les conduites téléphoniques, même à un
stade précoce, d'un acteur complètement négligé
par les études.
- L'accès du grand public à l'information par le canal
du téléphone.
Sur le plan de la recherche fondamentale en sciences
de la communication , il nous semhle que les domaines à privilégier
Cce sont en tous cas ceux qui nous intéressent personnellement)
devraient être les suivants :
- Le jeu (manipulation, maîtrise) avec le temps dans le comportement
téléphoníque.
- Les codes et usages (élaboration, ajustement, contexte, métalangage
...etc) et le discours social lié au téléphone.
- Les mécanismes psychologiques de communication qui agissent
derrière les pratiques téléphoniques. Le "bain"
d'affects, de mini données factuelles délivrés
par de nombreux entretiens approfondis, nous permet de supposer des
structures, des typologies latentes, chez les individus ou les groupes
.
"Dis -moi comment tu téléphone je te dirai comment
tu communiques" ou l' inverse.
sommaire