COMMUTATEUR M.D. SINCLAIR
DANE SINCLAIR, l'un des pionniers du téléphone britannique
Il est né à Caithness le 6 juin 1852 et
a rejoint le département télégraphique du North British
Railway en 1872.
En 1875, il fut choisi pour se rendre au Japon en
qualité d'inspecteur des télégraphes pour le gouvernement
japonais.
De retour au pays, après quatre ans passés
au Japon, il fut pendant un certain temps responsable du service télégraphique
du Dundee and Arbroath Joint Railway et, en 1882, il devint ingénieur
à la National Telephone Co. , dans le district de Glasgow. Cette
période de sa carrière fut marquée par un certain
nombre d'inventions liées à la téléphonie.
Lorsque les trois principales compagnies de téléphone
fusionnèrent pour former la nouvelle National Telephone Co., il
présenta aux administrateurs un rapport sur le système.
Son rapport servit de base à une réorganisation complète
et il fut nommé directeur de Londres.
En juin 1892, il devient ingénieur en chef
de la National Telephone Co., poste qu'il occupe jusqu'en 1902.
Il est le premier ingénieur britannique à appliquer un mécanisme
de commutation automatique au service téléphonique public.
Il le fait à Coatbridge, où un standard automatique de sa
propre invention relie un petit nombre d'abonnés à un central
principal éloigné via un circuit à jonction unique.
Un exemplaire de ce standard est conservé au musée de l'Institution.
En 1902, il rompt ses liens avec la National Telephone
Co. à la demande des directeurs de la British Insulated and Helsby
Cables, Ltd. , pour devenir directeur général de cette société.
Il devient plus tard directeur et, finalement, président de la
société, qui connaît une croissance rapide sous sa
direction.
Lors de la création de la Automatic Telephone
Manufacturing Co., Ltd. en 1911, il fut nommé directeur général,
poste qu'il occupa en plus de celui de directeur général
de British Insulated and Helsby Cables, Ltd.
Il a également été administrateur
de l' Associated Telephone and Telegraph Co. , de l' International Automatic
Telephone Co. , de la Midland Electric Corporation for Power Distribution,
Ltd. , d'Enfield Cable Works, Ltd. et de l' Electric Supply Company of
Victoria, Ltd.
C'était un homme d'une grande intégrité
et, malgré ses lourdes responsabilités professionnelles,
il s'intéressait avec bienveillance au bien-être des nombreux
employés qu'il dirigeait. Ses heures de loisir étaient consacrées
à la lecture contemplative, ses goûts étant ceux d'un
étudiant en littérature.
Il rejoint l'institution en tant qu'associé
en 1883, devient membre en 1893 et siège au Conseil de 1896 à
1898.
Les Brevets britanniques 3380 et 5964 ont été
délivrés en 1883 et le brevet 8541 en 1884.
Selon un article lu par Aitken en 1911 et son Manual
of the Telephone , le premier commutateur de Sinclair fut installé
à Glasgow en 1883 et quelques-uns d'entre eux furent utilisés
en Écosse pendant un certain temps.
sommaire
1883 Il est communément admis que le premier standard entièrement
automatique utilisé en Grande-Bretagne a été
breveté par MD Sinclair, alors
ingénieur pour la National Telephone Company à Glasgow.
Bien qu’il soit antérieur aux travaux bien connus de Strowger
en Amérique, il ne s’agit pas d’un développement
aussi significatif.
En effet, l'invention de Sinclair n'était pas un central téléphonique
complet, mais plutôt un commutateur de télécommande.
Aujourd'hui, nous appellerions ce concept un connecteur de ligne ou une
unité de concentrateur à distance.
L'appareil était destiné uniquement aux circuits monofilaires
et était efficace pour une ligne de jonction et cinq lignes
d'abonnés.
Lorsqu'un abonné appelait, son indicateur prenait contact avec
une barre coulissante qui reliait la ligne appelante à la ligne
de jonction menant au central et isolait toutes les autres lignes.
L'appareil de Sinclair présente plusieurs
points communs avec celui de Connolly
& MacTighe : dans ce dernier, une roue
crantée est utilisée à la place de la barre alternative
crantée ; un échappement électromagnétique,
un mouvement d'horlogerie et des relais font également partie de
l'instrument . Il a été exposé à l'Exposition
électrique de Paris de 1881.
Il s'agissait de la première tentative de central téléphonique automatique en Grande-Bretagne. Il a été inventé par Dane Sinclair, ingénieur à la National Telephone Company en Écosse, et a été utilisé dans l'un de leurs centraux installés à Coatbridge, près de Glasgow, en 1886, six ans avant la création du premier central automatique aux États-Unis en 1892. Le central comptait jusqu'à six abonnés et le standard automatique supprimait le besoin d'un opérateur au niveau du central (le central pour connecter les six lignes d'abonnés les unes aux autres). Les connexions au central (vers d'autres réseaux de succursales) nécessitaient toujours un opérateur. Il fonctionnait grâce à des électro-aimants et des mécanismes d'horlogerie

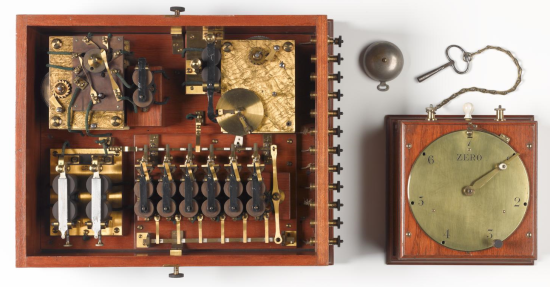
Tableau
de commutation automatique du sélecteur de ligne Sinclair avec
instrument d'envoi pas à pas et sonnerie séparée,
breveté par Dane Sinclair, probablement fabriqué par la
National Telephone Company, britannique, 1886.
Remarqez le cadran à 6 positions.
| Cet instrument, conçu par M. D Sinclair, de
la National Telephone Company,
Glasgow, remplit les mêmes fonctions, à savoir : celles
de commutation de tout abonné sur le central sur lequel il
est placé, en connexion avec tout autre abonné sur le
même instrument, ou avec tout autre abonné sur l'ensemble
du système, de manière similaire. Un émetteur pas à pas est employé dans un central pour transmettre des courants électriques à l'instrument automatique qui est placé dans le central, et chaque impulsion passe à travers les bobines d'un électro-aimant ou relais, qui agit sur l'échappement de un train de roues, et fait ainsi tourner par intermittence une broche sur laquelle est porté un pointeur. Dans un instrument conçu pour fonctionner avec six lignes d'abonnés, comme illustré, le pointeur a sept arrêts dans la révolution, et sept impulsions du central sont nécessaires pour envoyer le pointeur une fois, un arrêt étant effectué à chacun des les sept points En chacun de ces points est monté un ressort avec une borne, qui est reliée à une ligne d'abonné, et l'aiguille de la broche entre en contact avec la borne en face de laquelle elle s'arrête, au fur et à mesure qu'elle est renvoyée par les impulsions du central.   Les figures montrent l'appareil en perspective et en coupe . Les fils de l'instrument de chaque abonné
sont amenés à des indicateurs séparés
A A, qui sont montés en rangée devant une barre crantée
alternative, B. |