La
taxation des conversations téléphoniques
La facturation téléphonique
(téléphone fixe)
1879-1889 Dans le contrat de location d'une
ligne de télégraphe ou de téléphone,
il n'y avait pas de tarification à la durée de conversation.
Les touts premiers centraux téléphoniques manuels
ne comportaient pas d'équipement pour facturer le temps
des conversations, les opératrices étaient seulement
chargées d'établir et d'interrompre les conversations
entre abonnés.
Taxation et facturation sont étroitement liés, la
taxation est le moyen d'imputer un compte individuel ou un compteur
afin d'établir la facturation de l'abonné en fin
de bimestre comprenant son abonnement à la ligne et sa
consammation en durée de conversation.
Pour toute la suite les conversations sont taxées à
la durée et nous le verrons la facturation à la
durée dépendra du type d'abonnement ...
Sommaire
1889 - Abonnements
à Conversation Taxée :
La tarification par période indivisible de 3 minutes
était exprimée en francs (Taxation dite par «
Unité de Conversation »).
Dès la nationalisation le 1er septembre de la Société
Générale du Téléphone par la
loi du 16 juillet 1889 et l'instauration du monopole d'état
sur les conversations téléphoniques, concernant les
télécommunications manuelles, il est institué
un système de taxation des conversations assuré par
les opératrices manuelles, qui établissent
des Tickets de papier où sont notés le nom de
l’abonné demandeur, celui du demandé et son lieu
de résidence, ainsi que la durée de la communication
qu'elle soit locale ou interurbaine.
Les tickets étaient exploités par les services de
facturation afin d'établir la distance entre les deux bureaux
de raccordements des abonnés considérés, et
appliquer l’un des très nombreux tarifs unitaires fixés
en fonction de la distance.
Le prix de chaque conversation est donc fonction de
la distance et de la durée, sachant que la durée minimale
facturée est de 3 minutes, et ce par multiple de 3 minutes
indivisibles, sachant que toute période de 3 minutes commencée
est due entièrement.
Dans ce système à Unités de Conversation, l'intervalle
de taxation est donc toujours fixé (à 3 minutes) ; ce
qui varie est le prix facturé de cet intervalle en fonction
de la distance (La Taxe Unitaire).
Les montants sont donc exprimés directement en francs pour chaque conversation téléphonique comptabilisée.
Régulièrement, en général au moins une à deux fois par an, les tarifs du téléphone sont révisés à la hausse pour rattraper l’inflation et s’adapter également à l’évolution du réseau ainsi qu’à la politique tarifaire qui est décidée par le gouvernement et l’administration des Postes et Télégraphes.
Au commencement : 1 Réseau local = 1 Circonscription
de taxe.
Durant cette période, et jusqu'en 1936, chaque réseau
local (en général constitué d'un seul centre
téléphonique manuel, et parfois par un ou deux petits
centres satellites) constitue à lui seul une circonscription
de taxe locale.
Il y a donc une multitude de petits réseaux locaux téléphoniques
qui se construisent un peu partout, mais seulement où les territoires
sont suffisamment riches et/ou influents pour se l'offrir.
Nota sur l'utilisation de langues étrangères
:
dès le début du téléphone (manuel) en
France, il est strictement interdit d'utiliser une autre langue que
le français au téléphone, entre abonnés.
Une première dérogation à ce principe
n'interviendra qu'en 1917.
Les tarifs d'abonnements sont multiples voire anarchiques
Les décrets et arrêtés s'empilent les uns sur
les autres rendant la gestion très ardue. Surgissent par arrêtés
successifs des tarifs d'abattement sur les communications locales
ou pour certaines destinations entre certains réseaux, ou des
surtaxes sur d'autres, des surtaxes suivant les bureaux et les heures
de demande des appels, des tarifs spécifiques pour les communications
à heures fixes, des tarifs d'abonnements suivant la taille
des réseaux locaux... La situation est tout sauf unifiée,
tout sauf claire.
Elle n'est que le reflet d'un réseau originairement morcelé
et où le clientélisme politique influe trop sur l'administration
qui est encore dépourvue de sa toute puissance régulatrice.
De plus, au départ, les réseaux
locaux portent bien leur dénomination car ils ne sont même
pas interconnectés, les Liaisons Grande Distance sont encore
un rêve à construire. Les liaisons interurbaines, manuelles,
seront elles aussi construites au compte-goutte ville par ville.
Il existe donc jusques au début des années 1930 une
relative anarchie et d'énormes inégalités dans
le déploiement du maillage téléphonique sur le
territoire national.
1896 - Abonnements Forfaitaires Locaux.
Suite au recensement de la population intervenu cette année-ci,
les villes de plus de 80.000 habitants basculent dans l'Abonnement
Forfaitaire Local. Moyennant, dans ces grandes villes, un abonnement
annuel forfaitaire concédé et significativement plus
cher qu'un Abonnement à Conversations Taxées, les abonnés
ne payent pas de taxes supplémentaires lorsqu'ils téléphonent
à d'autres correspondants dans leur réseau local.
À titre de comparaison actuelle, il s'agirait du forfait "tout
compris".
Ce régime propre aux grandes villes sera progressivement éteint
entre 1920 et 1929.
1913 - Arrivée de l'Automatique Urbain.
Lorsque le premier réseau local à Nice, fut automatisé
(commutateur Strowger), il est décidé
que désormais les communications téléphoniques
locales, acheminées par voie entièrement automatique
(donc sans faire appel à la main d'œuvre des opératrices)
dans un même commutateur téléphonique ne seraient
plus taxées par Unité de Conversation à intervalle
régulier, mais désormais par une Taxe Forfaitaire
en francs et ce sans limite de durée (en contrepartie d'un
abonnement annuel).
Elle est comptabilisée automatiquement à
chaque début de conversation (lorsque l'abonné demandé
décroche son téléphone) sur un compteur élécto-mécanique
situé dans les locaux du commutateur téléphonique
automatique de départ.


Rangées de compteurs, un compteur par abonné.
À cette époque, le nombre d'abonnés
au téléphone est très réduit, l'abonnement
étant réservé aux classes les plus favorisées.
Pour pouvoir facturer chaque bimestre, un technicien était
chargé de photographier (par groupe de cent) les compteurs
du central, afin de transmettre les clichés aux services de
facturation.
À cela, il faille préciser qu'aucune
liaison existant entre deux villes ou entre deux centres téléphoniques
n'est encore automatisée (avant 1951).
En résumé, au début du téléphone
automatique, l'acheminement à 100% automatique n'est valable
que pour appeler son voisin de palier, de quartier, de sa ville, de
quelques villages alentours éventuels.
Dès que l'on veut joindre un abonné
situé à plusieurs kilomètres (seulement si la
liaison interurbaine existe déjà, sinon il existe alors
le télégraphe et le courrier postal parfaitement développé),
il est nécessaire de contacter une opératrice manuelle
de l'interurbain, en composant le 11, et de revenir ainsi au
manuel taxé toutes les 3 minutes par Unité de Conversation.
Le numéro de l'opératrice pouvait aussi
être « composé » avec un poste téléphonique
ancien dépourvu de cadran téléphonique en actionnant
le crochet du combiné ou du cornet 2 fois très rapidement,
ou quelques années plus tard, via un bouton poussoir spécial
installé en option sur les corps de postes téléphoniques.
Sommaire
À Voir sur le site de l'INA un reportage de 1972 sur la taxation téléphonique à cette époque
1913 - Abonnements Forfaitaires Locaux - gel
des souscriptions (concerne les petites agglomérations).
Concernant les petites agglomérations, où cohabitent
soit des Abonnements à Conversations Taxées, soit des
Abonnements Forfaitaires Locaux, le décret du 12 juin 1913
supprime les Abonnements Forfaitaires Locaux à la date du 1er
août 1913.
Les anciens abonnés conservent toutefois à titre transitoire
l'Abonnement Forfaitaire Local durant une certaine période.
1917 - Utilisation possible de la langue anglaise.
À partir du 14 septembre 1917, la Circulaire n°953 E. Tp.
autorise, en raison de la guerre, l'utilisation de la langue anglaise
dans les (seules) conversations urbaines (locales). Toutefois,
l'utilisation de la langue anglaise demeure interdite dans les conversations
téléphoniques interurbaines, et l'utilisation de toute
autre langue demeure strictement interdite au téléphone
entre abonnés, dans n'importe quel type de liaison.
A partir des années 1920-25, les nouveaux
centres manuels intérrurbain de Paris étaient dotés
d'un Calculographe.
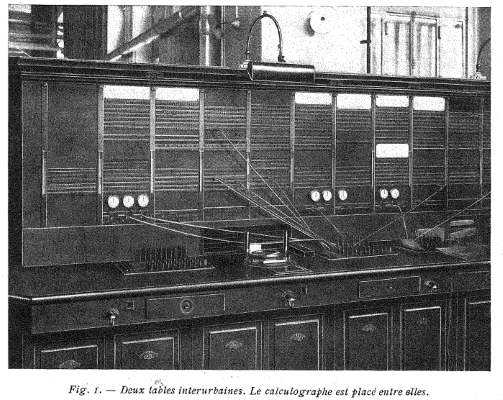
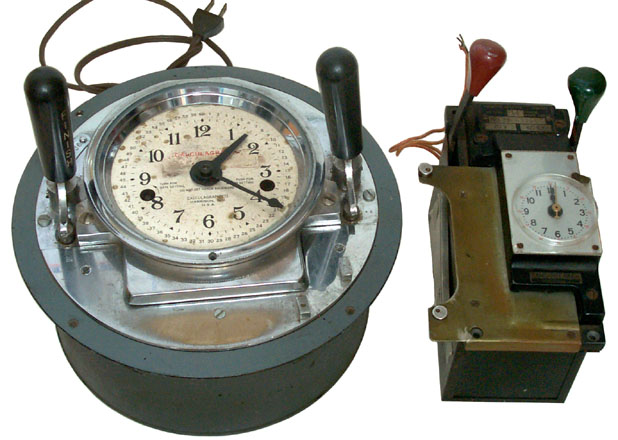

Empreinte 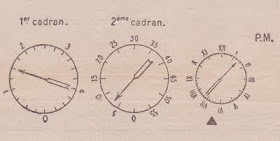
Alors que pour tous les centres manuels, les opératrices produisaient
manuellement un ticket pour chaque communication, sur ces nouveaux
centres le calculographe notait et imprimait sur une fiche,
la durée exacte des conversations (photo
ci dessus).
L'opératrice insère une carte et tamponne l'heure à
laquelle l'appel a commencé, puis la tamponne à nouveau
lorsque l'appel est terminé.
Notez que le modèle 33 est uniquement connecté à
une source d'alimentation, pas aux lignes téléphoniques,
de sorte que la précision de la synchronisation dépendait
de l'opérateur.
Son inventeur en 1904, Henry Abott a pris des brevets pour les compteurs
d'appels téléphoniques qui sont couplés aux lignes
téléphoniques.
L'empreinte était apposée sur des fiches (modèle
1392-19) que les opératrices des PTT, fiches qui étaient
transmises par tube pneumatique à la table de tri pour préparer
les factures. ( Détails
à lire dans la Nature de 1914 )
Ce système restera en service jusqu'à la généralisation
de l'automatique.
1925 Contrôlez le nombre de vos conversations téléphoniques taxées.
|
Le régime des conversations téléphoniques
taxées, a fait immédiatement se poser le problème
du comptage de ces conversations. C’est pour rendre ce contrôle aisé
qu'a été créé le petit compteur
représenté sur cette page. Il suffit d’appuyer,
même légèrement, sur le bouton situé
sur le compteur pour voir s’ajouter, automatiquement, dans
les fenêtres rondes du cadran, une unité au nombre
déjà inscrit, en même temps que retentit
un petit timbre indiquant que l’inscription est faite.
Un peu d’attention au début pour .ne pas oublier
d’appuyer sur le bouton et, bien vite, ce mouvement devient
aussi automatique que celui qui consiste à raccrocher
le récepteur, à la fin d’une conversation. Grâce à ce petit compteur, le contrôle du nombre des conversations est donc mis à la portée de tout abonné. |
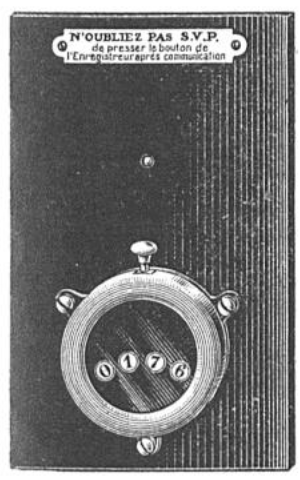 |
1920 - Abonnements Forfaitaires Locaux - gel des
souscriptions (concerne les grandes agglomération).
Concernant les grandes agglomérations où seuls sont
admis jusques à présent les Abonnements Forfaitaires
Locaux, la loi du 29 mars 1920 gèle les souscriptions de nouveaux
Abonnements Forfaitaires Locaux dans les réseaux de cette nature.
Tout nouvel abonné est systématiquement basculé
dans le régime des conversations taxées.
Les anciens abonnés conservent à titre transitoire l'Abonnement
Forfaitaire Local tant qu'ils ne demandent aucune modification ou
avenant dans leur abonnement au service téléphonique.
1924 - Abonnements à Conversations Taxées
- généralisation.
À partir de la publication de la loi du 22 mars 1924 portant
réforme des abonnements au service téléphonique
et du décret d'application du 10 janvier 1925 qui s'ensuit,
le système tarifaire est encore modifié.
En effet, désormais, les Abonnements Forfaitaires Locaux qui
étaient en vigueur depuis 1896 dans les villes plus de 80.000
habitants sont tous appelés à disparaître à
l'échéance de 1928.
Dans les faits, les Abonnements Forfaitaires sont tous commués progressivement jusqu'à leur extinction totale le 1er septembre 1929, via des arrêtés successifs, dans le régime des Abonnements à Conversations Taxées et ce même pour les Abonnements Forfaitaires Locaux déjà souscrits.
Les premières villes de France à basculer
dans le nouveau système :
1er février 1925 : Paris (bureau par bureau),
Reims.
16 février 1925 : Marseille, Nice, Toulon.
1er mars 1925 : Le Havre (à certifier).
31 mars 1925 : Mulhouse.
20 juillet 1925 : Saint-Étienne.
16 octobre 1925 : Nancy.
16 novembre 1925 : Tourcoing.
1er février 1926 : Lille, Roubaix.
1er octobre 1926 : Amiens.
16 novembre 1927 : Nantes.
1er janvier 1928 : Metz.
1er mars 1928 : Toulouse.
1er mai 1928 ; Bordeaux.
1er juillet 1928 : Lyon.
1er septembre 1929 : Rouen.
Sommaire
L'ancien régime téléphonique français
était basé sur le système de l'abonnement forfaitaire,
c'est-à-dire que la, taxe payée par l'abonné
à l'année, à l'Administration des Postes et Télégraphes,
était fixe et ne tenait aucun compte du nombre des conversations
de chaque abonné.
Un tel procédé était, évidemment, illogique
et inéquitable. Aussi, un nouveau système, dit «
à conversations taxées », a-t-il été
adopté dès 1925. L'abonnement donne droit, à
Paris, à 1.500 conversations par an. Les communications supplémentaires
sont, payées au tarif unitaire ordinaire, avec un léger
descompte. La mise en œuvre de cette nouvelle méthode
a nécessité l'établissement de compteurs automatiques
spéciaux et obligé l'administration à tenir,
pour chaque abonné, une comptabilité, particulière.
Jusqu’au 1er janvier 1925, le service téléphonique
parisien était organisé suivant le régime de
l’abonnement forfaitaire. La taxe, fixe par ligne, était
payée par l’abonné quatre fois par an et chacun
était libre d’user à sa guise de la téléphonie.
Ce régime, profondément inéquitable d’ailleurs,
condamné par toutes les administrations ou compagnies téléphoniques
étrangères, imposait à un abonné, utilisant
sa ligne deux ou trois fois par jour, un tarif aussi élevé
qu’à celui qui demandait deux cents conversations. Dans
le premier cas, une téléphoniste eût suffi pour
desservir mille abonnés, alors que, dans le second cas, elle
parvenait à peine à en servir une douzaine.
Le régime forfaitaire avait eu, également, pour conséquence,d?
constituer, sans aucun profit pour l’administration, des «groupes
de clients » non abonnés qui utilisaient les lignes des
fournisseurs : bouchers, boulangers, restaurateurs, crémiers,
marchands de vins, etc., mises bénévolement ou non à
leur disposition. Et le trahc augmentait sans cesse, l’institution
clandestine prenant de plus en plus d’extension.
Enfin, l’Etat n’avait pas tardé à reconnaître
que l’exploitation des lignes à gros tralic était
nettement déficitaire ; sur certaines d’entre elles, la
perte atteignait 3.000 francs par an.
C’est alors que fut décidée la substitution du
régime à conversations taxées au régime
forfaitaire.
La réglementation nouvelle fit couler beaucoup d’encre
dans la presse à l’époque ; mais les esprits se
calmèrent peu à peu et, actuellement, chacun s’y
est soumis.
Cela ne veut nullement dire que tous les abonnés soient
satisfaits et disposés à chanter les louanges du nouveau
régime. L’habitude de se plaindre, qui est le propre du
« génie » français, n’est pas disparue,
et les réclamations, d’ailleurs de moins en moins nombreuses,
en font foi. Un certain nombre sont incontestablement justifiées,
mais nous devons à la vérité de dire que la plupart
s’évanouissent à la lumière des faits.
Une courte incursion dans l’organisation téléphonique
actuelle permettra d’en faire comprendre le mécanisme,
non seulement au point de vue technique, mais aussi et surtout pour
ce qui concerne la comptabilité, car bon nombre d’abonnés
ne sont jamais d’accord, à ce sujet, avec les comptables
administratifs.
Comment fonctionnent les compteurs téléphoniques
Nous avons déjà expliqué, le fonctionnement des
compteurs téléphoniques. Ce sont des électro-aimants
dont l’armature, pourvue d’un cliquet, actionne une roue
à rochet qui commande les disques des chiffres. Ces chiffres
forment les nombres représentant le total des conversations
; ils apparaissent sur l’avant de l’appareil, derrière
une petite fenêtre garnie d’une lame de mica.
Le compteur de chaque abonné ne doit fonctionner que lorsque
le correspondant qu’il a demandé a décroché
son récepteur. C’est là le principe du système
: aucune communication autre que celle qui est demandée ne
doit être enregistrée et, au cours d’une même
conversation, le compteur ne peut fonctionner qu’une seule fois.
Il en est toujours ainsi sauf dans certains cas particuliers que nous
examinerons plus loin.
Voici ce qui se passe, électriquement, quand une communication
demandée est établie normalement :
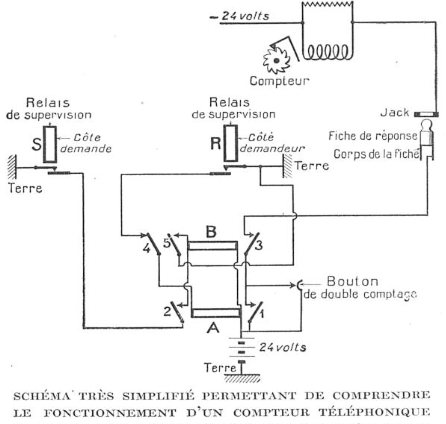
Nous supposerons, pour plus de simplicité, que les deux correspondants
sont reliés à un même bureau.
L’abonné demandeur étant à l’appareil,
la téléphoniste a enfoncé sa fiche de réponse
dans son jack. Aussitôt, par l’intermédiaire du
relais de supervision R, dont le contact est mis sur travail, le circuit
de la batterie de 24 volts se ferme par le relais A, le contact 4
du relais B et la terre.
Le relais A a donc fonctionné et fermé le contact 1,
qui prépare la fermeture du circuit de comptage. En même
temps, le contact 2 du relais A a également préparé
le fonctionnement du relais B.
L’opératrice, après avoir fait le test, enfonce
sa fiche d’appel dans le jack de l’abonné demandé.
Lorsque celui-ci a bouclé la ligne en décrochant son
récepteur, le relais de supervision S fonctionne, le relais
B se trouve intercalé dans le circuit de la batterie par le
contact de travail du relais S et le contact 2 du relais A. Le contact
3 du relais B se ferme pour établir le circuit de comptage.
Le compteur fonctionne.
Immédiatement après, l’alimentation du relais A
est coupée par l’ouverture du contact 4 du relais B qui
vient au collage ; le contact 1 a rompu en même temps le circuit
du compteur, lequel ne peut plus fonctionner. Et le relais B reste
sur collage pendant toute la durée de la conversation par le
contact 5 qui ferme son circuit sur la batterie de 24 volts et la
terre (relais de supervision R). A ce moment, quelles que soient les
manœuvres effectuées par l’abonné demandé,
le compteur restera en dehors du circuit.
Cependant, si le compteur doit fonctionner une deuxième fois,
lorsque l’abonné demandé appartient à l’une
des communes du réseau suburbain, pour lequel les conversations
sont taxées à 0 fr. 60 au lieu de 0 fr. 30, l’opératrice
appuie sur un bouton placé à portée de sa main
et effectue un nouvel envoi de courant dans le compteur, ainsi qu’on
le voit sur notre schéma. Le fait d’appuyer sur le bouton
rétablit le circuit de compteur par une dérivation prise
sur le circuit principal en dehors du contact 1 du relais A.
Il y a lieu de remarquer que, pendant toute la durée de la
conversation, le contact 3 est fermé et il demeurera dans cette
position tant que l’opératrice n’aura pas retiré
sa fiche du jack du demandeur.
Si l’opératrice s’est trompée en donnant un
autre abonné occupé, le compteur enregistrera une unité
puisque le circuit a été bouclé. Dans ce cas,
l’abonné demandeur devra rappeler, en agitant son crochet.
Comme sa fiche n’a pas été retirée du jack,
le compteur est resté bloqué et la nouvelle communication
donnée ne sera pas enregistrée.
Il convient donc de ne jamais raccrocher son appareil si une fausse
communication a été donnée. Dans tous les cas,
si une communication enregistrée n’est pas due, l’opératrice
établit une fiche de détaxe.
Pour éviter les « pas libre » il faut multiplier
le nombre de lignes d’abonnés
Si un correspondant ne répond pas à un appel ou s’il
n’est pas libre, l’administration ne perçoit aucune
taxe de dérangement, bien que, souvent, plusieurs téléphonistes
soient intervenues dans les manœuvres.
Or, de 16 à 18 % des demandes de conversation ne sont pas suivies
d’effet par suite de «pas libre». C’est que,
souvent, un grand nombre de maisons importantes, dont le trafic téléphonique
augmente constamment, ne possèdent pas assez de lignes. Elles
hésitent à en faire installer une ou deux en plus sans
se rendre compte combien ceux qui les appellent sont mécontents
de ne pouvoir obtenir une communication. Bien des fournisseurs ont
perdus des acheteurs éventuels, découragés à
la suite de 10 ou 15 appels infructueux. C'est ce genre d'abonnés
que l'administration s'adresse particulièrement. Chaque abonné
paye un minimum de 450 francs par an représentant la taxe de
1500 conversations. Le surplus est compté au tarif de 0. fr
30 par conversation.
Mais si un abonné possède deux ou plusieurs lignes groupées,
sur l’annuaire, sous une même rubrique, le décompte
des conversations s’effectue en bloc. C’est ainsi que, si
une ligne accuse 1.400 conversations, une autre 1.800 et une troisième
1.200, le total non assujetti à la taxe sera de 4.500, et la
ligne à 1.800 conversations sera exonérée de
la taxe supplémentaire.
Cette réglementation a été longuement étudiée
avant d’être mise en pratique. Il est bien évident
que la répartition du trafic est grandement facilitée
par le groupement des lignes ; c’est pourquoi une faveur lui
est accordée. L’administration cherche uniquement à
soulager le service par la suppression, aussi complète que
possible, des « pas libre », qui constituent l’entrave
la plus préjudiciable à une distribution normale du
trafic.
Toujours dans le même but, il a été décidé
qu’une ligne mixte, c’est-à-dire affectée
aux conversations de départ et d’arrivée, serait
considérée comme ayant atteint la saturation lorsqu’elle
aurait servi à l’échange de 16.000 conversations
dans les deux sens. Mais les lignes réservées exclusivement
aux communications de départ ne sont soumises à aucun
maximum limitatif. Ceci s’explique par le fait que l’on
cherche uniquement à réduire le nombre des « pas
libre », lesquels n’intéressent, que les communications
d’arrivée.
Lorsque la « saturation » d’une ligne est constatée,
on invite l’abonné à prendre une nouvelle ligne.
S’il s’y refuse, la double taxe est appliquée à
toutes les conversations de départ au-dessus de 8.000.
Quant aux lignes exclusivement réservées au service
d’arrivée, qui, surchargées, introduisent les «
pas libre » dans le service, elles font l’objet d’une
surveillance spéciale. Dès que le nombre des «
pas libre » atteint 25 % du trafic total, et si l’abonné,
avisé, se refuse à prendre une autre ligne, on lui supprime
l’escompte.
Actuellement, cette réglementation ne peut être mise
en pratique dans tous les bureaux parce que beaucoup d’entre
eux ne comportent pas les emplacements nécessaires. On préfère
réserver les places disponibles pour donner satisfaction aux
demandes d’abonnements nouveaux..
Comment sont calculées les taxes et les détaxes
Tant que, au cours d’une même année, le compteur
n’a pas enregistré 1.500 conversations (réseau
de Paris seulement), aucune taxe supplémentaire n’est
perçue. Dès que ce chiffre est dépassé,
la taxation fonctionne en déduisant du total des conversations
enregistrées, y compris les 1.500 premières, 5 % de
ce total. Ces 5 % représentent les erreurs que les abonnés
n’auraient pu faire rectifier.
Mais il est d’autres « cas » que les abonnés
ignorent. Beaucoup d’entre eux demandent les « réclamations
» à la suite d’une ou de plusieurs réponses
« pas libre ». La réclamation est comptée
comme conversation si le « pas libre » est confirmé,
tandis qu’elle est détaxée si la ligne était
— ou est devenue — libre dans l’intervalle de temps.
D’autres s’adressent aux « Renseignements »
pour demander un numéro. Si ce numéro figure dans l’annuaire,
la conversation est taxée et on ne la détaxe que si
le numéro n’y figure pas (cas d’un nouvel abonné,
par exemple). Il est, d’ailleurs, des abonnés — peu
nombreux, heureusement — qui n’ouvrent jamais leur annuaire
! Dès qu’ils ont besoin d’un correspondant, ils s’adressent
directement aux « Renseignements », qui le leur font donner,
mais, et on l’admettra sans peine, la conversation est taxée
double.
Insistons sur ce fait qu’une conversation avec les « Renseignements
» est toujours taxée si l’abonné peut, trouver
ce qu’il désire à l’annuaire.
On détaxe encore quand la conversation n’a pu avoir lieu,
par suite de « pas libre » avec un abonné de banlieue
desservi par la batterie locale parce que le compteur fonctionne avant
que l’abonné ait décroché son récepteur.
Toutes ces détaxes s’ajoutent aux 5 %.
Un léger escompte est consenti aux abonnés.
Voyons, maintenant, comment est calculé l'escompte.
A un moment donné de l’année, le compteur marque,
par exemple, 2.854 conversations, dont on déduit les 5 %, soit
143. Il reste donc 2.711 conversations, desquelles nous déduirons
encore 11 détaxes effectuées par les opératrices.
L'abonné aura à payer 2.700—1.500 acquittées
au commencement de l’année, soit 1.200 conversations à
0 fr. 30, qui représentent 3G0 francs.
Sur cette somme, l’administration établit un escompte
de la manière suivante :
Les 100 premières conversations sont dues intégralement
;
Les 100 suivantes, de 100 à 200, bénéficient
d’un escompte de 5 % ; pour celles comprises entre 200 à
300, l’escompte est de 10 % ; et de 20 % pour toutes les conversations
au-dessus de 300.
La comptabilité calculera donc ainsi :
De 100 à 200, 5 francs d’escompte ;
De 200 à 300, 10 francs d’escompte ;
Enfin, 00 francs à 20 % donnent 12 francs d’escompte.
Le total de cette remise s’élèvera donc à
27 francs. De sorte que l’abonné n’aura à
payer que 300 — 27 = 333 francs.
Le relevé du. nombre de conversations ne peut être inexact
Beaucoup d’abonnés tiennent eux-mêmes une comptabilité
fidèle de toutes les conversations qu’ils demandent et,
au moment ou ils reçoivent leur décompte, constatent
parfois une différence sensible à leur désavantage.
En règle générale, les écarts proviennent
de ce fait que, en l’absence du directeur ou du chef de service,
les employés utilisent le téléphone pour leur
propre compte et se gardent bien de porter ces unités à
la suite des autres. De très nombreuses expériences
ont été effectuées pour con-vaincre les abonnés
et, très souvent, le fait a été reconnu exact.
On le voit, le comptage ne peut donner lieu qu’à des erreurs
provenant d’une lecture trop rapide de la photographie, erreurs
qui peuvent être rectifiées lorsque l’abonné
réclame ; elles se rétablissent d’office, d’ailleurs,
au comptage suivant puisque le compteur a inscrit le total sans être
victime de l’erreur.
Ce nouveau système permet d’avantager l’abonné
et de mieux assurer le service
L’administration n’a pas pris que des mesures coercitives
contre les abonnés ; elle leur accorde des faveurs, comme,
par exemple, le calcul de l’escompte sur la totalité des
communications enregistrées par chaque groupe de lignes,afin
d’inciter au groupement. Dans le cas où un abonné
augmente son nombre de lignes mixtes, il est encore exonéré
d'une partie des frais de premier établissement. L’exonération
totale est même accordée pour l’établissement
de toute ligne d’arrivée nouvelle venant en surnombre.
Enfin, bien que l’unité de durée de conversation
soit de trois minutes , il n’en est pas tenu compte. L a plus
grande tolérance est donc accordée. Cependant, si certains
abonnés en usent trop largement et trop souvent, l’opératrice
les avertit qu’une taxe supplémentaire leur sera appliquée.
Cette surtaxe est généralement acceptée. Et si
toutes ces mesures aboutissent au développement du service
téléphonique, elles ont pour effet immédiat de
faciliter l’exécution de ce service en réduisant
le nombre des communications vides, avec les postes occupés
et avec le bureau des réclamations.
1926 - Début des communications interurbaines
manuelles à grande distance.
Par l'arrêté du 9 août 1926 , la première
liaison interurbaine à grande distance (Paris-Strasbourg) est
ouverte à l'exploitation publique. Le nombre de taxes (Unités
de Conversations) imputées est communiqué par l'opératrice
après la fin de l'appel, aux abonnés qui en font la
demande préalable.
Nous pouvons penser que le choix géographique
de cette première mise en service ne relève pas du hasard,
mais bien au contraire de la volonté très claire de
la France de réaffirmer le destin de l'Alsace-Moselle dans
la République Française.
Toutes les communications interurbaines seront
réglementées drastiquement par l'article 5 du décret
du 15 juillet 1926, à savoir :
- abonnement pour communications à heures fixes
(et non pas quand l'abonné le souhaiterait à n'importe
quelle heure)
-abonnement possible de moins d'un mois, ou alors renouvelable de
mois en mois.
-abonnement payable d'avance, tous les mois.
-droit pour l'Administration de limiter les conversations à
6 minutes, pour pouvoir écouler les autres demandes à
satisfaire.
1929 - Ouverture du Service de l'Heure.
Suite à l'instruction n°2444 E. Tp. du 5 décembre
1928 (BO P&T 1928 n°25, page 1054), les abonnés pourront
à l'avenir obtenir l'heure précise à la minute
près arrondie à la minute supérieure, les heures
exprimées en cycle de 0 à 24 heures, et ce pour le coût
d'une communication locale. L'heure sera délivrée par
une opératrice spécialisée qui répondra
: « Il est XX heures YY minutes au cartel du Bureau ».
Le service de l'heure est donc manuel à son ouverture initiale.
1932 - Gratuité des installations téléphoniques.
La loi du 15 juillet 1932 instaure, pour toute la France, la gratuité
des installations et des mises en service des lignes téléphoniques
situées dans un rayon de 4 km autour d'un centre téléphonique.
Cette mesure entraînera un grand afflux de demandes de souscriptions
et participeront ainsi à l’accroissement des listes d'attente.
1932 - Réseau de Paris et zone suburbaine.
L'arrêté du 22 juillet 1932 fusionne le réseau
téléphonique de Paris intra-muros aux réseaux
alentours dits de la zone suburbaine de Paris des communes mitoyennes
pour constituer un réseau local unique dénommé
Réseau de Paris.
Cette unification administrative et tarifaire suit tout simplement
la progression du maillage et de l'interconnexion des centres téléphoniques
automatiques de la zone la plus dense de France : Paris et sa proche
banlieue du département de la Seine. (équivalant aux
départements actuels des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne et Paris).
1936 - Circonscriptions de Taxes téléphoniques
Cantonales.
Elles sont créées par la loi de finance du 31 décembre
1936 concernant la répartition des réseaux locaux en
circonscriptions téléphoniques.
À cette époque, il est donc décidé que
chaque canton départemental constituerait une Circonscription
de Taxe dont son chef-lieu administratif des PTT serait le chef-lieu
de canton (sauf rare exception).
Désormais, il s'agit de la distance entre les chefs-lieux des deux cantons d'une conversation qui sert à facturer en fonction de la distance les conversations téléphoniques et à entamer un processus de rationalisation de la facturation.
Cette réforme réduit le nombre des circonscriptions métropolitaines à environ 4.000 et rationalise l'anarchie précédente qui témoigne du développement des réseaux téléphoniques locaux de la manière erratique des débuts.
Les réseaux locaux (qu'ils soient manuels ou automatiques) sont désormais regroupés dans chaque canton en une Circonscription de Taxe.
Le canton, créé sous la Révolution Française, étant à cette époque très important dans l'esprit collectif des habitants, cette décision a pour avantage d'être claire pour les usagers du téléphone, mais en revanche elle ne tient pas totalement compte des impératifs techniques inhérents à la construction réelle du réseau téléphonique, du relief géographique et des impératifs engendrés etc...
1940 - Conséquences causées par la
ligne de démarcation.
L'organisation votée en 1936 subsistera 20 ans et traversera
la seconde guerre mondiale tant bien que mal du fait que certaines
circonscriptions et 14 départements seront découpés
en deux et les lambeaux seront rattachés aux départements
voisins suite à l'établissement de la ligne de démarcation
séparant la Zone dite Libre de la Zone Occupée et de
la Zone Occupée Interdite).
Les 14 départements concernés sont :
- Ain (01)
- Allier (03)
- Charente (16)
- Cher (18)
- Dordogne (24)
- Gironde (33)
- Indre-et-Loire (37)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Pyrénées (Basses) (64)
- Saône-et-Loire (71)
- Savoie (Haute) (74)
- Vienne (86)
1943 : Exploitation avec comptage multiple semi-automatique
à la durée.
À partir du mois de janvier
1943, début de la disparition progressive des Tickets de taxation
remplis par les opératrices manuelles à la main,
et leur remplacement par un système de compteurs incrémentés
par les opératrices à l'aide de simples boutons comptabilisant
le nombre d'Unités de Conversations écoulées
(par période de 3 minutes) ainsi que leur taux qui est fonction
de la distance de l'abonné demandé.
Cette nouvelle évolution dite exploitation avec comptage multiple
semi-automatique à la durée, permet d'une part d'économiser
du papier, en continuelle pénurie depuis 1940, et d'autre part
de fiabiliser le système de taxation.
- de Janvier 1943 à Janvier 1947, la suppression
des Tickets de taxation commence par les communications entre Paris
et sa grande banlieue de Seine-et-Oise (vers les centres manuels que
l'on joignait par le 11, via le Bureau Régional Interurbain-Poissonnière
à Paris), et se poursuit par la Seine-et-Marne le 17 mai 1947.
- elle se poursuit à partir de 1949 par la totalité
de la province (vers les centres interurbains manuels que l'on joignait
par le 15, via des nouveaux Bureaux Régionaux avec imputation
de taxe semi-automatique.)
Rouen Régional : 7 mai 1949,
Bordeaux Régional : 2 avril 1950,
Nice Régional : 18 juin 1950,
Toulouse Régional : 8 juillet 1950,
Marseille Régional : 1er juin 1951,
Lyon Régional : 23 juin 1951,
Colmar Régional : 5 juillet 1951,
Angers Régional : 1er octobre 1951,
Montpellier Régional : 10 novembre 1951...
- elle se poursuit dès 1949 par les communications entre Paris
et la Province (vers les centres départementaux manuels obtenus
par le 10 suivis de l'indicatif départemental XY souhaité,
via Paris Interurbain Archives).
Cette évolution prépare donc, avant même les débuts de l'automatisation des communications interurbaines en 1951, le système de taxation automatisé à venir.
1945 : Tarification exprimée en Taxes de
Base (Taxation dite par « unité de conversation »).
La Taxe de Base est créée par décret du Gouvernement
Provisoire de la République Française n°45-289 du
22 février 1945.
La définition qui en est donnée
est la suivante : la taxe de base applicable aux conversations téléphoniques
et à certaines opérations du service téléphonique
est la taxe d'une conversation locale demandée à partir
d'un poste d'abonné.
Sa valeur initiale est alors fixée à 2,50 F par ce décret.
La Taxe de Base sert dorénavant à calculer
le prix de toute communication téléphonique, qu’elle
soit manuelle ou automatique.
- Cas du manuel : que la communication soit locale
ou interurbaine, le principe de taxation demeure identique, par Unité
de Conversation fixée à 3 minutes. Désormais
la Taxation est exprimée en nombre de Taxes de Base par unité
de conversation, et ce en fonction de la distance kilométrique
entre les chefs-lieux de canton des correspondants.
-Cas de l'automatique : Toute conversation obtenue par voie automatique
au niveau local est facturée au prix d'une Taxe de Base et
ce sans limite de durée.
Avant cette date, le coût d'une communication
téléphonique était toujours exprimé directement
en francs.
La logique de taxation, même si elle est désormais exprimée
en Taxes de Base, reste identique à ce qu'il se faisait avant
le 22 février 1945, mais permet de revaloriser de manière
comptable proportionnellement et plus aisément les tarifs en
conservant mieux son échelonnement et sa proportionnalité
en fonction de la distance.
1951 : Début de la taxation de l'Interurbain
Automatique.
Avec l'arrivée de l'Automatique Interurbain en commençant
par Paris, les liaisons interurbaines automatiques s'ouvrent au compte-gouttes.
Elles relient d'abord Paris à quelques grandes villes (Paris
- Fontainebleau, Paris - Orléans et Paris - Lyon), dont les
distances les séparant sont connues et permettent de facturer
de manière automatisée sans intervention humaine les
conversations suivant le système traditionnel des Unités
de Conversations de période fixée à 3 minutes,
à un taux qui est fonction de la distance de la ville appelée,
directement incrémentées sur des compteurs.
1956 : Circonscriptions de Taxes téléphoniques
Nouvelles.
Le décret n°56-823 du 14 août 1956 portant définition
de la Circonscription de Taxe téléphonique associé
à l’arrêté du 12 septembre 1956 organisant
la répartition des réseaux en circonscriptions de taxes
téléphoniques créent de nouvelles Circonscriptions
de Taxe téléphoniques se substituant aux anciennes Circonscriptions
Cantonales.
Ainsi à cette date, le chef-lieu de circonscription de taxe n’est désormais plus forcément le chef-lieu de canton, et des réseaux téléphoniques de cantons voisins peuvent être rattachés à un autre canton.
Le chef-lieu de circonscription téléphonique est désormais choisi par l’administration des PTT en fonction de la construction et de l’état réel du réseau téléphonique.
Est à l’origine de cette rationalisation Eugène Thomas, résistant, et déporté, reconnu de tous comme étant un Secrétaire d’État des Postes Télégraphes Téléphones si dynamique qu’il reste souvent en fonction dans les gouvernements de la IVème République même assez divergents de sa coloration politique.
Désormais, la France Métropolitaine est divisée en 478 nouvelles Circonscriptions de Taxes téléphoniques.
Du point de vue technique, dans les années 60, le coût d'une communication était une fonction quasi linéaire de la distance : c'est pourquoi on comptait en France 11 paliers tarifaires qui s'échelonnaient jusqu'à 500 km.
Sommaire
La Relève Bimestrielle de la Taxation des Abonnés.
Tous les deux mois, chaque Compteur de Taxes d'abonné
est donc relevé, au moyen d'appareils photographiques spéciaux,
couplés avec un masque métallique qui délimite
bien les compteurs à photographier à chaque cliché.
Volumineux dans les années 1920, ils deviendront plus légers
et maniables jusqu'à la 1991, année de suppression totale
de la méthode de taxation au compteur physique.
Comme pour le tout premier commutateur Strowger de 1913, les baies
de compteurs de tous les commutateurs éléctro mécaniques
étaient ordonnées de la même façon (une
centaine par cliché).
Ce système est caractérisé par
l'Administration des PTT comme étant rapide et sûr, en
raison d'un double contrôle comptable par comparaison des photographies
avec les relevés du bimestre précédent.
La garantie quasi totale d'exactitude des chiffres relevés
est avancée par l'Administration des PTT.
La photographie au service du relevé des
compteurs
Naguère encore, le relevé des compteurs était
effectué par deux agents, l’un grimpé sur une échelle
en face du bâti de ces compteurs, lisant les nombres, l’autre,
en bas, les inscrivant sur une feuille volante.
Ce système présentait plusieurs lacunes. Le premier
agent pouvait commettre une erreur de lecture et le second mal comprendre
un nombre ou se tromper encore dans sa transcription. Ces erreurs
étaient difficilement réparables,
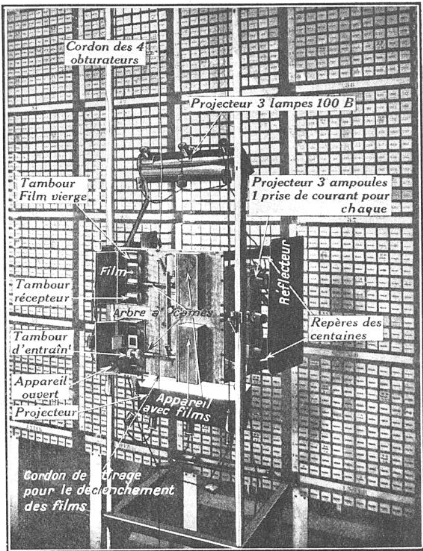 A cette
méthode a été substitué un procédé
photographique qui ne manque pas d’ingéniosité.
A cette
méthode a été substitué un procédé
photographique qui ne manque pas d’ingéniosité.
L’appareil photographique employé a été
construit spécialement dans ce but. Il est installé
sur un châssis susceptible de parcourir toute la longueur du
bâti des compteurs, comme une échelle mobile dans une
bibliothèque et peut, monter et descendre sur les deux longerons
verticaux du châssis en s’y fixant à trois hauteurs
différentes. Il prend ainsi, successivement, la photographie
de 100 compteurs (10 x 10) en une seule opération, que l’on
répète jusqu’à ce que tous aient été
photographiés.
Quatre projecteurs, aux lampes électriques très puissantes,
éclairent les compteurs, mais dans des conditions telles qu’aucune
réllexion de leur lumière ne puisse se produire sur
les lames de mica qui en ferment les fenêtres.
Lorsque tous les compteurs ont été ainsi photographiés,
on développe les clichés et on en tire des agrandissements
qui facilitent la lecture. Les chiffres sont reportés sur le
compte de chaque abonné.
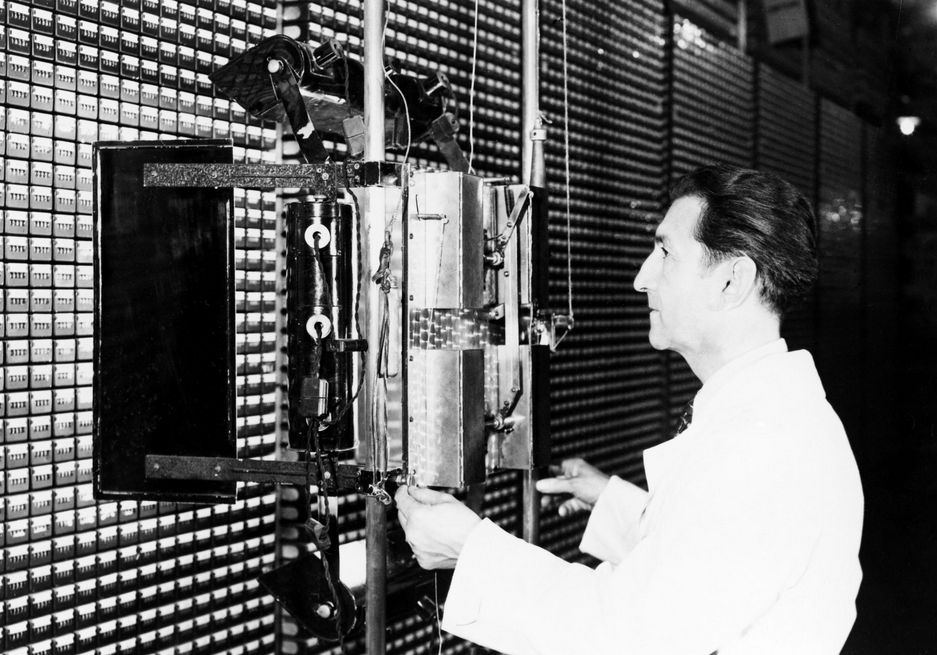
Ces appareils utilisés dès l'origine de la mise en service
des Commutateurs ROTARY 7A1 en Région Parisienne sont très
volumineux, et pourvus de 4 rampes d'éclairage avec un total
de 12 ampoules.
Dispositif léger
avec un appareil photo Foca Poste.


Photographie des compteurs sur un commutateur Rotary
un peu plus tardif que le Strowger
Ce modèle FOCA plus compact que le précédent,
permet de photographier 25 Compteurs de Taxes à chaque cliché,
avec un film de 40 poses.
L'éclairage, une seule grosse ampoule, est situé à
droite, intégré dans l'appareil.
Agrandir
pour lire en détail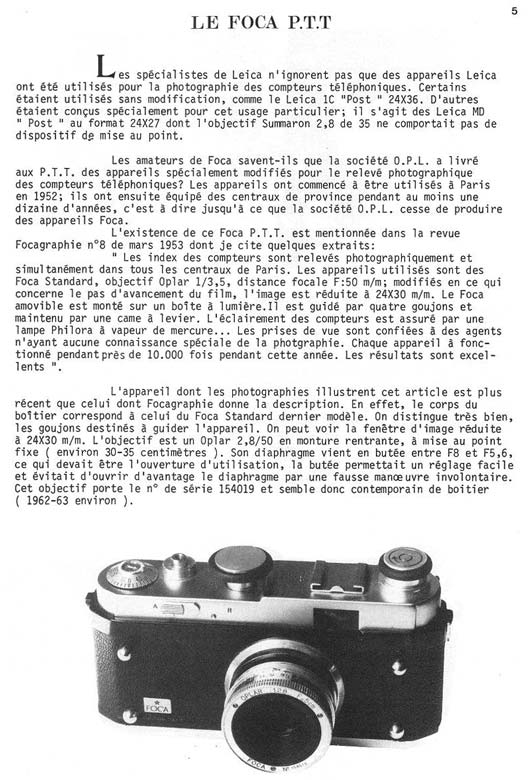 ,
, 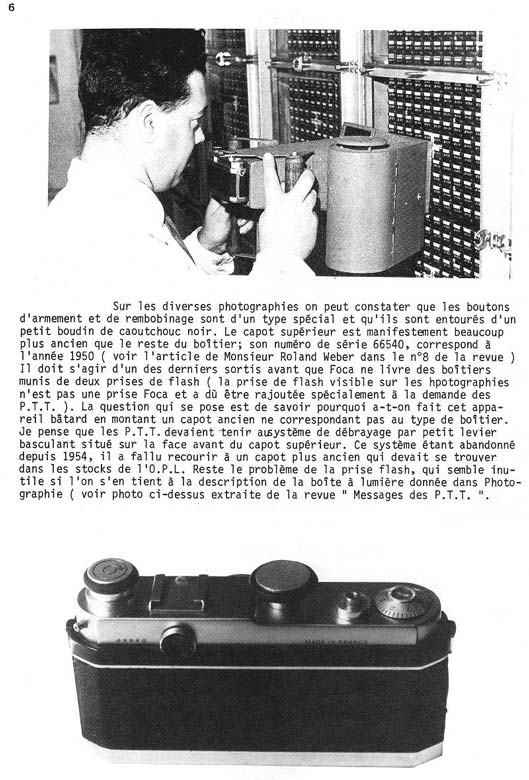 et
et 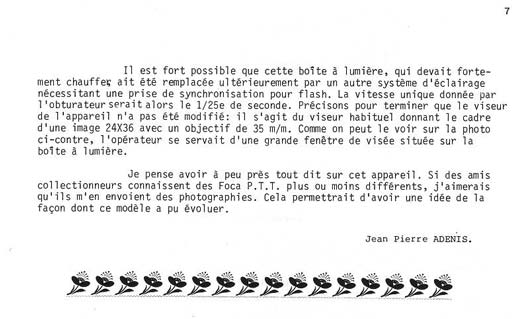
Les appareils de type Poste, contrairement à
leurs homoloques militaires, font partie d'une catégorie bien
particulière d'appareils. Ces modèles ayant pour rôle
le relevé des compteurs téléphoniques, leurs
caractéristiques sont adaptées à leur usage:
Obturateur monovitesse au 1/25 ème de seconde, fenêtre
d'exposition au format 24x30, dispositif d'avance du film et compteur
de vue gradué jusqu'à 42 adaptés au format, tétons
de fixation sur une boîte à lumière et boutons
d'armement et de rembobinage sur dimensionnés. Les séries
construites à base de boîtiers Standard conserveront
leur levier de débrayage et les objectifs sont généralement
à mise au point et diaphragme bloqués ( à f:9
ou f:6.3 sur les Oplar 3.5/5cm et à f:8 sur les Oplar et Oplex
2.8/5cm). Le tirage des objectifs est augmenté par allongement
du fût à la construction de l'objectif ou par ajout d'une
bague d'épaisseur variable quelquefois fixée par un
pied (sorte de petite goupille de 0.7mm de diamètre).
On peut distinguer facilement deux variantes principales selon le
type de châssis: PF1Bis chromé et Standard laqué
noir. Ensuite, sur les châssis Standard, on retrouve au début
des appareils avec capot de PF1Bis portant une numérotation
de PF1Bis puis des appareils avec capot de PF1Bis portant un numéro
de PF1Bis plus une griffe numérotée de Standard et enfin
des capots toujours du modèle PF1Bis mais avec seulement un
numéro de Standard sur la griffe. Toutes les autres caractéristiques
(type de synchronisation flash, rehausse de bouton, modèle
d'objectif...) sont très variables et se retrouvent sur tous
les modèles.
Les appareils Foca Poste n'étaient qu'un des éléments
d'un système complet pour effectuer le relevé puis la
facturation des consommations de téléphone. Ces systèmes
de relevé ont évolué avec les modèles
de standards téléphoniques et le système Lesca
est le nom le plus connu à l'instart des ensembles Alos utilisés
par exemple avec des appareils Alpa 11A.
Les différents types de centraux téléphoniques
et appareils d'éclairage:
(informations et photographies: Mr M Lainé, collectionneur)
Tout d'abord, les différences entre les matériels de
prise de vue s'expliquent par la diversité des types de centraux
téléphoniques. L'aspect général sous forme
de barres de compteurs présentaient des particularités.
Les autocommutateurs utilisés par l'administration des Postes
et Télécommunications pouvaient être les modèles
suivants: ROTARY (1940 à 1975), SRCT pour "Service des
Recherches et du Contrôle Technique des télécommunications"
(1950 à 1961), CROSSBAR (CP400 de 1956 à 1985) ou par
la suite Pentaconta. Sur les suivant, les appareils Foca ne sont plus
utilisés.
Le premier modèle de système d'éclairage est
à lumière continue fournie par deux lampes de 220V/250W.
Avec ce support, le boîtier photographique n'a donc pas besoin
de prise de synchronisation. Le dispositif se présente donc
sous forme d'un châssis pyramidal avec à son sommet une
platine de fixation du Foca par ses quatre tètons et à
sa base deux gros logements ventilés pour les lampes. Une poignée
permet la préhension du dispositif.
Le premier modèle de système d'éclairage est
à lumière continue fournie par deux lampes de 220V/250W.
Avec ce support, le boîtier photographique n'a donc pas besoin
de prise de synchronisation. Le dispositif se présente donc
sous forme d'un châssis pyramidal avec à son sommet une
platine de fixation du Foca par ses quatre tètons et à
sa base deux gros logements ventilés pour les lampes. Une poignée
permet la préhension du dispositif.
 Les types suivants
sont connus sous le nom de systèmes Lesca du nom de Georges
Lesca, Technicien Matériels Photographiques, ayant son atelier
21 rue des Bahutiers à Bordeaux. Les systèmes Lesca
sont composés de flashs annulaires contenus dans une boîte
à lumière qui prend place sur un châssis pyramidal
fermé ou ouvert sur une face. Un des deux dispositifs présentés
comprend en plus un accessoire destiné sans doute à
un type donné de standard téléphonique. Différentes
bagues allonge sont fournies par G Lesca suivant le type de cône.
Celle fournie avec l'appareil faisait 6.8mm et une bague supplémentaire
de 1.4mm devait être ajoutée pour l'utilisation sur un
cône SRCT. Un filtre gris polarisant marqué "polarex
50" était aussi fourni. Ce filtre portait des index de
réglage sur sa monture. Il était quelquefois collé
sur la boîte à lumière ou monté avec un
repère de réglage. On peut penser qu'un tel filtre trouvait
son utilité dans l'élimination des reflets parasites
sur les fenêtres des compteurs ou pour modifier la colorimétrie
et rendre plus visible les chiffres des compteurs.
Les types suivants
sont connus sous le nom de systèmes Lesca du nom de Georges
Lesca, Technicien Matériels Photographiques, ayant son atelier
21 rue des Bahutiers à Bordeaux. Les systèmes Lesca
sont composés de flashs annulaires contenus dans une boîte
à lumière qui prend place sur un châssis pyramidal
fermé ou ouvert sur une face. Un des deux dispositifs présentés
comprend en plus un accessoire destiné sans doute à
un type donné de standard téléphonique. Différentes
bagues allonge sont fournies par G Lesca suivant le type de cône.
Celle fournie avec l'appareil faisait 6.8mm et une bague supplémentaire
de 1.4mm devait être ajoutée pour l'utilisation sur un
cône SRCT. Un filtre gris polarisant marqué "polarex
50" était aussi fourni. Ce filtre portait des index de
réglage sur sa monture. Il était quelquefois collé
sur la boîte à lumière ou monté avec un
repère de réglage. On peut penser qu'un tel filtre trouvait
son utilité dans l'élimination des reflets parasites
sur les fenêtres des compteurs ou pour modifier la colorimétrie
et rendre plus visible les chiffres des compteurs.

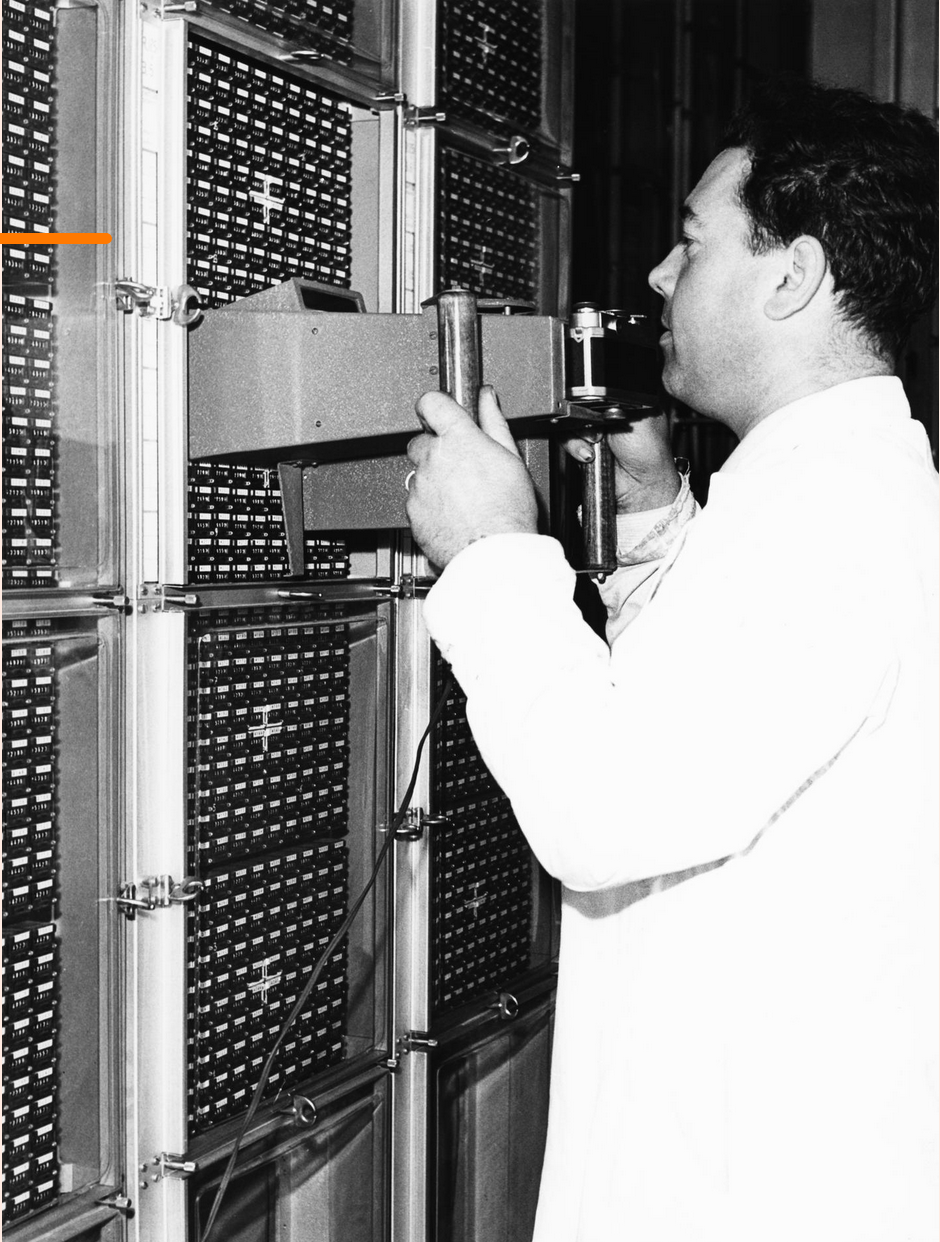 Relevé
des compteurs ROTARY 7B1 de la Région Parisienne.
Relevé
des compteurs ROTARY 7B1 de la Région Parisienne.


Photographie des compteurs sur un
commutateur pentaconta et d'un commutateur Cp400
Cette nouvelle méthode réservée aux communications obtenues par voie automatique, est instituée par les décrets et entre en vigueur le 1er septembre 1960. Le déploiement de ce nouveau système de taxation sera progressif à partir de 1962.
Elle est l'inverse de ce qu'il s'est toujours fait jusqu'à lors. Désormais, pour les communications automatiques, la logique de taxation est complètement modifiée.
Dorénavant, même si les prix des communications demeurent basés en partie sur la distance entre chefs-lieux, dans ce nouveau système, il s’agit désormais de l'intervalle de taxation qui varie en fonction de la distance des abonnés, et désormais le prix facturé à chaque intervalle demeure identique.
Chaque intervalle est facturé au prix fixe d'une Taxe de Base ; les intervalles de temps exprimés en secondes entre deux taxes de base sont d'autant plus courts que la distance entre les deux abonnés est grande.
Les communications locales et de circonscription obtenues par la voie entièrement automatique sont facturées une Taxe de Base en début de conversation, sans limite de durée.
De plus, pour la première fois apparaissent, uniquement pour la voie automatique, les tarifs de nuit à prix réduit.
1962 : Début de la Taxation par impulsion
périodique.
Le 15 août 1962, Nancy est la première
ville de France à basculer dans ce nouveau mode de taxation
périodique par ses deux commutateurs L43.
Le commutateur CP400 de Haguenau, mis en service le 18 août
1962, suit ce même jour. Il est le premier commutateur à
l'état natif fonctionnant en Taxation par impulsion périodique.
Paris commence progressivement sa conversion le 16 octobre 1962, avec
le premier central téléphonique Ségur (commutateurs
ROTARY 7A1 Ségur, Suffren et ROTARY 7B1 Fontenoy).
Le même jour, la ville de Nevers suit, avec son commutateur
L43.
1970 : Généralisation de la Taxation
par impulsion périodique.
Suite à la Décision du 28 décembre 1970 du Ministre
des Postes et Télécommunications, la taxation par impulsion
périodique est généralisée à l'ensemble
du territoire français, en ce qui concerne les communications
établies par voie entièrement automatique (ou semi-automatique
de départ).
La facturation en France
Le CRIT Centre Régional de Comptabilité, renommé
CFRT Centre de Facturation et de Recouvrement
des Télécommunications
est le centre régional où sont préparées
les futures factures.
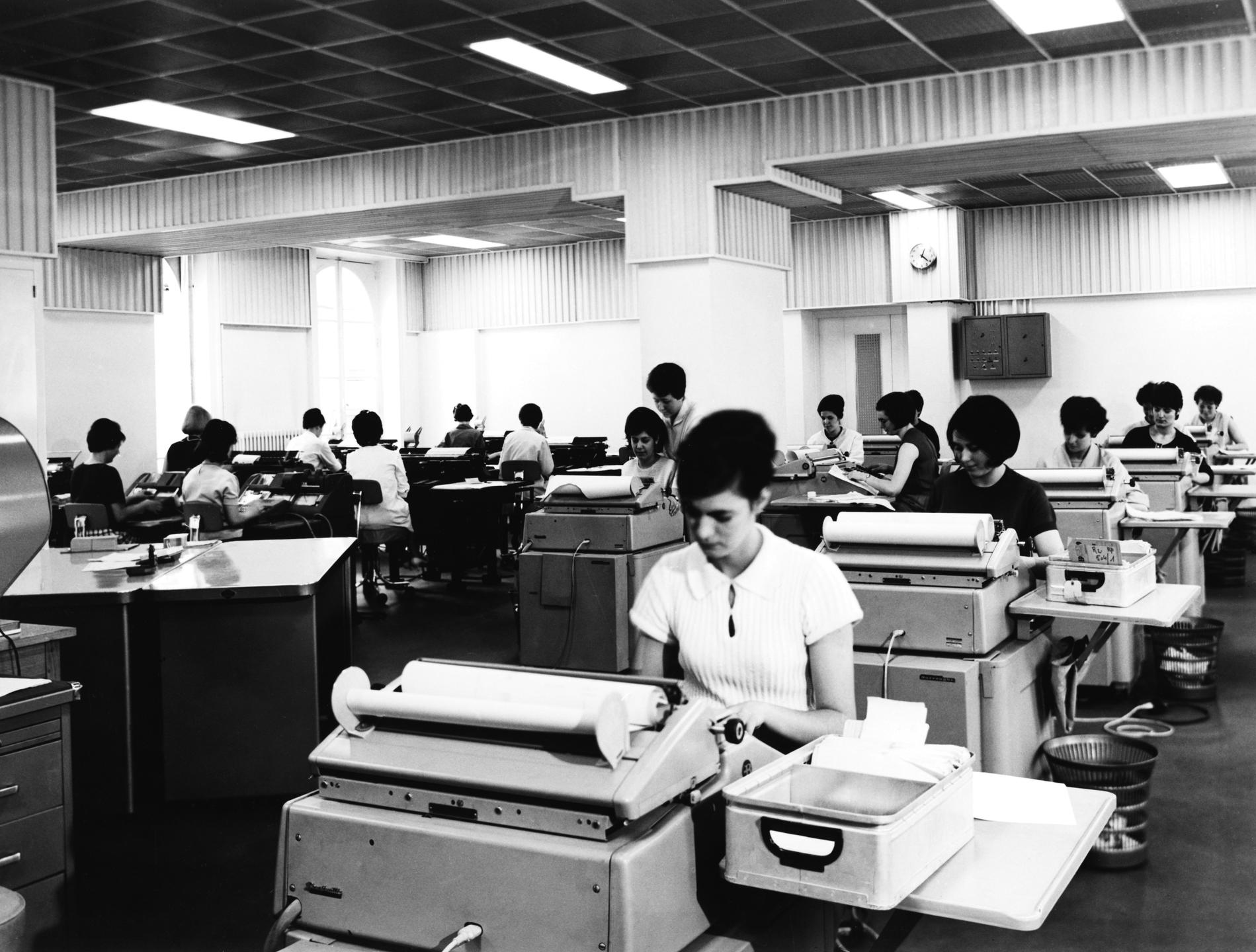 Salle du Centre Régional de Comptabilité
de Paris, 20 rue de Navarin
Salle du Centre Régional de Comptabilité
de Paris, 20 rue de Navarin
À partir des tickets et des photographies de compteurs de taxe,
les opératrices transfèrent manuellement compteur
par compteur, les données de facturation. Puis ces données
sont transférées à l'ordinateur régional
qui traitera la facturation de chaque abonné.
 Calculateur IBM (série 1400) du Centre Régional de Comptabilité
de Paris, avec des mémoires vives de tores magnétiques.
Calculateur IBM (série 1400) du Centre Régional de Comptabilité
de Paris, avec des mémoires vives de tores magnétiques.
Un CFRT spécifique chargé de centraliser
les données de taxation provenant de tous les Commutateurs
Internationaux Automatiques de France Métropolitaine.
Le CFRT International retransmet ensuite ces données mises
en forme à chaque CFRT dont dépend chaque abonné
.
La généralisation de la taxation par impulsion périodique aura mis dix années.
1970 Taxation Électronique Centralisée
:
Le dispositif à Taxation Électronique
Centralisée est mis en service en France à Toulouse,
associé au Commutateur de type PENTACONTA 1040 (Toulouse Jaurès
1 (TL507)) - mis en service le 23 juin 1970, hors service le 7 octobre
1986.
Une maquette de Taxation Électronique Centralisée
avait été mise en service au CNET le 15 juillet 1964.
Une expérimentation en service réel en France avait
déjà été engagée dès 1964
en Région Parisienne : le Commutateur CP400 en service à
Poissy en est alors le premier équipé (Poissy A1 - WD06)
à titre expérimental dès sa mise en service.
 En photo le dispositif
dans le Commutateur CP400 à Poissy.
En photo le dispositif
dans le Commutateur CP400 à Poissy.
Ainsi progressivement, les nouveaux commutateurs en seront-ils équipés,
ainsi que les commutateurs réputés pas trop anciens
et devant servir encore de nombreuses années ; les baies de
Compteurs de Taxes électromécaniques ne seront progressivement
plus utilisées et se verront désinvesties.
Nota sur l’abus consécutif de communications
locales à taxation sans limite de durée par certains
usagers peu scrupuleux.
À la décharge de l’Administration
des Télécommunications, il faut préciser qu’hélas,
il existait un nombre certain de profiteurs qui abusaient du système
de taxation des communications locales sans limite de durée.
En effet, puisque dans ce type d’appels téléphoniques
la Taxe de Base était payée en début de conversation,
et qu’ensuite la communication n’était plus jamais
taxée et ce quelle que soit sa durée, des petits malins
faisaient en sorte de téléphoner dès le matin
à leur arrivée par exemple sur leur lieu de travail
à leur conjointe, maîtresse, amant, enfants, grands-parents,
ami(e), etc. et de maintenir la conversation pendant toute la journée
et jusqu’au soir !
Non seulement l’abus contraire à toute
saine morale était caractérisé, mais il était
réglementairement impossible à facturer ou à
sanctionner.
Le pire est que le cumul de ce type de comportements égoïstes
encombrait gravement les ressources disponibles du réseau téléphonique
en bloquant pendant des durées interminables des mailles dans
les commutateurs et des liaisons urbaines locales qui de ce fait se
retrouvaient monopolisées par une minorité d’égoïstes
au détriment de la majorité des abonnés qui se
retrouvaient empêchés de communiquer…
L’administration, grâce à l’électronisation et à l’informatisation progressive du Réseau Téléphonique Commuté et spécialement des commutateurs téléphoniques locaux, a fini par découvrir le pot-aux-roses grâce à l’étude statistique des bandes magnétiques de taxation, et a finalement mis fin à ces abus en supprimant la tarification sans limite de durée, non sans tergiverser, en 1981, 1984 puis 1985.
1981 : Fin de la taxation forfaitaire sans limite
de durée des communications locales obtenues par un téléphone
public.
Le décret n°81-1052 du 27 novembre 1981 met fin, en tant
que ceci concerne les téléphones publics à la
facturation des communications locales (comprises dans une même
Circonscription de Taxe) au coût d'1 Taxe de Base sans limite
de Durée.
Désormais, toute conversation locale passée depuis une cabine téléphonique publique est facturée une Taxe de Base toute les 3 minutes (ce qui entraîne par la même occasion la suppression des taxiphones urbains de modèle ancien, qui ne peuvent encaisser qu'un seul jeton ou qu'une seule somme de monnaie en début de conversation. Ils sont remplacés par des taxiphones de type interurbain).
1983 : début de la facturation détaillée.
Après autorisation gouvernementale par arrêté
du 9 février 1983, le service de Facturation Détaillée
(FADET) est ouvert progressivement à l'exploitation
à partir du 5 décembre 1983. Les premiers commutateurs
à pouvoir délivrer ce service en France seront les commutateurs
de type Métaconta - 11F. Progressivement, la Facturation Détaillée,
alors payante, sera généralisée à l'ensemble
des commutateurs semi-électroniques et électroniques
temporels.
Nota : les quatre derniers chiffres des
numéros de téléphones (MCDU) sont alors systématiquement
occultés (pour la paix des ménages...)
Le décret n°83-258 du 30 mars 1983 paraît et double le prix des communications locales passées à partir d'un téléphone public. Mais en compensation, toute conversation locale passée depuis une cabine téléphonique publique est facturée une Taxe de Base toutes les 6 minutes.
1984 : Fin de la taxation forfaitaire sans limite
de durée des communications locales obtenues par un téléphone
ordinaire, pendant le plein tarif.
Le décret n°84-313 du 26 avril 1984 met fin à partir
du 15 février 1985 à la facturation des communications
locales (comprises dans une même Circonscription de Taxe) en
plein tarif au coût d'une Taxe de Base sans limite de Durée.
Désormais, les communications locales sont facturées
une Taxe de Base toutes les 20 minutes en plein tarif, mais demeurent
taxées d'une seule Taxe de Base en début de conversation
sans limite de durée durant les périodes de tarifs réduits.
1985 : Fin de la taxation forfaitaire sans limite
de durée des communications locales obtenues par un téléphone
ordinaire.
Le décret n°85-911 du 31 juillet 1985 supprime la taxation
sans limite de durée des conversations locales pour tous les
tarifs à partir du 1er décembre 1985.
Désormais, ces communications locales sont facturées
une Taxe de Base toutes les 10 minutes en plein tarif, et les tarifs
réduits ne permettent plus de bénéficier de la
tarification d'une Taxe de Base forfaitaire sans limite de durée.
Années 1980 Les contestations , analyse
de Christian VIGOUROUX
Qui ne connaît autour de lui, quelque abonné ayant reçu
un jour une facture de téléphone sur laquelle plusieurs
zéros supplémentaires étaient venus s’inscrire
malencontreusement, transformant les centaines en centaines de milliers
de Fr. Dans de tels cas, le service reconnaît immédiatement
ses erreurs. Mais, plus irritantes sont les factures bimestrielles
deux, cinq ou dix fois plus importantes que les précédentes.
L’abonné de bonne foi peut mettre en doute le bien fondé
de la facture mais le plus souvent sans résultat.
Il faut souligner que ces litiges sur les factures sont la rançon
d’un considérable succès qui a élevé
le taux de foyers raccordés au téléphone de 27
% en 1974 à 90 % en 1984. Il est loin, le temps où l’on
pouvait voir le directeur adjoint des télécommunications
de Clermont-Ferrand arriver avenue de Ségur avec, dans sa serviette,
de succulents fromages pour convaincre les responsables de l’administration
centrale d’octroyer quelques lignes supplémentaires à
l’Auvergne... -En outre, le ministère souligne depuis
quelques années la baisse du taux de contestation des taxes
:
2,9 contestations pour 1 000 factures émises en 1983, 3,2 en
1984, 3,7 en 1985, 2,6 en 1986 et 1,88 en 1987
Ces chiffres valent ce que valent les statistiques : ils peuvent signifier
meilleure tarification ou résignation des abonnés.
Mais il reste que les rapports entre les télécommunications
et leurs clients connaissent une évolution juridique et technique
accélérée.
Cette histoire mérite d’être brièvement retracée
entre les déboires d’hier et les espoirs qu’il n’est
pas illégitime de nourrir.
— Les déboires : surprises et impuissance de l’usager
1) Les factures téléphoniques
n’ont pas bonne presse. Au dos des bordereaux reçus, tous
les deux mois, par les abonnés figurent quelques explications.
Mais elles ne portent ni sur les tarifs, ni sur les tranches horaires,
ni sur d’éventuels conseils techniques permettant à
chacun de comprendre ses dépenses : sous la rubrique «remarques
importantes » figurent la mention de la «date limite de
paiement » et le rappel que le «titulaire d’un abonnement
est le seul responsable vis-à-vis de l’administration
de l’usage qui est fait de l’installation ». Le décor
est planté. Il s’agit moins de faire comprendre que de
faire payer. Or une facture lisible sera mieux admise. Le fisc l’a
bien compris qui multiplie les formules «pour calculer vous-même
votre impôt ».
L’abonné, qui ne peut ou ne sait noter régulièrement
ses consommations, devient ainsi un contestataire potentiel qu’une
facture codée va transformer en réclamant à l’administration
puis, parfois, en requérant au juge administratif. A la longue
cohorte de ceux qui se plaignent de l’hétérogénéité
de leurs factures sur une année, du montant de leurs factures
durant l’été où ils sont absents, des possibilités
d’interférences entre lignes, il est invariablement répondu
qu’ils doivent mieux surveiller leur entourage surtout quand
ils sont hors de chez eux. L’incompréhension atteint les
sommets quand l’abonné met sa ligne à disposition
de ses propres clients, qu’il s’agisse d’une entreprise
de location d’appartements à la journée ou au mois
à Paris, d’un hôtel du centre de Rouen ou d’un
taxiphone installé dans le hall d’une clinique privée
. Dans de tels cas, l’exploitant peut être pris entre l’incompréhension
du service public et celle de ses clients qui, bien sûr, ne
se plaindront pas de pouvoir appeler Los Angeles à un tarif
sans concurrence si d’aventure l’installation est temporairement
défectueuse.
Dans une telle situation, rien ne sert de brandir les relevés
du compteur interne à l’entreprise ou installé
chez le particulier qui en a fait la demande : l’administration
répondrait par son atout maître : le décret du
8 janvier 1955, aux termes duquel : «les abonnés sont
autorisés à faire équiper leurs lignes téléphoniques
de compteurs de taxes installés près du poste d’abonnement...
pour la détermination des taxes dues par l’abonné,
le compteur installé au centre téléphonique fait
seul foi ». A la suite des recommandations du médiateur,
les PTT qui ne commercialisent plus directement ces compteurs à
domicile depuis décembre 1986, vont renforcer l’information
des 60 000 personnes disposant de tels compteurs et demander aux industriels
du secteur d’indiquer dans leurs notices la «transparence
juridique » de ces appareils qui ne font pas foi.
Eviter ou réduire les «surprises » de l’abonné,
c’est économiser des litiges et donc améliorer
le service public.
Le premier système pour contrôler un défaut de
facturation ou technique, a été le machine Girard.
L'usager peut aussi demander la pose d'une machine " Girard branchée
en dérivation sur sa ligne. Cet appareil enregistre sur une
bande de papier tous
les chiffres composés au cadran du poste, la date, l'heure
de début et l'heure de fin de chaque communication (celle de
début seulement pour les tentatives de communication n'aboutissant
pas), les Impulsions de taxation envoyées au compteur pour
chaque communication efficace, ainsi que l'heure d'envoi des impulsions
. Il est à noter que dans tous les cas des contrôles
ainsi exercés, le nombre des impulsions inscrites sur la bande
a toujours correspondu à la différence des index du
compteur individuel à la fin et au début du contrôle,
ce quis confirme . le bon fonctionnement des compteurs.
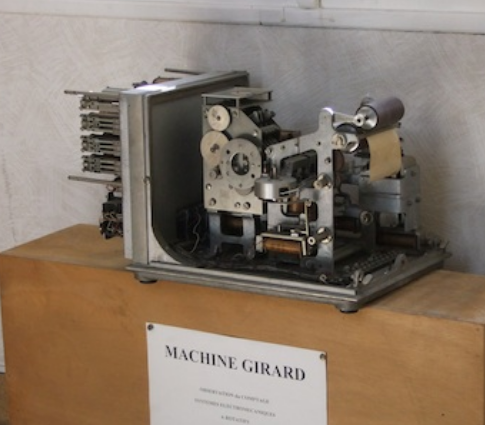 Machine
sans son couvercle.
Machine
sans son couvercle.
A l'issue de la période de contrôle, les indications
de la bande ainsi obtenue sont rapprochées de la comptabilité
tenue par l'abonné (tout abonné qui riclame est, en
effet supposé tenir une comptabilité rigoureuse de ses
appels ; pourtant, combien de réclamants n'en tiennent pas
compte!) . Il est alors facile do découvrir les omissions ou
les erreurs d'évaluation de taxes commises.. par l'abonné
: il est très rare que quelques omissions ne soient pas relevées
mais, surtout, la taxe globale des conversations interurbaines est
rarement appréciée à sa juste valeur, par méconnaissance
des règles exactes
de taxation à la distance et à la durée . Evidemment,
de tels contrôlene peuvent être pratiqués fréquemment,
ni pendant de très longues périodes, car le nombre d'appareils
enregistreurs mis à la disposition de chaque centre téléphonique
est nécessairement réduit en raison de leur prix élevé
.
Reconnaissant les inconvénients que présente pour les
abonnés l'imputation au compteur de la taxe des communications
téléphoniques interurbaines, l'administration comprend
très bien leur désir de pouvoir contr0ter directement
et en permanence leur consommation téléphonique, surtout
au moment où, dans toute la France, se multiplient les liaisons
interurbaines automatiques.
C'est pourquoi ; dès 1955, un décret (ne 55-53 du 8
janvier1955) a autorisé les abonnés des réseaux
où les taxes des comtnunications interurbaines sont imputées
au compteur à faire équiper leurs lignes téléphoniques
de compteurs de taxe installés près du poste d'abonnement,
c'est-à-dire à domicile . Chaque compteur fonclionne
en synchronisme avec, le compteur correspondant au centre téléphonique
et donne à la fois le nombre d'impulsions' enregistrées
pour chaque communication (une impulsion = une taxe de base de 25
francs) et le nombre total d'impulsions : Ces compteurs peuvent étre
installés soit par l'industrie privée (compteurs Sodeco),
et par l'administration. Une taxe de 18.75 francs est jusqu'ici perçue
pour l'équipement du centre téléphonique correspondant
en propre eu compteur de taxes installé chez l'abonné,
ainsi qu'une redevance mensuelle d'abonnement de 100 francs. En outre,
pour les compteurs fournis par l'administration, s'y ajoute une taxe
mensuelle d'entretien `de 600 francs. Le nombre des abonnés,
ayant depuis demandé à bénéficier-de cette
possibilité est extrêmement faible . Aussi, afin de développer
l'installation de compteurs à domicile l'administration vient-elle
de prendre la décision da ramener de 18 .75 à 5 .00
francs la taxe perçue pour 'l'équipement Initial malgré
le prix élevé de cet équipement complexe qui
doit permettre de .retransnlettre au demicille de l'abonné
les impulsions de comptage émises au centre télépionique
. C'est d'ailleurs en raison de ce prix ; élevé que
n'ont Jusqu'à présent été prévus
pour recevoir des équipements de ce type que les centres téléphoiques
de quelques très grandes (dont évidernment,Paris en
premier) . Mals tous les nouveauxcentres automatiques seront dorénavant
Installés avec de tels équipements et les centres déjà
en service en seront progressivement équipés.
2) Car il peut arriver que ce service de télécommunication
ait quelques difficultés à communiquer. Quant à
l’abonné, il aura acquis le sentiment de son impuissance.
- En premier lieu, plane sur la discussion entre le service et l’usager,
la menace de la coupure de ligne. Menace parfois disproportionnée
avec le litige qui peut se limiter à quelques centaines de
francs. Mais quelles que soient les conséquences pour l’abonné,
le «calendrier de recouvrement des factures » est organisé
avec une rigueur mathématique: jour J, envoi de la facture,
J + 23, rappel; J + 30, pénalité de 10 %; J + 35, suspension
de la ligne; J + 40, lettre recommandée avant résiliation;
J + 50, au plus tard, résiliation. Les télécommunications
sont fortes d’un pouvoir de sanction reconnu par l’article
L. 36 du code des PTT : «le service de la correspondance privée
peut être suspendu par le ministre des PTT soit partiellement,
soit totalement, sur l’ensemble du réseau des télécommunications
». Et l’article D 337 ajoute que le service peut à
tout moment mettre fin à un abonnement. La liste des motifs
de résiliation est longue (D. 340 et suivants), mais l’essentiel
est évidemment le non paiement des redevances dans les délais
impartis. Face à des textes aussi formels, le Conseil d’État
n’a pu que suivre l’administration pour admettre la légalité
de résiliations d’abonnement, même si l’usager
faisait valoir son âge et son état de santé et
sans qu’il soit besoin d’adresser préalablement à
l’abonné un avis de mise en recouvrement . La fermeté
dans l’utilisation de cette arme ultime qu’est la résiliation
n’est pas neuve : une caricature du journal satirique l’«Assiette
au beurre» de 1904 montre, devant une longue rangée de
demoiselles du téléphone bousculées par les appels,
le commis principal interroger son supérieur : «M. le
directeur, ces dames sont débordées et le public réclame
». Réponse : «Coupez les communications et faites
poursuivre les récalcitrants! »
Rien n’empêcherait d’ouvrir une place plus large au
sursis de paiement éventuellement avec consignation et, dans
des cas justifiés, à l’octroi de délais
pour les situations difficiles.
- En second lieu, l’abonné se heurte au mur de la charge
de la preuve. Sur ce plan, le juge a pu hésiter puisque les
tribunaux administratifs se sont partagés. Le Conseil d’État
a pris en considération l’impossibilité de faire
peser la charge de la preuve exclusivement sur l’une des parties,
l’administration, car il ne saurait être question de créer
à son encontre une sorte de présomption de «défaut
de décompte normal » sur le modèle de la jurisprudence
des travaux publics; en effet, l’usager se trouve en situation
de faiblesse envers le service technique, seul compétent pour
mesurer le service rendu.
Aussi dans ses récentes décisions, le juge administratif
a-t-il tiré parti du caractère inquisitoire de la procédure
contentieuse pour diriger lui-même l’administration de
la preuve. L’usager devra apporter des «présomptions
suffisamment sérieuses » et l’administration produire
documents, fiches de contrôles et résultats des vérifications
techniques. Le juge est alors amené à tenir la balance
entre les indices de l’abonné et ceux de l’administration.
Pour le premier : montant de facture sans commune mesure avec les
bimestres précédents, dérangements et anomalies
diverses, absence du domicile. Pour l’administration : présomptions
comme l’inexpérience du nouvel abonné qui n’avait
pas pris toute la mesure du coût du service, utilisation du
poste par un tiers en l’absence de l’abonné et surtout
coïncidence entre les relevés du compteur et ceux des
bandes de contrôle.
Le débat est difficile car aux abonnés honnêtes
et réellement victimes de surfacturation, se mêlent nécessairement
les habitués du «service public à crédit
» : ainsi l’abonné qui refusait de payer parce que
le fonctionnement de son compteur avait été interrompu
alors qu’il ne contestait pas avoir normalement utilisé
sa ligne.
- En troisième lieu, l’impuissance
de l’abonné se renforce par les difficultés d’accès
au prétoire. Dès que la requête porte sur un remboursement
de taxe, le juge considère qu’il est en présence
d’un litige de plein contentieux. Le pourvoi n’est pas dispensé
du ministère d’avocat comme le recours pour excès
de pouvoir. Cette exigence constante, soulève des difficultés
pour les litiges portant sur des sommes peu élevées
et le médiateur mentionne cette question dans ses propositions
de réforme.
- En dernier lieu, il faut souligner —
pour mémoire — que les taxes téléphoniques
ont trouvé leur juge. Est donc épargné aux abonnés
le détour par le tribunal des conflits qui n’était
pas rare dans les années 1978.
Désormais, le contentieux des usagers du téléphone
constitue un bloc presque complet de compétence administrative,
le juge judiciaire ne conservant que le contentieux de l’exécution
forcée.
Si l’on tentait un bilan de ces discussions administratives
et contentieuses autour des facturations téléphoniques,
il faudrait reconnaître qu’elles n’aboutissent que
très rarement à une modification de la décision
initiale du service. Cette immobilité, constatée tant
par le médiateur que par le juge administratif, peut résulter
de la qualité réelle de la facturation; elle peut aussi,
dans certains cas, avoir pour cause un certain retard de sens «commercial
» du service public. De là peut venir l’espoir.
Après les déboires qu’il a connus, l’usager
peut retrouver un service soucieux de mettre tous ses moyens techniques
nouveaux à la disposition de ses abonnés.
— Les espoirs : redécouvrir l’abonné
Pour améliorer la satisfaction de l’usager, il
faut agir avant comme pendant le litige.
1) Pour prévenir les réclamations,
mieux vaut constater, comme le faisait récemment le chef du
groupement de contrôle de gestion commerciale des télécommunications,
que «l’exigence des abonnés a augmenté ».
Les initiatives prises récemment par le ministère autour
de l’idée de «charte du consommateur » de
télécommunications vont dans le bon sens. Le contrat
téléphonique est un contrat verbal d’adhésion
dont les clauses sont peu connues des clients; il sera donc remis
à chaque abonné un document précisant les droits
et obligations, les tarifs, les possibilités de facturation
détaillée, les services annexés, le calendrier
en cas de non paiement et les modalités de réclamation.
On peut encore imaginer de parvenir, pour le téléphone,
à ce que le minitel offre d’ores et déjà
: l’affichage du coût de chaque communication. Même
si le «combiné téléphonique anti-réclamation
» n’est pas encore en service, ne doutons pas que l’évolution
accélérée des techniques de télécommunications
ouvrira, dans les prochaines années, des voies nouvelles à
la sécurité financière des abonnés. Encore
faut-il que les choix économiques et commerciaux soient faits
à temps, sans perdre de vue qu’un usager «captif
» peut cacher un client exigeant. D’autres services publics
à monopole suivent ce chemin.
2) Si la réclamation naît, elle doit être traitée
par des voies rapides, personnalisées et efficaces.
— Rapides, car le calendrier du recours doit être aussi
«serré » que celui de la sanction suspension-résiliation.
— Personnalisées, car les lettres-types
informant l’intéressé «que les contrôles
menés aussitôt n’ont révélé
aucune anomalie » auraient plutôt pour effet de multiplier
l’ardeur contentieuse de l’abonné. Ignorant la nature
de ces contrôles, leurs méthodes, leurs dates et leurs
résultats, celui-ci aura le sentiment d’être «débouté,
sans autre forme de procès ». Le ministre des PTT a rappelé
à ses chefs de service, par circulaire du 30 décembre
1986, la nécessité de traiter de façon particulière
chaque dossier de réclamation.
— Efficaces, car le nombre des factures
des PTT justifierait des formes nouvelles de discussion : qu’il
s’agisse d’appel au sein de l’administration elle-même,
lorsque l’agence commerciale locale a dit son dernier mot, ou
qu’il s’agisse d’approfondir des expériences
de commissions indépendantes statuant avant tout contentieux.
A cet égard, il serait probablement dommage que l’administration
abandonne trop rapidement toute perspective de mise en place de commissions
de conciliation : l’expérience de 1983-1984 à la
direction opérationnelle de Melun n’a pas répondu
aux espoirs des PTT. D’autres tentatives dont le bilan serait
contradictoire, pourraient donner un résultat différent.
3) Reste le domaine sensible de la charge de
la preuve. En cette matière, l’évolution ne viendra
pas tant du juge ou du légiste que de l’ingénieur
et du financier. Les deux «atouts » du service sont «GESTAX
» et «FADET »...
Le premier, l’instrument d’enregistrement
de la consommation quotidienne téléphonique avec mémorisation
sur 6 mois, permet de renseigner les abonnés directement —
et bientôt par minitel — sur le montant de leur facture.
Le système a été testé à Fontainebleau
et Alençon et sera opérationnel en 1988.
Par le second — facturation détaillée
— , plus de 600 000 abonnés reçoivent une facture
qui détaille appel par appel leur consommation. Pour éviter
les situations de vaudeville, seuls les 4 premiers chiffres sont indiqués,
assez pour connaître le coût et la région ou le
pays de l’appel, pas assez pour identifier l’interlocuteur
de l’abonné. Le coût de ce service a baissé
(8 F par mois depuis octobre 1986) mais il n’est pas encore utilisé
comme il pourrait l’être. Notons que «FADET »
permettra aux techniciens des télécommunications de
rejoindre leurs collègues de la Poste qui, depuis des lustres,
adressent à leurs clients de comptes postaux, un relevé
pour chaque opération.
Si l’on ajoute que les possibilités
techniques permettront d’autres services comme l’identification
de toutes les communications chères ou la photographie hebdomadaire
des compteurs, l’on mesure que la question des preuves va se
trouver posée dans des termes renouvelés dans les prochaines
années. Anticipant cette évolution, le ministère
a décidé une modification de l’article D. 293-1
du code des PTT afin que, pendant les 6 mois suivant l’émission
de la facture, l’administration tienne à la disposition
du client tous éléments justificatifs de cette facture.
Compte tenu de ces évolutions, il serait possible d’envisager
pour la facturation et les redevances téléphoniques,
Yaggiorna-mento que le fisc, à la suite du rapport de la commission
Aicardi en 1986, vient de connaître. Les articles 81 -VI de
la loi de finances du 30 décembre 1986 et 10 de la loi n°
87-502 du 8 juillet 1987 ont su renverser la charge de la preuve qui
pesait, dans un assez grand nombre de cas, sur le contribuable. Les
télécommunications sauront prendre leur part de cette
amélioration des relations avec cet abonné qui hésite
entre la résignation de l’usager et la méfiance
du client. Le Médiateur vient de proposer une réforme
tendant à mettre la preuve du bien fondé des factures
téléphoniques à la charge de l’administration.
Au terme de ce survol de la facturation du téléphone,
il serait vain de tenter une ordonnance pour guérir la «maladministration
». Le malade n’est pas en péril. Mais
le service public devra utiliser tous ses outils pour satisfaire l’abonné.
Le droit sera l’un de ces moyens. Lois et règlements sur
le téléphone pourront mieux protéger le consommateur,
assurer la clarté du contrat; le service doit s’assurer
de la qualité de la personne qui sollicite l’abonnement.
Mais la période à venir sera, plus encore que celle
passée, un temps de jeu complexe entre le droit et la technique
:
— la technique évolue : gageons
que ce qu’elle a pu supprimer (la clarté limpide des tickets
rédigés par l’opératrice remplacée
en 1945 par l’imputation au compteur), elle saura le restituer
sous une autre forme;
— le droit continue à jouer son
rôle en remettant heureusement la technique à sa place:
des différences de tarif du réveil par téléphone,
uniquement fondées sur la nature manuelle ou automatique du
central de rattachement, portent atteinte à l’égalité
des usagers. Le droit sollicite aussi le technicien en sanctionnant
les retards de vérifications de lignes en dérangement
ou les suspensions de lignes sans motif.
Quelles que soient leurs progrès, droit
et technique ne suffiraient pas si l’approche commerciale ne
venait pas renouveler à la fois la qualité du service
et la communication avec l’abonné. Ici finira la maladministration
et commencera la bonne facturation au service du public.
1985
: L'application informatique GESTAX
Conçue, développée
et mise en exploitation par 4 techniciens du Centre Principal d'Exploitation
de Fontainebleau et l'aide du CNET qui a fournis le premier
mini ordinateur SM90 sous Unix concu par le Cnet.
Cette application connéctée à un petit boitier
éléctronique conçu par le Cnet (l'ARDS automate
de recopie de données), aspire chaque message de taxation issu
des centres téléphoniques éléctroniques
comme les E10, Mt25 ... Ces données étaient stockées
6 mois et analysées chaque nuit afin de fournir journalièrement
aux services commérciaux les résultats d'analyses
de comportement des consommations téléphoniques
de chaque abonné. La dernière version permettait aussi
de produire localement une facturation détaillée
au jour le jour ainsi qu'une facturation détaillée
inversée quand les conversations étaient locales, alors
que la facturatin détaillée de l'époque n'était
disponible qu'en fin de bimestre.
Avec votre serviteur Jean Godi, Christian Nicouleau, Gilles Barzic
et Patric Laumonier.
Ce projet parmi les 92 présentés au jury national des
suggestions des télécoms a été retenu
et récompensé de 20 000 fr, en présence du ministre
des PTT J. Dondoux. L'application GESTAX est présentée
en démonstration au SICOB 1986 où elle remporta un vif
succès.
Jean 


A cette époque j'étais tout jeune et aspiré par
l'informatique qui se démocratisait au sein de l'administration.
Après le Cpe de Fontainebleau suivent de peu Alençon,
Montargis, Saint-Malo ... plus de déploiement en 1986.
GESTAX permet :
- Une gestion aisée des données de taxation à
distance, à partir des bureaux de comptabilité, ou des
agences.
En effet, l'on ne dérange plus l'équipe des techniciens
de commutation pour aller faire un relevé manuel dans les Commutateurs
électroniques ou électromécaniques ( Commutateurs
PENTACONTA, CP400 ... certains de ces systèmes les plus anciens
en seront équipés à partir de 1989).
- De pouvoir rapidement vérifier via un terminal distant
(Télétype ou Minitel ) le relevé compteur journalier
en cas de contestation de la part d'un abonné , faisant tomber
le taux de 4 contestations pour 1.000 lignes à inférieur
à 1 pour 1.000, et mettre fin aux mauvaises surprises en fin
de bimestre. En 1991 avec la généralisation le taux
de réclamation de facturation sera été a divisé
par 10.
- D'être alerté rapidement en cas de consommation
anormale, qui peut être le synonyme d'une fraude extérieure,
ou d'un abus d'utilisation par un membre d'une famille, d'un employé
... , et d'alerter rapidement l'abonné de ce qui paraît
être une anomalie,
À partir du 1er janvier 1988 et la naissance de la marque FRANCE
TÉLÉCOM, l'application GESTAX a été renommée
GESCOMPTE.
1986 : L'Unité Télécom (UT)
remplace la Taxe de Base (TB).
Par le décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986, la Taxe
de Base créée par décret du GPRF n°45-289
du 22 février 1945 devient l’Unité Télécom
(UT) à partir du 1er octobre 1986.
1987 : Nouvelle modification de la Tarification
Locale.
Désormais, à partir du 1er novembre 1987, les communications
locales sont facturées une Unité Télécom
toutes les 6 minutes en plein tarif.
1991 : Gescompte :
Fin de la Taxation mémorisée sur les compteurs mécaniques.
Déjà généralisée depuis 1988 sur
l'ensemble des commutateurs électroniques, les commutateurs
électromécaniques de type crossbar voient eux aussi
en fin 1991 la mémorisation de la taxation de chaque abonné
être informatisée via l'application de Gescompte.
Désormais, la traditionnelle photographie des compteurs
électromécaniques individuels d'abonnés installés
au Centre Téléphonique appartient au passé, et
permet statistiquement une division par 10 des réclamations
sur la facturation.
Après la réforme tarifaire, les Zones Locales Élargies de province n’ont plus en général qu’1 seul tarif régional, parfois 2 et marginalement 3.
Seule exception, la région Île-de-France pour laquelle la réforme entraîne moins de conséquences, la plupart de ces ZLE conservant 4 tarifs régionaux.
De plus, les Circonscriptions Tarifaires de moins
de 150.000 abonnés sont progressivement fusionnées,
de telle manière qu'il n'en existe désormais que 412
en métropole depuis le 4 octobre 2011 (plus 18 pour les Dom
et certains Com).
1993 L'évolution récente de la tarification
téléphonique
En France, comme ailleurs en Europe, les
territoires nationaux sont découpés en circonscriptions
tarifaires.
Généralement, le tarif appliqué à un appel
téléphonique dépend de la distance qui sépare
les circonscriptions où se trouvent les deux interlocuteurs.
Du point de vue technique, dans les années 60, le coût
d'une communication était une fonction quasi linéaire
de la distance : c'est pourquoi on comptait en France 11 paliers tarifaires
qui s'échelonnaient jusqu'à 500 km.
Grâce aux importants progrès techniques,
notamment avec le développement des satellites et des fibres
optiques, on assiste à une chute du poids de la distance dans
les coûts. Cette chute, répercutée sur les tarifs,
a entraîné la suppression progressive des paliers les
plus lointains.
Depuis 1979 et la disparition du palier « 100 à
200 km », il ne reste plus que 6 paliers : au-delà de
100 km, le même tarif est appliqué sur tout le territoire
national.
Les autres grands pays européens, plus avancés dans
cette évolution, à part l'Italie, ne proposent plus
que trois paliers tarifaires ; ce qu'ils ont obtenu non seulement
par un rapprochement de la limite du palier le plus cher, mais aussi,
à l'autre extrémité de l'échelle tarifaire,
par une extension de la zone locale où s'applique le tarif
le moins cher.
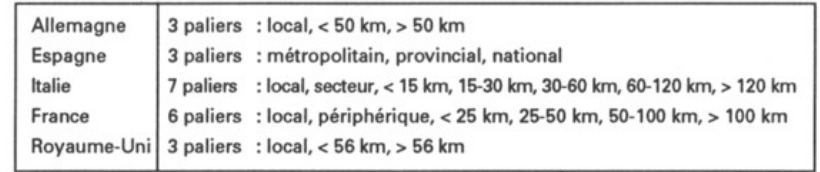
- Chute du rôle de la distance
II n'est pas impossible que la poursuite de
cette évolution conduise à la « postalisation
» du tarif téléphonique, c'est-à-dire,
comme pour la Poste, à un tarif unique sur tout le territoire
national.
En attendant, la chute du rôle de la distance
se manifeste aussi dans les prix. En France, alors que le prix des
appels locaux est stable depuis 1986, celui des appels à longue
distance ne cesse de décroître. Le tarif national le
plus cher est passé progressivement d'une U.T. (Unité
Télécom) toutes les 12 secondes en 1985 à une
U.T. toutes les 17 secondes, aujourd'hui, soit une baisse de 33 %,
et même de 44 %, pour les clients qui récupèrent
la T.V.A.
- Accroissement du rôle du temps
Parallèlement à la chute du rôle
de la distance, on assiste à l'accroissement du rôle
du temps. En effet, le coût d'un appel supplémentaire
dépend surtout de l'heure à laquelle il s'écoule.
S'il survient aux heures creuses de la journée, le coût
marginal est pratiquement nul ; en revanche, s'il survient au moment
où le réseau est déjà saturé, il
ne pourra pas aboutir. C'est un manque à gagner pour l'opérateur
à moins que celui-ci ne surdi- mensionne ses équipements
pour permettre aux appels de s'écouler normalement pendant
les quelque vingt à trente minutes que dure la pointe. Le coût
de ces appels est donc extrêmement élevé.
Pour résoudre ce problème, les techniciens
ont fait appel aux tarifica- teurs. Ceux-ci ont créé
la modulation horaire des tarifs afin d'assurer auprès des
clients la promotion des heures creuses et d'écrêter
les pointes de la courbe de charge. Voici les grilles, aux jours ouvrés,
de cinq opérateurs européens :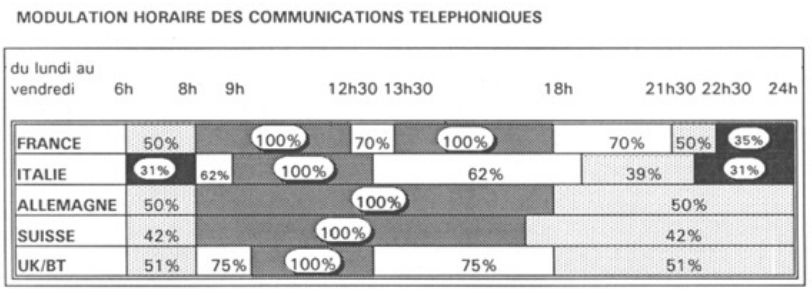
C'est en France et en Italie dont les grilles offrent quatre tarifs
répartis sur six ou sept plages horaires que le facteur temps
est le mieux intégré aux prix.
Par ailleurs, tous les pays européens, la Grèce
exceptée, ont renforcé le rôle du temps par l'introduction
de la tarification à la durée des communications locales,
alors que celles-ci avaient longtemps bénéficié
d'un tarif unique pour une durée de communication illimitée.
- Développement de nouveaux paramètres
La diversification des tarifs se développe
avec l'apparition de nouveaux paramètres, comme le volume de
trafic écoulé.
En France, Trafic Plus, créé en 1985,
propose une réduction du prix des communications nationales
moyennant un abonnement plus élevé.
En 1993 , cet abonnement est de 1 300 F T.T.C. par mois, ce qui équivaut
au prix de deux heures de trafic par jour, au tarif le plus cher.
Ce service est donc avantageux pour les entreprises qui dépassent
ce volume de trafic sur une même ligne.
Une autre manière de faire bénéficier les clients de l'effet de volume est d'offrir, comme en Grande-Bretagne, des tarifs réduits sur les axes les plus fréquentés. Les « low cost routes » concernent plus d'une centaine de liaisons entre les principales agglomérations de ce pays.
1993 : Création des premiers tarifs préférentiels
Primaliste.
Le 29 novembre 1993, le service Primaliste entre en vigueur. Il s’agit
du premier service permettant, grâce à l’électronisation
« intelligente » du réseau téléphonique
commuté, contre abonnement mensuel supplémentaire de
30 francs, de bénéficier d’une réduction
de 15 % sur les 5 correspondants préalablement choisis par
l’abonné sur le territoire métropolitain. Le tarif
n’est plus seulement fonction du jour, de l’heure d’appel
et de la distance, mais désormais, sur option, au choix de
l’identité de l’abonné demandé. Ce
service est particulièrement utile aux personnes appelant très
fréquemment un nombre limité de correspondants.
Poinr sur la situation
- Un niveau des prix satisfaisant
L'évolution des coûts du téléphone
grâce à la baisse du poids de la distance, et à
une meilleure prise en compte du temps ou du volume, a donc conduit
à une baisse des prix des communications au cours de ces dernières
années. Les clients eux-mêmes admettent volontiers que
le niveau du prix du téléphone en France est satisfaisant.
Et, s'ils croient en revanche, au vu de leur facture, que ce prix
n'a cessé d'augmenter, comme celui des autres services publics,
c'est sans doute parce qu'ils téléphonent davantage.
Le graphique suivant montre que la France, pour
le prix de ses communications, se situe dans la moyenne européenne.
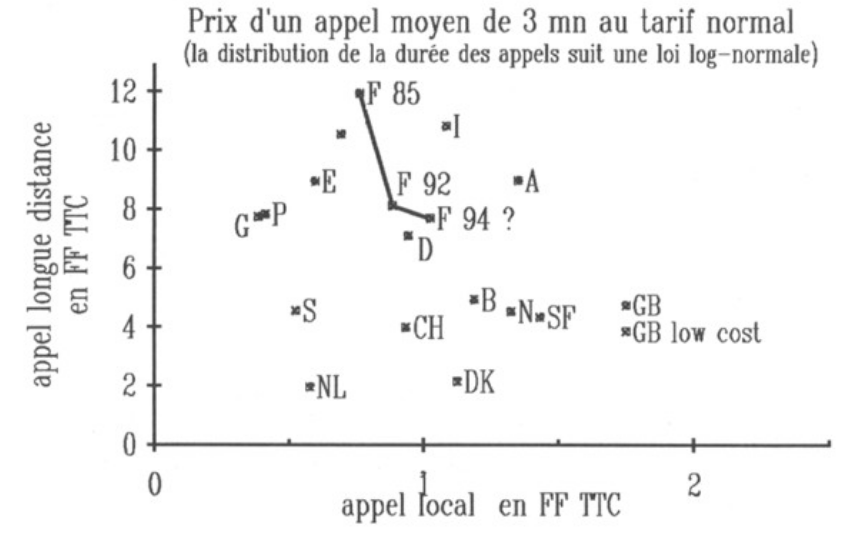
- Une modulation horaire bien comprise
La régulation de la courbe de charge
par la modulation horaire est un autre aspect positif de la tarification
en France.
Le graphique suivant met en évidence la différence (zone
hachurée) entre le trafic constaté en 1984, lorsqu'il
n'y avait qu'un seul tarif réduit commençant à
19 h 30, et le trafic écoulé en fonction de la modulation
horaire actuelle.
Le trafic d'une courbe à l'autre a augmenté
de 8,6 % ce qui témoigne d'une nette amélioration de
l'utilisation du réseau, avec une meilleure répartition
de la charge entre 18 h et 21 h, et une moindre sous-utilisation avant
8 h 00, entre 12 h 30 et 13 h 30, et entre 21 h 30 et 24 h 00.
En conséquence, et à investissement égal pour France Télécom, les clients qui ont bien compris le signal tarifaire, bénéficient d'un prix moyen de trafic plus bas, pour un trafic plus fluide, donc pour une meilleure qualité de service.
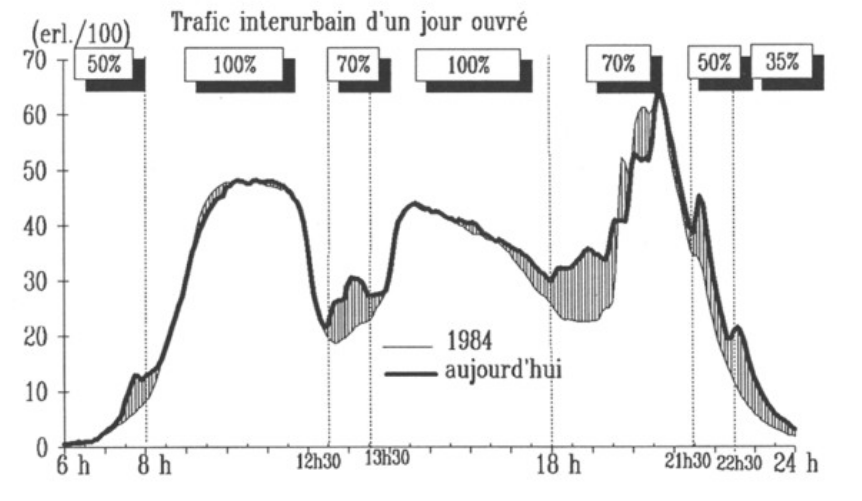
- Une structure de tarifs inadaptée
Mais, la structure des tarifs en France est mal adaptée au
nouvel environnement concurrentiel, car elle est trop éloignée
des coûts réels. Comparés à ceux des autres
pays d'Europe, les frais fixes sont très bas, les communications
locales bon marché, les appels lointains encore chers, ce qu'illustrent
les graphiques suivants.
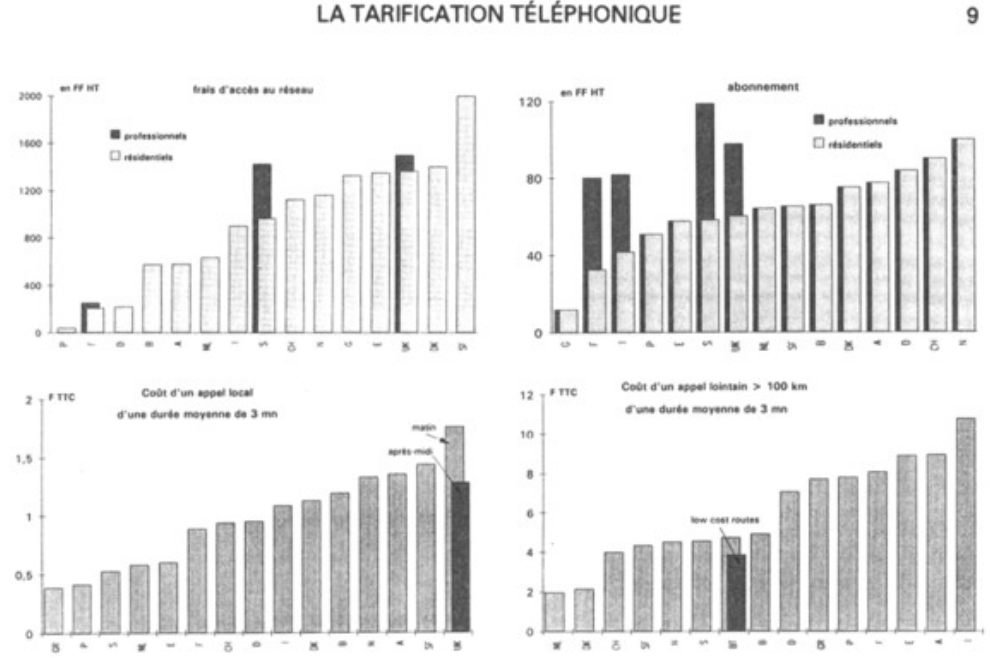
A noter, et à prendre comme référence
la position de l'opérateur British Telecom (B.T.), particulièrement
attentif à se rapprocher de la vérité des prix
depuis la création de son concurrent britannique Mercury (M.Y.).
Les pays méditerranéens, Italie,
Espagne, Portugal, Grèce, présentent une structure tarifaire
éloignée des coûts, ce qui peut s'expliquer par
des réseaux en plein développement, phase où
les frais d'abonnement et le prix des communications locales sont
relativement bas pour attirer la clientèle, et le prix du trafic
longue distance élevé pour faire face à de lourds
investissements.
La France qui du point de vue tarifaire se situe
encore dans ce groupe, a donc du chemin à faire pour adapter
la structure de ses tarifs à la maturité de son réseau,
comme l'ont déjà entrepris ses voisins « nordiques
». En réalité, une tarification éloignée
des coûts de revient engendre des transferts : par exemple les
villes payent les raccordements des campagnes, et les professionnels,
gros consommateurs d'interurbain, subventionnent les appels de proximité
des résidentiels, transferts qui justifient auprès des
clients la nécessité de rééquilibrer les
tarifs.
- Les inconvénients d'une géographie tarifaire complexe
La géographie et les règles tarifaires
en vigueur sont issues d'un système cohérent, mis en
place en 1956. Au fil des années, ce système tarifaire
a subi des modifications partielles pour suivre les évolutions
administratives, techniques ou économiques. Après, il
en résulte un système compliqué, injuste et aberrant
qui nécessite une réforme globale d'harmonisation.
C'est un système compliqué : il
est fondé sur le découpage du territoire national en
465 circonscriptions, et sur l'application de six différentes
cadences d'impulsion, gérées par de multiples règles
conduisant à neuf cas de tarification (sans compter les exceptions).
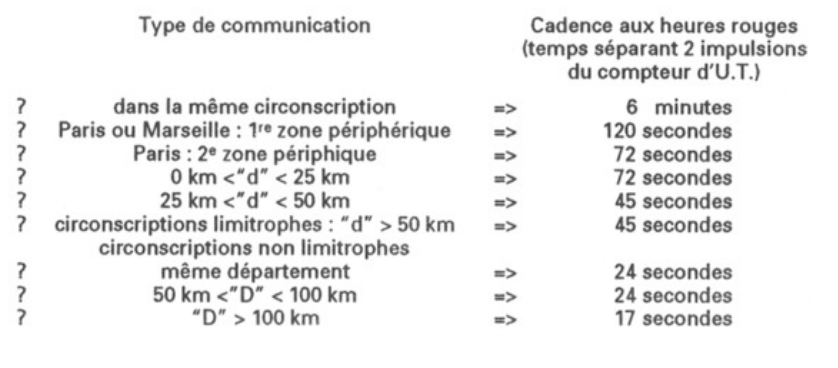
II existe deux critères pour mesurer
la distance : "d", distance entre les chefs-lieux de circonscription
lorsque cette distance ne dépasse pas 50 km, "D",
distance entre préfectures qui s'appliquent sur quatre paliers
de distance ; les autres critères sont indépendants
de la distance et font intervenir l'appartenance à la même
circonscription, l'appartenance aux zones périphériques
de Paris ou de Marseille ; le caractère limitrophe des circonscriptions,
l'appartenance au même département. Ces règles
déjà complexes souffrent encore d'exceptions : ainsi,
pour l'application des tarifs inter-départementaux l'Ile-de-France
est considérée comme un seul département avec
Paris pour chef-lieu ; de même, la Drôme et l'Ardèche
ne forment qu'un seul département avec Valence pour chef-lieu.
C'est un système injuste : les circonscriptions,
créées dans les années 50 à partir de
la notion administrative de canton et celle, technique de réseau,
sont très disparates en forme, en superficie, en nombre d'abonnés,
et donc en nombre de correspondants que l'on peut virtuellement atteindre
au tarif local. Bougé (49) ne compte que 2 700 abonnés,
alors que la circonscription de Paris qui englobe les départements
de la petite couronne, en compte 3 600 000 ! La plus grande partie
(75 %) des 465 circonscriptions actuelles a moins de 1 500 km2 et
moins de 50 000 abonnés.
Injuste aussi parce que la limite entre deux
circonscriptions crée un saut brusque de tarif, évidemment
très mal perçu par les interlocuteurs qui, bien que
proches géographiquement, se trouvent de part et d'autre de
cette limite.
C'est un système aberrant : il n'y a pas toujours concordance entre les limites de circonscription et celles des départements : Redon, partagée entre trois départements en est l'exemple le plus étonnant ; parfois aussi, comme c'est le cas pour la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, la limite traverse une même commune. Mais surtout, la double règle de mesure de la distance introduit des distorsions importantes entre les distances réelles, perçues par le client, et le tarif appliqué.
La cartographie des tarifs autour de Millau fait ressortir
les incohérences du système.
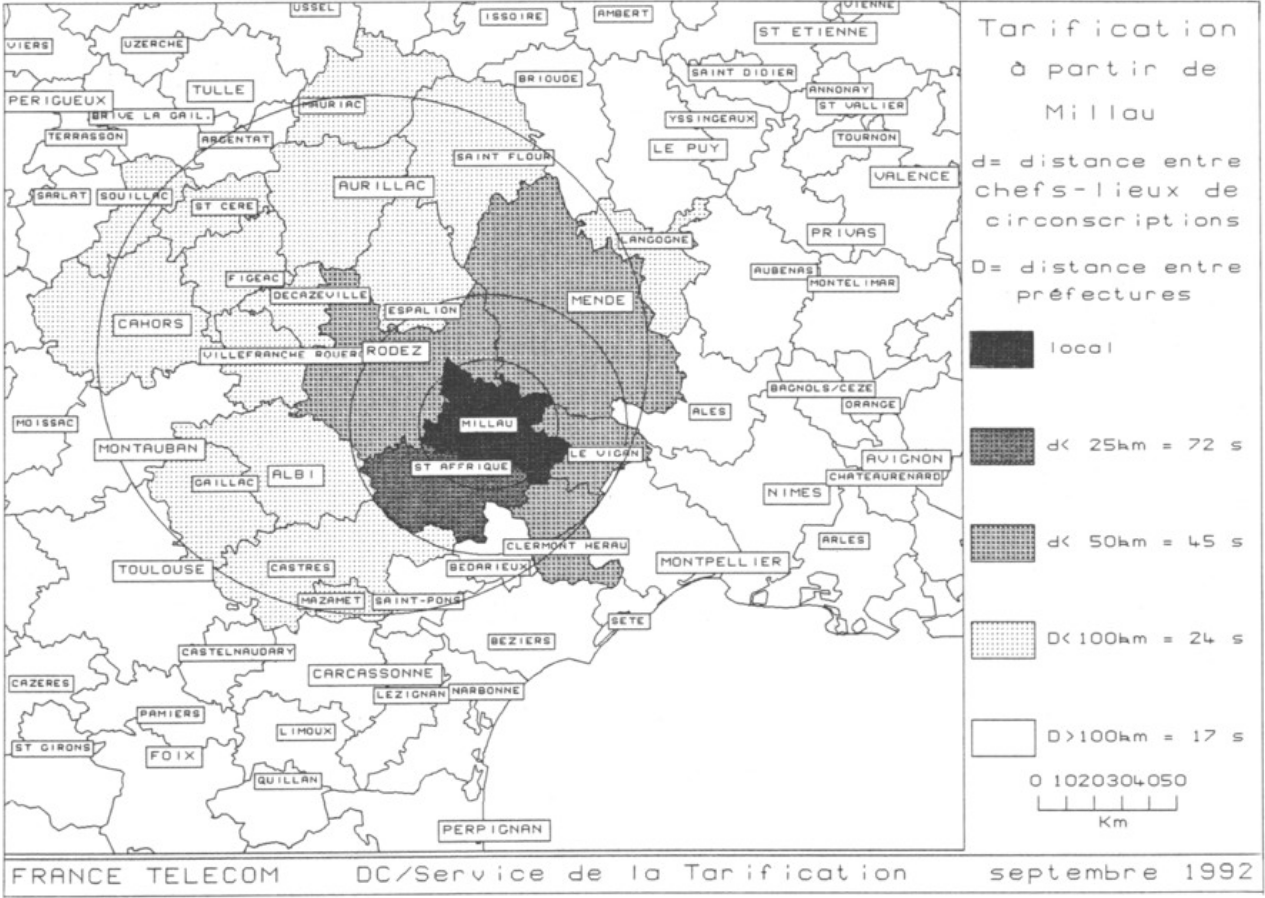
La zone qui, à partir de Millau, bénéfice
du tarif de voisinage à une U.T. toutes les 24 secondes, est
complètement excentrée vers le Nord et l'Ouest, alors
que les circonscriptions du Sud et de l'Est dont celle de Montpellier,
ne sont accessibles qu'au tarif le plus élevé.
Dans les faits, téléphoner à
Montpellier (distante de 84 km) coûte aussi cher aux habitants
de Millau que d'appeler Brest ou Strasbourg. Cela tient au fait que
Rodez est assez proche des préfectures situées au Nord-Ouest
de l'Aveyron, alors que plus de 100 km la sépare des autres
chefs-lieux du département. Mesurer la longue distance comme
on le fait aujourd'hui, par l'éloignement des préfectures,
peut conduire à des situations critiquables voire cocasses
:
- ainsi, une communication Millau-Bédarieux
(54 km) supporte le prix le plus cher, car Rodez est à plus
de 100 km de Montpellier (133 km précisément)
- en revanche, Millau-Souillac (155 km) bénéficie
du palier 24 secondes car Cahors-Rodez (91 km) n'atteind pas les 100
km.
Rappelons, ici, à titre d'explication sinon
de justification, que ce système a été mis en
place il y a plus de 30 ans, à une époque où
les échelons de distance s'étendaient jusqu'à
500 km. Alors, la prise en compte de la distance entre chefs-lieux
de département était une réelle et astucieuse
simplification. C'est la suppression progressive des paliers de distance,
sans que soit remit en cause le critère de mesure, qui a conduit
à la situation aberrante actuelle.
Sommaire
Les réformes envisagées
Pour remédier aux inconvénients de la situation actuelle,
le Service de la Tarification de France Télécom a depuis
longtemps imaginé, étudié et proposé diverses
solutions.
En 1980-1982, il anime le groupe de travail « Modernisation
de la Tarification Téléphonique », dont la plupart
des objectifs ont été réalisés (modulation
horaire des tarifs), ou sont en cours de réalisation (début
d'un rééquilibrage structurel et d'une diversification
des tarifs) comme le montre plus haut le chapitre sur l'évolution
récente de la tarification téléphonique.
Un autre objectif important, simplifier la tarification de voisinage,
a fait l'objet d'études approfondies, menées en collaboration
avec les Régions, l'I DATE, et la Faculté d'Orsay dont
l'aboutissement est un dossier bien argumenté, proposant une
solution originale, : créer des Zones Locales Elargies
ou Z.L.E.
En 1986, le rapport du Conseiller d'Etat Claude Lasry, qui reprend
les grandes lignes de cette proposition, avait été remis
au Ministre.
- Mais c'est seulement en novembre 1991 que la mise en place des Z.L.E.
est inscrite au Contrat de Plan signé entre France Télécom
et l'Etat.
- Le principe des Z.L.E. et les solutions européennes
1994 : Création des Zones Locales Élargies.
Après la nomination de M. Jean-Pierre Borie
en tant que Directeur du Projet des Zones Locales Élargies,
par la Décision n°44/DG/93 du 22 avril 1993 du Directeur
Général M. Charles Rozmaryn,
Après la première présentation du projet ZLE
le 13 mai 1993, présidée par le Directeur du Réseau
et de l'Exploitation M. Jean-Pierre Poitevin qui explique les enjeux
des ZLE,
Après une enquête réalisée dans toutes
les Directions Régionales entre le 15 mai et le 4 juin 1993
sur les besoins nécessaires en redimensionnements éventuels
des mémoires des Traducteurs, où il appert que :
- MT25 et Métaconta 11F : ressources mémoire suffisantes
;
- E10N1 : certains Traducteurs doivent recevoir une extension de mémoire
(ajout de carte(s)) ;
- E10N3 : la quasi-totalité des Traducteurs doivent recevoir
une extension de mémoire (ajout de carte(s)) ;
- E10B3 : ressources mémoire suffisantes, mais extension des
fichiers de traduction à réaliser ;
- AXE Spatial et AXE10 : (pas d'information trouvée à
ce jour) ;
- Crossbar Pentaconta et CP400 : non concernés par le passage
en tarification ZLE. Coût d'adaptation trop coûteux, sachant
que leur suppression est actée avant le 31 décembre
1994.
Après l'accord du Comité Interministériel d'Aménagement
du territoire intervenu le 12 juillet 1993,
Après une répétition générale réalisée
dans la nuit du 12 au 13 décembre 1993, la
France bascule en ZLE le 15 janvier 1994 à 8h00.
Le système de tarification des communications téléphoniques
est réformé en profondeur d'un point de vue géographique.
Il est, juste avant cette refonte, un des plus compliqués
du monde, avec 1 tarif local à l’intérieur de chacune
des 425 Circonscriptions Tarifaires étant de la taille approximative
d’un arrondissement de cantons (plus 20 circonscriptions pour
les Dom et certains Tom), 4 tarifs régionaux différents
autour de cette circonscription et un tarif national (anciennement
: interurbain).
Le but est de créer des Zones Locales
Élargies au tarif local pour chaque Circonscription Tarifaire,
en y incluant ses circonscriptions limitrophes, ce qui donne une zone
d’une superficie proche de celle d’un département
où désormais chaque abonné pourra joindre, en
moyenne, 440.000 correspondants au tarif local contre 60.000 auparavant.
En revanche, le tarif local double : il passe
à 1 Unité Télécom toutes les 3 minutes
en plein tarif.
Une des raisons invoquées pour créer les ZLE et remanier
le tarif local est de réduire les effets de frontière
hérités du découpage devenu trop ancien, ce qui
ne correspondait plus à la réalité démographique
du pays (la population ayant plus de relations installées en
dehors de leur voisinage direct du fait de la généralisation
de l’automobile) et qui était jadis basé sur des
impératifs technologiques disparus depuis (comme le manque
passé de faisceaux de liaisons interurbains et de grandes distances).
Une autre raison est de tenir compte qu’avec l’électronisation du réseau désormais acquise, la distance pèse de moins en moins dans le prix d’une communication tandis que la durée y pèse de plus en plus.
Les sauts de tarif de part et d'autre des limites
de circonscriptions étant ce qui apparaît le plus irritant
aux abonnés, des solutions originales ont été
mises en place en Europe.
Il s'agit d'étendre le tarif le moins cher, réservé
actuellement aux appels à l'intérieur d'une même
circonscription, aux appels échangés avec les circonscriptions
voisines. Cette nouvelle zone locale ainsi définie est aussi
dite « glissante », c'est-à-dire telle que les
abonnés, situés de part et d'autre d'une limite, s'appellent
toujours au tarif local.
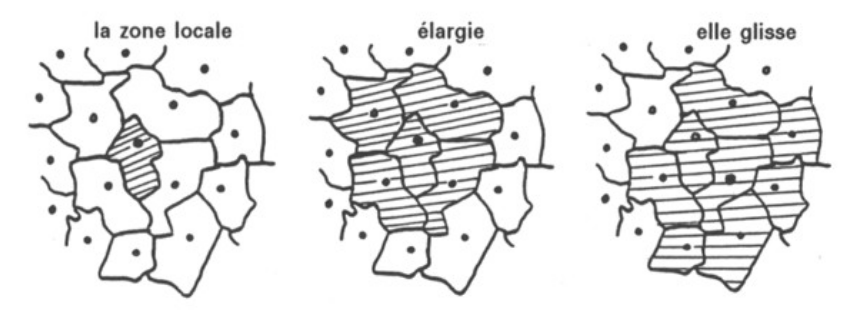
Carte de la Zone Locale Élargie Île-de-France (à partir de Paris) depuis le 15 janvier 1994.
Sommaire
ZLE : Les solutions européennes
En Europe, les zones locales élargies existent en deux versions
:
- en Allemagne Fédérale
: un abonné peut appeler, au tarif local, sa propre circonscription
ainsi que toutes celles dont le chef-lieu est à moins de 20
km. Cette méthode convient à des circonscriptions élémentaires
petites, cas de la R.F.A. qui en compte 3 750 d'une surface moyenne
de 70 km2. La zone locale type offerte à l'abonné allemand
est, grâce aux zones locales élargies, de 1 270 km2,
et lui permet d'atteindre 130 000 abonnés ;
- en Grande-Bretagne,
la zone d'appel local est constituée de la circonscription
de départ et de toutes les circonscriptions limitrophes ; partant
d'un territoire découpé en 639 circonscriptions, les
« charging groups », d'une taille moyenne de 380 km2 et
34 000 abonnés, on aboutit à de vastes zones locales
de 2 700 km2 et de 250 000 abonnés, en moyenne.
Outre la R.F.A. et la Grande-Bretagne, les zones
locales élargies existent en Suède (autour des grandes
villes) et aux Pays-Bas. Des solutions adaptées et spécifiques
sont à l'étude en Italie, en Espagne, en Suisse.
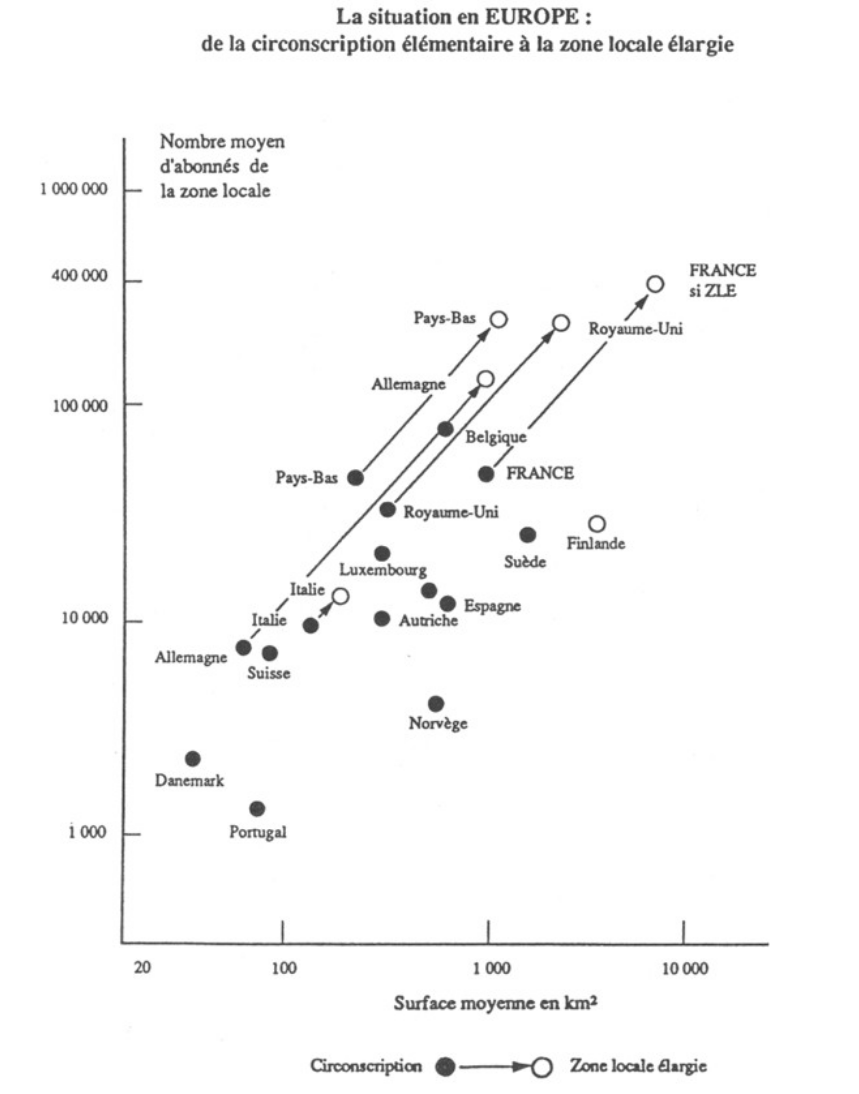
- Les effets des Z.LE. en France
La mise en place des Z.L.E. apportera
un remède aux inconvénients de la géographie
tarifaire décrits plus haut :
- concrètement, l'espace de proximité
sera en moyenne sept fois plus étendu : de 1 200 km2 et 55
000 abonnés (pour une circonscription moyenne) à 8 000
km2 et 400 000 abonnés (pour une Z.L.E. moyenne) ;
- les inégalités seront considérablement
atténuées : la plus petite Zone Locale devrait atteindre
50 000 abonnés, contre 2 700 abonnés actuellement pour
la plus petite circonscription ;
- la Préfecture accessible aujourd'hui
au tarif le plus bas pour seulement la moitié des abonnés
le deviendra pour 88 % d'entre eux ;
- l'effet du saut de tarif aux limites des circonscriptions
sera supprimé par l'application du principe dit « glissant
» ou en « écaille de poisson » à la
Zone Locale Elargie ;
- enfin, mesures corollaires à l'application
des Z.L.E., les règles de tarification seront simplifiées
: au lieu des neuf cas de tarification actuels,
compliqués de deux critères pour mesurer la distance,
on aura, outre le tarif local, cinq cas tarifaires correspondant exactement
à cinq paliers de distance, et un seul critère - la
distance entre chefs-lieux de circonscriptions - pour mesurer cette
distance.
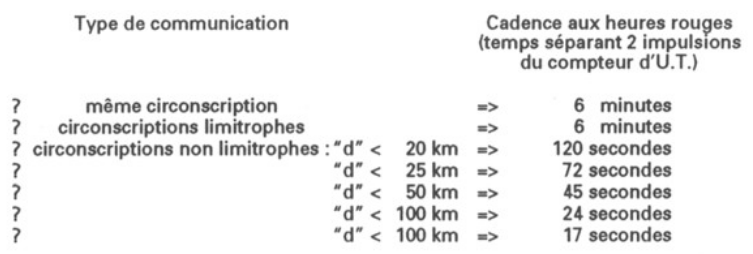
La réforme vue de Millau illustre la plupart
de ces améliorations :
- notable extension de la Zone Locale ;
- recentrage des paliers de tarif autour de
Millau ;
- accessibilité de Montpellier au tarif
de voisinage
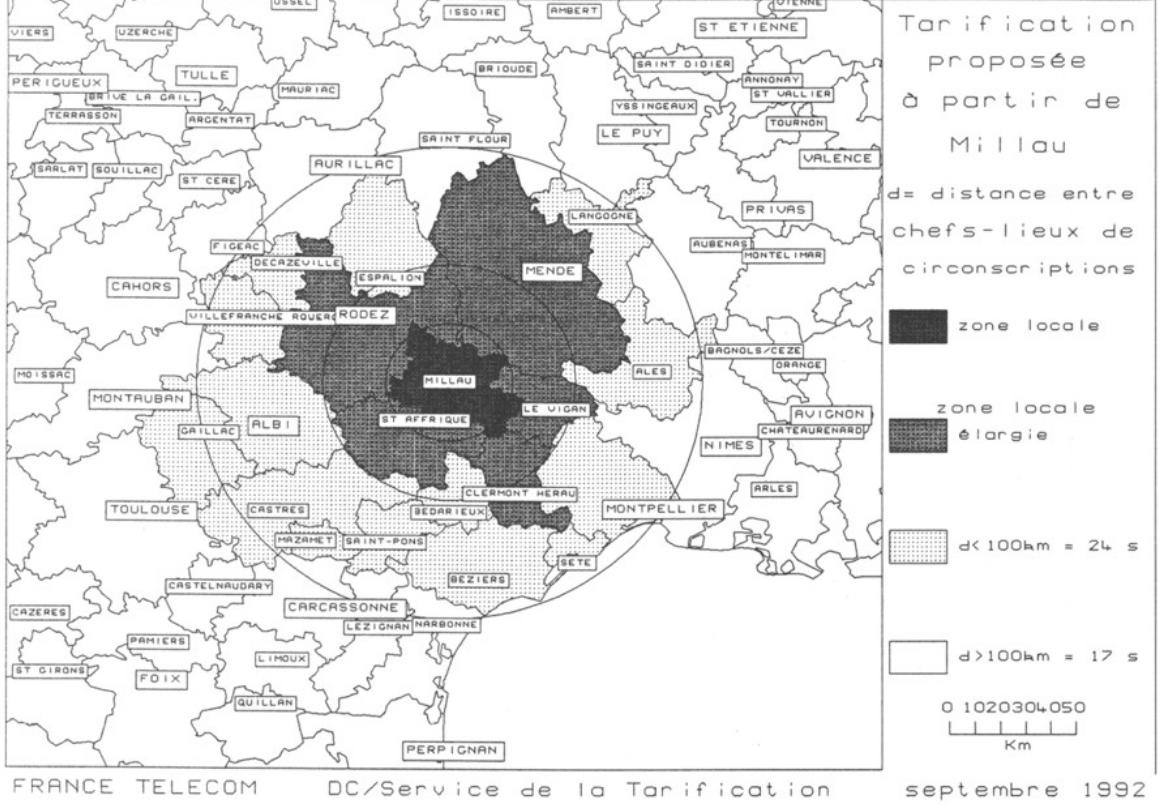
En France, cette importante réforme qui doit
remettre en ordre la géographie tarifaire a le mérite
d'être favorable aux clients dans leur ensemble, et d'une grande
simplicité d'application. En particulier, il ne sera pas nécessaire
de modifier les limites actuelles des circonscriptions (sauf en Ile-de-France
comme nous le verrons ci-dessous). D'ailleurs, les travaux d'A. Piatier,
prolongements de sa « Radioscopie des communes de France »
réalisée en 1974 sur les flux sociaux économiques,
ont montré qu'il y avait une étonnante adéquation
entre la zone d'influence d'un pôle urbain et le territoire
couvert par une circonscription. Les flux entre circonscriptions,
lorsqu'ils existent, manifestent l'existence d'un superpôle,
et sont, dans ce cas, parfaitement pris en compte par la ZLE de ce
superpôle.
- Le cas particulier de l'Ile-de-France
L'Ile-de-France représente une exception
dans le système général, source à la fois
de privilèges et de difficultés. D'une part, pour les
communications locales, la circonscription de Paris correspond à
l'ancien département de la Seine, et comprend donc, outre la
ville de Paris actuelle, la majeure partie des trois départements
qui l'entourent, soit 3 600 000 abonnés qui peuvent se joindre
au tarif local.
D'autre part, pour les communications de voisinage,
deux zones périphériques ayant des limites situées
à environ 20 et 30 km de Paris beneficent depuis 1964 d'un
tarif préférentiel (respectivement 120 et 72 secondes)
avec la capitale.
Enfin, pour les communications interurbaines avec la province, la distance en Ile-de-France est toujours mesurée à partir de Paris, quel que soit le département de départ. Cela conduit à des incohérences telles qu'un appel Provins-Troyes (67 km) coûte deux fois plus cher qu'un appel (Pro- vins-Pont-Audemer (222 km).
Ici, la simple application des Z.L.E. ne peut suffire
à restructurer la tarification de façon satisfaisante.
De nombreuses études dans le cadre de groupes de travail réunis
régulièrement depuis 1977 ont conclu à un redécoupage
nécessaire de l'Ile-de-France en 30 circonscriptions, qui devrait
améliorer fortement la situation des abonnés de banlieue
et de grande banlieue, et cela, sans léser les abonnés
de Paris et de la première couronne, grâce à l'application
des Z.L.E.
- Le Contrat de Plan
Le Contrat de Plan de quatre ans qui encadre
la politique tarifaire de France Télécom impose une
baisse moyenne de 3 % par an, par rapport au niveau de prix du P.I.B.
(Produit Intérieur Brut), et cela, pour toute la durée
du Contrat, c'est-à-dire jusqu'en 1994.
Si, comme on peut l'envisager, l'augmentation
du prix du P.I.B. est de l'ordre de 3 % par an, il suffirait à
France Télécom pour respecter le Contrat de Plan, de
ne pas modifier ses tarifs en francs courants. Or, pour rester conforme
aux recommandations de la C.E.E., il serait souhaitable que France-Télécom
révise la structure de ses tarifs sous l'éclairage de
la vérité des prix.
Cela suppose une augmentation des frais fixes (raccordements
et abonnements) ; une hausse du prix des communications locales ;
et la poursuite de la baisse des communications interurbaines et internationales.
Bien entendu, les baisses doivent compenser les hausses pour respecter
l'évolution quasi nulle en francs courants (et de l'ordre de
- 12 % en francs constants) prévue sur les quatre ans.
Ainsi, au terme du Contrat de Plan, en 1994,
on devrait aboutir à :
- un tarif local plus cher (de l'ordre d'une
U.T. toutes les 3 ou 4 minutes), compensé par un tarif de voisinage
moins cher, grâce à la mise en place des Z.L.E. ;
- un tarif lointain (une U.T. toutes les 18
ou 19 secondes) moins cher et une baisse du tarif international talonné
par la concurrence ;
- un abonnement plus cher (40 ou 45 F par mois
sur l'ensemble du territoire) et des frais de raccordements en hausse.
Conclusion
En France et en Europe, deux raisons, la maturité
des réseaux et un environnement de plus en plus concurrentiel,
concourent à faire évoluer les tarifs en tenant davantage
compte de la réalité des coûts.
Ainsi voit-on se développer des paramètres
concernant le volume, la durée des appels et l'heure à
laquelle ils s'écoulent, tandis que le rôle de distance
s'amenuise.
En France cette évolution conduit parallèlement
à envisager des mesures de remise en ordre de la géographie
et des règles tarifaires, dont la plus originale, déjà
adoptée par plusieurs pays voisins, est la mise en place des
Zones Locales Elargies.
Cette réforme, inscrite au Contrat de
Plan entre France Télécom et l'Etat, relève donc
aussi d'un souci d'harmonisation européenne. Dans quelques
années, le même principe de tarification sera sans doute
appliqué aux relations frontalières, et l'Europe progressera
ainsi dans les faits.
1997 : Tarification à la seconde (description).
Le 1er octobre 1997 marque l’abandon par comptage à intervalles
réguliers des Unités Télécom pour un nouveau
système de facturation des communications à la seconde
près sur la base d’un prix à la minute (mais moyennant
un crédit-temps à chaque début de communication
à prix fixe, crédit-temps compris entre 8 et 180 secondes
suivant la destination demandée). Cet événement
est dénommé « tarification à la seconde
».
La tarification à la seconde apparaît
plus juste, car l’on ne paye que ce que l’on consomme (après
le crédit temps à coût fixe facturé au
début de chaque communication). Auparavant, tout intervalle
de temps commencé entre deux impulsions de taxation était
dû d’avance et en totalité et ce même si l’abonné
raccrochait son téléphone bien avant l’arrivée
de l’Unité Télécom suivante.
De plus, la tarification à la seconde
est plus précise car, étant donné que jusqu’alors,
les baisses successives de tarifs (distances et plages horaires) ont
été faites en rallongeant la durée entre chaque
impulsion, les intervalles devenant statistiquement de plus en plus
longs entraînaient une distorsion de plus en plus importante
entre la réalité consommée et la réalité
facturée.
Concernant le cas de la facturation des communications
par paquet d’Unités Télécom forfaitaires
(dans le cas de service à coût fixe comme l’horloge
parlante) : ces communications sont désormais imputées
directement en francs sur la facture.
Enfin, en plus d’être un argument
commercial en terme publicitaire, la tarification à la seconde
permet une facturation plus aisée à mettre en œuvre
au niveau des calculateurs et permet aussi la multiplication avec
souplesse du nombre d’offres tarifaires.
Après 1997 il n'y aura plus de changement pour
la taxation et la facturation pour le téléphone fixe.
Sommaire
La taxation à distance ou Télétaxe / Télécomptage
Ce service de retransmission
des impulsions de taxes est primordial pour le fonctionnement des
taxiphones et publiphones interurbains, qu'ils soient à pièces
ou à cartes prépayées et aux particuliers (bar,
restaurants ...) proposant un service de téléphone et
de payement selon la durée.
Mise en service : depuis la parution du décret n°52-1231
du 13 novembre 1952 à titre expérimental, puis remplacé
par le décret n°55-53 du 8 janvier 1955, service
actuellement en vigueur par l’avis NOR : PMEI1314577V paru au
journal officiel du 13 juin 2013 et par l’arrêté
du 31 octobre 2013 NOR : PMEI1325257A relatifs au service universel,
les commutateurs téléphoniques sont également
en mesure de retransmettre, via la ligne téléphonique,
les impulsions de comptage (facturées et mémorisées
par le commutateur au cours de toute conversation payante) et ce pour
toute ligne téléphonique au domicile des abonnés
qui souscrivent au service spécifique de Dispositif de Renvoi
des Impulsions de Comptage sur un compteur spécial prévu
à cet effet.
En interne à Orange, ce service est codifié par l’appellation
TTX, et seul le compteur installé
au centre téléphonique fait foi.
Le 1er dispositif 50 Hz : Le commutateur envoie
par la ligne téléphonique des impulsions périodiques
modulées en mode commun à la fréquence de 50
Hz, via la terre utilisée en 3ème fil fantôme
(ou réel lorsque la terre chez l’abonné est très
mauvaise).
Ce système est également utilisé pour assurer
l’encaissement des publiphones à jeton ou à monnaie
des classes urbaine et interurbaine, dont une grosse part des travaux
relatifs à la taxation à distance et aux appareils à
encaissement dans les années 1950 sont dus à M. Jean
Briend, Ingénieur en Chef à la Direction Générale
des Télécommunications.
La première impulsion de taxation est dédoublée
par une inversion de la polarité de la ligne téléphonique,
afin de permettre le fonctionnement des plus anciens types de téléphones
à encaissement de monnaie ou de jeton qui font appel à
un électro-aimant d’encaissement spécifique.
Le procédé 50 Hz bien que devenu marginal, existe toujours
: en cas de ligne téléphonique de grande longueur, il
est le seul procédé à pouvoir couvrir les longues
distances.
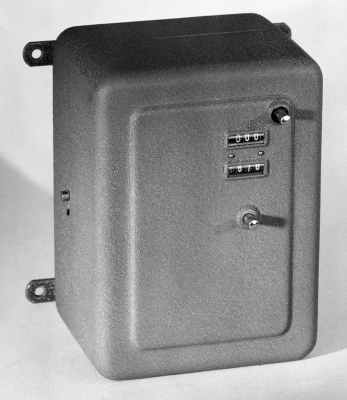 Premier modèle de Compteur de Taxes au domicile de l'abonné
au téléphone. Système 50
Premier modèle de Compteur de Taxes au domicile de l'abonné
au téléphone. Système 50
2ème dispositif 12 KHz : à partir
de Juillet 1977 (date de découverte) et jusqu’en 1983,
pour cause de fraude massive dite « fraude au 50 Hz »
dans les téléphones publics, le dispositif à
50 Hz est progressivement remplacé par une modulation d’impulsions
périodiques de 12 KHz réalisée entre les deux
fils de chaque ligne téléphonique connu depuis sous
la dénomination : Dispositif de Renvoi d’U.T post 83.
En plus des publiphones à monnaie ou à jeton, les publiphones
à cartes reliés à une ligne analogique utilisent
également ce dispositif.
La première impulsion de taxation à 12 KHz est également
dédoublée par l’inversion de polarité pour
permettre le fonctionnement des anciens téléphones à
monnaie ou à jetons.
Le premier modèle supportant la taxation à 12 KHz reprend
le même boîtier que le second modèle en système
50 Hz.
 Compteur de taxes téléphoniques installé
chez l'abonné
Compteur de taxes téléphoniques installé
chez l'abonné
La retransmission des impulsions
de taxation à distance nécessite le rajout d’équipements
supplémentaires contigus au commutateur qui nécessitent
un câblage intermédiaire supplémentaire au répartiteur
d’abonnés lors de la mise en service du dispositif.
Depuis le 1er décembre 1986, l'administration
n'installe plus de compteurs de taxes à domicile ; il revient
désormais à l'abonné de s'acheter et d'installer
son propre compteur de taxes.
Depuis le 1er janvier 1988, l'administration
n'assure plus la maintenance des compteurs de taxes installés
chez les abonnés ; il revient depuis lors à l'abonné
d'entretenir son propre compteur de taxes (ou le modèle administratif
préinstallé) à ses frais.
En revanche, le Dispositif de Retransmission
des Impulsions de Taxes au domicile de l'abonné demeure toujours
disponible actuellement, et il reste possible d'y souscrire.
Sommaire