Le réseau téléphonique du Palais Bourbon
La Troisième République,
est le régime républicain en vigueur en France de septembre
1870 à juillet 1940.
 Téléphoniste
sous la troisième république
Téléphoniste
sous la troisième république
Jonathan Chibois
Je suis un anthropologue du politique,
j'étudie les systèmes d'informations à l'Assemblée
nationale française et ailleurs pour mieux connaître notre
démocratie représentative en ce début de XXIe siècle.
J’ai le plaisir de vous annoncer la publication de mon dernier
article dans la Revue française de science politique, sur ces
curieux personnels que la Chambre des députés a longtemps
employés pour s’occuper du réseau téléphonique
du Palais Bourbon, à partir de 1881.
Je m’intéresse dans ces quelques pages
à ces curieux personnels que la Chambre des députés
a longtemps employés pour s’occuper du réseau téléphonique
du Palais Bourbon, à partir de 1881. Ces pages sont issues d’un
des quelques chapitres terminés de ma thèse, sur lequel
je travaillais en juin 2016, dont l’embonpoint m’a finalement
obligé à quelques coupes. Aussi bizarre que cela puisse
paraître, on ne retrouvera donc cette histoire de téléphoniste
que de manière anecdotique dans mon manuscrit final, alors même
qu’elle synthétise presque à elle-seule l’ensemble
de mon argument.
Mon premier objectif était dans ces pages de montrer que les
parlementaires n’ont pas (du tout) attendu le début du XXIe
siècle, ou même la seconde moitié du XXe siècle,
pour se saisir des techniques de communications modernes et au travers
elles questionner, renouveler, optimiser, le travail quotidien de la
représentation politique. La manière dont ils se sont
appropriés le téléphone à la fin du XIXe
siècle rappelle de fait grandement la manière dont ils
se sont appropriés le téléphone mobile, et même
Twitter, Telegram & co, plus d’un siècle plus tard.
J’en viens donc, entre les lignes ici, à défendre
l’idée que la manière dont on fait de la politique
dépend largement des outils, de techniques et de moyens que l’on
a à sa disposition, et en particulier de l’infrastructure
de communication qui nous entoure.
Mais, j’avais aussi ce souci avec ce projet d’exploiter et
de faire connaître cette mine de données qui existe dans
les archives de l’Assemblée nationale concernant l’aventure
que fut l’installation du téléphone au Palais. Ces
cartons n’ont pour ainsi dire jamais été exploités
en tant que tels, bien qu’ils soient riches et passionnants (la
seule exception réside à ma connaissance dans quelques
paragraphes de cet ouvrage). On y lit tous les enjeux que posèrent
l’émergence d’un moyen de communication inattendu à
une institution centrale de la République, à une période
de l’histoire où les infrastructures de communication commençaient
à peine à se mettre en place. Il y a encore beaucoup à
dire sur la question, je vous invite à vous y plonger à
votre tour.
En voici, le résumé :
Cet article traite des transformations du métier de député
en France durant la IIIe République, engendrées par l’installation
du téléphone et la création d’un service chargé
de son exploitation au Palais Bourbon, à partir de 1881. L’analyse
des archives historiques de la questure de la Chambre montre qu’en
raison de différentes contraintes, l’appropriation de ce
moyen de communication a été singulière, au sens
où elle a pris la forme d’un usage par délégation.
Plutôt que de téléphoner eux-mêmes, les députés
se sont en effet peu à peu déchargés de leurs appels
sur les téléphonistes, inaugurant des modalités
inédites de division du travail parlementaire. La formalisation
des usages du téléphone chez les députés
illustre alors la rationalisation du parlementarisme français
au début du 20e siècle.
Il faut remonter au temps où le
principe de la communication longue distance (quasi) instantanée
a cessé d’être un monopole d’État, laissant
la possibilité aux citoyens les plus riches de se l’approprier
pour faire des affaires juteuses. En France, tout ça se passe
grosso modo au début du Second Empire, alors que les députés
sont pour l’essentiel des notables, qui ont donc comme motivation
(parmi d’autres, j’entends) de faire fructifier leur patrimoine,
et que le déploiement du télégraphe électrique
remise le télégraphe aérien au rang d’antiquité,
en offrant la possibilité de converser (par opérateurs
interposés) avec les colonies et les places boursières
internationales. Voilà pour le contexte.
Où l’on apprend que les députés boudaient
les communications interurbaines
En 1882 donc, cela faisait près de trente
ans que le télégraphe électrique était déployé
partout dans le monde et s’était significativement démocratisé,
au point que même les citoyens moins fortunés pouvaient
l’utiliser au besoin (pour traiter affaire familiale par exemple),
chaque commune française disposant de plusieurs postes (au bureau
de poste, à la gare, à la mairie, à l’entreprise,
à la centrale électrique…). Les tarifs n’étaient
plus prohibitifs, les services étaient variés : envoyer
et recevoir un télégramme relevait d’une normalité.
C’était dans ce contexte que le téléphone
tentait depuis quelques années de faire sa place, en concurrence
technique directe avec le réseau télégraphique,
en vantant la possibilité de converser par la voix et cela sans
opérateur pour faire fonctionner le poste terminal. De belles
promesses qui amènent plusieurs questions concernant la Chambre
des députés. Qu’est ce qui a réellement motivé
les députés à abandonner le télégraphe
pour le téléphone ? Comment s’est passé la
transition ? Quels furent les usages premiers du téléphone
dans la vie parlementaire ?
Mon hypothèse était la suivante. Compte
tenu du fait que les députés de la Troisième République
devaient, tout en étant très occupé à Paris,
assurer une présence forte dans leur circonscription pour espérer
être réélus (comme aujourd’hui donc), je supposais
que le téléphone, et en particulier le réseau interurbain,
avait pu venir les soulager, en leur évitant un certain nombre
de déplacement du fait de la possibilité de traiter certaines
affaires à distance. Il faut préciser que si cette tension
local/national du mandat était similaire à aujourd’hui,
elle était autrement plus compliqué à résoudre.
D’une part, la Chambre n’offrait aucune assistance à
l’époque pour ce qui était de financer des collaborateurs
et un logement d’appoint à Paris, ce qui faisait que le
déménagement à la capitale était incontournable
pour qui se faisait élire député. D’autre
part, bien que le réseau de chemin de fer soit relativement étoffé
déjà, les temps de transports étaient d’une
manière générale nettement plus longs, ce qui rallongeait
sensiblement les aller-retours hebdomadaires.
Et bien non. La dépouille des archives de l’Assemblée
montre que si, depuis 1882 les communications téléphoniques
progressèrent de manière rapide et constante jusqu’aux
années 1920, moment où leur croissance explosa littéralement,
il faut toutefois distinguer les communications locales des communications
interurbaines. Or, ces dernières restèrent marginales
: moins de 1% du volume total annuel jusqu’aux années 1930
(à l’exception de la guerre 14-18 où l’on trouve
un pic à 10%). Les raisons étaient multiples, en deux
mots : le réseau national fut longtemps dans un état désastreux,
faisant que les communications étaient chères, les temps
d’attentes longs, les conversations souvent inaudibles et les coupures
fréquentes. Les promesses du téléphones n’étant
pas tenues, il semble que les députés préférait
préserver leurs habitudes télégraphiques en ce
qui concerne les communications longues distances.
Où l’on apprend que les députés boudaient
aussi les communications locales
Je me suis alors trouvé avec le paradoxe suivant. Alors que,
vu du XXIe siècle, le téléphone paraissait être
un moyen de communication idéal pour assurer une présence
continue dans un cadre de vie nomade, toute porte à penser qu’entre
1882 et 1920 il ne fut utilisé que dans un cadre local, sur le
réseau spécifiquement parisien. À en croire les
rapports annuels des téléphonistes de la Chambre, ces
usages téléphoniques locaux commençaient à
être même nombreux à la fin de la guerre. Pour preuve,
nous dit-on, en 1920, la Chambre a demandé 80 000 communications
vers l’extérieur. C’est un volume qui paraît
effectivement important comparé aux 20 000 de l’année
1900. Cependant, si on le rapporte à une grandeur connue, un
rapide et grossier calcul (80 000 communications ÷ 613 députés
÷ 52 semaines), nous apprend que tout se passait alors comme
si chaque député effectuait 2,5 appels par semaine.
Ça paraît en fait très peu comparé à
aujourd’hui où les terminaux téléphoniques
se multiplient sur les bureaux et dans les poches, mais comment en juger
par rapport aux autres moyens de communications disponibles à
l’époque ? Pour le télégraphe, qu’il
soit électrique ou pneumatique, impossible de savoir puisque
les terminaux étaient disposés dans un bureau public (bien
que lui-même installé dans le Palais Bourbon), où
les communications des députés et des résidents
du quartier n’étaient pas distinguées (pas même
en tarif). Par contre, pour ce qui est du courrier, plusieurs témoignages
indiquent que les députés pouvaient recevoir entre 20
et 60 lettres par jour, pour ne parler que de celles en provenance de
leur circonscription. Ces dernières contenaient diverses demandes
dont chacune nécessitait de la part du député de
rédiger pour chacune au moins trois autres lettres (un accusé
réception à destination du demandeur, une transmission
de la demande à qui de droit, puis plus tard une réponse
au demandeur). Bref, ça faisait du volume. À l’aune
de l’usage du courrier, donc, le téléphone paraît
avoir été largement sous-utilisé.
Mais, quoique minimes, la question de ces usages locaux
du téléphone demeure. Quels étaient-ils ? Difficile
à établir vu qu’il n’existe pas (à ma
connaissance) de témoignages de députés à
ce sujet, et les archives de l’Assemblée sont peu loquaces
sur ce point. On sait simplement que le service dit de « messages
téléphonés », était plutôt apprécié
et usité. Dans le sens entrant, un téléphoniste
de la Chambre prenait en note un message pour courir l’apporter
à un député en séance (ou ailleurs dans
le Palais) ; dans le sens sortant, le député dictait un
message à un téléphoniste qui le transmettait (par
téléphone) à l’agent de la Société
générale du téléphone du bureau le plus
près du domicile du destinataire, et ce dernier se chargeait
de le faire remettre en main propre (ce qui veut dire, oui, que les
facteurs téléphoniques ont existé un jour, marrant
non ?). On notera que ce sur ce plan, le téléphone était
placé en concurrence directe avec le télégramme,
dont il imitait le principe. On sait aussi que les téléphonistes
étaient chargés pour les députés en partance
pour leur circonscription de réserver auprès des gares
des places dans les trains, ce qu’il fallait souvent ensuite confirmer
au domicile du député (par téléphone donc).
Constatons alors que si, durant une semaine, le député
envoyait 2 messages téléphonés et faisait réserver
1 place de train, on atteignait déjà pour lui 4 appels,
ce qui était déjà bien plus que 2,5. Peut-être
alors n’est-il pas besoin de chercher plus loin.
À l’origine de la collaboration parlementaire
Mais alors, les députés, en s’appuyant sur le personnel
de la Chambre pour ces quelques services, utilisaient-ils le téléphone
oui ou non ?
D’un côté, non : comme ils ne manipulaient pas le
poste téléphonique de leurs propres mains, on peut se
dire que c’est le fait de disposer d’auxiliaires à
qui déléguer certaines tâches qui importait au premier
chef. D’un autre côté, oui : certes les tâches
demandés au personnel de la Chambre pouvaient être accomplies
autrement que par téléphone, ce sont néanmoins
bien des tâches expressément téléphoniques
qui leur étaient confiées (et non pas télégraphiques
ou postales). Notez que la question se pose pareillement aujourd’hui
: est-ce que faire tenir son propre compte Twitter par un collaborateur
est un usage de Twitter par les députés ? Il est difficile
de trancher sans adopter une posture normative. On a tous une idée
de ce que les députés devraient faire ou mieux faire,
mais ça ne nous aide pas à comprendre pourquoi eux préfèrent-ils
faire les choses d’une autre manière. Poser la question
de l’usage effectif, appelle une réponse morale.
Posons alors la question autrement.
Comment expliquer la présence d’un service téléphonique
à la Chambre, avec un personnel dédié, alors que
précisément une des promesses du téléphone
était la disparition des opérateurs à chaque extrémité
de la ligne pour coder et décoder le message (comme c’était
le cas du télégraphe) ?
Deux éléments de réponse.
Premièrement, le téléphone n’était
initialement disponible qu’à un seul point du Palais Bourbon,
qui plus est excentré, faisant que des personnes devaient aller
chercher les députés quand ils étaient demandés
au téléphone.
Deuxièmement, la mise en relation était initialement longue
et chaotique, et les députés n’ayant pas le temps
d’attendre, il fallait aussi des personnes pour s’occuper
d’établir la communication, puis pour aller chercher les
députés une fois le correspondant en ligne.
Dans les premiers temps, les questeurs traînèrent les pieds,
ils rechignaient à affecter du personnel spécifique pour
courir après les députés, ils préféraient
détacher au besoin un des garçons affectés à
la questure (dont la tâche était précisément
d’arpenter le Palais pour faire transiter les messages entre les
services).
Puis à partir des années 1890, les téléphonistes
attirèrent l’attention de leur hiérarchie sur le
fait que l’usage des députés évoluait. Ceux-ci,
notaient-ils, conversaient de moins en moins en directe avec leurs correspondants,
mais ils laissaient de plus en plus le soin aux téléphonistes
de téléphoner à leur place ou de prendre en note
les messages pour eux, puis de le leur faire parvenir en séance.
Les questeurs cédèrent alors, et progressivement le service
téléphonique s’étoffa : de trois employés
(qui se plaignaient d’être surchargés de travail)
en 1900, il était composé de neuf employés autour
de 1920 (qui se plaignaient d’être toujours autant surchargés).
C’est donc ainsi que naquit un service de secrétariat
à la Chambre, en lien étroit avec le téléphone
qui imposaient aux députés de faire preuve d’une
disponibilité impossible pour eux à tenir.
Ce qui était nouveau ce n’est pas le fait que les députés
disposent de collaborateurs ; ceux parmi les plus riches engageait déjà
depuis le Second Empire des secrétaires particuliers sur leur
fortune personnelle (ou sollicitaient des membres de leur famille pour
les aider). Ce qui était nouveau, c’est plutôt la
prise en charge par la Chambre de ce besoin qu’avaient les députés
de disposer d’auxiliaires dans le travail parlementaire au Palais.
On voit alors que la présence d’un secrétariat collectif
remonte bien avant le pool de “secrétaires dactylographes”
qui était à disposition des députés dans
les années 1930, lui-même déjà considéré
comme l’ancêtre de l’indemnité individuelle de
secrétariat instaurée en 1953, elle-même parente
de la fonction d’assistant parlementaire créée en
1976 (fonction qui, notons-le, sera peut-être dotée d’une
convention collective en 2016 !). D’ailleurs, cette année
1976 fut également celle où le standard téléphonique
cessa d’être le point d’entrée de tous les appels
vers l’Assemblée, puisque fut instaurée la possibilité
de joindre n’importe quel poste interne depuis l’extérieur…
et notamment ceux des bureaux personnels dont on venait tout juste de
doter les députés. Avec de nouveaux collaborateurs installés
dans de nouveaux bureaux, plus rien ne justifiait que le secrétariat
téléphonique soit assuré par le personnel de l’administration,
cette charge leur a donc été transférée.
De fait, aujourd’hui, le service téléphonique n’existe
plus en tant que tel, vraisemblablement démantelé quelques
années plus tard, au début des années 1980.
Voilà comment on découvre par une voie détournée que les collaborateurs des députés au Palais Bourbon ont pour premier ancêtre les téléphonistes de la Chambre (quand les collaborateurs en circonscription seraient plutôt issus des secrétaires particuliers des députés notables).
INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION ET DIVISION
DU TRAVAIL AU PALAIS BOURBON SOUS LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE
Le métier de député est une activité de
relations publiques au moins autant qu’une activité de législateur.
Exercer un tel mandat de représentant politique impose de composer
avec une large variété de personnes : habitants et élus
de circonscription, représentants de groupes d’intérêt,
journalistes, homologues parlementaires, ministres et membres de cabinets,
mais aussi collaborateurs proches à qui il est possible de déléguer
nombre de tâches et même de prérogatives. L’ensemble
de ces personnes constitue un réseau d’affinités
dont la gestion conditionne l’action.
Un député doit savoir s’appuyer sur lui, mais aussi
s’en arranger, pour parvenir à faire avancer les causes
qu’il choisit de défendre et réaliser son projet
politique. Pour solliciter, se rendre disponible mais aussi assurer
sa visibilité médiatique au quotidien, il dispose aujourd’hui
de plusieurs outils de communication, dont la pièce centrale
est le téléphone mobile. Ce dernier lui permet de garder
en toute circonstance l’ensemble de ces différents contacts
à portée de voix, de synchroniser avec eux ses activités
et plus généralement de demeurer informé.
La part de l’activité relationnelle au sein du travail de
représentation parlementaire n’est pas neuve.
Sous la Troisième République, en plus de siéger
dans la salle des séances pour légiférer, les députés
passaient déjà de longues heures chaque jour au Palais
Bourbon à répondre au courrier en provenance des circonscriptions,
mais aussi à arpenter les antichambres des ministères
pour faire valoir les droits et les revendications de leurs électeurs
(1).
Le bureau de poste accolé au Palais Bourbon disposait aussi d’un
télégraphe électrique, dont les députés
se servaient largement pour échanger des messages à grande
distance dans des délais resserrés, mais qui n’autorisait
pas un usage conversationnel proprement dit (2) .
Jusqu’au début du 20 e siècle, pour tenir une discussion,
par exemple pour rapporter un récit, pour débattre d’une
conduite à tenir en séance ou pour convaincre du bien
fondé d’une position politique, un député
devait être physiquement présent face à son interlocuteur.
Cette contrainte s’est dissipée à partir de 1879,
au fur et à mesure que les lignes téléphoniques
étaient déployées sur l’ensemble du territoire
national (3). Cet outil, offrant soudainement aux députés
la possibilité de converser de vive voix à distance, a
induit pour eux de nouvelles manières de gérer leur réseau
d’affinités, et donc d’envisager leur mandat.
1. Les témoignages de cette réalité sont nombreux.
Pour une synthèse, cf. Pierre Guiral, Guy Thuillier, La vie quotidienne
des députés en France, de 1871 à 1914, Paris, Hachette,
1980, chap. 4.
2. Quoique dans d'autres contextes, notamment dans le secteur marchand,
un tel usage ait pu être observé. Cf. Patrice Flichy, Une
histoire de la communication moderne. Espace public et vie privée,
Paris, La Découverte, 2004, p. 120.
3. Date de la première autorisation d'exploitation des réseaux
téléphoniques urbains. Cf. Catherine Bertho, Télégraphes
& Téléphones. De Valmy au microprocesseur, Paris,
Le Livre de poche, 1981, p. 196.
La nécessité impérieuse d’être présent
en un lieu pour faire entendre la voix de la représentation nationale
s’est estompée, leur permettant au jour le jour d’envisager
autrement leurs déplacements, leurs collaborations et plus largement
leurs activités. De surcroît, une forme inédite
d’assistance au travail parlementaire a progressivement émané
du service chargé de l’exploitation du téléphone
au Palais Bourbon, les téléphonistes de la Chambre acceptant
peu à peu de passer des appels pour les députés,
se muant par cette occasion en secrétaires téléphoniques.
En cela, le déploiement des réseaux téléphoniques
en France paraît pouvoir être associé aux transformations
du métier de député propres au début du
20e siècle (1) . La première finalité de cet article
est de décrire l’évolution de certaines modalités
de division du travail à la Chambre du fait de l’appropriation
de ce nouveau moyen de communication, durant les presque cinq décennies
qu’a duré la Troisième République.
L’analyse qui suit relève d’une anthropologie politique
des techniques, en ce qu’elle propose d’aborder la question
institutionnelle à partir de la compréhension de sa matérialité
et des rapports humains quotidiens qui la sous-tendent (2) . Elle participe
d’un projet de recherche qui s’inscrit notamment à
la suite des travaux successifs de Madeleine Akrich et Susan L. Star.
D’une part, elle prend comme postulat l’idée que les
dispositifs socio-techniques sont des « instruments politiquement
forts », puisqu’ils sont autant produits que producteurs
des modes d’organisation sociaux dans lesquels ils s’intègrent
(3). D’autre part, cette analyse s’intéresse à
l’installation téléphonique du Palais Bourbon, non
pas tant comme un outil mis à la disposition d’usagers,
mais davantage comme une infrastructure dans laquelle s’encastrent
des enjeux historiquement situés de division du travail, d’innovation
technique et d’organisation sociale (4).
De fait, cet article possède une seconde finalité au-delà
du seul champ des études législatives, celle de documenter
l’appropriation d’un moyen de communication moderne par une
institution d’État. Il apporte une pierre à l’édifice
des études des infrastructures informationnelles des sociétés
contemporaines, en proposant un éclairage en contexte sur un
moment clé de leurs mises en place.
Les matériaux de cette étude de cas proviennent des archives
du Secrétariat général de la questure (1806-1967)
de l’Assemblée nationale. On y trouve plusieurs cartons
relatifs à l’installation, à l’organisation
et à la gestion du réseau téléphonique et
des téléphonistes durant le temps de la Troisième
République (5). Cette documentation rassemble des rapports, des
factures, des modes d’emploi ainsi qu’une abondante correspondance
du personnel du service avec sa hiérarchie et le ministère
des P & T. Il faut également mentionner l’existence
au sein de cet ensemble d’une note synthétique de 1909,
de celles attribuées à un agent de la Chambre nommé
George Gatulle, qui propose une synthèse précise et documentée,
concernant l’historique et les logiques de fonctionnement du service
(6).
1. Nicolas Roussellier, Le parlement de l'éloquence. La souveraineté
de la délibération au lendemain de la Grande Guerre, Paris,
Presses de Sciences Po, 1997.
2. Marc Abélès, « Pour une anthropologie des institutions
», L'Homme, 35 (135), 1995, p. 65-85.
3. Madeleine Akrich, « Comment décrire les objets techniques
? », Techniques & Culture, 9, 1987, p. 49-64.
4. Susan Leigh Star, Karen Ruhleder, « Steps Toward an Ecology
of Infrastructure : Design and Access for Large Information Spaces »,
Information System Research, 7 (1), 1996, p. 111-134.
5. L'essentiel de cette documentation est rassemblé dans le fonds
du Secrétariat général de la questure, sous les
cotes de 12 P 78 à 12 P 84.
6. 13 P 16, « Téléphones de la Chambre des députés
», 1909. Pour plus d'informations sur les « notes Gatulle
», cf. Assemblée nationale, Petite histoire du Palais-Bourbon
par Georges Gatulle, Bordeaux, Elytis, 2011.
Avant d’expliciter en quoi l’appropriation du téléphone
a participé à l’évolution du métier
de député à cette période, plusieurs étapes
préalables seront nécessaires. Il faudra d’abord
expliquer les raisons pour lesquelles la Chambre a fait le choix fin
1881 de souscrire des abonnements téléphoniques, et décrire
la spécificité de l’infrastructure socio-technique
dont elle s’est dotée à ce moment. Il faudra ensuite
présenter le succès du téléphone chez les
députés et les tensions engendrées, pour ensuite
détailler son appropriation singulière. Cela fait, nous
serons alors en mesure de retracer la formalisation de la mission de
secrétaire téléphonique confiée aux téléphonistes
de la Chambre à partir des années 1900.
Un téléphone sur mesure pour la Chambre. Une architecture
de réseau mixte
Les travaux d’installation des premières lignes téléphoniques
au Palais Bourbon ont été réalisés en janvier
1882. Depuis plusieurs années, la questure était sollicitée
en ce sens par différentes compagnies d’exploitation du
téléphone mais aussi de la part du ministre des P &
T. Plusieurs projets avaient été envisagés mais
n’avaient pas été concrétisés, en grande
partie du fait de la prudence de la questure. Celle-ci rechignait à
se lier avec une entreprise privée plutôt qu’une entreprise
d’État et formulait de fortes exigences, comme la gratuité
des communications pour certains de ses usagers. Il faut aussi préciser
qu’en ce début de Troisième République, la
commercialisation de cet appareillage de communication balbutiait,
ses usages étaient entièrement à inventer et son
utilité effective à prouver. Initialement d’ailleurs,
le grand public comme ses démonstrateurs ne s’intéressaient
pas au téléphone pour l’interactivité des
échanges qu’il permettait, mais pour son potentiel en tant
qu’instrument de diffusion culturelle (1) . La questure de la Chambre
y a elle-même vu un vecteur de publicité parlementaire
et s’est d’abord penchée sur le projet de proposer
aux abonnés du réseau parisien la possibilité de
suivre la séance publique à distance sur le modèle
du théâtrophone (2) .
Lorsque, en novembre 1880, il a été décidé
d’étudier l’éventualité de se saisir
du téléphone comme moyen de communication pour les usagers
du Palais Bourbon, c’est un usage spécifiquement interne
que la questure a imaginé (3).
Il s’agissait « d’établir un réseau de
fils électriques qui permette à divers services de l’Administration
de communiquer entre eux à l’aide du téléphone
sans avoir aucunement à se déplacer » (4).
Pourquoi vouloir éviter de se déplacer ? D’abord
en raison d’une politique de régulation de l’espace
et de la population du Palais en cette fin de 19e siècle qui
imposait au personnel de l’administration toujours plus de discrétion
aux yeux du personnel politique de la Chambre (5) .
Les incessantes allées et venues des garçons de bureaux
qui, avant l’installation du téléphone et du pneumatique
au Palais, portaient les missives et la documentation parlementaire
entre les services, apparaissaient alors de moins en moins acceptables.
Ensuite, cette chasse aux déplacements inutiles avait pour cadre
une politique de modernisation bureaucratique. On considérait
nécessaire de rationaliser la transmission des informations (pour
en réduire les délais) et la coordination générale
(pour en améliorer l’efficacité) entre les bureaux
de l’administration parlementaire dispersés en différents
endroits du Palais.
1. Patrice A. Carré, « Un développement incertain
: la diffusion du téléphone en France avant 1914 »,
Réseaux, 9 (49), 1991, p. 27-44, dont p. 33.
2. 13 P 16, op. cit., 1909. Le théâtrophone a été
un service populaire jusqu'à la fin des années 1920 :
à ce sujet, cf. Danièle Laster, « Splendeur et misères
du théâtrophone », Romantisme, 13 (41), 1983, p.
74-78.
3. 13 P 16, op. cit., 1909.
4. 12 P 79, lettre de l'architecte de la Chambre aux questeurs, novembre
1880.
5. Delphine Gardey, Le linge du Palais-Bourbon. Corps, matérialité
et genre du politique à l'ère démocratique, Lormont,
Le Bord de l'eau, 2015, chap. 3.
Notons que cette dernière démarche des questeurs n’était
pas inédite, elle rejoignait celle d’autres administrations
publiques et privées qui, à la
même période et dans un même souci, investissaient
dans des appareils de transport de documents dans une réflexion
mêlant aménagement de l’espace et organisation du
travail (1) .
Ce sont neuf lieux stratégiques du Palais qui ont été
initialement identifiés et sélectionnés pour recevoir
un appareil téléphonique : l’hémicycle, le
bureau des procès-verbaux, le service du compte rendu analytique,
l’imprimerie, le cabinet de la présidence, le secrétariat
général de la présidence et certains appartements.
Comment ces neuf lieux ont-ils concrètement été
reliés entre eux ?
Dans un premier temps, la questure avait prévu un ensemble de
lignes dites directes, dans une architecture qui n’était
pas à proprement parler un réseau (2). En effet, ces lieux
clés étaient reliés deux par deux, en décalquant
l’installation téléphonique sur les flux de circulation
d’informations qui présidaient au processus législatif.
Cette solution a finalement été abandonnée au profit
d’une solution structurée autour d’un dixième
appareil appelé le poste central ou le multiple, auxquels les
neuf autres étaient reliés, qui était confié
à un opérateur chargé d’établir manuellement
et au cas par cas les liaisons demandées entre chacune de ses
branches (3).
Une telle installation en étoile était d’une part
plus souple à l’usage, puisqu’elle ne nécessitait
l’installation que d’un seul appareil dans chaque bureau,
quel que soit le nombre de destinataires joignables ; elle était
d’autre part plus économe en longueur linéaire de
fils, en nombre d’appareils et in fine en souscriptions d’abonnement
à la Société générale des téléphones.
Il faut savoir enfin que ce poste central était situé
dans un local nommé salle des téléphones, longtemps
accolé au secrétariat de la questure, si bien que ce dernier
n’était pas doté lui-même d’appareil propre
(4) .
Ainsi centralisée, cette architecture en réseau dotait
non seulement la questure d’un poste d’observation privilégié
pour surveiller les usages du téléphone au Palais, mais
reproduisait aussi l’organigramme de l’administration parlementaire.
Cependant, le réseau téléphonique de la Chambre
n’a pour ainsi dire jamais été exclusivement interne
et centralisé. Au cours des semaines et des mois qui ont immédiatement
suivi l’installation, en janvier 1882, de multiples ajustements
ont été effectués à cette installation suite
à son insuffisance manifeste (5) . En premier lieu, plusieurs
lignes ont été ouvertes vers le central téléphonique
le plus proche (vraisemblablement celui d’Opéra),
de façon à permettre les appels vers les abonnés
du réseau parisien. Une première a été souscrite
pour le poste central, à l’usage de la questure et des services
reliés au réseau interne. Deux autres ensuite l’ont
été pour l’usage plus spécifique des députés,
qui n’étaient pas branchées au poste central mais
indépendantes, dont les appareils étaient malgré
tout disposés dans la salle des téléphones, dans
des cabines insonorisées. En second lieu, certains services et
certains responsables de la Chambre se sont vus attribuer, en plus d’une
liaison avec le poste central, des lignes directes soit vers l’intérieur
soit vers l’extérieur du Palais. Il s’agissait par
exemple de permettre à la présidence de joindre sans intermédiaire
la préfecture de Police, aux appartements des questeurs de bénéficier
d’un accès direct au réseau parisien ou encore de
créer une liaison dédiée entre le service du compte
rendu analytique et son imprimerie. En troisième lieu, les directeurs
des journaux ont demandé à ce qu’un appareil soit
installé à leurs frais près des tribunes de la
presse, à proximité de l’hémicycle, directement
relié au réseau parisien afin de pouvoir joindre leurs
journalistes. Au fur et à mesure de son installation, il a donc
résulté de la découverte des usages possibles du
téléphone une architecture de réseau mixte à
la Chambre.
1. Delphine Gardey, La dactylographe et l'expéditionnaire.
Histoire des employés de bureau (1890-1930), Paris, Belin, 2001,
p. 134-136.
2. Il faut rappeler ici que, de manière générale,
et pour Alexander Graham Bell lui-même, l'idée d'organiser
les intercommunications téléphoniques en réseau
n'a pas émergé immédiatement, mais seulement après
plusieurs années. À ce sujet, cf. P. A. Carré,
« Un développement incertain... », art. cité.
3. 12 P 79, op. cit., 1880.
4. 13 P 16, op. cit., 1909.
5. 13 P 16, op. cit., 1909, p. 6 et suiv.
Les messieurs du téléphone
Une fois le chantier effectué, les lignes installées et
les appareils branchés, la questure a créé par
arrêté un service dédié au sein de son administration
pour en assurer le fonctionnement quotidien (1 ). Il était conçu
pour fonctionner avec trois personnes : un commis, un opérateur-téléphoniste
et un garçon de bureau. Le commis était le téléphoniste
en chef (ou téléphoniste principal), il lui revenait les
responsabilités administratives du service. Elles consistaient
notamment à tenir à jour un registre des communications,
à attribuer à toute demande d’appel vers l’extérieur
un ordre de passage (selon leur ordre d’arrivée mais aussi
leur priorité relative), ainsi qu’à prendre en note
d’éventuels messages reçus afin de les adresser à
leurs destinataires. L’opérateur-téléphoniste,
sous les ordres du premier, était chargé pour sa part
de toutes les tâches ayant un lien avec la manipulation du matériel.
Il lui revenait non seulement de s’assurer du bon fonctionnement
et de l’entretien des appareils et lignes, mais aussi d’établir
les communications internes et externes demandées par les services
administratifs sur le multiple, puis d’y mettre fin une fois la
conversation de l’usager terminée. Le garçon de bureau,
quant à lui, était le dernier de cette courte hiérarchie.
Il avait à sa charge les deux cabines dédiées aux
députés, à qui il proposait son assistance pour
la manipulation des appareils, et pour qui il prenait les appels entrants
afin de partir à leur recherche dans les couloirs du Palais Bourbon
pour les prévenir ou leur remettre un message pris en note.
La politique de modernisation bureaucratique – dont on a vu plus
haut qu’elle a en partie présidé au choix d’installer
le téléphone au Palais Bourbon – se manifeste ici
aussi dans le choix de constituer un service dédié au
téléphone. La logique de rationalisation a conduit la
Chambre à doter l’ensemble de son administration de nouveaux
outils et également à se restructurer pour une meilleure
différenciation de ses services et une plus grande spécialisation
des activités de ses personnels. Il en a résulté
notamment un doublement des effectifs de son personnel entre 1871 et
1914 (2), ainsi que la bipartition entre les services administratifs
et les services législatifs, encore en vigueur aujourd’hui,
qui distingue les personnels selon la proximité de leur activité
avec le travail parlementaire (3) . C’est également à
cette période qu’ont été créées
de nouvelles entités en son sein, chargées non pas directement
du travail parlementaire mais d’une fonction méta (4) ,
celle du traitement des données administratives en tant que telles,
dans le but de favoriser la circulation et la diffusion de l’information
entre tous ses acteurs.
1. 12 P 78, arrêté de questure
du 13 janvier 1882.
2. Hervé Fayat, « Le métier parlementaire et sa
bureaucratie », dans Guillaume Courty (dir.), Le travail de collaboration
avec les élus, Paris, Michel Houdiard, 2005, p. 29-48, dont p.
37.
3. D. Gardey, Le linge du Palais-Bourbon..., op. cit., p. 147-150.
4. Au sens d'A. Strauss : « A kind of supra-type of work »
(Anselm Strauss, « Work and the Division of Labor », The
Sociological Quarterly, 26 (1), 1985, p. 1-19, dont p. 8).
Au service de la lithographie revenait par exemple la charge de dupliquer
les documents parlementaires. Au service des téléphonistes
revenait celle de faire circuler les instructions présidant au
bon déroulement du processus législatif (1) .
Ce travail de traitement des données existait auparavant, mais
il était éparpillé. Différentes personnes
au sein de différents services en assumaient à leur niveau
une partie (par exemple en tant que dactylographe). Avec la mécanisation
d’un certain nombre de processus, qui requerraient des savoir-faire
spécifiques, ces fonctions ont été rassemblées
et confiées à des personnels spécialisés.
Autrement dit, à la fin du 19 e siècle, la questure a
entrepris de poser les premières pierres d’une infrastructure
informationnelle centralisée, cela notamment au travers de la
création du service du téléphone, dont les téléphonistes
se sont vus attribuer la gestion. Leur activité étant
davantage transversale que spécifiquement administrative ou législative,
leur place était hors de l’organisation bipartite nouvellement
instaurée, si bien qu’ils n’ont jamais été
intégrés à l’organigramme officiel (2). Un
tel positionnement se retrouve d’ailleurs aujourd’hui pour
le service des systèmes d’information, à qui est
confié l’entretien du réseau informatique qui relie
une multitude de points du Palais, mais aussi le développement
des applications métiers au travers desquelles le processus législatif
se déroule désormais (3) .
Il faut voir alors que, de la sorte, les téléphonistes
de la Chambre avaient beaucoup à voir avec les demoiselles du
téléphone. Comme elles, la responsabilité du bon
fonctionnement du service leur était confiée, par le soin
d’établir les liaisons, par la gestion des priorités
d’appel et (au besoin, de manière informelle) en offrant
de prendre un message ou de rappeler une fois une ligne occupée
devenue libre. Comme elles, ils prenaient sur eux les contraintes dont
se libéraient les usagers (4 ). Cette proximité de condition
était ressentie au quotidien, preuve en est qu’en 1919,
elle a été invoquée comme argument pour négocier
auprès de la questure une revalorisation salariale (5) . Il faut
dire que, fonctionnellement parlant, le service du téléphone
de la Chambre était comme un central de petite taille, obligé
pour fonctionner de se coordonner avec ceux du réseau parisien,
et tout particulièrement avec le central Gutenberg
à partir de son ouverture en 1891 (6) . Lorsqu’une personne
du Palais demandait à joindre un abonné, le téléphoniste
ne pouvait y satisfaire seul, il lui fallait relayer sa demande à
une opératrice du central, jusqu’à atteindre celui
de l’abonné en question. En sens inverse, la logique était
identique, c’était à eux d’établir la
connexion finale vers l’intérieur du Palais demandée
par une opératrice. Le degré d’interdépendance
était tel que certaines des demoiselles du central Gutenberg
ont été spécialement affectées à
la gestion des lignes de la Chambre, afin de garantir la fluidité
des communications d’intérêts considérés
comme supérieurs et plus complexes que les autres (en raison
par exemple de règles de priorité d’appel ou de règles
spécifiques de facturation).
1. Concernant le service de la lithographie, voir la cote 13 P 11.
2. Julien Le Magueresse, Répertoire numérique détaillé
des archives du Secrétariat général de la questure.
Notes historiques (1899-1945). 13 P 1-75, Assemblée nationale,
service de la bibliothèque et des archives, juillet 2010.
3. Au sujet du service des systèmes d'informations, de ses missions
et des enjeux entourant ses réalisations, cf. Jonathan Chibois,
« Du logiciel libre pour l'Assemblée nationale : liberté
du code versus liberté des usages », dans Camille Paloques-Berges,
Christophe Masutti (dir.), Histoires et cultures du Libre. Des logiciels
partagés aux licences échangées, Framabook, 2013,
<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00820360>.
4. Virginie Julliard, « Une “femme machine” au travail
: la “demoiselle du téléphone” », Quaderni,
56, 2004, p. 23-32.
5. 12 P 78, « Rapport de l'année 1919 ». Plus précisément,
le salaire des téléphonistes de la Chambre a été
aligné sur celui des dames téléphonistes, ces opératrices
des centraux qui bénéficiaient du grade d'employée
de l'Administration des PTT (et non pas d'auxiliaire) leur conférant
divers avantages.
6. Au cours de son histoire, le Palais Bourbon a été relié
successivement ou complémentairement à plusieurs centraux,
comme Opéra, Wagram et Gutenberg, même
si ce dernier paraît avoir été le principal.
Comment expliquer que le personnel du téléphone soit exclusivement
masculin à la Chambre, alors qu’il est à l’inverse
féminin dans toutes les administrations publiques et privées,
en France, en Europe et aux États-Unis à la même
période ?
Pour le comprendre, il faut rappeler que l’histoire de l’administration
de l’État français est essentiellement faite d’hommes,
avant que ne s’opère un grand renversement initié
par le recrutement massif des secrétaires sténodactylographes
au début des années 1880 (1) . Dans le secteur des technologies
de communication d’État, que ce soit l’administration
des postes, du télégraphe et de celle du téléphone
(avant leur fusion), ce revirement a fait l’objet d’énergiques
protestations, qui n’ont pas suffi à contrebalancer l’attrait
d’une main-d’œuvre à bas coût, dans le contexte
de détérioration du climat économique de la fin
de siècle (2). Il se trouve qu’à la Chambre, les
téléphonistes étaient choisis sur un critère
de confiance parmi le personnel déjà en poste. Or, comme
depuis la Révolution régnait une culture d’institution
sexiste car élitiste, ce personnel était exclusivement
masculin, encore sous la Troisième République. Par ailleurs,
contrairement aux autres administrations, le temps était ici
à un accroissement des moyens qui n’a pas obligé
la questure à s’engager dans ce mouvement de féminisation
(3). Ainsi, le fait que nous soyons face à deux services semblables
dans leurs missions mais opposés dans le genre de leur personnel
illustre l’inertie dont a pu faire preuve la Chambre pour préserver
entre ses murs des usages et des représentations du travail qui
étaient, dans le même temps, progressivement abandonnés
dans les autres secteurs de l’administration publique.
1. D. Gardey, La dactylographe et l'expéditionnaire..., op.
cit., p. 6-7.
2. Susan Bachrach, Jean-Michel Galano, « La féminisation
des PTT en France au tournant du siècle », Le Mouvement
social, 140, 1987, p. 69-87.
3. D. Gardey, Le linge du Palais-Bourbon..., op. cit., chap. 7.
Les députés « ne boudaient pas le téléphone
»
Dans son organisation, le service du téléphone a connu
deux périodes principales, que séparent les années
1900. Durant les deux premières décennies de son existence,
il semble s’être structuré à l’insu de
la questure, au sens où celle-ci n’a jamais jugé
utile de revoir l’organisation provisoire établie en 1882
en dépit de fortes contraintes pesant sur l’utilisation
du téléphone au Palais. Ce n’est pas qu’elle
se soit désintéressée du sort des téléphonistes,
ou qu’elle soit restée sourde aux réclamations des
députés. Il semble plutôt qu’elle ait tardé
à accepter la légitimité et la pertinence de ces
nouveaux usages de communication pour le travail législatif,
et plus précisément pour les élus dans l’exercice
de leur mandat, pour choisir d’y affecter les moyens requis. Ainsi,
face au refus manifeste de la questure d’accompagner ces évolutions
du travail de représentation politique, les députés
et les téléphonistes ont développé, de concert,
des usages adaptés aux contraintes dont ils étaient ensemble
tributaires.
Tensions autour du succès du téléphone à
la Chambre
Pour passer un appel, un député se présentait auprès
du téléphoniste en chef pour se signaler, voyait sa demande
inscrite dans un registre et recevait un ordre de passage. Il patientait
une première fois et, une fois son tour arrivé, il pénétrait
dans une cabine libre et décrochait le combiné. Il patientait
une seconde fois le temps d’obtenir la réponse de l’opératrice
du central, à qui il indiquait ensuite l’abonné à
joindre. Il patientait alors une troisième fois jusqu’à
ce que la connexion soit établie, puis il devait prendre soin
d’articuler, de parler d’une voix forte et de prêter
une attention soutenue pour saisir les propos de son interlocuteur,
la liaison étant généralement imparfaite. À
la sortie de la cabine, le téléphoniste en chef notait
la durée de la conversation. Le président et les questeurs
bénéficiaient pour leur part d’un régime d’exception
puisqu’ils disposaient, comme on l’a vu plus haut, d’appareils
au sein de leur secrétariat et de leurs appartements.
Dans un article intitulé « Paris boude le téléphone
», Chantal de Gournay explique que jusqu’à la fin
de la seconde guerre mondiale, la population résidentielle de
la capitale et de ses alentours ne s’intéressait que peu
à ce moyen de communication, ce qui tranchait avec le cas de
Londres ou de Boston (1) . Sous la Troisième République,
seule une élite urbaine située dans les arrondissements
centraux, autour du central Gutenberg, s’en est saisie : des commerciaux,
des industriels et des artisans, pour qui la transmission rapide d’informations
relevait d’un besoin professionnel. Il s’agissait pour eux
moins de pallier une distance géographique que de faciliter les
affaires en densifiant les réseaux entre partenaires économiques
regroupés sur un territoire restreint. Pour leur part, les députés
ne boudaient pas le téléphone.
Le volume des communications au départ du Palais Bourbon a été
multiplié environ par deux entre 1890 et 1900, par quatre entre
1900 et 1920, puis par six durant les seules huit années suivantes.
Concrètement, en 1928, ce sont près de seize communications
par semaine et par député qui sont comptabilisées
en moyenne, contre environ deux et demie en 1920 (2) .
Leur intérêt pour le téléphone était
comparable à celui de cette élite économique du
centre parisien, qu’ils composaient d’ailleurs en partie (3)
.
Étant donné que les conversations téléphoniques
avec les abonnés du réseau parisien n’étaient
pas facturées, elles ont rapidement cessé d’être
détaillées dans un registre, ce qui nous laisse sans aucun
moyen direct de les appréhender aujourd’hui. En revanche,
on trouve dans les archives un exemplaire du registre des communications
interurbaines de juillet 1936 à juin 1937, qui nous apprend que
les appels passés vers les circonscriptions d’élection
étaient de longue durée (environ quarante-cinq minutes
en moyenne) (4).
Par ailleurs, les députés semblaient friands du service
des messages téléphonés proposés par la
Société générale du téléphone.
Il offrait de dicter à une opératrice un message, qui
était transmis par téléphone au central le plus
proche de la destination souhaitée, puis transcrit et distribué
en main propre par coursier, à l’instar du télégramme.
Pourquoi d’ailleurs préférer l’un à l’autre
? On peut proposer deux éléments de réponse. D’une
part, le service du téléphone, situé au centre
du Palais Bourbon, bénéficiait d’une meilleure situation
que le bureau de poste et du télégraphe, situé
en périphérie (5). D’autre part, les députés
bénéficiaient d’un régime tarifaire les dispensant
de payer les appels passés sur le réseau spécifiquement
parisien,que ce soit depuis le Palais ou depuis leur domicile s’ils
étaient personnellement abonnés, rendantles messages téléphonés
vraisemblablement meilleur marché à courte distance que
les télégrammes (6).
1. Chantal de Gournay, « Paris boude le téléphone
», Réseaux, 9 (49), 1991, p. 61-71.
2. Calculs effectués par l'auteur sur la base de 500 000 communications
pour 604 députés en 1928, et 80 000 communications pour
613 députés en 1920.
3. Jean-Louis Briquet, « Notabili e processi di notabilizzazione
nella Francia del diciannovesimo e ventesimo secolo », Ricerche
di storia politica, 15 (3), 2012, p. 279-294 [trad. : <https://hal.archives-ouvertes.fr/
hal-00918922/>].
4. 12 P 81, « Communications interurbaines du 22/07/1936 au 18/06/1937
». Moyenne effectuée par l'auteur sur l'ensemble des unités
facturées sur la période, puis convertie sur la base d'une
unité pour trois minutes de communications.
5. 12 P 81, « Note concernant les communications téléphoniques
interurbaines demandées par MM. Les Députés non
abonnés au téléphone, de leur domicile et n'ayant
pas de compte ouvert à l'Administration des téléphones
», 11 mai 1894.
6. 12 P 78, « Rapport sur la gratuité des communications
interurbaines », 30 janvier 1929 ; 12 P 82, « Extrait du
tarif des abonnements téléphoniques », mai 1929.
En somme, alors que le téléphone avait initialement été
installé au Palais Bourbon pour l’usage de son administration,
c’est son usage par les députés qui constituait la
charge principale du service du téléphone. Cet usage des
députés était, semble-t-il, de deux ordres. Le
premier consistait à converser entre Paris et sa circonscription
d’élection, par exemple pour échanger avec les instances
de pouvoir locales (par exemple : une mairie, une préfecture)
ou avec ses proches. Le second consistait à envoyer et recevoir
des courts messages dans le cadre de la vie politique parisienne, par
exemple pour s’informer de l’évolution de certains
dossiers ou pour se donner rendez-vous. Ces deux formes d’utilisation
du téléphone n’étaient cependant pas équivalentes
en volume de communications. On sait en effet que ces appels interurbains
n’ont jamais dépassé 3 % du volume total (à
l’exception des années de guerre où elles ont connu
un pic à 9 %) (1). L’essentiel des appels émis depuis
le Palais étaient dirigés vers d’autres abonnés
de la capitale et cela, donc, dans une optique vraisemblablement moins
conversationnelle qu’informationnelle.
Le succès du téléphone à la Chambre n’était
cependant pas sans revers. Durant cette première période,
les téléphonistes ont dû gérer une situation
de constante surcharge. Elle était d’abord le résultat
de l’ouverture en 1893 des lignes interurbaines à la salle
des téléphones, dont les communications pourtant faibles
en volume mobilisaient beaucoup le service. Il faut savoir en effet
que, de manière générale, « l’état
du réseau est désastreux » selon les propos du gouvernement
en 1921 (2).
Sous la Troisième République, plutôt qu’une
entité pleinement intégrée en un tout, le réseau
téléphonique national était la fédération
d’une multitude de réseaux locaux, aux interconnexions insuffisantes.
Non seulement les temps de mise en relation des communications interurbaines
étaient interminables, mais les interférences rendaient
aussi les conversations pénibles. Et plus un appel nécessitait
de commutations pour atteindre un abonné, plus le risque était
grand de voir la communication coupée en cours de conversation,
ce qui impliquait de reprendre la procédure de mise en relation
à zéro (3) . La surcharge du service tenait ensuite aussi
à la fluctuation des volumes d’appels à traiter,
rendant difficile la gestion des ressources. Hors session ou les jours
sans séance, les téléphonistes parvenaient à
« écouler » sans retard les demandes de communication
entrantes et sortantes, voire pouvaient se trouver désœuvrés.
D’autres jours, lorsque les députés étaient
présents en nombre, les volumes d’appels connaissaient des
pics significatifs, obligeant la questure à renforcer ponctuellement
le service en affectant un ou deux garçons de cabine en plus.
De temps à autres, elle souscrivait aussi de nouvelles lignes
pour désengorger le service, mais la croissance des demandes
d’appel était telle qu’il ne fallait guère longtemps
pour renouer avec une situation de saturation. D’une manière
générale, plus l’activité de la Chambre s’intensifiait,
plus les temps d’attente pour obtenir une cabine disponible s’allongeaient
et plus les esprits des usagers s’échauffaient.
Ces contraintes pesaient sur les députés comme sur les
téléphonistes. Les premiers s’agaçaient de
patienter, eux qui ressentaient déjà à cette époque
ce sentiment d’urgence continue dont ils témoignent aujourd’hui
(4).
1. 12 P 78, « Graphique des communications
téléphoniques de toutes natures (1882-1924) », 17
mars 1924 ; 12 P 78,
« Rapport de fin d'année 1928 », 8 janvier 1929.
2. C. Bertho, Télégraphes et Téléphones...,
op. cit., p. 268-269.
3. C. Bertho, ibid., p. 316.
4. Olivier Costa, Éric Kerrouche, Qui sont les députés
français ? Enquête sur des élites inconnues, Paris,
Presses de Sciences Po, 2007, p. 107 et suiv.
Évolution du nombre de communications téléphoniques
au Palais Bourbon entre 1882 et 1924


« Graphique des communications téléphoniques de
toutes natures (1882-1924) », 17 mars 1924.
Crédit photographique : Communication de l'Assemblée
nationale.
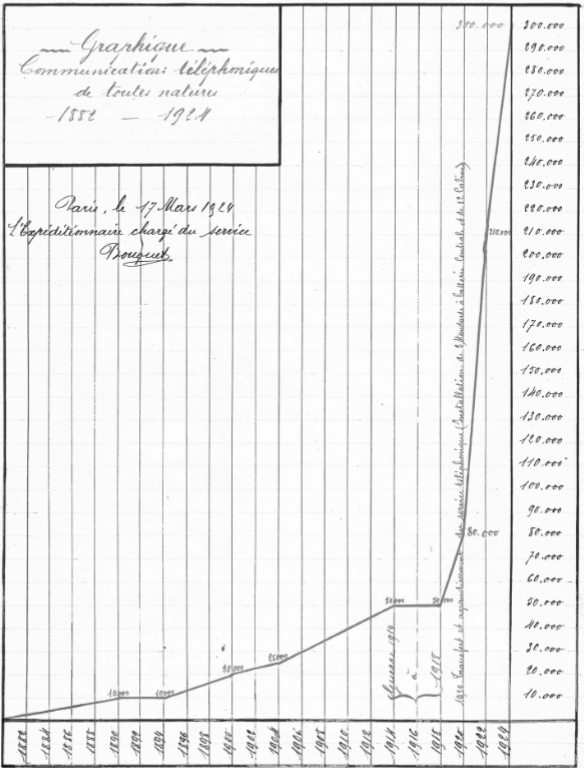
Ils ne cessaient de courir entre leurs diverses sollicitations et n’avaient
pas attendu le téléphone pour dénoncer les tâches
subalternes qui accaparaient leur temps (1) . Les seconds supportaient
sur leurs épaules une charge élevée, « très
souvent au-dessus de leurs forces » (2) .
Tous au Palais étaient « unanimes à reconnaître
avec quel empressement, quel tact et quel zèle » ces derniers
s’acquittaient « de ce travail si absorbant et si pénible
parfois » (3). Ils faisaient leur possible pour « donner
satisfaction à tous » afin que « que le service téléphonique
évite tous reproches » (4) . Plus généralement,
à la lecture de ces archives, on ne peut manquer de relever avec
quelle constance les responsables successifs du service du téléphone
ont alerté leur hiérarchie au sujet de leurs difficiles
conditions de travail, ont pointé l’état de surmenage
qui est le leur, et n’ont cessé de demander que leur soit
affecté du personnel supplémentaire.
User du téléphone par délégation
Dans ce contexte particulier de fortes contraintes techniques combinées
à une forte demande des députés, des usages alternatifs
de communication ont émergé chez les députés.
Alternatifs au sens où ils se sont éloignés des
usages prescrits dans le dispositif (5) . Au moment de commercialiser
le téléphone, en effet, Alexander Graham Bell avait imaginé
un moyen de communication qui ne nécessitait pas d’opérateurs
intermédiaires aux extrémités des lignes dans la
manipulation des appareils (6) . À la Chambre, les questeurs
avaient prolongé cette idée en 1882 quand ils ont créé
le statut des téléphonistes, en ne leur affectant que
des missions de maintenance ou de gestion administrative, et en aucun
cas d’assistance à l’usager. Toutefois, dans la pratique,
les téléphonistes ont toujours fait leur possible pour
simplifier la vie des députés, rendant des services qui
ne relevaient pas a priori de leurs prérogatives, en prolongeant
les arrangements d’une division du travail antérieure à
cette période de la fin du 19 e siècle (7) .
De tels services font l’objet d’une description explicite
dès 1890, dans une lettre à l’intention de la questure
où le téléphoniste en chef explique que si, «
pendant les premières années de l’installation, la
communication s’établissait directement entre les personnes
elles-mêmes », actuellement « la tendance se dessine
de la part du Député, sinon de faire téléphoner
en son lieu et place, [...] de laisser à l’employé
le soin de recevoir la réponse, de l’écrire et de
la lui faire parvenir en séance » (8).
Dans le rapport de l’année 1914, également, son successeur
explique que le service du téléphone doit faire face à
« un surcroît de travail dû [notamment] aux nouveaux
abonnements téléphoniques de Députés qui,
pris par les séances, chargent le service téléphonique
de transmettre leurs messages », ce qui, pour différentes
raisons, « augmentait particulièrement la tâche des
agents » (9) . Le téléphoniste en chef témoigne
ici de ce que l’on pourrait appeler un usage du téléphone
par délégation, pour reprendre une formulation proposée
par Éric Treille concernant le travail de production écrite
qu’ils confient aujourd’hui à leurs assistants parlementaires
(10) . On imagine que cette délégation d’usage ne
concernait pas les appels à vocation conversationnelle présentés
plus haut mais les autres, qui avaient pour objet une prise de renseignement
ou la transmission d’une instruction.
1. P. Guiral, G. Thuillier, La vie quotidienne des députés...,
op. cit., chap. 4.
2. 12 P 78, op. cit., 31 décembre 1916.
3. 12 P 78, lettre des questeurs aux membres du bureau, 7 mars 1902.
4. 12 P 78, « Rapport de l'année 1916 », 31 décembre
1916.
5. M. Akrich, « Comment décrire les objets techniques ?...
», art. cité.
6. P. Flichy, Une histoire de la communication..., op. cit., p. 119.
7. H. Fayat, « Le métier parlementaire et sa bureaucratie...
», cité.
8. 12 P 78, « Rapport à MM. les Questeurs », 10 mai
1890.
9. 12 P 78, « Rapport de fin d'année 1914 », 16 janvier
1915.
10. Éric Treille, « Écrire par délégation.
Pratiques d'écriture des assistants parlementaires de députés
socialistes »,
Mots. Les langages du politique, 85, 2007, p. 97-106.
C’est-à-dire que les personnels de l’administration
n’ont pas simplement été chargés de «
tenir la plume du député » (1) , ils ont aussi dû
tenir pour eux le combiné. Dès lors, pour comprendre pleinement
la place du téléphone dans la vie parlementaire de la
Troisième République, il faut également tenir compte
du fait que les députés pouvaient contourner les contraintes
évoquées plus haut, dans un fonctionnement où toutes
les parties se retrouvaient. Dans ces archives, on ne voit pas en effet
les téléphonistes dénoncer cette pratique de délégation
en tant que telle, ils ne se plaignaient que de ses conséquences
en termes de charge de travail. Peut-être ont-ils en effet perçu
leur intérêt dans un tel fonctionnement. Cette délégation
d’usage allait dans le sens d’un désencombrement de
la salle des téléphones, donc d’une réduction
du mécontentement de députés fatigués de
patienter.
Elle permettait aussi de fluidifier le trafic en offrant une meilleure
optimisation des ressources. En effet, les demandes de communication
pouvaient ainsi ne plus être traitées sur le champ et dans
leur ordre d’arrivée. On pouvait les regrouper, voire les
prioriser, non plus seulement selon l’importance de leur contenu,
mais aussi selon la disponibilité des lignes et selon la disponibilité
du personnel du service. De ce point de vue, la délégation
de la manipulation des appareils téléphoniques a certainement
soutenu la bonne marche du fonctionnement du service à la Chambre
avant 1900.
Alors que le téléphone avait été conçu
pour supprimer les opérateurs du télégraphe qui
encodaient et décodaient les communications, les députés
s’en sont cependant saisis en les réintroduisant. Cette
proximité de mise en œuvre entre le téléphone
et le télégraphe est à rapporter à la culture
socio-technique d’une époque, puisque l’émergence
d’un nouveau mode de communication ne provoque jamais ex nihilo
de nouvelles pratiques de communication, mais vient se greffer sur des
routines qui lui préexistent et prolonger des arrangements déjà
formés (2) . En effet, comme le rappelle Catherine Bertho, entre
1890 et 1930, le téléphone était avant tout «
un instrument d’homme de commandement », utilisé par
des abonnés de milieux sociaux aisés qui, à l’instar
des députés, ne manipulaient pas eux-mêmes le téléphone
mais en confiaient la charge à des employés (3) .
Dans le cadre domestique, le personnel de maison en usait pour effectuer
des commandes ou des réservations pour le foyer (demande de livraison
de produits alimentaires, location de véhicule avec chauffeur...),
ou pour recevoir des instructions de leurs employeurs. Dans le cadre
professionnel, les secrétaires du bureau décrochaient
l’appareil pour filtrer les appels ou pour transmettre un message
au nom de leur employeur (par exemple aux fournisseurs, aux clients).
Dans ce contexte, il faut voir alors que manipuler le téléphone
pouvait être considéré comme un geste servile, car
dénotait une soumission aux contingences aussi bien matérielles
que sociales, auxquelles on se refusait en vertu d’un certain prestige
(4)
.
1. Marc Abélès, Un ethnologue à l'Assemblée,
Paris, Odile Jacob, 2001, p. 139.
2. Philippe Mallein, Yves Toussaint, « L'intégration sociale
des technologies d'information et de communication : une sociologie
des usages », TIS, 6 (4), 1994, p. 315-335, dont p. 317.
3. C. Bertho, Télégraphes et Téléphones...,
op. cit., p. 231-245.
4. C. Bertho, ibid., p. 240.
La littérature scientifique – et tout particulièrement
le champ de la sociologie des usages – a déjà relevé
des situations similaires où l’usager ne manipule pas lui-même
un appareillage technique mais le fait manipuler par autrui pour son
propre compte. Cependant, ces cas n’ont pas fait l’objet de
recherches consacrées et ont été associés
aux problématiques du non-usage (1) . Or,
une telle disqualification pose problème. C’est ce que relève
Vincent Caradec – qui figure parmi ceux qui s’y sont intéressés
le plus près – quand il insiste sur l’ambivalence de
telles situations de délégation. Il montre qu’elles
peuvent aussi bien exclure, en éloignant l’individu d’un
appareil, qu’inclure, en les rapprochant (2).
Dans le cas qui nous occupe, la délégation d’usage
est bien inclusive. Certes, les téléphonistes permettaient
aux députés de s’affranchir des servitudes propres
à la manipulation d’un appareillage, dont les contraintes
d’utilisation impliquaient pour eux des renoncements et des frustrations.
Mais ils leur permettaient également de tirer pleinement profit
du réseau téléphonique, dans une division rationnelle
du travail où la manipulation d’un appareil complexe revenait
aux personnes les plus compétentes et où l’on considérait
souhaitable que chacun ne se disperse pas dans ses activités.
La formalisation d’un secrétariat téléphonique
L’usage délégué du téléphone
par les députés n’avait pas été anticipé,
il a émergé et s’est progressivement systématisé
dans un contexte spécifique, celui de la transformation du métier
de député des premières décennies du 20e
siècle, où s’est posée la question des moyens
matériels alloués aux députés. En 1899,
en effet, l’augmentation de l’indemnité (de 9 000 francs)
allouée aux députés avait été discutée,
sans succès. En 1906, elle a finalement été instaurée
(à 15 000 francs) déclenchant une vaste polémique
au sein de la société française autour de la question
de la professionnalisation du travail de représentation politique,
étroitement liée à celle des ressources nécessaires
pour assurer la qualité du travail législatif (3). Ces
décennies ont aussi été celles d’une crise
du parlementarisme français, en réaction à laquelle
les députés ont collectivement ressenti le besoin de renforcer
l’efficacité du régime délibératif.
À partir de 1915 notamment, différentes dispositions visant
à rationaliser la conduite des débats ont été
prises, afin que « le Parlement n’apparaiss[e] plus comme
un forum de l’éloquence mais comme un lieu de travail »
(4)
.
Or, c’est à cette période également que le
caractère provisoire de l’organisation du service du téléphone
a trouvé ses limites, sous la pression d’une nouvelle montée
en charge. En 1900, l’exposition universelle a d’abord provoqué
une hausse significative des communications entrantes et sortantes à
la Chambre. Cette même année, le téléphoniste
en chef a quitté son poste « à la suite d’une
maladie grave, résultat du surmenage nerveux que lui avait occasionné
la pratique du téléphone » (5).
En 1902, l’abaissement du tarif de l’interurbain a ensuite
provoqué un nouvel afflux d’utilisateurs parmi les députés
et a engendré la hausse d’un type d’appel particulièrement
source « de surmenage et [de] grande fatigue à la fin de
la journée » pour les téléphonistes (6) .
1. Annabelle Boutet, Jocelyne Trémenbert, « Mieux comprendre
les situations de non-usages des TIC. Le cas d'Internet et de l'informatique
», Les Cahiers du numérique, 5 (1), 2009, p. 69-100, dont
p. 88.
2. Vincent Caradec, « “Personnes âgées”
et “objets technologiques” : une perspective en termes de
logiques d'usage », Revue française de sociologie, 42 (1),
2001, p. 117-148.
3. André Garrigou, « Vivre de la politique : les “quinze
mille”, le mandat et le métier », Politix, 5 (20),
1992, p. 7-34.
4. N. Roussellier, Le parlement de l'éloquence..., op. cit.,
p. 53.
5. 12 P 78, op. cit., 7 mars 1902.
6. 12 P 78, « Année 1901 », 2 janvier 1902.
La refondation du service du téléphone
Cette tension produite, d’un côté, par l’accroissement
de la charge de travail et, de l’autre, par la nécessité
de toujours donner satisfaction aux usagers (qu’ils soient fonctionnaires
ou députés) a d’abord fait l’objet d’une
prise en charge interne au service du téléphone. Les téléphonistes
ont tenté en particulier d’enrayer la multiplication de
leurs actes d’écriture, de façon à «
alléger » le poids d’activités considérées
comme annexes (1) . Une expérience significative sur ce plan
est celle, en 1901, de la suppression du registre dit des inscriptions,
sur lequel était tenue la liste des appels entrants et sortants
aux cabines. Or, l’absence de ce registre, comme les téléphonistes
l’ont découvert à cette occasion, signifiait l’effacement
de la mémoire d’une grande partie de l’activité
du service, alors que celle-ci jouait un rôle fonctionnel dans
sa routine quotidienne (2) . Il servait par exemple de journal d’appels
récents, en permettant d’éviter aux téléphonistes
une partie des recherches des numéros d’abonnés.
Il servait aussi pour suivre et gérer les appels mis en attente,
le temps que les députés soient prévenus et se
présentent à la salle des téléphones. Il
servait par ailleurs à consigner la trace du travail collectivement
accompli, sans laquelle on ne pouvait plus produire de statistiques
et alerter la hiérarchie des situations de surcharge. Après
trois mois, le registre a été rétabli et, plus
tard, au début des années 1920, la questure a affecté
en ce sens un expéditionnaire au service. Il était chargé
de « la comptabilité téléphonique, la tenue
des livres, la rédaction des notes, bulletins, avis, etc. [ainsi
que de] la correspondance et les rapports avec l’Administration
des téléphones et les services de la Chambre, etc. »
(3).
L’échec de cette expérimentation paraît avoir
définitivement établi les limites auxquelles était
parvenu le service du téléphone dans son organisation
de 1882. L’idée d’une réforme plus structurelle
et organisationnelle a alors fait son chemin. Concomitamment aux débats
des députés au sujet de leurs propres conditions de travail,
la questure a progressivement infléchison positionnement. Elle
qui rechignait jusqu’ici à répondre aux besoins croissants
de lignes supplémentaires, à multiplier les cabines et
à faire évoluer les appareils au fur et à mesure
des progrès techniques réalisés s’est d’abord
résolue, en 1902, à sanctifier le service du téléphone
au sein de son administration (4). Elle a doté son personnel
d’une échelle de rémunération propre ainsi
que d’un avancement par grades, fixant le salaire du téléphoniste
en chef de 2 600 à 3 500 francs annuels et celui de son second
de 2 200 à 3 000 francs annuels. Elle a aussi accédé
aux revendications des téléphonistes en instaurant une
procédure de recrutement spécifique, prévue pour
s’opérer « parmi les agents du personnel intérieur
qui auraient été préalablement affectés
à ce service et y auraient fait preuve de l’aptitude nécessaire
», c’est-à-dire fondée donc sur un principe
de sélection. Elle leur a enfin affecté du personnel supplémentaire,
si bien qu’en 1908, le service est passé de trois à
cinq personnes, puis s’est étoffé au fur et à
mesure pour atteindre dix personnes en 1929. Ces réformes ont
fait de téléphoniste de la Chambre un métier à
part entière et non plus, comme c’était le cas jusqu’ici,
seulement un poste spécialisé au sein de l’administration
parlementaire.
1. 12 P 78, op. cit., 2 janvier 1902.
2. On pourrait dire ici, avec S. L. Star et J. R. Griesemer, que les
téléphonistes n'ont pris conscience qu'a posteriori de
la valeur de ce registre comme objet-frontière. Cf. Susan L.
Star, James R. Griesemer, « Institutional
Ecology, “Translations” and Boundary Objects : Amateurs and
Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39 »,
Social Studies of Science, 19 (3), 1989, p. 387-420.
3. 12 P 78, « Rapport de fin d'année 1923 », 31 décembre
1923.
4. 13 P 16, op. cit., 1909, p. 35.
Outre ces réformes statutaires, la questure a aussi investi sur
le plan matériel. Le service du téléphone s’est
vu doté d’un équipement récent, adapté
à la spécificité de l’installation téléphonique
du Palais, qui a permis à la fois un meilleur rendement et une
rationalité plus élevée de la division du travail.
En 1904, par exemple, un standard téléphonique complet
est installé pour la première fois dans la salle des téléphones,
autorisant un degré supplémentaire de centralisation des
lignes (1) . Jusqu’alors, on l’a vu plus haut, les lignes
des serviceset celles des députés étaient centralisées
dans la salle des téléphones, mais n’étaient
pas interconnectées. Les appels concernant le réseau interne
étaient gérés par l’opérateur-téléphoniste
au multiple et les appels des députés par les garçons
aux cabines. Avec le standard, toutes les lignes pouvaient être
rassemblées dans un seul meuble, ce qui donnait la possibilité
à un seul opérateur-téléphoniste de les
gérer. Cela dit, en 1920, un seul standardiste ne suffisait plus
à écouler toutes les demandes en un temps raisonnable,
il a fallu remplacer le standard par un autre de taille supérieure
pouvant permettre à deux opérateurs de travailler de concert,
puis encore une fois en 1925 par un modèle à quatre positions,
et en 1933 encore, par un autre à six positions (2). Pour ce
faire, un fonctionnement par roulement est mis en place, dans lequel
des équipes d’agents se relaient au standard plusieurs fois
par jour, selon un planning prédéfini, « de façon
à répartir également le travail » (3) . Lorsqu’ils
n’étaient pas préposés au standard, comme
on va le voir plus bas, ils rendaient des services d’ordre plus
gestionnaire aux députés.
Sur un troisième plan, sous la pression des députés,
la questure s’est enfin employée à négocier
auprès du ministère des P & T différents avantages
pour la Chambre. Fin 1903, pour pallier l’inconvénient du
temps d’attente avant la mise en relation, un système de
réservation a été mis en place. Un député
pouvait dès lors demander une communication interurbaine puis
vaquer à ses occupations le temps que son tour arrive ; le moment
venu, l’opératrice du central informait la salle des téléphones
et un agent partait le chercher (4) .
Également, en 1905, les questeurs ont obtenu que les communications
depuis la Chambre vers les préfectures et sous-préfectures
des circonscriptions d’élection soit prioritaires ; en 1911,
vers les mairies des députés-maires ; puis en 1929, pour
l’ensemble des communications interurbaines (5) . En revanche,
à partir de 1928, les députés non parisiens se
sont mobilisés en vain pour bénéficier d’une
prise en charge par la Chambre de l’intégralité de
leurs communications interurbaines, ce qui n’a été
accordé que bien plus tard, en 1985 (6) .
1. 13 P 16, ibid., p. 40.
2. 12 P 79, « Rapport relatif à l'installation du service
téléphonique à la Chambre », juillet 1920
; 12 P 78, « Rapport de fin d'année 1933 », 9 janvier
1934 ; 12 P 78, « Rapport de fin d'année 1925 »,
12 janvier 1926.
3. 12 P 78, « Constitution des équipes au standard les
jours de séance », 15 novembre 1920.
4. 13 P 16, op. cit., 1909, p. 25-26.
5. 13 P 16, ibid., p. 26 ; 12 P 79, « Rapport sur les besoins
présents du service de téléphone », 15 septembre
1929.
6. 12 P 78, op. cit., 30 janvier 1929 ; Thierry Renoux, « Les
moyens d'action de l'Assemblée », Pouvoirs, 34, 1985, p.
76.
L’élargissement des missions de soutien aux députés
À plusieurs niveaux, la questure a donc doté à
cette période l’administration parlementaire des moyens
de répondre à la demande de ses usagers. Cette évolution
n’est pas seulement lisible dans l’évolution structurelle
et organisationnelle du service, mais aussi dans le développement
de nouvelles missions, spécifiquement orientées vers le
soutien à l’exercice des mandats parlementaires. Entre 1900
et 1930, les téléphonistes ont non seulement vu leur travail
acquérir une légitimité aux yeux de leur hiérarchie,
mais ils ont aussi obtenu une place pleine dans les routines générales
du fonctionnement du Palais Bourbon. Le principe d’un usage délégué
du téléphone par les députés a lui-même
été reconnu comme incontournable par les autorités
de la Chambre et, à ce moment, a alors été généralisé.
Tout d’abord, et cela assez tôt puisqu’on en trouve
mention dès 1900, les archives nous apprennent que ce sont les
téléphonistes qui se chargeaient d’appeler les ministères
afin de leur transmettre les demandes d’inscription aux audiences
hebdomadaires, dont les députés faisaient inlassablement
la tournée pour défendre des dossiers de circonscription,
du début à la fin de la Troisième République
(1).
Pour cela, il leur revenait d’abord de les « consigner chaque
jour, dans leur ordre d’arrivée, sur un registre spécialement
destiné à cet effet », pour ensuite les classer
et les grouper afin d’éviter les demandes successives, et
ainsi éviter d’immobiliser inutilement les lignes (2).
Elles étaient enfin transmises aux différents ministères
par téléphone, chaque veille de jour d’audience,
et collationnées « pour éviter les réclamations
qui pourraient résulter de la négligence de certains ministères,
qui égarent parfois des noms » (3).
Ensuite, à partir des années 1920, lorsque les lignes
directes ont pu être installées entre la Chambre et chaque
gare parisienne, c’est aux téléphonistes qu’est
revenue la gestion des réservations des places des députés
dans les trains. Cette dernière activité représentait
trois ans plus tard à elle seule plus du quart du travail du
service téléphonique étant donné sa complexité.
En effet, les demandes à traiter étaient non seulement
nombreuses, mais aussi parfois urgentes car faites pour la plupart le
jour du départ, et il fallait aussi savoir y voir clair dans
une « grande diversité d’heures de départ,
de directions et de réseaux » (4). Qui plus est, chaque
place retenue nécessitait souvent trois communications distinctes
: il était fréquent en effet que ce soit par un appel
qu’un député manifeste son besoin, il en fallait
alors un second pour le téléphoniste afin de joindre la
gare de départ pour effectuer la réservation, puis un
troisième pour confirmer au demandeur.
Plusieurs éléments nous montrent enfin que le service
du téléphone a fini par occuper aussi une fonction de
bureau d’accueil et de renseignements, à l’instar de
celle occupée aux portes du Palais par le concierge (5).
D’abord, de par leur position de premiers interlocuteurs pour toutes
les communications à destination du Palais Bourbon, les téléphonistes
se faisaient réceptionnistes pour un « public qui souvent
manquaitde renseignements et qu’il falait aider afin de donner
satisfaction » (6). Dans ce dernier cas, la règle était
de « s’appliquer à ne fournir [...] que de brefs renseignements
généraux, autant par discrétion que pour dégager
les lignes » (7). En effet, c’était en priorité
aux députés qu’il s’agissait de venir en aide.
Bien que regrettant le temps qu’ils y consacraient, les téléphonistes
mettaient un point d’honneur à réaliser pour eux
des recherches ponctuelles de renseignements qui pouvaient être
« de toute nature » (par exemple un numéro d’abonné,
l’adresse d’un lieu de rendez-vous ou l’horaire d’une
manifestation) (8).
1. 12 P 78, « Exposé du Service Téléphonique
», décembre 1900.
2. 12 P 78, op. cit., 31 décembre 1923.
3. 12 P 78, ibid.
4. 12 P 78, « Rapport de fin d'année 1926 », janvier
1927.
5. 12 P 40, « Consignes pour les concierges du Palais »,
5 novembre 1907. La proximité entre les missions de concierge
et de téléphoniste sur le plan de l'accueil est rendue
explicite par le fait que, longtemps, la nuit et le dimanche, les lignes
téléphoniques de la Chambre étaient basculées
(par des commutations spécifiques) sur la loge du concierge de
la Cour d'honneur.
6. 12 P 78, op. cit., 2 janvier 1902.
7. 12 P 78, op. cit., 31 décembre 1923.
8. 12 P 78, op. cit., décembre 1900.
Plus encore, des instructions précises avaient été
données afin qu’ils se chargent de « “filtrer”
les communications » entrantes, et tout particulièrement
celles « à l’adresse de MM. les Questeurs, Secrétaires
Généraux, Chefs de service pour ne les établir
qu’avec le consentement de ces derniers ». Ici, on attendait
d’eux qu’ils « annoncent, au préalable, le nom
et, si possible, la qualité du demandeur » et cela en toute
discrétion, en procédant « entièrement à
l’insu du demandeur, par simple jeu de fiches » (1).
D’ailleurs, lorsque le téléphone automatique entre
en fonction en 1933, il n’est nullement question de supprimer le
standard, ce qui témoigne du fait que les tâches de réceptionniste
suffisaient à justifier le maintien la place des téléphonistes
à la Chambre (2) .
Ainsi, un certain nombre de missions visant à faciliter non pas
le travail législatif mais plus largement l’exercice des
mandats parlementaires ont été affectées aux téléphonistes.
Elles avaient pour point commun de requérir un accès permanent
aux lignes téléphoniques extérieures et une bonne
connaissance des logiques générales d’organisation
du réseau parisien et interurbain, elles ne pouvaient donc pas
être accomplies par d’autres personnels de l’administration.
Cette évolution a conduit à des ajustements sur le plan
de la division du travail. À plusieurs reprises durant les années
1920, on peut lire que le téléphoniste en chef se félicitait
de l’adoption d’un « système de spécialisation
» dans le service, conjointement au principe de roulement par
équipes qui prévalait jusqu’alors pour la tenue du
standard de la salle des téléphones. Selon ce système,
lorsqu’ils n’étaient pas occupés à répondre
aux appels et à interconnecter les lignes, les téléphonistes
se voyaient personnellement attribuer une des activités du service,
par exemple la réservation des places de chemin de fer à
l’une des gares, ou les inscriptions aux audiences d’un ministère
en particulier (3). Dès lors, à la fin des années
1920, à la Chambre comme dans toutes les grandes administrations
publiques et privées, la frontière entre la fonction de
secrétaire et celle de téléphoniste est devenue
indiscernable (4). Durant les deux dernières décennies
de la Troisième République, le service du téléphone
peut être considéré comme un secrétariat
téléphonique, bien qu’il n’ait jamais été
qualifié comme tel dans les archives consultées.
Conclusion. L’invisibilité de l’infrastructure téléphonique
Une question importante reste encore en suspens. Si l’installation
du téléphone à la Chambre peut effectivement être
associée aux évolutions du métier de député
au cours de la Troisième République, pourquoi n’en
est-il fait nulle part mention ?
Ce moyen de communication ne fait en effet l’objet d’aucune
description, ou simplement d’allusion, dans les mémoires,
souvenirs et analyses de députés et des personnels de
l’administration. Ni les récits de Paul Vigné d’Octon
ou Jules Delafosse (pour ne citer que les plus connus), ni les analyses
juridiques d’André Tardieu ou d’Eugène Pierre
n’évoquent ce moyen de communication, voire simplement l’existence
d’une salle des téléphones. Pour en avoir un écho,
il faut se tourner vers la presse (5) ou les demoiselles du téléphone
(6) . Le fait que le service du téléphone en lui-même
n’ait, rappelons-le, figuré sur aucun des organigrammes
successifs de l’administration de la Chambre participe du problème.
Sur l’ensemble de la question du téléphone au Palais
Bourbon, et plus généralement sur celle de ses infrastructures
de communication, nous sommes face à un silence historiographique,
qui ne s’est fissuré que récemment, en 2003, quand
le Secrétariat général de la questure s’est
séparé de ce fonds en le confiant au service des archives
de l’Assemblée.
1. 12 P 78, op. cit., 31 décembre 1923.
2. 12 P 79, « Mise en service du téléphone automatique
: utilisation de l'appareil », 1933.
3. 12 P 78, op. cit., 31 décembre 1923.
4. D. Gardey, La dactylographe et l'expéditionnaire..., op. cit.,
p. 182.
5. Par exemple en novembre 1925, dans une courte saynète s'ouvrant
sur une conversation téléphonique entre
un député à son domicile et un huissier de la Chambre
: Adrien Vély, « Ingrate patrie ! », Le Gaulois,
29 novembre 1925.
6. Par exemple dans l'autobiographie de M. Campana, dans les quelques
lignes où elle évoque la priorité des appels demandés
par les députés (Madeleine Campana, La demoiselle du téléphone,
Paris, J.-P. Delarge, 1976, p. 23).
Pour comprendre ce silence historiographique, il faut tenir compte de
la prégnance d’une exigence de discrétion qui, bien
que non explicitement formulée, s’imposait aux téléphonistes.
On a vu en effet qu’en 1882, ce moyen de communication avait d’abord
trouvé un intérêt aux yeux des questeurs parce qu’il
leur permettait de réduire en grande partie les allées
et venues incessantes des personnels de l’administration dans le
Palais Bourbon. On a ensuite compris que l’essor du principe de
l’usage délégué du téléphone,
à partir des années 1890, tenait d’une nécessité
pour les députés de s’affranchir des contraintes
matérielles liées à la manipulation des appareils,
au nom d’un besoin de simplification et d’efficacité.
Pour sa part, la formalisation du service, à partir des années
1900, peut être interprétée comme la recherche d’une
réponse définitive de la part de la questure à
une infrastructure de communication résistant encore trop à
un idéal de fluidité de circulation d’information,
et donc
manifestant aux yeux de tous une présence matérielle vécue
comme une entrave. En somme, à la Chambre d’une manière
générale, l’invisibilité de l’infrastructure
du téléphone était une condition requise pour son
intégration aux routines quotidiennes du Palais. La discrétion
des appareillages téléphoniques était perçue
comme fonctionnelle, en opposition aux appareillages télégraphiques.
Ces derniers, qui étaient localisés dans un bureau de
poste à l’écart du centre du Palais, et dont les
opérateurs ne pouvaient se montrer aussi dévoués
que ceux employés par l’Assemblée elle-même,
apparaissaient comme des obstacles à l’immédiateté
et l’évidence des communications par voie électrique.
Il faut voir alors que, si le travail des téléphonistes
de la Chambre n’est pas plus connu de nous, c’est qu’il
n’était que peu connu de leurs contemporains. Nous avons
affaire à une entreprise d’effacement de l’infrastructure
matérielle et du travail des agents du téléphone,
aux yeux des députés et des autres membres du personnel
de l’administration, qui participait de ce que Susan L. Star et
Anselm Strauss nomment une écologie du visible et de l’invisible
(1) .
Cette entreprise d’effacement possédait deux ressorts distincts.
Premièrement, elle tenait à la position subalterne de
personnels ne prenant en charge que des activités considérées
comme manuelles et physiques, certes éprouvantes et expertes
mais ne nécessitant pas de capacités réflexives.
Deuxièmement, cette entreprise tenait à la position hybride
de personnels affectés à la manipulation des appareils,
dont la contribution à l’organisation générale
du travail était moins reconnue comme le produit d’une activité
humaine que comme le résultat attendu d’un processus technique
(2) .
1. Susan L. Star, Anselm Strauss, « Layers of Silence, Arenas
of Voice : The Ecology of Visible and Invisible Work »,
Computer Supported Cooperative Work, 8 (1-2), 1999, p. 9-30.
2. Ou pour le dire avec les mots de B. Latour et S. Woolgar, les téléphonistes,
en tant qu'interfaces entre les entités humaines et non humaines
du réseau de coopération présidant à l'utilisation
du téléphone à la Chambre, ne pouvaient avoir d'autre
place qu'à l'intérieur de la boîte noire entourant
son fonctionnement. Cf. Bruno Latour, Steve Woolgar, La vie de laboratoire.
La production des faits scientifiques, Paris, La Découverte,
2008,
chap. 2.
La position des téléphonistes n’était alors
pas foncièrement différente de celle que l’on peut
observer dans d’autres contextes, à d’autres époques,
par exemple celle du technicien invisible des laboratoires de recherche
scientifique dont a fait état Steven Shapin (1).
Dès la fin du 19e siècle, ils préfiguraient ces
« petites mains qui produisent et entretiennent au jour le jour
la société de l’information et les services qui lui
sont associés » (2) .
Bien qu’invisibles et non reconnus comme tels, en tant que travailleurs
de l’information, les téléphonistes méritent
alors une place dans l’histoire du travail de collaboration avec
les élus.
Cela, au même titre que les personnels du service des études
et de la documentation créé en 1961, qui collectaient
des informations, transmettaient des dossiers et rédigeaient
des notes de synthèse pour tous députés qui en
faisaient la demande (3) . Au même titre également que
la douzaine de dames du service de sténodactylographie, créé
en janvier 1933, à qui les députés pouvaient dicter
leur correspondance personnelle, qu’elles étaient chargées
de mettre au propre à la machine à écrire (4) .
Ces dernières, d’ailleurs, constituaient pour Éric
Phélippeau le premier effort effectué par la questure
pour proposer aux députés non pas un soutien seulement
financier mais aussi humain (5).
La lecture des archives du service du téléphone nous montre
au contraire que cet effort est nettement plus ancien et suggère
même que le service
de la sténodactylographie n’a pas été créé
ex nihilo mais a émergé comme une déclinaison de
celui du téléphone. Dans les deux cas, les députés
pouvaient louer la force de travail d’une personne, de manière
ponctuelle et limitée en durée, en échange du paiement
d’une taxe préalablement acquittée auprès
d’un tiers. Ainsi, le cas des téléphonistes de la
Chambre apporte une pièce supplémentaire dans la généalogie
qu’É. Phélippeau nous propose, en montrant comment,
tout au long de la Troisième République, le besoin de
collaborateurs pour les députés s’est progressivement
constitué dans un entre-deux, bien loin des positions opposées
que sont aujourd’hui l’assistant parlementaire et le fonctionnaire
de l’administration. Les téléphonistes n’étaient
ni pleinement associés à l’exercice des mandats ni
pleinement réservés quant aux activités extra-législatives
des élus.
Aujourd’hui, le service du téléphone n’existe
plus en tant que tel. L’accueil téléphonique est
assuré par le service de la logistique parlementaire, tandis
que l’entretien de son infrastructure est confié pour l’essentiel
à des prestataires de service. Son démantèlement
remonte vraisemblablement à la fin des années 1970 (6).
À cette période, trois innovations successives ont en
effet recomposé la division du travail parlementaire, dans le
cadre d’une réforme visant à revaloriser le pouvoir
des députés. En 1974, des bureaux personnels dans l’enceinte
du Palais Bourbon leur ont d’abord été attribués,
équipés avec le matériel nécessaire à
leurs fonctions, et en particulier un poste téléphonique
personnel (7).
1. Steven Shapin, « The Invisible Technician
», American Scientist, 77 (6), 1989, p. 554-563.
2. Jérôme Denis, David Pontille, « Travailleurs de
l'écrit, matières de l'information », Revue d'anthropologie
des connaissances, 6 (1), 2012, p. 1-20, dont p. 3.
3. Claude Gibel, « L'évolution des moyens de travail des
parlementaires », Revue française de science politique,
31 (1), février 1981, p. 211-226, dont p. 221.
4. 2016-050/5, « Organisation d'un service nouveau de sténo-dactylographie
à l'usage de MM. les Députés pour leur correspondance
parlementaire », janvier 1933 ; 2016-050/6, « Répartition
par service des cadres et effectifs », septembre 1946.
5. Éric Phélippeau, « La formalisation du rôle
d'assistant parlementaire (1953-1995) », dans G. Courty (dir.),
Le travail de collaboration avec les élus, op. cit., p. 63-80.
6. À ce jour, la plupart des archives de l'administration parlementaire
ne sont pas consultables pour cette période récente, il
est donc encore difficile de statuer avec certitude sur ce point.
7. 14 P 58, lettre du 10 février 1978.
En 1976, avec l’instauration des contrats
d’assistant parlementaire, ils ont été dotés
de collaborateurs personnels, dont la présence entre les murs
du Palais a été acceptée par la questure et que
les députés ont été nombreux à choisir
d’installer dans leurs nouveaux bureaux plutôt qu’en
circonscription, afin de leur déléguer des tâches
requises par le travail législatif (1) .
Enfin, en 1977, un système de sélection directe
a permis aux correspondants extérieurs de joindre les différents
postes du Palais en évitant le standard et en composant directement
leur numéro de ligne (2). Par cette dernière transformation,
la questure faisait le choix de transférer les appels des députés
vers leurs bureaux respectifs et donc de basculer les activités
de secrétariat téléphonique du personnel de l’administration
vers les assistants parlementaires (3) . Elle actait la disparition
d’une prise en charge unique et collective du téléphone
au profit d’une prise en charge
plurielle et individualisée, quoique toujours déléguée
(4)
1. 2005-034/50-51 (consulté sous dérogation), lettre
du 31 mars 1976.
2. C. Gibel, « L'évolution des moyens de travail des parlementaires
», art. cité, p. 216.
3. Comme en atteste T. Renoux, « Les moyens d'action de l'Assemblée
», art. cité, note 7.
4. Je remercie sincèrement les archivistes de l'Assemblée
nationale pour leur prévenance et la patience dont ils ont fait
preuve face à mes interrogations durant cette recherche. Je remercie
aussi Valérie Schafer et Jérôme Denis pour leurs
remarques constructives sur la première version de cet article.
Jonathan Chibois
sommaire