LES SYSTEMES LEDUC et BARTELOUPS
Lors de l'exposition de Paris en 1881 en plus du système automatique américain Connolly, deux inventeurs Leduc (français) et Bartelous (belge), ont également présenté des machines de commutation automatique, qui n'ont également jamais été utilisées à cette date, mais le système Bartelous a été mis en service à Bruxelles en 1886 avec 19 abonnés. (lire la suite).
sommaire
Le système français LEDUC a été détaillé
dans "La lumière électrique du 1er avril 1882 "
|
APPAREILS LEDUC ET BARTELOUS Nous avons vu que l’appareil Connolly est destiné
à constituer un bureau central automatique, fonctionnant
sans l’intervention d’aucun employé pour mettre
en relation, entre eux, un certain nombre d’abonnés
formant un réseau, peu étendu, il est vrai, mais complet
et indépendant. Pour cela tous les appareils d’abonnés
sont reliés d’une part au sol et d’autre part par
l’intermédiaire de l’appareil automatique à
la ligne qui va au bureau central C. La pile est placée dans
ce dernier bureau et c’est de là que l’employé
fait manœuvrer l’appareil automatique pour mettre en relation
directe avec la ligne et isoler du reste du réseau secondaire,
soit l’abonné qui .l’appelle, soit celui que l’on
appelle d’un point quelconque du réseau principal.
Au moment où cette communication sera établie, l’extrémité m du levier n’étant plus repoussée par le doigt, la communication de ce dernier avec les contacts g est supprimée et la ligne sur la touche de laquelle se trouve le doigt est seule dans le circuit. Pour qu’il y ait concordance entre les mouvements du manipulateur et ceux du doigt, il faut que la roue R parte toujours d’un point fixe et revienne à ce point après chaque opération. Dans ce but, la roue R est munie d’une goupille T, qui dans la position de repos, bute contre un arrêt k formant l’extrémité de l’armature d’un électro-aimant Hughes H intercalé dans le circuit. Cet électro est construit de telle sorte qu’il ne soit affecté que par des courants inverses de ceux qui parcourent ordinairement le circuit. Or le premier courant qu’envoie le manipulateur est un courant négatif, tous les suivants étant supposés positifs. Ce premier courant déclanche donc la roue R et celle-ci en tournant, par le jeu d’une piècep, remet au contact l’armature de H. De cette façon, quand la conversation téléphonique est terminée, l’employé, en ramenant son manipulateur au repos, ramènera la roue au repos et sa goupille viendra forcément buter contre k. Une manette N en communication avec la ligne peut être mise en contact avec une série de blocs de cuivre communiquant les uns avec les autres en dessous du socle sur lequel ils sont fixés. Ces blocs communiquent en même temps avec une pile dont l’autre pôle est au sol. Mais entre le premier et le second bloc est placé un ressort que la manivelle vient toucher et qui fait commutateur. De cette façon, chaque fois que la manivelle touche un bloc, un courant est envoyé dans la ligne, .il fait avancer d’une dent la roue dentée R, mais le premier courant envoyé, par suite du jeu du commutateur, est de sens inverse des suivants, et c’est celui-là qui déclanche l’électro-aimant de Hughes H, et permet le départ de la roue R. Dans la vue d’ensemble de la fig. 4, l’appareil
Leduc est représenté sous sa dernière forme.
Dans la pratique, l’abonné d’un réseau secondaire appelle donc toujours l’employé du poste central et celui-ci, pour le mettre en relation avec un des abonnés d’un autre réseau secondaire, fait manœuvrer l’appareil de ce dernier. Quand uu abonné veut correspondre avec un autre appartenant au même réseau, cela peut avoir lieu avec un seul appareil : les différentes lignes 1, 2, 3, 4, sont reliées à la terre, à travers une résistance relativement grande. Si maintenant, ,par exemple, l’abonné 2 veut correspondre avec l’abonné 4, il demande au bureau central d’avertir 4 que 2 le demande et de remettre ensuite l’appareil au repos. 2 et 4 en prenant le téléphone sont en court circuit et peuvent s’entretenir sans subir l’influence des dérivations formées par les circuits des autres abonnés ; mais ce procédé ne garantit pas le secret delà conversation. C’est pourquoi il est préférable d’employer deux appareils conjugués et un doublefil. Dans ce cas, 2 demande au bureau d’avertir 4 ; l'employé appelle 4, laisse 2 sur le premier appareil et met 4 sur le deuxième, en établissant la liaison au bureau entre les deux. Le second appareil n’est pas un inconvénient,
il permet pendant que 2, par exemple, cause avec un des abonnés
de B, avec 2', par exemple, il permet, disons-noufe, à 1,
3, 4 de s’entretenir avec un autre abonné quelconque.
M.Leduc a, d’ailleurs, modifié son appareil et établi
; un petit commutateur mobilé à l’aide duquel
le bureau peut relier dans un seul appareil deux quelconques des
abonnés. Quant à l’appareil de M. Bartelous,
légèrement postérieur à
celui de M. Leduc, il contient les principaux organes de ce dernier
et n’en diffère pas bien sensiblement. Nous nous contenterons
d’indiquer que les disques de contacts s’y trouvent en
double de manière à faciliter les communications. M. Bartelous ne tarda pas à répondre par un courrier :
|
Bartelous 1, rue du Persil â Bruxelles — Commutateur susceptible d'être manœuvré à distance
Les deux systèmes automatiques
de Bartelous
Dans un livre de William Henry PREECE, on trouve
la description de ces deux systèmes.
Premier système. Celui présenté en 1879 à
l'exposition de Paris en 1881.
Cet appareil, inventé par Mr. Bartelous, de Bruxelles, a été
aménagé pour un service à double fil et un service
simple.
Le système qui emploie un fil double est représenté
sur les Fig.266, 267 et 268.

La figure 266 montre la station automatique. Fig.267 la station centrale
et Fig.268 la station de l'abonné.
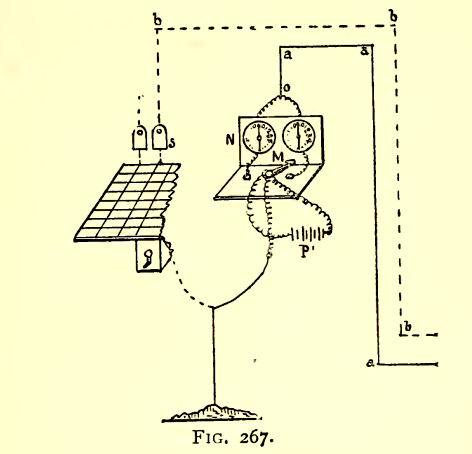
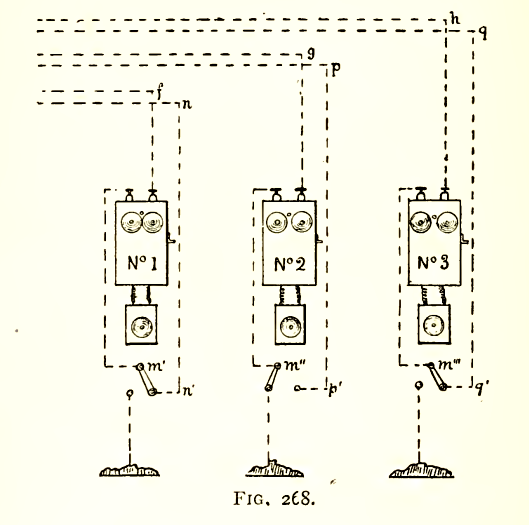
Le tableau automatique est constitué de deux disques circulaires
isolants A A', sur la circonférence desquels sont disposés
des contacts métalliques i, 2, 3 i', 2', 3'. A partir de ces contacts,
i, i' ; 2, 2'; 3, 3'.départ des lignes doubles joignant les différents
bureaux d'abonnés n° 1, n° 2, n° 3 ; sur chaque fil
de ligne est en outre établi un shunt cr ds dont chacun débouche
sur une bande métallique flexible r, s^ t, disposée en forme
de peigne sur une pièce transversale isolante G.
Perpendiculaires au centre des disques parallèles A A', se trouvent
deux axes X X, Y Y, dont le dernier porte une aiguille c ; un mouvement
de rotation par impulsions successives peut être imprimé
à ces axes par des moyens qui seront expliqués plus loin.
Lorsqu'un tel mouvement est imprimé à l'axe Y Y, l'aiguille
c est successivement amenée en contact avec les points 1, 2, 3.
L'axe XX porte deux aiguilles B B' ; l'extrémité qui porte
l'aiguille B traverse le disque A de telle sorte que cette aiguille tourne
également avant ce disque, dans un plan plus voisin de lui que
l'aiguille C, de sorte qu'elle rencontre également les contacts
1, 2, 3. l'aiguille b', placée à l'autre extrémité
de l'axe XX, tourne devant le disque A', et y rencontre les contacts 1',
2', 3'.
Cet axe porte une tige v v, qui lui est parallèle, et munie d'une
série de pointes qui, lorsque l'appareil est au repos, prennent
appui contre les bandes r, s, /, montées sur la pièce transversale
G. Mécaniquement l'aiguille c participe aux mouvements de l'axe
Y Y ; tandis que les deux aiguilles B et B' et la tige V V se déplacent
en conjonction avec X X. Électriquement l'aiguille b est reliée
à l'axe x x, l'aiguille C à l'axe Y Y ; mais l'aiguille
b' est isolée de l'axe qui la porte, et est reliée, par
un contact à friction H et un conducteur / /, à l'axe Y
Y.
Les deux axes sont mis en mouvement rotatif à partir du central
téléphonique au moyen d'une batterie p' (Fig.267), dont
le courant peut être inversé.
Ce courant est acheminé vers le tableau automatique (Fig.266) par
le fil a.
Lorsque, par exemple, on envoie un courant continu ou positif, il agit
sur un relais polarisé R (Fig. 266), de manière à
fermer le circuit d'une batterie locale p par l'intermédiaire de
l'électro-aimant E.
Lorsqu'un courant traverse cet électro-aimant, il attire son armature,
sur laquelle est monté un levier L, qui transmet l'action à
une roue à rochet D sur l'axe X X, et celle-ci lui communique son
mouvement à cette dernière.
Si le courant est de sens inverse, ou négatif, il agit sur le même
relais R de manière à fermer le circuit de la même
batterie locale p par l'intermédiaire d'un électro-aimant
e', dont l'action est transmise par le levier l' à l'axe Y Y.
Ces courants sont envoyés soit par une clé Morse M, complétée
par un interrupteur (Fig. 267) et un indicateur indiquant les positions
relatives des aiguilles B b' et C à la station automatique distante,
soit par un manipulateur automatique (représenté en Fig.
269) muni d'une clé Morse M et d'un mécanisme d'horlogerie,
qui fait tourner une aiguille rigide.
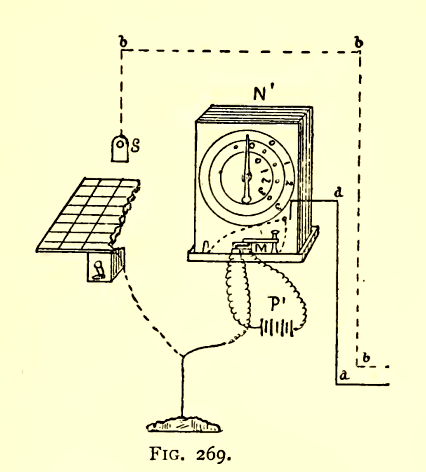
Ce dernier peut, au moyen d'une goupille, être arrêté
en n'importe quelle position sur un cadran gradué, dont les divisions
correspondent à celles des disques A a'. Lorsque la goupille est
retirée et réinsérée dans une position quelconque,
et que la touche M enfoncée, le mouvement de l'horlogerie transmet
de la pile P des courants en nombre égal à celui des divisions
sur lesquelles l'aiguille s'est déplacée sur le cadran ;
et ces courants, comme nous l'avons déjà dit, provoquent
un déplacement analogue des aiguilles du tableau automatique à
distance.
Dans la disposition représentée par les Fig. 266, 267 et
268, les postes d'abonnés, qui peuvent être de tout système
même avec appels magnétiques, ne sont sujets à aucune
modification.
On ajoute seulement à chacun un petit interrupteur à double
sens in, ni' in", dont la fonction sera facilement comprise en se
référant à la figure 268.
Au n° i et au n° 3, les interrupteurs in' et in'" ferment
le circuit par le fil de retour, sans aller à la terre ; tandis
qu'au n° 2 le circuit se termine à la terre.
Avant de décrire la manipulation de l'appareil, il convient de
mentionner qu'en plus des contacts 1 , 2, 3 . le disque A porte trois
autres contacts, marqués + , et respectivement.
La première, sur laquelle l'aiguille C s'arrête au repos,
est reliée à la masse, et n'a que la moitié de la
longueur des contacts i, 2, 3, de sorte qu'elle ne rencontre pas l'aiguille
B. Les deux autres contacts, notés
0, sont placés de part et d'autre du premier, sont également
à mi-longueur, mais sont disposés de manière qu'ils
ne puissent rencontrer que B, et non C.
Ces deux contacts 0 sont reliés chacun à un contact similaire
sur le disque a' ; il n'y a cependant aucun contact correspondant au +
sur cette dernière.
Supposons maintenant qu'un abonné (le n°2 par exemple) souhaite
appeler le central.
Il tourne la poignée de son interrupteur vers la gauche (comme
indiqué sur la figure), et envoie le courant d'appel. Celui-ci,
partant de la terre, parcourt le générateur, suit le fil
de ligne par g jusqu'à d (fig. 266), et, le contact en 2 étant
ouvert, traverse la bande s, et le point correspondant de la tige v v^
et arrive à l'axe X X. Ce dernier est, au moyen d'un contact à
friction F, relié au fil b b b, qui est relié à une
sonnerie d'appel au central, et de là va à la terre.
L'appel ayant ainsi été reçu au poste central, l'opératrice
constate le nom ou le numéro de l'abonné appelant ; puis
par les moyens indiqués ci-dessus, il amène l'aiguille B
sur le contact n°2 du disque A. En même temps l'aiguille B'
se sera déplacée en 2' sur le disque a', et les pointes
de la tige v v auront quitté le contact des bandes flexibles r,
s, t.
A partir de ce moment, la communication entre le central et l'abonné
n°2 sera exclusive en faveur de ce dernier.
Il aura été établi, à partir du tableau, au
moyen du fil b b b, du contact à friction F, de l'aiguille B, du
fil 2 y d g, et mis à la terre par l'interrupteur après
avoir parcouru l'instrument au N°2 ( Figs.266 à 268).
Supposons maintenant que l'abonné n°2 souhaite parler à
l'abonné n°3, qui est relié au même standard automatique.
En décrivant le mode opératoire dans ce cas, nous montrerons
en même temps comment la station centrale peut appeler n'importe
quel abonné, ainsi que comment s'effectuent les doubles connexions
pour un même groupe d'abonnés. On commence l'opération
au moment où, l'appel du n° 2 ayant été reçu
au poste central, le numéro de cet abonné et celui du correspondant
recherché ont été connus.
L'opérateur va maintenant procéder à l'appel de ce
dernier.
Il le fait par les moyens décrits ; il déplace les aiguilles
B et B' sur les contacts 3 et 3' des disques A et A', et envoie un courant
d'appel dans b b b.
Ce courant passe à travers ladite ligne, le ressort F, l'aiguille
B, la ligne Z ^ ^ A jusqu'à l'abonné n°3, et de là
à travers le commutateur m'" et le fil de retour, q k 3',
vers la station centrale (Figs.266 à 268).
Du point 3' où l'aiguille b' a été amenée,
le courant suit cette aiguille, le ressort H, le conducteur / /, l'axe
Y Y et l'aiguille c arrêtée par le contact +.
Cette dernière étant reliée à la terre, le
circuit est ainsi bouclé, et le courant d'appel envoyé dans
la ligne bbb agit sur la sonnerie d'appel du N°3.
L'abonné n°3 ayant répondu à l'appel, le courant
de la batterie p' au poste central s'inverse, et peut maintenant être
utilisé pour actionner l'aiguille C.
Ce dernier est ainsi amené au contact 2 du disque A, et le circuit,
au lieu de se terminer à la terre par la position de l'aiguille
c sur le contact +, se prolonge maintenant au-delà de cette aiguille
par le fil 2 y d g, et va à la terre par l'interrupteur m' , après
avoir transité par l'instrument de l'abonné n°2.
A la réception du signal de dégagement, la station centrale
ramène les différentes parties de l'appareil à leurs
positions de repos.Il ne reste plus qu'à expliquer l'utilisation
des contacts et 0' 0' sur les disques A et A'. Leur but est de contrôler
à distance la position de B b' et c.
Une référence aux diagrammes montrera que les différentes
aiguilles se déplaçant sur ces points provoquent en ligne
b b b des prises et des ruptures ; de sorte qu'en plaçant une pile
et un galvanomètre sur la ligne b b b, on puisse vérifier
ces différents changements, et contrôler à distance
la position des aiguilles.
Deuxième système
Brevet 1883 US 290,730 Dec 25,
Jacques V M Bartelous "Switching apparatus for telephone lines
"..
Il s'agit d'un système à un seul fil, représenté
sur les Fig.269, 270 et 271.
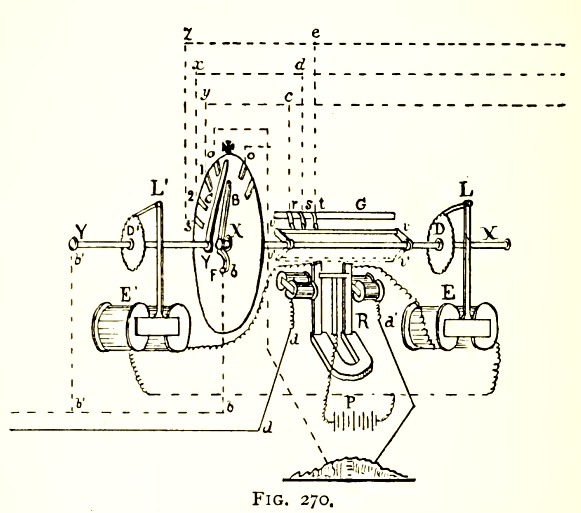

L'appareil (Fig.270) contient toujours les deux axes, l'axe Y Y portant
l'aiguille C, et l'axe X X ne portant qu'une seule aiguille et la tige
v v.
Les deux axes sont tous deux reliés à la ligne b b bhy Y
b b et Y b' b' .
Il n'y a aussi qu'un seul disque A portant les contacts I, 2, 3, ... auxquels
sont reliées les lignes d'abonnés, et auxquels répondent
les aiguilles B et c.
Il y a aussi trois divisions supplémentaires, +, 0, mais il n'y
a pas de contact au point +, et les contacts sont en liaison directe avec
la terre.
Les shunts sur les lignes d'abonnés débouchent sur les réglettes
r, s, t de la pièce transversale G.Fig.270, Comme dans le premier
système, nous avons ici aussi un relais R et les électro-aimants
E e' avec leurs leviers L \J .
L'arrangement général peut maintenant être représenté
par le diagramme, Fig.272.
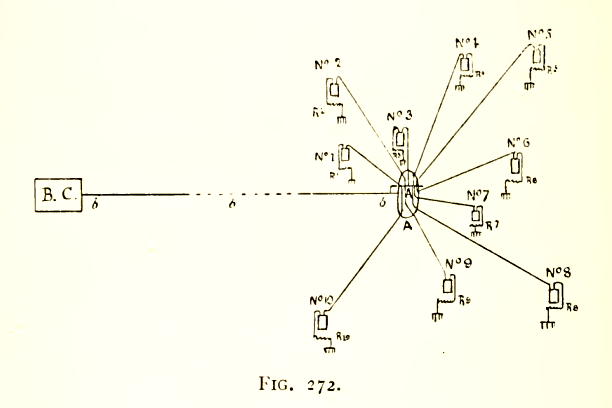
On voit que, lorsque l'appareil est au repos, les lignes des abonnés,
sans exception, bifurquent de la ligne b b b ^ du fait qu'elles sont reliées
à la tige v v et à l'axe X x.
Aucun de ces bureaux ne pourrait donc envoyer de courant d'appel au poste
central, car, en pratique, la ligne b b b^ qui relie ce dernier au standard
automatique A, est plus longue et, par conséquent, offre une résistance
électrique beaucoup plus grande que celle du poste central. la
résistance combinée des lignes Ai, A2, A3, etc.
Un nouveau principe a donc dû être introduit pour le système
unifilaire, et il consiste en l'ajout de résistances supplémentaires
r', R'', r'" sur les lignes d'abonnés. Ces résistances
sont ajustées de manière à ce qu'un courant soit
envoyé depuis l'une des stations. Le n°3 par exemple, et passant
par la ligne 3A jusqu'au point commun de connexion, s'y retrouve dans
les lignes auxiliaires Ai, A2, A3, avec une résistance suffisamment
élevée pour permettre à une petite partie du courant
de passer seulement. passer dans chacune des lignes.
La ligne b b b, en revanche, qui présente désormais une
résistance relativement beaucoup plus faible, laissera passer une
quantité de courant suffisante jusqu'au poste central pour y faire
sonner la sonnette d'appel, même si les courants dans les lignes
auxiliaires ne seront pas suffisamment forts. pour répondre aux
appels des autres postes.
Afin d'obtenir de bons résultats pratiques, les résistances
sont connectées de telle manière qu'elles puissent être
court-circuitées par une simple pression sur un bouton, pendant
que l'abonné envoie son courant d'appel, et, de même, que
le décrochage du téléphone en vue de la conversation
les retire du circuit.
Le fonctionnement du système sera maintenant facilement compris
en se référant aux chiffres, l'abonné n°2, par
exemple, souhaite appeler.
Il appuie sur le bouton d'appel et court-circuite ainsi sa résistance.
Le courant passe par g d s, tige V V, axe x x, ressort F, ligne b b b,
sonnerie d'appel S, jusqu'à la prise de terre du tableau de la
station centrale.
L'opérateur amène l'aiguille B sur le contact 2, la tige
V V quitte le contact des bandes r, s, t, et le circuit s'établit
par b b b,Y B, et la ligne 2 X d g.
Si l'abonné n°2 veut le n°3, l'opératrice du poste
central appelle ce dernier en amenant l'aiguille B sur le contact 3 et
en envoyant le courant d'appel par b' b b, F B et la ligne ^ z e Ji, au
poste n° 3. Dans cette position, les autres lignes sont déconnectées
et le courant d'appel, passant exclusivement à la ligne 3, est
suffisamment fort pour vaincre la résistance R'".
C'est le mode d'appel d'un abonné dans tous les cas.
Pour compléter la communication avec le n° 2, le courant, comme
dans le premier système, est inversé à la station
centrale, de manière à la faire agir sur l'axe Y Y, et à
amener l'aiguille C sur le contact 2.
Les abonnés nos 2 et 3 pourront désormais communiquer après
avoir court-circuité leurs résistances respectives en décrochant
leur téléphone, et le signal de libération pourra
être donné au poste central lorsque leur conversation sera
terminée.
Les contacts servent, comme dans le premier système,
à contrôler à distance la position des aiguilles au
moyen d'un galvanomètre.
Il faut remarquer que les modifications produites dans les phénomènes
électriques consistent, non seulement en des prises et des coupures
du circuit, mais encore en des variations très considérables
de la résistance de ce dernier.
Ainsi la position de repos donne lieu à une très forte déviation
du galvanomètre, car elle correspond à une dérivation
de courant à travers toutes les lignes dérivées.
Il convient également de noter qu'avec l'un ou l'autre système,
aucun appel ne peut être effectué vers la station centrale
par les abonnés d'un groupe dès qu'une des stations est
en communication.
Dans le premier système, l'abonné, averti de cet état
de fait par le fait que sa sonnerie d'appel n'a pas sonné en réponse
à son appel, peut se mettre dans ce qu'on peut appeler une attitude
d'attente en tournant la poignée de son interrupteur. à
gauche. Si maintenant l'opératrice du poste central, après
avoir remis tous les appareils à l'état de repos, envoie
un courant en ligne, ce courant agira sur la sonnerie d'appel de l'abonné
en attente, et l'informera ainsi que le la ligne est claire.
Dans le second système, le même résultat peut être
obtenu en ajoutant à chaque bureau une goutte annonciatrice au
moyen de laquelle, dès l'émission du signal, la résistance
supplémentaire est court-circuitée.
Dans ce cas également, un courant envoyé depuis la station
centrale, après la remise au repos de l'appareil, fera tomber la
goutte.
sommaire
Mentionnons enfin que M. Bartelous s'occupe désormais des derniers
détails d'un système encore plus complet que les précédents.
Ce système contient trois ou quatre fils entre la station centrale
et le standard automatique.
De ces quatre fils, l'un est la ligne de travail, le second est une ligne
d'appel, à laquelle sont connectés tous les bureaux des
abonnés à l'état de repos.
Quant aux communications, elles s'établissent au moyen d'un troisième
fil, ou au moyen du troisième et du quatrième fil.
Dans ce dernier cas, deux communications distinctes peuvent être
établies simultanément.
Les détails et les croquis de ce système n'ont pas encore
été publiés.
Le standard automatique de M.Bartelous a été adopté
par la Compagnie Téléphonique Belge.
A Bruxelles, la longueur des lignes de liaison avec la gare centrale
est de 7 kilomètres, avec une résistance de 350 ohms.
19 abonnés sont regroupés, la résistance supplémentaire
s'élevant à 2 000 ohms.
Avec des distances plus courtes et moins de résistance, jusqu'à
vingt-cinq personnes pourraient être regroupées.
Il est particulièrement applicable dans les districts périphériques
où le nombre d'abonnés n'est pas suffisamment grand pour
payer les dépenses d'un central ordinaire, ainsi que pour le service
du dimanche et de nuit dans les grands centraux.
En 1886 en Belgique il y avait 5 bureaux auxiliaires du réseau de Bruxelles sont desservis par des commutateurs automatiques du système Bartelous.
Brevet 1883 US
290,730 Dec 25, Jacques V M Bartelous "Switching apparatus for
telephone lines "..

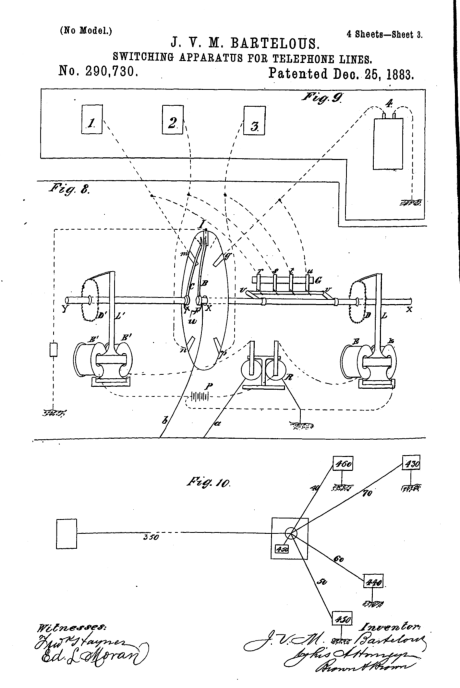
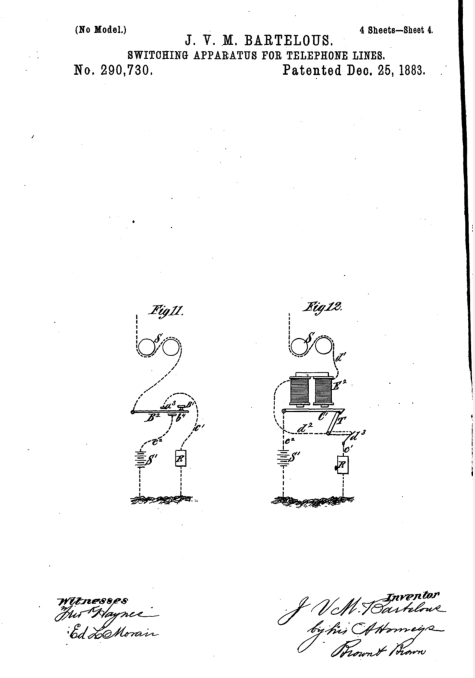
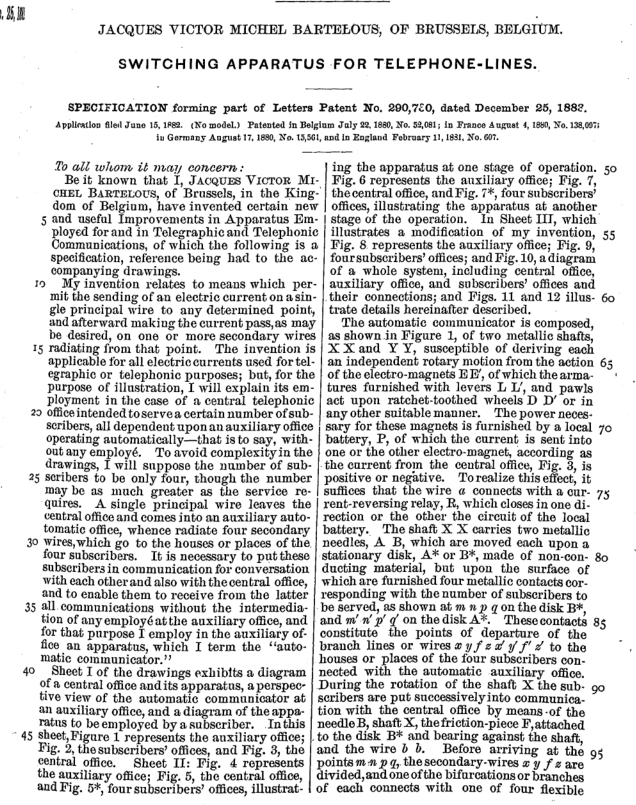
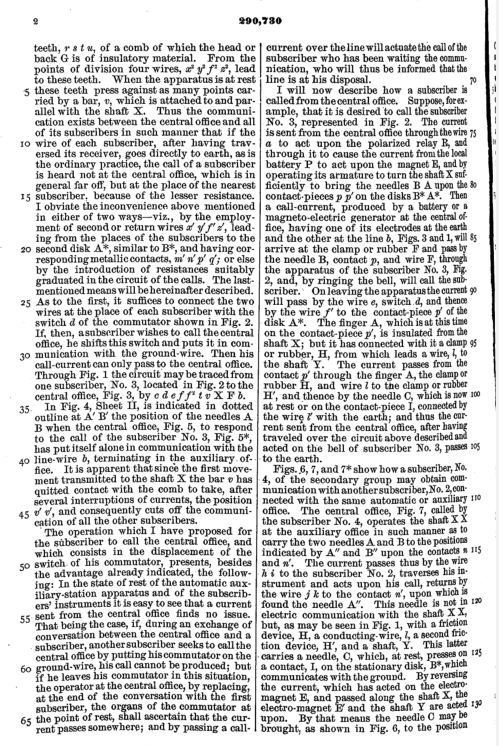
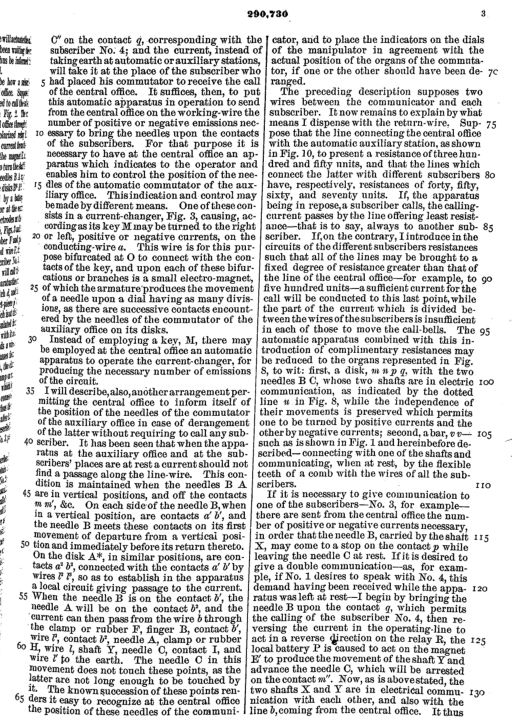
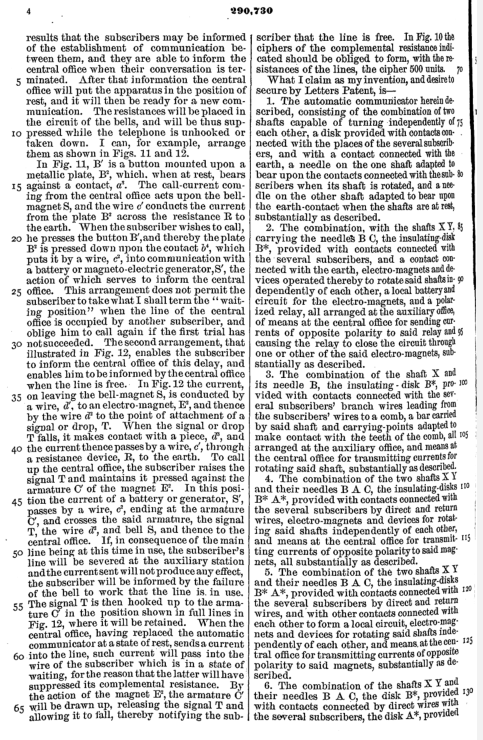

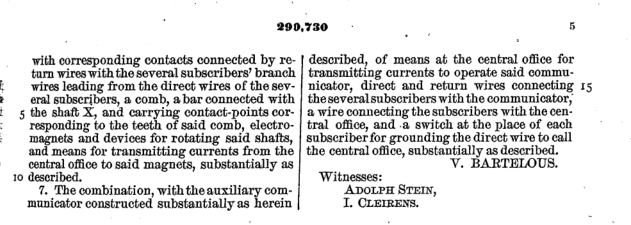
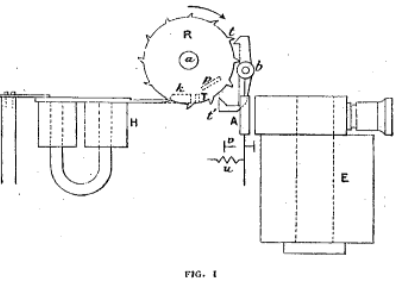
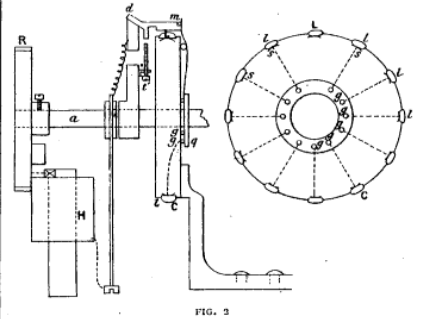
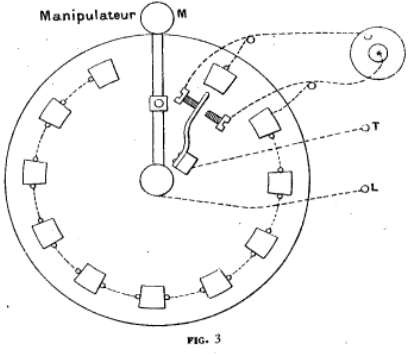
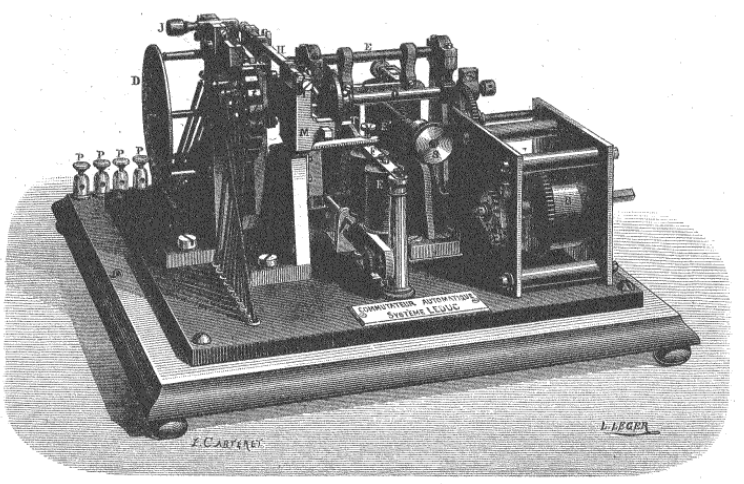 Fig.4
Fig.4