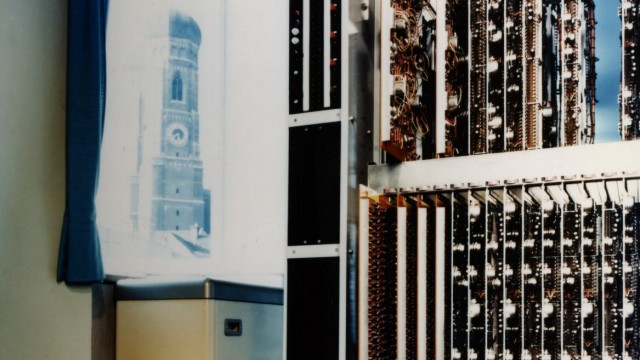sommaire
LE GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Le 20 août 1842, un arrêté
royal grand-ducal crée une Poste nationale luxembourgeoise.
Cette naissance de l'institution nationale est une suite de la Charte
de Guillaume II des Pays-Bas, octroyée au Luxembourg en 1841.
Le document entraîne la séparation constitutionnelle
entre le Grand-Duché et les Pays-Bas et dote le Luxembourg
d'une Assemblée des Etats indépendante.
Le 22 juillet 1861, un arrêté royal grand-ducal
crée l'Administration des Télégraphes,
disposant d'abord d'un seul bureau à Luxembourg et de télégraphes
électriques le long des chemins de fer Guillaume. Le bureau
de la capitale remplace le télégraphe de la garnison
prussienne dans la forteresse de Luxembourg, mis à disposition
du gouvernement luxembourgeois depuis 1855.
En 1869, l'Administration des Télégraphes est incorporée
dans l'Administration des Postes et le personnel de la Poste est formé
dans la manipulation des télégraphes.
Déjà en juillet 1880, Monseigneur
Johannes Koppes, évêque de la Ville de Luxembourg, conclut
une convention avec Félix Neuman, Directeur des Postes et Télégraphes,
sur le raccordement de son poste téléphonique au bureau
central de Luxembourg, en voie de construction.
Le raccordement sera réalisé le premier octobre 1885
à l'ouverture du premier centre.
 convention
convention
Au Luxembourg, les chemins de
fer ont résolu les problèmes de transport de l'industrie
lourde.
Un autre moyen de communication, d’un genre tout à fait
différent, est apparu au Luxembourg vers le milieu des années
1880 : le téléphone.
La loi du 20 février 1884 traite du service télégraphique
et du service téléphonique.
Son exploitation est réservée à l’Etat (art.1).
Soulignons deux attitudes contraires vis-à-vis de cette innovation.
-Le Conseil d’Etat manifeste quelque hostilité envers
ce projet inédit : coût trop élevé (environ
90 millions de francs), doutes quant à l’opportunité
d’un tel projet. En fait, l’opposition du Conseil d’Etat
a retardé le projet d’environ neuf mois.
-La Chambre de commerce et les professions libérales
(par exemple avocats, médecins) poussent le Gouvernement à
accélérer la réalisation du projet.
Deux problèmes techniques liés à l’installation
d’un réseau téléphonique sont apparus :
- Le Luxembourg fait appel à des techniciens allemands, ce
n’est pas la première fois. Voilà qui confirme
le poids de l’enseignement technique .
- Le nombre minimal d’abonnements dans la Ville est estimé
à 30 unités, qui sont rapidement atteints.
En 1885, le premier réseau téléphonique
national est mis en service.
Il s'agit du réseau de Luxembourg-Ville qui couvre la capitale
ainsi que Dommeldange, Eich, Septfontaines, Merl, Hollerich, Bonnevoie,
Pulfermühl, Schleifmühl, Hamm et Neudorf.
Le jour de sa mise en service, le 1er octobre 1885, le réseau
compte 91 abonnés.
C’est en pleine métamorphose de forteresse en ville ouverte
que la Ville de Luxembourg fut dotée d’un système
de télécommunication révolutionnaire, le téléphone.
Il faut s’imaginer le choc de civilisation vécu par les
habitants de la Ville durant le dernier quart du XIXe siècle.
En quelques années, ils passèrent d’une agglomération
quasi médiévale à ruelles étroites et
malsaines à une ville moderne entourée de parcs et de
larges boulevards et avenues bien aérés et entretenus.
Et surtout, une ville moderne dont une grande partie des maisons étaient
équipées d’appareils qui permettaient une conversation
entre des personnes éloignées les unes des autres

sommaire
Les annuaires téléphoniques nous
révèlent souvent comment le téléphone
s'est développé :
En 1885 le premier réseau téléphonique installé
dans la Ville de Luxembourg comportait quatre artères dont
une passait par le Boulevard Royal où il y avait, sur la maison
du restaurateur Johann Klapdohr, un embranchement des lignes dont
une partie allait vers Limpertsberg et une autre vers Eich. Ainsi,
le Boulevard Royal comptait parmi les premières adresses à
être équipées de lignes téléphoniques
et sur les 121 abonnés inscrits en 1885 à l’annuaire
téléphonique cinq habitaient Boulevard Royal.
Il s’agit d’une proportion importante si l’on considère
que ce boulevard était en 1885 une artère, récemment
urbanisée.
Ces cinq premiers abonnés au téléphone furent
les personnes suivantes, telles qu’inscrites à l’annuaire
de 1885 : JosephBrincour, Avokat u. Deputirter ; MichelFohl, Avo-kat-Anwalt
; LudwigGodchaux, Director ; Klapdohr Johann, Gasthofbesitzer ;Thierry
Ruckert, Rentner.
Comme adresse de ces abonnés l’annuaire indique Boulevard
des Königs.
Le téléphone fut installé relativement tôt
dans la Villa Gillard. Ceci est remarquable : les tout premiers abonnés
au téléphone étaient généralement
des personnes qui utilisaient ce moyen nouveau de communication à
des fins professionnelles, alors que les utilisateurs purement privés
étaient, au début du moins, une infime minorité
(3,7%). Curieuse-ment, l’abonnée inscrite à l’annuaire
téléphonique n’était pas la propriétaire
de la villa, Mme Gillard-Collart, mais sa mère, Mme Collart
de la Fontaine. S’agit-il d’une manière de signaler
le chef de ménage ? Ainsi, le « Livret à l’usage
des abonnés aux réseaux téléphoniques
– Handbuch für die Theilnehmer an den Fernsprecheinrichtun-gen
» (en vocabulaire courant contemporain : l’annuaire téléphonique)
de 1888 nous révèle l’inscription suivante :


 |
Curieusement, l’adresse
indiquée n’est pas le boulevard Royal, mais la rue
d’Eich, alors que la porte d’entrée de la Villa
Gillard donnait sur le Boulevard Royal et qu’aucune porte
d’entrée ne se trouvait dans la Côte d’Eich.
Et là aussi, il y a matière à étonnement,
puisque officiellement, cette rue d’Eich était appelée
partout ailleurs côte d’Eich. Puisqu’il y eut
un changement d’occupant de la Villa Gillard, en 1891, il
fallut également changer l’inscription dans l’annuaire
téléphonique.
Ce qui ne changea pas, ce fut le numéro d’abonnement
: le 246. Pour la désignation du nouvel occupant, il y
eut, au cours des années, des inscriptions changeantes,
ce qui devait certainement causer des inconvénients pour
retrouver un abonné dans l’annuaire.
Pour 1894, il convient de noter que la Villa Gillard semblait
jouir d’une notoriété suffisamment grande pour
justifier l’absence de toute précision pour l’adresse.
Ainsi, on peut supposer que tout le monde connaissait la Villa
Gillard et savait où la trouver. La simple indication du
nom de famille du ministre résident nous semble aujourd’hui
une forme d’impolitesse inacceptable.
Peut-être fut-ce aussi le cas à la fin du XIXesiècle.
Toujours est-il que l’inscription fut rapidement changée.
En 1896, l’adresse de l’antenne diplomatique française
au Luxembourg fut dépersonnalisée : ce n’est
plus le nom du diplomate qui est indiqué, mais sa fonction,
du moins en français, alors que dans version allemande,
c’est plutôt la fonction de la représentation
diplomatique qui est indiquée. Cette fonction fut d’ailleurs
redéfinie quelques années après et changée
en Légation. Dans l’entendement général
du public luxembourgeois cependant, ce fut toujours l’Ambassade
de France. En 1901, la situation géographique de la Villa
Gillard fut enfin précisée, mais le site n’appartenait
toujours pas au boulevard Royal. L’inscription à l’annuaire
de 1901 est la dernière pour le service diplomatique français
dans la Villa Gillard. Le bail de dix ans était arrivé
à son terme et la Légation de France déménagea
à l’avenue Marie-Thérèse, elle continua
à avoir le numéro d’abonné 246.
Telle était la rapidité du progrès technique
en ces temps. Si le numéro 246 appartenait à l’origine
à Mme Collart-de la Fontaine et devint le numéro
téléphonique du service diplomatique de la France
au Luxembourg, lorsqu’elle quitta la Villa Gillard dix ans
plus tard ce même numéro accompagna son titulaire
dans son déménagement. |
Entre temps, la Banque Internationale devint le nouveau
propriétaire de la Villa Gillard. A son ancienne adresse rue
Notre Dame, elle était parmi les premières maisons à
être équipées du nouveau moyen de communication.
Son numéro téléphonique était le 37.
Dans l’annuaire de 1903, nous observons que la Banque Internationale
put garder son ancien numéro à sa nouvelle adresse.
Mais quelle était cette adresse ? Nous pouvons admettre que
l’appareil téléphonique répondant au numéro
37 était installé dans le nouveau bâtiment érigé
par la Banque Internationale. La Villa Gillard, qui fut, elle aussi,
raccordée au réseau, hébergeait elle toujours
un appareil, qui devait être à la disposition du directeur
Adolphe Türk, premier occupant de la Villa ?Adolphe Türk,
membre de la direction de la Banque Internationale de 1894 à
1920, avait le numéro téléphonique 438 de 1902
jusqu’à la fin de son mandat en 1920.
La curieuse traduction de l’adresse de la Banque Internationale
«Eicherberg – montagne d’Eich » qui fut changée
par la suite en «Eicherberg – Côted’Eich »,
est à remarquer. La Villa Gillard était donc toujours
considérée comme faisant partie non pas du Boulevard
Royal, mais de la Côte d’Eich. Après 1920, les directeurs
de la Banque Internationale qui occupèrent la Villa Gillard
se succédèrent à une cadence rapide :
• de 1920 à 1922, Würth-Weiler Jos, n° 151 (1921)
qui fut prolongé en 21 51 (1922),
• de 1923 à 1927, Stumpff Th., bien qu’il ne fût
directeur que jusqu’en 1926, n° 24 38
• de 1928 à 1933, Sotil Vitalis, n° 24 38,
• de 1934 à 1961, Lambert Max, n° 36 56 qui fut prolongé
en 236 56.
Pour Würth et Stumpff, les annuaires indiquent comme adresse
: « boulevard Royal », l’ère de la Côte
d’Eich pour la Villa Gillard est définitivement révolue.
Pour les autres directeurs, les annuaires indiquent comme adresse
« boulevard Royal, 2 ». Ceci est à mettre en relation
avec l’adresse officielle du siège de la Banque Internationale,
«boulevard Royal, 2bis ». Les deux adresses, 2 et 2bis
furent toujours soigneusement distinguées.L’indication
«directeur général» semble être un
titre qui n’existait pas dans les organigrammes de la Banque
Interna-tionale. Max Lambert (1888-1957) fut membre de la direction
de 1932 à 1957, membre du conseil d’administration de
1940 à 1957 et président du conseil d’administration
de 1952 à 1957.
Dans le Rapport du Centenaire (1956), qui énumère tous
les postes dirigeants de la banque depuis sa création, on ne
trouve personne ayant porté le titre de directeur général.
L’occupation presque trentenaire de la Villa Gillard par Max
Lambert et sa famille mit fin à une tradition pourtant bien
établie : pour le public, la VillaGillard changea de nom et
devint la Villa Lambert, et ceci déjà très rapidement.
Quand en 1937, donc trois ans après l’emménagement
de Lambert dans la villa, la Banque Internationale voulut vendre son
siège à l’Etat, on parlait déjà de
la Villa Lambert. Faisons un grand bond dans le temps pour aboutir
au propriétaire du site qui a succédé à
la Banque Internationale, en négligeant l’Institut Monétaire
Luxembourgeois qui n’a pas occupé les lieux.
La Banque centrale du Luxembourg était inscrite à l’annuaire
téléphonique de l’année 2000 de la façon
suivante. Le numéro téléphonique était
devenu plus complexe et comportait huit chiffres. Le numéro
à six chiffres du département Monnaie Fiduciaire, Immeubles
et Sécurité découle de sa localisation, en 2000,
au Bâtiment Prince Henri, devenu en 2006 l’Immeuble Monterey.
En comparant l’annonce de la BCL dans l’annuaire de 2000
avec la liste télépho-nique de 2013, on peut évaluer
l’ampleur des changements qui ont eu lieu au sein de la Banque,
non seulement quant au personnel, mais aussi sur le plan de l’organisation
et des compétences.
sommaire
L'exploitation des lignes téléphoniques
dans le Grand-Duché de Luxembourg est réglementée
par un arrêté royal, qui fixe le prix de l'abonnement
à 80 francs par an dans les limites de la localilé où
se trouve le bureau central.
En Europe, c'est le prix de l'abonnement le moins élevé
qui existe actuellement, si l'on en excepte toutefois celui de quelques
sociétés coopératives en Suède et en Norwège.
Des conditions spéciales sont faites aux hôtels, cafés,
sociétés de réunions, etc., dont les clients
peuvent utiliser le téléphone.
Pour ces établissements, le nombre annuel des communications
auxquelles donne droit l'abonnement est limité à deux
mille.
Au delà de ce nombre, toute communication doit être payée
à raison de 25 centimes, mais cette taxe supplémentaire
peut être récupérée par l'abonné,
sur la personne qui l'a motivée en faisant usage des téléphones
au delà du chiffre accordé.
La rapidité avec laquelle s'est augmenté le nombre des
abonnés a démontré l'utilité des serviœs
que pouvait rendre cette nouvelle industrie qui fut accueillie avec
empressement par la population Luxembourgeoise.
A la fin de l'année 1886, ce réseau comptait
déjà 209 abonnés, et le nombre total des
communications établies par le bureau central s'élevait
à une moyenne de trois communications par jour et par abonné.
A la fin de 1887, il y avait trois 100 abonnés
au réseau téléphonique de la ville de Luxembourg.
Trois cabines téléphoniques publiques ont en outre été
ouvertes, avec un tarif de 25 centimes par cinq minutes de conversation.
Quatorze autres petits réseaux créés dans les
localités les plus importantes du Grand-Duché, rayonnent
autour de la ville de Luxembourg et sont tous reliés au réseau
central de la capital par l'intermédiaire duquel ils sont mis
en communication.
L'ensemble des abonnés du Grand-Duché s'élève
au nombre de 485.
Une somme de 100,000 francs fut votée en 1887, par la Chambre
des députés, en vue de construire de nouvelles lignes
téléphoniques de manière à établir
des communications dans tous les villages du pays.
En 1893 le nombre d’abonnés dans
la Ville de Luxembourg est d’environ 450. Pour augmenter
leur nombre, le réseau comprend en dehors de la Ville proprement
dite une partie au moins des communes de Hollerich, Rollingergrund,
Eich et Hamm (fusionnées en 1920 dans la capitale).

 
Carte du réseau en 1898 puis 2 cartes en 1899
L’extension du réseau téléphonique
à l’ensemble du pays se fait en deux étapes
:
D’abord, aux régions à caractère industriel,
commercial et touristique (entre 1886 et 1889), puis jusqu’en
1914 dans les zones rurales, y comprises des cabines téléphoniques
communales.
- Dès 1886, le service téléphonique fait concurrence
au service télégraphique, installé par le Gouvernement
entre 1862 et 1880.
- De 1905 à 1914, les premiers câbles (d’abonnés)
souterrains sont posés.
- Enfin, en 1922 le service téléphonique automatique
apparaît.
Un processus de démocratisation de l’accès au téléphone
s’est déclenché. L'ouverture du réseau téléphonique
à l’étranger se fait par étapes.
- A partir de 1898, les réseaux luxembourgeois sont reliés
à celui d’Arlon. La même année, des extensions
ont lieu, par exemple à Bastogne, Neufchâteau, Libramont.
- A partir du 1er juillet 1904, tous les réseaux belges et
luxembourgeois sont liés.
- En octobre 1898, une Convention sur le service téléphonique
entre le Luxembourg et la France est signée.
- Au 1er février 1900, le Luxembourg est relié à
Paris et à d’autres villes françaises.
La Convention réglant le service téléphonique
entre l’Allemagne et le Luxembourg est signée le 20 août
1902, trois mois après la nouvelle Convention ferroviaire du
11 novembre 1902.
C’est alors seulement que « l’Allemagne abandonne
définitivement l’obstruction systématique qu’elle
avait faite jusqu’ici dans la question du téléphone
». En fait, l’Allemagne a lié question téléphonique
et question ferroviaire.
Exposition universelle de Paris 1889 Le Luxembourg participe pour
la première fois en tant que pays indépendant. Les P&T
(aujourd’hui POST) présentent un plan pour équiper
le Luxembourg d’un réseau téléphonique.
sommaire
1907 Le multiple de Luxembourg-Ville 
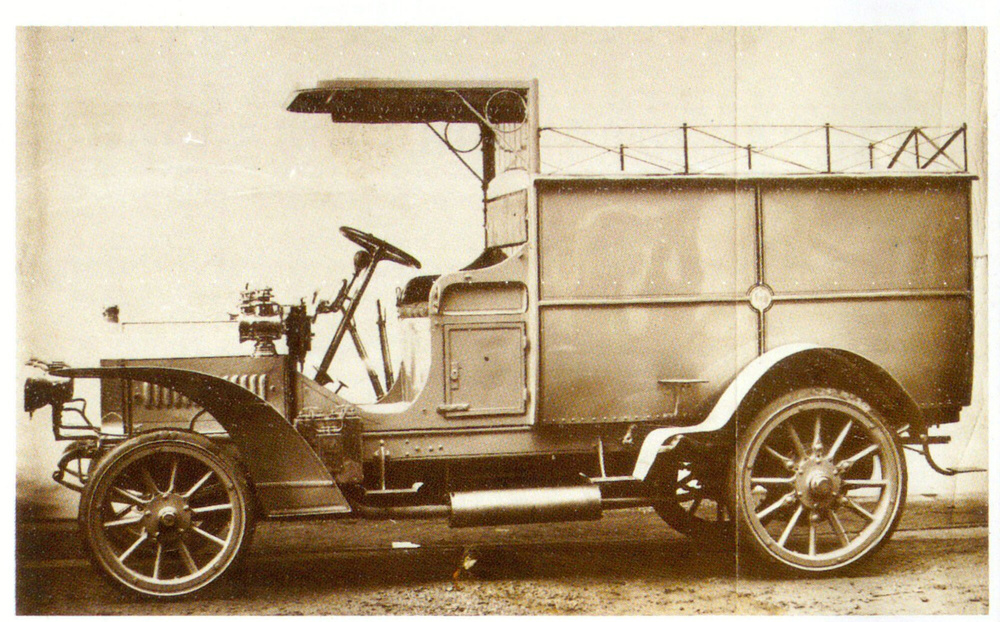
En décembre 1910, les services
postaux se dotent d'une première voiture postale automobile.
Elle atteint une vitesse maximale de 20 à 25 km/h.
sommaire
 
Carte du réseau téléphonique luxembourgeois en
1908, puis en 1912
En 1919, on comptait 875 postes téléphoniques
murales du type Boettcher avec microphone et de 4.515 postes
d’un nouveau modèle du type stf03 au Grand-Duché.


Poste téléphonique du type Boettcher
électrodynamique avec 2 écouteurs (Musée POST
Luxembourg)
Poste téléphonique mural du type Boettcher avec microphone
à charbon
L’appareil Boettcher avec microphone à
charbon constituait une amélioration des premiers appareils
téléphoniques qui étaient équipés
d’une embouchure (cornet) pour capter les sons de la voix de
l’utilisateur. Une membrane métallique, mise en vibration
par les ondes acoustiques, induisait un faible courant électrique
dans une bobine, disposée autour d’un aimant derrière
la membrane. Le courant électrique généré
par cet émetteur était transporté à distance
vers un dispositif analogue, appelé récepteur, où
une membrane, mise en mouvement par le courant, restituait les ondes
acoustiques originales. Comme le courant électrique était
faible, la communication téléphonique se passait bien
entre deux correspondants situés à faible distance.
A partir d’une distance de quelques dizaines de kilomètres,
la communication était à peine audible. Les deux récepteurs
attachés à un appareil téléphonique de
l’époque ne permettaient non seulement à un deuxième
interlocuteur d’écouter la conversation, mais ils facilitaient
également à un seul utilisateur de mieux entendre son
correspondant en tenant les deux écouteurs près des
oreilles.
Les premiers appareils téléphoniques installés
au Luxembourg étaient donc basés uniquement sur l’effet
électrodynamique, breveté par Graham Bell. Dans les
pays voisins on avait déjà remplacé les capteurs
de sons magnétiques par des microphones à charbon.
Le physicien anglo-américain David Edward Hughes avait mis
à point un tel dispositif à partir de 1878 pour améliorer
le transmetteur téléphonique de Graham Bell. Le désavantage
du microphone à charbon était l’ajoute nécessaire
d’une pile électrique locale dans les appareils.
 stf03 Siemens et Halske
stf03 Siemens et Halske
A partir de 1897, l’Admininistration
des Postes et Télégraphes procéda progressivement
à la transformation des 1.500 appareils Boettcher originaux
installés dans le réseau téléphonique,
respectivement au remplacement par le nouveau modèle stf03.
A la demande des abonnés, les services techniques de l’administration
enlevèrent l’appareil Boettcher pour remplacer, dans leurs
ateliers, l’embouchure et le transmetteur Bell par un microphone
à granules de charbon. Une pile sèche, logée
dans une petite armoire en bois, fut fixée à l’extérieur
du caisson. L’inducteur, actionné par une manivelle pour
appeler le bureau téléphonique, restait en place dans
le caisson de l’appareil.
La procédure d’échange s’est terminée
en 1906 et les appareils sans microphone, remplacés par des
modèles plus récents, furent vendus comme rebut à
un ferrailleur en 1911.
Lors de la mise en service de la première liaison
téléphonique internationale avec la Belgique, les ingénieurs
de l’Administration belge exprimaient leur inquiétude
au sujet de la qualité médiocre des microphones à
charbon utilisés au Luxembourg.
Les abonnés luxembourgeois comprenaient trés bien leurs
correspondents belges, tandis que ceux-ci n’entendaient que très
difficilement la voix des personnes luxembourgeoises.
L’Admininistration des Postes et Télégraphes
luxembourgeoise était contrainte de chercher un modèle
plus perfectionné.
Dès 1907, un nouveau appareil mural, équipé d’un
port-microphone mobile qui pouvait être déplacé
vers le haut et vers le bas, fut installé.
Ces postes téléphoniques du type stf03 ont été
fournis par la firme Siemens et Halske de Berlin.
En 1919,
le nombre d’abonnés au téléphone dépassait
5.000 unités, mais les raccordements étaient
concentrés à Luxembourg et dans les autres grandes localités.
Les utilisateurs étaient des notables, commercants, artisans
et quelques rares personnes privées.
A la campagne, l’existence du téléphone était
peu connue. Il fallait se déplacer dans une cabine publique
pour téléphoner, par exemple pour appeler un médecin
en cas d’urgence.
On comptait 71 cabines publiques de l’Etat et 238 cabines
publiques communales à travers le pays en 1919.
Luxembourg bureau de poste en 1920 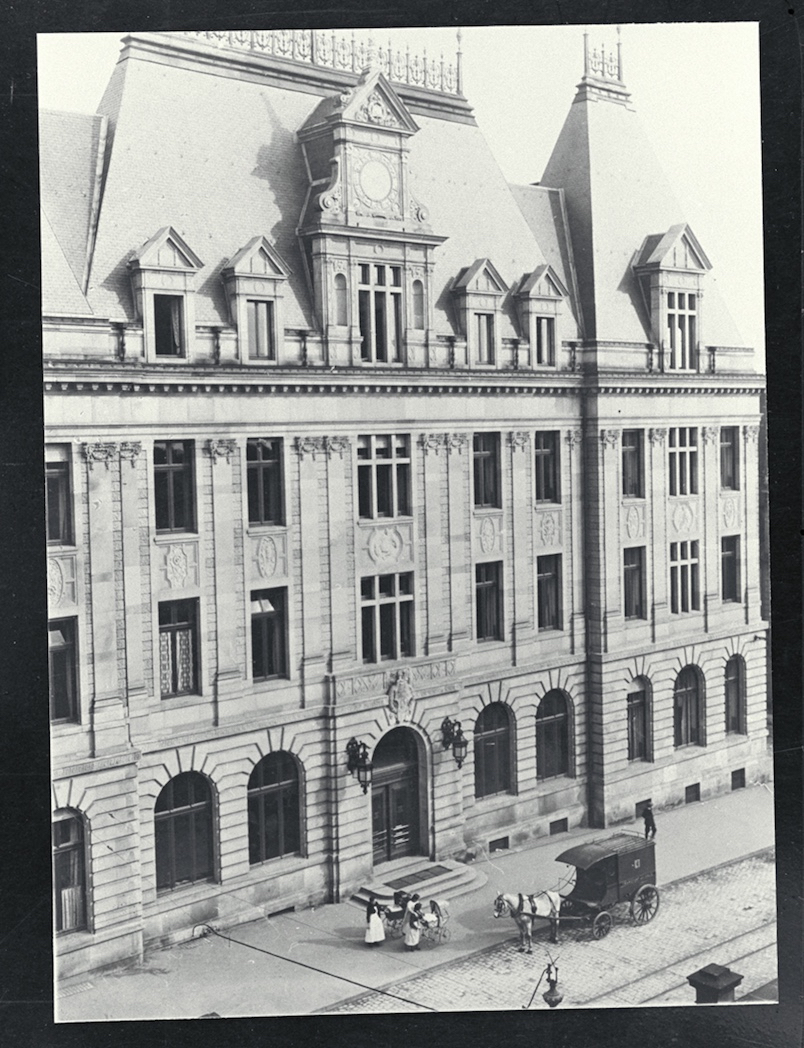
sommaire
En 1922, le réseau téléphonique
de la Ville de Luxembourg est doté d'un commutateur
automatique Thomson fonctionnant avec des sélecteurs
Strowger.
Le premier modèle dispose d'une capacité de seulement
3200 numéros, à cette date il y avait 2600 abonnés
de raccordés.
 Luxemburger Illustrierte n° 51
Luxemburger Illustrierte n° 51
A partir de 1938, l'Administration des Postes,
Télégraphes et Téléphones procède
à l'installation de commutateurs automatiques dans les centraux
téléphoniques du nord du pays. Il s'agit de commutateurs
du système Siemens fonctionnant avec des sélecteurs
Strowger.
En 1946, après la deuxieème guerre
mondiale, il n'y avait plus de téléphone du tout sur
les trois quarts du territoire.
Loi du 20 juillet 1950 concernant l'automatisation
intégrale du réseau téléphonique du Pays.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 5
juillet 1950 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même
mois portant qu´il n ´y a pas lieu à second vote
; Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à
faire procéder, par étapes s´échelonnant
sur plusieursannées, à l´automatisation intégrale
du réseau téléphonique du pays.
Art. 2. Un crédit de 300 millions de francs est
mis à la disposition du Gouvernement pour l´exécution
des travaux prévus par la présente loi.
Art. 3. Le Gouvernement est autorisé à
émettre un emprunt jusqu´à concurrence du montant
ci-dessus indiqué. Les modalités de l´emprunt,
sa durée, la date d´émission, les conditions de
remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la
coupure des obligations à émettre, l´époque
et le mode des souscriptions et du paiement des coupons, ainsi que
toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet
d´un arrêté ministériel.
Art. 4. Pour l´exécution de la présente
loi, ils era prévu1
- 1° au Budget des recettes de l´exercice 1950 un nouvel
article 895 « Produit de l´emprunt à réaliser
en exécution de la loi du 20 juillet 1950 concernant l´automatisation
intégrale du réseau téléphonique du pays
........ pour mémoire » et
- 2° au Budget des dépenses de l´exercice 1950, en
remplacement de l´art. 207 bis « Automatisation du pays
? 2me crédit (Sans distinction d ´exercice).................
5.000.000 » un nouvel article
Art. 207 bis libellé comme suit : « Travaux à
effectuer en exécution de la loi du 20 juillet 1950 concernant
l´automatisation intégrale du réseau téléphonique
du pays (Crédit non limitatif) 5.000.000».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée
au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 2o juillet 1950.
Charlotte Le Ministre des Finances,Pierre Dupong.
En 1950 le Gouvernement fut autorisé à
procéder à la modernisation et l’automatisation
intégrale des 51 centraux téléphoniques
du pays moyennant l’approbation par la Chambre des Députés
d’un crédit de 300 millions francs luxembourgeois.
Les travaux furent confiés aux firmes Siemens-Halske de Munich
et Albiswerk AG de Zurich et ont été achevés
en octobre 1963
En 1954 Dans le cadre de l'automatisation du
réseau téléphonique luxembourgeois, le Grand-Duché
fait appel à un sélecteur EMD (Edelmetall-Motor-Drehwähler)
de l'entreprise allemande Siemens & Halske, ainsi que de
la firme suisse Albiswerk Zürich AG.
Le premier entrant en service le 24 août 1954 faisant
du Luxembourg un pionnier mondial en cette matière. Photos
d'un centre avec les sélecteurs EMD.


Le sélecteur rotatif de moteur à contact en métal
précieux : le sélecteur EMD
|
Ce selecteur est un élément de
couplage électromécanique dans la technologie
de central téléphonique analogique .
Contrairement à son prédécesseur Strowger
à deux mouvements, le sélecteur rotatif à
levier (HDW) n'a qu'un seul mouvement de rotation.
Il est entraîné par un type spécial de moteur
pas à pas, qui se compose de deux bobine . Les fils vocaux
sont commutés via des contacts revêtus de métal
précieux (alliage palladium-argent), qui sont actionnés
électromagnétiquement et pressés contre
les contacts de segment disposés en demi-cercle autour
du sélecteur. Ainsi, lors de la sélection, une
connexion galvanique avec le "multiple" , les lignes
connectées sont évitées, de sorte que,
contrairement au sélecteur HDW, aucun bruit de craquement
ne se produit sur les lignes voisines aucune abrasion du revêtement
de métal précieux sur les bras de commutation
pour les fils de parole ne se fait.

Sélecteur rotatif à contacts
en métal précieux avec
son moteur à 2 relais.
Le sélecteur EMD
est un développement allemand, il a été
développé par Siemens selon les spécifications
de la poste fédérale allemande (DBP) et utilisé
dans le système allemand 55 et le système
55v.
En 1955, la direction des Postes a décidé de n'utiliser
à l'avenir que le sélecteur EMD afin de parvenir
à une technologie uniforme.
Le sélecteur EMD est également devenu un succès
à l'exportation, par exemple vers l'Italie et d'autres
pays.
En raison du type d'entraînement, il peut
également déplacer plus de bras de commutation
que le sélecteur à levier (trois bras de commutation
avec le sélecteur rotatif à levier, jusqu'à
huit bras de commutation avec l'EMD).
Les huit bras de commutation découlent de la nécessité
de connecter les lignes longue distance à quatre fils.
Il s'agit purement d'un sélecteur rotatif dont les champs
de contact sont tous disposés en demi-cercle sur un seul
niveau. Cela lui permet d'atteindre une vitesse de rotation
élevée. Les fils pour la conversation sont soulevés
lors de la rotation, ils ne sont pressés contre les lattes
que par un aimant de pression lorsque cela est nécessaire.
Il était donc possible d'utiliser des métaux nobles
pour une très haute qualité. Ce système
génère beaucoup moins d'interférences dues
aux vibrations sur les sélecteurs voisins. Grâce
aux aimants de pression, les contacts sensibles ne sont pas
usés par le meulage lors de la rotation. L'usure est
nettement inférieure et les résistances de contact
sont plus faibles, ce qui conduit à une bonne communication.
Lors du développement, une attention
particulière a également été portée
à l'installation et à la maintenance.
Le sélecteur EMD n'a pas besoin d'être
ajusté pendant l'installation, il peut donc être
installé et retiré très rapidement.
Le sélecteur est une construction sans soudure. Cela
accélère la construction d'un cadre. Il n'y a
aucun risque d'apparition de soudures à froid . Le sélecteur
EMD peut être contrôlé directement comme
une molette de levier, c'est ce qu'on appelle le contrôle
direct. Il peut également être contrôlé
via un registre et un marqueur (contrôle indirect).
Dans la technologie de 1955, le sélecteur
est contrôlé par un ensemble de relais adjacent
et le processus de numérotation par impulsions .
La méthode de numérotation multifréquence
ne peut pas être utilisée avec cette commande directe.
Selon la méthode de transmission, il
existe différentes conceptions, avec deux bras pour la
communication à deux fils dans le réseau local
ou huit bras pour la communication à quatre fils pour
le réseau longue distance.
L'entretien était plus facile, il y avait moins d'usure
et le bruit de fonctionnement était beaucoup plus silencieux.
 
Chercheur d'appel (AS) avec circuit d'abonné
du système 55v et Sélecteur EMD 4 fils - à
utiliser comme sélecteur de direction (RW).
En République fédérale
d'Allemagne , ces sélecteurs ont été utilisés
dans les centres de commutation de Deutsche Telekom à
partir de 1955 environ jusqu'à ce qu'ils soient entièrement
numérisés . Le dernier échange à
sélecteurs EMD de Deutsche Telekom AG a été
mis hors service le 17 décembre 1997 à Stolberg-Gressenich
. Au Deutsche Post de la RDA , des sélecteurs rotatifs
à moteur du système 58 similaires à l'électeur
EMD ont été utilisés dans une faible quantité.
Pendant ce temps, la numérisation du réseau de
renseignement a rendu cette technologie obsolète et les
électeurs EMD ne sont plus utilisés.


Sélecteurs EMD du dernier échange analogique allemand
en 1997. Central 55v
.
A la
"Deutsche Bahn", il restait jusqu'en 2005 un bureau
EMD actif. C'était le dernier bureau du genre en activité
en Allemagne.
|
Au début des années 1950 on comptait
16.800 abonnés au téléphone qui étaient
raccordés à 51 centraux téléphoniques
En 1963, le réseau téléphonique luxembourgeois
sera intégralement automatisé.
sommaire
Parmi les 51 centraux, 16 seront équipés d’un
commutateur automatique Strowger EMD installés
par les firmes Thomson-Houston de Paris
et Siemens-Halske de Berlin, les autres
seront équipés de commutateurs
Rotary installés par la société Bell
Telephone Company d’Anvers.
Deux abonnés raccordés à un tel central automatique
pouvaient correspondre entre eux sans l’intervention d’un
opérateur par la seule manoeuvre du cadran d’appel.
Les abonnés raccordés aux autres 35 centraux
continuaient à passer par un bureau de commutation manuelle,
comme au début de l’introduction du téléphone.
Le système téléphonique
central du Luxembourg était conçu en forme d’étoile,
la ville de Luxembourg représentant le nœud central.
Il y avait 6 noeud secondaires (centraux) qui désservaient
les plus petits centres répartis dans le pays.
Cela signifie que si l’on téléphonait d’Esch-sur-Alzette
à Ettelbruck, il fallait toujours passer par le central
de Luxembourg-Centre. Toute communication qui quittait le secteur
passait par celui-ci. Il s’agissait d’un point très
critique du réseau. En 1954, cette solution s’avérait
être pratique, mais plus tard, dans les années 1970,
cette configuration devenait de plus en plus gênante.

Malgré des travaux d’agrandissement dans les années
1950, l’espace disponible ne suffisait plus à un moment
donné. Voilà pourquoi, il fallait ajouter d’autres
centraux.
|
 |
C’est ainsi que les centraux de Kirchberg
et de Luxembourg-Gare furent créés dans les années
1960 et plus tard celui de Belair.
1969 le central EMD de Luxembourg-Gare, est mis en service,
il est construit avec les mêmes éléments que par
exemple celui de Wasserbillig, c’est-à-dire avec
des sélecteurs EMD.
Cette technologie était encore plus performante en comparaison
avec l’équipement du central de Luxembourg-Centre, qui datait
de 1954, mais qui avait été mis à niveau à
intervalles réguliers, le central de Luxembourg-Gare fonctionnait
bien mieux. Il y avait en effet de grandes différences à
la fois au niveau du fonctionnement et de la structure.
Le central de Luxembourg-Gare desservait une
partie du quartier de Luxembourg-Gare, ainsi que les localités
de Bonnevoie, Howald, Gasperich et Cessange. A un moment, on envisageait
d’étendre la couverture du quartier de la gare jusqu’au
Pont Adolphe, mais on s’apercevait rapidement que cela dépasserait
les capacités du central. Voilà pourquoi, la limite
du secteur se trouvait au niveau du bâtiment d’ARBED.
Il y avait donc une rue, dont le côté plus proche
de la gare correspondait à des numéros commençant
en 48 [et 49] et l’autre côté fonctionnait avec
des numéros débutant en 47 et desservis par le central
de Luxembourg-Centre.
Un autre grand problème connaissait son pic [à la
fin] des années 1960 et commençait à s’améliorer
dans les années 1980 grâce à un changement
majeur. Ainsi, à un moment donné, il n’était
pratiquement plus possible d’être raccordé au
réseau téléphonique à Bonnevoie. En
effet, les câbles devaient passer en-dessous des rails des
chemins de fer. Ces câbles avaient été posés
[au moment de la construction du réseau] et il n’y
avait aucune possibilité d’en accroître le nombre.
D’ailleurs, toutes les possibilités d’usage concentré
avaient déjà été mises en œuvre
avec notamment l’emploi de répartiteurs intermédiaires.
Ces répartiteurs étaient donc installés dans
des écoles ou dans des armoires, par exemple à côté
du siège de l’entreprise SOGEL. Les raccordements
finaux du central y débouchaient tout comme les câbles
des rues de Bonnevoie. Quand il fallait créer un nouveau
raccordement, on essayait donc de trouver une paire libre entre
le répartiteur intermédiaire et le répartiteur
principal [du Central Téléphonique Gare]. Dans le
câble, il y avait normalement encore quelques paires libres,
puisqu’il avait été conçu dans des dimensions
assez importantes [selon les estimations à la création
du central Gare].
Or, à un moment donné, les câbles venant du
central Gare étaient complètement saturés.
On utilisait alors en partie des concentrateurs de lignes,
comme on a pu les voir à Wasserbillig, mais il fallait
trouver une solution à long terme. Cette solution était
assez coûteuse, puisqu’il fallait creuser un tunnel
en-dessous des rails des chemins de fer. Ce tunnel avait un diamètre
de 2 mètres et on le remplissait ensuite de tuyaux, par
lesquels passaient alors les câbles téléphoniques.
Cette mesure mettait un terme à la pénurie des paires
et tout le monde pouvait désormais être raccordé
au réseau téléphonique.
Le central [de Luxembourg-Gare] fut agrandi une nouvelle
fois en 1978 [de 3000 raccordements], les travaux se terminant
en 1979.
Quand un tel central était construit, l’apport manuel
était énorme. L’entreprise SIEMENS envoyait
alors 10 monteurs, qui travaillaient pendant 6 ou 7 mois, sans
interruption. Il vaut d’ailleurs mieux taire la hauteur d’un
tel investissement.
Le central de Luxembourg-Gare hébergeait par ailleurs,
sur une partie du deuxième étage, [l’équipement
technique du] bureau manuel, sur lequel je vais revenir, ainsi
qu’un central qui assurait la liaison avec l’étranger.
Dans la terminologie allemande, on parlait du « Internationales
Kopfamt » [centre de transit international], que je vais
désormais appeler le centre IKA. Il se trouvait au deuxième
et au troisième étage du bâtiment de Luxembourg-Gare.
Si un abonné, peu importe où dans le pays, entrait
deux fois le chiffre 0 pour établir une liaison avec l’étranger,
il était transmis d’un central à l’autre
pour arriver à la gare de la capitale. Quand il composait
ensuite le 33 pour joindre la France, cette direction était
sélectionnée par le central IKA et un ordinateur
[équipé en majorité de relais mécaniques]
déterminait si l’appel était pour Paris, Strasbourg,
etc.
De Luxembourg-Gare partaient les liaisons pour toutes les grandes
villes de la France et de ses pays voisins, comme par exemple
en Suisse, Bâle et Zurich.
Le central de Luxembourg-Gare hébergeait également
le bureau manuel, on travaillait toujours avec des commutateurs
manuels, notamment aussi pour les liaisons avec l’étranger
En effet, en 1974, il était possible de sélectionner
nos pays voisins de manière automatique, mais dès
que l’appel devait aller au-delà, les liaisons passaient
d’abord à des centraux internationaux / bureaux interurbains
dans le pays de destination, que les employés de Luxembourg-Centre
contactaient pour faire une demande de connexion. Cette technologie
[avec les cordons avec fiches manuelles] était largement
obsolète, voilà pourquoi on construisait un nouveau
bureau manuel à Luxembourg-Gare et ce bureau était
de type “sans cordon“.
Tout fonctionnait grâce à des boutons, même
si, en coulisses, il s’agissait toujours de sélecteurs
EMD qui réagissaient et pilotaient le système en
fonction des signaux des boutons.
Une autre nouveauté consistait en une file d’attente.
Quand un client appelait et que tous les opérateurs étaient
occupés, il obtenait une place donnée dans la file
d’attente. Dès qu’un opérateur se libérait,
le premier dans la file d’attente fut connecté à
cet opérateur. Ce bureau déménageait à
son tour à Luxembourg-Gare et avec lui le service de renseignement.
Il ne s’agissait évidemment pas du renseignement lié
à l’espionnage. Quand les gens appelaient à
l’étranger ils ignoraient, pour la plupart du temps,
les numéros de téléphone, sauf s’il
s’agissait d’une entreprise avec laquelle ils collaboraient
régulièrement. Pour obtenir le numéro nécessaire,
ils pouvaient contacter le service de renseignement, qui détenait
tous les annuaires étrangers et pouvaient renseigner le
client.
Ce service était gratuit en ce qui concerne le renseignement
sur les numéros internationaux. Pour le service national,
le but était surtout de renseigner sur des changements
de numéros récents, en cas de déménagement
ou de création d’une nouvelle entreprise, puisque
l’annuaire ne paraissait qu’une seule fois par année.
Or, certains gens étaient un peu paresseux, ne disposaient
pas d’un annuaire ou ignoraient l’endroit où
ils l’avaient posé, et appelaient ce service pour
demander un numéro qui existait depuis vingt ans. Pour
de tels cas, les opérateurs avaient un bouton spécial
qui facturait une communication aux clients en question. Ces subtilités
étaient vraiment intéressantes.
En principe, nous ne travaillions que de 8h à 12h et de
14h à 18h. Mais nous avions néanmoins instauré
un roulement pour assurer une permanence le samedi matin. La moitié
de l’équipe, celle qui travaillait le samedi matin,
disposait alors d’une après-midi libre le vendredi
d’après. Nous avions donc un weekend prolongé
toutes les deux semaines.
Quand le central fut agrandi et notamment avec l’extension
du centre de transit international, qui fut relié à
de plus en plus de pays, le central de Luxembourg-Gare était
soumis au travail posté. Deux employés se relayaient
ainsi, le premier commençait à 6h du matin pour
terminer à 14h et le deuxième travaillait de 14h
à 22h. Pendant la nuit, le central n’était
pas occupé. Or, la Poste avait déjà installé
antérieurement un système d’alarme centralisé
qui débouchait au central de Luxembourg-Centre. Chaque
central y était relié et correspondait à
une lampe sur un tableau d’affichage. Quand une telle lampe
s’allumait, [l’équipe du] central de Luxembourg-Centre
devait intervenir en fonction de l’incident. En effet, ce
central avait un régime de travail posté de 24h
sur 24. Elle devait donc s’occuper de tous les incidents
et on lui déléguait souvent les cas délicats.
Dans les années 1980, les charges de cette équipe
étaient encore gérables, mais plus tard leurs responsabilités
croissaient sans cesse et il n’était plus agréable
d’y travailler.
Il y avait d’ailleurs encore une installation très
intéressante au central, à savoir le « correspondant
automatique ». Les signaux d’alarme étaient
commutés sur un tel correspondant automatique et il était
alors possible d’appeler de l’extérieur. Le signal
était alors transformé en indicatif d’appel,
p.ex. le signal “occupé“ en 450 Hertz, et chaque
tonalité correspondait à une signification spécifique.
En cas de signal d’alarme, le premier pas consistait donc
à appeler et à comparer l’indicatif d’appel
entendu avec un tableau de correspondance pour en déterminer
la signification. En fonction du type d’alarme, un alarme
« bleu » correspondait par exemple à un incident
important et consistait en une tonalité 450Hz continue,
il fallait réagir et contacter, si nécessaire, les
personnes compétentes. Quand ce principe fut mis en place,
les spécialistes pouvaient jouir d’un numéro
de service, à condition d’être prêt à
se rendre au central, pendant la nuit, y compris les weekends.
Les personnes qui acceptaient ces conditions, se voyaient accorder
le numéro de service. Cette configuration existait surtout
dans les années 1960 et au début des années
1970.
Quand j’ai commencé à travailler à la
Poste, un ingénieur devait apparemment accumuler de l’épargne
et monopolisait cette fonction. Initialement, on argumentait qu’il
fallait être fonctionnaire pour pouvoir jouir d’un
numéro de service, mais les excuses variaient au cours
du temps. Cette situation s’est améliorée avec
l’introduction du service du sémaphone. Les sémaphones
étaient de petits instruments qui pouvaient recevoir des
signaux par voie radiométrique quand on les appelait. Ils
pouvaient recevoir ces ondes partout et présentaient l’avantage
de pouvoir être emportés. C’est à ce
moment, que la Poste établît un nouveau service,
invisible aux clients, à savoir le service des «
astreintes à domicile ». Les personnes qui y participaient
recevaient un sémaphone et devaient réduire leurs
déplacements au minimum pour leurs périodes d’astreintes.
Quand une alarme était déclenchée dans un
central donné, on les contactait via sémaphone et
ils devaient ensuite appeler à Luxembourg-Centre pour obtenir
des informations sur le central en panne et alors s’y rendre.
Un roulement avait ainsi été mis en place avec 7
ou 8 personnes [pour le Central Téléphonique Gare],
de sorte que nous étions de service toutes les 4 ou 5 semaines.
Ceux de garde devaient porter le sémaphone près
d’eux pendant une semaine entière.
Venons-en maintenant aux PC [Personal Computers]. Les PC représentaient
une sorte d’objet sacré aux années 1980, dans
la mesure où ils étaient encore très chers.
Si mes souvenirs sont exacts, les premiers modèles que
l’on pouvait acquérir coûtaient un demi-million
de francs [environ 12.500 €], même si leur prix baissait
évidemment progressivement. Notre service n’en a pas
reçu. Parfois nous avions la chance de voir installer un
nouvel équipement qui était piloté par un
PC et ce dernier était alors inclus dans la livraison.
Certes, on ne pouvait pas s’en servir, vu qu’il devait
fonctionner en permanence pour gérer l’équipement.
Mais nous argumentions qu’un PC était encore sujet
à défaillance et qu’il fallait un substitut
en réserve. Nous avions donc au moins un PC, qui était
évidemment à la disposition du bureau du patron.
Avec la baisse progressive du prix des PC et surtout suite au
déménagement de la Poste à la Cloche d’Or,
une bonne offre avait été soumise par uneCes derniers,
en raison des différents fuseaux horaires, avaient déjà
passé le cap de minuit et n’avaient connu aucun problème
majeur. entreprise. Tout service était alors doté
d’un, voire d’un PC et demi. Quand approchait le nouveau
millénaire, la peur d’une défaillance générale
des systèmes était si grande, que nous recevions
des PC capables de survivre au passage Y2K. A partir de ce moment,
les PC étaient très répandus, de sorte que
pratiquement tout le monde en détenait un. En ce sens,
l’an 2000 était bénéfique pour nous.
Oui, le passage à l’an 2000 avait causé d’importantes
craintes sur les conséquences éventuelles. Un centre
de crise avait été mis en place à Luxembourg-Gare,
vu que le central offrait un espace suffisant, et on y installait
des équipes de toutes sortes de services avec des astreintes
et des permanences pour pouvoir réagir à un incident
éventuel. Aujourd’hui nous savons qu’aucun incident
n’a eu lieu. Les personnes les plus importantes étaient
présentes à minuit, d’autres venaient plus
tard pour faire des essais. Ils avaient cependant déjà
une certaine certitude quant aux capacités de survie du
EWSD, puisque le logiciel était également installé,
notamment dans de nombreux pays asiatiques. La Terre pouvait donc
continuer à tourner en toute tranquillité.
Témoignage
de Carlo STEMPER. |
Par la loi du 17 décembre 1972, le Grand-Duché
de Luxembourg devient un membre fondateur de l'organisation européenne
provisoire de télécommunications par satellite (EUTELSAT
Intérimaire), précurseur juridique de l'actuel EUTELSAT,
basé à Paris.
le 7 juillet 1977 Le Gouvernement est autorisé
à procéder à la construction d'un nouveau central
téléphonique à Luxembourg-Belair, y compris
l'aménagement des alentours.
A la suite d'une vaste consultation internationale lancée en
1977 l'administration a retenu pour l'équipement futur de ses
centraux téléphoniques le système EWS
offert par la firme Siemens.
Les dépenses occasionnées par
l'exécution du programme visé à l'article qui
précède ne peuvent pas dépasser la somme de quarante
millions de francs sans préjudice de l'incidence des hausses
légales de prix pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement
des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d'investissements
pour les télécommunications.
La pose de nouveaux câbles, la mise en oeuvre
de systèmes de multiplexage numérique et l'extension
de nombreux bâtiments de télécommunications ont
permis aux P et T de rétablir une fluidité du trafic
acceptable dès le début de 1978.
Toujours est-il que la surcharge persistante des commutateurs de Luxembourg-Ville
et d'Esch/AIzette-centre imposent à la fin de l'année
1978 toujours certaines gênes à l'écoulement du
trafic en période de forte charge.
Ce n'est que la mise en service des commutateurs à commande
par programme enregistré de Luxembourg-Belair et d'Esch-Wobrecken
qui permettra de décharger progressivement les centraux de
Luxembourg-ville et d'Esch-centre au fur et à mesure des basculements
successifs de trafic liés aux différentes phases de
reprise des raccordements et de rétablir une situation normale
sur l'ensemble du territoire national.
Mai 1979 Deux centraux semi-électroniques EWS sont
inaugurés simultanément à Luxembourg-Belair
et à Esch-Wobrecken.
Par après il importera de stabiliser cette
situation moyennant des extensions en équipements d'écoulement
de trafic judicieusement adaptées à la croissance continuelle
du trafic de télécommunication. Ainsi, l'accroissement
constant du trafic nécessite à
poursuivre les travaux d'extension au niveau des jonctions entre les
centraux nodaux et le central principal de Luxembourg.
En effet, bien que ces jonctions aient permis l'installation d'équipements
de multiplexage analogiques elles ont été renforcées
par de nouveaux câbles. La pose de ces câbles n'est pas
seulement dictée par les besoins en lignes de jonction supplémentaires
mais aussi par le souci d'un dédoublement des voies existantes
en vue d'une augmentation de la sécurité et d'un réacheminement
en cas de panne d'une jonction importante. D'autre part les nouvelles
jonctions permettent de regrouper les nombreuses lignes de transmission
digitale installées dans les secteurs nodaux pour les acheminer
sur des voies digitales à hiérarchie supérieure
vers Luxembourg.
L'installation d'un câble coaxial entre Luxembourg et le central
nodal de Filsdorf est le premier de jonction effecctuée. L'extension
de la liaison Luxembourg-Filsdorf est suivie, au fur et à mesure
des besoins, de poses de câbles de jonction entre Luxembourg
et les autres centraux nodaux qui toutefois, contrairement aux extensions
massives des années soixante-dix, sont étalées
dans le temps de façon à permettre une adaption courante
des moyens aux besoins en capacité de trafic.
Ces nouveaux réseaux assurent une longévité bien
supérieure à celle des réseaux aériens,
sont moins sensibles aux effets perturbateurs des ondes radioélectriques
et sont exposés à un moindre degré aux intempéries
ce qui se traduit par une réduction des travaux d'entretien
et de réparation.
L'assainissement du réseau des télécommunications
comportait également des aspects qualitatifs, telle la rapidité
d'intervention à la suite d'une demande de raccordement au
réseau de télécommunication car au moment de
ces changements, le délai d'attente pour un nouveau raccordement
dont la réalisation est techniquement possible, dépasse
les 30 jours pour 70 % du nombre des postes principaux installés.
Au fur et à mesure de la disparition progressive des réseaux
aériens le nombre d'agents a été réduit
jusqu'à deux ou trois agents par équipe dotée
du matériel nécessaire pour le montage des câbles
d'installation à la façade ou à l'intérieur
des immeubles. Il s'ensuit une multiplication du nombre d'équipes,
une plus grande flexibilité et une meilleure économicité
dans la mise en oeuvre des moyens en personnel et en matériel
disponibles. De plus la reprise sur ordinateur de l'inventaire du
réseau de télécommunication dont l'étude
commencée en 1978 aménera à raccourcir le délai
de renseignement des postulants pour un raccordement et le délai
moyen de réalisation des raccordements.
sommaire
Le système EWS Siemens.
|
Le système EWS possède
une structure éclatée en quatre niveaux fonctionnels:
les périphériques (réseaux de connexion,
joncteurs de ligne d'abonné et unités de commande
du réseau de connexion), les équipements de commande
décentralisés (AST et RSE), les organes de commandes
centraux (ZST) et le centre de commande permettant la centralisation
des fonctions d'exploitation et de maintenance corrective.
Cette organisation du système à plusieurs niveaux
séparant les fonctions de commutation en temps réel
des fonctions plus complexes et moins urgentes de gestion, permet
une adaptation des équipements des différents
niveaux à des tâches ou des environnements nouveaux
sans changement intégral du système, les quatre
niveaux étant interconnectés par des interfaces
normalisés dans le système.
La figure ci dessousdonne une vue d'ensemble sommaire du système
tel qu'il est introduit au Grand-Duché.
 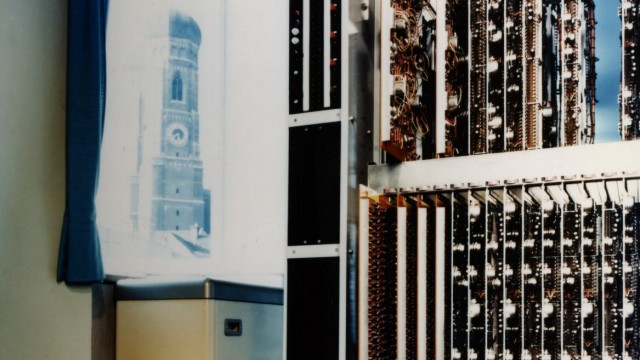
- Les unités de ligne d'abonnés.
Chaque ligne d'abonné est équipée d'une
telle unité qui a pour fonction de surveiller la ligne
afin de reconnaître le décrochage du combiné
de l'appareil téléphonique indiquant la volonté
de l'abonné d'établir une communication téléphonique.
- Les unités de commande du réseau de connexion.
Les unités de ligne informent l'unité de commande
du réseau de connexion du décrochage de l'abonné.
L'unité de commande identifie l'abonné et transmet
ces données au moyen des équipements de commande
décentralisé (AST) vers le processeur central
(ZST). Elle reçoit du processeur les indications nécessaires
à la commande des relais du réseau de connexion
qui établissent un circuit entre l'abonné et l'unité
de réception de la signalisation.
- Les unités de réception de la sélection.
Ces unités sont connectées à la ligne d'abonné
et envoient la tonalité d'invitation à la numération.
Dès réception de cette tonalité l'abonné
peut former le numéro d'appel désiré qui
est capté par l'unité et envoyé après
un transcodage vers le processeur central qui l'examine et fournit
à la commande du réseau de connexion les données
nécessaires à l'établissement de la communication.
- Les joncteurs pour trafic interne. Ces joncteurs sont insérés
dans le circuit si deux abonnés connectés au même
central entrent en communication. Ils se chargent de l'alimentation
en courant continu des appareils téléphoniques
et détectent le raccrochage des abonnés.
- Les joncteurs pour trafic urbain. Ces joncteurs sont divisés
en deux catégories.
Les joncteurs de départ comportent les adaptations nécessaires
pour l'interconnexion du central EWS avec les centraux existants
du réseau situés dans le même secteur, transmettent
la sélection vers le central auquel est rattaché
l'abonné demandé et alimentent l'appareil de l'abonné
qui a demandé la communication en courant continu.
Les joncteurs d'arrivée reçoivent la sélection
d'un autre central et la transmettent au processeur central
qui raccorde l'abonné demandé au joncteur au moyen
de l'unité de commande du réseau de connexion.
- Les joncteurs pour trafic interurbain. Ces joncteurs sont
aussi divisés en deux catégories ayant des fonctions
identiques à ceux prévus pour le trafic urbain
mais adaptés afin de connecter les centraux EWS à
des centraux existants appartenant à un autre secteur
téléphonique.
- Les joncteurs pour trafic international. Ces joncteurs servent
à véhiculer du trafic destiné à
des abonnés situés en dehors du territoire luxembourgeois.
Ils transmettent la sélection vers le central international
à Luxembourg-Gare et sont spécifiquement adaptés
aux équipements de ce central. En outre ils alimentent
l'appareil téléphonique de l'abonné en
courant continu.
- Les joncteurs pour sélection directe. Ils permettent
le raccordement de centraux privés à sélection
directe donnant la possibilité d'atteindre un poste téléphonique
spécifique sans l'intervention de l'opératrice.
- Le réseau de connexion. Le réseau de connexion
est constitué de relais miniaturisés à
contact scellé en boîtier métallique à
maintien magnétique et sert à la mise en communication
des abonnés entre eux ou avec les joncteurs.
Les équipements de commande décentralisés.
- L'équipement AST sert au transfert des informations
entre les périphériques et les organes de commande
centralisée. L'insertion d'un tel équipement est
nécessaire afin d'adapter les vitesses de traitement
de données élevées des organes centralisés
à ceux beaucoup plus basses des périphériques
et vice versa. En outre il s'occupe des adaptations des codes
et des puissances des signaux.
- L'équipement RSE dédoublé génère
les signaux auditifs, les impulsions de taxation et le courant
d'appel requis et les transmet aux périphériques
qui les réexpédient à leurs destinataires.
- L'équipement ESE surveille les périphériques
et les équipements décentralisés, les met
hors service en cas de défaillance et si possible les
remplace automatiquement par des équipements en attente.
Les organes de commande centraux.
Ces organes sont constitués essentiellement du processeur,
de ses mémoires et de ses équipements périphériques
ainsi que de l'interface permettant la connexion du centre de
commande.
- Le processeur central. Il comporte deux calculateurs SSP102
fonctionnant en microsynchronisme et équipés de
mémoires de travail à semiconducteurs de 2 Mbyte
chacun. Le processeur traite toutes les données et génère
tous les ordres nécessaires à l'établissement
et à la libération des circuits de communication,
effectue la taxation des conversations, les mesures de trafic
et toutes les autres opérations nécessaires au
fonctionnement du système.
- Les mémoires externes. Ces mémoires contiennent
tous les programmes du processeur et toutes les données
concernant les abonnés telles que position du compteur
de taxation, type d'appareil téléphonique, etc.
Elles utilisent comme support des bandes magnétiques
et sont dédoublées. Lors d'une perte d'information
dans les mémoires internes des calculateurs ceux-ci sont
rechargées à partir des mémoires externes.
- L'équipement d'intervention local. L'équipement
en question est un téléimprimeur permettant d'effectuer
toutes les opérations normalement exécutées
au centre de commande. Cet équipement est utilisé
lors d'une panne totale du centre de commande ou de la liaison
entre le centre et le central téléphonique.

La conception des centraux EWS, telle qu'elle
est décrite ci-dessus permet une télécommande
intégrale à partir d'un seul centre de commande.
Un déplacement sur place n'est requis qu'en cas de panne
des équipements ou pour les travaux d'extension ou de
raccordement dans le réseau. Toutes les opérations
d'exploitation, de surveillance et de mesure normales sont centralisées,
rationalisées et accélérées de la
sorte.
|
sommaire
Loi du 10 août 1992 portant création de l'Enteprise
des postes et télécommunications.
Après 150 années d'existence l'Administration
des Postes et Télécommuncations est transformée
le 10 août 1992 en Entreprise des Postes et Télécommunications
(EPT).
L'EPT est un établissement public qui jouit de l'autonomie
financière et administrative et est doté de la personnalité
juridique.
Elle reste placée sous la haute surveillance du membre du Gouvernement
luxembourgeois ayant les postes et télécommunications
dans ses attributions.
La loi de 1992 est le point final d'un long processus de demandes
pour plus d'autonomie au sein de l'Administration des Postes et Télécommunications.
Comme dans tous les pays les anciens centraux téléphoniques
sont remplacés par des centraux numériques de grande
capacité.
Les 7 commutateurs téléphoniques, les 7 centraux
de noeud (voir la carte) évoluent en centres numériques
EWSD.
Le système électronique Elektronisches Wählsystem
Digital ( EWSD ), traduit en anglais en Electronic Digital Switching
System , est un système d' échange téléphonique
allemand largement installé , initialement introduit en 1975
par Siemens AG , mais interrompu en 2017.
EWSD peut fonctionner comme un commutateur de bureau d'extrémité
local, un commutateur tandem ou dans une configuration combinée
pour un service de téléphonie fixe ou mobile. Siemens
affirme que les commutateurs EWSD effectuent la commutation de plus
de 160 millions de lignes d'abonnés dans plus d'une centaine
de pays. EWSD.
Données techniques :
- Les six principaux sous-systèmes d'EWSD sont le processeur
de coordination (CP), la commande de réseau de canal commun
(CCNC), le groupe de lignes réseau (LTG), l'unité de
ligne numérique (DLU), le réseau de commutation (SN)
et le RNIS primaire. Unité d'accès (PH).
- Toutes les unités système sont
redondantes afin que le côté inactif de chaque composant
puisse prendre le relais immédiatement en cas d'erreur.
- Le réseau de commutation se compose de quatre étages
de division spatiale de commutateurs 16x16 et d'une section de division
temporelle avec 16 étages de commutateurs 4x4. Le contrôle
est assuré par le processeur de coordination.
- Nombre de lignes d'accès: jusqu'à
250 000
- Nombre de lignes d'alimentation: 240000
- Liaison de trafic: 25200
- Tentatives d'appel en heure de pointe: 10 millions
- Zones tarifaires: 127, pour chaque zone de 6 tarifs
- Changement de tarif toutes les 15 minutes
- Besoin d'espace avec 10000 lignes d'accès: 35 mètres
carrés
....
3 février 1993 : mise en service du réseau
mobile LUXGSM
LUXGSM est la version luxembourgeoise du "Global
System for Mobile Communication" (GSM), soit d'un système
de radiotéléphonie cellulaire numérique flexible.
Il est le résultat d'un projet paneuropéen et avait
pour objectif la mise en place progressive d'une couverture mondiale
du réseau de téléphonie mobile.
Présenté dès juin 1993 au public, le service
fonctionne dans un premier temps uniquement au Grand-Duché
et en Allemagne, avant d'être étendu à l'Europe
et puis au monde entier.
1er janvier 2001 Lancement commercial de l'accès internet
LuxDSL
Depuis le premier janvier 2016, le service
LuxDSL Speedsurf n'est plus commercialisé.
1er janvier 2008 Lancement commercial du service
de télévision digitale IPTV - 'Tëlé vun
der Post'
Après le succès du projet pilote
IPTV en 2007, l'Entreprise des P&T lance en 2008 le service commercial
de la télévision digitale IPTV - 'Tëlé vun
der Post'. Depuis 2008, l'offre a été agrandie de manière
conséquente.
En 2010 il y avait 272 400 abonnés
au téléphone fixe et 764 973 au téléphone
mobile.
En 2013, l'Entreprise des Postes et Télécommunications
décide de changer sa dénomination commerciale en POST
Luxembourg.
Est aussi créée une nouvelle identité visuelle,
symbolisée par son logo. Présentés pour la première
fois le 15 juin 2013 à la Rockhal, les nouvelles couleurs et
le logo sont déployés à partir du 30 septembre
de la même année..
sommaire
La numérotation :
Les numéros de téléphones luxembourgeois comptait
seulement 6 caractères numériques, jusqu'en Mai
2000, puis sont passés à 8.
L'opérateur historique a utilisé un
plan de numérotation ouvert avec des nombres de longueurs variables,
où un identificateur de zone à deux chiffres est suivi
d'un à quatre chiffres, les 6 chiffres formant le numéro
d'abonné.
Après les numéros introduits avant cette date sont bien
entendu restés valides ce qui fait donc que le Luxembourg a
deux plans de numérotation différents. Contrairement
aux autres pays européens, les numéros luxembourgeois
n'ont pas de 0 au début, même au format local.
Les premiers caractères en début de
chaque numéro font offices de codes régionaux et permettent
d'identifier la localité :
| LISTE DES CHIFFRES INITIAUX |
| Chiffres initiaux |
Nom du lieu |
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
Luxembourg City |
| 23 |
Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich |
| 24 20 |
|
| 24 21 |
Weicherdange |
| 24 22 |
Luxembourg City |
| 24 23 |
Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich |
| 24 24 |
|
| 24 25 |
Luxembourg |
| 24 26 |
|
| 24 27 |
|
| 24 28 |
Luxembourg City |
| 24 29 |
Luxembourg/Kockelscheuer |
| 24 30 |
Capellen/Kehlen |
| 24 31 |
Bertrange/Mamer/Munsbach/Strassen |
| 24 32 |
Lintgen/Mersch/Steinfort |
| 24 33 |
Walferdange |
| 24 34 |
Rameldange/Senningerberg |
| 24 35 |
Sandweiler/Moutfort/Roodt-Sur-Syre |
| 24 36 |
Hesperange/Kockelscheuer/Roeser |
| 24 37 |
Leudelange/Ehlange/Mondercange |
| 24 38 |
|
| 24 39 |
Windhof/Steinfort |
| 24 40 |
Howald |
| 24 41 |
|
| 24 42 |
Plateau de Kirchberg |
| 24 43 |
Findel/Kirchberg |
| 24 44 |
|
| 24 45 |
Diedrich |
| 24 46 |
|
| 24 47 |
Lintgen |
| 24 48 |
Contern/Foetz |
| 24 49 |
Howald |
| 24 50 |
Bascharage/Petange/Rodange |
| 24 51 |
Dudelange/Bettembourg/Livange |
| 24 52 |
Dudelange |
| 24 53 |
Esch-Sur-Alzette |
| 24 54 |
Esch-Sur-Alzette |
| 24 55 |
Esch-Sur-Alzette/Mondercange |
| 24 56 |
Rumelange |
| 24 57 |
Esch-sur-Alzette/Schifflange |
| 24 58 |
Soleuvre/Differdange |
| 24 59 |
Soleuvre |
| 24 67 |
Dudelange |
| 24 70 |
|
| 24 71 |
Betzdorf |
| 24 72 |
Echternach |
| 24 73 |
Rosport |
| 24 74 |
Wasserbillig |
| 24 75 |
Grevenmacher-Sur-Moselle |
| 24 76 |
Wormeldange |
| 24 77 |
|
| 24 78 |
Junglinster |
| 24 79 |
Berdorf/Consdorf |
| 24 80 |
Diekirch |
| 24 81 |
Ettelbruck/Reckange-Sur-Mess |
| 24 82 |
|
| 24 83 |
Vianden |
| 24 84 |
|
| 24 85 |
Bissen/Roost |
| 24 86 |
|
| 24 87 |
Larochette |
| 24 88 |
Mertzig/Wahl |
| 24 89 |
|
| 24 90 |
|
| 24 91 |
|
| 24 92 |
Clervaux/Fischbach/Hosingen |
| 24 93 |
|
| 24 94 |
|
| 24 95 |
Wiltz |
| 24 96 |
|
| 24 97 |
Huldange |
| 24 98 |
|
| 24 99 |
Troisvierges |
| 25 |
Luxembourg |
| 26 20 |
|
| 26 21 |
Weicherdange |
| 26 22 |
Luxembourg City |
| 26 23 |
Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich |
| 26 24 |
|
| 26 25 |
Luxembourg |
| 26 26 |
|
| 26 27 |
Belair, Luxembourg City |
| 26 28 |
Luxembourg City |
| 26 29 |
Luxembourg/Kockelscheuer |
| 26 30 |
Capellen/Kehlen |
| 26 31 |
Bertrange/Mamer/Munsbach/Strassen |
| 26 32 |
Lintgen/Mersch/Steinfort |
| 26 33 |
Walferdange |
| 26 34 |
Rameldange/Senningerberg |
| 26 35 |
Sandweiler/Moutfort/Roodt-Sur-Syre |
| 26 36 |
Hesperange/Kockelscheuer/Roeser |
| 26 37 |
Leudelange/Ehlange/Mondercange |
| 26 38 |
|
| 26 39 |
Windhof/Steinfort |
| 26 40 |
Howald |
| 26 41 |
|
| 26 42 |
Plateau de Kirchberg |
| 26 43 |
Findel/Kirchberg |
| 26 44 |
|
| 26 45 |
Diedrich |
| 26 46 |
|
| 26 47 |
Lintgen |
| 26 48 |
Contern/Foetz |
| 26 49 |
Howald |
| 26 50 |
Bascharage/Petange/Rodange |
| 26 51 |
Dudelange/Bettembourg/Livange |
| 26 52 |
Dudelange |
| 26 53 |
Esch-Sur-Alzette |
| 26 54 |
Esch-Sur-Alzette |
| 26 55 |
Esch-Sur-Alzette/Mondercange |
| 26 56 |
Rumelange |
| 26 57 |
Esch-sur-Alzette/Schifflange |
| 26 58 |
Soleuvre/Differdange |
| 26 59 |
Soleuvre |
| 26 67 |
Dudelange |
| 26 70 |
|
| 26 71 |
Betzdorf |
| 26 72 |
Echternach |
| 26 73 |
Rosport |
| 26 74 |
Wasserbillig |
| 26 75 |
Grevenmacher-Sur-Moselle |
| 26 76 |
Wormeldange |
| 26 77 |
|
| 26 78 |
Junglinster |
| 26 79 |
Berdorf/Consdorf |
| 26 80 |
Diekirch |
| 26 81 |
Ettelbruck/Reckange-Sur-Mess |
| 26 82 |
|
| 26 83 |
Vianden |
| 26 84 |
Han/Lesse |
| 26 85 |
Bissen/Roost |
| 26 86 |
|
| 26 87 |
Larochette |
| 26 88 |
Mertzig/Wahl |
| 26 89 |
|
| 26 90 |
|
| 26 91 |
|
| 26 92 |
Clervaux/Fischbach/Hosingen |
| 26 93 |
|
| 26 94 |
|
| 26 95 |
Wiltz |
| 26 96 |
|
| 26 97 |
Huldange |
| 26 98 |
|
| 26 99 |
Troisvierges |
| 27 20 |
|
| 27 21 |
Weicherdange |
| 27 22 |
Luxembourg City |
| 27 23 |
Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich |
| 27 24 |
|
| 27 25 |
Luxembourg |
| 27 26 |
|
| 27 27 |
|
| 27 28 |
Luxembourg City |
| 27 29 |
Luxembourg/Kockelscheuer |
| 27 30 |
Capellen/Kehlen |
| 27 31 |
Bertrange/Mamer/Munsbach/Strassen |
| 27 32 |
Lintgen/Mersch/Steinfort |
| 27 33 |
Walferdange |
| 27 34 |
Rameldange/Senningerberg |
| 27 35 |
Sandweiler/Moutfort/Roodt-Sur-Syre |
| 27 36 |
Hesperange/Kockelscheuer/Roeser |
| 27 37 |
Leudelange/Ehlange/Mondercange |
| 27 38 |
|
| 27 39 |
Windhof/Steinfort |
| 27 40 |
Howald |
| 27 41 |
|
| 27 42 |
Plateau de Kirchberg |
| 27 43 |
Findel/Kirchberg |
| 27 44 |
|
| 27 45 |
Diedrich |
| 27 46 |
|
| 27 47 |
Lintgen |
| 27 48 |
Contern/Foetz |
| 27 49 |
Howald |
| 27 50 |
Bascharage/Petange/Rodange |
| 27 51 |
Dudelange/Bettembourg/Livange |
| 27 52 |
Dudelange |
| 27 53 |
Esch-Sur-Alzette |
| 27 54 |
Esch-Sur-Alzette |
| 27 55 |
Esch-Sur-Alzette/Mondercange |
| 27 56 |
Rumelange |
| 27 57 |
Esch-sur-Alzette/Schifflange |
| 27 58 |
Soleuvre/Differdange |
| 27 59 |
Soleuvre |
| 27 67 |
Dudelange |
| 27 70 |
|
| 27 71 |
Betzdorf |
| 27 72 |
Echternach |
| 27 73 |
Rosport |
| 27 74 |
Wasserbillig |
| 27 75 |
Grevenmacher-Sur-Moselle |
| 27 76 |
Wormeldange |
| 27 77 |
|
| 27 78 |
Junglinster |
| 27 79 |
Berdorf/Consdorf |
| 27 80 |
Diekirch |
| 27 81 |
Ettelbruck/Reckange-Sur-Mess |
| 27 82 |
|
| 27 83 |
Vianden |
| 27 84 |
Han/Lesse |
| 27 85 |
Bissen/Roost |
| 27 86 |
|
| 27 87 |
Larochette |
| 27 88 |
Mertzig/Wahl |
| 27 89 |
|
| 27 90 |
|
| 27 91 |
|
| 27 92 |
Clervaux/Fischbach/Hosingen |
| 27 93 |
|
| 27 94 |
|
| 27 95 |
Wiltz |
| 27 96 |
|
| 27 97 |
Huldange |
| 27 98 |
|
| 27 99 |
Troisvierges |
| 28 |
Luxembourg City |
| 29 |
Luxembourg/Kockelscheuer |
| 30 |
Capellen/Kehlen |
| 31 |
Bertrange/Mamer/Munsbach/Strassen |
| 32 |
Lintgen/Mersch/Steinfort |
| 33 |
Walferdange/Steinsel/Heisdorf |
| 34 |
Rameldange/Senningerberg |
| 35 |
Sandweiler/Moutfort/Roodt-Sur-Syre |
| 36 |
Hesperange/Kockelscheuer/Roeser |
| 37 |
Leudelange/Ehlange/Mondercange |
| 38 |
|
| 39 |
Windhof/Steinfort |
| 4 |
Luxembourg City |
| 40 |
Howald |
| 41 |
|
| 42 |
Plateau de Kirchberg |
| 43 |
Findel/Kirchberg |
| 44 |
|
| 45 |
Diedrich |
| 46 |
|
| 47 |
Lintgen |
| 48 |
Contern/Foetz |
| 49 |
Howald |
| 50 |
Bascharage/Petange/Rodange |
| 51 |
Dudelange/Bettembourg/Livange |
| 52 |
Dudelange |
| 53 |
Esch-Sur-Alzette |
| 54 |
Esch-Sur-Alzette |
| 55 |
Esch-Sur-Alzette/Mondercange |
| 56 |
Rumelange |
| 57 |
Esch-sur-Alzette/Schifflange |
| 58 |
Soleuvre/Differdange |
| 59 |
Soleuvre |
| 67 |
Dudelange |
| 70 |
|
| 71 |
Betzdorf |
| 72 |
Echternach |
| 73 |
Rosport |
| 74 |
Wasserbillig |
| 75 |
Grevenmacher-Sur-Moselle |
| 76 |
Wormeldange |
| 77 |
|
| 78 |
Junglinster |
| 79 |
Berdorf/Consdorf |
| 80 |
Diekirch |
| 81 |
Ettelbruck/Reckange-Sur-Mess |
| 82 |
|
| 83 |
Vianden |
| 84 |
Han/Lesse |
| 85 |
Bissen/Roost |
| 86 |
|
| 87 |
Larochette |
| 88 |
Mertzig/Wahl |
| 89 |
Esch-sur-Sûre |
| 90 |
|
| 91 |
|
| 92 |
Clervaux/Fischbach/Hosingen |
| 93 |
|
| 94 |
|
| 95 |
Wiltz |
| 96 |
|
| 97 |
Huldange |
| 98 |
|
| 99 |
Troisvierges |
|
Cela a été changé par l'introduction
d'un nouveau plan de numérotation en 1999
- Les numéros de téléphone introduits depuis
mai 2000 par l'opérateur historique commencent par "
2 " (généralement 26, 24 et récemment
27 ) suivi de deux à 6 chiffres. . L'identifiant de zone
est toujours présent et suit généralement
le 26, 27 ou 24,
cependant les numéros peuvent être transférés
vers n'importe quelle autre zone.
79 xxxx (exemple de numéro dans Consdorf )
+352 79 xxxx (en cas d'appel depuis l'extérieur du Luxembourg)
2679 xxxx (exemple de numéro dans Consdorf pour les nouvelles
lignes depuis mai 2000)
+352 2679 xxxx (en cas d'appel depuis l'extérieur du
Luxembourg)
4 xxx xx (exemple de numéro à Luxembourg-Ville
)
+352 4 xxx xx (en cas d'appel depuis l'extérieur du Luxembourg)

L'indicatif international pour du Luxembourg
est +352.
La typologie d'un numéro luxembourgeois composé
depuis l'étranger sera par exemple +35227862027.
Au format local, ce même numéro sera 27 86 2027.
|
sommaire
Le plan de migration 2020-2024
Afin de pouvoir continuer à offrir un service de téléphonie
fixe de haute qualité, le passage à une technologie
ultra-moderne est nécessaire.
L'arrêt du réseau téléphonique traditionnel
se fera progressivement jusquà la fin de l'année 2024.
Progressivement, POST va désactiver les 7 commutateurs téléphoniques
répartis sur le territoire.
La zone de Burange est la première à migrer en 2020,
suivie de la zone Est ...
sommaire
|
 convention
convention







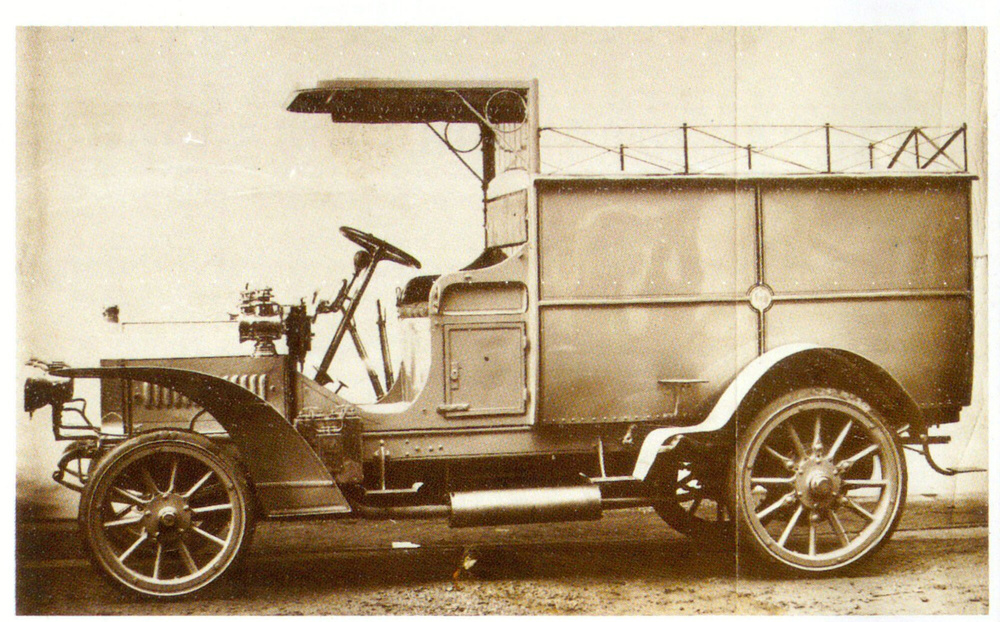




 stf03
stf03 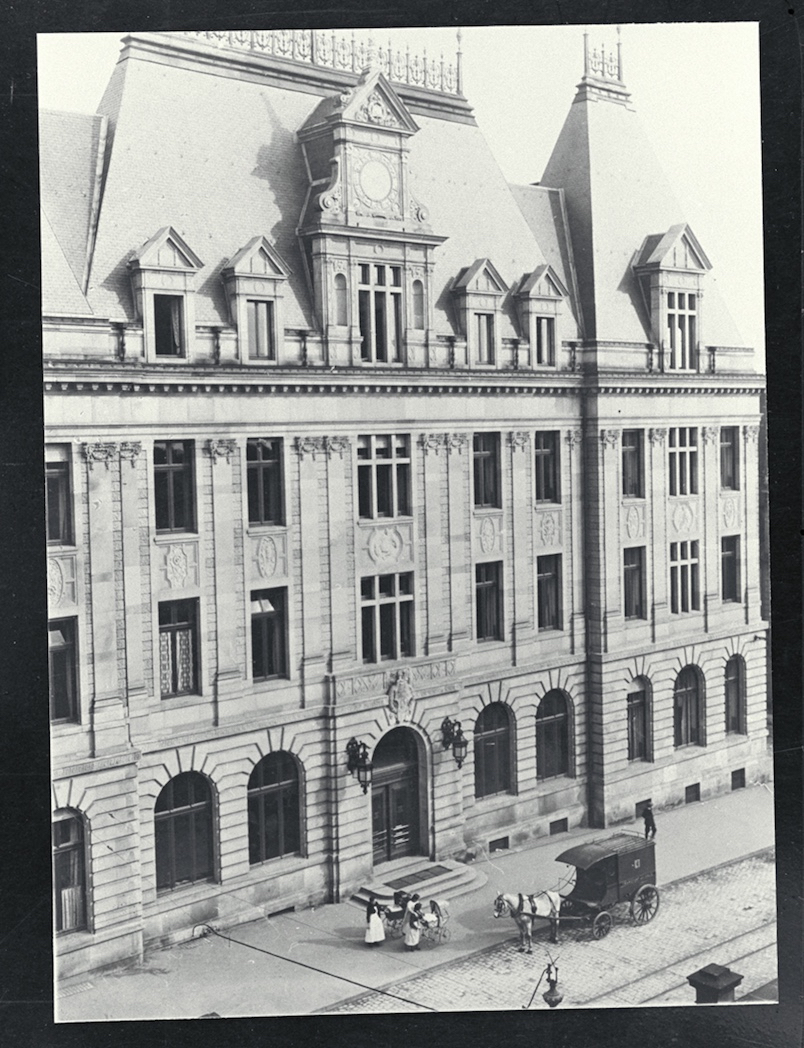
 Luxemburger Illustrierte n° 51
Luxemburger Illustrierte n° 51