Marcel PROUST et le téléphone
Marcel Proust, né le 10 juillet 1871 à Paris où il est mort le 18 novembre 1922, est un écrivain français, dont l'œuvre principale est la suite romanesque intitulée À la recherche du temps perdu, publiée de 1913 à 1927.
Marcel Proust naît à Paris (quartier d'Auteuil
dans le 16e arrondissement), dans la maison de son grand-oncle maternel,
Louis Weil, au 96, rue La Fontaine. Cette maison fut vendue puis détruite
pour construire des immeubles, eux-mêmes démolis lors du
percement de l'avenue Mozart.
Sa mère, née Jeanne Clémence Weil (Paris, 1849
- id., 1905), fille de Nathé Weil (Paris, 1814 - id., 1896),
un agent de change et de Adèle Berncastel (Paris, 1824 - id.,
1890), appartient à une famille de la grande bourgeoisie juive
dont certains membres jouent un rôle important dans l'histoire
du judaïsme français, notamment un oncle de Mme Proust :
Godchaux Weil, alias Ben Lévi, un écrivain célèbre
dans la communauté juive, et Adolphe Crémieux, président
de l'Alliance israélite universelle et ancien ministre, grand-oncle
et témoin de mariage de Mme Proust. Celle-ci, issue d'un milieu
très cultivé, apporte à son fils une culture profonde,
avec une affection parfois envahissante.
Son père, le Dr Adrien Proust (Illiers, 1834 - Paris, 1903),
fils de François Proust (1800-1801 - Illiers, 1855), un commerçant
prospère d'Illiers (Eure-et-Loir) et de Virginie née Catherine
Virginie Torcheux (Cernay, 1809 - Illiers, 1889), est professeur à
la faculté de médecine de Paris après avoir commencé
ses études au séminaire, et un grand hygiéniste,
conseiller du gouvernement pour la lutte contre les épidémies.
Marcel a un frère cadet, Robert, né le 24 mai 1873 (mort
en 1935), qui devient chirurgien. Son parrain est le collectionneur
d'art Eugène Mutiaux.
Sa vie durant, Marcel a attribué sa santé fragile aux
privations subies par sa mère au cours de sa grossesse, pendant
le siège de 1870, puis pendant la Commune de Paris. C'est pour
se protéger des troubles entraînés par la Commune
et sa répression que ses parents ont cherché refuge à
Auteuil. L'accouchement est difficile, mais les soins paternels sauvent
le nouveau-né.
« Peu avant la naissance de Marcel Proust, pendant la Commune,
le docteur Proust avait été blessé par la balle
d'un insurgé, tandis qu'il rentrait de l'hôpital de la
Charité. Madame Proust, enceinte, se remit difficilement de l'émotion
qu'elle avait éprouvée en apprenant le danger auquel venait
d'échapper son mari. L'enfant qu'elle mit au monde bientôt
après naquit si débile que son père craignit qu'il
ne fût point viable. On l'entoura de soins ; il donna les signes
d'une intelligence et d'une sensibilité précoces, mais
sa santé demeura délicate. »
Sa santé est fragile et le printemps devient pour lui la plus
pénible des saisons. Les pollens libérés par les
fleurs dans les premiers beaux jours provoquent chez lui de violentes
crises d'asthme. À 9 ans, alors qu'il rentre d'une promenade
au bois de Boulogne avec ses parents, il étouffe, sa respiration
ne revient pas, son père le voit mourir. Un ultime sursaut le
sauve. Voilà maintenant la menace qui plane sur l'enfant, et
sur l'homme plus tard : la mort peut le saisir dès le retour
du printemps, à la fin d'une promenade, n'importe quand, si une
crise d'asthme est trop forte.
Bien que réunissant les conditions pour faire partie de deux
religions, fils d'un père catholique et d'une mère juive
qui refusa de se convertir au christianisme par égard pour ses
parents, lui-même baptisé à l'église Saint-Louis-d'Antin
à Paris, Marcel Proust a revendiqué son droit de ne pas
se définir par rapport à une religion (en tout cas, pas
la religion juive), mais il écrit être catholique et ses
funérailles eurent bien lieu à l'église. Néanmoins,
dans sa correspondance, on peut lire qu'il n'était « pas
croyant ». Dreyfusard convaincu, il fut sensible à l'antisémitisme
prégnant de son époque et subit lui-même les assauts
antisémites de certaines plumes célèbres.
Il est au début élève d'un petit
cours primaire, le cours Pape-Carpantier, où il a pour condisciple
Jacques Bizet, le fils du compositeur Georges Bizet (décédé
en 1875) et de son épouse Geneviève Halévy. Celle-ci
tient d'abord un salon chez son oncle, où se réunissent
des artistes, puis, lorsqu'elle se remarie en 1886 avec l'avocat Émile
Straus, tient son propre salon, dont Proust sera un habitué.
Marcel Proust étudie ensuite à partir de 1882 au lycée
Condorcet. Il redouble sa classe de cinquième et est inscrit
au tableau d'honneur pour la première fois en décembre
1884. Il est souvent absent à cause de sa santé fragile,
mais il connaît déjà Victor Hugo et Musset par cœur,
comme dans Jean Santeuil. Il est l'élève en philosophie
d'Alphonse Darlu, et il se lie d'une amitié exaltée à
l'adolescence avec Jacques Bizet. Il est aussi ami avec Fernand Gregh,
Jacques Baignères et Daniel Halévy (le cousin de Jacques
Bizet), avec qui il écrit dans des revues littéraires
du lycée.
Le premier amour d'enfance et d'adolescence de l'écrivain est
Marie de Benardaky, fille d'un diplomate polonais, sujet de l'Empire
russe, avec qui il joue dans les jardins des Champs-Élysées,
le jeudi après-midi, avec Antoinette et Lucie Félix-Faure
Goyau, filles du futur président de la République, Léon
Brunschvicg, Paul Bénazet ou Maurice Herbette. Il cessa de voir
Marie de Benardaky en 1887, les premiers élans pour aimer ou
se faire aimer par quelqu'un d'autre que sa mère avaient donc
échoué. C'est la première « jeune fille »,
de celles qu'il a tenté de retrouver plus tard, qu'il a perdue.
Proust vers 1892 
Les premières tentatives littéraires de Proust datent
des dernières années du lycée. Plus tard, en 1892,
Gregh fonde une petite revue, avec ses anciens condisciples de Condorcet,
Le Banquet, dont Proust est le contributeur le plus assidu. Commence
alors sa réputation de snobisme, car il est introduit dans plusieurs
salons parisiens et entame son ascension mondaine. Il est ami un peu
plus tard avec Lucien Daudet, fils du romancier Alphonse Daudet, qui
a six ans de moins que lui. L'adolescent est fasciné par le futur
écrivain. Ils se sont rencontrés au cours de l'année
1895. Jean Lorrain, dans une chronique perfide du Journal, fait une
allusion à leur liaison, au moins sentimentale : Proust et Lorrain
s'affrontent en duel au pistolet le 6 février 1897 dans les bois
de Meudon, sans conséquences.
En 1896, il publie Les Plaisirs et les Jours, un recueil
de poèmes en prose, portraits et nouvelles dans un style fin
de siècle, illustré par Madeleine Lemaire, dont Proust
fréquente le salon, salon où il fait la connaissance de
Reynaldo Hahn, élève de Jules Massenet, qui vient chanter
ses Chansons grises au printemps 1894. C'est également chez Madeleine
Lemaire, au château de Réveillon, que Proust, qui a 23
ans, et Reynaldo Hahn, qui vient d'avoir 20 ans, passent une partie
de l'été 1894. Le livre passe à peu près
inaperçu et la critique l'accueille avec sévérité
— notamment l'écrivain Jean Lorrain, réputé
pour la férocité de ses jugements. Il en dit tant de mal
qu'il se retrouve au petit matin sur un pré, un pistolet à
la main. Face à lui, également un pistolet à la
main, Marcel Proust, avec pour témoin le peintre Jean Béraud.
Tout se termine sans blessures, mais non sans tristesse pour l'auteur
débutant. Ce livre vaut à Proust une réputation
de mondain dilettante qui ne se dissipe qu'après la publication
des premiers tomes d’À la recherche du temps perdu.
C'est en 1907 que Marcel Proust commence l'écriture de son grand
œuvre À la recherche du temps perdu dont les sept tomes
sont publiés entre 1913 (Du côté de chez Swann)
et 1927, c'est-à-dire en partie après sa mort ; le deuxième
volume, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, obtient le prix
Goncourt en 1919.
Marcel Proust meurt épuisé en 1922, d'une bronchite mal
soignée : il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise
à Paris, accompagné par une assistance nombreuse qui salue
un écrivain d'importance et que les générations
suivantes placent au plus haut en faisant de lui un mythe littéraire.
L'œuvre romanesque de Marcel Proust est une réflexion
majeure sur le temps et la mémoire affective comme sur les fonctions
de l'art qui doit proposer ses propres mondes, mais c'est aussi une
réflexion sur l'amour et la jalousie, avec un sentiment de l'échec
et du vide de l'existence qui colore en gris la vision proustienne où
l'homosexualité tient une place importante. La Recherche constitue
également une vaste comédie humaine de plus de deux cents
personnages. Proust recrée des lieux révélateurs,
qu'il s'agisse des lieux de l'enfance dans la maison de tante Léonie
à Combray ou des salons parisiens qui opposent les milieux aristocratiques
et bourgeois, ces mondes étant évoqués d'une plume
parfois acide par un narrateur à la fois captivé et ironique.
Ce théâtre social est animé par des personnages
très divers dont Proust ne dissimule pas les traits comiques
: ces figures sont souvent inspirées par des personnes réelles,
ce qui fait d’À la recherche du temps perdu en partie
un roman à clef et le tableau d'une époque.
La marque de Proust est aussi dans son style aux phrases souvent très
longues, qui suivent la spirale de la création en train de se
faire, cherchant à atteindre une totalité de la réalité
qui échappe toujours.
Au cœur de la Recherche du temps perdu se trouve une réflexion sur les nouvelles technologies téléphoniques qui révolutionnent la phénoménologie de l’écoute et de la communication au début du XXe siècle. L’expérience de la parole à distance, le relais ou la reproduction des sources sonores relayées et, surtout, l’écoute médiatisée ou l’« auscultation » dominent l’imaginaire de l’auralité dans l’œuvre proustien. L’article se propose d’appliquer les concepts de « surécoute » et d’« auscultation médiate » — deux stratégies de lectures développées par le philosophe et musicologue Peter Szendy — pour renouveler l’analyse du texte et réévaluer l’écoute en tant que thématique majeure du roman.
 |
Proust, le téléphone
et la modernité |
 |
A peine inventé,
à peine sorti du laboratoire, le téléphone
suscite l'imaginaire.
A la fin du dix-neuvième siècle, l'artiste - peintre ou écrivain - croise la technique. Fasciné et inquiet, il rencontre la machine. L'objet technique pénètre son univers. La multiplication des expositions universelles, industrielles et la diffusion de plus en plus large de la littérature de vulgarisation scientifique et technique, ne peuvent le laisser indifférent. Une nouvelle civilisation matérielle est sur le point de naître. Des techniques nouvelles font leur apparition. Le « progrès » est à l'ordre du jour ! en est, lui aussi, le témoin. |
Magie et modernité
L'électricité est, parmi ces technologies nouvelles, celle
qui provoque le plus de rêves, fantasmes et utopies. Fille de la
fondre et de l'éclair, fée mystérieuse, ses manifestations
multiples séduisent etéblouissent. La lumière électrique
vainc la nuit. Elle donne à voir autrement, créant ainsi
un nouveau paysage visuel. « Magique » lui aussi, le téléphone
vainc la distance et le temps.
Il permet la présence de l'absent. Il autorise l'ubiquité.
Transportant au loin les paroles, il brise par le son des mots (le «
grain de la voix ») les distances. Telle est la représentation
allégorique qu'en donne, dans les dernières années
du dix-neuvième siècle le peintre Puvis de Chavanne .
Loin d'être en reste, la littérature s'empare également
du téléphone. Dès le début des années
1880, Villiers de l'isle Adam, Jules Verne, Albert Robida et bien d'autres
font du téléphone — alors qu'il n'est dans la réalité
que fort peu diffusé — un instrument essentiel et universel
de communication, anticipant ainsi sur ses usages futurs. Outil merveilleux,
son introduction dans l'espace privé — il est de fait le premier
instrument de communication à pénétrer un espace
jusqu'alors relativement clos — perturbe également et modifie
radicalement les modes de communication . Il est un des signes d'une modernité
naissante.
Suivre le fil du téléphone
non seulement dans l’œuvre mais également dans la correspondance,
c’est tirer le portrait d’un écrivain qui, loin d’être
seulement le peintre de la fin d’une époque peuplée
de ducs et de duchesses, est aussi le témoin attentif de l’avènement
du monde moderne. Mais c’est surtout une façon originale d’entrer
en contact ou de poursuivre la conversation avec un génie dont
la voix, toujours présente, n’en finit pas de nous toucher
et de nous parler.
Quand et comment naît l’intérêt
pour le progrès technique chez Proust ?
Inutile d’en chercher les prémices dans Les Plaisirs et les
Jours. Le jeune Marcel dédaigne les nouveautés mécaniques.
En août 1895, Proust va avec Reynaldo Hahn
à Dieppe chez Madeleine Lemaire. En septembre, après un
court passage à Paris, les deux amis se déplacent en Bretagne,
d’abord à Belle-Île-en-Mer, puis à Beg-Meil (Finistère)
où il commence la rédaction de Jean Santeuil. En 1896, il
passe quelques semaines au Mont Dore en Auvergne. En octobre de la même
année, il séjourne à Fontainebleau et écrit
le fameux passage du téléphonage.
Que fait Marcel Proust à Fontainebleau en octobre 1896 ? Il téléphone ! À qui ? À sa mère bien sûr ! La conversation terminée, il en tire un « petit récit » à peine romancé qu’il joint à une lettre à sa mère, « petit récit que je te demande de garder et en sachant où tu le gardes car il sera dans mon roman ». À la recherche du temps perdu ne commencera à paraître qu’une quinzaine d’années plus tard mais le jeune Proust ne doute pas que l’expérience téléphonique qu’il vient de vivre alimentera son œuvre future.
En 1896 le jeune Marcel Proust dédaigne
les nouveautés mécaniques. À preuve, cette lettre
de sa mère, datée du 21 octobre 1896, au lendemain
de leur premier « téléphonage » entre Paris
et Fontainebleau : « Que de pardons tu lui [au téléphone]
dois pour tes blasphèmes passés. Quels remords d’avoir
méprisé, dédaigné, éloigné un
tel bienfaiteur ! Entendre la voix du pauvre loup — le pauvre entendre
la mienne ! »
Bienfaisante et à la fois déchirante — car la distance
et l’absence de l’être aimé se font sentir de plus
belle.
Le « drame du téléphone
» est représenté dans l’Urtext (texte original
) de la Recherche du temps perdu, dans les pages de Jean Santeuil.
La scène clef se déroule durant le séjour de Jean
à la station balnéaire de Beg-Meil. L’origine autobiographique
de ce passage, rapporté dans la biographie de George Painter, serait
le séjour de Proust à Fontainebleau en compagnie de Lucien
Daudet, en octobre 1896. C’est par un jour de mauvais temps et de
fâcherie entre les amis qu’un Proust déjà malingre
cherche désespérément à avoir sa mère
au téléphone. Proust saisit d’emblée l’importance
de cet épisode et son intérêt romanesque. L’expérience
de la voix désincarnée qu’impose le medium téléphonique
offre au jeune écrivain un défi technique mais aussi des
opportunités offertes par son usage drôlement imparfait,
gouverné par le malentendu, les contretemps, les raccrochages.
Aux frontières de cet espace
médiatisé où l’étiquette n’a pas
encore pris ses repères, le mélodrame et le pathos sont
continuellement en proie au comique et côtoient la farce. Dans Jean
Santeuil, Proust met en scène tous les éléments de
base (interruptions, légers contretemps), mais le ton reste dominé
par le pathétique, par une note de désespoir tragique :
Alors il se représente sa mère sonnant
au téléphone, l’appelant, ne comprenant pas pourquoi
Jean ne lui répond pas […]. Mais commotionnant, clair, voici
le timbre qui sonne, résonne, semble courir ça et là.
Vite il met le tube à l’oreille. La voix forte et dure d’un
garçon : « Est-ce M. Santeuil ? » Sans doute on parle
pour sa mère, pendant qu’on lui fait prendre le cornet, qu’elle
se hâte toute troublée. Une autre voix forte et dure d’un
autre garçon. Puis tout d’un coup — c’est comme
si tout le monde s’étant allé de la chambre il tombait
dans les bras de sa mère — vient là tout contre lui,
si douce, si fragile, si délicate, si claire, si fondue —
un petit morceau de glace brisée — la voix de sa mère.
« C’est toi, mon chéri ? » C’est comme si
elle lui parlait pour la première fois, comme s’il la retrouvait
après la mort dans le paradis. Car pour la première fois,
il entend la voix de sa mère.
Proust étire l’incident pour en extraire
toute la moelle dramatique. La voix isolée dans l’espace-temps
téléphonique ne se résume pas à la transmission
de données ; elle établit une présence dialogique
qui confirme l’écouteur autant que l’écouté.
Comme la société dans laquelle il vit, l'œuvre de Marcel
Proust est un lieu de rencontre entre deux époques. S'y télescopent
tradition et modernité. Avec sa sensibilité d'écrivain,
il est le peintre et le témoin — même si telle n'est
point la fin de son travail d'écriture — du lent basculement
d'un monde. Au monde des salons, à l'histoire lente, quasiment
immobile, qui traverse sans ruptures brutales un dix-neuvième siècle
en apparence sans fin, se juxtapose une société nouvelle,
Or dans cet univers qui lentement sous les yeux de Proust se construit,
des technologies nouvelles font leur apparition. Certes, elles ne le pénètrent
pas encore massivement, mais par interstices s'y glissent et contribuent
à sa formation. Chez Proust, le téléphone en est
un exemple flagrant. A plusieurs reprises, Proust l'évoque dans
son œuvre et lui consacre des passages relativement longs, témoignant
de l'accueil qui lui est réservé et de l'imaginaire, de
la poésie qu'il véhicule.
Chez Proust, le téléphone prend une valeur toute particulière.
Non seulement Proust écrit des pages qui permettent — et mieux
(peut-être) que de froides séries statistiques et, en tous
cas, en indispensable complément — à l'historien de
saisir l'accueil que la société française «
fin de siècle » réserve à un instrument bouleversant
les modes traditionnels de communication et de relation, mais encore sa
sensibilité exacerbée donne au téléphone une
dimension que peu d'écrivains ou de poètes ont su communiquer.
sommaire
« Le premier amusement passé...
»
Dans « A l'ombre des jeunes filles en fleurs », Marcel Proust,
saisissant le bavardage d'Odette, de Madame Bontemps et de Madame Cottard,
réunit dans une même séquence téléphone
et lumière électrique dont il fait les indices de la modernité,
quand bien même cette modernité serait-elle objet d'une crainte
voilée et d'incertitude
«Alors le docteur ne raffole pas comme vous, des fleurs ? demandait
Madame Swann à Madame Cottard.
— Oh ! vous savez que mon mari est un sage ; il est modéré
en toutes choses. Si, pourtant, il a une passion ». L'œil brillant
de malveillance, de joie et de curiosité : « Laquelle, madame
? » demandait Madame Bon-temps.
Avec simplicité, Madame Cottard répondait : « La lecture.
— Oh ! c'est une passion de tout repos chez un mari ! s'écriait
Madame Bontemps en étouffant un rire satanique,
— Quand le docteur est dans un livre, vous savez !
— Eh bien, Madame, cela ne doit pas vous effrayer beaucoup... - Mais
si !... pour sa vue. Je vais aller le retrouver, Odette, et je reviendrai
au premier jour frapper à votre porte.
A propos de vue, vous a-t-on dit que l'hôtel particulier que vient
d'acheter Madame Verdurin sera éclairé à l'électricité
? Je ne le tiens pas de ma petite police particulière, mais d'une
autre source : c'est l'électricien lui-même, Mildé,
qui me l'a dît.
Vous voyez que je cite mes auteurs ! Jusqu'aux chambres qui auront leurs
lampes électriques avec un abat-jour qui tamisera la lumière.
C'est évidemment un luxe charmant.
D'ailleurs nos contemporaines veulent absolument du nouveau, n'en fût-il
plus au monde. Il y a la belle-sœur d'une de mes amies qui a le téléphone
posé chez elle ! Elle peut faire une commande à un fournisseur
sans sortir de son appartement !
J'avoue que j'ai platement intrigué pour avoir la permission de
venir un jour pour parler devant l'appareil. Cela me tente beaucoup, mais
plutôt chez une amie que chez moi. Il me semble que je n'aimerais
pas avoir le téléphone à domicile.
Le premier amusement passé, cela doit être un vrai casse-tête.
Allons, Odette je me sauve, ne retenez plus Madame Boniemps puisqu'elle
se charge de moi, il faut absolument que je m'arrache, vous me faites
faire du joli, je vais être rentrée après mon mari
! »
 |
Ici le téléphone est
à la fois le neuf, la nouveauté mais aussi amusement.
Son usage se caractérise par le futile, II n'est pas, somme
toute, essentiel et « le premier amusement passé...
» il devient un « vrai casse-tête ».
Or ces attitudes face au téléphone ne sont peut-être pas très éloignées de celles qu'avaient nos contemporains face au Minitel Combien de nos parents, amis ou voisins n'ont-ils pas, eux aussi, « platement intrigué » pour se servir de ce terminal que nous étions parmi les premiers à posséder et qui, lui aussi, pouvait permettre « de faire une commande à un fournisseur sans sortir de son appartement ». Si l'histoire de l'innovation s'est considérablement accélérée, l'histoire des attitudes face à l'innovation (l'histoire des sensibilités) épouse un rythme beaucoup plus lent. |
« Aussi désagréable que la vaccine.. »
Si pour Madame Cottard, le téléphone se présente comme un « casse-tête », c'est pour cela qu'elle le refuse. Il est un autre personnage — et un personnage central — de l'univers proustien qui, non seulement le refuse, mais le fuit. De Françoise, la servante fidèle, nous savons, qu'elle est d'origine rurale : « J'ai dit qu'elle était d'un petit pays qui était tout voisin de celui de ma mère, et pourtant différent par la nature du terrain, les cultures, le patois, par certaines particularités des habitants, surtout ».; « Sa présence dans notre maison, c'était l'air de la campagne et la vie sociale dans une ferme, il y a des décennies, transportés chez nous... ».
Or dans la littérature (et on retrouvera maintes fois ce thème dans le cinéma français des années 1920/1930), une des caractéristiques de la servante issue — comme elles l'étaient, dans la plupart des cas — de la campagne, est d'opposer un vif refus à des gestes techniques qui, jusqu'à leur arrivée à la ville, leur étaient inconnus. Françoise ne fait pas exception. A trois reprises, au moins, Proust y revient.
Dans « Sodome et Gomorrhe » le narrateur explique l'inhabituelle place du téléphone dans l'espace domestique par les réactions qu'il provoque chez Françoise . « D'ailleurs, autant peut-être qu'Albertine, toujours pas venue, sa présence en ce moment dans un « ailleurs » qu'elle avait évidemment trouvé plus agréable, et que je ne connaissais pas, me causait un sentiment douloureux qui, malgré ce que j'avais dit, il y avait à peine une heure, à Swann, sur mon incapacité d'être jaloux, aurait pu, si j'avais vu mon amie à des intervalles moins éloignés, se changer en un besoin anxieux de savoir où, avec qui, elle passait son temps.
Je n'osais pas envoyer chez Albertine, il était trop tard, mais dans l'espoir que, soupant peut-être avec des amis, dans un café, elle aurait l'idée de me téléphoner, je tournai le commutateur et, rétablissant la communication dans ma chambre je la coupai entre le bureau de poste et la loge du concierge à laquelle il était relié d'habitude à cette heure-là. Avoir un récepteur dans le petit couloir où donnait la chambre de Françoise eût été plus simple, moins dérangeant, mais inutile. Les progrès de la civilisation permettent à chacun de manifester des qualités insoupçonnées ou de nouveaux vices qui les rendent plus chers ou plus insupportables à leurs amis. C'est ainsi que la découverte d'Edison avait permis à Françoise d'acquérir un défaut de plus, qui était de se refuser, quelque utilité, quelque urgence qu'il y eût, à se servir du téléphone. Elle trouvait le moyen de s'enfuir quand on voulait le lui apprendre, comme d'autres au moment d'être vaccinés. Aussi le téléphone était-il placé dans ma chambre, et, pour qu'il ne gênât pas mes parents, sa sonnerie était remplacée par un simple bruit de tourniquet. De peur de ne pas l'entendre, je ne bougeais pas. Mon immobilité était telle que, pour la première fois depuis des mois, je remarquai le tic-tac de la pendule ».
Elle refuse de « l'apprendre » (le nouvel objet technique nécessite un apprentissage) mais sa crainte se fait curiosité quand il s'agit d'aller surprendre quelque conversation que le narrateur souhaiterait lui cacher. A l'oreille collée au trou de la serrure, se substitue, pour saisir les paroles du maître ou de la maîtresse de maison, l'irruption de la domestique, espérant dérober à leur secret deux ou trois paroles qui lui sont cachées, dans la pièce où l'on téléphone. « Maïs j'étais obligé d'interrompre un Instant et de faire des gestes menaçants, car si Françoise continuait — comme si c'eût été quelque chose d'aussi désagréable que la vaccine ou d'aussi périlleux que l'aéroplane — à ne pas vouloir apprendre à téléphoner, ce qui nous eût déchargés des communications qu'elle pouvait connaître sans inconvénient, en revanche elle entrait immédiatement chez moi dès que j'étais en train d'en faire d'assez secrètes pour que je tinsse particulièrement à les lui cacher. Quand elle fut enfin sortie de la chambre non sans s'être attardée à emporter divers objets qui y étaient depuis la veille et eussent pu y rester, sans gêner le moins du monde, une heure de plus, et pour remettre dans le feu une bûche rendue bien inutile par la chaleur brûlante que me donnaient la présence de l'intruse et la peur de rne voir « couper » par la demoiselle, « Pardonnez-moi, dis-je à Andrée, j'ai été dérangé. »
«... Quitte à visiter des contagieux »
Or, non seulement Françoise ne décroche pas le téléphone quand celui-ci sonne, mais encore ne téléphone pas elle même quand on le lui demande. Elle fait appel dans ce cas à un « employé du téléphone » :« J'étais prêt, Françoise n'avait pas encore téléphoné ; fallait-il partir sans attendre ? Mais qui sait si elle trouverait Albertine ? si celle-ci ne serait pas dans les coulisses ? si même, rencontrée par Françoise, elle se laisserait ramener ? Une demi-heure plus tard le tintement du téléphone retentit et dans mon coeur battaient tumultueusement l'espérance et la crainte.
C'étaient, sur l'ordre d'un employé de téléphone, un escadron volant de sons qui avec une vitesse instantanée m'apportaient les paroles du téléphoniste, non celles de Françoise qu'une timidité et une mélancolie ancestrales, appliquées à un objet inconnu de ses pères, empêchaient de s'approcher d'un récepteur, quitte à visiter des contagieux.
 |
Elle avait trouvé au promenoir
Albertine seule, qui, étant seulement allée prévenir
Andrée qu'elle ne restait pas, avait rejoint aussitôt
Françoise. « Elle n'était pas fâchée
? Ah ! pardon ! Demandez à cette dame si cette demoiselle
n'était pas fâchée ?... — Cette dame me
dit de vous dire que non, pas du tout, que c'était tout le
contraire ; en tous cas, si elle n'était pas contente, ça
ne se connaissait pas. Elles vont aller maintenant aux Trois-Quartiers
et seront rentrées à deux heures ».
Je compris que deux heures signifiait trois heures car il était plus de deux heures. Mais délai! chez Françoise un de ces défauts particuliers, permanents, inguérissables, que nous appelons maladies, de ne pouvoir jamais regarder ni dire l'heure exactement. Quand Françoise, ayant ainsi regardé sa montre, s'il était deux heures disait : il est une heure, ou il est trois heures, je n'ai jamais pu comprendre si le phénomène qui avait lieu alors avait pour siège la vue de Françoise, ou sa pensée, ou son langage ; ce qui est certain, c'est que ce phénomène avait toujours lieu. L'humanité est très vieille, l'hérédité, les croisements ont donné une force insurmontable à de mauvaises habitudes, à des réflexes vicieux. » Pour Françoise le téléphone est objet de frayeur et dans ces trois séquences qui mettent en scène la domestique et le téléphone, on remarque que Proust emprunte au vocabulaire médical : vaccinés, vaccine et contagieux. Dans les sociétés traditionnelles, les paysans cherchaient refuge hors du village quand ils entendaient les cloches de l'église sonner le tocsin annonçant l'épidémie. La sonnerie du téléphone, pour Françoise, joue un rôle semblable. Elle donne le signal de la fuite. Comme de la peste, il importe de s'en éloigner au plus vite. |
«... Approcher nos lèvres de la planchette
magique»
Dans le conte, la fée a pour attribut essentiel une baguette magique;
qui s'en empare, possède à son tour — à condition
de s'en servir comme il sied — des pouvoirs surnaturels.
Dans la « féerie téléphonique » telle
que Proust la décrit «nous n'avons qu'à approcher
nos lèvres de la planchette magique et à appeler... ».
Baguette ou planchette magiques permettent de convoquer celles qui vont
intercéder pour nous, rendre possible le miracle, la communication.
Le geste est simple, une parole, un simple mouvement des lèvres,
comme un baiser « Et nous sommes comme le personnage du conte à
qui une magicienne, sur le souhait qu'il en exprime, fait apparaître,
dans une clarté surnaturelle, sa grand-mère ou sa fiancée,
en train de feuilleter un livre, de verser des larmes, de cueillir des
fleurs, tout près du spectateur et pourtant très loin, à
l'endroit même où elle se trouve réellement. Nous
n'avons pour que ce miracle s'accomplisse, qu'à approcher nos lèvres
de la planchette magique et à appeler — quelquefois un peu
trop longtemps, je le veux bien — les Vierges Vigilantes dont nous
entendons chaque jour la voix sans jamais connaître le visage, et
qui sont nos Anges gardiens dans les ténèbres vertigineuses
dont elles surveillent jalousement les portes ; les Toutes-Puissantes
par qui les absents surgissent à notre côté, sans
qu'il soit permis de les apercevoir; les Danaïdes de l'invisible
qui sans cesse vident, remplissent, se transmettent les urnes des sons;
les ironiques Furies qui, au moment que nous murmurions une confidence
à une amie, avec l'espoir que personne ne nous entendait, nous
crient cruellement : J'écoute»; les servantes toujours
irritées du Mystère, les ombrageuses prêtresses de
l'Invisible, les Demoiselles du téléphone!»
Outre l'allusion aux microphones antiques (planchette de sapin sous laquelle
sont fixés crayons de charbon, puis granulés de coke, vibrant
au son de la voix), Proust fait ici des anonymes demoiselles du téléphone
des être surnaturels dont tout dépend. Sorcières,
leurs paroles sont incantation : « Je me décidai à
quitter la poste, à aller retrouver Robert à son restaurant
pour lui dire que, allant peut-être recevoir une dépêche
qui m'obligerait à revenir, je voudrais savoir à tout hasard
l'horaire des trains. Et pourtant, avant de prendre cette résolution,
j'aurais voulu une dernière fois invoquer les Filles de la Nuit,
les Messagères de la parole, les divinités sans visage;
mais les capricieuses Gardiennes n'avaient plus voulu m'ouvrir les Portes
merveilleuses, ou sans doute elles ne le purent pas; elles eurent beau
invoquer inlassablement, selon leur coutume, le vénérable
inventeur de l'imprimerie et le jeune prince amateur de peinture impressionniste
et chauffeur (lequel était neveu du capitaine de Borodino), Gutenberg
et Wagram laissèrent leurs supplications sans réponse et
je partis, sentant que l'Invisible sollicité resterait sourd. »
. Et, peut-être, est-ce pour cela qu'une demoiselle du téléphone
est toujours un grand poète :« Mais déjà une
des Divinités irascibles aux servantes vertigineusement agiles
s'irritait non plus que je parlasse, mais que je ne dise rien. «
Mais voyons, c'est libre ! Depuis le temps que vous êtes en communication,
je vais vous couper. » Mais elle n'en fit rien, et tout en suscitant
la présence d'Andrée, l'enveloppa, en grand poète
qu'est toujours une demoiselle du téléphone, de l'atmosphère
particulière à la demeure, au quartier, à la vie
même de l'amie d'Albertine, « ( C'est vous? » me dit
Andrée, dont la voix était projetée jusqu'à
moi avec une vitesse instantanée par la déesse qui a le
privilège de rendre les sons plus rapides que l'éclair.
« Ecoutez, répondis-je, allez où vous voudrez, n'importe
où, excepté chez Madame Verdurin. Il faut à tout
prix en éloigner demain Albertine. — C'est que justement elle
doit y aller demain. — Ah!».
Dans ces extraits qui reprennent en partie un article que Proust avait
consacré au téléphone dans le Figaro du 20
mars 1907 (Journées de lecture), le narrateur présente
les demoiselles du téléphone comme des personnages de légende,
hors du monde réel, mais aussi — invoquant le peintre à
venir — comme les représentantes, les médiatrices d'une
modernité en formation.
La femme au téléphone serait ainsi signe d'un monde moderne
: « Pendant qu'Albertîne allait ôter ses affaires, et
pour aviser au plus vite je me saisis du récepteur du téléphone,
j'invoquai les Divinités implacables, mais ne fis qu'exciter leur
fureur qui se traduisit par ces mots : «Pas libre, » Andrée
était en train, en effet, de causer avec quelqu'un. En attendant
qu'elle eût achevé sa communication, je me demandais comment,
puisque tant de peintres cherchent à renouveler les portraits féminins
du XVIIIe siècle où l'ingénieuse mise en scène
est un prétexte aux expressions de l'attente, de la bouderie, de
l'intérêt, de la rêverie, comment aucun de nos modernes
Boucher et de ceux que Saniette appelait des Watteau à vapeur,
ne peignit, au lieu de «La Lettre», du «Clavecin»
etc., cette scène qui pourrait s'appeler : «Devant le téléphone»,
et où naîtrait si spontanément sur les lèvres
de l'écouteuse un sourire d'autant plus vrai qu'il sait n'être
pas vu. »
Plus ou moins ridiculisés, les usages mondains
du téléphone se complètent par les « téléphonages
amoureux » — expression employée par Proust dans une
lettre à Antoine Bibesco — pratiqués par Saint-Loup
et surtout par le narrateur. Nouvelle pratique trompeuse et dangereuse
en ce qu’elle peut intensifier le « terrible besoin d’un
être » absent, le désir d’une impossible ubiquité
et d’un savoir total, inaccessible. Désir insensé,
mais qui est la définition même de l’amour nommé
jalousie chez Proust. Ce n’est donc pas un hasard si le narrateur
fait allusion au réseau international du téléphone
au moment même où il croit découvrir la nature «
gomorrhéenne » d’Albertine : « Albertine amie
de Mlle Vinteuil et de son amie, pratiquante professionnelle du saphisme,
c’était auprès de ce que j’avais imaginé
dans les plus grands doutes, ce qu’est au petit acoustique de l’Exposition
de 1889 dont on espérait à peine qu’il pourrait aller
au bout d’une maison à une autre, le téléphone
planant sur les rues, les villes, les champs, les mers, reliant les pays.
» Le développement du réseau planétaire suggère
l’imprévisibilité de l’avenir, accentuant aussi
la jalousie désespérée du héros, incapable
d’atteindre « tous les points de l’espace et du temps
que cet être [qu’il aime] a occupés et occupera »
Cette image technologique est d’abord associée à Swann
dans le Carnet 4, où elle renvoie plus clairement à l’angoissante
ubiquité de la femme aimée et soupçonnée de
trahison, Odette : « […] ce qu’il [Swann] admettait de
la culpabilité d’Odette était à la réalité
comme la possibilité de se parler un bout d’une chambre à
l’autre dans les premières expériences d’Edison
avec l’universel réseau téléphonique. Il n’y
avait probablement pas une ville, pas un quartier de Paris pas un jour
où elle ne se fût donnée (peut’être finir
par le téléphone) ». Malgré la note de régie
mise entre parenthèses (« peut être finir par le téléphone
»), ni Swann ni Odette ne parle jamais au téléphone
dans la Recherche. La chronologie veut que la métaphore du «
réseau universel téléphonique » soit liée
au « couple du 20e siècle »: le narrateur et Albertine
voyageant en automobile et se téléphonant dans Sodome et
Gomorrhe. Mais paradoxalement, le progrès technique de la communication
contribue à illustrer l’incommunicabilité irrémédiable
de l’amour.
Dans une de ses Chroniques au Figaro, Marcel Proust décrit sa fascination pour le travail des « Demoiselles du téléphone », ces « vierges vigilantes par qui les visages des absents surgissent près de nous », qu'il reprend presque littéralement dans Le côté de Guermantes p. 432 à propos de la conversation téléphonique du Narrateur et de sa grand-mère.
| Un matin, Saint-Loup m’avoua qu’il avait
écrit à ma grand’mère pour lui donner de
mes nouvelles et lui suggérer l’idée, puisqu’un
service téléphonique fonctionnait entre Doncières
et Paris, de causer avec moi. Bref, le même jour, elle devait
me faire appeler à l’appareil et il me conseilla d’être
vers quatre heures moins un quart à la poste. Le téléphone
n’était pas encore à cette époque d’un
usage aussi courant qu’aujourd’hui. Et pourtant l’habitude
met si peu de temps à dépouiller de leur mystère
les forces sacrées avec lesquelles nous sommes en contact que,
n’ayant pas eu ma communication immédiatement, la seule
pensée que j’eus, ce fut que c’était bien
long, bien incommode, et presque l’intention d’adresser
une plainte : comme nous tous maintenant, je ne trouvais pas assez
rapide à mon gré, dans ses brusques changements, l’admirable
féérie à laquelle quelques instants suffisent
pour qu’apparaisse près de nous, invisible mais présent,
l’être à qui nous voulions parler et qui, restant
à sa table, dans la ville qu’il habite (pour ma grand’mère
c’était Paris), sous un ciel différent du nôtre,
par un temps qui n’est pas forcément le même, au
milieu de circonstances et de préoccupations que nous ignorons
et que cet être va nous dire, se trouve tout à coup transporté
à ces centaines de lieues (lui et toute l’ambiance où
il reste plongé) près de notre oreille, au moment où
notre caprice l’a ordonné. Et nous sommes comme le personnage
du conte à qui une magicienne, sur le souhait qu’il en
exprime, fait apparaître dans une clarté surnaturelle
sa grand’mère ou sa fiancée en train de feuilleter
un livre, de verser des larmes, de cueillir des fleurs, tout près
du spectateur et pourtant très loin, à l’endroit
même où elle se trouve réellement. Nous n’avons,
pour que ce miracle s’accomplisse, qu’à approcher
nos lèvres de la planchette magique et à appeler - quelquefois
un peu trop longtemps, je le veux bien - les Vierges Vigilantes dont
nous entendons chaque jour la voix sans jamais connaître le
visage, et qui sont nos Anges gardiens dans les ténèbres
vertigineuses dont elles surveillent jalousement les portes ; les
Toutes-Puissantes par qui les absents surgissent à notre côté,
sans qu’il soit permis de les apercevoir ; les Danaïdes
de l’invisible qui sans cessent vident, remplissent, se transmettent
les urnes des sons ; les ironiques Furies qui, au moment que nous
murmurions une confidence à une amie, avec l’espoir que
personne ne nous entendait, nous crient cruellement : « J’écoute
» ; les servantes toujours irritées du Mystère,
les ombrageuses prêtresses de l’Invisible, les Demoiselles
du téléphone !
Et aussitôt que notre appel a retenti, dans la nuit pleine d’apparitions sur laquelle nos oreilles s’ouvrent seules, un bruit léger - un bruit abstrait - celui de la distance supprimée - et la voix de l’être cher s’adresse à nous. C’est lui, c’est sa voix qui nous parle, qui est là. Mais comme elle est loin ! Que de fois je n’ai pu l’écouter sans angoisse, comme si devant cette impossibilité de voir, avant de longues heures de voyage, celle dont la voix était si près de mon oreille, je sentais mieux ce qu’il y a de décevant dans l’apparence du rapprochement le plus doux, et à quelle distance nous pouvons être des personnes aimées au moment où il semble que nous n’aurions qu’à étendre la main pour les retenir. Présence réelle que cette voix si proche - dans la séparation effective ! Mais anticipation aussi d’une séparation éternelle ! Bien souvent, écoutant de la sorte, sans voir celle qui me parlait de si loin, il m’a semblé que cette voix clamait des profondeurs d’où l’on ne remonte pas, et j’ai connu l’anxiété qui allait m’étreindre un jour, quand une voix reviendrait ainsi (seule, et ne tenant plus à un corps que je ne devais jamais revoir) murmurer à mon oreille des paroles que j’aurais voulu embrasser au passage sur des lèvres à jamais en poussière. Extrait de Le côté de Guermantes (À la recherche du temps perdu de Marcel Proust) |
L'autre soir en te quittant, je suis resté quelques heures comme tu m'avais laissé, c'est-à-dire pas trop mal, mais vers le matin a commencé une crise vraiment terrible qui a duré plus de vingt-quatre heures et m'a laissé anéanti. Voici le brouillon qui me semble convenable. Si on te posait des colles et te demandait d'où vient l'expression "le triste avantage", rappelle-toi que c'est dans le sonnet d'Oronte du Misanthrope: "L'espoir, il est vrai, nous soulage, Et [nous] berce, un temps, notre ennui: Mais, Philis, le triste avantage, Lorsque rien ne marche après lui" ... J'avais mille choses à te dire mais suis encore brisé de ma crise. Bien tendrement à toi... Je n'ai pas osé mettre "l'article de mon ami Marcel Proust" mais cela aurait peut-être été le plus franc. En tout cas je crois que, comme cela, cela va bien. Tu feras d'ailleurs toutes les modifications que tu jugeras utiles. "Cher Monsieur [Gaston Calmette], vous avez
bien voulu insérer une première fois sous votre rubrique:
"Le scandale téléphonique", mes doléances
contre une administration qui en prend vraiment trop à son
aise avec les malheureux contribuables. Il ne s'agit pas cette fois
des demoiselles du téléphone, de celles que l'autre
jour, M. Marcel Proust appelait les "Déesses sans visage"
et les "Filles de la nuit" [allusion aux Furies, extraite
de l'article de Proust]. Son article a eu beaucoup de succès
ici, et on s'est arraché ce jour-là le Figaro plus
encore que de coutume. Nous ne disons plus "je vais vous téléphoner",
mais "je vais demander aux Vierges laborieuses [expression
peut-être empruntée à Jules Michelet dans L'Insecte]
de me donner votre numéro" et plus souvent hélas
les "Jalouses Furies" ne veulent rien savoir. |
 Article du Figaro du 20 mars 1907
Article du Figaro du 20 mars 1907
|
"Journées de lecture" de MARCEL PROUST. Extrait du journal Le Figaro du 20 mars 1907. Journées de lecture Vous avez sans doute, lu les Mémoires de
la comtesse de Boigne. Il y a « tant de malades », en
ce moment, que les livres trouvent des lecteurs même des lectrices.
Sans doute, quand on ne peut sortir et faire des visites, on aimerait,
mieux en recevoir que de lire. Mais, Il par ces temps d'épidémies
», même les visites que l'on reçoit ne sont pas
sans danger. C'est la dame qui de la porte où elle s'arrête
un moment rien qu'un moment et où elle encadre sa menace,
vous crie « Vous n'ayez pas peur des-oreillons et-de la scarlatine
? Je vous préviens que ma fllle et mes petits enfants les
ont. Puis-je entrer ? »; et entre sans attendre de réponse.
Marcel Proust |
«La voix pure comme un petit morceau de glace»
Proust accorde aux sens, au senti, une importance considérable
Tout son travail d'écrivain, pourrait-on dire, est là. Mille
notations, d'un petit pan de mur jaune à une petite phrase musicale,
d'un goût particulier à une odeur évocatrice, fourmillent
dans chaque page. « L'ouïe, ce sens délicieux, nous
apporte la compagnie de la rue, dont elle nous retrace toutes les lignes,
dessine toutes les formes qui y passent, nous en montrant la couleur.
» Le détail se fait essentiel (Dieu est dans le détail,
disait Flaubert !). La voix, son « grain » y joue un rôle
majeur. La voix révèle. Elle caractérise Charlus
ou Gisèle (sa « voix rogom-meuse»!). Or la voix au
téléphone prend une dimension nouvelle
Lointaine mais proche, connue mais redécouverte comme si, pour
la première fois, le narrateur l'entendait grâce à
l'écouteur — et c'est d'un contact physique qu'il s'agit —
collé à l'oreille. Dès Jean Santeuil que Proust écrit
vers 1896-1900 et qui ne sera publié que longtemps après
sa mort, la voix au téléphone est évoquée
dans un chapitre qui a pour titre «Jean à Begmeil, le téléphonage
à sa mère». « Maintenant il voulait télégraphier,
faire quelque chose qui le mette en communication immédiate avec
sa mère. « Mais monsieur, nous avons le téléphona
« On sonna On répond tout de suite. Il demande la communication
avec un tapissier qui habite dans sa maison. « Auriez-vous la bonté
de dire à Mme Santeuil de descendre au téléphone
parler à son fils ? — Oui. » Mais voilà déjà
bien un quart d'heure de cela, on ne sonne plus. Que se passe-t-il? «Monsieur,
dit le maître d'hôtel, c'est qu'il n'y a qu'un fil d'ici Paris.
Par mégarde on a accordé une autre communication. 11 peut
y en avoir pour longtemps. » Alors il se représenta sa mère
sonnant au téléphone, l'appelant, ne comprenant pas pourquoi
Jean ne lui répond pas (car elle à dû descendre tout
de suite, elle doit être déjà depuis déjà
quelque temps au téléphone). S'il pouvait lui expliquer,
lui dire : « Maman, prends patience. » Et quand la communication
lui sera rendue, sa mère partie, lasse d'attendre, fatiguée,
déçue surtout (elle avait dû courir si vite, si joyeuse,
au téléphone, c'aurait dû être presque le même
bonheur que si on lui avait dit : «Voici M. Jean revenu»,
sans qu'elle ait l'ennui qu'il ait quitté Begmeil). Il s'affole,
languit de son attente, aiguise cruellement sa déception, et savoure
l'amertume d'être retombé tout seul, sans elle; à
deux cents lieues d'elle quand ils auraient pu être là, l'un
à l'autre. D'autant plus que c'est fini, il ne pourra pas déranger
deux fois le tapissier.Mais commotionnant, clair, voici le timbre qui
sonne, semble courir ça et là. Vite, il met le tube à
l'oreille. La voix forte et dure d'un garçon : «Est-ce M.
Santeuil?» Sans doute on parle pour sa mère, pendant qu'on
lui fait prendre le cornet, qu'elle se hâte toute troublée.
Une autre voix forte et dure d'un autre garçon. Puis tout d'un
coup — c'est comme si tout le monde s'étant allé de
la chambre il tombait dans les bras de sa mère — vient là
tout contre lui, si douce, si fragile, si délicate, si claire,
si fondue, un petit morceau de glace brisé, la voix de sa mère«
C'est toi, mon chéri ? »
 |
C'est comme si elle lui parlait pour
la première fois, comme s'il la retrouvait après la
mort dans le paradis. Car pour la première fois, il entend
la voix de sa mère.
Toujours il écoute ce qu'elle lui dit, mais sa voix il ne l'avait jamais remarquée, pas plus que sa voix à lui par exemple. Alors, la recevant ainsi tout d'un coup, au moment où il la désire le plus et s'y attend le moins, où il est prêt à entendre encore la voix d'un garçon, il est stupéfait de l'abîme qu'il y a entre ces dures voix et ce tout petit morceau la de glace brisée où semblent couler par en dessous des pleurs, tous les chagrins soufferts depuis quelques années qui ne cessent de circuler dans cette voix, sanglots ou gémissements qu'elle n'a jamais laissé éclater pour ne pas faire de peine aux siens et qui sont cachés là tout près, comme les souvenirs des morts dans l'aspect coutumier de sa chambre, à un doigt d'elle, dans les tiroirs. |
Mais surtout ce qui le frappe et le stupéfie
après ces voix d'hommes, c'est de trouver, dans cette voix qui
semble à cent lieues d'eux, d'y trouver cette chose qu'il lui
semble n'avoir jamais vue au monde et trouver là pour la première
fois : la douceur — la douceur, la petite essence divine dont il
a souvent rêvé, en l'imaginant pas du tout comme elle était,
suave, magnifique, et qu'il a là dans son oreille, tout près,
comme les petits morceaux offerts d'un coeur brisé. Alors, comme
on sent tout ce que Jean est pour sa mère. Depuis qu'il est grand,
qu'il est presque quelqu'un comme son père, qu'il fait des études
auxquelles elle ne participe pas, Mme Santeuil s'humilie presque devant
son fils. Elle ne se compte pour rien près de lui. Dans ce petit
morceau de voix brisée on sent toute sa vie pour lui donnée
à ce moment comme à tous, la seule tendresse qui soit
toute à lui, sans une parcelle retenue pour soi, la voix pure
comme un petit morceau de glace où il n'y a pas de voix, pas
de force, la voix et la force de l'orgueil, de l'égoïsme,
des désirs, de l'intérêt, non rien que de la douceur,
de la douceur surnaturelle qui était près de lui
sans qu'il le sût, qui n'avait pas l'air extraordinaire,
et qui ainsi surprise tout d'un coup entre ces autres voix s'entend
comme à cent lieues d'elles, de la douceur qui se brise et fond
si doucement à l'oreille, au cœur. Mais il est vite repris
par la vie; que faut-il lui dire? Ils se parlent et il n'entend plus
sa voix, comme en vivant avec elle il ne connaît pas sa personne.
Elle est là. Tout en lui parlant des choses utiles, il se dit
: « Maman, maman, tu es là, approche-toi, je veux t'embrasser,
oh! Je ne t'embrasserai pas d'ici longtemps, maman, ma petite maman,
maman ! » voit que sa mère se fatigue et ne comprend plus
distinctement ce qu'elle lui dit... Il sonne. C'est fini. »
sommaire
Invisible mais présent
La voix de la mère, toujours écoutée, enfin entendue,
apparaît ici — accentuée par l'artifice téléphonique
— voix de l'au-delà, douce, tendra
C'est en des termes relativement semblables que le narrateur de la Recherche
évoque la voix de sa grand-mère.
Extrait
de La recherche du temps perdu
Un matin, Saint-Loup m'avoua qu'il avait écrit à ma grand-mère
pour lui donner de mes nouvelles et lui suggérer l'idée,
puisqu'un service téléphonique fonctionnait entre Doncières
et Paris, de causer avec moi. Bref, le même jour, elle devait
me faire appeler à l'appareil et il me conseilla d'être
vers quatre heures moins un quart à la poste. Le téléphone
n'était pas encore à cette époque d'un usage aussi
courant qu'aujourd'hui. Et pourtant l'habitude met si peu de temps à
dépouiller de leur mystère les forces sacrées avec
lesquelles nous sommes en contact que, n'ayant pas eu ma communication
immédiatement, la seule pensée que j'eus, ce fut que c'était
bien long, bien incommode, et presque l'intention d'adresser une plainte
: comme nous tous maintenant, je ne trouvais pas assez rapide à
mon gré, dans ses brusques changements, l'admirable féerie
à laquelle quelques instants suffisent pour qu'apparaisse près
de nous, invisible mais présent, l'être à qui nous
voulions parler et qui, restant à sa table, dans la ville qu'il
habite (pour ma grand-mère c'était Paris), sous un ciel
différent du nôtre, par un temps qui n'est pas forcément
le même, au milieu de circonstances et de préoccupations
que nous ignorons et que cet être va nous dire, se trouve tout
à coup transporté à des centaines de lieues (lui
et toute l'ambiance où il reste plongé) près de
notre oreille, au moment où notre caprice l'a ordonné.
Et nous sommes comme le personnage du conte à qui une magicienne
sur le souhait qu'il en exprime, fait apparaître, dans une clarté,
surnaturelle, sa grand-mère ou sa fiancée en train de
feuilleter un livre, de verser des larmes, de cueillir des fleurs, tout
près du spectateur et pourtant très loin, à l'endroit
même où elle se trouve réellement. Nous n'avons,
pour que ce miracle s'accomplisse, qu'à approcher nos lèvres
de la planchette magique et à appeler – quelquefois un peu
trop longtemps, je le veux bien – les Vierges Vigilantes dont nous
entendons chaque jour la voix sans jamais connaître le visage,
et qui sont nos Anges gardiens dans les ténèbres vertigineuses
dont elles surveillent jalousement les portes ; les Toutes-Puissantes
par qui les absents surgissent à notre côté, sans
qu'il soit permis de les apercevoir ; les Danaïdes de l'invisible
qui sans cesse vident, remplissent, se transmettent les urnes des sons
; les ironiques Furies qui, au moment que nous murmurions une confidence
à une amie, avec l'espoir que personne ne nous entendait, nous
crient cruellement : « J'écoute » ; les servantes
toujours irritées du Mystère, les ombrageuses prêtresses
de l'Invisible, les Demoiselles du téléphone !
Et aussitôt que notre appel a retenti, dans la nuit pleine d'apparitions
sur laquelle nos oreilles s'ouvrent seules, un bruit léger –
un bruit abstrait – celui de la distance supprimée –
et la voix de l'être cher s'adresse à nous.
C'est lui, c'est sa voix qui nous parle, qui est là. Mais comme
elle est loin ! Que de fois je n'ai pu l'écouter sans angoisse,
comme si devant cette impossibilité de voir, avant de longues
heures de voyage, celle dont la voix était si près de
mon oreille, je sentais mieux ce qu'il y a de décevant dans l'apparence
du rapprochement le plus doux, et à quelle distance nous pouvons
être des personnes aimées au moment où il semble
que nous n'aurions qu'à étendre la main pour les retenir.
Présence réelle que cette voix si proche – dans la
séparation effective ! Mais anticipation aussi d'une séparation
éternelle ! Bien souvent, écoutant de la sorte, sans voir
celle qui me parlait de si loin, il m'a semblé que cette voix
clamait des profondeurs d'où l'on ne remonte pas, et j'ai connu
l'anxiété qui allait m'étreindre un jour, quand
une voix reviendrait ainsi (seule, et ne tenant plus à un corps
que je ne devais jamais revoir) murmurer à mon oreille des paroles
que j'aurais voulu embrasser au passage sur des lèvres à
jamais en poussière.
Ce jour-là, hélas, à Doncières, le miracle
n'eut pas lieu. Quand j'arrivai au bureau de porte, ma grand-mère
m'avait déjà demandé ; j'entrai dans la cabine,
la ligne était prise, quelqu'un causait qui ne savait pas sans
doute qu'il n'y avait personne pour lui répondre car, quand j'amenai
à moi le récepteur, ce morceau de bois se mit à
parler comme Polichinelle ; je le fis taire, ainsi qu'au guignol, en
le remettant à sa place, mais, comme Polichinelle, dès
que je le ramenais près de moi, il recommençait son bavardage.
Je finis en désespoir de cause, en raccrochant définitivement
le récepteur, par étouffer les convulsions de ce tronçon
sonore qui jacassa jusqu'à la dernière seconde et j'allai
chercher l'employé qui me dit d'attendre un instant ; puis je
parlai et après quelques instants de silence, tout d'un coup
j'entendis cette voix que je croyais à tort connaître si
bien, car jusque-là, chaque fois que ma grand-mère avait
causé avec moi, ce qu'elle me disait, je l'avais toujours suivi
sur la partition ouverte de son visage où les yeux tenaient beaucoup
de place, mais sa voix elle-même, je l'écoutais aujourd'hui
pour la première fois. Et parce que cette voix m'apparaissait
changée dans ses proportions dès l'instant qu'elle était
un tout, et m'arrivait ainsi seule et sans l'accompagnement des traits
de la figure, je découvris combien cette voix était douce
; peut-être d'ailleurs ne l'avait-elle jamais été
à ce point, car ma grand-mère, me sentant loin et malheureux,
croyait pouvoir s'abandonner à l'effusion d'une tendresse que,
par « principes » d'éducatrice, elle contenait et
cachait d'habitude. Elle était douce, mais aussi comme elle était
triste, d'abord à cause de sa douceur même, presque décantée,
plus que peu de voix humaines ont jamais dû l'être, de toute
dureté, de tout élément de résistance aux
autres, de tout égoïsme ; fragile à force de délicatesse,
elle semblait à tout moment prête à se briser, à
expirer en un pur flot de larmes, puis l'ayant seule près de
moi, vue sans le masque du visage, j'y remarquais, pour la première
fois, les chagrins qui l'avaient fêlée au cours de la vie.
Était-ce d'ailleurs uniquement la voix qui, parce qu'elle était
seule, me donnait cette impression nouvelle qui me déchirait
? Non pas ; mais plutôt que cet isolement de la voix était
comme un symbole, une évocation, un effet direct d'un autre isolement,
celui de ma grand-mère, pour la première fois séparée
de moi. Les commandements ou défenses qu'elle m'adressait à
tout moment dans l'ordinaire de la vie, l'ennui de l'obéissance
ou la fièvre de la rébellion qui neutralisaient la tendresse
que j'avais pour elle, étaient supprimés en ce moment
et même pouvaient l'être pour l'avenir (puisque ma grand-mère
n'exigeait plus de m'avoir près d'elle sous sa loi, était
en train de me dire son espoir que je resterais tout à fait à
Doncières, ou en tout cas que j'y prolongerais mon séjour
le plus longtemps possible, ma santé et mon travail pouvant s'en
bien trouver) ; aussi, ce que j'avais sous cette petite cloche approchée
de mon oreille, c'était, débarrassée des pressions
opposées qui chaque jour lui avaient fait contrepoids, et dès
lors irrésistible, me soulevant tout entier, notre mutuelle tendresse.
Ma grand-mère, en me disant de rester, me donna un besoin anxieux
et fou de revenir. Cette liberté qu'elle me laissait désormais,
et à laquelle je n'avais jamais entrevu qu'elle pût consentir,
me parut tout d'un coup aussi triste que pourrait être ma liberté
après sa mort (quand je l'aimerais encore et qu'elle aurait à
jamais renoncé à moi). Je criais : « Grand-mère,
grand-mère », et j'aurais voulu l'embrasser ; mais je n'avais
près de moi que cette voix, fantôme aussi impalpable que
celui qui reviendrait peut-être me visiter quand ma grand-mère
serait morte. « Parle-moi » ; mais alors il arriva que,
me laissant plus seul encore, je cessai tout d'un coup de percevoir
cette voix. Ma grand-mère ne m'entendait plus, elle n'était
plus en communication avec moi, nous avions cessé d'être
en face l'un de l'autre, d'être l'un pour l'autre audibles, je
continuais à l'interpeller en tâtonnant dans la nuit, sentant
que des appels d'elle aussi devaient s'égarer. Je palpitais de
la même angoisse que, bien loin dans le passé, j'avais
éprouvée autrefois, un jour que petit enfant, dans une
foule, je l'avais perdue, angoisse moins de ne pas la retrouver que
de sentir qu'elle me cherchait, de sentir qu'elle se disait que je la
cherchais ; angoisse assez semblable à celle que j'éprouverais
le jour où on parle à ceux qui ne peuvent plus répondre
et de qui on voudrait au moins tant faire entendre tout ce qu'on ne
leur a pas dit, et l'assurance qu'on ne souffre pas. Il me semblait
que c'était déjà une ombre chérie que je
venais de laisser se perdre parmi les ombres, et seul devant l'appareil,
je continuais à répéter en vain : « Grand-mère,
grand-mère », comme Orphée, resté seul, répète
le nom de la morte. Je me décidai à quitter la porte,
à aller retrouver Robert à son restaurant pour lui dire
que, allant peut-être recevoir une dépêche qui m'obligerait
à revenir, je voudrais savoir à tout hasard l'horaire
des trains. Et pourtant, avant de prendre cette résolution, j'aurais
voulu une dernière fois invoquer les Filles de la Nuit, les Messagères
de la parole, les divinités sans visage ; mais les capricieuses
Gardiennes n'avaient plus voulu ouvrir les Portes merveilleuses, ou
sans doute elles ne le purent pas ; elles eurent beau invoquer inlassablement,
selon leur coutume, le vénérable inventeur de l'imprimerie
et le jeune prince amateur de peinture impressionniste et chauffeur
(lequel était neveu du capitaine de Borodino), Gutenberg et Wagram
laissèrent leurs supplications sans réponse et je partis,
sentant que l'Invisible sollicité resterait sourd.
En arrivant auprès de Robert et de ses amis, je ne leur avouai
pas que mon coeur n'était plus avec eux, que mon départ
était déjà irrévocablement décidé.
Saint-Loup parut me croire, mais j'ai su depuis qu'il avait, dès
la première minute, compris que mon incertitude était
simulée, et que le lendemain il ne me retrouverait pas. Tandis
que, laissant les plats refroidir auprès d'eux, ses amis cherchaient
avec lui dans l'indicateur le train que je pourrais prendre pour rentrer
à Paris, et qu'on entendait dans la nuit étoilée
et froide les sifflements des locomotives, je n'éprouvais certes
plus la même paix que m'avaient donnée ici tant de soirs
l'amitié des uns, le passage lointain des autres. Ils ne manquaient
pas pourtant, ce soir, sous une autre forme à ce même office.
Mon départ m'accabla moins quand je ne fus plus obligé
d'y penser seul, quand je sentis employer à ce qui s'effectuait
l'activité plus normale et plus saine de mes énergiques
amis, les camarades de Robert, et de ces autres êtres forts, les
trains, dont l'allée et venue, matin et soir, de Doncières
à Paris, émiettait rétrospectivement ce qu'avait
de trop compact et insoutenable mon long isolement d'avec ma grand-mère,
en des possibilités quotidiennes de retour.
« Je ne doute pas de la vérité de tes paroles et
que tu ne comptes pas partir encore, me dit en riant Saint-Loup, mais
fais comme si tu partais et viens me dire adieu demain matin de bonne
heure, sans cela je cours le risque de ne pas te revoir ; je déjeune
justement en ville, le capitaine m'a donné l'autorisation ; il
faut que je sois rentré à deux heures au quartier car
on va en marche toute la journée. Sans doute, le seigneur chez
qui je déjeune à trois kilomètres d'ici me ramènera
à temps pour être au quartier à deux heures. »
À peine disait-il ces mots qu'on vint me chercher de mon hôtel,
on m'avait demandé de la poste au téléphone. J'y
courus car elle allait fermer. Le mot « interurbain » revenait
sans cesse dans les réponses que me donnaient les employés.
J'étais au comble de l'anxiété, car c'était
ma grand-mère qui me demandait. Le bureau allait fermer. Enfin
j'eus la communication. « C'est toi, grand-mère ? »
Une voix de femme avec un fort accent anglais me répondit : «
Oui, mais je ne reconnais pas votre voix. » Je ne reconnaissais
pas davantage la voix qui me parlait, puis ma grand-mère ne me
disait pas « vous ». Enfin, tout s'expliqua. Le jeune homme
que sa grand-mère avait fait demander au téléphone
portait un nom presque identique au mien et habitait une annexe de l'hôtel.
M'interpellant le jour même où j'avais voulu téléphoner
à ma grand-mère, je n'avais pas douté un seul instant
que ce fût elle qui me demandât. Or c'était par une
simple coïncidence que la poste et l'hôtel venaient de faire
une double erreur.
...
Au téléphone la grand-mère est une voix. La voix
vraie (la grand-mère vraie), sa musique est lue sans partition,
sans le masque du visage nous dit Proust. Or cette voix présente
est la voix de l'absente. Ici l'éphémère communication
téléphonique est preuve et épreuve de la séparation.
sommaire
« Cent fois plus rapide que le tonnerre »
Et la voix d'Andrée entendue au cours d'une banale conversation
téléphonique un sourire d'autant plus vrai qu'il sait
n'être pas vu... » (dont Proust en quelques mots évoque
les rites naissants) suscite chez l'auteur l'image d'une polyphonie
téléphonique : « ... Pardonnez-moi, dis-je à
Andrée, j'ai été dérangé. C'est absolument
sûr qu'elle doit aller demain chez les Verdurin ?
— Absolument, mais je peux lui dire que cela vous ennuie.
— Non, au contraire ; ce qui est possible, c'est que je vienne
avec vous.
— Ah !» fit Andrée d'une voix ennuyée et comme
effrayée de mon audace, qui ne fit du reste que s'en affermir.
« Alors, je vous quitte et pardon de vous avoir dérangée
pour rien.
— Mais non », dit Andrée et (comme maintenant l'usage
du téléphone était devenu courant, autour de lui
s'était développé l'enjolivement de phrases spéciales,
comme jadis autour des « thés ») elle ajouta : «
Cela m'a fait grand plaisir d'entendre votre voix ».
J'aurais pu en dire autant, et plus véridiquement qu'Andrée,
car je venais d'être infiniment sensible à sa voix, n'ayant
jamais remarqué jusque-là qu'elle était si différente
des autres.
Alors, je me rappelai d'autres voix encore, des voix de femmes surtout,
les unes ralenties par la précision d'une question et l'attention
de l'esprit, d'autres essoufflées, même interrompues, par
le flot lyrique de ce qu'elles racontent ; je me rappelai une à
une la voix de chacune des jeunes filles que j'avais connues à
Balbec, puis de Gilberte, puis de ma grand-mère, puis de Mme
de Guermantes ; je les trouvai toutes dissemblables, moulées
sur un langage particulier à chacune, jouant toutes sur un instrument
différent, et je me dis quel maigre concert doivent donner au
Paradis les trois ou quatre anges musiciens des vieux peintres, quand
je voyais s'élever vers Dieu, par dizaines, par centaines, par
milliers, l'harmonieuse et multisonore salutation de toutes les Voix.
Je ne quittai pas le téléphone sans remercier en quelques
mots propitiatoires Celle qui règne sur la vitesse des sons,
d'avoir bien voulu user en faveur de mes humbles paroles d'un pouvoir
qui les rendait cent fois plus rapides que le tonnerre. Mais mes actions
de grâce restèrent sans autre réponse que d'être
coupées. » Mais le téléphone est aussi attente,
attente de la communication bien sûr mais attente surtout de l'appel.
La délivrance tient ici à un simple signal, le bruit de
la sonnerie : « Enfin Françoise alla se coucher ; je la
renvoyai avec une rude douceur, pour que le bruit qu'elle ferait en
s'en allant ne couvrît pas celui du téléphone. Et
je recommençai à écouter, à souffrir ; quand
nous attendons, de l'oreille qui recueille les bruits à l'esprit
qui les dépouille et les analyse, et de l'esprit au cœur
à qui il transmet ses résultats, le double trajet est
si rapide que nous ne pouvons même pas percevoir sa durée,
et qu'il semble que nous écoutions directement avec notre coeur.
J'étais torturé par l'incessante reprise du désir
toujours plus anxieux, et jamais accompli, d'un bruit d'appel; arrivé
au point culminant d'une ascension tourmentée dans les spirales
de mon angoisse solitaire, du fond du Paris populeux et nocturne approché
soudain de moi, à côté de ma bibliothèque,
j'entendis tout à coup, mécanique et sublime, comme dans
Tristan l'écharpe agitée ou le chalumeau du pâtre,
le bruit de toupie du téléphone.Je m'élançai,
c'était Albertine. Je ne vous dérange pas en vous téléphonant
à une pareille heure!
— Mais non... , dis-je en comprimant ma joie, car ce qu'elle disait
de l'heure indue était sans doute pour s'excuser de venir dans
un moment si tard, non parce qu'elle n'allait pas venir.
«Est-ce que vous venez ? demandai-je d'un ton différent.
— Mais... non, si vous n'avez pas absolument besoin de moi.
Une partie de moi à laquelle l'autre voulait se rejoindre était
en Albertine. Il fallait qu'elle vînt, mais je ne le lui dis pas
d'abord ; comme nous étions en communication, je me dis que je
pourrais toujours l'obliger, à la dernière seconde, soit
à venir chez moi, soit à me laisser courir chez elle.
« Oui, je suis près de chez moi, dit-elle, et infiniment
loin de chez vous ; je n'avais pas bien lu votre mot. Je viens de le
retrouver et j'ai eu très peur que vous ne m'attendiez. »
Je sentais qu'elle mentait, et c'était maintenant, dans ma fureur,
plus encore par besoin de la déranger que de la voir que je voulais
l'obliger à venir. Mais je tenais d'abord à refuser ce
que je tâcherais d'obtenir dans quelques instants. Mais où
était elle? A ses paroles se mêlaient d'autres sons : la
trompe d'un cycliste, la voix d'une femme qui chantait, une fanfare
lointaine retentissaient aussi distinctement que la voix chère,
comme pour me montrer que c'était bien Albertine dans son milieu
actuel qui était près de moi en ce moment, comme une motte
de terre avec laquelle on a emporté toutes les graminées
qui l'entourent. Les mêmes bruits que j'entendais frappaient aussi
son oreille et mettaient une entrave à son attention : détails
de vérité, étrangers au sujet, inutiles en eux-mêmes,
d'autant plus nécessaires à nous révéler
l'évidence du miracle ; traits sobres et charmants, descriptifs
de quelque rue parisienne, traits perçants aussi et cruels d'une
soirée inconnue qui, au sortir de Phèdre, avaient empêché
Albertine de venir chez moi, » Si l'appel, sa sonnerie retentit
comme dans un opéra, est sauveur, la conversation -Albertine
appelle d'un lieu inconnu que seuls quelques bruits laissent deviner
-aiguise la curiosité, la jalousie. Ici, aussi, la présence
de la voix ne peut vaincre la distance, elle l'amplifie et la rend plus
douloureuse mais révèle » l'évidence du miracle
».
Le monde de Proust est, pour reprendre l'expression de Gilles Deleuse
, un monde de signes, signes à déchiffrer. Les conversations
téléphoniques, les voix, le bruit de la sonnerie ou l'attitude
de Françoise sont de ces signes qui disent le vacillement d'un
monde.
Non seulement le téléphone est porteur et transmetteur
de signes (signes du temps, de son passage : sons immédiats,
fragiles, paroles aussitôt dites, évaporées...)
mais il est en lui même un signe. Signe de distinction sociale
chez Mad? mr Verdurin chez qui pendant la guerre on vient téléphoner
:
«Après le dîner on montait dans les salons de la
Patronne, puis les téléphonages commençaient.
Mais beaucoup de grands hôtels étaient à cette époque
peuplés d'espions qui notaient les nouvelles téléphonées
par Bontemps avec une indiscrétion que corrigeait seulement,
par bonheur, le manque de sûreté de ses informations, toujours
démenties par l'événement. » .
Signe de la ville « effrayante » également chez Françoise,
signe de la nouveauté chez Madame Cottard...
Or le téléphone, comme l'apparition de l'éclairage
électrique, comme l'aéroplane ou l'automobile que Proust
à plusieurs reprises évoqué, est le signe de la
modernité, Il fait partie de ces innovations technologiques qui
marquent la naissance du vingtième siècle, créatrices
d'un monde nouveau partant, de fictions nouvelles...
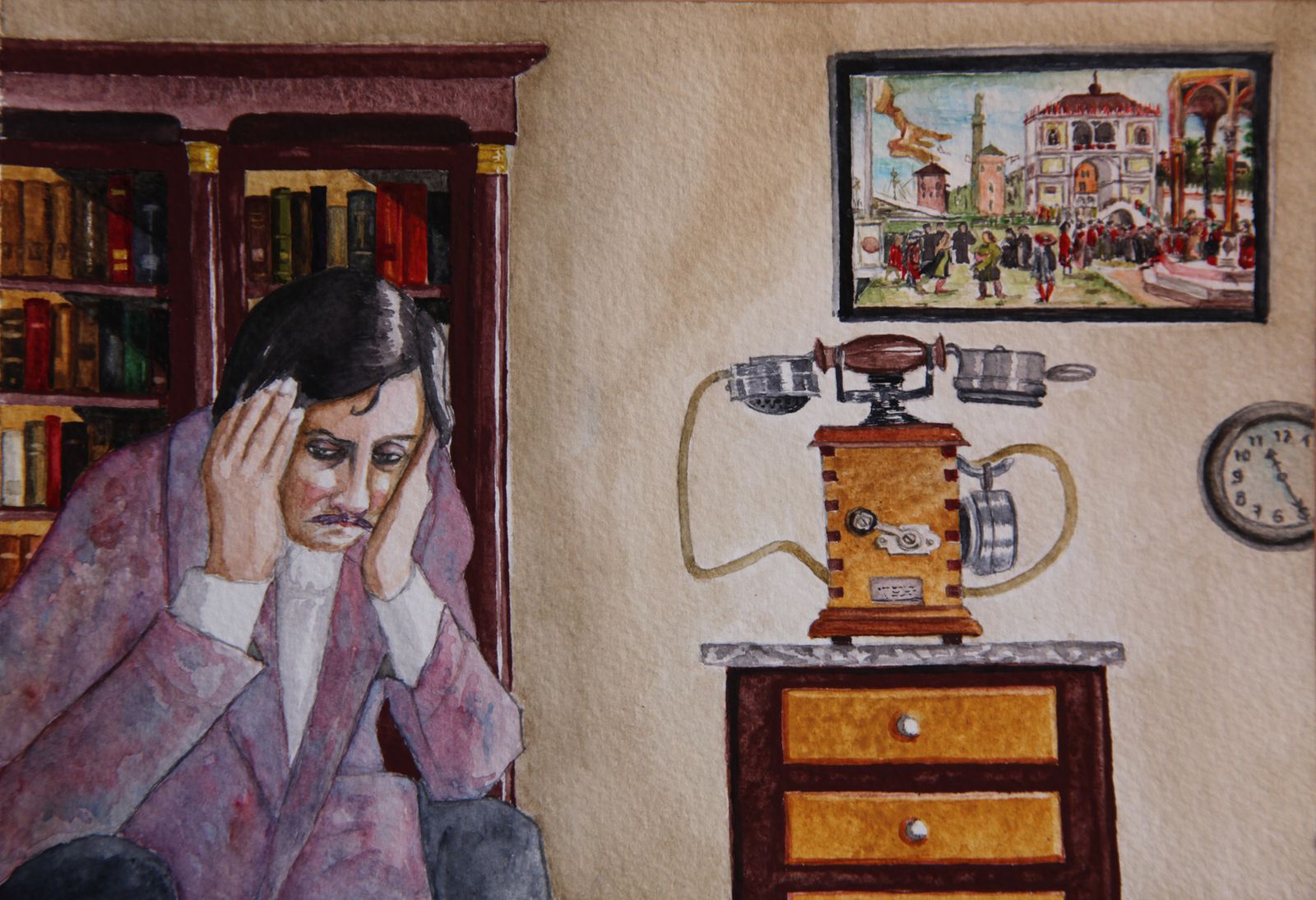
L'attente... du téléphonage d'Albertine.
sommaire
|
L’influence du séjour de Marcel Proust à Fontainebleau sur son œuvre de Frédéric Viey Le Musée de la Diaspora à
Tel-Aviv considère Marcel Proust comme étant un
des personnages juifs les plus éminents. Marcel Proust
milita dans les rangs des Dreyfusards même s’il ne
ressentait aucun sentiment juif. Tout comme pour ses ancêtres
Weil,l’assimilation fit un travail
redoutable. Marcel Proust et Fontainebleau : Le séjour de Marcel Proust à Fontainebleau
fut complètement gâché par un déluge
de pluie et des crises d’asthme. Marcel Proust inséra
dans ses romans malgré tout quelques souvenirs vécus
à Fontainebleau : Aurait-il pu prolonger sa vie dans le rôle de Swann ? |
|
Dans son ouvrage De la Démocratie en Amérique, Tocqueville écrit « [qu’il] n’y a qu’un journal qui puisse venir déposer au même moment dans mille esprits la même pensée (1) ». La presse écrite est certes un instrument de communication efficace, voire une arme littéraire performante, qui a gagné en popularité et en puissance grâce au développement des technologies de l’imprimerie et du transport ferroviaire ; que l’information soit diffusée plus largement et plus rapidement depuis l’avènement de la feuille de chou, il faut donc bien le reconnaître. Mais cette forme de démocratisation des idées n’est pas garante d’une meilleure compréhension de ces idées. C’est le terme « même », dans l’énoncé de Tocqueville, qui choque la phénoménologue en moi… et en Marcel Proust. Ce dernier raconte, dans son roman À la recherche du temps perdu (2), un épisode où le héros-narrateur prend conscience que l’article qu’il avait soumis au journal Le Figaro a enfin été publié (3). Cet événement, également narré dans Contre Sainte-Beuve4, est l’occasion d’un certain nombre de réflexions sur la réception d’un texte. Prenons ce dernier texte et proustifions. D’abord, Contre Sainte-Beuve n’existe pas. En 1908, Proust fait part de ses intentions d’écrire un article contre la méthode de Charles-Augustin Sainte-Beuve, critique littéraire du xixe siècle réputé pour la justesse de ses jugements et le caractère innovateur de son approche critique. Or, Proust n’est pas d’accord avec le positivisme beuvien ; il est impossible, selon lui, de comprendre la genèse et la nature d’une œuvre d’art par le seul biais de la biographie de son auteur. C’est à l’été 1909 qu’il écrit la majorité de ce texte qui prendra d’abord la forme d’un essai, puis celle d’une conversation fictive avec sa mère. Il abandonne finalement le projet pour se consacrer entièrement à sa vocation de romancier. En 1954, Bernard de Fallois récupère les manuscrits qui témoignent du projet d’article de Proust. Il les transcrit, les met en ordre et les publie sous le titre de Contre Sainte-Beuve. Cette publication peut d’ailleurs être considérée comme la seconde rentrée littéraire de Proust, tant les réactions qu’elle produisit furent importantes dans le milieu proustien, voire dans le milieu littéraire en général. Le portrait que Proust brosse du (pauvre, pauvre !) Sainte-Beuve peut paraître simpliste. C’est que Proust ne passe que très peu de temps à l’élaborer ; « [la] méthode de Sainte-Beuve n’est peut-être pas au premier abord un objet si important (5) », explique-t-il dans sa préface. Cette dernière n’est en fait qu’un prétexte à l’élaboration des thèses esthétiques que Proust souhaite mettre de l’avant. Malheureusement, la postérité ne retient du célèbre critique que cette image quelque peu caricaturale et fort sévère. Il faut cependant noter qu’ici tourne déjà le manège proustien, à savoir que Proust admet d’entrée de jeu – du moins, on le comprend implicitement – que le Sainte-Beuve qu’il présente n’est pas la personne réelle, telle qu’elle a véritablement existé par et pour elle-même, mais plutôt l’impression qu’il a gardée de cet être en tant que phénomène perçu via différentes sources6. Il y a un Sainte-Beuve de Proust comme il y a un Nerval, un Baudelaire ou encore un Balzac de Sainte-Beuve. Et le Sainte-Beuve que le lecteur aborde, dès les premières pages de l’essai, n’appartient pas plus à la première figure, celle qui s’ancre absolument dans la réalité, qu’à la seconde, issue de l’imagination de Proust ; elle est encore une troisième figure, à la croisée de tous ces chemins. Si la méthode beuvienne occupe les pages centrales du document qui nous intéresse, il ne s’agit cependant pas du sujet qui nous occupera dans les prochains paragraphes. Le chapitre qui retient notre attention, le cinquième de seize, s’intitule plutôt « L’article dans “Le Figaro” (7) ». Dans cette section, Proust apprend que l’article qu’il avait soumis au Figaro a enfin été publié ; sa signature se trouve au bas de cinq colonnes parues en première page du journal. Sa mère, sachant que quelque chose de « prodigieux (8) » se produira lorsque son fils se lira, laisse celui-ci seul dans sa chambre avec une copie qu’elle lui a apportée. La négligence inhabituelle avec laquelle elle lui donne le journal, tentant par le fait même de ne pas gâcher la surprise, fournit tout de suite l’indice nécessaire à Proust pour appréhender l’événement exceptionnel qui est sur le point de se produire. Comme quoi les signes extérieurs que nous émettons involontairement trahissent parfois nos intentions à notre insu, tandis que d’autres fois, ceux que nous manifestons volontairement ne traduisent pas le message que nous souhaiterions transmettre à notre interlocuteur. Par ce petit épisode anodin, Proust préfigure déjà le thème de ses réflexions sur la réception d’un texte. Connaissez-vous l’auteur du premier article paru dans la revue que vous avez entre les mains au moment même où vous lisez cette ligne ? En avez-vous seulement remarqué le titre ? Peut-être sauterez-vous tout bêtement ce texte-ci. Et donc, vous ne vous poserez jamais ces questions… ou, du moins, vous ne saurez jamais que je vous les ai posées. Ce sont ces questions empreintes d’une angoisse jalouse que Proust se pose en tentant de se placer, devant ses propres colonnes, dans une posture de « lecteur ». Il joue le jeu d’une approche naïve, tant au niveau de la facture visuelle que du contenu de son article. « [Cette] feuille qui est à la fois une et dix mille par une multiplication mystérieuse, tout en la laissant identique et sans l’enlever à personne (9) » – Tocqueville fois dix, donc –, entre dans les maisons de lecteurs potentiels, tombe sous les yeux d’hommes et de femmes à peine éveillés, d’esprits plus ou moins cultivés, instruits, intelligents. À la première relecture, Proust se lance des fleurs. « Réellement, il me paraît impossible que les dix mille personnes qui lisent en ce moment l’article ne ressentent pas pour moi l’admiration que j’éprouve pour moi-même (10) », écrit-il. Non mais quel génie ! D’abord auteur, ensuite lecteur, il a recouvert d’une seconde couche sémiotique les colonnes qu’il avait rédigées. C’est donc un superbe palimpseste qui s’offre à son regard. On s’arrête alors de lire Proust et on lui reproche de ne pas avoir appliqué sa méthode ; n’avait-il pas d’abord voulu lire son article avec cette « indifférence de lecteur non averti11 » ? Plutôt raté comme tentative d’intropathie. Or, comme s’il nous entendait le réprimander, Proust se ressaisit et, une page plus loin, dans une constatation fort lucide, dit : « Ces images que je vois sous mes mots, je les vois parce que j’ai voulu les y mettre ; elles n’y sont pas (12). » C’est la révélation valéryenne. Envoyé, corrigé, dactylographié, imprimé, multiplié, distribué, digéré, interprété, ressassé, morcelé, démembré, ignoré ; son article ne lui appartient plus. Les mots qui s’y trouvent sont des vases, des vases qu’il avait remplis de toute son individualité d’auteur et qui seront remplis (ou laissés vides) par dix mille lecteurs, dix mille individus dont pas un n’a la même personnalité. Le remplissage que ces derniers effectueront dépendra de leurs ressources, de leur tempérament, de leurs connaissances, de leur sensibilité, de leur jugement, de leur expérience, bref, de la somme de ces choses qui participent à la construction de leur être, de la plus humble architecture spirituelle à la majestueuse cathédrale psychologique. Avec cette nouvelle perspective phénoménologique, Proust donne à repenser le pouvoir du journal et des mots qui y sont amalgamés à même les chroniques, les éditoriaux et les articles de la presse quotidienne. Pour comprendre ce que cette théorie de la réception a de phénoménologique, il faut retourner aux influences philosophiques de Proust et plus particulièrement à Henri Bergson. Pour ne donner que le Bergson de Turmel, si peu étoffé soit-il, il faut savoir que ce philosophe, sans être entièrement engagé dans la veine phénoménologique (encore piqué de certains tics d’un psychologisme que contestera ultérieurement Merleau-Ponty), place l’intuition au premier rang. Pour lui, ce n’est que par une visée intuitive que nous est rendue accessible l’Essence des choses. En d’autres termes, nous ne saisissons jamais la Vérité qui gît au creux du principe même des êtres, constamment en mouvement, mais nous en éprouvons l’impression fugitive. Proust phénoménologue, Proust intuitif, Proust impressionniste : équivalences qui indiquent que le référent est pour l’écrivain quelque chose d’impénétrable. L’impossibilité de connaître les choses en soi, il faut donc l’admettre de concert avec l’épistémologie kantienne, embryon de la phénoménologie – et Proust a lu La Critique de la raison pure, du moins il est au fait des théories qui y sont développées. Or, si l’Objet subit ce déplacement, de la réalité à l’esprit humain, qu’advient-il de l’objectivité ? Si la seule donnée dont nous sommes absolument certains est notre propre vécu de conscience, doit-on en conclure que tout jugement n’est que pur subjectivisme ? Comment reconquérir le consensus universel ? Vient alors La Critique de la faculté de juger, étayant l’esthétique kantienne, où germe déjà timidement la base de l’intersubjectivité telle que décrite par Husserl dans sa cinquième Méditation cartésienne. Mais tout cet académisme commence à peser à Proust et il nous somme de revenir prestement à son article. C’est alors que nous comprenons la volonté d’assentiment qui se cache non seulement derrière le langage et la littérature, mais aussi et d’autant plus derrière la presse. Puissants moteurs d’imagination, les mots sont – au même titre que les courageux petits camelots – les Hermès de la pensée. Ils peuvent livrer le message des dieux sur terre, mais ne sont qu’un moyen d’exprimer l’Essence, la Vérité, l’Idée. Le travail d’interprétation, le déchiffrage des signes, la traduction de ces hiéroglyphes est donc précisément une besogne à la fois dionysiaque et titanesque, c’est-à-dire une tâche qui incombe à l’homme parce qu’il est pris dans cette dualité naturelle, entre son corps et son esprit, entre ses sensations et ses réflexions ; il est cette moitié d’hermaphrodite aristophanesque pour qui le journal est une tour de Babel. Dans cette volonté de communion des esprits, de partage des connaissances, de compréhension universelle se cache donc une vérité humaine universelle : ego cogito. Je pense, j’ai une conscience, une conscience personnelle, individuelle, qui n’appartient qu’à moi et à l’intérieur de laquelle personne ne peut entrer sauf moi. Or, cette limitation est le signe de mon imperfection et la communication est le seul moyen de surmonter cette tare. Si seulement nos pensées s’expliquaient d’elles-mêmes, si seulement elles étaient d’une limpidité telle qu’il n’y aurait jamais de malentendus, si seulement nous pouvions sortir de nous-mêmes ! Quel fantasme proustien le journal accomplit-il donc lorsque le précieux article paraît dans Le Figaro. Proust s’empresse d’ailleurs de s’en procurer d’autres exemplaires – pour les donner à ses amis bien entendu ! – qui lui permettent de « toucher du doigt l’incarnation de [sa] pensée en ces milliers de feuilles humides (13) ». Mais même devant ces copies toutes fraîches, il a du mal à se mettre dans la peau d’un nouveau lecteur. Il se dit alors qu’il devra demander l’opinion de ses amis et de ses connaissances qui auront lu son texte. Il souhaite commencer son sondage avec sa mère. Mais y a-t-il d’avis plus partial que celui d’une maman chérie ? J’en profite pour remercier ma mère qui, à la lecture de cet article, n’en verra peut-être pas la portée ni l’intérêt, mais qui prendra tout de même le temps de se rendre jusqu’au mot de la fin pour pouvoir légitimement déployer sa fierté parentale. Nos proches ne sont pas nos meilleurs critiques, mais il faut leur rendre ce qui leur appartient : ils font probablement partie des quatre ou cinq personnes qui lisent nos articles, nos mémoires et nos thèses sans remarquer les endroits où les rouages grincent encore ; nous n’avons pas besoin de leur remettre une version 7.3. Merci. Pour en revenir à l’enquête de Proust, notons seulement qu’avant de connaître enfin l’avis de sa mère, ce dernier commence par interroger sa servante Félicie (Françoise, dans la Recherche). Il lui demande d’abord ce qu’elle a pensé du « passage sur le téléphone (14) ». Or, il existe bel et bien un article publié dans Le Figaro, signé de la plume de Marcel Proust (Sainte-Beuve le biographe en serait tout excité !), dont une importante partie est consacrée aux opératrices téléphoniques. Paru le 20 mars 1907, ce passage de « Journées de lecture (15) » sera presque intégralement repris dans Le côté de Guermantes lors de l’épisode de la conversation téléphonique entre le narrateur et sa grand-mère (16). En voici, selon moi, le meilleur extrait : Je disais qu’avant de nous décider à lire, nous cherchons à causer encore, à téléphoner, nous demandons numéro sur numéro. Mais parfois les Filles de la Nuit, les Messagères de la Parole, les Déesses sans visage, les capricieuses Gardiennes ne veulent ou ne peuvent nous ouvrir les portes de l’Invisible, le Mystère sollicité reste sourd, le vénérable inventeur de l’imprimerie et le jeune prince amateur de peinture impressionniste et chauffeur, – Gutenberg et Wagram ! – qu’elles invoquent inlassablement, laissent leurs supplications sans réponse ; alors, comme on ne veut pas faire de visites, comme on ne veut pas en recevoir, comme les demoiselles du téléphone ne nous donnent pas la communication, on se résigne à se taire, on lit. Ainsi, on l’aura compris, l’art de la conversation fait partie des délassements mondains qui priment, chez beaucoup de gens, le plaisir de la lecture. Si les épidémies ou le temps empêchent de se rendre chez ses voisins, le téléphone devient une commodité, voire une nécessité. Les gens s’en servent de manière banale sans réfléchir au prodige presque magique que cette technologie leur permet d’accomplir. D’une certaine manière, il en va de même pour la presse écrite. Or, plus personne ne s’étonne en sautant d’une colonne à l’autre… sauf Proust. Rappelons-nous aussi que la lecture vient seulement après la mondanité. On comprend mieux pourquoi Proust annonce, vers la fin de son article, que ce dernier devait d’abord s’intituler « Le Snobisme et la Postérité (17) ». Et puis, en retournant au corpus d’ensemble que forme le Contre Sainte-Beuve, il paraît évident que Proust y dénonce les fameuses « Causeries » du lundi, forme de l’écriture journalistique beuvienne. Ce reproche va suivre jusque dans la Recherche, où le narrateur affirme que « [l’artiste] qui renonce à une heure de travail pour une heure de causerie avec un ami sait qu’il sacrifie une réalité pour quelque chose qui n’existe pas… » (18). Proust a remarqué, en effet, que la superficialité du bavardage déteint sur la littérature et corrompt la presse. Cela nous amène à considérer la grande majorité des lecteurs potentiels : ceux qui ne passent jamais à l’état de lecteurs actuels, de lecteurs en acte, en entéléchie. Ils possèdent un cerveau et des yeux, ne sont pas analphabètes, reçoivent le journal tous les jours ou toutes les semaines – comptons, ici, pour être généreux : la Semaine, le 7 Jours, le Paris Match, le Journal de Québec, le Star Système et j’en passe – et finissent par feuilleter rapidement la presse en ne regardant que les images pour se rendre à la section où se trouve leur divertissant sodoku. Ainsi va le constat proustien le plus fatal du cinquième chapitre du Contre Sainte-Beuve de Fallois : « Je voudrais penser que ces idées merveilleuses pénètrent à ce même moment dans tous les cerveaux, mais aussitôt je pense à tous les gens qui ne lisent pas Le Figaro, qui peut-être ne le liront pas aujourd’hui, qui vont partir pour la chasse, ou ne l’ont pas ouvert (19). » De quoi faire pleurer Tocqueville… (Et moi, qui viens peut-être de rédiger un futile exercice de style philosophico-littéraire.) Bref, vous, inestimables lecteurs – ou devrais-je
dire « toi, singulier interprète » ? – qui
vous rendrez à la conclusion de cette proustification, pouvez
vous estimer heureux de participer activement à cette quête
intellectuelle qui fut le premier ressort de la presse littéraire.
Mais ne perdez jamais de vue, à l’instar de Proust,
que malgré toutes les bonnes intentions dont vous nourrirez
votre travail journalistique, nulle transmission purement objective
des idées n’est possible ; préparez-vous à
être trahis par vos propres mots. Pire encore, préparez-vous
à trahir les mots, les vôtres comme ceux des autres
: Proust est souvent très pessimiste par rapport aux relations humaines et spécialement par rapport à la possibilité d’une quelconque amitié véritable. Cependant, la littérature est ce moyen par lequel une réelle communion intellectuelle serait accessible. Qu’est-ce donc que la presse – et surtout la presse littéraire, qui donne un accès privilégié au moi profond de son auteur parce que la fiction n’a pas à se soucier des apparences, selon Proust – sinon une manière plus efficace que la conversation ou la correspondance (parce qu’elle a le potentiel de relier des milliers d’esprits à la fois) pour faire éclore de grandes filiations d’idées et de grands débats ? En s’émerveillant devant les moyens de communication de son époque, comme le téléphone ou la presse écrite, Proust reste néanmoins lucide quant à leur utilité et à leur efficacité ; il sait que ces fantastiques instruments technologiques ne suffisent pas à éclairer tout un chacun. Cependant, il se prête au jeu et publie plusieurs articles dont certains serviront plus tard de matière à son œuvre magistrale, À la recherche du temps perdu. Ainsi participe-t-il à l’enrichissement et au recyclage de la presse littéraire. Sur ce fertile échange, de fiction à diction, il faut garder à l’esprit l’ultime choix de Proust, à savoir celui de se consacrer exclusivement à la rédaction de son œuvre romanesque. Si la carrière de ce dernier débute avec l’écriture de dissertations, d’articles, de pastiches et d’essais, elle se termine avec la composition d’une œuvre narrative. Chez l’écrivain, l’intelligence est un mal nécessaire pour parvenir au beau, au sublime, à l’art. Pierre Clarac rappelle d’ailleurs en citant la correspondance proustienne que l’essai du Contre Sainte-Beuve a été composé, entre autres raisons, afin de montrer que les « pastiches [de Proust] sont de la critique à leur manière21 » et donc d’ajouter à la compréhension de l’acte littéraire. Cela témoigne des premiers espoirs tocquevillesques qu’entretient Proust à l’égard de l’écriture, et plus spécialement à l’égard de la presse littéraire ; elle aurait le pouvoir de montrer, d’expliquer, de révéler les Idées. Après s’être laissé porter un moment sur les ailes optimistes et démocratiques du journal, Proust est repris par une certaine gravité aristocratique. Il s’adresse désormais à ceux qui auront la sensibilité suffisante et le tempérament ainsi fait qu’ils pourront se reconnaître dans sa vision du monde. Tel cet orgiophante, adepte de Phanès-Protogonos, il cible quelques rares initiés qui se retrouveront grâce au rire, mot de passe complice, signe d’une sympathie intellectuelle. Des associations qui créent leurs périodiques
pour véhiculer leur message aux individus qui font entendre
leur voix dans la presse afin de créer des clans, de Tocqueville
à Proust donc, une constante demeure : le langage est partage.
Alors que le premier voyait dans le Verbe une communion immédiate
des esprits, le second, plus lucide, dénote une communication
biaisée, figurée, codée, qu’il s’agit
de déchiffrer. Si rien n’est donné en soi, effectivement,
tout reste à être dévoilé, tout demande
à apparaître, à être mis en lumière.
Ce constat phénoménologique, que nous avons fait tout
au long de ce court article, mène à la conclusion
suivante : la lecture est une activité. Le texte publié
est un appel vers l’altérité, une demande d’investissement
qui dépasse infiniment le cadre des colonnes du journal.
La presse, véritable réseau, ne nous renvoie pas uniquement
les uns aux autres en tant que contemporains pouvant réagir
à telle chronique, tel éditorial ou tel article ;
plutôt toile d’Arachné, tapisserie en poils de
chameau, elle nous met également en relation avec l’humanité,
elle nous met au défi de comprendre son motif, son architecture.
Devant l’exigence de défiler le texte, chaque lecteur
réagira différemment, si tant est qu’il réagisse.
Et ce que Proust a surtout voulu montrer, par la réception
de son propre article paru dans le Figaro, c’est que personne
n’aura accès à l’entièreté
de son contenu tel qu’il a été pensé par
son auteur : certains, comme nos amis et parents, sont trop partiaux
; d’autres, comme nos connaissances, sont trop attachés
à notre figure sociale ; d’autres encore, qui ne nous
connaissent pas, ne peuvent comprendre nos références,
etc. Mais cette insuffisance des mots, à laquelle Proust
consent finalement malgré une amère déception,
n’est-elle pas la condition de possibilité même
de la métaphore et ainsi le fertilisant de toute la littérature
? Au final, en dépit du constat élitiste de Proust,
n’est-il pas indispensable que foisonnent les tentatives de
se dire pour qu’au moins une de ces démarches engendre
à nouveau le désir de créer, le besoin de quitter
l’île de Calypso ? Bref, s’il ne fallait retenir
qu’une seule chose de ce fameux article du Figaro, c’est
que Tocqueville n’aurait pas pu l’écrire, ni le
chapitre qui en raconte la réception dans le Contre Sainte-Beuve,
car on n’est jamais si lucide par rapport aux choses et aux
événements qu’une fois qu’ils ont révélé
leurs failles, longtemps après leur prometteuse invention.
Trop grande liberté d’expression, presse licencieuse
; trop grande facilité de réception, presse paresseuse… CLARAC, Pierre, « Notices, notes et choix
de variantes – Contre Sainte-Beuve », dans Contre Sainte-Beuve,
précédé de Pastiches et mélanges et
suivi de Essais et articles, édition générale
établie par Pierre Clarac avec la collaboration d’Yves
Sandre, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade),
1971, p. 819-829. Notes de bas de page 1 - Alexis Tocqueville, « Rapport des associations
et des journaux » (II, VI), dans De la démocratie en
Amérique, t. 2, annoté par André Gain, Paris,
Éditions Librairie de Médicis, 1951, p. 151. |
J'espère que tout cela vous a donné l'envie de lire les oeuvres de M.Proust.

