L'histoire
des câbles sous-marins
La technologie des câbles remonte aux années
1800, lorsque des scientifiques et des ingénieurs comme Werner
Siemens ont découvert comment poser des câbles télégraphiques
au fond des rivières, de la Manche et de la mer Méditerranée.
La France s'est toujours intéressée
aux câbles sous-marins. Et pour cause, elle fut l'une des deux
grandes puissances coloniales, et les câbles télégraphiques
apportaient la solution pour diriger les colonies à partir
de la métropole.
Le développement du réseau fut modeste au tout début,
mais à compter de 1893 et jusqu'en 1914 l'effort fut considérable,
et permit de s'affranchir des Anglais pour relier métropole
et colonies. En 1939, le réseau français comptait environ
60 000 km et était essentiellement orienté vers la Méditerranée
et vers l'Afrique occidentale, avec deux traversées Atlantique
Nord et Atlantique Sud. Le réseau mondial, quant à lui,
cerclait le globe d'environ un demi-million de kilomètres de
câbles télégraphiques.
Les câbles de télécommunications sous-marins installés
entre 1850 et 1956 ont servi au réseau mondial de télégraphie
par câblogrammes, ils utilisaient d'abord une technologie de
câbles binaires en cuivre pur isolés à la gutta-percha,
puis coaxiale à partir de 1933 grâce à la découverte
du polyéthylène.
sommaire
Dès le début, avant tout il fallait résoudre
le problème de l'isolation de l'âme du câble en
cuivre :
En 1838, premiers essais de câbles sous-marins
isolés avec du caoutchouc.
En 1841 un ingénieur, Wheatstone, propose
à la Chambre des Communes de relier par câble l'Angleterre
à la France.
En 1842, Samuel Morse réussit à installer un câble
sous le port de New-York, prouvant ainsi que le concept de câble
sous-marin est faisable.
En 1843, à Singapour, découverte de la gutta-percha,
isolant naturel, par le docteur William Montgomerie.
En 1845, l'allemand Werner von Siemens invente l'extrusion et le collage
de la gutta-percha sur un fil de cuivre.
En 1847 William Siemens, alors officier de l'armée de Prusse,
posa avec succès le premier câble sous-marin utilisant
une isolation à la gutta percha, à travers le Rhin entre
Deutz et Cologne .
En 1849, Charles Vincent Walker, électricien du South Eastern
Railway, a submergé un fil de deux miles enduit de gutta-percha
au large de Folkestone, qui a été testé avec
succès.
Si la maitrise des problèmes technologiques
appartient aux anglais la première liaison franco-anglaise,
est financée par des capitaux français.
C’est dès 1845
que deux entrepreneurs anglais, les frères John-Watkins
et Jacob Brett, proposent au Government Registration Office
de réaliser une liaison Europe / Amérique, puis à
l’Admiralty une liaison Grande Bretagne / colonies, enfin comme
premier test une liaison plus modeste en France et en Prusse et finissent
par obtenir en 1847 une autorisation de Louis-Philippe pour un câble
trans-Manche, mais ils ne parviennent toujours pas à réunir
les fonds privés nécessaires.
Peu après, le 10 août 1849, c’est Louis Napoléon,
à cette date « Prince Président », très
anglophile et passionné de nouvelles technologies, qui leur
concède un droit d’atterrissement d’un câble
sous-marin de télégraphie électrique.
Le 28 août 1850, la English
Channel Submarine Telegraph Company de John Watkins Brett,
à bord du remorqueur Goliath, pose le premier câble
sous-marin entre le cap Gris-Nez, en France, et le cap Southerland,
en Royaume-Uni, mais il fonctionne à
peine 11 minutes car il se rompt à de nombreux endroits. Il
s'agit simplement d'un fil de cuivre enduit de gutta-percha, sans
aucune autre protection.
Beaucoup des premières tentatives ont échoué,
en partie parce que le câble posé au fond de l’océan
se déchirait en deux sous l’effet de la pression.
 Le Goliath
Le Goliath  Le Blazer
Le Blazer
Le 25 septembre 1851, un second câble à quatre
conducteurs renforcé à 8 tonnes, est construit par les
frères Brett et, le 19 octobre 1851, est posé
par le remorqueur Blazer, entre Calais et Douvres,
il fonctionnera commercialement durant 40 ans !…
Il sera retenu par l'histoire comme le premier câble commercial
sous-marin télégraphique.
Les grands noms de cette nouvelle industrie sont donc
à partir de 1850 tous anglo-saxons: Gisborne (à
l’origine du projet transatlantique de Cyrus Field), Charles
T. Bright, John Pender (que l’on surnommera «
the cable king » vers 1872), sans compter Newall et tous
ses collègues qui développent à partir de 1864
sur les bords de la Tamise la célèbre TelCon (Telegraph
Construction & Maintenance Co Ltd).
sommaire
Le 1er décembre 1852, les équipements
intermédiaires de Douvres et Calais sont supprimés pour
établir une liaison télégraphique directe entre
les deux capitales. Les messages sont transmis en moins d'une heure
entre la bourse de Paris et celle de Londres au lieu de trois jours
auparavant
Le premier télégramme expédié le soir
même, ne reçut pas de réponse : un pêcheur
de Boulogne avait coupé. le câble avec son chalut croyant
avoir pêché une algue d'or.
En 1853, des câbles plus performants
ont été posés, reliant la Grande-Bretagne à
l'Irlande , la Belgique et les Pays-Bas et traversant Les Ceintures
au Danemark . La British & Irish Magnetic Telegraph Company a
achevé la première liaison irlandaise réussie
le 23 mai entre Portpatrick et Donaghadee en utilisant le William
Hutt. Le même navire a été utilisé pour
la liaison de Douvres à Ostende en Belgique, par la Submarine
Telegraph Company. Pendant ce temps, la Electric & International
Telegraph Company a posé deux câbles à travers
la Mer du Nord , de Orford Ness à Scheveningen , Pays Bas.
Ces câbles ont été posés par le câblier
Monarch, un bateau à aubes qui est devenu plus tard le
premier navire à disposer d'un équipement permanent
de pose de câbles.
Le 10 juin 1853, Napoléon III accorde une seconde concession
aux frères Brett. Ils relient la Corse et l'Algérie
à la France.
Très vite en France, les financiers,
le gouvernement, s'intéresse au problème des liaisons
télégraphiques. Napoléon III qui vient, en 1851,
d'accéder au pouvoir, est déjà entouré
de ceux qui deviendront les barons de l'empire industriel français.
L'heure est à la mobilisation des capitaux et à l'exaltation
de l'effort industriel.
L'Etat soutient vigoureusement les efforts des Compagnies (Compagnie
du télégraphe sous-marin, Compagnie de la méditerranée,
Compagnie du câble transatlantique) qui se créent pour
poser et exploiter les câbles.
Les raisons de cet intérêt croissant pour les câbles
sous-marins sont multiples : d'abord parceque cela touche au monopole.
Le monopole de la transmission des signaux tel qu'il avait été
défini par la loi du 2 mai 1837 et le décret loi du
27 décembre 1851 était formulé d'une manière
assez large pour que tous les progrès techniques puissent être
repris en compte tour à tour.
Mais il s'agit aussi et surtout d'une politique d'état.
Les câbles sous-marins représentent au moment où
la rivalité franco-anglaise est plus vive que jamais un enjeu
politique, commercial et militaire (notamment lors des opérations
de conquête) dont on mesure tout de suite l'importance. Londres
est alors la première place financière du monde et les
milieux d'affaires français par exemple ont intérêt
à connaître au plus vite le cours de la bourse de Londres,
plus d'intérêt en tout cas que leurs collègues
anglais le cours de la bourse de Paris. C'est ce qui explique l'intérêt
porté par les financiers français à l'établissement
de la liaison Douvres-Calais.
sommaire
Souvenons-nous que les frères Brett (qui géraient
l’entreprise familiale de leur père, fabriquant de meubles
et tapissier à Bristol) ont proposé sans succès
en 1845 au gouvernement britannique un projet de liaison Amérique
/ Europe qui aurait suivi la route du « Atlantic Cable »
finalement adoptée 12 ans plus tard. En janvier 1849, l’avocat
de Philadelphie Horatio Hubbell soumet aux deux chambres des USA un
mémorandum proposant d’établir un câble
entre Terre-Neuve et l’Irlande, câble qui serait suspendu
dans l’océan par environ deux cents bouées. Il
passera ensuite son temps à se défendre des attaques
juridiques de Morse qui lui conteste une telle antériorité
d’un projet transatlantique. En décembre 1849, le docteur
en homéopathie J.H. Pulte de Cincinnati propose de raccorder
les deux côtés de l’Atlantique en installant un
câble essentiellement terrestre via l’Alaska, Bering and
la Russie, totalisant 18,500 miles depuis Little Rock (Arkansas) jusqu’à
Londres mais il ne parvient pas à intéresser le gouvernement
américain à son projet.
Un projet analogue sera repris par l’entrepreneur américain
Perry Collins en 1861 en partenariat avec la Western Union –
qui à cette date avait achevé la liaison San-Francisco
/ New-York – mais sera abandonné en 1866 après
le succès final de l’Atlantic Cable.
Notons que c’est sur la base d’un télégramme
transmis par les constructeurs de cette ligne télégraphique
en Alaska et mentionnant la présence de mines d’or dans
cette région, que le secrétaire d’état US
William Seward négocie le rachat de l’Alaska au Tsar russe
en 1867 !
C’est en 1852 que naît le vrai projet transatlantique:
Frederick Newton Gisborne, ingénieur télégraphiste
de l’ « Amérique du Nord Britannique », témoin
du succès des frères Brett dans le câble Douvre
/ Calais, constitue une compagnie pour établir une ligne télégraphique
terrestre traversant Terre-Neuve de St Jean au Cap Ray et pour poser
un premier câble entre l’ile du Prince Edouard et l’ile
du Cap Breton.
Mais la liaison Terre-Neuve / New-York reste très incomplète;
or, l’idée était la suivante: lorsque les paquebots
atterrissent sur St-John et recalent leur navigation après
la grande traversée en provenance d’Europe, d’abord
on peut estimer avec précision leur ETA à New-York mais
surtout, de petits voiliers ou vapeurs peuvent s’en approcher,
récupérer des messages dans des containers ou des bouteilles
balancées par dessus bord par des informateurs et télégraphier
à New-York les « time-sensitive news » des finances
et de la presse avec plusieurs jours d’avance sur la remise normale
de ces nouvelles à l’arrivée des bateaux au west
side de Manhattan.

La route Trinity Bay (Terre-Neuve) - New-York télégraphie
terrestre télégraphie sous-marine
En fin 1853, les finances de Gisborne sont à sec et celui-ci
recherche de nouveaux financements à New-York et c’est
là qu’il rencontre le fameux Cyrus Field. Cyrus Field
, le plus jeune de sept frères, né en 1819 dans le Massaschussets
« monte » à New-York à 15 ans avec 8 $ en
poche et réalise une fortune telle dans l’industrie du
papier qu’il peut se permettre de prendre sa retraite à
l’âge de 33 ans ! Field est interessé par l’idée
de Gisborne, à condition de ne pas s’arrêter à
Terre-Neuve, d’aller jusqu’au bout et de traverser l’Atlantique
jusqu’en Irlande et en Angleterre avec le câble télégraphique.
Il commence par écouter des conseillers prestigieux, comme
le Cdt Maury, Directeur de l’observatoire national des USA (qui
vient justement de présenter au Secrétaire d’état
à la Marine les résultats d’une campagne de sondages
éxecutés sur le trajet Irlande / Terre-Neuve) et bien
sûr, l’incontournable Pfr Morse qui confirme, sans autre
argument que son inoxydable confiance en son propre génie,
qu’un tel projet hante ses nuits et ses jours depuis 1843…
Field, une fois convaincu que son projet devrait être viable,
s’attaque à la réalisation de la section New-York
/ St John: il achète à Morse les droits de ses brevets,
et rachète pour 40 000 $ à Gisborne les privililèges
et droits que sa Newfoundland Electric Telegraph Company avait obtenus
du parlement canadien (exploitation pendant 50 ans de la télégraphie
terrestre et sous-marine à Terre-Neuve, au Labrador, dans la
province du Maine, de la Nouvelle Ecosse et dans l’Ile du prince
Edouard). Il s’attache aussi à réunir des soutiens
financiers et politiques en vue de son projet: la New-York, Newfoundland
and London Telegraph Company est constituée le 6 mai 1854 et
un capital de 1 500 000 $ est aussitôt souscrit.
A l’automne 1854, Field va à Londres commander
le câble de la liaison cap Ray / cap North (il y rencontre John
W Brett et William Thomson): le câble y est fabriqué
et chargé sur une barque à voiles vers Terre-Neuve :
la barque aidée d’un remorqueur entame la pose à
partir de cap Ray mais une tempête combinée à
une sous-estimation du poids du câble oblige à couper
celui-ci pour éviter de faire couler la barque.
Field retourne à Londres, commande un nouveau câble qui
est posé (par un steamer) et par ailleurs, sur l’ile,
malgré d’énormes difficultés, la ligne terrestre
St John – cap Ray est également achevée en 1856.
Field obtient du gouvernement britannique une subvention annuelle
de 14 000 £/an pour l’usage du futur câble, ainsi
que le prêt de navires de la Royal Navy pour effectuer de nouveaux
sondages. Il a plus de mal à Washington mais obtient finalement
qu’une loi soit votée lui accordant les mêmes avantages
qu’à Londres, soit 70 000 $/an et la mise à disposition
de deux vaisseaux de l’US Navy pour les opérations de
pose. Cette aide substantielle des deux gouvernements à une
entreprise purement privée et commerciale est symptomatique
de l’importance aux niveaux diplomatique, stratégique,
scientifique et économique que ces pays accordent à
ce projet, pourtant encore bien utopique aux yeux de beaucoup.
Les 2 500 nm de câble sont produits en 6 mois à Londres,
en parallèle par Glass Elliot & Co et par R.S.Newall &
Co (qui toutes deux sont à l’origine des fabriquants de
câbles de mines) sur la base d’une âme centrale de
7 brins de cuivre fournie et isolée par la Gutta Percha Cy.

Fabrication du câble.
sommaire
La pose est entreprise dès 1857 : un
départ en fanfare des 4 navires (les mêmes que ceux de
1858 dont nous avons parlé au début) est organisé
le 5 août depuis Valentia bay en Irlande, tous les bateaux naviguant
cette fois vers l’ouest de concert mais, dès le 10 août,
un défaut d’isolation est constaté puis un arrachement
du câble dans la machine de pose qui oblige à renoncer
à cette campagne. Comme nous l’avons vécu en introduction,
la nouvelle campagne de 1858, avec toutes ses péripéties,
semble « successful » mais échoue in fine au milieu
de la fête…
Le 29 juillet 1858, 4 navires sont réunis par
52°02' de latitude Nord et 33°18' de longitude Ouest, c’est
à dire au milieu de l’atlantique Nord, à égale
distance de l’Irlande vers l’Est et de Terre-Neuve vers
l’Ouest.

Trois de ces navires appartiennent à la Royal Navy, le quatrième
à la US Navy: Mise à disposition par sa très
gracieuse majesté Victoria, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne
et d’Irlande.
Le 5 août 1858, à l'initiative
de Cyrus Field, Charles Bright et John Brett, le premier câble
transatlantique est posé entre Valentia (Irlande)
et Trinity Bay (Terre-Neuve), par les deux navires militaires
reconvertis en câbliers, les Niagara et Agamemnon.
L'Agamemnon
HMS Agamemnon, une frégate à trois mâts
« man-of-war » de 2ème classe, deux ponts,
91 canons, 860 hommes, 70 m de long, 3 200 tonneaux, construite
en 1852, qui s’est couverte de gloire en bombardant Sébastopol
lors de la guerre de Crimée (« Russian war«
); il y a 2 ans, en 1856, 
|
l’Agamemnon a été désarmé
et motorisé à Portsmouth avec deux lignes d’arbres
d’hélice. l’Agamemnon est commandé par
le Captain Moriarty et accompagné et assisté par
HMS Valorous, bâtiment de servitude et d’aide aux
manœuvres, mise à disposition par la US Navy,

|
|
L'USS Niagara
L a frégate à vapeur USS
Niagara, 5 630 tonnes de déplacement, plus de 100 m de
long (record du monde à l’époque), construite
en 1855 par le chantier George Steers (constructeur du célèbre
yatch America qui rapporta l’America’s Cup au New-York
Yatch Club en 1857), et la plus rapide aussi, puisqu’atteignant
12 nœuds sur son unique ligne d’arbre.
Le Niagara est commandé par William L. Hudson (1794 –
1862) qui s’est rendu célèbre, à l’issue
des guerres napoléoniennes, en bataillant en méditerranée
contre les pirates barbaresques et les ottomans (« US
second barbary war« , 1815). Le Niagara est assisté
par HMS Gorgon (mise à disposition par la Royal Navy).
L’ensemble de cette manœuvre est réalisée
en pleine mer, par houle de 3 à 5 m.
|

|

|
L’Agamemnon et
le Niagara sont chargés chacun de 1 200 nm de câble
et équipés sur le pont d’une machinerie spécifique
(mise au point par le remarquable ingénieur William E.
Everett) pour laisser filer leurs câbles respectifs au fond
de la mer tout en les retenant mais sans risquer les rompre.
Avec l’assistance des bateaux accompagnateurs et de plusieurs
chaloupes, l’extrémité du câble stocké
sur le Niagara est hissé sur le pont de l’Agamemnon
et une épissure est soigneusement réalisée
entre les deux sections de câble, puis cette jonction est
délicatement mise à l’eau et coulée
jusqu’à toucher le fond (1500 brasses ou fathom soit
1 829 m de hauteur d’eau) grâce à une fonte
en plomb.
Et c’est la quatrième fois en un mois que ce rendez-vous
des divers bâtiments et cette manœuvre acrobatique
ont ainsi lieu au milieu de l’Atlantique: La première
fois, début juin 1868, avant de d’atteindre le point
de rendez-vous midatlantique, un véritable ouragan –
l’un des pires de toute l’histoire de l’atlantique
nord – s’est déchaîné sur la flotte. |

 Machineries du Niagara
sommaire
Carte du câble télégraphique transatlantique
de 1858.
Machineries du Niagara
sommaire
Carte du câble télégraphique transatlantique
de 1858.

Les bateaux ont néanmoins
pu continuer leur navigation jusqu’au point prévu mais,
après la pose de l’épissure au fond, pendant la
pose des deux demi-câbles, la liaison électrique s’est
rompue quand les deux bâtiments poseurs n’étaient
séparés que de 12 (=2X6) nm. Donc, on coupe ces petites
sections que l’on abandonne au fond et on recommence la manœuvre;
la deuxième fois, c’est quand 2X80 nm de câble ont
été posés que la rupture électrique se
produit. On recoupe, on recommence la manoeuvre, l’épissure,
etc. et cette troisième fois, c’est après un total
de 2X250 nm de pose après l’épissure que le défaut
se reproduit, ce qui contraint l’ensemble des bâtiments
à revenir à Queenstown en Irlande après avoir
coupé et abandonné au fond les poses effectuées.
Le découragement ne faisant pas partie des équipements
embarqués, après un réapprovisionnement, la flotte
repart de Cork le 17 juillet, avec moins d’enthousiasme qu’en
juin mais, cette fois-ci, il semblerait que la malchance se soit éloignée:
à bord des deux navires poseurs, on sait tout de suite si la
pose est réussie ou pas: même avec la moitié de
l’atlantique entre eux, les deux bâtiments sont toujours
reliés par les sections de câble déjà posées
de chaque côté de l’épissure: ils ont d’importante
batteries à bord et peuvent donc en permanence communiquer
ou tout au moins vérifier la réalité de la continuité
électrique sur toute la longueur du câble posé
et à poser.
La pose se conclut le jeudi 5 août par
deux atterrissements triomphaux à quelques heures d’intervalle,
l’un à Trinity bay à Terre-Neuve et l’autre
à Valentia bay en Irlande. La liaison télégraphique
entre Terre-Neuve et New-York avait été préalablement
réalisée et c’est donc dès le 5 aout 1858
que Cyrus Field, le patron de ce fantastique projet « The Atlantic
Telegraph Company« , expédie de Terre-Neuve à
New-York et en relai à toutes les grandes villes américaines
déjà raccordées par télégraphie
terrestre, un message triomphant clamant sa réussite historique.
Au total, 4 200 km de câble, d’un poids de 7 000 tonnes,
sont posés. Le câble est constitué d'une âme
composée d'un toron de sept fils de cuivre pur gainé
de trois couches de gutta-percha (12,2 mm de diamètre). Il
est armé de 18 torons formés chacun de sept fils de
fer, le tout enrobé d'une mince couche de toile goudronnée.

La pose se conclut le jeudi 5 août par deux atterrissements
triomphaux à quelques heures d’intervalle, l’un à
Trinity bay à Terre-Neuve et l’autre à Valentia
bay en Irlande. La liaison télégraphique entre Terre-Neuve
et New-York avait été préalablement réalisée
et c’est donc dès le 5 aout 1858 que Cyrus Field,
le patron de ce fantastique projet « The Atlantic Telegraph
Company« , expédie de Terre-Neuve à New-York et
en relai à toutes les grandes villes américaines déjà
raccordées par télégraphie terrestre, un message
triomphant clamant sa réussite historique.
sommaire
Le 10 août 1858, Le message, envoyé
depuis l'Angleterre, était : « L'Europe et l'Amérique
sont unies par la télégraphie, Gloire à Dieu
au plus haut des cieux, paix et bonne volonté aux hommes sur
Terre ». La transmission du message de 100 mots dure 67 minutes.
La reine Victoria envoya ensuite un télégramme de
félicitations au président James Buchanan dans sa résidence
d'été à l'hôtel Bedford Springs en Pennsylvanie
et exprima l'espoir que le câble constituerait « un lien
supplémentaire entre les nations dont l'amitié repose
sur leur intérêt commun et leur estime réciproque
».

Le président lui répondit que « c'est un triomphe
plus glorieux, parce que beaucoup plus utile à l'humanité,
que ceux gagnés par des combattants sur le champ de bataille.
» et « Que le télégraphe transatlantique,
avec la bénédiction du ciel, se révèle
être un lien perpétuel de paix et d'amitié entre
les nations apparentées, et un instrument destiné par
la Divine Providence à répandre la religion, la civilisation,
la liberté et la loi dans le Monde ».
On ne peut imaginer l’explosion d’enthousiasme provoqué
par cette annonce dans tout le pays: saluts au canon, pavillons envoyés,
cloches sonnant des heures durant, poèmes et chansons spécialement
composés et entonnés sur les places, célébrations
religieuses, banquets géants, etc. Des orateurs exaltés
parlent du « roi Cyrus » ou de « Cyrus le Grand
», l’un d’eux déclamant: « Colomb dit:
il y a un monde, faisons-en deux, mais Field dit: il y a deux mondes,
n’en faisons qu’un! ». Le 16 août, on publie
les messages suivants échangés via le câble entre
la reine Victoria et le Président américain James Buchanan.
Ces premiers messages, codés en Morse ont été
difficiles à déchiffrer.
Ces messages ont engendré une explosion
d'enthousiasme. Le lendemain matin, un tir de salut de 100 canons
retentit à New York, les rues étaient décorées
de drapeaux, les cloches des églises sonnaient, et la nuit
la ville était illuminée. Le 1er septembre, il y eut
un défilé suivi d'une procession aux flambeaux et de
feux d'artifice, qui provoquèrent un incendie dans l'hôtel
de ville.
La ligne ne fonctionne que vingt jours,
jusqu'au 1er septembre : Wildman Whitehouse, ingénieur de la
société Newall, pensant accélérer la transmission,
provoque le claquage de la liaison en appliquant une tension de pile
destructrice.
Le fonctionnement du nouveau câble fut compromis par le fait
que les deux principaux ingénieurs électriciens de la
société avaient des idées très différentes
sur la façon dont le câble devait fonctionner. Lord Kelvin
et le Dr Wildman Whitehouse se trouvaient aux extrémités
opposées du câble, ne communiquant que par le câble
lui-même.
Lord Kelvin, situé à l'extrémité
ouest (Terre-Neuve), pensait qu'il était suffisant d'utiliser
une tension basse et de détecter seulement le front montant
du courant qui sortait du câble et qu’il était inutile
de surveiller la suite du signal (le code Morse utilisait un courant
électrique positif pour un « point » et un courant
négatif pour un « tiret »). Lord Kelvin avait inventé
un galvanomètre à miroir précisément optimisé
pour détecter rapidement le changement de sens du courant.
À l'extrémité est du câble
(en Irlande) se trouvait Wildman Whitehouse. Il était l'électricien
en chef de la compagnie et docteur en médecine – c’était
un autodidacte dans le domaine de l’électricité.
Whitehouse estimait que, pour que la détection du changement
du sens du courant en réception soit la plus rapide possible
le câble devrait être alimenté à partir
d'une source à haute tension (plusieurs milliers de volts venant
de bobines d'induction).
La situation a été aggravée
par le fait que alors que du code Morse intelligible était
vu sur le galvanomètre à miroir à l'extrémité
coté est, Whitehouse insistait pour que le galvanomètre
de Kelvin soit déconnecté et remplacé par son
propre enregistreur télégraphique breveté qui
était beaucoup moins sensible.
Les conséquences de ces mauvaises manipulations et de la conception
imparfaite du câble, conjuguées aux tentatives répétées
de Whitehouse d’alimenter le câble sous haute tension,
ont compromis l'isolation du câble ; il fallait de plus en plus
de temps pour envoyer les messages. Vers la fin, l'envoi d'une demi-page
de texte de message prenait jusqu'à un jour.
sommaire
1858 le télégraphe à Jersey
:
La plupart des premiers circuits télégraphiques
ont été construits sur terre à l'aide de poteaux
et de fils ouverts, mais le premier câble sous-marin réussi
a été posé en 1851 de Douvres à Calais.
Les frères John et Jacob Brett ont proposé en 1845 d'établir
un système général de communication télégraphique
pour la Grande-Bretagne, et en 1847 ont obtenu une concession du gouvernement
français pour établir un câble entre l'Angleterre
et la France.
Comme nous l'avons déjà évoqué, le câble
de Bretts de 1850 n'a pas fonctionné, mais une deuxième
tentative entre Douvres et Calais en 1851 s'est avérée
un succès durable : le premier câble télégraphique
sous-marin commercialement viable au monde.
En 1858, il y avait des lignes télégraphiques partout,
y compris quelques câvles sous-marins, une expansion grandement
encouragée par les compagnies de chemin de fer qui utilisaient
elles-mêmes la télégraphie de manière intensive
et fournissaient également les routes sur lesquelles les systèmes
télégraphiques pouvaient être érigés.
C'est dans ces circonstances que le désir d'une connexion télégraphique
avec le Royaume-Uni a grandi.
Les hommes d'affaires de Jersey,
toujours soucieux de profiter de tous les avantages, étaient
très enthousiastes à l'idée d'une connexion
quasi instantanée avec la bourse de Londres ou leurs partenaires
commerciaux. Fin juin 1858, le fabricant et entrepreneur de câbles,
W T Henley d'East Greenwich, arriva à Guernesey prêt
à préparer les tranchées pour la partie terrestre
du câble et il était attendu à Jersey peu
après. Le 6 juillet, la London Shipping Gazette rapportait
: " Initialement destiné à aller de Weymouth
via Alderney à Jersey puis Guernesey, le câble ira
désormais Aurigny-Guernesey-Jersey, atterrissant à
l'Ancresse Bay Alderney et St Martins Point Jersey. La dernière
route maritime empruntée était de l'île de
Portland.
Le câble a été posé par le navire câblier
Elba qui appartenait au fabricant de câbles R S Newall
and Company, l'Elba était peut-être le premier navire
correctement équipé pour la pose de câbles
ayant des réservoirs circulaires, des cônes ... qui
sont devenus l'équipement standard pour les opérations
de câble.
Le 3 août, l'Elba est arrivé de Birkenhead
pour poser le câble télégraphique
de Jersey à Guernesey , à Aurigny
puis à Weymouth.
Le câble était recouvert de
gutta percha et roulé dans un grand tambour dans la mer
et sur le rivage. La gutta percha est une substance naturelle
obtenue principalement à partir du latex du genre malais
Sapotaceae d'arbres à caoutchouc. Il est plus dur que le
caoutchouc normal et beaucoup moins flexible. Il est cependant
étanche, très résistant aux courants électriques
et très résistant à l'usure et a été
largement utilisé comme matériau isolant au début
des équipements électriques et a continué
à être utilisé pour le câble sous-marin
dans le XXe siècle.
L'opération sera terminée avec succès en
septembre 1858. Des problèmes se sont développés
rapidement avec onze ruptures survenues en 1860 en raison des
tempêtes, des mouvements de marée et de sable et
de l'usure des roches. Un rapport adressé à l'Institution
of Civil Engineers en 1860 expose les problèmes pour aider
aux futures opérations de pose de câbles. |
 |
En septembre 1858, après plusieurs jours
de détérioration progressive de l'isolant et de corrosion
du câble, le câble tomba en panne.
Dans l'enquête qui s'ensuivit, le Dr Whitehouse fut jugé
responsable de l'échec et la société n'a pas
échappé aux critiques pour avoir employé un ingénieur
électricien sans qualifications reconnues. Certains
ont aussi fait valoir que la fabrication, le stockage au soleil et
la manipulation défectueuse du câble de 1857/1858 auraient
de toute façon conduit à une défaillance prématurée.
La défaillance rapide (3 semaines) de
ce premier câble mina la confiance du public et des investisseurs
et retarda les efforts pour établir une nouvelle connexion
transatlantique. La Guerre de Sécession, entre 1861 et 1865
contribua aussi à retarder les projets de nouveaux câbles.
La tentative suivante ne fut entreprise qu’en 1865 avec des matériaux
très améliorés ; après quelques échecs,
la liaison fut achevée et mise en service le 28 juillet 1866.
Ces nouveaux câbles s'avérèrent plus durables.
Câble Jersey France
Dès 1858, il y avait des rumeurs selon lesquelles un câble
serait posé de Jersey à la France.
La Submarine Telegraph Company, fondée par Thomas Crampton,
avait posé le premier câble télégraphique
à travers la Manche en 1851. En 1858, il y avait déjà
un transporteur télégraphique international qui avait
posé plusieurs câbles pour la France et détenait
une licence du gouvernement français pour transporter des télégraphes
sur le territoire français. Au cours de l'été
1859, la Submarine Telegraph Company a demandé aux gouvernements
britannique et français l'autorisation de faire passer un câble
de Jersey à la France.
Au début, la Channel Islands Telegraph Company et leur société
mère, l' Electric and International Telegraph Company , qui
étaient des rivales de la Submarine Telegraph Company, ont
soulevé des objections à la pose d'une extrémité
à terre à Jersey.
En conséquence, les États ont d'abord été
avisés par les autorités britanniques d'empêcher
tout câble d'atterrir à Jersey. Après de nouvelles
négociations, cependant, la Channel Islands Telegraph Company
a retiré son objection et la Submarine Telegraph Company a
obtenu une licence du gouvernement britannique.
 |
En septembre 1858 ,
le gouvernement de Sa Majesté a nommé le comte de
Malmesbury pour diriger les négociations avec la France
au nom de la Submarine Telegraph Company pour renouveler la licence
d'exploitation sur le sol français et pour l'autorisation
du câble de Jersey. Le gouvernement français a d'abord
été réticent à renouveler ce qui était
un monopole virtuel mais a finalement concédé et
renouvelé la licence pour 25 ans, la moitié de la
période initialement demandée. Cela a en effet ouvert
la voie au câble français.
L'itinéraire à emprunter par le nouveau câble
allait de la baie de Fliquet à Jersey à Pirou, sur
la côte normande au sud de Lessay, et jusqu'à Coutanches.
Le 10 janvier 1860, le câblier Resolute est affrété
pour poser le câble.
Le câble utilisé sur cette route était plus
important que celui utilisé par la Channel Islands Telegraph
Company. Une description contemporaine indiquait que le câble
était composé de 7 brins de cuivre recouverts de
gutta percha et ayant les mêmes dimensions que le câble
atlantique posé en 1858. La gaine extérieure est
composée de 12 fils fils de fer de calibre n°5. Le
câble résultant était légèrement
plus important que celui de la Manche. |
La ligne terrestre à Jersey a été
posée sous terre par le fabricant et entrepreneur de câbles,
WT Henley de Woolwich, depuis le débarcadère à
Fliquet, via StMartins Church, Five Oaks, St Saviors Road, James Street,
Colomberie, Hill Street jusqu'au télégraphe de Church
Street bureau.
sommaire
Voilà donc une entreprise gigantesque, quatre années
d’efforts et d’investissements réduits à néant,
plus de 2 200 nm de câbles irrécupérables, perdus
au fond de l’océan. Et pourtant, loin de désespérer
et de jeter l’éponge, la même équipe va évaluer
les raisons de l’échec, les corriger et recommencer, réunir
à nouveau les hommes, les techniques, les dollars et les livres
et va finir par réussir lors des nouvelles campagnes de 1865
/ 1866.
Comme nous l’avons vécu en introduction,
la nouvelle campagne de 1858, avec toutes ses péripéties,
semble « successful » mais échoue in fine au milieu
de la fête… Nous constations plus haut, qu’à
l’issue de cette campagne de 1858, jusqu’en1865, on ne constate
plus de projet de câble sous-marin transatlantique :
- Côté US, la « civil war » bloque toute
nouvelle entreprise et l’éloquence et les allers-et-retours
incessants de Cyrus Field entre les USA et Londres (la guerre renforce
selon lui le besoin d’une telle liaison) ne suffisent pas à
remobiliser de nouveaux investisseurs sur le projet.
- Côté UK, face à un bilan global désastreux
(à peine 25% des 11 000 nm posés dans tous les océans
par l’industrie britannique sont opérationnels), le Board
of Trade (ministère du commerce) organise avec l’Atlantic
Telegraph Co une commisssion d’experts (la Commission «
Galton« ) qui analyse scientifiquement les raisons techniques
des échecs et produit en 1861 un remarquable « parliamentary
bluebook« , véritable audit technologique proposant un
ensemble de recommandations de sélection de matériaux,
de méthodes de fabrication, de techniques de pose et de réparation,
… Pendant ce temps, dans les chantiers Millwall au bord de la
Tamise, le « petit géant » Isambard Kingdom Brunel
[ il mesure 1m.59, il a construit des résaux ferroviaires,
des tunnels, des ponts, des quais et de grands bateaux à vapeur
en acier] fait construire le fameux Great Eastern (211 m, 22
500 tons), qui se révèle un excécrable paquebot
– qui cause la faillite de ses 3 premiers armateurs – mais
un excellent navire câblier !
 Construction
du « Leviathan » de 1854 à 1858 il devient
le « Great Eastern » en 1858 Construction
du « Leviathan » de 1854 à 1858 il devient
le « Great Eastern » en 1858
sommaire
De 1858
à 1865, plus d’activité de câble sous-marin
transatlantique chez les anglo-américains: en effet, en 1859,
nous sommes en pleines crises annonciatrices de la « civil war«
, la guerre de sécession, la première guerre «
moderne » qui éclate en juillet 1861 et qui s’achèvera
en avril 1865 après le massacre de 617 000 combattants.
Avec moins d’incidences directes sur les
câbles sous-marins, la période 1861 – 1867 est également
celle de la calamiteuse intervention française au Mexique qui
conduit les USA à s’opposer à la France pour chasser
du Mexique nos soldats, au moment même où la guerre prusso-autrichienne
se conclut par une victoire claire de la Prusse à Sadowa (1865)
et laisse donc la France isolée face à la Prusse. Dans
l’ambiance de relations internationales aussi tendues et complexes,
de nouveaux accords et investissements pour des câbles télégraphiques
intercontinentaux deviennent donc des exercices de diplomatie voués
à l’échec.
Isambard Brunel Finalement, en 1864, Field obtient la participation
à son projet de John Pender, le patron de The Telegraph Construction
& Maintenance Co Ltd (issue de la fusion de Gutta Percha Co et
de Glass Elliott & Co) qui s’engage comme fournisseur du
câble; puis il trouve un accord avec Daniel Gooch, le dernier
en date propriétaire du Great Eastern.
En mai 1865, 2 300 nm de nouveau câble ont été
fabriqués selon un cahier des charges très rigoureux,
résultant, mais en les améliorant encore, des recommandations
de la Commision Galton de 1861.
Ils ont été chargés et lovés soigneusement
dans les gigantesques cales du Great Eastern: au centre de l’illustration
jointe, on reconnaît, avec canne et haute-forme gris, le Prince
de Galles, futur Edouard VII, en visite durant cette opération,
nous vous retrouverons bientôt en France, Monseigneur…

Entretemps, Field s’est rendu sur l’invitation de Ferdinand
de Lesseps, à l’inauguration du canal de Suez, en tant
que représentant de la Chamber of Commerce in New-York.
Le Great Eastern appareille de Valentia (Irlande) le 17
juillet 1867 pour cette nouvelle campagne de pose, le 23 juillet
1865 : après 84 nm posés, incident électrique
localisé environ 10 nm derrière la poupe – demi-tour,
récupération de 12 nm de câble posé: on
découvre une pointe de métal qui a percé l’isolant
et atteint l’âme de cuivre: on croit à un sabotage
mais, en fait, c’est un brin d’acier cassant détaché
des filins de l’armature lors des manoeuvres qui expliquera l’incident;
tout va bien ensuite mais à 600 nm du but, nouveau défaut,
cette fois la machine de pont pour relever la section en cause se
révèle insuffisamment puissante et le cable explose
et plonge par 3600 m de fond. On localise, on drague, on tente de
relever trois fois mais les attelages se rompent l’un après
l’autre. Il n’y a plus qu’à marquer le point
d’une belle bouée et à rentrer à la maison
!
Mais tout le monde y croit encore ! Field reprend ses navettes entre
Londres et New-York; et, pour des raisons fiscales anglaises, il constitue
une nouvelle société – The Anglo-American Telegraph
Cy – , puis il lève £ 600 000 de nouveau capital,
on redéfinit les spécifications du câble, on améliore
les machines et méthodes pour tenir compte des derniers incidents,
on lance les fabrications (on commande la totalité du futur
câble et on garde à bord les 750 nm non posés
à l’été 1865, on refait un carénage
soigné du Great Eastern, on charge 8 500 tonnes de charbon
et la nouvelle campagne de pose transatlantique démarre le
13 juillet 1866; tout se passe alors tellement bien (même
la météo) que l’équipage s’ennuie et
consulte constamment les parliamentary & financial news retransmises
depuis Valentia en temps réel.
L’arrivée à Heart’s Content – le nouveau
point d’atterrissement à Terre-Neuve – le 27 juillet
1866 est évidemment un triomphe.
La liaison Europe–Terre-Neuve se trouvait ainsi
assurée.
sommaire
Cerise sur le gateau, au retour vers l’europe, le Great Eastern
et ses navires accompagnateurs retrouvent le point où le câble
de 1865 s’est cassé et fin août, après 30
essais manqués de manoeuvres et d’acrobaties, on parvient
à remonter le câble à bord du Great Eastern; on
vérifie que tout fonctionne OK vers l’Irlande, une bonne
épissure et cap vers l’Ouest, on repart vers Terre-Neuve
pour finir en beauté la pose débutée en 1865.
Le Great Eastern à Heart’s Content en 1866 La queen Victoria
échange à nouveau des congratulations avec le président
US qui est cette fois Andrew Johnson! On a désormais deux cables
USA / Europe en bon état de fonctionnement, l’ère
des échanges d’informations entre les deux continents
va démarrer « full speed » et constituer un colossal
marché de services qui continue encore aujourd’hui de
croître.
A ce point, une remarque: ces campagnes de pose successives
de 1857 à 1866 démontrent que les débuts de la
télégraphie intercontinentale constituent un exploit
humain fantastique reposant non seulement sur les découvertes
scientifiques de savants, les réalisations remarquables d’ingénieurs,
les paris financiers hors normes d’entrepreneurs ambitieux et
opiniâtres, les soutiens de politiques visionnaires (oui, ça
existait à l’époque!) mais aussi et enfin j’allais
dire surtout de marins exceptionnels; et, quand on parlera des progrès
fabuleux des liaisons par câbles, on pensera aux télécoms,
canaux téléphoniques, répéteurs immergés,
numérisation, fibres optiques, etc. et on pourra avoir tendance
à oublier l’aspect purement maritime de cette industrie:
« y’a qu’à » dérouler le câble
au fond de l’eau depuis un gros bâteau, où est le
problème ?
Détailler les véritables exploits maritimes qui ont
été réalisés durant ces campagnes sortirait
du cadre de cet exposé, mais le lecteur un tant soit peu sensibilisé
aux métiers de la mer aura certainement réalisé
que les problèmes étaient multiples et d’une complexité
hors normes, surtout avec les équipements et moyens disponibles
au milieu du XIXe siècle ! Quelques exemples pratiques de difficultés:
1/ la précision de navigation nécessaire (alors qu’on
fait le point au sextant) pour retrouver un tronçon de câble
de 5cm de diamètre par 3000 m de fond: les bouées de
marquage ne résolvent pas tout: leurs ancres peuvent déraper
ou les filins se casser…
2/ même si l’on arrive à crocher le câble
au fond, imaginer et mettre en oeuvre des grapins, filins et attelages
capables de le saisir et de le remonter sans le massacrer sous des
tensions de plusieurs tonnes, la limite de rupture du câble
de grands fonds de 1865 étant théoriquement de 8 tonnes.
3/ les machines et freins contrôlant la sortie à l’eau
du câble imposent une vitesse constante d’environ 6 nm
de câble par heure en pose normale: donc, c’est la vitesse
du navire par rapport au fond qu’il faut réduire quand
le fond descend et augmenter quand le fond remonte!…Allez faire
cela avec un sondeur à huile de coude et un moteur mû
par une machine à vapeur de 1860 !
Et, de fait, cet aspect purement maritime a connu autant de difficultés
vaincues et autant de progrès – sinon plus – que
l’industrie des câbles elle-même: des navires câbliers
construits exclusivement pour la pose et les réparations de
câbles se sont révélés indispensables dès
1873 et l’on est passé en 160 ans de l’Agamemnon,
avec son gréément de marine à voile et ses machines
à vapeur fraichement installées pour les campagnes de
1857/58, à des navires câbliers de la classe «
Pierre de Fermat » (lancé en 2014 dans un chantier norvégien
pour la filiale Orange Marine de France Telecom), bâtiments
bourrés de technologies ultra-modernes qui en font les navires
civils les plus chers à la tonne.
sommaire
Le galvanomètre à
miroir Kelvin


Le galvanomètre à miroir est breveté en 1858
par Thomson, c'est un instrument pour lire les courants de signal
faible sur de très longs câbles télégraphiques
sous-marins . Cet instrument était beaucoup plus sensible
que tous les précédents, permettant la détection
du moindre défaut dans l'âme d'un câble lors
de sa fabrication et de sa submersion.


Gravure galvanométre Kelvin, modèle Chauvin-Arnould,
Modèle H von Helmotz
Thomson a décidé qu'il avait
besoin d'un instrument extrêmement sensible après
avoir participé à l'échec de la tentative
de pose d'un câble télégraphique transatlantique
en 1857. Il a travaillé sur l'appareil en attendant une
nouvelle expédition le l'année suivante.
Il a d'abord cherché à améliorer un galvanomètre
utilisé par Hermann von Helmholtz pour mesurer
la vitesse des signaux nerveux en 1849.
Le galvanomètre de Helmholtz avait un miroir fixé
à l'aiguille en mouvement, qui était utilisé
pour projeter un faisceau de lumière sur le paroi opposée,
amplifiant ainsi considérablement le signal.
Thomson entendait rendre cela plus sensible en réduisant
la masse des pièces mobiles, mais dans un éclair
d'inspiration tout en regardant la lumière réfléchie
par son monocle suspendu autour de son cou, il se rendit compte
qu'il pouvait se passer de l'aiguille et son montage dans son
ensemble. Il a plutôt utilisé un petit morceau de
verre miroir avec un petit morceau d'acier magnétisé
collé au dos.
Celui-ci était suspendu par un fil dans le champ magnétique
de la bobine de détection fixe. Pressé d'essayer
l'idée,
Thomson a d'abord utilisé un poil de son chien, mais a
ensuite utilisé un fil de soie de la robe de sa nièce
Agnès.
 Galvanomètre par HW Sullivan, Londres. Fin du 19e ou
début du 20e siècle.
Galvanomètre par HW Sullivan, Londres. Fin du 19e ou
début du 20e siècle.
Ce galvanomètre a été utilisé à
la station de câble transatlantique, Halifax, NS, Canada
|
sommaire
|
Le câble télégraphique
transatlantique : suite
Pour la France, la voie de communication entre Londres et
New–York présentait un point faible : c’était
la ligne aérienne de Terre-Neuve.
Cette ligne établie dans une région presque déserte
était sujette à de nombreuses interruptions à
cause des tempêtes qui règnent dans cette région
surtout en hiver. Les réparations y étaient difficiles
par suite du manque de communications. C’est pour remédier
à cette situation que la « New-Newfoundland-London
C » décida de poser un câble sous-marin de
Plaisance à Saint-Pierre, d’une part, de Saint-Pierre
à Nord-Sydney, d’autre part. Deux vapeurs, dont
le Chiltern, opérèrent la pose.
Le 30 Août 1867 le premier câble venant de
Plaisance était amené à l’Anse à
Dinan où cet événement avait attiré
une foule de curieux.
C’était la première fois que Saint-Pierre
se trouvait en communication télégraphique avec
la France.
Le Journal Officiel de l’époque relate cet événement
mémorable avec force détails. Puis on procéda
à la pose de la section Anse à Dinan–Sydney.
Le bureau du câble se trouvait à l’emplacement
de la maison de Mme Cazier, près de la route du Cap à
l’Aigle. Les deux câbles étaient joints au
bureau part deux lignes aériennes. A cause de la difficulté
du creusage, on se contente de soutenir les poteaux par des
amas de pierres amoncelées à leur pied. On peut
encore voir quelques-uns de ces tas de pierres.
Le succès du câble transatlantique fit abandonner
un grandiose projet de liaison Europe–Amérique.
L’idée était d’établir une ligne
aérienne le long du Pacifique jusqu’en Alaska, de
traverser le détroit de Behring par un câble et
de continuer par une ligne aérienne traversant toute
la Sibérie.
Deux expéditions avaient déjà commencé
l’érection de deux lignes aériennes et le
vapeur Egmont était rendu sur les lieux, prêt à
poser la section de câble. Quand on apprit le succès
des deux câbles transatlantiques, le projet fut abandonné
et le vapeur revint avec son câble encore à bord.
En 1868 fut fondée la « Compagnie du câble
transatlantique français ».
En 1869, le Great Eastern partit de Brest le 15
Juillet et arriva à Saint-Pierre le 23 Juillet, ayant
posé le premier câble Brest–Saint-Pierre.
Le câble atterrissait à l’Anse à Pierre
où l’on avait construit une maison qui existe encore
aujourd’hui.
C’était la première liaison directe
avec la France et elle fut inaugurée par un message
à l’adresse de l’Empereur. Trois vapeurs :
le Cory, le Scandinavia et le Chiltern posèrent la section
Saint-Pierre–Duxbury (Cap Cod) près de Boston.
"En ce jour de juillet 1869, ce n’est pas vers
le quai que se dirige la foule. Elle escalade les collines et
se répand sur le petit sentier qui mène à
l’anse à Pierre. C’est là, en effet,
que le Great Eastern posera une des extrémités
du câble transatlantique qui, de Brest à Saint-Pierre,
reliera l’Europe à l’Amérique. Des photos
sont prises. Malheureusement, la journée est brumeuse,
les clichés ne sont pas bons. Et c’est dommage car
nous aurions une image exacte de la société saint-pierraise
de ce temps. Le lendemain, l’empereur Naopléon III
et le Président des États-Unis échangent
les premiers messages télégraphiques officiels
entre les deux continents."
Au début les communications se faisaient directement
de l’Anse à Pierre. Mais on travaillait à
la pose de quatre câbles souterrains pour relier l’Anse
à Pierre au bureau de la ville. C’étaient
des câbles non armés, logés par paires dans
deux canalisations en fonte.
Le tracé des câbles, battu par les allées
et venues des travailleurs, fut adopté comme route de
l’Anse à Pierre, au lieu du sentier précédemment
utilisé et qui partait de la caserne, passait à
l’ouest de la vallée des Sept Etangs pour aboutir
derrière l’ Etang de l’Anse à Pierre.
Le 28 Août, les manipulations se firent à partir
de la ville. La Compagnie des Câbles avait acheté
l’immeuble inachevé du notaire, Mr Salomon, la partie
en pierres du bureau actuel de la Western–Union.
En 1872, la « New–York–Newfoundland–London
C° » acheta le terrain avoisinant et construisit un
immeuble en bois qui constitue aujourd’hui la partie en
bois du bureau de la Western Union. Ils y transférèrent
leur bureau. La proximité des deux bureaux facilitait
l’échange des télégrammes d’une
compagnie à l’autre.
La même année, elle doublait ses câbles en
posant un câble de Plaisance à l’Anse à
Dinan et un autre de l’Anse à Ravenel à Sydney.
Deux souterrains constitués par deux câbles non
armés dans une conduite en bois furent posés entre
l’Anse à Dinan et le nouveau bureau. Cette conduite
passait dans l’étang qui en a tiré son nom
d’ Etang du Télégraphe.
Entre Ravenel et le bureau, on plaça deux câbles
armés du type du câble de 1867. Ces câbles
partant du bureau montaient à l’emplacement actuel
de la T.S.F., descendaient à l’abattoir, puis gagnaient
la vallée de Ravenel en longeant le bas du cimetière.
Cette même année, la société
du Câble Transatlantique Français avait
projeté la pose de deux nouveaux câbles : un câble
de gros type allant de Brest à Halifax et un autre de
petit type d’Halifax à New–York. Les câbles
étaient embarqués et les navires prêts à
partir quand arriva l’ordre de surseoir à la pose.
En effet, à cette époque, les deux câbles
transatlantiques de 1865 et 1866 laissaient à désirer
; des fautes s’y étaient déclarées
qui gênaient les communications. D’autre part, l’accord
n’était pas parfait entre, l’Atlantic Cable
C° et l’Anglo–American. Cette dernière
compagnie entra en pourparlers avec la société
du Câble Transatlantique Français.
Au début de 1873, on arriva à une entente : le
projet primitif était abandonné. Au lieu de la
ligne Brest–Halifax–New–York, on revint à
la ligne Valentia–Heart’s Content–Sydney.
Le câble de petit type permit de poser deux câbles
entre Terre-Neuve et Sydney. Ils sont connus sous les noms de
Southern et Northern. Ce dernier passait par la Baie et en 1917,
on le coupa et on l’amena à l’Anse à
Pierre. Le Southern passe à quelques milles au Sud de
St Pierre.
Le câble de gros type permit cette année 1873 la
pose d’un câble entre Valentia et Heart’s Content.
Le parcours étant plus court que celui de Brest–Halifax,
il restait une grande longueur de câble. La Compagnie
fit fabriquer une longueur supplémentaire et en 1874,
elle posait un deuxième câble entre Valentia et
Heart’s Content.
A cette époque, deux compagnies de câbles travaillaient
dans l’immeuble actuel de la Western Union.
L’Anglo-American, occupant la partie en pierres, exploitait
les câbles Brest–Saint-Pierre et Saint-Pierre Duxbury.
A l’origine les signaux étaient reçus au
miroir. C’était un galvanomètre muni d’un
petit miroir. La lumière d’une lampe était
réfléchie et, suivant ses mouvements, se déplaçait
sur le mur. Un déplacement dans un sens correspondait
à un point et un mouvement dans le sens contraire à
un trait de l’alphabet morse. Un opérateur suivait
ces déplacements et épelait les lettres des mots
transmis, qu’un deuxième opérateur écrivait
sous sa dictée.
Dans la suite, Lord Kelvin inventa le « recorder »
qui enregistrait les signaux sur un bande de papier que l’on
interprétait ensuite, interprétation souvent délicate
et qui demandait une longue formation. Ceux qui ont jadis travaillé
au Câble Français en savent quelque chose.
La deuxième compagnie, La New–York–Newfoundland–London
C°, avait son bureau dans l’immeuble en bois qui est
aujourd’hui la salle des accumulateurs de la Western Union.
Elle exploitait deux câbles de Saint-Pierre à Nord–Sydney.
Ces câbles étant relativement courts, les courants
qu’ils laissaient passer étaient assez forts pour
permettre de travailler le morse ordinaire. Lorsque l’Anglo-American
absorba la deuxième compagnie, les deux bureaux furent
d’abord maintenus et gardèrent leur nom propre :
bureau du câble et bureau du morse avec leurs employés
propres : employés du câble et employés
du morse.
sommaire
En 1866, le câble de Brest fut abandonné
et le bureau de morse fut transféré au bureau
du câble dans la salle d’opération actuelle.
En 1870, suite à
une requête du gouvernement britannique, un câble
sous-marin reliant Londres à Bombay est installé
avec le câblier Great Eastern.
Dès les années 1870, des systèmes de transmission
duplex et quadruplex (multiplexage) ont été mis
en place pour pouvoir transmettre simultanément plusieurs
messages sur chaque câble.
En 1878 se fonda une nouvelle compagnie de câbles
: La Compagnie Française du Télégraphe
de Paris à New–York, communément connue sous
le nom de P.Q. (du nom du fondateur, Pouyer-Quartier) ou simplement
de Télégraphe Français.
En 1879 L’année suivante, la compagnie posait
un câble de Brest à Saint-Pierre avec atterrissage
à l’Anse à Ravenel et deux câbles pour
relier Saint-Pierre au Continent Américain : l’un
allant à Canso et l’autre à Cap Cod. Le bureau,
d’abord situé Rue Nielly, fut ensuite transféré
au Quai de la Roncière. Les souterrains étaient
constitués par quatre câbles armés.
Le câble de Canso se terminait dans le bureau de la Compagnie
Mackay–Bennet souvent connue sous le nom de « Commerciale
».
Deux opérateurs furent détachés de Saint-Pierre
à Canso et quand le câble fut abandonné,
il furent embauchés par la compagnie Mackay-Bennet.

Le New York Times a rapporté l'atterrissage du câble
le 17 novembre 1879
|
THE NEW OCEAN CABLE IN PLACE
THE FINAL SPLICE MADE—A CONGRATULATORY DISPATCH TO
FRANCE.
NORTH EASTHAM, Mass., Nov 17, 1879. The steamer Faraday
returned at 7:30 A.M. Sunday, and anchored a mile off
the beach. George Van Chauvin [actually von Chauvin],
cable engineer, boarded the steamer, followed soon after
by President Bates and vice-president Thomas Swinyard,
who went on board to welcome Capt. Trott, of the Faraday,
and L. Loeffler, the agent of Siemens Brothers. The work
was immediately commenced on the shore end of the cables
and at 6 P.M. it was on the beach and laid through a trench
dug to receive it, and signals exchanged with the Faraday
from a temporary building on the beach. The shore end
being landed, the officers connected with the cable company
and the American Union Telegraph Company, with M. P. Magno,
Inspector of French telegraph lines, and Count von Hoff,
went on board of the steamer, and she proceeded to the
spot where the cable is buoyed, about 10 miles off shore.
To-day the final splice was made, and the cable was worked
throughout the entire circuit from Cape Cod to Brest.
About 1,000 people visited the beach yesterday from adjoining
towns, many of whom went on board the Faraday.
The first dispatch over the new cable to Brest, from
this station, was the following:
NANSET BEACON LIGHT, CAPE COD.
NORTH EASTHAM, Mass., Nov. 17, 1879.
To President of Compagnie Francaise du Telegraph de
Paris et New-York:
It gives me unbounded pleasure to send to you, through
your own cable, this moment completed, the warmest congratulations
of my company upon an achievement in respect of which,
both as regards rapid construction and the laying, as
well as perfect insulation, there is no parallel in cable
history, it being only just seven months from this very
day, the 17th of November, since the concession to your
company was granted by the French Government. Messrs.
Siemens Brothers, Mr. Loeffler, Capt. Trott, and Mr. George
Von Chauvin, your worthy representatives in this country,
deserve the highest praise for the energetic and able
part each has taken in this great enterprise, through
the success and instrumentality of which, it is devoutly
hoped, that national friendship and commercial intercourse
between our two Republics, as well as between the Old
and New Worlds generally, will be still further strengthened
and advanced.
D.H. BATES
President American Union Telegraph Company.
The steamer Faraday arrived back from making the final
splice at 3:30 P. M. The entire party soon after assembled
on the beach, where mutual congratulations were exchanged.
All the business having been finished, a final departure
from the beach took place, and, at a few minutes before
6 o'clock, the party started from North Eastham Station,
by special train, for Boston. Previous to starting, Cable
Director Brugiere and Engineer Von Chauvin telegraphed
their thanks, on behalf of the French Cable Company, to
Secretary Evarts for the liberal action of the American
Government, by means of which the cable was landed under
very favorable circumstances.
BOSTON, Nov. 17. The officers of the new French Cable
Company and the American Union Telegraph Company, who
assisted at the landing of the cable at North Eastham
arrived here at 9:45 P. M., and left here in a later train
for New-York
|
sommaire
En 1880, l’Anglo-American avait en projet la pose
d’un troisième câble transatlantique (1PZ)
entre Valentia et Heart’s Content, puis un quatrième
(2PZ) pour 1882. Elle se trouverait ainsi avoir à Terre-Neuve
quatre câbles transatlantiques et seulement deux câbles
pour les joindre au continent
américain : le Northern et le Southern (1873).
Ces câbles ne touchaient pas Saint-Pierre. Des deux câbles
de la New–York–Newfoundland–London C°, celui
de 1867 était abandonné et celui de 1872 était
en bien mauvais état. Il fut décidé de
poser deux câbles à deux âmes, l’un
de Plaisance à Saint-Pierre et l’autre de Saint-Pierre
à Sydney. Mais on s’aperçut qu’un câble
à trois âmes coûterait moins cher et c’est
à cette solution qu’on se rallia et en 1880 on posa
le « tricore » ou câble à trois âmes,
avec atterrissage à l’Anse à Pierre. Les
souterrains de l’Anse à Pierre en ville furent constitués
par deux câbles du même type mais non armés.
Ils étaient disposés dans une conduite en fonte
rappelant le canon d’un fusil à deux coups.
En 1882, l’Angleterre détiendra
près des deux tiers des câbles du monde.
À partir de 1897, un troisième
câble français de l'Atlantique, le premier câble
direct de la France aux États-Unis, a été
fabriqué et posé par La
Société Industrielle des Téléphones
entre Deolen (Brest) et Orléans en utilisant
le CS François Arago de la société
comme navire de tête, ensemble avec les navires britanniques
affrétés CS Dacia et CS Silvertown.
Avec 3 173 milles marins
pour 4600 tonnes, le Direct était
le plus long câble à travée unique posé
jusqu'à cette époque.


Exemple de mallette pour le câble Brest-Cape Cod 1897-98
Image courtoisie et copyright 2008 François de Nerville
 Le bâtiment de la gare vers 1905.
Le bâtiment de la gare vers 1905.



En 1911, la Compagnie américaine Western Union
conclut un accord avec l’Anglo–American.
Par cet accord, la compagnie anglaise abandonnait à la
Western Union l’exploitation de ses câbles contre
l’assurance d’un dividende fixe versé à
ses actionnaires. C'est ainsi que l’Anglo–American
fit place à la Western–Union .
En même temps s’opéraient des progrès
techniques.

En 1916, les vieilles piles au bichromate et celles
au sulfate de cuivre furent remplacées par des accumulateurs
au plomb. Un groupe électrogène fut monté
pour les charger, puis un deuxième en 1920.
En 1917 1,2 million de mots par semaine c’est ce
que permettaient de transférer les 21 câbles reliant
l’Angleterre et la France, année des premiers services
téléphoniques publics transatlantiques. Avec des
coûts prohibitifs, très peu y avaient accès.
En 1918, le câble appelé
« Northern », posé en 1873 entre Heart’s
Content et Sydney, fut coupé dans la Baie et les deux
bouts amenés à l’Anse à Pierre.
sommaire
En 1920, on posait un nouveau câble entre Saint-Pierre
et Plaisance. Pour ce câble on avait utilisé les
trente premiers milles du vieux câble
de Brest de 1869. On l’avait continué jusqu’à
Plaisance par des sections récupérées au
cours des campagnes précédentes. Pour relier ces
nouveaux câbles au bureau on posa un souterrain de sept
conducteurs enfermés dans un tube de plomb.
Une révolution se produisait dans le travail des câbles.
Jusqu’à ce moment, les télégrammes
étaient transmis sur une section de câble et retransmis
sur une autre section, ce qui nécessitait deux opérateurs.
Entre Londres et New York il y avait plusieurs sections de câbles
ce qui nécessitait de nombreuses retransmissions de câbles
nécessitant l’emploi d’un grand nombre d’opérateurs
et entraînant un grand retard et de nombreuses erreurs.
Le nouveau plan était de remplacer le relais humain par
un relais mécanique, ce qui supprimait les retards et
permettait une communication presque instantanée entre
Londres et New–York. Mais à cause des déformations
des signaux dans les diverses sections, on était obligé
de restreindre le plus possible le nombre de relais. On décida
donc de créer une ligne directe Londres–New-York
ne comportant que trois relais, l’un à Penzance
(Angleterre), l’autre à Bay Roberts (Terre-Neuve)
et le troisième à Saint-Pierre.
Pour cela il fallait un câble Saint-Pierre–New-York.
Le câble de Duxbury n’étant guère utilisé,
on décida de le couper au large de Canso et de le jonctionner
à un autre câble qui allait de Canso à Hamel
près de New–York.
Le nouveau câble ainsi obtenu fut connu sous le nom de
câble « Saint-Pierre–Hamel ».
De nouveaux progrès vinrent bientôt changer la
situation du tout au tout. On avait imaginé des relais
qui régénéraient les signaux en supprimant
toutes les déformations dues à la ligne. Ceci
permettait d’augmenter le nombre des relais sur une ligne
sans amener de distorsions.
Le but à poursuivre désormais était d’augmenter
la vitesse des câbles en coupant en sections plus courtes.
Dans ce but, en 1922, on décida de créer
une nouvelle station à Canso. Le câble Saint-Pierre–Hamel
fut de nouveau coupé et les deux bouts amenés
à Canso. La station n’ouvrit qu’au printemps
1923.
En 1927, courber la trajectoire de la lumière
par réfraction a permis la création de nombreuses
inventions telles que la fibroscopie, ou encore les fontaines
lumineuses. Le premier usage de la réfraction avec de
longues fibres de verre est le fait de Baird et Hansell. Les
premières utilisations opérationnelles de la fibre
optique remontent aux années 1950 et concernent le domaine
médical, avec le fibroscope.
En 1928, il y avait 21 câbles télégraphiques
transatlantiques entre l’Europe et le Canada ou les États-Unis.
Ces câbles sous-marins ont conservé
un monopole sur les télécommunications transatlantiques
jusqu’à l’invention et le développement
des premières liaisons télégraphiques transocéaniques
par onde radio (TSF) au début du XXe siècle (première
démonstration par Guglielmo Marconi en 1901).
En 1929, le tremblement de terre n’affecta pas les
câbles de la Western Union passant à Saint-Pierre,
mais le câble de Cap Cod de la Compagnie Française
fut coupé et sérieusement endommagé.
Quelques mois plus tard celui de Brest était aussi interrompu.
La Compagnie n’ayant pas les fonds nécessaires pour
la réparation de ses câbles décida de fermer
son bureau en 1932.
Pendant ce temps, la technique des câbles évoluait
rapidement. La Western Union posait de nouveaux câbles
dont la vitesse était considérablement augmentée
par l’adjonction d’un ruban de ferro–nickel enroulé
en spirale sur l’âme en cuivre du câble. Ces
nouveaux câbles permirent, aux
essais, une vitesse de 3200 lettres par minute.
En 1930, on avait préparé les plans pour
la pose de deux câbles de ce genre entre Sydney et Terre-Neuve
en passant par Saint-Pierre.
La vitesse des anciens câbles fut aussi augmentée
par l’emploi d’amplificateurs à lampes.
D’autre part, le vieux code des câbles était
abandonné et remplacé par un système à
cinq impulsions par lettre, genre Baudot.
Avec ce système, le télégramme s’imprimait
en caractères d’imprimerie sur une bande de papier.
Pendant la dernière guerre, la station de Saint-Pierre
joua un rôle important en relayant une grande partie des
communications entre l’Amérique et l’Angleterre.
Pour mieux assurer ces communications deux nouveaux câbles
souterrains de sept conducteurs chacun furent placés
en 1944 entre l’Anse à Pierre et le Bureau en remplacement
des anciens souterrains devenus défectueux.
Aujourd’hui, la Western Union reste la seule compagnie
de câbles à Saint-Pierre, où elle exploite
dix câbles : cinq venant de Terre-Neuve, quatre de North-Sydney
et un de Canso. Huit de ces câbles sont munis d’amplificateurs
à lampes.
La raison d’être de la station de Saint-Pierre est
de servir de relais pour les circuits Europe–Amérique.
Mathurin Le Hors
Nota : texte intégral retranscrit par Georges Le Hors
d’après un document dactylographié par l’Auteur
qui, après avoir assuré pendant de nombreuses
années la maintenance de l’ensemble des installations
de la station de Saint-Pierre, a terminé sa carrière
au poste de Directeur.
Bien que non daté, la description des lieux permet de
situer sa rédaction aux années 1950/1951 lors
de sa prise de retraite.
Certains barbarismes peuvent s’expliquer par la traduction
d’un texte d’abord écrit en anglais.

|
sommaire
Les câbles sous-marins transatlantiques français
Depuis le succès des frères Brett sur
le Calais – Douvres de 1851, l’administration française
reconnaît que l’industrie des câbles sous-marins
est 100% anglaise, et a donc recours aux divers fournisseurs britanniques
(y compris Siemens & Halske) pour des liaisons locales avec nos
îles (la Corse d’abord) et avec l’Algérie.
Beaucoup d’échecs, la longueur cumulée du réseau
sous-marin gouvernemental français n’est que de 320 km
en 1866. [à noter le Pirou (Coutances) – Jersey en 1859
et le Anse du Verger – Chausey en 1865].
 Erlanger
Erlanger  Reuter
Reuter
La France décèle également vite les liens existant
entre le développement de la télégraphie sous-marine
et la constitution d'un empire colonial.
En effet, après celui qui traverse la Manche, le premier câble
commandé par le gouvernement français est un câble
vers l'Algérie en 1861.
C'est dans ce même esprit deconquêtes coloniales que l'Angleterre
esquisse en 1859 un projet vers la Mer rouge.
C’est en 1868, qu’apparaît
à Paris dans notre récit un personnage pittoresque:
le banquier francfortois Frédéric Émile Erlanger:
il s’associe avec Julius Reuter (le fondateur de l’agence
anglaise de presse et d’informations financières Reuters
qui existe toujours) dont il est le courtier et il obtient le 6 juillet
1868 de Napoléon III, auprès de qui il a ses entrées,
une concession de 20 ans pour la pose et l’exploitation d’un
câble entre la France et les USA via St-Pierre au profit de
la Société du Câble Télégraphique
Français (la SCTF,
qu’il a créée avec son associé):
Comment est-ce possible ? Pour ce qui concerne Reuter, jusqu’en
1851 (date de création de la ligne télégraphique
Bruxelles / Aix-la-Chapelle), son agence de presse doit avoir recours
à 200 pigeons voyageurs pour acheminer les messages entre ces
deux sites. En 1863, il est installé à Londres: des
bateaux venant des États-Unis jettent des bidons contenant
les dépêches au large de Cork, les bidons sont récupérés
et les informations télégraphiées de Cork à
Londres où elles arrivent avant les navires. Il n’est
donc pas étonnant que Reuter trouve intéressant de faire
des affaires avec un banquier qui propose d’établir une
ligne directe entre Paris et New-York Friedrich Emil Erlanger (1832-1911),
est le fils aîné du comte Raphael von Erlanger (1806-1878),
banquier et homme politique installé à Francfort.
Dès 1848, Emile est associé dans la banque de son père.
En 1853, le gouvernement d’Othon Ier de Grèce le le recrute
comme consul général et agent financier sur la place
de Paris. Il négocie alors pour d’autres cours royales
divers emprunts: la reine Marie II de Portugal lui octroie en remerciement
le titre de baron. Lors d’un voyage en Égypte, il croise
Ferdinand de Lesseps et lui offre de l’aider à trouver
des financements pour le canal de Suez. Le 30 juin 1858, il épouse
Florence Louise Odette Lafitte (1840–1931), la petite-fille du
célèbre banquier français Jacques Laffitte. En
1859, il prend officiellement la tête de la banque Erlanger
à Paris, puis fait franciser son nom, se faisant appeler «
Frédéric Émile Baron d’Erlanger ».
Il est considéré comme l’inventeur des emprunts
à haut-risque sur les pays en voie de développement
(autrement dit, « junk bonds« ), qui vont se multiplier
sur les places européennes jusqu’au scandale des emprunts
russes. Parmi eux, des emprunts pour le Bey tunisien (auquel il vend
par ailleurs pour 1 million de Francs une centaine de canons défectueux)
et surtout sur le coton américain: Erlanger réussit
par cet emprunt à créer durant les deux dernières
années de la guerre de sécession une véritable
monnaie indexée sur le coton qui permet aux sudistes d’acheter
des bateaux, des approvisionnements et des armes, pour lutter contre
le blocus (« blockade runners« ) imposé par les
nordistes. En prétendant que ces bons seront remboursés
à valeur faciale même si le Sud perd la guerre il fait
une fortune en ruinant les naifs qui l’ont cru.
sommaire
En 1861 pour la pose du câble d'Algérie,
l'administration français achète spécialement
le Deux-Décembre, un vieux vapeur anglais qu'il faut
transformer. Elle transforme de même, en 1874, la Charente.
En 1963 Le premier service des câbles
sous-marins est créé à Toulon,
Une usine de fabrication fut construite sur un terrain militaire adossé
aux remparts du Mourillon aujourd'hui disparu, à peu
près à la hauteur de l'actuel stade Mayol. Modeste,
55 mètres de long sur 22 mètres de large, elle abritait
une câbleuse de petit modèle, mue à la vapeur
et capable de fabriquer des câbles de faible longueur destinés
aux liaisons côtières ou aux réparations des câbles
de grand fond déjà en service avec l'Algérie.
Deux entrepôts installés, l'un à Brest, l'autre
au Havre, permettaient de stocker les câbles de réserve.
Par contre, les tentatives de pose de liaisons directes vers la
Corse et l'Afrique du Nord ne sont pas à la hauteur des espérances
du pouvoir politique de l'Empire.
En France, l'hostilité de la Chambre à la politique
coloniale par d'abord par le refus de voter les crédits télégraphiques.
Le lien existant entre l'utilisation des câbles sous-marins
et l'extension de l'empire colonial constitue donc à la fois
un frein et un moteur au développement de la télégraphie
sous-marine en France.
Cependant l'administration du télégraphe, alors puissante
(elle dépend jusqu'en 1876 du ministère de l'Intérieur)
et assurée de l'aide efficace de l'armée et de la marine
s'oppose aux parlementaires.
La collaboration entre l'Etat et les compagnies privées de
télégraphie sous-marine s'intensifie. Une usine d'état
est créée à La Seyne sur Mer.
Domination britannique des premiers câbles
Des années 1850 à 1911, les systèmes
de câbles sous-marins britanniques dominent le marché
le plus important, l' océan Atlantique Nord .
Les Britanniques avaient à la fois des avantages du côté
de l'offre et de la demande. En termes d'approvisionnement, la Grande-Bretagne
avait des entrepreneurs disposés à investir d'énormes
quantités de capitaux nécessaires pour construire, poser
et entretenir ces câbles.
En termes de demande, le vaste empire colonial britannique a conduit
à des affaires pour les câblodistributeurs d'agences
de presse, de sociétés de commerce et de transport maritime
et du gouvernement britannique.
De nombreuses colonies britanniques comptaient d'importantes populations
de colons européens, ce qui rendait les informations à
leur sujet intéressantes pour le grand public du pays d'origine.
Les responsables britanniques pensaient que dépendre des lignes
télégraphiques qui traversaient un territoire non britannique
posait un risque pour la sécurité, car les lignes doivent
être coupées et les messages doivent être interrompus
pendant la guerre. Ils cherchaient à créer un réseau
mondial au sein de l'empire, connu sous le nom de All Red Line , et,
à l'inverse, préparaient des stratégies pour
interrompre rapidement les communications ennemies.
En 1865 et 1866, deux nouveaux câbles
télégraphiques transatlantiques sont posés
par le Great Eastern.
sommaire
Avec l’expérience du câble de 1858,
un câble amélioré fut conçu sous la responsabilité
de Samuel Canning. Le noyau consistait en sept brins torsadés
de cuivre très pur pesant 300 livres par mille marin (73 kg/km),
enduits d’un composé de Chatterton, puis recouverts de
trois couches de gutta-percha, alternant avec trois couches minces
d’un composé cimentant l'ensemble et portant le poids
de l'isolant à 400 lb/mille marin (98 kg/km). Le noyau était
recouvert de chanvre saturé d’une solution de conservateur
; sur le chanvre étaient enroulés en spirale dix brins
de fils d'acier à haute résistance produits par Webster
& Horsfall Ltd de Hay Mills (Birmingham), chacun recouvert de
fins filaments de manille imprégnés de conservateur.
Le poids du nouveau câble était de 35,75 quintaux (4
000 lb) par mille marin (980 kg/km), soit près du double du
poids de l'ancien câble.
L’usine de Hay Mills a réussi à fabriquer en 1865
30 000 milles (48 000 km) de fils métalliques (1 600 tonnes)
fabriqués par 250 travailleurs en onze mois.
Le navire câblier Great Eastern, le plus long du monde à
cette époque (211 m), avait la capacité d'emporter toute
la longueur de câble nécessaire ; il réalisa seul
la pose de deux nouveaux câbles transatlantiques durant les
années 1865 et 1866.
Le câblier était commandé à l'époque
par le capitaine Sir James Anderson. Le navire disposait de trois
espaces de stockage en cale pour les câbles, le stockage s'effectuant
sur de grosses bobines. Ce câblier pouvait transporter une longueur
de câble de 2 300 milles nautiques (4 300 km).
À minuit le 15 juin 1865, le Great Eastern
quitta l'estuaire de la Tamise en Angleterre pour rejoindre l’Île
de Valentia là où se trouvait la connexion avec le câble
télégraphique reliant l'Irlande à l'Angleterre.
Le 31 juillet après avoir posé 1 062 milles (1 968 km)
de câble, ce dernier s’est rompu.
Le Great Eastern rentra en Angleterre, puis se vit confier deux nouvelles
missions par l'Anglo-American Telegraph Company.
La première était la pose d'un nouveau câble entre
l’Angleterre et le Canada (Heart's Content à Terre-Neuve),
la seconde étant de terminer la pose inachevée du câble
de 1865. Le Great Eastern fut modifié pour améliorer
les équipements du pont qui manipulaient le câble.
Le 13 juillet 1866, il débuta la pose d'un nouveau câble.
Malgré une météo difficile et peu de visibilité,
le navire mena à bien sa mission durant la journée du
27 juillet 1866, en atteignant le port de Heart's Content à
Terre-Neuve (Canada). Le matin suivant à 9 heures un message
extrait de l'édito du Times en provenance d’Angleterre
arriva au navire : « C'est un grand travail, une gloire pour
notre nation ainsi que pour les Hommes qui ont rendu cela possible
». La connexion avec la terre fut effectuée dans la journée.
Il s'ensuivit le 29 juillet un échange de télégrammes
entre la Reine Victoria et le président des États-Unis
Andrew Johnson.
Le 9 août 1866, le Great Eastern reprend la
mer avec pour mission de retrouver le câble perdu en juillet
1865, puis de poursuivre sa mise en place jusqu'à Terre-Neuve.
Retrouver un câble perdu au milieu d'un océan s’apparente
à chercher une aiguille dans une botte de foin. Robert Halpin,
capitaine du câblier durant cette mission, retrouva la zone
où le câble avait cassé. Pendant plusieurs jours
le navire ratissa lentement le fond marin à l'aide d'un grappin
relié au navire. Le câble fut une première fois
ramené jusqu'à la surface avant de malheureusement se
décrocher du grappin et repartir au fond. Quatre jours plus
tard le câble fut une nouvelle fois accroché, l’opération
de levage aura duré 26 heures avant de voir le câble
sécurisé à bord du navire. Après que l’intégrité
du câble eut été contrôlée par des
électriciens, l'ancien câble fut connecté au câble
présent dans la cale du câblier. Le navire reprit sa
route en déroulant le câble vers le Canada. Heart's Content,
petit village Canadien situé à Terre-Neuve, fut atteint
le samedi 7 septembre 1866.
Le Great Eastern avait mené sa mission à bien ; il y
avait maintenant deux lignes transatlantiques de télégraphe
opérationnelles.
sommaire
Le câble « français »
de 1869
La concession de 1868 impose à la SCTF
que son câble ne touche que la France et les USA. Le tracé
sera donc Brest (Le Minou) / St-Pierre / Duxbury
(Massachusets).
En 1869, la société du câble
transatlantique français SCTF
avec le navire britannique SS Great Eastern pose un câble
reliant la France au lieu-dit Petit Minou commune de Plouzané
à environ 10 km à l'ouest de Brest et aux États-Unis
à Duxbury sur la presqu'île du Cap Cod via Saint-Pierre-et-Miquelon
au large de Terre-Neuve.
Le constructeur est anglais bien sûr (TelCon)
le poseur aussi (Great Eastern + 4 navires acompagnateurs) mais, plus
surprenant, le financement également (60% souscrits à
la bourse de Londres en moins de 8 jours) et le siège social
est établi à Londres. Tout va très vite, mais
une semaine avant la fin de pose prévue le 23/07/1869, on n’a
toujours pas le droit d’atterrissement sur la côte américaine.
Grâce à des pressions de Cyrus Field, le Président
américain Ulysse S. Grant donne son feu vert mais il exige
une réciprocité de droit d’atterrissement en France
pour les projets américains, ce qui fait tomber la clause d’exclusivité
que la SCTF prétendait
obtenir.
Par ailleurs, le gouvernement du Massachusets – dont plusieurs
élus ont laissé des plumes dans l’emprunt coton
d’Erlanger – fait obstacle à la remise de la «
landing license« , ce qui oblige Erlanger à activer ses
réseaux et, via l’entrepreneur new-yorkais James Scrymser,
il graisse la patte à deux représentants du New Jersey
($ 10 000) et obtient du Gouverneur le droit d’atterrissement
sur la côte de cet Etat (ce qui aurait été très
avantageux car bien plus près de New-York). Du coup, l’autorisation
d’atterrir à Duxbury tombe du ciel immédiatement.
Ces nouveaux frais, augmentés des ponts d’or attribués
aux ingénieurs anglais et à Sir James Anderson, le commandant
du Great Eastern, font exploser le budget. Le complément de
financement n’est souscrit que par entités anglaises déjà
actionnaires de l’Anglo.
Dès la mise en service,le concurrent Anglo-American divise
ses tarifs par quatre, SCTF ne
peut pas suivre et signe en janvier 1870 un accord d’intégration
dans le pool transatlantique anglais, Reuter leur revend ses parts
et ce câble soit-disant français est racheté en
1873 par l’Anglo.
Suite à la mise hors service en 1872 du câble de 1866,
John Pender fait poser en 1873 et 1874 deux nouveaux câbles
Valentia / Hearts Content. En réaction, une nouvelle tentative
de concurrencer l’Anglo est initiée par les anglais Siemens
Brothers: ils posent le « direct US » avec leur propre
câblier le Faraday, premier du nom le Faraday, 1er navire
câblier spécialisé, pose en 1874 le Direct US
States Cy cable (Siemens Bro)


Le direct US n’est pas plus direct que les autres: pour «
bypasser » le Canada il aurait fallu plus de 3 000 nm de câble
et, avec les techniques disponibles, la vitesse de tranmission aurait
été trop basse. Le direct US touche donc Tor Bay (Nouvelle
Ecosse) car l’Anglo a l’exclusivité des atterrissements
à Terre-Neuve. Derechef, dès la mise en service du direct
US, l’Anglo lance une guerre des tarifs, met la Direct US States
Cy en difficultés financières et l’intègre
dès 1875 dans le système du globe telegraph trust cy.
Compte tenu de la mise hors service en 1877 du câble de 1865,
et de la pose en 1880 d’encore un câble Valentia / Hearts
Content, ce seront donc en 1880 pas moins de 5 câbles transatlantiques
en exploitation opérationnelle que contrôle Pender il
mérite bien désormais son titre de « the cable
king« !
Où en sommes-nous côté France, maintenant ?
La guerre de 1870 et la chute de l’empire, suivies de la commune
sont bien sûr des traumatismes mais, dès 1873, le territoire
est libéré (sauf l’Alsace et la Lorraine), les
indemnités dues aux allemands sont payées plus vite
que prévu (nous allons en reparler) et l’économie
repart de plus belle en croissance jusqu’à l’exposition
universelle de 1878, elle-même suivie de la crise financière
de 1880-1882.
Les grands investissements d’infrastructures comme les chemins
de fer se multiplient en France dans les années 1870 et les
entrepreneurs industriels et leurs banques, bien que de sensibilité
royaliste ou bonapartiste, semblent très bien s’accommoder
du nouveau régime républicain.
En 1877, le réseau mondial de câbles sous-marins totalise
118 500 km dont 103 000 km anglais, 1 250 km français 750 km
allemands, 400 km italiens et aucun câble international américain.
sommaire
Depuis que le câble ex-« français » de 1869
est passé sous pavillon britannique, plusieurs voix s’élèvent
en France dans la sphère publique comme dans la sphère
privée pour considérer comme inadmissible que nos communications
diplomatiques et commerciales avec l’Amérique du Nord
soient tributaires de l’étranger.
Mais une seule de ces voix va passer à l’acte: il s’agit
d’Augustin-Thomas Pouyer-Quertier, un industriel normand
qui a fait une brillante carrière politique, est sénateur
et ex-ministre des finances de Thiers lors de la négociation
du traité de Francfort avec Bismark en 1871. « PQ
», comme on l’appelle, fonde la Cie Fse du Télégraphe
de Paris à New-York en 1879 et va réaliser le premier
câble transatlantique vraiment français. C'est un personnage
hors du commun :
Pouyer-Quertier est une force de
la nature, commerçant rusé, industriel audacieux,
orateur redoutable, bon vivant (et même très au-delà).
Augustin-Thomas Pouyer-Quertier (« PQ ») né
en 1820, cet industriel normand du textile est formé au
petit séminaire d’Yvetot et au collège royal
de Rouen – il n’est pas polytechnicien, contrairement
à ce que disent certaines biographies – il se forme
sur l’industrie textile en Angleterre et en Allemagne et
installe une filature à Fleury sur Andelle, député
de la Seine-Inférieure en 1857, il combat les accords commerciaux
de libre-échange avec les anglais qui causent une grave
crise cotonnière: il est un ardent protectionniste, anti-monopoles,
dès 1845 il est ami avec Comte Louis Alexis Léon
de Valon et la Vicomtesse Appolonie de La Rochelambert (liée
aux Hohenzollern) c’ est un invité habituel du chateau
de Rosay dans l’Eure (le 1er departement industriel de France),
il devient légitimiste, marie à grands frais ses
2 filles aux fils des familles Lambertye et de La Rochelambert,
il rachète en 1859 l’usine La Foudre au Petit-Quevilly
et obtient le vote d’une loi sur les chemins de fer d’intérêt
local il est ministre des finances de Thiers dès le 25/02/1871
il négocie le traité de Francfort avec Bismarck
il participe avec les Valon à la tentative de restauration
du Comte de Chambord « Henri V » en 1873 il est élu
sénateur de la Seine-Inférieure en 1876 il décline
en 1877 la proposition de Mac Mahon de former un gouvernement
après Gambetta il est président en 1879 de la Cie
Fse du Télégraphe de Paris à New-York qu’il
vient de créer sa société de filature passe
en S.A. en 1883, signe de sérieuses difficultés
financières il est éjecté de la présidence
de la CFTPN en 1887 ,en1891, il décède en laissant
4 millions de dettes Négociations avec Bismarck du traité
de 1871. |
PQ

|
PQ nommé par Thiers ministre
des finances est envoyé à Berlin pour négocier,
d’abord accompagné de Jules Favre ministre
des affaires étrangères, puis seul : en effet, on
a vu que pour marier ses filles jumelles dans la noblesse PQ est
devenu très proche d’Appolonie de la Rochelambert
dont les amitiés de jeunesse avec la famille royale de
Prusse ne peuvent que donner confiance à Bismarck.
PQ embarque avec Favre à Berlin comme secrétaire
particulier Bertrand de Valon fils d’Appolonie. Bismarck
fait de la surenchère au début et refuse brutalement
toute concession. PQ obtient une entrevue avec l’empereur
Guillaume Ier et la suite des négociations se passe mieux
et même étonnamment bien. PQ a fini par bien plaire
à Bismarck, par sa brutalité oratoire dissimulant
une rouerie bien normande, son caractère bon-vivant, seul
capable de lui résister et même le battre dans des
concours de beuveries.
 Bismarck
Bismarck 
Lettres et notes intimes, 1870-1871, recueillies par A.
de Mazade .
1 - Sur l’évacuation du territoire.
C’était, disait Pouyer-Quertier, à l’Hôtel
de France, à Berlin; j’étais couché;
vers 5 heures du matin, bruit de bottes et cliquetis d’armes
dans les couloirs. Je me redresse et j’écoute. On
frappe fortement à la porte — Entrez— Bismarck
parait, en grande tenue de cuirassier blanc— Vous ! Prince
? à cette heure ? — Oui, moa ! J’ai passé
la nuit près de mon Empereur pour traiter nos grandes affaires.
— Eh bien ? — Eh bien ! bonne nouvelle, et j’ai
voulu être le premier à vous l’annoncer: L’Empereur
accepte toutes vos conditions. __ Je n’attendais pas moins
de vos influences. __ J’ai dit simplement : L’Empereur
etc. __ Eh bien, Prince, veuillez passer dans mon petit salon;
je me lève pour télégraphier à mon
Gouvernement. — Vous pouvez vous lever devant moi; j’ai
été soldat, J’endosse une robe de chambre.
— Et maintenant, dit Bismarck, avant tout, rédigeons
nos conventions. Sur une méchante table, à la lueur
d’une bougie, Bismarck en grande tenue, moi en costume de
nuit, nous rédigeons en double: « Demain, à
midi, les troupes prussiennes auront évacué le territoire
Français etc. « __ Quand partez-vous, Monsieur le
Ministre ? __ Mais demain, Prince. __ Eh bien puisque nous voilà
bons amis, je veux que tout le monde le sache: je vous accompagnerai
au départ. A propos, combien vous a coûté
votre voyage à Berlin ? — Mille francs. — Vous
vous trompez; les chemins de fer allemands coûtent bien
moins que les chemins de fer français ! Au départ.
Bismarck et moi causions sur le quai de la gare de Berlin,. —
Salignac dis-je au colonel Salignac-Fénélon qui
m’accompagnait, voulez-vous aller régler le retour
? Salignac revient. — Monsieur le Ministre, nous avons payé
l’aller et le retour. — Vous voyez bien, dit Bismarck,
que nos chemins de fer coûtent moins que les vôtres
! Trois fois, en route, aux buffets, déjeuners et diners
plantureux, parfaitement servis; et quand Salignac se présente
pour payer, toujours cette réponse: C’est pour Monsieur
le Ministre plénipotentiaire français. C’est
compris dans l’aller et le retour ! Nous finissons par nous
apercevoir que les serviteurs du Prince et sa cave nous suivent
depuis Berlin. Et je rédige cette dépêche:
« Dans ces conditions, les chemins de fer allemands coûtent
moins que les chemins de fer français ».
2 - Sur le paiement de l’indemnité de guerre.
M. Thiers m’envoie en Allemagne, en me disant de m’adjoindre,
si je veux, Jules Favre; Jules Favre et moi: nous nous donnons
rendez-vous à Pantin. J’y arrive assez facilement.
Mais Jules Favre, au sortir de Paris, est reconnu par les fédérés
qui veulent le jeter à la Seine; il leur échappe
et se fait escorter jusqu’à Pantin par un escadron
prussien. A Berlin, Bismarck nous invite tous les deux. Il offre
un cigare à Jules Favre. — Merci ! Je ne fume pas.
Puis dans une énorme chope, il lui offre un mélange
de bière, d’eau-de vie, etc. mis en ébullition
fervente par un tisonnier rouge. – Prince ! Je ne bois pas
!! – Si vous ne buvez ni ne fumez, eh bien, allez-vous coucher
! Jules Favre part en effet. Au nom de la Patrie, j’avale
d’un trait l’affreux breuvage, à la satisfaction
du Prince, qui dit à Guillaume: « Il ne faut rien
lui refuser ».
3 - Sur la délimitation du territoire
Je refusais d’accepter la délimitation proposée
par Bismarck, parce que, pour arriver à Belfort qui nous
restait, il fallait passer par une langue de terre étroite
comme une large rue, entre deux longues frontières prussiennes.
— Après tout, Prince, dis-je au bout d’une grande
discussion, je ne veux pas que mes enfants soient Prussiens, et
ils le deviennent par votre délimitation qui met chez vous
les propriétés de mon gendre,.. — Ah ! Question
de gentilhommerie entre nous ! Où commencent les propriétés
de votre gendre ? dit Bismarck en appuyant un crayon sur la carte.
Il promène son crayon sur les points que j’indique
et si violemment qu’il le casse. — Enfin ! dit-il, il
en a donc bien grand, des propriétés, votre gendre
? Et il cède. J’ai conservé la carte et le
crayon. En fait, mon gendre, M. de Lambertye n’était
pas encore mon gendre, mais devait le devenir et l’est devenu.
J’ai eu le bonheur de conserver ainsi à la France
cinq ou six mille habitants et des mines importantes. |
sommaire

sommaire
Au bout de quatre ans, l'entreprise fut absorbée par l'Anglo-American
Telegraph Company.

 1870 "Les câbles
éléctriques sous marins (pdf)" Hédouin
1870 "Les câbles
éléctriques sous marins (pdf)" Hédouin
1869 "Manuel
Pratique de Télégraphie sous-marine (pdf)"
Ternant.
On peut lire en détail la conception et la pose des câbles
sous-marins de cette époque.
La Marine Impériale prêta un navire câblier
construit en Angleterre en 1862 sous le nom d' « Electric
Pacha » puis rebaptisé « Dix Décembre
» et enfin « Ampère » en 1870. Navire
aux moyens limités, il posa néanmoins, après
maintes péripéties, le câble Oran-Carthage en
1864.
 Câblier Ampère.
Câblier Ampère.
En 1870, à la demande du gouvernement britannique, Bombay est
relié à Londres par un câble sous-marin posé
par le Great Eastern, opération combinée de quatre
compagnies de câbles.
En 1870, La Société
du Câble Transatlantique Français, SCTF
pose un câble reliant la France depuis Brignogan (29890)
en Bretagne à Salcombe en Grande-Bretagne. Le câble
fonctionnera jusqu'en 1900.
sommaire
En juin 1871, la Grande-Bretagne est reliée à Hong Kong
et, un an plus tard, à l'Australie.
En 1873 Un second navire, La Charente,
est affecté au service des câbles sous-marins en 1874
et basé à Toulon. L'Ampère (ex Dix décembre)
rejoint la base du Havre. Il a été construit en Angleterre
en 1862 et aménagé en câblier par la Compagnie
des Forges et Chantiers de la Seyne sur Mer.
Mis en service en 1874, il posa et répara de nombreux câbles
tant en Méditerranée que dans l'Atlantique et fut déclassé
en 1931, après 69 ans de service.
 Câblier La Charente 1874
Câblier La Charente 1874
Ces navires étaient armés par un équipage militaire,
les travaux dirigés par un ingénieur des Télégraphes.
Cette situation dura jusqu'en 1885 ; les équipages militaires
retirés, l'administration dut s'occuper du recrutement et de
la formation de son personnel. Les besoins de communications rapides
devenant de plus en plus impérieux, l'industrialisation accélérée
de la France, le développement des relations commerciales internationales
rendaient indispensable un changement des structures. Dans cette perspective,
un décret du 27 février 1878 avait réalisé
la fusion des services postaux et télégraphiques sous
l'autorité du ministère des Finances .
En 1877, les réseaux télégraphiques britanniques
ont une longueur de 103 068 km sur les 118 507 km du réseau
mondial. 43 câbles atterrissent en France.
Des câbles transatlantiques supplémentaires
ont ensuite été posés entre Foilhommerum (île
de Valentia, Irlande) et Heart's Content (Terre-Neuve) en 1873, 1874,
1880 et 1894 ; d'autres ont été posés entre les
États-Unis (Duxbury dans le Comté de Plymouth et Cap
Cod) et la France (Brest-Déolen), le Portugal ou la Belgique.À
la fin du XIXe siècle, des câbles britanniques, français,
allemands et américains reliaient l'Europe et l'Amérique
du Nord et constituaient un réseau sophistiqué de communications
télégraphiques.
Dans les années 1870, des systèmes de transmission duplex
et quadruplex (multiplexage) ont été mis en place pour
pouvoir transmettre simultanément plusieurs messages sur chaque
câble.
En 1874 Le câblier Faraday, est
construit comme le premier navire conçu spécifiquement
pour la pose de câbles.
sommaire
La nouvelle concurrence américaine et
ses conséquences sur la « PQ Cable » :
Les américains débarquent : Jay Gould All America Cables
1881, J.W. Mackay et J.G.Bennett Jr Commercial Cable Cy 1883
Jusqu’à présent les américains sont absents
du marché des câbles télégraphiques –
ils ont développé un ensemble considérable de
réseaux terrestres désservant la plupart des centres
importants de l’immense pays. Western Union
en contrôle l’essentiel et se connecte à l’Anglo
American pour les échanges de trafic avec l’Europe.
Un concurrent de la WU est L’American
Union Telegraph Cy qui est le partenaire choisi par la PQ pour
s’interconnecter avec les territoires US.
Les nouveaux intervenants sur l’atlantique sont:
1 - Jason « Jay » Gould, (1836, Roxbury N.Y. –
1892, NYK city) qui a fait fortune dans les tanneries et le commerce
du cuir, puis dans les Chemins de fer: il prend le contrôle
de WU puis en 1881 rachète les droits et actifs de l’American
Union, enfin il crée All America Cables et contracte avec Siemens
Brothers pour 2 cables en service en 1882;
2 - John William Mackay (1831, Dublin – 1902), ouvrier
de chantier naval à New-York, puis matelot en 1851sur un clipper
pour rejoindre via le cap Horn la ruée vers l’or (mais
il y arrive trop tard), on le retrouve à Virginia City où,
après des coups de bourse chanceux, il fait fortune dans les
mines d’argent. Puis il s’installe à Paris en 1876
et continue de fructueuses affaires qui lui permettent de racheter
en 1883 la Postal Telegraph (dernière
concurrente sérieuse de la WU); à cette occasion, il
se lie d’amitié avec James Gordon Bennett Jnr (qui a épousé
la fille Reuter et a fondé le International Herald Tribune),
ils créent ensemble la CCC (Commercial Cable Cy) et contractent
aussi avec Siemens Bro pour deux autres
nouveaux câbles en 1883 et 1884.
Inutile de dire que, si cette nouvelle concurrence d’origine
américaine pose de sérieux problèmes à
l’Anglo-American, elle s’avère totalement catastrophique
pour la PQ, dont la situation est fragile à bien des points
de vue, en particulier financier; en effet, la PQ a eu « le
flair » de choisir comme banque l’Union Générale
qui disparaît dans le crach boursier français de 1882.
Ces épreuves amplifient la zizanie évoquée plus
haut et provoquent un véritable éclatement du Conseil
et de la Direction de la Société, le ministère
des P&T intervenant de plus à contre-temps. Une partie
de l’équipe PQ souhaite avec le Comte Dillon profiter
de la situation pour s’allier aux américains contre les
anglais et l’autre partie (Pouyer-Quertier, Collignon,..) licencient
Dillon et veulent continuer à négocier les tarifs et
quotas dans le cadre du pool de l’Anglo.
Finalement c’est le clan Dillon, supporté par la CCC,
Siemens et le ministère qui l’emporte : Dillon revient
en force dans la société, Pouyer-Quertier est «
démissionné » de la présidence et les accords
avec l’Anglo sont dénoncés.
Notons au passage que le Comte Dillon est à partir de 1886
un important support du Général Boulanger et que, convaincu
d’avoir utilisé les ressources de la Société
pour financer le mouvement boulangiste, il devra démissionner
de la PQ en juillet 1888. L’Anglo poursuit la PQ devant les tribunaux
français: une longue procédure s’en suit à
partir de 1887 avec l’intervention de ténors du barreau:
l’avocat de la PQ n’est autre que Waldeck Rousseau (qui
a été déjà 2 fois ministre) et l’avocat
de l’Anglo est maître Barboux (de l’Académie
française), qui défend aussi de Lesseps dans l’affaire
de Panama.
Le nouveau président de la PQ Cable Cy est l’ex-Capitaine
de Frégate Brueyre-Dellorier qui négocie une nouvelle
convention d’échange de trafic avec la Commercial mais,
avec ce changement d’alliances, PQ n’est plus que le bureau
français de la CCC.
La guerre des tarifs entre anglais et américains s’arrête
en 1888, mais le niveau atteint de 1Sh. ou 1,25F par mot ne permet
plus à PQ d’équilibrer son compte d’exploitation.
Pire, l’interruption du câble de PQ pendant plusieurs mois
en 1894 fait encore plonger les recettes.
La PQ couverte de dettes est déclarée en faillite en
décembre 1895 [Pouyer-Quertier est mort le 2/4/1891, lui aussi
criblé de dettes] Pendant ce temps-là, une autre entité
française la Sté Fse des Télégraphes
Sous-Marins à laquelle participe la Société
Générale des Téléphones (réseau
nationalisé en France) a déployé et exploite
un réseau de câbles sous-marins dans les Antilles et
un magnifique projet de câble Brest/Lisbonne/Açores/Haïti
soutenu par le gouvernement français est bloqué en 1892
par la chute de ce même gouvernement et le changement de ministre
des P&T.
Les avoirs de la PQ et de la SFTSM sont fusionnés
dans une nouvelle société: la Compagnie
Française des Câbles Télégraphiques,
CFCT créée en début
1896 et présidée par le Contre-Amiral Jules Caubet.
sommaire
1877 l'année ou le téléphone de Bell commence
à être exploité, faisons le point (Supplément
au Numéro 29 (vol. III) du Journal télégraphique).
EXTRAIT DU TABLEAU DES CABLES TELEGRAPHIQUES
SOUS-MARINS.
Pour chaque câble ou section de câble
la Nomenclature fait connaître les points d'atterrissement,
l'époque de la pose, le nombre des fils conducteurs, la longueur
en milles nautiques du câble et du développement des
conducteurs qui le composent et, enfin, au moyen d'une des quatre
lettres A, B, C et D, la nature du service applicable.
Sous la lettre A, comme le fait connaître l'explication des
signes placée en tête du tableau, nous comprenons tous
les câbles exploités par une des Administrations contractantes
ou par une Compagnie ayant officiellement accédé à
la Convention et, pour qui, par conséquent, le régime
conventionnel est obligatoire.
Les lettres B, C et D sont réservées aux exploitations
privées on gouverne-, mentales restées indépendantes
de la Convention.
De ces Offices, les uns admettent, en fait, toutes les dispositions
du Règlement international, leurs câbles sont désignés
par la lettre B ; les autres les acceptent également comme
règle générale, mais avec quelques dérogations
de détail, à leurs lignes s'applique la lettre C; enfin,
les câbles indiqués sous la lettre D sont ceux des exploitations
qui suivent un régime spécial, sensiblement différent
de celui de la Convention.
Regardons la fin de l'inventaire des administrations gouvernementales
: la France a 26 câbles sous marins pour 673 milles.


Détail des câblesdu réseau de l'état,
en direction des différents pays ou îles Françaises.

Dans l'autre sens en provenance de Grande Bretagne il y avait 24 câbles
de compagnies privées.

Dans cet état des lieux en 1877 on y trouvera aussi les
câbles :
Du Réseau international. de St-Sébastien à Ondarraizu
(France) en 1875.
De Direct àpanish Telegraph Company entre
Barcelone et Marseille en 1874.
De Det Store Nordiske Telegraph Selskab (Great-NortheriiTelegraph
Company) de Fano (Danemark) à Calais (France) en 1873.
Du Réseau occidental de Malte de Marseille (France) à
Bone (Algérie) en 1870.
Du Réseau Eastern Extension Australasiaand China Telegraph
Cyde de Singapore à Saigon (Cochinchine française) 1871.
Du Réseau Anglo-Anierican Telegraph Company du Minou près
Brest (France) à St-Pierre (îles St-Pierre Miquelon)
1869.
Du Réseau Anglo-Anierican Telegraph Company de Salcombe (Angleterre)
à Brignogan (France) 1870.
De Central .American Telegraph Company de Demerara(Guyane anglaise)
à Cayenne (Guyane française) 1875 et de Cayenne à
Para (Brésil) 1875
Tableau pour les compagnies privées dans le monde

sommaire
En Angleterre et en France, Bell
enchaîne les démonstrations et fait parler la presse
scientifique, il ètablit
la première liaison téléphonique intercontinentale
(36 Km) entre Douvres et Calais sur un seul fil (télégraphique)
et retour par la terre.
Dans l'univers illustré page 754 du
1 décembre 1877, nous lisons dans "la
France" que le téléphone vient de fonctionner
entre la France et l'Angleterre. Deux cornets acoustiques aimantés
ont élé placés la semaine dernière a Saint-Margaret,
sur la côle anglaise, près de Douvres, et a Sangatte,
près de Calais, puis reliés entre eux par un fil métallique.
Des conversations ont été échangées ainsi
à travers le détroit, les résultats obtenus ont
paru très satisfaisants aux inspecteurs des lignes de Douvres
et de Calais.
Les téléphones qui ont servis à cet événement
sont aujourd'hui chez un collectionneur
Australien 
En 1878, le gouvernement décide de créer un secrétariat
d'Etat aux Postes et Télégraphes, rattaché au
ministère des Finances.
Celui-ci définit une politique de câbles sous-marins
pour la Méditerranée et sur l'Atlantique Nord. Au secteur
public, le réseau des îles côtières, les
liaisons franco-anglaises et les câbles de la Méditerranée
; au secteur privé, dans le cadre d'une convention avec l'Etat,
les réseaux de l'océan Atlantique.
Les premiers câbles directs Antibes - Saint
Florent (1878) et Marseille - Alger (1879) permettent
de sécuriser les liaisons posées respectivement en 1866
et 1871.
En 1879, un nouveau câble français
est posé. Son propriétaire était La
Compagnie Française du Télégraphe de Paris à
New York, qui a passé un contrat avec la société
anglaise Siemens Brothers pour
fabriquer et poser le câble.
La commande a été passée en mars 1879 et Siemens
a commencé à la poser en juin, en utilisant son câblier
Faraday , construit en 1874 comme le premier navire conçu
spécifiquement pour la pose de câbles.
Le câble s'étendait sur 2 242 milles marins à
travers l'Atlantique de Deolen (environ 17 km à l'ouest de
Brest) à Saint-Pierre et 827 milles marins de là à
Cape Cod, Massachusetts, atterrissant à une station construite
sur mesure près du phare de Nauset Light Beach à North
Eastham. qui a été utilisé pendant les douze
années suivantes.
 Le
Direct Brest France à Orléans MA 3174 Miles
Le
Direct Brest France à Orléans MA 3174 Miles
Cette station, lorsqu'elle était en service, était le
terminus américain d'un câble télégraphique
qui arrivait directement à Orléans depuis la France.
Il s'appelait "Le Direct" le câble direct. Il a été
installé en 1898 et mesurait près de 3200 miles de long.
(En 1929 Le câble est trop endommagé par un séisme
et ne sera pas réparé.)
En 1880, la compagnie française du télégraphe
de Paris à New York pose le câble reliant la France (station
de Brest-Déolen) à Porthcurno en Grande-Bretagne. Le
câble est coupé en 1940 puis réparé en
1947. La ligne est fermée en 1962 en même temps que la
station de Brest-Déolen où il atterrit.
En 1881 Deux usines privées sont construites
à Calais par la société industrielle des Téléphones
et à Saint-Tropez par la société A. Grammont.
Elles se partageront le marché.
Pendant 80 ans, l'usine de La Seyne fabrique ou rénove les
câbles usagés relevés au cours des réparations
entreprises sur le réseau gouvernemental.


Les différents câbles transatlantiques.
 1883
1883
Carte des pôles montrant les câbles
sous-marins et, en rouge, les principales lignes télégraphiques,
1883
En 1891, le premier câble téléphonique
sous-marin entre Sangatte et St-Margaret est posé par le câblier
Monarch : il s'agit d'une liaison simple voie inaugurée
le 19 mars par le ministre Jules Roche et son homologue britannique,
M. Raikes.
 Orleans Cable Station under construction in 1891
Orleans Cable Station under construction in 1891
La gare de North Eastham était quelque peu isolée et
difficile d'accès en hiver, c'est pourquoi en 1891 une nouvelle
gare fut construite à Orléans, près du quartier
commercial de la ville. Un câble de l'ancienne station de Nauset
a été posé à travers Nauset Marsh jusqu'au
pied de Town Cove à Orléans, puis jusqu'à la
nouvelle maison de la station de câble. L'entretien de la grande
et ancienne gare uniquement comme point de connexion s'est avéré
trop coûteux et, par conséquent, la maison de la gare
de Nauset a été vendue en 1893. En même temps,
une petite cabane qui mesurait environ dix pieds sur quinze a été
construite près de l'ancienne station comme point de connexion
pour le câble. Cette cabane fait actuellement partie de la structure
connue sous le nom de French Cable Hut.
Le 1er juillet 1891, la Chambre des députés
se penche sur la politique française de télégraphie
par câbles sous-marins.
Plus généralement, faut-il confier la construction d’un
réseau public, en l’occurrence celui des télécommunications
nationales au secteur privé ou au service public ? L’avenir
de l’usine à câble de La Seyne-sur-mer est posé
pendant la longue séance parlementaire qui se déroule
ce jour là.
Entre 1871 et 1887, la longueur du réseau français
passe de 1.000 Km à 12.000 Km, 6.000 Km de câbles achetés
en Angleterre pour la PQ et 6.000 Km de câbles gouvernementaux
fabriqués en partie à La Seyne. Le secteur public n’a
pas failli, un câble Toulon – Ajaccio a été
fabriqué à La Seyne et posé par la Charente au
début de 1891.
Par contre, la PQ est en difficulté puisque son président
fondateur est mis en minorité et écarté par son
conseil d’administration en 1891. La PQ doit répondre
devant les tribunaux de sa nouvelle attitude vis-à-vis des
compagnies transatlantiques, qui l’accusent de rupture de contrat.
Elle
se dirige vers une faillite.
Il était évidemment nécessaire
de s'affranchir en partie de la tutelle britannique.
D'autre part, l'explosion des besoins favorisait
la création d'une industrie purement française. L'usine
fut conçue en raison de deux objectifs :
- assurer la fabrication d'une grande partie de nos câbles côtiers
et de grand fond ;
- créer un marché de référence permettant
d'agir sur les prix proposés par les anglais ou l'industrie
française : Société Industrielle des Téléphones,
installée à Calais ou la Société Grammont
dont la création était projetée.
Aucune extension n'étant possible à Toulon par manque
de terrains appropriés, le choix se porta sur la Seyne sur
Mer, où la partie marécageuse, encore vierge, de
la place des Esplageolles à l'enceinte de BrégailIon,
réunissait les conditions souhaitées.
Les travaux furent rondement menés grâce à la
collaboration active de toutes les administrations intéressées,
en particulier de la municipalité de la Seyne.
Cartes des câbles, publiées par le
Bureau télégraphique international de Berne en 1897,
montrent le tracé du câble de 1879 de Brest à
Saint-Pierre et Miquelon, continuant jusqu'à Cape Cod.

Ces cartes de 1897 montrent le tracé du câble de 1879

sommaire

Section de câble télégraphique sous-marin Rattier-Menier
1895
En 1898, la compagnie française des câbles télégraphiques
(CFCT) pose un câble reliant
la France (station de Brest-Déolen) aux États-Unis (Orleans
sur la presqu'île de Cap Cod) sans passer par Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le câble est surnommé le « Direct », il est
long de 6 000 km. Il sera coupé en 1940, rétabli en
1952 et fermé en 1959.
En décembre 1899, après avoir
expérimenté avec succès l'appareil entre Marseille
et Alger, un vœu est adopté pour développer l'usage
de l'appareil Baudot sur les câbles sous-marins d'Algérie.
Evolution des réseaux de câbles sous-marin


sommaire
Réseaux
de télécommunications Anglaises

sommaire
En 1901, l’Anglo-American exploite 6 câbles
transatl. la CFCT exploite 2 câbles
transatl. la WU (All Americas) exploite
2 câbles transatl. la Commercial CC
exploite 5 câbles transatl. la Deutsche
Atl Tel exploite 2 câbles transatl.
Après la domination anglaise totale de 1866 à 1879,
seule l’arrivée des entreprises américaines en
1881-1884 a donc réussi à imposer un minimum de concurrence
réelle.
En 1902 et 1903, premier câble télégraphique
transpacifique, reliant les États-Unis à Hawaï,
à Guam et aux Philippines en 1903. Pose d'une liaison Canada,
Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji.
En 1905, l'administration des Postes, Télégraphe
et Téléphone (PTT) pose un câble reliant la France
(Brest-Petit Minou) à Dakar-Yoff (Sénégal).
Il est posé en quatre expéditions par le câblier
François Arago. Il permet de communiquer avec l'Afrique
de l'Ouest et l'Amérique du Sud via Dakar-Yoff. Sa gestion
est confiée à la Compagnie française des câbles
sud-américains (SUDAM). Il est coupé en 1940, rétabli
et dérouté sur la station de Brest-Déolen en
1945. Il est fermé en 1961.
 Câblier François Arago de 1882-1914
Câblier François Arago de 1882-1914
En 1905, Marseille est reliée à
l'Afrique du Nord par 5 câbles sur Alger, Oran et Bizerte. Marseille
est reliée à Dakar via Oran, Tanger, Cadix et les Canaries.
Les navires se succèdent : l'Ampère 2 remplace la Charente
en 1930 puis la darse accueille l'Emile Baudot, l'Arago, l'Alsace
et le d'Arsonval.
La conduite des navires est confiée à
des états-majors et des équipages de la Marine marchande
et la conduite des réparations et des poses à des fonctionnaires
de l'administration.
La France peut être considérée,
loin derrière l'Angleterre, comme la seconde puissance mondiale
en matière de câbles sous-marins. Elle possè 18
% du kilométrage mondial (la Grande-Bretagne 53 %). La particularité
française est l'importance relative de son p.arc de lignes
administratives, le poids de la seule société privée
française de câbles sous-marins (qui assure la liaison
transatlantique) restant faible.
La mise au point des câbles sous-marins améliore de manière
foudroyante les relations télégraphiques. La croissance
du réseau est continue jusqu'au moment où se manifeste
la concurrence de la radio.
Depuis, le rôle des câbles télégraphiques
n'a cessé de diminuer (notamment en ce qui concerne le colume
de trafic effectué plus que la longueur du réseau lui-même).
Les câbles cependant continuèrent d'être utilisés.
Ils présentent en effet, par rapport la TSF, de multiples avantages
: exploitation plus régulière, moins entachée
d'erreurs, délais de transmission précis, faibles dépenses
d'exploitation. Les réparations sont pourtant longues et coûteuses
et l'exploitation d'un prix de revient élevé pour de
longues distances .
 Navire
Câblier Edouard Jeramec construit en 1913 pour
la CFCT . Navire
Câblier Edouard Jeramec construit en 1913 pour
la CFCT .
La CFCT va réaliser en 1897 – 1898 le plus long câble
sous-marin jamais construit à cette époque: le Direct
Déolen/Cape Cod, 6 000 km.
C’est enfin un câble de technologie française, car
il existe désormais trois usines de fabrication de câbles
sous-marins en France : La-Seyne/mer (1881, administration française),
Calais (1891, SIT filiale de SGT) et St-Tropez (1892, A. Grammont).
La pose échoue en 1897 mais réussit en 1898. Ce retard,
cumulé avec la catastrophe de 1902, l’éruption
de la Montagne Pelée provoque de sérieuses difficultés
financières à la CFCT et une nouvelle intervention de
l’état avec un nouveau montage financier est nécessaire.
En Martinique : le réseau antillais de la CFCT est dévasté,
le câblier Pouyer-Quertier sauve 1855 vies. C’est sous
la direction d’Edouard Jeramec (ex-administrateur de la Cie des
Chemins de Fer du Nord), nommé président de CFCT en
1903, que la CFCT se rétablit progressivement et retrouve en
10 ans une profitabilité normale qui lui permet en 1913 de
lancer un nouveau navire câblier qui prend le nom du président,
comme au temps de Pouyer-Quertier.
sommaire

câbles télégraphiques transatlantiques en 1912
: atterrissements nord-européens

câbles télégraphiques transatlantiques en 1912
: atterrissements nord-américains Nous n’avons considéré
que les trajets sur l’atlantique nord.
 Câblier Arago 1914-1950
Câblier Arago 1914-1950
En 1917, 21 câbles transatlantiques franco-anglais en
service permettent théoriquement d'acheminer 1,2 million de
mots par semaine dans les deux sens.
En 1928, il y avait 21 câbles télégraphiques
transatlantiques entre l’Europe et le Canada ou les États-Unis
En 1929, 12 câbles transatlantiques sont rompus au sud
de Terre-Neuve à la suite du séisme de 1929 aux Grands
Bancs le 18 novembre et du glissement de terrain sous-marin généré.
 Câblier Ampère 2 1930-1944
Câblier Ampère 2 1930-1944
sommaire
En 1943 : les premiers répéteurs
immergés (adaptés à des profondeurs de 200 brasses)
sont placés en mer d'Irlande entre Anglesey et l'île
de Man et permettent un développement considérable des
câbles coaxiaux sous-marins reliant le Royaume-Uni avec l'Allemagne
, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark. Une fois ces projets expérimentaux
réalisés avec succès, il est alors possible de
commencer un projet transatlantique plus ambitieux.
Après 1945, pendant que les navires
Alsace, d'Arsonval et Emile Baudot remettent en état le réseau
télégraphique, le personnel de l'usine de Toulon est
très impliqué dans la définition des premiers
répéteurs téléphoniques et les expérimentations
de l'administration et de l'industriel français (CIT et Câbles
de Lyon). Les deux premières liaisons téléphoniques
expérimentales sont réalisées entre Toulon et
Ajaccio en 1946 et entre Cannes et Nice en 1950. L'usine cesse la
production de câbles télégraphiques dans les années
50 car la nouvelle technologie des câbles téléphoniques
assure la relève et conduit à l'abandon des réseaux
télégraphiques en 1962.
En 1950, première liaison téléphonique
sous-marine entre Key West (Floride, États-Unis) et La Havane
(Cuba). Sa capacité est de 24 circuits et chacun des deux câbles
contient quatre répéteurs
En 1953 : le Postmaster General annonce que
l'accord pour le premier câble téléphonique transatlantique
est signé (le 1er décembre). Une des premières
difficultés rencontrées est le choix d'un itinéraire
pour les 2 câbles nécessaires, comme le plus court, et
peut-être le meilleur, est déjà occupé
par des câbles télégraphiques.
Fin 1953, des sites adaptés à la pose de câbles
sont choisis à Terre-Neuve et en Écosse. L'ensemble
du câble transatlantique est posé par le câblier
‘’Monarch‘’, construit pour le bureau des
postes en 1945. Il est le seul capable d’installer les 3 000
km de câble qui doivent être déposés en
une seule pièce à travers la partie la plus profonde
de l'Atlantique. Lors de la pose des répéteurs rigides,
il est nécessaire pour un navire câblier de s'arrêter
à chaque fois.
En 1955, mise au point définitive des amplificateurs
répéteurs immergés permettant des liaisons téléphoniques
modulées à très grande distance.
En 1955 : les premières longueurs de câble sont
fabriquées et en mars le câblier, équipé
de nouveaux engins de pose, entreprend des essais au large de Gibraltar.
Peu après, il commence à travailler sur la pose du premier
câble transatlantique, d'ouest en est.
A la fin de juin 1955 le '’Monarch'’ pose le câble
de Clarenville.
Après un nouvel approvisionnement, il y revient en évitant
les icebergs de l'Atlantique nord, pose le câble à travers
l'Atlantique jusqu’à Rockall Bank. Le voyage se déroule
sans incident, en dehors de violentes tempêtes près de
Rockall. Dans l'intervalle le câblier 'Iris' pose les câbles
écossais.
Le '’Monarch'’ rechargé en câble, retourne
à Rockall Bank afin de poser les 1 000 derniers kilomètres
vers Oban où la jonction finale est effectuée le 26
septembre 1956 . TAT 1 est terminé trois mois avant la
date prévue.
Mise en service de TAT1,
premier câble transatlantique téléphonique
à technologie coaxiale et à modulation de courant
et de fréquences.
|
La communication télégraphique
est relativement facile car elle est établie dès
la détection des impulsions électriques à
l’autre extrémité et quelles que soient la
distorsion de ces impulsions et les variations de leur amplitude
avec le temps.
Par contre, l’intelligibilité de la parole téléphonique
nécessite un traitement des signaux judicieux et dépend
de la précision avec laquelle sont reproduites les variations
de l’amplitude et de la fréquence des sons. Même
si, les plans de réalisation de cette liaison ont été
arrêtés dès 1953, le premier câble
téléphonique sous-marin transatlantique le TAT
1 (Transatlantique 1), a été inauguré
le 25 Septembre 1956,
Il a été salué comme le départ de
l'ère moderne de la communication globale.
Le câble a été conçu pour relier
les États-Unis et le Canada au Royaume-Uni, avec des
possibilités pour que des circuits puissent être
loués à d'autres pays d'Europe occidentale.


Installation du câble Transatlantique téléphonique
TAT1, Oban, Scotland, 1955.
Le câble fournissait 30 circuits téléphoniques
vers les États-Unis et six vers le Canada. La plupart
étaient pour les communications avec le Royaume-Uni,
le reste était relié par Londres pour donner un
accès direct à l'Europe.
Entrepris par les prédécesseurs
de BT, le Département d’Ingénierie de la
British Post Office, avec l'American Telegraph and Telephone
Company, les laboratoires de la Bell Telephone et la Canadian
Overseas Telecommunications Corporation (Société
canadienne des télécommunications d’outre-mer),
le projet de £ 12,500,000 a demandé trois ans pour
le parachever.
Pendant ce temps, le système a été étudié,
fabriqué et installé, ce qui a nécessité
le développement de nouvelles techniques pour placer
le câble dans les eaux profondes.
Les liaisons télégraphiques entre le Royaume-Uni
et les Etats-Unis existaient depuis le milieu du siècle
dernier, mais il a fallu attendre 1927 pour voir le premier
service de radiotéléphonie commerciale entre les
deux pays. Initialement 2.000 appels par an étaient faites
à travers
l'Atlantique, mais le coût était prohibitif - en
1928, le taux de base pour les appels vers New York était
de 9 £ pour trois minutes.
C’est seulement avec le développement de nouveaux
équipements, tels que les câbles coaxiaux avec
l'isolation au polyéthylène, et les répéteurs
immergés à large bande et l’équipement
de la fréquence porteuse, que la téléphonie
transatlantique par câble a pu être réalisée.
Ces nouvelles technologies ont été développées
juste avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Un point
essentiel pour la Post office a été le développement
de répéteurs sous-marins qui étaient suffisamment
robustes et fiables pour les zones autour de la côte et
l'Europe continentale.
 Construction
des répéteurs
Construction
des répéteurs

Hommes tirant le premier segment
à terre à Clarenville, Newfoundland, Canada, 1955.
Mis à part le court atterrissement, l'ensemble du câble
téléphonique transatlantique a été
posée par le navire câblier de la Post Office Monarch.
Il était le seul navire à être capable de
réaliser les 1500 miles nautiques de câble qui
devait être posés d’une seule pièce
dans la partie la plus
profonde de l'Atlantique, entre Oban en Ecosse et Clarenville,
Terre-Neuve. Le câble ensuite a traversé le détroit
de Cabot à Sydney Mines, en Nouvelle-Écosse.
Lors de la cérémonie inaugurale à Lancaster
House à Londres le 25 Septembre 1956, le service a été
ouvert par le ministre des Postes, qui a parlé au Président
de AT & T à New York, et au ministre des Transports
du Canada.

Carte de l’itinéraire du câble
d’Oban à Clarenville et diagramme topographique
du fond de l’océan.
Au cours de sa première année de
service, le TAT1 a effectué deux fois plus d'appels que
les circuits de radio n’en avaient réalisé
en un an environ 220 000 appels entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, et 75 000 entre la Grande-Bretagne et Canada - générant
2 millions de livres à se partager entre les trois pays.
En 1956, le premier câble téléphonique transatlantique
a été considéré comme une réussite
technologique majeure, rien de moins qu’une base solide pour
la recherche et l'amélioration future. Il a ouvert la voie
à de nouveaux développements tels que les câbles
transatlantiques sophistiqués à fibre optique numérique,
qui peuvent passer des dizaines de milliers d'appels simultanément. |
sommaire
Câbles sous-marins en Méditerranée
|
De 1850 à 1860 la longueur totale des câbles sous-marins
s’élève à 20,826 km, dont 5,173 km
en Méditerranée et en Mer Noire.
En 1860. Abandon des câbles posés par plus de 300
m de profondeur après leur premier dérangement.
De 1860 à 1878. Echecs français. Monopole britannique.
La Métropole était liée à la Corse
par l’Italie et à l’Algérie par l’Espagne.
4 lignes sont créées et sont des échecs.
1860. Câble Toulon-Alger.
1861. Toulon-Minorque. Glass Elliot & Cie. Abandon.
1861. Port-Vendres-Minorque. Glass Elliot & Cie. Abandon.
1861. Câble Toulon-Ajaccio. Glass Elliot & Cie. Abandon.
1863. 1er navire câblier français le Dix-Décembre
et création d’un atelier à Toulon.
1863–1865. Réalisation du plan pour relier les îles
côtières provençale au Continent.
1864. Echec de la pose d’un câble entre Oran et Carthagène
par le Dix-Décembre.
1866. Réseau de 194 km installé par le Dix-Décembre
: Livourne-Macinaggio (11,396 km) et Bonifacio-Santa Teresa
(14,816 km)ainsi que des liaisons côtières.
1870. 5 février. Installation de la liaison Marseille-Bône-Malte
(828,022 km) avec de la technologie britannique.
1870–1878. La IIIe République renégocie avec
l’Eastern le contenu des conventions des câbles de
Méditerranée sur des bases plus équitables;
1871. Adolphe Thiers renégocie le contrat pour constituer
le 1er câble direct Marseille-Alger (921,999 km) qui est
posé un an après la liaison Marseille-Bône-Malte
de l’Eastern Telegraph.
1872. Absorption de la compagnie Marseille Algiers Malta Company
par l’Eastern.
1873. Un second navire, la Charente est basé à
Toulon en complément de l’Ampère (ex Dix-Décembre
qui rejoint Le Havre).
1874. Bonifacio-Sta Theresa. 14,816 km.
1874. Marseille-Barcelone N°1. 407,410 km.
1877. Marseille-Bone N°2. 857,513 km.
1878. Première ligne directe avec la Corse posée
entre Antibes et Saint-Florent. 238,908 km.
Une politique de câbles sous-marins est définie
en lien avec les ambitions coloniales de la France.
1879. Marseille-Alger N°2. 927,482 km.
1890. Marseille-Alger N°3. 903,707 km.
1891. Bonifacio-Sta Theresa. (Fournisseur La Seyne). 14,816
km.
1891. Toulon-Ajaccio. (Fournisseur La Seyne). 319,540 km.
1891. 1er juillet. La Chambre vote un crédit de 5.000.000
francs pour l’installation de 2 câbles : 1
1892. Marseille – Oran N°1. 1097,564 km. 2 Marseille-Tunis.
Les Liaisons sont adjugées à la SIT et
à A. Grammont (usine de Saint-Tropez).
1893. Marseille-Bizerte N°1. 986,322 km.
Développement de câbles vers : La Nouvelle Calédonie,
Madagascar, La Réunion, l’Indochine et, surtout,
l’Afrique du Nord.
1900. Premiers câbles enterrés à faible
affaiblissement, sur des courtes distances.
1901. Oran-Tanger (fournisseur La Seyne). 516,880 km.
1905. Tanger-Cadix (fournisseur La Seyne). 145,212 km.
1905. Marseille-Barcelone N°2. 407 km.
1913. Marseille-Alger N°4. 890,879 km.
1923. Menton-Gênes.
1926. Marseille-Philippeville. 845,834 km.
1928. Paris est relié à Alger.
1931. Marseille-Bizerte N°2. 957,867 km.
1932. Pose d’un câble vers l’Afrique du Nord.
Marseille-Oran N°2. 1178,816 km.
1936. Nabeul-Igalo. 1495,914 km.
1938. Câble Marseille-Bizerte N°3. 889,715 km.
1938. Nabeul-Beyrouth. 2496,866 km.
1939. Câble Marseille-Oran. N°3. 1080,446 km.
Dans cette période : 9 câbles
entre Marseille et les principaux ports africains : Alger, Oran,
Bizerte…
1940–1945. Guerre Mondiale. Un navire câblier allemand
est basé à Marseille afin de couper les câbles
posés entre Gibraltar et Alexandrie.
Des sous-marins allemands doivent détruire les atterrissements
en Méditerranée et en Atlantique. Les destructions
sont rapidement réparées.
Autres réseaux méditerranéens :
Italie. 12 câbles. 404 km. 1886. Usine Pirelli de La Spezia.
Navire-câblier Pirelli : Citta di Milano.
Espagne. 3 câbles avec les Baléares. 239 km.
Réseaux anglais en Méditerranée Orientale
sécurisés par la France jusqu’à Malte.
La ligne Gibraltar-Alexandrie est renforcée par les Anglais
: 1897, 1889, 1912 , 1921 avec 2 navires câbliers basés
à Malte et en Grèce.
Les anglais construisent un réseau mondial exploité
par des compagnies privées très liées à
leur gouvernement.
Premiers systèmes modernes. 1945
– 1988
1946. Premiers câbles avec répéteurs
: Toulon-Ajaccio.
1946. Prototype de répéteur sous-marin posé
par 2500 m de profondeur. Construits par Câble de Lyon,
à Bezons et qualifié à La Seyne.
1950. Liaison prototype avec un répéteur posée
entre Cannes (06) et Nice (06). Fonctionne jusqu’en 1958.
Ouvre la voie à l’industrie française.
1956. Le réseau de câbles sous-marins téléphoniques
se développe parallèlement à celui des
satellites géostationnaires.
1956–1963. Systèmes de réseaux de première
génération. Amplificateurs à lampes, répéteurs
souples, capacités inférieures à 120 circuits
téléphoniques, fréquence maximum transmise
de l’ordre du Mhz.
1957. Nouveau câble Marseille-Alger. 30 octobre. L’Ampère
pose la partie sous-marine. 1ère liaison téléphonique
équipée de répéteurs bidirectionnels
posée par grande profondeur. 60 circuits d’excellente
qualité sont acheminés.
1961. Nouveau câble Perpignan-Oran.
1964–1970. Systèmes de réseaux de la seconde
génération. Amplificateurs à lampes, répéteurs
rigides et articulés, câbles coaxiaux à
porteur central, capacités 120 à 360 voies à
4 kHz, systèmes multiplicateurs de circuits.
1988. Le réseau des câbles téléphoniques
sous-marins en Méditerranée atteint sa longueur
maximum : 51 561 km soit près de 14% du réseau
mondial.
1988–2002. L’ère des fibres optiques
La France pose 2 liaisons expérimentales
afin de qualifier les types de cables :
1982. Cagnes–Juan-les-Pins (06).
1984. Antibes (06) –Port-Grimaud (83).
1986. 1ère liaison commerciale Marseille (13)–Ajaccio.
EMOS est la 1ère grande artère méditerranéenne.
L’Angleterre est exclue d’une coopération franco-italienne
impliquant Pirelli. 3 840 circuits téléphoniques
acheminés par paire de fibres.
1995. Nouvelle génération avec des pompes optiques
afin d’amplifier le signal. Le secteur des télécommunications
est dérégulé aux Etats-Unis, puis en Grande-Bretagne.
Arrivée des carrier’s carriers qui créent
la confusion. Plusieurs éléments du marché
ont des influences majeures :
La demande est croissante, elle connaît même des
exponentielles avec internet. L’offre technologique ne
cesse d’évoluer augmentant la concurrence et tirant
les prix vers le bas. La mise en service du T.A.T. 12 améliore
la qualité de la transmission de façon exponentielle.
Le multiplexage de plusieurs ondes est facilité. A certains
égards, l’offre pose d’énormes problèmes
aux exploitants et aux industriels en développant une
offre de capacité considérable faisant baisser
les prix de vente et obligeant au renouvellement fréquent
des équipements.
1996. FLAG est posé entre l’Angleterre et le Japon
en passant par la Méditerranée.
2003. Le réseau Méditerranée comprend 6
artères en service reliant Gibraltar à la Méditerranée
Orientale.
L’Italie et la Grèce développent des réseaux
côtiers.
Le réseau italien est devenu majoritaire en Méditerranée.
La Sicile, par sa position géographique, est devenue
le centre du réseau méditerranéen.
1992. 25 novembre. Le Mediterranean Cable and Maintenance Agreement
représente un accord global pour l’entretien du
réseau.
Un navire italien est désigné. Une boucle à
fibres optiques relie les Iles d’Hyères au continent.
2 liaisons sur La Corse existent.
Les câbles à fibres optiques sont ensouillés
au fond de la mer dans les zones à risque. L’entretien
des réseaux nécessite l’utilisation d’outils
d’intervention performants .
|
sommaire
En 1950, les répéteurs immergés
apparaissent et permettent de ré-amplifier régulièrement
le signal.
Ce n'est qu'avec le développement des câbles coaxiaux
avec isolation en polyéthylène, de l'équipement
à large bande de fréquence porteuse et répéteurs
immergés que la téléphonie par câble transatlantique
peut être réalisée et progressivement mise en
place juste avant et pendant la seconde guerre mondiale.
Lorsque le premier câble téléphonique transatlantique
est inauguré le 25 septembre 1956, il est salué comme
une percée majeure dans les télécommunications.
Il est conçu pour relier les États-Unis et le Canada
au Royaume-Uni, avec des facilités pour des circuits destinés
à être loués à d'autres pays d'Europe de
l'Ouest.
A partir de Londres, des circuits directs sont connectés en
permanence vers l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suisse, et
un circuit pour le Danemark prolonge le trafic américain vers
la Norvège et la Suède.
L'ensemble du projet a pris 3 ans pour un coût de £ 120
000 000.
En 1959, mise en service de TAT2, (Penmarc'h Terre Neuve). Cette
nouvelle station française entraîne la fermeture de l'ancienne
station de Déolen en Locmaria-Plouzané (France).
De 1960 à 1970, mise au point du câble à
porteur central, réalisation de nouvelles enveloppes mécaniques
des répéteurs, création de nouvelles machines
de pose et perfectionnement des méthodes de contrôle
de pose.
En 1965, transistorisation des répéteurs.
En 1966, le dernier câble télégraphique
Bay Roberts-Horto est débranché.
Les nouveaux câbles coaxiaux et les satellites
se partagent le marché du téléphone à
grande distance.
Ils conduisent l'Administration à décider la rénovation
du domaine en le spécialisant dans l'entretien du réseau
de Méditerranée.
A Toulon, la reconversion permet de construire successivement
: le central téléphonique, la darse des navires câbliers
avec deux quais dans le cadre de la construction du port de Brégaillon,
un grand entrepôt couvert de 18 cuves de stockage et un bâtiment
pour les équipements de nouveaux câbles sous-marins atterrissant
aux Sablettes.
L'industrie française se lance à la conquête du
marché des câbles sous-marins. La politique industrielle
de l'Administration est claire : l'industriel construit des liaisons
téléphoniques clés en main qui sont posées
par le navire de pose de l'administration, d'abord le Marcel Bayard
(1961-1981) puis le Vercors à partir de 1974.
L'administration définit les nouvelles technologies dans ses
laboratoires de recherche (CNET) et entreprend la promotion des nouveaux
câbles.
Le centre de La Seyne met au point les techniques d'après-vente.
Deux navires câbliers entretiennent les réseaux d'Atlantique
et de Méditerranée (Ampère 3) dans le
cadre d'Accords de maintenance.
Le personnel de la base La Seyne est renouvelé. Les marins,
souvent Pieds-Noirs et africains (du fait de la suppression de la
base de Dakar), ont remplacé les équipages corses et
marseillais de l'époque du télégraphique.
La mise en service du Vercors, en 1974, permet à l'idustrie
française de conquérir progressivement la Méditerranée
autrefois acquise aux intérêts britanniques.
A la fin de l'ère du coaxial, le réseau a été
construit à Calais à plus de 50 %. Il est entretenu
par les navires de La Seyne sur Mer. Le centre de Marseille est saturé
par 7 câbles en service.
Les dernières liaisons atterrissent à
Martigues et à La Seyne à partir de 1977. Ainsi, les
câbles La Seyne-Bastia (1977), La Seyne-Tripoli (1979),
La Seyne-Grèce (1981) et La Seyne-Palerme- Alexandrie (1986)
permettent à la base de La Seyne de devenir un complexe unique
au monde qui participe au rayonnement de la technologie française.
Des techniciens étrangers viennent se former aux techniques
de jointage.
Des équipes d'intervention sont envoyées pour remettre
des câbles en service à Beyrouth et à Alexandrie
mais également à Colombo et à Singapour. D'autres
équipes arment des navires de circonstance en câbliers
pour poser des câbles en Chine. D'autres enfin se succèdent
à bord du navire câblier Vercors qui assure un programme
de pose soutenu.
En 1977 l'administration des P. T. T. possédait
encore 23 câbles télégraphiques (télégraphie-harmonique)
utilisés en même temps pour la téléphonie,
la plupart à répéteurs immergés : 12 pour
le réseau méditérannéen, 7 câbles
franco-anglais, 1 vers l'Afrique et 3 vers l'Amérique.
Les premiers câbles sous-marins à fibres
optiques sont posés à partir de 1982. Comme pour la
génération précédente, l'administration
des P & T et l'industriel français installent leurs premières
liaisons expérimentales en Méditerranée : A ntibes
- Nice (1982), Antibes - Port Grimaud (1984) et Marseille - Ajaccio
(1987).
Du côté industriel, Alcatel signe avec Pirelli un accord
de coopération dès 1987, ce qui permet aux deux industriels
d'éliminer le constructeur britannique de Méditerranée.
Pour Alcatel c'est un premier pas avant de s'implanter en Australie
et aux Etats-Unis.
En 1984, après l'achat du constructeur britannique STC,
Alcatel devient le premier constructeur mondial.
En 1985, pose du dernier câble analogique de grande capacité
Sea-Me-We 1 - Marseille-Singapour - 13 500 km en huit segments - 1
380 voies téléphoniques. Boucle le premier tour de la
Terre.
sommaire
1986 : les câbles à fibre optique
Ils sont conçus pour transmettre les signaux numériques
: les 0 et les 1 du code binaire sont codés sous la forme de
très brèves impulsions lumineuses, émises par
des diodes laser microscopiques.
Ils sont constitués d’une, deux ou trois paires de fibres
placées dans un bloc optique recouvert d’une armature
d’acier, d’une enveloppe de cuivre pour l’alimentation
électrique, d’une gaine d’isolation en polyéthylène.
Le tout est protégé par une à trois armures d’acier,
au voisinage des côtes.
Le premier câble transatlantique à fibres optiques, le
TAT 8, est posé en 1988, et permet, grâce à une
unité de branchement en mer, de relier simultanément
la France, l’Angleterre et les U.S.A. Ce câble offre une
capacité de 40 000 communications téléphoniques
simultanées.
Comme les câbles coaxiaux, les câbles optiques sont équipés
de répéteurs (à partir des années 1990,
ils sont espacés de plus de 100 km). Depuis 1995, des régénérateurs
"tout optique" compensent l’atténuation du signal
dans la fibre, ce qui permet d’augmenter considérablement
le nombre des circuits (le TAT 14 posé en 2001 a une capacité
de plus de 7 000 000 de communications simultanées.
En 1988, mise en service de TAT8, premier câble
transatlantique à fibres optiques (2 × 280 Mbit/s) équivalent
à 40 000 circuits téléphoniques.
En 1990, mise au point de la fenêtre 1 550 nm, longueur
d'onde dans le verre de la fibre optique minimisant les effets de
la diffraction. La bande passante utile est portée à
12,5 THz (soit 12 500 GHz).
En 1995, génération tout optique des liaisons
avec la mise au point de l'amplification optique dans les répéteurs
par fibres dopées à l'erbium. Technique EDFA (Erbium
Doped Fibre Amplified). Mise en service des câbles transatlantiques
TAT12, TAT13 et TPC5 à amplification optique à correction
d'erreurs. La capacité passe de la technologie 560 Mbit/s par
fibre à 60 Gbit/s.
En 1998, première génération de système
de filtrage optique WDM (multiplexage en longueurs d'onde où
plusieurs couleurs portant chacune un signal différent sont
transmises simultanément). La capacité par paire de
fibres est de 20 à 40 Gbit/s. Pose du câble AC1 États-Unis-Allemagne
utilisant cette technique, avec deux fibres et 16 couleurs, transporte
160 Gbit/s.
A partir de 1998, après la construction du
transatlantique TAT 8, un troisième réseau se met progressivement
en place.
Le 23 août 1999, mise en service de Sea-Me-We 3, premier
câble à technologie WDM, relie tous les pays d'Europe
et tout l'océan Indien jusqu'au Japon. 40 atterrissements,
40 000 km, permettant une capacité initiale de 500 Mbit/s.
La modularité des équipements terrestres permettant
des mises à niveau des terminaux sans toucher à la partie
maritime, ce câble a aujourd'hui une capacité de 130
Gbit/s par paire de fibres, soit 260 fois sa capacité initiale.
En 2000, nouvelle amélioration de la technologie EDFA,
la capacité passe à 10 Gbit/s par couleur, soit 160
Gbit/s par paire de fibres
En 2001, mise en service du câble TAT-14,
États-Unis - Grande-Bretagne - Allemagne - France. Technique
: amplificateurs optiques EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) sur
64 couleurs, capacité : 5,12 térabits par seconde.
En 2001, après une production de 70.000 Km
dans ses trois usines de Calais, Sydney et Portland, Alcatel doit
faire face à la crise des télécommunications.
France Télécom connaît une
évolution différente du fait de la dérégulation
des télécommunications dans la communauté européenne
(1995).
La direction de l'opérateur s'impose de nouveaux objectifs
: s'implanter dans le monde entier et construire deux réseaux
terrestres en Amérique du Nord et en Europe reliés par
des câbles sous-marins. Simultanément, des secteurs d'activité
sont abandonnés (Enseignement et Recherche), d'autres sont
filialisés.
C'est ainsi que France Télécom Marine est créée
le 1er janvier 2000 avec pour objectif d'assurer la rentabilisation
des quatre navires câbliers.
La base marine de La Seyne sur Mer perd sa fonction d'accueil des
câbles sous-marins. Ceux-ci quittent le littoral français
puisque deux grandes liaisons à fibres optiques ont été
installées entre 1990 et 2003 : SEA-ME-WE 2 (1994) et France
- Grèce (1996).
La Sicile est actuellement le centre du réseau
méditerranéen. Deux causes à cela : la nouvelle
réglementation française pour l'attribution des concessions
d'atterrissement et le manque d'investissement des opérateurs
français dans le réseau. Le réseau italien stratégiquement
placé au centre du réseau méditerranéen
possède également un réseau national de câbles
sous-marins longeant la côte occidentale.
Le réseau français est plus réduit
: outre les deux câbles internationaux, il ne comporte que la
boucle des îles d'Hyères, deux liaisons sur la Corse
et deux câbles côtiers en Corse.
sommaire
Le réseau mondial a atteint 650 000 à
700 000 Km en 2002, sensiblement plus qu'à l'époque
du télégraphique.
Deux navires de pose sont en activité : le Vercors,
qui sera remplacé en 2002 par le René Descartes,
et le Fresnel, nouveau navire construit en 1996. Comme les
câbles à fibres optiques sont systématiquement
ensouillés au fond de la mer au moment de leur pose, le développement
des techniques d'ensouillage avait été anticipé
par les équipes de La Seyne sur Mer.
L'ensouillage
Déjà utilisé dans les zones
à risque à partir de 1970, l'ensouillage a demandé
un effort de recherche pour maintenir l'outil à niveau.
Tout commença en 1974, à la
mise en service du Vercors. L'opérateur américain
AT&T cherchait un navire de pose capable de tirer la charrue
et trouva un écho favorable auprès de son partenaire
français.
L'administration accepta également
de participer au programme de recherche du sous-marin télécommandé
SCARAB, lancé en 1975 et définitivement opérationnel
en 1980.
En 1980, le Vercors, seul navire à exploiter
la charrue américaine, est équipé d'une
charrue fabriquée par deux entreprises locales, SIMEC
(Fuveau) et ECA (La Garde).
D'autres charrues suivront : Elise 2 et 3, les tracteurs autonomes
CASTOR 1 et 2 et enfin les sous-marins télécommandés
(ROV) SCORPIO et HECTOR. France Télécom privilégie
les engins télécommandés de préférence
aux engins habités et les rades des Sablettes, de La
Ciotat ou du Prado sont les lieux d'expérimentation des
nouveaux outils.
Il y a une grande coopération entre tous les utilisateurs
du milieu sous-marin situés sur le littoral de la Méditerranée,
entre les donneurs d'ordre, la Marine Nationale (Certsm ou Gismer),
Comex et l'industrie pétrolière, EDF, France Télécom.
Ils ont des objectifs différents et permettent aux nombreuses
entreprises spécialisées de participer à
la conquête des abysses : Comex, Eca, Simec, Travocéan,
Intersub, Cybernetic, Sermar, Muller. Toutes ont apporté
leur compétence, certaines sont toujours en activité.
Depuis 1990, les navires de pose Vercors et Fresnel mis
en œuvre par les ingénieurs et marins seynois posent
les grands systèmes de câbles sous-marins dans
tous les océans du globe aussi bien pour Alcatel que
pour les constructeurs américains ou japonais.
Entre 1997 et 2001, ils ont installé plus de 50% des
40.000 Km du SEA-ME-WE 3, mais aussi des liaisons reliant le
Japon aux Etats-Unis et l'Australie à Hawaï. On
reproche souvent à France Télécom de ne
pas faire connaître localement les réussites accumulées
pendant cette décennie.
C'est sans doute exact mais les déplacements du personnel,
les changements de programme et les nombreux séjours
à la mer des navires perturbent les opérations
de relations publiques.
|
En 2002, en conservant les terminaux à
10 Gbit/s, les systèmes multiplexent jusqu'à 100 couleurs
par paire, capacité de l'ordre de 1 térabit/seconde.
En 2002, pose du câble Apollo, de Cable & Wireless, constitué
de deux câbles (Apollo North et South), contenant quatre paires
de fibres optiques. Chaque câble a une capacité de transmission
de 3,2 térabits par seconde.
En 2005, conception du système DWDM (de l'anglais Dense
Wavelength Division Multiplexing). Technologie à 10 Gbit/s
par couleur avec environ 100 couleurs par fibre.
En 2010, systèmes sous-marins avec technologie 40 Gbit/s
utilisant la détection cohérente, environ 100 longueurs
d'onde par fibre optique.
En 2012, un million de kilomètres de câbles à
fibre optique sont au fond de la mer.
En 2015, deux projets de câbles sous-marins concernent
la France et l'Europe :
un câble pacifique doit relier la Polynésie
française à la Chine et à l’Amérique
du Sud, sans passer par les États-Unis20 ;
le câble AEConnect doit relier New-York à Londres avec
un débit de 52 Tbit/s21.
En 2017 et 2018, achèvement de la construction
commune et mise en service par Microsoft et Facebook, d'un câble
sous-marin à fibres optiques, qui traverse l'océan Atlantique
pour relier Virginia Beach (États-Unis) à Bilbao (Espagne).
Ce lien numérique représente 6 600 km de câbles.
Baptisé Marea, le câble dispose de huit paires de fibres
et a une capacité initiale estimée de 160 térabits
par seconde qui peut augmenter facilement grâce à une
interopérabilité avec des équipements réseaux
multiples.
En avril 2019, Google a terminé l'installation du câble
Curie (nom choisi en honneur de Marie Curie) reliant Los Angeles à
Valparaiso, avec un débit de 72 Tbps. La mise en service est
prévue en 2020.
En 2020, Google déploie, en partenariat avec Orange,
le câble Dunant prévu pour l'été 2020.
Le nom est un hommage à Henry Dunant, fondateur de la Croix
Rouge. Ce câble sous-marin aura une vitesse de transmission
de 300 térabits par seconde et reliera, sur 6 600 km, Virginia
Beach, sur la côte est des États-Unis, à Saint-Hilaire-de-Riez,
en France, une commune proche des Sables-d'Olonne. Cette installation
du câble Dunant est significative, avec Marea et Curie, de la
place prise par les GAFAM sur les réseaux de câbles sous-marins
en ce début de XXIe siècle.
Le 28 juillet 2020, Google annonce qu’il va déployer
un nouveau câble transatlantique pour le transit des données
Internet. La date de mise en service est prévue pour le courant
2022. Cette nouvelle infrastructure, nommée Grace Hopper, en
hommage à l’informaticienne américaine, doit relier
New York à Bude au Royaume-Uni et à Bilbao en Espagne.
Il sera équipé de 16 paires de fibres (à comparer
aux douze paires de fibres du câble Dunant).
En 2021, un consortium mené par Facebook, Microsoft,
Vodafone a prévu le déploiement du câble «
Amitié » long de 6 600 km, qui reliera Lynn (Massachusetts)
aux États-Unis, au Royaume-Uni à Bude et en France,
à la commune Le Porge proche de Bordeaux (atterrissage du câble
confié à Orange28). Le câble devrait être
constitué de 16 paires de fibres et permettre un transit de
données de 320 Tbit/s.
sommaire
En 2023 : 552 câbles sillonnent le fond
des océans et sont devenus les liaisons vitales de nos vies
numériques. Ils sont au cœur d’enjeux à la
fois techniques, économiques et géopolitiques . câbles
sous-marins existants ou en projet.
Les câbles d’aujourd’hui envoient jusqu’à
250 térabits par seconde de données,
La fibre optique est idéale pour la transmission de données
haut débit et longue distance, mais la technologie a ses limites.
C’est pourquoi il est nécessaire d’augmenter la force
du signal à l’aide de répéteurs disposés
tous les 50 à 100 km.
Les répéteurs doivent être
alimentés, et c’est là qu’une autre partie
de la construction du câble entre en jeu. À l’extérieur
des brins de fibre optique, une couche de cuivre transporte l’électricité
jusqu’à 18 000 volts. C’est suffisant pour alimenter
des répéteurs tout au long de l’océan Pacifique
à partir d’une seule extrémité du câble,
bien que l’alimentation soit généralement disponible
aux deux extrémités pour une plus grande fiabilité.
Ces câbles, aussi épais qu’un
tuyau d’arrosage, sont des merveilles de haute technologie. Le
plus rapide, le câble transatlantique Amitié, récemment
achevé et financé par Meta, Microsoft et d’autres
géants du secteur de la Tech, peut acheminer 400 térabits
de données par seconde.
Les câbles actuels utilisent 16 paires de fibres, mais un nouveau
câble que NTT est en train de construire entre les États-Unis
et le Japon utilise 20 paires de fibres pour atteindre 350 Go/s. Un
autre géant japonais de la technologie, NEC, utilise 24 paires
de fibres pour atteindre des vitesses de 500 To/s sur son câble
transatlantique.
Parallèlement à l’installation de nouveaux câbles,
il est parfois possible de moderniser les câbles existants en
les dotant d’un nouvel équipement réseau. Selon
Brian Lavallée, une récente mise à niveau effectuée
par Ciena a permis de quadrupler la capacité des lignes à
fibre optique sans rien changer sous l’eau.
Microsoft mise également sur une amélioration des fibres
optiques elles-mêmes. En décembre, il a acquis une société
appelée Lumenisity qui développe des fibres creuses
avec un minuscule canal d’air central. La vitesse de la lumière
dans l’air est 47 % plus rapide que dans le verre, ce qui réduit
la latence, qui est une limite essentielle à la performance
des réseaux.
Les câbles transpacifiques ont un temps de latence d’environ
80 millisecondes. La réduction du temps de latence est importante
pour les interactions informatiques sensibles au temps, comme les
transactions financières. Microsoft s’intéresse
également aux fibres optiques creuses pour les lignes à
courte distance, car la réduction de la latence permet de rapprocher
les centres de données et d’assurer un basculement plus
rapide en cas de défaillance de l’un d’entre eux.
Pourtant, ces câbles sous-marins sont
aussi étonnement rudimentaires : ils sont enduits de goudron
et déroulés par des navires selon le même procédé
que celui utilisé dans les années 1850 pour poser le
premier câble télégraphique transatlantique. SubCom,
fabricant de câbles sous-marins basé dans le New Jersey
(Etats-Unis), était à l’origine un fabricant de
cordages dont l’usine était située à proximité
d’un port en eau profonde pour faciliter le chargement sur les
navires.
552 câbles sous-marins existants ou en projet
Bien que les liaisons par satellite gagnent
en importance grâce à des constellations comme Starlink
de SpaceX, les câbles sous-marins sont vitaux aux commerce et
communications mondiales, acheminant plus de 99 % du trafic entre
les continents. TeleGeography, un cabinet d’analyses qui suit
l’évolution de ce secteur, a recensé 552 câbles
sous-marins existants ou en projet, et d’autres sont en cours
de déploiement à mesure que l’Internet se répand
dans toutes les régions du globe et tous les pans de nos vies.
On sait que les géants de la Tech comme
Meta, Microsoft, Amazon et Google gèrent des centaines de centres
de données remplis de millions de serveurs. On les surnomme
les « hyperscalers ». Ce que l’on sait moins, c’est
qu’ils gèrent également de plus en plus le système
nerveux de l’Internet que sont les câbles sous-marins.
« L’ensemble du réseau de câbles sous-marins
est l’élément vital de l’économie »,
explique Alan Mauldin, analyste chez TeleGeography. « C’est
grâce à lui que nous envoyons des courriels, des appels
téléphoniques, des vidéos YouTube et des transactions
financières. »
Selon ce cabinet d’analyse, les deux tiers du
trafic Internet proviennent des hyperscalers. D’après
David Coughlan, directeur général de SubCom, la demande
de données des câbles sous-marins de ces acteurs incontournables
augmente de 45 % à 60 % par an. La demande de données
des hyperscalers n’est pas seulement motivée par leurs
propres besoins en contenu, comme les photos Instagram et les vidéos
YouTube visionnées dans le monde entier. Ces entreprises gèrent
aussi souvent des services de cloud computing, comme Amazon Web Services
et Microsoft Azure, qui sont à la base des opérations
mondiales de millions d’entreprises. « La demande mondiale
de contenu ne cessant d’augmenter, il faut disposer de l’infrastructure
nécessaire pour pouvoir y répondre », explique
Brian Quigley, qui supervise les réseaux sous-marins et terrestres
de Google.
Mais l’augmentation du trafic internet via les
câbles sous-marins suscite également des inquiétudes.
L’année dernière, le sabotage à l’explosif
des gazoducs Nordstream 1 et 2 reliant la Russie à l’Europe
a été beaucoup plus difficile sur le plan logistique
que de sectionner un câble internet de l’épaisseur
d’un pouce. Des soutiens de Vladimir Poutine ont laissé
entendre que les câbles sous-marins pouvaient être attaqués.
Par exemple, Taïwan possède 27 câbles sous-marins
que les militaires chinois pourraient considérer comme des
cibles en cas d’invasion de l’île.
Les risques de perturbations sont bien réels.
Ainsi, les performances de l’internet au Vietnam ont souffert
des pannes sur cinq câbles pendant des mois au début
de l’année. Sur l’île de Tonga, une éruption
volcanique l’a privé de la plupart des communications
pendant des semaines.
Mais ces risques sont éclipsés
par les avantages très réels, qu’ils soient macroéconomiques
ou purement personnels. Le réseau devient plus fiable et plus
performant grâce à des débits plus rapides et
à la multiplication des nouveaux câbles, ce qui incitera
de plus en plus de pays à s’y joindre.
Les avantages économiques sont considérables. Selon
McKinsey, les liaisons par câbles sous-marins se traduisent
par des vitesses d’accès à l’Internet plus
élevées, des prix plus bas, une augmentation de 3 à
4 % de l’emploi et une hausse de 5 à 7 % de l’activité
économique.
Au moment où la demande de trafic des hyperscalers a explosé,
les entreprises de télécommunications qui installaient
traditionnellement les câbles sous-marins se sont retirées
du marché.
« Il y a environ 10 ans, un grand nombre
de fournisseurs de télécommunications traditionnels
ont commencé à se concentrer sur le sans-fil et sur
ce qui se passait dans leurs réseaux du dernier kilomètre
», explique Frank Rey, qui dirige la connectivité des
réseaux à grande échelle pour le service cloud
Azure de Microsoft. Les délais d’attente pour le déploiement
de nouveaux câbles se sont allongés, la phase de planification
s’étendant à elle seule sur trois à cinq
ans. Les hyperscalers ont alors décidé de prendre les
choses en main.
Ils ont d’abord commencé par investir
dans des projets tiers, une démarche logique étant donné
que les câbles sous-marins sont souvent exploités par
des consortiums regroupant de nombreux partenaires. Mais les hyperscalers
construisent désormais leurs propres câbles.
TeleGeography prévoit que 10 milliards
de dollars seront investis pour de nouveaux câbles sous-marins
entre 2023 et 2025 dans le monde. Google a déjà déployé
plusieurs câbles nommés Curie, Dunant, Equiano, Firmina
et Grace Hopper. Deux câbles transpacifiques sont également
en cours de construction : Topaz cette année et, avec AT&T
et d’autres partenaires, TPU en 2025.
L’installation d’un câble transatlantique
coûte entre 250 et 300 millions de dollars, selon TeleGeography.
Mais ces infrastructures sont essentielles. Si une région de
Microsoft Azure tombe en panne, les centres de données d’une
autre région sont sollicités pour garantir que les données
et les services des clients continuent de fonctionner. Aux États-Unis
et en Europe, les câbles terrestres supportent la majeure partie
de la charge, mais en Asie du Sud-Est, ce sont les câbles sous-marins
qui dominent.
sommaire
Historiquement, l’amélioration technologique
des câbles sous-marins se fait sur les câbles eux-mêmes.
Les câbles à paires de cuivre utilisés pendant
près d’un siècle sont remplacés par des
câbles coaxiaux à partir de 1956, année de la
pose du premier câble téléphonique transatlantique
(TAT-1). Ces derniers permettent d’avoir plusieurs circuits téléphoniques
simultanés, mais seront supplantés à leur tour
par les câbles en fibre optique à partir de 1988 (pose
du TAT-8).
Orange est l’un des leaders du secteur avec,
à son compteur, une participation dans 450 000 km de câbles
à travers le monde. « Les équipes en charge de
la stratégie d’investissement, du pilotage, du déploiement
et de l’exploitation des câbles sous-marins peuvent réaliser
un investissement soit en propre, soit dans le cadre d’un consortium
où plusieurs acteurs co-investissent », souligne Carine
Romanetti. Le secteur vit aujourd’hui une évolution majeure
avec l’entrée des GAFAM, et en particulier Google, Facebook,
Amazon et Microsoft, sur le terrain. Ces acteurs, à l’origine
de 70 % de l’augmentation du trafic mondial d’après
Cisco, jouent en effet un rôle de plus en plus important en
investissant massivement dans le déploiement de leurs propres
infrastructures afin d’interconnecter leurs data centers.
Orange Marine, filiale d’Orange, qui a déjà
déposé plus de 180 000 km de câbles en fibre optique
au fond des océans, se charge de la pose et de la maintenance
des câbles grâce à une flotte câblière,
composée de six navires, qui représente 15 % de la flotte
mondiale et qui est l’une des plus expérimentées
au monde.
La pose d’un câble se déroule en
plusieurs étapes et prend en général quelques
mois. Il faut tout d’abord obtenir les autorisations des pays
concernés afin d’effectuer une reconnaissance des fonds
marins permettant de réaliser des cartes détaillées
de la zone de pose. Le câble et les répéteurs,
qui sont disposés tous les 50 à 100 km afin de retraiter
et réémettre le signal qui se dégrade après
une certaine distance, sont ensuite chargés à bord d’un
navire câblier. Après avoir raccordé le câble
à la station terrestre du pays de départ, celui-ci le
dépose sur le sol marin jusqu’au pays d’arrivée.
Dans les zones où le câble est susceptible d’être
endommagé par l’activité humaine, une charrue creuse
un sillon et y enterre le câble. Cette opération, appelée
ensouillage, lui assure une certaine protection contre les ancres
et chaluts. Une fois la traversée du navire terminée,
le câble est raccordé à la station terminale télécom,
bâtiment technique du réseau du pays d’arrivée,
et la connexion entre le réseau domestique et le réseau
international est réalisée.
Bien que protégés par une gaine résistante
et ensouillés dans les zones les plus sensibles, les câbles
peuvent être endommagés. Les causes de dysfonctionnement
sont multiples : séismes, glissements de terrain, ancres, filets
de pêche,… Lorsqu’un défaut est repéré,
il est crucial d’y remédier au plus vite, car c’est
la connectivité internationale d’un ou plusieurs pays
qui peut se trouver affectée. Une réparation peut prendre
plusieurs jours, voire plusieurs semaines en fonction de la disponibilité
d’un navire de maintenance et du temps de transit pour arriver
sur la zone de réparation. De plus, son coût est très
élevé, et peut atteindre le million d’euros dans
les pires scénarios. Par ailleurs, lorsqu’un câble
est détérioré et que la connexion ne peut pas
être redirigée sur une autre route, des millions de personnes
sont privées de connexion Internet.
« Pour éviter ce scénario, les
routes sont doublées ou triplées, c’est ce qu’on
appelle la sécurisation du trafic, explique Carine Romanetti.
Orange mène actuellement un projet pour améliorer la
sécurisation de la Guyane, dont 85 % à 90 % du trafic
est à destination des États-Unis, et qui est principalement
desservie par le câble AMERICAS-II, avec une sécurisation
partielle par un lien passant par le Suriname. Le nouveau câble
Kanawa, en cours de pose, fait 1 700 km de long, possède deux
paires de fibres optiques, et a une capacité maximale de 10
térabits par seconde par paire de fibres. Sa mise en service
est prévue pour début 2019. »
sommaire
Un réseau mondial vital
Au-delà de l’interconnexion des plus de
4 milliards d’internautes à travers le monde, le réseau
sous-marin assure aussi environ 8 000 milliards d’euros de transactions
quotidiennes. On comprend donc aisément son aspect géopolitique
et pourquoi il est parfois la cible d’actes de piraterie. À
noter que la législation qui régit le partage des fonds
marins entre les différents acteurs et pays est écrite
par les Nations unies.
« Le réseau de câbles sous-marins
joue également un rôle clé dans le désenclavement
numérique de l’Afrique, ajoute Carine Romanetti. Orange
fut notamment à l’initiative du câble Africa Coast
to Europe (ACE) reliant, depuis 2012, l’Europe à la côte
ouest de l’Afrique, et continue de contribuer activement au développement
du câble ACE avec la mise en service du dernier segment jusqu’à
Cape Town en Afrique du Sud prévue pour mi-2019. Pour améliorer
la sécurisation de ses filiales et accompagner la forte croissance
du trafic sur cette route, Orange poursuit ses investissements stratégiques
dans la zone et a conclu un partenariat avec MainOne, qui prévoit
l’acquisition de capacité et la construction de deux nouvelles
branches vers Dakar (Sénégal) et Abidjan (Côte
d’Ivoire) d’ici mi-2019, sur le câble de plus de 7
000 km de long qui relie le Portugal au Nigéria. »
Les câbles sous-marins, avec leur positionnement
stratégique au fond des océans, pourraient bientôt
avoir de nouveaux usages. L’Union internationale des télécommunications
coordonne en effet, avec une centaine de partenaires, une initiative
qui vise à mettre en place des capteurs sur les câbles
sous-marins afin de mesurer, en temps réel, les facteurs du
changement climatique liés à la circulation des océans.
Giuseppe Marra, du National Physical Laboratory au Royaume-Uni, propose,
quant à lui, de les utiliser comme sismographes, ce qui pourrait
notamment contribuer à améliorer la détection
des tsunamis.
D’autres utilités seront sans doute découvertes
dans les années à venir, car il est certain qu’avec
une progression du trafic de données de 35 % par an, les câbles
sous-marins demeureront des réseaux de communication essentiels.
Les câbliers, installés au fond
de la rade de Toulon depuis 1860, concentrent leur activité
maintenant sur la pose et la maintenance de câbles à
fibre optique à haut débit.
---
sommaire
| Problèmes de bande passante
Les premiers câbles télégraphiques
sous-marins longue distance exposés de redoutables problèmes
électriques. Contrairement aux câbles modernes,
la technologie du 19ème siècle ne permettait pas
de répéteurs amplificateurs en ligne dans le câble.
De grandes tensions ont été utilisées pour
tenter de surmonter la résistance électrique de
leur énorme longueur mais la capacité distribuée
et l'inductance des câbles se combinées pour déformer
le télégraphe impulsions dans la ligne, à
la bande passante du câble , limitant sévèrement
le débit de données pour l’opération
télégraphique à 10-12 mots par minute .
Dès 1816, Francis Ronalds avait présenté
que les signaux électriques étaient retardés
lors du passage à travers un fil ou un noyau isolé
posé sous terre, et a souligné la cause de l'induction,
en utilisant l'analogie d'un long pot de Leyde . Le même
effet a été remarqué par Latimer Clark
(1853) sur les noyaux immergés dans l'eau, et en particulier
sur le long câble entre l'Angleterre et La Haye. Michael
Faraday a montré que l'effet était supérieur
par la capacité entre le fil et la terre (ou l'eau) qui
l'entourait. Faraday avait remarqué que demandé
fil est chargé à partir d'une batterie (par exemple
en l'air sur une touche télégraphique), la charge
électrique dans le fil induit une charge opposée
dans l'eau lors de son déplacement. En 1831, Faraday
a décrit cet effet dans ce que l'on appelle maintenant
la loi d'induction de Faraday . Lorsque les deux charges s'attirent,
la charge d'excitation est retardée. Le noyau agit comme
un condensateur réparti sur la longueur du câble
qui, couplé à la résistance et inductance
du câble, limite la vitesse à laquelle un signal
traverse le conducteur du câble.
Les premières conceptions de câbles
n'ont pas réussi à analyser correctement ces effets.
Célèbre, E.O.W. Whitehouse avait écarté
les problèmes et insisté sur la faisabilité
d'un câble transatlantique. Lorsqu'il est devenu par la
suite électricien de la Atlantic Telegraph Company ,
il a été impliqué dans un différend
public avec William Thomson . Whitehouse pensait avec une tension
suffisante, n'importe quel câble pourrait être requis.
Thomson pensait que sa loi des carrés montrait que le
retard ne pouvait pas être surmonté par une tension
plus élevée. Sa recommandation était un
câble plus gros. En raison des tensions excessives recommandées
par Whitehouse, le premier câble transatlantique de Cyrus
West Field n'a jamais fonctionné de manière fiable
et a finalement été court-circuité vers
l'océan lorsque Whitehouse a augmenté la tension
au- au-delà de la limite de conception du câble.
Thomson a conçu un générateur
de champ électrique complexe qui minimise le courant
en résonnant le câble, et un galvanomètre
à miroir sensible à faisceau lumineux pour détecter
les faibles signaux télégraphiques. Thomson est
devenu riche sur les redevances de ceux-ci, et plusieurs inventions
connexes. Thomson a été élevé au
rang de Lord Kelvin pour ses contributions dans ce domaine,
principalement un modèle mathématique précis
du câble, qui a permis de concevoir l'équipement
pour une télégraphie précise. Les effets
de l 'électricité atmosphérique et du champ
géomagnétique sur les câbles sous-marins
ont également motivé bon nombre des premières
expéditions polaires.
Thomson avait produit une analyse mathématique de la
propagation des signaux électriques dans les câbles
télégraphiques en fonction de leur capacité
et de leur résistance, mais comme les longs câbles
sous-marins fonctionnaient à des vitesses lentes, il
n'a pas inclus les effets de l'inductance. Dans les années
1890, Oliver Heaviside avait produit la forme générale
moderne des équations du télégraphe , qui
incluaient les effets de l'inductance et qui étaient
essentiels pour étendre la théorie des lignes
de transmission aux fréquences supérieures requises
pour les données et la voix haute vitesse.
Téléphonie transatlantique
La pose d'un câble téléphonique transatlantique
a été sérieusement envisagée à
partir des années 1920, la technologie requise pour des
télécommunications économiquement viables
n'a été développée que dans les
années 1940. Une première tentative de pose d'un
câble téléphonique pupinisé a échoué
au début des années 1930 en raison de la Grande
Dépression .
TAT-1 (Transatlantique n ° 1) a été
le premier transatlantique système de câble téléphonique
. Entre 1955 et 1956, un câble a été posé
entre la baie Gallanach, près de Oban , en Écosse
et Clarenville, Terre-Neuve-et-Labrador . Il a été
inauguré le 25 septembre 1956, transportant 36 canaux
téléphoniques.
Dans les années 1960, les câbles
transocéaniques étaient câbles coaxiaux
qui transmettaient signaux de bande vocale multiplexés
en fréquence . Un courant continu haute tension sur les
répéteurs alimentés par le conducteur interne
(amplificateurs bidirectionnels présentés à
intervalles le long du câble). Les répéteurs
de première génération restent parmi les
amplificateurs à tube à vide les plus fiables
jamais représentés. Les derniers ont été
transistorisés. Beaucoup de ces câbles sont encore
utilisables, mais ont été abandonnés car
leur capacité est trop petite pour être commercialement
viables. Ont été utilisés comme instruments
scientifiques pour mesurer les ondes sismiques et autres événements
géomagnétiques.
Autres utilisations
En 1942, Siemens Brothers de New Charlton ,
Londres, en collaboration avec le Royaume-Uni Laboratoire national
de physique , a adapté la technologie des câbles
de communication sous-marins pour créer le premier oléoduc
sous-marin au monde dans l'opération Pluton pendant Seconde
Guerre mondiale .
Câbles de télécommunications
optiques
Dans les années 1980, des câbles
à fibres optiques ont été développés.
Le premier câble téléphonique transatlantique
à utiliser la fibre optique a été le TAT-8
, qui est entré en service en 1988. Un câble à
fibre optique comprend plusieurs paires de fibres. Chaque paire
une fibre dans chaque sens. TAT-8 avait deux paires opérationnelles
et une paire de secours.
Les répéteurs à fibre optique
modernes utilisent un amplificateur optique à semi-conducteurs
, généralement un amplificateur à fibre
dopée à l'erbium . Chaque répéteur
contient un équipement séparé pour chaque
fibre. Ceux-ci comprennent le reformage du signal, la mesure
des erreurs et les contrôles. Un laser à semi-conducteurs
envoie le signal dans la longueur de fibre suivante. Le laser
à semi-conducteurs excite une courte longueur de fibre
dopée qui agit elle-même comme un amplificateur
laser. Lorsque la lumière traverse la fibre, elle est
amplifiée. Ce système permet également
le multiplexage par répartition en longueur d'onde ,
ce qui augmente la capacité de la fibre.
Les répéteurs sont alimentés
par un courant continu constant transmis le long du conducteur
près du centre du câble, de sorte que tous les
répéteurs d'un câble sont en série.
Des équipements d'alimentation électrique sont
installés dans les stations terminales. Généralement,
les deux extrémités de la génération
de courant avec une extension réalisée une tension
positive et l'autre une tension négative. Un point de
terre virtuel existe à peu près à mi-chemin
le long du câble en fonctionnement normal. Les amplificateurs
ou répéteurs tirent leur puissance de la différence
de potentiel entre eux. La tension transmise par le câble
est souvent comprise entre 3 000 et 15 000 V CC à un
courant pouvant atteindre 1 100 mA, le courant augmentant avec
la tension décroissante; le courant à 10 000 VDC
est jusqu'à 1 650 mA. Par conséquent, la quantité
totale de puissance envoyée dans le câble est souvent
jusqu'à 16,5 kW.
La fibre optique utilisée dans les câbles
sous-marins est choisie pour sa clarté exceptionnelle,
permettant des cours de plus de 100 kilomètres (100 km)
entre les répéteurs pour minimiser le nombre d'amplificateurs
et la distorsion qu ' ils provoquent. Les câbles non répétés
sont moins chers que les câbles répétés,
mais leur distance de transmission maximale est limitée,
mais leur distance de transmission maximale a augmenté
au fil des ans; en 2014, des câbles non répétés
d'une longueur maximale de 380 km étaient en service;
Cependant, ceux-ci impliquent que des répéteurs
non alimentés soient positionnés tous les 100
km.
|
sommaire
Les câbles pendant la Première Guerre mondiale
Tous les plans stratégiques de toutes
les grandes puissances avant la guerre de 1914-1918 se révélèrent
chimériques, avec une seule exception : le plan stratégique
anglais de câbles sous-marins fonctionna sans accroc du
début jusqu’à la fin de la guerre.
Le matin du 5 août 1914, quelques heures
seulement après la fin de l’ultimatum anglais, le
navire câblier Telconia coupa les cinq câbles qui
liaient l’Allemagne au monde extra-européen. Pendant
les mois qui suivirent, les forces anglaises, françaises,
et japonaises coupèrent les câbles allemands dans
l’Atlantique sud et dans le Pacifique et capturèrent
les émetteurs de TSF dans les colonies allemandes. À
partir de 1915, l’Allemagne ne pouvait communiquer avec
le monde extra-européen qu’avec la TSF depuis son
territoire ou avec l’aide de pays neutres.
La politique anglaise de contrôle des
câbles était devenue beaucoup plus subtile depuis
1899. Les Anglais censurèrent les télégrammes
privés, commerciaux et de presse, mais n’essayèrent
pas d’interrompre les communications des pays neutres comme
la Suède, les Pays-Bas, ou les États-Unis. Au
lieu d’imposer la censure sur les télégrammes
diplomatiques ou d’exiger qu’ils soient rédigés
en clair ou dans un code commercial connu, ils laissèrent
passer les messages des gouvernements neutres en code, mais
les observèrent soigneusement tout en apprenant à
les déchiffrer. Afin de mettre à exécution
ce plan de captation et de déchiffrement des télégrammes
étrangers, ils recrutèrent les employés
à la retraite des compagnies de câbles et les envoyèrent
dans les stations de câbles autour du monde13.
En comparaison avec le succès de la politique
agressive des Britanniques, les essais allemands d’interrompre
les communications entre les membres de l’Entente cordiale
furent rares et restèrent sans effet. La ligne terrestre
entre la Grande-Bretagne et l’Inde fut coupée, ainsi
que les câbles dans la mer Baltique entre la Russie et
ses alliés occidentaux. De même, quand l’Empire
ottoman se joignit aux puissances centrales en novembre 1914,
l’Entente perdit ses câbles dans la mer Noire. Les
communications avec la Russie furent temporairement détournées
vers la TSF jusqu’en janvier 1915 quand un navire câblier
anglais posa un nouveau câble anglo-russe passant au nord
de la Norvège.
Les Allemands n’eurent pas plus de succès
dans les autres mers. Des croiseurs allemands attaquèrent
les stations de câble anglais de l’île Fanning
dans l’océan Pacifique et de l’île Cocos
dans l’océan Indien, mais causèrent peu de
dégâts et les interruptions de service furent très
brèves. À part de rares exceptions, les communications
des membres de l’Entente entre eux et avec leurs colonies
et le reste du monde restèrent intactes pendant toute
la guerre. Bien au contraire, elles furent même améliorées
par la saisie des câbles allemands qui furent détournés
pour servir aux besoins de l’Entente.
Bien entendu, les câbles ne suffirent
pas à transmettre tout le trafic commercial et les informations
en augmentation à cause de la guerre. C’était
surtout le cas dans l’Atlantique nord après l’entrée
des États-Unis dans la guerre au début de 1917.
Pour suppléer aux câbles, les puissances alliées,
et surtout les États-Unis, construisirent de puissants
émetteurs de TSF. Mais les messages les plus importants
et les plus secrets furent envoyés par câble, et
les services de renseignements allemands n’obtinrent aucune
information de valeur en interceptant les messages transmis
par TSF.
Pendant ce temps, les services de renseignements
de la marine anglaise purent intercepter et déchiffrer
les messages allemands transmis par des voies détournées
sur les câbles anglais. Le plus célèbre
de ces télégrammes fut celui envoyé par
le ministre allemand des Affaires étrangères Arthur
Zimmermann à son ambassadeur de Mexico Heinrich von Eckhardt,
lui ordonnant d’inciter le Mexique à attaquer les
États-Unis. Ce télégramme fut envoyé
dans le code diplomatique suédois superposé au
code diplomatique allemand et passa de Stockholm à Buenos
Aires par un câble anglais, et de Buenos Aires à
Washington par un câble américain. L’idée
saugrenue de Zimmermann fut connue des Américains quand
les Anglais déchiffrèrent le message et l’envoyèrent
au président Wilson, le persuadant de déclarer
la guerre à l’Allemagne.
L’entre-deux-guerres
Après quelques querelles au lendemain
de la guerre, l’industrie des câbles retourna à
son fonctionnement normal en 1922-1923. On répara les
vieux câbles, les anciens câbles allemands furent
remis en service par leurs nouveaux propriétaires, et
la demande en communications outre-mer ne fit qu’augmenter.
Dans les années 1920 par conséquent, les compagnies
câblières posèrent de nouveaux câbles
plus efficaces à travers l’Atlantique nord. Les
compagnies de câbles américains dominèrent
cette partie du monde, mais elles furent également rejointes
par des compagnies anglaises, françaises, allemandes,
et même italiennes. Les Anglais posèrent un câble
nouveau et bien plus rapide à travers l’océan
Pacifique. Dans les autres océans, où la demande
était moins intense, les vieux câbles, aidés
par de puissants émetteurs de TSF, suffirent à
transmettre le trafic.
L’introduction de la radio à ondes
courtes en 1927, suivie par la dépression économique
en 1929, faillit ruiner les compagnies de câbles. Les
directeurs de la compagnie anglaise Eastern and Associated,
qui dominait l’industrie des câbles dans toutes les
mers du monde sauf l’Atlantique nord, comprirent que leur
commerce n’avait plus d’avenir. Ils proposèrent
de vendre les câbles de leur compagnie, de distribuer
ses réserves financières à ses actionnaires,
et de clore ainsi ses affaires. Seule l’intervention du
gouvernement britannique sauva le réseau de ce sort ignominieux.
En fusionnant tous les intérêts de câbles
et de radio dans une seule compagnie contrôlée
par le gouvernement et appelée Imperial and International
Communications Ltd., le gouvernement veilla à ce que
les bénéfices obtenus par la radio maintiennent
en vie le réseau des câbles.
La raison pour laquelle le gouvernement entreprit
de sauvegarder une technologie périmée était
entièrement stratégique. Les stratèges
anglais savaient très bien que le trafic par radio était
vulnérable au déchiffrement et, contrairement
aux Allemands, ils n’étaient pas convaincus que
les machines à chiffrer représentaient une garantie
de sécurité. Comme tous les stratèges,
ils pensaient à la guerre précédente. Dans
leur cas, c’était une bonne attitude à prendre.
Les câbles pendant la Seconde Guerre mondiale
À partir de la
Première Guerre mondiale, l’histoire des télécommunications
militaires se concentre presque exclusivement sur les communications
par radio. La technologie de la radio fit un bond en avant avec
l’introduction des émetteurs à ondes courtes
qu’on pouvait installer dans n’importe quel véhicule,
et même cacher dans une valise, et qui pouvaient pourtant
transmettre à longue distance. À partir de ce
moment-là, la radio devint indispensable aux opérations
des forces mobiles sur terre, en mer, et dans les airs. Mais
les transmissions par radio avaient un gros défaut :
on pouvait les intercepter. Pour pallier ce défaut, les
inventeurs s’efforcèrent de construire des machines
à chiffrer comme l’Enigma des Allemands, la machine
Typex britannique, et la M-109 américaine. Les renseignements
militaires, l’issue des batailles, et peut-être la
guerre elle-même dépendirent alors de la capacité
des belligérants à intercepter, situer et déchiffrer
les messages de leurs ennemis transmis par radio. Comme l’histoire
de la radio et des codes secrets est parmi les plus passionnantes
de la Seconde Guerre mondiale, les historiens ont plus ou moins
ignoré le rôle des câbles. Pourtant les câbles
jouèrent un rôle tout aussi crucial que la radio
pendant ce conflit.
Quand la Seconde Guerre mondiale commença
en septembre 1939, les Anglais avaient bien préparé
leurs communications télégraphiques. Afin de protéger
leurs câbles, ils avaient placé la plupart de leurs
stations de câbles dans des abris antiaériens.
Ils avaient aussi remplacé tous les employés étrangers
des compagnies de câbles par des sujets britanniques et
avaient équipé toutes les stations de câbles
avec des émetteurs à ondes courtes en cas de panne.
Du côté offensif, ils étaient
prêts, comme pendant la première guerre, à
couper tous les câbles ennemis. Les télégraphistes
en retraite ou sans emploi furent recrutés pour censurer
tous les messages privés et commerciaux entre les diverses
possessions britanniques. Les messages entre pays neutres passant
par les possessions britanniques furent examinés, mais
pas censurés. Les communications avec les ambassades
de pays neutres en Irlande, maintenant un pays indépendant,
mais lié au reste du monde par des câbles anglais,
furent retardées d’un jour. En prenant ces mesures,
les Anglais s’assurèrent qu’un nombre maximum
de messages passeraient par radio. Pour les capter, la marine
anglaise construisit des stations d’interception en Grande-Bretagne,
en Méditerranée, et en Extrême-Orient. Ils
étaient encore loin de pouvoir déchiffrer les
messages ennemis, mais ces efforts, entrepris dès le
début de la guerre, furent couronnés de succès
pendant les batailles aériennes au-dessus de l’Angleterre
et pendant la guerre sous-marine dans l’océan Atlantique.
Dès que la guerre commença, des
navires câbliers britanniques coupèrent les câbles
allemands dans la Manche, comme ils l’avaient fait vingt-cinq
ans avant. Cela ne gêna pas les Allemands, qui avaient
d’excellentes communications par radio avec le monde. Un
an plus tard, quand l’Italie entra en guerre, les navires
anglais coupèrent aussi les câbles italiens. En
revanche, les Italiens coupèrent tous les câbles
entre Gibraltar et Malte et deux des câbles reliant Malte
à Alexandrie, mais ils en manquèrent trois autres.
Ainsi, les Anglais restèrent en communication avec Malte
par les câbles qui contournaient l’Afrique, ce qui
leur donnèrent un avantage important dans les batailles
en Afrique du Nord.
En dehors de la Méditerranée,
les seules pertes importantes de câbles alliés
se produisirent dans le Pacifique occidental, où les
Japonais s’emparèrent des stations de câbles
et coupèrent les câbles à Hong Kong, Shanghai
et Singapour et en Indochine et dans les Indes orientales néerlandaises.
Bien qu’ils eussent saisi presque trente mille kilomètres
de câbles et onze stations, ils ne les utilisèrent
pas. Au début de 1942, un navire de guerre japonais bombarda
la station de câbles de l’île Cocos dans l’océan
Indien, un nœud important dans le réseau de câbles
entre la Grande-Bretagne, l’Inde, et l’Australie,
mais causa peu de dommages. Le câble résista et
continua à transmettre pendant toute la guerre, à
l’insu des Japonais dont les photos aériennes montraient
des bâtiments endommagés et qui pensaient que la
station avait été abandonnée.
À part dans l’océan
Pacifique occidental, les Alliés gardèrent l’usage
de leurs câbles et les employèrent efficacement
pendant toute la guerre. Dans certaines circonstances, leur
emploi fut décisif. En mai 1942, le service de renseignements
de la marine américaine envoya un message par câble
à la garnison de l’île Midway, leur ordonnant
d’envoyer un message en clair par radio disant que leur
installation à distiller l’eau était en panne.
Le jour suivant, la marine japonaise, ayant intercepté
le message, informa ses navires que l’endroit qu’ils
étaient sur le point d’attaquer et qu’ils appelaient
« AF » manquait d’eau. Grâce à
ce stratagème, la marine américaine savait vers
où se dirigeait la flotte japonaise, et put la surprendre
à la bataille de Midway.
Pendant la campagne nord-africaine
de 1942, la Grande-Bretagne avait toujours l’avantage des
communications secrètes avec l’Égypte et
Malte. Pendant plusieurs mois, le général Rommel
obtint d’excellents renseignements sur la disposition des
forces britanniques grâce aux dépêches que
l’attaché militaire américain en Égypte
envoyait tous les soirs à Washington. Quand les Anglais
découvrirent la fuite, l’avantage des renseignements
passa de leur côté, car les forces allemandes et
italiennes en Afrique du Nord ne possédaient pas de câbles
et se fiaient entièrement à leurs messages chiffrés
envoyés par radio que les Anglais apprirent à
déchiffrer. Les batailles dans le désert libyen
se gagnèrent autant sur les renseignements qu’avaient
les Anglais et les Allemands que sur les armes ou la qualité
des généraux.
Alors que les Allemands et les Japonais n’avaient
que la radio comme moyen de communiquer, les États-Unis
et la Grande-Bretagne envoyaient la plupart de leurs messages
secrets par câble. Pour s’assurer que leurs communications
resteraient secrètes, ils posèrent des câbles
nouveaux à chaque débarquement en territoire ennemi
: en Afrique du Nord en 1942, en Sicile et en Italie en 1943,
et en Normandie en 1944. L’avantage des Alliés pendant
la Seconde Guerre mondiale ne reposait pas seulement sur le
fait qu’ils avaient déchiffré les codes ennemis,
comme l’ont affirmé beaucoup de livres récents,
mais aussi parce qu’ils avaient réussi à
maintenir des communications plus sûres que les puissances
de l’Axe.
sommaire
LES NAVIRES-CABLIERS DANS LA GUERRE 1939-1945
En septembre 1939, la flotte câblière comprend
l’Emile Baudot (1917) basé à Brest, l’Ampère
(1930) basé à La Seyne et l’Arago (1914)
désarmé à La Seyne sur Mer. Par ailleurs,
une quatrième unité, l’Alsace, est en construction
à Rouen et destiné à être basé
à Dakar en remplacement de l’Arago. Dans les mois
qui précèdent la guerre, les navires posent des
câbles microphoniques au large des ports métropolitains
pour assurer leur
protection contre les sous-marins ennemis.
Dès l’invasion allemande, la Direction des Câbles
sous-marins, suivant le plan de mobilisation déménage
de Paris (rue du Cherche-Midi) à Montpellier (27 bis
rue Gambetta).
L’effectif est réduit, le directeur René
Couderc nommé en 1929, 5 ingénieurs, 2 rédacteurs
et 3 agents.
Le 3 septembre 1939, la guerre est déclarée entre
l’Allemagne et les alliés franco-anglais. Comme
rien ne se passe sur le front Ouest, on assiste à une
« drôle de guerre ».
Le 10 mai 1940, l’armée allemande envahit la Belgique
et les Pays-Bas puis la France. Paris est déclaré
« ville ouverte » le 15 juin 1940. Brest est occupée
le 20 juin. Le 22 juin, l’Armistice est signé à
Rethondes. La France métropolitaine est partagée
en deux parties, la zone occupée et la zone libre, siège
du gouvernement de Vichy. Pétain engage la France dans
une politique de collaboration avec l’Allemagne. Les conditions
imposées à la
France provoquent qui entraîne la chute du gouvernement
Paul Reynaud remplacé par P Laval.
Le général De Gaulle, membre du gouvernement Reynaud,
est à Londres et constate qu’il ne fait plus partie
du nouveau gouvernement de Pierre Laval. Il lance son appel
(du 18 juin) sur les ondes de la BBC.
Inquiet du contenu des accords avec l’Allemagne, Churchill
ordonne le 3 juillet 1940 l’opération « Catapult
» pour neutraliser la flotte française. Elle comporte
3 phases :
- la saisie des navires réfugiés en Grande Bretagne
(dont l’Emile Baudot)
- la neutralisation de la flotte française basée
à Mers El Kébir (Amiral Gensoul)
- la neutralisation de la flotte française d’Alexandrie
(Amiral Godfroy).
Reprenons les journaux de bord des navires. L’Arago est
à La Seyne sur Mer et attend son remplaçant, l’Alsace.
L’Ampère traverse le détroit de Gibraltar,
venant de Calais et se dirigeant vers La Seyne. Il arrive le
dimanche 27 août et après une réparation
du câble de Porquerolles, il est transformé en
croiseur auxiliaire et être armé d’un canon
de 100 mm, deux canons de 75 (anti-aériens) et une mitrailleuse
lourde (du 13 septembre au 12 octobre 1939).
La pose du câble Marseille – Oran n° 3 est réalisée
de nuit tous feux éteints entre le 1er et le 9 novembre
sous la protection d’escorteurs de la Marine Nationale.
En janvier 1940, l’Ampère pose un câble entre
les îles Planier et Pomègues pour la Marine. Il
est à Casablanca le 15 janvier, à Oran du 18 au
27 janvier. Le 28 janvier, le navire commence la pose d’Oran
– Gibraltar, opération interrompue plusieurs fois
par le mauvais temps est terminée le 27 février.
On ignore s’il fonctionna un jour (officiellement non mais
la vérité attend peut-être les historiens).
Les opérations s’enchainent puisque le navire change
les atterrissements du Marseille – Oran 1932 à Ain
El-Turk (Oran) et est envoyé pour réparer la liaison
Istanbul – Constanza (Roumanie) et la prolonger sur Izmir.
G Bourgoin note le caractère spécial de cette
mission. Le 7 mai, le navire quitte Istanbul et arrive à
La Seyne le 11 mai 1940. Le 23 juin 1940, l’Ampère
protège un convoi partant de Marseille à destination
d’Oran. Il y arrive le 26 juin. Le commandant Pelletier
hésite entre mouiller à Oran ou à Mers
El Kébir. Le choix du Cdt Pelletier est particulièrement
judicieux. Il choisit Oran, remplit les conditions de l’Armistice
en désarmant le navire et débarque son personnel.
La construction de l’Alsace s’achève le 25
avril 1940 à Rouen. Il rejoint Brest le 8 mai après
les essais à la mer et sa transformation en croiseur
auxiliaire à Cherbourg. Il doit remplacer l’Emile
Baudot prévu en arrêt technique. Le 1er juin, le
navire appareille pour travaux sur le Brest – Dakar sous
protection d’un escorteur au Nord de l’île de
Sein. Il est de retour le 11 juin5, réparation terminée
après 18 dragues, 3 bouées-câbles et 3 bouées
marques ! Le 16 juin, la ville de Brest est bombardée,
le navire reçoit son baptême du feu.
Le 17 juin, l’Alsace appareille de Brest pour une effectuer
une réparation sur le Brest – Fayal – New York
au large des Açores. La réparation de l’Alsace
terminée, sans information de Paris, les principaux du
navire décident de rejoindre Dakar. Le navire est à
quai à Dakar le 29 juin 1940.
L’Emile Baudot pose des câbles d’écoute
sous-marine le long des côtes. Il rentre à Brest
début 1940 pour une visite d’entretien. Le 19 juin,
l’Emile Baudot reçoit l’ordre de l’Amirauté
de se joindre au dernier convoi de navires de guerre et de commerce
pour rejoindre l’Angleterre (Plymouth) avec 80 personnes
à bord. A Plymouth, le désordre est indescriptible.
Le 12 juin, l’Italie déclare la guerre à
la France et à la Grande Bretagne. L’Amirauté
demande l’appareillage de l’Arago pour couper le câble
Gênes – Barcelone au large des Baléares. Le
câble est coupé mais la crainte de navires ennemis
pousse le navire et ses deux navires de protection à
rejoindre Port-Vendres pour se mettre à l’abri.
Quelques jours plus tard, il appareille en convoi pour Oran
où il est mis en réserve.
Les accords franco-allemands d’armistice prévoient
la démobilisation de l’Armée Française
et la neutralisation de la Marine Nationale. Ainsi, Paul Leca,
aviateur en formation à Gaillac comme tous les appelés
de l’Armée est démobilisé et renvoyé
dans ses foyers à Marseille. Il reste disponible pour
tout embarquement dans la Marine Marchande.
Dans la nuit du 2 au 3 juillet 1940, l’Emile Baudot toujours
à Plymouth est saisi par un commando militaire. Le personnel
à bord est envoyé à Liverpool. Quant au
navire saisi et désormais britannique, il sera basé
en Inde. Il sera rendu à Gibraltar le 22 décembre
1944 dans un état déplorable et sans archives
ce qui ne permet pas de reconstituer son emploi du temps au
service de la Grande Bretagne.
Le lendemain, le 3 juillet 1940, la flotte anglaise de Somerville
détruit l’escadre de l’Amiral Gensoul basée
à Mers El-Kébir (1297 morts côté
français). Une première tragédie pour la
Marine Nationale française !
Par contre devant Alexandrie, les deux amiraux Cunningham et
Godfroy qui se connaissent évitent l’affrontement
et s’accordent pour neutraliser la flotte française.
Stationné ne Egypte, elle pourra reprendre le combat
à partir de juillet 1943.
Après l’opération « catapult »,
le personnel de l’Emile Baudot est envoyé à
Liverpool en vue d’un rapatriement en
France. Le 24 juillet, il embarque sur le Meknès de la
Cie Générale Transatlantique, torpillé
au large d’Ouessant.
Le navires britanniques d’escorte sauvent la plupart des
naufragés à l’exception de deux matelots
et du boulanger qui périssent dans le naufrage. Les rescapés
retournent à Liverpool. Cinq jours plus tard, ils embarquent
sur l’Aveyron et rejoignent la France sans incident.
Les trois autres navires-câbliers français sont
démilitarisés sur place. L’Alsace est à
Dakar le 1 août 1940,
l’Ampère est à Oran 11 août et l’Arago
à Casablanca. René Couderc retrouve son autorité
sur la flotte câblière. La vie continue La reconquête
des colonies françaises par les FFL commence à
partir l’été 1940 et la résistance
s’organise en métropole. Dès le 27 mai 1940,
le Gal de Gaulle affirme son autorité sur les territoires
libérés et Brazzaville devient la capitale de
la France Libre. Des territoires choisissent la France Libre
dès juin 1940 : Tchad, Cameroun, AEF mais également
les territoires du Pacifique (Nouvelles Hébrides, Tahiti
et Nouvelle Calédonie), les Antilles et les
comptoirs de l’Inde (officiellement le 9 septembre 1940).
Par contre, La tentative de reprise de Dakar le 23 septembre
1940, mal préparée localement, est un échec
et l’Indochine passe bientôt sous contrôle
japonais .
Le 27 octobre 1940 à Brazzaville, De Gaulle affirme son
manifeste, acte fondateur de la France Libre. Ce choix n’est
pas anodin, car Brazzaville est l’un des 4 centres radiotélégraphiques
de l’espace colonial et l’information « libre
» sera diffusée de Brazzaville et de Londres.
Pendant cette période, la vie continue pour l’Alsace.
Il est démilitarisé à Dakar le 1 août
1940 et répare le Casablanca – Dakar du 19 au 29
août 1940 sous protection. Son chef de mission M Miramont
décède le 2 septembre. Le 23 septembre 1940, le
navire se trouve en première ligne lorsque les FFL appuyés
par une force britannique attaquent la ville de Dakar. René
Couderc décide alors d’envoyer le navire à
Casablanca qui semble offrir plus de sécurité
et surtout moins d’intérêt pour les britanniques.
Il appareille le 9 janvier 1941 et y arrive le 14 janvier 1941
e l’Arago le rejoint le 19 janvier. En février et
L’activité principale des navires est de récupérer
le cuivre en « épluchant » les câbles
abandonnés.
Des opérations côtières (avec l’Alsace)
sont menées sur le câble microphonique avec récupération
de nombreuses ancres mais entre le 24 janvier et le 10 mars.
Ensuite, on enregistre de nombreux actes d’indiscipline
de l’équipage sénégalais et des cadres
européens (qui réclament le long cours) entre
avril et juillet 1941 assortis de sanctions diverses dont des
séjours en prison de quelques jours à six mois).
Apparemment, le navire a peu d’activités jusqu’en
juin 1942. L’Alsace appareille de Casablanca le 8 juin
1942 pour Oran (arrivée le 11 juin). Il réduit
son équipage et attend...
Le 31 octobre, il fait route sur Alger et entre au bassin de
carénage à Alger. (ordre de la direction). Une
grande fébrilité est notée à bord
avec débarquement de matériel, destruction de
documents secrets et des alertes annonciatrices de l’opération
« Torch ». Il est à flot le 12 novembre mais
sans remorqueur pour déhaler. A sa sortie, il complète
son équipage car il doit se rendre à Casablanca
Un complément d’équipage est embarqué
le 2 décembre pour un appareillage en convoi le 20 décembre.
Ainsi, Paul Leca embarque comme graisseur le 3 décembre
1942 se trouve toujours à bord le 20 décembre.
Paul Leca se souvient de cette période qui suit l’Armistice
et sa démobilisation. « Je suis à Marseille
depuis ma démobilisation de l’Armée de l’air
le 10 septembre 1941. Muni de mes certificats de mécanicien
et de pilote, je réussis grâce à un ancien
Corse à embarquer sur le Djebel Amour, moutonnier de
la C° de Navigation Mixte qui assure les transports entre
Marseille et l’Afrique du Nord. Tout un programme ....
Mon plan initial est d’embarquer sur un autre navire rapatriant
des prisonniers de Syrie. »
Au retour du Djebel Amour, les prisonniers sont tous rapatriés
et Paul embarque à nouveau. L’inspecteur des Affaires
maritimes visant le livret s’étonne de me voir embarquer
comme nettoyeur sur ce navire compte tenu de mon niveau d’études
et de ma qualification de mécanicien:
« Avec un emploi à terre, je gagne 600 francs par
mois alors que j’en gagne 800 à bord, tous frais
payés, répond Paul.
Bien que peu convaincu, l’inspecteur me laisse embarquer.
Une première campagne du 10 au 20 septembre 1941 est
suivie d’un second embarquement de 3 mois jusqu’au
17 décembre 1941 et enfin d’un embarquement de 6
mois sur l’El Kantara jusqu’au 2 juillet 1942.
Le 8 juillet 1942, pas de sursis, je dois faire mon service
national dans les chantiers de Jeunesse. Grâce à
ma qualification d’inscrit maritime, j’ai le choix
entre Port la Nouvelle et Cap Matifou. Je choisis le chantier
de la Marine Nationale en Algérie où je séjourne
jusqu’en novembre 1942, où j’embarque sur l’Alsace.
Revenons à l’Arago. Il est réarmé
en mars 1941 puis désarmé. Après réarmement,
il quitte Casablanca pour Oran le 7 novembre 1941. Le navire
est prêt à appareiller d’Oran pour Dakar mais
il faut compléter son équipage. Cette décision
viendra un an plus tard mais ce sera l’Alsace qui partira
à Dakar. En attendant le navire restera au fond du port
de commerce avec son équipage réduit.
En fait, les NC Arago et Alsace et leurs équipages, dont
Paul Leca sur l’Alsace sont rattrapés par l’opération
« Torch » qui va modifier le cours de la guerre.
La longue période d’inaction est terminée.
A la Seyne sur Mer, l’Ampère assure l’entretien
des câbles qui relient Marseille à l’Afrique
du Nord, les deux parties de la zone libre. Après sa
démilitarisation en août 1940, Il enchaîne
les opérations sous protection qui sont décrites
dans les journaux des travaux n° 10 et n° 11 de l’Ampère
2: Ces réparations sont séparées par des
routes en convois .
Le 8 novembre 1942, à l'aube, les premiers vaisseaux
alliés de l'opération Torch (en français
Flambeau) abordèrent les plages d'Afrique du nord de
ses différents objectifs (Alger, Oran et Casablanca),
à la surprise de ses équipages, sans avoir été
inquiétée par les sous-marins de l’Axe, qui
attendaient plus loin, du côté de Malte. Ce débarquement
marque un tournant de la Seconde Guerre mondiale sur le front
occidental, conjointement avec les victoires britanniques d’El
Alamein (24 octobre 1942 au 8 novembre 1942) et soviétique
de Stalingrad (17 juillet 1942 au 2 février 1943).
Par contre, il n’était pas prévu que les
généraux de Vichy accueillent les Alliés
à coups de canon à Oran et sur les plages du Maroc
où ils ne se rendent que le 11 novembre 1942. La prise
d’Alger se fait en un jour, le 8 novembre 1942 grâce
à la résistance française. Au soir du 8
novembre, Juin obtint de Darlan l'autorisation d'ordonner le
cessez-le-feu, ce qui permet aux troupes alliées de pénétrer
dans Alger sans trop de problèmes. Du même coup,
les Alliés disposent, le soir même du 8 novembre,
d'un grand port intact, où troupes et matériels
vont pouvoir immédiatement débarquer sur une grande
échelle. Le bilan des opérations est de 1346 morts
chez les français et 479 morts du côté allié.
La prise de contrôle de l'Afrique du Nord entraîne
le ralliement à la France Libre de l'ensemble des colonies
africaines. Le général de Gaulle n'avait été
ni consulté ni mis au courant du débarquement
par les alliés. Il se rend à Alger pour empêcher
que le pouvoir ne lui échappe et constitue, avec le général
Giraud le Comité français de la Libération
nationale (CFLN). L’amiral Darlan, fidèle au gouvernement
de Vichy est assassiné le 24 décembre 1942.
L'établissement d'une tête de pont alliée
en Afrique permet de préparer le débarquement
de Sicile et d’ouvrir en 1943 la campagne d’Italie
.
Le 27 novembre 1942, Hitler décide l’invasion de
la zone libre. La flotte se saborde lorsque l’occupant
prend Toulon .
G Bourgoin note dans son étude6 que la Direction décide
d’envoyer le navire à Dakar pour le protéger
et que les britanniques décident alors de le réquisitionner.
Apparemment, les deux autorités ont besoin du navire
et le programme qui va suivre montre une activité ininterrompue
du navire jusqu’à la fin de la guerre sur les câbles
français ou anglais de la côte d’Afrique.
L’arrêt à Gibraltar est justifié par
des raisons de sécurité et peut-être pour
embarquer des documents concernant les câbles britanniques.
L’Alsace appareille en convoi le 20 décembre 1942,
le navire mouille devant Gibraltar le 23 décembre en
rade extérieure de Gibraltar. Il appareille le 2 janvier
sous escorte et arrive à Casablanca le 3 mars 1943. Retrouvant
l’Arago, il est prévu de permuter les câbliers
Arago et Alsace et de baser l’Alsace à Dakar avec
l’équipage de l’Arago. Paul et plusieurs membres
des chantiers de jeunesse refusent les conditions de vie à
bord du vieil Arago .
Ils débarquent au dépôt de la Marine Marchande
de Casablanca. Ils restent mobilisables dans la Marine Nationale.
L’Alsace est à Dakar le 19 mars 1943. Revenant à
Paul. Après son débarquement, il reprend contact
avec l’aviation militaire (parc régional 94 de
Casablanca) et quitte la marine marchande le 18 avril 1943.
Il réussit à se faire affecter dans l’aviation
(du 20 avril 1943 au 25 août 1943) et part pour les Etats-Unis
le 15 octobre 1943. Il en revient muni de ses brevets de mitrailleur
et de mécanicien sur l’appareil Maraudeur et prend
une part active dans la campagne contre l’Allemagne.
Il est démobilisé le 28 mai 1947 avec le grade
de sergent–chef de réserve et recherche un travail.
Enfin, l’Ampère est à La Seyne sur Mer, sous
le commandement de Jean Pelletier. Il est sur rade le 27 novembre
1942 et le seul à arborer le drapeau tricolore. Pourtant
les autorités allemandes commencent à s’intéresser
à lui et finissent par le réquisitionner le 20
décembre 1943 puis l’envoyer à Marseille.
A partir de Mars 1943, l’Alsace et son équipage
africain se lancent dans la remise en état des câbles
de la cote d’Afrique .
L’Ampère 2 est réquisitionné par les
Allemands le 20 décembre 1943. Le navire est transformé
en croiseur
antiaérien. Le personnel a le choix entre un emploi à
terre dans un service des PTT, ce qui le soustrait au STO et
de conserver sa solde. Ou de reprendre sa liberté. La
majorité conserve leur emploi dans les PTT.
L’Arago est remis aux Domaines en 1946 et acheté
par la Marine Nationale, puis revendu à un chantier de
démolition Seynois en 1950. La Marine le renomme le Scaphandrier
Van Oudenhove.
Enfin, les autorités britanniques remettent l’Emile
Baudot à l’Ingénieur en Chef Michel et au
commandant Jean Pelletier le 24 décembre 1944 à
Gibraltar.
Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent
sur les plages de Normandie. Paris est libéré
le 25 août 1944.
Le 15 août 1944, les troupes alliées débarquent
sur les plages de la Côte d’Azur, les villes de Marseille
et Toulon sont libérées le 25 août mais
les autorités allemandes avaient décidé
de détruire leurs forces vives.
Les chantiers et la ville de La Seyne, l’arsenal de Toulon,
le port de Marseille et son pont transbordeur sont minés
et détruits. Enfin, le 8 mai 1945, l’Allemagne signe
sa capitulation.
Dans les ruines du port de Marseille, on retrouve deux navires-câbliers
parmi toutes les unités coulées par les Allemand
entre le 15 et le 25 août 1944. Ils sont coulés
le long du quai Jamet et il s’agit du Giasone 2, navire
câblier italien et l’Ampère 2. Après
une inspection du navire, ce dernier est irrécupérable.
Le Giasone 2, par contre, semble offrir quelques perspectives
de récupération après renflouement.
La guerre est finie et des quatre navires en service en septembre
1939, l’armement des PTT n’en possède plus
que deux capables de remettre en état un réseau
particulièrement éprouvé. Le directeur
René Couderc commence à réfléchir
au devenir de sa flotte mais également à ses hommes.
Il a été promu Inspecteur Général
Adjoint en 1942, puis Inspecteur Général et peut
compter sur son adjoint, l’IGC Michel. Il perd deux chefs
de
mission, Miramont, chef de mission des navires de la côte
d’Afrique est décédé le 2 septembre
1940 et l’ingénieur en chef Arnold Hanff9 s’est
réfugié dans sa faille à La Souterraine
(Creuse) puis a choisi le maquis10. Il a été capturé
et fusillé le 14 mars 1944 à Brantôme par
les allemands. Par ailleurs, il récupère un ingénieur11
qui avait choisi tardivement le régime de Pétain
et se trouve dégradé par la Commission d’épuration
instituée au sein du ministère des PTT et muté
d’office à la DCSM le 12 juillet 1945.
Quant à René Couderc, l’administration décide
de le placer mis en position de détachement au titre
de l’article 33 de la loi du 30 décembre 1913 au
commissariat à la mobilisation des métaux non
ferreux. Elle le réintégre dans les cadres de
l’Administration à partir du 1er août 45 et
il est admis d’office à faire valoir ses droits
à la retraite, à compter de la même date.
Il n’aura donc pas la charge de remettre le réseau
en état.
Revenant à Paul Leca. Après son débarquement
de l’Alsace à Casablanca et son refus d’embarquer
sur l’Arago, il reprend contact avec l’aviation militaire
(parc régional 94 de Casablanca) et quitte la marine
marchande le 18 avril 1943. Il réussit à se faire
affecter dans l’aviation (du 20 avril 1943 au 25 août
1943) et part pour les Etats-Unis le 15 octobre 1943. Il en
revient muni de ses brevets de mitrailleur et de mécanicien
sur l’appareil Maraudeur et prend une part active dans
la campagne contre l’Allemagne. Il est démobilisé
le 28 mai 1947 avec le grade de sergent–chef de réserve
et recherche un travail....
De retour à Marseille... Plusieurs voies s’ouvrent
devant lui. Son expérience dans l’aviation lui permet
d’obtenir du secrétariat de l’aviation civile
une licence de mécanicien d’aéronefs à
compter du 7 septembre 1947 (valable jusqu’au 28 mars 1948).
Il se rend à Paris au siège d’Air France
en pensant à tous ses camarades du groupe Franche Comté
dont beaucoup sont disparus. Il constate que la compagnie nationale
est peu sensible aux états de services légaux
et il se tourne alors vers les navires câbliers.
Il embarque sur le d’Arsonval le 23 avril 1948 comme
graisseur. Il est nommé chauffeur le 9 juin. Le 3 mai
1951, il est affecté sur l’Ampère à
Rouen jusqu’en novembre 1952. Le 12 juillet 1952, il est
nommé Officier Mécanicien de 3ème classe
et est embarqué sur l’Alsace à La Seyne.
Marcel Bayard remplace René Couderc à la direction
des câbles sous-marins. Il complète la flotte câblière
et s’attelle à la rénovation des réseaux
d’Atlantique et de Méditerranée. Le réseau
de la Côte d’Afrique avait été remis
en état en 1943-1944. Des prélèvements
importants ont été saisis par les câbliers
britanniques et américains, les câbles ennemis
devenant la principale source de réapprovisionnement
de câbles de réserve puisque toutes les usines
à câbles étaient détruites .
|
sommaire
|
La création de l'usine de la Seyne
sur Mer
Un décret du 10 janvier 1881 affecta au service,
un terrain de 10.654 mètres carrés appartenant
à l'État.
Les travaux commencèrent aussitôt ; il s'agissait
de creuser une darse et son chenal d'accès, de construire
une usine avec ses dépendances, hangars, magasins, ateliers,
pavillon administratif.
Fin 1881, les bâtiments étaient terminés,
la darse et le chenal en voie d'achèvement. On avait
installé : deux chaudières, une machine motrice,
une câbleuse (tout ce matériel provenait de l'atelier
du Mourillon) et trois tours à bobiner le fil de fer,
un tour à bobiner le fil de caret, un tour à bobiner
les bandes de toile. Les établissements Mouraille et
Cie de Toulon avaient réalisé et mis en place
trois nouvelles chaudières, une machine motrice et les
systèmes de transmission pour les câbleuses à
venir. Deux câbleuses (ou machines à revêtement),
l'une pour les câbles côtiers et atterrissements,
l'autre pour les câbles grands fonds et intermédiaires,
avaient été commandées en Angleterre à
la compagnie The India Rubber Gutta Percha and Telegraph works.
Le marché avait été conclu le 27 octobre
1880, et les machines arrivèrent à la Seyne
le 1er octobre 1881 sur le vapeur « Venetia ».
Le montage effectué par les ouvriers anglais débuta
le 25 décembre de la même année et fut achevé
le 7 mars 1882. Les deux machines rendues à quai coûtèrent
95.000 F. Les fabrications commencèrent aussitôt.
 Une cableuse de l’usine des câbliers à
La Seyne
Une cableuse de l’usine des câbliers à
La Seyne
La fabrication des câbles télégraphiques
Le câble était constitué d'un conducteur
électrique et d'une armature.
Le conducteur électrique ou âme en cuivre pur était
formé de plusieurs fils de 1 millimètre de diamètre
environ, câblés autour d'un fil central de 3 millimètres.
Le toron ainsi obtenu, souple et supportant bien les efforts
de traction et de lovage, passait dans un bac contenant la matière
isolante maintenue à une certaine température
(mélange de gutta-percha, goudron et résine; cette
dernière facilitant l'adhésion de la gutta sur
le cuivre). Au
sortir du récipient à composer, le toron passait
dans le bac à gutta-percha gardée liquide par
la chaleur et sortait par une filière, de telle façon
que la couche de gutta fut homogène et exempte de bulles
d'air. Cette couche était ensuite refroidie sous une
rampe à eau avant que le câble soit enroulé
sur bobines et soumis à diverses mesures électriques
sous une température constante (résistance, isolement,
capacité).
Ces mesures permettaient d'établir les caractéristiques
du câble au mille marin et de vérifier s'il ne
présentait pas de défaut.
Les proportions entre la quantité de fil de cuivre et
de matière isolante étaient déterminées
au Mille Nautique selon le type de câble à fabriquer
et la vitesse de transmission désirée Pour les
câbles de moyenne longueur, cette proportion s'établissait
à 59 kilogrammes de cuivre pour 59 kilogrammes de gutta.
Mais pour les câbles de grande longueur (transatlantique,
par exemple) les poids variaient entre 160 kilogrammes de cuivre
pour 140 kilogrammes de gutta et 300 kilogrammes de cuivre pour
180 kilogrammes de gutta.
La gutta extraite de la sève ou des feuilles de l'arbre
à gutta qui pousse en Malaisie ou en Amérique
du Sud est un isolant très convenable (lui a été
utilisé jusqu'à une date récente. Il a
maintenant été remplacé par le polyéthylène.On
passait ensuite à la protection du câble. L'âme
était dirigée sur une câbleuse où
elle était recouverte de deux couches de fil de jute
tanné, successivement enroulées en sens inverse,
afin de la protéger de l'armature de fil de fer qui allait
la recouvrir. On soudait les différentes longueurs d'âme
entre elles (opération très délicate) et
l'on passait au recouvrement en fil de fer de l'âme ainsi
recouverte. Parfois avant la mise sous jute, on enroulait autour
l'âme un mince ruban en cuivre destiné à
la protéger de la gourmandise des tarets, petits vers
des eaux chaudes particulièrement friands de la gutta.
Suivant la profondeur à laquelle la section fabriquée
devait être immergée, on la recouvrait d'une ou
de deux couches de fil de fer et de deux couches de toile de
jute goudronné, fil de fer et jute toujours enroulés
en sens inverse, la toile de jute évitant en partie le
glissement sur les poulies et daviers.
 Personnel d’encadrement de l’usine des câbliers.
Personnel d’encadrement de l’usine des câbliers.
Au cours de ces opérations, on disposait une couche de
goudron de Norvège froid sur l'armature en fil de fer
et une couche de composé bitumeux chaud sur chaque ruban
goudronné dans le but de préserver le câble
de la corrosion. A la sortie de la câbleuse, le câble
était lové dans des cuves de stockage emplies
d'eau en attendant son chargement sur le navire câblier.
En 1892, l'installation de machines complémentaires
s'avéra nécessaire. Les consultations lancées
auprès des industriels français ne donnèrent
aucun résultat et force fut de se rabattre sur India
Rubber à Londres. Le 28 octobre 1892 un marché
fut passé avec cette société pour la fourniture
de deux câbleuses légères de grand fond.
La première fut construite en quatre mois, la seconde
en cinq mois et demi, pour un prix global de 54.520 F, livrées
à Marseille.
L'installation fut effectuée par le fournisseur et la
mise en service eut lieu en octobre 1893.
En 1894, l'usine dans son ensemble était achevée.
Elle devait rester ainsi jusqu'à la fin de son activité,
à part quelques acquisitions de terrains, adjonctions
ou améliorations. L'éclairage, au gaz l'origine,
fut électrifié en 1895, l'énergie était
produite par l'usine En 1929-1930, l'enceinte du domaine, consumée
par une palissade en pitchpin, fut remplacée par un mur,
le sol du hall des machines cimenté, un château
d'eau édifié et le raccordement à la voie
ferrée desservant les Forges et Chantiers, réalisé.
Le 27 novembre 1942, les forces allemandes occupèrent
la poche de
Toulon et l'usine par la même occasion. Toute activité
arrêtée, il ne restait plus qu'à protéger
les installations et les réserves, ce à quoi,
le personnel se consacra avec beaucoup d'application. Les occupants
ne tardèrent point à lorgner du côté
du navire câblier « Ampère » qui séjournait
dans
la darse, avec l'idée de le transformer en croiseur auxiliaire.
Malgré les ruses de l'État Major et de l'équipage
qui avaient entrepris des démontages inutiles et sans
fin, le navire fut saisi le 20 décembre 1943. On parvint
à mettre à l'abri à Salernes certaines
machines et appareillage, ainsi que les instruments de mesure
et le contenu des magasins.
Grâce à ces précautions, les fabrications
purent reprendre dans un délai record à la libération
du territoire. En août 1958, l'activité de l'usine
fut définitivement arrêtée ; le câble
télégraphique avait fait son temps et les machines
étaient impropres à la fabrication des câbles
téléphoniques. Elles
furent remises aux Domaines pour la vente.
Ainsi avec l'abandon des câbles télégraphiques,
disparaissait l'usine de la Seyne sur Mer, l'usine, car le service
des câbles sous-marins lui même repartait pour un
avenir différent, mais aussi prometteur.
sommaire
La concurrence du privé (1891-1918).
Le grand décollage de l’activité
câblière démarre en 1892 avec les deux autres
usines construites par le secteur privé : l’une
est construite en 1888 à Calais par la Société
Générale des Téléphones, l’autre
installée en 1892 à Saint-Tropez par le Société
Grammont. La SGT achète également un navire de
pose : le François Arago. La Société Industrielle
des Téléphones, constituée en 1895, regroupe
toutes les activités câbles sous-marins de la SGT
: les deux usines de Bezons et Calais et le François
Arago. Elle construira des liaisons dans le monde entier : un
transatlantique, un réseau aux Antilles, des câbles
côtiers, méditerranéens et sur la Côte
d’Afrique mais également des liaisons destinées
à raccorder les territoires français au réseau
mondial : Nouvelle Calédonie, Madagascar, Indochine ….
1891 est une année clé dans l’histoire
des câbles. Le 19 avril 1891, un dimanche, la presse nationale
et toutes les Autorités civiles et militaires inaugurent
l’usine de Calais. Le Westmeath (futur François
Arago) est amarré au quai de la Loire avec son chargement
de câbles du réseau des Antilles. Il appareille
le 21 avril à 11 heures du soir compte tenu de la marée.
Le 21 juillet 1891, un curieux débat
se déroule à la Chambre des députés.
On vote un crédit de 5.500.000 francs pour construire
des liaisons Marseille-Oran et Marseille-Tunis. Millerand et
la gauche défendent la construction des câbles
à La Seyne mais le Ministre Freyssinet sort un lapin
: la construction d’une seconde usine privée entre
Toulon et Marseille. Il ajoute : " c’est à
la Chambre de juger où est l’intérêt
de l’Etat et si c’est à elle de dire si elle
voit cet intérêt dans la mainmise de l’Etat
sur une fonction industrielle nouvelle ou au contraire dans
une porte plus largement ouverte à l’initiative
privée ". La Chambre suit le Ministre du Commerce
et de l’Industrie, les crédits sont votés
mais l’attribution des marchés fera l’objet
d’un appel d’offres entre les sociétés
privées. Ainsi, chaque industriel aura la responsabilité
de l’installation d’une liaison : à l’usine
de la SIT de Calais, la liaison Marseille-Oran et à l’usine
Grammont de Saint-Tropez, la liaison Marseille-Bizerte-Tunis.
L’usine de La Seyne continue ses fabrications
de câbles à partir d’âmes (fils isolés
à la gutta) approvisionnées dans le secteur privé
en Angleterre ou en France (Bezons) ou reconstitue des r&serves
à partir de câbles relevés sur réparation.
Ils sont utilisés sur le réseau côtier.
Pendant toute cette période, la fumée qui sortait
de la cheminée de l’ usine donnait le signal d’une
fabrication et les travailleurs seynois accouraient pour trouver
une embauche temporaire en complément de leur activité.
En 1895, Paul Bayol est remplacé par
Charles Morris à la tête du service des câbles
sous-marins. Les responsables de la Charente cèdent également
leur place. M Phillipot succède à M Guisolphe.
M. Augustin prend une seconde retraite en 1908 et est remplacé
par M Durbec. En 1902, Henri Reynouard est sanctionné
pour avoir distribué le Pèlerin à des ouvriers
et à des marins et il est muté disciplinairement
à Vannes. On ne badine pas avec les principes sous le
Ministère Combes ! Le domaine bénéficia
de deux agrandissements en 1896 et surtout en 1904 (5.485 m2).
Lorsque les autres usines sont trop occupées
à construire le réseau d’Atlantique Nord
de la CFTC ou le réseau colonial d’Afrique de l’Ouest
(Brest-Dakar 1905) et de l’océan indien, l’usine
de La Seyne fabrique des liaisons importantes. Les deux câbles
Oran – Tanger (1901) et Tanger – Cadix (1905) ont
été fabriqués à La Seyne. De Cadix
on peut rejoindre Saint-Louis et Dakar, et disposer d’une
liaison de secours en cas de rupture du Brest-Dakar.
Nous disposons du témoignage de Louis
Roussel qui embarqua sur presque toutes les campagnes du François
Arago comme second Ingénieur en tant qu’ adjoint
de Louis Rouillard (inventeur d’un grappin toujours en
service). Au départ de L. Rouillard, il est chef de mission
et il rend compte du travail à bord de ce navire poseur
de câbles sous-marins. Entre 1893 et 1914, un siècle
avant le Vercors, le François Arago a parcouru le monde
: des Antilles en Nouvelle Calédonie, d’Atlantique
Nord en Chine, de Madagascar à la Côte d’Afrique.
La Direction quitte La Seyne pour Paris (1905).
La Seyne de 1905 à 1919.
La Direction du service quitte La Seyne en 1905
pour la capitale. M Laroze est nommé directeur du service.
Il n’a pas laissé le souvenir d’ un homme dynamique.
Le directeur de l’usine est alors M Pasquion qui conserva
ses fonctions jusqu’à la retraite prise à
La Seyne.
Un quatrième Marseille – Alger est
posé en 1913. Le remplacement de la Charente est programmé.
On commande le navire en Angleterre sur les plans d’un
navire existant pour réduire les coûts d’étude
et de fabrication. Mais la guerre éclate et le navire
n’est livré qu’en 1918 : ce sera l’Emile
Baudot. La charge de maintenir le réseau d’Afrique
du Nord sera encore assurée par la Charente, qui ne chômait
pas.
La guerre des réseaux sera une constante
des guerres mondiales. La Convention Internationale du 14 mars
1884 sur la protection des câbles sous-marins n’est
pas applicable en temps de guerre. C’était la volonté
des Britanniques. Ainsi, ceux qui ont la maîtrise des
mers ont également celle des réseaux télégraphiques.
Après les deux conflits mondiaux, les vainqueurs se partageront
les câbles et les navires des vaincus au titre des dommages
de guerre.
Au début de la guerre, les alliés
ont reconfiguré le réseau Allemand. Le câble
Emden – Ténériffe - Monrovia est
transformé en Brest – Casablanca – Dakar. A
la fin de l’opération, le navire-câblier Dacia
est coulé en décembre 1915 par un sous-marin allemand
en rade de Funchal (Madère). A la fin de la guerre, l
es dépouilles sont partagées à partir du
Cap des Palmes entre les Anglais (à l’Ouest) et
les Français (à l’Est).
Michel Zunino embarque mousse le 16 octobre
1916 sur la Charente, il a 13 ans et son certificat d’études
en poche. Présenté par ses parents, il découvre
le monde du travail dans toute sa rigueur. La journée
de travail est longue et dure. M Zunino terminera sa carrière
premier maître soudeur à la fin des années
60, en étant chargé du contrôle en usine
des fabrications de câbles.
Lorsque la radiotélégraphie commerciale
apparaît dans les années 20, cette nouvelle technique
est plus complémentaire que concurrente. Elle permet
de relier les villes de l’intérieur. La radiotéléphonie
grande distance transatlantique ne se développe qu’à
partir de 1935. Elle n’a jamais été une véritable
concurrente de la télégraphie.
sommaire
L’entre deux guerres et la seconde guerre
mondiale (1919-1945).
L’Empire Colonial soutient la politique
industrielle du secteur des câbles sous-marins. En 1922,
le réseau français représente 25% de la
longueur totale du réseau mondial (76.000 MN / 318.158
MN). Le réseau public comprend les câbles côtiers,
le réseau de Méditerranée et les anciens
câbles allemands alloués en 1919 au titre des dommages
de la guerre. Deux sociétés privées, la
CFCT et la SUDAM exploitent leurs réseaux en service
respectivement sur l’Atlantique Nord (CFCT) et l’Afrique
et l’Amérique du Sud (SUDAM).
Au lendemain de la première guerre mondiale,
l’activité se réduit. M Laroze n’a pas
laissé une bonne image de son passage.
Original et peu ambitieux, il a laissé son nom dans les
tables du Conseil d’Etat où sont enregistrés
les recours pour " excès de pouvoir ". On raconte
qu’il s’installait dans le wagon réservé
aux Parlementaires lorsqu’il prenait le train pour venir
à Toulon. Il déjeunait en commençant de
préférence par un saucisson à l’ail
qui décourageait toute intrusion dans son compartiment,
y compris celle des contrôleurs qui ne lui demandaient
que rarement de justifier de sa condition de Parlementaire.
A un contrôleur insistant, il répondait invariablement
: Vous m’insultez mon Ami ?
Il faut rappeler, à sa décharge,
que les investissements publics sont orientés vers le
développement de la radio à partir de 1920.
L’Emile Baudot ne comble pas les espoirs
mis en lui. Le modèle assurait l’entretien du réseau
de la Manche par petits fonds et près des côtes.
Or, on lui demande d’essuyer les coups de Mistral et la
mer Méditerranée. En 1925, la société
A. Grammont est choisie pour la construction du câble
Marseille-Philippeville. La pose est confiée à
un navire anglais le Silvergray. Ce sera la dernière
fabrication de l’usine qui cesse son activité en
1926. Sur ce navire, deux représentants du service, le
commandant de Pontbriant et son lieutenant M Pelletier. Ce dernier
a écrit l’histoire détaillée de son
passage aux câbles sous-marins entre 1926 et 1960 et collabore
à l’ouvrage de Louis Baudoin sur " L’histoire
Générale de La Ville
de La Seyne sur Mer ".
En 1930, la dégradation de la qualité
du service et les interruptions trop fréquentes des liaisons
sur l’Algérie provoquent
des remous au Parlement. L’Administration prend plusieurs
mesures : La nomination d’un nouveau directeur : M Couderc
et le lancement d’un navire : l’Ampère 2. Le
navire est construit à La Ciotat et, à sa mise
en service, l’Emile Baudot est envoyé au Havre pour
l’entretien des câbles côtiers et des câbles
avec l’Angleterre.
L’arrivée de l’Ampère sonne le glas
de la Charente, restituée à la Marine Nationale.
Les usines de Calais et La Seyne reprennent une activité
soutenue. Il s’agit de renforcer du réseau de Méditerranée
et de redéfinir la configuration du réseau
de Cote d’Afrique.
Un navire-câblier supplémentaire,
l’Arago est acheté en Angleterre et basé
à Dakar en 1932. L’équipement de tous les
navires est modernisé et des sondeurs électriques
remplacent les sondeurs acoustiques. Chaque pose est précédée
d’une
campagne de sondage et le meilleur tracé possible est
recherché. Les fabrications s’améliorent,
le réseau est rénové, les réparations
sont moins nombreuses.
En 1935, l’Administration des PTT reconfigure
le réseau de la côte d’Afrique. La liaison
Lomé – Douala est utilisée pour en faire
un Cotonou–Douala et la liaison Monrovia–Lomé
(partie Est) pour un nouveau Grand Bassam– Cotonou. Le
reliquat (partie Ouest du Monrovia – Lomé) est utilisé
comme câble de réparation. Il s’agissait de
câble de grand fond mais les besoins étaient surtout
par petits fonds, ce qui eut des résultats assez catastrophiques.
Ce travail demandera six mois à l’Arago sous la
direction de l’Ingénieur Miramont.
Les câbles Bizerte 1931, Oran 1932 et
Oran 1939 sont construits à Calais. Pour fabriquer le
câble Marseille-Bizerte 1938, les âmes sont fournies
par l’usine de Bezons et le câble est armé
à La Seyne. On commande le câble Nabeul - Beyrouth
1939
en Angleterre puisque l’usine de Calais fabrique du câble
microphonique pour la Marine. Les câbles Nabeul-Beyrouth
et Nabeul-Igalo sont opportunément installés à
la veille de la seconde guerre mondiale pour permettre à
la France de rester en relation avec ses alliés balkaniques
sans avoir à passer par l’Allemagne et ses alliés.
Pour l’inauguration de la liaison Nabeul–Igalo
à Cattaro, le ministre Jardillier fait le déplacement
avec l’Ampère. Le chef cuisinier Poly se souvient
d’un homme simple venant aux cuisines demander un changement
de menu, préférant les haricots et les pommes
de terre du menu de l’équipage à la place
de la langouste servie au carré des officiers. Le Président
du Conseil, Léon Blum devait apprécier cet homme
qui savait se faire apprécier du personnel des PTT.
sommaire
La guerre (1939 – 1945).
A la veille de la Seconde guerre, le réseau
français est équilibré. Le remplacement
de l’Arago est commandé au chantier de Normandie
à Rouen : ce vaisseau sera l’Alsace. Il est livré
par les chantiers de Rouen quelques semaines avant l’invasion
allemande. Après son armement à Brest, il est
envoyé réparer un câble aux Açores.
A la fin des travaux, il rejoint Dakar et y passera la guerre.
Ce sera le plus chanceux de tous les navires-câbliers.
Compte tenu de la rapide défaite de la France, le réseau
n’est plus utilisable dans les zones occupées.
Les Anglais coupent les câbles atterrissant
à Brest et réquisitionnent l’Emile Baudot
" manu militari " dans le port de Plymouth.
Les activités de la base de La Seyne
sont réduites. L’usine manque de matières
premières. Les câbles du réseau méditerranéen
sont toujours en exploitation jusqu’au moment de l’
invasion de la zone occupée. Devant les risques causés
par les bombardements alliés, le personnel et les archives
sont transférés à Salernes.
La Direction des Câbles est transférée
de Paris à Montpellier. L’Ampère 2, basé
à La Seyne, reste au port comme la flotte de Marine Nationale
de Toulon. Le navire est d’ailleurs militarisé et
son Commandant prend ses instructions de l’Amirauté.
Après l’occupation de la zone libre,
les Allemands saisissent l’Ampère 2 et l’envoient
à Marseille rejoindre un navire Italien : le Giasone.
Ils sont chargés de détruire le réseau
anglais. Mais les Anglais, maîtres sur mer, ne leur laissent
pas la possibilité de sortir. De leur côté,
ils coupent tous les câbles étrangers, y compris
certains câbles français et en prélèvent
des sections pour rénover le réseau.
A la Libération, l’Ampère
et le Giasone sont sabordés par les Allemands dans le
port de Marseille. Seul le Giasone est récupérable.
L’usine de La Seyne est miraculeusement préservée
de la destruction en août 1944. Les chantiers navals proches
sont pourtant entièrement détruits avant le repli
allemand. On doit ce miracle à M Thole, un Allemand du
service des PTT, qui protége l’usine de sa destruction
car il savait que la coopération entre les deux pays
reviendrait avec la
paix. Il sut s’opposer aux officiers SS.
sommaire
L’après-guerre : rénovation
du réseau (1945-1960)
L’activité reprend dès la
fin de la guerre à l'arrêt définitif de
l'usine en 1956.
Les fabrications cèdent progressivement
la place. Les ateliers développent les parties mécaniques
des répéteurs et
de nouvelles procédures de pose des câbles téléphoniques.
On forme le personnel soudeur aux méthodes de raccordement
des câbles coaxiaux et d’énergie (IFA par
exemple).
Cette époque n'est pas une période
d’inaction :
il s’agit de développer la nouvelle technologie
de câbles sous-marins téléphoniques et des
répéteurs souples et de trouver des activités
à un personnel qualifié.
Il faut également remettre en état
le réseau avec une flotte nombreuse mais peu appropriée.
En Méditerranée, l’Alsace assure le travail,
bientôt rejoints par l’Emile Baudot et le d’Arsonval
après leur remise en Etat. Ensuite on envoie l’Emile
Baudot à Brest car il est le plus adapté à
l’entretien du réseau côtier. Après
la construction de l’Ampère en 1951 (qui remplace
le Baudot), les deux navires Alsace et Ampère 3 veillent
sur le réseau côtier et sur les câbles de
Méditerranée et de la côte d’Afrique.
Le d’Arsonval rejoint Brest.
L’ère du téléphonique
des premières générations (1956 - 1970).
En 1956, apparaissent les premiers câbles
téléphoniques : Marseille-Alger, Kélibia
- Bou Ficha posés par l’Ampère 3, modifié
spécialement.
Lorsque les deux liaisons téléphoniques
sur Alger (1957) et Oran (1961) sont mises en service, elles
sont fiables et assurent le trafic vers l’Algérie.
C’est la fin des liaisons télégraphiques
… Pour poser la liaison Perpignan – Oran, un nouveau
navire est mis en service : le Marcel Bayard. C’est le
premier câblier moderne à propulsion diesel-électrique.
Il possède une machine de pose à l’arrière
adaptée aux poses de répéteurs. Il est
basé & agrave; Brest avec le d’Arsonval.
1965, avec la pose de la liaison Cannes–Ile
Rousse, marque le démarrage d’une période
de pose. Chaque année, une nouvelle liaison sera posée
vers le Maroc, la Tunisie, Israël et le Liban. Mais cette
année-là, rares sont ceux qui parient sur l’avenir
des câbles sous-marins. Les premiers satellites sont lancés
et leur principale fonction civile est de transmettre les communications
(téléphone et télévision). Le câble
sous-marin, une technique ancienne, semble être dépassé.
La direction cherche des solutions pour diversifier
les activités : campagnes océanographiques, pose
de câbles d’énergie, campagnes " spot
" (recherche des débris de la caravelle Ajaccio-Nice
– pose de matériel de recherche civile ou militaire).
Il s’agissait de tenir…
Le développement des techniques de pêche
au large de Terre Neuve donne une opportunité. Les premiers
transatlantiques de 1961 et de 1965 demandent deux ou trois
réparations par mois. Les PTT français et britanniques
sont co-propriétaires de ces câbles et obtiennent
de l’ATT une présence de navires-câbliers
européens. Une nouvelle aventure commence lorsque, chaque
année entre 1965 à 1972, l’Ampère
effectue une campagne d’été de six mois sur
les bancs de Nerre Neuve.
Sous la direction de G. Baron, chef de mission
et de M. Paglia, directeur de l’usine, l’Ampère
effectue sa première campagne en 1965. Etat-major, équipage
et mission se rendent compte du décalage entre les méthodes
de réparation appliquées par le service et celles
des Anglo-Saxons. L’Ampère répare un câble
en 48 heures contre 16 heures au Cyrus Field ou au Lord Kelvin
qui assuraient le travail. Il faut apprendre à se servir
du matériel et appliquer les méthodes de réparation
développées par le British Post Office. Pour les
ingénieurs et les techniciens navigants, Terre Neuve
est un laboratoire et un bon moyen de se perfectionner dans
la langue de Shakespeare.
M. Paglia se chargera de l’approvisionnement
du matériel de mesure et de jointage, du transfert de
technologie et de la formation de la mission technique. Les
commandants moderniseront les équipements du navire.
Il faut apprendre pour préparer l’avenir. Les équipages
connaissent un renouvellement complet. Une nouvelle génération
embarque sur les navires du midi, du personnel inscrit maritime
rapatrié d’Afrique du Nord rejoint les équipages
corses, marseillais et la vieille garde africaine embarquée
sur le navire de garde à Dakar. Les nouvelles équipes
se forment dans les brumes des bancs de Terre Neuve et du Groenland,
parmi les icebergs et les ours blancs. Avec des fortunes diverses,
tout le monde se mettra à l’Anglais. Quelques années
plus tard, certains marins se fixeront dans le Nouveau Monde
et quelques Seynois trouveront des épouses qui vivent
actuellement dans la région. La refonte des statuts du
personnel inscrit maritime (Etat-major et Equipage) est nécessaire,
de même que le régime de l’indemnité
de mer des fonctionnaires embarqués.
A toutes ces questions, des solutions seront
trouvées. Cinq ans plus tard, l’acquis doit être
transféré en Méditerranée.
En 1970, la mutation de La Seyne est décidée
avec la transformation de l’usine en base de maintenance.
|
sommaire
LE CONTRE AMIRAL JULES CAUBET AU
COEUR DES DEBATS POLITIQUES ET DES DECISIONS
|
La France ne maîtrise pas davantage le
développement du téléphone, invention récente
(1876), confiée au secteur privé. La France a
accumulé les retards et les mécontentements des
milieux d’affaires. Après un long débat public,
la Chambre adopte la loi du 16 juillet 1889 qui met fin
au monopole de fait de la SGT (Société Générale
des Téléphones) dont les réseaux téléphoniques
sont rachetés par l’Etat.
La SGT recherche des débouchés pour ses
usines et multiplie les investissements dans les Antilles (Haïti,
Saint Domingue, etc).
Elle fonde une filiale : la Société française
des télégraphes sous-marins (SFTSM) pour
relier tous les réseaux des îles par des câbles
sous-marins.
Mais en 1891, la SFTSM rencontre des difficultés pour
rentabiliser l’ambitieux réseau construit dans les
Antilles. La SGT, son actionnaire principal, se tourne vers
l’Etat en faisant remarquer qu’elle avait construit
l’usine de Calais et acheté le câblier François
Arago pour satisfaire les besoins de l’Etat et de la politique
coloniale.
Le débat du 1er juillet s’inscrit dans un contexte
politico-industriel complexe et le ministre du Commerce et des
P&T, Jules Ribot, est député du Var. En souhaitant
confier la construction des deux câbles Marseille –
Oran et Marseille – Tunis au secteur privé, il songe
à la SGT (Société
Générale des Téléphones), et à
un nouveau venu, l’industriel Grammont, qui projette d’installer
une usine à Saint Tropez.
Dans cette hypothèse, le gouvernement modifie l’équilibre
entre secteur public et privé institué en 1863
et pérennisé en 1880 avec la construction de l’usine
de La Seyne-sur-Mer .
L’affaire traîne depuis plus de deux
ans, car les industriels refusent les conditions techniques
de l’appel d’offres rédigé par les services
du ministère des P & T. Il s’agit de spécifier
un isolement inférieur à 1.000 mégohms
pour se prévenir contre l’utilisation de la résine
isolante qui
s’échappe du câble avec le temps. L’année
1890 est utilisée à la rédaction de conditions
techniques acceptables par le constructeur.
Dans cette affaire, la SGT a retardé
la mise en service des deux câbles attendus, sans doute
pour que l’usine de Calais soit complètement opérationnelle.
Le député Bastid, rapporteur du budget, ne maîtrise
pas bien ce dossier technique. Or, la commission doit présenter
une politique de câbles sous-marins visant à définir
des mesures pour réduire notre retard par rapport à
la Grande Bretagne. Il cède ce dossier au jeune député
socialiste de Paris Etienne Alexandre Millerand, élu
pour la première fois en 1884.
La France vient alors de se doter d’une industrie bipolaire
avec la Société Industrielle des Télécommunications
et Alexandre Grammont.
Elle possède également deux opérateurs
réseaux privés : la SFTSM et la Compagnie Française
du Télégraphe de Paris à New York (PQ).
Le contre amiral Caubet est nommé président de
la SFTSM en 1892, puis devient président de la
Compagnie Française des Câbles Télégraphiques
(CFCT) lorsqu’elle fusionne avec la PQ. Il donne
son nom au câblier mis en service en 1896.
Le 17 mars 1902, lorsqu’il est remplacé à
la présidence de la CFCT, il reste au Conseil d’Administration
jusqu’à sa mort le 2 février 1912.
Rappelons qu’en 1876, date de la constitution de la PQ,
le réseau télégraphique de la France la
place très loin derrière la Grande Bretagne.
Pour celui-ci, l’objectif est simple : Comment utiliser
au mieux l’argent public ?
Alexandre Millerand reprend et approfondit le dossier de son
prédécesseur. Il demande un devis au directeur
de l’usine de La Seyne et se déplace à La
Seyne.
Lorsqu’il se rend à La Seyne le 11 mai, il vient
de dénoncer vigoureusement à la tribune de l’assemblée
le massacre de onze manifestants à
Fourmies, le 1er mai. Sa mission à La Seyne-sur-Mer lui
permet d’interroger directement le directeur, le personnel
de l’usine et celui du navire
câblier la Charente. Il estime qu’ils peuvent avoir
des avis différents de ceux des bureaux du ministère.
Il s’agit d’un dossier politique, l’article
du Vingtième Siècle en témoigne.
Millerand définit l’objet de son voyage dans Le
Petit Var. Jules Ribot n’est-il pas l’élu du
Var ?
Alexandre Millerand emporte l’approbation de la commission
sur son projet de résolution par 14 voix contre 6. Il
propose :
- l’achat des deux câbles, l’extension de la
capacité de production de l’usine de La Seyne (deux
nouvelles machines à câbler et trois nouvelles
cuves de stockage de la production, l’élargissement
de la darse pour l’accueil du navire de pose pour 3.500.000
francs) ;
- l’achat d’un nouveau navire pour 2.000.000 francs
;
Ce projet de résolution est en conflit avec les vues
du ministre qui souhaite lancer un appel d’offres limité
aux industriels français. Celui-ci inscrit le débat
dans les derniers jours de la séance parlementaire, car
la proposition de la commission ne satisfait pas ce vieux routier
du parti Républicain. Jules Ribot ne manque pas de rappeler
ses vues à ses services.
Avant le débat, Millerand convoque Morris, le directeur
de l’usine de La Seyne, par la voie hiérarchique.
L’entrevue est chaleureuse, car Morris reçoit deux
lettres du cabinet du directeur général Mara datée
des 16 et 17 juin. Il est chaudement félicité.
Le ministre ne partage pas l’enthousiasme de son haut fonctionnaire
car il souhaite élargir les activités du secteur
industriel privé et éventuellement supprimer les
activités de l’usine de La Seyne-sur-Mer.
La position du rapporteur l’inquiète car elle est
en ligne avec la position traditionnelle du gouvernement : «A
l’Etat la construction et l’entretien du réseau
côtier et de la Méditerranée ; et au secteur
privé le reste du réseau, en particulier le réseau
concédé construit en Atlantique Nord et le
futur réseau colonial. »
Le 1 er juillet, trois députés soutenant le ministre
ouvrent le feu contre le texte de la commission: Eugène
Jolibois (républicain), le baron Jean Marie de Soubeyran
(droite conservatrice) et le radical Frédéric
Prévet. Ce sont des ténors du débat parlementaire.
Eugène Jolibois, avocat Général, Préfet
et Conseiller d’Etat sous le Second Empire, est député
républicain de la Charente-Maritime depuis 1876. Frédéric
Prévet, maire et conseiller général de
Nangis qui siége au Conseil du Figaro, homme d’affaire,
propriétaire de conserveries à Meaux et en Nouvelle
Calédonie, député de la gauche radicale
depuis 1885. Comme Jolibois, il défend la politique coloniale
du gouvernement.
Le baron Jean-Marie de Soubeyran député sous l’Empire
entre 1863 et 1870, représentant en 1871 et à
nouveau député depuis 1876 connaît mal son
dossier. Chef du Personnel au Ministère des Finances
en 1854, sous-gouverneur du Crédit Foncier entre 1860
et 1878, il est élu dans la Vienne depuis 1871 .
Millerand saute sur l’occasion pour défendre l’existence
de l’usine de La Seyne, construite sous le ministère
Cochery, qui vient de construire et installer une ligne
de 350 Km avec la Corse, et qui fabrique des câbles à
un prix inférieur au secteur privé. Comme elle
est utilisée à reconditionner les câbles
relevés après une réparation et que le
réseau s’étend, elle déborde d’activités
Camille Pelletan, ami de Clemenceau et farouche adversaire de
Gambetta, Ferry et Freyssinet, pose adroitement la question
qui divise les républicains: Faut-il supprimer l’usine
de La Seyne construite par eux dix ans plus tôt ?
Bien sûr que non et Millerand retourne les arguments de
ses adversaires. Lorsqu’une industrie existe, il faut la
nourrir. Pour l’usine d’Etat, les réparations
sont quotidiennes.
L’usine travaille à un prix plus réduit que
le privé. Par exemple, pour réparer le câble
Marseille - Alger en 1871, un entrepreneur privé demande
une provision de 100.000 francs avant de commencer les travaux.
La réparation du câble par La Charente ne coûte
que 80.000 francs.
La différence entre les opposants et la commission porte
sur l’utilisation de 2 MF affecté au remplacement
de la Charente. Ce navire, construit en 1862 en Angleterre,
doit être remplacé. Ce crédit de 2 MF sera
représenté l’année prochaine, ou dans
deux ans, s’il n’est pas voté aujourd’hui.
Cette demande s’appuie sur un document remis par Baron,
directeur de la construction et de l’exploitation électrique
à Bastid, précédent rapporteur de la commission.
Il y aura dans deux ans cinq câbles sur l’Afrique
du nord et trois sur la Corse. De nombreuses réparations
sont à attendre et le budget tunisien prendra en charge
0,5 MF du coût d’un navire neuf.
La question fondamentale est la suivante : Veut-on remplacer
La Charente ou préfère t-on attribuer une subvention
de 2 MF à l’industrie privée ?
Il s’agit, plus précisément de SGT/SIT, seul
constructeur français, puisque le deuxième industriel,
la société Menier n’a pas d’outil industriel
et sert de faire valoir.
Le ministre Jules Roche, journaliste, qui a collaboré
à La Justice de Clemenceau dès sa fondation, a
été élu député de Draguignan
en 1882 avec l’étiquette radicale. Opportuniste,
il s’est séparé de Clemenceau pour se faire
élire en Savoie en 1885 avec l’étiquette
républicaine. C’est un spécialiste des affaires
financières, longtemps rapporteur du budget des Finances,
qui excelle dans la pratique des chiffres et brouille le débat
en insistant sur la vanité des chiffres présentés
par les intervenants. Pour lui, la question est simple.
L’affaire est en discussion depuis trois ans et le débat
technique est terminé. L’intérêt supérieur
de l’industrie, de la colonie exige ces câbles car
il faut cinq heures pour atteindre l’Algérie alors
que Londres atteint l’Inde en 25/30 minutes. On cite 0,5
MF ou 1,5 MF pour réparer le navire, 1,8 MF ou 2,5 MF
pour construire un câblier neuf, 3,5 MF ou 4,2 MF pour
construire les deux câbles selon que l’on s’adresse
à un service ou un autre mais la question n’est
pas là.
L’Angleterre a une industrie et il convient de suivre son
exemple. J’ai fait venir le directeur de La Seyne, ajoutet-il,
et lui ai demandé de me garantir les chiffres avancés
pour m’engager devant vous. Je ne le peux pas.
En fait, le ministre fait souvent état de documents dont
la commission n’a pas eu connaissance, ce dont s’étonne
Millerand. Par exemple, lorsque le ministre précise que
trois sociétés différentes sont intéressées,
Menier, SGT/SIT et une troisième établie dans
l’Isère et qui construira une usine entre Toulon
et Marseille.
On procédera donc à un véritable appel
d’offres entre trois compagnies françaises dans
l’intérêt de la France. Il provoque encore
l’étonnement du rapporteur qui n’a pas été
informé de ce troisième constructeur.
Pour clore le débat le ministre indique que l’usine
de La Seyne-sur-Mer sera cantonnée dans son rôle
de remise en état des câbles relevés
sur réparation et de petits câbles côtiers.
L’usine est sauvée.
Dès lors, le président de la Chambre peut clore
le débat et passer au vote.
Deux textes sont proposés. Ils diffèrent de cinq
mots :
Art 1 : Il est ouvert au ministre du commerce, de l’industrie
et des colonies (2ème section) sur l’exercice 1891,
un crédit extraordinaire de 5.500.000 francs pour l’établissement
des lignes sous-marines de Marseille à Tunis et de Marseille
à Oran, et qui sera inscrit à un nouveau chapitre
27bis et intitulé : « Etablissement par l’usine
de La Seyne, de lignes sous-marines entre Marseille et Oran
et entre Marseille et Tunis.
Art 2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen
des ressources générales du budget ordinaire de
l’exercice 1891.
Le texte prévoyant la construction à La Seyne-sur
Mer est repoussé par 293 voix contre 223.
Le texte amputé de la référence à
La Seyne-sur-Mer est accepté par 317 voixcontre 162.
Mais le débat avait démontré tout l’intérêt
de l’usine de l’Etat.
Outre le recyclage des câbles usagés et la construction
de liaisons neuves, elle permettait d’analyser les prix
offerts par les industriels quand il était fait appel
au secteur privé. Dans les années qui suivent,
la quasi-totalité du réseau construit sera attribué
aux deux industriels français.
Les difficultés du secteur concédé (1892-1900)
En 1892, la société Grammont construit une troisième
usine de fabrication de câbles sous-marins à SaintTropez,
aux Canoubiers.
La construction des deux câbles sur l’Afrique du
Nord sont confiés à la SIT (Marseille – Oran
1892) et à Grammont (Marseille – Bizerte –
Tunis
1893), posés par le navire câblier François
Arago de la SIT.
A partir de 1893, le réseau français s’étoffe
avec la mise en service de la liaison Australie – Nouvelle
Calédonie (1893), puis Madagascar – Mozambique (1895),
New York – Haïti (1896) et Brest – Cap Cod –
New-York (1898).
Le programme des usines affiche complet.
Le secteur concédé est en difficulté. La
PQ ne se remet pas de l’erreur stratégique commise
en éliminant le président Pouyer-Quertier puis
en quittant le pool des compagnies alliées au bénéfice
de la compagnie américaine Commercial Cable.
Quant à la SFTSM, elle dessert les Caraïbes, une
région en crise (crise du sucre) et desservie par deux
compagnies anglaises et la Western Union.
L’Etat doit intervenir, regrouper les actifs des deux compagnies
au sein d’une nouvelle société : la Compagnie
Française des Câbles télégraphiques
(CFCT), à compter du 1 er janvier 1896.
Le 24 juin 1899, Alexandre Millerand sera nommé ministre
du Commerce, de l’Industrie et des P & T du gouvernement
Waldeck Rousseau, l’un des plus longs ministères
de la Troisième République (22 juin 1899 –
7 juin 1902). Le président du Conseil (qui a défendu
la PQ dans son procès contre les membres du Pool) et
Millerand défendront l’intérêt national.
Lorsque la CFCT est pratiquement en faillite et qu’il convient
de sauver le réseau concédé d’un transfert
à l’étranger ou de la faillite pure et simple,
Millerand se heurtera encore aux intérêts des industriels.
Cette fois, il n’y aura pas de débat à la
Chambre mais chaque année le ministère des P &
T étoffera le réseau gouvernemental, ouvrant de
nouvelles lignes de crédits
pour l’achat de nouveaux câbles... au meilleur coût.
sommaire
Jules Caubet n’était pas le premier officier de
marine impliqué dans le secteur des câbles sous-marins
puisque les ingénieurs hydrographes François Delamarche
(1815 – 1884) et Charles Martin Ploix (1824 – 1895)
et le Lieutenant de vaisseau Antoine Alexandre Cavalier (1819
– 1882) ont été chargés de l’étude
des tracés et de la pose des premiers câbles sous-marins,
en faisant carrière dans l’administration des P
& T.
Plus tard, trois officiers de marine se succédent au
conseil d’administration de la PQ le vice amiral Charles
Dompierre d’Hornoy (1816 – 1901), ministre de la Marine
de septembre 1869 à mars 1871 (sous l’Empire) et
de mai 1873 à mai 1874 (sous la République).
Le vice amiral Auguste Bosse, vice président de la PQ
en 1879, et le capitaine de Frégate Bruyère Dellorier,
président de PQ de 1887 à mai 1893 avant de laisser
la place à un liquidateur.
Le CA Caubet est nommé au Conseil d’administration
de la SFTSM en 1892 sur proposition du président Léauté.
L’année suivante, Léauté retournant
dans le monde des affaires, le propose au Conseil d’Administration
pour le remplacer. La construction du réseau dans les
Antilles est terminée, les résultats de cette
activité ne sont pas à la hauteur des espoirs
des actionnaires. En faisant appel à un haut
fonctionnaire, il s’agit de repositionner les activités
de la société dans le cadre de la politique du
gouvernement. L’autre société, la PQ a connu
une révolution de palais en 1886 avec l’éviction
de son fondateur Pouyer Quertier.
Ses successeurs l’ont placée dans une situation
inextricable vis-à-vis des sociétés étrangères
en rompant unilatéralement tous les accords conclus.
La société est au bord de la liquidation.
Ainsi, en 1895, lorsque Caubet arrive à la présidence
alors que les deux sociétés sont pratiquement
en faillite. Le contre amiral Caubet apparaît comme le
représentant du Ministre de la Marine et des Colonies
chargé de mettre de l’ordre dans un secteur en crise.
Résumé de la carrière du contre amiral
Jules Caubet
Né le 1 février 1828 à Perpignan (Pyrénées
Orientales).
Provenance : Ecole navale
Aspirant le : 1 août 1846
Enseigne de Vaisseau : 2 avril 1851
Lieutenant de Vaisseau : 27 novembre 1859
Capitaine de Frégate : 1 juin 1870
Capitaine de Vaisseau : 9 avril 1878
Contre-amiral : 20 mars 1886
Légion d’Honneur : (Chevalier : 15 septembre 1854,
Officier 21 août 1874 et commandeur) Officier de l’Instruction
Publique.
Médaille de la Baltique : 1854,
Médaille de Crimée : 1855 ;
Chevalier de l’Ordre de la Tour et de l’Epée
(Portugal) ;
Décoré de la 5ème classe de l’Ordre
du Medjidié (Turquie).
Administrateur de la SFTSM : 10 novembre 1892
Président de la SFTSM : 23 novembre 1893
Président de la CFCT : 1 janvier 1895
Administrateur de la CFCT : 17 mars 1902 au 2 février
1912.
L’amiral Caubet est un canonnier de valeur et un tireur
émérite, et l’on raconte qu’il a fait
autant de cas du second prix d’ensemble qui lui fut décerné
en 1858, à l’Ecole de tir, lorsqu’il était
enseigne de vaisseau détaché au bataillon d’apprentis
fusiliers, que de ses deux citations à l’ordre du
jour pour faits de guerre.
Il débuta, en 1886, aux Antilles sur la frégate
la Danaïde, ou il servait comme aspirant. On le vit ensuite
dans l’escadre de la Méditerranée, sur
l’Océan en 1849, sur l’Iphigénie en
1850, puis il passa sur la Minerve, bâtiment-école
de canonnage. Ce n’est que quelques mois plus tard qu’il
fut promu enseigne de vaisseau.
Il partit alors pour le Sénégal, où il
rejoignit le brick La Palinure, de la division des côtes
occidentales d’Afrique et se distingua, aux mois de juin,
juillet et août 1853, à l’attaque du fort
de Bissao, à l’affaire de Boë et à la
prise de Grand Bassam.
Il ne quitta le golfe du Benin qu’en janvier 1854, pour
monter sur le vapeur le Duperré, vers lequel il fit la
première expédition de la Baltique et une partie
de la campagne en mer de Bomarsund. Le 30 mai 1855, il reçut
le commandement de la canonnière la Stridente et, cinq
mois plus tard, après l’évacuation de Sébastopol
par les Russes, il était appelé à se rendre
avec l’escadre française devant la ville de Kinburn,
à l’embouchure du Dniepr; il coopéra à
la prise de la place et fut mis encore à l’ordre
du jour. Sa brillante conduite en cette affaire ne lui valut
pourtant aucune récompense. Il était trop jeune
enseigne et le tableau d’avancement était déjà,
dit-on, trop rempli; d’autre part, il y avait à
peine une année qu’il avait à l’occasion
de la prise de Bomarsund, reçu la croix de chevalier
de la Légion d’Honneur. Il semble cependant qu’en
cette circonstance on fit preuve de mauvaise volonté.
A cette époque, M Caubet avait 27 ans et demi ; or, beaucoup
de ses collègues ont été lieutenant de
vaisseau à cet âge et tous n’avaient pas,
comme le commandant de la Stridente, quatre ans de campagne
de guerre et deux citations En revenant en France, M Caubet
passa dans l’escadre, à bord de l’Ulm, sur
lequel il resta deux ans, puis fut envoyé au bataillon
d’apprentis fusiliers, où il remporta le succès
dont nous avons parlé plus haut. C’est peu de temps
après avoir quitté l’école de tir,
en novembre 1859, qu’il fut promu lieutenant de vaisseau.
On le renvoya dans l’escadre ou il servit sur l’Eylau
d’abord, ensuite sur l’Alexandre et au mois d’octobre
1861, il entre à l’Ecole Navale en
qualité de professeur. Il y reste environ cinq années
et en sortit pour prendre le commandement de l’aviso le
Capelan, qui appartenait à la division du littoral nord
de la France.
De là, – on était alors en 1868, - M Caubet
partit, à bord de la Circé, pour les côtes
du Brésil et l’embouchure du Rio de la Plata ; où
il remplit,
pendant dix-huit mois à peu près, les fonctions
de secrétaire du contre-amiral Fisquet, commandant en
chef de la station française. M Fisquet, qui
avait connu et apprécié le lieutenant Caubet en
Crimée, répara les injustices de ses prédécesseurs;
il fit inscrire son secrétaire au tableau d’avancement
et lui fit donner le commandement de l’aviso le Bruix.
Peu de temps après, la guerre éclatait, la France
était envahie et M Caubet, qui avait reçu l’ordre
de rentrer en France aussitôt après sa nominations
de capitaine de Frégate, fut placé comme second
à bord de la Couronne, dans l’escadre qui se formait
à Toulon sous les ordres du vice-amiral Jurien de la
Gravière. C’est ainsi que le commandant Caubet eut
l’occasion de prendre part, en avril 1871, à la
répression des troubles qui agitèrent alors Marseille.
L’année suivante, M Caubet devenait le second du
Louis XIV, bâtiment-école de canonnage et, en 1873,
il partait avec le transport l’Ardèche, qu’il
commandait, pour visiter les côtes de l’Algérie
et de nos colonies de l’Atlantique. Chargé ensuite
de la direction du bâtiment central de la réserve
à Brest, M Caubet rentra dans l’escadre d’évolutions,
en décembre 1875, comme second du Desaix et il était,
en 1878, aide-major au port de Brest, lorsqu’il reçu
son brevet de capitaine de vaisseau. On lui donna alors le commandement
du Tage, avec lequel il se rendit en Nouvelle-Calédonie,
puis, celui du Suffren et du Trident dans l’escadre d’évolutions
; sur l’un de ces deux bâtiments, il fut capitaine
de pavillon du commandant en
sous-ordre, le contre-amiral Paul Martin, aux côtés
duquel il se trouva au bombardement de Sfax et à la prise
de Gabès.
Au mois de février 1883, M Charles Brun, Ministre de
la Marine, fit de Caubet son premier aide de camp et le nomma,
dans les premiers jours du mois de septembre de la même
année, au commandement de l’Ecole navale. M Caubet
n’a quitté le Borda qu’en octobre 1885 et a
reçu quelques mois après les étoiles de
contre-amiral.
Un peu plus tard, il a été nommé major
général de la marine de Rochefort où commande
en chef l’excellent amiral Pritzbuer. Il est membre du
Conseil des Travaux de la Marine en 1988 et est affecté
dans le cadre de réserve (2ème section) le 1er
février 1890.
En 1912, il figure encore dans l’annuaire de la Marine
en tête de liste du cadre de réserve (2ème
section) du corps des contre-amiraux.
sommaire
LA CARRIERE DE JULES CAUBET AUX CABLES SOUS-MARINS
Entre 1888 à 1891, la Société Française
des Télégraphes sous-marins (SFTSM) a construit
un réseau dans les Antilles en bénéficiant
des concessions obtenues par le comte d’Oksza. Ce physicien
polonais, également diplomate négociait des concessions
pour les offrir aux industriels. Il avait déjà
contribué à la création de la West African
Telegraph Co par un industriel britannique (Indian Rubber, Gutta
Percha and Telegraph Works Company). Le réseau, installé
en 1886 entre Dakar et Bonny (Angola), bénéficie
de concessions obtenues auprès des gouvernements
français, portugais et britanniques.
D'Oksza réalise une opération semblable en obtenant
des concessions avec le Venezuela, la colonie de Curaçao,
Haïti, la République de Saint-Domingue (République
Dominicaine) et le gouvernement espagnol pour Cuba. Cette fois-ci,
il se tourne vers des financiers français, et la Société
Générale des Téléphones (SGT) pour
former la Société Française des Télégraphes
sous-marins (SFTSM) le 1 août 1887.
La SGT gère des réseaux terrestres dans la région,
en particulier en République Dominicaine. Plus tard,
la SFTSM obtient des droits en Guyane
Hollandaise (Surinam) et au Brésil, assortis d’un
droit d’exploitation exclusive pour le trafic entre le
Brésil et les Etats-Unis. Ce privilège bloquera
les initiatives anglaises et américaines dans la région.
Entre 1887 et 1891, le réseau de la SFTSM est construit
en plusieurs phases en faisant appel initialement à un
constructeur britannique (W.T.Henleyand Company).
Ensuite, la participation de Société Générale
des Téléphones consiste à armer le câble
à Calais. Enfin, le câble de la dernière
phase est fabriqué à
Bezons (partie électrique) et à Calais (armure),
et posé par le navire Westmeath. Après ces opérations,
la SGT achète le Westmeath, le rebaptise François
Arago et filialise l’activité câbles sous
marins en créant en 1891 la Société Industrielle
des Téléphones (SIT).
La SFTSM pose ensuite la première grande liaison construite
par la SIT entre la Nouvelle Calédonie à l ‘Australie
(mise en service le 16 octobre 1893) et le président
Leauté est sollicité pour devenir administrateur
délégué de la Société Industrielle
des Téléphones (SIT). Il juge cette fonction incompatible
avec la présidence de la SFTSM et démissionne
le 16 novembre. Il propose au Conseil d’Administration
de désigner le contre amiral Caubet pour le remplacer.
Celui-ci accepte en demandant que J. Dupelley, directeur de
la compagnie, soit associé à son mandat. On et
jamais trop prudent !
En effet, J Dupelley gère les réseaux des Antilles
qui sont soumis à la concurrence des sociétés
britanniques et aux réalités économiques
locales : crise économique à Saint-Domingue, troubles
politiques au Venezuela.
Il est incontournable car il négocie la jonction du réseau
avec l’Europe mais se heurte à l’industriel
britannique TCM qui vient d’obtenir du
gouvernement portugais un accord de principe pour un atterrissement
aux Açores.
Le gouvernement français, en particulier le ministre
des Affaires Etrangères Ribot, est très actif.
Son intervention permet au gouvernement français de doubler
les anglais et d’obtenir le 14 juin 1892 une concession
valable jusqu’au 1 avril 1893.
L’idée est de construire une liaison reliant Brest
– Lisbonne – les Açores et Haïti. Une
convention pour réaliser cette liaison est signée
entre l’Etat et la CFTSM le 25 juin 1892 mais le gouvernement
tombe. Le nouveau ministre des P & T (Siegfried) bloque
le projet. Elle coûte à la SFTSM le prix de la
caution versée (400.000 francs) et contribue à
maintenir isolé le réseau des Antilles.
Les britanniques obtiennent finalement la concession qui permet
l’établissement de la liaison Porthcurno –Lisbonne
– Açores – Saint Vincent – Saint Hélène
– Le Cap.
En cette fin d’année 1893, La Compagnie Française
du Télégraphe de Paris à New York (PQ -
du nom de son ancien président Pouyer Quertier)
est en faillite et en procès avec la puissante société
anglaise Anglo-Américan Telegraph. La cause de la PQ
est, semble t-il, perdue d’avance mais le gouvernement
souhaite sauver le réseau d’Atlantique Nord. Beaucoup
d’argent public et privé a été dépensé
pour atteindre un objectif jugé
indispensable : se doter d’un grand réseau de câbles
sous-marins indispensable à ses ambitions coloniales.
La France vient de mettre en service deux usines de fabrication
des câbles sous-marins à Calais (1891) et à
Saint-Tropez (1892) et il n’est pas question de s’arrêter
au milieu du gué. En 1892, les compagnies étrangères
gèrent un réseau de 230.000 Km, et toutes les
correspondances
officielles et privées des colonies lointaines empruntent
le réseau britannique. J. Caubet et J.
Dupelley se chargent donc de la fusion des avoirs des deux sociétés
au sein d’une nouvelle entité La Compagnie Française
des Câbles Télégraphiques (CFCT).
Le nouveau schéma est cohérent. Jules Caubet préside
la nouvelle société lorsqu’elle est nommée
Compagnie Française des Câbles Télégraphiques
(CFCT) est fondée le 1 janvier 1895. La convention du
28 mars 1896 est approuvée la loi du 2 juillet 1895 au
terme d’un long cheminement. Cette convention annule la
convention entre la SFTSM et ses créanciers. Aux termes
de la nouvelle convention, la CFCT s’engage à établir,
entretenir et exploiter une liaison directe entre Brest et Cap
Cod, prolongée jusqu’à New York par la voie
terrestre. à exploiter les lignes existante Brest –
Saint Pierre – Canso et Cap Cod. à rattacher les
deux réseaux d’Atlantique Nord et des Antilles dans
un délai de deux ans.
Pour l’entretien du réseau, l’achat d’un
second câblier est décidé. Comme le NC Pouyer
Quertier, il portera le nom du président de la CFCT.
 NC
Julles Caubet 1905-1915.
NC
Julles Caubet 1905-1915.
Réunir les deux réseaux est la tache prioritaire.
La CFCT constitue immédiatement une filiale de droit
américain, la United States and Hayti Telegraph Company.
Celle-ci commande le câble à la Société
Industrielle des Téléphones (SIT) en avril 1896
et la liaison est mise en service le 7 décembre 1896..
Ensuite, la CFCT commande une
liaison transatlantique à la SIT. C’est la plus
longue jamais réalisée (6.000 km) et ce câble,
appelé « Le Direct ». Il sera un bon argument
commercial. Le 4 mai 1897, l’Ambassadeur de France à
Washington dépose la demande d’atterrissement du
câble direct au Cap Cod. La SIT installe les atterrissements
en avril – mai et juin 1897 et confie la pose principale
au navire britannique Silverston. La pose est un
échec et les opérations qui devaient être
terminées avant le 16 décembre 1897 ne sont achevées
que le 2 septembre 1898. Ces retards dans les mises en service
entraînent des frais financiers qui hypothèquent
la rentabilité de la nouvelle société.
Pour faire face à la pression des créanciers
(banques, Société Générale des Téléphones
et SIT), ceux-ci se regroupent au sein de la Société
Générale française des Télégraphes
(SGDF) et
accordent une avance 10 MF à la CFCT (accord du 31 janvier
1898). Les frais de remise en état du câble transatlantique
de 1879 (Brest – Saint Pierre -Cap Cod) sont de 5,8 MF,
somme très supérieure aux estimations et le trafic
du réseau des Antilles stagne ; par contre le trafic
transatlantique se développe avec la mise en service
du « Direct ».
Cette hausse du trafic a une conséquence curieuse car
la convention de 1895 prévoyait la suppression d’une
subvention si le trafic transatlantique excède un certain
seuil. Or, ce seuil est malheureusement dépassé
dès 1900 et la société perd une source
de revenus indispensable..
A cette époque, les relations franco-britanniques traversent
une période de crise qui culmine lors de l’affaire
de Fachoda (10 juin 1899).
Le gouvernement se trouve privé des communications officielles
qui transitent dans les réseaux britanniques. J. Dupelley
multiplie les articles dans
les revues pour attirer l’attention des dirigeants sur
la fragilité des réseaux français et leur
dépendance vis-à-vis des compagnies britanniques.
En effet, en 1901, le réseau mondial se présente
de la façon suivante
sommaire
1900 Les câbles télégraphiques en temps
de guerre de J. Depelley
Les premières paroles échangées
entre l’Europe et l’Amérique, par le câble
transatlantique de 1858, étaient des paroles de paix
qui réclamaient la neutralisation des lignes télégraphiques.
Le Président des États-Unis demandait, dans
sa dépêche de félicitations à
la reine Victoria, « que toutes les nations civilisées
déclarent spontanément et d’un commun
accord que le télégraphe électrique
sera neutre à jamais, que les messages qui lui seront
confiés seront tenus pour sacrés même
au milieu des hostilités. »
Ce vœu, échappé à
l’enthousiasme que fit naître cette première
communication télégraphique de la pensée
humaine entre les deux continens, ne devait pas avoir
de réalisation prochaine. Après quarante
années, la neutralisation des câbles n’est
pas encore reconnue. Elle sera vraisemblablement un progrès
de l’avenir ; mais, pour l’instant, la télégraphie
sous-marine est un puissant instrument de guerre, au profit
du pays qui a eu la prévoyance de s’en assurer
les services.
Dès que la possibilité de
correspondre à grande distance, au moyen de câbles
sous-marins, a été démontrée
pratiquement, l’Angleterre a compris quelle prépondérance
commerciale et politique devait lui donner la création
d’un grand réseau restant sous sa domination.
Sans se laisser décourager par les onéreux
échecs du début, avec une persévérance
que l’on doit admirer, elle est arrivée à
créer et à développer, méthodiquement,
sans bruit et sans arrêt, un réseau de câbles
télégraphiques sous-marins qui couvre aujourd’hui
le monde entier et l’enserre dans une immense toile
d’araignée dont Londres est le centre. C’est
là que les fils de cette toile convergent, et dans
le monde, il ne se produit pas un incident, pas un fait
politique ou commercial, dont la nouvelle ne soit d’abord
transmise à Londres. C’est un merveilleux
agent d’information et d’influence que l’Angleterre
a entre les mains, agent d’autant plus redoutable
que les autres pays en sont dépourvus.
Un simple examen d’une carte
télégraphique montre l’enchaînement
des câbles appartenant aux Compagnies anglaises
; explique certaines difficultés de notre politique
coloniale ; et jette un peu de lumière sur des
faits qui ont dû quelquefois paraître incompréhensibles.
- Du côté de l’Amérique
du Nord, dix câbles transatlantiques relient l’Angleterre
au Canada et aux États-Unis. Plus bas, vers l’Amérique
du Sud, trois autres lignes anglaises traversent l’Atlantique
et rattachent le Brésil au Portugal, à l’Espagne,
et, par leurs prolongemens, à Londres même
; d’autres lignes anglaises s’étendent
du Nord au Sud, le long du Pacifique ; d’autres encore
enveloppent toutes les Antilles et l’Amérique
centrale, et complètent ce premier réseau
qui met l’Amérique entière à
quelques secondes de Londres.
- Vers l’Orient, les lignes
anglaises qui s’y dirigent, en partant de Londres,
quadruplées sur certains points, tournent l’Europe
par Gibraltar, touchent à Malte et à l’Egypte,
longent la Mer-Rouge jusqu’à Aden.
- A Aden se trouve ce qu’on peut appeler un nœud
de lignes télégraphiques, dont l’importance
politique se révèle aujourd’hui. De
là, en effet, part un premier faisceau de trois
câbles qui se dirigent vers l’Inde, et se prolongent
par d’autres lignes jusqu’à la Chine,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande ; une autre
ligne part du même point, se dirige vers la côte
orientale d’Afrique en desservant Zanzibar, Mozambique,
Delagoa Bay, Natal et le Cap de Bonne-Espérance.
Ce grand réseau oriental a son point central, où
toutes les lignes viennent se nouer, à Aden.
- Vers la côte occidentale
d’Afrique, les mêmes lignes anglaises qui relient
Londres au Portugal et à l’Espagne descendent
d’abord jusqu’à Bathurst, au-dessous
du Sénégal, puis, de là, festonnent
le long de la côte jusqu’au Cap, où
elles rejoignent celles de la côte orientale, enfermant
tout le littoral africain dans un cercle télégraphique
anglais.
Mais, là aussi, il faut remarquer les conditions
de complet asservissement vis-à-vis de l’Angleterre
dans lesquelles ce réseau est constitué.
De même que, pour l’Orient, Aden est le point
où convergent les lignes qui rayonnent vers les
Indes, la Chine et l’Australie, et vers l’Afrique
jusqu’au Cap de Bonne-Espérance ; de même,
sur la côte occidentale d’Afrique, un point
de convergence de toutes les lignes existe en territoire
anglais, à Sierra-Leone, et surtout à Bathurst
; c’est dans ces stations anglaises que passent forcément
les correspondances du réseau qui s’étend
le long de la côte jusqu’au Cap, en desservant
des territoires français et portugais, qui le subventionnent
d’ailleurs largement.
L’importance et le danger de cette
organisation pour tout ce qui n’est pas anglais sauteront
aux yeux dès que l’on connaîtra les
clauses du cahier des charges que le gouvernement anglais
impose à ses compagnies télégraphiques.
En voici les principales ; elles suffisent pour accuser,
d’une manière bien saisissante, les vues politiques
qui ont guidé nos voisins dans la création
si persévérante de leur réseau télégraphique
:
« ART. 3. — Le câble
proposé ne doit, en aucune station, posséder
d’employés étrangers ; de même,
les fils ne passeront dans aucun bureau et ne pourront
être sous le contrôle d’un gouvernement
étranger.
« ART. 5. — Le Gouvernement
de Sa Majesté ne prendra aucun engagement ni aucune
responsabilité en ce qui regarde le câble,
au-delà du paiement du subside.
« ART. 6. — Le subside
sera accordé pendant vingt ans, et payable à
chaque période complète de douze mois, sous
la condition que le câble sera maintenu en bon état
et aura fait un bon service, et que ce service entre le
Royaume-Uni et les colonies et protectorats anglais n’aura
pas subi d’interruption.
« ART. 7. — Les dépêches
du Gouvernement impérial et colonial doivent avoir
la priorité lorsqu’elle est demandée.
Elles seront transmises à demi-tarif qui n’excédera
pas une somme à déterminer.
« ART. 9. — En cas de
guerre, le Gouvernement pourra occuper toutes les stations
en territoire anglais ou sous le protectorat de l’Angleterre,
et se servir du câble au moyen de ses propres employés.
»
Ainsi, en temps normal, le gouvernement
britannique s’est assuré spécialement
pour ses dépêches, partout où existe
une ligne télégraphique anglaise, un droit
de priorité qui appartient à toutes les
dépêches d’Etat d’après
les conventions internationales. L’inscription de
ce privilège peut paraître naturelle, mais,
en réalité, elle a pour but et pour effet
de faire céder le pas aux dépêches
anglaises, par les dépêches d’Etat de
tous les autres pays. Il ne faut pas chercher ailleurs
l’explication de difficultés ou de retards,
singulièrement favorables aux intérêts
britanniques, que subissent certaines transmissions télégraphiques.
Mais combien plus dangereuse est cette
situation en cas de guerre !
Les événemens du Transvaal viennent de faire
ouvrir les yeux sur un péril menaçant pour
tous les pays qui ont des colonies à défendre.
Non seulement la censure anglaise établie à
Aden refuse les correspondances chiffrées venant
de Lourenço-Marquès, de Durban et du Cap
; elle arrête aussi celles qui arrivent de Madagascar
aussi bien que de l’Est-Africain allemand.
Que serait-ce si, au lieu d’une guerre entre l’Angleterre
et le Transvaal, les hostilités existaient entre
l’Angleterre et la France ?
C’est la question du rôle des câbles
télégraphiques qui est posée brutalement
par ces faits. Quel a été ce rôle
jusqu’à présent ? Quel sera-t-il, dans
l’avenir, pour un pays comme la France, qui a un
immense empire colonial à défendre, et des
intérêts traditionnels d’influence et
de commerce à soutenir sur tous les points du globe
?
Bien que d’une origine très
récente puisqu’elle remonte à quarante
ans à peine, les câbles télégraphiques
sont déjà mêlés si directement
à la vie internationale maritime et coloniale de
tous les pays, que l’intérêt et l’importance
de leur existence ne peuvent plus être ignorés
ou méconnus. En temps de guerre notamment, ils
peuvent être un moyen d’action d’une telle
portée que l’on a pu dire justement que la
nation qui disposerait seule d’un réseau télégraphique
sous-marin, pour renseigner ses escadres sur les mouvemens
et la force de ses adversaires, serait maîtresse
de la mer.
Ce qui se passe en ce moment pour les
correspondances avec l’Afrique marque la dangereuse
dépendance dans laquelle sont placés tous
les pays, par le fait seul de l’état de guerre
entre l’Angleterre et le Transvaal. Les événemens
qui se sont déroulés l’année
dernière, au cours de la guerre hispano-américaine,
où deux puissances maritimes se sont trouvées
aux prises, fournissent, d’une manière encore
plus concluante, la démonstration de l’influence
que doivent prendre les communications télégraphiques
dans un conflit colonial. On constate, en effet, qu’une
guerre télégraphique s’est engagée
entre l’Espagne et les Etats-Unis, dès le
début des hostilités, et s’est poursuivie
parallèlement aux opérations militaires
; on trouve, pour la première fois, un ensemble
de faits précisant et faisant en quelque sorte
apparaître matériellement le rôle considérable
que les lignes télégraphiques sous-marines
pourraient avoir à jouer dans une grande guerre.
Avec une imprévoyance, dont toute
la sympathie que méritent ses malheurs ne doit
pas empêcher de voir aujourd’hui les conséquences,
et qui devrait être une leçon pour les autres
pays, l’Espagne est restée, jusqu’au
moment de la déclaration de guerre, sans posséder
de lignes télégraphiques indépendantes
et sûres entre Madrid et la Havane. Elle soutenait
depuis plusieurs années, contre l’insurrection
cubaine, une lutte ouvertement favorisée par les
Américains, et elle n’avait d’autres
moyens de correspondre avec Cuba que les lignes télégraphiques
américaines. Ses dépêches officielles,
ses instructions secrètes parvenaient à
la Havane par les fils qui reliaient New-York à
la Floride en traversant les Etats-Unis, et par les câbles
américains de la Floride. Cette imprudence nous
frappe aujourd’hui, après les événemens
qui l’ont révélée, et paraît
incompréhensible ; pourtant, il faut être
indulgent pour l’apprécier, car d’autres
pays, parmi lesquels se trouve la France, sont, à
l’heure présente, tout aussi imprévoyans,
et seraient, pour leurs possessions coloniales, dans la
même situation que l’Espagne, si la guerre
venait à leur être déclarée.
C’est seulement au moment où
les hostilités ont été ouvertes avec
les Etats-Unis, c’est-à-dire à la veille
de l’interruption des communications par le nord
de Cuba, que l’Espagne entreprit avec quelque vigueur
la recherche de moyens de correspondance autres et plus
sûrs que les lignes américaines. Il était
beaucoup trop tard. Ce n’est pas par des mesures
improvisées qu’une organisation de service
télégraphique peut être faite à
d’aussi grandes distances. Les autres lignes qui
desservaient Cuba sans toucher aux États-Unis venaient,
par le Sud, aboutir à Santiago de Cuba, à
500 kilomètres de la Havane. Ces lignes n’étaient
prolongées jusqu’à la Havane que par
des fils terrestres déjà entre les mains
des insurgés, et par des câbles immergés
le long des côtes, par conséquent très
exposés à être coupés. Du jour
au lendemain, la Havane pouvait donc être isolée
de Santiago, et l’Espagne était menacée
de n’avoir aucune communication télégraphique
avec le théâtre principal de la guerre où
était engagée sa fortune coloniale.
Quelle différence de procédés
et de situation du côté des États-Unis
!
Le jour même où la
guerre est déclarée, l’un des premiers
actes du gouvernement est d’appliquer une censure
étroite sur toutes les lignes télégraphiques
qui peuvent atteindre Cuba. Les câbles de la Floride
à la Havane, appartenant à une compagnie
américaine, sont saisis et desservis militairement.
Toutes les stations américaines, où touchent
les autres lignes en relation même indirecte avec
Cuba, sont également occupées par des télégraphistes
militaires. Une prohibition complète s’applique
aux dépêches espagnoles gouvernementales,
aux dépêches codées ou chiffrées
pour les Indes occidentales, enfin à toute dépêche
en clair ayant une tendance hostile aux États-Unis.
Ces premières mesures, toutes
rigoureuses qu’elles soient, paraissent insuffisantes.
Les Américains veulent isoler complètement
Cuba en coupant tous les câbles qui aboutissent
sur les côtes de l’île, sauf les câbles
de la Floride à la Havane, qui sont déjà
entre leurs mains, et dont l’un, relevé à
bord d’un navire de guerre, met en communication
l’escadre chargée du blocus de la Havane et
le gouvernement fédéral à Washington.
Trois navires sont rapidement outillés pour couper
les câbles : le Mangrove, l’Adria et le Saint-Louis.
Dès le 25 avril, jour de la déclaration
de guerre, le Mangrove quitte Key-West pour se rendre
dans le sud de Cuba avec l’ordre de détruire
les câbles qui atterrissent à Santiago, c’est-à-dire
les câbles anglais de la Jamaïque et le câble
français d’Haïti.
L’Adria et le Saint-Louis suivent
quelques jours plus tard le Mangrove, pour l’aider
dans ses opérations, au cours desquelles ces navires
sont toujours protégés par des cuirassés.
D’autres navires sont également munis d’outils
et d : engins spéciaux pour rompre les câbles.
Malgré ce grand déploiement
de forces, pendant plusieurs semaines les tentatives faites
sont complètement infructueuses. Les dragages exécutés
à quelque distance de la côte restent sans
résultat. Les côtes cubaines présentent
cette particularité, commune à presque toutes
les Antilles, de descendre à pic à de grands
fonds, de telle sorte qu’à une faible distance
du rivage, on trouve déjà une grande profondeur
de mer. Le dragage des câbles y est donc difficile,
si l’on ne vient les chercher aux atterrissages.
C’est ce que, après de nombreuses tentatives
inutiles, les Américains doivent se résoudre
à faire et, même dans ces conditions, ils
n’ont obtenu des succès que par des coups
d’audace et en courant de très sérieux
dangers.
Le 18 mai, le Saint-Louis, voulant
faire une tentative décisive pour couper, devant
Santiago, les câbles de la Jamaïque, qui avaient
été inutilement cherchés au large,
avait commencé les dragages à 7 milles du
feu de Santiago. Peu à peu, ne trouvant pas de
câble, il se rapproche de la côte jusqu’à
un mille de l’entrée de la passe de Santiago.
A cet endroit, il croche un câble ; mais, au même
moment, le feu des forts espagnols commence et l’opération
devient dangereuse ; le travail se précipite, on
monte le câble à bord, on le coupe et on
en rejette hâtivement les bouts à la mer.
Le Saint-Louis se retire bien convaincu qu’il a interrompu
les communications avec la Jamaïque. La nouvelle
en est donnée par toute la presse américaine
: c’est un véritable exploit. On annonce,
en même temps, que le câble français
de Santiago a été coupé vers son
atterrissage à Haïti et que, par suite, Cuba
est complètement isolée.
Or, le câble relevé
était un tronçon de vieux câble, abandonné
dans une réparation ancienne ! Ce vieux câble,
noyé depuis de longues années, ne devait
plus s’attendre à revoir le jour dans une
circonstance aussi glorieuse. Aucune des lignes télégraphiques
de Santiago n’avait en réalité été
atteinte. Quant au câble français, il n’a
jamais été touché sur la côte
d’Haïti.
Ayant reconnu le résultat
négatif de l’expédition tentée
à Santiago, les Américains ne se tinrent
pas pour battus. Ils voulurent couper les câbles
qui reliaient Santiago à la Havane, afin d’isoler,
de toute communication par le Sud, le maréchal
Blanco déjà sans communication avec le Nord.
Ces câbles se développent le long de la côte
sud de Cuba et ont plusieurs atterrissages. A l’un
d’eux, celui de Cienfuegos, une tentative de rupture
fut faite dans des conditions particulièrement
audacieuses.
Cienfuegos est situé à
l’intérieur des terres, au fond d’une
baie dans laquelle on entre par un canal de 3 milles de
longueur. A l’entrée du canal se trouve un
phare placé sur une hauteur de 300 pieds, au bas
de laquelle court une plage étroite couverte de
sable ; à peu de distance du phare s’élevait
la guérite d’atterrissage des câbles,
visible de très loin en mer. Les forces américaines
réunies devant ce point se composaient de quatre
navires de guerre. Deux canots à vapeur et deux
à rames furent mis à la mer ; chacun des
canots avait un équipage de seize hommes armés
et munis d’outils pour détruire les câbles
; les canots à vapeur devaient faire la remorque
des barques jusqu’au rivage, pendant que les navires,
placés à un mille environ, bombarderaient
le phare et la guérite des câbles.
L’opération, commencée
au point du jour, fut menée rapidement. Pendant
que les navires dirigeaient un feu très vif sur
le rivage, les canots s’approchaient de terre jusqu’à
une distance de moins de 100 mètres de la guérite
déjà presque détruite. La profondeur
de l’eau était encore trop grande pour draguer
les câbles. A la grande surprise des Américains,
les Espagnols n’ouvrirent pas le feu ; les canots
s’approchèrent jusqu’à quelques
mètres du rivage, par des fonds de 20 pieds à
peine, où ils crochèrent d’abord le
câble allant vers l’Est, dans la direction
de Santiago. Il fallut trente hommes solides pris sur
les deux canots, pour hisser le câble à bord
; c’était un câble d’atterrissage,
gros comme un bras d’homme, et le poids à
sortir de l’eau semblait être de plusieurs
tonnes. Après l’avoir mis à bord, on
put le couper.
L’un des bouts, celui qui allait
à la guérite, fut rejeté à
l’eau ; on releva l’autre sur une longueur de
150 pieds, avec la pensée de l’amener à
bord de l’un des navires, pour essayer de communiquer
avec Santiago ; mais le poids était tel que le
canot faillit chavirer. On dut rapidement faire une nouvelle
coupure pour jeter le câble à la mer, en
en gardant à bord environ 100 pieds. Toutes ces
opérations s’étaient accomplies sans
que les Espagnols eussent fait un feu sérieux sur
les Américains.
Le même travail fut entrepris
immédiatement sur l’autre câble allant
dans la direction de la Havane. Ce n’est encore qu’à
60 pieds du rivage que ce câble put être croche,
pendant que les navires redoublaient leur feu, en faisant
passer les obus par-dessus la tête des hommes travaillant
sur les canots. La position devenait cependant dangereuse,
car les Espagnols commençaient à tirer vigoureusement
sur les Américains ; les balles pleuvaient autour
des canots et déjà quelques hommes étaient
blessés. Le câble fut coupé de la
même façon que l’autre, et rejeté
à la mer. En le relevant dans ces petits fonds,
on avait aperçu un troisième câble.
Les Américains voulurent aussi le couper, et ils
avaient déjà mis des grappins à la
mer pour le crocher, lorsque le feu des Espagnols devint
si vif que l’opération dut être abandonnée.
Les canots furent ramenés aux navires, ayant perdu
plusieurs hommes ; les navires eux-mêmes avaient
été sérieusement éprouvés
par le feu des Espagnols, puisque le commandant de l’un
d’eux, le Nashville, avait été atteint.
Mais, par une chance heureuse, les Américains avaient
bien coupé les deux câbles qui desservaient
Cienfuegos ; le troisième câble qu’ils
n’avaient pu toucher mettait simplement en communication
la guérite avec Cienfuegos, et n’avait aucune
importance.
Le résultat de cette opération
dangereuse était d’une valeur capitale. La
rupture des câbles de Cienfugos isolait complètement
la Havane, et privait de toute communication entre eux
le maréchal Blanco et l’amiral Cervera, enfermé
à ce moment dans le port de Santiago.
Mais, malgré tous ces efforts,
Santiago restait encore en relation télégraphique
avec l’extérieur, par les câbles anglais
de la Jamaïque et par le câble français
d’Haïti. Ce n’est que le 7 juin que le
câble français put enfin être coupé.
La nouvelle de l’interruption ne fut pas inexacte
cette fois. La rupture eut encore lieu près de
l’atterrissage et par de tout petits fonds, après
un bombardement de la côte qui chassa les Espagnols
vers l’intérieur. Les Américains débarquèrent
aussitôt des troupes, et c’est à ce
moment qu’ils commencèrent à occuper
les environs de Santiago.
Quant aux câbles anglais de la Jamaïque,
venant atterrir dans la passe de Santiago, sous la protection
des forts espagnols, ils ne furent pas coupés,
malgré plusieurs tentatives dont la première
produisit l’erreur plaisante qui a été
racontée. Tous les dragages faits en pleine mer
furent sans aucun résultat, et, comme l’atterrissage
ne pouvait être abordé, il fut impossible
de couper la communication, qui n’a pas cessé
de fonctionner jusqu’à la fin des hostilités.
Elle semble d’ailleurs avoir été de
peu d’utilité pour les Espagnols et avoir
peu gêné les Américains, qui en étaient
arrivés à organiser, sous la direction d’un
homme du plus haut mérite, le brigadier-général
A. W. Greely, un remarquable service de surveillance sur
toutes les lignes télégraphiques qui pouvaient
rejoindre Cuba. Ce service fut incontestablement un des
élémens du succès des Américains,
qui furent puissamment aidés par le désarroi
et le découragement jetés parmi leurs adversaires,
grâce à l’absence de nouvelles et de
renseignemens exacts.
Un enseignement ressort, en tous cas,
d’une manière frappante de l’ensemble
de ces faits : c’est que, contrairement à
ce que l’on pensait jusqu’à présent,
la rupture des câbles par des moyens improvisés
offre de très grandes difficultés. Les Américains
ont mis en œuvre des ressources et des forces considérables
contre un pays mal défendu, et ce n’est qu’au
prix de très grands dangers qu’ils ont réussi
à rompre quelques lignes. Autant, en effet, il
est facile, à un navire installé et outillé
pour ce travail, et à un personnel expérimenté,
de relever et de réparer un câble dont la
position est exactement connue, autant il est difficile
et peu pratique, en temps de guerre, de rechercher des
câbles hors des points où ils viennent atterrir
à la côte. C’est uniquement sur ces
points qu’il a été possible d’arriver
à quelques résultats, et encore le récit
qui vient d’être fait montre combien certaines
opérations ont été périlleuses.
Il semble, dès lors, que
l’on trouverait des garanties de défense en
gardant secret le tracé des câbles que l’on
pose, et en dissimulant les atterrissages au lieu de les
marquer, comme on le fait aujourd’hui, par des guérites
et des balises visibles de très loin. Il semble
aussi qu’il serait aisé de choisir l’emplacement
des atterrissages, de manière à y organiser
une défense qui en rendrait l’approche dangereuse
en temps de guerre.
Une autre constatation ressort des mêmes
faits : c’est l’intérêt que présentent
les communications télégraphiques en temps
de guerre. Isoler Cuba de l’Espagne et des autres
pays a été le but qui, au commencement de
la guerre hispano-américaine, attira tout d’abord
les efforts des Américains. Leurs premières
opérations furent engagées pour couper les
câbles ; ils y ont réussi incomplètement
puisque les câbles de la Jamaïque sont restés
en service. Mais qui pourrait dire que, mieux informés
de la marche de leurs propres opérations, mieux
renseignés sur l’état et les mouvemens
des forces américaines, les Espagnols n’auraient
pu faire une plus longue résistance ?
Le rôle des câbles s’est
donc affirmé d’une façon qui doit préoccuper
tous les pays. Une nation qui a des escadres à
faire mouvoir et des colonies à défendre,
doit posséder, si elle veut tenir son rang, des
« dépôts de charbon et des câbles
télégraphiques. » On l’admet
aujourd’hui comme une vérité. Un court
exposé du progrès fait par cette idée
dans les nations maritimes et coloniales, nos voisines
et nos concurrentes, présentera peut-être
quelque intérêt.
Si, au milieu des graves problèmes
coloniaux devant lesquels se trouve une partie de l’Europe,
un pays devait être à l’abri des inquiétudes
que peut faire naître le rôle des câbles
télégraphiques en temps de guerre, c’est
assurément l’Angleterre. Nous avons vu qu’elle
possède, par ses Compagnies de câbles, la
plus grande partie du réseau télégraphique
qui sillonne les mers ; qu’elle a entre les mains,
avec ce réseau de plus de 250 000 kilomètres,
un moyen de véritable domination sur le monde entier.
Pourtant, elle n’est pas encore
rassurée, parce que certains de ses câbles
touchent, sur quelques points de leur parcours, à
des territoires non anglais. Elle veut, — et l’on
sait ce qu’est la volonté anglaise, —
un réseau de câbles prenant ses atterrissages
exclusivement en territoire britannique. C’est une
nouvelle expansion de son impérialisme, qu’elle
veut étendre cette fois jusqu’aux profondeurs
des océans. On pourrait croire à quelque
fantaisie, si l’idée d’avoir des câbles
« impériaux » n’était effectivement
soutenue en Angleterre par des personnalités de
tout premier rang, et si elle n’avait déjà
fait naître des projets qui vont être réalisés.
Le gouvernement anglais a décidé,
il y a quelques mois, qu’une subvention de 500 000
francs serait ajoutée par la Métropole aux
subventions, atteignant un million, données par
le Canada et l’Australie, pour l’établissement
d’un câble transpacifique partant de Vancouver
pour atteindre l’Australie en se dirigeant sur les
îles Fanning et Norfolk, rochers à peu près
déserts perdus dans le Pacifique, mais rochers
anglais ! Ce câble est destiné à prolonger,
par une ligne exclusivement britannique, les câbles
anglais du nord de l’Atlantique et les lignes canadiennes.
L’étude technique en est faite ; l’exécution
demandera dix-huit mois, et tout récemment, le
19 octobre dernier, à propos de ce projet, M. Chamberlain
faisait connaître à la Chambre des Communes
que la direction de la nouvelle ligne transpacifique sera
confiée à un Conseil de huit membres dont
les réunions se tiendront à Londres. Le
Gouvernement sera représenté, dans ce Conseil,
par trois membres dont le président, le Canada
par deux, l’Australie et la Nouvelle-Zélande
par trois. Le Canada a déjà désigné
lord Aberdeen et lord Strathcona ; les colonies australiennes
et la Nouvelle-Zélande seront représentées
par les agens généraux de la Nouvelle-Galles
du Sud, de Victoria et de la Nouvelle-Zélande,
et des négociations se poursuivent, entre le Chancelier
de l’Échiquier et le Postmaster général,
pour arrêter le choix des représentans de
la Métropole. Ce projet doté, comme on le
voit, d’un patronage très gouvernemental,
forme une première partie du nouveau câble
impérial qui doit faire le tour du monde.
L’autre partie est sortie de l’état
de simple projet, et a déjà un commencement
d’exécution ; elle consiste dans l’établissement
d’une ligne nouvelle partant de la côte anglaise,
touchant à Gibraltar, à Bathurst, aux Iles
de l’Ascension et de Sainte-Hélène,
et enfin au Cap. Du Cap, elle se dirigera sur l’île
Maurice, dont on fait un dépôt de charbon
et dont on veut faire aussi un grand centre télégraphique.
De Maurice enfin, un câble sera posé vers
l’Australie, et fermera le cercle dont on veut envelopper
le monde entier. La première section de ce câble
vient d’être immergée et ouverte au
service entre le Cap et l’île de l’Ascension
; elle sera prolongée dans quelque semaines jusqu’à
Bathurst.
Pour ce second projet, déjà
si avancé, la dépense doit être de
125 millions de francs ; mais cela n’effraye pas
nos voisins. Un journal de Londres dit à ce sujet
: « La somme de 125 millions demandée pour
ce projet suffirait pour construire 5 cuirassés,
mais il faut comprendre qu’un tel réseau offrira
l’avantage de rendre chaque navire de guerre cinq
fois plus puissant et plus utile qu’il ne l’est
à présent ».
Il faut supposer qu’après
l’établissement de ces grandes lignes, l’Angleterre
se sentira un peu rassurée et aura un moment de
tranquillité. Mais quel enseignement n’y a-t-il
pas pour la France à voir que l’importance
du rôle des câbles en temps de guerre inquiète
même le pays qui possède les quatre cinquièmes
du réseau télégraphique existant
aujourd’hui !
Si l’on passe aux États-Unis,
qui viennent d’expérimenter, avec l’Espagne,
l’usage que l’on peut faire des câbles
en temps de guerre, on constate aujourd’hui le même
désir de s’assurer le concours de ces moyens
de défense et de lutte, et, dans la manière
dont ce désir se manifeste, on reconnaît
le sens pratique et prévoyant de ce peuple, pour
qui la politique coloniale est cependant toute nouvelle.
Il y a, en effet, une bien frappante leçon dans
le projet présenté au Congrès, dès
le 10 février dernier, pour la pose d’un câble
transpacifique, destiné à relier les Philippines
aux États-Unis, avant même que l’occupation
fût effective.
Voici le message adressé au Congres
par le Président, à l’occasion de ce
projet :
« Comme conséquence
de la ratification du traité de Paris par le Sénat
des États-Unis et de la ratification présumée
par le gouvernement espagnol, les États-Unis vont
se trouver en possession des îles Philippines. Les
îles Hawaï et Guam faisant partie du territoire
américain et présentant des points intermédiaires
d’atterrissage commodes pour la pose des câbles,
le besoin d’établir des communications télégraphiques
reliant les États-Unis et les îles du Pacifique
s’impose absolument et dans le plus bref délai.
Une telle communication devrait être établie
de façon à se trouver entièrement
sous le contrôle des États-Unis, en temps
de paix comme en temps de guerre. A l’heure qu’il
est, des télégrammes ne peuvent arriver
aux Philippines qu’en empruntant les lignes de pays
étrangers, et la navigation seule nous permet de
correspondre avec les îles Hawaï et Guam, ce
qui occasionne des retards de huit jours pour chaque courrier.
Une pareille situation ne devrait pas être tolérée
plus longtemps.
« Le moment est venu de poser, à
travers le Pacifique, un câble allant jusqu’à
Manille, avec relais aux îles Hawaï et Guam.
Deux méthodes pour l’établissement
d’une pareille communication s’offrent à
première vue : d’abord, construction et entretien
de ce câble par le gouvernement des États-Unis
; ou bien, construction et entretien de cette ligne par
une compagnie américaine, à des conditions
dictées par le Congrès.
« Je ne veux pas indiquer
de préférence au Congrès sur l’une
ou l’autre de ces méthodes. Un câble
de cette longueur ne saurait être construit en peu
de temps ; on pense qu’il faudrait au moins deux
ans, à partir du moment où l’ordre
aura été donné, pour que la ligne
puisse être posée avec succès. En
outre, des sondages sont encore indispensables à
l’ouest des îles Hawaï, avant que le choix
de la meilleure route ne soit définitivement arrêté.
« Etant données ces
différentes circonstances, il devient absolument
nécessaire que telles mesures soient prises par
le Congrès avant la fin de la session, qui permettent
de s’assurer les moyens d’établir ce
réseau télégraphique. Je recommande
cette question à l’attention du Congrès,
en le priant d’agir avec toute la célérité
que comporte un sujet aussi important.
« W. MAC KINLEY. »
Passant immédiatement aux actes, le gouvernement
américain a déjà fait exécuter,
avant le vote du Congrès, par un navire de guerre,
une campagne de sondages pour l’étude de la
route du nouveau câble. Ce travail est dès
à présent terminé.
Pour leurs débuts dans la
politique coloniale, les États-Unis montrent, par
ce projet, une compréhension clairvoyante des nécessités
qui nous ont longtemps échappé en France.
Nous avons des colonies depuis des siècles. Depuis
vingt-cinq ans, nous avons conquis un vaste empire colonial,
et la plus grande partie de nos possessions ne sont encore
reliées télégraphiquement à
la métropole que par les moyens les plus précaires.
Un autre grand pays se prépare
aussi à prendre une place parmi les nations coloniales
par la création d’un réseau télégraphique
sous-marin. L’Allemagne elle-même, malgré
une situation géographique qui ne lui donne des
côtes que sur la mer du Nord, veut avoir des câbles
qui soient indépendans et lui assurent la sécurité
pour ses correspondances télégraphiques,
au moins avec l’Amérique. Elle va réaliser
un projet sur lequel l’attention doit s’arrêter
un instant. Il est, en effet, d’origine et de conception
françaises. C’est le projet qui a été
étudié en France, sous le nom de «
projet des Açores, » et qui a été
abandonné. Il est repris aujourd’hui et va
être réalisé, de point en point, par
l’Allemagne. Il consiste dans l’établissement
de lignes nouvelles qui relieront l’Allemagne à
l’archipel des Açores, et les Açores
à l’Amérique du Nord, en créant
au milieu de l’Atlantique le centre télégraphique
que la France aurait pu établir elle-même,
il y a quelques années.
On a remarqué, sans doute, l’information
publiée, il y a quelque temps, par les journaux
américains, annonçant que l’Allemagne
avait obtenu l’autorisation de faire atterrir un
câble sur le littoral des États-Unis. On
a lu également les dépêches amicales
qui ont été échangées à
cette occasion entre l’Empereur allemand et le Président
Mac Kinley. Or, cette autorisation et cet échange
de télégrammes visaient ce projet. Dans
dix-huit mois, deux ans au plus, un câble transatlantique
sera posé entre l’Allemagne et l’Amérique,
en passant par les Açores. Il sera établi
par une compagnie allemande, avec le concours du gouvernement,
et l’entreprise est placée, dès à
présent, sous le plus haut et le plus officiel
des patronages. Tous ces faits montreraient, si cela était
encore nécessaire, l’importance donnée,
dans tous les pays maritimes, à la question des
câbles télégraphiques.
On serait injuste si, après avoir
indiqué ce que font ou veulent faire les autres
pays, on passait sous silence ce qui a été
réalisé en France pour commencer au moins
à garantir notre pays contre certains dangers.
Il y a trois ans seulement, il n’existait,
comme entreprise télégraphique française,
qu’un petit réseau de câbles reliant
quelques-unes des Antilles entre elles et à l’Amérique
du Sud ; puis une seule ligne transatlantique entre Brest
et les Etats-Unis, sans débouchés assurés
en Amérique, dépendant par conséquent
des compagnies anglaises et américaines, et à
peu près complètement asservie par elles.
Dans le courant de ces trois dernières
années, un effort intéressant a été
fait pour rompre le cercle d’hostilités concurrentes
qui avait paralysé jusqu’alors toutes les
entreprises françaises de télégraphie
sous-marine.
Un premier câble a été
établi entre Haïti et l’Amérique
du Nord, pour relier le réseau des Antilles au
câble transatlantique qui venait aboutir à
Brest. Ce câble transatlantique a été
lui-même doublé par une nouvelle ligne sous-marine
qui relie directement Brest à New-York. La nouvelle
ligne est la plus longue qui existe actuellement : elle
a plus de 6 000 kilomètres ; sa construction et
son immersion ont présenté des difficultés
exceptionnelles, et, pour ses débuts, l’industrie
française a accompli une œuvre audacieuse,
à laquelle ses concurrens eux-mêmes rendent
justice.
Aujourd’hui, un système télégraphique
français fonctionne, avec ses ressources de trafic
propres, avec des développemens de lignes qui lui
permettent d’atteindre l’Amérique du
Nord, toutes les Antilles et l’Amérique du
sud jusqu’au Brésil. Ce système télégraphique
comprend déjà 23 500 kilomètres de
câbles ; il vient au troisième rang comme
importance et étendue de réseau, et, seul
jusqu’à présent, il se développe
en face de l’énorme monopole des compagnies
anglaises. Son point d’attache est Brest, son exploitation
et sa direction sont françaises, et il apporte
aux correspondances avec nos possessions américaines
les garanties et les sécurités que l’on
réclame pour toutes nos possessions coloniales.
Malheureusement, il n’en est pas
de même pour l’Afrique, l’Orient et l’Extrême-Orient.
Vers ces régions, nos correspondances ne peuvent
être transmises par des lignes françaises
que jusqu’à Marseille pour l’Orient,
jusqu’à Alger ou Oran pour l’Afrique.
De ce côté, rien n’a encore été
entrepris et nous avons tout à faire.
Nous avons vu qu’un actif mouvement
d’idées et de projets se produit dans tous
les grands pays maritimes, en faveur de la création
de réseaux de câbles. Les événemens
de la guerre hispano-américaine avaient donné
une poussée vigoureuse à ce mouvement ;
les incidens plus récens de la guerre du Transvaal
viennent de faire toucher du doigt le danger qu’il
peut y avoir à laisser subsister le monopole britannique
qui pèse sur toutes les nations[2]. La France particulièrement
se trouverait menacée et atteinte, si les circonstances
l’amenaient à soutenir une guerre contre l’Angleterre.
La seule idée qu’il lui serait alors impossible
de correspondre avec ses colonies et avec ses escadres
en Orient et en Afrique éveille une poignante inquiétude.
Par quels moyens peut-on modifier
cet état de choses ? Quelles mesures est-il encore
possible de prendre ? Ces questions paraissent aujourd’hui
de la plus pressante actualité. Elles ont surgi
tout à coup devant l’opinion qui, surprise
par la découverte d’une insuffisance nouvelle
dans nos moyens de défense, n’est pas loin
d’accuser nos pouvoirs publics d’imprévoyance.
Il est inutile de reprendre l’historique
des tentatives faites, depuis une vingtaine d’années,
pour constituer des réseaux télégraphiques
français. Sauf la création du réseau
qui relie maintenant la France aux États-Unis et
à ses possessions américaines, elles ont
toutes échoué lamentablement et ne fourniraient
qu’une preuve de plus de l’ignorance où
nous avons été de nos intérêts.
Quelques petits câbles ont cependant
été immergés : entre Majunga et Mozambique,
pour Madagascar[3] ; entre Nouméa et la côte
Australienne pour la Nouvelle-Calédonie ; entre
Saigon et Haïphong, pour le Tonkin ; entre les Canaries
et Saint-Louis, pour le Sénégal ; enfin,
entre Obock et l’île de Périm pour notre
possession de la Mer-Rouge. Ces petits câbles, dont
les plus importans sont exploités par des compagnies
anglaises que nous subventionnons, aboutissent tous à
des lignes anglaises et n’en sont en réalité
que de simples annexes.
On doit d’autant mieux signaler cette
situation qu’elle est le résultat d’une
erreur, qui a dominé jusqu’à présent
ce qu’on a voulu appeler déjà notre
« politique des câbles, » et qui hante
encore certains esprits. Afin de remettre au lendemain
certaines charges budgétaires inévitables
si l’on a quelque souci de l’avenir du pays,
on a préféré les demi-mesures, si
habituelles en France, en posant aux quatre coins du monde
de petits bouts de câbles pour relier certaines
de nos colonies au réseau télégraphique
général. On oubliait que ce réseau
appartient en fait aux compagnies anglaises, à
qui l’on a confié jusqu’au soin déposer
et d’exploiter certains de ces câbles. Celles-ci,
heureuses de l’aubaine, reçoivent les subventions
françaises et tirent tout le bénéfice
de l’établissement du télégraphe
dans les pays nouveaux que nous colonisons. Ces bouts
de câbles éloignés les uns des autres,
sans lien entre eux, sont une charge parfois lourde, qui
ne donne aucune sécurité à nos correspondances
et nous laisse toujours tributaires du réseau anglais.
C’est donc une conception erronée
et dangereuse de la question des câbles que celle
qui consiste à créer de petits réseaux
locaux pour nos colonies. La conception vraie, celle qui
seule peut conduire à une solution pratique, est
la création de systèmes télégraphiques
groupant nos possessions coloniales par régions,
et les rattachant à la métropole par des
câbles indépendans du réseau anglais.
C’est le seul moyen d’avoir des réseaux
de câbles qui puissent devenir productifs à
un moment donné, en les constituant de telle façon
que le trafic télégraphique créé
par les nouvelles lignes ne soit plus détourné
au bénéfice des lignes anglaises. C’est
ce transit de la correspondance entre nos colonies et
la France qui peut fournir la rémunération
des nouvelles entreprises : il est naïf de l’abandonner
aux entreprises rivales. C’est aussi à cette
condition seulement que nous éviterons la domination
anglaise, et que nous aurons entre les mains l’agent
d’information et de défense qui nous est indispensable,
surtout dans un moment où nous avons tant d’intérêts
à surveiller en Chine, au Siam, à Madagascar,
au Maroc et dans toute l’Afrique occidentale.
Il semble d’ailleurs que l’on
doive, dans les circonstances actuelles et pour l’avenir,
envisager la question des câbles avec une courageuse
ampleur, si on veut la résoudre. Il existe aujourd’hui
une lacune dans l’armement de la France pour la défense
de ses intérêts dans les pays d’outre-mer,
lacune qu’il faut combler sans perdre de temps, si
l’on veut être prêt pour certaines éventualités
menaçantes.
Il faut, par conséquent,
se résoudre à procéder par mesures
d’ensemble vigoureuses et rapides, comme on l’a
fait lorsque des insuffisances ou des faiblesses ont été
constatées dans nos arméniens, dans l’organisation
de nos lignes de chemins de fer et dans la construction
de nos navires. C’est à ce prix que nous pourrons
regagner le temps si inutilement perdu depuis quelques
années. L’étude et le choix d’un
programme, dont l’exécution serait suivie
avec la continuité de vues et la persévérance
dont les Anglais nous donnent chaque jour l’exemple,
seraient une chose aisée à l’heure
présente, car les enseignemens de la guerre hispano-américaine
et de la guerre du Transvaal paraissent avoir disposé
le gouvernement et l’opinion publique elle-même
à porter de ce côté leur attention
et leur sollicitude.
Il ne s’agirait pas, au surplus,
d’engager directement l’État dans les
dépenses d’établissement des réseaux
et d’en faire porter toute la charge au budget. L’intervention
de l’initiative privée pourrait fournir en
France, comme cela a eu lieu en Angleterre, les moyens
de réaliser ces entreprises. Seulement, il faut
bien comprendre et admettre que les nouveaux réseaux
télégraphiques, n’ayant plus le choix
des pays riches à desservir, ne seront d’abord
et pour plusieurs années que des instrumens politiques
établis en vue de défendre un intérêt
d’ordre général pour le pays ; ils
ne deviendront des instrumens d’industrie et de commerce,
productifs de ressources suffisantes pour assurer leur
existence, que progressivement, au fur et à mesure
du développement de nos colonies et, partant, du
trafic télégraphique. C’est seulement
après quelques années qu’ils pourront
vivre par eux-mêmes et se passer d’un concours
gouvernemental.
Ce concours, qu’il soit donné
sous forme de subventions, comme en Angleterre, ou de
simples garanties, doit être fourni, pour les débuts,
dans des conditions assez larges pour apporter au moins
la sécurité aux capitaux engagés.
Il serait amplement justifié par un intérêt
politique dont on ne peut plus méconnaître
l’importance. Cet intérêt est de la
même nature, du même ordre que celui qui a
fait, il y a cinquante ans, accorder les subventions postales.
Aujourd’hui, la télégraphie complète
la poste, la précède dans toutes les relations
éloignées ; elle est, tout autant que sa
respectable devancière, un moyen d’incontestable
influence et elle peut être appelée à
jouer un rôle autrement actif et utile dans la solution
des questions qui intéressent notre avenir et notre
défense en pays d’outre-mer. Pourquoi, dès
lors, ne pas admettre l’idée d’un large
concours de l’Etat en faveur des réseaux télégraphiques,
pour les mêmes raisons qui ont fait inscrire les
subventions postales au budget et les y font maintenir
?
Pour rassurer les esprits que l’équilibre
de nos finances pourrait inquiéter, il faut se
hâter de dire que cette participation de l’État
serait vraisemblablement bien loin d’atteindre le
chiffre des subventions actuellement attribuées
aux services postaux. De plus, au lieu d’être
permanente comme la charge des subventions postales, elle
pourrait être réductible et même disparaître
au bout d’un certain temps, lorsque, par le développement
normal de la correspondance télégraphique,
les réseaux auraient acquis des ressources d’existence
assurées.
Par une heureuse fortune, l’établissement
des réseaux de câbles, réclamés
par notre défense, répond, en effet, la
plupart du temps, à des besoins économiques
et commerciaux d’une telle valeur que ces besoins,
donnant une certitude d’avenir, suffiraient, dans
un pays plus audacieux que le nôtre, à provoquer
la création de ces réseaux.
La télégraphie sous-marine
est un nouvel instrument de travail et de progrès,
qui débute dans la vie internationale, et dont
les applications peuvent avoir des développemens
sans limites. Il y a quarante ans à peine que le
premier câble transatlantique a été
ouvert au service, et, l’année dernière,
plus de 30 millions de mots ont été échangés
entre l’Europe et l’Amérique du Nord.
Il est impossible d’apprécier ce que sera
ce mouvement de correspondances dans quarante nouvelles
années, alors que l’usage du télégraphe
se propage chaque jour. Il atteindra peut-être 80
ou 100 millions de mots entre les deux continens, et c’est
précisément dans cette merveilleuse expansion
de la télégraphie sur tous les points du
globe que la France devrait se trouver prête à
prendre sa grande et légitime part.
Par conséquent, au simple point
de vue économique, c’est un domaine nouveau
qui s’ouvre devant l’activité française.
Ce domaine a déjà été exploré
; de grandes entreprises télégraphiques
se sont constituées dans d’autres pays : en
Angleterre, pour rayonner sur le monde entier et le dominer
; en Danemark, pour desservir le nord de l’Europe
et l’Asie. Toutes, elles ont eu des débuts
laborieux ; cependant, aujourd’hui, elles en sont
arrivées à un état de puissante prospérité,
qui se traduit, pour l’ensemble de celles de ces
entreprises qui ont acquis leur développement normal,
par des recettes annuelles qui dépassent 110 millions
de francs.
La situation géographique de la
France, à l’extrémité de l’Europe
continentale, en face de l’Amérique, avec
des côtes sur l’Atlantique et la Méditerranée,
se prête admirablement à la création
de ces entreprises. Si nous avions eu un peu de hardiesse
et de persévérance,, nous aurions, depuis
plusieurs années, des câbles nous reliant
avec nos colonies, ainsi que de nombreux câbles
transatlantiques, et le grand centre des échanges
télégraphiques entre l’Europe et le
monde entier, au lieu de Londres, serait peut-être
Paris.
N’y aurait-il pas, d’ailleurs,
pour la France, un rôle intéressant à
prendre dans le mouvement qui se manifeste aujourd’hui
dans tous les pays, pour arriver à s’affranchir
du monopole télégraphique anglais ?
Pour annihiler ce monopole et en supprimer le danger,
il suffit qu’un réseau non anglais soit créé
et puisse atteindre toutes les régions où
l’Europe possède des intérêts.
Peut-être serait-ce un acte de sage et prévoyante
politique que d’associer à cette entreprise,
dans les mesures conciliables avec les besoins de notre
défense, les autres pays qui, ne pouvant eux-mêmes
avoir des réseaux, veulent cependant échapper
à la dépendance où ils se trouvent
?
Le caractère international ainsi donné aux
nouveaux réseaux serait la meilleure des sauvegardes
contre les ruptures en temps de guerre, et si, dans l’avenir,
ces réseaux se multipliaient et formaient à
leur tour, au fond des mers, une nouvelle toile d’araignée
inoffensive et pacifique, on aurait fait le pas le plus
décisif vers la neutralisation des câbles.
Il y aurait assurément là une œuvre
d’émancipation et de progrès dont la
France devrait prendre l’initiative, et où
elle se retrouverait fidèle à ses vieilles
et historiques traditions.
J. DEPELLEY
|
sommaire

La CFCT se lance dans un plusieurs projets qui consiste à
relier Oran à Saint Louis (Sénégal), Libreville
à Porto Novo et Saint Louis à Para (Brésil)
; mais le gouvernement a changé. Depuis le 22 juin 1899,
le nouveau ministre du Commerce, de l’industrie et des
P&T est Alexandre Millerand. Il connaît bien la question
des câbles sous-marins pour avoir souvent argumenté
contre le « parti colonial » à la Chambre
des députés. Il a d’autres vues et fait voter
un crédit de 5.500.000 francs le 25 janvier 1901 pour
le rachat de la compagnie britannique qui exploite le câble
Dakar – Para (Brésil) ainsi que les câbles
de la cote d’Afrique desservant la Guinée, la Cote
d’Ivoire et le Dahomey (Bénin) à la compagnie
West African Telegraph Co mais il souhaite que l’administration
conserve l’exploitation des câbles tout en confiant
l’entretien à des câbliers anglais.
Depuis la fin de l’année 1900, la CFCT connaît
des difficultés financières. L’affaire est
jugée par le tribunal de commerce et seul un concordat
avec son principal créancier, la SGDF peut lui éviter
la faillite. Jules Caubet négocie une aide de l’Etat
mais il s’agit d’un nouveau plan de sauvetage. Il
obtient 8 millions de francs pour l’amélioration
du réseau, la construction d’un navire, et un rééchelonnement
des dettes contre l’abandon de créance de la SGDF
et un contrôle accru de l’Etat. Une nouvelle convention
avec l’Etat est signée le 28 mars 1901, approuvée
par la Chambre des Députés et ratifiée
le 31 juillet 1901. Le concordat est signé le 9 novembre
1901 entre la CFCT (Caubet – Dupelley), le Ministère
des
Finances (J Caillaux), le Ministère du Commerce, de l’Industrie
et des P&T (A Millerand) et la SGFT, (Villars).
Caubet doit céder la place au représentant des
créanciers. Il démissionne le 17 mars 1902 pour
être remplacé par Villars. Celui-ci prend ses fonctions
quelques semaines avant l’éruption de la Montagne
Pelée, le 8 mai 1902. La CFCT doit faire face aux conséquences
de l’éruption : les
câbles Martinique – Puerto Plata et Martinique –
Guadeloupe sont coupés et la l’île est isolée
du monde.
Face à la situation, la CFCT doit respecter la convention
: affréter un service de navires pour remettre les messages
privés à la société anglaise, payer
50% des frais d’installation de la liaison radiotélégraphique
installée par le capitaine Férié entre
la Martinique et la Guadeloupe pour acheminer le courrier officiel
acheter du câble de réserve à la SIT alors
qu’elle peut obtenir de meilleurs prix en Angleterre, se
priver des subventions des conseils généraux des
îles qui considèrent que le service public n’est
pas assuré.
La CFCT est encore en cessation de paiement et l’Etat doit
intervenir. Le 11 novembre 1903, Villars démissionne.
Il est remplacé par Edouard Jéramec. Quant au
contre amiral Caubet, il reste au Conseil d’Administration.
Il assistera très ponctuellement aux Conseils d’Administration
qui se réunissent tous les quinze jours jusqu’au
15 janvier 1912.
Le Conseil suivant (12 février 1912) est informé
de son décès survenu le 2 février 1912.
sommaire
La CFCT à la veille de la guerre de 1914 –1918
Le nouveau président Edouard Jéramec mettra dix
ans pour redresser la société. Il réussit
à pacifier les relations entre la société,
l’administration et le constructeur. A partir de 1904,
il est aidé par une croissance continue du trafic transatlantique.
En 1913, l’administration l’autorise à construire
le successeur du câblier Caubet. Cette mesure, la modernisation
de l’équipement d’exploitation (installation
en 1912
d’amplificateurs Heurtley sur le Brest – Saint Pierre)
et l’installation de bureaux commerciaux à Londres
et à New York permettent de revenir
progressivement à l’équilibre financier.
A la différence des compagnies étrangères,
les sociétés privées françaises
ont toujours été sévèrement encadrées
par leurs ministères de tutelle. La CFCT, pas plus que
ses devancières, n’a disposé de moyens pour
investir et améliorer sa productivité. Par comparaison,
les sociétés anglaises et américaines,
moins encadrées par leurs gouvernements, peuvent facturer
normalement le trafic officiel. Celles-ci reçoivent également
des subventions pour maintenir en service des lignes coloniales
non rentables.
Dans la thèse de M de Margerie publiée en 1909,
l’auteur montre que les sociétés anglaises
bénéficient d’un excédent annuel d’exploitation
qui
permet de provisionner pour des investissements ultérieurs
tout en distribuant des dividendes dans une fourchette de 5
à 9 % du capital investi.
Pourtant, tout en construisant un réseau à faible
coût, la CFCT a permis à la France d’être
présente dans le domaine concurrentiel alors que
l’administration, de par son statut de puissance publique,
en est empêchée. Celle-ci ne sera pas récompensée
puisque, après la présidence de Jules
Caubet, la longueur du réseau de la compagnie reste stable
(21.204 Km en 1910 ; 20.853 Km en 1928).
Le réseau colonial construit à partir de 1900
câbles d’Indochine, de Madagascar, d’Indonésie
et d’Afrique de l’Ouest) est construit par l’administration
et concédé à des entreprises britanniques
ou géré par la direction des câbles sous-marins
(réseau côtier, câbles franco-anglais et
câbles sur l’Afrique du Nord.
sommaire
LE NAVIRE CABLIER « CONTRE AMIRAL CAUBET»
Le navire Contre Amiral Caubet a été construit
en 1875 par les Forges et Chantiers de Méditerranée
à Graville (Le Havre) sous le nom de « Portena
». Il est acheté le 9 juillet 1896 par la Compagnie
Française des Câbles Télégraphiques
(CFCT) qui transforme le navire en câblier. La commande
pour la transformation du navire en câblier est signée
le 30 août 1896 avec le chantier britannique de Glasgow
Johnson et Phillips pour un montant forfaitaire de 20.000 livres.
En décembre, le ministre de la Marine autorise le président
Caubet à donner son nom au Portena et le Conseil du 22
octobre décide « toutes les mesures nécessaires
pour changer le nom du navire ». Le navire quitte Glasgow
le 26 février 1897 pour charger du câble à
Calais puis rejoindre le Havre, son port d’attache le 2
avril 1898. Il rejoint Saint Pierre le 21 avril pour sa première
réparation entre Saint Pierre et Cap Cod.
Si les équipements câbliers sont neufs, le navire
a une coque et une machine qui ont plus de 20 ans de service.
Pendant sa carrière, le navire sera souvent éprouvé
par les conditions météorologiques régnant
dans l’Atlantique Nord. En 1902 – 1903, lorsque les
câbles atterrissant à la Martinique sont endommagés
par les conséquences des éruption de la Montagne
Pelée (mai à août 1902) et que la liaison
New York – Cap Haïtien, le navire est en arrêt
technique pour avoir brisé son arbre porte hélice.
La vie à bord était difficile. En 1905, Edouard
Jéramec charge le docteur du Pouyer Quertier d’une
évaluation des conditions de travail à bord des
navires et accorde une prime de travaux câbles de 0,5
franc par jour. Les rapports du Conseil d’Administration
indiquent qu’un matelot meurt du
scorbut en 1905, sa famille portant plainte contre la société
pour manque de soins. En 1910, des incidents éclatent
à bord sur la qualité du vin et de
la nourriture ; le commandant Villedieu jugé trop faible
est débarqué. Son remplaçant rédige
un rapport, débarque un graisseur qui sera puni de
deux mois de prison par le tribunal maritime.
Avant de démissionner en 1903, le président Villard
avait inscrit au budget une provision pour l’acquisition
d’un nouveau navire. Le Minia puis le
Viking ont été envisagés. Son successeur
(Edouard Jéramec) avait reçu des assurances du
ministre au moment de sa nomination mais il ne fut pas
autorisé à passer la commande d’un navire
neuf à un chantier français. En février
1911, le navire avait alors 37 ans lorsqu'il rentre au port
d'attache
très éprouvé par les glaces. Il ne sera
plus chargé de travaux et servira de dépôt
de câble jusqu’à son remplacement. C’est
en 1913, à peine un an après la mort du contre
amiral Jules Caubet, que l’administration accepte le remplacement
du navire Celui-ci, construit à Granville est lancé
le 28
novembre 1913, et reçoit le nom du président,
comme ses prédécesseurs. Il effectue ses essais
du 26/28 mars 1914 et rejoint son port d'attache
d'Halifax le 29 mai 1914 après être passé
chargé du câble à Londres. Quand au câblier
Caubet, il est vendu à une société américaine
en 1915, rebaptisé Vigo, il quitta le monde des câbles
sous-marins.
Ses caractéristiques sont les suivantes :
Jauge brute : 2.078 tonneaux
Port en lourd : 2355 tonnes
Longueur : 102 mètres.
Largeur : 10,60 mètres
Creux : 7,70 mètres
Hélice unique. Machine compound. Machines à câbles
de Johnson and Phillips
|
sommaire
LE NAVIRE CABLIER D’ARSONVAL. (Le
nom d'arsonval est bien connu dans ce site,
c'était un pionnier du téléphone.)
Initialement construit pour la marine italienne
en 1941 aux chantiers de Gènes, le navire Giasone est destiné
à plusieurs tâches différentes (navire de
défense anti-aérienne, remorqueur, navire-câblier),
sa première activité est de coupé les câbles
alliés à partir de sa base de Gènes jusqu’en
1943.
Lorsque l’Italie abandonne l’Allemagne en 1943 et se
range aux côté des alliés, le navire est réquisitionné
et basé à Marseille. Il continue son activité
de coupeur de câbles en arborant sa curieuse tenue camouflée.

Le 15 août 1944, dès le débarquement de Provence,
l’occupant fait sauter les installations portuaires, plus
de 200 navires et le pont transbordeur de Marseille. Parmi ces
navires le Giasone et l’Ampère . L’Ampère
se révèle irrécupérables mais pas
son voisin qui est jugé digne d’être renfloué.
La mise en service du NC d’Arsonval était annoncée
avant la fin de l’année 1947 après de longs
et coûteux travaux. Il faut ensuite avoir l’aval de
la
Commission des réparations pour francisé le navire
réclamé par son pays d’origine.
Après avoir pris connaissance du montant des travaux, l’Italie
abandonne le navire et le navire commence une longue campagne
accosté sur le quai des Belges à Marseille où
il fête le 8 mai aux coté du navire britannique Sainte
Margareth. Enfin prêt, son inauguration a lieu le 11 juillet
1948 à La Seyne sur Mer puis célèbre la fête
nationale aux côtés de l’Emile Baudot. Sa mise
en service comble à la fois le vide de trois navires perdus
(Ampère 2) ou hors d’âge (Arago et Emile Baudot)
et le besoin de navires est immense. Elle permet de remplacer
l’Arago mais c’est l’Alsace qui est basé
à Dakar.
Dès sa mise en service, il est basé à La
Seyne sur Mer et participe à la remise en état du
réseau en Méditerranée (4 réparations
en 1950, 7 réparations en 1951 et 12 réparations
en 1952). Il est appelé en Atlantique pour terminer la
remise en état du Brest-Cap Cod (entre 1949 et 1952 avec
l’Alsace, le Pierre-Picard et l’Emile Baudot).
En automne 1950, il est chargé de posé le premier
répéteur sous-marin téléphonique entre
Cannes et Nice par 2.200 mètres de profondeur fournissant
4 voies téléphoniques amplifiée et qui marchait
encore sans défaillance pendant 4 ans avec une stabilité
de gain remarquable comme le rappelait Mr Julien 13.
Pour le directeur du navire, « Ce navire jeune, qui n’était
pas un câblier à sa mise en service et qui a été
transformé à cet effet en 1947. Le résultat
de cette adaptation ne donne que partiellement satisfaction. Les
défauts majeurs du d’Arsonval sont son faible rayon
d’action, partie arrière très mal défendue
contre le mauvais temps et sa très faible économie.
En Atlantique Nord, ses zones d’intervention sont limitées
au plateau continental Est, à condition de ne pas s’écarter
à plus de 150 nautiques d’un port d’abri et de
mazoutage ».
En décembre 1964, l’administration se sépare
de son navire. Il est alors basé à Brest près
d’un nouveau navire, le Marcel Bayard adapté à
la pose des nouveaux câbles coaxiaux. Pour l’entretien
du réseau côtier et du réseau d’Afrique
de l’Ouest, on fera appel aux navires de La Seyne sur Mer
(Ampère ou Alsace). La flotte câblière est
donc réduite de 4 à 3 unités.
On a ignoré que l’Administration met en service un
premier navire océanographique, le Jean Charcot et la flotte
est toujours de 4 navires. Le CNEXO, devenu IFREMER tire bénéfice
de la compétence de l’Administration des PTT pour
assurer les nombreuses missions qui lui sont confiées.
Quant au D’Arsonval, vendu à un acheteur Belge, il
sera démoli à Anvers à partir du 18 février
1965. |
sommaire
Navire câblier L'Alsace
|
Ce navire câblier a été
construit en 1938-1939 aux Chantiers de Normandie de GrandQuevilly,
à Rouen.
Lancement du cablier "Alsace" aux
Chantiers de Normandie à Grand-Quevilly le 20 juin 1939
en présence de Jules Jullien, alors ministre des postes,
télégraphe, téléphone et transmissions.
Il était destiné à remplacer l' «
Arago » stationné à Dakar et conçu
pour naviguer sous les tropiques. Il fut lancé début
1940 en présence de monsieur Julien, ministre des PTT.
- Longueur hors tout : 88,05 mètres
- Largeur hors membrure : 12,10 mètres
- Déplacement : 2 092 tonnes
- Port en lourd : 1 500 tonnes
- Tirant d'eau : 5,30 mètres
- Puissance : 2 650 CV (deux machines à vapeurs alternatives,
chauffées au mazout)
- Vitesse de croisière : 11,5 noeuds
- Vitesse maximum : 14,5 nœuds
- Trois cuves à câbles.
- Rayon d'action : 25 à 28 jours
Armé à Brest, il appareilla le 17 juin 1940 pour
sa première campagne. L'armée allemande avançait
rapidement et la veille, un violent bombardement sur la ville
et la rade lui donna le baptême du feu. A noter qu'il
traversa toute la guerre sans encombre, il en est des navires
comme des hommes.
Chargé de réparer le câble Brest-Fayol-New
York à la hauteur de Fayol, il gagna Dakar, sa réparation
terminée, dans l'attente des ordres. Il rejoignit peu
après Casablanca où il séjourna onze mois,
contraint à l'inactivité par la pénurie
de mazout.
Fin 1941, il appareilla pour Alger.
Au débarquement allié, il reprit ses activités
et devait naviguer tant en Méditerranée, qu'en
Atlantique Nord et Sud.
Il fut désarmé en 1973 à Brest et conduit
à Landevennec (cimetière marin), puis remis aux
Domaines qui le vendirent en juillet 1974, pour la démolition.
Son compas de route et sa table de mesures sont visibles au
musée des câbles sous-marins à la Seyne
sur mer. Quant à l'appartement du Chef de Mission, conçu
par un décorateur parisien, il a été démonté
et remisé dans un entrepôt de la direction des
télécommunications du réseau international
à Brest.
|
sommaire
LE Navire Câblier FRANÇOIS ARAGO
Le NC FRANÇOIS ARAGO (1882 - 1944) a eu une carrière
bien remplie.
• Initialement, ce câblier construit en 1882 par la
Société anglaise WT. Henley's Telegraph Works Company
s'appelait le Westmeath.

• Le navire est affrété en 1887 par la Société
Générale des Téléphones.
Cette compagnie absorbe en 1888 une société locale
: La Participation des Câbles des Antilles et crée
la Société Française des Télégraphes
Sous Marins. Le navire pose un vaste réseau de câbles
entre le Brésil et les Caraïbes est réalisé.
• En 1893, le navire est acheté par la Société
Générale des Téléphones et devint
le "François Arago". Cette société
filialise ses activités d'installation de câbles
sous marins, le François Arago et la fabrication des câbles
dans l'usi ne de Calais au sein d'une nouvelle entité :
La
Société Industrielle des Téléphones.
• La liaison Australie - Nouvelle Calédonie sera le
premier câble posé par le navire en 1893. Il terminera
sa carrière de câblier en 1914.
• J.F. Guillaume, chef de service à FCR est particulièrement
fier de rappeler à ses visiteurs que la photo de l'état
major d'un navire des années 1900 qui est accrochée
dans son bureau est celle du NC François Arago dont le
Chef de Mission est un de ses parents par alliance.
• Photo de l'équipage avec le grand père Le
Floch et son grand oncle Le Genziec.

Le François Arago ex Westmeath (à ne pas confondre
avec l’Arago tout court) a été construit en
1882 pour W.T.Henley’s Telegraph Works Company et loué
en 1887 à la société française des
télégraphes sous-marins, puis acheté en 1893
par la société Industrielle des téléphones.
Il sera utilisé comme câblier jusqu’en 1914.
(d’après cableships and submarine Cables de K.R. Haigh)
.
|
sommaire
Organisation administrative
En janvier 1988, La DGT prend le nom de France
Télécom, et Radio France Câbles & Radio
(FCR) devient FT Marine, puis en juillet 2013, La raison sociale
et le nom juridique de France Télécom SA devient Orange
SA et France Télécom Marine devient Orange Marine.
|
1886: Création de la Société
Française des Cables sous-marins, avec l'apuis des
PTT des déposa un projet de liaison entre la métropole
et Madagascar via Tunis, Suez et Obok.
1892 la Société française
des Télégraphes sous-marins (SFTSM) . Le
contre amiral Caubet.
1892: Pose du câble télégraphique
entre Marseille et Oran (Algérie).
1893: Pose du câble télégraphique
entre Marseille et Tunis (Tunisie).
1895: PQ et SFTSM fusionnent pour dedenir
la Compagnie Française des Câbles Télégraphique
(C.F.C.T.).
1900: Création de la Société
Française de Télégraphe et de Téléphone
sans Fil.
1905: Un câble sous-marin est installé
de Brest en France à Dakar, au Sénégal,
sur une distance de 2847 nm.
1913: Suite à un accord entre
le Maroc et la France l’Office Chérifien des Postes
des Télégraphes et des Téléphones
est créer.
1915: Le câble sous-marin Brest
– Casablanca – Dakar est installé.
1945: Le gouvernement français
met fin aux activités la Compagnie Française des
Câbles Télégraphiques et confie la gestion
des câbles transatlantiques à la Compagnie des
Câbles Sud-Américains (Sudam).
1952: Les PTT transférèrent
leurs câbles africains à la Sudam.
1959: SUDAM et la CFCT fusionnent pour
devenir Compagnie Française des Câbles Sous-marins
et Radio.
1960: Le Cameroun deviennent indépendant
de la France et confie l'exploitation des télécommunications
internationales à la société France Câbles
Radio.
1962: Création de l’office
d’État des postes et télécommunications
de la Polynésie française.
1971: Création de STIMAD
(Société des Télécommunications
Internationales de la République de Madagascar) pour
les appels à l'international en par France Câbles
Radio et de l’Etat malgache.
1972: Le Senegal et la France Câbles
Radio font la création de Télésénégal.
1972: Création de la Société
des Télécommunications du Cameroun (INTELCAM)
pour prendre en charge l'ensemble des activités de France
Câbles Radio.
1976: Les PTT fond la création
de la Compagnie Française des Câbles Sous-marins
et de Radio.
1977: Suite à l' indépendance
de Djibouti, la Société des Télécommunications
Internationales de Djibouti (STID) est créer, dont
Compagnie Française des Câbles Sous-marin est actionnaire.
1979: Le Gouvernement Centrafricain et
la Compagnie France Câbles Radio fond la création
de la Société Centrafricaine de Télécommunications
Internationales (SOCATI), pour exploiter les communications
internationales et télex.
1981: Nationalisation de Télésénégal.
1982: La Compagnie Française des
Câbles Sous-marins devient Radio France Câbles
& Radio (FCR).
1985: FCR fait la création de
FCR Nouvelle-Calédonie.
Janvier 1988: La DGT prend le nom de
France Télécom, et Radio France Câbles &
Radio (FCR) devient FT Marine.
Novembre 1989: DGT et de la SOCATI fusionnent
pour devenir Société Centrafricaine des Télécommunications
(SOCATEL). SOCATEL est détenue à 60 % par l’État
et 40 % par France Cables & Radio.
Février 1992: France Câble
et Radio fait l'acquisition de Maxwell Satellite Communications
Ltd (Maxsat),
Mai 1993: France Câbles et Radio
(FCR) fourni l’installation de la Mission d’Assistance
Technique à SOTELGUI.
Mars 1995: Les télécommunications
nationales du Ministère des PTT et STELMAD fusionnent
pour devenir TELMA (SA). France Câbles Radio (France Télécom)
34 % du capital de TELMA et l’Etat malgache 66 %.
Juillet 1995: Création de Data
Telecom Services (DTS), par Télécom Malagasy (TELMA)
et France Câble Radio (FCR).
Janvier 1997: France Télécom
Câble et Radio détenu par France Télécom
fait l'aquisiton de 51 % de CI-Telcom.
Janvier 2000: France Câble et Radio
céde sa participation de 25% de la Société
des télécommunications internationales de Djibouti
(STID) à la demande du gouvernement djiboutien.
Août 2004: France Télécom
céde sa participation dans Telma.
Mai 2007: France Télécom
fait l'acquisition de licences en Centrafrique. France Cables
& Radio céde sa participation dans Socatel à
l’État centrafricain.
Octobre 2010: Telecom Italia céde
Elettra à France Télécom Marine.
sommaire
Juillet 2013: La raison sociale et le
nom juridique de France Télécom SA devient Orange
SA et France Télécom Marine devient Orange
Marine.

|
sommaire
|
Le câblier Great Eastern fut le
plus grand paquebot de son époque. Navire britannique
au destin singulier, il prit pour nom Leviathan puis
très vite fut rebaptisé Great Eastern par la société
the Great Ship Company qui le rachète en 1858,
après un lancement mouvementé.

Lancement du Great Eastern : Le monde illustré,
du 14 novembre 1857.
Dès sa construction les problèmes
s’accumulent : retards, incendies et décès
de trois ouvriers. Le lancement prévu le 3 novembre 1857
devant plus de 100 000 personnes est un fiasco, son poids est
tel qu’il ne peut être mis à l’eau. Ce
n’est qu’au troisième essai, le 31 janvier
1858, qu’il est mis à flots
Paquebot de croisière destiné à rallier
l’Australie sans escale, il devient navire câblier,
puis termine sa vie comme salle de music-hall et de fête
foraine, avant de finir à la casse.
Le monstre impressionne tant Victor Hugo qu’il lui consacre
un poème dans La légende des siècles :
" Le dernier siècle a vu sur la Tamise croître
un monstre à qui l’eau sans borne fut promise, […]
/ Quand il marchait, fumant, grondant, couvert de toile, Il
jetait un tel râle à l’air épouvanté
que toute l’eau tremblait, et que l’immensité
comptait parmi ses bruits ce grand frisson sonore "
 Le Great Eastern
Le Great Eastern
Le Great Eastern, conçu par Isambard Kingdom Brunel mesure
211 mètres de long, 25 mètres de large et 18 mètres
de haut. Le tirant d'eau est de 6,1 mètres et 9,1 mètres
à pleine charge, pour un déplacement de 27 000
tonnes. En comparaison, le Persia, lancé en 1856, ne
mesure que 119 mètres de long pour 14 mètres de
large.
L’exploitation commerciale du Great Eastern
est loin d’être rentable, il ne fera jamais le plein
de passagers. Plusieurs traversées sont émaillées
d’accidents. Alors qu’il essuie une violente tempête,
il perd une roue à aubes. Une autre fois, il heurte un
récif près de Long Island.
Il est le premier paquebot géant et le plus grand navire
jamais construit à son époque, avec une capacité
d'embarquement de 4 000 passagers sans qu'il soit nécessaire
de le réapprovisionner en charbon entre la Grande-Bretagne
et la côte est des États-Unis. Il détient
longtemps le record du navire le plus long (jusqu'en 1899) et
le plus gros du monde (jusqu'en 1901).
Après des débuts difficiles comme paquebot, il
est reconverti et pose le premier câble transatlantique
sous-marin puis sert d'attraction publicitaire et touristique
jusqu'à sa démolition en 1889.
Il est surtout célèbre pour avoir
incarné le gigantisme des projets de Brunel, son «
père » et concepteur qui l'appelait « mon
gros bébé », et de la révolution
industrielle du XIXe siècle. Il est aussi célèbre
pour ses malheurs et ses échecs, de sa construction à
son exploitation, qui lui ont donné la réputation
d'un navire maudit, accentuée par les légendes
qui l'ont entouré, dont celle qui rapporte que, lors
de sa démolition, deux cadavres d'ouvriers emmurés
vivants furent découverts dans la double-coque.
Après de nombreux déboires, le
Great Eastern est vendu aux enchères en 1864 pour 25
000 £ (son coût de construction avait été
de 1 000 000 £) à Daniel Gooch et ses associés.
Cyrus Field, un industriel américain
qui s'est lancé en 1857 dans un pari gigantesque, la
pose du premier câble télégraphique transatlantique
entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord décide
de l'utiliser comme navire câblier et le rachète
pour 50 000 £ avec l'Atlantic Telegraph
Company.
Le Great Eastern est en effet le seul navire capable de transporter
les 3 200 km de câble nécessaires.
En 1865, sous le commandement du capitaine Sir James Anderson,
il pose le câble mais le perd dans l'Atlantique par plus
de 3 000 mètres de fond au large de Terre-Neuve6.
Puis, en juillet 1866, il pose enfin un nouveau câble
opérationnel, depuis l'Irlande jusqu'au Canada (Terre-Neuve)
puis récupère le tronçon de câble
perdu en 1865 et en achève la pose .
De 1866 à 1878, sa seconde carrière lui permet
ainsi de poser près de 48 000 km de cinq autres câbles
sous-marins, notamment quatre transatlantiques de Brest à
Saint-Pierre-et-Miquelon, et un sous l'océan Indien d'Aden
à Bombay.
Entre-temps, rééquipé par Forrester &
Co. à Liverpool, il a également effectué
deux traversées pour la Compagnie des Affréteurs
du Great Eastern. En 1867 où une compagnie française
l’armera pour transporter des visiteurs américains
à l’exposition universelle de Paris. Jules Verne
fait le récit de cette traversée dans son livre
intitulé Une ville flottante.
Mais dans les années 1870, de nouveaux navires, spécifiquement
construits pour la pose de câbles sous-marins rendent
le Great Eastern obsolète. Il l'est aussi pour le transport
de passagers, notamment sur l'Atlantique où toutes les
grandes compagnies se sont lancées dans une course effrenée
à la performance. Sa largeur l'empêche d'emprunter
le canal de Suez alors mis en service.
Après une douzaine d'années passées à
Milford Haven au pays de Galles, la compagnie décide
donc de le vendre aux enchères.
Il est finalement acheté par Edward de Mattos en 1885
pour 26 000 £ afin de servir de gigantesque panneau publicitaire
et attraction flottante.
Il sert de salle de spectacle, de cirque ou de music-hall flottant
à Liverpool en 1886 mais aussi à Dublin et Greenock
en 1887 (il parvient à attirer 70 000 spectateurs en
un mois lors de la foire-exposition), de gymnase et d'attraction
publicitaire le long de la Mersey pour les magasins Lewis's.
Ces derniers propriétaires de fait le vendent aux enchères
en 1888 pour 16 000 £, un prix largement inférieur
à sa valeur en métal (qui en rapporte 56 000)
mais qui n'a même pas été rentable au vu
des travaux de démolition.
Il est démoli à Rock Ferry, sur l'estuaire de
la Mersey, près de Birkenhead par Henry Bath & Sons
en 1889-1890.
La démolition a pris dix-huit mois et nécessité
le travail de deux cents hommes. Un mât a été
acheté par les propriétaires de l'Everton Football
Club en quête d'un emblème pour leur stade d'Anfield,
devenu peu après, en 1892, celui du Liverpool Football
Club. Il orne toujours un des kops du stade.
|
À Saint-Pierre et Miquelon comme à Terre-Neuve,
l’arrivée des communications via le câble transatlantique
signifie un essor économique.câbles sous-marins. À
Heart’s Content, par exemple, le câble emploie à
son apogée, quelque 200 personnes (dans une communauté
de 1500 âmes). La compagnie de câble construit des logements,
une école.
Une aristocratie s’installe: on y joue
au tennis et au criquet et les employés gagnent bien leur vie,
surtout les femmes télégraphistes qui gagnent en général
plus que les hommes à cause de leur rapidité et de l’exactitude
de leur travail.
sommaire
|
LES
ÉTABLISSEMENTS MENIER
Fabrication du caoutchouc
et des câbles électriques
La fabrication
du caoutchouc et de la gutta-percha dans l'usine de Grenelle
datent des années 1860. De par son mariage, Émile
Justin Menier accède à un environnement industriel
qui ne peut qu'attirer sa curiosité et aiguiser son appétit
d'extension. Le monde de la chimie est en ébullition,
le caoutchouc associé à la vulcanisation démontre
des propriétés encore inconnues susceptibles de
créer une industrie nouvelle. La matière première
ne manque pas chez les Menier : les terres américaines
fournissent l'hévéa et la belle famille GÉRARD,
le savoir-faire par l'intermédiaire des l'entreprise
AUBERT & GÉRARD.
HISTORIQUE
En 1850, MM. Aubert
et Gérard s'associent pour le commerce du caoutchouc. Peu de
temps après, M. Garnier devient leur commanditaire. Puis, le
29 mars 4860, M. Garnier se retire, et MM. Aubert et Gérard
continuent seuls sous la raison Alexandre Aubert et Gérard.
En 1856, en dehors de ses droits dans la société française avec
MM.Aubert et Gérard, M. Garnier fonde en Allemagne avec Albert
et Louis Cohen, une autre société pour la fabrication du caoutchouc.
Le 22 avril 1859, une
nouvelle société prend la suite de celle-ci. Elle se fonde entre
MM. Albert et Louis Cohen, MM. Aubert et Gérard et M. Menier;
ce dernier comme commanditaire pour 800.000 francs. Le 19 novembre
1860, un M. Vaillant, commis principal et factotum de M. Aubert,
succède à M. Louis Cohen. En 1864, M. Albert Cohen est remplacé
par un M. Julius Blanke. Au mois de juillet 1864, une nouvelle
société prend la suite des affaires de celle créée le 22 avril
1859. Elle est formée entre MM. Julius Blauke et Vaillant, associés
en nom collectif, MM. Aubert et Gérard, M. Menier, M. Anatole
Gérard, madame veuve Gérard, M. Lapierre et M. Badon Pascal,
commanditaires de 800,000 francs dans certaines proportions.
Enfin, dans la même année,
les établissements de France et d'Allemagne sont fusionnés.
Le 13 décembre, une seule société, pour leur exploitation, est
formée entre Aubert et Gérard, associés en nom collectif, d'une
part, M. Menier, M. Anatole Gérard et madame veuve Gérard, d'autre
part, commanditaires pour 2.500.000 francs.
Telles sont donc
les phases de ces deux affaires qui ont fini par réunir et confondre
tous leurs éléments. Mais, en dehors des commandites, M. Menier
avait, dans le cours de toutes ces mutations, rendu des services
considérables à MM. Aubert et Gérard et sur leurs pressantes
sollicitations. Ainsi, il débute le 26 mars 1859, par cautionner
MM. Albert et Louis Cohen, jusqu'à concurrence de 375.458 francs.
En 1860, il cautionne une indemnité de 400,000 francs à M. Louis
Cohen. A partir de l'année 1862, M. Menier paye, tous les semestres,
les termes d'une créance hypothécaire de 409,000 thalers (408,150
francs) en principal due à M. Kraun, représentant de la banque
de Hanovre.


Le 30 mars 1859,
il fait à MM. Albert et Louis Cohen une ouverture de crédit
de 200.000 francs en acceptations payées par lui aux échéances.
Le 11 décembre 1860, il rend un service de même nature pour
150.000 francs. En février 1862, un autre de même nature pour
450.000 francs. Au mois d'avril 1863, la banque de Brunswick
ouvre un crédit de 500.000 francs sous le cautionnement de M.
Menier. Ce crédit s'est élevé à 1.442.166 francs et a été remboursé
par M. Menier. Au mois de juillet 1863, il cède à la banque
de Hanovre la priorité de son rang hypothécaire sur les usines
de Harbourg, et postérieurement il paye le solde de l'ouverture
de crédit ouvert par cette banque.
Les 28 et 29 avril 1864, il devient
acquéreur desdites usines, à la charge d'acquitter les créances
hypothécaires. En outre, d'autres remises d'espèces et négociations
de valeurs sont faites par M Menier à MM. Aubert et Gérard.
En 1867, M Menier n'avait pu arracher de MM. Aubert et Gérard,
ni comptes, ni argent ni loyers pour la fabrique même de Harbourg
dont M. Menier, avait été forcé de se rendre propriétaire, loyers
que MM. Aubert et Gérard s'étaient formellement engagés à payer
à chaque-terme, suivant l'usage pays; il n'était dressé aucun
inventaire des opérations sociales et les commanditaires n'avaient
jamais été convoqués depuis la constitution de la Société.
Après avoir fait constater cette
situation plus qu'anormale, il assigne MM. Aubert et Gérard,
et par jugement du 26 mars 1868, le tribunal de commerce de
la Seine prononce la dissolution et nomme un liquidateur. MM.
Aubert et Gérard interjettent appel. M. Menier suit l'exécution
provisoire, puis, le 19 janvier 1867, il intervient une convention
aux termes de laquelle MM. Aubert et Gérard s'obligent à payer
à M. Menier en principal, intérêts et frais toutes les sommes
qu'il a versées dans les affaires précédemment citées. Par suite
de cette transaction, tout l'actif reste entre leurs mains,
et MM. Aubert et Gérard en abusent pour se lancer dans des affaires
plus qu'aléatoires.
Le 28 février
1870, M. Menier, encore abusé sur la situation et continuant
à ne rien recevoir, accepte la proposition de MM. Aubert et
Gérard, consistant à soumettre à des arbitres l'apurement de
leurs comptes et la solution de toutes les difficultés s'y rattachant.
Maître Teulet, avocat à la Cour, Maître Cesselin,
avoué près le tribunal, et M. Rousseau, expert-comptable et
arbitre-rapporteur au tribunal de commerce, sont choisis pour
" arbitres-amiables-compositeurs ".N'ayant pu amener une transaction,
et le compromis prêt d'expirer, ces arbitres ont, le 15 février
1870, déposé leur sentence. M. Aubert a formé opposition à cette
sentence le 6 décembre 1872. Et M. Gérard le 13 janvier 1873.
PROCÈS
ET CONTENTIEUX
MM. Aubert et Gérard
se sont associés pour faire commerce du caoutchouc en 1850.
Ils étaient alors sans ressources. En 1858, lorsqu'ils se trouvent
dans l'embarras, ils sollicitent M. Menier, leur ami, de leur
rendre un service; il y consent et les cautionne pour une somme
importante envers MM. Garnier et Clostre. M. Menier est obligé
de payer les sommes cautionnées. Il continue ensuite à rendre
des services à MM. Aubert et Gérard. Puis, il devient leur commanditaire.
Ceux-ci abusent de son amitié et de sa confiance; ils ne cessent
de le tromper à l'aide de manoeuvres frauduleuses et même de
faux. Ils ont pour guide et pour instrument un homme d'affaires
véreux, habile, tortueux, machiavélique, M. Leroy.
II capte M. Menier.
Il est chargé pour lui de suivre un procès de chantage fort
désagréable (affaire Tremplier). Il exploite ce procès avec
une habileté infernale; il le complique; il l'embrouille; il
empêche les transactions; il s'ingénie par tous les moyens à
le faire traîner en longueur, et pendant tout ce temps, il leurre
M. Menier avec l'affaire Aubert et Gérard; il le nourrit d'illusions
et de mensonges, lui extorque toujours des sommes importantes;
il endort sa vigilance et l'empêche d'exercer ses droits vis-à-vis
de ses débiteurs et ses commandités.
MM Aubert et Gérard
inspirent, excitent ces manoeuvres et ils en profitent. Ils
poussent même les choses jusqu'à l'infamie : M. Leroy, conseil
de M Émile Justin Menier, largement rémunéré par lui,
et de plus, son obligé, avait, dans l'intimité des démêlés de
famille. Il trahit ces secrets, et va, avec M. Aubert, les révéler
aux adversaires de M. Menier dans le procès Tremplier, et leur
remet des documents volés
Ils ont intérêt
à déconsidéré l'homme dont ils serrent la main tous les jours,
dont la caisse est toujours ouverte pour les obliger, mais avec
lequel ils savent qu'il est impossible de n'avoir pas un jour
des difficultés sérieuses. Aussi, à un moment donné, M. Menier,
fatigué de donner de l'argent, demande des renseignements et
des justifications sur la situation de la Société; tous les
moyens dilatoires sont mis en oeuvre, et les calomnies, jusque-là
occultes, souterraines, se produisent au grand jour.
M. Menier, disent-ils,
agit pour s'emparer de l'affaire, parce qu'elle est prospère.
MM. Aubert et Gérard ont fait sa fortune en l'aidant dans une
circulation écrasante, qui les a obérés! MM. Aubert et Gérard
l'ont, trompé et abusé pendant plus, de dix années. Avec des
capitaux énormes, du crédit, une industrie prospère qui en d'autres
mains, devait être l'instrument d'une grande fortune, ils arrivent
à la ruine. Et lorsque que M.Menier s'aperçoit enfin que tout
cela est dû a l'impéritie, au désordre, à l'incurie; que, sans
soupçonner la fraude, on appréhende cependant une catastrophe,
MM. Aubert et Gérard se jettent dans les aventures, ils jouent
avec les affaires les plus scabreuses; ils gaspillent les fonds
qui ne leur appartiennent pas, jusqu'à ce que, la vérité se
faisant jour, ils soient, dans la nécessité d'abdiquer.
Alors, ils implorent
M. Menier et ils le sollicitent en "pleurant" de les
sauver du déshonneur. Mais, dès qu'ils ont recueilli les résultats
de la mansuétude de M. Menier, c'est-à-dire, dès qu'ils sont
parvenus à éviter la faillite avec le cortège qu'elle traînait
pour eux, en raison du déficit, du désordre des écritures, des
faux, des dépenses excessives, des moyens ruineux employés pour
soutenir l'agonie, puis à faire payer par le gendre, les amis
les plus intimes, les calomnies reprennent leur cours, et le
procès commence.
En résumé, MM. Aubert et Gérard n'avaient rien; ils ont, pendant
plus de dix ans, vécu avec plus de 50.000 francs par an; ils
ont doté leurs enfants, acquis des propriétés; ils ont, par
une série de manoeuvres frauduleuses, entraîné M. Menier à une
perte de plusieurs millions, et ils se posent en victimes, ils
sont spoliés.
Notes personnelles
Menier 1878
Usine de Grenelle 
En 1872, l'usine
Menier au bord de seine près de la ligne du pont d'Alma
aux Moulineaux est détruite par un incendie et reconstruite
de telle manière que Julien Turgan en 1878 pouvait écrire
dans son tour de France des usines françaises à
la pointe du progrès, ceci : " L'usine de Grenelle
est essentiellement moderne, où tout est nouveau, où
tout est imprévu, intéressant, où le progrès
est en quelque sorte quotidien". D'autres revues précisent
que l'outillage est de fabrication Menier ; sans mot dire, on
revendique pleinement l'appartenance de l'usine de Grenelle
au patrimoine national. La guerre est encore présente
dan bien des esprits ; il fallait éviter toute ambiguïté
sur l'origine des lieux.
L'établissement livre
au commerce toutes les pièces de caoutchouc nécessaires
aux divers usages industriels, joints, rondelles, tuyaux d'arrosage,
pour les chemins de fer, tampons de choc, rondelles de suspension,
durites, etc. Mais les grandes spécialités de
l'usine de Grenelle sont les courroies de transmission, la fabrication
de l'ébonite, ou caoutchouc durci, et enfin les fils
conducteurs de sonnerie et câbles sous-marins à
partir de 1873.
La maison Menier fabrique pour la ville de Paris et en 1879
pour d'autres villes françaises les câbles pour
la téléphonie souterraine.
En 1877, le câblier l'Ampère pose entre le Havre
et Honfleur le premier câble de fabrication nationale
sorti des Établissements Menier, d'un diamètre
de 55 mm, son poids est de 10 tonnes au kilomètre il
est capable de résiter sans se briser à un effort
de 40 tonnes
Du câble
à l'ampoule, il n'y pas grand chemin, les Menier s'intéressent
également à la production d"énergie.
En 1875 étaient installées 14 machines Gramme
à Noisiel et à Grenelle. L'Exposition universelle
de 1878 couronne Menier de deux médailles d'or pour le
caoutchouc et la gutta-percha, la seconde pour les câbles
électriques. A cette même exposition, l'autre grand
fabricant de câbles éléctriques, Rattier,
se fait remarquer En 1881, après l'Exposition d'électricité,
Henri Menier reçoit la croix de la Légion d'Honneur.

La fabrique de
Grenelle possède un atelier principal pour le caoutchouc
ressemblant à un hall de plus de 1200 m², à
mi hauteur, le long de ses murs, une galerie à jour d'environ
3 mètres de large. Une ligne de colonnes de fonte, élevée
au centre dans le sens de la longueur, porte l'arbre de transmission
des poulies. Un canal parallèle et médian conduit
la vapeur partout où elle est nécessaire, car
il est indispensable pour toutes les opérations que doit
subir le caoutchouc, d'avoir à sa portée les moyens
de se procurer la température voulue.
Le caoutchouc provient
du Brésil, de Madagascar, des Indes, de Bornéo.
Le Valle-Menier fondé au Nicaragua par Émile Justin
Menier, fournit également une grande part des exportations.
Le produit de l'hévéa arrive sous forme de grosses
poires, celles-ci sont ouvertes et placées dans des sacs
remplis d'eau chaude où elles se ramollissent de manière
à faciliter les opérations ultérieures.
Placées ensuite sous un laminoir formé de deux
cylindres animés de vitesses inégales et arrosés
d'un courant d'eau, elles sont arrachées, déchiquetées
et débarrassées de toutes les matières
terreuses qu'elles contiennent. Un second passage dans le déchiqueteur
rend la gomme assez propre et assez ductile pour qu'elle puisse
déjà, par son adhérence, former une guipure
grossière.
On réitère
l'opération jusqu'à ce que cette guipure soit
transformée en feuille pleine à la surface rugueuse
que l'on transporte dans un vaste séchoir, où
elle se débarrasse complètement des eaux de lavage.
C'est à ce moment que le caoutchouc, bien sec, est mélangé
avec le soufre nécessaire à la vulcanisation ainsi
qu'avec les différents corps qui en se mélangeant,
doivent lui communiquer certaines propriétés,
selon les usages auxquels on le destine. Chaque ouvrier travaille
une masse de 20 Kgs et procède à son homogénéisation.
Cette masse doit être parfaitement homogène dans
toutes ses parties. La vulcanisation est découverte en
1842 par l'américain Gooyear et quelques temps après,
par l'anglais Hancock. C'est la combinaison du soufre et du
caoutchouc portés à la température de 170
degrés qui modifie profondément les propriétés
du caoutchouc. Chimiquement pure, la résine de l'hévéa
est blanche et solide à la température ordinaire,
elle possède une grande élasticité qu'elle
perd si on la refroidit à zéro degré, elle
se ramollit à 50 degrés et les morceaux fraîchement
coupés se soudent alors à eux-mêmes très
facilement.


Fabrique de Caoutchouc Harburg-Wien Menier- JN Reithoffer
Combiné
au soufre, le caoutchouc devient tenace et élastique,
il ne durcit plus au froid et ne se ramollit plus à la
chaleur, il conserve son élasticité jusqu'à
180 degrés sous zéro, il ne se soude pas à
lui-même, il est insoluble dans tous les solvants connus,
on comprend alors l'avenir d'un tel produit sur les multiples
applications de la vie de tous les jours mais aussi militaires
et industrielles. La vulcanisation poussée à l'excès
donne l'ébonite ou caoutchouc durci. Ses qualités
en font un isolant adopté presque exclusivement pour
les pièces isolantes des appareils électriques.
Autre application,
les courroies dont la réalisation par l'usine Menier
est la grande spécialité. Vulcanisées par
chaleur humide, elles conservaient des traces d'humidité
rendant le produit peu stable et une durée de vie médiocre.
Le procédé employé à l'usine Menier
est celui de la vulcanisation par chaleur sèche ; on
obtient alors des courroies parfaitement homogènes fabriquées
au moyen d'une toile très solide, d'un tissu particulier
que l'on enduit très fortement de caoutchouc sur les
deux faces à l'aide d'une machine rotative. Caoutchouc
et toile ont ainsi remplacé les traditionnelles courroies
de cuir.
Pour l'Exposition
universelle de 1878 Menier avait, pour le compte de MM. Geneste
et Herscher, fourni toutes les courroies des appareils de ventilation
de la salle des fêtes du trocadéro, disposées
dans les caves en zone humide elles ne demandèrent aucune
intervention particulière.
La fabrication
des conducteurs et des câbles électriques est de
beaucoup la partie la plus importante de l'usine de Grenelle.
La fabrication en est complexe et délicate. Le fil métallique
en cuivre passe dans un bain à base de résine
destiné à faire adhérer la gaine de gutta-percha
rendue demi fluide par la chaleur. Cette pâte est alors
comprimée dans des filières de nickel d'où
elle s"échappe en recouvrant le fil de cuivre qui
passe exactement dans l'axe. Pour éviter toute déformation,
on plonge le fil dans un bac d'eau froide et enroulé
sur des tambours ou dévidoirs.

Exploitation Générale
de Caoutchouc ancienne Maison Menier
C'est alors que
le fil passe des mains de l'ouvrier dans celles du technicien
qui le soumet aux premières épreuves électriques
pour s'assurer qu'il est parfaitement isolé et qu'il
ne se produit aucune déperdition de fluide dans toute
sa longueur. Cette vérification toute scientifique est
renouvelée jusqu'à cinq fois sur le même
conducteur. Ce n'est qu'après que les conducteurs sont
employés à la confection des câbles. On
les enrubanne alors de trois couches protectrices de coton tanné
enduites de goudron en un matelas de chanvre intermédiaire.
Après chaque opération, les conducteurs sont renvoyés
au laboratoire pour être soumis à de nouvelles
épreuves électriques. Enfin, les faisceaux de
fils sont recouverts d'une armature qui diffère suivant
l'usage auquel on les destine.
Les câbles
souterrains sont formés d'une enveloppe de plomb ou de
fonte revêtue d'une épaisse couche de bitume afin
de résister aux coups de pioche. Les câbles fluviaux
et sous-marins sont recouverts d'un guipage de gros fils de
fer réunis par torons de trois ou quatre fils. Pour les
câbles affectés à la télégraphie
aérienne, à la téléphonie et à
l'éclairage électrique, l'enveloppe isolante des
fils n'est plus en gutta-percha mais en caoutchouc.
Enfin, le laboratoire
des essais possède une pile de 300 éléments
Callaud, plusieurs galvanomètres à miroir du système
W. Thomson, des condensateurs et des caisses de résistances
de la plus grande précision. L'usine compte également
6 machines à vapeurs d'une force totale de 1.000 chevaux.
Plus de 500 ouvriers hommes et femmes sont employés dans
la manufacture qui traite en 1891 et par an 200.000 KG de caoutchouc
brut
NAISSANCE
DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES TÉLÉPHONES
A partir des années
1890, le caoutchouc est entré dans la vie quotidienne,
les entreprises doivent s'adapter aux demandes de plus en plus
nombreuses et diverses, elles perfectionnent leur matériel
pour proposer des produits de plus en plus attractifs. Mais
cette rentabilité entraînent une surproduction
des sociétés caoutchoutières de plus en
plus nombreuses. Des rapprochements par fusion vont s'opérer.
Création de la
société industrielle des téléphones en 1893 avec
l'absorption de RATTIER située à Bezons depuis 1863, de la société
générale des téléphones et de l'usine Menier de
Grenelle, le capital est de 18 millions de Francs et 18 brevets,
Henri Menier en est l'admnistrateur. La société
possède également un câblier, le François
Arago d'une valeur d'un million et demi de Francs. Pour mémoire,
la société générale des téléphones était
en 1880 la fusion de la Compagnie des Téléphones : Système Gower,
et la Société Française des Téléphones : Système Edison.

|
SCANDALE
politico-financier dans lequel Gaston
Menier n'est pas exempt de toute participation. Sous le
titre "Les deux millions" le journal "Le Briard",
le 27 juillet 1895 rapporte les faits : Gaston Menier
est accusé d'avoir couvert de sa protection la candidature
de Charles Prevert lors des élections sénatoriales de
1894.
Question :
"Pourquoi Gaston Menier a-t-il montré autant d'acharnement
à soutenir la candidature de M.Prevert au sénat ?
Réponse : "Les deux millions" s'appuyant sur un article
paru dans le journal Officiel du 1er juillet 1889, Le
Briard découvre "le pot aux roses".
Charles Prevert, alors député au moment des faits, bataille
à la tribune de la chambre afin que l'État fasse appel
à la participation de l'usine de caoutchouc de Grenelle,
propriété des Menier, pour la fabrication de câbles télégraphiques
entre Marseille, Tunis, et Oran, dans le cadre d'une opération
juteuse, puisque sur les cinq millions de francs de crédits
demandés, deux millions de bénéfices nets sont à gagner.
Heureuses élues, la société des téléphones et la société
Menier s'allient en 1893 pour l'occasion et se fondent
en
"Société industrielle des téléphones".
" Veau d'or, que de bassesses, que de lâchetés, que de
crimes tu fais commettre!" s'exclame la rédaction du Briard,
outrée par ces arrangements Prevert-Menier.
Nouvelle fabrication
pneumatique
En 1894 la présence d'un pneu de
fabrication Menier est observée sur les vélodromes
parisiens, le pneu possède des qualités
de légèreté et de démontage
remarquablement facile. La fixation sur la jante fait
l'objet du brevet ci-dessous qui sera daté de 1899.
Probablement une amélioration du système
par l'entreprise de Wien Harburg, anciennement Menier.


Procédé de vulcanisation
à plat et fixation. Les patins caoutchouc-fer
MENIER
Ce patin dure cinq fois plus
qu'une semelle en cuir, l'expérience qui en a été
faite par de véritables marcheurs le prouve; en
effet, nous avons des attestations données par
ces derniers, qui ont porté pendant 10 mois la
même chaussure, sans user complètement leur
patin.
|
|
|
Société
Industrielle des Téléphones
Rattier-Menier PARIS
|
|
Coupe
du câble.
Au centre le "mono brin" de forte section entouré
de ses 12 fils de cuivre. Protégeant l'ensemble,
plusieurs couches de gutta-percha.
|
 |
| |
|
|
Un
conducteur central en cuivre de 2,5 mm² sous 12 conducteurs
également en cuivre de 0.6 mm² torsadés.
L'ensemble est isolé par de la gutta-percha et
forme l'âme du câble, la partie conductrice
diffusant le signal.
L'âme est protégée par une enveloppe
de chanvre qui devait être imbibée de poix,
de goudron, d'huile ou de suif.
|
| |
|
15
Brins d'acier disposés en hélice pour la
protection mécanique et servant de tenseurs
|
 |
| |
|
|
L'ensemble
est recouvert de gutta-percha
|
|
sommaire
|
1898 – Installation d’une ligne téléphonique
entre Saint-Pierre et l’Ile aux Chiens août 24, 2020
Samedi 25 juin 1898 – Journal Officiel
des Iles Saint-Pierre et Miquelon
Ports et rades
Avis
Il a été immergé en tête
de rade un câble téléphonique reliant St-Pierre
à l’Ile-aux-Chiens.
Ce câble forme un angle dont le
sommet est à l’Ouest du Petit St-Pierre, l’un
des côtés atterrissant au Cap à l’Aigle,
un peu à l’Ouest, et l’autre côté
dans l’Anse à Tréhouart.
Les capitaines qui en mouillant dans ces
parages viendraient à lever le câble, sont invités
à se dégager en prenant toutes les précautions
pour ne pas le couper.
 Ligne téléphonique Ligne téléphonique
– Dans quelques jours, le
téléphone reliant l’île aux Chiens
à Saint-Pierre sera installé .
Cette heureuse innovation a pu s’accomplir sans trop de
frais, par suite de la gracieuseté de la compagnie française
des câbles télégraphiques qui a fait don
à l’administration d’une certaine quantité
de câbles sous-marins.
Le câble a été mouillé,
le 1er juin, en deça du « Petit Saint-Pierre.»
Un armateur de l’île aux Chiens, M. Huet, qui en
sa qualité de capitaine au long-cours connait les difficultés
hydrographiques du fond, a su donner au parcours du câble
une direction favorable à éviter des avaries.
Tout fait présumer que le câble
est bien posé et que les accidents de rupture seront
rares, surtout si les capitaines ou patrons veulent bien avoir
le soin, quand leur ancre s’accrochera, de le dégager
sans provoquer une cassure.
Un bureau central va être établi
à l’île aux Chiens, qui sera le bureau de
la poste. Ceux qui voudront avoir communication téléphonique
avec Saint-Pierre et vice-versa paieront une taxe de cinquante
centimes. Il a été entendu que les abonnés
demeurant tant à Saint-Pierre qu’à l’île
aux Chiens seront affranchis de cette taxe supplémentaire.
Gratitude. – M. le Gouverneur de la colonie
a adressé à M. Betts, Directeur à St-Pierre
de la compagnie française des câbles télégraphiques,
la lettre suivante:
Monsieur le Directeur,
Par une communication en date du
13 juin 1897, la compagnie française des câbles
télégraphiques a eu l’amabilité de
céder gratuitement au Gouverneur de la colonie une longue
étendue de cables sous-marins. L’administration
vous remercie bien vivement de ce don, qui lui a permis d’utiliser
un bout de câble servant à établir une ligue
téléphonique entre St-Pierre et l’ile aux
Chiens.
Je ne crois pas trop m’avancer en vous disant que la colonie
vous gardera toujours un souvenir reconnaissant de la gracieuseté
qui lui a été faite, alors qu’elle sait qu’il
vous était loisible de faire ce cadeau à des particuliers,
et que vous l’avez réservé à l’administration
locale qui, d’ailleurs, en fait profiter le public.
Je vous prie d’agréer etc.
CAPERON
|
sommaire
2023 La carte mondiale des câbles de télécommunications
sous-marins
99% du réseau internet passe par les câbles sous-marins
Des centaines de câbles de télécommunications
longs de milliers de kilomètres assurent aujourd’hui les
transmissions de données intercontinentales. Véritables
autoroutes de l’information, ces câbles sous-marins, véhiculent
environ 99% des communications mondiales et sont donc indispensables
au fonctionnement d’un réseau comme Internet.
Le site Submarine Cable
Map (TeleGeography) propose une carte intéressante qui offre
une vue interactive de ces interconnexions :
 Carte des câbles sous-marins réseau internet France
Carte des câbles sous-marins réseau internet France
On peut y voir, notamment, que le câble
sous-marin le plus proche de Villeneuve d’Ascq (où
sont situés les bureaux d’Eurafibre) est celui reliant
Ostende (BE) à Broadstairs (UK), il porte le nom de «
Tangerine » et il est exploité par CenturyLink, une entreprise
de télécommunications et fournisseur d’accès
à Internet partenaire d’Eurafibre !
Le câble sous-marin en fibre optique le plus long.
Il existe plus de 420 câbles dans le monde,
totalisant 1,3 million de kilomètres, soit plus de trois fois
la distance de la Terre à la Lune. Le record : 39.000 kilomètres
de long est pour le câble «
SEA-ME-WE 3 » (pour South-East Asia – Middle East –
Western Europe 3) qui interconnecte l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient
et l’Europe de l’Ouest.
Sea-Me-We
3
Avec 36 nouveaux câbles, l'année 2020
fut marquée par un nombre record de déploiements.
Ces infrastructures sont aujourd'hui aussi cruciales que les gazoducs
et les oléoducs. Mais sont-elles aussi bien protégées
?
Les câbles sous-marins modernes utilisent la fibre optique pour
transmettre les données à la vitesse de la lumière.
Or, si à proximité immédiate du rivage les câbles
sont généralement renforcés, le diamètre
moyen d'un câble sous-marin n'est pas beaucoup supérieur
à celui d'un tuyau d'arrosage.
Depuis plusieurs années, les grandes puissances
se livrent une "guerre hybride", mi-ouverte mi-secrète,
pour le contrôle de ces câbles. Alors que l'Europe se
concentre de plus en plus sur les menaces de cybersécurité,
l'investissement dans la sécurité et la résilience
des infrastructures physiques qui sous-tendent ses communications
avec le monde entier ne semble pas aujourd'hui une priorité.
Or, ne pas agir ne fera que rendre ces systèmes
plus vulnérables à l'espionnage et aux perturbations
qui coupent les flux de données et nuisent à la sécurité
du continent.
On recense en moyenne chaque année plus
d'une centaine de ruptures de câbles sous-marins, généralement
causées par des bateaux de pêche traînant les ancres.
Il est difficile de mesurer les attaques intentionnelles, mais les
mouvements de certains navires commencèrent à attirer
l'attention dès 2014 : leur route suivait les câbles
sous-marins de télécommunication.
Les premières attaques de l'ère
moderne datent de 2017 : câbles Grande-Bretagne–USA, puis
France–Etats-Unis, arrachés par les chalutiers d'une grande
puissance coutumière de l'emploi de forces irrégulières
lors de tensions internationales. Si ces attaques demeurent inconnues
du grand public, elles n'en sont pas moins préoccupantes, et
démontrent la capacité de puissances extérieures
à couper l'Europe du reste du monde. On rappellera qu'en 2007,
des pêcheurs vietnamiens ont coupé un câble sous-marin
afin d'en récupérer les matériaux composites
et de tenter de les revendre. Le Vietnam perdit ainsi près
de 90% de sa connectivité avec le reste du monde pendant une
période de trois semaines. Une attaque de ce type est extrêmement
facile à réaliser, y compris par des acteurs non étatiques.
sommaire
Les câbles des prochaines années continueront
à s’appuyer sur les technologies de la génération
des systèmes optiques actuels, mais de nombreuses évolutions
pourront servir l’augmentation de capacité et l’amélioration
des services associés.
Microsoft mise ainsi sur une amélioration des fibres optiques
elles-mêmes. En décembre 2022, il a acquis une société
appelée Lumenisity qui développe des fibres
creuses avec un minuscule canal d’air central. La vitesse
de la lumière dans l’air est 47 % plus rapide que dans
le verre, le temps de latence (environ 80 millisecondes à ce
jour), qui est une limite essentielle à la performance des
réseaux en sera réduite. Google va utiliser des fibres
à deux cœurs et on annonce l’utilisation de fibres
optiques à quatre cœurs permettant 20 fois plus de données
que les câbles actuels.
Cependant, au-delà, aucune révolution
technologique nouvelle n’est aujourd’hui entrevue dans les
laboratoires, signifiant que la révolution optique, commencée
il y a plus de 35 ans, est proche d’avoir complété
son cycle technologique. La limite de l'efficacité spectrale
maximale atteignable vient de la théorie de l'information.
C’est la limite dite de la loi de Shannon. Mais
le multiplexage spatial est un autre progrès qui viendra directement
de l'augmentation du nombre de paires de fibres dans le câble,
limité techniquement à ce jour, à 12 paires.
En particulier, une difficulté pratique majeure viendra de
la puissance électrique disponible sur un câble sous-marin.
Loi de Shannon : Le théorème
de Shannon (1916, Michigan– 2001), du nom de l'ingénieur
qui en a publié la démonstration en posant les bases
de la théorie de l'information chez Bell Laboratories en 1949,
énonce (en première approximation) que la représentation
discrète d'un signal exige des échantillons régulièrement
espacés à une fréquence d'échantillonnage
supérieure au double de la fréquence maximale présente
dans ce signal.
Les fibres creuses
L'importance des fibres à âme creuse par rapport aux
fibres à âme en silice traditionnelles ne réside
pas dans la réduction des coûts due à l'absence
d'âme solide, mais dans la propagation supérieure des
signaux lumineux dans l'air plutôt que dans les fibres de verre.
Une formule fondamentale issue de la physique
au lycée illustre cet avantage :
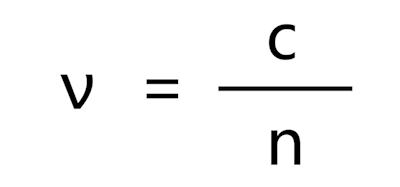 Ici, ( v ) représente
la vitesse de la lumière dans un milieu, ( c ) est la vitesse
de la lumière dans le vide, communément appelée
environ 300,000 XNUMX kilomètres par seconde, et ( n ) est
l'indice de réfraction du milieu. La vitesse de la lumière
varie selon les différents supports. Ici, ( v ) représente
la vitesse de la lumière dans un milieu, ( c ) est la vitesse
de la lumière dans le vide, communément appelée
environ 300,000 XNUMX kilomètres par seconde, et ( n ) est
l'indice de réfraction du milieu. La vitesse de la lumière
varie selon les différents supports.
L'indice de réfraction de l'air est d'environ
1, tandis que d'autres milieux ont des indices de réfraction
supérieurs à 1. Par exemple, l'eau a un indice de réfraction
de 1.33, le cristal de 1.55 et le diamant de 2.42. Le verre varie
entre 1.5 et 1.9 selon sa composition.
Cela signifie que la lumière voyage à
travers les fibres traditionnelles à noyau de silice à
une vitesse nettement inférieure à ( c ). Les données
expérimentales suggèrent que l'utilisation de fibres
à âme creuse peut augmenter la vitesse des signaux lumineux
d'environ 47 % par rapport aux fibres traditionnelles à âme
de silice. Cette augmentation pourrait réduire
considérablement la latence des communications par fibre optique
d’environ un tiers. Selon les calculs des instituts de recherche,
la latence des fibres à âme de silice est d'environ 5
microsecondes par kilomètre, tandis que pour les fibres à
âme creuse, elle est d'environ 3.46 microsecondes par kilomètre.
Sur une distance de 1000 1.54 kilomètres, cela pourrait réduire
la latence de XNUMX milliseconde.
Une telle amélioration de la latence
est d'une grande importance pour les secteurs qui s'appuient sur des
transactions à haute fréquence, telles que la négociation
de titres financiers, ainsi que pour les scénarios de soins
de santé et de fabrication industrielle à distance.
Compte tenu des avantages techniques de la fibre optique à
noyau creux, des universités et des entreprises nationales
et étrangères du secteur de la fibre optique ont actuellement
mené des recherches pertinentes . La plus connue est lumenisity,
une filiale de l'Université de Southampton, qui réduira
le coefficient d'atténuation de la fibre optique à noyau
creux à 0,174 dB/km en 2022, représentant le plus haut
niveau technique de l'industrie. Bien entendu, limitée par
la maturité de la technologie de la fibre à noyau creux,
notamment l'amélioration des performances de la fibre (diminution
du coefficient d'atténuation), la maturité du processus
de fabrication et l'amélioration des normes, elle se concentre
actuellement principalement sur les tests et la recherche scientifique.
Par exemple, en 2021, British Telecom a annoncé qu'elle coopérerait
avec Lumenisity et la société de réseau mondial
Mavenir au British Telecom Laboratory pour tester un câble à
fibre optique à noyau creux de 10 km de long. Par conséquent,
il est prévu qu'il faudra encore un certain temps avant qu'il
ne soit commercialisé.
sommaire
|























































 Orleans Cable Station under construction in 1891
Orleans Cable Station under construction in 1891








































 Ligne téléphonique
Ligne téléphonique


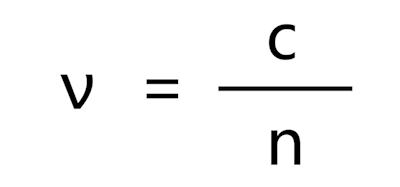 Ici, ( v ) représente
la vitesse de la lumière dans un milieu, ( c ) est la vitesse
de la lumière dans le vide, communément appelée
environ 300,000 XNUMX kilomètres par seconde, et ( n ) est
l'indice de réfraction du milieu. La vitesse de la lumière
varie selon les différents supports.
Ici, ( v ) représente
la vitesse de la lumière dans un milieu, ( c ) est la vitesse
de la lumière dans le vide, communément appelée
environ 300,000 XNUMX kilomètres par seconde, et ( n ) est
l'indice de réfraction du milieu. La vitesse de la lumière
varie selon les différents supports.