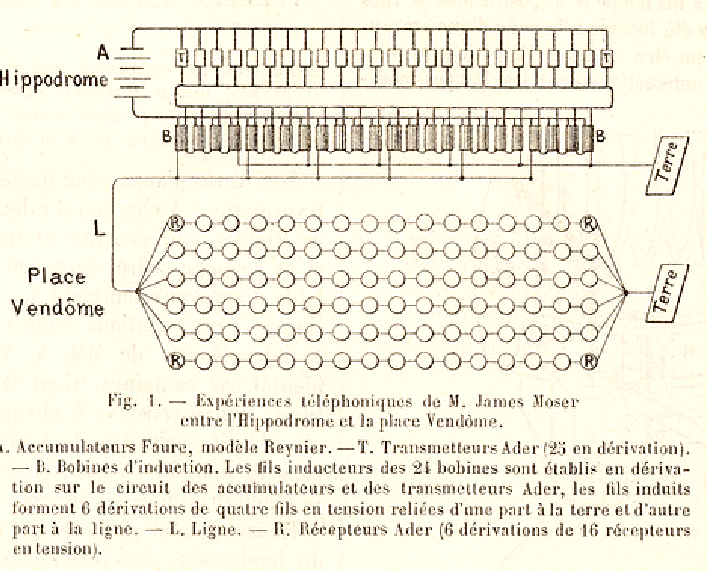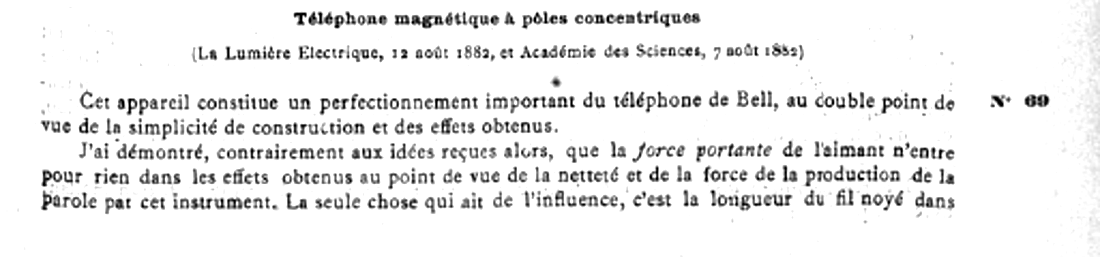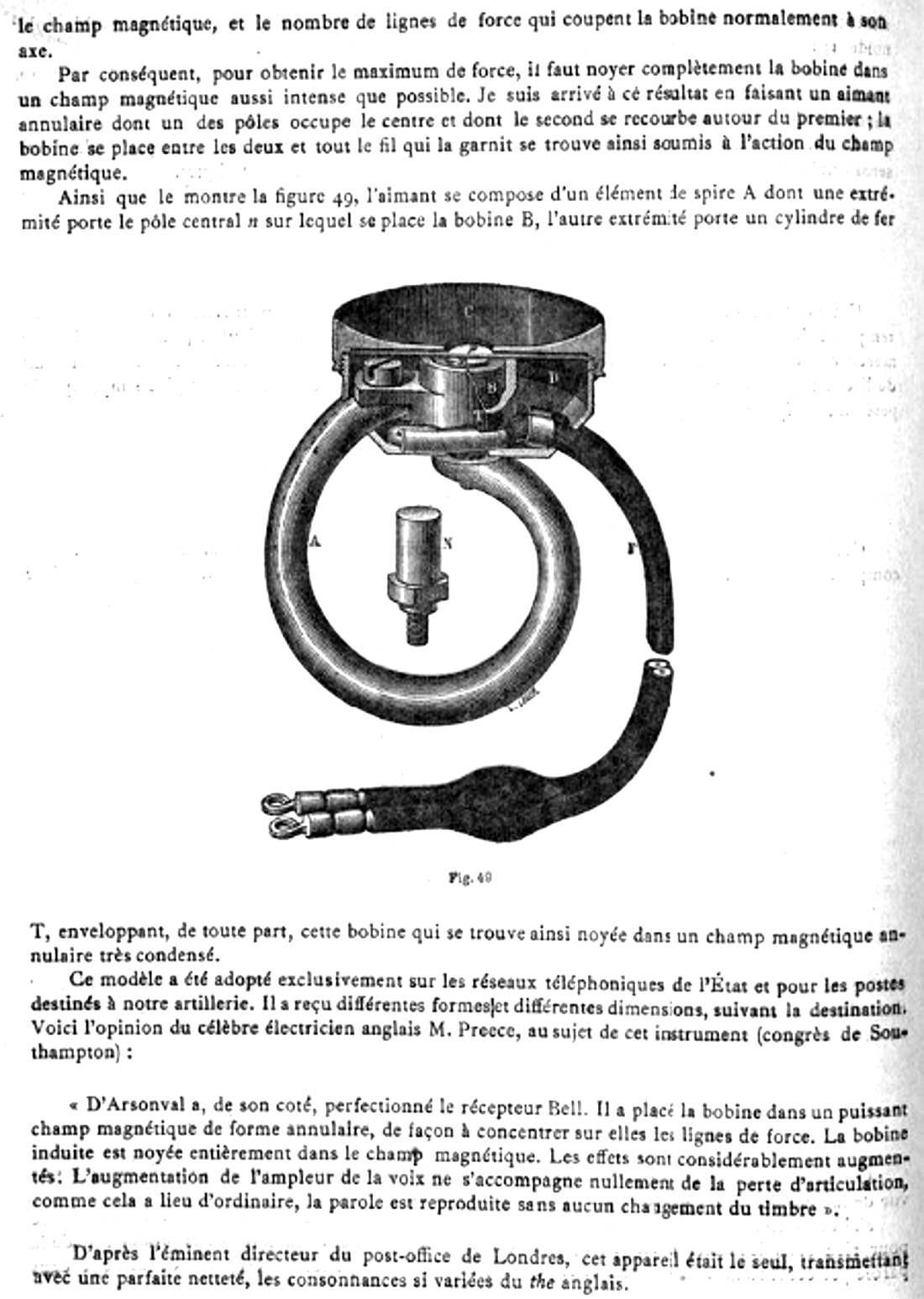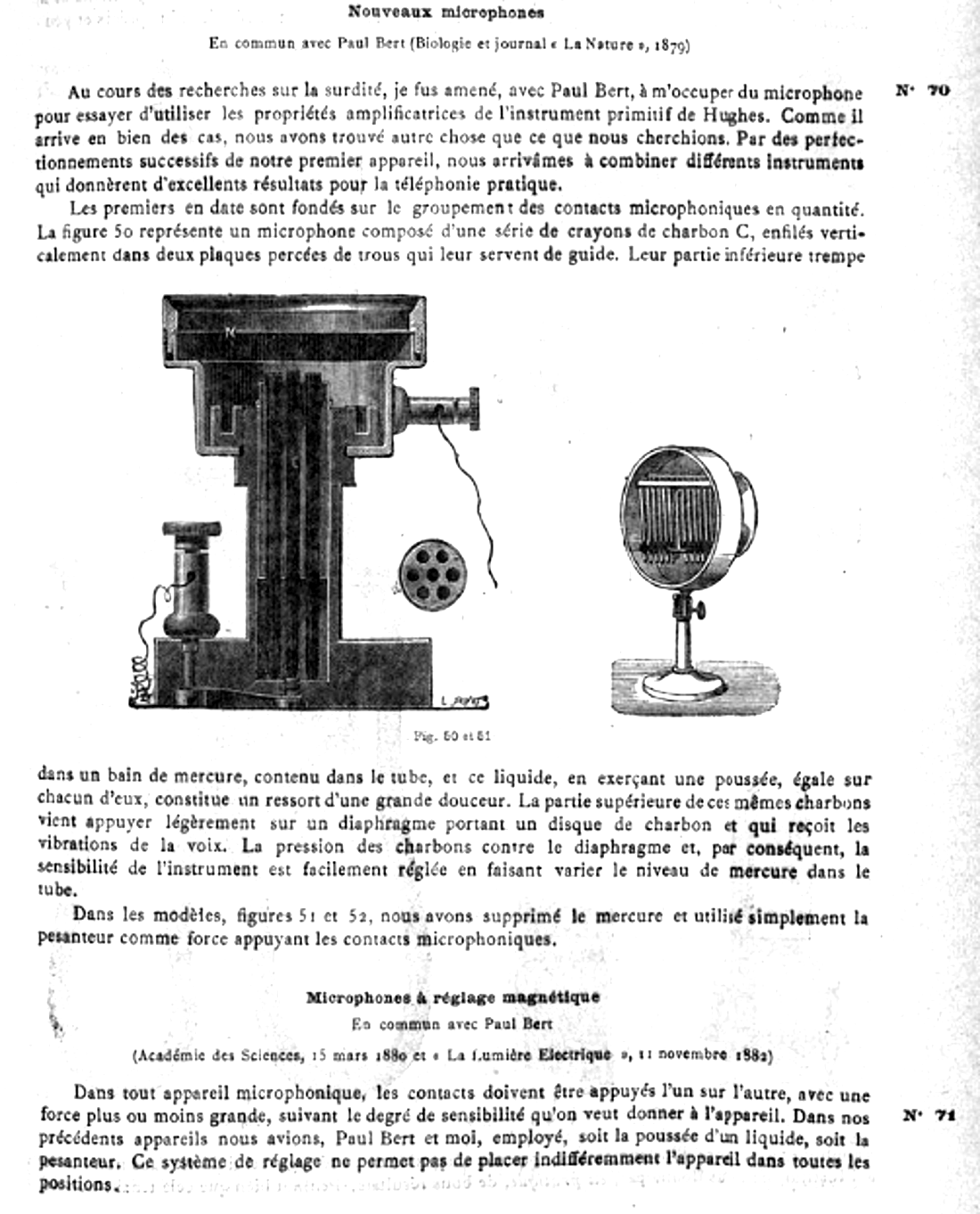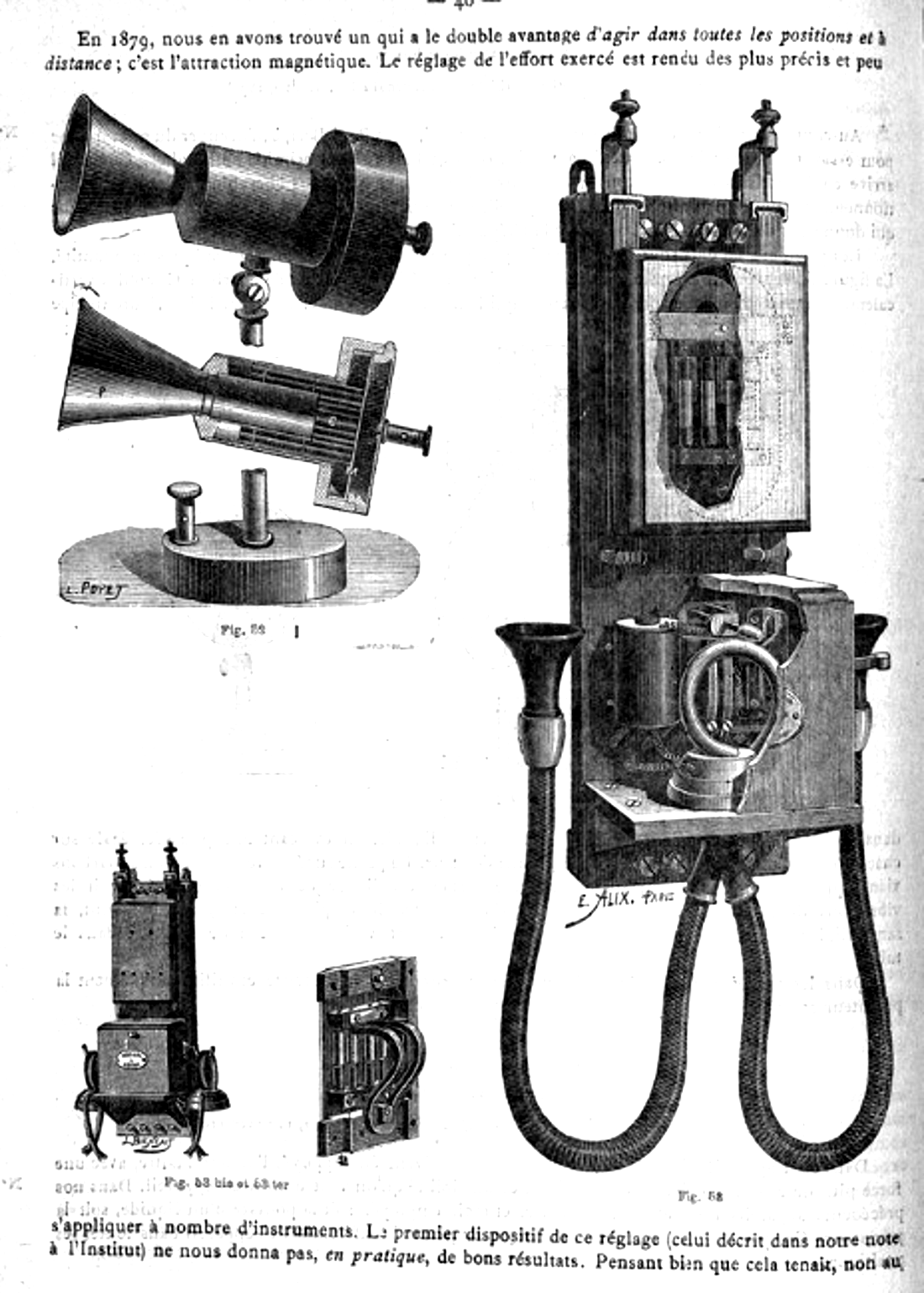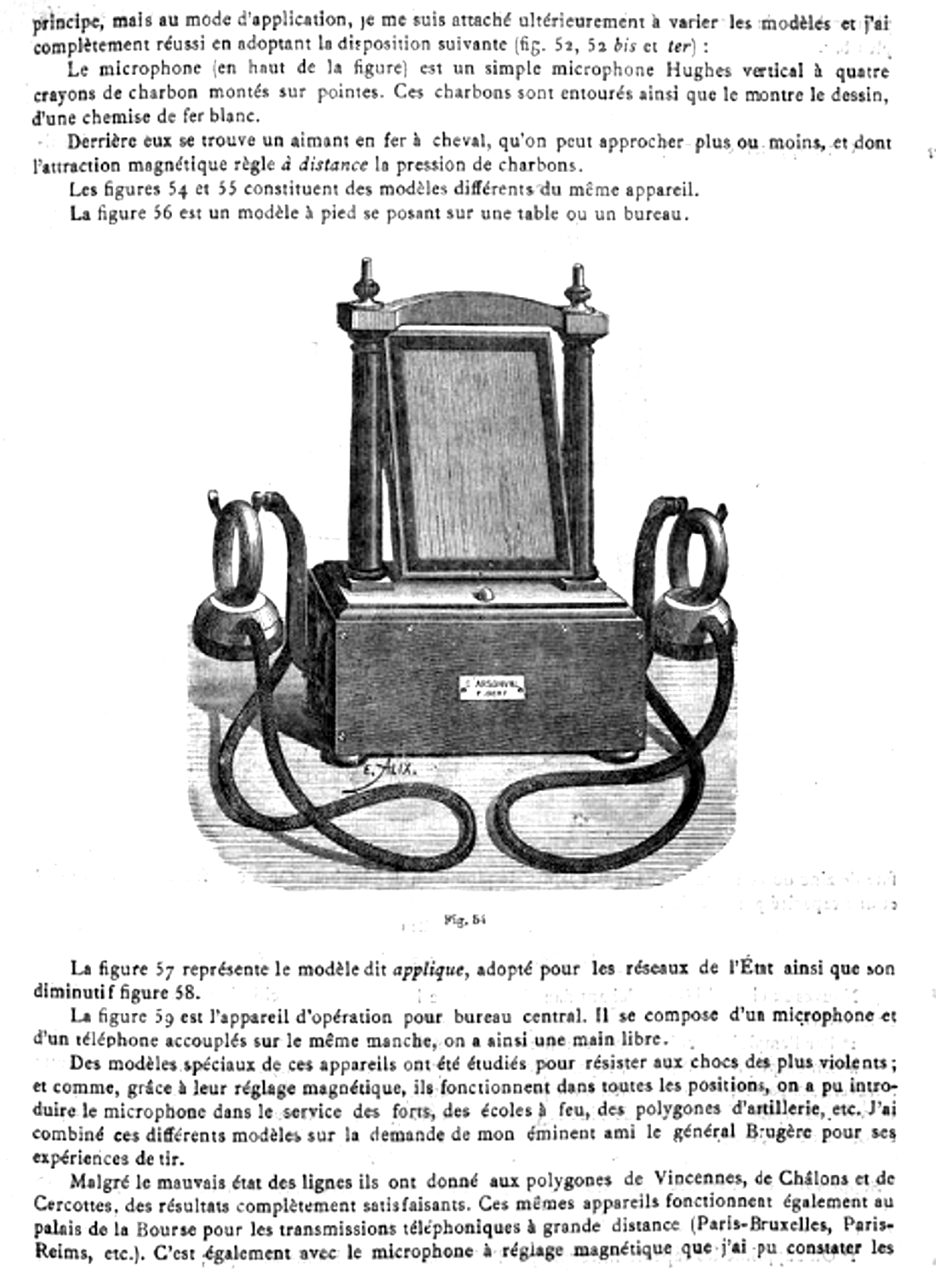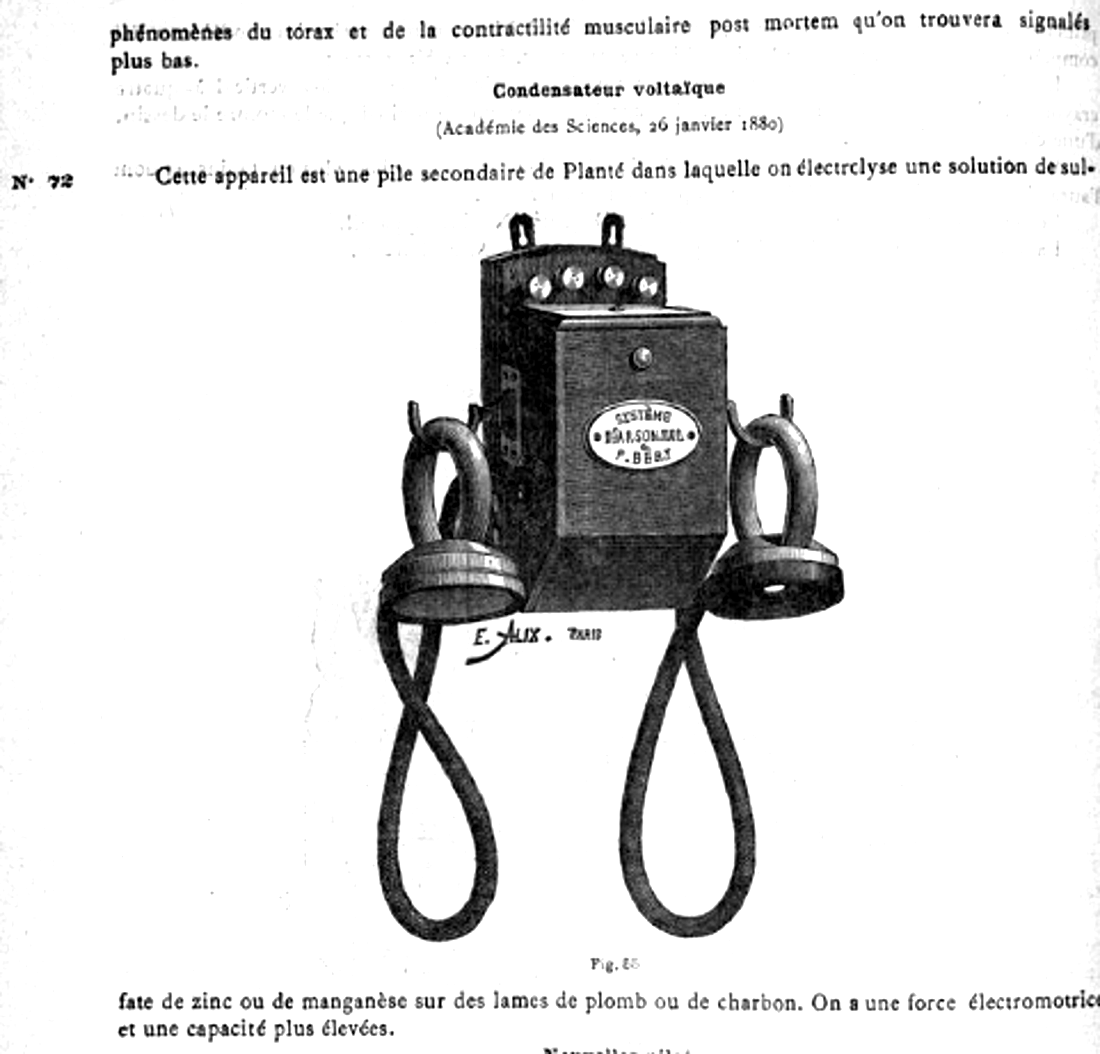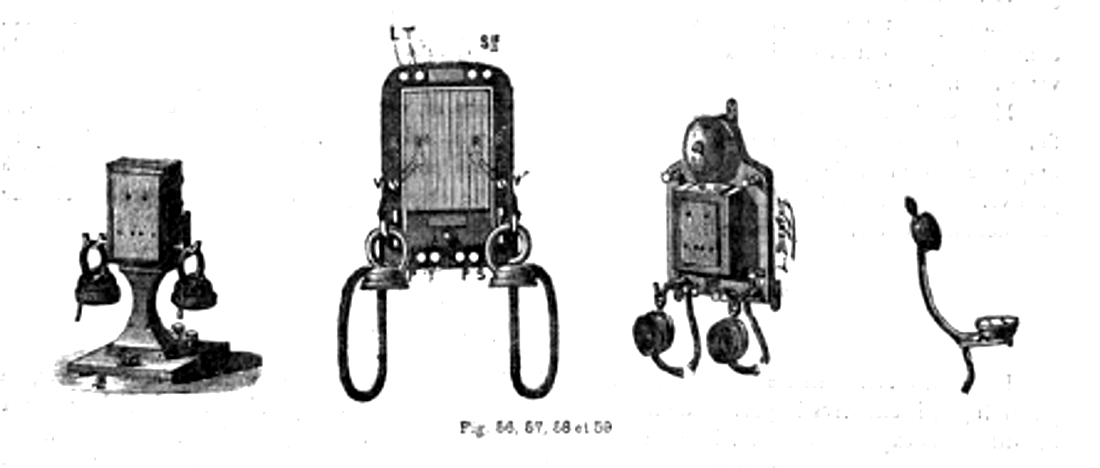|
Arsène
D'Arsonval
Jacques Arsène
d'Arsonval, né le 8 juin 1851 à La Porcherie (Haute-Vienne)
et mort le 31 décembre 1940 dans la même commune, est
un médecin, physicien et inventeur français.
Issu de familles aristocratiques de la région, tant du côté
paternel que maternel, il est le dernier de la lignée des
d’Arsonval en Limousin. Il repose à La Porcherie, près
de sa maison natale, dans ce Limousin qu’il a tant aimé.
La carrière scientifique d’Arsène d’Arsonval
débute à la fin du XIXème siècle. Alors
que la guerre franco-prussienne (1870/1871) vient de se terminer
et qu’est instaurée la Troisième République,
c’est le début d’une nouvelle ère en France.
Les expositions universelles de 1878, 1889 et 1900 à Paris,
vitrines technologiques et industrielles, permettent à la
France de s’affirmer sur le plan scientifique et culturel vis-à-vis
du reste du monde.
Médecin de formation, ses recherches lui
valent d’être admis à l’Académie
de médecine puis à l’Académie des sciences
et de devenir titulaire de la Chaire de médecine du Collège
de France. Génial touche-à-tout, il voit son nom
associé à de multiples découvertes et appareils
scientifiques.
On cite souvent la déclaration qu'il aurait faite au Congrès
international des électriciens de 1881 : « Canaliser
l'électricité est bien démocratiser la force.
Il y a plus : transporter la force à grande distance c'est
pouvoir se passer du charbon, dont les provisions s'épuisent,
c'est pouvoir utiliser les forces naturelles, jusqu'ici perdues...
grâce à la science, la possibilité d'hier sera
la banalité de demain »
Dans ce site, nous n'allons pas raconter ici tous les travaux et
études que ce médecin scientifique a réalisé,
nous nous intéresserons uniquement aux travaux sur le téléphone
et son origine.
|

Ce sont des recherches sur la surdité, qui le conduisent
avec son ami Paul Bert, à s’intéresser
à la téléphonie. |
sommaire
Brève biographie :
1851 juin 8 Jacques Arsène
d'Arsonval naît au château de la Borie à La Porcherie
en Haute-Vienne, fils de Pierre Catherine d'Arsonval, médecin,
et de Marie-Louise Betzi de Beaune.(France)
1862 D'Arsonval entre au petit séminaire
diocésain de Brive.
1873 oct D'Arsonval s'installe à Paris. D'Arsonval
se présente au concours d'externat des hôpitaux de
Paris
1874 D'Arsonval devient préparateur
bénévole auprès de Claude Bernard.
1875 D'Arsonval est externe chez le Dr Bayer à l'Hôtel-Dieu
à Paris. Il invente la seringue à piston plein.
1876 Arsène d'Arsonval s'investit sur l'étude
des phénomènes de tension superficielle et d'osmose,
d'un point de vue biologique.
D'Arsonval entreprend des recherches sur la calorimétrie
en biologie dans le laboratoire de Marey, physiologiste au Collège
de France.
1877 août 6 Arsène d'Arsonval présente
sa thèse de doctorat. Il poursuit ses expériences
sur la calorimétrie animale. Il crée un calorimètre
enregistreur.
1878 Avec Bert, d'Arsonval construit un microphone à
réglage magnétique.
1879 D'Arsonval, associé à Abakanowitz, crée
à St-Maur-des-Fossés, le "Laboratoire Volta".
1882 Arsène d'Arsonval dirige le laboratoire de biophysique
du Collège de France.
1884 Une commission officielle animée par d'Arsonval
édicte les 1ères règles de sécurité
à observer dans les interventions sur les réseaux
de distribution électrique.
1888 D'Arsonval est élu membre de l'Académie
de médecine..
1894 L'École supérieure d'électricité
est créée à Paris. D'Arsonval est élu
membre de l'Académie des sciences.
1902 nov 8 Le physicien Claude et les industriels Delorme
et Gallier ayant mis au point un procédé industriel
de liquéfaction de l'air, ils constituent avec 21 autres
actionnaires la Sté Air Liquide.
1906 D'Arsonval et Bordas inventent le procédé
de lyophilisation au laboratoire de biophysique du Collège
de France à Paris.
1908 La Cie Générale de Radiotélégraphie
est créée par la fusion des ateliers Carpentier, Gaiffe
et Rochefort ; d'Arsonval en devient le Pdt.
1910 déc 27 Gaumont présente son Chronophone
(Elgéphone) à l'Académie des Sciences de Paris
avec l'exposé du professeur d'Arsonval.
1911 D'Arsonval et Ferrié participent aux premières
émissions de TSF et aux premiers essais de téléphone
sans fil.
1913 Avec Arsène d'Arsonval, G. Claude constate les
propriétés explosives de l'air liquide.
1914 L'Etat autorise 19 stations radio expérimentales
: la CGR, Ducretet-Roger, la Sté industrielle de TSF, les
Chemins de fer, le CNAM, l'Ecole supérieure d'électricité,
des constructeurs de l'aéronautique comme Farma et Bréguet,
etc
1915 D'Arsonval, alors qu'il travaille sur les équipements
électriques de transmission, montre qu'en cas de chocs électriques
à haute tension une réanimation est possible par respiration
artificielle.
1918 D'Arsonval est élu Pdt de l'Institut d'actinologie.
1940 déc 31 Jacques Arsène d'Arsonval meurt
à La Porcherie en Haute-Vienne. |
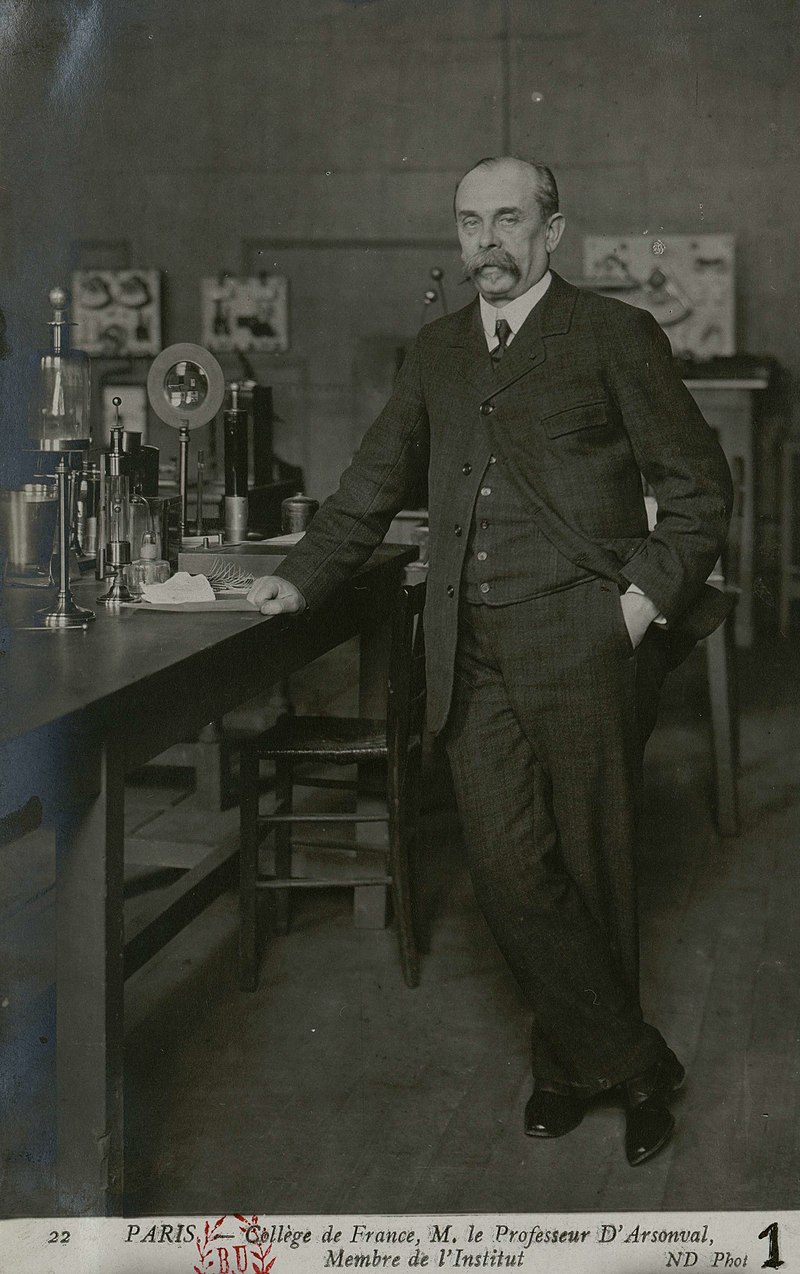
Œuvres et publications scientifiques
|
«Utilisation des forces naturelles.
Avenir de l'électricité», in La Revue scientifique,
septembre 1881, n°12, p. 370-372.
«Utilisation des forces naturelles par l'électricité.»,
in La Revue Scientifique, octobre 1881, n°18, p. 550-556.
«Discussion de la commission d'électro-physiologie.»,
in La Revue Scientifique, décembre 1881, n°24, p. 725-729.
«Recherches expérimentales sur les piles hydro-électriques.»,
1/2, in La Lumière électrique, mars 1881, n°13,
p. 246-248.
«Recherches expérimentales sur les piles hydro-électriques.»,
2/2, in La Lumière électrique, avril 1881, n°17,
p. 300-303.
«Action physiologique des courants alternatifs»,
in: CR Soc Biol(1891), 43, 283-286.
«Recherches sur la décharge électrique
de la torpille», in : J. Phys. Theor. Appl.(1896), 5(1),
149-154.
«Interrupteur électrolytique», in: J.
Phys. Theor. Appl. (1899), 8(1), 206-209
«L'air liquide» in: J. Phys. Theor. Appl.(1898),
7(1), 497-504
«Discours prononcé à la séance solennelle
de la Sorbonne», [S.l.] , [s.n.] [1933] Gauthier-Villars
(Paris), 6 p., 8°, Extrait de la Plaquette du "Cinquantenaire
de la Soc. franç. des Électriciens", novembre
1933.
D'Arsonval.
Soixante-cinq ans à travers la Science de Louis
Chauvois (de nombreux textes sont issus de cet ouvrage)
|
sommaire
1876 Arsène d'Arsonval s'investit sur l'étude
des phénomènes de tension superficielle et d'osmose, d'un
point de vue biologique.
D'Arsonval entreprend des recherches sur la calorimétrie en biologie
dans le laboratoire de Marey, physiologiste au Collège de France.
C'est à partir de 1877 que Caude
Bernard décide d'étudier les échanges
de température du système sanguin et charge D'Arsonval
de se s'occuper de la partie instrumentale.
Les aiguilles thermoélectrques :
D'Arsonval a l'idée de se servir de l'électricité
en utilisant le principe du thermocouple : deux fils de métaux
différents (de cohéficient de dilatation différents)
soudés à une extrémité et plongés
dans le milieu à étudier. Ce thermocouple donne naissance
à un courant variable mesurable avec un galvanométre.

La mesure des températures par l'électricité
A. D’ARSONVAL, des extraits d'un article de La Lumière
Électrique, Journal universel d’Électricité,
N°54, ANNÉE 1881
« Au point de vue du travail, l’être
vivant est une véritable machine thermique. . .
... Le système nerveux, en excellent chef d'Etat, laisse
aux cellules leur individualité et leur indépendance
propres, tout en faisant concourir l'activité de chacune
d'elles au bien commun de la république organique.
Un homme d'Etat puisant ses inspirations dans la physiologie générale,
ferait à coup sûr d'excellente politique.
Ainsi pas une action dans l'organisme n'échappe à
la surveillance du système nerveux, et chaque acte est
précédé, accompagné ou suivi d'une
manifestation calorifique. Me voilà, dira-t-on, bien loin
de mon sujet; j'y entre en plein, au contraire. Ces préliminaires
n'avaient pour but que de montrer l'immense intérêt
qui s'attache à l'étude de la chaleur animale, et
combien est important chaque perfectionnement instrumental qui
permet d'aborder cette étude avec plus de précision.
. . . L'électricité constitue
aujourd'hui le moyen d'étude le plus parfait et
le plus délicat dont le physiologiste puisse disposer.
Cette circonstance motive suffisamment, par conséquent,
la persévérance que je mets à perfectionner
cette précieuse méthode, pour la voir sortir du
laboratoire et s'introduire dans la clinique. D'après ce
que j'ai dit ci-dessus, on comprend qu'il y ait un grand intérêt
à pouvoir prendre la température des différentes
parties du corps vivant, tant à la superficie même
que dans les régions les plus profondes. . . Il faut que
l'appareil thermométrique puisse pénétrer
dans l'intérieur des organes les plus profonds, dans l'intimité
des tissus, sans entraîner de douleur, lorsqu'il s'agit
de l'application médicale.
Les soudures thermoélectriques se prêtent
merveilleusement à ces exigences. On peut les faire d'une
ténuité extrême, et leur sensibilité
est telle, qu'on peut obtenir très facilement le centième
de degré centigrade. C'est A-C. Becquerel qui employa le
premier cette méthode pour l'étude de la chaleur
animale. Claude Bernard la reprit plus tard pour l'étude
de la température du sang. Le principe de la méthode
est resté le même, mais les instruments ont été
perfectionnés de manière à en faciliter l'emploi.
. . Une installation thermoélectrique comporte trois parties
bien distinctes :
1° Les soudures exploratrices;
2° Le galvanomètre ;
3° Les appareils accessoires pour avoir des températures
constantes ou pour grouper de certaine manière les sondes
exploratrices. . .
Les aiguilles thermoélectriques employées
jusqu'en 1876 se composaient toutes de 2 fils hétérogènes
soudés par leur extrémité qui se terminait
en pointe aiguë. On vernissait ces fils avec soin ; car,
au contact des liquides animaux, des fils nus de métaux
différents auraient donné naissance à des
courants hydroélectriques rendant toute observation impossible.
Ce vernis était très sujet à s'enlever, comme
bien on pense, et constituait un danger permanent.
J'ai supprimé cette difficulté en remplaçant
l'un des fils par un tube qui entoure l'autre fil et le protège
contre les liquides animaux. On n'a plus de la sorte qu'un seul
métal à l'extérieur et le danger est évité.
. .
La thermométrie ne s'occupe que de la répartition
de la chaleur produite; à la Calorimétrie revient
l'étude de la production. C'est certainement le point le
plus important. Depuis quelques années, j'ai inventé
des méthodes calorimétriques pour la physiologie
qui permettent « de faire inscrire par l'animal lui-même,
sans corrections et pendant un temps indéfini, la quantité
de chaleur qu'il produit à chaque instant. »
Les renseignements que fournit cette nouvelle méthode,
où l'électricité a sa part, sont de la plus
haute importance pour la théorie et pour la pratique médicale.
J'y reviendrai plus tard ».
|
sommaire
Au début D'Arsonval se sert du galvanométre
de Thomson mais pas satisfait de ses mesures, après le perfectionnement
des aiguilles thermoélectrques, il décide de fabriquer
un galvanomètre plus performant.
|
Le Téléphone employé comme
galvanoscope
En attendant la construction trois ans plus tard (1880) de son
merveilleux instrument, l'ingéniosité de son esprit
a tout de même trouvé moyen de réaliser un
« révélateur de courant », un «
galvanoscope » comme on dit, infiniment plus sensible que
la patte de grenouille et d'affirmer la réalité
des deux courants intra-musculaires, et c'est du téléphone
électrique que GRAHAM BELL venait
d'inventer qu'il a tiré ce moyen.
A litre de memorandum, rappelons que le téléphone
primitif de BELL était simplement composé de deux
ensembles bobinaires semblables à la partie ZN de la fig.
40, bobines formant l’une transmetteur, l’autre récepteur,
et où un courant continu de pile était modulé,
au transmetteur, par des déplacements de la membrane vibrante
devant laquelle on parlait. Ces modulations modifiaient alors,
au récepteur, l'aimantation de la tige de fer doux centrale
et donc attiraient plus ou moins la membrane de l'écouteur,
Cet appareillage primitif se trouva presque aussitôt perfectionné
ir l'introduction, comme transmetteur, du « microphone à
crayons de charbon » (fig. 40) de Hughes, devant lequel
on parle et qui augmente considérablement les effets magnétiques
par les variations de contact des charbons ébranlés.
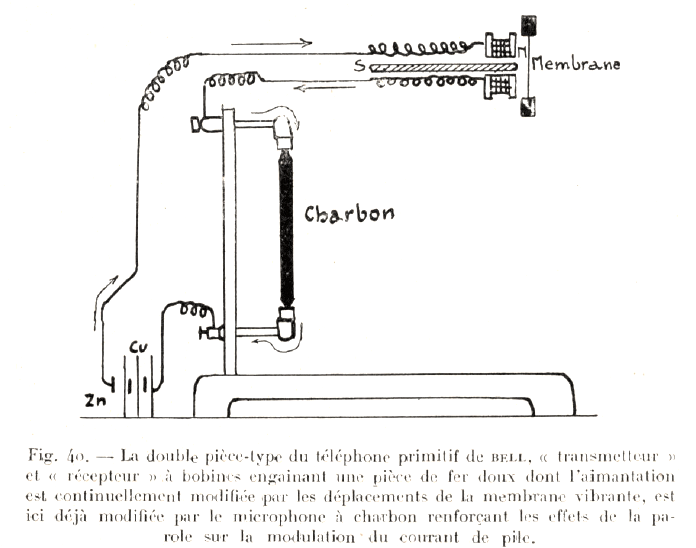
Par la suite, le poste transmetteur et le
poste écouteur se trouvèrent construits de pareille
façon avec chacun leur microphone amplificateur dans le
parleur et dans l’écouteur, ainsi que nous en usons
actuellement dans nos « téléphones à
grenaille ».
Donc, vers la fin de l’année 1877
, M. D'ARSONVAL se dit que s’il existe bien effectivement
un courant continu émergeant de la nutrition d'un muscle
au repos, ce courant il n'y a pour le révéler qu'à
le dériver à travers un récepteur téléphonique.
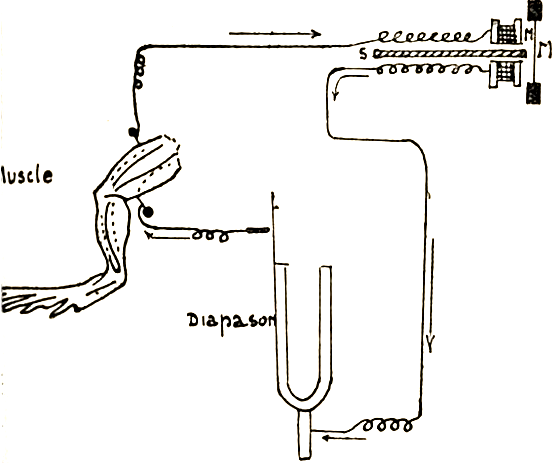
Mais puisqu'il est supposé « continuellement uniforme
», on ne pourra cependant ainsi — s'il existe —
le déceler sans un artifice, étant donné
que la membrane du récepteur téléphonique
ne peut vibrer que sous l'effet de variations, de modulations,
dans l'intensité du continu. Et alors M. D'ARSONVAL se
dit qu'en intercalant un diapason en vibration dont l’une
des branches va faire alternativement rupteur et rétablisseur
sur le fil du cireuit « muscle-téléphone »,
s'il existe bien effectivement dans ce circuit un courant la plaque
téléphonique devra vibrer à l'unisson de
ces variations. Il est bien évident que si, dans le circuit,
il n'existe pas de courant venant du muscle, rien ne pourra porter
à la plaque les interruptions et contacts de la branche
du diapason. En un mot, le résultat de l'expérience
va juger de la réalité ou de la non-existence de
courants dans le muscle au repos.
Or, la plaque vibre et le jeune préparateur du Collège
de France peut montrer que son « galvanoscope-léléphonique
» est deux cents fois plus sensible que la « patte
galvanoscopique » jusqu'alors employée pour déceler
des courants de faible intensité.
Aussi voit-on tout de suite son invention passer dans les laboratoires
de recherches et intéresser au plus haut point les expérimentateurs.
« Mes expériences — trouve-t-on écrit
dans l'exposé des Titres et Travaux scientifiques de l'inventeur
— furent répétées par divers savants,
et notamment par M. TARCHANNOFF, à Saint-Pétersbourg,
avec un plein succès, en suivant mes indications.
Ultérieurement, M. MARY fit usage de ma méthode
pour l'étude de la décharge des poissons électriques
et arriva facilement à prouver sa discontinuité.
M. ROBIN employa également le téléphone pour
l'étude de l'organe électrique rudimentaire de cerlains
poissons.
...
|
Notes de M. A d’Arsonval sur
les causes des courants électriques d’origine
animale dits courants de repos, dans les comptes-rendus
de la Société de biologie, juillet 1885
« La patte de la grenouille était considérée
comme l’un des réactifs les plus sensibles aux
courants électriques et employée constamment
comme galvanoscope.
Par une expérience très simple, j’ai
montré en décembre 1877, que le téléphone
est environ deux cents fois plus sensible que la patte galvanoscopique.
Je proposai alors l’usage de cet instrument pour l’étude
de l’électricité animale en général,
et du tétanos électrique du muscle en particulier.
En disposant un interrupteur vibrant, j’ai pu déceler,
par le téléphone, le passage d’un courant
continu, et je montrai ainsi l’existence des courants
électriques musculaires et nerveux, ainsi que la
variation négative. Mes expériences furent
répétées par divers savants et, notamment
par M. de Tarchannoff, à Saint-Pétersbourg,
. . . »
A. d’Arsonval.
|
Suivront de multiples expériences que l'on
peut lire dans l'ouvrage D'Arsonval.
Soixante-cinq ans à travers la Science de Louis
Chauvois
Exposé de M. D'ARSONVAL dans le "Comptes
rendus des séances de la Société de biologie
et de ses filiales du 2 mars 1878"
communique une expérience (en 1877) relative à la
sensibilité des nerfs aux excitations électriques.
On croit généralement que le nerf
est l'élément organique le plus sensible aux courants
électriques, et qu'il est plus sensible à ces excitations
que ne le sont.les appareils les plus sensibles. Il n'en est rien
cependant, car le téléphone est plus sensible que
le nerf aux courants induits interrompus.
M. d'Arsonval a préparé à
l'avance une grenouille galvanoscopique.
Il excite les nerfs lombaires avec un courant
induit interrompu, et constate le degré de l'appareil auquel
ces nerfs sont insensibles, c'est-à-dire
le degré d'intensité du courant qui cesse de pouvoir
déterminer la contraction des muscles.
Si alors on met le même courant en rapport avec un téléphone,
on constate que la membrane de cet appareil entre en vibration.
M. d'Arsonval se propose d'utiliser ce fait
pour étudier différents phénomènes
nerveux
Exposé de Marcelin Berthelot présente
l'expérience en détails à l'Académie
des sciences le 1er avril 1878 :
Le téléphone est un instrument
d'une sensibilité exquise. J'ai été amené
à le comparer avec le nerf qui est considéré
comme le réactif ieplus sensible de l'électricité,
depuis les célèbres expériences de Galvani.
Il résulte de ces expériences que le téléphone
le plus mal construit est an moins cent fois plus sensible que
le nerf,pour-déceler de faibles variations étectriques.
Voici en quoi consiste l'expérience :
Je prépare une grenouille à la manière de
Galvani. Je prends l'appareil d'induction de Siemens et Halske,
usité en Physiologie sous le nom d'appareil à chariot;
j'excite avec la pince ordinaire le nerf sciatique et j'éloigne
la bobine induite jusqu'à ce que le nerf ne réponde
plus a l'excitation électrique. Je remplace alors le nerf
par le téléphone, et le courant induit qui n'excitait
plus le nerf fait vibrer avec force le téléphone.
J'éloigne la bobine induite, et le tétéphone
vibre toujours.
Dans le silence de la nuit j'ai pu entendre vibrer le téléphone
en éloignant la bobine induite à une distance quinze
fois plus grande que celle du minimum d'excitation du nerf; par
conséquent, si l'on admet pour l'induction, comme pour
les actions à distance, la loi des carrés inverses,
on voit que dans cette circonstance le téléphone,
cet instrument d'une si grande simplicité, est au moins
deux cents fois plus sensible que le nerf.
J'ajoute que l'emploi de ces faibles courants d'induction est
très commode pour régter le téléphone;
on recule ou t'on avance l'aimant jusqu'à ce que la vibration
entendue soit maximum.
Nous possédons dans le téléphone
un instrument d'une sensibilité exquise. Il est, comme
on le voit, beaucoup ptus sensible que la patte galvanoscopique.
J'ai songé à en faire un galvanoscope. On n'étudie
que très-difficilement les courants musculaires et nerveux
avec le galvanomètre de 3oooo tours de du Bois-Raymond,
parce que l'appareil manque d'instantanéité et que
l'aiguille, à cause de son inertie, ne peut manifester
de variations électriques se succédant rapidement,
comme celles qui ont lieu par exemple dans le muscle lorsqu'on
le tétanise. Cet inconvénient n'existe plus avec
le téléphone, qui répond toujours par une
vibration à un changement étectrique, quelque rapide
qu'il soit. C'est donc un excellent instrument pour étudier
le tétanos électrique du muscle. On peut être
sûr d'avance que le courant musculaire
excitera le téléphone, puisque ce courant excite
le nerf qui est moins sensible que le téléphone.
L'instrument nécessite pour cela quelques dispositions
spéciales; j'ai entrepris par ce moyen une série
d'expériences sur l'électricité animale,
qui feront l'objet de Communications subséquentes.
Le téléphone ne peut servir qu'à
constater les variations d'un courant électrique, quelques
faibles qu'elles soient il est vrai; j'ai trouvé le moyen
de constater, par son intermédiaire, la présence
d'un courant continu, quelque faible qu'il puisse être.
J'y ai réussi en employant un artifice très simple.
Je lance dans le téléphone le courant supposé,
et, pour obtenir des variations, j'interromps mécaniquement
ce courant par un diapason. Si aucun courant ne traverse le téléphone,
il reste muet, si au contraire le plus faible courant existe,
le téléphone vibre à l'unisson du diapason.
Des courants hydro-électriques ou thermo-électriques
très-faibles peuvent ainsi être constatés
en employant une disposition spéciale de l'instrument pour
chaque cas.
D'après ce qui précède,
on voit donc que le téléphone est de tous les galvanoscopes
le plus sensible pour déceler la présence, soit
de faibles variations électriques, soit de faibles courants
continus, en se servant de l'artifice que j'indique.
Je ne doute pas que son emploi ne fournisse
des résultats intéressants dans l'étude de
i'é!ectricité animale que je vais étudier
par ce moyen nouveau. »
Téléphone
employé comme galvanoscope Note de M. D'ARSONAL, présentée
par M. Berthelot.
|
sommaire
Le nouveau galvanoscope : appareil permettant
de déceler un courant électrique, présenté
le 16 avril 1880 à la société d'encouragement pour
l'industrie nationale par Mr d'Arssonval :
|
Entre les branches d’un aimant en fer à
cheval et tout autour de la pièce cylindrique de fer doux
rendue fixe, peut osciller le fin bobinage conducteur de courant
rendu mobile et simplement suspendu par un fil de torsion extrêmement
fin. L’interaction électromagnétique courant-aimant
entraîne une rotation du cadre. Le cadre porte un miroir
argenté qui permet, par réflexion d’un faisceau
lumineux, de faire une lecture optique sur une échelle
graduée avec une très grande précision.
« C’est en 1880 que j’ai
introduit, en électrométrie, les galvanomètres
à circuit mobile. Ces appareils ont trois avantages bien
précieux :
- ils sont absolument apériodiques (Se dit d’un appareil
de mesure qui atteint sa position de régime sans oscillation)
;
- la partie mobile n’étant pas magnétique ils
sont soustraits à l’influence du magnétisme
terrestre ou des aimants voisins; le couple moteur peut être
rendu très grand puisqu’il est proportionnel au produit
de l’intensité à mesurer par l’intensité
du champ magnétique.»
A. d’Arsonval.
Associé avec des résistors
(shunts) en parallèle, le galvanomètre est un ampèremètre,
et avec des résistors en série il devient un voltmètre.
Selon les caractéristiques mécaniques et électriques
du cadre mobile il est utilisé en mode continu, ou impulsionnel.
Dans les laboratoires il peut être aussi utilisé
en galvanomètre balistique, en thermo-galvanomètre,
en galvanomètre différentiel, en galvanomètre
« de zéro ». Cette polyvalence donne au galvanomètre
une place de première importance dans la mesure de «
l’électricité ».
 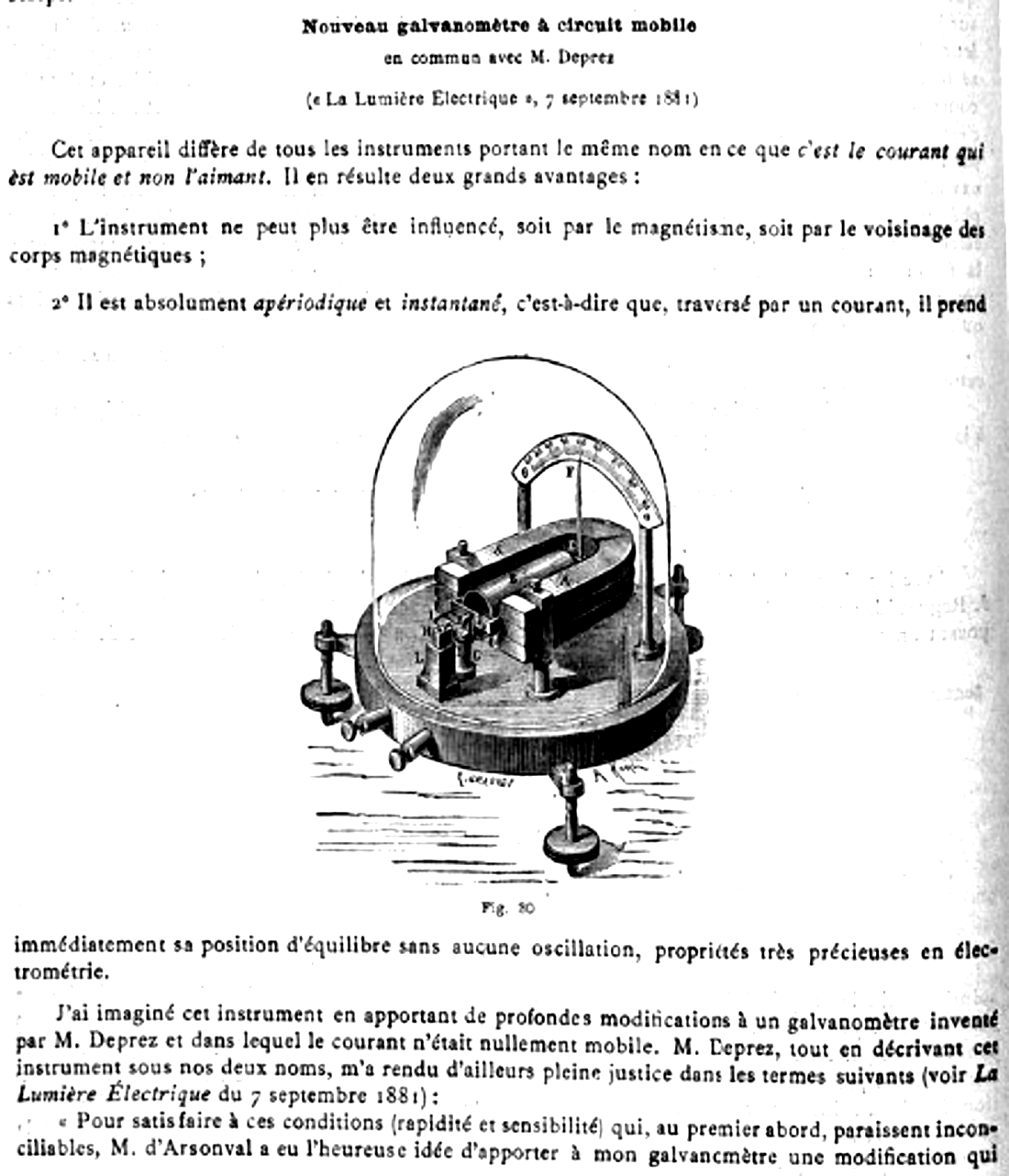
Le galvanomètre à cadre mobile Deprez - d’Arsonval
Le galvanomètre à cadre mobile
(à fil unique) encore appelé galvanomètre
à corde ou galvanomètre à vibration, a permis
une avancée certaine, dans la recherche conduisant aux
électrocardiographes, oscillographes . .
|
sommaire
1878 L'Exposition Universelle de Paris
Pour honorer la mémoire de Claude Bernard, le stand du Collège
de France présente ses travaux à l'expostion unverselle
de Paris.
Arsène D'Arsonval en tant qu'organisateur présente plusieurs
de ses inventions.
Il est aussi intéressé par les nombreux téléphones
exposés sur d'autres stands et achète un microphone de
Hugues, découverte toute récente et découvre également
le phonographe d'Edison ...
La rencontre avec Paul Bert
Paul
Bert,

|
Né
le 19 octobre 1833 à Auxerre et mort le 11 novembre 1886
à Hanoï, c'est un médecin, physiologiste et homme
politique.
Élève de Claude
Bernard, suppléant de Pierre Flourens au Muséum national
d'histoire naturelle, il étudie la physiologie de la respiration
(en altitude et en plongée) et s'intéresse à
la greffe et à l'anesthésie.
Élu député
radical à partir de 1872, lors de la crise de 1877 il est
l'un des 363.(Le manifeste des 363 est une déclaration adressée
le 18 mai 1877 par les députés républicains
au président de la République Patrice de Mac Mahon,
qui lui exprime leur opposition à la politique qu'il mène
et à l'instauration du monarchiste duc de Broglie à
la présidence du Conseil, alors même que la majorité
de la Chambre est républicaine. )
Il est ministre de l'Instruction publique et des Cultes de 1881
à 1882. Anticlérical, il est l'un des fondateurs de
l’« école gratuite, laïque et obligatoire
» qu'instaurent les lois de Jules Ferry, auquel il succède
comme ministre de l'Instruction publique. Soutien de la politique
de colonisation, il publie plusieurs manuels scolaires.
En janvier 1886, il est nommé résident supérieur
de l'Annam-Tonkin, en Indochine, où il meurt quelques mois
plus tard des suites du choléra. |
Ancien
éléve et préparateur de Claude Bernard devenu Docteur,
à cette période, il fit connaissance avec Arsène
d'Arsonval .
Paul Bert succéda à Claude Bernard au poste de
professeur de physiologie à la faculté des sciences.
En 1878 il crée "Les Revues scientifiques"
publiées dans le journal La République. Il y publie plusieurs
articles sur le téléphone :
- Le téléphone
- Les nouvelles applications et perfectionnements du téléphone
; MM de Champvallier, d'Arsonval, salet, Du Moncel, Trouvé.
- Le téléphone à Mercure : Antoine Bréguet.
- Le téléphone : Hughes.
- L'électro motographe de Edison
- Le microphone explorateur : Chardin et Bejot , Ducretet.
- La harpe téléphone : Gower.
Le 1er mai 1878 P. Bert est présent à Londres lors de
la soirée scientifique de la Royal Society ou il y retrouve Arsène
d'Arsonval.
Connaissant bien tous les appareils il en déduit que :
- Le téléphone Bell est un bon récepteur mais il
est un pière transmetteur, il est trop sensible aux courants
induits propagés par les sources électriques.
- Le microphone de Hugues est un excellent transmetteur mais reste un
appareil de laboratoire.
- Le téléphone magnétique Gower est un bon récépteur
mais le transmetteur est moins efficace que le transmetteur à
charbon de Edison.
- Le microphonr Edison se dérègle fréquemment.
- Edison ne réussit pas à faire fonctionner correctement
son électro motographe qui se dérègle systématiuement.
- Les autres projets de micropone sont encore à l'état
de projet, il faudra Août 1879 pour celui
de Locht-Labye, novembre 1879 pour celui de Maiche ,juillet 1880 pour
le microphone de Ader, 1881 pour Beillehache et 1882 pour Bourdin-Journaux
et d'Argy.
Eté 1879 le seul transmetteur à charbon qui semble bien
fonctionner est celui de Crossley.
Comptes rendus des séances de la Société de
biologie de 1879 :
"M. BERT, aidé par M. d'Arsonval, a essayé de
faire entendre les sourds à l'aide du microphone et du téléphone.
Le premier appareil grandissait tellement les sons, les bruits respiratoires,
vasculaires, du malade, que celui-ci n'entendait plus qu'un bruit continu
et très-fatigant. MM. Bert et d'Arsonval ont cherché,
en modifiant le receptacle du microphone, à faire entendre à
un sourd la voix d'un orateur parlant à une tribune dans les
conditions ordinaires d'une assemblée parlementaire."
Afin de protéger l'invention, Bert et D'Arsonval déposent
le premier brevet N° 132 477 en septembre 1879 pour un "Nouveau
microphone avec réglage des crayons de charbon par attraction
magnétique".
En octobre 1879, Paul Bert envoie un article à "La Lumière
Electrique" (comte Théodore du Moncel)
Avec Paul Bert, d'Arsonval retrouve le même mode de fonctionnement
qu'il avait avec Claude Bernard décédé en 1878,
Bert a les idées et oriente les recherches, d'Arsoval assure
le côté pratique.
sommaire
NOUVEAUX MICROPHONES D'ARSONVAL En commun avec PAUL
BERT
Biologie et Journal La Nature
(1879)
Au cours des recherches sur la surdité,
je fus amené, avec PAUL BERT, à m'occuper du
microphone pour essayer d'utiliser les propriétés
amplificatrices de l'instrument primilif de Hugues, Comme il arrive
en ienb des cas, nous avons trouvé autre chose que ce que
nous cherchions, par
des perfectionnements successifs de notre premier appareil, nous
arrivâmes à combiner différents instruments
qui donnèrent d'excellents résultats pour la téléphonie
pralique.
Les premiers en date sont fondés sur le groupement des contacts
microphoniques en quantité : série de crayons de charbon,
enfilés verticalement dans deux plaques percées de
trous qui leur servent de guide,
Leur partie inférieure trempe dans un bain de mercure contenu
dans le tube, et ce liquide, en exerçant une poussée
égale sur chacun d'eux, constilue un ressort d'une grande
douceur, La partie supérieure de des mêmes charbons
vient appuyer légèrement sur un diaphragme portant
un disque de charbon et qui reçoit les vibrations de la voix.
La pression des charbons contre le diaphragme (et, par conséquent,
la sensibilité de l'instrument) est facilement réglée
en faisant varier le niveau de mercure dans le tube
Dans les modèles suivants, nous avons supprimé
le mercure et utilisé simplement la pesanteur comme force
appuyant les contacts microphoniques.
En 1879, nous en avons trouvé un qui a le double
avantage d'agir dans toutes les posilions et à distance
; c'est l'attraction magnétique.
Le réglage de l'effort exercé est rendu plus précis
el peut s'appliquer à nombre d'instruments,
Le premier dispositif de ce réglage (celui décrit
dans notre note à l'Institut) ne nous donna pas, en pralique,
de bons résultats, Pensant bien que cela tenait, non au
principe, mais au mode d'application, je me suis attaché
uniquement à varier les modèles et j'ai complètement
réussi en adoptant la disposition suivante :
Le microphone est un simple microphone Hughes
vertical à quatre crayons de charbon montés sur
pointes (fig. 58). Ces charbons sont entourés, ainsi que
le montre le dessin, d'une chemise de fer blanc. Derrière
eux se trouve un aimant en fer à cheval, qu'on peul approcher
plus ou moins, et dont l'attraction magnétique règle
à distance la pression des charbons.….
Des modèles spéciaux de ces
appareils ont élé étudiés pour résister
aux chocs les plus violents ; et comme, grâce à leur
réglage magnétique, ils fonctionnent dans loutes
les posilions, on à pu introduire le microphone dans le
service des forts, des écoles à feu, des polygones
d'artillerie, ete... J'ai combiné ces différents
modèles sur la demande de mon éminent ami, le général
BRUGÈRE, pour ses expériences de tir.
Malgré le mauvais état des
hignes ils ont donné aux polygones de Vincennes, de Châlons
el de Cercotles, des résultats complètement salisfaisants,
Ces mêmes appareils fonctionnent également au Palais
de la Bourse, pour les transmissions téléphoniques
à grande distance (Paris-Bruxelles, Paris-Reims, elc..….).
La figure ci contre représente
un microphone composé d’une sérié
de crayons de charbon, enfilés verticalement dans deux
plaques percées de trous qui leur servent de guide.
Dans une première verion, la partie inférieure
trempe dans un bain de mercure, contenu
dans le tyibe, et ce liquide, en exerçant une poussée,
égale sur chacun d’eux, constitue un ressort d’une
grande douceur. La partie supérieure de ces mêmes
çharbons vient appuyer légèrement sur
un diaphragme portant un disque de charbon et qui reçoit
les vibrations de la voix. La pression des charbons contre
le diaphragme et, parçonséquent, la sensibilité
de l’instrument est facilement réglée en
faisant varier le niveau de mercure dans le tube,
Dans les modèles, suivants, nous avons supprimé
le mercure et utilisé slmplemeut la pesanteur comme
force appuyant les contacts microphoniques. |
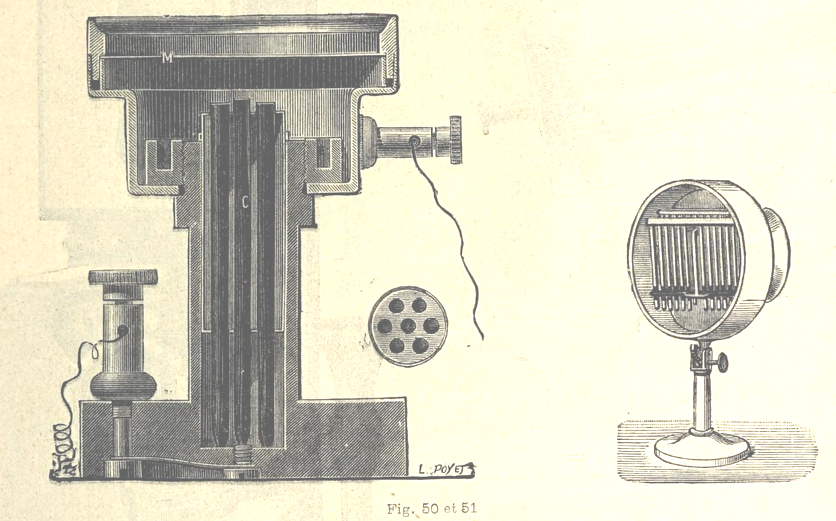 |
Le premier modèle février 1880 de
la Société Ducretet et Cie
 

En 1880, Ducretet rencontre Bert et d’Arsonval
et construit les premiers téléphones expérimentaux.
19 janvier 1881 premier Brevet N° 140
690 construit par Ducretet .
|
sommaire
Lu dans la revue La Nature de 1880
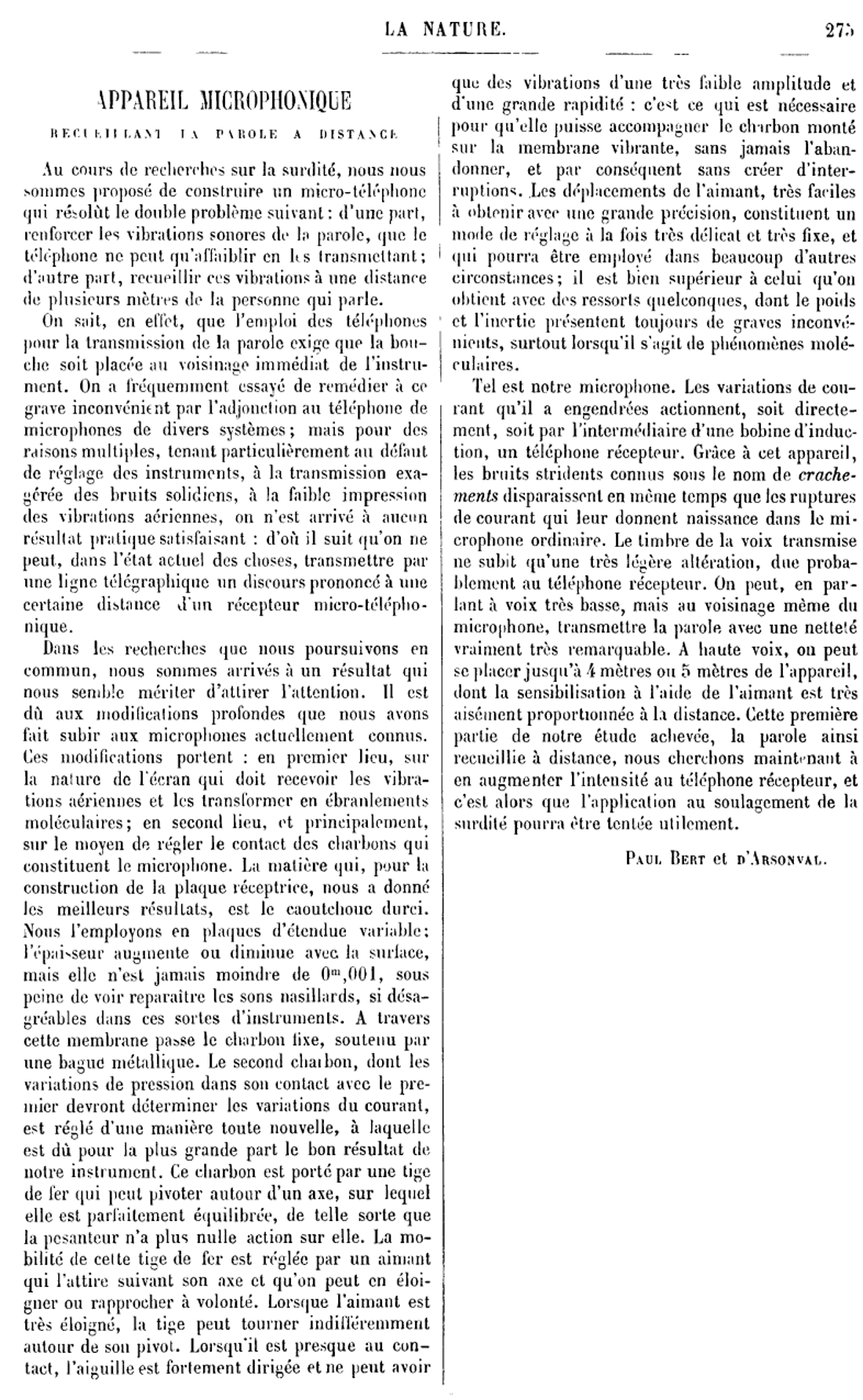
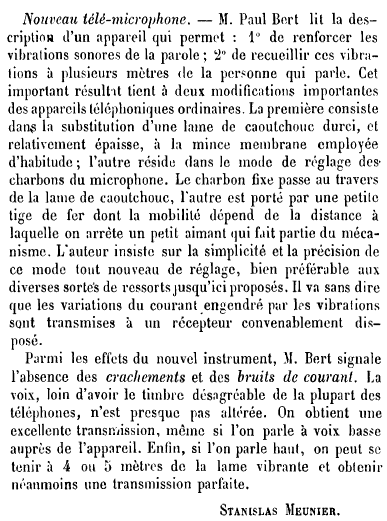
sommaire
Microphones à réglage
magnétique, en commun avec Paul Bert
Vu dans l'Académie des Sciences, du 15 mars 1880 et «
La Lumière Electrique », de novembre 1882
Dans tout appareil microphonique, les
contacts doivent être appuyés l’un sur l’autre,
avec une force plus ou moins grande, suivant le degré de
sensibilité qu’on veut donner à l’appareil.
Dans nos précédents appareils nous avions, Paul Bert
et moi, employé, soit la poussée d’un liquide,
soit la pesanteur, Ce système de réglage ne permet
pas de placer indifféremment l’appareil dans toutes
les positions.
En 1879, nous en avons trouvé un qui a le double avantage
d'agir dans toutes les positions et à distance c'est 1'attraction
magnétique.
Le réglage de l’efifort exercé est rendu
des plus précis et peu s’appliquer à nombre d’instruments.
Le premier dispositif de ce réglage ne nous donna pas, en
pratique, de bons résultats. Pensant bien que cela tenait,
non au principe, mais au mode d’application, je me suis attaché
ultérieurement à varier les lles modèles et
j’ai complètement réussi en adoptant la disposition
suivante ....
Extrait de la nature de
1880
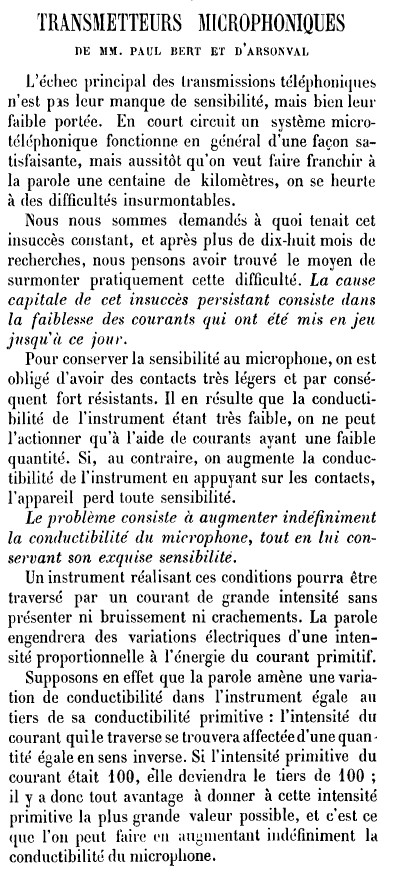 |
 Premier modèle 1881
Premier modèle 1881
Second modèle 1881 
|
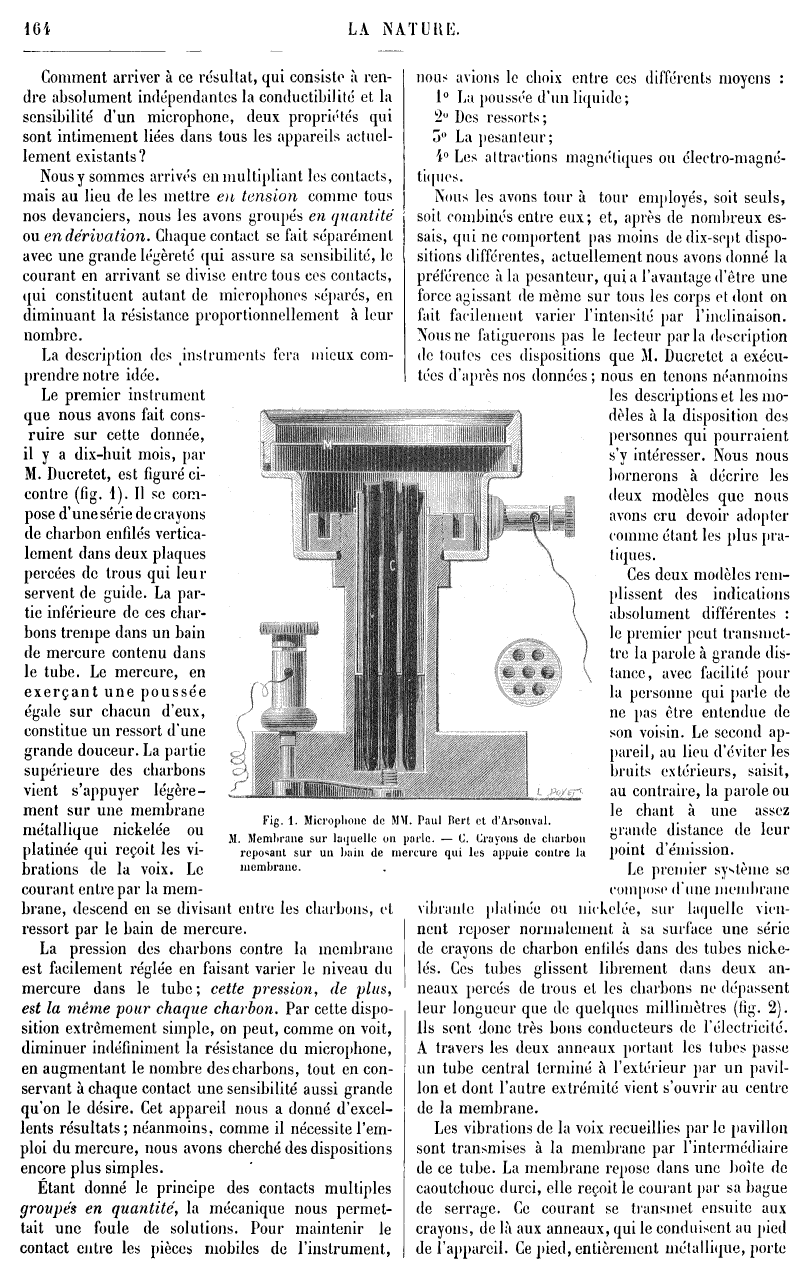
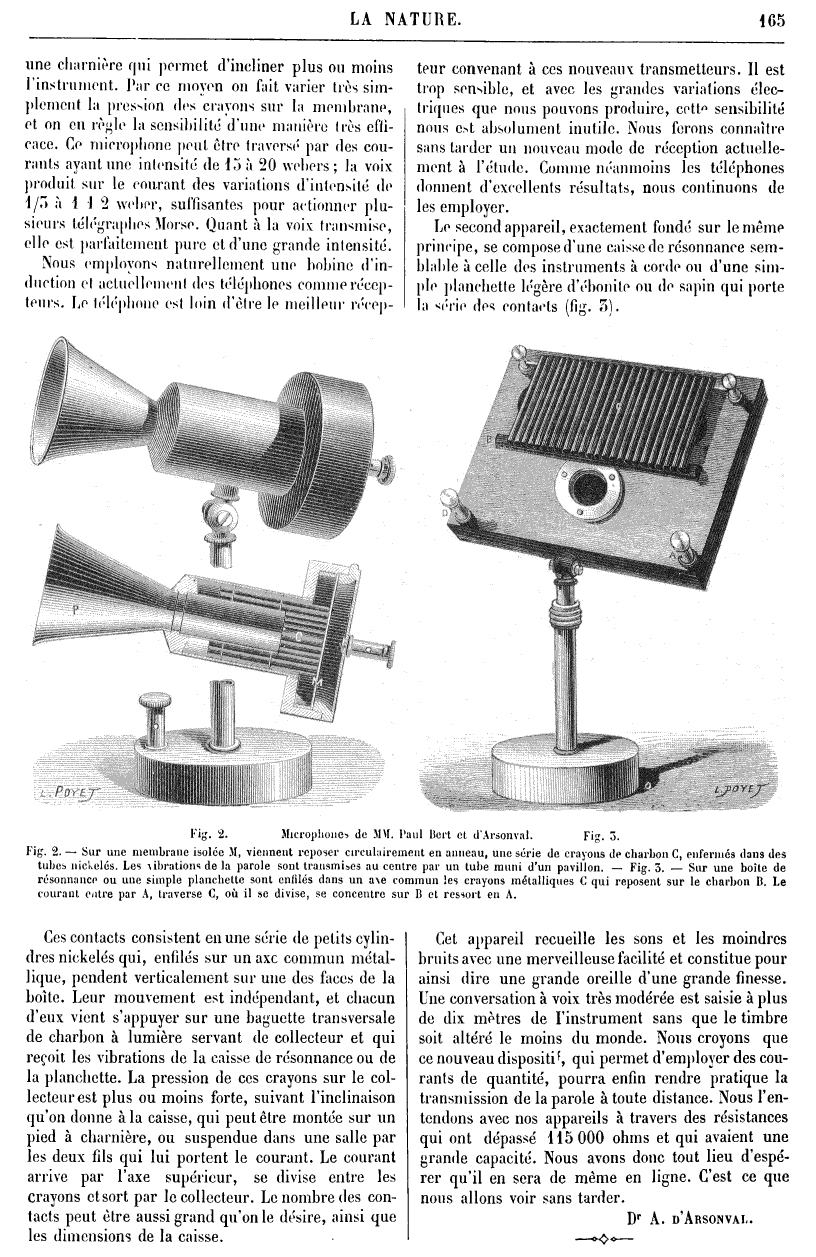
|
|
Exposition internationale d’électricité
de 1881 : L’attraction vedette est le téléphone.
L’appareil avait déjà été
présenté en 1876 à l’exposition
de Philadelphie.
Le téléphone de Bell et ses variantes, tel
celui de Edison, se répandent avec une extrême
rapidité.
La raison essentielle en est la densité du réseau
de lignes télégraphiques déjà
existantes. Elles sont utilisées par le téléphone
qui a d’ailleurs souvent été désigné
comme un "télégraphe parlant".
Le problème est cependant celui de la résistance
électrique de ces lignes et la faible intensité
du signal émis.
Les cinq ans qui séparent la découverte de
l’exposition de 1881 ont été mis à
profit par Bell lui-même et par d’autres ingénieux
techniciens pour trouver des solutions.
Un premier "amplificateur" est utilisé
au niveau de l’émetteur. Celui-ci devient un
"microphone" capable de transmettre au loin les
sons les plus faibles.
Sa réalisation met en œuvre une propriété
du graphite dont la découverte est attribuée
à l’Américain David Hughes. L’intensité
du courant débité par la pile varie donc au
gré des vibrations et son intensité est bien
plus forte que celle du faible courant produit dans la bobine
inductrice initialement proposée par Bell. Dès
lors la résistance des fils de la ligne télégraphique
n’est plus un problème.
Plusieurs microphones Darsonval et Paul Bert sont
ainsi présentés à l’exposition
, celui à mercure et ceux fonctionnanr par la pesanteur,
qui comportent une série de tubes de graphite soumis
à une pression réglable.
Cette même année 1881 , A.
d’Arsonval fait partie de la chancellerie à
laquelle est confiée l’organisation du Congrès
International des électriciens, ouvert à Paris
le 15 septembre 1881, sous la présidence du Ministre
des Postes et des Télégraphes, Adolphe Cochery.
Alors qu’au même moment se tient l’Exposition
International d’électricité, ce Congrès,
avec sa commission d’électrophysiologie, est
en quelque sorte, une « rampe de lancement »
pour le préparateur du cours de médecine au
Collège de France.
|
sommaire
En 1882 Paul Bert devenu ministre de l'Instruction
Oublique et des Cultes propose à A.d'Arsonval de créer
un laboratoire de faculté pour honorer la mémoire
de Claude Bernardet de lui en confier la direction ave Brown-Séquard.
Paul Bert le 13 janvier 1882 crée au Collége de
France le laboratoire de physique biologique rattaché à
l'école pratique des hautes études. Peu de jours
après le 26 janvier car le président Gambetta démissionne
du gouvernement.
C'est un nouveau départ pour d'Arsonval qui va enseigner
au Collède de France. Il s'installe dans les locaux rue
de la Montagne Sainte-Geneviève juste à côté
du tout neu magasin de la Société Lenczewsky,
spécialisé dan la fabrication d'instruments de précision
et d'électricité. Société qui qui
vient d'obtenir une édaille d'argent à l'exposition
internationale d'électricité de 1881.
En temps que voisin, d'Arsonval recontre donc Ladislas
Lenczewsky et son nouvel associé Paul
de Branville qui deviendronts tous deux les constructeurs
des appareils conçus par d'Arsonval.
1882 Téléphone magnétique
à pôles concentriques :
| Un premier modèle est
réalié à partir d'un aimant en fer à
cheval ,mais il n'est pas assez puissant
et d'Arsonval en revient aux formes usuelles comme cela est
décrit dans La Lumière Electrique du 12 août
1882. |
 |
Il construit un nouveau prototype et dépose
un brevet N° 148 598, le 21 avril 1882 appelé "
Un nouveau système de téléphone".
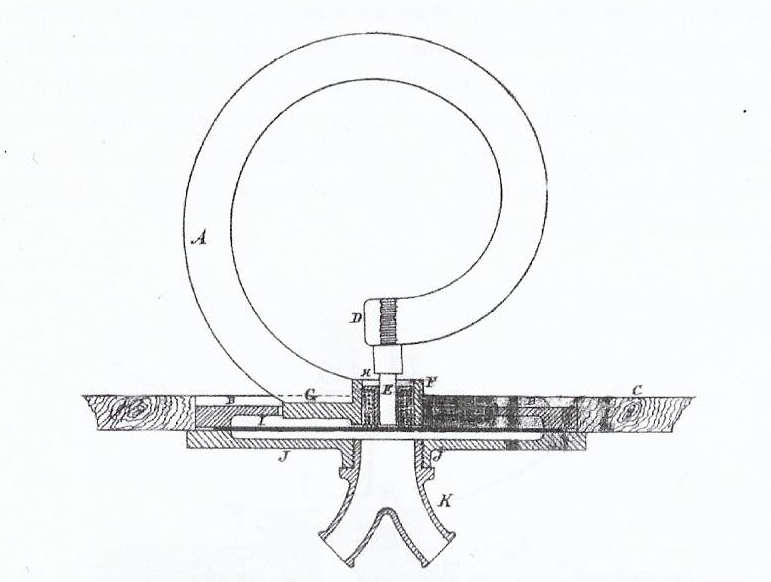 l'appareil est solidaire
de la planche de fond en bois. Une douille vient se viser sur
la tablette pour le branchement des tubes acoustiques. C'est une
solution simple et économique et restera en option sur
d'autres modèles bien que les tubes acoustiqus soient très
peu utilisés à cette époque. l'appareil est solidaire
de la planche de fond en bois. Une douille vient se viser sur
la tablette pour le branchement des tubes acoustiques. C'est une
solution simple et économique et restera en option sur
d'autres modèles bien que les tubes acoustiqus soient très
peu utilisés à cette époque.
Le téléphone magnétique à pôles
concentrés
Le 27 juillet 1882, d'Arsonval dépose un
certificat d'addition à son brevet N° 148 598 afin
d'améliorer son téléphone qui n'est plus
fixé sur une lanchette, l'aimant est spiroïdal et
sert de poignée.Il est appliqué directement à
l"'oreille ou il est muni d'un double tube acoustique permettant
d'équiper 'appareil que d'un seul recepteur.
 |
Le recepteur (premier
modèle sans bornes de raccordement)
Cet appareil constitue un perfectionnement important du téléphone
de Bell, au double point de vue de la simplicité de
construction et des effets obtenus. J’ai démontré,
contrairement aux idées reçues alors, que la
Jorce portante de l’aimant n’entre pour rien dans
les effets obtenus au point de vue de la netteté et
de la force de la production de la parole par cet instrument.
La seule chose qui ait de l’influence, c’est la
longueur du fil noyé dans le
champ magnétique, et le nombre de lignes de force qui
coupent la bobine normalement son axe.
Par conséquent, pour obtenir
le maximum de force, il faut noyer complètement bobine
dans un champ magnétique aussi intense que possible.
Je suis arrivé à ce résultat en faisant
un aimant annulaire dont un des pôles occupe le centre
et dont le second se recourbe autour du premier ; la bobine
se place entre les deux et tout le fil qui la garnit se trouve
ainsi soumis l’action 4u champ magnétique. |
Ainsi que le montre la
figure 49, l’aimant se compose d’un élément
de spire A dont une extrémité porte le pôle
central n sur lequel sq place la bobine B, l’autre extrémité
porte un cylindre de fer T, enveloppant, de toute part, cette
bobine qui se trouve ainsi noyée dans un champ magnétique
annulaire très condensé. Ce
modèle a été adopté exclusivement
sur les réseaux téléphoniques de l'Etat et
pour les postes destinés à notre artillerie. Il
a reçu différentes formes et différentes
dimensions, suivant la destination
Voici l’opinion du célèbre électricien
anglais M. Preece, au sujet de cet instrument (congrès
de Sou» thampton) :
« D’Arsonval a, de son coté, perfectionné
le récepteur Bell. Il a placé la bobine dans'un
puissant champ magnétique de forme annulaire, de façon
à concentrer sur elles les lignes de force. La bobine induite
est noyée entièrement dans le champ magnétique.
Les effets sont considérablement augmentés. L’augmentation
de l’ampleur de la voix ne s’accompagne nullement de
la perte d’articulation, comme cela a lieu d’ordinaire,
la parole est reproduite sans aucun changement du timbre »,
D’après l'éminent directeur
du post-office de Londres, cet appareil était le seul,
transmettant avec une parfaite netteté, les consonnances
si variées du the anglais .
Un deuxième certificat d'addition pris le 5 décembre
1882 présente une forme famillière avec un pavillon
en ébonite.
   
L’aimant du récepteur d’Arsonval
(fig . 5) est un anneau brisé (fîg. 6). Sur l’un
des pôles est vissé un noyau de fer doux qui supporte
une bobine de 200 ohms de résistance. (Anneau brisé
ou appelé anneau en fer à cheval)

Sur l’autre pôle est fixé un anneau de fer doux
entourant la bobine, dont les spires sont ainsi comprises entre
les deux surfaces polaires de l’aimant.
Le boîtier est en laiton nickelé; il supporte la
plaque vibrante en tôle étamée, dont le diamètre
est de 61 mm et l'épaisseur de 0,31 mm. Le couvercle est
garni d’un pavillon en ébonite. Ce récepteur
est construit par la maison L.Digeon
et Cie ou par la maison Lenczwski.
Le poste micro-téléphonique mobile :
Le microphone est un simple microphone Hughes vertical
à quatre crayons de charbon montés sur pointes.
En 1879 d'Arsonval et Bert doivent améliorer leur système
pour rivaliser avec le microphone de Ader et espérer être
présent lors de l'adjudication qui sera faite pour équiper
le réseau de l'état.
Le 3 mai 1882 Bert et d'Arsonval déposent le brevet N°
148 748 pour "un nouveau système de transmetteur microphonique".
Les charbons sont entourés ainsi que le montre le dessin,
d’une chemise de fer blanc.
Derrière eux se trouve un aimant en fer à cheval,
qu’on peut approcher plus ou moins, et dont l’attraction
magnétique règle à distance la pression de
charbons.
Ce modèle esr décrit dans la revue "La lumière
électrique" du 11 novembre1882.
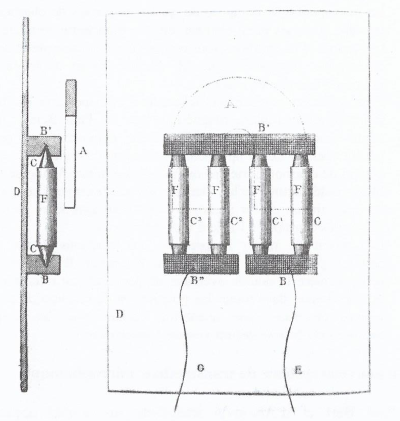 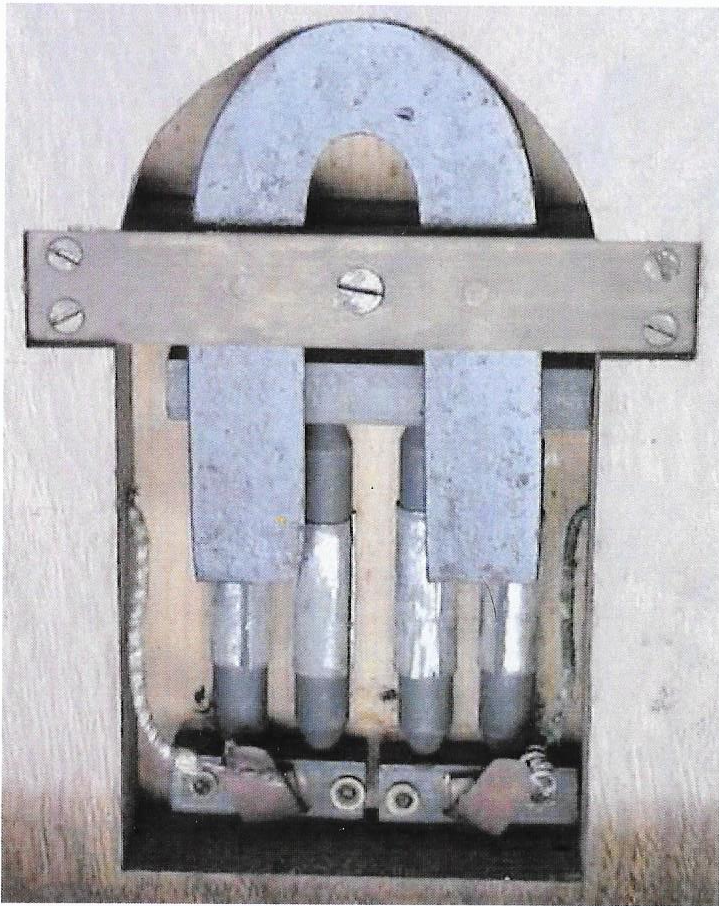
sommaire
Paul Bert et d'Arsonval imaginent un nouvel appareil d'abord
construit chez Lenczwski en
été 1882 et présenté dans le
brevet du 3 mai 1882, N° 148 748. C e poste est aussi
conçu et construit par De Branville
.
Les deux constructeurs proposent d'équiper l'appareil avec
les nouveaux récepteurs, mais il est généralement
livtré avec les tubes acoustiques.
Le style rappelle un miroir orientable que l'on trouvait
dans les chambres à cette époque.
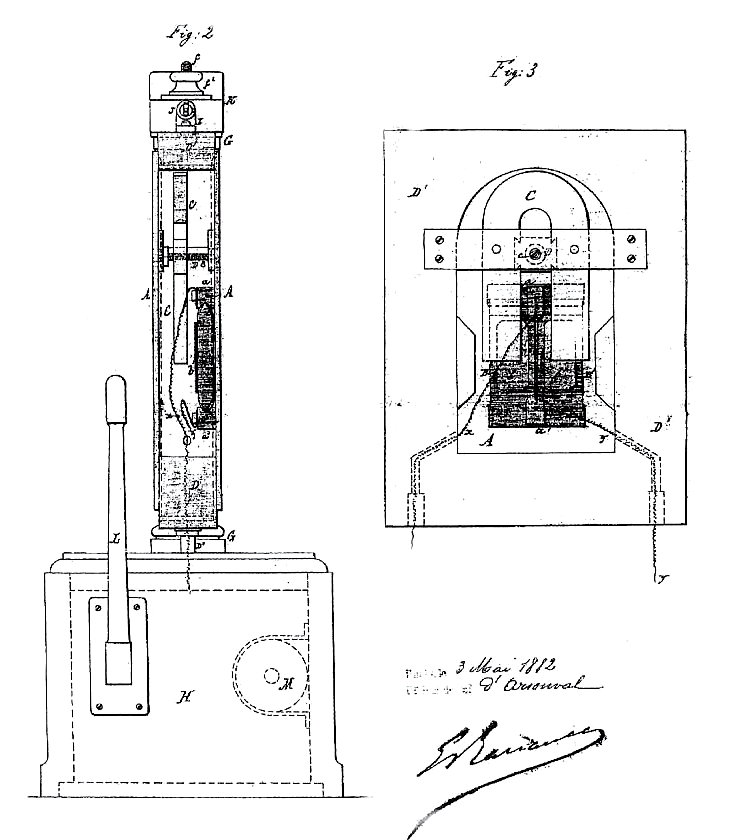
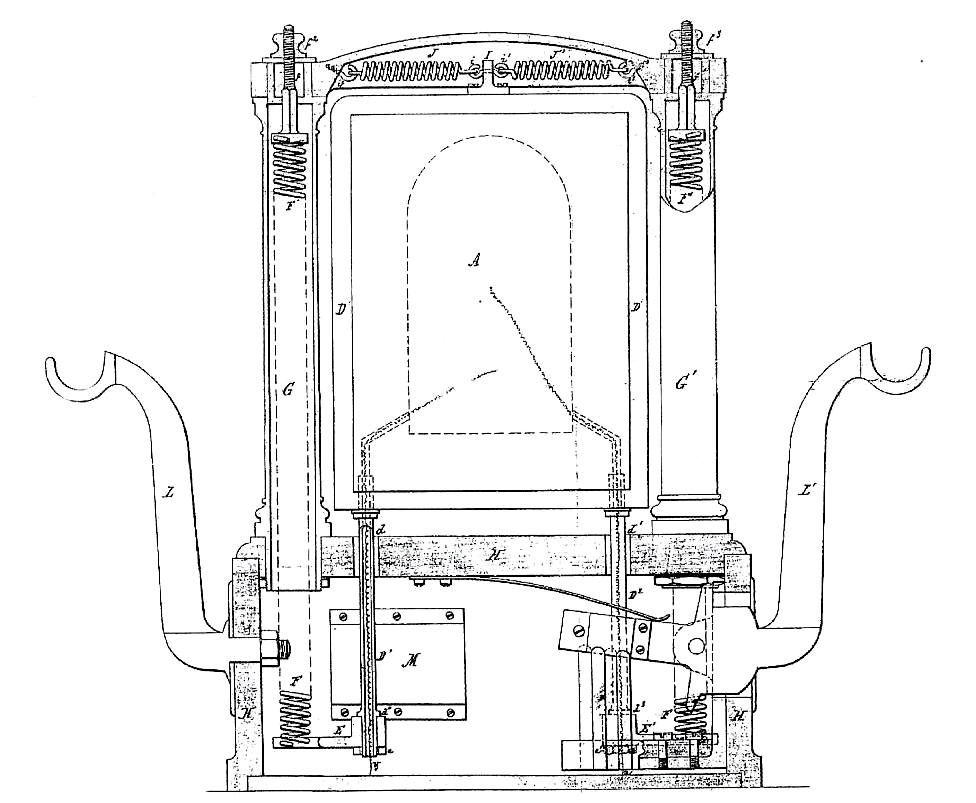
D'Arsonval conserva l'appareil numéroté N° 2
et est encore conservé au musée d'Arsonval à
la Porcherie, (donné par le Collège de France qui
en avait hérité).
Parmi les collectionneurs il existe deux exemplaires le N°5
appartenant à Claude Fiengo en photo ci dessous
et le N°11 celui de Jean
Godi.
Modèle N° 5 Lenczwski
1882  ,
N° 11 De Branville 1882-1883 ,
N° 11 De Branville 1882-1883

Détails du modèle N°5 
 Il est
encore muni d'un écouteur interne posé sur le fond
en bois et la pièce métallique filletée pour
raccorder le Y des tubes acoustiques (il a été trouvé
sans le Y et les tubes acoustiques). Il est
encore muni d'un écouteur interne posé sur le fond
en bois et la pièce métallique filletée pour
raccorder le Y des tubes acoustiques (il a été trouvé
sans le Y et les tubes acoustiques).
MICROPHONES A REGLAGE MAGNETIQUE En commun
avec PAUL BERT
Exposé à l'Académie des Sciences, 15 mars
1880, et La Lumière Electrique, 11 novembre 1882.
Dans tout appareil microphonique, les contacts doivent être
appuyés l'un sur l'autre, avec une force plus ou moins
grande, suivant le degré de sensibilité qu'on veut
donner à l'appareil. Dans nos précédents
appareils, nous avions, PAUL BERT et moi, employé, soit
la poussée d’un liquide, soit la pesanteur,
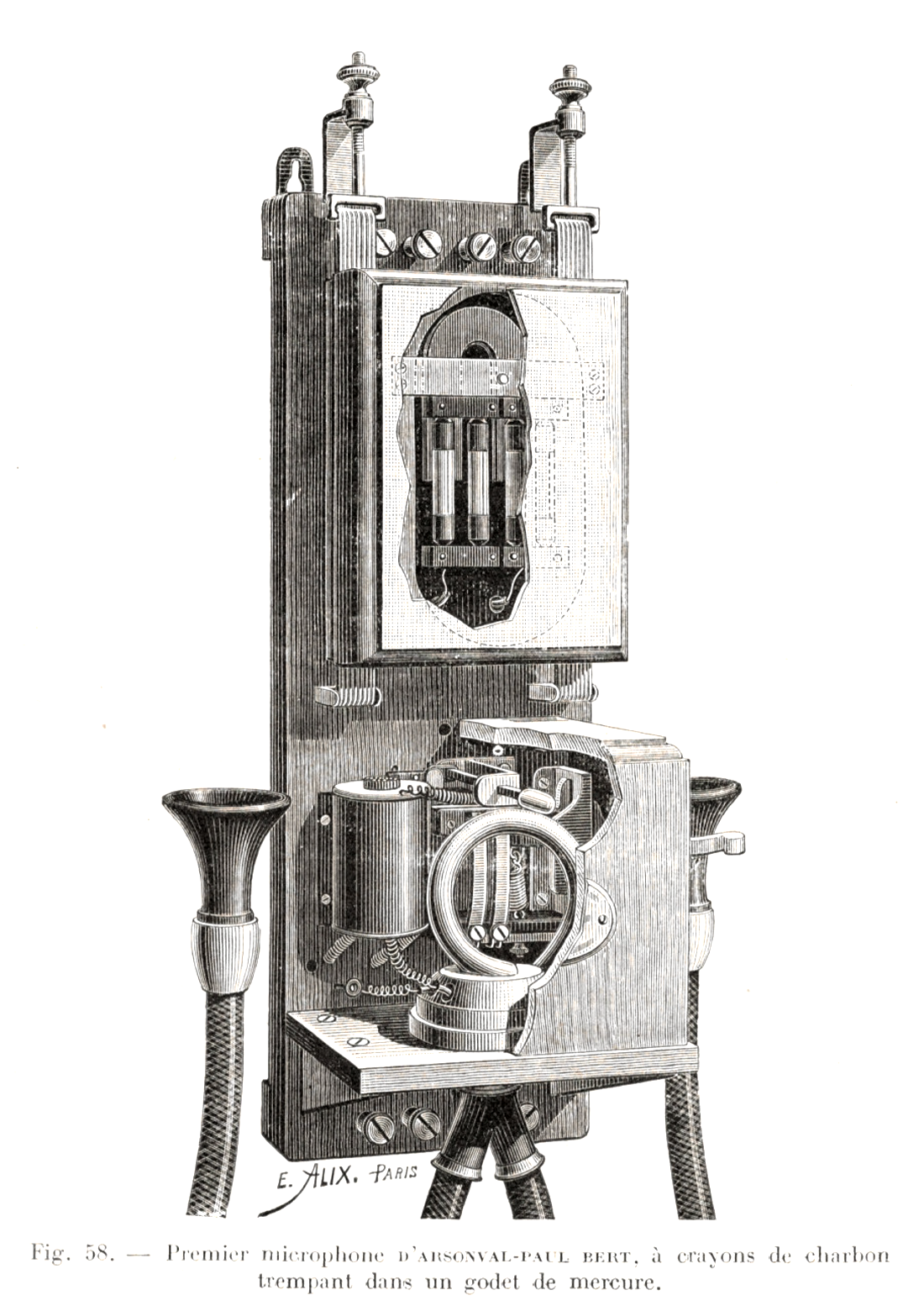
 modèle 1882
avec écouteur interne en fer à cheval et tubes acoustiques. modèle 1882
avec écouteur interne en fer à cheval et tubes acoustiques.
Fig. 58. — Premier microphone D'ARSONVAL-PAUL BERT, à
crayons de charbon trempant dans un godet de mercure.
Ce système de réglage ne permet pas de placer indifféremment
l'appareil dans loutes les positions alors d'Arsonval invente
un système ou les charbons sont enrobés par des
chemises métalliques et attirées par un aimant afin
d'éviter qu'ils ne bougent et engendrent des "crachottements"
.
Le microphone portatif
  
Le 27 juillet 1882, d'Arsonval met au point un système
plus petit et dépose un Certificat d'addition à
son brevet initial.
Le microphone est conçu pour fonctionner dans toutes les
positions, le puissant aimant recourbé exerce une attraction
sur les chemises métalliques supportant les charbons, évitant
à ceux ci d'émettre des "crachements".
C'est un Sytème qui tient dans la main , il est décrit
dans "la lumière électrique" du 11 novembre
1882.
C'est un microphone à quatres charbons sur une plaque de
vibrante de six centimètres de côté et qui
ne pèse que 300 grammes, contenu dans une petite boite
.
D'Arsonval pensait que cet appareil devrait intéresser
les militaires et construit aussi un tout petit modèle
de table.
modèle exposé au Cnam 
Modèle détenu par le collectionneur Pierre Martin
 
Ces modèles ont été étudiés
pour résister aux chocs les plus violents ; et comme, grâce
à leur réglage magnétique, ils fonctionnent
dans toutes les positions, on a pu introduire le microphone dans
le service des forts, des écoles à feu, des polygones
d’artillerie, etc.
J’ai (d'Arsonval) combiné ces différents modèles
sur la demande de mon éminent ami le Général
Brugère pour ses expériences de tir.
Malgré le mauvais état des lignes ils ont donné
aux polygones de Vincennes, de Châlons et de Cercottes.
des résultats complètement satisfaisants. Ces mêmes
appareils fonctionnent également au palais de la Bourse
pour les transmissions téléphoniques à grande
distance (Paris-Bruxelles, Paris- Reims, etc.).
Les
Combinés d'opératrice pour les bureaux centraux
:
Lenczewski qui travaille aussi pour d'autres inventeurs : Golubitsky,
Abdank, Maiche ... , est sollicité pour le marché
du combiné pour équiper les "demoiselles
du téléphone" des bureaux centraux.
Avec De Branville en ocobre 1882 ils mettent au point un appareil
portatif sous le nom de "appareil d'opérateur pour
central" et remportent le marché.

Il se compose d’un microphone et d’un téléphone
accouplés sur le même manche, on a ainsi une main
libre.
L'administration retient aussi le "commutateur à crochet"
de Jules Sieur (comme sur la photo) pour le bureau de Reims. Rappelons
que Sieur vient d'inventer le système téléphonique
complet : tableaux, annonciateurs, conjoncteurs et clés,
matériel plus simple que celui de la SGT ou de Brown utilisés
avant sur les premiers centraux téléphoniques.
|
sommaire
La SGT mécontente des décisions
de l'Etat et que leur matériel n'a pas été
retenu, est très inquiète à propos de leur
renouvellement de concession prévue en 1884.
Alors la société représentée par le
Armengaud Jeune, ingénieur conseil et expert en brevets,
intente un procès aux principaux constructeurs de téléphoen
en novembre 1882. Ce procès est raconté, sur ce site,
dans l'histoire du téléphone
en France.
La société Lenczewski qui a obtenu une médaille
d'rgent à l'exposition de 1881, en attendant le procès
a interdiction de commercialiser ses appareils en France. Lenczewski
se retire des affaires et cède ses parts à de Branville
le 31 janvier 1883.
Depuis 1882, certains constructeurs ont jetés l'éponge
et ne fabriquent plus de téléphones pour les réseaux
urbains : Beillehache, Portevin, Corneloup, Desruelles, Fotenilles
et la société anonyme d'éclairage et de chauffage
de Nice et Locht-Labye ne commercialise plus en France. D'autre
sociétés ne sentent pas inquietes par les menaces
come Bréguet et Mildé continuent à équiper
les réseaux de l'Etat; Reste Maiche et Journaux dans l'attente
du verdict du procès en cours.
Le 8 avril 1884 suite à une conre expertise pour examiner
la validité des brecets Edison, le rapport attribue un certain
nombre dedécouvertes de Edison, mais ne considère
comme contrefaits que les appareils saisis qui étaient munis
d'une bobine d'induction.
En attendant la fib du procès, de Branville en profita pour
fabriquer de u nouvel appareil poste micro téléphonique
sans bobine et toujours équipés de recepteurs et transmetteur
Bert et d'Arsonval, et aussi un plus petit modèle avec de
plus petits écouteurs surnommé "recepteur montre"
et suspendus par de petits anneaux ...
Il faudra attendre 1891 pour le procès de la SGT soit rejugé
en appel et qui contrdt le premier jugement, Locht-Labye et la société
de gaz de Nice se pourvoient en cassation.
Pour continuer à commercialiser ses appareils, de Branville
préfera négocier avec la SGT en reversant 5% de ses
ventes et en apposant sur une plaque fixée au téléphone
la mention " Licence concédée par la Scté
Gle des Téléphones pour les brevets Edison". |
En août 1883 d'Arsonval expose à
l'exposition internationale d'électricité de Vienne et
remporte un rand succès.
Le 12 juillet 1884 Adolphe Cochery
nomme d'Arsonval "Chevaler de la légion d'honneur".
Le 5 juillet 1884 C'est le colonel Brugère qui remet à
d'Arsonval les insignes de la légion d'honneur. A cette occasion,
Bruyère explique à d'Arsonval son souhait de perfectionner
les systèmes de communication employés par l'armée.
Avec De Branville, d'Arsonavl saisit l'opportunité et construisent
plusieurs appareils inventés par Sieur, Abdank et d'Arsonval
lui même pour répondre aux usages militaires :
- le parleur pour l'artillerie à microphone magnétique
à pôles concentrés. 1885 certificat d'addition au
brevet N° 148 598
- le poste téléphonique fixe : poste mural avec
le parleur pour microphone et deux écouteurs Teilloux. Ce poste
sera aussi proposé au public.
 

sommaire
Le transmeteur longue distance :
Suite aux essais décevants des éléphones Rysselberghe
(voir Belgique) pour la ligne Roue Le Havre,
de Branville est solliité par l'état pour fournir un appareil
pouvant fonctionner sur la ligne Paris Reims.
Pour ce il faut une bobine d'induction et la SGT en profite pour attaquer
en justie le ministère des P&T.
Ce modèle est équipé d'un commutateur de ligne
commandé par le crochet droite, d'un bouton d'appel et de deux
récepteurs à pôles concentriques.
 modèle mural 1885,
puis 1888 modèle mural 1885,
puis 1888
modèle de table 1885 et 1888  Bitéléphone 1891
Bitéléphone 1891 
Avec écouteurs d'Arsonval en fer à cheval, et version
"Bitélephone" avec écouteurs Mercadier,
version qui évoluera en 1888 pour fonctionner sur tous les réseaux
de l'Etat.
Le 30 novembre 1885 Bert et d'Arsonval sont invités
à l'inauguration de la ligne à grande distance Paris Reims,
l'administration ayant choisi les téléphone Ader et Bert&d'Arsonval.
Détails vus dans le livre "Le Montillot"
|
1888 Le transmetteur D’ARSONVAL

— Les trois prismes de charbon A, A,, D (fig. 39) sont boulonnés
sur la planchette de sapin XY. Entre ces trois prismes sont placés
quatre cylindres de charbon, tels que C, dont chacun est entouré
d’une enveloppe de tôle nickelée c. Les quatre
charbons cylindriques sont mobiles entre les prismes qui leur
servent de support; ils sont montés par deux en dérivation
et par deux en série.
Un aimant en fer à cheval NS est fixé sur le ressort
R. Cet aimant a pour objet de régler la mobilité
des charbons en agissant sur leur gaine de tôle c. Pour
cela, il faut que. suivant les besoins, on puisse augmenter ou
diminuer l'espace qui sépare l’aimant des cylindres
de char bon.
A cet effet, le ressort R qui supporte l’aimant NS est commandé
par une came excentrée B.
La came de réglage B est calée sur l’axe bb
qui se prolonge d’une face à l’autre de l'appareil
et qui est absolument indépendant de l’aimant NS.
D’un côté, son extrémité est filetée
et s’engage dans un écrou F fixé à l’ébénislerie
du transmetteur ; de l’autre, l’extrémité
b tra verse une pièce métallique E, également
fixée à l’ébénisterie ; mais,
sur la face opposée, b se termine par une tête de
vis masquée par une contre-vis Y, que l’on enlève
pour opérer le réglage.
Si, au moyen d’un tournevis, on fait avancer ou reculer d'un
pas de vis l’axe bb, ce qui ne déplace pas sensiblement
la came B dans le sens latéral, on fait exécuter
à cette came une révolution complète et,
en raison de son excentricité, on passe par toutes les
positions de réglage que le microphone est susceptible
de recevoir ; ce réglage peut se faire pendant la conversation.
— La clé d’appel, à double fil, se compose
de deux systèmes semblables à celui que représente
la figure 40.
Sur la plaque d’ébonite E, fixée à la
partie supé rieure GG du boîtier, sont adaptés
trois plots A, B, C ; l’autre face de la clé présente
une disposition identique.
Dans chacun de ces deux groupes, le plot C représente le
massif de la clé, A est le plot de repos, B le plot de
travail.
Sur le bouton-poussoir P, sont montés deux ressorts parallèles
r, r,, frottant l’un sur le groupe de plots CBA antérieur,
l’autre sur le groupe postérieur. Ces deux ressorts
sont isolés l’un de l’autre par la pièce
d’ébonite E, ; leur extrémité rK n’abandonne
jamais les plots C ; mais l’extrémité r passe
des plots A sur les plots B, lorsqu’on appuie sur le bouton
P. Ce dernier est ramené à sa position de repos
par le ressort R. Les écrous F, F, F, servent à
attacher les fils de com¬ munication ; il en existe également
trois sur le groupe postérieur, qui n’a pas été
représenté.
— Dans la figure 41 le levier-commutateur est
vu en dessus.
C’est une tige métallique AB qui pivote autour de la
vis à centre V. Cette tige porte cinq ressorts : a communique
avec AB, b et c sont accouplés et isolés de AB par
la lame d’ébo¬ nite f\dete sont également
accouplés et isolés de AB par la lame d’ébonite
. En regard de ces ressorts, sont disposés des plots que
la figure 41 représente en plan et en élévation.
Les plots H, J, sont composés chacun de deux blocs métalliques
montés sur ébonite : g, h pour le plot II, i, j pour
le plot J. Le plot K est entièrement en métal. Le
plot M comprend trois blocs métalliques l, m, n, montés
sur ébonite.
L'axe du levier AB supporte la prise de communication N ; le ressort
antagoniste est accroché en G sur le levier lui-même.
Lorsque le crochet mobile est a avec g , b avec î , c avec
A, d et e avec l. Lorsque le crochet est relevé pour la conversation,
a est appuyé sur h, b sur j, c sur k, d sur m, e sur n.
— La figure 42 montre le diagramme des
communications intérieures; elles y sont représentées
vues par la face postérieure de l’appareil, comme
lorsqu’on démonte celui-ci ; les bornes sont donc
retournées, et le crochet mobile dirigé vers
la droite.
Pour permettre de voir clairement les communications, le levier-commutateur
a été figuré en plan ; il est dans la
position de conversation ; de même, les ressorts de
la clé d’appel ont été placés
verticalement, bien qu’ils soient horizontaux.
La communication L,N est un toron de fils de cuivre qui traverse
le ressort antagoniste, formé par un long ressort à
boudin.
Dans la position d’appel, les plots j, h , m, n sont
isolés ; les ressorts d, e, sont appuyés, sur
le plot l, mais sans communication électrique.
Les courants d'appel venant de la ligne passent par
L1 ... S1 , sonnerie,. S2 ... L2
Pour repondre, on appuie sur le bouton-poussoir P ; les ressorls
r1, r2 abandonnent les- plots s1, s2 et prennent contact avec
les plots p1, p2, tout en restant en relation avec les plots
u1, ti2. Le courant de la pile CS, ZS va sur la ligne par
CS, L2 ... p2, fait fonctionner la sonnerie du correspondant
et revient a ZS par L2, A, c, b, i, â2, r2, p2.
Pendant la conversation, le circuit primaire est ferme par
: pile microphonique, CM ... z1, enroulement primaire de la
bobine BL, y1,, ZM. Le circuit secondaire est constitue
par L,, N, a, A, recepteur R2, Z3, c2, enroulement secondaire
de la bobine B1 ...L2, ligne, poste du correspondant.
On voit que, dans la position d'appel, l'independance absolue
des circuits est assuree. Le circuit primaire etant isole
en m et en n, le circuit secondaire en j et en h. Pendant
que le poste recoit l'appel, sa pile est isolee enp
p1 rt p.2 ; lorsqu'il repond, sa sonnerie est isolee
en s1, et s2. L'independance est egalement obtenue pendant
la conversation; il est facile de reconnaitre, en effet, que
le circuit primaire est completement separe des deux autres
; quant au circuit dfappel, il est isole en 1{ et p.2
pour la pile, et en f, g pour la sonnerie. |
 |
— Le modèle mural et le modèle
portatif, construits par la maison L. Digeon
et Cie (France), sont absolument identiques sous le rapport
du système d’appel et du mécanisme de commutation.
— L’appareil portatif n’est, en quelque sorte, qu’un
transmetteur mural monté sur colonne. Les modèles
plus récents sont équipés de recepteurs Aubry.
Enfin, en 1889, D'Arsonval perfectionnait
le récepteur du téléphone BELL de telle façon
que — sous le nom de « téléphone
magnétique à pôles concentriques »
— son invention méritait alors au Congrès de
Southampton, du célèbre électricien anglais
M. PREECE, l'éloge suivant :
M. d'Arsonval a, de son côté,
perfectionné le récepteur BELL. Il placé
la bobine dans un puissant champ magnétique de forme annulaire,
de façon à concentrer sur elle les lignes de force,
La bobine induite est noyée entièrement dans le
champ magnétique. Les effets sont considérablement
augmentés. L'augmentation de l'ampleur de la voix ne s'accompagne
nullement de la perte d'articulation, comme cela a lieu d'ordinaire,
la parole est reproduite sans aucun changement du timbre,
D'après l’éminent directeur
du post-office de Londres, cet appareil était le seul transmettant
avec une parfaite netteté les consonnances si variées
du the anglais.
Ce modèle de récepteur fut d’ailleurs à
son tour adopté exclusivement sur les réseaux téléphoniques
de l'Etat et pour les postes destinés à notre artillerie,
et reçut différentes formes et différentes
dimensions, suivant la destination.
|
Fin 1888, c'est la réussite, la France compte
10 837 abonnés sur 16 réseaux gérés par
'Etat et 11 réseaux gérés par la SGT.
Janvier 1889 la SGT est décalrée mal fondée en
ses demandes, elle fait aussitôt appel, mais entre temps tout
le monde peut proposer des téléphones avec des micros
à charbon et de bobine d'induction. De Branville peut commercialiser
librement ses appareils, c'est le début de la fortune pour d'Arsonval
agé de 37 ans.
2 Septembre 1889 c'est la nationalisation du téléphone,
l'Etat prend possession de tous les éseaux de la SGT, de Branville
fait agtéer 3 autre modèles : un modèle Sieur et
deux d'Arsonval.
En 1892 , d'Arsonval pour échapper au versement
de 5% sur ses ventes à la SGT, fabrique un nouveau modèle
de micropone et dépose le brevet le 11 octbre 1892 pour un "microphone
à réglage électro-magnétique".
La partie mcrophone est la même mais la fixation de l'aimant est
différente et donne droit à un nouveau brevet non attaqué
par la SGT.
1893 Modèles avec écouteurs Aubry
  Micro
1893 Micro
1893
C'est en 1893que Louis Digeon
succède à de Branville et d'Arsonval lui propose de revisiter
le sytle de ses appareils, et construit deux nouveaux modèles.
Ces deux modèles pour les réseaux urbains, avec le microphone
à réglage magnétique connaissent 30 ans de succès
et renforcent la fortune d'Arsonval. Le modèle sur pied très
élégant, est vendu un peut plus cher que le mural.
l’organe magnétique du récepteur
Aubry est un aimant circulaire dont
les pôles convergent vers le centre.   
Sur chacun de ces pôles est vissé un noyau de fer doux
qui supporte une bobine de 100 ohms. Les deux bobines, montées
en série, ont une résistance de 200 ohms. Cet ensemble
est assujetti sur une plaque métallique dite membrane porte-aimant
; elle est percée de deux trous pour laisser passer les deux
extrémités du fil de la bobine qui vont rejoindre les
bornes extérieures, isolées du boîtier métallique.
La plaque vibrante, en tôle étamée, a 61 mm de diamètre
et 0,32 mm d’épaisseur. Le couvercle est muni d’un
pavillon en ébonite.
Ce récepteur est construit par la maison L.
Digeon et Cie .
En 1901 ce sera Gérard Mambret qui reprendra la suite de fabrication
de ces modèles.
sommaire
Divers documents :
La Nature du 10 mars 1883 NOUVELLES RECHERCHES TÉLÉPHONIQUES
ET MICROPHONIQUES
|
ÉTUDES SUR LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE
DES CONTACTS EN CHARBON, PAR M. SHELFORD BIDWELL. — BATTERIES
TÉLÉPHONIQUES DE M. JAMES MOSER. — NOUVEAU
RÉCEPTEUR MAGNÉTO-ÉLECTRIQUE DE M. D’ARSONVAL.
Peu après l’apparition du téléphone
de Bell, du transmetteur à charbon d’Edison et du
microphone de Hughes, qui constituent trois inventions réelles
et de premier ordre, surgirent un nombre incalculable d'appareils
semblables, pour ne pas dire identiques, à ces créations
originales, et les téléphones et microphones de
MM. X, Y, Z, se comptèrent bientôt par centaines.
C’est là un phénomène naturel, qui se
retrouve à chaque invention nouvelle qui réussit,
soit dans le domaine scientifique, soit dans le domaine industriel;
c’est en quelque sorte la sanction obligée du succès.
Heureusement qu’à côté des nombreux inventeurs
du lendemain, des inventeurs de seconde main, pourrait-on dire,
se trouvent quelques travailleurs modestes qui savent rendre hommage
à l’invention originale et s’occupent seulement
de la perfectionner sans exagérer outre mesure le mérite
de leurs travaux : les uns en étudiant scientifiquement
le mécanisme des phénomènes jusque dans les
plus petits détails, en faisant varier tous les éléments
du problème pour bien connaître l’influence
de chacun d’eux, les autres en perfectionnant les dispositions
et la construction des appareils pour les amener à l’état
pratique, multiplier leurs applications, et résoudre les
nouveaux problèmes posés chaque jour par le développement
de ces applications.
C’est à quelques recherches et à quelques appareils
de cette nature que nous voulons consacrer aujourd’hui une
place dans La Nature.
Occupons-nous d’abord des transmetteurs microphoniques. Depuis
Edison et Hughes, les innombrables transmetteurs à pile
construits par les inventeurs sont constitués par des contacts
en charbon, variables dans leurs dispositions, leur nombre et
leur groupement.
Quelles tentatives faites avec des contacts métalliques,
des poudres semi-conductrices, n’ont pas donné de
résultats bien brillants et n’ont pas, jusqu’à
présent, reçu d'applications. M. Shelford Bidwell
a étudié le phénomène dans tous ses
détails, et il vient de présenter le résultat
de ses recherches à la Société Royale de
Londres en janvier dernier.
Ses expériences ont eu pour but de déterminer quantitativement
l’influence des variations de pression et des variations
de courant sur la résistance des contacts en charbon et
des contacts métalliques. Ne pouvant reproduire ce travail
in ertenso, nous signalerons ici les résultats de ces recherches,
tels que M. Shelford Bidwell les a résumés dans
sa communication.
1° Contacts en charbon.
Les changements de pression produisent, des variations de résistance
proportionnellement plus grandes lorsque la pression est petite
que lorsqu’elle est grande. Les variations de résistance
sont relativement plus grandes, avec des courants faibles qu’avec
des courants puissants. Les changements d’intensité
du courant produisent proportionnellement de plus grands changements
de résistance avec de faibles courants et des pressions
légères qu’avec des courants intenses et de
grandes pressions. Lorsque la résistance d’un contact
en charbon a été diminuée par une augmentation
de pression, elle reprend très approximativement sa première
valeur lorsque cette pression cesse.
Le passage d’un courant dont l'intensité ne dépasse
pas une certaine limite dépendant de la pression produit
une diminution de la résistance d’autant plus grande
que le courant est plus intense. Lorsque le courant dépasse
une certaine limite, la résistance du contact est alors
augmentée d’une manière permanente, et d’une
quantité d’autant plus grande que la pression est
elle-même plus grande. A moins de dispositions spéciales
qui maintiennent le courant constant, la diminution de résistance
qui résulte de l’augmentation de pression est plus
grande que celle due à l’augmentation dépréssion
seule; elle est due aussi en partie à l’augmentation
d’intensité du courant. Il n’est pas prouvé
que la diminution de résistance qui est la conséquence
d’une augmentation de courant, puisse être attribuée
à l’effet de la température.
2° Contacts métalliques.
Dans le cas du bismuth, et probablement aussi dans le cas d’autres
métaux, la résistance est d’autant plus grande,
pour une pression donnée, que le courant est plus faible.
Une augmentation de courant est accompagnée d’une
diminution de résistance, et si le courant est ramené
à son intensité première, la résistance
varie peu et ne reprend sa première valeur dans aucun cas.
Une augmentation de pression produit une plus grande diminution
de résistance avec des pressions faibles qu’avec de
grandes pressions, et avec de faibles courants qu’avec des
courants intenses. La résistance affaiblie par une augmentation
de pression ne reprend pas sa valeur première lorsque l’excès
de pression est enlevé. La manière si différente
dont se comportent les contacts métalliques et les contacts
en charbon sous l’action des variations de pression et de
courant expliquent parfaitement la supériorité
de ces derniers et leur emploi exclusif dans les transmel- leurs
microphoniques aujourd’hui en usage. Les principes si simples
mis en lumière par les expériences méthodiques
de M. Shelford Bidwell permettront de grouper plus scientifiquement
et plus rationnellement qu’on ne l’a fait jusqu’ici,
les contacts multiples pour les placer dans les meilleures conditions
de fonctionnement et utiliser le mieux possible leurs variations
de résistance dans chaque cas particulier, suivant la nature
de la source électrique, celle des sons à transmettre
et la longueur de la ligne, éléments qui influent
dans une si grande mesure sur les variations de résistance
des contacts et sur l’intensité du courant qui les
traverse.
On se rappelle les expériences d’auditions théâtrales
téléphoniques faites par M. Clément Ader
a l’Exposition d’électricité de 1881,
expériences qui furent, sans contredit, le plus grand succès
de cette Exposition. La transmission s’effectuait à
l’aide de 10 transmetteurs Acier, et
de 10 lignes doubles (20 fils), dans 80 récepteurs Ader,
ce qui permettait de faire écouter quarante personnes à
la fois. M. James Moser s’est proposé d’augmenter
le nombre d’appareils récepteurs et de diminuer le
nombre de lignes et il est arrivé au résultat suivant
: transmettre la parole et la musique à cent téléphones
à la fois à l’aide d'une simple ligne.
Les expériences ont eu lieu l’automne dernier entre
l'Hlippodrome et le bureau de la Société internationale
des téléphones, place Vendôme. M. James Moser
a obtenu ce résultat en construisant de véritables
batteries de transmetteurs, de bobines induites et de téléphones
récepteurs dont il fait varier à volonté
le nombre et le groupement, suivant la nature de la ligne, le
nombre de récepteurs, etc. Le diagramme ci-contre (tig.
1) montre comment étaient groupés les ap- pareils
dans les expériences faites entre l'Hip- podrome et la
place Vendôme. 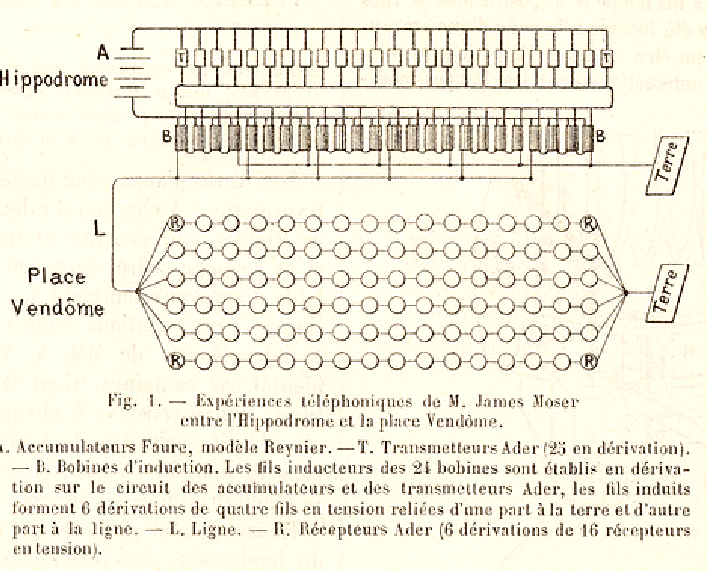
Fig. I. — Expériences téléphoniques
de M. James Moser entre l’Hippodrome et la place Vendôme.
A. Accumulateurs Faure, modèle Reynier.
—T. Transmetteurs Ader (25 en dérivation). — B.
Bobines d’induction. Les fils inducteurs des 24 bobines sont
établis en dérivation sur le circuit des accumulateurs
et des transmetteurs Ader, les fils induits forment 6 dérivations
de quatre fils en tension reliées d’une part à
la terre et d’autre part à la ligue. — L. Ligne.
— R. Récepteurs Ader (6 dérivations de 16 récepteurs
en tension).
La source électrique se composait d’accumulateurs
Faure, modèle Reynier, dont on pouvait faire varier le
nombre à volonté à l’aide d'un commutateur
; les transmetteurs étaient du système Ader, au
nombre de 25, et montés en dérivation. Sur le diagramme,
les transmetteurs T sont représentés l’un à
côté de l’autre, mais, en pratique, ils étaient
disposés en cinq rangées verticales de cinq appareils,
sur une planche d’environ 1 mètre
de côté placée au-dessus de l’orchestre
de l’Hippodrome dans une position un peu inclinée.
Chaque transmetteur Ader se compose de 10 crayons disposés
en deux séries en tension de b charbons en quantité,
c’est-à-dire 20 contacts par transmetteur (4 en tension,
5 en quantité), soit en tout 000 contacts en charbon influencés
simultanément et synchroniquement par les vibrations. Le
circuit des accumulateurs et des 25 transmetteurs était
fermé sur les fils inducteurs de 24 bobines d’induction
identiques à celles employées par la Société
générale des téléphones, montées
en quantité. Le courant total dans le circuit inducteur
était de 24 ampères, soit 1 ampère par bobine
et l ampère environ par transmetteur Ader. Les 24 fils
induits des 24 bobines d’induction étaient groupés
en 6 dérivations de 4 bobines en tension et reliés,
d’une part à la terre, d’autre part à
la ligne unique qui établissait la communication entre
l’Hippodrome et le bureau de la place Vendôme, en passant
par le bureau central de la rue Neuve-des-Petits-Champs. Les 93
téléphones récepteurs Ader étaient
groupés en 6 dérivations renfermant chacune 16 appareils
en tension.
Le montage de tous les transmetteurs en quantité est dicté
par cette considération, démontrée théoriquement
et expérimentalement par M. J. Moser, que les variations
du courant inducteur, et par suite celles du courant induit, sont
proportionnelles à l’intensité du courant qu’on
a intérêt à rendre le plus grand possible,
sans cependant dépasser pour chaque contact microphonique,
une certaine intensité au-dessus de laquelle il se produit
des étincelles et des crachements. Un courant d’un
ampère par transmetteur Ader correspond à 1 /5 d’ampère
par contact, ce qui est une bonne moyenne pour les transmetteurs
de ce type. Nous ferons remarquer, en passant, que M. James Moser
est arrivé, par une voie et des considérations toutes
différentes et d’une manière tout à
fait indépendante, à mettre en pratique les principes
posés par les expériences de M. Shelford Bidwell
sur les contacts microphoniques. Pour le groupement des bobines
induites et des récepteurs, on serait conduit, d’une
part, à monter tous les appareils en tension, pour diminuer
l’influence de la résistance de la ligne, et, d’autre
part, à faire au contraire un montage en quantité
pour marcher à des tensions peu élevées qui
réduisent l’influence des fuites ou dérivations
et des effets électrostatiques. En pratique, on choisit
une disposition intermédiaire appropriée à
la nature de la ligne sur laquelle doit s’effectuer la transmission.
Le même système a permis à M. J. Moser de
téléphoner entre Paris et Nancy sur une ligne aérienne
de 350 kilomètres de longueur, mais en groupant les bobines
induites d’une manière un peu différente :
trois dérivations seulement renfermant chacune 8 bobines
en tension et 2 téléphones Goloubitzky en tension
au poste récepteur. Dans le premier cas, les effets d’induction
dus à l’action des lignes extérieures sont,
non pas détruits, mais affaiblis dans une grande mesure,
parce que l’intensité de ces courants induits n’est
qu’une fraction très petite comparée à
celle des courants qui agissent effectivement sur les récepteurs
et qui proviennent du transmetteur multiple employé par
M. Moser.
 Fig. 2. — Téléphone magnéto-électrique
de.M, d’Arsonval.
Fig. 2. — Téléphone magnéto-électrique
de.M, d’Arsonval.
Dans le cas de la ligne aérienne
de Paris à Nancy, avec deux récepteurs, l’induction
ne peut être vaincue que par l’emploi d’un double
fil.
Les récepteurs téléphoniques ont aussi reçu
quelques perfectionnements pendant ces derniers temps. Parmi ces
perfectionnements, nous devons signaler ceux que M. d'Arsonval
a apportés aux récepteurs magnéto-électriques,
et qui l’ont conduit à faire construire par M. Leczensky
l’appareil représenté ligure 2.
M. d’Arsonval reconnaît que l’expérience
a montré que le principe du téléphone Bell
devait être conservé, mais qu’on pouvait néanmoins
apporter à cet admirable instrument certaines modifications
de nature à en augmenter les effets et en faciliter la
construction.
Le téléphone de M. d’Arsonval n’a pas
d’autre prétention que de présenter quelques-unes
de ces modifications.
Lorsqu'un fil, traversé par un courant ondulatoire ou interrompu,
est placé dans le voisinage d’un aimant, son action
sur le champ magnétique est d’autant plus grande que
le fil est placé dans une partie où le champ magnétique
est plus intense. On obtiendra le maximum d’effet en noyant
complètement le fil dans le champ magnétique et
en rapprochant les pôles le plus possible pour augmenter
l’intensité du champ dans la partie où se trouve
le fil. Pour arriver à ce résultat, et placer tout
le fil dans la partie où le champ est le plus intense,
M. d’Arsonval a pensé à faire un champ magnétique
annulaire, comme dans les électro-aimants de Nicklès,
en prenant pour centre un des pôles de l’aimant tandis
que l’autre pôle vient l’envelopper circulairement
: la bobine est placée dans l’espace annulaire ainsi
ménagé entre les deux pôles, comme le représente
la figure 2.
La boîte qui supporte le diaphragme est simplement pincée
entre l’aimant et le noyau central; il suffit de visser l’embouchure
pour fixer la plaque vibrante. Deux cordons souples amènent
le courant à la bobine, sans que l’appareil présente
aucune borne extérieure.
Le téléphone complet ne pèse que 350 grammes
et présente autant de puissance qu’un Gower dont le
poids est beaucoup plus grand ; il transmet très nettement
la parole sans en altérer sensiblement le timbre, à
cause des faibles dimensions de la plaque vibrante.
En le munissant d’un pavillon, on l’entend dans toute
une salle, à la condition, bien entendu, de faire usage
de transmetteurs à pile.
Ajoutons que M. Leczensky construit aussi des téléphones
d’Arsonval avec de l’acier comprimé de M. Clémandot.
Comme cet acier comprimé peut s’aimanter sans être
trempé, et que la trempe a souvent pour effet de déformer
les pièces qui la reçoivent, il en résulte
que les téléphones en acier comprimé sont
susceptibles d’un meilleur ajustement que les mêmes
appareils en acier trempé ordinaire. Tel qu’il est
construit, le récepteur d’Arsonval est très
maniable, très simple et très portatif, qualités
qui contribueront sans aucun doute à multiplier le nombre
de ses applications.
E. Hospitalier
|
En pdf, la publication : EXPOSÉ
DES TITRES ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES DU Dr. D’ARSONVAL,
PARIS 1894 :
en vue de l’élection de A. d’Arsonval à l’Académie
des Sciences (Section de Médecine et Chirurgie) et de sa nomination
de professeur de la Chaire de médecine au Collège de France
en remplacement de M. Brown-Séquard.
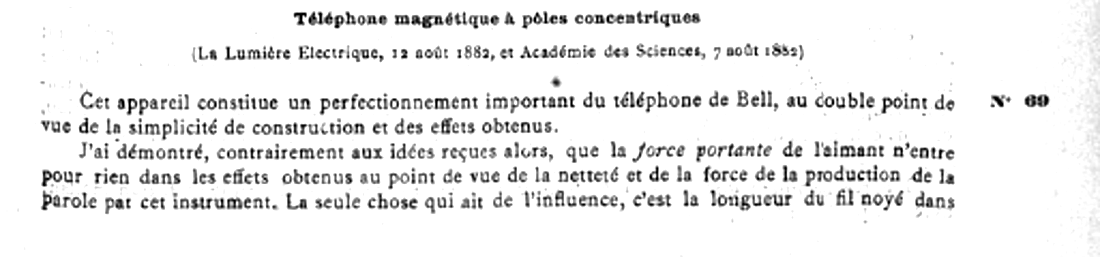
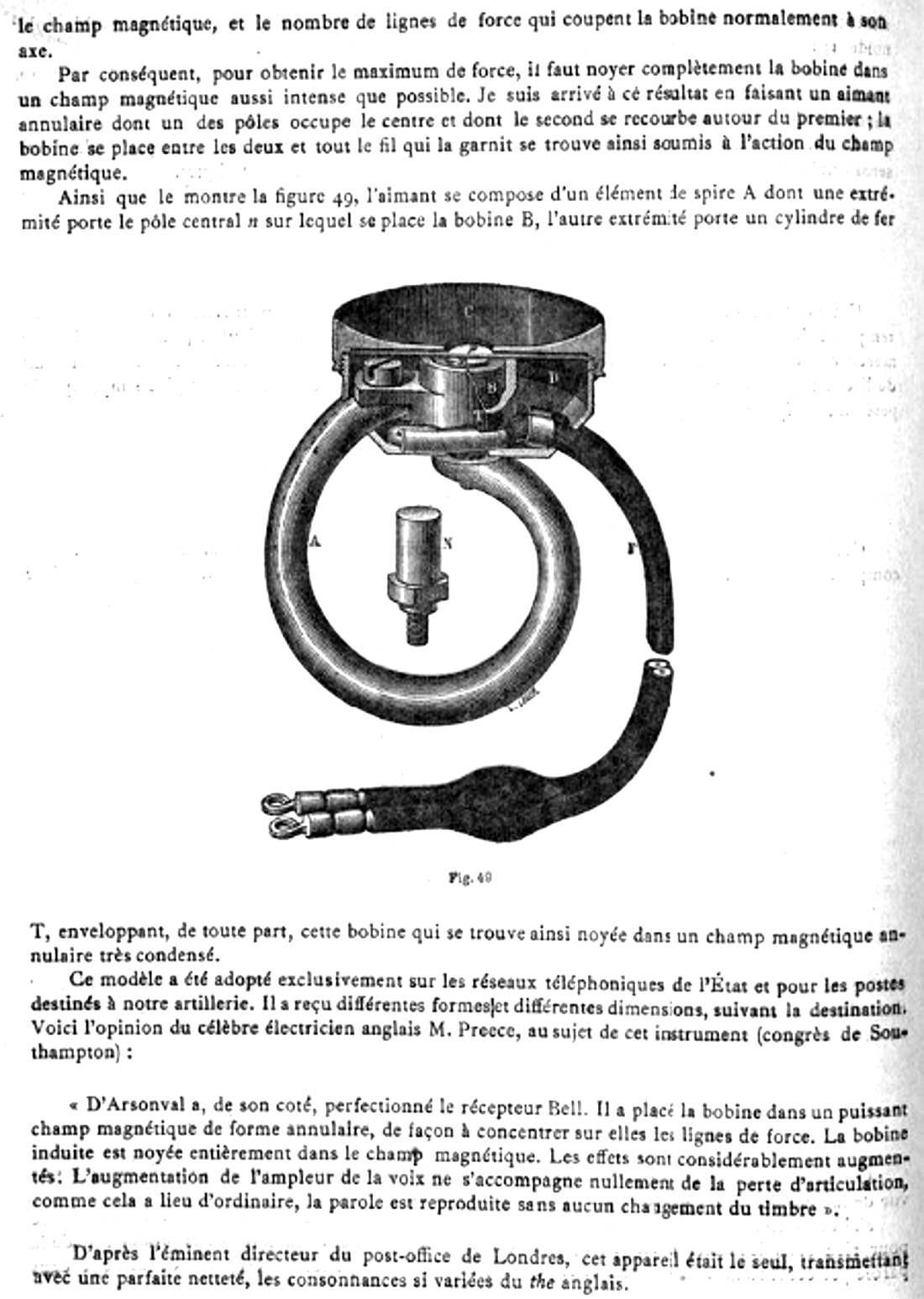
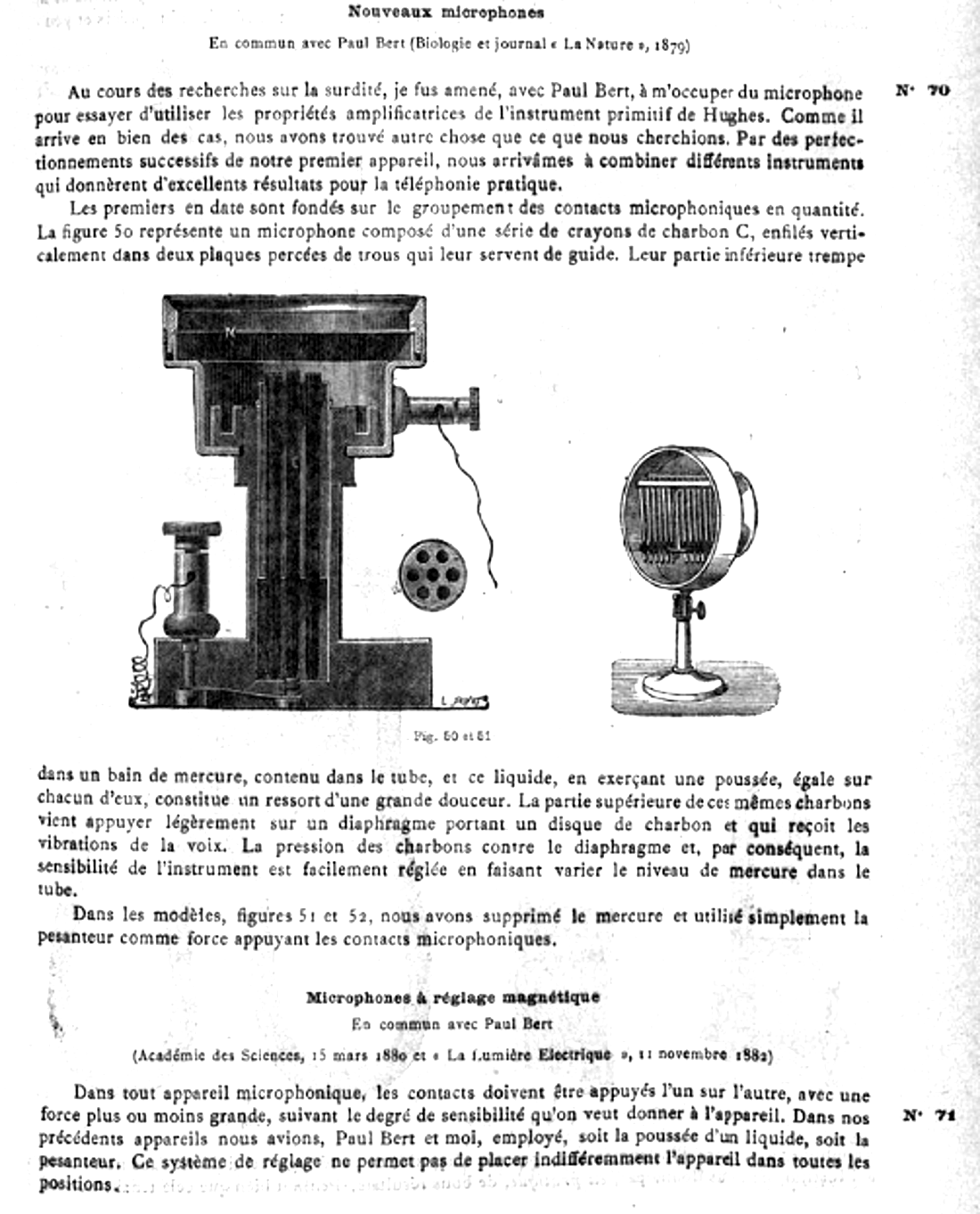
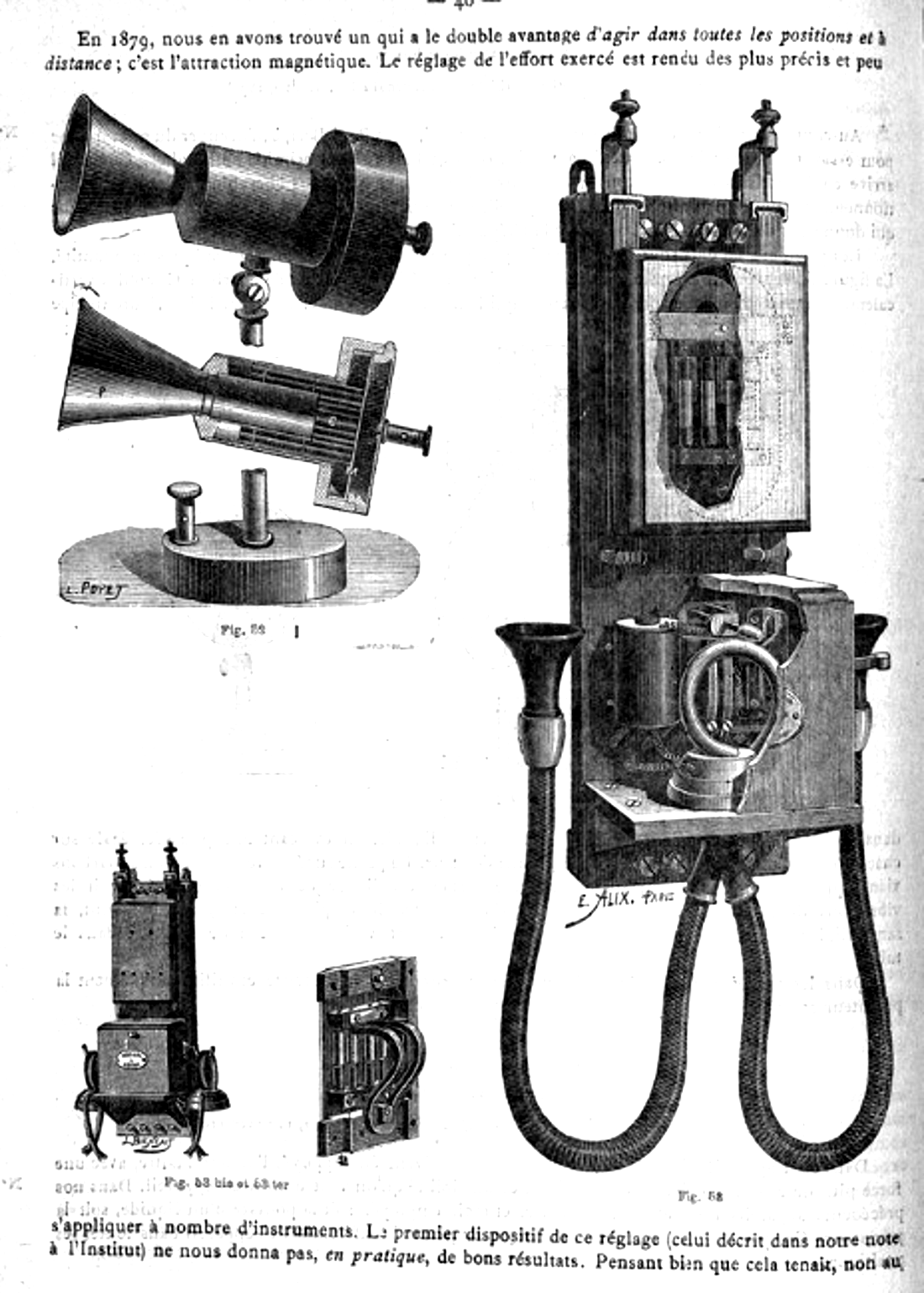
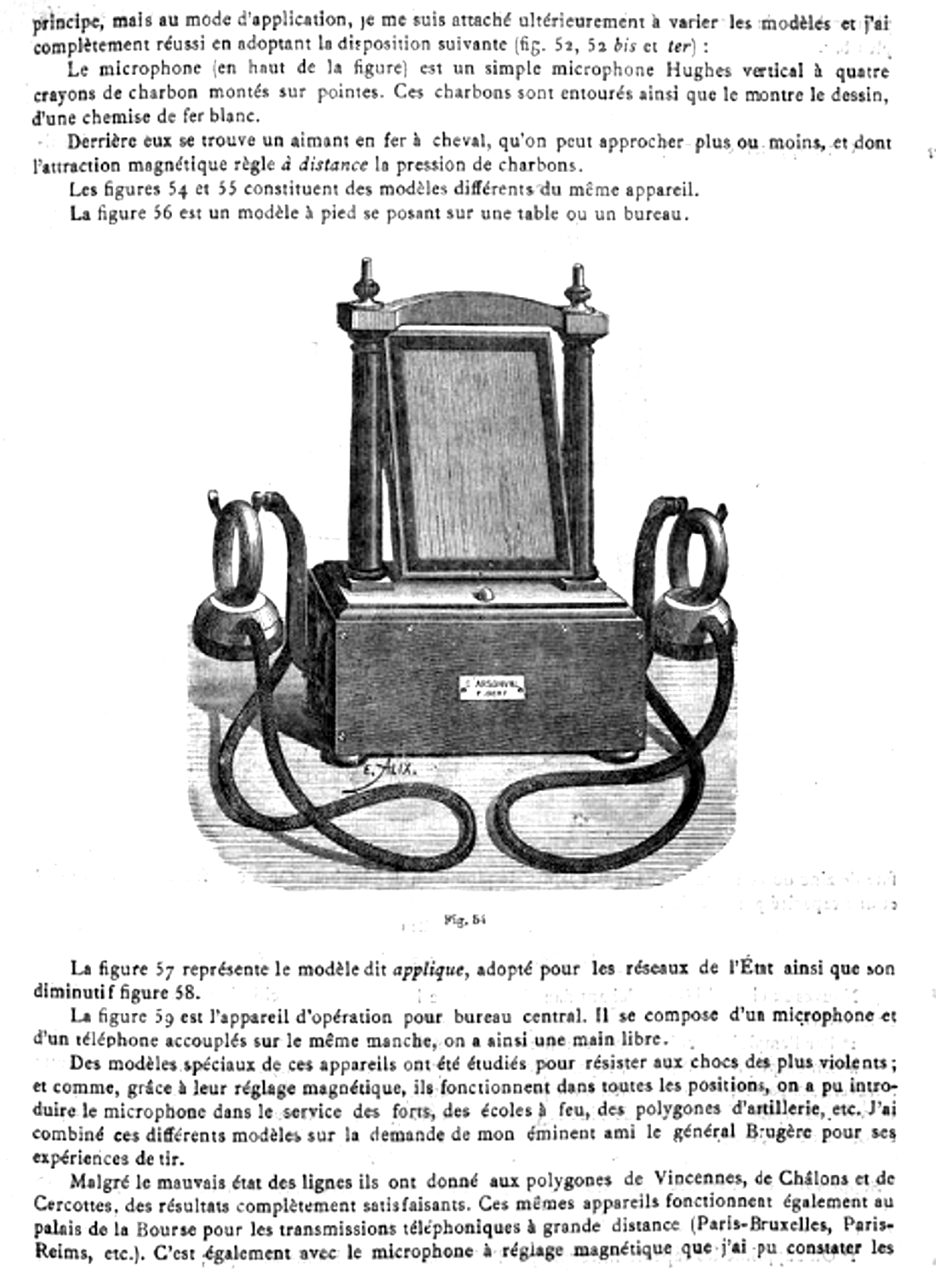
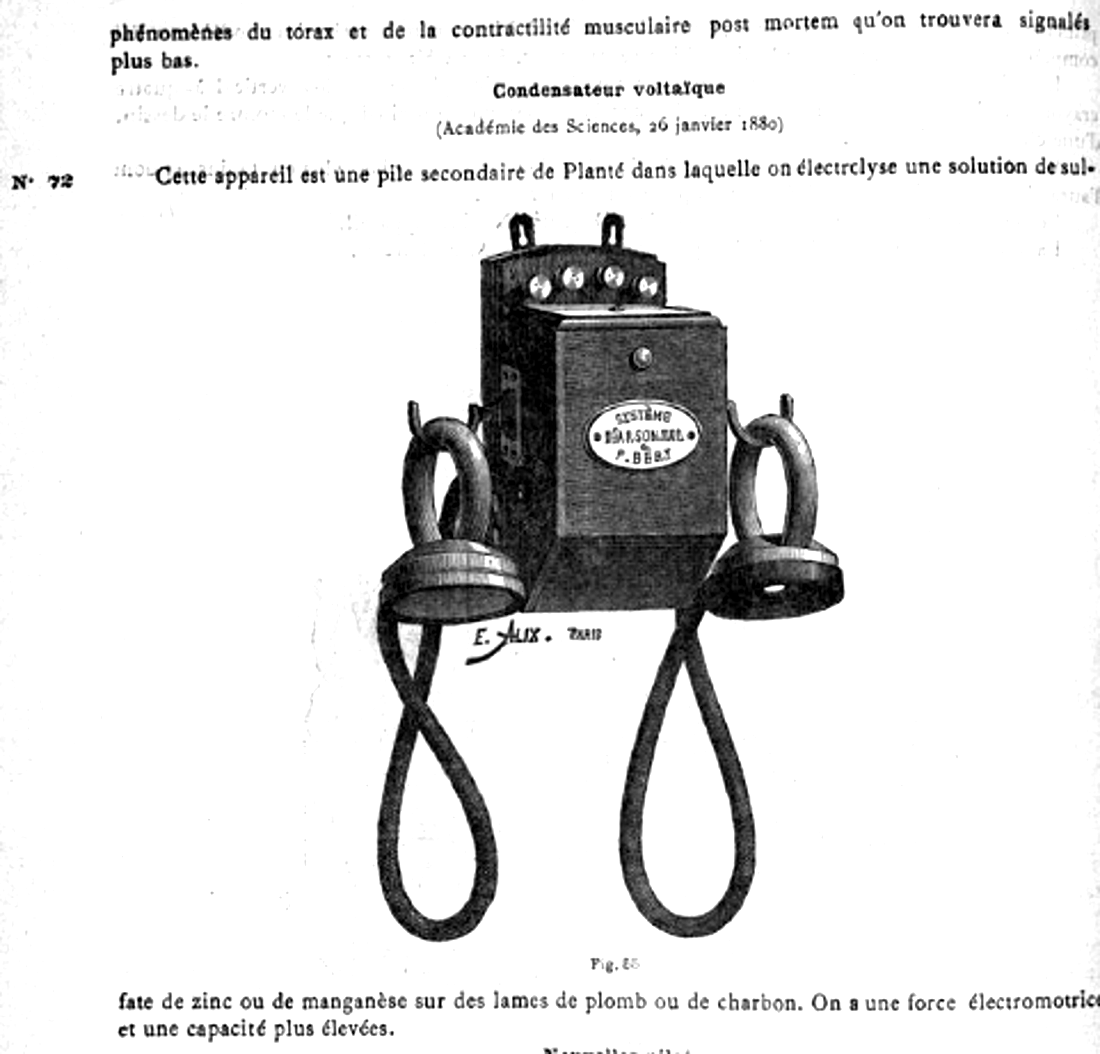
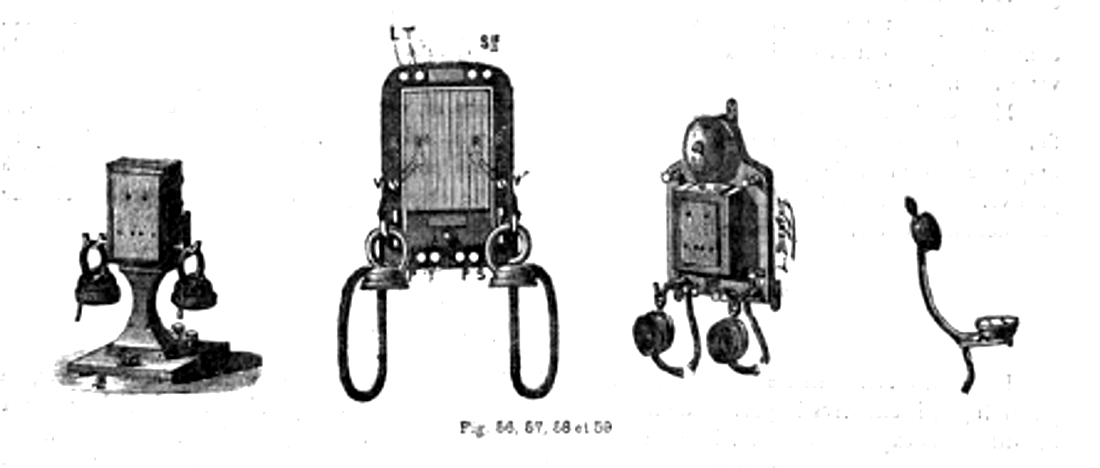
sommaire
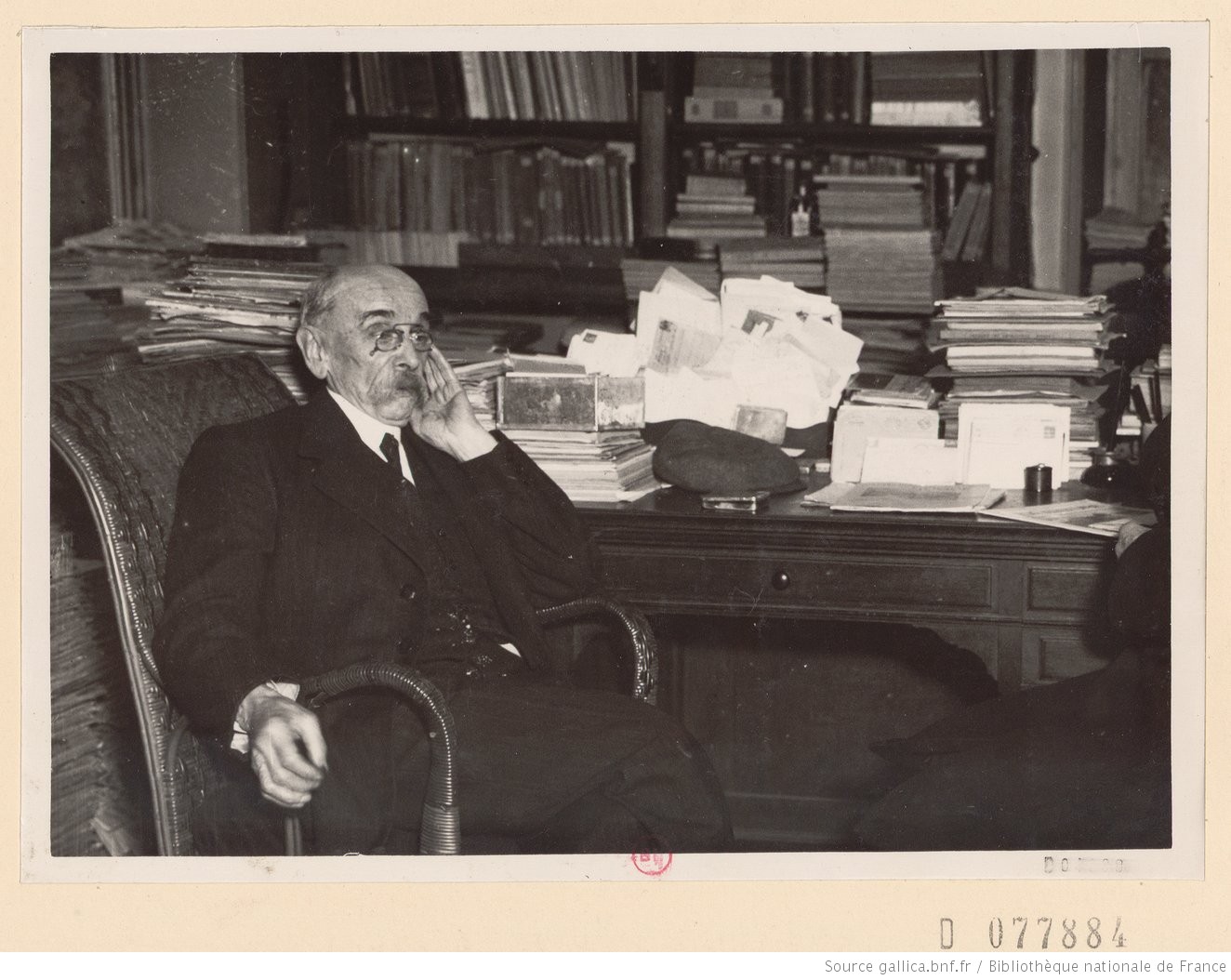 En 1940 Arsène d'Arsonval décede à l'âge de
89 ans.
En 1940 Arsène d'Arsonval décede à l'âge de
89 ans.
1951 la France célébre le centenaire de la naissance
d'Arsonval dans un hommage de René Sudre publié dans
la Revue des Deux Mondes |
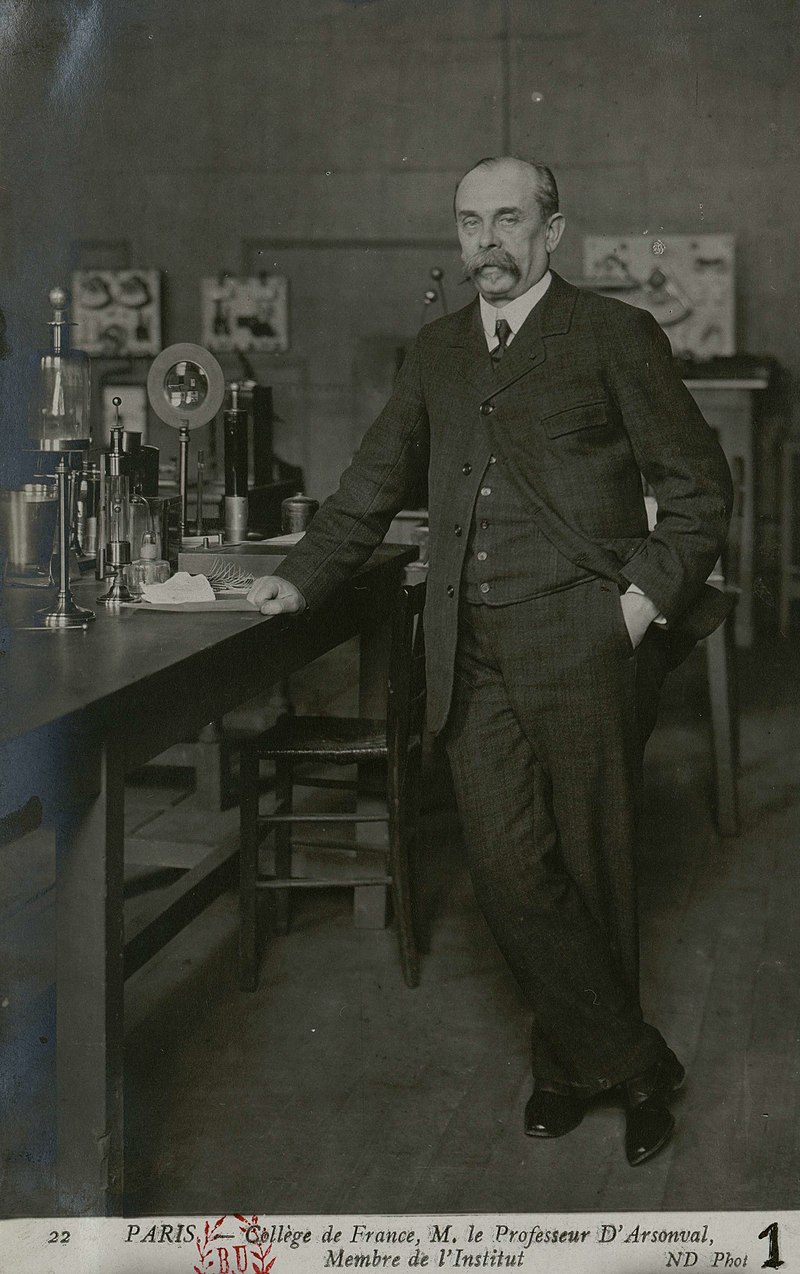
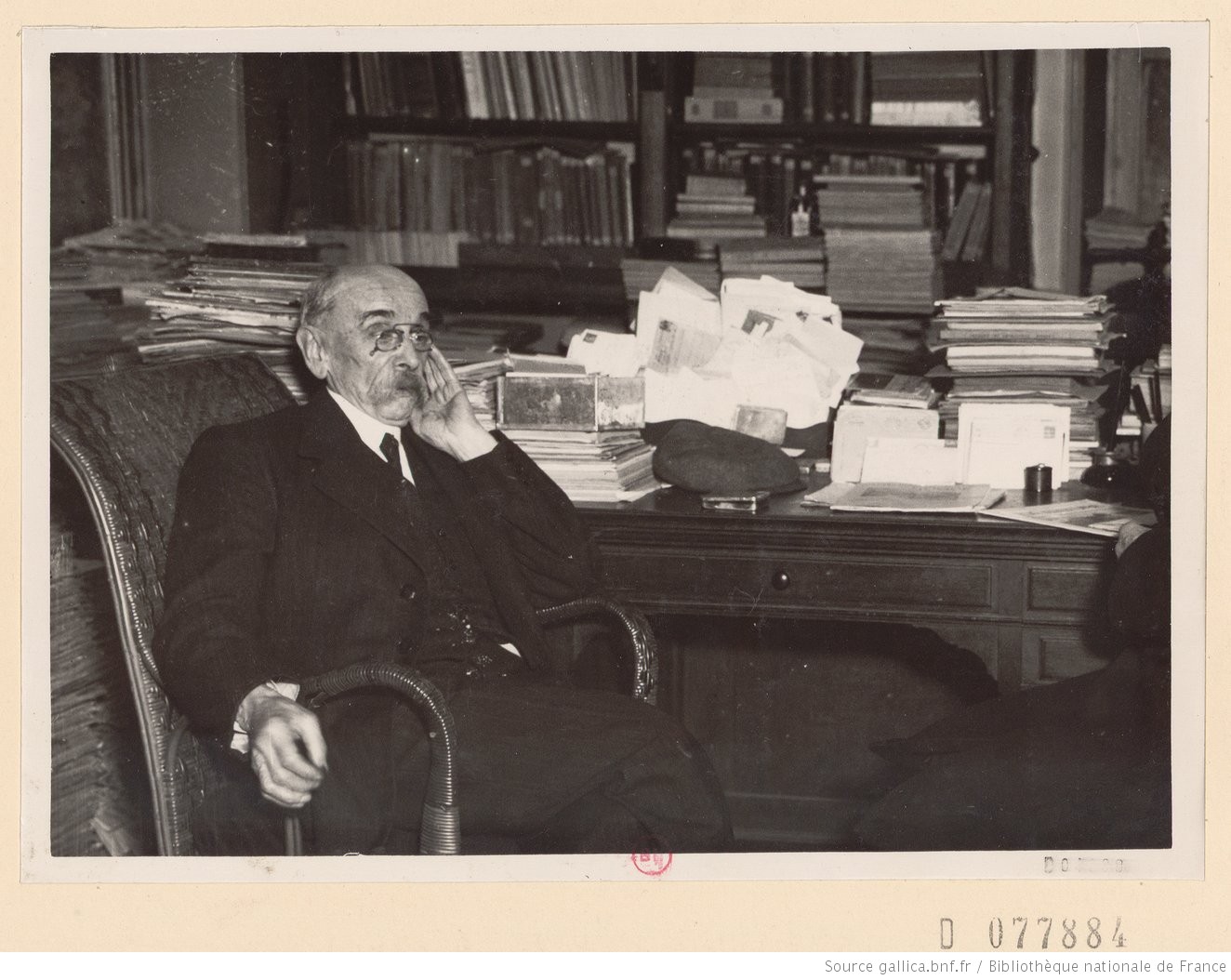 En 1940 Arsène d'Arsonval décede à l'âge de
89 ans.
En 1940 Arsène d'Arsonval décede à l'âge de
89 ans.

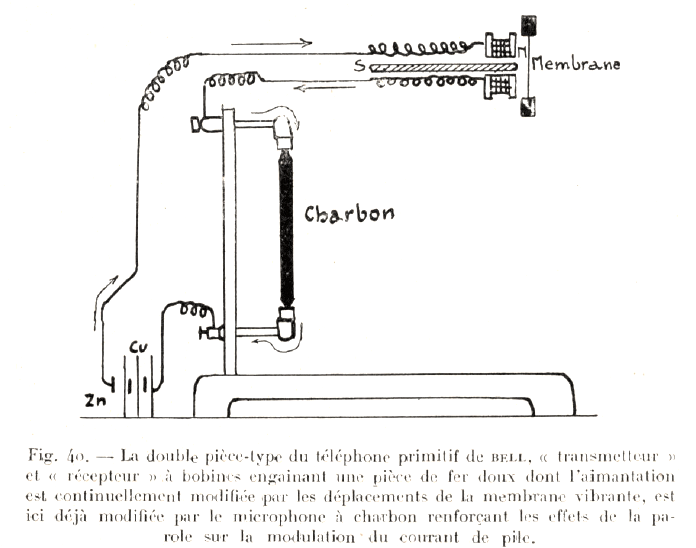
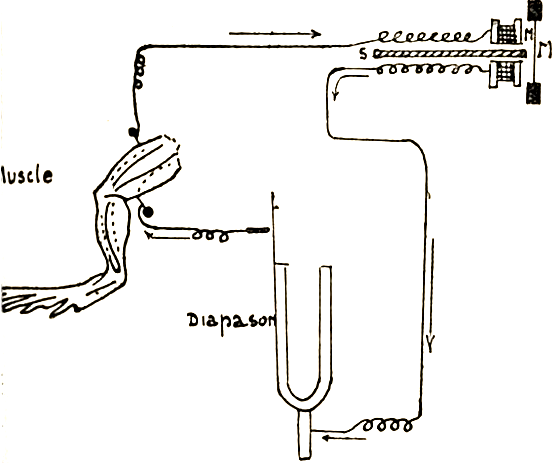

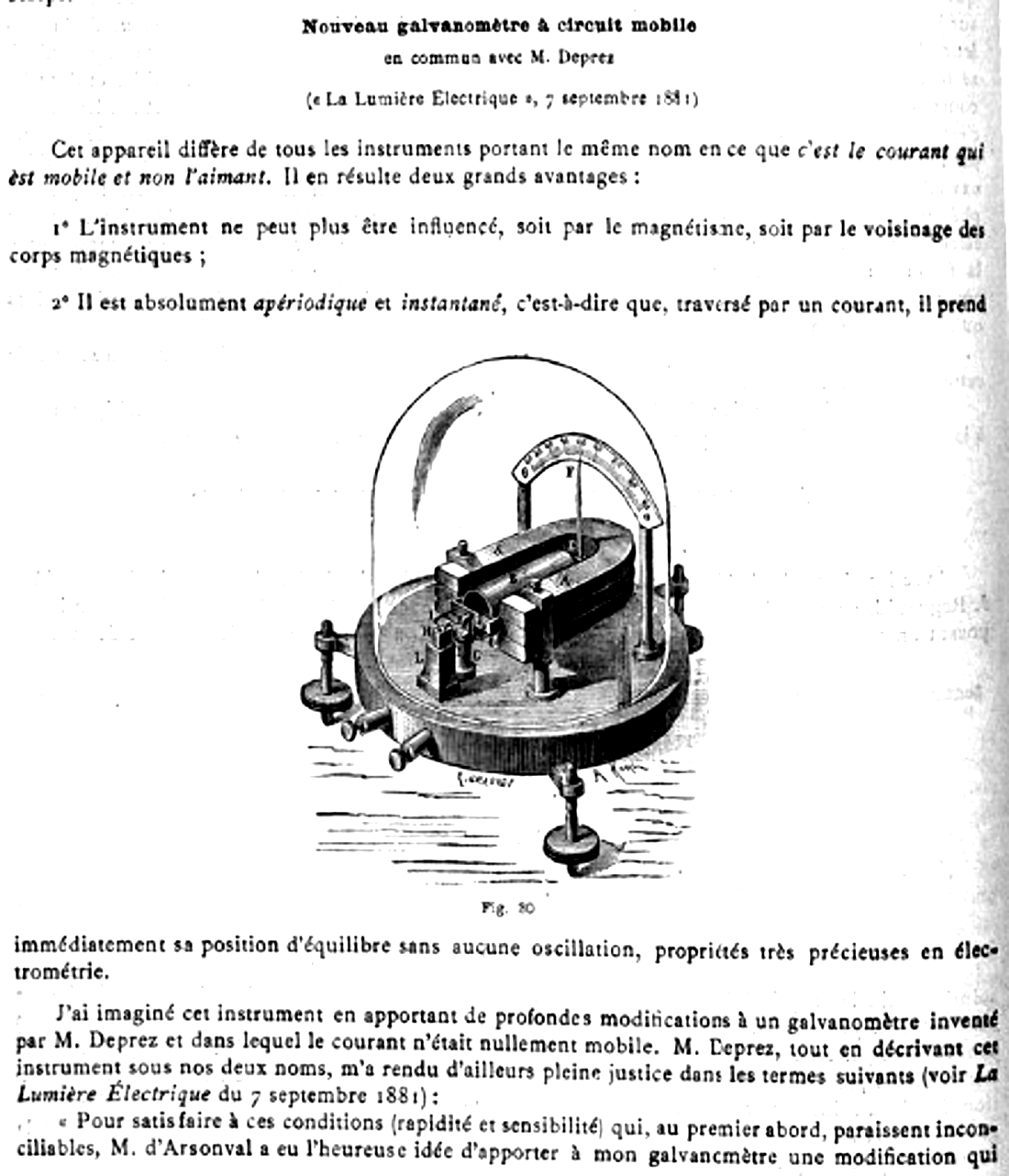

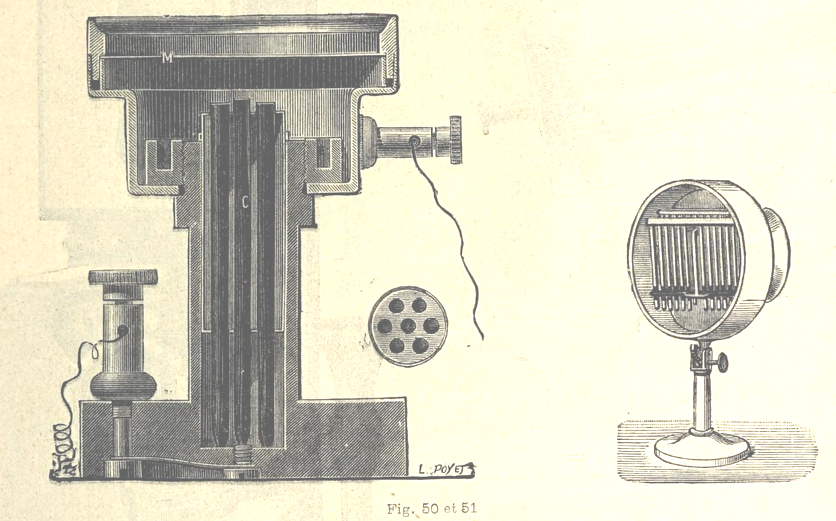



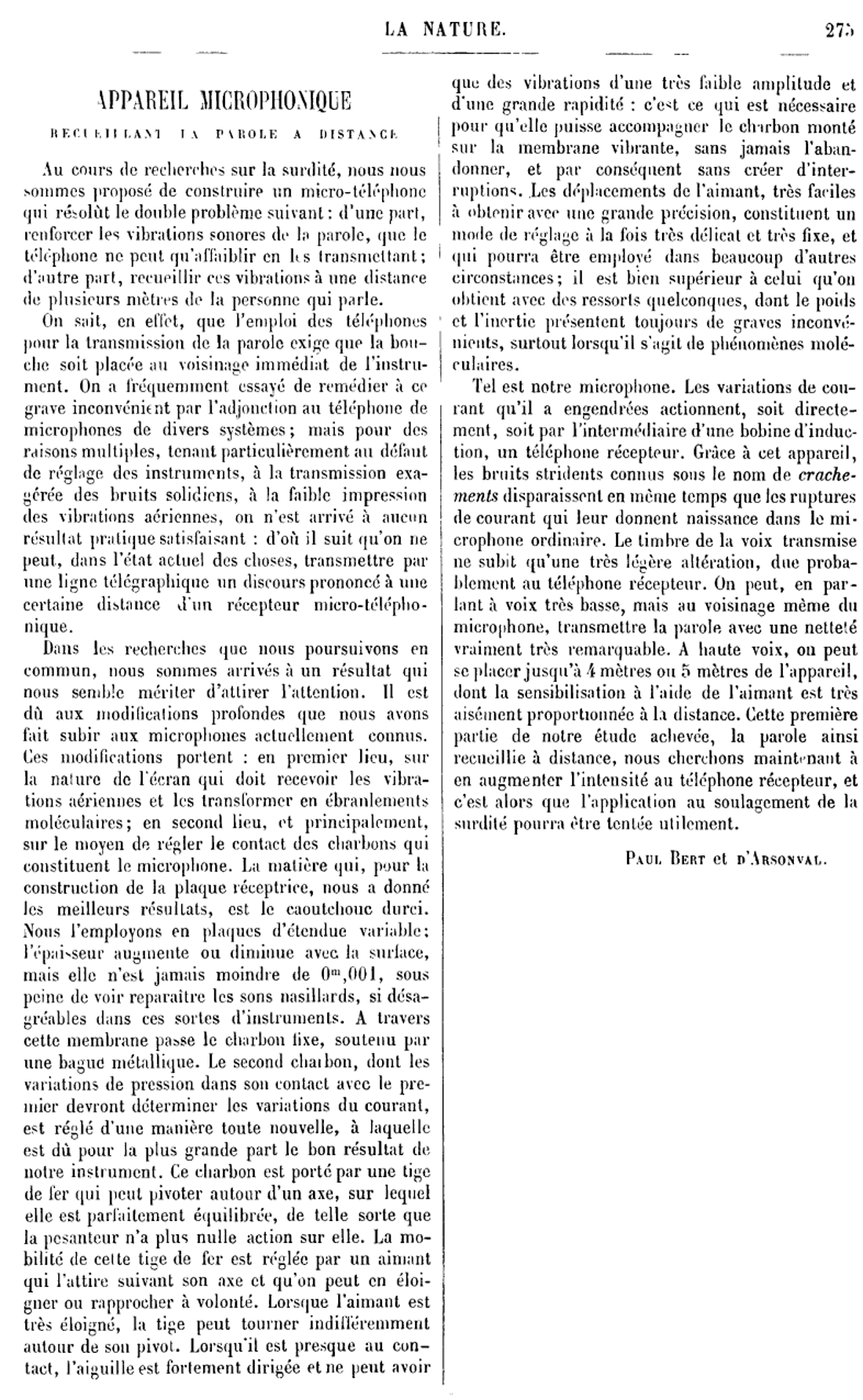
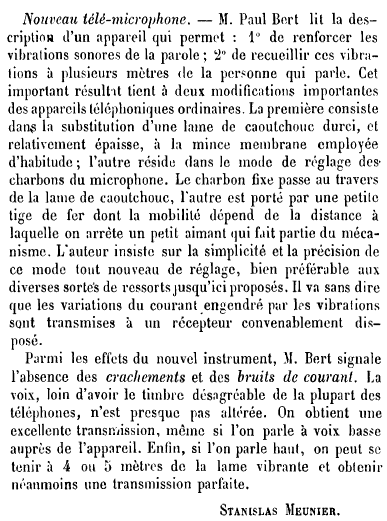
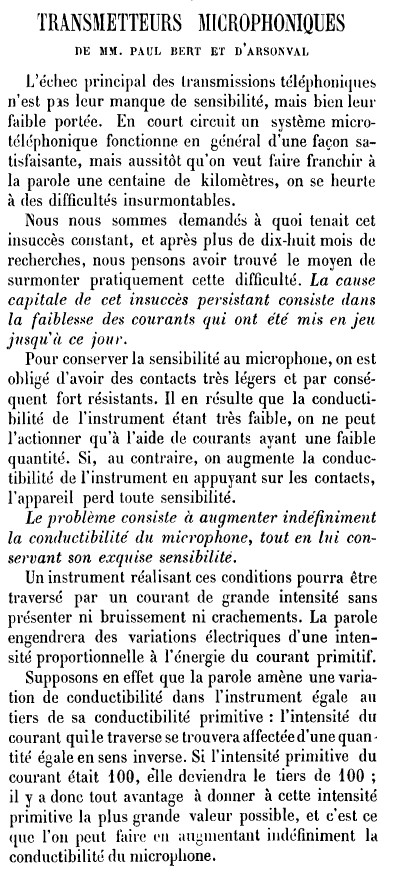
 Premier modèle 1881
Premier modèle 1881
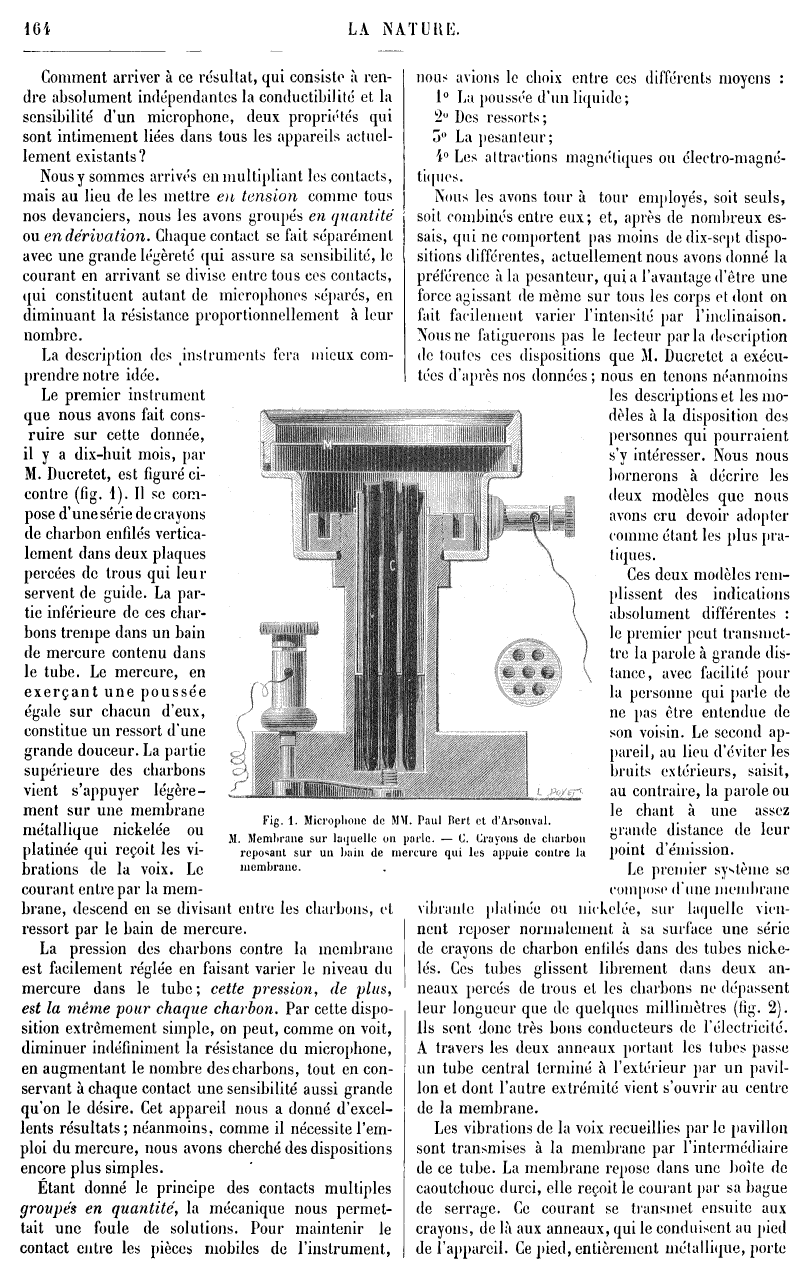
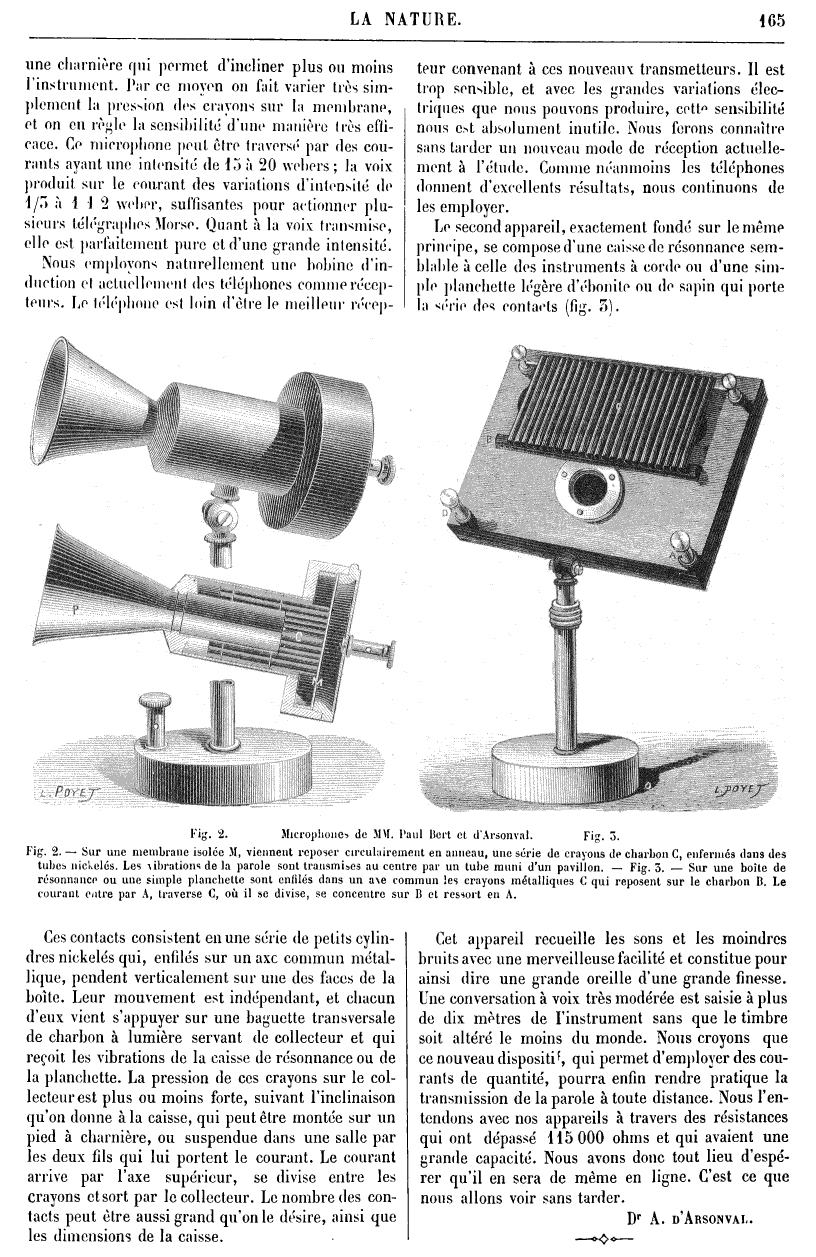

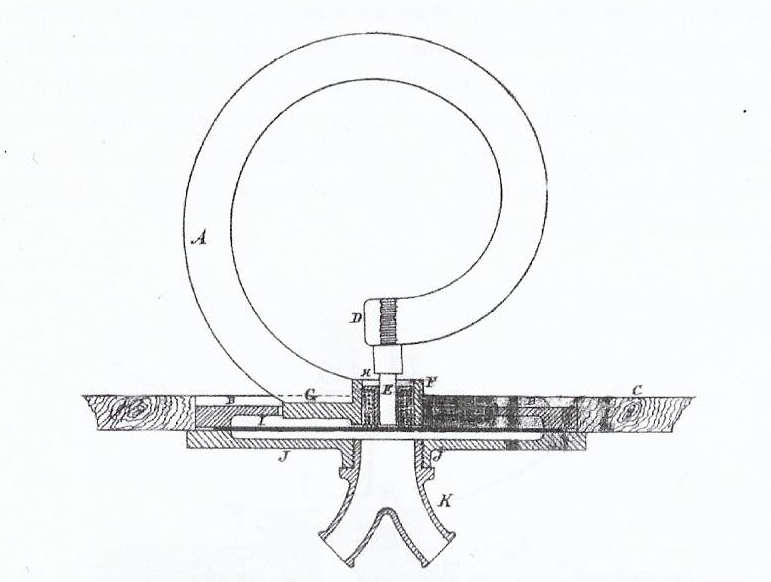 l'appareil est solidaire
de la planche de fond en bois. Une douille vient se viser sur
la tablette pour le branchement des tubes acoustiques. C'est une
solution simple et économique et restera en option sur
d'autres modèles bien que les tubes acoustiqus soient très
peu utilisés à cette époque.
l'appareil est solidaire
de la planche de fond en bois. Une douille vient se viser sur
la tablette pour le branchement des tubes acoustiques. C'est une
solution simple et économique et restera en option sur
d'autres modèles bien que les tubes acoustiqus soient très
peu utilisés à cette époque.





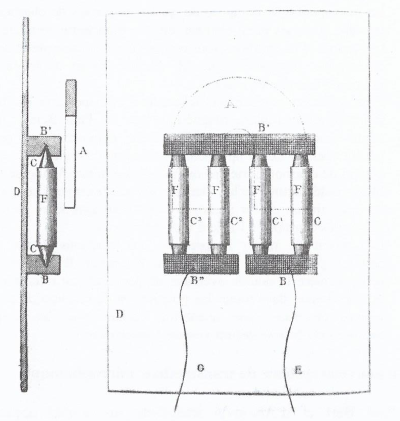
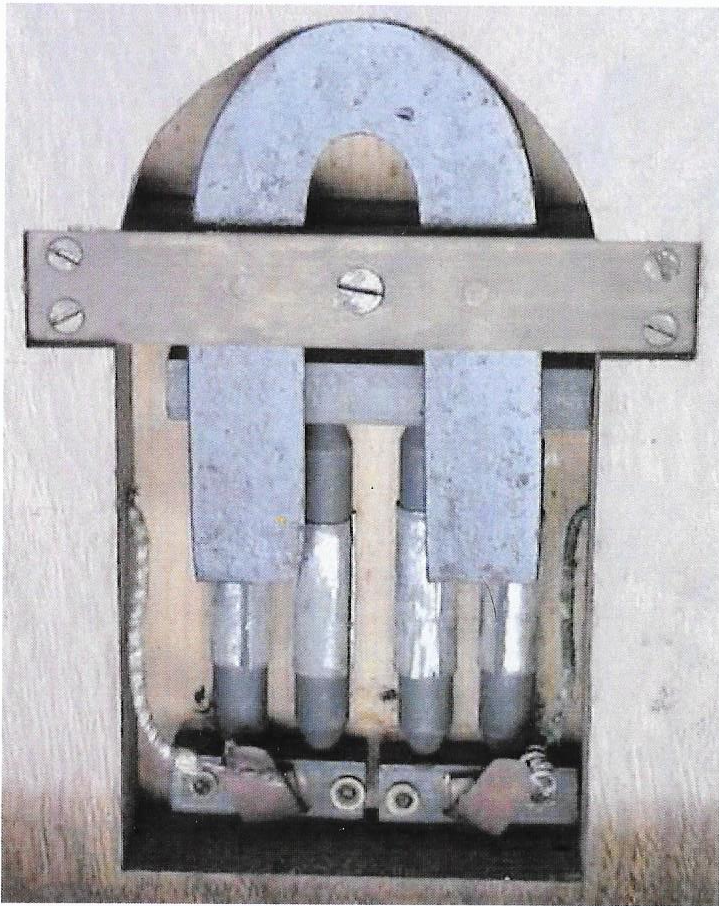
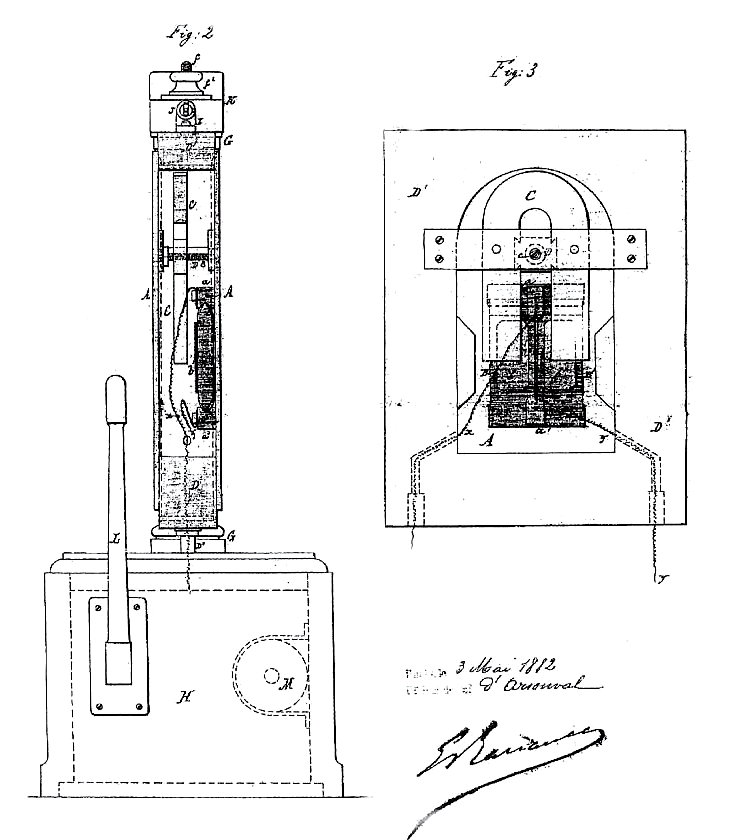
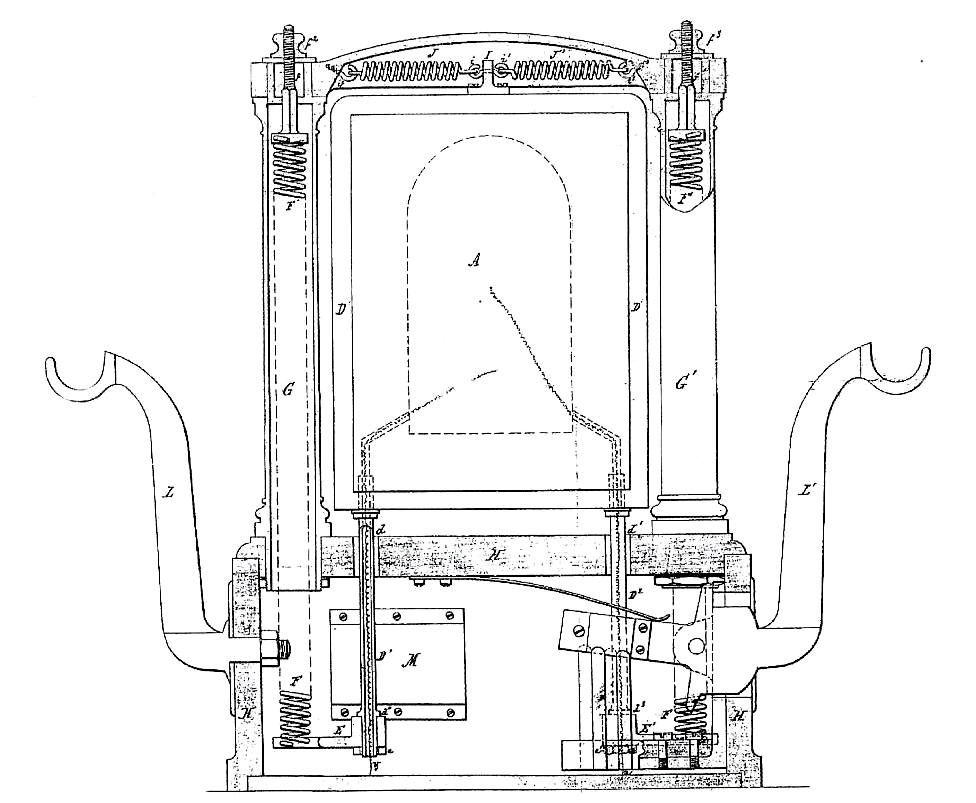
 ,
N° 11 De Branville 1882-1883
,
N° 11 De Branville 1882-1883


 Il est
encore muni d'un écouteur interne posé sur le fond
en bois et la pièce métallique filletée pour
raccorder le Y des tubes acoustiques (il a été trouvé
sans le Y et les tubes acoustiques).
Il est
encore muni d'un écouteur interne posé sur le fond
en bois et la pièce métallique filletée pour
raccorder le Y des tubes acoustiques (il a été trouvé
sans le Y et les tubes acoustiques).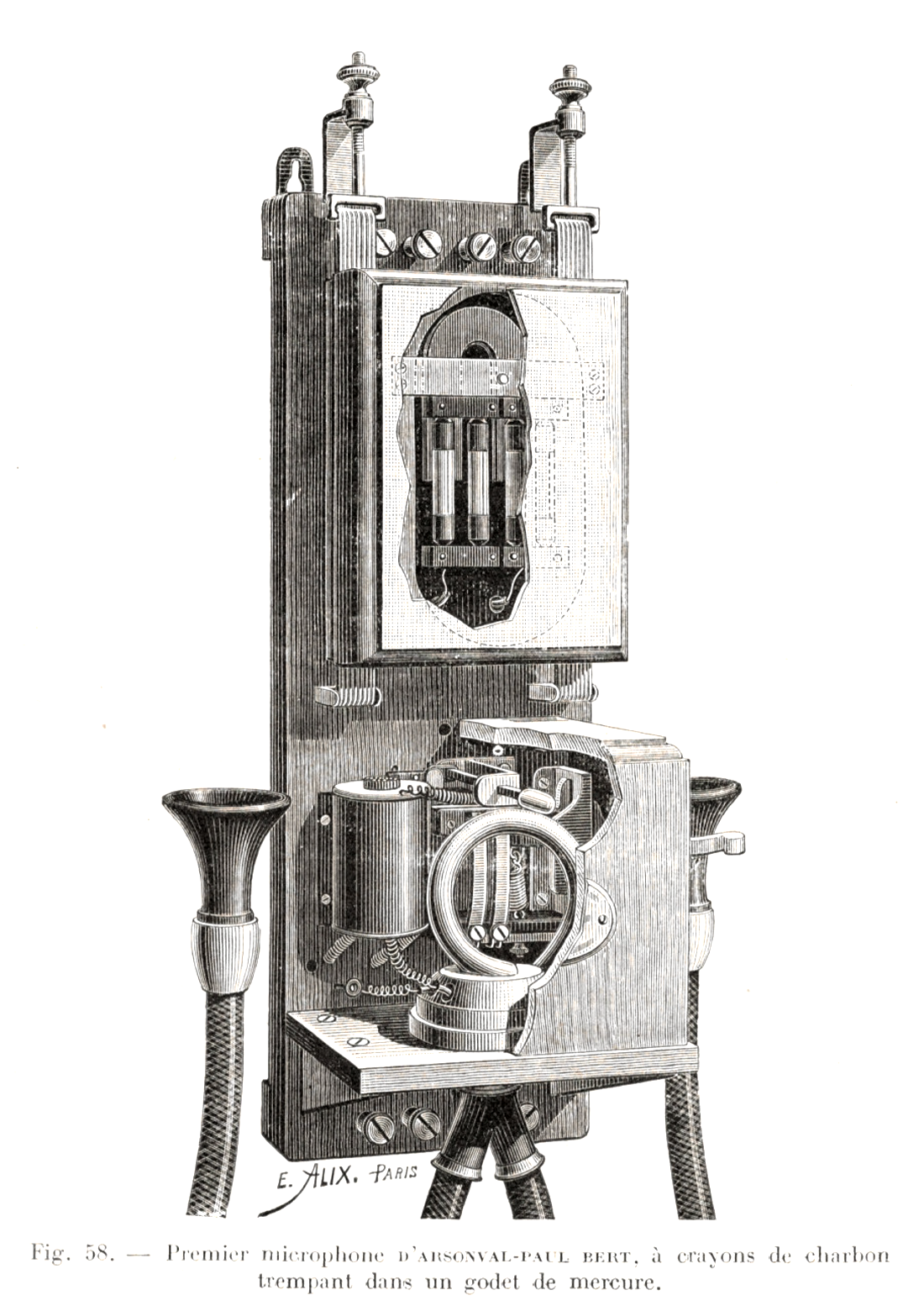










 modèle mural 1885,
puis 1888
modèle mural 1885,
puis 1888