BTMC
Bell Telephone Manufacturing Company et
ATEA Ateliers de Téléphone et Electricité
Anversoise
L'industrie téléphonique d'Anvers
Des que les résultats obtenus avec les premières installations téléphoniques
établies dans les Etats-Unis d'Amérique en 1878, eurent démontré
la possibilité d'une exploitation commerciale de l'invention de Graham
Bell, ses compatriotes pensèrent transporter ces entreprises
en Europe.
Mr F. R. Welles de New-York, connaissant
la réputation de l'industrie beige et l'avantageuse situation géographique
de la ville d'Anvers conçut le projet de fonder dans la métropole
belge une Société s'occupant exclusivement de la fabrication des appareils
téléphoniques.
Il parvint a faire partager ses vues par quelques uns de nos concitoyens
et notamment par Mr le Sénateur Van den Nest et Mr A. Mols.
A cette époque la Téléphonie était tout a fait a ses débuts : il n'existait
que quelques modestes réseaux téléphoniques en Europe, et la construction
des téléphones y était tout a fait rudimentaire.
Les projets de Mr Welles allaient bientôt changer la situation et
donner à cette industrie une impulsion considérable.
 |
La National Bell Telephone Company a été fondée
en Écosse par Graham Bell en 1877.
C'est en 1879, que Gardiner Hubbard de la Bell
Telephone Company de Boston, beau-père d' Alexander
Graham Bell est venu en Europe pour promouvoir les ventes
de ses équipements téléphoniques. Au cours de sa tournée du
continent, le gouvernement belge lui a offert les plus grandes
incitations financières pour établir le siège d'une filiale
européenne en Belgique. En 1880, l'American Bell Telephone Company
s'est séparée de l'entreprise National Bell Telephone Company.
Hubbard est l'un des fondateurs et premier président
de la Bell Telephone Company
IBTC.
Etablie à Anvers, l’IBTC avait pour objet de
diffuser le téléphone en Europe.
Dès 1880, trois sociétés privées
avaient entrepris d’établir et d’exploiter
les premiers réseaux téléphoniques en Belgique
: la Société générale
de téléphonie de Belgique, la Compagnie
belge du téléphone (fondées
toutes deux en 1880), et surtout l’international Bell Telephone
Company-IBTC.
En 1880, elle constitua quatre filiales qui couvraient les réseaux
d’Anvers, de Bruxelles, de Liège et de Verviers.
A ces filiales, l’IBTC apportait essentiellement ses capacités
technologiques ; l’essentiel des apports financiers provenait
d’investisseurs belges. IBTC a démarré des usines de fabrication
subsidiaires dans les grandes villes de toute l'Europe, car
les politiques nationalistes favorisaient les fabricants locaux.
|

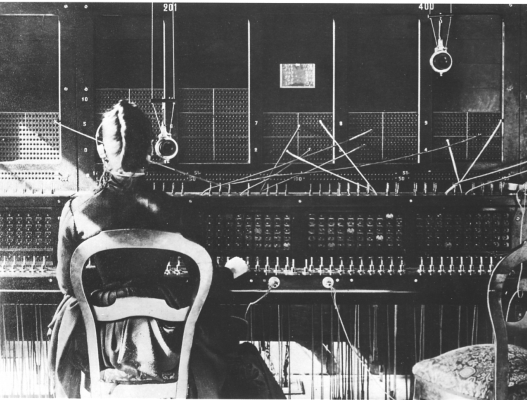
Arrvée des fils au centre téléphonique d'Anvers. Opératrice
devant le Multiple (standard téléphonique)
A cette date la Belgique ne comptait que 2000 abonnés au téléphone.
À cette époque, les gouvernements n'avaient pas pris
le temps d'administrer les systèmes téléphoniques. Même en Europe,
les compagnies de téléphone étaient exploitées comme des entreprises
privées. L'inconvénient était que, à mesure que la demande augmentait,
Bell ne disposait pas de fonds suffisants pour étendre ses réseaux
téléphoniques au rythme requis. Lorsque des capitaux supplémentaires
étaient nécessaires, WE Western
Electric a acheté toutes les actions détenues par Bell Telephone.
Vers 1880 dans la région de Bruges, avec l'aide de son
ami Jean-Louis Lescouwier de Bikschote, E.
Christiaen fabrique un microphone à barres de charbon,
muni d'une plaque réglable devant lequel on parle. Les boiseries
ont été réalisées par le menuisier de
Passendaal Louis Germonprez. Le premier test a été effectué
entre la maison de M. Christiaen et celle de son domestique Jules
Vantournout, située dans la Molenstraat, à 150 mètres.
Les deux appareils étaient reliés par un conduit avec
des isolateurs fixés aux maisons. Le résultat fut étonnant.
Les inventeurs ont établi une liaison d'essai entre les gares
de Roulers et de Passendale-Moorslede, le tout premier appel téléphonique
sur une si longue distance a été étonnamment
réussi. Il s'en suivit une demande d'autorisation de mener
une expérience entre les gares de Moorslede-Passendale et de
Beselare, avec l'intention que si le résultat était
convaincant, l'institution serait autorisée à être
mise en œuvre dans toutes les gares de Belgique.
Cependant, leur invention et n’a jamais pu être commercialisée..
C'est Aloïs Honraedt de Molenstraat qui a fabriqué les
premiers appareils d'après les plans d'E. Christiaen et de
Lescouwier. Le résultat fut encore une fois étonnant.
On disait ici que l'État rachèterait le brevet si le
test Bruxelles-Paris était tout aussi réussi. Le résultat
était à nouveau positif. L’achat n’était
plus qu’une question de formalités et…. de prix.
Mais Christiaen avait fixé le prix trop haut... le règlement
a été reporté. Plusieurs mois plus tard, une
entreprise a mis au point un système similaire, mais avec quelques
améliorations et les mauvaises langues, qui ont toujours existé
et existeront toujours, ont toujours prétendu que c'étaient
avec les plans de Christiaen et de Lescouwier, envoyés à
l'étude, qui avaient été modifiés ...
Bruges En 1881, à l'occasion de la célébration
du cinquantième anniversaire de l'indépendance de la
Belgique, l'Exposition industrielle de Flandre occidentale a lieu
à Bruges. Le secrétaire de Bikschote, M. Lescouvier,
y a exposé ce « système téléphonique
». Il y avait pas mal de visiteurs qui pensaient que c’était
une invention du diable. Mais diabolique ou non, l'industriel brugeois
Charles Callewaert prit sous son bras le secrétaire de Bikschote
et fit installer quelques mois plus tard une ligne téléphonique
de son moulin à farine de la Coupure jusqu'à sa maison
près de la porte de Gand à Bruges. Distance : 200 m.
Elle devint la première ligne téléphonique (privée)
de Bruges...
Mais la percée à Bruges tarde à venir. Dans «
l’annuaire téléphonique officiel » de toute
la Belgique de 1888, Bruges n’est pas encore mentionnée.
C'est précisément cette année-là que Bruges
reçut son premier « téléphone officiel
» et ce n'est qu'en 1890 que quelques connexions téléphoniques
officielles furent signalées pour Bruges. Les membres n’étaient
mentionnés que par leur nom ; les numéros n'existaient
pas encore.
En 1904, le premier bureau de télégraphe et de téléphone
fut établi à côté de la gare de Bruges
: une petite salle. de 3 m sur 3, où les premiers opérateurs
téléphoniques devaient effectuer les raccordements demandés
par les 248 abonnés déjà présents à
Bruges : après tout, le téléphone n'avait pas
encore de cadran rotatif !
A la même époque, le long des voies ferrées, apparaissent
les doubles poteaux téléphoniques qui doivent supporter
les nombreuses lignes de ville à ville, de village à
village. Certains de ces poteaux et quais ont même « déraillé
» à Bruges, où ils ont constitué une (grosse)
épine dans le pied de la beauté urbaine de Bruges.
Le Téléphone à Zedelgem
Entre pot et pinte, Louis Monbailliu, boucher-aubergiste de «Gemeentehuis
», a appris que le conseil communal d'Aartrijke avait fait installer
un téléphone dans la maison communale de cette ville.
Une fois au lit, il jouait avec l'idée que Zedelgem ne devait
certainement pas ou ne serait pas inférieure à la commune
voisine et, s'assoupissant peu à peu, il rêvait de cet
appareil ultra-moderne dans son bar, placé à côté
de la porte du bureau et de la salle des archives de la commune. Et...
une effervescence avec tous les habitants curieux de Zedelgem venus
voir ce merveilleux appareil avec lequel on pouvait parler via un
fil à quiconque voulait écouter, à des kilomètres
de distance. ... Et quiconque venait voir ou utiliser cette nouvelle
merveille du monde ne pouvait s'empêcher de commander une pinte
bien ferme... Louis a vu son chiffre d'affaires augmenter d'heure
en heure de façon fabuleuse.
Cette image de rêve l'a réveillé et c'est seulement
alors que lui est venue l'idée que lui seul, en tant que conseiller
communal, pourrait devenir l'homme avec le premier téléphone
à Zedelgem, puis dans sa propre maison. Il lui a fallu des
jours pour régler tous les points à ce sujet : quand,
comment et surtout ce qu'il allait proposer au conseil communal comme
nécessité pour un téléphone à Zedelgem.
Le 15 décembre 1903, il y a eu un conseil municipal. L'ordre
du jour était chargé de projets de loi soumis pour la
construction et la réparation des autoroutes et ces coûts
devaient être inclus dans le budget.
sommaire
Aux US en février 1882, Western Electric et Bell signèrent
un contrat faisant de Western Electric Bell le seul fournisseur de
téléphone.
Théodore Vail, le patron de la société Bell (aujourd'hui American
Bell Telephone) tenait à exporter vers l'Europe. Il était convaincu
par Enos Barton de Western Electric et Gardiner Hubbard
de l'American Bell que la fabrication européenne plutôt que l'importation
était la seule solution qui permettrait de surmonter les sentiments
nationalistes locaux et le coût élevé du fret et des tarifs.
26 Avril 1882 Création de la Bell
Telephone Manufacturing Company
Les fondateurs étaient Francis Welles envoyé de WE
Western Electric, Louis de Groof fondé de pouvoir de l'
IBTC, et des personannalités locales A Van den Nest, A Mois, E;et
M Grisar puis J Osterrieth.
|
Bell Telephone Manufacturing
Company
SOCIETE ANONYME Au capital de Frs. 5,000,000. Fondée à Anvers
Le 26 avril 1882
Publié au Moniteur du 14 mai 1882. Siege Social, n° 18, rue
Boudewyns.
CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Administrateur-Président A. VAN DEN NEST.
Administrateur-Délégué et Directeur C. H. MINOR.
Administrateur ALEXIS MOLS.
Administrateur F. R. WELLES.
Administrateur T. DELVILLE
Directeur C. H. MINOR.
Administrateur T. DELVILLE.
Sous-Directeur J. S. WRIGHT.
Directeur Commercial J. B. CHRISTOFFEL
|
 |
Le siège social est établi dans un immeuble loué au 278 de la Dambruggestratt
à Anvers, la ou fut installé le central téléphonique initial.
sommaire
|
Le 26 avril 1882, la Bell Telephone Manufacturing
Company est fondée et ouvre son usine à Anvers. Elle appartenait
à 45 % à Bell et à 55 % à Western Electric.
27 avril 1882 Première séance du conseil d'administration
(Document ci contre)
Les opérations outre-mer de Western Electric sont placées sous
le contrôle de Francis Welles, un jeune Américain. Il
figurait dans les procès-verbaux de la BTMC comme "administrateur
délégué", à peu près l'équivalent d'un directeur général.
Le Conseil était composé d'Arthur Van den Nest, banquier et
vice-maire d'Anvers (président) ; Francis Welles ("administrateur
délégué"); Alexis Mols, financier et commerçant (secrétaire)
; Jean-Corneille et Louis De Groof (ils avaient été les agents
locaux de Bell); et J. Stappers. D'autres dignitaires locaux
étaient Ernest et Maximilian Grisar (Ernest était l'un des fondateurs
de la société d'exploitation locale Bell, Maximilian était un
homme d'affaires local impliqué dans une société minière au
Congo) et Jacques Osterrieth. Au bout de quelques mois, JC De
Groof est nommé deuxième "administrateur délégué" pour seconder
Francis Welles.
Avoir un Belge en charge a aidé politiquement et aurait été
nécessaire pendant que Welles voyageait à travers l'Europe.
Ezra Gilliland de Western Electric a
été envoyé en Europe pour aider à démarrer l'entreprise.
|
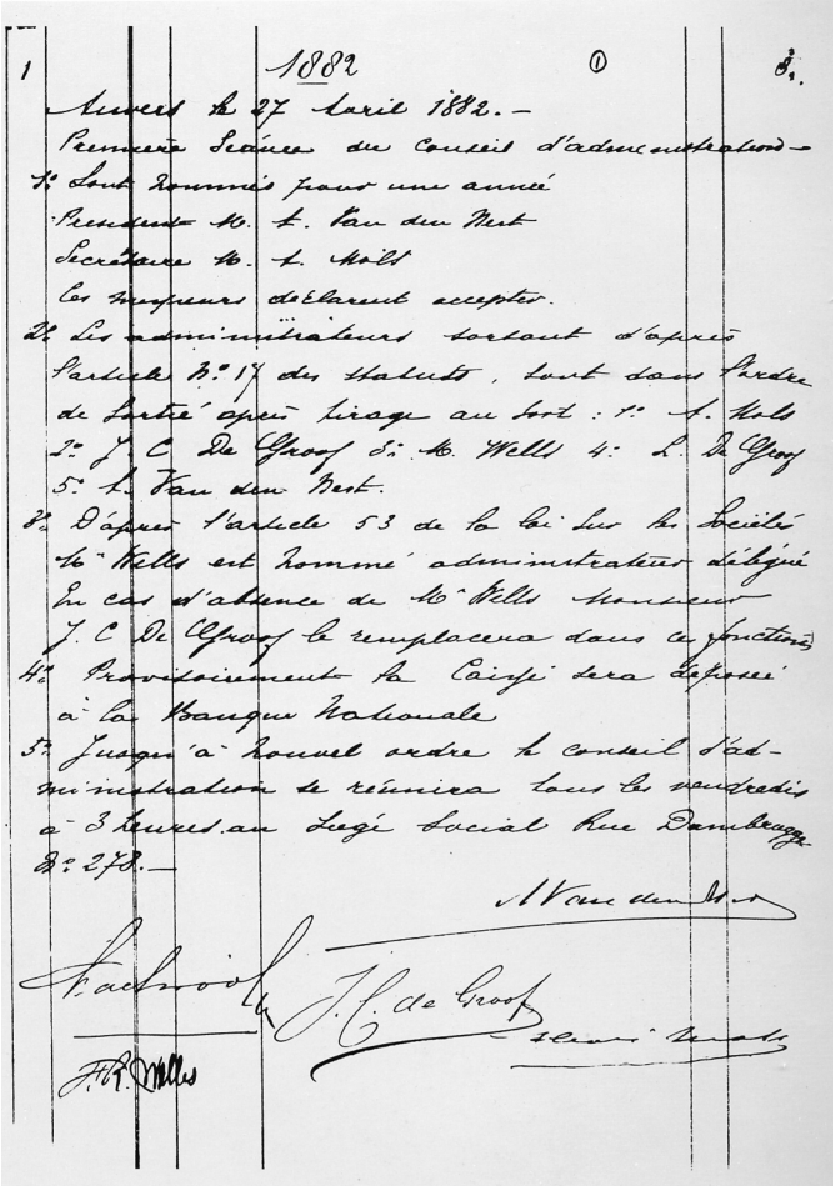
Agrandir |
Ezra Gilliland ami et collègue de Thomas Edison
a construit le premier central téléphonique à Indianapolis sous le
nom de Gilliland Telephone Manufacturing Company a ensuite
travaillé pour la Bell Telephone Company de Western Electric et a
aidé à établir la branche fabrication à Anvers,

F.T. Welles |
Quand la S.A.Bell
Telephone Mfg dirigée par Ezra Gilliland fonctionnait
bien, Gilliland est retourné aux États-Unis et a été remplacé
par Francis Welles, qui a agi en tant qu'administrateur
délégué (à peu près l'équivalent d'un directeur général).
Arthur Van den Nest, qui était à l'époque vice-bourgmestre d'Anvers,
a agi en tant que président de la nouvelle société.
Louis De Groof administrateur, fut nommé second administrateur
délégué afin d'assister Francis Welles
Francis Raymond Welles (né à Athènes, Pennsylvanie, le
18 août 1854 - décédé à Vernet-Les-Bains, France, le 14 décembre
1936), est diplômé de l'Université de Rochester avec un baccalauréat
accéléré (AB) en 1875 , et un an plus tard, il a commencé à travailler
comme secrétaire d'Enos M. Barton, co-fondateur de Western Electric.
Barton l'avait envoyé plus tôt en Australie et en Nouvelle-Zélande
pour aider aux opérations là-bas,
Welles était auparavant le secrétaire d'Enos Barton de la Western
Electric Company à Chicago. Barton l'a ensuite été
transféré à Bruxelles.
En 1889 en France il fonda avec G.Aboilard une société d'import
de câbles téléphoniques système Patterson. Le 6 janvier 1890 ils
fondent une société au nom collectif "G.Aboillard & Co" et
installent une usine au 46 avenue de Breteuil à Paris... cette
société est devenue "Le Matériel Téléphonique". |
A Anvers la S.A.Bell
Telephone Mfg qui n'avait pas encore pas
Les premiers bâtiments privés avec bureaux, entrepôt et atelier
sont érigés du côté nord de la Boudewijnsstraat N°4 , conçus par J.L.
Hasse. Il a utilisé une architecture en brique avec des éléments de
style éclectique, néo-Renaissance ou néo-traditionnel.
Peu après le 22 juillet 1882, un incendie detruisit les ateliers
; ceux-ci furent alors transférés provisoirement Canal des Vieux Lions
chez Hoskin/Black é CO Au Ankerrui.
Le conseil d'Administration en aôut 1882 engagea des égociations en
vuede l'achat d'un terrain pour consruire un atelier. Le choix se
porta sur la Boudewijnsstraat pour deuxarcelles de 910 et 340 m2.


Le 13 novembre 1882 la construction de la première usine débute,
la société s'y installa en automne 1883.
 L'usine en
1884
L'usine en
1884 
Les bureaux sont situés au premier étage et le rez-de-chaussée comprenait
le magasin, l'atelier d'assemblage, l'expédition, la salle des machines
et la loge du concierge. La production employa 35 personnes dont
8 femmes. Quelques mois plus tard, il fallu songer à des extensions.
Dès les premiers mois, le chiffre d'affaires réalisé prouvait aux
fondateurs que leur espoir ne serait pas déçu, et en 1883 l'on décida
de construire l'usine de la rue Boudewyns, 18, on elle existe encore
à présent.
Depuis lors les installations se sont considérablement développées
et constituent a présent une des plus importantes usines mécaniques
du pays .
BTMC est devenue
la propriété majoritaire du fabricant de téléphones Western Electric
et a également créé plusieurs autres divisions en tant que sociétés
nationales à travers l'Europe continentale et la Russie . Western
Electric était elle-même plus tard détenue majoritairement par l'
American Bell Telephone Company , rendant le contrôle de BTMC à l'organisation
Bell.
|
La première tâche de Welles était d'établir
un réseau d'agents pour donner à l'entreprise une présence dans
chaque grande entreprise.
Cela semble avoir été un succès puisque Western Electric a autorisé
la reconstruction de l'usine après qu'elle ait été détruite
par un incendie .
Welles était diplômé d'université, le premier employé
par WE Il était un bon choix.
Agé de 27 ans, éduqué et polyglotte, il s'attache à constituer
un réseau d'agents dans toute l'Europe pour donner à l'entreprise
une présence dans chaque grand pays.
En l'espace d'un an environ, l'entreprise anversoise remportait
de nouveaux contrats dans plusieurs pays européens.
Bien que l'intention de BTMC était de construire les téléphones
muraux conventionnels à deux et trois boîtiers (initialement
à partir de pièces importées), ils ont rapidement découvert
que des entreprises locales comme LM Ericsson et Siemens &
Halske fabriquaient de meilleurs téléphones plus petits dans
des styles préférés par le public... Par exemple, le combiné
a été introduit par Ericsson en 1892.
Les unités équivalentes de Bell, en particulier l'émetteur Blake,
étaient trop volumineuses pour être utilisées dans un combiné.
Suite à un incendie qui détruisit l'usine le 22 juillet 1882,
Welles fut autorisé par Western Electric à la reconstruire.
Cela montrait leur foi dans le potentiel des marchés européens.
|
|
sommaire
Durant les premières années, le développement
du téléphone demeura quelque peu anarchique.
Du point de vue juridique, la réglementation applicable au
téléphone n’avait pas été clairement
définie. La loi du 14 avril 1852 avait consacré le monopole
public dans le secteur du télégraphe. Toutefois, la
loi du 23 mai 1876 permettait l’octroi de concessions locales
dans des circonstances exceptionnelles. L’adoption d’une
nouvelle réglementation sur le téléphone suscita
de longs débats. En attendant, le gouvernement adopta l’arrêté
royal du 15 mars 1880. Ce dernier prévoyait un régime
de concession et établissait une procédure d’enquête
afin de déterminer la durée des concessions et le taux
des taxes à leur appliquer.
Du point de vue économique, les trois sociétés
en présence tentaient de développer au maximum leur
réseau. Ainsi, à Bruxelles, elles se disputaient les
abonnés par une concurrence acharnée. Elles réduisaient
les prix afin d’obtenir le plus grand nombre de clients. Le réseau
se développa de façon désordonnée. Chaque
opérateur construisait son propre réseau dans les endroits
potentiellement les plus rentables. Il en résultait un enchevêtrement
de réseaux non reliés entre eux, des appareils différents
qui ne pouvaient être mis en correspondance les uns avec les
autres et des clients mécontents qui se limitaient à
des appels dans leur réseau. Les coûts d’exploitation
restaient extrêmement élevés pour satisfaire une
demande encore faible. A l’époque, les clients restaient
essentiellement des entreprises, des commerces ou des administrations
(nationales ou communales).
Rapidement, le marché imposa des fusions. Elles aboutirent
à un monopole de facto du plus puissant des opérateurs
: la société belge du téléphone Bell,
qui absorba ses concurrents de taille plus faible. En 1881, l’IBTC,
la CBT et la SGTB regroupèrent leur capital dans la Compagnie
belge du téléphone Bell-CBTB. Cette opération
présentait toutefois un coût élevé. Il
fallut restructurer les réseaux, ce qui entraîna des
coûts importants. Très vite, les prix augmentèrent.
L’Etat belge, conscient du bouleversement impliqué par
le téléphone dans la vie en société, décida
dans l’intérêt général de rendre ce
nouveau moyen de communication accessible à tous. Comme le
soulignait le gouvernement libéral de l’époque,
"le projet de loi considère le téléphone
comme constituant un service public analogue au service des postes
et télégraphes". L’Etat devait assurer le
bon fonctionnement de ce service public. Par ailleurs, il convenait
d’éviter les abus de puissance économique. Selon
le gouvernement, "cet instrument de progrès doit être
mis à la portée de tous et ne peut constituer le privilège
de quelques-uns. Or, tels seraient les effets inévitables dune
organisation vouée à la spéculation privée.
Non seulement celle-ci se contenterait d’organiser les opérations
fructueuses et lucratives, laissant le reste du pays à l’écart,
mais elle pourrait exclure certains citoyens des avantages de ces
communication qui, sous l’empire d’influences individuelles,
seraient réservées à leurs rivaux ou à
leurs concurrents". La situation de monopole privé ne
répondait pas à ces objectifs. Il fallait par conséquent
encadrer le marché de la téléphonie par un régime
juridique spécifique, qui puisse adapter cette évolution
du marché aux exigences du service public.
Certains préconisaient la libéralisation de ce marché
; d’autres revendiquaient un monopole public comme la seule garantie
valable de service public. Le débat aboutit à une solution
de compromis.
La loi du 11 juin 1883 instaura un régime de concession.
Le choix d’un régime de concession se justifiait, selon
les auteurs de la loi, parce que "l’initiative privée
est mieux à même que l’administration de lancer
l’affaire, de vulgariser l’invention qui à ses débuts
se heurtera à des défiances. Elle n’est assujettie
ni à la raideur ni au formalisme administratif et sa propagande,
stimulée par son intérêt, sera plus active et
plus féconde".
Le téléphone constituait un service public, dans le
sens que sa fourniture "abordable" présentait un
intérêt pour la collectivité. Cela ne signifiait
pas qu’elle devait en assumer la gestion elle-même, mais
seulement que son contrôle apparaissait nécessaire, sous
une forme ou une autre. En revanche, l’Etat n’entendait
pas conférer un monopole privilégié à
une entreprise privée. Le monopole privé comporte un
risque d’abus de position dominante dans le chef du bénéficiaire
du monopole, qui-se borne à développer les activités
rentables. Les activités répondant au service public
et non à un objectif de rentabilité économique
ne sont pas prises en considération. D’où l’importance
d’un encadrement juridique. Le régime de la concession
tentait de corriger la situation possible de monopole, notamment par
des règles qui obligeaient le concessionnaire à maintenir
un prix non prohibitif.
Le choix effectué correspondait ainsi à une approche
fonctionnelle du service public. L’Etat estime qu’une activité
doit être accomplie en réponse à une mission d’intérêt
général. Le mode d’action pour mener à bien
cette mission n’est toutefois pas précisé. Par
opposition, l’approche organique du service public fait référence
à l’organisme mis en œuvre par l’Etat en vue
d’accomplir la mission d’intérêt général.
Le débat se concentra dès lors sur les modalités
de la concession. Plusieurs éléments suscitèrent
des oppositions : l’obligation systématique de procéder
à des adjudications publiques pour les concessions, la durée
de celles-ci, ainsi que l’obligation de remplacer les fils aériens
par des conducteurs souterrains.
Le régime de la concession visait à imposer la fourniture
au consommateur d’un service à un prix abordable. Par
là, on entend un prix représentatif d’un marché
en concurrence qui contraint l’opérateur à l’efficacité.
Il lui permet de survivre par une gestion rigoureuse de ses coûts
tout en dégageant une marge bénéficiaire raisonnable
et il permet aux individus de bénéficier d’un accès
raisonnable à tous ses services. L’Etat concède
le réseau ou une partie de celui-ci au concessionnaire qui
peut gérer ses activités selon ses propres méthodes
dans les limites des conditions précisées par le cahier
des charges prévu par la loi du 11 juin 1883 concernant l’établissement
et l’exploitation de réseaux téléphoniques.
Toutefois, il est extrêmement difficile d’établir
le caractère véritablement concurrentiel d’un prix,
particulièrement quand l’édification d’un
réseau au coût initial élevé complique
nécessairement l’évaluation des rendements et dissuade,
à partir d’un certain moment, les concurrents potentiels.
Le cahier des charges précisait notamment que
:
- la concession n’accorde aucun privilège au concessionnaire.
L’Etat peut décider d’octroyer d’autres concessions
ou d’exploiter lui-même une partie du réseau (art.
2) ;
- les bureaux du réseau concédé peuvent être
raccordés aux bureaux télégraphiques de l’Etat,
mais à charge du concessionnaire (art. 4) ;
le concessionnaire est obligé d’ouvrir des bureaux au
public (art. 7) ;
- toute personne ayant un établissement dans le périmètre
de la concession doit pouvoir demander un accès au réseau
dans les conditions générales de l’abonnement (art.
8) ;
- un prix plafond est fixé pour l’abonnement et pour les
communications aux bureaux (art. 9-11) ;
à l’expiration de la concession qui est d’une durée
maximale de 25 ans (art. 1), le gouvernement devient propriétaire
des installations de la ligne, sans aucune obligation financière
vis-à-vis du concessionnaire (art. 23) ;
- le gouvernement est libre de racheter la concession à partir
de la deuxième année (art. 25)...
Ces dispositions affirment le droit de l’Etat et définissent
les obligations du concessionnaire. Seul l’Etat peut avoir une
influence directe sur le nombre d’opérateurs sur le marché.
Même s’il se limite à un concessionnaire étant
donné les spécificités du marché, l’Etat
se réserve "la faculté de créer la concurrence
si le concessionnaire ne répond pas aux conditions imposées".
Il peut désigner d’autres concessionnaires : "si
la société refusait d’introduire des améliorations
que la science et l’expérience ont fait reconnaître
utile, le gouvernement accorderait une nouvelle concession".
Il peut proposer lui-même des services et il peut également
reprendre, de façon anticipée, les activités
concédées. Son autonomie de manœuvre est donc très
grande.
Fort rapidement, toutefois, la mise en œuvre de la loi du 11
juin 1883 s’écarta des fondements de la législation.
Par négociation directe, le gouvernement accorda à la
CBTB l’essentiel des concessions dans les grandes villes du pays
: Bruxelles, Anvers, Charleroi, Gand, La Louvière, Verviers,
soit quelque 85 % du marché belge. Il accorda à la CLTB
la concession dans la région liégeoise (soit quelque
10 % du marché) [12]. D’autres concessions, de moindre
importance, furent accordées à d’autres opérateurs
après adjudication publique. Elles concernaient les villes
de Courtrai, Louvain, Malines, Mons, Namur et Termonde. Par la suite,
il intervint directement pour financer le développement des
réseaux locaux dans d’autres villes : Ostende (en 1885),
Bruges et Tournai (en 1890) ou Nivelles et Huy (en 1894). Enfin, l’Etat
se réservait le réseau interzonal et international.
Cela fut facilité par la découverte du procédé
Van Rysselberghe qui permettait, moyennant certaines adaptations,
d’affecter le réseau du télégraphe aux communications
téléphoniques. La première liaison internationale,
avec Paris, fut assurée dès 1887.
En synthèse, toutefois, la société
Bell devenait largement concessionnaire pour l’établissement
et l’exploitation du réseau local en Belgique. La société
Bell se trouva soumise aux conditions de service public fixées
dans un cahier des charges. Les avantages de la concurrence ne purent
par conséquent guère être mis en évidence.
Le concessionnaire n’avait pas été désigné
par adjudication publique car "il fallait avoir égard
aux capitaux engagés et aux sacrifices importants faits par
la société. La société Bell assurera au
public qui fait usage des téléphones la réalisation
de tous les progrès que la matière comporte, progrès
qui lui seront garantis par la concurrence éventuelle d’autres
entreprises". En principe, l’Etat se réservait la
possibilité de désigner d’autres concessionnaires
si nécessaire, de façon à inciter l’opérateur
privé à une efficacité maximale. En pratique,
cette possibilité fut vite abandonnée. En effet, selon
le gouvernement, "les nécessités de l’exploitation
téléphonique commandent le téléphone".
Dès 1885, il fut par conséquent décidé
de ne pas ouvrir les marchés à la concurrence.
En tout état de cause, la concession devait être octroyée
pour une durée de 25 ans au maximum avec la possibilité
pour l’Etat d’y mettre fin dès la dixième
année en rachetant le réseau. Ainsi, "l’exploitation
par les concessionnaires ne sera qu’une transition qui nous préparera
à l’exploitation par l’Etat". Toutefois, une
indemnisation importante était prévue en cas de rachat.
Ce régime ne constituait pas une exception. Il faut souligner
qu’il existait, à la fin du XIXème siècle,
une évolution du marché du téléphone vers
un monopole du plus puissant opérateur privé. Elle tenait
à l’économie même des réseaux. Les
Etats-Unis ont d’ailleurs dû se rallier à une solution
similaire, avec la consécration progressive du monopole d’ATT.
L’importance des investissements exigés par rapport à
une demande encore limitée ne permettait pas le partage du
marché entre différents opérateurs privés.
Le rendement de l’investissement n’apparaissait pas assez
élevé. A cette contrainte financière s’ajoutait
également une contrainte de nature technique. Il fallait garantir
l’interopérabilité des réseaux, ce que permettait
plus facilement un contrôle du marché. Cela explique
aussi la symbiose qui existait entre les opérateurs de télécommunications
et les fournisseurs des terminaux.
Dès 1885, l’octroi d’une concession à la seule
société Bell fut contestée. Plusieurs sociétés
présentèrent une demande de concession pour certaines
villes. Elles prétendaient fournir un service à un prix
plus compétitif que la société Bell. Selon elles,
"si le gouvernement repoussait ces demandes, le monopole serait
implicitement établi et consacré". Leur argumentation
trouvait une justification dans le fait que, lorsqu’elle avait
été soumise à une procédure d’adjudication
publique, la société Bell avait toujours été
évincée par d’autres concurrents. Par ailleurs,
les services fournis par elle suscitaient de nombreuses critiques
de la clientèle, qui accusait souvent l’opérateur
d’abuser de sa position d’exclusivité.
Pourtant, le gouvernement rejeta ces demandes. L’expérience
d’un marché de la téléphonie desservi par
plusieurs acteurs lui fournissait des arguments suffisants. En concurrence,
la rentabilité des investissements n’apparaissait pas
garantie (comme l’avaient d’ailleurs montré les premières
années de développement du réseau). En plus,
si la téléphonie locale devait être envisagée
comme un service d’intérêt public, il paraissait
difficile de concevoir une division de ce service entre plusieurs
concessionnaires. Selon le gouvernement, une division du service minimum
à pourvoir aboutirait à un système totalement
inefficace. Or, l’Etat ne pouvait octroyer de concession que
pour autant que l’entreprise présente un caractère
incontestable d’utilité générale.
Selon le gouvernement, la concurrence devait se faire librement entre
les demandeurs de la concession, mais pendant la procédure
d’octroi de la concession. Après cette procédure,
compte tenu du marché, mieux valait reconnaître l’utilité
d’un droit exclusif. De toute façon, si le choix de la
société Bell n’avait pas fait l’objet d’une
adjudication publique pour les raisons précitées, l’Etat
pouvait à tout moment imposer d’autres concessionnaires
ou reprendre le réseau.
sommaire
En 1884, la toute première ligne interurbaine européenne est créée
entre Anvers et Bruxelles, et en 1887 la première ligne internationale
en Europe est ouverte entre Bruxelles et Paris.
La Bell Telephone Manufacturing Company BTMC
en tant que principale entreprise de fabrication pour aider International
Bell dans sa croissance dans toute l'Europe, où de nombreux pays avaient
des politiques commerciales nationalistes favorisant les fournisseurs
nationaux.
BTMC était détenue à 45 % par l'American Bell Telephone Company et
à 55 % par le principal fournisseur américain de Bell, Western Electric
dont Bell était également un actionnaire majoritaire. Western Electric,
une société américaine créée à l'époque du télégraphe, est devenue
l'unique fournisseur de téléphonie d'American Bell la même année.
IBTC a démarré des usines de fabrication subsidiaires
dans les grandes villes de toute l'Europe, car les politiques nationalistes
favorisaient les fabricants locaux. L'usine BTMC a rapidement développé
une gamme de téléphones européens pour concurrencer d'autres sociétés.
Cela a supprimé le coût supplémentaire des droits d'importation. Dans
une certaine mesure, ces téléphones ont été assez bien réussis. Dans
les premiers modèles, ils utilisaient des pièces achetées auprès d'autres
fabricants jusqu'à ce qu'ils puissent concevoir leurs propres versions.
Dans d'autres téléphones, ils ont copié les styles locaux. La plupart
d'entre eux ne sont jamais revenus aux États-Unis et sont maintenant
rares. En particulier, ils ont développé leurs propres téléphones
de bureau à combiné bien avant que les États-Unis ne les utilisent.
Leur premier téléphone de bureau (connu en Australie sous le nom de
Tour Eiffel, un nom appliqué au téléphone squelette d'Ericsson aux
États-Unis) s'est largement vendu à travers la Grande-Bretagne et
ses colonies et certains pays européens, mais est pratiquement inconnu
aux États-Unis. Il n'a probablement été produit que dans l'usine d'Anvers,
et peut-être plus tard à l'usine de Woolwich créée par Western Electric
en Grande-Bretagne. Au tournant du siècle, l'usine d'Anvers comptait
environ 700 employés.
En 1885, la fabrication locale à Anvers (Bell
Antwerp) avait remplacé l'importation de centraux manuels
et d'instruments téléphoniques. Le volume de fabrication a plus que
doublé chaque année lorsque Bell a commencé à approvisionner la majeure
partie de l'Europe. Avant le tournant du siècle, Bell était le principal
fournisseur de systèmes téléphoniques en Égypte, en Chine, au Japon
et en Amérique du Sud.
En 1887, un site de 1.186,75 m2 a été acheté
sur le côté sud de Boudewijnsstraat pour la poursuite de l'expansion
du complexe. Hasse est resté l'architecte permanent de l'entreprise
et a agrandi l'usine prospère des deux côtés de la Boudewijnsstraat.
En 1896-1897, la nouvelle usine est construite, à l'emplacement actuel
des bâtiments, avec des ateliers associés et une forge. C'est la partie
la plus ancienne de l'usine qui subsiste, dans le coin sud-est du
bloc. Les extensions, changements et innovations se succèdent rapidement.
En 1888 la hauteur du bâtiment fut portée à 3 étages.
Sur le plan technique pour rester à la page, Duncan Dewar , le premier
directeur d'usine, fut régulièrement envoyé en voyage d'étude pour
examiner les progrès enregistrés dans l'industrie des télécommunications.

Les premiers appareils téléphones étaient de type mural avec magnéto
et un microphone (ou transmetteur) blake et un récepteur Bell. Les
premiers commutateurs de type stanard étaient développé par Western
Electric.
Standard à batterie locale 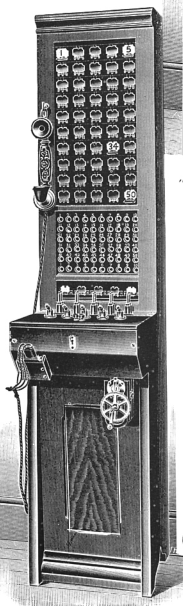

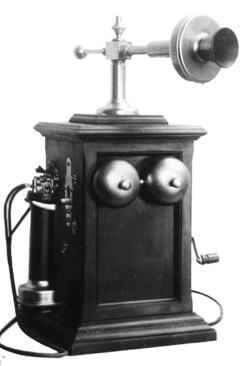
Dès 1884, BTMC envisagea
d'étendre la production à plusieurs standards, le premier multiple
développé par Leroy B.Firman qui était le directeur
général de l'American District Telegraph. Il a été breveté
No.
252,576. le 17 janvier 1882. Il s'agissait d'un Tableau de
commutation multiple pour centraux téléphoniques, qui facilitait les
connexions dans le central, et simplifiait et accélérait le travail
de l'opérateur téléphonique.
BTMC a commencé à produire des
tableaux de distribution complets en 1887 (après une période de transition
où ils ont utilisé des tableaux de distribution partiellement fabriqués
aux États-Unis.)
L'installation d'Anvers était en grande partie responsable
de l'introduction du téléphone dans une grande partie de l'Europe,
avec ses premiers centraux téléphoniques manuels.

Annuaire téléphonique de 1886 de la société
privée « Compagnie Belge du Téléphone
Bell », qui exploitait (une partie) du réseau téléphonique
belge à cette époque.
sommaire
Début de l'expansion européenne
|
- Belgique
Les premiers centraux téléphoniques de Belgique sont ouverts
en 1878. Une société est créée à Bruxelles en 1879, et d'autres
suivent. La concurrence a été reconnue comme insatisfaisante
et les différentes sociétés ont été encouragées à fusionner.
La Compagnie Belge du Téléphone Bell ( Bell Telephone Company
of Belgium ) a été créée en 1882, en tant que filiale belge
de l'International Bell Telephone Company de New York. À la
fin de 1886, la division belge avait un total de 6 900 kilomètres
de lignes téléphoniques et 3 532 abonnés dans sept villes, dont
Bruxelles , Anvers , Charleroi ,Gand , Verviers et Liège.
Le système de commutation rotatif a été fabriqué à Anvers à
partir de 1913 environ et a été utilisé par plusieurs pays à
travers le monde, dont la France, les Pays-Bas, la Norvège et
la Nouvelle-Zélande (mais pas comme l'espérait la poste britannique).
Cependant la fabrication est perturbée par l'invasion allemande
en Belgique en 1914.
- En Suisse
Le premier centre téléphonique en Suisse a été ouvert à
Zurich , exploité en vertu d'une licence accordée par l'IBTC
à un groupe d'hommes d'affaires le 24 juillet 1880. Au cours
de 1881, des centres ont ensuite été ouverts à Genève , Lausanne
et Winterthur par le gouvernement, qui peu après a racheté la
bourse de Zurich . Quatorze centres fonctionnaient à la fin
de 1883, et le double un an plus tard.
- Au Pays-Bas
La Nederlandsche Bell Telefoon Maatschappij ( Dutch Bell Telephone
Company ) a été créée aux Pays-Bas en 1881. À la fin de 1886,
la division néerlandaise disposait d'un total de 3 700 kilomètres
de lignes téléphoniques, plus 2 623 abonnés dans huit villes,
dont Amsterdam . , Rotterdam , La Haye , Groningue, Haarlem
et Arnhem .
- Italie
En Italie , la société a rapidement établi des échanges
à Milan , Turin et Gênes , et des échanges dans une douzaine
des autres plus grandes villes ont été lancés en 1881 par d'autres
intérêts sous les auspices d'un groupe de financiers parisiens.
À la fin de 1886, la division italienne avait un total de 8
073 abonnés dans douze villes, plus environ 12 500 kilomètres
de lignes téléphoniques. Les échanges les plus importants étaient
à Rome (2 022 abonnés), Milan (1 089), Gênes (950) et Naples
(873).
- En Suède et Norvège (1881-1908)
L'International Bell Telephone Company était également responsable
de l'introduction du téléphone en Norvège et en Suède . En 1881,
des bourses sont établies à Stockholm , Göteborg et Malmö .
IBTC a créé la première compagnie de téléphone suédoise, Stockholms
Bell Telefonaktiebolag , formée avec l'aide de trois anciens
surintendants suédois des PTT nommés Lybeck, Bratt et Recin.
La nouvelle société a établi son premier échange dans le bâtiment
Skandinaviska Kreditaktiebolag sur la rue Västerlånggatan à
Stockholm, utilisant à l'origine des équipements conçus par
Alexander Graham Bell et son assistant Thomas Watson , et importés
du fournisseur de Bell à Boston. Les premiers téléphones suédois,
qui avaient des bobines de signal, des sonneries et des microphones
Blake , étaient disponibles en modèles de bureau ou muraux,
se connectant à des standards de type Gilliland.
Lorsque le central téléphonique suédois de Bell a officiellement
ouvert ses portes à Stockholm le 1er septembre 1880, il comptait
121 abonnés, passant à 218 plus tard dans l'année, la majorité
de ses utilisateurs appartenant au gouvernement, aux entreprises
et aux foyers de la classe supérieure. La filiale suédoise a
rapidement ouvert plus d'échanges dans les sections Södermalm
et Norrmalm de la capitale au cours de sa première année, opérant
entre 9h00 et 22h00 tous les jours, mais en mai 1883, elle est
passée à des opérations 24 heures sur 24, facturant les abonnés
entre 160 et 280 couronnes suédoises (SEK) par an selon leur
emplacement à Stockholm (moins cher) ou en dehors de la ville
proprement dite (plus cher). La structure tarifaire de Bell
n'était pas particulièrement chère, car les tarifs étaient plus
élevés dans la plupart des pays à l'époque et seulement inférieurs
dans quelques autres.
Après 1883, la filiale de Bell a été forcée de réduire ses tarifs
en raison de la concurrence d'une autre compagnie de téléphone
nouvellement formée, bien qu'elle ait également pu augmenter
sa base d'abonnés. Il a ensuite dû limiter ses opérations à
la section Östermalm de la ville, où il a lancé un nouveau réseau
pour les abonnés privés avec des frais moins élevés en utilisant
un plan tarifaire différent avec un nombre inférieur d'appels
autorisés par mois (sa structure tarifaire initiale prévoyait
des appels illimités). En 1898, la filiale de Bell a conclu
un contrat avec son concurrent, SAT, lui permettant d'exploiter
ses installations, augmentant ainsi sa base d'abonnés à environ
7 000 foyers et entreprises.En raison de l'intervention du gouvernement
et d'autres raisons, les filiales de Bell ont finalement été
légiférées hors de la Suède et de la Norvège en faveur des entreprises
nationales. Stockholms Bell Telefonaktiebolag a complètement
cessé ses opérations téléphoniques en 1908, après avoir acquis
15 285 abonnés à ce moment-là, dans un environnement réglementaire
qui avait auparavant permis une concurrence commerciale sans
restriction.
- En Russie
La société Bell a introduit le téléphone en Russie en 1883
à Saint-Pétersbourg (ou Petrograd) et à Moscou . À la fin de
1886, la division russe d'IBTC avait un total de 3 440 abonnés
dans six villes, avec 9 550 kilomètres de lignes téléphoniques.
Ses principaux échanges se trouvaient à Saint-Pétersbourg (1
080 abonnés), suivi de Moscou (690) et de Varsovie (533).
Un commerce important s'est développé entre la Belgique et la
Russie à l'époque tsariste, avec jusqu'à 20 000 Belges de centaines
d'entreprises qui y travaillaient. Cependant, tous les investissements
et usines russes de l'IBTC ont ensuite été perdus pendant la
révolution russe de 1917 .
Cession
|
sommaire
Retour sur la petite histoire :
Le brevet du téléphone de Graham Bell
enregistré le 14 février 1876, entraîna, trente ans après la création
de la Western Union WU,
celle de Bell Telephone Company
le 9 juillet 1877, année où la WU
ne daigna pas acheter le brevet dont il s’agit ! Car c’est bien là
que se situe la naissance de l’AT&T .
Bien que ses débuts fussent confidentiels, la technologie téléphonique
ne fut pas sans inquiéter le géant du télégraphe électrique, la WU.
En conséquence, les dirigeants de la WU décidèrent de constituer un
réseau concurrent sans reconnaître les droits de Graham Bell ; c’est
ainsi qu’ils créèrent l’American Telephone Company raison socia le
qui aura un « cousinage » futur au regard de l’AT&T. L’American
Telephone Company créée en décembre 1877 engagea trois techniciens
de renom : Thomas Edison, A. E. Dolbear et Elisha Gray, ce dernier
ayant été le rival malheureux de Graham Bell en raison d’un délai
de dépôt de brevet postérieur de 2 heures.
Face à cette attitude, la Bell Telephone entama un affrontement juridique
avec la WU, situation qui entraîna l’engagement, en 1878, de Théodore
Vail au poste de directeur général de la Bell Telephone qu’il consolida
juridiquement et financièrement, en donnant à la Compagnie AT&T
le nom de National Bell Telephone Company. Il faut préciser que la
plainte de la Bell contre la WU avait impliqué les trois filiales
de cette dernière : la Gold and Stock Telegraph Company, l’American
Speaking Telegraph Company et l’Harmonic Telegraph Company. Dès lors,
la WU se trouva contrainte à la négociation qui aboutit à l’accord
du 10 novembre 1879 par lequel la WU reconnaissait enfin les droits
de Graham Bell, c'est-à-dire : cession du réseau téléphonique déjà
installé, des brevets en matière de technique téléphonique et renoncement
à toute activité dans le domaine téléphonique.
À titre de réciprocité, la Bell rachetait le réseau téléphonique de
la WU et renonçait à toute activité dans le télégraphe, activité apparemment
confidentielle – à notre connaissance – si l’on juge le peu de recherche
et d’exploitation télégraphique de la Bell.
Puis, en devenant, le 19 mars 1880 l’American Bell Telephone Company,
la compagnie prenait le contrôle de la Western Electric spécialisée
dans l’équipement téléphonique, au moment où elle totalisait 30 000
postes principaux. L’ouverture, le 2 juin 1880, de la liaison à longue
distance Boston – New York marqua les débuts du Long Lines System.
En 1884, on découvre le moyen de faire fonctionner des lignes
longues encore primitives.
Théodore Vail va utiliser ces lignes dites longues pour assurer l’emprise
de la WU sur les petites compagnies locales.
En février 1885, Vail créa une filiale uniquement dédiée
à la construction des « long lines » : l’American
Telephone and Telegraph Company (AT&T). Ses statuts,
déposés le 28 février de cette année, lui donnaient pour mission de
construire et d’exploiter des lignes hors des États Unis. Ce qui ne
l’empêcha pas de verrouiller les petites compagnies en les obligeant
à passer par elle pour être raccordées au réseau longue distance et,
avec la Western Electric et les laboratoires de recherches, de contrôler
l’apparition de technique innovantes susceptibles de mettre en danger
son systèm
De filiale de l’American Bell, l’AT&T devint le 30 décembre
1899, le centre de gravité du groupe.
AT&T prend alors la tête du
monolithique et monopolistique Bell System .
En 1890 lors d'une vente d'actions à Western
Electric, American Bell a ensuite cédé sa propriété de BTMC pour se
concentrer sur les opérations du système téléphonique, mais comme
American Bell était l'actionnaire majoritaire de Western Electric
depuis 1881, elle a conservé une propriété indirecte d'IBTC.
sommaire
A partir de 1891 les exportations ont été activement
encouragées, en particulier par le directeur commercial John Balthazar
Christoffel, un vendeur né. Il a ouvert de nouveaux marchés en
Inde, en Amérique du Sud et en Chine. Les agences à travers l'Europe
ont réussi.
Les exportations de BTMC ont continué
à se développer, vers l'Australie, l'Angleterre, la Suède, l'Allemagne,
la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, l'Italie, la Grèce, la Hongrie,
la Russie, l'Autriche, l'Égypte, le Panama, le Japon, la Chine, l'Argentine
et la Suisse.
l'IBTC à l'origine a été créé pour "... la
production, la vente, l'achat et la location d'équipements de téléphonie
et de télégraphie et tout ce qui est directement ou indirectement
lié à l'électricité" . Alors que la demande de services augmentait,
la Bell Telephone Company avait des fonds d'exploitation insuffisants
pour augmenter rapidement le réseau de central téléphonique,
En juillet 1890, American
Bell vendit sa part (45%) de BTMC à Western
Electric et devint purement une société d'exploitation.
Western Electric a ajouté ses propres administrateurs au conseil d'administration
de BTMC. Les administrateurs de Bell ont été remplacés par des candidats
de WE. Les dirigeants licenciés ont créé une nouvelle société, ATEA,
(Ateliers de Téléphone et Electricité Anversoise) voir en bas de page,
pour construire des téléphones en cocurence avec BTMC.
En 1893, l’Etat mit fin à la concession.
Même avec toutes les précautions prises dans le cahier
des charges, le régime de la concession ne permettait pas de
répondre de façon satisfaisante aux exigences du service
public. Le prix appliqué restait prohibitif pour beaucoup de
monde. De plus, seules les zones rentables avaient été
pratiquement exploitées. Il n’existait pas de couverture
dans la Campine, le sud des provinces de Hainaut et de Namur, et dans
la province de Luxembourg.
Finalement, il fallait remédier au dualisme des industries
téléphonique et télégraphique, dont l’une
était monopolisée par l’Etat et l’autre partagée
entre l’Etat et principalement une société industrielle
: "la télégraphie a des rapports si intimes avec
la téléphonie qu’il est indispensable de prendre
garde que l’une ne vienne jeter le trouble dans l’autre".
Ces considérations menèrent l’Etat à confier
l’exploitation du réseau téléphonique à
une administration nationale. Le service public du téléphone
passait ainsi d’une conception fonctionnelle à une conception
organique. Dans ce nouveau contexte, le monopole d’Etat (et donc
l’exploitation de l’ensemble du réseau par l’Etat)
devait permettre de développer un système compensatoire
où les parties les plus rentables subsidiaient les parties
les moins rentables. Cela rendait le service accessible à tous
dans des domaines identiques, c’est-à-dire à un
même tarif.
Les brevets pour le système à batterie centrale furent acquis. Cette
petite révolution marqua un tournant dans le mode d'exploitation des
réseaux et des équipements. Au cours des années suivantes,
l’Etat effectua d’ailleurs des investissements importants
(qui passèrent de 460.000 francs en 1893 à 13 millions
en 1913. En 1898 le premier central à batterie centrale fut installé
à titre d'essai dans les locaux de la société.
En 1895 Le côté opérationnel de Bell
Antwerp a été acheté par le gouvernement belge à un prix
équitable et l'entreprise a continué à prospérer grâce à ses activités
de fabrication et d'installation en expansion.
En 1894 Trophime Delville directeur et ingénieur
de BTMC, développe un nouveau type de microphone qui a été fabriqué
à des dizaines de milliers d'exemplaires.


L'émetteur de Trophime Delville de 1894 était une amélioration
belge inspirée du modèle anglais Hunnings. L'émetteur
Hunnings, tel que breveté, était rempli de poussière
de charbon grossière pour fournir la résistance variable
nécessaire. Il souffrait beaucoup du tassement. Bell, Edison
et d'autres chercheurs travaillant sur ce problème ont découvert
que des granulés de carbone, plutôt que de la poussière,
résolvaient le problème du tassement.
Le ùicrophone Delville utilisait des granulés de charbon,
soigneusement calibrés. La Bell Telephone Manufacturing Company
d'Anvers le qualifiait d'« émetteur longue distance »,
car il était beaucoup plus sensible que son émetteur
Blake-Berliner standard.
En 1900, BTM Cétait également
la nouvelle société mère ( AT&T ) principal fournisseur de systèmes
téléphoniques en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, et l'installation
était passée à un effectif de 700 personnes opérant à partir d'une
usine considérablement agrandie.
La gamme d'équipements produits par l'usine a été élargie au cours
de cette période. Des standards complets ont été produits à partir
de 1887 et l'influence des inventions et des pratiques européennes
a abouti à une gamme de téléphones qui ont été produits pour concurrencer
d'autres entreprises et éviter le trafic sur les équipements importés.
Le succès du système à batterie centrale se refléta sur le volume
d'emploi qui passa de 700 peu avant 1900 à 1800 vers 1907, la première
augmentation substentielle du capital fut portée de 1 à 5 milions
de francs belges.
En 1902 sur le continent européen, la Belgique
bénéficie du premier central à batterie centrale qui fut mis à en
service à Bruxelles.

Ce système est compatible avec les bureaux de queques centaines jusqu'à
plusieurs milliers d'abonnés. Il est économiquement justifiable à
partir de 450 abonnés.
En 1908 pour étendre les ateliers de production,
les entrepôts à bois de l'usine furent tansférés vers le terrain situé
au Kiel à l'extérieur de la ville.
À la fin du XIXe siècle, les gouvernements européens
sont passés à nationaliser leurs compagnies de téléphone et les concessions
de services téléphoniques de la Compagnie Belge du Téléphone Bell
ont été autorisées à expirer ou ont été achetées par le gouvernement
belge.
L'État belge a repris les réseaux, après l'expiration des concessions.
IBTC n'avait pas d'installations de production propres et importait
des équipements des États-Unis. À l'origine, ils obtenaient leurs
produits auprès de fournisseurs de l' American Bell Telephone Company
tels que Williams et Gilliland , et plus tard de Western Electric
.
La Bell Telephone Manufacturing Co. a obtenu aux diverses expositions
universelles auxquelles elle prit part, les distinctions les plus
flatteuses lui
attestent la valeur des produits de sa fabrication.
Distinctions obtenues.
Exposition d'Anvers 1894 Grand Prix.
Exposition de Bruxelles 1897 Grand Prix.
Exposition de Liege 19o5 Deux Grands Prix.
Exposition de Milan 1906 Deux Grands Prix .
Exposition de Bruxelles 1910 Grand Prix.

Installation caractéristique à batterie centrale. Le bureau central
d'Anvers.
sommaire
Welles dirigera la société BTMC pendant les
30 prochaines années, assisté de Louis De Groof,
BTMC était plus
enclin à expérimenter que sa société mère américaine. Certains premiers
téléphones utilisent les berceaux des coques d'émetteur et de récepteur
en fonte d'aluminium comme alternative au laiton usiné et plaqué.
BTMC a introduit les premiers combinés en acier beaucoup moins cher
à fabriquer. Le style s'écartait des production américaines , bien
que les designs aient toujours été moins élaborés que, disons, LM
Ericsson. Comme aux États-Unis, l'accent a été mis sur l'amélioration
de la fiabilité des composants.
Un domaine vital dans lequel BTMC avait des décennies d'avance sur
sa société mère américaine était la téléphonie automatique.
L'arrivé de la téléphonie automatique restructure
les ateliers de fabrication
En 1903, WE aux États-Unis
et donc BTMC, a obtenu les droits sur le système de commutation
automatique des frères Lorimer
et a commencé à le redévelopper à un rythme tranquille, en raison
du manque de financement.
Sous la coupe de l'ingénieur FR McBerty et d'autres, ce système était
devenu en partie développé en tant que systèmes Rotary
et Panel,
mais le sentiment chez WEétait
que Rotary ne serait pas adapté à une utilisation américaine.
WE a transféré le développement
du système rotatif McBerty en tant que Nr. 7 à leur filiale E Zwietusch
& Co. en Allemagne afin d'obtenir des commandes de la Reichspost
allemande.
Eduard Zwietusch était un Américain d'origine allemande, salarié d'International
Western Electric.
En 1904, Zwietusch est naturalisé allemand. Ses travaux ont abouti
au brevet des principes des mécanismes de contrôle des centraux du
Rotary en 1911 en Allemagne et en Angleterre. En 1912, son entreprise
est rachetée par Siemens & Halske, bien qu'il reste aux commandes
jusqu'en 1921.
Cela a mis WE hors de contrôle
de son produit. mais a cependant conservé une participation minoritaire
dans l'entreprise . Le développement du Rotary lui a été retiré et
transféré à BTMC.
Sous Francis Welles, BTMC avait travaillé à la production des centres
Rotary pour le marché belge. WE prévoyait de fabriquer le système
Rotary à la fois dans ses installations d'Anvers (BTMC) pour le marché
continental européen et de North Woolwich (près de Londres) pour le
Royaume-Uni et ses dominions.
En 1910, il y eut une importante réunion à
Paris du "Bureau International de l'Union Télégraphique" sur le thème
de "l'Automatisation de la Téléphonie". Il y avait 100 représentants
de 21 pays présents. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait
maintenant une fiabilité mécanique et électrique suffisante dans les
systèmes automatiques en fonctionnement à cette époque.
L'acceptation des centraux automatiques sur le marché n'était qu'un
problème économique et non un problème technique. Cette rencontre
était un signe pour tous les fabricants de télécoms (européens) d'élargir
leurs produits à la téléphonie automatique. WE aux États-Unis, cependant,
n'avait très peu fait de progrès dans ce nouveau domaine.

(agrandir) Anvers 4 Boudewijnstraat, Anvers vers
1910 les usines BTMC
En 1909, le premier pont a été construit sur la Boudewijnsstraat
entre les différents blocs de construction. De la C.G.T.A. l'ancien
hangar de tramway de Boudewijnstraat a été acheté en 1925 pour agrandir
davantage le site de l'usine.
En 1911 de nouveaux ont étés achetés à la Diercxsensstraat
pour agrandir les ateliers existants. Ces nouveaux ateliers étaient
destinés aux activités des futurs centraux téléphoniques atomatiques.
En 1910, John Balthazar Christoffel directeur
des ventes chez BTMC a écrit un
aperçu des pays du monde « livrés» par l'usine d'Anvers.
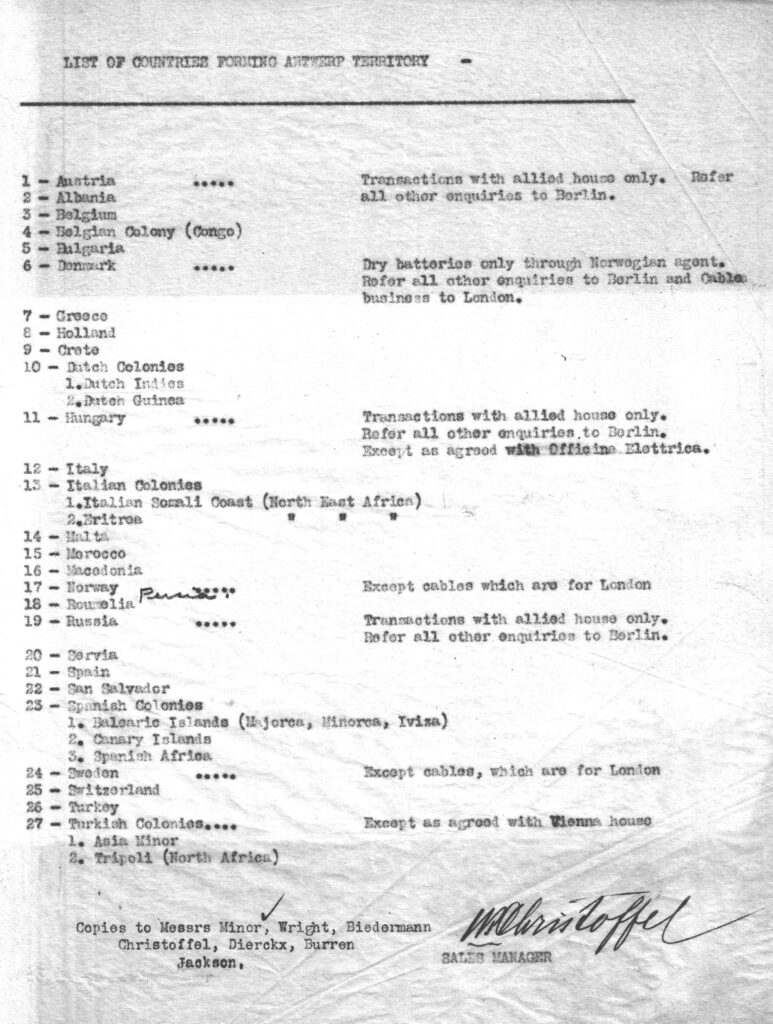 Agrandir
Agrandir
sommaire
|
Organisation de la Societe.
Les ateliers et les bureaux
Le succès de la Société est du une grande partie à son organisation
faite à l'instar de celle de la Western Electric Company de
Chicago.
Chaque employé a sa part de responsabilités, dans le travail
qui lui a été confié selon ses aptitudes, ce qui lui permet
de déployer le maximum de son initiative et de son talent.
Les différents départements, tout en travaillant indépendamment
les uns des autres, collaborent tous a un seul but : le progrès
de la Compagnie. Grace a cet agencement, un ordre parfait règne
dans les bureaux comme dans les ateliers.
La Société, en prenant pour régle de ne fabriquer que des appareils
de
premiere qualité, utilise des machines de haute précision et
un outillage trés
perfectionné. et donnent une idée de leur équipement. Leur disposition
est telle que toutes les opérations se succèdent avec facilité
sans la moindre perte de temps.
En général, toutes les matières arrivent brutes a l'usine, et
le travail de
manipulation qu'elles comportent, est réparti entre une quarantaine
de sections.
Voici d'abord les ateliers de construction mécanique proprement
dite :
- Département des machines à décolleter, avec ses tours automatiques,
ses
machines automatiques à faire les vis, etc. ;
- Département des fraiseuses ;
- Département des machines à découper, avec ses puissantes machines
à grande production, et ses machines à double effet permettant
de réduire le nombre des opérations ;
- Département des perceuses et taraudeuses, avec ses machines
à mèches
multiples pour le perçage rapide de pieces compliquées ;
- Département de l'outillage, fournissant aux précédents les
outils spéciaux que nécessite notre fabrication ;
Les centaines de milliers de pièces détachées
que produisent journellement les
ateliers précédents reçoivent le fini désiré clans une autre
série de départements :
- Département du nickelage, ou s'obtiennent par électrolyse
non seulement le
nickelage, mais l'étamage, le zinguage, le cuivrage ;
- Département du décapage ;
- Département du vernissage et de l'émaillage.
Les bobines pour les récepteurs, relais, sonneries, etc., sont
formées dans
un atelier spécial, muni de bobineuses automatiques perfectionnées,
inventées et construites par nous.
Les différentes pieces sont finalement assemblées dans le département
de
montage des appareils, d'ou sortent les règlettes de jacks,
les clefs, les fiches,
les générateurs, etc. Les transmetteurs et récepteurs sont montés
dans un autre atelier.
|
Installation téléphonique privée de l'établissement.
Les photographies ci-jointes montrent la disposition des différents
départements de notre usine,
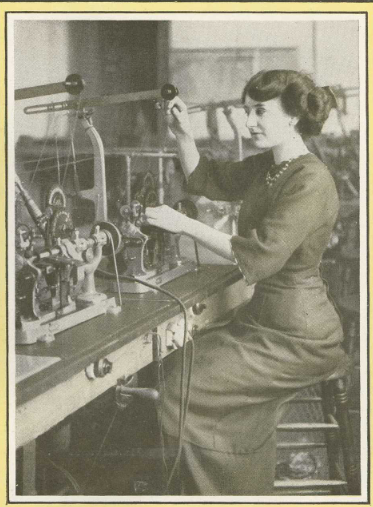
Opératrice sur machine à bobinage automatique.
|
Salle des dessinateurs 
 Salle
de bobinage Salle
de bobinage |
|
Enfin les appareils commutateurs sont fabriqués dans une série
d'ateliers spéciaux :
- atelier des répartiteurs et bâtis, ou se fabriquent les charpentes
métalliques ;
- département de la boiserie pour commutateurs ;
- département de l'assemblage des commutateurs ;
- département du câblage, ou sont préparés d'avance, avec toutes
leurs connexions, les câbles des grands bureaux téléphoniques.

Salle de montage des commutateurs
Cette brève et incomplète description indique
jusqu'à quel point la Bell Téléphone Manufacturing C°, a poussé
la division du travail, et donne une idée de la minutie de son
organisation.
Des ingénieurs spécialistes surveillent constamment la fabrication
de nos appareils, tout en cherchant à en améliorer la qualité
et en diminuer le prix ; des expériences minutieuses sont poursuivies
dans ce but par nos ingénieurs qui disposent, à cet effet, d'un
laboratoire pourvu de tous les instruments de précision nécessaires.
Tous nos appareils sont soumis à une inspection rigoureuse à
laquelle nous attachons une grande importance. La matiere première,
aussi hien que les différentes manipulations qu'elle subit,
sont sévèrement controlées, et avant qu'un appareil achevé soit
mis. en magasin ou expédié, on le vérifie à nouveau pour s'assurer
si ses conditions électriques mécaniques répondent à celles
stipulées dans la spécifications clients ou sur les dessins
dréssés par les ingénieurs.
L'équipement de notre usine nous permet de mettre journellement
au point 5oo appareils et postes télléphoniques, en plus des
commutateurs et des différents accessoires électriques.
C'est ainsi que nous avons pu réinstaller, le bureau provisoire
d'Anvers (4800 lignes d'abonnés), le bureau de Naples (4300
lignes) et celui de Turin (532o lignes), chacun dans un delais
de 35 jours, lorsqu'il furent détruits par l'incendie.
Les ateliers disposent d'une force motrice d'environ I000 chevaux
produite par trois machines a vapeur quatre chaudières consommant
annuellement 5000 tonnes de charbon.
Cette force est transmise aux ateliers par voie électrique au
moyen de trois dynamos et de moteurs répartis dans les diverses
divisions.
Les ateliers et les bureaux sont éclairés à l'électitéis mais
le gaz se trouve cependant insyallé partout afin d'y suppléer
en cas d'accident.
Le chauffage à vapeur maintient une bonne et douce chaleur dans
tons les locaux pendant l'hiver ; trois ascenseurs assurent
les transports aux divers étages, un pour le personnel, les
autres pour les marchandises.
Polissage des métaux 
 Vernissage
des métaux. Vernissage
des métaux.
BTMC BILAN AU 31 DECEMBRE 1910
_____ ACTIF_____________________________ PASSIF ________
Cautionnement Frs._____ 320,320.00 ______ Capital Frs. 5,000,000.00
Rente sur Etat __________10,000.00 ___ Réserve statutaire 176,973.06
Caisse ________________19,367.33 ________ Obligations 350,000.00
Débiteurs ___________ 2,295,172.32 ________ Créditeurs 560,460.10
Effets en portefeuille ______13,206.61 ____ Profits et pertes
498,060.25
Usines et matériel ___3 ,92 7,42 7. 15
____ Total __________6,585,493.41 ________________6,585,493.41
La Societe, employait environ 500 personnes
en 1893, 1300 en 1902 et en 1912 elle en occupe 1800.
Le chiffre total des salaires atteint pour cette année pres
de frs. 2.550.000, et la valeur des appareils fabriqués annuellement
pout être évaluée a la somme globale de frs. 6.000.000, dont
les 3/4 sont exportés dans toutes les parties du monde.
Les commutateurs et appareils téléphoniques de la « Bell Telephone
Manufucturing Co » sont en usage non seulement en Belgique,
mais aussi en Angleterre, Hollande, Italie, Suisse, Bulgarie,
Japon, Amérique du Sud, Australie et Afrique du Sud. C'est également
elle qui a fourni les deux premiers bureaux teléphoniques de
Pékin.
|
|
Prévisions d'Hygiène, de Sécurité
et d'Humanité.
Aérage des ateliers.
L'hygiène des locaux de travail constituant un des premiers
facteurs de réussite d'une industrie, les précautions qu'elle
prescrit sont scrupuleusement observées dans notre usine. Les
ateliers sont bien aérés au moyen de ventilateurs électriques.
Des aspirateurs fonctionnant continuellement, renouvellent l'air
et évacuent les matières vicieuses, poussières, etc.
Propreté.
Tous les jours cinq minutes avant la céssation du travail, l'outillage
et les matériaux sont remis en ordre et en place, et l'on procède
ensuite au
nettoyage de tous les locaux. Une fois par semaine — le samedi
— tous les ateliers sont lavés a grande eau et tous les trimestres
a lieu un nettoyage general à l'aide d'appareils spéciaux.
Hygiene preventive.
Chaque département est pourvu d'un nombre suffisant de crachoirs
hygiéniques. Des lavabos avec conduites d'eau potable sont installés
clans chaque atelier ; des W. C. entretenus avec soin, se trouvent
a chaque étage.
 Infirmerie
de l'établissement. Infirmerie
de l'établissement.
Secours en cas d'accident.
La fabrique dispose d'une infirmerie et d'une pharmacie contenant
tous les médicaments et instruments modernes de chirurgie pour
soigner immédiatement les ouvriers en cas d'accident. Un médecin
et un infirmier diplômé sont attachés a l'établissement.
Sécurité
Afin de prévenir les accidents, toutes les machines sont munies
d'appareils protecteurs, et des réglements sont affichés dans
les ateliers appellant l'attention des ouvriers sur les dangers
auxquels ils s'exposent en ne les observant pas.
Tous les appareils protecteurs nécessaires tel que lunettes
préservatrices, gants et tabliers de caoutchouc, etc. sont mis
a la disposition des ouvriers.
Dans chaque département trouvent des interrupteurs électriques
permettant d'arreter immediatement les machines en cas d'accident
des extincteurs d'incendie sont insinstallés dans tous les locaux
et les ouvriers sont mis au courant de leur maniement.
Pensions.
Un système de pensions a été créé par les directeurs de la Compagnie
applicable aux membres de son personnel agés de 6o ans, attachés
depuis 20 ans à l'usine. Il est alloué pension immediate à ceux
qui, apprès avoir servi la Compagnie pendant dix ans, ne sont
plus a même de travailler par suite d'un accident ou d'une maladie.
Le montant de la pension est base sur la duré des années de
service et le salaire moyen des dix dernières annees d'emploi.
La pension est payée mensuellement jusqu'a la mort de l'employé
et dans certains cas elle est continuée pendant une année après
le décès au profit de la famille.
Maison de retraite.
Grace au don généreuxe Frs. 75000, fait par le président du
Conseil d'Administration de notre Société, Mr. le Sénateurn
An den Nest, dont l'exemple fut suivi par Mr. Welles et par
le conseil d'Administration, une somme de Fr. 125.000 a été
miss à la disposition du Bureau de
Bienfaisance d'Anvers à l'effet de créer des maisons de retraite
on les personnes agées ayant travaillé pour la Société seront
soignées gratuitement jusqu'à la fin de leurs jours.
Assistance.
L'association d'assistance mutuelle existant parmi nos ouvriers,
est largement subsidié chaque nannée par notre Conseil d'Administration.
|
Le grand développementt qu'a pris la Societe
depuis sa fondation en 1882, l'a rangé parmi les plus importants
étahlissements inclustriels de la Belgique. Nous exportons pour
environ Frs. 5.000.000 de materiel téléphoniquee par an, ce qui
représente un chiffre important dans le total de l'exportation
nationale, qui s'élève à 5100 millions dont il faut déduire 2809
millions representant la valeur des marchandises qui traversent
le pays en transit.
La plupart des matières premières nécessaires à notre fabrication
sont de provenance belge de sorte que notre exportation intervient
pour une bonne part dans l'enrichissement du pays. Il n'est pas
exagéré de dire qu'une dizaine de milliers de citoyens belges
sont les bénéflciairess de notre industrie, qui d'autre part influence
considérablement le développement de la téléphoniee en Europe,
et a fait progresser par cela même l'industrie générale du pays.
Grâce a nos relations avec la Western Electric Co de Chicago dont
nous exploitons les brevets et les procédés, la Belgique a profité
de la grande experience de cette maison américaine en matière
de téléphonie.
Il est universellement reconnu que le prodigieux développement
de la téléphonie aux Etats-Unis est étroitement lié à celui de
la Western Electric Co qui y a toujours occupé le premier rang
dans l'industrie téléphonique.
Tandis que d'autres pays, avant d'arriver au système téléphoniquee
à batterie centrale, en essayant plusieurs autres équipements
pour des grands reseaux, la Belgique fut le premier pays du continent
qui a adopté d'emblée cette heureuse innovation américaine.
En effet, le bureau des telephones de Bruxelles construit
par nous en 1895, est admiré par les ingénieurs spécialistes
des téléphones du monde entier, et reconnu comme un des meilleurs
bureaux existant.
Les autres bureaux centraux belges, d'Anvers, Liege, Gand, Charleroi
et Verviers sont egalement du même système et leur excellent fonctionnement
démontre le grand mérite de nos appareils et justifie leur haut
renom.
 
Travail d'estampage et Atelier de Menuisrie mécanique.

Salle d'assemblage des petits commutateurs .
Expédition 
|
Types d'appareils pour installations à appel
magnétique.
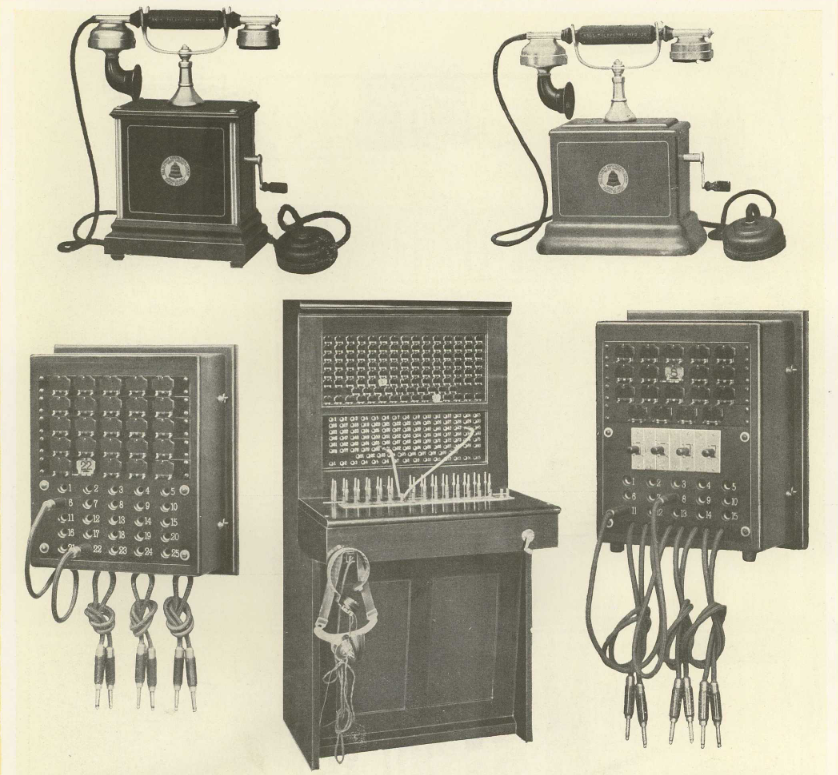
Quelques types caractéristiques d'appareils pour installations
à Batterie Centrale.
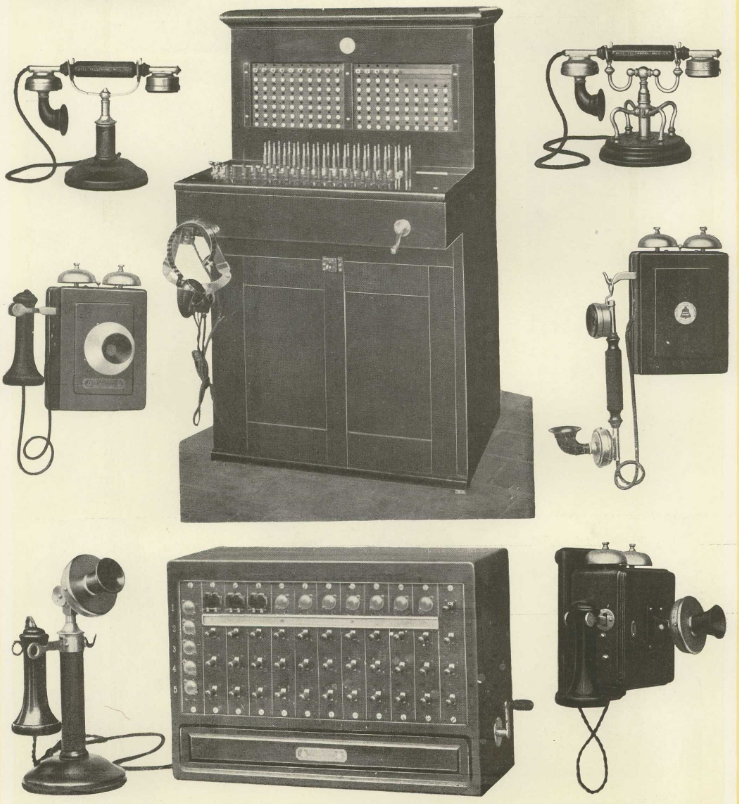 |
sommaire
En 1911 le développement définitif du système
Rotary fut transféré à Anvers et confié à la Bell Telephone qui s'attela
à la tâche avec succès.
McBerty a été transféré en Belgique pour soutenir le développement
et mettre en place les processus de fabrication.
Ses principaux efforts ont porté sur le développement du sélecteur
semi-cylindrique à partir du sélecteur
Lorimer entièrement cylindrique ainsi que sur l'ingénierie
des premiers centraux sur site. Il y avait un autre groupe d'ingénierie
actif dans le développement des mécanismes de contrôle et du sélecteur
pour le système Panel.
Le travail de mené par McBerty aboutit sur la mise au point et à la
fabrication du système Rotary semi-automatique.
Il fallut accélerer la production pour les commandes venant d'Angleterre,
de Suisse, de France, de Suède, de Norvège et de Nouvelle-Zélande.
Le système Rotary est devenu leader en Europe et dans des pays aussi
éloignés que la Nouvelle-Zélande. BTMC
possédait déjà des centres semi-automatiques en 1912 et 1915 à Landskrona
(Suède) et Angers (France). Le premier centre Rotary entièrement automatique
a été mis en service à Darlington (Angleterre) le 10 octobre 1914,
un jour après la fermeture de BTMC pendant quatre ans après l'invasion
de la Belgique.
Les commandes de la Reichpost ont été annulées et le central Rotary
semi-automatique commandé pour Berlin a finalement été installé à
la place à Angers en France par la socciété LMT "Le matériel
téléphonique". Il est entré en service en 1915.
Des développements fondamentaux majeurs ont été réalisés pendant la
Première Guerre mondiale (1916-1917) dans l'usine WE de Hawthorn USA,
en combinant le système McBerty Nr7 avec les principes de contrôle
du concept Automanual acquis par WE en 1916.
Ceux-ci ont été introduits à partir de 1919-1920 tout au long de L'Europe
en tant que Rotary système
7A (automatique).
Les développements d'ingénierie mécanique de McBerty ont été refaits
à partir de 1920 par Deakin, aboutissant à de nouveaux viseurs et
sélecteurs pour les systèmes 7A1, 7A2, 7B et 7D, tout en utilisant
les sélecteurs 7300 pour les versions à commande électronique 7E et
7EN également.
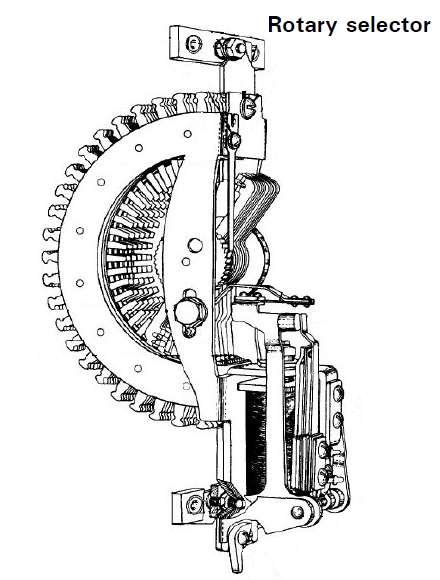

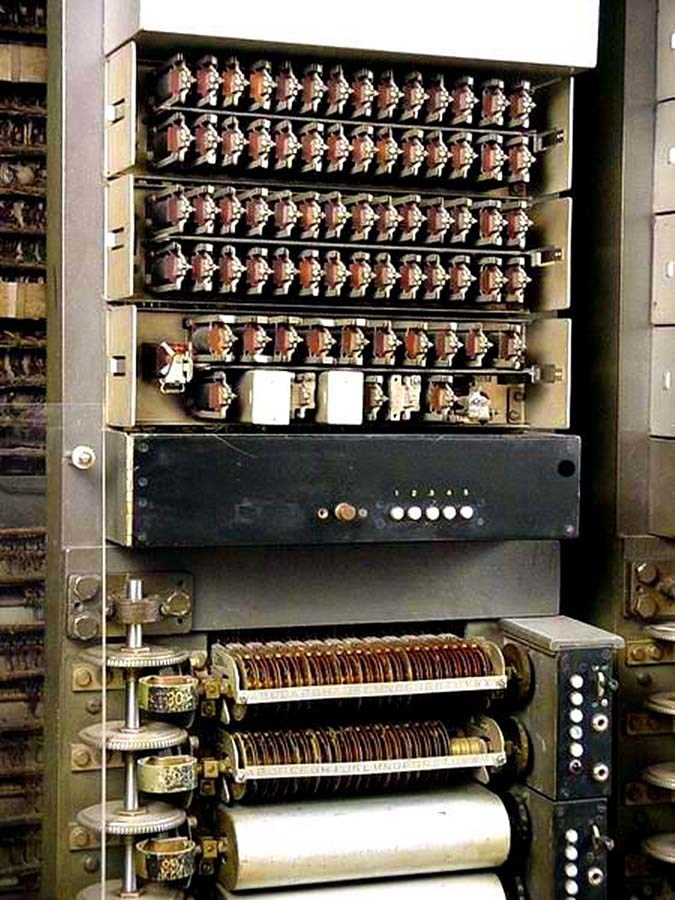 Rotary 7A1
Rotary 7A1
BTMC a également
produit le premier cadran
de WE pour le système Rotary, et ses téléphones automatiques utilisaient
des combinés en standard.
La Belgique porta son choix sur le Rotary, le premier central automatique
sera installé à Uccle (Bruxelles) en 1922 .

Le conflit interne entre WE et Bell (devenu AT&T) s'est également
poursuivi. AT&T possédait 96% des actions de WE en 1913, mais
WE a continué à élargir sa large gamme d'équipements électriques plutôt
que de se concentrer sur les téléphones.
AT&T a poursuivi sa croissance en rachetant des sociétés d'exploitation
téléphonique indépendantes et en les convertissant en équipements
WE. Bien que la situation de l'approvisionnement se soit améliorée
lorsque WE a mis en service ses nouvelles usines plus grandes.
AT&T et WE devenaient maintenant nerveux face à un nouvel adversaire
- le gouvernement des États-Unis. Le gouvernement s'intéresse aux
immenses multinationales qui se développent, et certains hommes politiques
estiment qu'il s'agit là d'un domaine qui doit être maîtrisé. AT&T
était une entreprise qui les intéressait.
Aux États-Unis, la technologie était encore loin derrière.
La société Bell, aujourd'hui American Telephone & Telegraph, a
continué de s'appuyer sur des standards et des opérateurs manuels.
Dans certains cas, il rachèterait une société d'exploitation indépendante
et supprimait son central automatique pour le remplacer par un standard
manuel.
La retraite d'Enos Barton de WE en 1908 a permis à
AT&T de mettre des personnes au conseil d'administration de WE
qui avaient de l'expérience dans les deux sociétés. Peu à peu, les
deux entreprises se rapprochent, mais un accord sur des objectifs
communs est encore loin.
Pour l'instant, AT&T devait faire face aux affirmations du ministère
américain de la Justice selon lesquelles AT&T violait le Sherman
Anti-Trust Act, qui traitait des monopoles et des comportements anticoncurrentiels.
Theodore Vail, président d'AT&T, a adopté une stratégie inhabituelle
et inattendue. Il a proposé de permettre aux sociétés d'exploitation
indépendantes de se connecter aux réseaux longue distance d'AT &
T. AT&T cesserait de racheter les indépendants, sauf approbation
du gouvernement. La croissance de Western Electric devrait désormais
provenir de l'utilisation accrue du téléphone et des ventes à l'étranger,
et non du rachat de concurrents par AT&T.
sommaire
En 1913 Francis Welles a démissionné (à sa propre demande)
de la société en 1913, à l'âge de 58 ans, et est peut-être retourné
aux États-Unis.
Il a été remplacé par Alexis Mols. La Première Guerre mondiale
a causé des problèmes majeurs.
Lorsque la guerre éclata en Europe en 1914, Gerard Swope, directeur
général des ventes de WE et désormais responsable des opérations internationales,
était en Allemagne pour négocier des contrats avec Siemens & Halske.
Lorsqu'il a finalement rejoint BTMC à Anvers, il a constaté que la
plupart des employés étaient partis. Les dirigeants américains de
l'entreprise étaient partis pour le Royaume-Uni ou étaient rentrés
chez eux, tandis que de nombreux employés de l'usine avaient été détachés
auprès de l'armée belge ou déplacés vers d'autres pays non occupés.
Palais des Lumières - Expo Gand 1913 Nous ne pouvons
aborder ici une étude complète de tous les groupes de
l’Electricité dans le Palais des Lumières; mais
à titre de mémorial de cette belle manifestation de
l’industrie électrique belge, il est juste de citer les
firmes qui y prirent part.
Au premier rang, il faut nommer la plus importante
et en même temps la plus complète et la plus remarquable
par la diversité des produits exposés, montrant ainsi
l’effort énorme réalisé en vue de lutter
avec un plein succès contre la concurrence étrangère
dans toutes les branches de l’industrie électrique : les
Ateliers de construction électrique de Charleroi. Bell telephone
manufacturing C° ; The Antwerp telephone and electrical works
; L’Union des exploitations électriques ; la Société
anonyme de téléphonie privée ; la Société
Energy-Car, (anc. firme Braun et Tudor) ; Henri Dehousse et Cie ;
Ecole pratique de télégraphie sans fil de Laeken ; Société
belge d’électricité, éclairage et force
motrice ; Société anonyme franco-belge pour les applications
de l’électricité ; Société anonyme
des accumulateurs Tudor; Société l’industrielle
d’accumulateurs ; la Centrale électrique du Nord ; Société
anonyme des Usines à cuivre et à zinc de Liège
; Société anonyme Union des Tramways ; Anciennes usines
Defuisseaux ; Société belge pour la fabrication de cables
et fils électriques ; Collectivité des électriciens
belges ; Société électrique J. de Paifve et Olivier
; Société John Cockerill ; Charles Vanderstuyft &
Cie ; Edouard Rouvroy (Gand).
Quant à l’industrie proprement dite des téléphones
et des télégraphes en Belgique, représentée
par les grands établissements créés successivement
à Bruxelles et à Anvers, aucun autre pays n’y a
donné une plus grande extension, comme nous avons pu le constater
en visitant à Gand quelques-unes de ces importantes installations
du Palais des Lumières. .
L'occupation allemande
Des troupes étaient stationnées dans l'usine. Il a essayé de continuer
les affaires, mais le 1er août, l'Allemagne a envahi la Belgique.
Il part aussitôt pour la Bretagne. Ce fut la fin des contacts de WE
avec leurs entreprises européennes pendant quatre ans. Le personnel
de l'usine BTMC a passé en contrebande des travaux de conception,
a enterré les registres de l'entreprise et a expédié du matériel essentiel
aux États-Unis.
1918 Le chaos. L'usine BTMC a donc été paralysée, pillée pendant
toute la durée de l'occupation belge et ses bureaux ont été détruits
par l'armée d'invasion.


Avant  Après
Après
De nombreux employés de BTMC se sont enfuis en Angleterre, en France,
aux États-Unis, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suisse. Ils ont développé
davantage le commutateur rotatif, et l'ont construit et installé dans
leur nouveau pays d'origine.
Dès le 14 novembre 1918, 3 jours seulement
après la fin de la guerre, des mesures drastiques sont prises pour
réactiver l’usine d’Anvers grâce à une équipe réduite de cinquante
agents qui travaillaient dans l'usine avant la guerre... En effet,
l’usine avait été totalement pillée par l’occupant allemand, qui en
avait volé jusqu’aux générateurs électriques à vapeur de l’usine,
pourtant réputés comme intransportables !
Le Service Belge de la Restitution Industrielle s'emploie dès Novembre
1918 à enquêter, à retrouver et à récupérer la plus grosse part des
matériels pillés... Les machines-outils encore utilisables de l'usine
(466 sur les 550 disparues) sont retrouvées dans les territoires libérés
d'Alsace-Moselle. Les fameux générateurs de vapeur de l'Usine ROTARY
d'Anvers sont finalement retrouvés en Pologne quelque part dans une
forêt à l'est de Varsovie, étant utilisés par l'Allemagne pour une
usine de production de méthanol ! Ils sont récupérés par la Belgique
en catastrophe juste avant le début de la guerre soviéto-polonaise
de Mars 1919...
La révolution russe a également entraîné la perte
d'une usine russe et d'investissements. Avant 1914, il y avait beaucoup
de contacts économiques entre la Belgique et la Russie à l'époque
du tsar. Avec 160 entreprises belges opérant en Russie à l'époque,
il y avait plus de Belges en Russie en 1914 (à l'époque environ 20
000 personnes) que dans la colonie du Congo belge en Afrique. Après
la guerre, la question de l'indemnisation a apparemment été poursuivie
avec l'Allemagne, mais les résultats ne sont pas connus.
sommaire
Dès Janvier 1919, les premières machines-outils
de remplacement arrivent des U.S.A. Malgré le pillage complet dont
elle fut victime, l’usine d’Anvers parvient à reprendre ses activités
dans des conditions convenables dès 1920.
L'après guerre : reconstruction publique et innovation
privée
En 1919, l’Etat s’engage résolument dans la reconstruction
de ses réseaux télégraphique et téléphonique complètement détruits
par la guerre. Les grandes lignes, surtout télégraphiques, sont rétablies
en quelques mois, malgré la pénurie de matières premières (les fils
de bronze, en particulier) et d’appareils. Mais la reconstruction
est particulièrement utilisée, à partir de 1920, pour moderniser le
réseau téléphonique : les premiers projets d’automatisation des connexions
sont développés (le bureau d’Uccle, à Bruxelles, est automatisé dès
novembre 1922 !27), davantage de « postes à prépaiement », ancêtres
des cabines téléphoniques publiques, sont installés, les communications
internationales sont étendues.
Tels sont les progrès – principalement d’origine technique – les plus
déterminants réalisés dans les années 1920. Ils sont l’œuvre de l’administration,
qui conserve son monopole d’exploitation télégraphique et téléphonique.
Des liens étroits sont néanmoins maintenus avec les deux entreprises
privées qui lui fournissent le matériel et les appareils nécessaires,
les sociétés Bell BTMC et ATEA,
bien que celles-ci soient désormais toutes les deux contrôlées par
une des grandes multinationales De nouveaux contrats relatifs à l’automatisation
du téléphone sont même signés en 1928 avec Bell pour la plus grande
partie du réseau, et en 1932 avec ATEA, pour les zones de Mons, Verviers
et Hasselt. C’est la poursuite d’un duopole des partenaires industriels
de l’administration, qui se maintiendra encore pendant près de soixante
ans.
En 1919, Swope, l'un des derniers partisans
de WE en tant que producteur d'une large gamme de produits électriques,
quitta WE pour prendre le relais de son concurrent, General
Electric. Chez General Electric, il a pu réaliser le rêve
de Barton et GE est devenu un puissant fabricant de tout ce qui est
électrique. WE était maintenant dirigé par Charles DuBois, et sous
sa direction, WE a abandonné la fabrication de radios, la diffusion
et les tubes à vide pour se concentrer davantage sur les téléphones.
En 1922, il écrivait "Nos brevets sont sous le contrôle de l'American
Telephone and Telegraph Company et 97 % de notre capital social lui
appartient. Nos programmes et politiques sont tous soumis à l'examen
et à la censure de l'American Telephone & Telegraph Company. ...
Nous n'avons aucun secret pour les responsables d'AT&T et aucun
objectif ou ambition autre que de faire notre part pour le système
Bell".
Le besoin de centraux automatiques aux États-Unis
s'est soudainement fait sentir, mais le seul système pratique disponible
(pensaient-ils) était produit par leur concurrent AE Automatic
Electric. AT&T a ravalé sa fierté et produit l'appareillage
de commutation Strowger
d'AE sous licence. C'était étrange, car le système Rotary
était maintenant de retour en production à BTMC
et le premier centre d'après-guerre a été installé la même année,
soit au Canada, soit à Masterton en Nouvelle-Zélande.
Entre janvier 1921 et novembre 1954 le département relais parvint
à produire 1 million de relais "flat type" ce qui a nécessité 100
000 kg de fer, 25000 kg e cuivre blanc, 9000 kk de cuivre jaune, 1000
kg d'ébonite, 7000 kg d'acier, 18000 kg de fil émaillé, 6000 lg de
fibres, 2000 kg de papier, 2000 kg de coton,et 30 kg de matériaux
de contact.
Rappelez vous : En 1889 en France Welles
fonda avec G.Aboilard une société d'import de câbles téléphoniques
système Patterson. Le 6 janvier 1890 ils fondent une société au nom
collectif "G.Aboillard & Co" et installent une usine au 46 avenue
de Breteuil à Paris... après le mort de Aboillard en 1908, elle fut
appelée Le Matériel Téléphonique LMT
.
En 1912 elle introduit le Rotay en France et reçu la commande
de deux centres pour Angers qui sera mis en service en 1915 et Marseille
en 1919.
LMT met en chantier une grosse usine de fabrication à Boulogne-Billancourt,
anticipant les commandes massives à venir. Cette nouvelle usine ouvre
ses portes en 1925.
En 1926, le choix de la France se porte sur le système Rotary.
Un élément déterminant avait été entre le succés de démonstrations
du système organisé par le Belge Albert Damoiseaux, collaborateur
de Bell travaillant au Rotary depuis 1913, dans un local loué Avenue
de Breteuil à Paris. Albert Damoiseaux (a été en fonction jusqu'en
1927) supervisant le développement. De nombreux ingénieurs et techniciens
venant de différents pays collaborèrent à la construction et au développement
du central parisien et reçurent leur formation de Damoiseaux.
En septembre 1928 les 6000 lignes du centre
Rotary de Carnot à Paris
entrent en service .
Par la suite, des centraux ont été installés en Australie,
en Belgique, au Danemark, en Angleterre, en France, en Hongrie, en
Italie, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Roumanie, en Afrique du
Sud, en Suède et en Suisse.
sommaire
Dans les nouveaux ateliers loués à la Museumstraat
une nouvelle étape est franchi, avec la production d'équipements de
transmission dont les bobines de charges et les amplificateurs. (photo
à droite) Ici a été construit le premier pot de bobine de charge du
câble Bruxelles-La Panne.
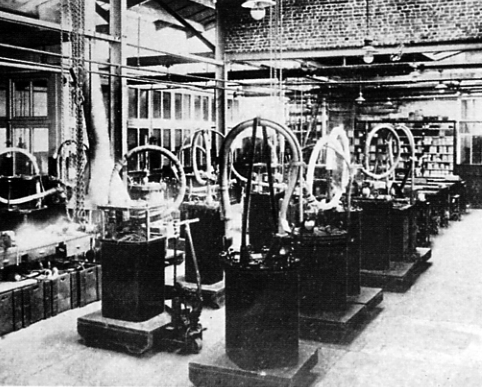
Chez AT&T, actuellement dirigé par Harry Thayer,
d'autres mouvements ont eu lieu pour consolider la coopération plus
étroite.
En 1925, Walter Gifford, pour être le prochain président
d'AT&T, a mis tous les chercheurs dans une nouvelle société appelée
Bell Telephone Laboratories Inc. Il s'agissait d'une coentreprise
AT&T et WE, avec 4000 employés. BTMC, l'un des centres de recherche
les plus puissants de WE, n'était pas impliqué. Il y avait une attitude
à l'époque chez Western Electric aux États-Unis qui a été qualifiée
de "pas inventée ici". NOUS avions tendance à ignorer tout ce qui
n'avait pas été inventé en interne. L'absence antérieure d'un système
de commutation automatique l'avait mis en évidence. McBerty avait
un bon système au Rotary, mais il a été développé en Belgique et donc
presque à l'étude.
En mars 1922 Bell dans 8 pays, avait déjà mis en service
15 centraux privés Rotary type 7000 de 400 lignes de capacité.
En 1926 furent installés les premirers centres ruraux Rotary 7D, système
économique qui connu un grand succès pour les zones peu peuplées.
 Autocommutateur
rural de Contich
Autocommutateur
rural de Contich
sommaire
C'est en 1925 que la société mère de Bell
Antwerp, Western Electric, avait un besoin urgent de
capitaux pour ne pas rater l'expansion de la téléphonie aux États-Unis.
Pour lever le capital nécessaire, Western Electric a vendu Bell Antwerp
et plusieurs autres compagnies de téléphone européennes à International
Telephone and Telegraph Corporation (ITT).
À la suite d'actions antitrust aux États-Unis, AT&T, sa société
mère, a vendu toute sa division européenne et les filiales d'IBTC
à l' International Telephone & Telegraph
Company mettant fin à une présence de 46 ans sur le continent.
Des critiques importantes à l'encontre d'AT&T (un monopole ) avaient
émergé aux États-Unis selon lesquelles les tarifs du système téléphonique
national étaient plus élevés que nécessaire et qu'AT&T utilisait
ces revenus pour subventionner ses opérations européennes. Pour cette
raison et d'autres, et également en raison de l'intervention réglementaire
du gouvernement américain, le président d'AT&T, Walter Gifford,
a cédé presque tous les intérêts internationaux détenus par le système
Bell en 1925, à l'exception de la Bell Telephone Company of Canada
et Northern Electric .
La division européenne et ses filiales ont été vendues à International
Telephone & Telegraph Company , au début de l'ascension fulgurante
de cette société dans l'industrie internationale des télécommunications.
Charles DuBois, président de WE, avait un grand
intérêt et une certaine fierté pour les opérations outre-mer de WE.
Il savait que Western Electric International avait atteint une part
de 47 % du marché de la téléphonie à l'étranger en fabriquant dans
la plupart des pays ayant une présence téléphonique importante. Il
négociait avec IT&T International
Telephone & Telegraph de Sosthenes Behn, une multinationale
qui n'opérait pas aux États-Unis, pour relier les sociétés d'exploitation
téléphonique d'IT&T aux opérations
de fabrication à l'étranger de WE. Cela renforcerait encore plus la
position internationale de WE. Les négociations étaient actuellement
au point mort et IT&T avait acheté un concurrent de WE. Il semblait
que WE devrait soit racheter IT&T, soit avoir un concurrent
majeur pour sa fabrication à l'étranger. Puis DuBois est tombé malade
et a quitté le travail pendant plusieurs mois pour récupérer.
En août 1925, Walter Gifford a orchestré la vente de Western Electric
International à IT&T, y compris BTMC et les usines européennes
WE.
Les usines ont été renommées Standard Telephones and Cables en Grande-Bretagne
et Standard Electric ailleurs.
L'usine d'Anvers, étonnamment, a conservé son nom d'origine
BTMC.
Lorsque DuBois est retourné au travail, l'affaire était conclue. Bien
qu'il soit contre toute réduction supplémentaire de la gamme de fabrication
de WE, il a été rejeté par Gifford et d'autres membres du conseil
d'administration d'AT&T. Toutes les activités de fourniture non
téléphoniques restantes de WE ont été transférées à une nouvelle société
appelée Greybar Electric Company en 1925.
WE était désormais entièrement dédiée à la production de téléphones
et toujours liée exclusivement à AT&T. C'était une position dangereusement
restreinte pour une telle entreprise.
En 1928, Greybar a été vendu à ses employés. DuBois a démissionné
de son poste de président de WE. Pour être juste envers Gifford, WE
et AT&T avaient besoin d'argent pour payer leur programme désespéré
de construction et d'installation de centraux automatiques.

Après que l'entreprise belge ait quitté le giron américain en 1925,
le nom de BTMC"Bell Telephone
Manufacturing Company" a été conservé, sans doute pour des raisons
de tradition, bien que certains témoignages affirment que cette anomalie
est née d'un oubli des avocats de l'entreprise. Dans tous les cas,
le nom Bell est resté le nom légal de l'entreprise avec le droit d'utiliser
le logo Bell.
Contrairement à la politique de contrôle centralisé
d'AT&T, IT&T accordait à ses entreprises une grande indépendance,
étant entendu qu'elles devaient bien performer dans leur propre pays.
L'intention de Behn n'était pas de faire un profit rapide, mais de
construire un réseau international de systèmes téléphoniques gérés
et fournis par ses propres entreprises. Ils coopéreraient dans des
domaines communs tels que la recherche. Initialement, une grande partie
de cette recherche était concentrée au BTMC. International
Telecommunications Laboratories Inc a été créée en tant
que société mondiale d'informatique et de technologie pour centraliser
et diffuser des informations sur les activités de toutes les filiales
d'ITT dans les différents domaines techniques.
En 1925, de sérieuses propositions de rachat
du réseau téléphonique belge sont formulées,conduisant à un débat
animé au Sénat sur l’opportunité de privatiser ou non la régie destéléphones
. Le refus finalement opposé à la vente du réseau belge mène à une
réflexion plus vaste sur les modalités d’action de l’Etat dans les
télégraphes et lestéléphones.
En plus de l'accroissement des ateliers de la Boudewijnsstraat,
il est construit une usine à Hoboken.
La chaîne de transport des pièces entre départements faisait 1200
m de long desservnt 36 stations, les plateaux pouvaient contenir jusqu'à
30 kg de charge. 
La superficie de production avait atteint 110 000 m2, la fabrication
des 50 000 produits distincts nécessitait 2400 machies.
Par la même occasion fut installé un vaste complex
sportif pour le personnel, inauguré le 13 mai 1926 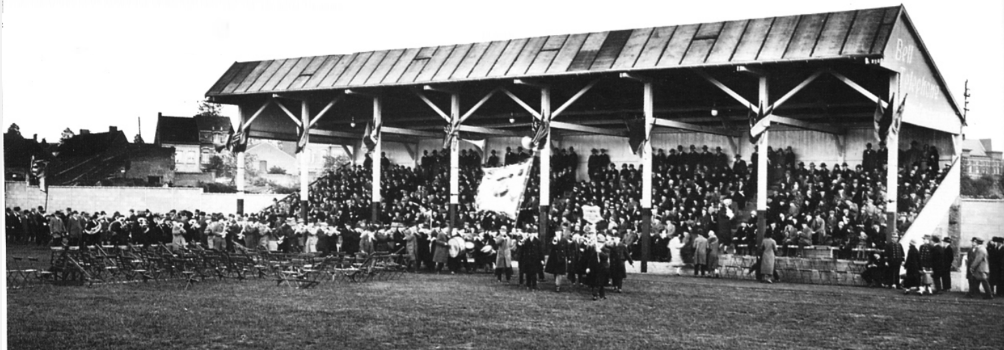
En 1926, ATEA
est rachetée par le groupe Theodore Gary, qui nomme un conseil d'administration
composé de personnalités locales influentes, de managers et d'investisseurs
britanniques et d'un ingénieur américain .
Cependant, la crise économique a laissé son empreinte
dans les années 1930.
Lorsque la récession internationale a atteint son point bas, Bell
n'avait encore que 2 700 employés. Bell tente de renverser la vapeur
en se concentrant sur le secteur des consommables durables, dont la
radio, un nouveau média qui fait alors fureur. Au cours de la même
décennie, Bell a également commencé à produire des équipements de
réfrigération, des systèmes de climatisation et même des ampoules
électriques.
En 1927 La pénétration rapide de la téléphonie automatique
dans de nombreux pays a entraîné une expansion remarquable pour Bell.
La main-d'œuvre a augmenté régulièrement, atteignant un sommet d'avant-guerre
en 1927 avec plus de 11 000 employés.
Toujours au cours de ces années dorées, le Bell Telephone Stadium,
un parc de sports et de loisirs pour les employés, a été ouvert à
Hoboken.
Par l'intermédiaire d'ITT, BTMC
a obtenu le contrat d'automatisation (partielle) et d'expansion du
réseau téléphonique espagnol.
En Belgique, ITT a tenté de reprendre le réseau belge, ce qui a été
refusé par l'État belge. BTMC
a donné la priorité à son projet espagnol et a retardé les livraisons
en Belgique.
En 1928, ils sont parvenus à un accord et BTMC
a reçu un contrat de 10 ans pour fournir des centraux rotatifs au
réseau belge. (En 1932, ATEA a également obtenu un contrat similaire.)
Comme de nombreux autres pays, le gouvernement belge a jugé important
de soutenir leurs industries locales.
Le Rotary 7A fut amélioré en remplaçant la commande
par friction par la commande à engrenage.
La nouvelle version le 7A1 avait aussi un combineur horizontale et
un nouveau type de chercheur.
Malgrè la récession économique des années 30, les progrès ne s'arrêtent
pas, la version 7A2 beaucoup plus simple et tenant 30% moins de place
est mis au point. Il fut installé à BUCAREST.
En même temps, l’évolution de la radiodiffusion impose
également à l’Etat deprendre des initiatives et de réfléchir à son
rôle dans cette nouvelle activité. Cela conduit àl’adoption d’un impressionnant
train de réforme en 1930. Cinq lois fondamentales sont promulguées
cette année-là en matière de télécommunications, qui consacrent le
rôle exclusif de l’Etat dans ce secteur pour plusieurs décennies.
La régie des télégraphes et des
téléphones (loi du 19 juillet 1930)
| Les nouvelles exigences du marché de la
téléphonie
Jusqu’au début du XXème siècle,
le téléphone resta l’apanage d’une minorité.
Toutefois, la demande de raccordements téléphoniques
augmenta progressivement, surtout après 1918. De plus,
la technologie effectua des progrès substantiels. L’administration
des téléphones dut assurer le passage du réseau
manuel à un réseau automatique. Elle dut également
transformer le système des câbles et des fils par
le placement de câbles souterrains. Cela impliquait des
investissements importants que l’Etat effectua pendant
l’entre-deux-guerres. Très vite, cependant, l’administration
se trouva à court de moyens financiers. L’intégration
de son budget dans celui de l’Etat limitait ses moyens
d’action. De plus, l’administration ne pouvait pas
contracter d’emprunts. En fait, son organisation interne
ne suffisait plus pour répondre aux exigences de modernisation
et d’expansion imposées par le développement
du marché.
La proposition de rachat du réseau téléphonique
belge par un opérateur privé étranger parut
un moment tentante. Cela pouvait permettre de renflouer les
caisses de l’Etat Cette proposition fut néanmoins
rejetée pour les mêmes raisons que la proposition
alternative de retour au système de concession. L’Etat
se serait écarté de sa mission : assurer lui-même
un service public et contrôler les aspects économiques
du réseau téléphonique. Dans ce contacte
changeant, l’exploitation du réseau téléphonique
nécessitait une structure ayant une capacité de
gestion autonome et la souplesse d’une entreprise industrielle
et commerciale. A cette fin la loi du 19 juillet 1930
instaura le régime juridique de régie autonome.
La Régie des télégraphes et des téléphones-RTT
naissait.
La création de la Régie des télégraphes
et des téléphones-RTT
La situation mena à une refonte de l’Administration
des télégraphes et des téléphones
afin de l’adapter aux besoins de l’avenir. Le nouveau
régime juridique de la régie autonome devait doter
l’organisme des téléphones d’une capacité
financière importante et d’un mode de gestion plus
efficace et flexible. Le gouvernement ayant exclu le recours
à des opérateurs privés pour cause d’incompatibilité
avec la notion de service public qui incombe à l’Etat,
le législateur a voulu répondre aux exigences
d’une exploitation commerciale tout en sauvegardant les
droits de l’Etat et du Parlement. La régie reste
cependant une administration de l’Etat, même s’il
s’agit d’une administration personnalisée,
c’est-à-dire dotée d’une personnalité
juridique distincte.
L’Etat cédait la propriété des installations
et des réseaux publics à la régie, qui
disposait d’une personnalité juridique distincte
de celle de l’Etat. Cela permettait à la RTT de
tenir une comptabilité séparée de celle
de l’Etat et de bénéficier d’une autonomie
financière et administrative. La RTT détenait
un patrimoine propre. Elle avait la responsabilité entière
de ses moyens financiers. Elle devait veiller à sa rentabilité
et, en principe, ne pouvait recevoir aucune contribution de
l’Etat.
Par l’introduction d’une comptabilité industrielle
à partie double, la RTT devait être capable d’identifier
la rentabilité du service rendu. Comme on l’avait
souligné alors, cela "résultera probablement
vers une modification à la hausse des tarifs justifiée
par l’identification du prix de revient du service, comprenant
les charges de l’entreprise et l’utilité plus
grande que représentera l’utilisation du téléphone
pour l’abonné. Pour faire face aux investissements
à plus long terme à réaliser dans le cadre
de l’évolution technologique, la RTT devait prévoir
l’alimentation d’un fonds d’amortissement. Ce
dernier devait permettre en temps voulu le renouvellement des
installations et du matériel devenus improductifs. De
plus, sa capacité financière pouvait être
accrue par la souscription d’emprunts.
Les mesures à prendre dans le cadre de cette gestion
commerciale restaient soumises à la décision du
ministre ayant les télégraphes et les téléphones
dans ses attributions. Il détenait en effet tous les
pouvoirs de gestion. Le Parlement avait un droit de regard sur
le compte de prévisions qui est soumis annuellement à
son approbation. Si la RTT voulait souscrire un emprunt, elle
devait obtenir l’approbation du ministre des Finances.
Les missions du service public
La mission de la RTT consistait à exploiter,
dans l’intérêt général, avec
application des méthodes industrielles et commerciales,
la télégraphie et de la téléphonie
avec et sans fil. Elle devait accomplir cette mission dans le
respect des trois principes du service public :
le principe de continuité évitant toute interruption
du service ;
le principe d’égalité requérant un
traitement égal pour tous les usagers se trouvant dans
les mêmes conditions ainsi qu’une opportunité
égale offerte aux fournisseurs par des appels d’offre
;
le principe d’adaptation du service offert par la régie,
dans l’intérêt général, pour
répondre aux besoins nouveaux des usagers.
Pour remplir sa mission, la régie bénéficiait
d’un monopole sur l’établissement et l’exploitation,
pour la correspondance du public, des lignes et des bureaux
téléphoniques. Elle détenait ainsi l’exclusivité
des services de communication à caractère public.
Etaient considérés comme services à caractère
public essentiellement les services de la téléphonie
vocale.
La montée des problèmes dans le cadre de la Régie
Au fil des décennies, le fonctionnement de la RTT a toutefois
suscité plusieurs difficultés. D’abord, les
autorités politiques lui ont parfois donné des
fonctions contradictoires. Ensuite, au fur et à mesure
que des nouveaux procédés se développaient,
son contrôle est apparu de plus en plus négatif.
Enfin, la bureaucratisation a fortement réduit l’efficacité
du service public.
La confusion des fonctions économiques
L’autonomie attribuée à la
RTT restait malgré tout relative. D’abord, le contrôle
parlementaire et la nécessaire approbation de la souscription
d’emprunts par le gouvernement limitaient fortement la
capacité d’action de la RTT. Ensuite, le contrôle
de ses plans d’investissement par le gouvernement soumettait
son activité aux aléas de la situation politique.
Sa stratégie générale demeurait dans les
mains de l’Etat. Pendant les périodes d’instabilité
politique, les décisions prises pouvaient manquer de
constance et de perspective de long terme.
Enfin, dans pareil contexte, le ministre compétent
pouvait écarter la régie de sa mission première
de service public pour répondre à un besoin d’instruments
de politique économique. De fait, la RTT assuma un rôle
économique de plus en plus important. D’une part,
elle permettait de créer directement des emplois. D’autre
part, le développement du réseau permettait de
soutenir indirectement la production industrielle. Pendant les
années 1960, une politique d’investissement intensive
porta la Belgique à la pointe du secteur de télécommunications
en Europe. Néanmoins, ce rythme d’investissements
ne pouvait être maintenu spécialement en période
de croissance plus faible. A partir de la crise de 1973, les
ressources de la RTT connurent un affaissement certain.
Dans ce cadre, il convient d’évoquer
aussi les faveurs de plus en plus grandes concédées
par la RTT à son principal fournisseur. La loi du 19
juillet 1930 permettait à la régie de conclure
des contrats à long terme avec des producteurs de fournitures
nécessaires à l’exploitation des télégraphes
et des téléphones (article 19 alinéa 3).
Cette disposition mena en pratique à une relation de
dépendance réciproque entre la régie et
son fournisseur privilégié, Bell Company [41].
D’une part, Bell représentait un potentiel économique
et technologique considérable pour la RTT. D’autre
part, la RTT représentait un marché sûr
pour Bell Company. Les contrats de fourniture furent agrémentés
de partenariats dans la recherche. La RTT investit dans la recherche
réalisée par Bell Company. A terme, la balance
pencha en faveur du fournisseur qui pratiqua des prix élevés
mettant au maximum à profit sa situation de monopole.
Cette situation n’arrangea pas les problèmes financiers
qui menacèrent la régie à partir des années
1970.
Pour accroître les ressources disponibles,
la loi du 7 décembre 1984 avait modifié l’article
1 de la loi du 19 juillet 1930 et permis à la RTT de
s’associer au secteur privé. Cette disposition offrait
des possibilités à la RTT pour financer le développement
de ses activités. Elle pouvait prendre des participations
dans des organismes ou des sociétés publics ou
privés, existants ou à créer, belges, étrangers
ou internationaux. Néanmoins, cette participation devait
toujours être majoritaire lorsqu’il s’agissait
de son infrastructure. La RTT demeurait donc toujours l’investisseur
principal.
La confusion des rôles économique et réglementaire
La régie définissait les normes
techniques auxquelles les équipements de raccordement
au réseau public devaient satisfaire. Elle seule avait
le pouvoir d’agréation de ces équipements.
Selon l’article 4 alinéa 6 de la loi du 19 juillet
1930, le gouvernement pouvait assermenter des agents de la régie
et leur conférer la qualité d’agents de police
judiciaire. En cas de violation des prescriptions en matière
de normes, la régie pouvait sanctionner directement.
En pratique, la régie déterminait
quels types de terminaux pouvaient être commercialisés.
Même si leur fourniture par un tiers était autorisée,
ces terminaux devaient obtenir son autorisation pour être
connectés au réseau public. Cette autorisation
était rarement donnée. La régie préférait
fournir elle-même la connexion entre le réseau
public et l’abonné. Elle jouait ainsi à la
fois le rôle de juge et de partie. Cette situation menait
à une extension de facto du monopole aux terminaux et
à leur raccordement au réseau public.
Les manquements à la fourniture de service public
Dans la réalité quotidienne, la
prestation du service public n’a pas toujours rencontré
les souhaits du public. Les principes ont été
fortement tempérés par l’absence de responsabilité
de la régie dans le cadre de ses activités. Le
mauvais fonctionnement des lignes et des changements dans les
services rendus ne pouvaient en aucun cas entraîner une
possibilité de recours des usagers. Cette exonération
de responsabilité n’incitait pas les agents à
un comportement commercial. L’intervention politique des
cabinets ministériels et des parlementaires a fini par
s’immiscer dans les services les plus simples, comme l’installation
d’une ligne (qui pouvait attendre des mois dans certains
cas).
Le régime de la régie autonome
avait été instauré par l’Etat parce
que les autorités politiques estimaient que les mécanismes
du marché ne mènent pas spontanément aux
résultats économiques et sociaux souhaités
pour les télécommunications. Néanmoins,
la définition vague de ce monopole a été
étendue en amont et en aval de l’activité
économique générale liée aux télécommunications.
En amont, la dépendance de la RTT face à son fournisseur
la contraignait à augmenter ses prix. En aval, son pouvoir
d’agréation lui permettait de fixer les règles
du marché des terminaux. L’absence de responsabilité
de la RTT lui accordait le contrôle complet de la qualité.
Cet état des choses mena à une pratique de prix
élevés, un manque d’initiative innovatrice
et un faible niveau de qualité. Le monopole public a
ainsi révélé ses faiblesses, bien après
le monopole privé. L’accélération
des évolutions technologiques a rendu l’inadéquation
des mécanismes de la loi de 1930 encore plus visible.
|
sommaire
En 1932 fut célebré le cinquantenaire de l'entreprise, sans
grand éclat, étant donné la période crise mondiale.
 1932 Visite
du Roi Albert au centenaire..
1932 Visite
du Roi Albert au centenaire..
En 1934 l'usine de Hoboken fut fermée.. Pendant
cette période pour minimiser les les licenciements il fut pratiqué
une politique de mise à la pension anticipée avec dédommagements,
et en 1934 l'effectif était ramené à 2700.
C'est en 1935 que le système 7A2
prend de l'importance avec l'extension du réseau de Rio de Janeio
et avant la Seconde Guerre mondiale, il a été
installé en Belgique, au Brésil, au Pérou, au Mexique, en Norvège,
au Danemark, en Nouvelle-Zélande et en Égypte.
Le 26 avril 1935 Leo Va Dick est nommé directeur général, puis
en novembe il devint également administrateur-délégué

À la fin de 1938, 2 120 000 lignes rotatives
étaient installées dans 41 pays.
|
La Radio
Dans le cadre de son programme de diversification, en pleine
crise économique, la Bell porta ses efoorts sur le domaine de
la Radio, le récepteurs, les hauts parleurs, les stations émetrices
de radio.
La mise en place d'instalations PAS "Public Address System"
fait fureaur et devint une nouvelle activité. Il y eut des manifestations
des émissions radiophoniques publiques de plusieurs milliers
de personnes au centre de la ville à l'occasion de grands matches
de foot ...

|
 |
Ces appareils radiophoniques étaient des produits
saisonniers, la demande était concentrée de l'automne et d'hiver .
Il fallu chercher un produit d'été et le choix se porta sur les installations
de réfrigération, le conditionnement d'air à usage industriel et domestique.
Ces produits pouvaient être fabriqués avec les outils des ateliers
existants.
En 1938 le centre de radiodiffusion de Bruxelles fut une réussite,
il y avait à cette époque 173 stations émettrices en service fabriquées
à Anvers.
Il y avait aussi des différents systèmes par courants porteurs dont
la première entre La Panne en Belgique et St.Margarets au Royaume-Uni.
 Système à
courants porteurs
Système à
courants porteurs
Table de mixage de station radio
sommaire
Avant guerre en 1927 il y avait 11 122 collaborateurs
dans l'entreprise.
1939 Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la
décision fut prise de trandférer en Scandinavie et aux Etats-Unis
un certain nombre de machines et d'outils de production des centraux
7A et 7D. La charge de fabrication a été reprise par les autres sociétés
d'ITT.
La Belgique a de nouveau été envahie et les exportations de BTMC
et de France ont été fermées.
Le 10 mai 1940 il fut décidé d'éteindre les chaudières pour éviter
les risques d'explosion en cas de bombardements. Près de 500 caisses
d'appareils, d'outils et modèles de laboratoire furent expédiés en
France.
Plus de 1000 travailleurs furent mobilisés.
Nombreux étaient les travailleus qui avaient pris la fuite. Le 5 juillet
1940 il ne restait que 63 employés et 141 ouvriers. Fin aôut le nombre
étaitpassé à 2300.
Le 1er mai 1942 Bell fut placé sous l'administration de l'occupant.
en octobre 2500 es 5700 membres du personnel furent requis pour le
travail obligatoire en Allemagne mais ramené à 300 après des négociations
ardues.
A la libération en 1944 les usines Bell d'Anvers et
de Hoboken échappèrent à toute dévastation compte tenu du départ précipité
de l'occupant.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, une nouvelle
période de croissance semble imminente, mais pour cela Bell devra
attendre 1945.
En 1947/48, les commandes dépassent largement
la capacité de production et divers ateliers de production doivent
être temporairement loués.
Pour cette raison, une usine a été construite à Hoboken en 1948.
ITT a créé la société Federal Telephone and Radio aux
États-Unis et y a commencé la production. Cette usine était destinée
à approvisionner leurs marchés en Amérique latine, mais a également
approvisionné des marchés comme l'Australie après la guerre jusqu'à
ce que les entreprises locales puissent se redresser.

Sosthenes Behn a pris sa retraite en tant que président d'ITT
en 1956. Il est décédé l'année suivante à l'âge de 75 ans. Sa mort
est passée largement inaperçue. Dans le monde entier, le rôle d'ITT
est toujours débattu en termes historiques. C'était l'une des premières
multinationales au monde et, par conséquent, ses entreprises se sont
impliquées des deux côtés dans un certain nombre de guerres.
Il a aidé à développer une industrie électrique moderne dans de nombreux
pays. La même année, la première liaison internationale entièrement
automatique entre Bruxelles et Paris est installée. La partie belge
a été prise en charge par BTMC.
Fin 1954 l'effectif était revenun à plus de 8000 et
ce chiffre allait encore s'accroître les années suivantes.
Dès le début des années 50 arrive les premières commandes
de nouveaux systèmes 7E et ME (plus atd 8A et 8B), système ou l'électronique
faisait son entrée. Les système 8A et 8B sont vite abandonnés au profit
des commutateurs Crossbar.
Le Telex allait ouvrir à Bell un nouveau domaine.
La nouvelle direction d'ITT a décidé de réduire une grande partie
de ses recherches dans certains domaines de l'électronique grand public
pour se concentrer sur la téléphonie.
sommaire
Le 24 octobre 1953 à 14 heures, 2000
abonnés du réseau de Liège sont raccordés
à un nouveau centre automatique !
A partir de ce moment, les numéros d’appel
de ces abonnés sont modifiés. Les mentions de ces abonnés
figurent pour la dernière fois avec leur nouveau et leur ancien
numéro. C’est ainsi que pour les réseaux de Liège,
Aywaille, Comblain-au-Pont, Engis, Esneux, Fexhe-le-Haut-Clocher,
Micheroux, Trooz et Visé, il faut former le numéro d’appel
de l’abonné. Par contre, pour Anthisnes, Bassenge, Blegny,
Louveigné, ROTHEUX-RIMIERE, Sprimont, Verlaine, Villers-l’Evêque
et Warsage, il faut former le numéro mentionné en regard
du nom du bureau intéressé. A l’agent qui répond
à l’appel, il faut encore indiquer le numéro du
correspondant. Mais pour la première fois, Rotheux-Rimière
hérite du 04/71.44.22.
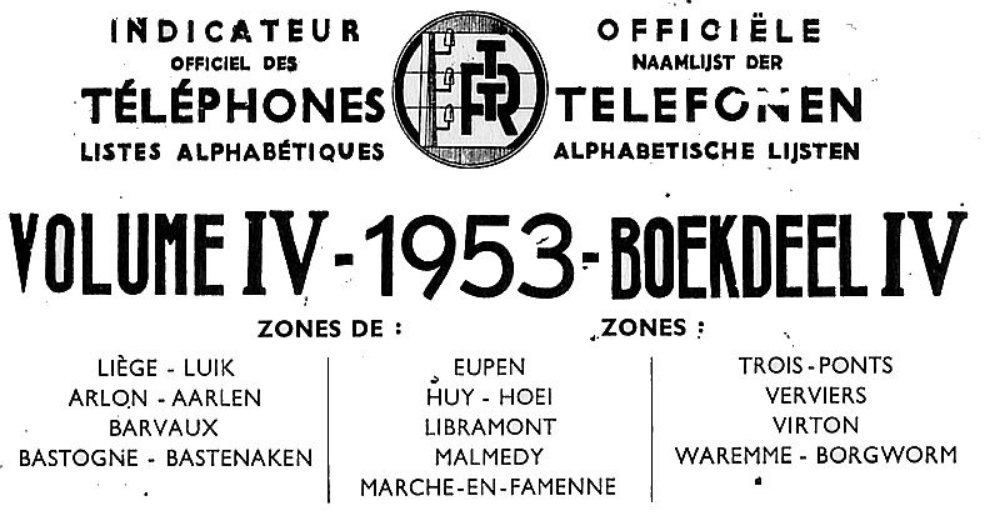
En 1953, la Belgique est divisée en cinq zones : Bruxelles
(I), Gand (II), Anvers (III), Liège-Luxembourg (IV), Mons,
Charleroi, Namur (V). Chaque tome (5 parties) représente la
division en zones (ex. Eupen, Huy, Barvaux ou Libramont). Chaque zone
est divisée en secteurs (ex. Rotheux, Houffalize, Spontin ou
Mouscron). Ajoutons enfin qu’il existe des bureaux téléphoniques,
centres de zones (ex. Liège, Verviers, Bastogne ou Arlon) et
des bureaux téléphoniques (ex. Rotheux, Esneux, Sprimont
ou Anthisnes).
Parlons à présent des secours (hulp in Vlaanderen).
D’abord en cas d’incendies graves, d’explosions, d’inondations,
de sinistres de toutes natures il faut donner votre numéro
de téléphone au poste que vous alertez. Sur le territoire
belge, il faut appeler le Corps National de Secours qui intervient
à la requête d’une autorité civile ou militaire.
Pour un SOS urgent il faut former le 34.80.97, le 34.80.98 ou le 34.80.99…la
maison a le temps de brûler ! En cas d’accident d’avion,
il faut aviser l’aérodrome national de Bruxelles au 12.88.05
ou les postes de secours les plus proches (police, pompiers, gendarmerie).
Et là rien n’est simple non plus ; il faudrait presque
un mini bottin téléphonique dans son portefeuille…
Ainsi, par exemple, dans la région de Liège, pour appeler
les pompiers il faut faire le 23.23.21 mais à Seraing, le 34.09.53,
à Herstal le 66.09.73, à Jemeppe le 33.94.39 ou encore
à Flémalle le 33.94.39. Si la catastrophe a lieu à
Sclessin, on est perdu ! Si on veut appeler la police dans cette même
zone on a plus de chance car il y a 14 numéros à retenir.
Pour Sclessin, cela se complique puisque on peut appeler Tilleur,
Saint-Nicolas ou encore Montegnée ! Quant à la Gendarmerie,
c’est plus simple, mais ils arriveront moins vite car les bureaux
sont situés à Chênée, Fexhe-Slins, Flémalle-Haute,
Fléron, Hollogne-aux-Pierres et Wandre. Le temps de choisir
et notre maison est en cendres…
Particularités linguistiques
Allo ! Je ne vous entends pas. Articulez SVP ou plutôt épelez
le nom que vous voulez me donner. Là aussi, il faut respecter
les consignes et l’indiquer dans son petit bottin. Arthur, Bruxelles,
Caroline, Désiré, Emile, Frédéric, Gustave,
Henri, Isidore, Joseph, Kilogramme, Léopold, Marie, Napoléon,
Oscar, Piano, Quiévrain, Robert, Suzanne, Téléphone,
Ursule, Victor, Waterloo, Xavier, Yvonne, Zéro. Bref, imaginez
devoir épeler le nom du cousin Arthur-Valentin Vandepyperzeele
de Wezembeek-Oppem ! Soulignons aussi que les mots usités sont
évidemment quasi les mêmes en néerlandais…
Ainsi, quand il y a doute sur l’audition d’un mot, il convient
de l’épeler en disant Marie Emile Marie Oscar Isidore
Robert Emile Désiré Emile Napoléon Emile Ursule
Piano Robert Emile (tout cela pour mémoire de Neupré
!).
Le monde à portée de cornet !
Les relations téléphoniques sont évidemment ouvertes
avec tous les pays européens et même mondiaux, à
l’exception de l’Albanie. Les taxes diffèrent évidemment
suivant les pays en relation.
Par exemple, pour une période de trois minutes, on paie 24
francs pour Lille, 93 pour Berlin, 174 pour Gibraltar, 192 pour Helsinki
et même 198 pour le Vatican (ils ne perdront jamais le nord…).
Quand il s’agit de communications « urgentes », double
tarif, quand elles sont « éclair », triple tarif,
on va quand même pas se gêner surtout quand grand-maman
est mourante et qu’il faut expliquer en détail ce qui
est arrivé… Mais examinons aussi les pays « extra-européens
» car si vous avez une communication éclair à
destination de la Bolivie, il vous en coûtera 3006 francs !
Par contre, si vous souhaitez téléphoner en Chine, en
Mongolie, ou au Vietnam, c’est impossible. Par ailleurs, je vous
conseille la Nouvelle-Zélande (480 francs), le Congo belge
(294 francs) ou encore les Açores (288 francs). Il est même
possible de téléphoner à des bateaux soit par
l’intermédiaire de la station d’Ostende, soit par
celle d’Anvers,… cela dépend d’où le
bateau est parti ! Avec un bateau étranger, je cite : «
la taxe varie suivant la nature du bateau et la distance à
laquelle il se trouve » (sic). Sans blague… Les paquebots
sont évidemment accessibles comme les belges Albertville, Armand
Grisar, Baudouinville, Charlesville, Copacabana, Elisabethville, Gouverneur
Galopin, Léopoldville ou Mar del Plata. Les paquebots américains,
britanniques, français, italiens, néerlandais et même
norvégien (le Oslofjord, très cher au-delà de
35° de longitude ouest).
Un annuaire exhaustif
Comme chacun d’entre vous s’en doute, les renseignements
contenus dans l’annuaire sont d’une précision d’horloger.
C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit de payer. Tarifs
téléphoniques, abonnements, appareils accessoires (commutateur
à manettes, microphone de poitrine, cordon à deux fiches,
annonciateur, générateur magnétique, vibrateur
d’appel,…), communications de toutes nature à l’intérieur
du pays ; tous ces services font grimper votre facture de façon
impressionnante. Téléphoner est un luxe. Quant aux indications
techniques figurant sur les fiches annexées aux relevés
de compte des abonnés, elles comprennent sur le ticket l’indicatif
interurbain, le numéro appelé, le numéro appelant,
la taxe unitaire par trois minutes, l’indication de service,
la date, l’heure précise, le nombre de minutes de communication.
Quant aux services spéciaux, n’hésitez pas à
les utiliser mais faites-le à dosage homéopathique car
que ce soit le service de réveil (achetez plutôt un réveil),
le service des « abonnées absents » ou l’horloge
parlante (achetez une bonne montre), ils entraîneront votre
facture mensuelle vers des sommets alpins voire himalayens.
Plus on paye, plus on a de renseignements. Ainsi, l’adjonction
d’un texte nécessitant l’emploi d’une ou plusieurs
lignes de texte supplémentaires, l’insertion de mentions
supplémentaires sous des vocables désignant son commerce
ou son industrie, le grossissement de son inscription ou d’une
partie de celle-ci au moyen de grandes lettres, l’inscription
d’une mention concernant une tierce personne habitant le même
immeuble… Quant aux annonces et réclames, gérées
par la firme « Publi-télé » elles varient
selon la demande, de la petite annonce à 1.000 francs (8 lignes
de texte) à la page entière (21.000 francs par volume…),
tout est possible. Notons que la Banque de Paris et des Pays-Bas (future)
Paribas investit en demi-page et que (il faut le supposer) l’entreprise
la plus florissante sont les macaronis Soubry (seule pleine page).
Des recommandations originales et particulières
En page 39 de l’annuaire, une page spéciale en corps grands
et gras donne des renseignements et des informations essentielles.
Si vous appelez d’un poste automatique, formez votre numéro
avec soin. Répondez immédiatement aux appels en énonçant
votre numéro ou votre nom. Si, par suite d’un encombrement,
l’un des services spéciaux ne répond pas immédiatement,
ne raccrochez pas prématurément pour renouveler vos
appels, sinon le bénéfice de votre première attente
est perdu. Enoncez vos demandes de la manière la plus concise.
Ne vous servez pas du téléphone pendant un orage. J’en
passe et des meilleures…
Retour à Rotheux
Après ces pérégrinations à travers les
règlementations officielles, techniques et pratiques, il est
temps de revenir à la maison, à Rotheux en particulier
puisque Rotheux-Rimière possède un bureau téléphonique
central. Il rassemble les abonnés de Petit-Berleur, Tavier,
Ehein, Saint-Séverin, Neuville-en-Condroz, Plainevaux, Limont,
La Vaux, Bonsgnée, Rimière, Englebermont, Nandrin, Cokaipré,
Sotrez, Berleur, Yvoz, Angoxhe, Fraineux, Ramet et Rotheux.
Les numéros de 1 à 10 sont : Administration communale
de Rotheux (1), Hôtel Neupré , Paquay (2), Café
du Centre de Limont, Jules Pirlot (3), Jules Aerts de Berleur (4),
le château de L. Braconier (5), les cultivateurs Deville-Wathieux
à Sotrez (6), le 7 est inconnu au bataillon, le 8 c’est
chez de Villenfagne à Saint-Séverin, tandis que le 9
appartient à J. Gony, agent de change à Neuville et
le 10 à personne ! Le 13 est le numéro de l’assureur
Clovis Parent. On dénombre 270 numéros au total (moins
ceux qui ne sont pas attribués). Trois médecins sont
inscrits : Léon Pierquin à Plainevaux (269), Albert
Souris (56) et Denis Varlet (tous deux de Rotheux). On peut se faire
coiffer chez Prosper Antoine (132), Marcel Briers (148), ou chez Peeters
(255) à Neuville. Si on a soif, on a le choix : Madame J. Aimont
(101) est liquoriste, Laurent Berger tient le café Bodega (77)
à Plainevaux, Julia Daper vous sert au café du Bon Accueil
à Neuville, A. Lacroix vend des vins et des spiritueux (178)
à Saint-Séverin, Léon Leroux tient son café
(190) et une quincaillerie !, tandis que Jules Pirlot est installé
à Limont , au Café du Centre (3) tout comme la veuve
Servais (228), limontoise aussi.
En bref, on trouve de tout, quatre curés, des boulangers, des
bouchers-charcutiers, des garagistes (cinq), des cultivateurs, des
fermiers, une accoucheuse, des assureurs, des menuisiers, un notaire,
des meuniers, et même un représentant en … VIA…KA
! ( ?)
Pour terminer, prévenons le lecteur que si il souhaite faire
apparaître une mention, il vaut mieux qu’il s’adresse
à la Régie des T. et T. et non à l’imprimeur…
Cela aussi il fallait l’inventer !
sommaire
L'un des résultats de la nouvelle politique, a été
la création du premier l'ordinateur, la Machine mathématique
IRSIA-FNRS. Il a été repensé pour gérer la commutation et
le contrôle téléphoniques dans le cadre d'un projet conjoint entre
diverses sociétés Standard Electric, BTMC et les PTT néerlandais.
Bien qu'alimenté par des tubes à vide et des bandes de papier perforées,
c'était clairement la voie de l'avenir. Des versions ultérieures ont
été développées en utilisant le nouveau transistor.
En 1950 le développement d'une machine à calculer électronique
fut confié à Bell, ces travaux allaient durer 5 ans , et
le 21 janvier 1955, le Roi Baudouin est venu visiter le premier
ordinateur construit en Belgique.
On ne peut parler des débuts de l'informatique en Belgique sans évoquer
Vitold Belevitch, figure remarquable du monde scientifique
belge.
Vitold Belevitch (1921-1999) était un mathématicien et ingénieur électricien
belge d'origine russe qui a produit des travaux importants dans le
domaine de la théorie des réseaux électriques. Né de parents fuyant
les bolcheviks, il s'installe en Belgique où il travaille sur les
premiers projets de construction d'ordinateurs.
|

Vitold Belevitch.
|
V. Belevitch fut nommé
docteur en sciences appliquées de l'UCL en 1945. Il avait passé
une partie de la guerre aux US où il avait poursuivi ses études.
Il édita plusieurs ouvrages, dont le plus important concernait
une théorie des circuits classique, publié en 1968. Il était professeur
à l'UCL (Ecoles Spéciales) en théorie des circuits. Il a travaillé
dans le domaine de l'électronique pour calculateurs depuis 1951
à la demande du gouvernement Belge . En plus de ses activités
il était responsable du laboratoire des transmissions à
BTMC (Bell
Telephone Mg), ou il a travaillé intensément à la conception
d'un premier ordinateur, lequel a été développé entre
1951 et 1956 à BMTC.
Le but de ce programme était de "rattraper" les progrès réalisés
dans le monde anglophone pendant la guerre. Il aboutit à la construction
de la Machine mathématique IRSIA-FNRS appelée MMFI .
A partir de 1952, Belevitch représente le volet électrotechnique
de ce projet. En 1955, Belevitch devint directeur du Centre belge
de calcul (Comité d'Étude et d'Exploitation des Calculateurs Électroniques)
à Bruxelles qui exploitait cet ordinateur pour le gouvernement.
En 1963, Belevitch est devenu le chef du nouveau Laboratoire de
Recherche MBLE (plus tard Philips Research Laboratories Belgium)
sous la direction du directeur de la recherche Philips Hendrik
Casimir à Eindhoven. Cette installation s'est spécialisée dans
les mathématiques appliquées pour Philips et a été fortement impliquée
dans la recherche informatique. Belevitch est resté à ce poste
jusqu'à sa retraite en novembre 1984. |
| Depuis est paru la monographie réalisée par Marie
d'Udekem Gevers, intitulée "La Machine mathématique IRSIA-FNRS
(1946-1962), monographie éditée en 2011 par l'Académie Royale
de Belgique accéssible
en pdf ici |
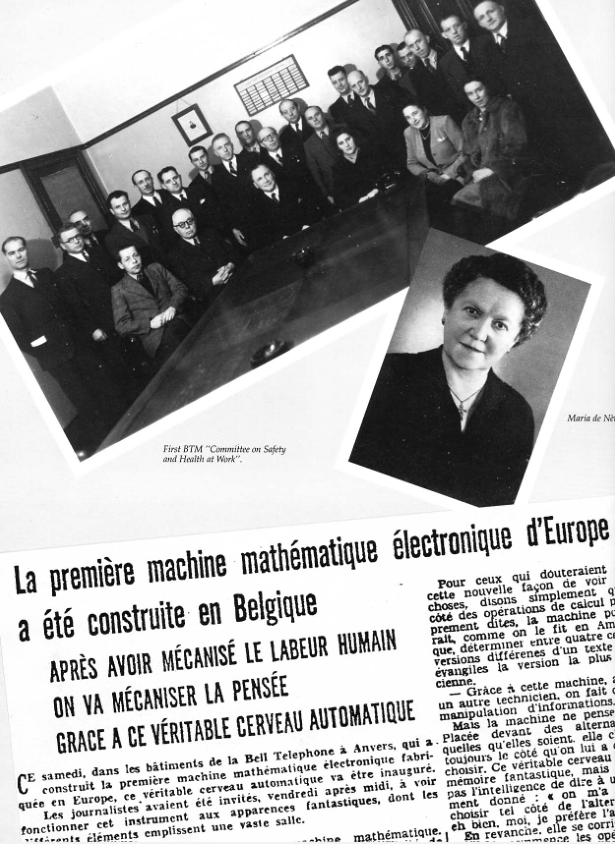

Coupure de presse (extraite d’un journal non identifié)
Dans le cadre, Maria de Nève le 31 décembre 1954 atteint l'age
de la retraite après 45 ans de carrière, la plus longue enregistrée
par une femme dans l'entreprise Bell.
La rétrospective publiée par Bell en 1982 lors de
son centenaire contient la phrase suivante « S.M. le Roi Baudouin
s’intéressa de près à ce projet et visita le 21 janvier 1955 le premier
ordinateur construit en Belgique ». Le même document offre la photo
reprise ci-dessous. On y voit de gauche à droite : le Roi Baudouin
, M. Linsman (de face), et deux autre personnes dont l’identité est
controversée.
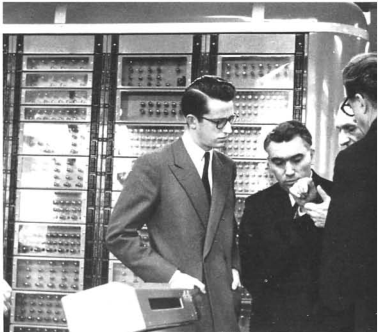
Revenons en 1955 à cette présentation voila ce
qu'écrivait la presse :
"La première machine mathématique électronique d'Europe à été construite
en Belgique. Après avoir mécanisé le labeur humain on va mécaniser
la pensée grâce à ce véritable cerveau automatique.
La découverte et la réalisation de ces machines électroniques marqueront
en effet profondémenrt les années qui viennent. Une véritable révolution
scientifique est en marche . Elle dégagera notre imagination créatrice
des tâches souvent écrasantes qui freinent le développement de notre
pensée.
Abandonnons à ces appareils les calculs fastidieux, les montagnes
de chiffres, la détection des erreurs ... Réservons nous toute la
partie noble de la pensée. Négliger cette aide serait refuser son
temps"
Cette visite est qualifiée de « privée » dans le journal anversois
La Métropole du 14 février 1955.
Passons en revue les titres de différents journaux, saluant cet événement
:
• « Un cerveau électronique construit à Anvers. Visite incognito du
Roi » : souligne La Nation Belge (samedi 22 janvier 1955) ;
• « Le Roi s’intéresse au cerveau électronique d’Anvers » titre La
Libre Belgique (22 janvier 1955) ;
• « Visite royale à Anvers – Le Souverain a examiné la plus grande
machine électronique d’Europe » annonce La Métropole du 22-23 janvier.
L'exploitation expérimentale de la MMIF initiale (17 baies) dure jusqu’au
1 novembre 1955 ; s'en suit le démantèlement de la machine dès le
1 novembre, et la reconstruction dans la nouvelle tour Bell sous une
forme étendue (au final comportant 34 baies) et achèvée en fin décembre
1956 . Suivi la Phase de tests de la MMIF et de corrections des routines
jusqu’à fin mars 1957. L'une des premières tâches auxquelles il a
été confié a été le calcul des fonctions de Bessel. Belevitch a utilisé
cette machine pour étudier les fonctions transcendantales.
sommaire
1954"Den Bell" ou la tanière Bell
Aujourd'hui la tour Bell de Anvers est un bâtiment historique d'Anvers
Sud, sur la Francis Wellesplein. Le bâtiment sert de bâtiment administratif
de la ville d'Anvers (OCMW et diverses entreprises municipales autonomes),
mais n'est pas destiné aux services directs aux habitants ou aux entreprises
.
Le 26 avril 1954 fut posée la première pierre et la tour fut inaugurée
2 ans plus tard.
La pièce maîtresse de l'entreprise est la tour impressionnante de
14 étages et 58 mètres de haut surplombant la Bresstraat.
Le bâtiment abritait des bureaux et un centre administratif de l'entreprise
et est une réalisation importante de l'architecte Hugo Van Kuyck.
Il a également réalisé l'immeuble de bureaux de la Sint-Laureisstraat,
qui a été ajouté à la tour, dans le respect du style et de la hauteur
de construction des bâtiments existants.



Lorsqu'Alcatel Bell a quitté le bâtiment en 2006, les autorités municipales
ont décidé de transformer le complexe d'une surface de pas moins de
21 400 m² en leur immeuble de bureaux central.

sommaire
1956 LCT (Laboratoire
de recherche en France) la BTMC,
construit un petit autocommutateur électronique à 20 lignes pour la
Marine.
|
Central téléphonique automatique privé électronique
à 20 lignes.
DÉVELOPPÉ et fabriqué par le LCT
Laboratoire Central de Télécommunications, Paris, et par BTMC
Bell Téléphone Manufacturing Company, Anvers.
C'est un autocommutateur privé entièrement électronique de 20
lignes il était au centre de l'intérêt du pavillon de
Bell à l'Exposition universelle de 1958 à Bruxelles.
La photographie d'illustration montre des visiteurs qui s'appelaient
continuellement les uns les autres en utilisant les téléphones
sur la table et s'émerveillaient de voir leurs connexions établies
rapidement par des moyens purement électroniques.
Le central peut gérer 4 conversations simultanées et 2 appels
simultanément au moyen de 20 circuits de ligne d'abonnés, 4
circuits de jonction et 2 registres. Les éléments de circuit
fondamentaux utilisés (1) sont des diodes à jonction de silicium,
de commutation de la parole commandées par des circuits magnétiques
bistables constitués d'une réactance saturable en série avec
un condensateur pour former un circuit ferrorésonnant.
En excluant complètement les contacts mobiles, tels que ceux
des relais, la durée de vie de l'équipement devient pratiquement
indéfinie.
Le poste d'abonné utilisé avec l'équipement diffère de la conception
conventionnelle : les chiffres sont transmis à partir d'un clavier
et non avec un cadran et la sonnerie a été remplacée par un
dispositif électroacoustique piloté par un amplificateur à transistor
dans le poste.
Dans le central, le circuit de ligne de l'abonné comprend un
transformateur de ligne et le dispositif définissant l'état
de la ligne, occupée ou libre, etc. Les circuits de commutation
de la parole à diode au silicium utilisent deux diodes miniatures
pour établir un chemin de la parole entre les abonnés. En condition
de blocage, les diodes sont équivalentes à une résistance de
1 000 mégohms en parallèle avec un condensateur de 5 picofarads.
Dans l'état conducteur, ils ont une résistance de seulement
4 ohms. La puissance crête transmise est de 50 milliwatts et
l'atténuation totale de ligne à ligne est de 1 décibel. Les
interrupteurs à diodes sont actionnés par les bascules magnétiques,
qui forment également les compteurs de registre. Ces bascules
sont pilotées par une alimentation 10 volts de 8 kilocycles
par seconde. A cette tension, ils ont deux conditions de fonctionnement
; dans un état, le courant passé est 15 fois plus que celui
de l'autre état. Après conversion en courant continu par des
redresseurs au sélénium, la sortie de la bascule polarise les
diodes en état conducteur ou bloquant.
Des circuits imprimés sont utilisés dans le commutateur; ses
dimensions ne sont que de 22 x 53 x 61 centimètres . La puissance
consommée par le central lui-même (hors courants micro des postes
d'abonnés) n'est que de 30 watts en 24 volts.
 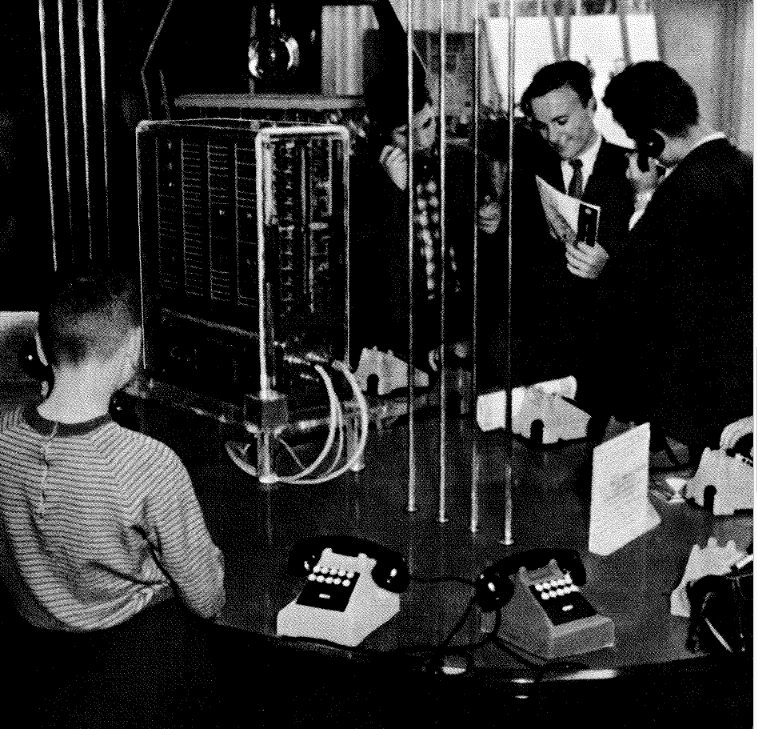
1 - C. Dumousseau, « Central téléphonique automatique à 20 lignes
entièrement électronique », Communication électrique, tome 34
pages 92-101 ; juin 1957
|
Sur la même technologie un autre centre à 240 lignes
sera construit pour la Marine.
sommaire
Bell pris par ausii à l'installtion du réseau Eurovision,
en installant le système de liaison herziennes en Belgique. En 1954
est innové le système de vote électrique à la chambre des députés
... et la première liaison internationale automatique entre Bruxelles
et Paris ...
L'exposition universelle de 1958 donna à Bell une occasion unique
d'exposer sa gamme de produits.
 Contrôle des
postes de télévision
Contrôle des
postes de télévision
1958 un terrain en dehors de l'aglomération
a été acheté à Gand pour la construction d'une nouvelle usine.
BTMC a également
développé de nouvelles technologies telles que des machines de tri
de courrier pour la Poste. (En 1959, onze ont été livrés au bureau
de poste de Providence, Rhode Island, USA). Ils se sont également
développés dans des produits tels que les équipements de navigation
pour bateaux, les équipements de refroidissement industriels, les
systèmes de signalisation, les télécommandes, les téléviseurs, les
systèmes télex, les récepteurs radio et les systèmes de transmission.
En 1961 Leo Van Dick abandonne la présidence
après 60 ans de carrière. C. Van Rooy pris la suite à la tête
de l'entreprise.
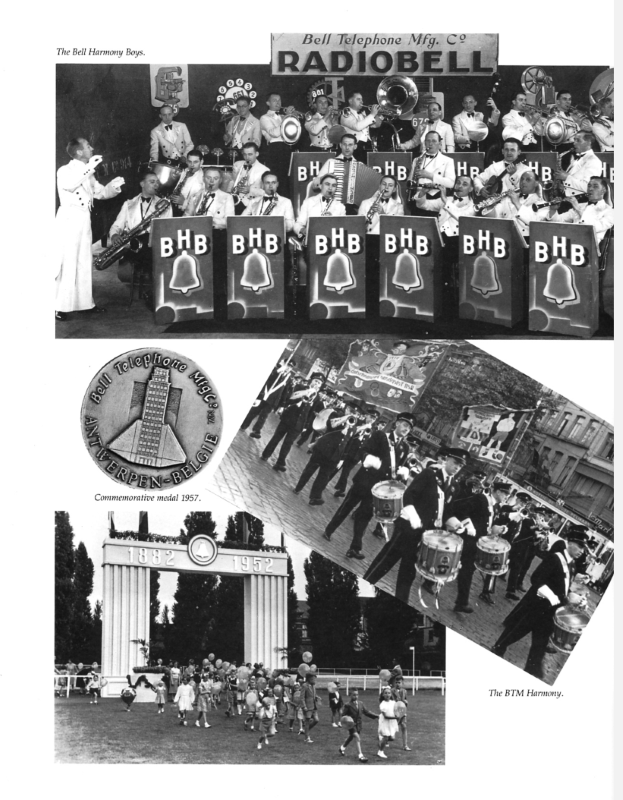
En 1965, Bell entre également dans le domaine
des voyages spatiaux.
Dans les années 1960, le Pentaconta
de conception française et BTMC a réalisé d'importantes ventes dans
le monde entier, remplaçant finalement l'ancien système Rotary. Il
s'est vendu à la fois en tant que systèmes de commutation publics
et en tant que PABX.
Les commandes à l'exportation de systèmes Pentaconta en Inde (1964)
et en Roumanie (1965) ont apporté à BTMC un nouveau type de contrat.
La livraison d'équipements s'est accompagnée d'un transfert de savoir-faire
et d'une aide au démarrage de la production locale sous licence.

En 1967, les centraux contrôlés par programme stocké Metaconta
10C conçus par BTMC sont entrés sur le marché,
permettant aux opérations STD d'être introduites dans de nombreux
pays.
Le Metaconta 10C ainsi que la version modernisée 10CN, furent les
dignes successeurs du Rotary et du Pentaconta. Dans le monde, plus
de 3 millions de lignes ont été installées et, dans certains pays,
des lignes ont également été produites localement dans le cadre d'accords
de licence.
En tant que décennie, les années 1970 seront principalement
caractérisées par un bond en avant sans précédent. Dans le domaine
de la R&D, Bell a concentré ses efforts sur la microélectronique,
le développement de logiciels, les études de systèmes, les applications
informatiques et l'introduction de nouvelles techniques telles que
la modulation par impulsions et codage (PCM).
Au début des années 1970, Bell employait environ 15
000 personnes. Lorsqu'Alcatel a quitté le bâtiment en 2006, le conseil
municipal d'Anvers a choisi le complexe comme centre névralgique de
l'administration municipale.
Jusque-là, les services administratifs de la ville d'Anvers étaient
basés dans des dizaines d'endroits répartis sur le territoire de la
ville.
Depuis 2010, plus de 2 200 collaborateurs travaillent sur ce site
central. Avec cet ambitieux projet de centralisation, la ville maîtrise
ses dépenses d'entretien et d'énergie.
Vooruitzicht a développé le site en utilisant des techniques de construction
durables et en utilisant de manière optimale l'espace disponible.
La cour intérieure a une belle disposition avec des équipements sportifs
et des sections d'arbres et est accessible au public. Le bâtiment
de la tour compte douze étages et abrite des dizaines d'espaces multifonctionnels,
des salles de réunion, des salles de réception formelles et un auditorium
pouvant accueillir 178 personnes. Ces espaces peuvent être loués en
dehors des heures de bureau. la climatisation est assurée par des
stores automatiques et un système de ventilation hybride prenant en
compte les saisons et l'heure de la journée.
La combinaison de la ventilation mécanique et naturelle assure un
climat intérieur agréable et écologiquement sain.
En 1977 le pont de la Boudewijnsstraat reliant
les deux usines disparut, pour que l'ancien bâtiment céde la place
à l'actuel parking. Le pont actuel est plus récent.
sommaire
Dans les années 1980, l’évolution
technologique et la multiplication des services de télécommunications
qui en découle, met la structure monopolistique en cause. Le
régime de la régie autonome se trouve tiraillé
entre son rôle d’acteur économique dans un secteur
de pointe et son rôle de service public dans la structure d’une
administration. La régie a fini par ne remplir aucun des deux
rôles de façon correcte. Néanmoins, dans la terminologie
courante, il existait maintenant une extrême ambiguïté
autour de la notion même de service public. Pour les uns, le
caractère public relevait de l’intérêt collectif
présenté par le service et pour les autres, du statut
public de l’entité et surtout de celui des salariés
qui le fournissaient
En 1981, Dans le domaine de la technologie
de commutation, la numérisation a trouvé une application dans le nouveau
système de commutation numérique "Système
12", le premier central en Belgique étant installé
à Brecht en 1981.
Le système actuel Alcatel 1000 S12 d'ITT qui est produit et
exporté à grande échelle , et dont aujourd'hui plus de 50 millions
de lignes ont été commandées par 39 pays, est la version moderne de
cette première génération de centraux téléphoniques entièrement numériques.
Malheureusement, les programmes informatiques ont
mis du temps à se perfectionner et l'AX de LM Ericsson est devenu
un concurrent majeur entre-temps.
L'Australie a été l'un des premiers à adopter le 1000 S12, avec un
contrat initial portant sur 6,5 millions de lignes.
La politique de BTMC consistant à développer ses nouveaux systèmes
en coopération avec des ingénieurs d'autres sociétés ITT a porté ses
fruits ici. Les ingénieurs australiens formés par BTMC de STC (Standard
Telephones and Cables Australasia P/L) ont ensuite aidé à vendre le
système à la Chine. Ce contrat devait aider à répondre à la demande
chinoise de 10 à 12 millions de lignes en un an seulement.
Dans les années 1980, les premiers lecteurs de cartes
magnétiques ont été introduits dans les téléphones, sur la base des
recherches de l'ATEA et plus tard du BTMC. Ce travail s'est poursuivi
sur les cartes d'identité et de crédit, VISA adoptant le premier système
d'ATEA. Les travaux sur les systèmes numériques se sont poursuivis
avec Anvers développant le DSL (Digital Subscriber Line).
En 1983, BTMC et Fabbrica Apparecchiature per
Comunicazioni Elettriche Standard SpA, une société sœur en Italie,
développaient un système de réseau numérique à intégration de services
(RNIS).
Une conséquence nécessaire de ces travaux a été le développement de
l'expertise et de la recherche dans la technologie des transistors
et des circuits intégrés.
BTMC est également devenu actif dans la technologie spatiale dans
les années 1960. Ils ont développé et construit des équipements pour
l'Organisation européenne de développement des lanceurs (ELDO) pour
Gove, en Australie.
Ils ont également livré des équipements pour le satellite ESRO-I,
mis en orbite en 1968 pour l'ESRO (European Space Research Organisation).
Vers 1985, RTT lance un appel d'offres pour
la numérisation des centraux belges.
Il y avait six concurrents pour le contrat majeur et RTT n'était plus
en mesure d'insister pour que les entreprises locales obtiennent le
contrat.
Au final, les trois entreprises locales, BTMC, ATEA et MBLE ont été
englouties par les plus grandes. ITT a centralisé sa fabrication d'équipements
téléphoniques et la fabrication de BTMC a été fusionnée avec la société
française CGE (Compagnie Générale
d'Electricité) en 1987 après une fière histoire de fabrication
de téléphones et d'échanges depuis plus de cent ans.
CGE elle-même était dans le secteur de la fabrication électrique depuis
plus de cent ans.
En 1991, la société a été rebaptisée Alcatel
Alsthorm. Ses travaux de recherche se sont poursuivis et
l'entreprise a remporté de nombreux prix internes d'excellence et
de développement. En 2006, Alcatel fusionne avec Lucent.

Pour une communication interactive à distance, des
réseaux puissants sont nécessaires. Alcatel
possède la technologie et le savoir-faire technologique nécessaires
pour transformer n'importe quel réseau en « autoroute de l'information
», qu'il soit en cuivre, en câble coaxial ou en fibre optique. La
technologie de pointe d'Alcatel comprend l'ATM (commutation haut débit),
l'ADSL (accès haut débit), le SDH (transmission haut débit) et le
Skybridge (système de communication par satellite).
Cependant, même à travers une succession de propriétaires, le BTMC
a conservé son nom d'origine. C'est actuellement une unité de Nokia
Corporation sous le nom de Nokia Bell NV.
L'activité fabrication de Téléphones et de Commutateurs
n'a pas été les seules activités de BTMC, il y avait aussi la Télégraphie,
a Radio-Téléphonie et Télégraphie et les appareils de Signalisation
que l'on peut voir dans les catalogues.
Deux catalogues et le centenaire BTMC à consulter : Catalogue
1 BTMC , Catalogue
1914 , Catalogue
1936 , Centenaire
BTMC



BTMC Catalogue 1924 et matériel en production autours de 1910
sommaire
À Anvers, la «Bell Telephone Manufacturing Company»
a été fondée en 1882, familièrement appelée «den Bell». Dix ans plus
tard, en 1892, ATEA suit.
'Den Bell' et ATEA ont développé et produit des postes téléphoniques
et des standards pour les Pays-Bas et l'étranger.
À son apogée, le secteur comptait environ 20 000 employés.
Dans les années 1980, les deux sociétés sont passées entre des mains
étrangères, et 2016. les héritiers sont à nouveau réunis au sein de
Nokia.
ATEA "Ateliers de Téléphone
et Electricité Anversoise" ou "The Antwerp Telephone and Electrical
Works"
C'est la première dénomination officielle de
ATEA qui appartient successivement à des sociétés belges,
britanniques, américaines et allemandes, et fabrique des équipements
téléphoniques en Belgique depuis les années 1890.
En avril 1892, une nouvelle société nommée «Antwerp
Telephone and Electrical Works» a été créée par 3 personnes
ainsi que 5 agents locaux fournissant une partie du capital-risque
et ont démarré leur entreprise à Berchem, une banlieue d'Anvers.
Les Ateliers de Téléphonie et d'Electricité, fondés
vers 1890, étaient installés dans les anciens ateliers Coveliers.
Peu de temps après, le 11 avril 1892, l'Usine téléphonique et électrique
d'Anvers (ATEA) est fondée ; la même année, François Durlet soumet
un projet de construction de nouveaux ateliers sur la Coveliersstraat,
prolongé jusqu'à la Boomgaardestraat en 1898-99 et le troisième quart
du XXe siècle ; l'aile à l'angle/Belpairestraat, conçue par l'ingénieur-architecte
Léon De Vroey date d'environ 1919.
En 1972, ATEA a déménagé dans la zone industrielle de Herentals .
Les bâtiments vacants à Berchem sont rénovés depuis 1990.
La mission de l'entreprise était la fabrication, l'achat, la vente
et la location de matériel de téléphonie, télégraphie et électricité.
Ils ont livré, entre autres, des centres manuels et des téléphones
dans toute l'Europe.
Outre la Belgique et les Pays-Bas, d(autres marchés
ont été passés dans de nombreux pays, même avant la Première Guerre
mondiale. Quelques exemples :
Russie Saint-Petersburg, Moscow, Kiev, Riga, Odessa
Italie Rome, Milan, Turin, Bologna, Como, Piacenza, Venice,
Naples, Palermo-Sicily
Royaumes Unis Canterbury, Moorgate,
Glasgow
Pologne Warsaw , Lodz
Allemagne Bielefeld
Mexique Vera Cruz
En regardants d'anciens catalogues de téléphones, nous observons beaucoup
de ressemblance avec les téléphones d'autres fournisseurs.
De nombreuses sociétés de téléphonie de cette période ont utilisé
des pièces de Siemens et Ericsson jusqu'à ce qu'elles puissent en
construire elles-mêmes.
Parmi celles-ci figurent BTMC en Belgique, Sterling et Peel
Conner en Grande-Bretagne, Elektrisk Bureau en Norvège,
Mollers au Danemark et des entreprises françaises.
La plupart de ces entreprises utilisaient à peu près toutes les pièces
importées sauf celles en bois, puis ont progressivement commencé à
introduire leur propre ferronnerie au fur et à mesure que l'entreprise
grandissait.
Malgré de nombreux changements de nom d'entreprise, les produits ont
toujours conservé la marque ATEA.
|
Année
|
Companie
|
Nom
|
|
1892
|
The Antwerp
Telephone and Electrical Works
|
Atea
|
|
1919
|
The New
Antwerp Telephone
and Electrical Works
|
Atea
|
|
1931
|
Automatique Electrique de
Belgique
|
Atea
|
|
1939
|
Automatique Electrique
|
Atea
|
|
1962
|
Automatic Electric
|
Atea
|
|
1970
|
Atea
|
Atea
|
|
1971
|
GTE Atea
|
Atea
|
|
1986
|
Atea
|
Atea
|
|
1995
|
Siemens Atea
|
Atea
|
Les affaires ont ralenti pendant la Première Guerre mondiale
et l'entreprise a pratiquement fait faillite.
En 1919, une nouvelle société a été fondée The
New Antwerp
Telephone and Electrical Works.
|

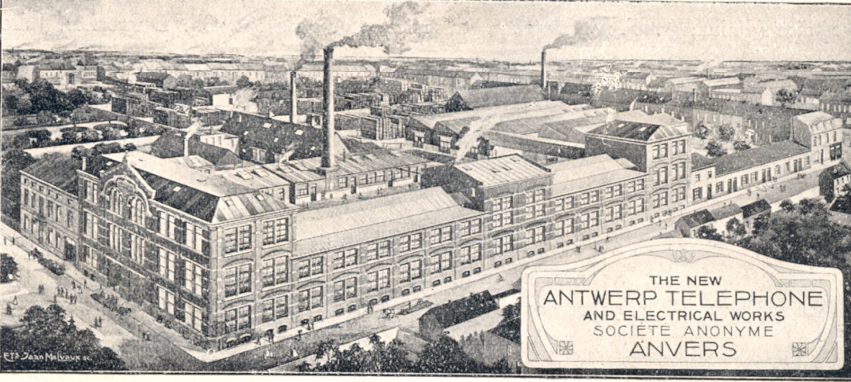

 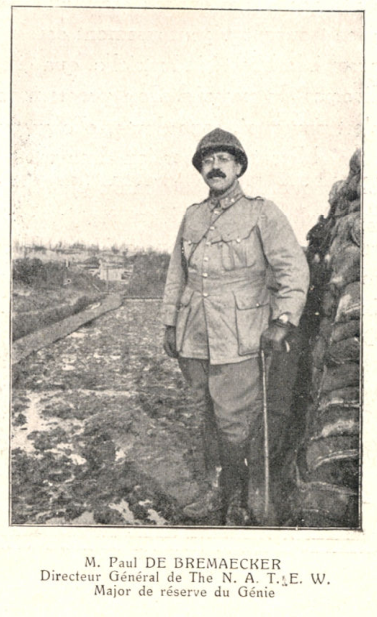
L'entreprise a été relancée, pour reprendre les affaires de
The Antwerp Telephone and Electrical Works (1892), société anonyme
en liquidaton par expiration du contrat social, avec les actionnaires
suivants :
- La "Banque d'Outremer" représentant un groupe apportant de
nouveaux capitaux à risque,
- L'ancienne « Travaux téléphoniques et électriques d'Anvers
», apporte les biens immobiliers, les outils, les machines et
le savoir-faire de l'ancienne société.
- Les membres du conseil d'administration étaient également
actionnaires minoritaires.
A l'armistice on se remet au travail, remettre les usines en
activité, celles ci ne contenaient plus rien, toutes les machines
et le matériel avait été réquisitionné par les Allemands. L'usine
fabrica des appareils, commutateurs, accéssoires pour les systèmes
d'installations publiques et privés.
Elle a obtenu une licence de centre téléphonique automatique
pour le Benelux ( Belgique , le Pays-Bas et Luxembourg) et Espagne,
et pour la fabrication du système la Relay Automatique Téléphone
Compagny de Londres.


Atelier Polissage
 Atelier
Usinage Atelier
Usinage
La gamme de produits est élargie par la création
d'une division sur les appareils de mesure ( wattmètres, voltmètres,
etc. ). Ils ont livré des équipements de mesure en tant que
produits OEM pour les centrales électriques, les mines, les
navires ….
En 1926, ils signent un contrat avec la Grèce, pour automatiser
leur réseau national téléphonique, et ils devraient prendre
une franchise sur ce réseau.
La technologie RAT, développée par Betulander était techniquement
bonne mais coûteuse, surtout pour les grandes installations.
|
En 1926, ATEA est rachetée par le groupe Theodore
Gary, qui nomme un conseil d'administration composé de personnalités
locales influentes, de managers et d'investisseurs britanniques et
d'un ingénieur américain.

ATEA était célèbre
pour la personnalisation des compteurs. Les compteurs de kilowattheures
étaient également un produit très populaire, beaucoup d'entre eux
étant achetés par la compagnie d'électricité locale . Cette gamme
de produits a connu du succès jusque dans les années 1960 et au début
des années 1970.
La « nouvelle usine téléphonique et électrique d'Anvers
» devait rechercher des solutions rentables. Ils ont donc contacté
Automatic Electric en Chicago
pour obtenir une licence en technologie
Strowger.
Associated Telephone and Telegraph, propriétaire d'Automatic Electric,
a pris une « participation majeure dans l'entreprise. Grâce à cette
relation, ATEA a eu accès avec
la technologie Strowger en 1926 et a été soutenue par Automatic
Telephone Manufacturing Company (ATM)
de Liverpool . ATM avait déjà une expertise dans la technologie Strowger
avant la Première Guerre mondiale ; ils ont livré leur premier central
à la poste britannique en 1912.
La société d'exploitation belge locale s'est également intéressée
aux équipements Strowger et les livraisons de centres adaptés ont
commencé à la fin des années 1920.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, ATEA a été contraint
de fabriquer la version Siemens du commutateur à pas.
L'association avec l'ATM
a eu quelques avantages secondaires ; ATEA
a commencé à construire et à fournir des contrôleurs de feux de signalisation,
certaines versions contenant même la technologie Strowger. Ce produit
était très populaire, en particulier dans Belgique , où Atea était
leader du marché jusque dans les années 1980.
Un autre produit bien connu au cours de ces années était les systèmes
d'interphone pour les portes d'entrée .
L'alliance avec Automatic Electric a été une étape importante dans
l'évolution de l'entreprise, initiant une longue période de stabilité.
Il y a eu des hauts et des bas économiques, causés par des facteurs
externes (tels que la crise des années 1930, la Seconde Guerre mondiale,
etc.) , mais ATEA a continué de
croître depuis qu'elle appartenait à Automatic
Electric de Chicago.
L'assemblage de téléphones était une tâche nécessitant
beaucoup de main-d'œuvre dans le premier quart du XXe siècle.
Vers 1930, cela a commencé à s'industrialiser. Après avoir
d'abord utilisé du bois et de l'ébonite, le métal et la bakélite ont
ensuite été introduits dans les années 1930. Le style a également
été influencé par l'époque à laquelle le téléphone a été construit.
nous constatons une évolution importante du style des téléphones au
fil des ans.
Une ligne de produits importante était l' activité PAX et PABX , non
seulement pour le marché local, mais aussi pour l'exportation.
Des clients importants ont également été trouvés à l'étranger, c'est-à-dire
dans d'anciens Congo belge . Certains équipements comme les téléphones
et les compteurs ont été adaptés pour la survie en milieu tropical.
La compagnie des chemins de fer et l'armée étaient
de gros clients, et Atea a commencé à acquérir une expertise dans
les réseaux privés.
Atea avait une grande entreprise dans les "Systèmes
téléphoniques à clé", surtout après la Seconde Guerre mondiale.
Le système 600 était très populaire dans les années 1950 et 1960,
suivi du succès du système 800, qui était très avancé à l'époque où
il a été développé.
Le système 800 était particulièrement répandu dans L'Europe, l'Amérique
latine , le Moyen-Orient et Asie . Après la fin de son cycle de vie
(avec plus de 2 millions de téléphones installés), une usine de production
a été installée à Brésil .
Le transistor a été inventé en 1948, mais ce n'est
qu'en 1960 que les applications industrielles électroniques sont apparues.
Un des premiers commutateurs semi-électroniques, l'EAX-A1 a été installé
en 1967 dans Hasselt , Belgique .
L'intelligence a été réalisée avec une logique câblée sur des composants
discrets et un réseau de commutation à relais Reed.
La technologie de base a été transférée d'Automatic Electric, mais
la conception complète a été réalisée en Belgique .
L'entreprise de réseau privé a également développé
un système similaire appelé PREX.
A la demande de la Société d'Exploitation Téléphonique
RTT, la conception d'un commutateur commandé par programme mémorisé
a été lancée, le système A2PT. Le premier interrupteur de cette génération
a été livré au client en 1974.
L' évolution de la technologie s'est accélérée et
la société mère d'Atea, Automatic Electric, a rejoint GTE ( General
Telephone & Electronics) en 1955. ATEA
est devenue l'une des nombreuses sociétés du groupe en 1962 et a été
renommée GTE Atea en 1971.
l'entreprise pourrait bénéficier de son appartenance à GTE.
Le système de central téléphonique N2EAX, un système
de contrôle de programme stocké avec un énorme processeur central,
a été conçu par Automatic Electric pour le marché intérieur dans les
années 1970. C'était un centre électronique, mais avec un réseau de
commutation contrôlé par relais Reed. Atea était, en coopération avec
une société sœur en Milan , Italie , responsable de la version internationale.
En commutation privée, la technologie des PABX numériques
GTD-120 et GTD-1000 d'Automatic Electric a été transférée à Atea et
adaptée aux exigences internationales. Atea a eu le premier PABX numérique
en L'Europe en 1978.
Le marché (très élargi grâce à GTE International) était très fragmenté,
avec de nombreuses exigences différentes des clients. Un système contrôlé
par logiciel utilisant un ensemble de 8080 microprocesseurs offrait
une bonne flexibilité.
Les systèmes ont été vendus principalement en Belgique
, Danemark , Italie , le Royaume-Uni , Afrique du Sud , mais aussi
dans des pays exotiques comme Malaisie .
Dans certains pays, comme le ROYAUME-UNI , des coentreprises
ont été créées pour faciliter les affaires . D'autres pays comme Chine,
Inde et l'ancien unifié Yougoslavie nécessaires à la production locale
par le biais de coentreprises.
Bientôt, le GTD eut un successeur, l'OMNI-S (même
architecture, technologie plus récente) et plus tard la famille OMNI
200 à coût réduit.
Le principal avantage de la version européenne de ces PABX était leur
signalisation flexible , soit sur les réseaux publics, soit sur les
réseaux privés. Un programme de tronc universel (piloté par table)
a permis une adaptation facile à n'importe quel système de signalisation
de réseau. La mise en place d'un nouveau schéma de signalisation a
été réalisée en quelques heures.
sommaire


A la fin des années 1970, un nouveau style de téléphone
est très bien accueilli sur le marché.
Les systèmes à clé électronique tels que 8000 et 8800 (vendus sous
le nom de « rhapsody » dans le ROYAUME-UNI ) a suivi le même style.
Le DATEA 2000, un téléphone avec des capacités de vérification de
carte de crédit (et EFT, transfert électronique de fonds), a été un
premier pas vers la communication de données et Internet.
Dans la commutation publique, le N2EAX a été bientôt suivi par le
système GTD5 , un central entièrement numérique, et encore une fois
Atea a été impliqué dans l'internationalisation.
Il y a eu une évolution technologique de la commutation
électromécanique à la commutation électronique dans les années 1960
et 1970.
Cela a été bientôt suivi par une deuxième vague avec le passage du
contrôle matériel au contrôle logiciel. Les investissements en R&D,
en particulier dans les logiciels, ont considérablement augmenté et
GTE a décidé de se retirer de la R&D et de la production d'équipements
téléphoniques.
Au 1 er octobre 1999 , après 107 ans d'existence,
ATEA est devenue pleinement intégrée
à l'organisation Siemens
En 2007, Siemens a conclu une joint-venture avec Nokia, sous
le nom de "Nokia Siemens Networks" (=NSN).
Le siège social de NSN Belgium se trouve à Herentals, dans un nouveau
bâtiment sur le parking de l'ancien ATEA. L'ancien ATEA a été vendu
à un syndic qui l'a transformé en centre d'affaires.
sommaire
Publication
Un premier livre de Jan Verhelst a été publié
en 2008, un second en 2013. Depuis lors, la recherche a mis au jour
de nombreuses pièces qui s'intègrent dans le puzzle de ce qu'était
ATEA. D'où le sous-titre "Quelques pièces de puzzle ajoutées à l'histoire
de l'entreprise"
Une nouvelle édition est arrivé en 2017 "ATEA 125 ans"



Logo Belle époque et Logo 1930-1960
Les 'Amis du Musée ATEA', un certain nombre d'anciens
employés, entretiennent encore aujourd'hui la mémoire de la compagnie
de téléphone, entre autres en publiant sur l'histoire de l'entreprise.
"Depuis la publication du premier livre en 2009, nous avons trouvé
de nombreuses pièces qui s'intègrent dans le grand puzzle de ce qu'était
ATEA", déclare Jan Verhelst. "De plus, nous sommes régulièrement surpris
par la quantité d'informations qui sont récemment devenues disponibles
en ligne."
Toutes les informations sur le livre 'ATEA 125 ans' sont disponibles
sur le site
des Amis de l'ATEA muséum .
sommaire
La loi du 21 mars 1991 relative aux entreprises
publiques autonomes
A partir de 1985, le développement de nouvelles
possibilités techniques, la politique de déréglementation
partielle menée aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, le retard
progressif des opérateurs publics d’Europe occidentale
ont incité les autorités européennes à
prendre une série d’initiatives. Elles y ont été
encouragées par le développement de la jurisprudence
de la Cour de Justice, notamment dans l’arrêt British Telecom
de 1985. En 1987, la Commission a publié un Livre vert sur
les télécommunications. En 1988, le Conseil des ministres
a adopté une résolution définissant le cadre
général d’une libéralisation partielle du
secteur des télécommunications. Celle-ci concernait
à la fois les terminaux et les nouveaux services à haute
valeur ajoutée qui devaient désormais être ouverts
à la concurrence. Elle ne concernait pas les services de base
de la téléphonie vocale, que les Etats membres pouvaient
toujours réserver à l’opérateur public.
Il s’agissait d’un compromis destiné à préserver
les monopoles existant dans la plupart des Etats.
Dans ce contexte, deux directives ont été
adoptées en 1990.
La première directive 90/387 CEE émanait du Conseil
des ministres. Reposant sur l’article 100 A CEE, elle définissait
les principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP),
c’est-à-dire les conditions de l’accès au
réseau des télécommunications pour les prestataires
de nouveaux services.
La seconde directive 90/388 CEE émanait de la Commission. Reposant
sur l’article 90 § 2 CEE, elle tirait les conséquences
de la première en définissant les obligations des Etats
membres qui entendaient maintenir des droits exclusifs ou spéciaux
aux opérateurs publics de façon à préserver
la fourniture d’un réseau ouvert.
Ce nouvel environnement a été à l’origine
des dispositions concernant les télécommunications de
la loi du 21 mars 1991 relative aux entreprises publiques autonomes.
Les aspects généraux
Le débat élargi à toutes les entreprises publiques
à finalité économique.
Depuis le début des années 1980, des propositions avaient
été faites pour réformer le monopole de la RTT.
Il fallait sortir la RTT de sa situation financière précaire,
tout en assurant la continuité du service public. Néanmoins,
peu d’initiatives concrètes furent prises. Il fallut attendre
les mesures de la Communauté européenne pour amorcer
le débat sur une mise en cause des monopoles publics existants
en Belgique. Ce dernier aboutit au vote de la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Le sort de la RTT se trouva ainsi lié à celui d’autres
entreprises publiques (Postes, Sabena, SNCB).
Cette loi trouve son origine dans le nouveau contexte économique
et technologique dans le domaine des services, ce qui représente
un défi important pour les entreprises publiques actives dans
le secteur tertiaire. L’évolution concernait d’abord
les télécommunications et les transports aériens.
Les postes et les transports ferroviaires étaient à
l’époque moins concernés. De plus en plus, "des
services concurrents aux services traditionnellement pourvus par les
seuls pouvoirs publia, sont fournis par des entreprises privés,
à l’exception des services qui bénéficient
de droits exclusifs de l’Etat". Il faut faire face à
cette concurrence. Par ailleurs, du point de vue technologique, une
panoplie de nouveaux services voit le jour. Leur prise en charge par
les seules entreprises ou administrations publiques n’apparaît
pas aisée et peut-être pas justifiable. En effet, de
façon générale, "les Etats entrent en concurrence
pour attirer les investisseurs chez eux. La compétition se
fait surtout au niveau de la qualité du service. Dans ce contexte
nouveau, il convient de renforcer la capacité concurrentielle
des entreprises publiques vis-à-vis des sociétés
privées, mais aussi leur efficacité dans la réalisation
des activités pour lesquelles elles disposent d’une concession
exclusive".
En réponse à ces observations, la loi vise à
introduire dans la législation belge un nouveau régime
juridique pour les organismes d’intérêt public qui
exercent des activités commerciales ou industrielles : l’entreprise
publique autonome. Ce nouveau statut tentait de procéder à
une meilleure définition des objectifs de structures publiques
et un meilleur contrôle de leur réalisation. Il fournissait
ainsi une définition plus précise de la notion de service
public, du point de vue tant des prestataires que des consommateurs.
A la base de ce changement se trouvait le contrat de gestion.
Le contrat de gestion
Les objectifs.
L’objectif de la réforme est double : "assurer la
compétitivité des entreprises publiques dans leurs activités
en concurrence et améliorer les conditions dans lesquelles
elles assument leur mission de service public". Ainsi, ce nouveau
régime juridique fait la distinction entre les services qui
répondent à un objectif de service public et les autres.
Les premiers doivent être accessibles à tous les citoyens
sur base d’égalité, doivent être continus
et adaptés en fonction du développement de besoins nouveaux.
La mise en œuvre de ces trois principes du service public est
prioritaire dans la gestion des entreprises publiques et elle n’est
pas conditionnée par la recherche de profits. L’entreprise
détient des droits exclusifs dans les limites de son activité
de service public.
La mission de service public n’exclut pas la
possibilité pour les entreprises publiques autonomes d’offrir
d’autres services. Ce développement est même utile
pour assurer la rentabilité de l’entreprise. L’accomplissement
du service public n’est pas toujours compatible avec la recherche
de rentabilité. Le développement d’autres activités
dans un contexte concurrentiel permettra de maintenir un équilibre
financier et peut-être même d’exploiter de façon
plus intensive des infrastructures non saturées par la seule
utilisation pour les missions de service public. Elle permet aussi,
en théorie, d’utiliser de façon plus optimale les
facteurs de production.
La distinction des tâches.
Le régime juridique de l’entreprise publique autonome
tente de concilier le contrôle nécessaire à la
réalisation du service public et l’autonomie de gestion
indispensable à une mise en concurrence des autres services.
Cette création originale en droit belge repose sur la distinction
entre les tâches de service public et les autres. L’entreprise
conclut avec l’Etat un contrat de gestion. Celui-ci précise
les missions de service public et leurs modalités d’exécution.
L’originalité de ce contrat est qu’il permet un contrôle
limité à la mission de service public. Le commissaire
du gouvernement exerce exclusivement un contrôle sur la conformité
à la loi, aux statuts et au contrat de gestion. L’entreprise
est autonome pour les autres activités. Un contrat de gestion
a été conclu entre l’Etat et la RTT. Il a été
approuvé par l’arrêté royal du 19 août
1992. Il a une durée de cinq années. Sa portée
a cependant été réduite par des révisions
de la loi de 1991 concernant le secteur des télécommunications.
Le fonctionnement des entreprises publiques
Toutes les tâches des entreprises publiques, tant celles qui
relèvent de la mission de service public que les autres, restent
très liées entre elles (que ce soit au niveau du personnel,
au niveau des gestionnaires, au niveau des équipements, …).
La loi de 1991 instaure une structure organique permettant une gestion
autonome de ces activités prises dans leur ensemble. Deux organes
de gestion sont constitués : un conseil d’administration
et un comité de direction. Ils sont investis de la responsabilité
de la gestion de l’entreprise. Leurs membres sont nommés
pour une durée de six ans et le renouvellement de leur mandat
dépendra de leurs performances dans l’exécution
du contrat de gestion. Le conseil d’administration fixe la stratégie
à moyen terme pour l’entreprise par le biais d’un
plan pluriannuel. Les éléments de ce plan qui concernent
l’exécution des tâches du service public sont seuls
soumis à l’approbation du ministre en fonction des dispositions
fixées dans le contrat de gestion.
Toujours dans un souci de répondre aux exigences
du contexte de concurrence accélérée, une attention
particulière est portée à la qualité des
services fournis, qui constitue souvent dans le domaine des services
l’avantage compétitif majeur. Deux organes sont constitués
entre autres à cette fin. Ils permettent d’évaluer
la qualité du service par le biais de ses utilisateurs. Le
service de médiation permet de recevoir des plaintes, de donner
un avis et le cas échéant, d’avoir le rôle
d’arbitre. Le comité consultatif est chargé d’une
compétence d’avis sur les services prestés aux
usagers.
L’autonomie de gestion des entreprises publiques
autonomes se traduit, "au moins partiellement, par un lien concrétisé
par un contrat de gestion négocié". On s’éloigne
du lien de tutelle tel que l’a connu la RTT. L’entreprise
doit veiller à remplir sa mission de service public mais elle
maîtrise la gestion journalière de ses activités.
Elle peut développer toute activité compatible avec
son objet social. Elle peut créer des filiales en Belgique
ou à l’étranger. De plus, elle peut, sous certaines
conditions, se transformer en société anonyme de droit
public avec une possible participation du secteur privé au
capital.
L’entreprise reçoit également plus
d’autonomie dans la fixation du statut de son personnel. Elle
peut faire appel à du personnel de haut niveau de façon
contractuelle, en plus des dispositions prévues par la loi
pour le personnel associé à la réalisation de
la mission de service public, qui reste statutaire. Dans les faits,
toutefois, l’expérience montre que la cohabitation de
personnels dotés de statuts différents pose parfois
des difficultés.
La liberté d’action de l’entreprise
doit être nuancée. L’Etat entend rester majoritaire,
tant au niveau de l’actionnariat que des votes au sein des organes
de gestion. Par ailleurs, le commissaire du gouvernement exerce une
surveillance. Celle-ci est limitée de plusieurs manières
: il s’agit d’un contrôle de légalité
et non d’opportunité, qui couvre uniquement les missions
de service public et par conséquent la mise en œuvre du
contrat de gestion. Dans les faits, au cours des dernières
années, le rôle de commissaire du gouvernement a souvent
été plus limité que ne l’avait envisagé
la loi de 1991.
Le régime général des télécommunications
Le régime juridique de la RTT ne répondait
plus aux exigences de "l’évolution technologique
au plan européen et mondial eu égard en particulier
à l’intégration des moyens informatiques et audiovisuels
dans les télécommunications". En 1991, le législateur
tient à fournir un cadre juridique qui permette à ce
secteur de se développer étant donné son rôle
économique générateur de croissance économique
et d’emplois. Dans ce cadre, l’objectif est d’offrir
aux usagers la gamme la plus large possible de services au meilleur
rapport qualité-prix. Des dispositions particulières
pour les télécommunications ont donc été
introduites dans le titre III de la loi du 21 mars 1991.
La séparation de la réglementation et de l’exploitation
des télécommunications et le rôle croissant de
l’IBPT
Le Livre vert de 1987 et la résolution de 1988
relative au marché commun des services et équipements
de télécommunications avaient notamment prévu,
afin de mieux appliquer les principes de la concurrence, de dissocier
les fonctions de réglementation et de fourniture dans le secteur
des télécommunications. Aussi, la transformation de
la RTT en Belgacom a été accompagnée de la création
d’une nouvelle institution, l’institut belge des services
postaux et de télécommunications-IBPT.
L’ouverture à la concurrence des services
non réservés de Belgacom et la nécessité
d’une gestion autonome et commerciale étaient incompatibles
avec des fonctions de réglementation. Celles-ci sont donc reprises
par la puissance publique, assistée par l’IBPT. Cet institut,
organisme d’intérêt général, dépend
directement du ministre ayant les télécommunications
dans ses attributions. Cette réforme ne signifie donc pas un
retrait de l’Etat. Le gouvernement est présent, tant par
sa fonction de réglementation - plus importante que par le
passé -, que par son rôle d’actionnaire majoritaire
du principal opérateur des télécommunications.
Ceci montre par ailleurs que la séparation de la réglementation
et de l’exploitation demeure très loin d’être
complète.
L’IBPT prend en charge une série d’attributions
anciennes de la RTT. Il a un rôle d’encadrement général
du développement des télécommunications en Belgique.
Cela signifie qu’il veille à la fois à l’élaboration
et à la mise en œuvre de la réglementation. Il
est chargé notamment des missions suivantes :
il donne un avis motivé dans les cas prévus par la loi ;
il assiste le ministre dans la définition des stratégies
de développement des télécommunications ;
il a un rôle d’assistance dans les relations avec Belgacom,
entre autres dans la négociation du contrat de gestion entre
l’Etat et Belgacom;
il a un rôle de contrôle du respect de la réglementation
relative aux télécommunications ;
il rassemble les déclarations imposées par la loi, notamment
en matière d’exploitation de services non réservés,
de réseaux privés d’agrément de terminaux [79]
et d’obtention de dérogations;
il a un rôle d’arbitrage en cas de litiges entre des personnes
offrant des infrastructures ou des services de télécommunications;
il a un rôle de police. Par arrêté royal, la qualité
d’officier de police judiciaire peut être conférée
aux agents de l’IBPT, chargés de la constatation des infractions
à la loi et aux arrêtés pris en exécution
de celle-ci ;
il est chargé de la gestion du spectre des fréquences
radioélectriques et du contrôle de leur utilisation;
il est chargé de l’examen technique des demandes d’autorisation
d’exploitation d’un réseau de radiodistribution ou
de télédistribution. Il propose les conditions dans
lesquelles tel réseau peut être utilisé pour l’exploitation
d’un service non réservé.
Un comité consultatif a été crée
au sein de l’IBPT. "Celui-ci rassemble toutes les personnes
intéressées du secteur des télécommunications
afin de permettre une concertation structurelle" et de guider
la politique générale des télécommunications
de façon à répondre au maximum aux besoins qui
se développent.
Les services réservés à Belgacom
La séparation de la réglementation et
de la fourniture des services limite Belgacom à des activités
économiques. Pour celles-ci, Belgacom détient des droits
exclusifs sur l’exploitation de l’infrastructure et l’offre
de services réservés. En 1991, les services réservés
comprenaient la téléphonie, les services de télex,
de mobilophonie et de radiomessagerie, les services de commutation
de données, la télégraphie et la mise à
disposition de liaisons fixes. Les autres services offerts, c’est-à-dire
les services non réservés, étaient mis en concurrence,
mettant ainsi à exécution la directive 90/388 CEE relative
à la concurrence dans le marché des services. Infrastructure
et services réservés formaient ensemble les "télécommunications
publiques".
La loi de 1991 établit ainsi un régime
hydride. D’une part, il existe un monopole pour les services
réservés et l’infrastructure et, d’autre part,
les services non réservés sont mis en concurrence. Les
opérateurs privés de services non réservés
dépendent de Belgacom pour la capacité de transmission,
à cause de ses droits exclusifs sur l’infrastructure publique.
La directive 90/387 CEE concernant l’établissement d’un
réseau ouvert des télécommunications (Open Network
Provisions) a prévu des dispositions pour éviter de
possibles abus de position dominante. L’objectif consistait à
assurer un accès ouvert à l’utilisation de l’infrastructure
publique. Les conditions d’accès doivent être basées
sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
Dans cette perspective, le chapitre X du titre III
de la loi du 19 mars 1991 précise les mesures que Belgacom
doit prendre en vue de préserver une concurrence loyale. L’accès
aux services réservés ne peut être refusé
que sur base des exigences essentielles (sécurité, intégrité
du réseau, interoperabilité des services et protection
des données). Les tarifs appliqués aux concurrents de
services non réservés, doivent refléter les coûts
réels, c’est-à-dire le prix de revient majoré
d’une marge bénéficiaire raisonnable. Aussi, aucune
subsidiation n’est admise des télécommunications
publiques vers les autres activités de Belgacom. La réalisation
concrète de ces conditions ne peut être vérifiée
que sur la base d’un système comptable qui rend transparente
l’information sur les coûts (on attend encore dans les
faits l’élaboration de pareil système).
Ces différentes dispositions ont toutes pour
objectif de veiller au respect des règles de concurrence pour
les services non réservés dans un environnement partiellement
libéralisé. Dans ce contexte, l’IBPT a un rôle
essentiel de garant de la concurrence.
La mission de service public de Belgacom
Comme l’a rappelé le gouvernement, la concession exclusive
des télécommunications publiques avait été
jugée nécessaire pour plusieurs raisons. L’exiguïté
de notre pays impose une organisation dans un souci de rentabilité.
Il faut répondre aux principes du service public. La normalisation
au niveau national et international doit être facilitée.
Il faut rencontrer la nécessité de répondre aux
exigences de sécurité nationale. L’offre des structures
fondamentales de télécommunications doit être
garantie. On retrouve ici une série de justifications qui avaient
déjà été avancées dans le cadre
de la loi de 1883. Dans le présent contacte, toutefois, comme
en 1930, les concepts de service public et de concurrence semblent
avoir été jugés peu compatibles.
En contrepartie de cette concession exclusive sur
les télécommunications publiques, Belgacom doit assumer
une série de tâches de service public. Ces tâches
sont détaillées dans le contrat de gestion. Elles concernent
notamment l’infrastructure (établissement, maintenance,
modernisation et fonctionnement), les installations publiques de télécommunications,
les tarifs des prestations, l’établissement de relations
contractuelles avec les clients et la qualité du service. Une
série d’objectifs chiffrés ont été
intégrés dans le contrat de gestion.
La préparation de la libéralisation générale
de 1998
Depuis 1991, le monde des télécommunications a connu
des mutations considérables. Le développement de nouveaux
procédés, souvent liés à l’accroissement
des capacités de communication et à la compression des
données, a engendré l’émergence de nouveaux
services et de nouveaux concurrents. Cette émergence a stimulé
la compétition internationale. Elle a aussi provoqué
une multitude d’alliances et de regroupements visant à
fournir des services internationaux sur l’ensemble des continents
(Concert rassemble BT et MCI, Global One groupe Deutsche Telekom,
France Telecom et Sprint, World Partners lie ATT et plusieurs opérateurs
européens tels que Telefonica, KNP et Swiss Telecoms, eux-mêmes
rassemblés dans Unisource). D’autres accords associent
de plus en plus des opérateurs de télécommunications
et de télévision.
En 1994, la Communauté européenne a
dû constater l’échec de la libéralisation
partielle entamée en 1987. Largement motivée par la
peur d’un dépassement économique, elle a décidé
de procéder à une libéralisation générale
des télécommunications (terminaux, services en ce compris
la téléphonie vocale, et les infrastructures) en 1998.
La directive 95/62 CE a défini les principes du réseau
ouvert en matière de téléphonie vocale. En 1996,
la Commission a proposé une nouvelle directive sur le même
sujet, qui ouvre de nouvelles perspectives concernant la notion de
service universel. Les directives 95/91 et 96/19 CE de la Commission
ont supprimé diverses restrictions pesant sur l’utilisation
des réseaux câblés de télévision
comme infrastructure alternative. Elles ont aussi introduit la possibilité
pour un opérateur d’établir sa propre infrastructure.
En 1995, l’entrée en vigueur de l’Accord général
sur le commerce des services-GATS, mis en œuvre par l’Organisation
mondiale du commerce-OMC, a entraîné l’ouverture
de négociations sur la libéralisation du commerce des
services de télécommunications. Elles ont mené
à la conclusion d’un accord sur la libéralisation
des services de télécommunications en décembre
1996.
Dans ce nouveau contexte, la législation de
1991 sur les entreprises publiques autonomes a dû être
adaptée. Cette adaptation poursuivait plusieurs objectifs.
Elle devait donner à Belgacom les moyens de faire face aux
nouvelles exigences liées à la libéralisation
générale. Elle devait aussi assurer l’accès
au marché belge de nouveaux opérateurs dans le respect
des règles de concurrence. Elle a également permis la
vente de 49,9 % des titres de Belgacom à des partenaires extérieurs.
La loi du 21 mars 1991 a été modifiée par la
loi du 12 décembre 1994 et la loi du 20 décembre
1995.
En 1996, trois arrêtés royaux ont été
pris. Ils concernent la libéralisation des infrastructures
alternatives pour les services non réservés, la libéralisation
des marchés de télécommunications et les services
près tés au titre du service universel. Ces arrêtés
présentent une grande importance. Il n’est toutefois pas
facile de décrire leurs implications. D’un côté,
ils complètent la loi du 21 mars 1991. De l’autre, ils
la complètent tant qu’ils finissent par en modifier la
perspective. D’un côté, ils définissent les
obligations applicables à l’heure actuelle mais, de l’autre,
ils visent également à décrire les obligations
applicables à partir de 1998.
Ces arrêtés devront en outre être
complétés par d’autres dispositions réglementaires.
Les autorités belges doivent en fait définir le nouveau
cadre réglementaire des télécommunications avant
la libéralisation générale de 1998. Il s’agit
d’une tâche extrêmement difficile. Les arrêtés
royaux du 28 octobre 1996 ont, pour ainsi dire, un pied dans le présent
et un pied dans l’avenir. On essaiera ici de détailler
ce qui relève de chacune de ces perspectives.
La consolidation stratégique de Belgacom par sa transformation
en société anonyme de droit public
A partir de 1993, l’Etat belge a commencé
à chercher des partenaires extérieurs pour l’entreprise
publique. La démarche procédait de plusieurs soucis.
D’une part, le mouvement d’alliances entre des opérateurs
sur le marché européen des télécommunications
a incité Belgacom à rechercher des partenaires à
l’étranger. Plus fondamentalement, certains dirigeants
percevaient le retard de l’entreprise dans la fourniture de services
à haute valeur ajoutée. D’autre part, le gouvernement
avait décidé d’assainir son budget 1993 par des
ventes d’actifs publics. La démarche suivie, baptisée
"consolidation stratégique" pour souligner une volonté
de prendre en considération les intérêts à
long terme de l’entreprise, constituait en fait une réorientation
indispensable à la survie de Belgacom. Elle permet de développer
les contacts extérieurs de l’entreprise et surtout d’apporter
une réponse à l’évolution technologique
par un partenariat avec des entreprises connaissant davantage l’évolution
des marchés libéralisés.
Dans ce cadre, Belgacom a été transformée
en société anonyme de droit public par application de
l’article 37 de la loi du 21 mars 1991. Elle peut ainsi faire
appel à des capitaux privés. La loi du 12 décembre
1994 a modifié la loi du 21 mars 1991 et a précisé
toutes les dispositions de cette transformation. Belgacom a alors
été transformée en société anonyme
de droit public par l’arrêté royal du 16 décembre
1994. Les statuts de la société ont été
modifiés par arrêté royal du 19 mars 1996. Le
consortium ADSB formé par Ameritech International, Tele Danmark
A/S et Singapour Telecommunications Limited a été retenu
comme partenaire stratégique par le gouvernement pour former
l’alliance avec Belgacom. L’arrêté royal du
19 décembre 1995 a autorisé l’Etat à céder
des actions de Belgacom. La loi du 12 décembre 1994 spécifie
que cette cession ne peut aller jusqu’à la majorité
des titres.
En effet, l’Etat avait mis comme préalable
à cette opération "qu’elle ne doit pas porter
atteinte aux caractéristiques essentielles du statut de Belgacom,
entreprise publique autonome, tout particulièrement en ce qui
concerne la situation du personnel et la garantie de la fourniture
du service universel". Aussi, il n’y a pas de privatisation
complète, puisque l’Etat reste un actionnaire majoritaire.
Il détient la moitié des actions plus une action et
nomme un nombre proportionnel aux actions d’administrateurs au
sein du conseil d’administration. Néanmoins, l’appréciation
correcte du rôle de l’Etat réclamait une étude
minutieuse de la convention conclue entre les actionnaires à
l’occasion de la cession des parts au consortium ADSB. Bon nombre
de décisions doivent être prises à des majorités
particulières, ce qui diminue en fait la suprématie
de l’actionnaire étatique. Or, cette convention n’a
pas été rendue publique. Par ailleurs, quoique cela
ait été peu souligné, il s’agit d’une
privatisation un peu particulière. En effet, certaines des
sociétés du consortium ADSB sont elles-mêmes des
sociétés publiques.
En tout état de cause, l’Etat a fixé
certaines limites dans la réalisation de la consolidation stratégique:
le maintien de son contrôle majoritaire, la sauvegarde du rôle
économique du secteur des télécommunications
comme générateur d’emplois, la réalisation
d’une alliance stratégique c’est-à-dire par
l’intégration d’un ou plusieurs opérateurs
stables, et l’élargissement de l’assise financière
par l’entrée en bourse et par la cession au personnel
d’une partie du capital. Le dernier point n’a pu être
réalisé : l’entrée en bourse a été
exclue étant donné l’urgence de la privatisation,
surtout pour les finances de l’Etat.
La mise en concurrence progressive de certains services et de l’infrastructure
alternative
Les règles de 1991
Les droits exclusifs concernant la téléphonie vocale
La directive 90/388 CEE relative à la concurrence dans le marché
des services de télécommunications a imposé aux
Etats membres l’abolition des droits occlusifs en matière
de service de télécommunications. Elle établissait
toutefois une exception très importante pour les services de
téléphonie vocale. Les Etats membres pouvaient continuer
à conférer des droits exclusifs dans ce secteur. Par
ailleurs, cette directive avait explicitement exclu de son champ d’application
certains services, comprenant notamment la radio-téléphonie
mobile et la radiomessagerie.
Par conséquent, la Belgique a ouvert à
la concurrence, dans la loi de 1991, tous les services de télécommunications,
à l’exception de la téléphonie vocale et
des services expressément exclus du champ d’application
de la directive. Ces exceptions apparaissent dans la loi du 21 mars
1991 comme services réservés de télécommunications.
Cependant, la Commission n’a pas approuvé
cette interprétation de la directive 90/388 CEE. Selon elle,
en effet, l’exclusion de la téléphonie mobile et
de la radiomessagerie du champ d’application de la directive
n’implique pas leur exclusion du champ d’application des
règles de concurrence. Les définitions respectives de
la téléphonie vocale dans la directive européenne
et dans la loi belge reflètent ainsi une certaine divergence.
Pour la Commission, la directive établit des exceptions aux
principes de concurrence. Ces exceptions doivent par conséquent
être interprétées de manière stricte. "Lorsque
de nouveaux services vocaux ou compléments de ces services
sont introduits pour satisfaire à une demande qui n’est
pas satisfaite par le service téléphonique habituel,
ils doivent en principe être considérés comme
non réservés".
La définition maximaliste de la téléphonie
vocale dans la législation belge semblait ainsi permettre à
Belgacom d’étendre son monopole à une variété
de services vocaux plus large. Ainsi, par exemple, la référence
dans la directive à un service au départ et à
destination de points de terminaison du réseau public commuté
n’est pas reprise au niveau belge. Cette référence
exclut des services réservés, entre autres, un service
exploité par une entreprise sur une ligne louée internationale
qui permet aux clients d’appeler via le réseau public.
Selon la directive, par ailleurs, le service réservé
doit être exploité pour le public, notion que l’on
ne retrouve pas dans la définition belge. Néanmoins
la Commission européenne a précisé que les groupes
fermés d’utilisateurs et les réseaux d’entreprises
constituaient des exemples de services qui ne sont pas à destination
du public. La Belgique a ainsi été amenée plusieurs
fois à préciser la portée exacte de sa définition.
En fin de compte, malgré la définition
maximaliste de la téléphonie vocale donnée par
les autorités belges, Belgacom se trouve aujourd’hui déjà
confrontée à une concurrence dans ce domaine. Les lignes
téléphoniques internationales devraient, par exemple,
être un des services les plus rentables pour l’opérateur
public. Cependant, d’autres opérateurs offrent des tarifs
nettement plus compétitifs par la technique du "call-back".
Il s’agit d’un mécanisme de rappel automatique par
un opérateur étranger. Il permet de faire effectuer
la facturation non par Belgacom, mais par un opérateur étranger.
La méthode de la "International calling card" a le
même effet : il s’agit d’une carte téléphonique
qui permet à son détenteur d’être facturé
par l’intermédiaire de sa facture de téléphone
privée ou professionnelle. Des tarifs avantageux y sont souvent
associés. Ces services n’entrent pas dans la définition
restrictive de la téléphonie vocale.
Ces méthodes représentent un manque
à gagner pour Belgacom. L’entreprise procédait
à d’importantes subsidiations croisées des revenus
des appels internationaux vers le raccordement au réseau local
et les appels locaux. Dans une perspective de pleine libéralisation,
elle doit rééquilibrer ses tarifs locaux en fonction
des coûts réellement encourus pour se préparer
à un régime de concurrence. En 1996, le troisième
rééquilibrage des tarifs ("tariff rebalancing")
a d’ailleurs suscité des plaintes des organisations de
consommateurs contre Belgacom auprès de la Commission européenne,
pour abus de position dominante. Ces plaintes n’ont finalement
pas produit d’effets.
Les droits exclusifs concernant l’infrastructure
Par ailleurs, toute l’infrastructure des télécommunications,
même utilisée pour les services non réservés,
a été considérée comme infrastructure
publique. Elle a donc été accordée en concession
exclusive à Belgacom par la loi de 1991. Cette concession ne
couvre cependant pas les "équipements et moyens (…)
destinés au service de la radiodiffusion et des réseaux
de radiodiffusion et de télédistribution". Ceci
implique une capacité d’utiliser le domaine public et
les propriétés.
Il existe des exceptions à l’exclusivité
de Belgacom sur l’infrastructure publique. D’une part, le
ministre peut préciser, sur avis de l’IBPT, les cas où
une exception au monopole sur l’infrastructure publique se justifie.
D’autre part, certaines entités publiques qui détiennent
un réseau propre (Etat, communautés, régions,
provinces, communes) peuvent l’exploiter, mais uniquement pour
un usage propre .
Le régime juridique des infrastructures a été
fortement modifié par l’arrêté royal du 28
octobre 1996 concernant les infrastructures alternatives. Celui-ci
a permis, on le verra, l’exploitation commerciale de réseaux
jusque-là réservés à d’autres usages
que l’offre de télécommunications au public.
La libéralisation progressive de la mobilophonie
En 1991, le législateur avait maintenu les droits exclusifs
de Belgacom dans le domaine de la mobilophonie pour deux raisons.
D’une part, "la mobilophonie implique une infrastructure
de type radioélectrique concurrente à l’infrastructure
fixe de Belgacom et par conséquent elle constitue un danger
pour le réseau de téléphonie fixe". D’autre
part, "les obligations de service public ne seraient pas nécessairement
satisfaites par un réseau de mobilophonie dans les mains d’un
concurrent".
La loi de 1991 autorise par ailleurs les entreprises
publiques autonomes à constituer des sociétés
ou à prendre des participations. En vertu de cette disposition,
Belgacom a créé en décembre 1994 une filiale
Belgacom Mobile, dans laquelle elle détient 75 %. Les 25 %
restants ont été souscrits par la société
Air Touch Belgium, filiale de la société américaine
Pactel. Belgacom Mobile a entrepris d’établir un réseau
national de mobilophonie GSM.
Le maintien initial d’un droit exclusif
Le maintien d’un droit exclusif a rapidement été
mis en cause. L’argumentation de l’Etat belge a été
rejetée par la Commission européenne. Selon elle, il
s’agissait d’une extension abusive du monopole à
un service nouveau et d’un abus de position dominante. La directive
96/2 CE, modifiant la directive 90/388 CEE, impose d’ailleurs
d’abolir toute forme de droits occlusifs et spéciaux dans
le secteur des communications mobiles et personnelles. En outre, le
développement accéléré des services de
mobilophonie et la définition de la norme GSM soutenue par
tous les Etats membres de l’Union européenne rendaient
la libéralisation préférable, pour ne pas freiner
le développement de ce service en Belgique.
La suppression du droit exclusif
Le gouvernement a réalisé le caractère inévitable
de la mise en concurrence. La loi du 12 décembre 1994 a modifié
celle du 21 mars 1991 dans ce sens. La mobilophonie a reçu
le statut de service non réservé, mais néanmoins
réglementé. Selon les travaux préparatoires,
"les techniques de radiocommunication ont chacune des spécificités
qui nécessitent d’être réglementées
dans l’intérêt général". Les
modalités du régime ont été précisées
dans l’arrêté royal du 7 mars 1995. Chaque opérateur
qui veut fournir un service de mobilophonie en Belgique doit demander
l’autorisation du ministre compétent. Il doit répondre
aux conditions d’un cahier des charges qui instaure, entre autres,
une obligation d’universalité géographique et des
règles relatives à la tarification. Ce cahier des charges
est appliqué aux services similaires exploités par Belgacom.
En vertu de cette nouvelle réglementation, une licence de deuxième
opérateur a été mise aux enchères. Aux
termes d’une procédure, Mobistar, société
formée sous la direction de France Telecom, a été
désignée en 1996 comme le deuxième opérateur
du réseau de mobilophonie en Belgique. Il existe à l’heure
actuelle un débat afin de se prononcer sur la possibilité
et la nécessité d’un troisième opérateur.
Par ailleurs, la licence a dû être payée
par la société Mobistar. La Commission européenne
a dès lors exigé que le paiement d’une somme identique
(9 milliards de francs belges) soit exigé du premier opérateur,
afin d’assurer un traitement équitable des différents
concurrents. La légalité de cette décision a
été discutée. On peut se demander si l’évaluation
effectuée dans une procédure d’enchères
doit être considérée comme automatiquement correcte.
On peut aussi s’interroger sur la prise en considération
de frais antérieurs plus importants, compte tenu des progrès
technologiques intervenus entre l’installation du premier réseau
de mobilophonie et celle du second. Quoi qu’il en soit, la décision
n’a pas été contestée en justice.
La réglementation sur la mobilophonie souligne
la tendance de l’Etat à augmenter les règles qui
encadrent le marché des télécommunications pour
les nouveaux opérateurs. Dans ce cas précis, les conditions
auxquelles doit répondre un nouvel opérateur (qui lient
également Belgacom) reprennent essentiellement les principes
de base du service public. La libéralisation se traduit dès
lors, dans les faits, par l’obligation de soumettre les nouveaux
opérateurs à des obligations de service public. Il n’est
par conséquent pas justifié, comme on l’a parfois
entendu, de prétendre que la libéralisation aboutit
à une dégradation du service public.
Enfin, même si les services de mobilophonie
avaient été libérés, les opérateurs
GSM devaient encore en 1995 utiliser l’infrastructure de Belgacom
pour l’interconnexion des différents éléments
qui constituent leur réseau en vertu de la loi du 21 mars 1991.
Le groupe Belgacom se trouve ainsi à la fois concurrent et
partenaire des autres opérateurs de mobilophonie. Cette restriction
a toutefois été levée par l’arrêté
royal du 28 octobre 1996 sur la libre concurrence dans les marchés
de services de télécommunications. Les opérateurs
de mobilophonie peuvent maintenant recourir à une infrastructure
propre.
Le secteur des radiocommunications
La loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications
organise, avec ses arrêtés d’application, l’utilisation
du spectre radioélectrique. Cette réglementation est
nécessaire dans la mesure où le spectre radioélectrique
constitue une ressource rare qui doit être partagée entre
différentes utilisations afin d’éviter le risque
d’interférences. La loi du 21 mars 1991 précise
qu’elle n’altère en rien les dispositions de la loi
sur les radiocommunications de 1979 et ses arrêtés d’application.
La loi de 1979 soumet l’établissement
et l’exploitation d’une station ou d’un réseau
de radiocommunication à une autorisation écrite du ministre.
Cette autorisation est personnelle et révocable. Une exception
avait été prévue à l’attention de
Belgacom qui ne se trouvait pas soumise à cette autorisation.
L’autorisation porte d’une part sur l’exploitation
d’un réseau et d’autre part sur l’attribution
des fréquences utilisables. Aujourd’hui, cette loi se
heurte au processus de libéralisation. En effet, la libéralisation
des services et de l’infrastructure a des implications directes
sur la gestion du spectre et sur la demande de fréquences qui
augmente constamment Dans ce contexte, il importe de gérer
l’octroi de fréquences selon les principes de concurrence
loyale.
D’ailleurs, ce système a déjà
été corrigé par l’introduction d’exigences
relatives à l’utilisation des fréquences dans le
cahier des charges relatif aux services de mobilophonie. La loi du
30 juillet 1979 devrait être adaptée pour tenir compte
de ces changements. La mise en concurrence de certaines activités
de Belgacom (la mobilophonie) exige notamment de soumettre Belgacom
à un système similaire à celui de ses concurrents.
Cela implique la suppression de l’article 2 de la loi du 30 juillet
1979 autorisant de plein droit à Belgacom à exploiter
tout service de radiocommunication. Cela implique aussi de ne limiter
le nombre d’autorisations que pour des exigences essentielles.
Ainsi par exemple, la rareté des bandes de fréquences
a été invoquée pour limiter l’accès
au marché belge de mobilophonie à deux opérateurs.
L’évolution technologique, entre autres
la numérisation et les techniques de compression, augmente
la capacité d’utilisation du spectre. De nouveaux opérateurs
doivent pouvoir construire leur propre infrastructure et doivent pouvoir
faire appel à l’infrastructure de tiers. Il faut également
assurer des contrats d’interconnexion équitables de nouveaux
réseaux aux réseaux fixes existants.
Les lois et du 30 juillet et du 21 mars 1991 sont
complémentaires. Le spectre radioélectrique exige, on
l’a vu, une gestion particulière. Elle est dans les mains
de l’IBPT qui est en charge de l’attribution des fréquences
mais également de la coordination nationale et internationale.
Cependant des adaptations sont nécessaires pour tenir compte
d’une part de l’évolution technologique, de l’harmonisation
européenne des agréments et des spécifications
de nouveaux systèmes et d’autre part, des exigences d’une
concurrence loyale telle que la fixation claire des critères
d’attribution de fréquences entre différents opérateurs.
La libéralisation partielle de l’infrastructure alternative
A partir de 1994, dans le cadre de la libéralisation
générale du secteur des télécommunications,
les autorités européennes ont annoncé leur volonté
de supprimer également les droits exclusifs concernant les
infrastructures de télécommunications. Cela concernait
en premier lieu ce qu’on appelle les infrastructures alternatives.
Par là, on entend l’infrastructure existante, à
l’exception du réseau public de télécommunications,
qui est utilisée à d’autres fins que la transmission
de services de télécommunications (eau, gaz, électricité,
chemin de fer, radio et télédistribution). Moyennant
certaines adaptations techniques, ces réseaux alternatifs peuvent
également servir pour les services de télécommunications.
Aussi, la loi du 20 décembre 1995 a introduit
la possibilité pour les instances qui exploitent une infrastructure
alternative (eau, gaz, électricité, chemin de fer, radio
et télédistribution), d’utiliser cette infrastructure
pour fournir des services de télécommunications non
réservés. Ceci constitue un premier pas vers la libéralisation
de l’infrastructure alternative pour la fourniture des services
de téléphonie vocale en 1998. En revanche, le régime
juridique de la création de nouvelles infrastructures alternatives
n’a pas encore été défini.
A l’heure actuelle l’ouverture des infrastructures
alternatives pour les services non réservés concerne
surtout le réseau câblé de télédistribution
qui représente un potentiel important pour la transmission
de services de télécommunication. Sa libéralisation
apparaissait importante à la Commission européenne pour
le développement rapide de la concurrence. L’investissement
nécessaire à son adaptation pour la transmission de
services de télécommunications reste raisonnable comparé
à l’investissement requis par d’autres types d’infrastructures
de transmission.
Dans la perspective de la libéralisation générale,
une société a été créée
à l’initiative du gouvernement flamand : Telenet Vlaanderen.
Elle bénéficie de la coopération de l’opérateur
local américain US West. A l’heure actuelle, cette société
a pour objectif de fournir des services de téléphonie
vocale et de développer de nouveaux services à haute
valeur ajoutée. Toutefois, l’étendue du territoire
couvert et des services offerts n’a pas encore été
déterminée avec exactitude.
La libéralisation générale des services et des
infrastructures de télécommunications
Le service universel
Le contexte du développement de la notion de service universel
Le monopole de la téléphonie vocale
accordé à l’opérateur public pour financer
ses activités de service public a longtemps été
considéré comme seule solution possible tant au niveau
social, économique que politique. Aujourd’hui l’Etat
ne compte pas démissionner de sa fonction de garant du service
public. Cependant, il existe une perception de plus en plus répandue
en Europe (et dans le monde) que la concurrence se justifie davantage
que le monopole en raison des nouvelles exigences de l’évolution
technologique et de l’émergence de la société
de l’information.
A partir de 1994, cela a incité les institutions
de la Communauté européenne à rechercher un système
qui devrait permettre à l’Etat d’assurer sa mission
dans un environnement libéralisé. Il s’agit de
répondre, dans le cadre de la libéralisation, aux objectifs
consacrés du service public par de nouveaux mécanismes.
Ceux-ci doivent garantir un service de qualité à un
prix abordable à toutes les catégories de personnes.
Tel est le principe du service universel. Son développement
rapide a permis de calmer certaines appréhensions suscitées
par la perspective d’une libéralisation complète.
La définition du service universel
Dans un secteur des télécommunications
soumis à la concurrence, le service minimal à fournir
doit être défini au niveau de la Communauté européenne.
Sinon, l’adoption de mesures différentes par les Etats
membres peut provoquer des distorsions à la concurrence entre
les opérateurs. Cette définition a suscité de
nombreux débats. Néanmoins, le concept a connu un développement
extrêmement rapide dans l’Union européenne à
partir de 1994. En 1996, la Commission a présenté deux
communications sur ce sujet. La première définit les
paramètres essentiels du service universel. La seconde tente
d’encadrer les initiatives des Etats membres.
Le service universel est défini aujourd’hui
comme un ensemble minimal de services définis, d’une qualité
donnée, mis à la disposition de tous les utilisateurs
indépendamment de leur localisation géographique et
à un prix abordable . La notion de prix abordable doit
cependant prendre en considération les conditions spécifiques
nationales. Le service universel recouvre les principes du service
public (universalité, variabilité et continuité).
Dans une certaine mesure, il pourrait ainsi se substituer au service
public. Néanmoins, cette substitution dépend de l’étendue
donnée au concept de service public dans les différents
Etats membres.
En tout état de cause, dans le cadre communautaire,
les Etats membres ont la liberté d’évaluer si les
activités prestées au titre du service universel, telles
que définies dans la directive européenne, permettent
de répondre aux exigences du service public. Ils peuvent, en
vertu du principe de subsidiarité, compléter la définition
du service universel d’éléments du service public
national qui n’auraient pas été prévus au
niveau communautaire. Pour cela, toutefois, il faut qu’aucune
entrave à la concurrence ne soit ainsi créée
et que ces éléments ne soient pas financés par
les mécanismes prévus pour le service universel.
Les divergences qui peuvent apparaître aujourd’hui
sont notamment liées aux différents développements
technologiques réalisés dans les Etats membres. Ainsi,
les Etats où le réseau RNIS est déjà bien
développé l’introduisent comme un élément
obligé du service universel pour les entreprises. D’autres
divergences peuvent résulter de conceptions différentes
quant aux implications sociales de la société de l’information.
Le financement du service universel
La fourniture du service universel est considérée
comme une activité non économique, c’est-à-dire
non assortie de profits. Jusqu’à récemment, l’Etat
avait estimé que le seul moyen de financer des prestations
de ce type consistait à établir un monopole. Celui-ci
permettait une subsidiation croisée des activités non
rentables par les activités rentables. La suppression de tous
les droits exclusifs oblige à concevoir de nouveaux mécanismes
de financement.
La nouvelle version directive ONP a introduit une
solution plus adaptée à la libéralisation générale
de 1998. Elle prévoit la constitution d’un fonds de service
universel. Chaque opérateur qui fournit des activités
en concurrence doit contribuer à ce fonds. Il est utilisé
pour financer les coûts additionnels engendrés par les
activités non économiques du service universel. Le service
universel permet d’octroyer des droits spéciaux aux opérateurs
qui participent à sa réalisation. Les exigences essentielles
répondent aux spécificités du marché des
télécommunications :
la sécurité et l’intégrité des réseaux
;
l’interconnexion des réseaux et l’interopérabilité
des services ;
la protection et la confidentialité de l’information sur
les clients.
Le rôle du service universel dans la société
de l’information
Le développement de la société de l’information
est une priorité pour la Communauté européenne
aujourd’hui. Tous les effets de l’émergence de la
société de l’information dans la vie privée
et dans la vie des affaires ne sont pas encore identifiables, mais
elle ouvre la voie à une profonde transformation économique
et sociale. Le développement des industries liées aux
technologies de l’information constitue son moteur principal.
La part croissante des services dans l’économie exige
de consacrer une attention particulière au développement
de nouveaux services. La gamme la plus large de services doit être
mise à disposition du consommateur au meilleur rapport qualité-prix.
Selon les autorités communautaires, la libéralisation
des marchés de télécommunications devrait favoriser
les investissements privés et publics nécessaires au
développement de la société de l’information
en Europe. Toutefois, l’action de la Communauté doit veiller
au renforcement de la cohésion économique et sociale.
Elle doit aussi définir des principes communs sur le contenu
et le financement du service universel. Cette notion doit évoluer
en fonction des progrès des technologies, du développement
du marché et des besoins des utilisateurs. Elle doit permettre
d’éviter le développement d’une société
de l’information à deux vitesses entre ceux qui ont accès
à l’information et ceux qui ne l’ont pas.
La définition du service universel dans la réglementation
belge
La loi du 20 décembre 1995 a introduit dans la loi du 21 mars
1991 la notion de service universel. Désormais défini
dans l’article 68 de la loi du 21 mars 1991, il constitue "la
fourniture de services de télécommunications permettant
l’accès à un ensemble minimal de services définis
dune qualité donnée à tous les utilisateurs indépendamment
de leur localisation géographique et à un prix abordable".
Belgacom est désignée comme prestataire du service universel
et est par conséquent tenue de fournir seul le service universel
sur tout le territoire.
Le coût du service universel est calculé
annuellement par l’IBPT sur base des informations fournies par
le prestataire du service. Un fonds pour le service universel est
créé et tout opérateur offrant au public des
infrastructures ou des services non réservés est tenu
de contribuer à ce fonds proportionnellement à son chiffre
d’affaires dans le secteur. L’IBPT gère le fonds.
Plusieurs dispositions indiquent que le service universel devrait
avoir un prestataire. Ce prestataire doit couvrir l’ensemble
du territoire sur lequel il doit offrir des tarifs uniformes.
Le contenu du service universel a été
précisé dans l’arrêté royal du 28
octobre 1996 portant la liste des services prestés au titre
du service universel des télécommunications. Le service
universel se traduit par un service de téléphonie moderne
et de qualité à un prix abordable accompagné
d’un service de base en matière de renseignement, assistance
et information. L’IBPT assure le contrôle du respect des
obligations du prestataire du service universel.
L’article 2, 5° de l’arrêté
royal du 28 octobre 1996 établit une liste de services prestés
au titre du service universel : "la fourniture de manière
ininterrompue, en cas de non-paiement de la facture téléphonique,
des éléments du service universel (…) suivants
: (a) la possibilité d’être appelé par un
autre abonné, à l’exclusion des appels en PCV,
(b) la possibilité de former les numéros d’urgence
et autres numéros gratuits". Ce droit de raccordement
minimal, quoiqu’il arrive, constitue un changement complet par
rapport à la situation antérieure. Il s’agit par
ailleurs d’un droit peu établi jusqu’ici dans d’autres
pays développés. Il réclame non seulement des
capacités financières, mais également des capacités
techniques, et notamment informatiques, importantes. Il sera extrêmement
intéressant d’examiner l’évaluation des coûts
financiers de ce mécanisme ainsi que sa mise en œuvre
pratique sur le réseau.
Un autre élément notable tient à
l’article 2, 7° du même arrêté. Il prévoit
"la mise à disposition à un prix abordable, en
ce qui concerne la connexion, le coût des communications et
de la redevance, dune ligne dune capacité permettant l’interactivité,
en vue de fournir un accès à des réseaux de données,
notamment Internet, et répondre ainsi aux besoins particuliers
des hôpitaux, des écoles, des bibliothèques publiques".
Ce genre de service est déjà fourni par certains opérateurs
aux Etats-Unis, par exemple. Le droit accordé apparaît
toutefois moins strict, puisque les conditions de prix n’ont
pas été définies. Le caractère abordable
des prix n’est pas davantage défini, même si le
principe de fourniture du service de base à des prix uniformes
sur l’ensemble du territoire doit être respecté.
La notion de prix abordable devra être examinée
au regard des normes établies par les autorités réglementaires
en matière de prix ("price caps"). Comme l’a
montré l’expérience des dernières années,
il ne suffira pas d’établir une norme générale
des prix. Pareille norme prend en considération l’ensemble
des services offerts au public. Elle peut parfaitement être
respectée alors que les réductions de prix ne bénéficient
qu’aux clients importants, et même que les prix offerts
aux petits consommateurs augmentent. Il n’y aura pas de véritable
service universel si les normes de prix ne prennent pas en considération
de façon spécifique les petits consommateurs.
Par ailleurs, des précisions devront certainement
être apportées dans un prochain arrêté concernant
les aspects financiers du service universel. Tant l’obligation
de péréquation tarifaire que l’accès public
à des réseaux d’information pour les écoles,
les hôpitaux et les bibliothèques sont des éléments
nationaux des obligations du service universel. Ils sont ajoutés
par l’Etat fédéral aux exigences minimales de la
réglementation communautaire. Ces charges supplémentaires
engendrées par ces obligations ne pourront pas, on l’a
vu, être financées par le fonds du service universel
afin de ne pas entraver la concurrence. Le problème ne se posera
peut-être pas pour la péréquation tarifaire, mais
il se posera certainement pour l’accès public à
des réseaux d’information reconnus à des établissements
d’utilité générale.
Les rapports avec le contrat de gestion
"En ce qui concerne le fournisseur actuel du service universel,
les principes essentiels du contrat de gestion en cours seront maintenus".
Ils seront mis en concordance avec les dispositions de l’arrêté
royal. Cette situation paraît transitoire. A l’avenir,
les dispositions de l’arrêté royal du 28 octobre
1996 supposent la suppression de la majeure partie du contrat de gestion.
Des obligations de service public subsisteront sans doute ; elles
seront inscrites dans un cahier des charges et s’appliqueront
à tous les opérateurs qui participent à la réalisation
du service universel. Il s’agira en fait d’un régime
similaire à celui élaboré à partir de
1995 pour les services de mobilophonie.
En tout état de cause, la précision
des dispositions de l’arrêté royal du 28 octobre
1996, et selon toute vraisemblance, d’un autre arrêté
royal définissant les modalités techniques du service
universel, réduiront beaucoup la portée de toute négociation
contractuelle.
Le remplacement partiel du service public par le service universel
Les trois grands principes du service public - universalité,
continuité et variabilité - sont à la base de
la notion de service universel. Par certains aspects essentiels, les
deux notions diffèrent Sur le plan juridique, la notion de
service public dépasse celle de service universel.
Une première différence entre les deux
notions concerne leur fondement juridique. Les activités de
service public sont fixées dans un contrat. Par définition,
elles sont négociables. Par contre, c’est un arrêté
délibéré en Conseil des ministres, sur avis de
l’IBPT, qui établit la liste des services prestés
au titre du service universel. Il s’agit donc d’un acte
unilatéral de nature réglementaire et générale
qui ne lie pas l’Etat et un opérateur, mais qui s’applique
de façon générale à l’ensemble des
personnes prestant des services au titre de service universel. Par
ailleurs, les deux notions de service public et de service universel
s’éloignent dans les modalités de leur mise en
œuvre, et notamment leur mode de financement. Les droits exclusifs
octroyés pour financer les activités de service public
ne se justifient pas dans le cadre du service universel. Celui-ci
est financé par le fonds.
Enfin, il existe des différences entre les
notions au point de vue du contenu. A l’heure actuelle, le concept
de service public dépasse en ampleur celui du service universel.
Il suffit à cet égard de comparer les dispositions du
contrat de gestion de 1992 et celle de l’arrêté
royal de 1996 sur le service universel. La définition du service
universel reste vague sur certains points. Le cadre réglementaire
du service universel tient à être souple et évolutif
dans un marché des télécommunications libéralisé
et en évolution technologique permanente. Une extension future
des prestations fournies dans le cadre du service universel a d’ailleurs
été évoquée.
Une illustration du service universel : la libéralisation des
infrastructures alternatives pour les services non réservés
L’arrêté royal du 28 octobre 1996
concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé
à l’article 92, § 1 de la loi du 21 mars 1991, introduit
un article 92bis qui forme la base de la libéralisation de
l’infrastructure alternative. En même temps, l’article
125 de la loi a été abrogé. Cela modifie en réalité
les conditions d’exploitation de ces infrastructures. Naguère
établies par l’article 7 de la loi du 6 février
1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution,
elles relèvent maintenant de l’article 92 de la loi du
21 mars 1991. La gestion de ces infrastructures pour les services
de radio et de télédiffusion relève, dans le
système fédéral belge, de la compétence
des communautés. Une organisation duale en résulte,
car la gestion d’une même infrastructure revient à
des niveaux de compétences différents en fonction des
services transférés. Ce partage de compétences
apparaît inadapté - et suscite déjà des
conflits de compétence - dans le nouveau contexte de convergence
technologique entre les télécommunications, l’audiovisuel
et l’informatique. La frontière entre services de télécommunications
et services audiovisuels devient de plus en plus perméable.
Les modalités de l’arrêté
royal sont les suivantes. Tout opérateur peut exploiter l’infrastructure
alternative existante pour offrir des services publics non réservés
de télécommunications moyennant l’obtention d’une
licence individuelle, à condition que ce soit compatible avec
le maintien du service universel. Par services publics de télécommunications,
on entend les services de télécommunications offerts
au public. Le détenteur d’une licence bénéficie
de droits et d’obligations spéciaux sur le plan de l’interconnexion
et de l’utilisation du domaine public et des propriétés
et de la contribution au fonds de service universel. L’attribution
des licences est soumise pour avis à l’IBPT et la décision
revient au ministre. Elle est déterminée sur la base
de critères tels que la contribution au service universel,
la qualité, la fiabilité, la couverture géographique,
… et en fonction de la position du demandeur sur le marché.
L’utilisation d’infrastructure non publique
est gérée par un système plus souple de simple
déclaration. La distinction entre infrastructure publique et
non publique remonte aux temps de la RTT. L’infrastructure non-publique
concernait uniquement les infrastructures qui ne servaient pas à
offrir des services de télécommunications au public.
Elle constituait la propriété de certaines autorités
ou d’entreprises d’utilité publique. Cette infrastructure
devait servir exclusivement à un usage propre. Le nouvel arrêté
royal sur l’infrastructure alternative lève la plupart
de ces contraintes et modifie par conséquent en réalité
la définition de l’infrastructure non publique. Ainsi,
cette infrastructure peut être utilisée à d’autres
fins qu’à un usage propre.
La libéralisation générale des communications
mobiles et personnelles
L’arrêté royal du 28 octobre 1996
transposant les obligations en matière de libre concurrence
sur les marchés des services de télécommunications
découlant des directives en vigueur de la Commission européenne
permet de retirer la radiomessagerie (sémaphonie) des services
réservés de Belgacom. En plus, il prévoit une
dérogation à l’article 92 § 1 de la loi du
21 mars 1991 pour les opérateurs de systèmes de télécommunications
mobiles et personnelles. Ils peuvent dorénavant créer
leur propre infrastructure sans devoir passer par l’infrastructure
de Belgacom. Néanmoins une licence est requise.
Dans l’immédiat, ce dernier changement
n’apparaît pas susceptible de produire des conséquences
importantes. A moyen terme, en revanche, il contribuera certainement
au renforcement de la concurrence dans le domaine de la téléphonie
vocale.
La gestion de l’espace de numérotation
Le même arrêté royal du 28 octobre 1996 insère
dans la loi du 21 mars 1991 un article 105bis qui soumet la gestion
de l’espace de numérotation national à l’IBPT.
L’institut doit établir, et éventuellement modifier,
les plans de numérotation et attribuer la capacité de
numérotation afin qu’elle soit disponible et suffisante.
Il ne faut pas sous-estimer l’impact économique des questions
de numérotation. D’abord cet élément est
susceptible de jouer un rôle déterminant dans un système
de concurrence. La capacité concurrentielle repose notamment
sur la possibilité de garantir à un client la conservation
de son numéro. Par ailleurs, la couverture de l’ensemble
du territoire par le prestataire de service universel peut fortement
changer de signification selon la division du territoire.
Des problèmes à régler
Avant 1998, de nombreux problèmes devraient encore être
réglés afin de garantir un minimum de sécurité
dans l’environnement juridique de l’ouverture totale de
ce marché à la concurrence. Il s’agit essentiellement
du régime des licences, des obligations d’interconnexion,
du financement du service universel et du régime de la création
de nouvelles infrastructures. La libéralisation générale
de l’infrastructure sera nécessairement liée à
l’élargissement du système de licences. Le mécanisme
d’octroi des licences ne doit pas être trop restrictif,
sinon il entravera la libéralisation. En revanche, il doit
être conditionnel, sinon il ne garantira pas l’application
des principes de fourniture d’un réseau ouvert Pour éviter
des abus de position dominante, la directive ONP introduit le principe
de proportionnalité des conditions de licences par rapport
aux exigences essentielles et au service universel. La mise en œuvre
de ce principe dans les Etats membres sera complexe.
L’interconnexion va également jouer un
rôle essentiel dans la libéralisation. Probablement,
une période transitoire donnera une position dominante à
l’opérateur qui détenait auparavant le monopole.
Le succès des autres opérateurs dépendra par
conséquent des conditions de connexion au réseau dominant.
Il est nécessaire de fixer les conditions de cette connexion
et d’éviter des abus de position dominante. L’évaluation
des coûts réels, directs et indirects, de l’interconnexion
suscitera sans nul doute des affrontements. Beaucoup dépendra
de la transparence de l’information transmise par l’opérateur
dominant. Il conviendra d’établir un équilibre
entre les exigences de la transparence et de la confidentialité
des informations de l’entreprise.
Conclusions : les perspectives incertaines du futur
Au cours des prochaines années, les opérateurs
de télécommunications vont devoir affronter, en Belgique
comme dans les autres Etats européens, une multitude d’incertitudes.
La technologie constitue une première source d’incertitudes.
Le progrès ouvre de nouvelles possibilités qui modifient
sans cesse le fonctionnement du marché, et même de la
réglementation. Ainsi, par exemple, le deuxième opérateur
de mobilophonie n’a pas dû affronter les mêmes difficultés
que le premier. En raison notamment des facilités accrues de
transmission, les investissements requis, pour établir un réseau
similaire, ont été nettement moins lourds. De même,
les avantages comparatifs du téléphone et du câble
dans la transmission des programmes multimédia ne cessent de
se modifier.
La réglementation internationale, accompagnée
par les répercussions de réformes engagées dans
divers pays, comme les Etats-Unis, constitue une deuxième source
d’incertitudes. Elle pourrait entraîner à terme
la remise en cause de certaines règles européennes et
nationales. Le GATS contient une série de principes dont la
mise en œuvre effective (liberté d’investissement,
accès au marché, régime des subsides) peut avoir
des conséquences importantes.
La troisième source d’incertitudes réside
dans la réglementation européenne elle-même. Même
avant 1998, cette réglementation appelle déjà
sans cesse des modifications, des précisions et des mesures
complémentaires. A titre d’exemple, en deux années,
l’Union européenne a connu pas moins de trois textes différents
sur la libéralisation de la téléphonie vocale.
Le concept de service universel n’arrête plus de susciter
des raffinements successifs. Tout cela, d’ailleurs, ne constitue
qu’une simple ouverture. A ces premiers éléments
s’ajouteront plus tard les différences entre les législations
nationales d’application des normes européennes et le
développement rapide de nouvelles possibilités technologiques.
L’essentiel des difficultés surviendra après le
1er janvier 1998. A partir de ce moment, les incertitudes risquent
d’engendrer une multiplication des conflits juridiques.
Toutes ces contraintes sont susceptibles d’exercer
leurs effets sur l’élaboration et la mise en œuvre
de la réglementation belge. De ce point de vue, deux éléments
doivent particulièrement retenir l’attention. Il s’agit
de l’évaluation comptable et du financement du service
universel, ainsi que des obligations d’interconnexion. Ces questions
sont d’ailleurs en partie liées. Toutefois, il convient
de prêter une attention au problème de la concurrence
entre les réseaux. Au fur et à mesure que la concurrence
se développe dans le domaine des infrastructures, le marché
belge des télécommunications retourne en quelque sorte
vers ses origines. A la fin du XIXème siècle, il n’avait
pas été possible de gérer de manière rationnelle
la multiplication des réseaux. A la fin du XXème siècle,
la numérisation de toutes les formes de communication ouvre
des perspectives d’interopérabilité plus grandes.
Néanmoins, jusqu’ici, les pays anglo-saxons ayant mis
en place une libéralisation poussée, ont souvent connu
des marchés oligopolistiques, et non des marchés pleinement
concurrentiels. La perspective d’une concurrence totale demeure
par conséquent jusqu’ici une vision théorique.
Il existe des incertitudes quant au fonctionnement d’un régime
non encadré ; les évolutions technologiques rendent
en tout état de cause toute prospective extrêmement aléatoire.
L’organisation de la libéralisation réclamera
en outre plusieurs réformes juridiques importantes. La Belgique
devra surmonter un problème qui a trait à l’actuelle
répartition des compétences. Celle-ci, en effet, n’a
pas été élaborée dans la perspective de
la convergence des technologies et des autoroutes de l’information.
A l’heure actuelle, il existe déjà des contradictions
entre certains textes fédéraux et communautaires. La
Cour d’arbitrage se verra certainement sollicitée au cours
des prochaines années.
Ensuite une nouvelle répartition des compétences
entre le législateur et le gouvernement devra être conçue.
La loi du 21 mars 1991 constituait une loi de transition, adaptée
à un environnement encore largement monopolistique. Depuis
lors, l’environnement européen a connu des mutations très
importantes, mais le cadre légal belge n’a pas évolué
de la même manière. La loi est ainsi revue de façon
périodique, à un rythme de plus en plus rapide et d’une
manière de plus en plus incompréhensible. Il conviendrait
d’établir les principes de la libéralisation du
marché belge dans un nouveau texte législatif. Les modalités
feraient alors l’objet d’habilitations spécifiques
au gouvernement. Pour encadrer l’action réglementaire
de celui-ci, un régime de contrôle parlementaire devrait
être mis en place.
En troisième lieu, il conviendrait sans doute
de mettre fin à la superposition des responsabilités
du ministre des Télécommunications. A l’époque
du monopole, la juxtaposition de la responsabilité du cadre
réglementaire et de la gestion de la participation de l’Etat
dans l’entreprise publique pouvait se justifier. Plus l’ouverture
du marché se développe, et plus le risque d’un
conflit d’intérêt devient fort.
En dépit des éléments non encore
déterminés de la réglementation, plusieurs conclusions
peuvent déjà être tirées des mesures prises
en 1991 et 1996. D’abord, un retard important a été
comblé, tant en matière de réglementation que
de gestion de l’entreprise publique. La libéralisation
a entraîné une nette amélioration de la qualité
des services et une diffusion rapide de nouveaux procédés
technologiques. Cependant, il reste des aspects flous dans la réglementation
et des rigidités dans le fonctionnement de l’entreprise
publique. Ensuite, l’avance de la Belgique dans la définition
du service universel constitue un élément important.
Elle a en effet permis de peser sur les débats concernant la
libéralisation générale des télécommunications
au sein des institutions européennes. Le concept de service
universel est à la fois nouveau et compliqué, dans la
mesure où il s’applique à une réalité
extraordinairement mouvante. Néanmoins, derrière ses
caractéristiques de nouveauté apparaît le visage
du service public, tel qu’il avait été défini
lors de l’apparition du téléphone en Belgique (et
non avec les déviations qu’il a connues par la suite).
Compte tenu de l’importance économique, et même
sociologique au sens le plus large du terme, des communications dans
la société il a plus que jamais sa raison d’être
sommaire


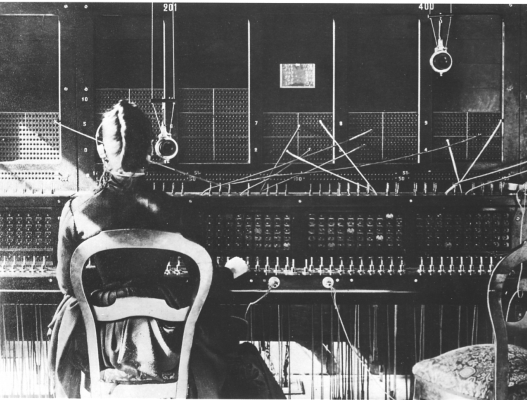




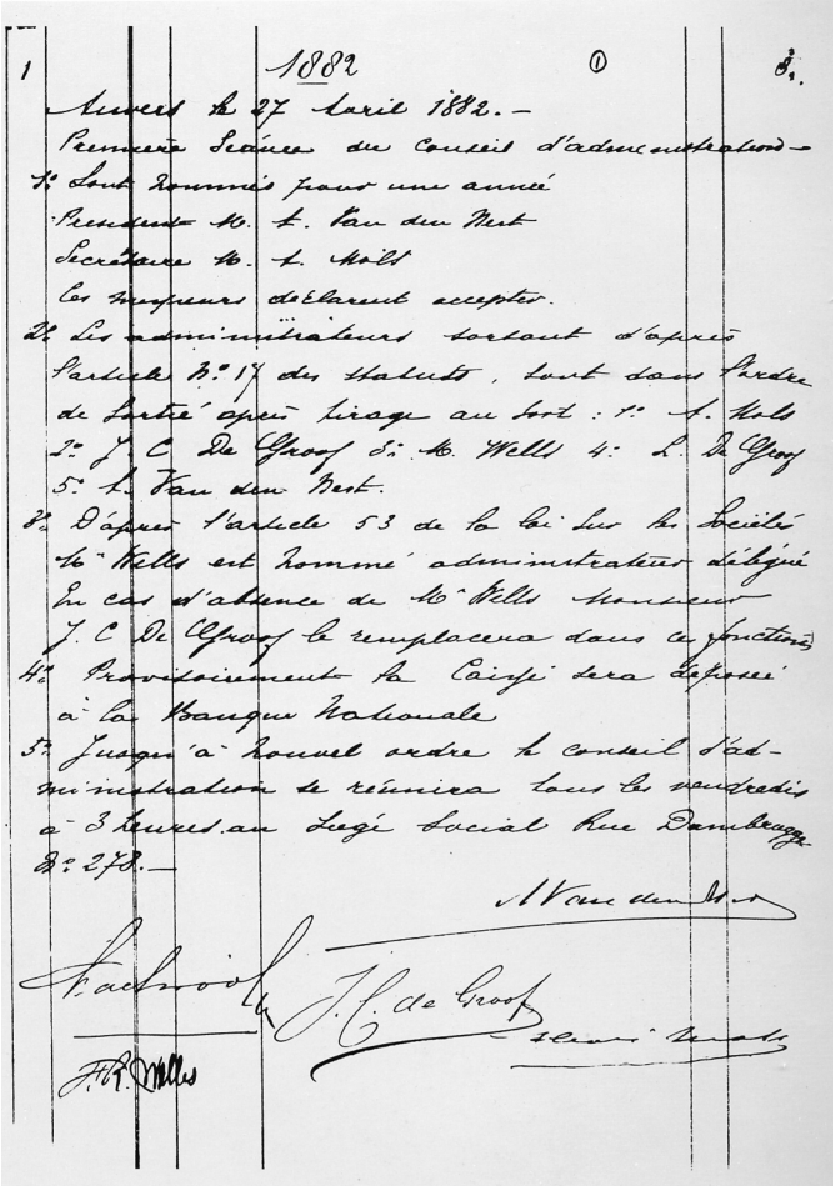



 L'usine en
1884
L'usine en
1884 


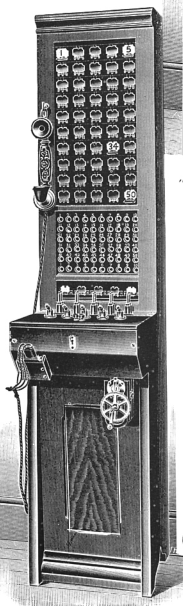

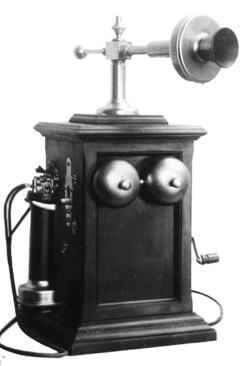






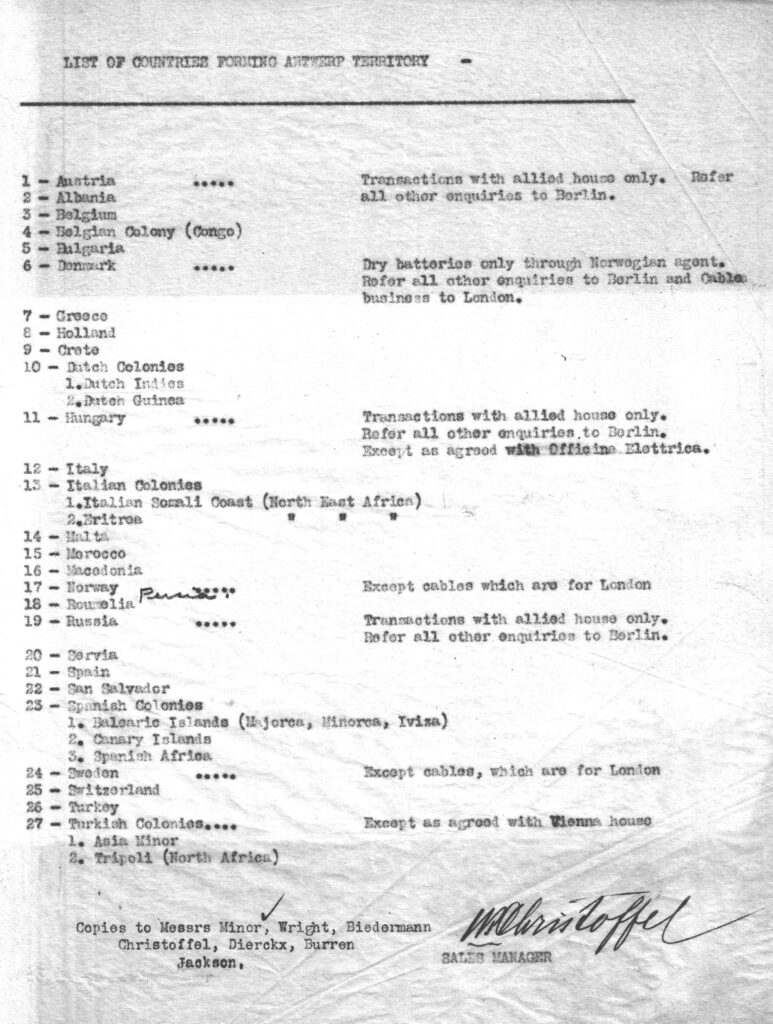

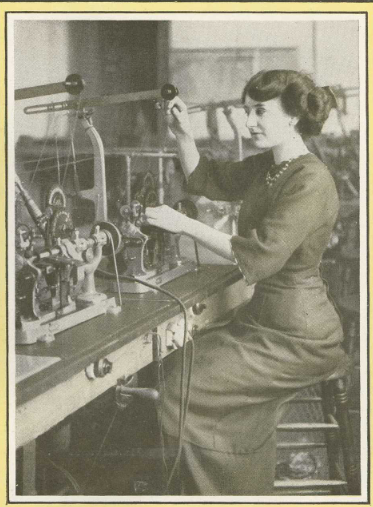

 Salle
de bobinage
Salle
de bobinage

 Vernissage
des métaux.
Vernissage
des métaux.  Infirmerie
de l'établissement.
Infirmerie
de l'établissement.



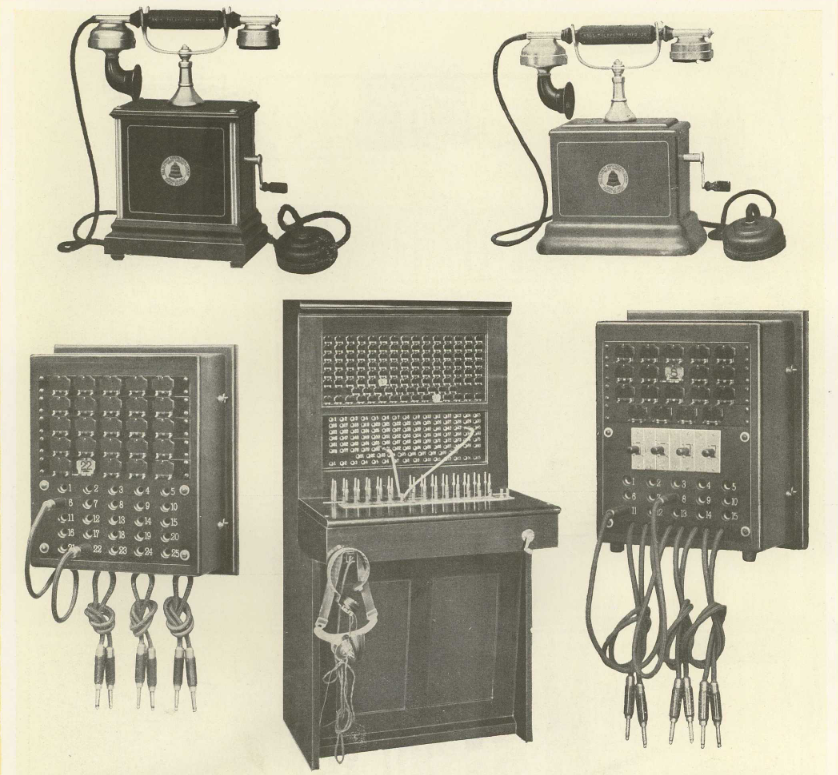
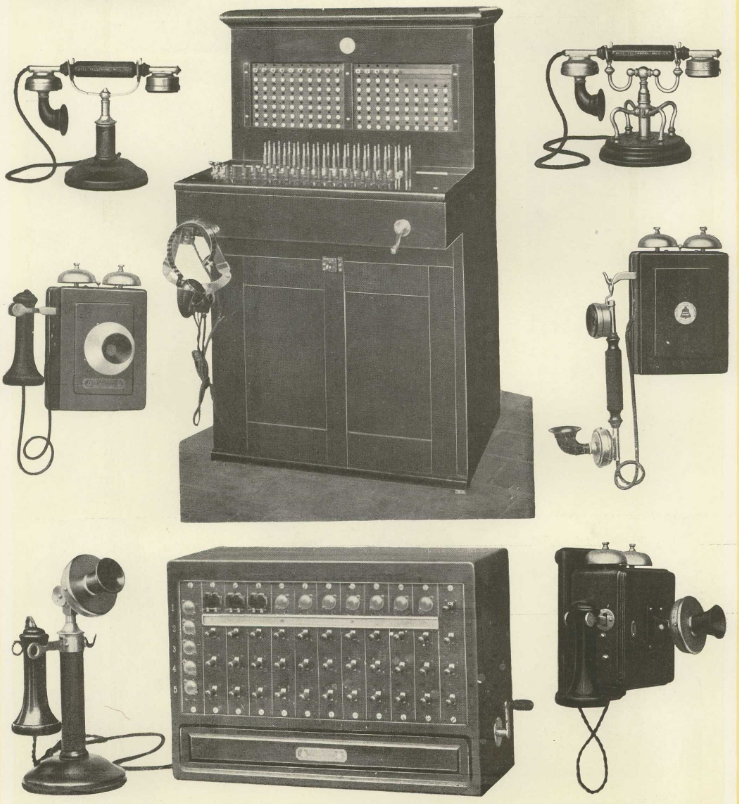
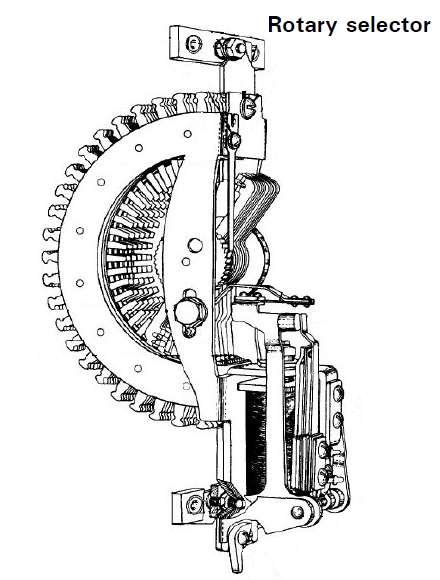

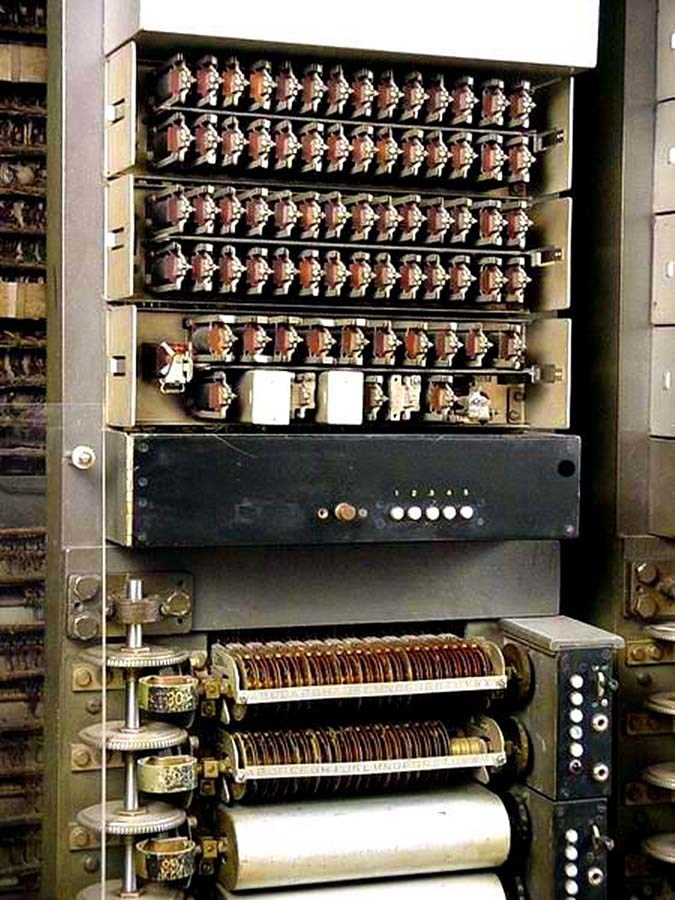



 Après
Après
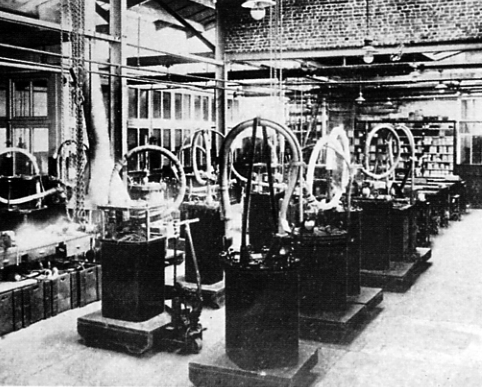
 Autocommutateur
rural de Contich
Autocommutateur
rural de Contich

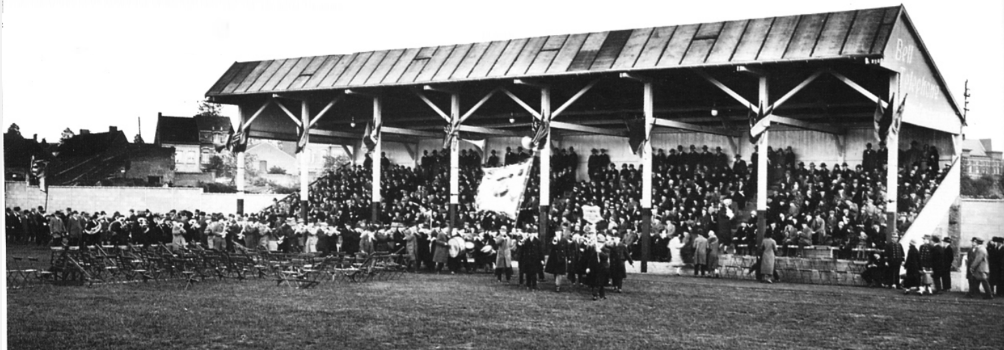
 1932 Visite
du Roi Albert au centenaire..
1932 Visite
du Roi Albert au centenaire..


 Système à
courants porteurs
Système à
courants porteurs

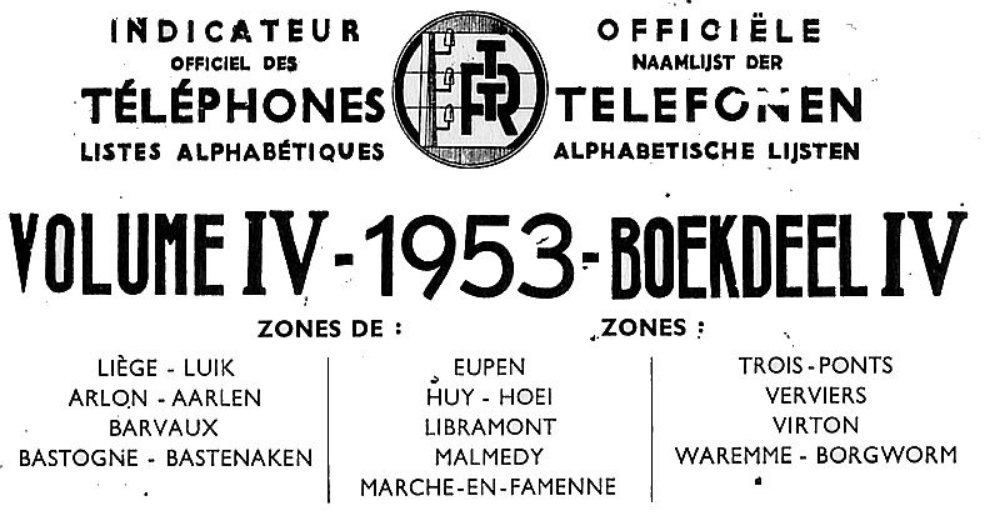

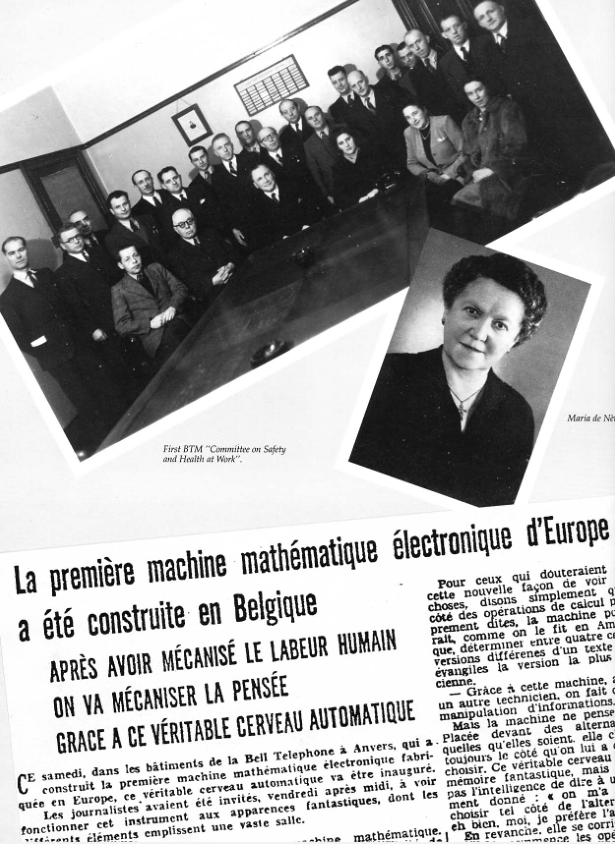

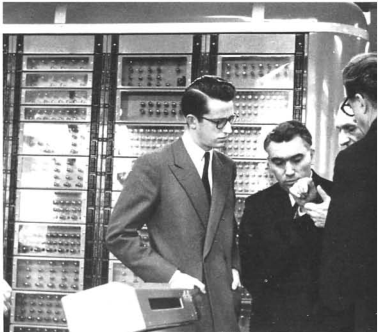





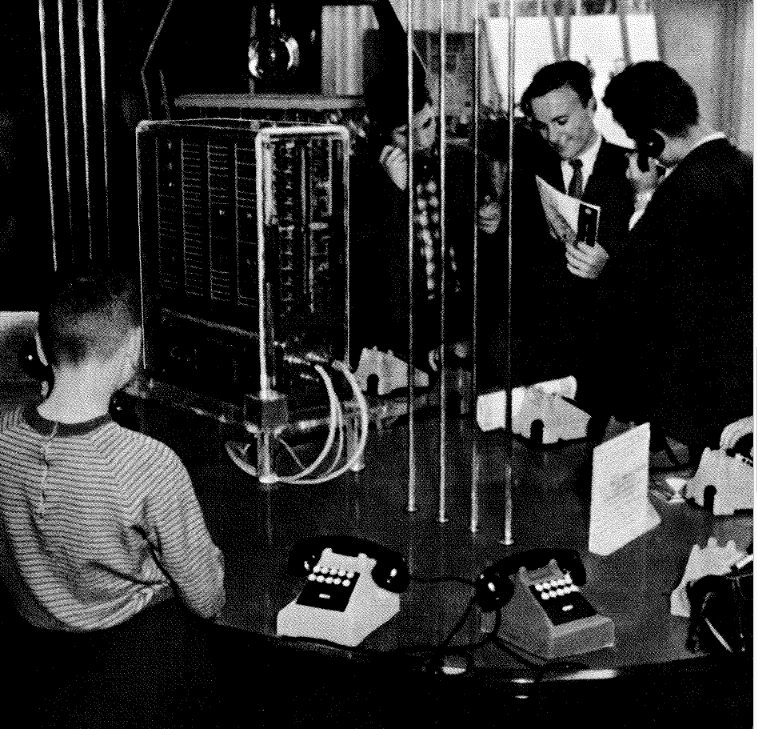
 Contrôle des
postes de télévision
Contrôle des
postes de télévision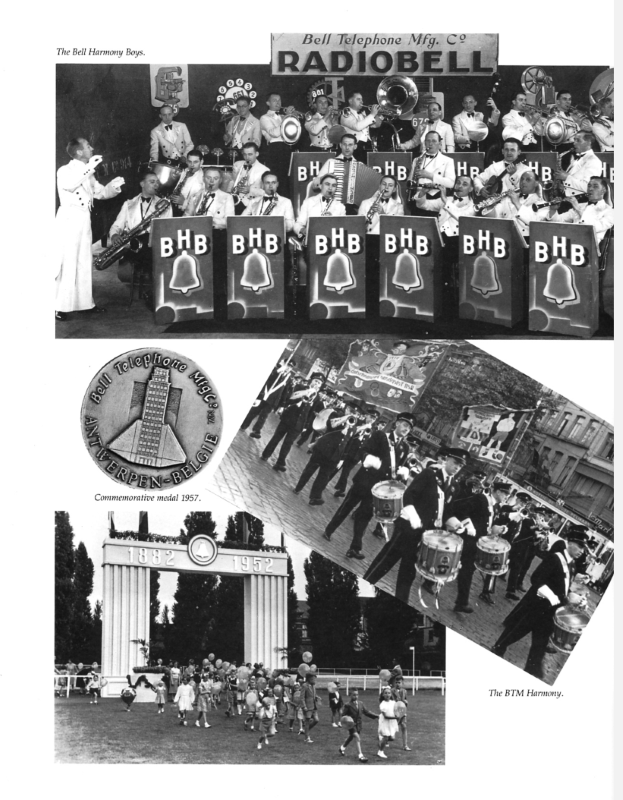






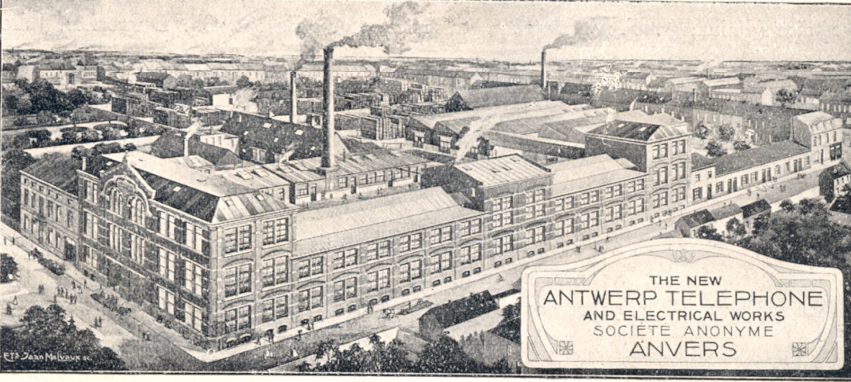


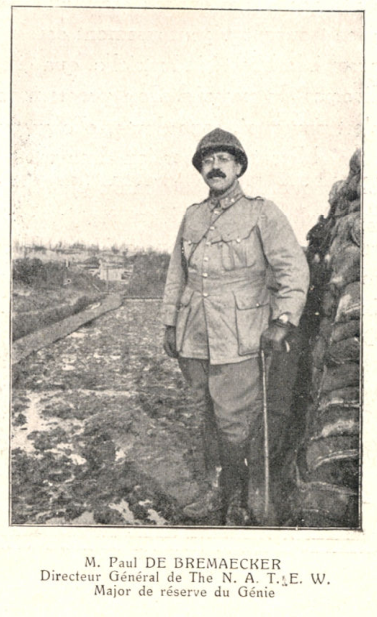


 Atelier
Usinage
Atelier
Usinage




