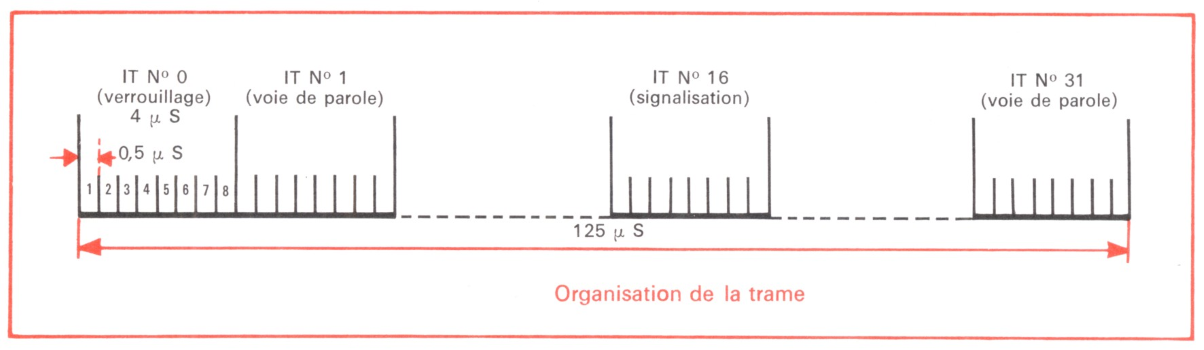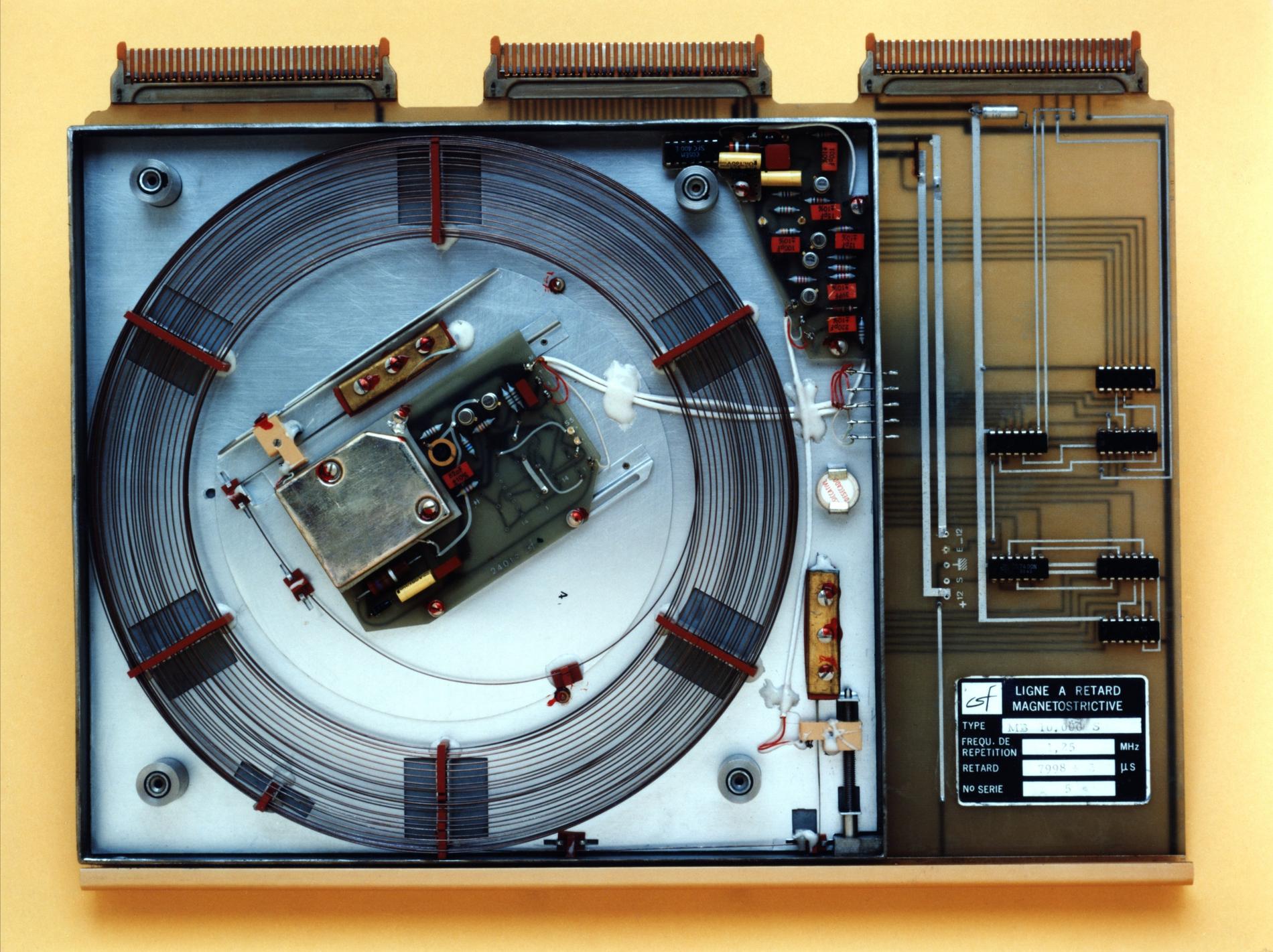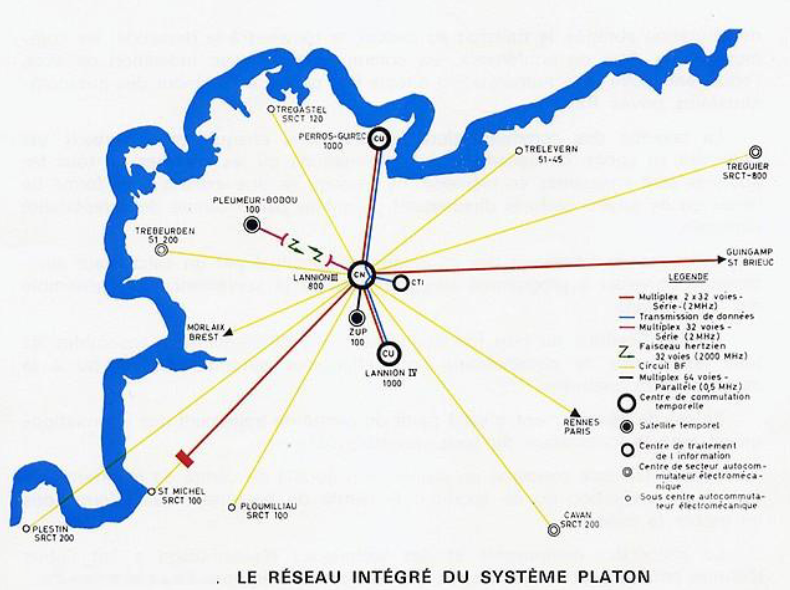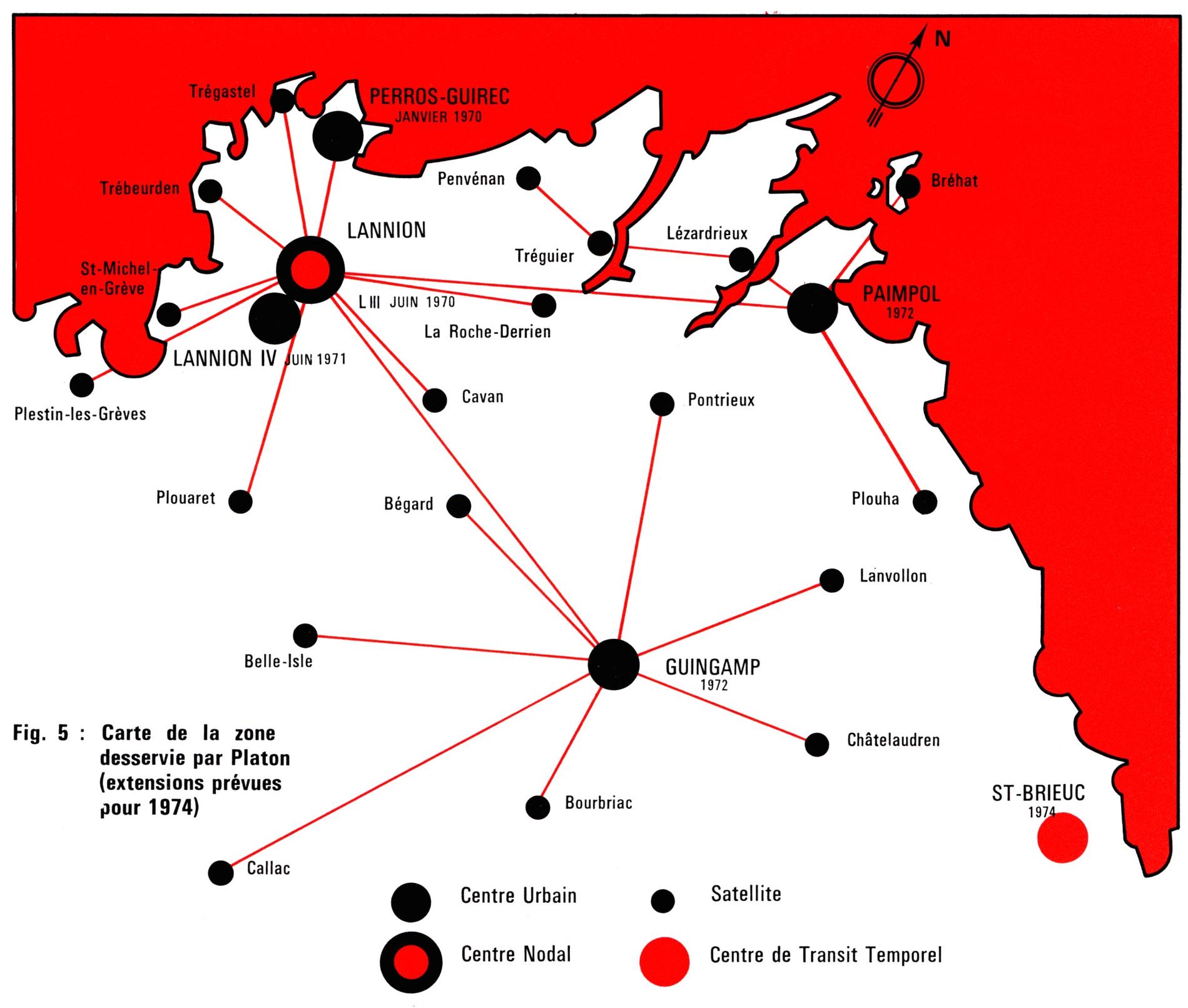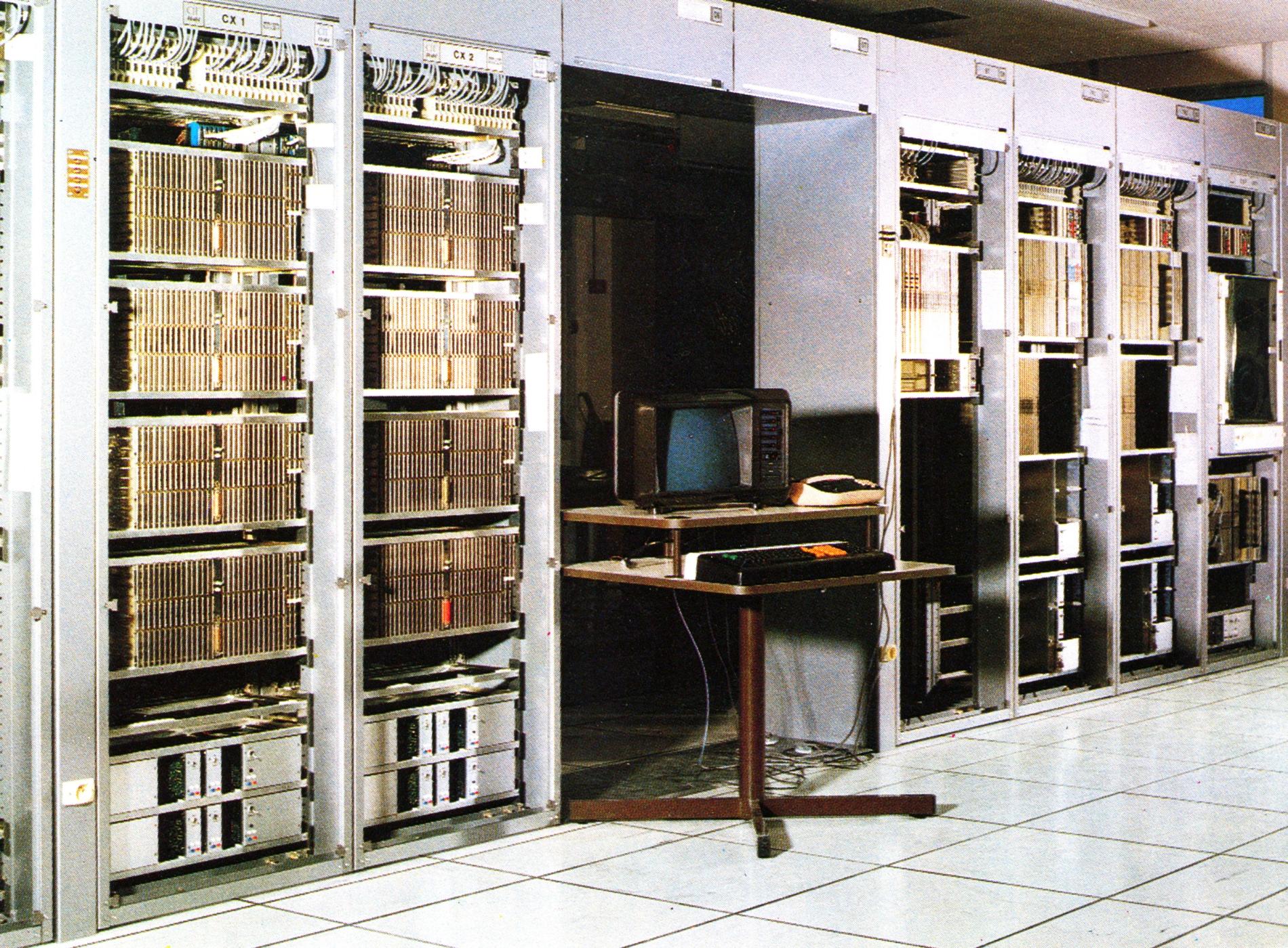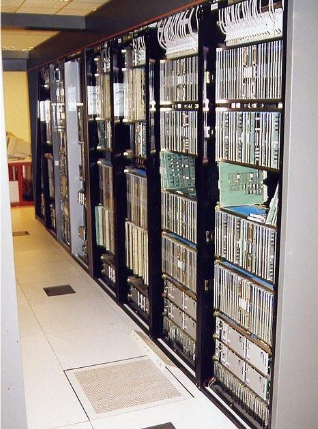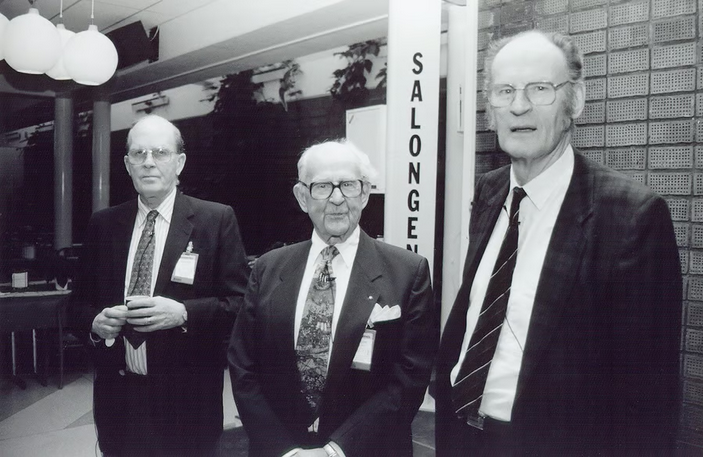1963-2030
Les centraux électroniques
La recherche Numérique
Durant l’année 1961 L-J Libois du CNET,
lance le projet de recherche Numérique, qu’il avait négocié
avec son directeur P. Marzin.
Sa première décision est de prendre comme adjoint André
Pinet. Les deux ingénieurs se connaissent bien. André
Pinet a commencé sa carrière au département transmission
de la Direction de recherche des télécommunications
en 1942. Au départ technicien, grâce à la formation
continue il deviendra ingénieur. En 1946 L-J Libois débute
sa carrière d’ingénieur des Télécommunications
au CNET, récemment fondé, et prend la responsabilité
du service transmission, dans lequel André Pinet deviendra
rapidement son adjoint.
En 1961 les bases théoriques de la commutation numérique
sont à peu près maitrisées, notamment avec les
apports du laboratoire LCT de l’avenue de Breteuil, lié
à la société LMT. En effet en 1947 Maurice Deloraine,
alors directeur technique du groupe ITT, avait déposé
le premier brevet de commutateur numérique à répartition
temporelle et soutenu une thèse de Docteur-Ingénieur
à Paris sur ce thème. Puis au sein du LCT, en 1948-50
Pierre Aigrain vérifie la faisabilité d’une commutation
analogique à répartition temporelle avec modulation
PAM (Pulse amplitude modulation) et enfin en 1958 le brevet E. Touraton-J-P.
Le Corre, ingénieurs au LCT, complète celui de M. Deloraine.
André Pinet, le chef de projet possède
une bonne expérience dans des domaines variés, y compris
sur la commutation.
Sur le numérique il a été un pionnier en ayant
travaillé sur le codage PCM (Pulse Code Modulation), dès
1947, dans la ligne de l’invention d’Alec Reeves en 1938
au laboratoire LMT de Paris, puis dans une deuxième étape
à partir de 1958, au moment où on peut utiliser des
transistors pour faire des réalisations expérimentales.
Il est un chef de projet pragmatique qui donne des objectifs intermédiaires
et fait des choix pouvant être révisés plus tard,
en fonction de la disponibilité de nouveaux composants.
Pierre Marzin suggère l’idée d’installer une
antenne du Cnet (Centre
national d'études des télécommunications) à
Lannion.
Le 23 octobre 1963, le CNET
de Lannion est inauguré par le ministre des PTT, Jacques Marette.
Le Centre National d’Études des Télécommunications
(CNET) de Lannion dont la création remonte à avril 1959
(1962 pour la commutation téléphonique) est devenu depuis
le centre de Recherche et de Développement de France
Telecom (FT/R&D) ;
Suite aux travaux et recherches principalement sur le projet Antinéa
Ramsés, loin de Paris, et de leur hiérarchie,
les ingénieurs du Cnet se sentent libres d’essayer, d’oser.
Ils lancent un pari sur l’avenir, raconte Yves Bouvier, maître
de conférences à la Sorbonne Université et spécialiste
de l’histoire des Télécommunications.
Au lieu de travailler sur l’appareil de commutation téléphonique
de demain, ils décident de plancher sur celui d’après-
après-demain.
Le projet prend le nom de PLATON , prototype lannionais
d’autocommutateur temporel à Organisation Numérique.
Les matériels n’en sont encore qu’à leurs
balbutiements, les transistors ont été inventés
en 1948, mais les chercheurs imaginent utiliser des composants électroniques
pour remplacer l’électromécanique des standards
téléphoniques. Et bingo.
..... Toute la grande histoire
du système PLATON, qui deviendra E10 est liée au
centre de Lannion
et d'Alcatel est racontée à cette page
.
sommaire
Les Bell Labs élaborent une nouvelle technique
de transmission
Au début des années 1960, le fabricant
de matériel de télécommunication Western Electric
du groupe American Telegraph and Telephone (AT&T) lance après
quelques années de recherches conduites par les Laboratoires
Bell, instance de recherche et développement du même
groupe, la production industrielle d'un système multiplex à
modulation par impulsion et codage MIC.
Ces développements ont pour objectif immédiat d'apporter
une réponse économique et pratique à la saturation
des liaisons entre centraux téléphoniques, résultat
d'une croissance soutenue du réseau téléphonique
américain. La nouvelle technique permet d'éviter ou
de réduire la pose, coûteuse et difficile en milieu urbain,
de nouveaux câbles. Elle utilise la modulation, soit la combinaison
de plusieurs voies téléphoniques sur un même support,
en les répartissant non plus en fréquence mais dans
le temps sous la forme d'impulsions codées. La première
mise en service de ce système combinant 24 voies téléphoniques
est effectuée à Chicago en 1962, prologue à une
industrialisation rapide et importante : dès 1964, 2 millions
de km-circuits sont opérationnels.
Le système MIC : multiplexage à 32
voies
C'est Alec H. Reeves en 1938 qui a conçu
l'idée de numériser la parole, appelée
PCM modulation
par impulsions et codage, mais à une époque
où la technologie dominante empêchait sa réalisation
économique.
C'était un scientifique britannique qui a reconnu le
potentiel de la modulation par impulsions codées pour réduire
le bruit lorsque la parole est transmise sur de longues distances.
Avec un signal analogique, chaque fois que le signal est amplifié,
le bruit contenu dans le signal est également amplifié
et un nouveau bruit supplémentaire est ajouté. Avec
la modulation par impulsions codées, il suffit de régénérer
les impulsions, donc le contenu en bruit du signal n'est pas augmenté.
Reeves a breveté l'invention en 1938.
Malheureusement, son idée nécessitait des circuits assez
complexes (selon les normes des années 1930), qui n'étaient
pas rentables en utilisant des vannes tube à vide).
Trente ans plus tard, lorsque ses idées ont pu être réalisées,
l'importance de son invention fondamentale a été reconnue
par l'attribution à Reeves en 1965 de la médaille Ballantine
de l'Institut Franklin, par la médaille d'or de la ville de
Columbus en 1966 et en 1969 par l'inclusion de PCM sur le timbre-poste
à 1 shilling au Royaume-Uni.
Le multiplexage
Un autre choix effectué en 1963
est celui du multiplexage à 32 voies, dicté par
une vision d’avenir du « tout binaire », alors qu’américains
et japonais travaillent sur la base de 24 voies, suivant une vision
conservatrice venant du multiplexage de voies analogiques.
Ce choix du 32 voies, validé par la Direction Générale
des Télécommunications, est proposé à
l’ensemble des administrations européennes via la CEPT.
L’accord européen sur cette norme est obtenu en fin 1968
et l’UIT en 1969 reconnait les deux normes européennes
et américaines. La reconnaissance mondiale de cette norme conforte
le CNET
Lannion dans ses choix pour aller vers la réalisation d’un
réseau numérique complet.
Le concept révolutionnaire est de transformer une banale
donnée physique, vibratoire, ondulatoire et palpable (la voix
humaine), non plus en simples signaux électriques analogiques
comme tout ce qui se faisait avec plus ou moins de réussite
depuis la fin du XIXème siècle et qui consistait à
répartir, commuter puis faire transiter ces signaux électriques
sur des lignes de câbles coaxiaux grâce à différentes
astuces (amplification électrique, modulation en amplitude,
modulations en fréquences, multiplexage ensemble de plusieurs
modulations analogiques), technologies analogiques par qui tous les
ingénieurs lambda ne juraient que par elles depuis 1945, mais
désormais de transformer ce phénomène physique
en suites de nombres mathématiques, puis de traiter ces nombres
de manière purement et uniquement mathématique, en les
combinant entre eux par calculs et en les transportant sur de si longues
distances sous forme de nombres. C'est le système MIC (Modulation
par Impulsion et Codage).
L’utilisation de la transmission MIC s’avère souvent
très intéressante dans les zones éclatées
car elle permet de retarder des investissements en
nouveaux câbles.
Faisant suite au salon Intelcom 77 qui se déroule à
Atlanta (U.S.A) du 9 au 14 octobre 1977, il est décidé
que désormais seuls des systèmes temporels 100% numériques
seront conçus et installés à l'avenir en France,
la Commutation Semi-Électronique
Spatiale ne devant constituer qu'une étape intermédiaire
limitée.
La partie historique plus détaillée des systèmes
numériques, du développement à l'industrialisation,
dont le projet PLATON à Lannion
est détaillée dans cette
page.
sommaire
Principe de la conversion des signaux analogiques
en signaux numériques binaires :
Pour passer d'un état analogue à une grandeur physique
(les ondes vibratoires vocales) à un état mathématique
formé par un ensemble de nombres... en signaux numériques
téléphoniques, il est nécessaire de procéder
en trois étapes : l'échantillonnage, la quantification
puis le codage binaire.
- Étape 1 : Échantillonnage.
C'est un peu e même principe que le cinéma 24 photos
par seconde suffisent pour tromper l'oeil et voir la scéne
avec une bonne fluidité.
En téléphonie classique avec des téléphones
basiques qui existent depuis l'invention du téléphone,
les signaux analogiques vocaux (ainsi que les tonalités transmises)
d'une conversation en cours entre deux abonnés sont tout d'abord
échantillonnés à la fréquence de 8.000
Hz. (Un échantillon vocal est prélevé et mesuré
toutes les 125 µs. Ceci signifie que l'on effectue 8.000 mesures
de tension à chaque secondes.)
Un tel échantillonnage permet de pouvoir reconstituer à
chaque extrémité de la chaîne de commutation et
de transmission les conversations de manière fidèle
jusqu'à une fréquence maximale audible de 4.000 Hz,
limite suffisante pour reconstituer des conversations en cours qui
soient compréhensibles. L'échantillonnage est en fait
une approximation d'un signal analogique dans le temps.

- Étape 2 : Quantification.
Une fois les échantillons vocaux prélevés toutes
les 125 µs, il est nécessaire de procéder à
une seconde approximation : l'approximation en niveau de tension.
En effet, un signal analogique étant susceptible de prendre
une infinité de valeurs entre une tension A et une tension
B, cet aspect impose de réduire les valeurs de tensions possibles
de ces échantillons en un nombre limité de valeurs-étalons.
La valeur de sortie de l'étage de quantification est la valeur-étalon
de référence la plus proche de la valeur réelle
de la tension d'échantillonnage d'entrée.
Il a été retenu, en norme téléphonique,
que les niveaux de tensions échantillonnées seraient
compris entre 256 niveaux de tensions différents (256 valeurs-étalons).
(Chaque échantillon est donc systématiquement arrondi
en une valeur numérique comprise entre une valeur comprise
entre 0 et 255.)
Une telle quantification, même s'il ne s'agit pas de Haute-Fidélité
telle que l'on pourrait la qualifier en acoustique, permet en norme
téléphonique, le codage de suffisamment d'états
d'amplitude possibles des signaux vocaux.

Étape 3 : Codage.
Puis ces échantillons vocaux, qui peuvent prendre 256 valeurs
différentes sont convertis en numération binaire (en
base 2) sur des mots d'une longueur de 8 bits. À partir de
là, les échantillons sont devenus des nombres exprimés
en base 2, c'est à dire par un nombre au format de 8 chiffres,
dont chaque chiffre peut prendre la valeur 0 ou 1.
Comme ces signaux codés sont échantillonnés à
la fréquence de 8.000 Hz, sur un mot binaire de 8 bits, le
débit équivalent en éléments binaires
par secondes (e.b/s) sera de 8.000 Hz x 8 bits = 64.000 bits/s. Bit
se traduit par Élément Binaire : 0 ou 1.

Il serait déjà avantageux de réaliser des transmissions
sur de longues distances sous forme numérique, car l'intérêt
premier serait de pouvoir amplifier de manière peut coûteuse
la liaison numérisée, étant donnée que
nous savons à l'avance qu'à un instant donné,
la valeur théorique transportée est soit égale
à 0, soit égale à 1. Par contre, nous ne pourrions
transporter sur de longues distances qu'une seule voie téléphonique
simultanément, ce qui finalement ne s'avérerait pas
très avantageux... Il faut donc trouver un moyen supplémentaire.
Le Multiplexage Numérique.
Lorsque nous avons échantillonné à chaque instant
T, toutes les 125µs, en fait, cet instant T a duré 3,90µs.
(durée fixée par les normes téléphoniques
: il faut l'instant le plus court possible, mais tout en gardant une
durée suffisamment longue de sécurité, eu égard
aux tolérances des composants électroniques, qui eux,
sont bien réels, et ne sont pas des formules mathématiques
parfaites...)
Donc, sur une liaison numérique, nous voyons qu'il y a un temps
mort de 125µs - 3,90µs = 121,10µs.
Puisqu'il existe un si grand temps mort entre deux échantillons
numériques vocaux, pourquoi ne pas y insérer d'autres
échantillons vocaux émanant d'autres conversations téléphoniques
?
Ainsi nous pourrions transmettre sur une même liaison numérique
125µs/3,90µs = 32 conversations téléphoniques
numérisées à la fois ! En fait, si la durée
d'échantillonnage est de 3,90µs, nous avons 32 Intervalles
de Temps disponibles (IT) pour faire circuler à la fois successivement
et simultanément 32 conversations téléphoniques.
C'est ce que l'on appelle le Multiplexage Numérique : à
partir d'une simple liaison numérique, nous pouvons acheminer
simultanément 32 voies téléphoniques, de quoi faire
disparaître la pénurie de capacités de voies de
transmissions de conversations, en réutilisant les liaisons métalliques
existantes, qui ne peuvent acheminer en basses fréquences qu'une
seule conversation à la fois...
Le Multiplexage Numérique est en fait un système Multiplex
à répartition dans le temps.
Ces signaux numérisés sous forme de mots binaires de 8
bits, émanant d'une conversation en cours, avec un débit
binaire de 64.000 bits/s, sont ensuite insérés dans une
voie d'un Circuit MIC, et ce côte à côte avec d'autres
signaux provenant d'autres conversations en cours. (jusqu'à 30
conversations téléphoniques simultanées peuvent
circuler sur une même liaison MIC.)
Un Circuit MIC est équipé de 32 voies, car une Liaison
MIC est "découpée" en 32 Intervalles de Temps
de 3,90µs chacun.
Mais seulement 30 voies sont en réalité réservées
au transport des conversations téléphoniques, car 2 voies
sont notamment affectées à la synchronisation et au contrôle
d'erreur. En effet, parmi les 32 voies, numérotées de
0 à 31,
- la voie 0 est destinées à la synchronisation : qui doit
permettre d'indiquer aux équipements de multiplexage (ou de démultiplexage)
quel est le premier Intervalle de Temps parmi les 32 possibles,
- la voie 16 est destinée par convention à l'échange
de signaux de signalisation (dialogues) entre équipements téléphoniques,
pour permettre l'aiguillage des conversations, le contrôle d'erreurs
etc...
Le risque de diaphonie (mélange) entre plusieurs conversations
est quasiment inexistantant.
Une fois multiplexés, les signaux des 30 voies
de conversations téléphoniques sortent sur une Liaison
M.I.C.
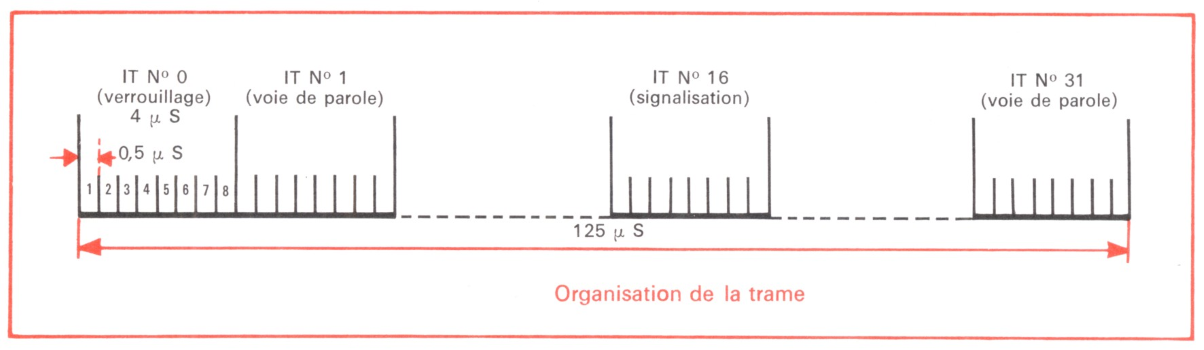
sommaire
Technologie sonore pour les conversations téléphoniques.
a. Les microphones à charbon et les haut-parleurs
Historiquement, les micros utilisés dans les téléphones
sont des micros à charbon. La technologie consiste en une capsule
de granules de charbon tenues entre 2 électrodes métalliques,
les granules de charbon jouent le rôle d’une résistance
électrique. Quand ces granules de charbon sont soumis à
l’onde sonore émise par la voix, leur géométrie
change et la résistance électrique aussi, ce qui permet
de réaliser une transduction d’une énergie sonore
à une énergie électrique. Leur réponse
en fréquence est relativement médiocre puisqu’elle
est comprise entre 200 Hz à 3500 Hz. Ce type de micro était
beaucoup utilisé jusque dans les années 50 à
la radio ou dans les films. Les voix des films des années 30
à 60 ressemblent d’ailleurs aux voix filtrées que
l’on entend dans nos téléphones. Quand il y a des
séquences de téléphone dans les films anciens,
la différence entre le timbre des voix filtrées et des
voix normales est moins flagrant que dans les films actuels.
Les haut-parleurs embarqués sur les téléphones
fixes sont calqués sur la qualité médiocre des
microphones avec une bande passante guère plus large (en général
200 Hz - 5 kHz). Tout comme les microphones, ils ont un taux de distorsion
important malgré leur petite puissance. Tout cela fait du téléphone,
un système audio de bien mauvaise qualité. Mais le but
n’est pas là...
L’important est de transmettre le message porté par la
voix. Avec la bande passante de 300 Hz à 3400 Hz des micros
à charbon, même si certains détails fins disparaissent
en chemin, la voix avec son flot de messages et d’émotions
nous parvient sans problème.
Malgré l’évolution des microphones (dynamiques,
piezzo) et haut-parleurs de téléphones, le passage au
numérique, la médiocrité des communications téléphonique
demeure : la qualité sonore des voix téléphonique
n’est pas si éloignée des années 1960.
Ceci est du à la norme G 771 qui a été adoptée
lors du passage à la téléphonie numérique.
b. La compression G.771
La norme G.771 régie le codage des signaux audio du téléphone
nécessaires à leur transit sur un réseau de téléphonie
numérique.
Elle définit les différentes méthodes de codage
des signaux audio appliqués à la voix humaine. Il s’agit
de transcoder la voix pour réduire à la fois la dynamique
sonore et le débit.
Les micros utilisés pour les téléphones numériques
sont de meilleure qualité que les vieux micros à charbon,
mais l’exigence de réduction de débit oblige à
une rédaction de la bande passante. Dans un premier temps la
voix est numérisée en PCM comme nous venons de l'expliquer.
Ensuite le codage G.771 réduit les 13 ou 14 bits en 8bits.
La fréquence d'échantillonnage étant de 8 kHz,
la bande passante est limitée à 4 kHz selon le principe
de la fréquence de Nyquist.
Chaque échantillon est codé sur 8 bits pour un débit
total de 64 kbit/s. Les codages de la norme G.771 reposent sur un
principe de quantification non uniforme. Pour les échantillons
de bas niveaux et de hauts niveaux, une « petite » variation
ne sera pas perçue par le système quand une même
« petite » variation pour des échantillons de niveaux
moyens sera retranscrite par un changement d’intervalle de codage.
Cela revient a accorder plus de précision aux signaux qui correspondent
à un niveau de voix normal, au détriment d’une
mauvaise précision pour les chuchotements et les cris. Ce système
très ingénieux permet de combiner en simultané
deux fonctions qui sont souvent confondus par le grand public ; la
compression de dynamique et la compression de données.
Le traitement de dynamique qui est réalisé par ce codage
est plus précisément l’action cumulée d’un
expander qui a le rôle d’amortir encore plus les bas niveaux
et celui d’un compresseur qui est de limiter les hauts niveaux.
L’amortissement des bas niveaux permis par l’expander conduit
à réduire le bruit de fond, bruit de fond acoustique
provenant de l’environnement extérieur ou bruit de fond
introduit par l’électronique du téléphone.
Une directive de l’OMS21 relative aux bruits dans l’environnement
indique que le rapport signal/bruit doit être d’au moins
15 dB pour toutes les
situations où la voix doit être absolument intelligible
(salle de classe ou conversation téléphonique par exemple)
Au sein de la norme G.771, il y a deux lois de codage : La loi Mu
qui est utilisée en Amérique du Nord et au Japon et
la loi Mu qui est appliquée en Europe et dans le reste du monde.
Ces deux lois se distinguent par leur adaptation à différents
protocoles. Leurs courbes de compression sont légèrement
différentes mais l’influence sur le son n’est pas
significative.
Les systèmes de téléphonie sur smartphone utilisent
maintenant le réseau internet pour transiter la voix et non
les réseaux cellulaires (pas d’antennes relais). C’est
comme si deux ordinateurs étaient reliés entre eux par
internet et qu’ils échangeait un flux sonore plutôt
que des e-mails. Ils utilisent le protocole VoIP (Voice Over Internet
Protocol) en associant des adresses IP aux téléphones.
Cette technologie à l’avantage de permettre des débits
beaucoup plus grand qu’en téléphonie cellulaire.
Cela a permis la création de la norme G.722 qui propose une
bande passante « haute définition » pour la voix
: 50 - 7000 Hz au lieu de 300 - 3400 Hz avec la norme G.771. Si cette
technologie se démocratisait, cela pourrait changer l’idée
de son téléphonique filtré qu’utilise le
cinéma pour distinguer les interlocuteurs de part et d’autre
de la ligne.
sommaire
Cette révolution technologique conduit à la réalisation
de trois générations de centraux électroniques.
I - Les systèmes électroniques de
type temporel de 1ère génération déployés
en France sont les suivants :
- PLATON prototype,
- E10 N4 Présérie,
- E10 N3 (dont ACROPOLE),
- E10 CTI,
- E12.
Les Commutateurs électroniques de type temporel
de 1ère génération, mis en conception à
partir de 1964 dans les laboratoires du CNET de Lannion qui est en
activité depuis le 15 juin 1963, sont inaugurés
pour la première fois en France (et dans le monde) le 6 janvier
1970 avec PLATON I implanté à Perros-Guirec.
Ils sont aujourd'hui obsolètes et en totalité démontés.
Le dernier Commutateur Électronique Temporel de 1ère
génération de France, un E10N3, est mis à l'arrêt
le 23 août 1999 à Aix-en-Provence - Cézanne 2
.
Entre temps, en Juin 1977, sont publiées par
l'Administration des Télécommunications les Normes d'Exploitation
et de Fonctionnement (N.E.F.) qui constituent le cahier des charges
des systèmes de commutation électronique utilisés
dans réseau français pour le raccordement des abonnés,
auxquels tous les concepteurs/constructeurs de commutateurs téléphoniques
doivent désormais se conformer s'ils veulent espérer
pouvoir vendre leurs produits à la République Française...
Le Colloque International de Commutation, présidé
par M. Louis-Joseph Libois, qui se tient à Paris du 7 au 11
mai 1979 confirme que la seule voie d'avenir sera à brève
échéance la Commutation Électronique Temporelle.
Un Commutateur électronique temporel occupe
la moitié de l'espace d'un commutateur semi-électronique
spatial, à capacité égale.
Un Commutateur électronique de type temporel est désormais
entièrement électronique, dépourvu de toute pièce
mobile.
Un Commutateur électronique de type temporel est également
pourvu de logiciels de fonctionnement. On parle de Commande à
Programme Enregistré.
À partir des Commutateurs temporels, la totalité des
opérations de commutation des abonnés entre eux est
désormais réalisée sous forme de signaux numériquement
codés, commutés et transmis sous forme d'Intervalles
de Temps (IT).
Désormais, les communications ne sont donc
plus commutées physiquement dans un réseau métallique
avec des contacts physiques (qu'ils fussent des contacts rotatifs,
ou à barres croisées, ou à micro contacts à
relais ou à rubans) tel qu'ils étaient conçus
jusques alors, où chaque voie ne permettait que le transport
d'une seule conversation à la fois et sous forme de signaux
électriques analogiques.
Ce nouveau type de commutation consiste désormais
à « découper » les lignes de transmissions
en fonction du temps, et non plus d'éclater dans l'espace des
connexions physiques métalliques, puis d'empiler des conversations
via des lignes de transmissions en fonction du spectre de fréquences
analogiques comme nous savions le faire jusqu’à lors.
C’est d’ailleurs la diffusion à grande
échelle de cette technologie à partir de la fin des
années 1960, suite à l'évolution technologique
et à la miniaturisation des composants électroniques,
qui permet progressivement la numérisation et l’informatisation
de tout notre monde.
Principe de sécurisation des commutateurs temporel.
Dans les Commutateurs temporels de série, il a été
décidé de dédoubler les organes de calculs et
de commande, pour que si un organe subit une avarie, un autre puisse
prendre le relais en attendant la réparation. Suivant leur
architecture, le dédoublement est effectué par différents
moyens
Principe de conversion des signaux analogiques
des abonnés entrants ou sortants dans un commutateur d'abonnés
temporel.
Dans tout Commutateur temporel, un principe immuable est de coder
numériquement par échantillonnage les conversations
vocales dès leur entrée dans le Commutateur via les
organes de raccordement d’abonnés, puis d’assurer
leur acheminement uniquement sous forme numérique « mathématique
» via un type de transmission d’un concept mathématique
entièrement nouveau, qui consiste en l’emploi de la technologie
du multiplexage entièrement numérique mise au point
à la même époque, bien que pensé et développé
progressivement depuis 1937 : il s’agit du système
MIC (Modulation par Impulsion et Codage) qui permet d’accroître
la capacité d’écoulement du trafic.
Cette opération, le Multiplexage Numérique, est réalisée
dans les Unités de Raccordement d'Abonnés des commutateurs
électroniques temporels, et ce quelles que soient leur version
ou leur dénomination (EMA, CSA, CSE, URA2G, CSN, CSNHD)
Le Multiplexage Numérique est un système Multiplex à
répartition dans le temps.
Principe général d'établissement d'une conversation
téléphonique.
- Quand un abonné souhaite appeler un correspondant, il décroche
alors son combiné et le Commutateur lui envoie la tonalité
continue, comme tout commutateur téléphonique, ce qui
constitue l'invitation à numéroter.
- L'abonné numérote alors au clavier ou au cadran de
son téléphone.
- Le Commutateur va alors réceptionner le numéro de
téléphone et via ses différents organes.
- Une fois le numéro de téléphone mémorisé
et traduit, il va tenter d'établir une route dans son Réseau
de Connexion pour mettre en relation les deux abonnés lorsque
l'abonné appelé décrochera son téléphone.
- soit les deux abonnés sont reliés au même Commutateur
d'abonnés, et la communication téléphonique ne
transitera que par ce seul Commutateur d'abonnés.
- soit les deux abonnés sont éloignés et de ce
fait reliés à des Commutateurs différents, auquel
cas, la conversation téléphonique circulera par un certain
nombre de Centres de Transit, suivant la distance, jusqu'à
mettre le Commutateur d'abonnés de départ en relation
avec le Commutateur d'abonnés d'arrivée. Dans le principe
rien ne change, mais ceci rajoute plusieurs étapes de commutation
successives, ainsi que des nécessités de dialogues entre
commutateurs par des liaisons dédiées.
Principe de la commutation temporelle, proprement
dite :
Le but est de connecter ensemble deux Intervalles de Temps quelconques
appartenant à des liaisons numériques MIC quelconques.
Ce qui revient mathématiquement à transférer
l'échantillon d'un MICm ITi entrant sur un MICn ITj sortant.
Dans un Commutateur intégralement temporel, la commutation
temporelle consiste en fait en une transposition d’Intervalles
de Temps (IT), par le biais de glissements temporels calibrés
par multiples de 3,90µs, d’une Liaison MIC entrante vers
une Liaison MIC sortante, par l’utilisation, dans le cas d’un
Réseau de Connexion entièrement temporel, de Mémoires
Tampon.
Chaque abonné est connecté sur un équipement
de raccordement d’abonné. Chaque conversation empruntant
un équipement de raccordement d’abonné analogique
est d’abord convertie en données numériques binaires,
puis est reliée à une liaison MIC bien déterminée.
Dans cette Liaison MIC qui lui est attribuée, une voie spécifique
fixe lui est aussi attribuée (il s’agit en fait d’un
Intervalle de Temps bien déterminé), qui est toujours
la même parmi les 30 voies possibles de sa liaison MIC (liaison
MIC qu’il partage avec 29 autres abonnés).
Concernant chaque abonné qui souhaite joindre un correspondant,
le Commutateur va devoir déterminer une route que la conversation
numérisée devra emprunter, de la liaison MIC entrante
vers une liaison MIC sortante ; et ce pour chaque voie de conversation
entrante de chaque Liaison MIC entrante, à destination de la
bonne voie de sortie souhaitée dans la Liaison MIC sortante
souhaitée par le Commutateur.
Pour ce faire,
-la totalité des liaisons MIC entrantes est connectée
à l’entrée du Réseau de Connexion,
-la totalité des liaisons MIC sortantes est connectée
à la sortie du Réseau de Connexion.
La mission du Commutateur téléphonique
consiste à réaliser un brassage des voies de conversations
provenant des liaisons MIC entrantes, pour les répartir, suivant
le routage que les traducteurs ont déterminé, vers les
liaisons MIC sortantes, et ce en dispatchant les voies d’entrées
dans le Réseau de Connexion, vers les voies sortantes du Réseau
de Connexion.
Dans un premier temps, toutes les liaisons MIC entrantes
du Commutateur sont démultiplexées à l'entrée
du Réseau de Connexion.
Dans un second temps, pour chaque liaison MIC démultiplexée
entrante, le contenu numérique échantillonné
de chacune des 30 voies téléphoniques est mémorisé
dans une Mémoire Tampon d’Entrée (MTE), durant
le laps de temps nécessaire qui va permettre l’aiguillage
sous forme temporelle des conversations entrantes vers les voies de
conversations sortantes.
Dans un troisième temps, une fois que le Commutateur aura déterminé
pour chaque Liaison MIC entrante, sur quelles autres Liaisons MIC
sortantes les 30 voies téléphoniques devront pouvoir
véhiculer les conversations numérisées, le Commutateur
va commander au bon instant, pour chaque voie téléphonique
entrante le transfert du contenu de la Mémoire Tampon de Sortie
(MTS) vers la bonne voie de sortie de la bonne Liaison MIC sortante
du Réseau de Connexion.
Dans un quatrième temps, une fois les opérations d’aiguillages
réalisées au sein du Réseau de Connexion, les
voies composant les circuits MIC sortants sont alors multiplexées
et les Liaisons MIC peuvent continuer à transmettre les voies
de conversation, mais au passage, les voies entrantes ont été
dispatchées sur différentes Liaisons MIC de sortie…
- Dans le cas où l’abonné demandé est relié
au même Commutateur que l’abonné appelant, la conversation
sera intégralement traitée par ce même Commutateur
: elle arrivera sur la voie déterminée d’un MIC
entrant pour être redirigée sur la bonne voie du bon
MIC sortant qui est affectée à l’abonné
demandé.
- Dans le cas où l’abonné demandé est relié
à un Commutateur différent de l’abonné appelant,
la conversation devra passer par plusieurs Commutateurs téléphoniques,
ce qui dans le principe ne change rien, mais ajoute des étapes
de même nature…
Les Réseaux de Connexion numériques Mixtes - Temporels
et Spatiaux
Certaines variantes existent dans les Réseaux de Connexion
des Commutateurs temporels.
Dans un Réseau de Connexion numérique
intégralement temporel (PLATON, E10N3, E10B3, MT20 de petite
capacité et MT25 de petite capacité), il faut beaucoup
de Mémoires Tampon afin de stocker le temps nécessaire
les signaux de conversation des voies entrantes pour les rediriger
vers les bonnes voies de sortie.
Vu le prix de ces mémoires au début de la commutation
temporelle, ainsi que par souci de simplification du Réseau
de Connexion, il a parfois été décidé
pour certains systèmes (AXE10, AXE Transgate 4, E12, E10N1,
MT20 de grande capacité et MT25 de grande capacité)
d’intégrer un ou plusieurs étages réalisés
en électronique numérique spatiale entre l’étage
d’entrée temporel et l’étage de sortie temporel
des Réseaux de Connexion, afin de pouvoir se passer d’un
maximum de Mémoires Tampon. Cet
étage numérique spatial de brassage est
plus simple à réaliser et beaucoup moins coûteux.
Par contre, un étage spatial numérique,
même s’il permet d’améliorer le brassage, ne
peut procéder qu’au basculement d'un Intervalle de Temps
donné (IT) d'une Liaison MIC entrante vers une autre Liaison
MIC sortante, toujours à la même position temporelle
donnée.
Donc, un étage spatial numérique ne
permet en aucun cas de décaler l’Intervalle de Temps (IT)
entre une Liaison MIC entrante et une Liaison MIC sortante. Donc,
ce ou ces étages ne viennent qu'en appoint dans un Réseau
de Connexion numérique, mais ne peuvent pas assurer à
eux seuls la commutation téléphonique complète.
Ce qui revient, pour un étage numérique
spatial mathématiquement à transférer l'échantillon
d'un MICm ITi entrant sur un MICn ITi sortant. (avec le même
ITi en entrée comme en sortie), sans avoir besoin de mise en
mémoire tampon.
Il s’agit là d’un compromis entre
la technique pure et la finance, pour pouvoir réaliser un brassage
entre les Liaisons numériques MIC entrantes et sortantes. Cette
technique fonctionne tout aussi parfaitement que la technique de connexion
purement temporelle. Cependant, l’intérêt de cet
artifice tend depuis de nombreuses années à s’estomper,
étant donné la baisse des prix vertigineuse des circuits
Mémoires.
En revanche, dans un Commutateur temporel, quelque
soit sa génération et son modèle, le Réseau
de Connexion temporel est systématiquement dupliqué.
sommaire
PLATON
: (Prototype Lannionnais d'Autocommutateur Temporel à Organisation
Numérique)
Le système PLATON est inventé par les ingénieurs
des télécommunications du CNET, implanté depuis
1963 à Lannion, sous la houlette de M. Louis-Joseph Libois*,
leur directeur. Le responsable des études menées sur
la Commutation Électronique Temporelle PLATON est M. l'Ingénieur
en Chef - André Pinet (1920 - 2017).
Participent au projet PLATON, la Société Lannionnaise
d’Électronique (filiale de la CIT), l'AOIP et le laboratoire
de la SOCOTEL.
Organisation d’un commutateur temporel à
commande répartie : (cas du prototype PLATON et des commutateurs
E10N4, E10N3, E10N1 et E10B3 qui en découlent).
Le principe est de dédoubler les lignes de transmissions suivant
la nature de leur usage, afin de constituer ainsi deux sous-réseaux
distincts dans le but de rationaliser ces commutateurs en termes de
fiabilité et de sécurité de fonctionnement, ainsi
qu’en matière économique. Il est à noter
que ce principe de dédoublement est déjà clairement
établi par les équipes de recherches dès l'année
1961.
- Le premier sous-réseau est spécialisé dans
les opérations devant être exécutées en
temps réel, qui ont trait à la commutation : (Réception
: des appels extérieurs, des décrochages des téléphones
des abonnés, de la numérotation ; envoi des tonalités
et des courants de sonneries, établissement des conversations,
taxation de l’abonné.)
- Le second sous-réseau est spécialisé dans les
opérations de gestion, qui sont en fait réalisables
en temps différé, et ce lorsque le commutateur est moins
sollicité en terme de charge d’abonnés : (Extraction
des données d’exploitation (taxation, incidents) ; planification
des opérations de maintenance et des mises à jour logicielles
du système, comme la révision des programmes de calculs
; ou encore du plan de numérotation général,
ou de la programmation des numéros des abonnés raccordés
au commutateur ainsi que de leurs options d’abonnements à
d’éventuels services supplémentaires.) Ces opérations
sont prises en charge par un Centre de Traitement des Informations.
- Après publication de la Note Technique Interne
n°39 du 21 juillet 1965 relative au projet d'installation d'un
ensemble de commutation temporelle intégré au réseau
téléphonique général dans la zone de Lannion,
il est immédiatement procédé à la mise
en étude d'une première maquette expérimentale
de laboratoire ce même mois, installée au CNET de Lannion.
- La mise en construction de la maquette débute le 9 décembre
1965 et en Février 1966, deux "abonnés" peuvent
se parler à travers le Réseau de ConneXion de la maquette.
- Cette maquette expérimentale,
composée du minimum d'organes nécessaires, sera opérationnelle
au mois d'Avril 1969 et permettra de valider l'ensemble des cartes
composant chaque organe ainsi que la structure de la machine en fonctionnement
dynamique.
Première maquette expérimentale de Commutation Temporelle
installée dans les laboratoires du CNET Lannion.

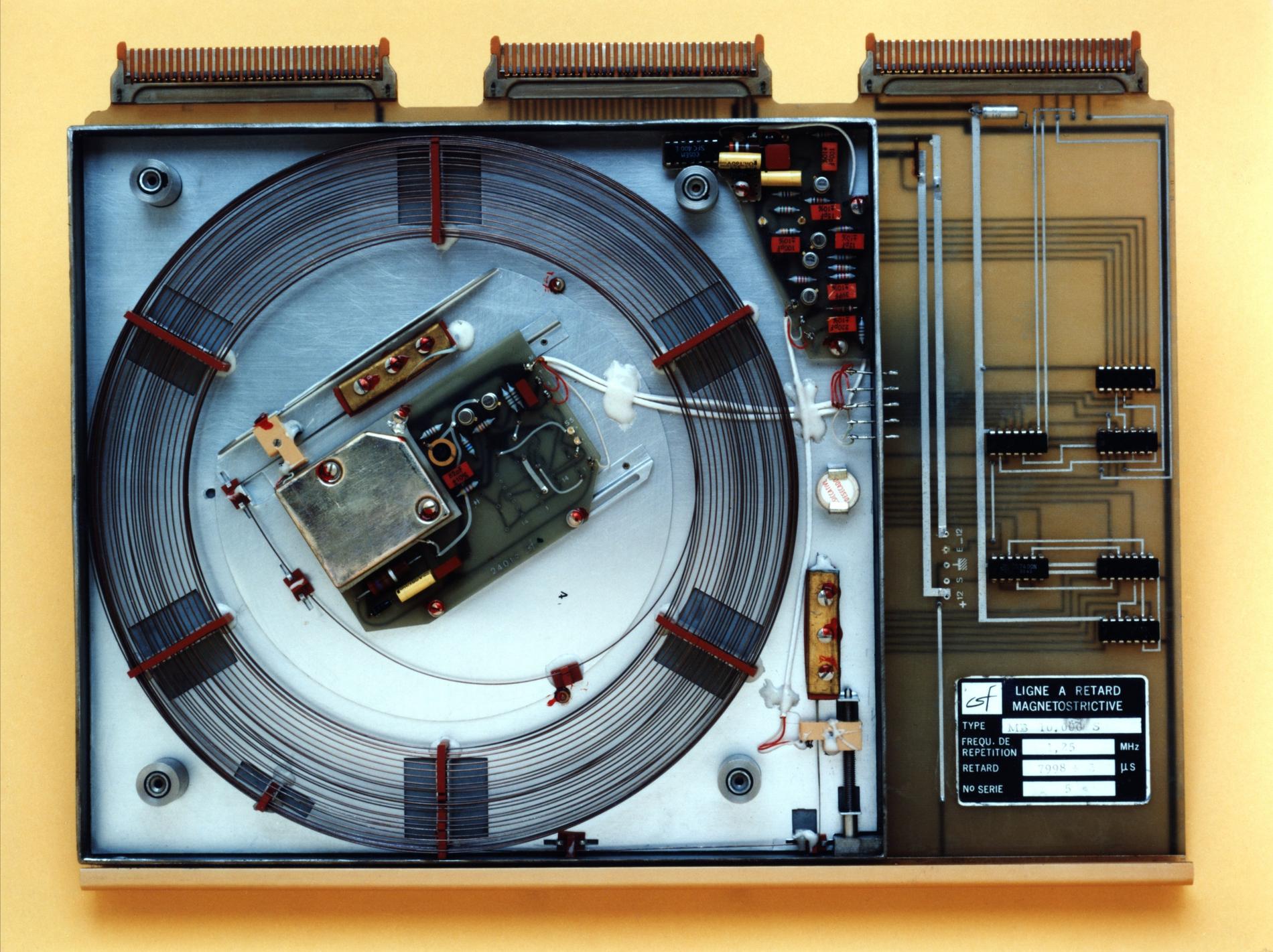
Ligne à Retard Magnétostrictive, utilisée
comme Mémoire Vive(RAM) dans les Commutateurs prototypes PLATON
- Le premier Commutateur PLATON créé
est capable de gérer 800 abonnés - dans la ville de
Perros-Guirec.
- Le Centre de Traitement des Informations (CTI) est un calculateur
de type RAMSES I conçu par le CNET.
- Le premier appel téléphonique expérimental
entre deux « abonnés tests » de ce même Commutateur
prototype est établi le 30 juillet 1969.
- Le premier appel téléphonique expérimental
sortant à destination d’un Commutateur téléphonique
du réseau est émis le 4 septembre 1969.
- Le premier appel téléphonique expérimental
entrant en provenance d’un Commutateur téléphonique
du réseau est reçu le 8 septembre 1969.
- Premier essai de mise en service temporaire, sur le réseau
téléphonique public, du premier Commutateur temporel
d'abonnés au monde, en France, à Perros-Guirec le 6
janvier 1970.
- L’inauguration du Commutateur PLATON par le Directeur Régional
des Télécommunications de Rennes, Roger Légaré
a lieu le 26 janvier 1970.
- Le basculage définitif des abonnés sur le commutateur
PLATON est effectif le 13 mars 1970 après stabilisation du
prototype par corrections diverses.

Commutateur prototype n°1 PLATON de Perros-Guirec Poste mis
en service le 6 janvier 1970, premier Commutateur téléphonique
Électronique Temporel du monde. Mis hors service le 10 avril
1979 - Fabricant : CNET.
Dans le cas de PLATON I - Perros-Guirec, les travées sont en
forme de L, avec ce coude caractéristique à 90°.
Ce type de construction mécanique relève de l'exception.
- Un second prototype PLATON, une fois quelques
améliorations éprouvées sur le premier, est ensuite
mis en service à Lannion même le 16 juin 1970. (Commutateur
Nodal Lannion III).
- Ce second prototype PLATON sera officiellement inauguré le
même jour par M. le Ministre des PTT - Robert Galley le 16 juin
1970.
- Le Commutateur Nodal Lannion III dessert à sa mise en service
600 abonnés locaux, plus 400 circuits de transit nodal. Sa
capacité sera étendue le 15 janvier 1971.
- Deux centres satellites temporels de 500 abonnés de Plestin-les-Grèves
et Saint-Michel-en-Grèves, reliés au Commutateur nodal
de Lannion III, sont mis en exploitation en Mai 1971.
Il sera mis hors service le 10 avril 1979 .
- Un troisième prototype PLATON d'une
capacité de 1.000 abonnés extensible à 8.000
est mis en exploitation en tant que Commutateur d'abonnés à
Lannion le 2 juin 1971. (Commutateur d'abonnés Lannion IV)
; Inauguration officielle le 18 juin 1971 en présence de M.
le Directeur Général des Télécommunications
- Pierre Marzin, .
- Le Commutateur Lannion IV est capable de gérer 8.000 abonnés,
regroupés en 32 Unités de Sélection, pour un
trafic de 600 erlangs, son Centre de Traitement des Informations (CTI)
est équipé en première monte d'un Calculateur
10010-CII.
- Nous avons pu établir avec certitude que les 3 prototypes
PLATON étaient déjà retirés du service
avant la fin de l'année 1980 ; PLATON I Perros-Guirec ayant
été arrêté le 10 avril 1979, soit 9 années
de fonctionnement révolues. (Remplacé par Perros-Guirec
Marché E10N3 mis en service ce même jour.) Il sera mis
hors service en Mai 1978.
Ces trois Commutateurs prototypes PLATON constituent
la cellule de base de commutation temporelle intégrée.
C'est grâce à cet ensemble de Commutateurs PLATON que
les tests grandeur nature en exploitation réelle ont pu être
menés et détecter les défauts de communication
entre machines, et y remédier. De ces trois prototypes découlera
la famille E10 (E10N4, E10N3, E10N1 et E10B3) développée
industriellement.

Ci-dessus : le Centre de Traitement des Informations (CTI) Modèle
CII 10010, associé au Commutateur Prototype PLATON Lannion
III.
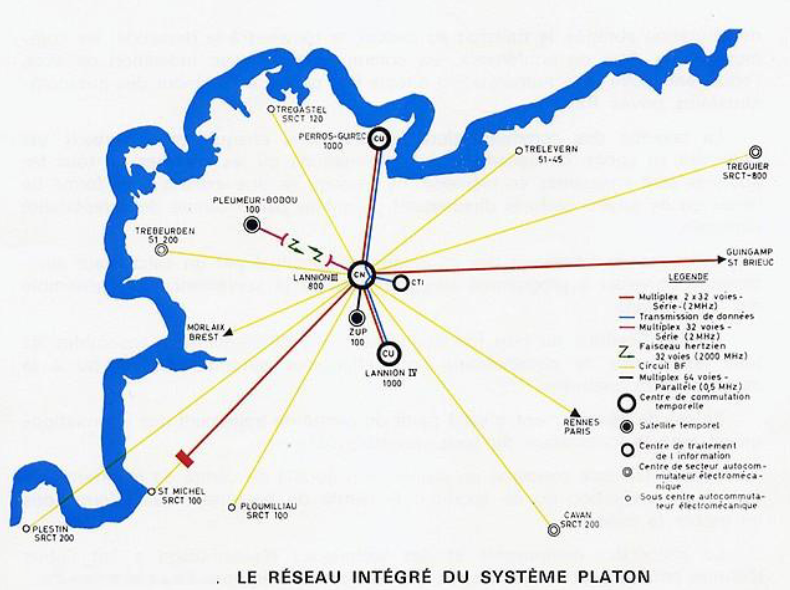
sommaire
Au niveau architectural et fonctionnel :
Le premier sous-réseau du Commutateur PLATON,
qui n’est, rappelons-le, qu’un prototype, est équipé
d’un unique Traducteur (TR), d’un seul Taxeur (TX) et de
2 Multienregistreurs (MR) (nombre de Multienregistreurs extensible
à 8 si nécessaire). Ces 3 organes constituent l’organe
de commande du Commutateur. Il est également pourvu de 2 Marqueurs
(MQ).
- Le Traducteur (TR) stocke le routage des conversations téléphoniques
suivant les abonnés demandés.
- Les 2 Multienregistreurs (MR) assurent le déroulement et
le séquencement de l'établissement en temps réel
des communications et leur arrêt.
- Le Taxeur (TX) est chargé d'établir et de comptabiliser
les taxes des conversations pour chaque abonné en temps réel.
- Les 2 Marqueurs (MQ) assurent l'interface entre l’organe de
commande constitué et les Unités de Raccordement d'Abonnés
de 1ère génération, nommés Équipements
de Modulation d’Abonnés (EMA) et les circuits de sortie
(raccordés au reste du réseau téléphonique)
nommés Équipements de Modulation de Circuits (EMC),
via le Réseau de Connexion (CX).
- Le Réseau de Connexion (CX), dans un Commutateur PLATON est
100% de type temporel, à un seul étage, de type T, d'une
capacité de 32 Unités de Sélection, capable de
commuter un maximum de 64 multiplex numériques MIC.
- Chaque EMA peut héberger 511 abonnés (la position
Zéro étant impossible).
- Chaque EMC peut être relié à 62 circuits de
transit.
- Est également présent un Organe de Contrôle
(OC) chargé des opérations de test et de maintenance
du système.
Le second sous-réseau du premier prototype PLATON
est assuré par le Centre de Traitement des Informations (CTI),
qui est constitué par un calculateur RAMSES I créé
par le CNET, chargé de gérer, en différé
dans le cadre du service normal, le Commutateur. (Ce calculateur est
remplacé quelques mois plus tard par un CII-10010, plus puissant).
L’équivalent de la duplication de certains
organes de commande est théoriquement assuré dans le
Commutateur PLATON : en cas de panne du Traducteur (TR) ou du Taxeur
(TX), la fonction défaillante peut-être reprise en secours
par le Centre de Traitement des Informations (CTI) associé
à l’Organe de Contrôle (OC) qui peuvent ainsi suppléer
en temps réel à certaines avaries partielles du Commutateur.
Au niveau du développement et de la fabrication
matérielle de PLATON :
Les mémoires des programmes de fonctionnement des différents
organes du Commutateur (ce que l’on pourrait qualifier de mémoire
morte ROM) sont constituées de simples matrices à diodes,
finalement très primitives.
Les mémoires tampon de données du Commutateur (ce que
l’on pourrait qualifier de mémoire vive RAM) sont constituées
par des lignes à retard à magnétostriction réglables
"au tournevis".
Après des tentatives laborieuses menées par le CNET
à partir de 1965 avec les circuits intégrés de
technologie DTL dont les temps de transfert s'avéreront trop
lents, le réseau de connexion (CX) 100% numérique est
finalement reconçu avec succès en 1967 avec les tous
nouveaux circuits intégrés de la famille TTL de Texas
Instruments apparus en 1966, qui donnent de meilleurs résultats
de fonctionnement.
Même les baies de raccordement des abonnés de ce prototype,
conçues initialement par l'AOIP, sont entièrement électroniques
et dépourvues de toute pièce mobile. Elles sont dénommées
EMA (Équipements de Modulation d’Abonnés). La Concentration/Expansion
des abonnés est effectuée directement en numérique
(électronique temporelle). En raison de l’utilisation
de technologies récentes, ces baies de raccordement s’avèrent
malheureusement très coûteuses alors.
À partir du Commutateur PLATON, tous les Commutateurs
électroniques de type temporel sont capables d'accepter la
numérotation depuis l'abonné de départ en fréquences
vocales (DTMF) en plus d'accepter la numérotation à
impulsions décimales en vigueur en France depuis 1913.
sommaire
La Famille 1000-E10
: Incluant deux sous-familles : E10 et MT de la société
française Alcatel qui faisait partie du groupe franco-américain
Alcatel-Lucent :
Sous-famille E10,
(abréviation : E pour Électronique car 100% électronique,
projet n°10), (licence Alcatel époque CGE), dont
le prototype est issu du projet PLATON, en France existent les types
suivants de 1ère génération :
E10N4 - E10 Niveau 4. Le Commutateur
E10N4 marque le début de la mise en industrialisation du projet
PLATON, mais voit aussi ses caractéristiques améliorées.
Notamment, les Commutateurs E10N4 voient leur Réseau de Connexion
supporter jusqu'à 15.000 abonnés, sous 64 Unités
de Sélection, pour un trafic de 1.200 erlangs.
Temporel de première génération,
l'organe de commande consiste en une commande répartie entre
plusieurs organes différents et spécialisés.
Chaque organe est dédoublé pour assurer la sécurité
du système et fonctionnent en service normal, en partage de
charge. Ces organes dédoublés sont : les Traducteurs
(TR) et les Marqueurs (MQ). Au nombre de 2 à 8 ce sont les
Multienregistreurs (MR). Le Taxeur (TX) n'est pas un organe dédoublé.
- Le Taxeur (TX) est chargé d'établir et comptabiliser
les taxes des conversations pour chaque abonné.
- Les Traducteurs (TR) calculent les routages des conversations téléphoniques
suivant les abonnés demandés.
- Les Multienregistreurs (MR) assurent l'enregistrement de la numérotation
et sa réémission, puis le déroulement et le séquencement
de l'établissement en temps réel des communications
et leur arrêt. Chaque Multienregistreur MR constitue un ensemble
de 66 Enregistreurs et occupe une baie. (à comparer au volume
équivalent d'une baie d'Enregistreurs de Rotary 7A1 formée
de 4 Enregistreurs). Les Multienregistreurs sont les seuls organes
du système E10N4 à pouvoir prendre des initiatives en
temps réel.
- Les Marqueurs (MQ) sont l'interface entre les organes de commande
précités et les Unités de Raccordement d'Abonnés
via le Réseau de Connexion (CX).
Est également présent un organe d'Équipement
de Tonalités et d'Auxiliaires (ETA) incluant les :
- Générateurs de Tonalités (GT),
- Récepteurs multiFréquences pour la numérotation
au clavier et pour la signalisation intercentre (RF).
- Le Réseau de Connexion (CX), dans un commutateur E10N4 est
100% de type temporel, à un seul étage, de type T, capable
de commuter un maximum de 128 multiplex numériques MIC.
- Chaque commutateur élémentaire, de 16 Unités
de Sélection chacun, permet le raccordement de 32 multiplex
MIC et peuvent être combinés jusqu'à 4 exemplaires
pour former un commutateur d'une capacité maximale de 128 multiplex
numériques MIC, chaque MIC pouvant traiter 30 voies téléphoniques
à pleine charge, sous un trafic de 1.200 erlangs maximum.
- Est également présent un Organe de Contrôle
(OC) chargé des opérations de test et de maintenance
du système.
Dès 1972, les Commutateurs E10N4 puis E10N3
permettent de gérer jusqu’à 15.000 abonnés
(dès la présérie E10N4 qui aurait compté
18 machines entre le 24 mai 1972 et le 28 septembre 1976).
- Le premier Commutateur E10N4 prototype (équipé d'Unités
de Raccordement d'Abonnés de type CSA à mini relais
à contacts scellés) est mis en service en France le
24 mai 1972 à Guingamp (Guingamp Centre 1 (CN21)). (Sa Mise
hors service intervient le 11 juin 1980).
Guingamp Centre 1 et Paimpol 2, qui sont des
prototypes E10N4, ressemblent beaucoup aux Commutateurs PLATON dont
ils sont directement issus.
Un second perfectionnement important est le remplacement des cartes
mémoire à Lignes à Retard Magnétostrictive
par des cartes à Registres à Décalages conçues
à partir de circuits intégrés de type TTL, ce
qui permet de stabiliser et de fiabiliser facilement le fonctionnement
des Commutateurs.
 Commutateur Prototype E10N4 - PLATON - Guingamp Centre 1
Commutateur Prototype E10N4 - PLATON - Guingamp Centre 1
Mis en service le 24 mai 1972 - Hors Service le 11 juin 1980 - Fabricant
: SLE. Au premier plan, dans la première travée, 3 baies
de Concentrateurs Spatiaux-temporels d'Abonnés (CSA), qui portent
les cartes d'abonné.
Le second et dernier prototype E10N4 - PLATON de Paimpol 1
(RN531) est mis en service le 30 juin 1972 et Hors Service le 11 juin
1980 - Fabricant : SLE.
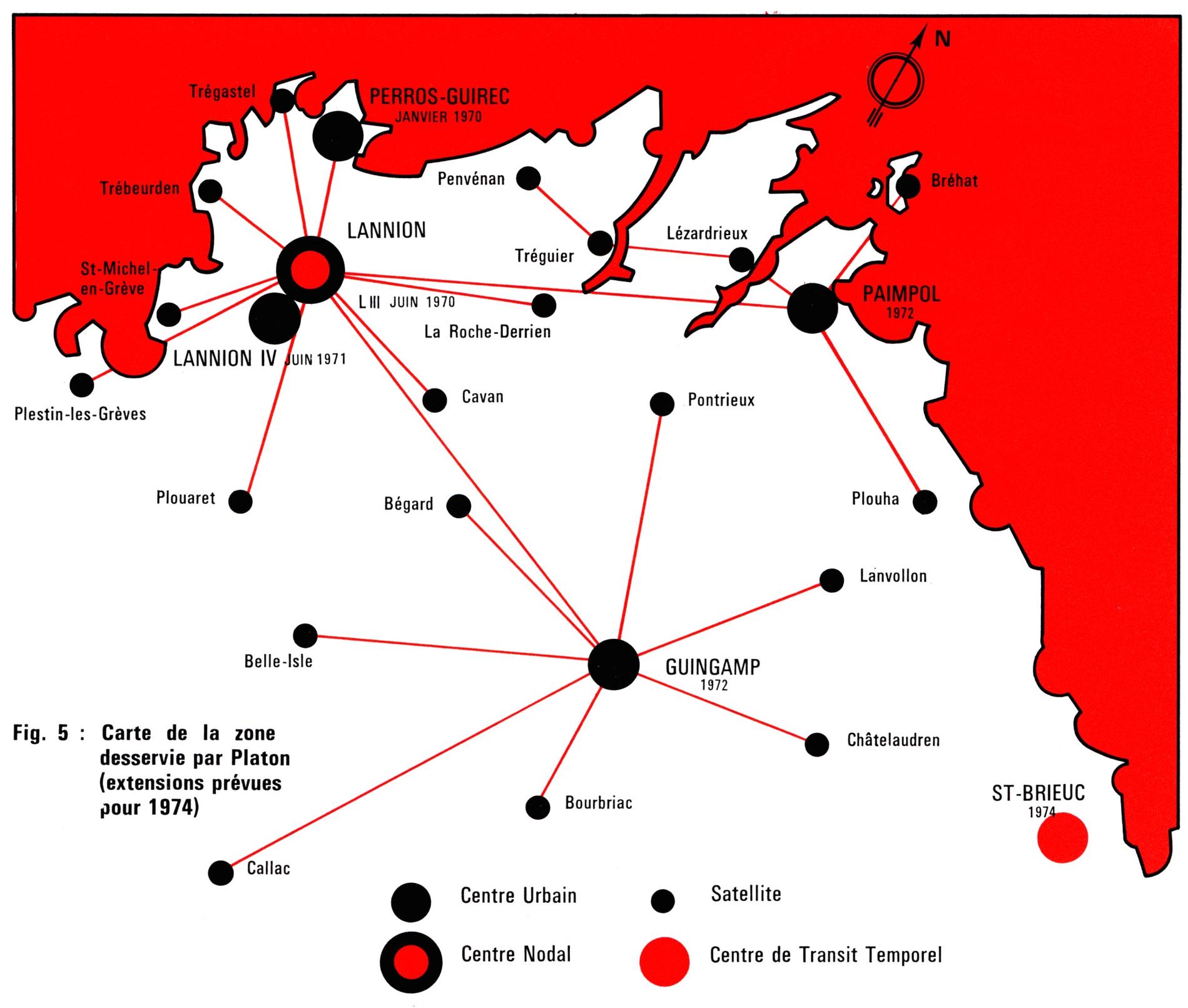
Les deux premiers Commutateurs E10N4 - PLATON Prototypes de Guingamp
et de Paimpol ainsi que les trois prototypes PLATON et l'ensemble
des satellites déjà mis en service précédemment,
constituent alors le premier Réseau Local Intégré
entièrement maillé en technologie temporelle
(dans le monde).
- Le Commutateur E10N4- La Flèche-sur-Sarthe
1 est mis en service le 6 avril 1973. Il est le premier de la présérie
E10N4.
- S'ensuit le Commutateur E10N4 - Poitiers-Grailly 2 (PT11) mis en
service le 22 juin 1973.
Le premier Commutateur E10N4 mis en service en tant
que Centre Nodal est mis en service à Rennes, (Rennes-Lavoisier
2 le 27 mars 1975.
Un Centre Nodal est en réalité un Centre de Transit
terminal pour abonnés ruraux : il est à la fois un centre
d'abonnés et un centre de transit...
- Le premier Commutateur E10N4 exporté à l'étranger
sera mis en service en Pologne, à Winogrady, en 1975.
En 1972, contrairement à PLATON, le type d’Unités
de Raccordement d’Abonnés retenu n’est pas 100% électronique.
En effet, lancer une production de série dès 1972 des
commutateurs équipés de baies de raccordement d’abonnés
EMA de 1ère génération réalisées
en matériel électronique à composants discrets
ou intégrés aurait été tout simplement
ruineux.
Aussi, pour mettre en service la présérie
E10N4 , il a donc été proposé en lieu et place
des EMA, un autre type de baies de raccordement d’abonnés
à moindre coût : le CSA (Concentrateur Spatio-temporel
pour Abonnés), équipé de relais à tiges
à contacts scellés et miniaturisés chargés
de réaliser les matrices d'expansion/concentration en analogique-spatial,
couplés à des convertisseurs analogiques-numériques
MIC. Chaque MIC ayant une capacité de 30 voies téléphoniques.
- Le CSA est donc un dispositif terminal semi-électronique,
conçu par la CIT-Alcatel.
- Les matrices d'expansion/concentration des CSA sont réalisées
avec des relais reed à 3 contacts : 2 contacts pour le transports
des conversations analogiques et 1 contact de maintien électrique
(même principe que pour le commutateur semi-électronique
spatial PÉRICLÈS).
- Chaque CSA peut héberger 511 abonnés (la position
Zéro étant impossible à adresser électroniquement).
Concernant les Commutateurs E10N4, il existe, comme
pour PLATON, au dessus de chaque groupe constitué par quelques
un de ces commutateurs, un Centre de Traitement des Informations (CTI)
chargé de superviser en différé un groupe de
commutateurs E10 dans toutes ses fonctions (exploitation, maintenance,
sauvegarde du système et de la taxation...).
Chaque CTI est équipé, en ce qui concerne les
premiers commutateurs de la présérie installés
entre 1972 et 1975, d'un calculateur Mitra 15 de la société
SEMS.
 Centre de Traitement des Informations de type MITRA 15.
Centre de Traitement des Informations de type MITRA 15.
Ultérieurement, tous les Commutateurs E10N4 installés
en France seront ensuite convertis en commutateurs E10N3 au niveau
fonctionnel, grâce au remplacement de leur Centre de Traitement
des Informations (CTI) par un calculateur Mitra 125.
Dès leur "conversion rapide", les Commutateurs E10N4
seront dès lors considérés et comptabilisés
comme étant des Commutateurs E10N3, ce qui explique
que l'on retrouve si peu de littérature titrée E10N4.
E10N3 - E10 Niveau 3
- (Dénomination initiale : E10A).
Le Commutateur E10N3 est le résultat direct de la mise en industrialisation
par la Compagnie Industrielle des Télécommunications
- Alcatel de la présérie E10N4. Connu aussi sous l'appellation
E10/64 US. (car constitué de 64 Unités de Sélection).
L'E10N3 est prêt à partir de 1976.
La serrurerie (coffrets, menuiserie métallique)
est totalement repensée et améliorée pour une
mise en industrialisation en vue d'une fabrication en grande série.
À partir de 1976, après la baisse de prix des composants
électroniques, les baies de raccordement d'abonnés EMA
de 2ème génération entièrement électroniques,
à base de nouveaux circuits intégrés hybrides
ou monolithiques, deviennent abordables et seuls seront installés
ultérieurement des Commutateurs E10N3 équipés
de cette technologie EMA 2G.
L'amélioration fonctionnelle principale consiste ensuite en
l'adoption d'un nouveau calculateur Mitra 125 pour le Centre de Traitement
des Informations (CTI) à partir de 1977.
Dans le système E10N3, Temporel de première
génération, l'organe de commande consiste, tout comme
pour le système E10N4, en une commande répartie entre
plusieurs organes différents et spécialisés.
Chaque organe est dédoublé pour assurer la sécurité
du système et fonctionnent en service normal, en partage de
charge. Ces organes dédoublés sont : les Traducteurs
(TR) et les Marqueurs (MQ). Au nombre de 2 à 8 ce sont les
Multienregistreurs (MR). Le Taxeur (TX) n'est pas un organe dédoublé,
mais il sauvegarde régulièrement les informations de
taxation sur bandes magnétiques.
- Le Taxeur (TX 02) est chargé d'établir
et comptabiliser les taxes des conversations pour chaque abonné.
- Les Traducteurs (TR 06) constituent la mémoire programmable
(et modifiable) des routages possibles dans le Commutateur Téléphonique
ou vers d'autres Commutateurs téléphoniques du Réseau.
- Les Multienregistreurs (MR 09) assurent l'enregistrement de la numérotation
et sa réémission, puis le déroulement et le séquencement
de l'établissement en temps réel des communications
et leur arrêt. Chaque Multienregistreur de type MR 09 constitue
un ensemble de 66 Enregistreurs et occupe une baie. (à comparer
au volume équivalent d'une baie d'Enregistreurs de Rotary 7A1
formée de 4 Enregistreurs). Les Multienregistreurs sont les
seuls organes du système E10N3 à pouvoir prendre des
initiatives en temps réel.
- Les Marqueurs (MQ 02) sont l'interface entre les organes de commande
précités et les Unités de Raccordement d'Abonnés
via le Réseau de Connexion (CX 05).
- Le Réseau de Connexion (CX 05), dans un Commutateur E10N3
est 100% de type temporel, à un seul étage, de type
T, capable de commuter un maximum de 128 multiplex numériques
MIC.
Est également présent un organe d'Équipement
de Tonalités et d'Auxiliaires (ETA 06) incluant les :
- Générateurs de Tonalités (GT),
- 1 ou 2 Multirécepteurs Récepteurs de Fréquences
pour la numérotation au clavier et pour la signalisation intercentre
(RF), chaque ensemble RF étant constitué de 31 circuits
de récepteurs de fréquences.
- Enfin, le Commutateur E10N3 est naturellement complété
par des Unités de Raccordement d'Abonnés, comme tout
modèle de Commutateur. Il s'agit des baies EMA 01 de 2ème
génération inaugurées en 1976 capables d'héberger
jusqu'à 511 abonnés lorsque les alvéoles sont
toutes équipées de cartes de 16 abonnés. La capacité
s'en trouvant réduite lorsque sont utilisées des cartes
de 8 abonnés seulement (cas des abonnés discriminés
avec retransmission des impulsions de taxation au domicile).
- L'étape de concentration en sortie de chaque EMA 01 de 511
abonnés s'effectue sur 60 voies numériques, par l'utilisation
de 2 liaisons numériques MIC. ( l'équipement numéro
Zéro ne peut pas recevoir d'abonné.).
Concernant les Commutateurs E10N3, il existe, comme
pour PLATON, au dessus de chaque groupe constitué par quelques-uns
de ces commutateurs, un Centre de Traitement des Informations (CTI)
équipé d'un calculateur chargé de superviser
en différé un groupe de Commutateurs E10 dans toutes
ses fonctions (exploitation, maintenance, sauvegarde du système
et de la taxation...).
- Concernant le Centre de Traitement des Informations
(CTI) le calculateur Mitra 15 réalisé en technologie
à circuits intégrés TTL à partir de 1972
et des premiers E10N4, est progressivement remplacé à
partir de 1977 par un calculateur Mitra 125, une fois la mise au point
définitive du E10N3 réalisée.
- Les dérouleurs à bande de papier perforé sont
rapidement remplacés par des dérouleurs à bandes
magnétiques aussi bien dans les premiers E10N3 que dans leur
CTI de rattachement afin d'effectuer les sauvegardes externes de sécurité,
ou à l'inverse afin d'importer des données de programmation
logicielles dans le commutateur ou dans le CTI.

Vue d'ensemble d'un Commutateur temporel E10N3 .
Rambouillet B1 Mis en service le 20 septembre 1978 - Hors service
le 25 mai 1994 - Fabricant : CIT-Alcatel
Concernant les Services Confort : E10N3 ne supportait ni le Signal
d'Appel, ni la Conversation à Trois, ni le Mémo Appel
(service du réveil), ni le service Présentation de l'Identité
du Demandeur (PID) mis en service en France Métropolitaine
le 2 septembre 1997, ni la Portabilité du Numéro d'Abonné
(en cas de déménagement dans la même Circonscription
Tarifaire) mise en service à partir du 1er janvier 1998.
-E10N3 supportait le Transfert d'Appel Local (à partir du 22
janvier 1982). (Local = dans la même circonscription de taxe,
uniquement)
-E10N3 supportait le Transfert d'Appel National (totalité du
parc équipé entre Juin 1988 et Mai 1989).
-E10N3 a pu bénéficier, très tardivement, du
service de Facturation Détaillée (à partir de
Mai 1990 sur certains E10N3, puis Février 1991 sur l'ensemble
des E10N3).
169 Commutateurs d'abonnés E10N3+E10N4 sont installés
en France, dont 14 en Île-de-France, y compris Paris intra-muros.
- Dès 1972, les Commutateurs E10N4 et E10N3 permettent de gérer
jusqu’à 15.000 abonnés (dès la présérie
E10N4 qui aurait compté 18 machines entre le 24 mai 1972 et
le 28 septembre 1976).
- Dès 1976, ce système est capable d'écouler
jusqu'à 50.000 appels à l'heure, en pleine charge.
- Attention, les Commutateurs E10N4 et E10N3, n'étant pas totalement
conformes aux Normes d'Exploitation et de Fonctionnement (NEF), bénéficient
de certaines dérogations. En effet, ces systèmes sont
mal protégés contre une surcharge d'appels, car ils
ne savent pas faire le tri entre les appels entrants et les appels
locaux et ne savent pas prioriser les appels. Ces systèmes,
qui sont ne l'oublions pas les premiers temporels du monde, ne savent
pas "choisir".
- Le premier Commutateur E10N3 normalisé (et
qui de ce fait est le 1er E10N3) et équipé avec des
Unités de Raccordement d'Abonnés entièrement
électroniques à composants discrets, les EMA2G, est
mis en service le 19 octobre 1976 sur le site de Lannion (Lannion
Centre ). Tous les Commutateurs E10N3 ultérieurs seront équipés
de ces nouveaux EMA2G. On distingue les EMAL 01 pour les abonnés
locaux et les EMAD 01 pour les abonnés distants. Chaque EMA2G
reçoit jusque 512 abonnés.
- À noter la mise en service dans Paris Intra-Muros d'un unique
Commutateur d'abonnés E10N3, le 28 mai 1980, ce Commutateur
était aussi nommé ACROPOLE ( Autocommutateur Central
Répartissant ses Organes Périphériques Pour Offrir
des Lignes Eloignées). Il s'agit de Tuileries 3 ET1 (AE24),
qui fonctionnera jusques au 16 juillet 1992. Ce Commutateur E10N3
a été utilisé pour désengorger les quartiers
d'affaires du centre de Paris que les systèmes ROTARY 7A1 ne
pouvaient pas traiter en termes de trafic. En effet, il s'agit d'abonnés
d'affaires téléphonant de 5 à 7 fois plus qu'un
abonné moyen.
- Le premier Commutateur E10N3 Mobile (déplaçable en
camion semi-remorque) est prêt à l'emploi à la
mi-1978. D'une capacité de 8.000 abonnés et pourvu de
baies EMAD (Équipements de Modulation d'Abonnés Déportés),
il est destiné à faire face à toute avarie majeure
pouvant survenir sur un Commutateur E10N3, comme par exemple une inondation
ou un incendie pouvant survenir dans un centre téléphonique.
Le temps de réparer ou de reconstruire le centre téléphonique,
le Commutateur E10N3 Mobile prend la relève. Les Commutateurs
E10N3 Mobiles sont nommés les "Mobidix".
- Le Commutateur E10N3 le plus récent de France est mis en
service le 14 octobre 1986 (Champagnole 2).
- Le premier Commutateur E10N3 de France à être arrêté
en 1985 serait Seloncourt 1.
- Le premier Commutateur E10N3 de Paris & Île-de-France
à être arrêté le 16 juillet 1992 est Tuileries
3 ET1 (ACROPOLE).
- Notons que le Commutateur Rambouillet B1 est retenu comme prototype
pour tester la préparation au passage à la Numérotation
à 10 chiffres à partir de 1993 (site pilote en système
E10N3), bien qu'il ne connaîtra lui-même jamais cette
Nouvelle Numérotation (arrêt le 25 mai 1994).
- L'ultime Commutateur E10N3 d'Île-de-France est arrêté
le 31 janvier 1995 (Beaumont-sur-Oise A2).
- Le dernier Commutateur E10N3 de France est arrêté le
3 mars 1999 (Guingamp Centre 2).
E10CTI
: les Centres de Transit temporels Interurbains sont directement dérivés
du E10N3. Ce système est capable de gérer jusqu'à
36.000 circuits de transit par cœur de chaîne.
- Le premier Commutateur E10CTI , commandé en 1972, est mis
en service en France, à Saint Brieuc, le 12 mars 1975. (sa
capacité est de 1.800 circuits de transit).
- Le Commutateur E10CTI de Saint-Brieuc est le premier Centre de Transit
à commutation temporelle du monde. Il assurera ses fonctions
de transit jusques en Mars 1984, date de sa mise hors service.
- L'unique Commutateur E10CTI de Paris, commandé en 1973, est
mis en service le 7 décembre 1976 au centre téléphoniques
des Tuileries : Tuileries E10CTI. (Sa capacité est de 5.000
circuits de transit, étendue ultérieurement à
18.000 ce qui pour un commutateur de transit de technologie E10N3
est énorme). Il assurera ses fonctions de transit jusques au
15 janvier 1988, date de sa mise hors service.
- Comme les autres Commutateurs E10N3, ils sont tous obsolètes
et démontés.
E12
(abréviation pour Électronique projet n°12
ou E12
)
(licence Alcatel époque CGE) C'est un autre système
dérivé aussi du prototype PLATON. Temporel de seconde
génération, de capacité double que les Commutateurs
E10N3 de la même époque..
Le système E12 est mis en étude à partir de 1971
par le biais de la création d’une filiale commune CITEREL
entre CIT-Alcatel et Ericsson-France.
L'ambition de départ des ingénieurs
était de constituer un Commutateur dont l'organe central de
calcul pourrait fonctionner entre 40 et 50 années sans jamais
s'arrêter d'assurer son service. Hélas, les effectifs
des équipes chargées de concevoir ce système
n'étaient pas assez nombreux et le projet prit trop de retard
et fut doublé par d'autres systèmes.
Le système E12 devait constituer le premier « réseau
intelligent » et offrir des services améliorés
par rapport à tout ce qui se faisait jusques alors.
Tout système E12 pourrait être utilisé
en Commutateur d'abonnés où il serait capable de gérer
50.000 abonnés par cœur de chaîne, mais cet usage
n’est finalement pas retenu, au profit de la famille E10 puis
MT25.
Le système E12 est utilisé en Centre
de Transit Interburbain (E12CTI) où il est capable de gérer
jusqu'à 49.552 circuits de transit par cœur de chaîne.
Deux Commutateurs de transit E12 ont en outre été reconvertis
et utilisés pour les numéros Libre Appel dès
1985 (les numéros verts / appels gratuits) puis deux autres
pour la Carte Pastel dès le début 1989. (Ce que l'on
nommera le Réseau Intelligent)
Un Commutateur E12 est de conception très centralisée
; il est organisé sur 4 niveaux :
1 ) - 1er niveau : l'Unité de Commande Dupliquée
(UCD) constituée par deux calculateurs électroniques
CS40 fonctionnant en synchronisme en effectuant les mêmes tâches
identiques au même instant, ce qui permet un contrôle
par comparaison. Chaque calculateur CS40 est équipé
du processeur IRIS80. Ultérieurement, l'Unité de Commande
Dupliquée a vu son mode de calcul transformé en fonctionnement
en partage de charge, ce qui permet de meilleures performances.
- Chaque calculateur CS40, réalisé suivant les prescriptions
des PTT est capable de traiter 150.000 communications à l'heure,
soit 40 communications à la seconde, d'où son appellation
: Calculateur - Secondes - 40. La puissance de traitement d'appels
à l'heure sera ultérieurement portée à
350.000 avec des calculateurs améliorés CS40 B3.
2 ) - 2ème niveau : l'Unité de Gestion des MarQueurs
(UGMQ) constituée par les Marqueurs (MQ) qui sont l'intermédiaire
entre l'Unité de Commande Dupliquée (UCD) et l'Unité
de Connexion (UCX).
3 ) - 3ème niveau : l' Unité de ConneXion (UCX)
composée du Réseau de Connexion (RCX) initialement pourvu
d'une capacité de 960 multiplex numériques MIC de 30
voies téléphoniques chacun, capacité énorme
au début de la mise en étude de ce système en
1972. Elle sera par la suite portée à 1536 multiplex
numériques MIC pour un écoulement maximal de 15.000
erlangs.
- Le Réseau de Connexion, dans un commutateur E12 est certes
de type temporel mais est formé de 5 étages : un étage
d'entrée temporel, un étage de sortie temporel, mais
au milieu de ces 2 étages, 3 étages spatiaux réalisés
en technologie numérique. Le Réseau de Connexion TSSST
est une adaptation qui a été utilisé afin de
pouvoir assurer à moindre frais et à moindres difficultés
un brassage optimal entre les voies entrantes et sortantes. Le Système
de Connexion d'un commutateur E12, bien qu'étant vu comme étant
de type temporel selon que l'on se place à son entrée
ou à sa sortie, n'en est pas moins « entrelardé
» par trois couches de technologie numérique spatiale
ce qui constitue une curiosité du système, tout comme
dans le cas du commutateur E10N1.
4 ) - 4ème niveau : l'Unité de Signalisation
(US) chargée de la réception et la distribution des
différentes signalisations, qui agit sous le commandement direct
de l'Unité de Commande Dupliquée (UCD).
Chaque Commutateur E12 est équipé d'un
programme d'autodiagnostic avec localisation automatisée des
défauts et de leur emplacement. Sa fiabilité est même
conçue pour pouvoir fonctionner sans défaillance majeure
et sans interruption de service et durant plusieurs dizaines d'années,
fait impressionnant à l'époque de sa mise en étude.
- Seuls 14 Commutateurs E12 ont été
mis en service en France (la commande du 14ème commutateur
E12 ayant été validée in extrémis ).
- Le système E12 est capable d'écouler en charge typique
jusqu'à 150.000 puis 350.000 appels à l'heure et jusqu'à
540.000 appels à l'heure en limite maximale absolue.
- La capacité typique de raccordement d'un Commutateur E12
est de 48.000 circuits en tant que Commutateur de Transit.
- le système E12 est mise en étude à partir de
1971.
- Un premier exemplaire prototype E12 est mis en expérimentation
en laboratoire à Boulogne-Billancourt en 1975.
- En tant que Commutateur d'Abonnés, un Commutateur E12 est
équipable de baies EMA ou CSA (tirées du matériel
E10N3), mais cet usage n'est pas retenu, au profit de la fonction
de Centre de Transit Temporel.
- Après une consultation lancée en Avril 1979, le système
E12 est validé par l'Administration en 1980.
- Avant leur installation et mise en service, les Centres de Transit
Temporel E12 sont nommés dans les documents d'époque
(vers 1979-80) GCE pour Grands Centres Électroniques. (car
appelés à prendre la suite des GCI électromécaniques
crossbar).
- Le premier Commutateur E12 de série, commandé en fin
1977, est mis en service à Massy-Palaiseau le 29 avril 1981
(Massy CTZP1).
- Le premier Commutateur E12 de province est mis en service en Septembre
1981. Il est officiellement inauguré le 16 octobre 1981 par
M. le Ministre des PTT - Louis Mexandeau.
- Après installation de quelques exemplaires de série
comme par exemple, Saint-Germain-en-Laye CT1 le 26 mai 1982, le système
E12 est brusquement abandonné en 1984 pour raisons économiques
par la CIT-Alcatel, suite au rapprochement d'avec Thomson Télécommunications
intervenu à partir de Juillet 1984, pour se recentrer sur les
gammes E10 et MT car déjà très implantées
et commercialisées dans le monde entier.
- C'est aussi le système E12 qui supporte la mise en service
des premières communications de données commutées
TRANSDYN par satellite le 16 décembre 1986. Les débits
des liaisons sont de 256 kbit/s. Le satellite utilisé est Télécom
1. Massy E12 CT est le point de liaison avec Télécom
1.
- La dernière mise en service d'un Commutateur E12 intervient
en Juin 1987 (Saint-Ouen-l'Aumône CTZP1).
- La totalité des 7 Commutateurs E12 encore en service dans
les années nonante a été démontée
avant l'introduction de la Nouvelle Numérotation téléphonique
à 10 chiffres intervenue le 18 octobre 1996.
- Il aurait été constaté que le système
E12 était incompatible à la norme RNIS, ce qui le condamnait
de facto à terme. Ainsi la note N°22/DG du 3 juin 1991
stipule la nécessité de supprimer ces commutateurs téléphoniques
à l'horizon 1995.
- L'ultime Commutateur E12 de France utilisé en Centre de Transit
Temporel est mis à l'arrêt à la mi-janvier 1995
(Saint-Ouen-l'Aumône CTZP1 (RP81)).
- La totalité des Commutateurs E12 a été remplacée
par des Commutateurs MT20 entre 1992 et 1995.
sommaire
II - Les systèmes électroniques de
type temporel de 2ème génération :
Les Commutateurs électroniques de type temporel de 2ème
génération sont mis en service pour la première
fois en France le 16 juin 1981 (système E10N1). En effet,
la République Française demeure la locomotive mondiale
de la Commutation Électronique Temporelle, suite à
une succession de choix politiques, techniques et industriels ambitieux
de plus de deux décennies et devance en cela les conclusions
unanimes du Colloque International de Commutation qui se tient du
21 au 25 septembre 1981 à Montréal (ISS' 81) qui confirme
le tournant massif et définitif au tout électronique
temporel et à la transmission en tout numérique MIC.
Les Commutateurs électroniques de type temporel
de 2ème génération sont aujourd'hui en voie d'obsolescence
; leur démontage est en cours (2020).
Ils sont caractérisés par une capacité de raccordement
typique comprise entre 15.000 et 65.000 abonnés par cœur
de chaîne, avec une capacité d'établissement d'appels
téléphoniques typiquement comprise entre 90.000 et 200.000
appels à l'heure ; le tout avec une fiabilité renforcée
par rapport à leurs prédécesseurs temporels de
première génération et une résistance
accrues face aux surcharges éventuelles.
Les systèmes électroniques de type
temporel de 2ème génération déployés
en France sont les suivants :
- E10N1,
- MT20,
- MT25,
- MT35 (mort-né)
Réseaux de Connexion numériques
Mixtes - Temporels et Spatiaux
Certaines variantes existent dans les Réseaux de Connexion
des Commutateurs temporels.
Dans un Réseau de Connexion numérique
intégralement temporel (PLATON, E10N3, E10B3, MT20 de petite
capacité et MT25 de petite capacité), il faut beaucoup
de Mémoires Tampon afin de stocker le temps nécessaire
les signaux de conversation des voies entrantes pour les rediriger
vers les bonnes voies de sortie.
Vu le prix de ces mémoires au début de la commutation
temporelle, ainsi que par souci de simplification du Réseau
de Connexion, il a parfois été décidé
pour certains systèmes (AXE10, AXE Transgate 4, E12, E10N1,
MT20 de grande capacité et MT25 de grande capacité)
d’intégrer un ou plusieurs étages réalisés
en électronique numérique spatiale entre l’étage
d’entrée temporel et l’étage de sortie temporel
des Réseaux de Connexion, afin de pouvoir se passer d’un
maximum de Mémoires Tampon.
Cet étage numérique spatial de brassage est plus simple
à réaliser et beaucoup moins coûteux car il est
dépourvu de mémoires (éléments coûteux)
: il est constitué de circuits de portes logiques à
commutation rapide, synchronisées sur la cadence de fonctionnement
des Liaisons numériques MIC.
Par contre, un étage spatial numérique, même s’il
permet d’améliorer le brassage, ne peut procéder
qu’au basculement d'un Intervalle de Temps donné (IT)
d'une Liaison MIC entrante vers une autre Liaison MIC sortante, toujours
à la même position temporelle donnée.
Donc, un étage spatial numérique ne permet en aucun
cas de décaler l’Intervalle de Temps (IT) entre une Liaison
MIC entrante et une Liaison MIC sortante. Donc, ce ou ces étages
ne viennent qu'en appoint dans un Réseau de Connexion numérique,
mais ne peuvent pas assurer à eux seuls la commutation téléphonique
complète.
Il s’agit là d’un compromis entre
la technique pure et la finance, pour pouvoir réaliser un brassage
entre les Liaisons numériques MIC entrantes et sortantes. Cette
technique fonctionne tout aussi parfaitement que la technique de connexion
purement temporelle. Cependant, l’intérêt de cet
artifice tend depuis de nombreuses années à s’estomper,
étant donnée la baisse des prix vertigineuse des circuits
Mémoires.
En revanche, dans un Commutateur temporel, quelque soit sa génération
et son modèle, le Réseau de Connexion temporel est systématiquement
dupliqué pour raison de sécurité.
sommaire
Famille 1000-E10
: incluant deux sous-familles : E10 et MT de la société
française Alcatel qui fait aujourd'hui partie du groupe franco-américain
Alcatel-Lucent :
Sous-famille E10,
(abréviation : E pour Électronique car 100% électronique,
projet n°10), (licence Alcatel époque CGE), dont le prototype
est issu du projet PLATON, en France existe le type suivant de 2ème
génération :
E10N1 - E10 Niveau 1
- (Dénomination initiale : E10B). Temporel de seconde génération
mis en étude à partir de 1976 et commandé le
15 décembre 1976 par l'Administration des Télécommunications.
Connu aussi sous l'appellation E10/128 US. (composé de 128
Unités de Sélection). L'organe de commande consiste
en une commande répartie entre plusieurs organes différents
et spécialisés. Chaque organe est dédoublé
pour assurer la sécurité du système et fonctionnent
en service normal, en partage de charge. Ces organes dédoublés
sont : les Taxeurs (TX), les Traducteurs (TR) et les Marqueurs (MQ).
Au nombre de 2 à 5 ce sont les Multienregistreurs (MR) suivant
l'importance du trafic à traiter.
- Les Taxeurs (TX 30) sont chargés d'établir
et comptabiliser les taxes des conversations pour chaque abonné,
ainsi que leur facturation détaillée.
- Les Traducteurs (TR 30) constituent la mémoire programmable
(et modifiable) des routages possibles dans le Commutateur Téléphonique
ou vers d'autres Commutateurs téléphoniques du Réseau.
Pour ce faire, ils stockent toutes les caractéristiques des
abonnés, et toutes celles des faisceaux de circuits d'acheminement.
Chaque TR 30 possède une capacité de 1.000 acheminements
différents et peut supporter jusqu'à 40.000 abonnés
en pleine charge.
- Les Multienregistreurs (MR 30) assurent l'enregistrement de la numérotation
et sa réémission, puis le déroulement et le séquencement
de l'établissement en temps réel des communications
et leur arrêt. Chaque Multienregistreur de type MR 30 constitue
un ensemble de 254 Enregistreurs et occupe une baie. (à comparer
au volume équivalent d'une baie d'Enregistreurs de Rotary 7A1
formée de 4 Enregistreurs). Les Multienregistreurs sont les
seuls organes du système E10N1 à pouvoir prendre des
initiatives en temps réel.
- Les Marqueurs (MQ 30) sont l'interface entre les autres organes
de commandes précités et les Unités de Raccordement
d'Abonnés via le Réseau de Connexion (CX 30).
- Est également présent un Organe de Contrôle
(OC) chargé des opérations de test et de maintenance
du système. Cet organe n'est pas dupliqué.
- Sont également présents des organes (au nombre de
2 à 16, suivant options et capacité système retenues)
d'Équipement de Tonalités et d'Auxiliaires (ETA 30),
Chaque ETA étant basé sur l'utilisation d'un microprocesseur
central Intel 8085, incluant les :
- Générateurs de Tonalités (GT),
- Multirécepteurs de Fréquences pour la numérotation
au clavier et pour la signalisation intercentre (RF), chaque ensemble
RF étant constitué de 32 circuits de récepteurs
de fréquences.
- Additionneurs de voies pour les Circuits de ConFérence à
3 (CCF). Sachant que chaque ETA ne peut contenir que 2 CCF seulement,
chaque CCF permettant de régir 8 Conférences à
3 simultanément, ce qui limitera l'accès aux souscriptions
des Services Conforts lorsqu'ils se démocratiseront à
partir des années nonante et précipitera en conséquence
la fin anticipée du système E10N1 en 2002.
- Le Réseau de Connexion (CX 30), dans un Commutateur E10N1
est certes de type temporel mais est formé de 3 étages
: un étage d'entrée temporel, un étage de sortie
temporel, mais au milieu de ces deux étages un étage
spatial de technologie numérique toutefois.
Il s'agit là d'un compromis qui a été utilisé
afin de pouvoir assurer à moindre frais et à moindres
difficultés un brassage optimal entre les voies entrantes et
sortantes pour des Réseaux de Connexion de grande capacité
(pour l'époque) que l'on ne savait pas concevoir en technologie
temporelle pure.
Mais le Réseau de Connexion d'un Commutateur E10N1, n'en reste
pas moins un réseau entièrement numérisé
même si en son sein, un étage de technologie spatiale
numérique est nécessaire pour permettre un brassage
optimal à moindre coût et avec un maximum de performances
techniques pour l'époque.
Dès 1981, chaque commutateur élémentaire, de
32 Unités de Sélection chacun, permet le raccordement
de 64 multiplex MIC et peuvent être combinés jusqu'à
4 exemplaires pour former un commutateur d'une capacité de
256 multiplex numériques MIC de 30 voies téléphoniques
chacun, sous un trafic de 2.500 erlangs.
Dès 1984, chaque commutateur élémentaire, de
32 Unités de Sélection chacun, permet le raccordement
de 64 multiplex MIC et peuvent être combinés jusqu'à
6 exemplaires pour former un commutateur d'une capacité de
384 multiplex numériques MIC de 30 voies téléphoniques
chacun, sous un trafic de 3.800 erlangs.
Dès 1987, chaque commutateur élémentaire, de
32 Unités de Sélection chacun, permet le raccordement
de 64 multiplex MIC et peuvent être combinés jusqu'à
8 exemplaires pour former un commutateur d'une capacité de
512 multiplex numériques MIC de 30 voies téléphoniques
chacun, sous un trafic de 5.000 erlangs.
- Les Unités de Raccordement d'Abonnés
:
En 1980, au commencement des Commutateurs E10N1, les unités
de raccordement d’abonnés sont des CSE 31 (Concentrateur
Satellite Electronique type 31) dont la matrice de concentration analogique
est désormais entièrement électronique réalisée
à l'aide de composants discrets ou intégrés (100%
électronique), sans pièce mobile, à coût
compétitif. Le CSE 31 est conçu par la CIT-Alcatel.
- Chaque CSE 31 peut héberger jusques 1023 abonnés analogiques,
lorsque les alvéoles sont toutes équipées de
cartes de 16 abonnés. La capacité s'en trouvant réduite
lorsque sont utilisées des cartes de 8 abonnés seulement
(cas des abonnés discriminés avec retransmission des
impulsions de taxation au domicile).
- L'étape de concentration en sortie de chaque CSE 31 de 1023
abonnés s'effectue selon 3 options possibles, sur 60, 90 ou
120 voies numériques, par l'utilisation de 2, 3 ou 4 liaisons
numériques MIC, suivant le trafic souhaité et sa densité
estimée.
- Chaque CSE 31 est articulé sur l'utilisation de 4 microprocesseurs
Intel 8085 combinés aux périphériques d'interface
Intel 8741.
Mais à partir de 1987, les CSE31 ont été
remplacés par une nouvelle génération plus évoluée
conçue par Alcatel, compatible avec les services supplémentaires
à valeur ajoutée et au Numéris : il s’agit
des CSN (Centre Satellite Numérique) qui seront même
déployés dans les commutateurs MT25 pourtant conçus
par Thomson à l'origine.
Dans le système E10N1, le Commutateur doit avoir atteint le
Palier Logiciel n°6 pour accepter la connexion avec les CSN.
Concernant cette nouvelle technologie des CSN, lorsqu'elle
est utilisée pour le raccordement des lignes analogiques, la
conversion des signaux analogiques de conversation en signaux numériques
s'effectue dès le premier étage d'entrée dans
les cartes de raccordement d'abonnés. À partir de là,
tout le reste de la chaîne de commutation du Commutateur de
départ vers le Commutateur d'arrivée, en passant par
les transmissions s'effectue en signaux numériques.
- Chaque CSN peut héberger jusqu'à 5120
abonnés analogiques.
- Chaque CSN peut héberger jusqu'à 2560 abonnés
Numéris.
- Tout CSN peut héberger à la fois des abonnés
analogiques et des abonnés Numéris, par panachage des
cartes terminales d'abonnés.
- Eux seuls étant capables d'héberger des abonnés
Numéris, l'arrivée des CSN dans le réseau téléphonique
français sont alors la condition première à la
naissance de Numéris dans notre pays.
- Les premiers CSN mis en service sont d'abord raccordés sur
Commutateurs E10N1 existants courant 1987, peu avant l'arrivée
du Numéris le 21 décembre 1987 à Saint-Brieuc.
- Puis, les premiers raccordements de CSN sur Commutateur MT25 suivent
avec la mise en service à Paris de MONTMARTRE 4 ET1 le 24 mars
1988 ; ces CSN ci ne desservent en premier que des abonnés
analogiques ; le Numéris ne sera déployé via
les commutateurs MT25 qu'ultérieurement à partir du
21 mars 1990.
- En Avril 1988, la synchronisation du Réseau Téléphonique
est réalisée, préalable technique nécessaire
à la généralisation sur tout le territoire du
RNIS en France.
- Puis, suivent en Île-de-France les premiers CSN mis en service
sur E10N1 avec le Commutateur E10N1 de Puteaux (PUTEAUX 6 ET4) mis
en service le 4 mai 1988 avec des CSN en première-monte, Commutateur
dont l'usage est réservé, par décision de l'administration,
très-majoritairement aux abonnés Numéris.
 Un
des tous premiers CSN mis en service.
Un
des tous premiers CSN mis en service.
Concernant les Commutateurs E10N1, tout comme PLATON, il existe au
dessus de chaque groupe constitué par quelques-uns de ces Commutateurs,
un Centre de Traitement des Informations (CTI) équipé
d'un calculateur MITRA 225 réalisé en technologie TTL,
chargé de superviser en différé un groupe de
commutateurs E10 dans toutes ses fonctions (exploitation, maintenance,
sauvegarde du système et de la taxation...). A titre transitoire,
les tous premiers exemplaires E10N1 de présérie sont
supervisés par un CTI équipé d'un calculateur
MITRA 125. Ceux-ci seront rapidement remplacés par un MITRA
225.
À la création du système E10N1
entièrement normalisé, de pleine série, un CTI
pourvu d'un calculateur MITRA 225 permet de gérer jusqu'à
80.000 voire 100.000 abonnés, répartis sur un maximum
de 5 à 6 Commutateurs E10N1. Puis, au fur et à mesure
des évolutions, des paliers, les ressources disponibles s'avéreront
tout juste suffisantes pour qu'un CTI avec MITRA 225 puisse superviser
un maximum de 2 Commutateurs E10N1, eu égard, les années
passant, à la complexification des logiciels et des services
optionnels se diversifiant.
- En 1991, le calculateur des CTI mis en service cette
année-là est remplacé par un OMC83 2G plus puissant
et sera raccordé aux ultimes Commutateurs E10N1 les plus récents
qui seront mis en service cette année-ci. La validation des
OMC83 2G a été faite par le CNET Lannion A le 7 janvier
1991, et les deux premiers OMC 83 2G mis en service, expérimentalement,
le sont à Grenoble et à Épinal. Ce nouveau calculateur
développé par Alcatel est basé sur l'utilisation
de Multiprocesseurs Alcatel 8300. Un CTI pourvu d'un calculateur OMC83
2G peut superviser 6 Commutateurs E10N1 à lui seul, au lieu
de 2 pour un MITRA 225 à cette même époque...
Le système Mitra 225 avait fait son temps et arrivait en bout
de course.
- En 1993, la fabrication des calculateurs MITRA 225, de la société
SEMS cesse totalement. Les pièces de rechange n'étant
plus disponibles, le parc de calculateurs MITRA 225 qui supportent
les CTI doit être changé. Le calculateur Alcatel OMC83
2G est choisi.
- En 1996, l'ensemble du parc des calculateurs MITRA 225 des CTI est
donc remplacé par des calculateurs OMC83 2G. (Organe de Maintenance
Centralisé, dérivé du standard X83, de 2ème
Génération).
Des dérouleurs à bandes magnétiques sont utilisés
aussi bien dans un E10N1 que dans son CTI de rattachement afin d'effectuer
des sauvegardes externes de sécurité (telles que des
données de taxation), ou à l'inverse afin d'importer
des données de programmation logicielles dans le Commutateur
ou dans le CTI.
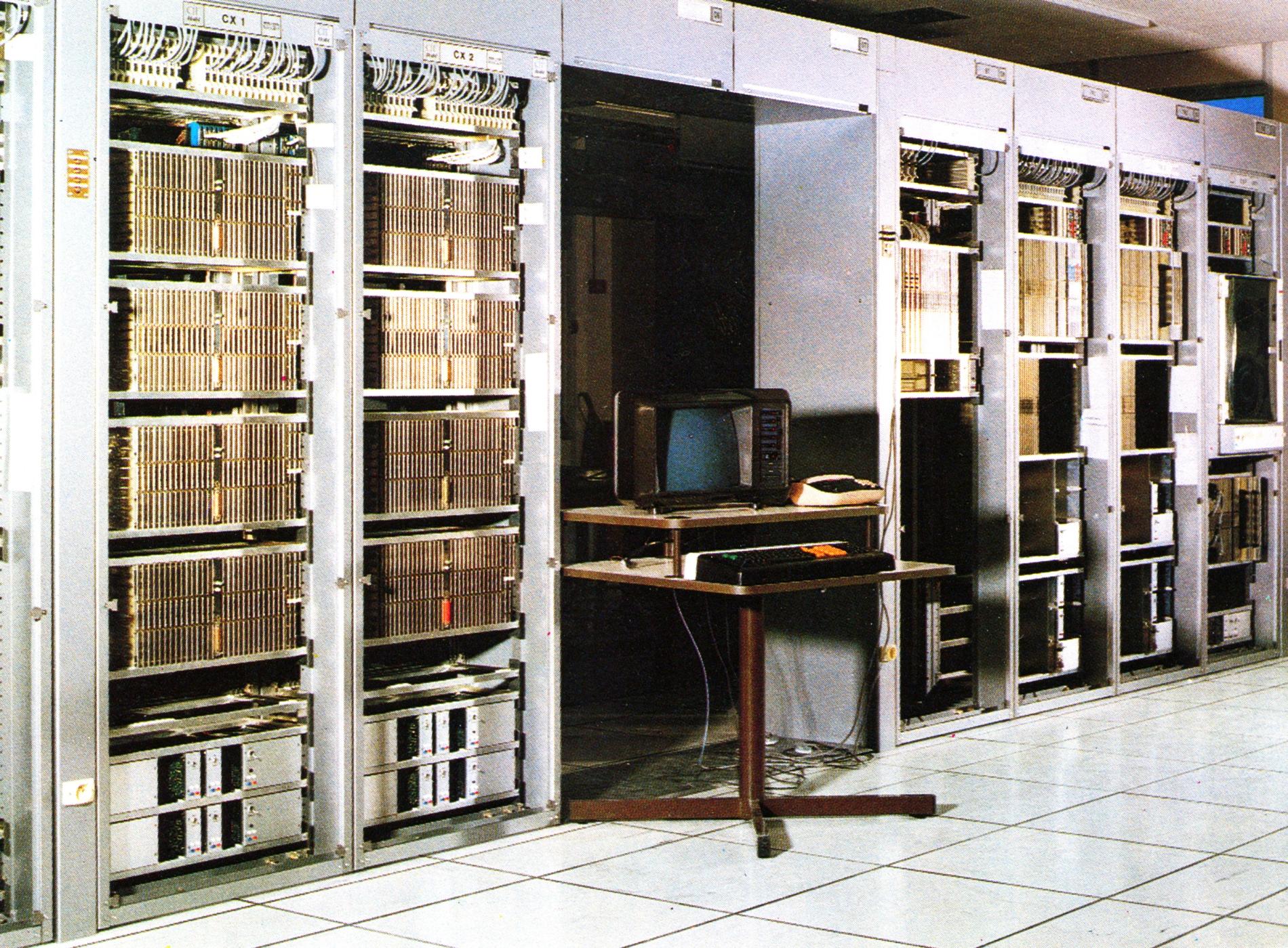

Commutateur E10N1 prototype BREST-CENTRE 3 (QU67), alors en expérimentation
courant 1980. mis en service le 16 juin 1981 - hors service le
19 mars 2002. A droite, le centre de Traitement des Informations de
Saumur, équipé d'un ordinateur MITRA 225.
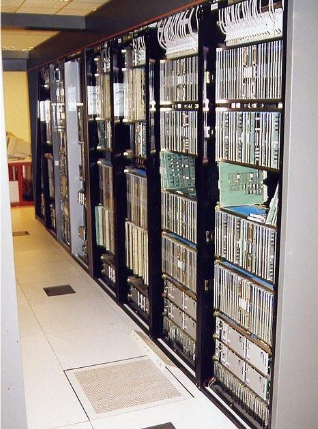

En 1981 Le centre téléphonique CP400 de Fontainebleau
dés années 1960 est remplacé par un système numérique E10 N1 (de
2ème génération). Il est mis en Service
le 1er juin 1982 rue de la Paroisse. Mis hors Service le 22 juillet
1998.
Concernant les Services Confort : le système
E10N1 supporte les services du Mémo Appel (Réveil),
du Transfert d'Appel Local (à l'intérieur de la même
Circonscription de Taxe), du Signal d'Appel et de la Conversation
à 3 depuis le 1er juin 1984 ; mais les ressources matérielles
disponibles ne permettent pas de pouvoir accueillir tous les candidats
à la souscription de ces services.
Le Transfert d'Appel National est disponible sur la totalité
du parc des Commutateurs E10N1 depuis le 1er février 1988.
Il ne pouvait fournir qu'à un maximum de 15% des abonnés
lui étant raccordés le nouveau service de Présentation
de l'Identité du Demandeur (PID) mis en service en France depuis
le 2 septembre 1997 en France Métropolitaine et le 1er octobre
1997 dans les DOM. (Limitation qui a également accéléré
la suppression de ce système pourtant très fiable)
426 Commutateurs E10N1 sont installés
en France, dont 35 en Île-de-France inclus 2 dans Paris
intra-muros et dont les 18 en Outre-mer. (soit plus que les 416 cités
dans les sources habituelles... et ce, sans comptabiliser les E10N1
provisoires en remorque utilisés çà et là
en cas de panne de commutateur existant, ou dans l'attente d'une mise
en service d'un nouveau commutateur à venir.)
- Les Commutateurs E10N1 seront les premiers à supporter en
France les abonnés de type Numéris (RNIS) à partir
du 21 septembre 1987 à Brest puis en Île-de-France à
partir du 3 août 1988.
- Le système E10/128US est capable de gérer dès
1981 jusqu'à 30.000 abonnés par cœur de chaîne.
Il est capable d'écouler jusqu'à 200.000 appels à
l'heure, en pleine charge.
- Le système E10/192US est capable de gérer dès
1984 jusqu'à 45.000 abonnés par cœur de chaîne.
Il est capable d'écouler jusqu'à 250.000 appels à
l'heure, en pleine charge.
- Le système E10/256US est capable de gérer dès
1987 jusqu'à 60.000 abonnés par cœur de chaîne.
Il est capable d'écouler jusqu'à 300.000 appels à
l'heure, en pleine charge.
Les 3 premiers Commutateurs E10N1 du monde, commandés en Décembre
1977, sont mis en service au Yémen du Nord (Sanaa, Hodeidah
et Taëz) en Septembre 1980 et délivrent le service téléphonique
de base, en attendant la mise au point définitive du logiciel
en cours de finalisation en France, à Brest.
- En France, les opérations de validation du système
E10N1 commencent à Brest sur le prototype, à partir
du 19 janvier 1981.
- Ce premier Commutateur E10N1 de France (quatrième au monde),
d'une capacité initiale de 12.000 abonnés, est mis en
service sur le réseau public le 16 juin 1981 - 6H00 - à
Brest (BREST CENTRE 3).
Ce même Commutateur E10N1 sera d'ailleurs inauguré en
grande pompe le 18 septembre 1981 par M. le Ministre des PTT - Louis
Mexandeau en présence de 27 ministres des PTT du monde entier.
Le troisième pays à mettre en service son premier Commutateur
en 1982 serait la République d'Irlande (Eire), dans la ville
de Kells. Le 9 mai 1980, un accord de coopération technique
est signé entre les PTT des deux pays. Le 19 janvier 1982,
ce premier Commutateur E10N1 irlandais, installé par Alcatel,
est inauguré par Messieurs les Ministres des PTT irlandais-Patrick
Cooney et français-Louis Mexandeau, au cours d'une inauguration-démonstration
devant le Commutateur en fonctionnement. Le système E10N1 sera
massivement déployé dans les villes moyennes, les villages
et la campagne irlandaise, de telle sorte qu'il pourvoira jusqu'à
la moitié des lignes en service dans ce pays. Retrouvez en
cliquant ici le reportage des PTT Irlandais de 1982 (archive RTÉ)
avec les deux ministres des PTT !
- Le premier Commutateur E10N1 (à Unités de Raccordement
d'Abonnés de type CSE) d'Île-de-France est mis en service
le 14 janvier 1982 (ARPAJON A3).
- Le premier Commutateur E10N1 (à Unités de Raccordement
d'Abonnés de type CSE) de Paris intra-muros est mis en service
et inauguré le même jour par le Directeur Général
des Télécommunications Jacques Dondoux le 21 décembre
1983 au centre téléphonique de Raspail (RASPAIL 2 ET1).
Nota : Paris-intra muros ne comptera seulement que deux Commutateurs
E10N1 avec RASPAIL 3 ET2 (AD73) ; Paris intra-muros étant "donné"
au MT25. Pour la petite histoire, la raison de cette notable exception
se justifiait par la présence dans Paris intra-muros, pour
le prestige, d'au moins un site abritant de l'E10N1 qui était
systématiquement proposé lors des multiples visites
d'Ingénieurs et de politiques français ou étrangers
de passage dans la capitale.
Dans le monde, le premier Commutateur E10N1 équipé en
première monte des nouvelles baies de raccordement d'abonnés
de type CSN est commandé le 22 janvier 1985 puis mis en service
en Chine, à Pékin, en 1986. Le nouveau réseau
téléphonique temporel de Pékin constitué
de 14 Commutateurs E10N1 est inauguré officiellement le 12
janvier 1987, en présence de M. l'Ingénieur Général
des Télécommunications Albert Delbouys.
- En France, le premier Commutateur E10N1 équipé en
première monte des nouvelles baies de raccordement d'abonnés
de type CSN est mis en service le 7 décembre 1987 à
Saumur (SAUMUR) (département 49).
- Le Commutateur E10N1 Centrex- AÉROPORT NORD 2 est mis en
service le 18 mai 1989 à Roissy Charles de Gaulle. Il pourvoit
le service Numéris dès sa mise en service ainsi qu'une
multitude de services spécialisés.
Il remplace le CommutateurMétaconta Centrex AÉROPORT
NORD 1 (ND01) de 1972.
Le Commutateur E10N1 Centrex - AÉROPORT NORD 2 (ND02) est arrêté
le 4 juin 1997.
- Le Commutateur E10N1 le plus récent d'Île-de-France
est mis en service le 26 mars 1991 (CERGY A5 (NE75)).
- Le Commutateur E10N1 le plus récent de France est mis en
service en 1991.
- Les dernières extensions de Commutateurs E10N1 existants
sont commandées en 1995.
- Les deux premiers Commutateurs E10N1 a être mis hors service
avant Mars 1990 sont : LE CHEYLARD (VL43) et TOULOUSE MIRAIL 3.
Le programme global de démontage des Commutateurs E10N1 a débuté,
en France, en 1997. Il devait se conclure initialement en 2005 ; puis
la décision a été prise en Janvier 2000 de procéder
à un plan massif de retrait total et rapide de tous les Commutateurs
E10N1, en raison du manque de ressources qui empêchait de fournir
à tous les abonnés les Services Confort et qui étaient
totalement incompatibles avec la présélection locale
devant entrer en vigueur en France le 1er janvier 2002.
- Avant 2000, un chef de projet "Renouvellement E10N1" est
nommé, il s'agit de M. Guy Vassal, pour hâter l'arrêt
des Commutateurs E10N1. (Les 9,5 millions de lignes téléphoniques
de cette dernière campagne de retrait des 340 Commutateurs
E10N1 alors encore en service, sont basculées sur des Commutateurs
AXE10 et E10B3, de 3ème génération.)
- Le premier Commutateur E10N1 d'Île-de-France et Paris est
désactivé le 3 juin 1997 (RASPAIL 3 ET2).
- Le dernier Commutateur E10N1 d'Île-de-France est désactivé
le 27 juin 2001 (ÉVRY A4).
- Le dernier Commutateur E10N1 de France est désactivé
le 10 décembre 2002 (RIOM 2).
En dehors de l'Europe, le système E10N1 est connu sous la dénomination
OCB-181 (Organe de Commande type B, version 1, mis en service en 1981).
sommaire
Sous-famille MT
-Matrice Temporelle- (licence Thomson-CSF Telephone), mise
en développement à partir de 1975 par la société
LMT à l'insu de sa maison mère ITT dès 1971.
Après signature d'un protocole d'accord signé entre
Thomson et LMT le 28 avril 1976, LMT est ensuite rachetée par
la société Thomson-CSF en Juin 1976 dans le cadre de
la "francisation" de l'industrie des télécommunications
voulue par M. le Président de la République Valéry
Giscard d'Estaing ;
La première commande de l'administration pour un prototype
date d'Octobre 1977 (AUBERVILLIERS 1 CTU ).
Avant leur installation et mise en service, les Centres de Transit
Temporel MT20 sont nommés dans les documents d'époque
(vers 1979-80) GCE pour Grands Centres Électroniques (car appelés
à prendre la suite des GCI électromécaniques
crossbar).
À noter que la société LMT a commencé
à étudier la commutation temporelle dès 1971,
à l'insu de sa maison-mère américaine ITT, après
en avoir déposé le brevet de base depuis 1945.
Famille robuste mais ayant été techniquement très
longue à mettre au point, notamment au niveau logiciel où
toutes les difficultés seront résolues en 1984.
MT20, Temporel de seconde génération,
type à grande capacité d’écoulement de trafic,
commandé en Octobre 1977 par l'Administration des Télécommunications.
Le système MT20 est un système de commutation à
commande centralisée. Dans son architecture générale,
le système MT20 est en fait le descendant direct du système
MÉTACONTA 11F semi-électronique spatial, dont son Réseau
de ConneXion (RCX) est devenu 100% électronique temporel.
Les tous premiers exemplaires de Commutateurs MT20 ont fonctionné
initialement avec des calculateurs centralisés LCT3202 utilisés
sur les Commutateurs MÉTACONTA 11F : l'on parle alors de MT20L
(La lettre L signifiant Large capacité); les calculateurs MU320
(nom complet : Mercure 320), mis en étude au début de
l'année 1978, étant des dérivés améliorés
parachevés ultérieurement en 1983.
De surcroît, le tout premier Commutateur MT20L, implanté
à Aubervilliers par la société LMT, reprend l'aspect
extérieur des baies des Commutateurs MÉTACONTA 11F formées
de panneaux horizontaux amovibles. Les armoires métalliques
avec portes articulées verticales seront étudiées
et déployées un peu plus tard...
L'architecture du système temporel MT20 est bâtie
sur quatre niveaux.
1 ) - Le premier niveau est constitué
par une Unité de Commande Dupliquée (UCD) basée
sur un ensemble de deux calculateurs fonctionnant en service normal
en partage de charge (pourvue de deux processeurs de type MU320 de
technologie à circuits intégrés ECL, ayant tous
été remplacés entre 1990 et 1993 par le type
MU321 deux fois plus puissant puis, par le type MU322 à partir
de 1995, puis enfin pour certains commutateurs MT20, par des processeurs
MU323 avec nouvelle amélioration de 30% des performances à
partir de 2003 ).
2 ) Le second niveau est constitué par l'Unité
de SIgnalisation (USI)
- d'une part constituée de Signaleurs (SI) équipés
de microcalculateurs MU29 (nom complet : Mercure 29) chargés
d'effectuer les tâches non répétitives comme la
surveillance et le test des équipements, qui sont constitués
par des microprocesseurs AMD2901.
- d'autre part constituée des processeurs Périphériques
Programmés de Signalisation (PPS) chargés d'effectuer
la majeure partie des tâches simples et répétitives,
entre l'Unité de Commande Dupliquée (UCD), le Réseau
de ConneXion (RCX) et les liaisons connectées avec les commutateurs
distants, pour assurer notamment l'échange des signaux de ligne
(tonalités) et d'enregistreur servant à acheminer les
appels.
3 ) Le troisième niveau est l'Unité de ConneXion
(UCX). Elle comprend notablement le Réseau de ConneXion (RCX)
d'un commutateur MT20. L'Unité de ConneXion (UCX) a pour rôle
de connecter, grâce à des organes dénommés
Groupes Temporels (GT), deux intervalles de temps quelconques appartenant
à des liaisons numériques MIC quelconques. Deux types
sont possibles :
- soit de type purement temporel TT (un étage d'entrée
temporel, un étage de sortie temporel) pour une capacité
maximale de raccordement de 512 MIC. (Nota : une Unité de Commande
Dupliquée (UCD) composée de calculateurs MU320 ne peut
supporter qu'un Réseau de ConneXion (RCX) de 512 liaisons MIC
au maximum.) Cette solution ne semble avoir été mise
en œuvre en France que de manière limitée, pour
cause de capacité de trafic trop réduite.
- soit de type Temporel-Spatial-Spatial-Temporel pour une capacité
pouvant s'étendre jusqu'à 2048 MIC. (Avec calculateurs
MU321, MU322 ou MU323 uniquement). Dans ce cas, pour maintenir l'accessibilité
totale du réseau agrandi, le brassage de ces différents
Groupes Temporels (GT) entre eux est alors assuré par l'organe
supplémentaire de Sélection de Groupe (SG). Les Sélecteurs
de Groupes (SG) sont en fait des matrices numériques spatiales
de commutation dites "supermultiplex". Ce Réseau
de ConneXion (RCX), de type temporel est formé de 4 étages
: un étage d'entrée temporel, un étage de sortie
temporel, mais au milieu de ces 2 étages, 2 étages spatiaux
réalisés en technologie numérique. Le Réseau
de Connexion TSST est une adaptation qui a été utilisée
afin de pouvoir assurer à moindre frais et à moindres
difficultés un brassage optimal entre les voies entrantes et
sortantes.
4 ) Le quatrième niveau équipé des cartes
de circuits périphériques (les joncteurs chargés
de communiquer avec les autres centres de transit).
- Soit les jonctions d'entrée et de sortie sont déjà
sous forme numérique (ce qui est le cas actuellement) et le
branchement des liaisons numériques MIC est direct,
- soit les jonctions d'entrée et de sortie sont analogiques
(ce qui n'existe plus actuellement) auquel cas il faille passer par
une Unité de Raccordement de Circuit (URC) chargée de
convertir les signaux traversant le commutateur à la norme
MIC. (L'on parle aussi d'Unité d'ADaptation UAD).
- Dans le cas des Commutateurs MT20 utilisés en Centres internationaux,
à une époque où certaines liaisons internationales
n'étaient pas encore toutes automatisées, il était
adjoint une Unité de Raccordement des Opératrices (URO)
permettant de connecter 30 postes d'Opératrices manuelles à
chaque MT20CI.
Utilisé massivement en centre de transit interurbain,
notés MT20TN pour Transit National, ainsi qu'en Centre International,
notés MT20CI, et à la marge en centre téléphonique
pour les abonnés situés dans leur périmètre
géographique voisin.
100 Commutateurs MT20 Transit National sont
mis en service en France (108 si l'on compte les 6 changements
de code SGTQS ainsi que les deux MT20 de Monaco, partie intégrante
du réseau français jusqu'au 21 juin 1996 21H00). Le
système reste encore déployé en France en 2017
en version MT20TN.
- 17 Commutateurs MT20 Centre International sont mis en service en
France (13 pour la métropole, 4 pour les D.O.M). Aujourd'hui
tous les MT20CI sont démontés.
- Le système MT20 est capable de gérer 15.000 circuits
de transit par cœur de chaîne avec un Réseau de
Connexion TT.
- Le système MT20 est capable de gérer 60.000 circuits
de transit par cœur de chaîne avec un Réseau de
Connexion TSST.
- Le système MT20 peut faire transiter en son sein 400.000
appels à l'heure, à pleine charge avec deux calculateurs
MU320.
- La société LMT commence à étudier la
commutation temporelle en 1971.
- Une maquette de Réseau de ConneXion temporel est opérationnelle
en 1973.
- Une maquette semi-autonome reliée à l'autocommutateur
Pentaconta MOLITOR 1 PC1 (CC32) (à Boulogne-Billancourt (92))
est mise en test en 1976. Les microprocesseurs y sont introduits au
niveau des Signaleurs-Marqueurs avec succès.
- Le modèle de Calculateur MU320 est mis en étude au
début de l'année 1978. Les Premiers Commutateurs MT20
mis en service (prototype et présérie) seront donc équipés
de Calculateurs LCT3202 hérités du système MÉTACONTA
11F, en attendant leur remplacement.
- Le premier prototype MT20 complet, commandé en Octobre 1977,
est mis à l'essai le 31 mars 1981. Il mis en service dans le
réseau public de l'État en France à Aubervilliers
en Août 1981 en tant que Centre de Transit Urbain (Commutateur
MT20L équipé de deux calculateurs LCT3202). (Nota :
certaines sources évoquent une mise en service expérimentale
dès Février 1980 à Aubervilliers - AUBERVILLIERS
CTU1). Ce Commutateur MT20L Prototype sera arrêté le
28 février 1986 étant donnée son instabilité
en fonctionnement - ceci se produit parfois pour les prototypes.
- Une présérie de deux Commutateurs MT20L utilisés
en tant que Centres de Transit Secondaire est commandée le
20 avril 1979. Il s'agit d'AMIENS CAMPUS pour une capacité
initiale de 1.000 erlangs et d'ANNECY LES ROMAINS pour une capacité
initiale de 1.600 erlangs.
- Le premier Commutateur MT20 de présérie est mis en
service le 25 juin 1982, en France à AMIENS CAMPUS . Il sera
inauguré le 1er juillet 1982 en présence de M. le Ministre
des PTT Louis Mexandeau et de 30 autres ministres des PTT du monde
entier. (Commutateur MT20L équipé de deux calculateurs
LCT3202). ANNECY LES ROMAINS (AY02) suivra le 18 octobre 1982 en MT20L
également.
À partir de cette présérie, le système
MT20 est fiabilisé.
Suivront quelques Commutateurs MT20TN (probablement MT20L) : au moins
8.
- Suit le premier Commutateur MT20TN de série, mis en service
à Paris au centre téléphonique de BONNE-NOUVELLE
CTU1 le 30 août 1983, utilisé en tant que Centre de Transit
Urbain (MT20 équipé de deux calculateurs MU320).
- Le premier Commutateur MT20CI mis en service en France est MARSEILLE
SAINT-MAURONT CIA 2 le 26 avril 1984.
- Le premier Commutateur international de France utilisant le code
de signalisation par canal sémaphore CCITT n°7 est le Commutateur
MT20CI - BAGNOLET 4 CTI, mis en service le 4 janvier 1990 (arrêt
le 12 février 2002).
Les Commutateurs MT20 les plus récents de
France sont mis en service en 1994/95 :
Concernant les MT20 CI : PARIS-BAGNOLET 5 CTI (RT17) le 2 novembre
1994.
Concernant les MT20TN d'Île-de-France : PLESSIS-BOUCHARD 1 CTZP
le 20 septembre 1994.
Concernant les MT20TN de Province : LYON-LACASSAGNE CTT5 CTS le 24
octobre 1994 et TOULOUSE FERRIÉ CTT4 CTS3 le 13 oct 1995.
- Les dernières extensions de Commutateurs MT20 déjà
existants sont mises en service en 1997.


Salle de Connexion du Commutateur prototype MT20 - AUBERVILLIERS 1
CTU et salle des calculateurs.
Concernant spécifiquement les Commutateurs
MT20 utilisés en Centres Internationaux :
- Les Commutateurs MT20 Internationaux sont hiérarchisés
en 3 niveaux croissants :
- Niveau (1) MT20CIA (Centre International Automatique) : raccordés
uniquement avec les pays européens frontaliers avec la France,
car ne disposant pas de salles de Transmissions équipées
d'Annuleurs d’Écho (A.E) nécessaires à partir
de 2.000 km environ de distance. Les dix Commutateurs MT20CIA sont
implantés en Métropole à proximité d'une
frontière, (dont quatre MT20CIA en Outre Mer).
- Niveau (2) MT20CTI (Centre de Transit International) : maillés
avec les principaux pays du monde, car situés géographiquement
sur un Point d’Interconnexion de Commutation et de Transmissions
qui disposent de systèmes concentrateurs et d'Annuleurs d’Écho
(A.E) sur place, au plus près des commutateurs. Ils étaient
maillés avec les principaux pays du monde. Les quatre Commutateurs
MT20CTI sont implantés à Paris et à Bagnolet.
- Niveau (3) MT20CTIP : (Centre de Transit International Principal)
: maillés avec les principaux pays du monde ainsi qu'à
beaucoup de petits pays avec lesquels la France n'échange que
très peu de trafic téléphonique. Situés
géographiquement sur un Point d’Interconnexion de Commutation
et de Transmissions qui disposent de systèmes concentrateurs
et d'Annuleurs d’Écho (A.E) sur place, au plus près
des commutateurs. Les trois Commutateurs MT20CTIP sont implantés
à Paris et Reims.
- L'organisation du trafic international de 3ème génération,
mise en place au début des années 1980 est techniquement
complexe et s'avère devenir trop couteuse à maintenir
en l'état, en raison de la dérégulation des télécommunications
et de la perte du monopole des télécommunications nationales
et internationales survenue le 1er janvier 1998. Les réductions
des coûts deviennent alors prioritaires sur la survie des Commutateurs
MT20CI.
- En 1999, il est décidé de retirer progressivement
du réseau la totalité des 17 Commutateurs MT20CI français,
après la mise en service du premier Commutateur AXE Transgate
4/CTI4G.
M. Christian Kling est nommé le 1er août 1999 Chef de
Projet du retrait des treize Commutateurs MT20 CI de métropole.
M. Jean-Claude Froeliger sera chargé du retrait des quatre
Commutateurs MT20CIA d'Outre Mer.
- Il est évident qu'à partir de l'année 2001
où le parc de Commutateurs de nouvelle génération
fut entièrement déployé (AXE Transgate 4/CTI4G),
les jours des Commutateurs MT20CI étaient comptés :
- Tous les Commutateurs MT20CI ont été désactivés
entre 2001 et 2003.
- Le premier Commutateur MT20CI à être mis à l'arrêt
le 15 janvier 2001, à 9H30 est PARIS-BAGNOLET 5 CTI .
- L'ultime Commutateur MT20CI de France Métropolitaine à
être mis à l'arrêt le 9 décembre 2002 à
10H30 est REIMS CITP3.
- L'ultime Commutateur MT20CI d'Outre-Mer à être mis
à l'arrêt le 20 mai 2003 est FORT-DE-FRANCE CIA.
- Un total de 100.000 circuits internationaux a dû être
muté pour mettre à l'arrêt les 17 MT20CI français.
- Les Commutateurs MT20CI ainsi démontés servirent de
banque d'organes aux MT20TN encore en service.
Concernant spécifiquement les Commutateurs
MT20 utilisés en Centres de Transit National :
- Le système MT20TN a permis le remplacement massif des Commutateurs
de Transit Électromécaniques dont les plus perfectionnés,
les GCI PENTACONTA ; remplacement intervenu entre 1989 et 1994.
- Le retrait très progressif des Commutateurs MT20TN commence,
d'après nos recherches, en 1997. Il accompagne alors la diminution
progressive du trafic téléphonique fixe commuté.
- LILLE-BOITELLE CTU2 est le premier Commutateur MT20TN de France
à être mis hors service entre Février 1997 et
Janvier 1998.
- Deux Commutateurs MT20TN de province (TOULOUSE CAPITOLE CTU et LYON
LALANDE CTU sont mis à l'arrêt en 1999, démontés,
récupérés et remontés dans deux Départements
d'Outre Mer afin d'être reconvertis en Centre de Transit National
réservé uniquement au Réseau Intelligent MT20RI
concernant l'acheminement des numéros spéciaux à
taxation spéciale (Audiotel, Kiosque, etc...) dans les DOM.
LYON LALANDE CTU est remis en service le 3 mai 2001 en Guadeloupe
et devient Baie-Mahault MT20 RI et gère le trafic CT RI de
Guadeloupe, Martinique et Guyane jusqu'à son arrêt le
7 mars 2022.
TOULOUSE CAPITOLE CTT2 est remis en service le 15 octobre 2001 à
La Réunion et devient SAINTE-CLOTILDE MT20 RI et gère
le trafic CT RI de La Réunion et de Mayotte jusqu'à
son arrêt le 10 mars 2022.
- FONTENAY CTU1 est le premier Commutateur MT20TN d'Île-de-France
à être mis hors service le 20 octobre 2003.
- Les années 2003, 2004 et 2005 voient une baisse du parc des
Commutateurs MT20TN avec 34 arrêts de Commutateurs en seulement
3 ans (Projet RÉSEAU 2005).
- Les contrats de maintenance par les fabricants des systèmes
MT20TN cessent en 2008. La disponibilité des pièces
de rechange de ces vénérables machines devient depuis
lors fort compliquée dans la mesure où même les
usines qui les fabriquaient n'existent plus. La maintenance, qui devient
alors un art, est depuis lors assurée totalement en interne
par France Télécom / Orange, avec succès.
sommaire
MT25, Temporel
de seconde génération, commandé le 20 avril 1979
par l'Administration des Télécommunications, robuste
mais ayant été très long à mettre au point,
il est directement dérivé du système MT20 dans
son architecture, à laquelle il a été adjoint
des Unités de Raccordement d'Abonnés où sont
connectées des cartes de 8 abonnés (en lieu et place
des circuits de jonctions intercentre du MT20). Le logiciel de fonctionnement
du système MT25 est lui aussi entièrement remanié
par rapport à celui du système MT20.
Le système MT25 est un système de commutation téléphonique
à commande centralisée. Tout comme le système
MT20, son architecture est construite sur quatre niveaux :
1 ) Le premier niveau est constitué
par une Unité de Commande Dupliquée (UCD) basée
sur un ensemble de deux calculateurs fonctionnant en service normal
en partage de charge (pourvue de deux processeurs de type MU320 (nom
complet : Mercure 320) de technologie à circuits intégrés
ECL, ayant tous été remplacés entre l'année
1989 et l'année 1997 pour les 11 tous derniers par le type
MU321 deux fois plus puissant puis, sur option, par le type MU322
au fil des modernisations à partir de 1995 : depuis 2014, les
MT25 en service sont tous pourvus de processeurs MU322 qui sont aussi
les plus fiables). Le système MT25 est effectivement essentiellement
centralisé, car les communications sont toujours établies
puis toujours coupées sur l'ordre exclusif de l'Unité
de Commande Dupliquée.
2 ) Le second niveau est constitué par l'Unité
de SIgnalisation (USI)
- d'une part constituée de Signaleurs (SI) équipés
de microcalculateurs MU29 (Mercure 29) chargés d'effectuer
les tâches non répétitives comme la surveillance
et le test des équipements, qui sont constitués par
des microprocesseurs AMD2901.
- d'autre part constituée des processeurs Périphériques
Programmés de Signalisation (PPS) chargés d'effectuer
la majeure partie des tâches simples et répétitives,
entre l'Unité de Commande Dupliquée (UCD), le Réseau
de ConneXion (RCX) et les liaisons connectées avec les commutateurs
distants, pour assurer notamment l'échange des signaux de ligne
(tonalités) et d'enregistreur servant à acheminer les
appels.
3 ) Le troisième niveau est constitué de l'Unité
de ConneXion (UCX). Elle comprend notablement le Réseau de
ConneXion (RCX) d'un commutateur MT25.
L'Unité de ConneXion (UCX) a pour rôle de connecter,
grâce à des organes dénommés Groupes Temporels
(GT), 24 GT maximum, deux intervalles de temps quelconques appartenant
à des liaisons numériques MIC quelconques.
Deux types sont possibles :
- soit de type purement temporel TT (un étage d'entrée
temporel, un étage de sortie temporel) pour une capacité
maximale de raccordement de 512 MIC. (Nota : une Unité de Commande
Dupliquée (UCD) composée de calculateurs MU320 ne peut
supporter qu'un Réseau de ConneXion (RCX) de 512 liaisons MIC
au maximum.)
- soit de type Temporel-Spatial-Spatial-Temporel pour une capacité
pouvant s'étendre jusqu'à 2048 MIC. (Avec calculateurs
MU321 ou MU322 uniquement). Dans ce cas, pour maintenir l'accessibilité
totale du réseau agrandi, le brassage de ces différents
Groupes Temporels (GT) entre eux est alors assuré par l'organe
supplémentaire de Sélection de Groupe (SG). Les Sélecteurs
de Groupes (SG) sont en fait des matrices numériques spatiales
de commutation dites "supermultiplex". Ce Réseau
de ConneXion (RCX), de type temporel est formé de 4 étages
: un étage d'entrée temporel, un étage de sortie
temporel, mais au milieu de ces 2 étages, 2 étages spatiaux
réalisés en technologie numérique. Le Réseau
de Connexion TSST est une adaptation qui a été utilisée
afin de pouvoir assurer à moindre frais et à moindres
difficultés un brassage optimal entre les voies entrantes et
sortantes.
4 ) Le quatrième niveau est constitué par les
Unités de Raccordement d'Abonnés (URA).
Les baies retenues initialement pour les Commutateurs MT25 sont de
type URA 2G. Elles ont été développées
de Juillet 1975 à Septembre 1978 par l’Association des
Ouvriers en Instruments de Précision (AOIP) en collaboration
avec la Société Anonyme de Télécommunications
(SAT) filiale du groupe Philips et adoptées officiellement
par l’Administration en Janvier 1979.
Une URA 2G est un Concentrateur Temporel, à interface entrée/sortie
analogique vis-à-vis de ces abonnés, connectée
au Cœur De Chaîne par l'intermédiaire de 2, 3 ou
4 liaisons numériques MIC de 30 voies numériques pour
chaque MIC, le nombre de MIC variant suivant le nombre d'abonnés
raccordés sur ladite URA 2G ainsi que la densité de
trafic statistique à écouler.
La plupart des baies équipées de type URA 2G ont été
démontées à la fin 2000, et remplacées
par des baies de CSN étant donné que les URA 2G ne supportaient
pas l'arrivée de certains nouveaux services comme la Présentation
de l'Identité du Demandeur (PID).
Les MT25 sont équipés, dès 1983, de baies de
cartes de raccordement d'abonnés de type URA 2G (Unités
de Raccordement d’Abonnés de 2eme Génération).
Chaque carte comprend 16 abonnés analogiques (les cartes d'abonnés
discriminés TTX avec retransmission des impulsions de taxation
à domicile 12KHz comprennent seulement 8 abonnés).
Les MT25 sont équipés à partir de 1987, soit
de baies de type URA 2G, soit de baies de type CSN (Centre Satellite
Numérique), plus perfectionnées.
(Nota : les équipements CSN sont les mêmes que ceux des
Commutateurs de la famille E10. Ils ont été conçus
par Alcatel pour être également compatibles avec les
MT25, ce qui a permis de prolonger la vie des Commutateurs MT25, en
pouvant offrir les services modernes aux abonnés comme la Présentation
de l'Identité du Demandeur. Mais les CSN rendus compatibles
permirent à Alcatel, ayant entre-temps racheté à
Thomson-CSF sa branche Commutation Publique, de cesser la conception
de l'Unité de Raccordement Numérique (URN) mise en étude
par Thomson-CSF peu de temps avant cette absorption...)
- Chaque URA 2G peut héberger 1023 abonnés analogiques
ordinaires. (la position numéro zéro ne pouvant être
attribuée.)
-Chaque URA 2G peut héberger 511 abonnés analogiques
discriminés.
- Un Commutateur MT25 à Réseau de ConneXion TT peut
recevoir jusqu'à 15 URA 2G.
-Un Commutateur MT25 à Réseau de Connexion TSST peut
recevoir jusqu'à 64 URA 2G.
- Chaque CSN peut héberger 5120 abonnés analogiques.


V vue d'ensemble du cœur de chaîne du Commutateur MT25
captif de Paris-Cévennes ; initialement pourvu de deux Dérouleurs
de Bandes Magnétiques (DBM) situés entre les 2 Calculateurs.
Concernant les Services Confort : le système
MT25 supporte les services Mémo Appel (Réveil) et Transfert
d'Appel Local depuis le 15 septembre 1985, la Facturation Détaillée
depuis début 1987, les services Signal d'Appel et Conversation
à 3 depuis le 30 juin 1987 ; le service du Transfert d'Appel
National depuis le 1er février 1988, la Présentation
de l'Identité du Demandeur depuis le 2 septembre 1997 (Uniquement
pour les abonnés reliés sur CSN ; l'URA2G étant
incompatible avec ce service).
Le Système MT25 est largement utilisé pour les centres
téléphoniques d'abonnés, 307 Commutateurs
MT25 sont installés en France, dont 103 en Île-de-France,
inclus Paris intra-muros.
- Le système MT25 est capable de gérer jusqu'à
15.360 abonnés pour un MT25 pourvu d'un Réseau de Connexion
Temporel-Temporel.
- Le système MT25 est capable de gérer jusqu'à
61.440 abonnés pour un MT25 pourvu d'un Réseau de Connexion
Temporel-Spatial-Spatial-Temporel.
- Le système MT25 est capable d'écouler jusqu'à
120.000 appels à l'heure, en pleine charge, si équipé
de processeurs MU321.
- Le système MT25 est capable d'écouler jusqu'à
240.000 appels à l'heure, en pleine charge, si équipé
de processeurs MU322.
- Le premier Commutateurs MT25 de France a avoir été
commandé le 20 avril 1979 est BERNY 2 ET1. Il est situé
à Antony. (Mais il ne sera pas le premier Commutateur MT25
mis en service : sa mise en service, prévue en Mars 1982 a
été repoussée en raison de logiciels à
mettre au point.)
- Le premier Commutateur MT25 est mis en service en France, à
Paris, au centre téléphonique de Philippe-Auguste le
15 novembre 1983 (MT25 PHILIPPE-AUGUSTE 2 ET1).
- Le premier Commutateur MT25 d'Île-de-France est mis en service
le 6 décembre 1983 à Antony : (BERNY 2 ET1) avec une
capacité initiale de 17.000 abonnés. (après la
1ère commande du 20 avril 1979, la mise en construction a démarré
en premier, mais ayant pris du retard, Philippe Auguste est mis en
service légèrement en avance.)
- Le premier Commutateur MT25 mis en service en province le 20 décembre
1983 est RENNES MALAKOFF 2.
- Le premier Commutateur MT25 de France équipé de CSN
en première monte (au lieu des URA2G) est commandé le
12 juin 1986. Il est mis en service le 24 mars 1988 à Paris
(MONTMARTRE 4 ET1) avec une capacité de 22.000 abonnés.
Les CSN permettant d'accueillir les abonnés Numéris
en plus des abonnés analogiques standards.
- Le premier Commutateur MT25 de France a être construit dans
une cage de Faraday, destinée à le durcir pour résister
à une décharge causée par une bombe atomique,
est mis en service à Paris le 8 juin 1988 (PALAIS-ROSE 2 ET1).
Mis hors service le 11 février 2014.
- Le premier Commutateur MT25 de France équipé du processeur
MU321 est mis en service le 19 janvier 1989 à Paris (CARNOT
5 ET2).
- Le premier Commutateur MT25 de France équipé à
l'origine de Calculateurs MU320 les échange pour des Calculateurs
MU321 le 10 novembre 1989 (BASSANO 2 ET1). La conversion des autres
Commutateurs MT25 de France se poursuivra jusqu'en 1997.
- Le Commutateur MT25 d'abonnés le plus récent de Paris
est mis en service le 4 juin 1991 (PHILIPPE-AUGUSTE 3 ET2).
- Le premier Commutateur spécialisé MT25 de France est
mis en service le 21 juillet 1991 (service aux entreprises - PARIS
ÉCHIQUIER COLISÉE NUMÉRIS 5).
- Le premier Commutateur téléphonique ayant porté
un indicatif AB.PQ de Téléphonie Mobile à la
norme GSM 2G en France (07.10) est un Commutateur d'abonnés
MT25 de Paris, à partir du 14 novembre 1991 (TRUDAINE 5 ET1)
- Le Commutateur MT25 le plus récent d'Île-de-France
est mis en service le 21 janvier 1992 (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE B2).
- Le Commutateur MT25 d'abonnés le plus récent de France
est mis en service le 18 mars 1992 (CHÂTEAU-CHINON 2).
- Le Commutateur spécialisé MT25 le plus récent
de France est mis en service en Octobre 1993 (service aux entreprises
- PARIS ÉCHIQUIER COLISÉE NUMÉRIS 7).
- Les dernières extensions de Commutateurs MT25 existants sont
commandées en 1995.
- La plupart des URA 2G ont été remplacées par
des CSN au cours des années 1995 à 2005 en basculant
les abonnés sur des cartes de raccordement qui supportaient
ces nouveaux services modernes.
- Le premier Commutateur MT25 à être arrêté
en France le 7 juin 1998 est CONCARNEAU 2.
- Le premier Commutateur MT25 d'Île-de-France à être
arrêté le 25 septembre 1998 est SARCELLES A3.
- Le premier Commutateur MT25 de Paris intra-muros à être
arrêté le 6 mai 1999 est BEAUJON 4 ET2.
Jusqu'en 2002, concernant les Commutateurs MT25, MT20 et E10N1,
les opérations d'arrêt/basculage des commutateurs téléphoniques
sont effectuées par le constructeur Alcatel. Pour une question
d'économies (Plan TOP 5a), il est décidé de monter
une filière interne France-Télécom pour reprendre
l'intégralité de cette activité. Un chef de Projet,
M. Gilbert Calbet, est nommé à cet effet le 25 juin
2003.
- Initialement, l'arrêt total des Commutateurs MT25 est envisagé
pour 2010. Mais en raison de la nécessité de procéder
au retrait des Commutateurs E10N1 en priorité, la vie des Commutateurs
MT25 est prorogée une première fois jusques en fin 2015.
- Par ailleurs, la suppression de la Taxe Professionnelle au 1er janvier
2010 qui frappait chaque cœur de chaîne en fonctionnement
amplifie ce répit.
- Finalement, l’arrêt total d’exploitation des Commutateurs
MT25, replanifié pour la fin 2015, est repoussé une
seconde fois à la fin 2020.
- Le dernier Commutateur MT25 de province est mis hors-service le
15 octobre 2019 ; il s'agit de LIMOGES PONT NEUF NODAL 2 .
- Le dernier Commutateur MT25 de Paris intra-muros est mis hors service
le 29 septembre 2020 ; il s'agit de JEMMAPES 2 ET2.
- Le dernier Commutateur MT25 d'Île-de-France (et de France)
est mis hors service le 13 octobre 2020 ; il s'agit d'AULNAY-SOUS-BOIS
A3.
sommaire
MT35, présenté
en 1983 par Thomson-CSF, variante modulaire de petite capacité
conçue pour les zones à faible densité de population.
Un Commutateur MT35 peut être utilisé
indifféremment en commutateur d'abonnés ou en commutateur
de transit, ou de manière mélangée.
Il s'agit d'un système à commande répartie.
Construit en technologie CMOS pour la plupart des circuits intégrés
utilisés, et NMOS pour les circuits complexes et spéciaux.
Il s'agit également d'un système à
Réseau de Connexion (RCX) réparti, car chaque Baie Terminale
(BT) est parfaitement autonome et constitue un véritable commutateur
automatique capable de prendre en charge jusqu'à 1200 abonnés
analogiques par baie en charge typique si la baie est reliée
à des liaisons numériques MIC et jusqu'à 800
abonnés analogiques par baie en charge typique si la baie est
reliée à des liaisons de transmission analogiques de
basse fréquence.
Il s'agit d'un système modulaire qui permet de connecter entre
elles par des liaisons numériques MIC spécialisées
jusqu'à 14 Baies Terminales (BT) pouvant être accouplées
pour constituer un commutateur modulaire capable de gérer jusqu'à
17.000 abonnés.
L' Architecture d'un Commutateur MT35 est constituée
en 4 niveaux : (concerne chaque Baie Terminale (BT) constituant tout
ou partie d'un commutateur MT35).
1 ) 1er niveau : l'Unité de CoMmande (UCM) dupliquée,
à base de microprocesseurs MC68.000, contrôlant l'Interface
de Commande Numérique (ICN).
2 ) 2ème niveau : l'Interface de Commande Numérique
(ICN) dupliquée chargée des échanges entre les
Unités Terminales Numériques (UTN) et l'Unité
de CoMmande (UCM), via l'intermédiaire de Marqueurs (MQC).
3 ) 3ème niveau : le Réseau de Connexion Numérique
modulaire (RCN) formé d'une Matrice Temporelle Symétrique
(MTS) pouvant connecter temporellement 8 liaisons numériques
MIC entrantes vers 8 liaisons numériques MIC sortantes.
4 ) 4ème niveau : les Unités Terminales Numériques
(UTN). (au nombre de 1 à 5), où sont connectés
les abonnés analogiques, les jonctions Basses Fréquences
analogiques ou les liaisons numériques MIC, (était prévue
l'arrivée ultérieure des abonnés RNIS).
Une et une seule Baie d'Exploitation et de Maintenance (BEM) est nécessaire
pour superviser le Commutateur MT35 complété par au
moins une Baie Terminale (BT).
Bien parti pour être acheté par l'administration
des Télécommunications en 1983 pour couvrir les zones
à faible densité, il n'est finalement pas déployé
en France, car le système est abandonné en automne 1984
en raison de la fusion CIT Alcatel – Thomson CSF Telephone initiée
à partir de Juillet 1984 et aboutie par un acte de fusion-scission
du 31 octobre 1985.
Le système MT35 sera toutefois vendu en Amérique
du Sud, notamment au Chili dès 1983 en 6 exemplaires, avant
son arrêt rapide de commercialisation.
sommaire
III - Les systèmes électroniques
de type temporel de 3ème génération :
Les commutateurs électroniques de type temporel
de 3ème génération sont, en France, mis en service
pour la première fois le 4 janvier 1990 (système AXE10).
Ils sont caractérisés par une grande capacité
de raccordement typique de 100.000 à 200.000 abonnés
par cœur de chaîne, et une capacité accrue d'établissement
d'appels téléphoniques supérieure à 500.000
appels à l'heure ; le tout avec une fiabilité renforcée
par rapport à leurs prédécesseurs temporels de
seconde génération.
Ils sont compatibles avec tous les services confort
commercialisés, y compris la Présentation de l'Identité
du Demandeur (PID) en vigueur depuis le 2 septembre 1997 en France
Métropolitaine et le 1er octobre 1997 dans les DOM, ainsi que
la Portabilité du Numéro depuis le 1er janvier 1998,
sans limitation ni adaptation particulière.
Les systèmes électroniques de type
temporel des 3ème génération déployés
en France sont les suivants :
- E10B3,
- E10B3/CTN3G,
- AXE10,
- AXE TRANSGATE 4 / CTI4G.
Réseaux de Connexion numériques
Mixtes - Temporels et Spatiaux
Certaines variantes existent dans les Réseaux de Connexion
des Commutateurs temporels.
Dans un Réseau de Connexion numérique
intégralement temporel (PLATON, E10N3, E10B3, MT20 de petite
capacité et MT25 de petite capacité), il faut beaucoup
de Mémoires Tampon afin de stocker le temps nécessaire
les signaux de conversation des voies entrantes pour les rediriger
vers les bonnes voies de sortie.
Vu le prix de ces mémoires au début de la commutation
temporelle, ainsi que par souci de simplification du Réseau
de Connexion, il a parfois été décidé
pour certains systèmes (AXE10, AXE Transgate 4, E12, E10N1,
MT20 de grande capacité et MT25 de grande capacité)
d’intégrer un ou plusieurs étages réalisés
en électronique numérique spatiale entre l’étage
d’entrée temporel et l’étage de sortie temporel
des Réseaux de Connexion, afin de pouvoir se passer d’un
maximum de Mémoires Tampon. Cet étage numérique
spatial de brassage est plus simple à réaliser et beaucoup
moins coûteux.
Par contre, un étage spatial numérique, même s’il
permet d’améliorer le brassage, ne peut procéder
qu’au basculement d'un Intervalle de Temps donné (IT)
d'une Liaison MIC entrante vers une autre Liaison MIC sortante, toujours
à la même position temporelle donnée.
Donc, un étage spatial numérique ne permet en aucun
cas de décaler l’Intervalle de Temps (IT) entre une Liaison
MIC entrante et une Liaison MIC sortante. Donc, ce ou ces étages
ne viennent qu'en appoint dans un Réseau de Connexion numérique,
mais ne peuvent pas assurer à eux seuls la commutation téléphonique
complète.
Il s’agit là d’un compromis entre la technique pure
et la finance, pour pouvoir réaliser un brassage entre les
Liaisons numériques MIC entrantes et sortantes. Cette technique
fonctionne tout aussi parfaitement que la technique de connexion purement
temporelle. Cependant, l’intérêt de cet artifice
tend depuis de nombreuses années à s’estomper,
étant donné la baisse des prix vertigineuse des circuits
Mémoires.
En revanche, dans un Commutateur temporel, quelque soit sa génération
et son modèle, le Réseau de Connexion temporel est systématiquement
dupliqué.
Famille 1000-E10
: Incluant deux sous-familles : E10 et MT de la société
française Alcatel qui fait aujourd'hui partie du groupe franco-américain
Alcatel-Lucent :
Sous-famille E10,
(abréviation : E pour Électronique car 100% électronique,
projet n°10), (licence Alcatel époque CGE), dont le prototype
est issu du projet PLATON, en France existe le type suivant de 3ème
génération :
sommaire
E10B3, est issu
des systèmes E10B et du E10-5.
Le système E10B3 est un système Temporel de troisième
génération. L'architecture de base est révisée
en profondeur par rapport à ses deux prédécesseurs,
les Commutateurs E10N3 et E10N1. Le système E10B3 de conception
très novatrice s'apparente plutôt à un système
informatique qu'à un système téléphonique,
directement inspiré en cela par la structure du système
E10-5.
Tout comme ses prédécesseurs E10N4,
E10N3 et E10N1, le système E10B3 reprend une architecture fortement
décentralisée.
Le Cœur de Chaîne, décentralisé, est constitué
de Calculateurs qui sont, dans le système E10B3, renommés
"Stations".
Ce modèle de Commutateur est le premier système d'abonnés
à être mis en service après la dissolution en
France de l'Administration des PTT survenue le 1er janvier 1991.
Pour satisfaire aux desiderata de l’Administration qui souhaitait
un successeur amélioré au Commutateur E10N1, la société
ALCATEL avait comme objectif de créer un nouveau Commutateur
avec les caractéristiques suivantes :
-Accroissement de la capacité de raccordement du nombre d’abonnés,
-Accroissement de la capacité de traitement d’appels à
l’heure en pleine charge,
-Accroissement de la fiabilité et de la sécurité
du système,
-Possibilités d’adjoindre dès le début de
commercialisation, ou ultérieurement, de nouvelles fonctionnalités
évolutives ou des matériels de technologies futures.
Pour y parvenir, ALCATEL avait comme contrainte interne de devoir
réduire les coûts du nouveau système E10B3 :
-d’une part en repartant de l’énorme base logicielle
déjà existante et opérationnelle créée
pour le système prédécesseur E10N1,
-d’autre part en adoptant les composants électroniques
courants et les processeurs disponibles dans le commerce grand public
à l'instar du système E10-5.
-de surcroît, un Commutateur E10B3 ne comporte plus que 32 types
de cartes différents, contre 160 pour son prédécesseur
E10N1. Cet effort d'harmonisation des matériels participe aussi
de la réduction du coût/abonné.
Au lieu d'utiliser comme le font ses prédécesseurs ou
ses contemporains un bus temporel d'interconnexion des organes de
commande, son fonctionnement interne utilise désormais le protocole
de communication en Réseau Local d'Interconnexion en Anneau
à Jeton (Token Ring), via des Multiplex de communication entre
des blocs fonctionnels totalement informatisés (Stations Multiprocesseur
-SM) et qui sont décorrélés des organes physiques,
si bien qu’en ouvrant la totalité des baies composant
un Commutateur E10B3, il soit très difficile à l’œil
nu de différencier les différents organes qui semblent
tous matériellement identiques.
Les différentes Station Multiprocesseur (SM)
sont pilotées par un système d'exploitation nommé
Hyperviseur chargé de les faire cohabiter ensemble. L'Hyperviseur
est le logiciel de base de fonctionnement du Commutateur E10B3.
Chaque Station Multiprocesseur est pilotée par de multiples
microprocesseurs internes couplés entre eux, de la famille
Motorola MC68000.
Pour les Machines Physiques (les différents
Organes d'un Commutateur) qui existaient auparavant sur les prédécesseurs
E10N3 puis E10N1 et qui étaient matériellement distinctes
les unes des autres, correspondent désormais sur le Commutateur
E10B3 à de nouvelles Machines Logiques (ML) basées sur
les logiciels récupérés du système précédent
E10N1, portés par les microprocesseurs de la famille MC68000.
Parmi les Stations Multiprocesseur d'un Commutateur
E10B3, il existe notamment :
- La Station Multiprocesseur de Commande principale (SMC), (il en
existe au moins un exemplaire, mais il peut en exister plusieurs suivant
l'importance du commutateur) : parmi laquelle sont incluses les Machines
Logiques (ML), chacune pilotée par un logiciel indépendant.
Chaque Machine Logique reproduit la fonction d'un Organe connu dans
les commutateurs temporels à commande répartie :
- Les Taxeurs (ML TX) chargés d'établir et comptabiliser
les taxes des conversations pour chaque abonné.
- Les Traducteurs (ML TR) constituent la mémoire programmable
(et modifiable) des routages possibles dans le Commutateur Téléphonique
ou vers d'autres Commutateurs téléphoniques du Réseau.
- Les Multienregistreurs (ML MR) qui assurent le déroulement
et le séquencement de l'établissement en temps réel
des communications et leur arrêt.
- Les Marqueurs (ML MQ) sont l'interface entre les autres organes
de commandes précités et les Unités de Raccordement
d'Abonnés via le Réseau de Connexion (RCX).
Il existe donc dans un Commutateur E10B3 autant de
Machines Logiques (ML) que d'organes existants, sachant naturellement
qu'il existe plusieurs Taxeurs, Traducteurs, Multienregistreurs et
Marqueurs. Les Machines Logiques de même type fonctionnent,
en service normal, en partage de charge.
- La Station Multiprocesseur de Connexion (SMX) :
constituée d'un Coupleur Multiplex Principal, associé
à un (ou deux) coupleur(s) spécialisé(s), chargé
d'accéder au Réseau de Connexion temporel (RCX) du commutateur.
Il est à signaler que le Réseau de Connexion (RCX) du
commutateur E10B3 est (à nouveau) 100% temporel, mais désormais
pourvu de capacités accrues de connexions. Le Réseau
de Connexion d'un Commutateur E10B3 ne comporte qu'un unique étage
Temporel, mais d'une puissance nettement améliorée par
rapport aux précédents systèmes.
Chaque Commutateur E10B3 permet le raccordement sur son Réseau
de Connexion temporel synchrone (RCX) de 2048 multiplex numériques
MIC entrants de 30 voies téléphoniques chacun, et 2048
multiplex numériques MIC sortants.
Ultérieurement, en 1997, un nouveau type de
Réseau de Connexion (HC2) à commutation temporelle asynchrone
(structure ATM) est mis à l'étude puis en expérimentation
en 2000 à France Télécom. Les Commutateurs E10B3
qui en sont équipés acceptent comme précédemment
le raccordement de 2.048 multiplex numériques MIC de 30 voies
téléphoniques chacun, mais au fonctionnement global
amélioré : la Matrice ATM traite la Voix mais aussi
les Données (DATA), et bénéficie également
d'autres améliorations très techniques.
- La Station Multiprocesseur de Terminaisons (SMT)
: est chargée de relier au cœur de chaîne les éventuelles
Unités de Raccordements d'Abonnés Distantes, via liaisons
numériques MIC.
Le type préférentiel d'unités
déportées sont des CSND, mais également des équipements
de générations plus anciennes : Les CSED, mais aussi
les URA 2G de Thomson créées initialement pour le système
MT25. (Les URA 2G sont de moins en moins utilisées depuis le
courant des années 2000 car elles ne supportaient pas le service
de Présentation de l'Identité du Demandeur (PID) commercialisé
en 1997...)
- La Station Multiprocesseur Maintenance (SMM) : constituée,
par sécurité, de deux Stations Multiprocesseur Maintenance
dupliquées et identiques (SMMA et SMMB), fonctionnant en synchronisme
; l'une fonctionnant en pilote, l'autre étant laissée
en réserve en cas de défaillance, chargée d'assurer
la fonction d'exploitation et de maintenance du Commutateur.
- Elle supporte l'Organe de Contrôle (ML OC) chargé des
opérations de test et de maintenance du système.
- Elle assure la supervision et la gestion du système.
- L'archivage des données du système. (Plan de numérotage,
tables de traduction des indicatifs téléphoniques, données
des options des abonnés, compteurs de taxation...)
- L'interface homme-machine (alarmes, écrans, claviers...)
- La protection du système. (attaques, surcharges, avaries...)
- La réinitialisation du système en cas d'avarie grave.
(en dernier recours)
Dans un Commutateur E10B3, les Centres de Traitement
de l'Information (CTI) installés à distance et supervisant
plusieurs Commutateurs E10 de générations précédentes
n'existent plus en tant que tel : désormais, chaque Commutateur
E10B3 possède sa propre Station Multiprocesseur de Maintenance
(SMM), qui accomplit les mêmes fonctions de supervision que
les anciens CTI.
- Il existe notamment la Station Multiprocesseur Auxiliaire
(SMA) constituée des Machines Logiques (ML) suivantes :
- ML ETA, pour Équipements de Tonalités et d'Auxiliaires,
chargée d'émettre les tonalités, les sonneries...
- ML PUPE, chargée de dialoguer avec les Commutateurs extérieurs.
La sauvegarde externe de sécurité peut
être effectuée par des dérouleurs à bandes
magnétiques, puis ultérieurement par des dérouleurs
à cassettes (supprimés depuis 2000, remplacés
par des liaisons entrée-sortie informatiques).
Protection d'un commutateur E10B3 contre d'éventuelles
surcharges de fonctionnement.
Les Commutateurs E10B3 bénéficient de protections
contre les surcharges de fonctionnement très efficaces, par
le biais de programmes de défense particulièrement puissants.
Dans la mesure où nous avons à faire à un Commutateur
à commande répartie de conception très décentralisée,
et que les organes internes et les fonctions sont au minimum dédoublés,
et que de surcroît chaque fonction assurée par un organe
ou un groupe d'organes est équipée de programmes de
surveillance de défauts dans toutes les parties stratégiques
du Commutateur, que ces programmes de défense sont en mesure
de détecter, classer les incidents par ordre d'importance des
défauts ; d'alerter l'équipe de maintenance, de désactiver
un éventuel organe défaillant et de répartir
sa charge de travail dans les organes disponibles restants, le temps
qu'une équipe d'intervention répare l'avarie, la possibilité
qu'une panne intrinsèque dans un organe provoque par "capillarité"
l'arrêt total de fonctionnement d'un Commutateur E10B3 est en
réalité infime. Ce Commutateur est réputé
pour sa solidité "à toute épreuve"
ou presque, ce qui fait son succès depuis 1991...
Mais il demeure cependant une seule possibilité gravissime
de mettre très facilement en panne avec arrêt total ce
type de Commutateurs temporels : la surcharge grave d'appels téléphoniques
à traiter. En effet, dans le cas d'une catastrophe, ou au moment
des vœux de bonne année à minuit du 31 décembre
au 1er janvier, ou encore d'un jeu concours particulièrement
populaire par exemple, il pourrait se produire, si un bien trop grand
nombre d'abonnés décrochait chacun leur téléphone
au même moment, que la totalité des organes du commutateur
se retrouvassent tous saturés au même moment et dans
ce cas là, le système en entier se bloquerait et le
Commutateur tomberait totalement en panne immédiatement.
En effet, au contraire des anciens Commutateurs à organes tournants
et aux Commutateurs crossbar qui étaient bien trop lents, et
ainsi permettaient d'amortir un surplus de demandes à satisfaire,
un Commutateur électronique temporel est si réactif,
si rapide à établir la relation avec les abonnés
au décrochage des téléphones, qu'un tel amortissement
est impossible.
Pour éviter qu'une telle surcharge puisse se produire, il a
été mis en place une fonction de surveillance du trafic
instantané dans le Commutateur E10B3 toutes les 500 ms, aux
points stratégiques qui sont les plus soumis aux surcharges
en premier lieu : les Multienregistreurs (ML MR).
1) Dans le cas de surcharges exceptionnelles mineures (SCH1), chaque
Multienregistreur surchargé (ML MR) refuse les appels de départ
non urgents et ne provenant pas de lignes téléphoniques
prioritaires.
2) Dans le cas de surcharges exceptionnelles importantes (SCH2), chaque
Multienregistreur (ML MR) refuse les appels de départ et les
appels d'arrivée non urgents et ne provenant pas de lignes
téléphoniques prioritaires. (ce qui de ce fait renvoie
sa propre charge de travail vers un Multienregistreur qui n'est peut-être
pas surchargé)
3) Dans le cas de surcharges exceptionnelles graves (SCH3), tous les
nouveaux appels de départ ou d'arrivée sont indistinctement
rejetés, et ce sans même atteindre les Multienregistreurs
(ML MR). La Machine Logique (ML PUPE) traitant des protocoles de signalisation
entre Commutateurs stoppe toute tentative d'arrivée d'appel
entrant ou sortant du Commutateur en danger.
Lorsqu'un nouvel appel de départ est refusé par le Commutateur,
le Commutateur ne renvoie aucune tonalité, il n'aiguille pas
l'abonné demandeur vers un répondeur téléphonique.
L'abonné n'est que seulement connecté électriquement
à une ligne téléphonique muette alimentée
en 48 volts.
En revanche, toutes les conversations téléphoniques
en cours avant le début de la surcharge sont préservées
et maintenues jusqu'au raccrochage de l'un des deux correspondants.
Par cette méthode très astucieuse, un Commutateur E10B3
est à peu près certain d'être protégé
contre toute surcharge d'utilisation exagérée.
Les CSN 1G :
Concernant les équipement de raccordement d'abonnés
locaux, c'est à dire pour les équipements non délocalisés,
et situés dans le même local que le cœur de chaîne
: les équipements de raccordement d’abonnés retenus
sont des CSN1G (Centres Satellites Numériques de 1ère
génération) déjà mis au point depuis 1987
et employés avec le prédécesseur E10N1.
Leur fonctionnement est sécurisé, leurs connexions internes
étant dédoublées. Chaque CSN permet le raccordement
de 5.120 abonnés !
Les CSE et les URA 2G ne peuvent pas être connectés directement
à un cœur de chaîne E10B3, car ces technologies
sont plus anciennes, et le passage par une Station Multiprocesseur
de Terminaisons (SMT) est obligatoire pour assurer l'adaptation générationnelle
des normes. Les CSE et les URA2G sont alors traitées comme
s'il s'agissait d'Unités de Raccordement Distantes (Bien que
pouvant se situer dans la même pièce que le reste du
Commutateur.)
Les CSN HD :
À noter qu'à partir de 1996, une nouvelle technologie
de Centres Satellites Numériques à Haute Densité
(CSNHD) est mise service en surplus des CSN de 1ère génération.
(Présenté en réunions fin 1995). Cette technologie
remplit les mêmes fonctions mais sous un volume deux fois moindre,
d'où l'appellation CSN de Haute Densité.
Ces nouveaux CSNHD équipent en première monte les Commutateurs
E10B3 mis en service à partir de 1996, mais ces baies de CSNHD
sont notamment installées lors de déménagements
d'équipements vers d'autres sites. Elles permettent un gain
de place par réduction de l'encombrement, et qui dit réduction
d'encombrement implique réduction de coûts fixes récurrents.
 E10B3 baies ouvertes.
E10B3 baies ouvertes.
|
|
En 2023, 170 ans après le premier
télégraphe de Fontainebeau, et après
135 ans de téléphonie à Nemours et aussi
à Fontainebleau, l'arrêt du dernier centre
E10 rue de paroisse, est programmé fin 2023 pour faire
suite au "tout ip", l'internet.
C'est la Fin du téléphone
fixe.
3 minutes de visite du dernier autocommutateur
électronique de Fontainebleau.
(Le son est coupé, la climatisation de la salle fait
énormément de bruit).
|
183 Commutateurs E10B3 sont mis en service en France
dont 13 Commutateurs E10B3 équipés d'un Réseau
de Connexion asynchrone amélioré HC2,
dont 10 Commutateurs E10B3 déployés en Outre-Mer, qui
assurent à la fois leur rôle de Commutateurs d'Abonnés,
mais qui cumulent le rôle de Centre de Transit. Ils sont ainsi
chargés de renvoyer le trafic national éloigné,
ainsi que le trafic international vers la métropole.
Le système E10B3 très robuste et très stable,
pourvu de nouveaux organes de connexion et de commande, est capable
de gérer 200.000 abonnés par cœur de chaîne.
- Le système E10B3 est capable d'écouler, selon le constructeur,
jusqu'à 705.000 appels à l'heure, en pleine charge.
(en réalité la valeur typique de 518.400 est retenue
pour le dimensionnement).
- La mise en étude du système E10B3 débute dans
les laboratoires de la CIT-Alcatel en 1986 à Lannion. La validation
du système débute en Mars 1991 à Lannion, sur
un autocommutateur captif du CNET.
Pour la France, dans le réseau de France-Télécom,
le premier Commutateur E10B3 est mis en construction à la mi-1990,
puis il est mis en service à Brest le 6 novembre 1991 - 6H00
- (BREST EST 2). (Il s'agit du premier prototype)
- Concernant Paris, le premier Commutateur E10B3 est mis en service
au Centre Téléphonique Paris-Invalides le 13 janvier
1992 (INVALIDES 4 ET2 ) second E10B3 de France. (Il s'agit du second
prototype).
- La mise en service de INVALIDES 4 ET2 est initialement prévue
le 4 décembre 1991. Elle est reportée in extremis pour
mise à jour du programme enregistré.
- Le troisième et ultime prototype expérimental E10B3
sera mis en service lui aussi avec un peu de retard le 19 mars 1992
: Paris TURBIGO 5 ET2.
- Concernant l'Île-de-France, le premier Commutateur E10B3 est
mis en service à Magny-le-Hongre (MAGNY-LE-HONGRE A1) le 14
février 1992, qui dessert aussi le parc d'attraction Euro-Disney
Resort ouvert le 12 avril 1992. (Il s'agit du premier exemplaire de
série).
- Le Commutateur E10B3 Centrex AÉROPORT NORD 3 non géré
par France Télécom est mis en service le 4 juin 1997
à Roissy Charles De Gaulle. Il remplace le Commutateur E10N1
Centrex AÉROPORT NORD 2 de 1989.
- Concernant Paris, le Commutateur E10B3 le plus récent mis
en service le 8 décembre 1998 est NORD 7 ET2.
- Concernant l'Île-de-France, le Commutateur E10B3 le plus récent
mis en service le 2 mars 1999 estNEMOURS A3.
Le premier Commutateur E10B3 de France (et du monde) pourvu d'un Réseau
de Connexion ATM HC2 mis en service le 15 novembre 2000 est LE MANS
LYAUTEY 4.
- Les dernières mises en service en système E10B3 de
France ont lieu en province. Elles datent de 2002 (REIMS-CÉRÈS
3, le 24 septembre 2002).
- Le premier Commutateur E10B3 de France à être mis hors
service est NICE-CARRAS le 30 mars 2010.
- Le premier Commutateur E10B3 de Paris Intra-Muros à être
mis hors service est GOBELINS 3 ET1 le 14 novembre 2017.
En dehors d’Europe, le système E10B3 est connu
sous la dénomination OCB-283 (Organe de Commande type
B, version 2, calculateur Alcatel 8300 dupliqué).
E10B3/CTM est
un E10B3 utilisé en Centre de Transit National Mobile.
Avec l'arrivée du téléphone mobile de 2ème
génération (le GSM) en 1992, s'est très vite
posé le choix technologique de l'acheminement du transit téléphonique
des communications émises (et reçues) à partir
des téléphones mobiles.
Initialement, les premiers Commutateurs téléphoniques
pour abonnés mobiles où étaient rattachés
les premiers indicatifs de téléphonie mobile sont des
Commutateurs d'abonnés ordinaires, utilisés habituellement
en Commutateurs d'abonnés fixes.
Les premiers Commutateurs d'abonnés mobiles seront d'ailleurs,
en Île-de-France des MT25 d'abonnés fixes ainsi partagés
(où seront rattachés les premiers indicatifs AB.PQ mobiles
(France Télécom comme SFR). Concernant Lyon, ce sera
un AXE10 d'abonnés fixes qui sera utilisé (LYON BACHUT
AXE).
Et au tout début de la téléphonie mobile GSM
de 2ème génération, le trafic téléphonique
généré par les abonnés mobiles GSM était
donc acheminé par le même réseau téléphonique
de transit que celui des abonnés fixes, alors constitué
presqu'exclusivement de Commutateurs de transit national MT20, temporels
de 2ème génération. (Les derniers Commutateurs
de transit électromécaniques Crossbar étant en
cours d'arrêt.)
En environ 2 ans, s'est posée, avec l'explosion des abonnements
au téléphone mobile, la nécessité de repenser
le réseau téléphonique dans son entier.
Il a alors été décidé de créer
des Commutateurs d'Abonnés Mobiles, où ne seraient
désormais reliés uniquement les abonnés mobiles
et ainsi de faire cesser cette cohabitation des abonnés mobiles
au sein des commutateurs d'abonnés fixes (historiques).
Ces Commutateurs sont des Commutateurs pour Service Mobile - CSM
- connus sous leur acronyme britannique MSC.
Les tous premiers MSC furent des Commutateurs temporels de 2ème
génération MT20 à titre transitoire, très
rapidement remplacés par des MSC temporels de 3ème génération
E10B3 en quelques années seulement.
Ainsi, lors de la création du 3ème opérateur
de téléphonie mobile Bouygues Télécom,
tous les indicatifs AB.PQ de Bouygues GSMF3 ont été
créés dès 1995/96 directement sur des Commutateurs
de Service Mobile (MSC).
Une fois créés ces Commutateurs pour Service Mobile
(MSC), il a été créé un nouveau réseau
dédié de Commutateurs de Transit pour la téléphonie
mobile, où l'essentiel du trafic téléphonique
entre abonnés mobiles devait être désormais acheminé.
(Sachant qu'en cas de débordement, le trafic puisse être
écoulé en secours par le réseau de transit fixe,
au cas où...)
Un réseau de Commutateurs de Transit Mobile a été
créé en Commutateurs de transit de 3ème génération
et a compté jusqu'à 8 Commutateurs E10B3-CTM.
- Suivant leur configuration et le choix qui a été fait,
les E10B3-CTM ont assuré 3 types de fonctions différents
:
Centre de Transit téléphonique mobile "standard"
: E10B3/CT,
Centre de Transit des Messageries Vocales, pour acheminer les messages
enregistrés sur les boîtes vocales : E10B3/CTMV,
Centre de Transit acheminant aussi bien le transit téléphonique
mobile que les messages des boîtes vocales : E10B3/CT&CTMV.
- Le premier Commutateur E10B3-CTM a été mis en service
le 1er avril 1996 (Paris BEAUJON FTMRT/CT).
- Ces huit Commutateurs E10B3-CTM pour Transit Mobile ont été
créés avec un Réseau de Connexion classique.
- Deux de ces Commutateurs de Transit Mobile, spécialisés
uniquement dans le transit des Messages Vocaux enregistrés,
sont arrêtés assez rapidement dans les années
2003-2004 (BEAUJON FTMRT/CTMV et PHILIPPE-AUGUSTE FTMRT/CTMV ), ils
n'ont donc jamais fait l'objet d'évolution technologique en
matière de Réseau de Connexion.
- Quant aux 6 autres, ils ont été convertis en technologie
HC3 entre 2001 et 2003. (BEAUJON FTMRT/CT, BLANC MESNIL FTMRT/CT et
CACHAN FTMRT/CT&CTMV).
- Le tout premier Commutateur E10B3 avec Réseau de Connexion
converti en technologie HC3 dans le monde est LYON ÉCULLY FTMRT/CT
le 1er juillet 2001.
- Ce réseau a en outre été complété
par 2 Centres de Transit Mobile équipés en technologie
AXE10 de Ericsson, mis en service le 9 mai 2000 (TOULOUSE KENNEDY
FTMRT/MSCT ) et le 18 octobre 2001 (MARSEILLE FTMRT/MSCT). Ces deux
Commutateurs de Transit Mobile possèdent, cas particulier,
également la fonction Commutateur d'abonnés Service
Mobile (MSC) ; ce sont donc des MSCT.
- Ce réseau a assuré la majeure partie du transit du
trafic mobile durant de nombreuses années (20 ans), accompagnant
l'accroissement du nombre d'abonnés téléphoniques,
du nombre d'opérateurs et de la taille du trafic global à
traiter.
Au début des années 2010 s'est posée la question
du devenir de ce réseau téléphonique de transit
commuté mobile.
La décision a été prise d'arrêter ce réseau
de transit commuté et de basculer la totalité du trafic
téléphonique de transit de la téléphonie
mobile sur le protocole internet VoIP.
- Aussi, la totalité des 6 Commutateurs téléphoniques
de Transit Mobile restant a été mise hors service en
2015, avant le 31 décembre de cette année ; et la totalité
du trafic mobile de transit basculé sur des machines utilisant
le protocole VoIP Internet.
- Le premier Commutateur de Transit Mobile E10B3-CTM à être
mis hors service est POITIERS GRAND CERF FTMRT/CT le 21 septembre
2015,
- Les deux derniers Commutateurs de Transit Mobiles E10B3-CTM à
être mis hors service sont BEAUJON FTMRT/CT et BLANC MESNIL
FTMRT/CT le 7 décembre 2015 simultanément.
Concernant les 6 Commutateurs de Transit Mobile E10B3-CTM qui étaient
tous équipés, juste avant leur arrêt, de Réseau
de Connexion de type HC3 de 16.384 multiplex MIC 2Me.b/s de 30 voies
téléphoniques chacun, ou directement de MIC 8Me.b/s
de 120 voies chacun, voire d'accès SDH à fibres optiques
à 155 Me.b/s (SDH STM-1). (HC = Haute Capacité) : cinq
d'entre eux sont désormais mis à l'arrêt et vont
servir à entretenir le réseau de transit E10B3-CTN3G
fixe ; quant au sixième, BEAUJON FTMRT/CT, il a été
adapté pour rentrer dans le réseau de transit du téléphone
fixe à la date du 5 décembre 2018, réseau fixe
prévu pour durer jusqu'en 2030.
Depuis le 7 décembre 2015, ce réseau de transit
téléphonique commuté spécifique à
la téléphonie mobile en France n'existe plus. Il est
donc remplacé par des machines utilisant le protocole internet
VoIP.
E10B3/CTN3G est
un Commutateur E10B3 utilisé en Centre de Transit National
Fixe.
La décision de déployer des Commutateurs E10B3 utilisés
en centre de transit national fixe est prise en Décembre 1998
pour faire face à l'accroissement du trafic de transit téléphonique
dans certaines zones très denses, pour le trafic du téléphone
fixe.
- Le premier Commutateur de transit E10B3/CTN3G est mis en service
en France le 9 février 2000 à Lyon.
- Le Commutateur de transit E10B3/CTN3G le plus récent de France
est mis en service à Marseille le 24 octobre 2001.
- 7 Commutateurs E10B3/CTN3G sont mis en service en France entre le
9 février 2000 et le 24 octobre 2001.
Ils sont initialement pourvus de performances initiales améliorées,
par rapport à celles des Commutateurs E10B3 utilisés
en commutateurs d'abonnés : le raccordement sur Réseau
de Connexion temporel asynchrone (HC2) de 2048 multiplex numériques
MIC entrants de 30 voies téléphoniques chacun, et 2048
multiplex numériques MIC sortants.
- À partir de Novembre 2001, les Commutateurs de transit E10B3/CTN3G
sont équipés d'un nouveau Réseau de Connexion
le plus récent (HC3) à commutation temporelle asynchrone
(structure ATM) ce qui permet aux E10B3/CTN3G le raccordement de 16.384
multiplex numériques MIC 2Me.b/s de 30 voies téléphoniques
chacun, ou directement de MIC 8Me.b/s de 120 voies chacun, voire d'accès
SDH à fibres optiques à 155 Me.b/s (SDH STM-1). (HC
= Haute Capacité)
- À titre de comparaison, un Commutateur de transit CTN3G HC3
remplace à lui seul 8 Commutateurs MT20TN ; MT20TN qui sont
pourtant déjà des Commutateurs de grande capacité.
- 5 Commutateurs CTN3G sont convertis en technologie HC3, et 2 autres
sont livrés en technologie HC3 à l'état natif.
La conversion du parc en HC3 est effective en Février 2002.
- Un Commutateur de transit CTN3G est capable d'écouler, selon
le constructeur ALCATEL, jusqu'à 2,5 millions d'appels à
l'heure, en pleine charge.
- Un Commutateur de Transit E10B3/CTN3G occupe moins de place qu'un
Commutateur E10B3 d'abonnés, étant dépourvu des
nombreuses baies de type CSN où sont raccordés les abonnés.
En effet, le Commutateur de transit traite directement des liaisons
numériques MIC entrantes et sortantes. Sa puissance de calcul
et de commutation de conversations dans le temps n'en est pas moins
importante pour autant.
Ces 7 Commutateurs E10B3/CTN3G sont toujours en activité en
2022.
- La mise en service d'un 8ème Commutateur E10B3/CTN3G est
actée depuis le 4 octobre 2016. La mise en service est effective
depuis le 5 décembre 2018. Il s'agit de Paris BEAUJON CTN3G
- qui est une machine recyclée mise à l'origine en service
le 1er avril 1996 pour le Téléphone Mobile.
Les 8 Commutateurs E10B3/CTN3G assureront leur service jusqu'à
la fin du Vrai Téléphone, envisagée tout d'abord
en 2013, puis rapidement en 2018, puis repoussée en 2022, puis
encore repoussée en 2025 et 2028 et désormais repoussée
en 2030.
sommaire-
Le central téléphonique AXE
d' Ericsson est la plate-forme de commutation numérique
la plus utilisée au monde et est présente dans toute
l'Europe et dans la plupart des pays du monde. Il est également
très populaire dans les applications mobiles. Ce système
hautement modulaire a été développé en
Suède dans les années 1970 pour remplacer la gamme très
populaire de commutateurs électromécaniques crossbar
Ericsson ARF, ARM, ARK et ARE utilisés par de nombreux réseaux
européens à partir des années 1950.
|
20e anniversaire d'Ellemtel AB, la coentreprise
d'Ericsson et de Swedish Telecom.
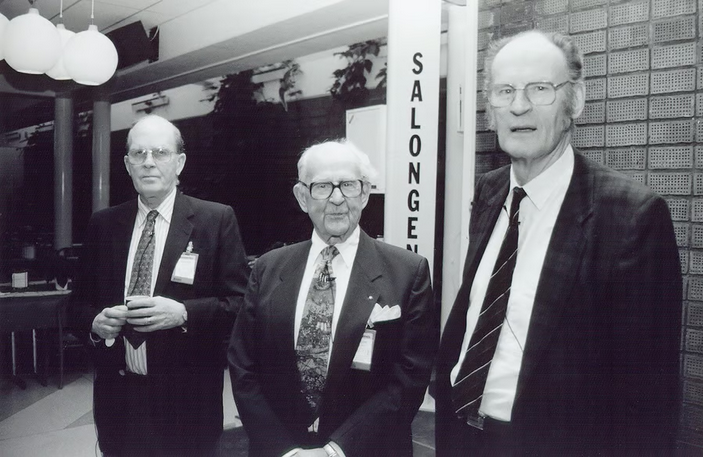
De gauche à droite : John Meurling, ingénieur
chez Ericsson et co-auteur de la Chronique Ericsson, Bertil
Bjurel, ancien directeur général de Swedish Telecom,
et Bengt Gunnar Magnusson, ingénieur et premier responsable
chez Ericsson du projet de développement AXE.
Le développement du système AXE fut la première
et la plus importante mission d'Ellemtel lorsqu'elle démarra
ses opérations en juillet 1970.
La tâche consistait à concevoir un commutateur
électronique qui répondrait aux objectifs quelque
peu différents des deux propriétaires. Pour Televerket,
les PTT suédois, obtenir un commutateur spécialement
conçu et adapté aux caractéristiques du
réseau téléphonique suédois était
une préoccupation majeure. Ericsson, en revanche, s'intéressait
principalement aux marchés d'exportation et souhaitait
donc un commutateur qui soit adapté au plus grand nombre
possible de systèmes téléphoniques internationaux.
La signification de la désignation AXE n'est pas tout
à fait claire, mais la plupart des sources s'accordent
à dire que le commutateur électronique expérimental
automatique est l'interprétation la plus probable. Le
chef de projet pour le développement de l'AXE était
Bengt-Gunnar Magnusson, qui avait été reconnu
comme le meilleur ingénieur de Suède. La première
tâche consistait à évaluer les propositions
précédentes d'Ericsson et de Televerket pour la
conception des commutateurs. Les plans d'Ericsson pour le développement
ultérieur de son commutateur AKE avaient été
présentés sous un jour moins favorable, après
que les PTT australiens eurent choisi pour une commande importante
un commutateur américain, plutôt que l'AKE.
Les trois organisations ont chacune produit des spécifications
sur la façon dont le nouveau système devrait fonctionner
en fonction de leurs points de vue différents. Ellemtel
a développé une proposition pour l'architecture
système du nouveau commutateur, tandis qu'Ericsson et
Televerket ont développé deux spécifications
d'exigences différentes pour les opérations que
le commutateur devrait être capable d'effectuer, son coût,
le nombre d'abonnés qu'il devrait gérer, etc.
Ce travail était en grande partie terminé en 1971,
et les trois parties ont entamé un dialogue qui a abouti
à un certain nombre de conclusions concernant les spécifications
d'exigences pour le nouveau commutateur.
En 1972, Ellemtel a développé une proposition
détaillée pour la conception du nouveau commutateur.
La proposition comprenait le développement d'un microprocesseur
dédié pour contrôler le commutateur, ce
qui allait conduire à un conflit féroce autour
du projet AXE. La raison était qu'Ericsson, en parallèle
avec le projet AXE, avait continué le développement
de son commutateur AKE.
Le coût supplémentaire de 100 millions de SEK dans
le projet AXE pour un projet dédié était
trop élevé pour permettre la poursuite du projet
AKE. Televerket a soutenu la proposition AXE d'Ellemtel et,
après de considérables troubles internes, la direction
d'Ericsson a décidé de ne pas poursuivre le projet
AKE et a plutôt décidé en mai 1972 de consacrer
toutes les ressources à AXE. Ce fut en pratique la percée
du projet AXE.
Après l'approbation formelle du projet AXE, il y a eu
une période de développement intensive au cours
de laquelle Ellemtel a produit le matériel et le logiciel
du système. D'un point de vue technique, l'AXE était
révolutionnaire à plusieurs égards, notamment
grâce à son architecture système modulaire
avancée, qui en faisait un système à plusieurs
dimensions. La conception du nouveau commutateur comprenait
également le développement du langage de programmation
Plex, un langage de haut niveau spécialement conçu
pour les systèmes téléphoniques. Il était
basé sur Eriplex, un langage de haut niveau précédemment
développé par Ericsson pour le commutateur AKE.
En 1974, Ellemtel a décidé de geler toutes les
modifications proposées du système AXE afin de
garantir que le premier prototype de station AXE soit prêt
pour le 100e anniversaire d'Ericsson en 1976. Le prototype a
été installé dans la station de Televerket
à Södertälje. Bien qu'Ericsson ait pu démontrer
la première station AXE rudimentaire à temps pour
la célébration de l'anniversaire, le commutateur
n'était pas complètement fonctionnel. Le véritable
démarrage des opérations a eu lieu au début
de 1977. À la fin des années 1970, des livraisons
supplémentaires d'AXE ont été effectuées
en Finlande, en France, en Suède, en Australie et en
Arabie saoudite. Bien que la conception de base du commutateur
ait été établie, plusieurs de ces commandes
ont entraîné des améliorations importantes
du système AXE.
Les coûts de développement du projet AXE s'élevaient
à environ 500 millions de couronnes suédoises,
dont la part d'Ericsson était d'environ les trois quarts.
Si les coûts de développement de l'AXE étaient
élevés, son importance pour Ericsson était
énorme. Selon l'ancien président et directeur
général Björn Svedberg, cela aurait été
une catastrophe pour Ericsson de ne pas avoir développé
le système AXE. Au lieu de cela, Ericsson est passé
au cours des années 1980 d'un fabricant électromécanique
traditionnel à un producteur d'électronique de
haute technologie.
Avec AXE, Ericsson disposait au début des années
1980 du système de commutation le plus avancé
et le plus flexible du marché, ce qui a permis à
l'entreprise de doubler sa part de marché et de faciliter
son entrée sur le marché américain. Le
résultat le plus important est peut-être que ce
système de commutation extrêmement flexible a fait
d'Ericsson un acteur majeur de la téléphonie mobile
dès le début. En 1992, Ericsson avait reçu
des commandes pour près de 400 stations de commutation
AXE pour la téléphonie mobile, ce qui correspond
à 40 % du marché mondial.
En termes de croissance technologique, AXE a
survécu à une série de changements remarquables.
Cela va du premier déploiement de commutateur en 1976,
qui contrôlait réellement les dispositifs à
relais, à l'introduction de la commutation numérique,
de l'ATM, et maintenant à une architecture de commutateur
logiciel. Dans ce dernier cas, AXE joue le rôle de serveur,
contrôlant les dispositifs de passerelle basés
sur diverses technologies, notamment le transport IP, et faisant
entrer l'architecture AXE dans le monde de la voix sur IP.
|
AXE10, système
Temporel de troisième génération, de la société
suédoise Ericsson.
Les Commutateurs AXE10 fabriqués en France le sont par la société
Matra Ericsson Telecommunications (MET) dans l'usine de Longuenesse
(62). En service dans presque tous les pays du monde, capable de gérer
jusqu'à 128.000 abonnés sur un seul cœur de chaîne
!
Il s'agit d'un système essentiellement centralisé (tout
en étant partiellement décentralisé). - Prononcer
: A. IXE. EU. DISS. -
En France, le système AXE10 est l'ultime système
téléphonique ayant été mis en service
dans le réseau téléphonique public avant la dissolution
de l'Administration des PTT survenue le 1er janvier 1991. Le principe
de son déploiement dans le réseau téléphonique
français a été retenu en 1987.
Au niveau de l’interface logicielle homme-machine,
le système AXE10 communique en langue française (Thomson
étant chargée de la francisation). En revanche, tout
comme son prédécesseur AXE spatial, les codes de commande
utilisés pour communiquer avec le système sont directement
basés sur la langue anglaise ce qui hélas n’est
pas mnémotechnique pour les locuteurs français.
- Au premier niveau, l'Organe de Commande (CP) est historiquement
constitué par deux calculateurs APZ212-10 aujourd'hui tous
remplacés par des APZ212-20 fonctionnant en service normal
en synchronisme, c'est-à-dire en exécutant les mêmes
tâches en même temps.
Ultérieurement, courant 1999, les baies
de mobilier de couleur bleue référencées BYB202
cessent d'être fabriquées par Ericsson. Ce mobilier est
alors remplacé par un nouveau mobilier plus miniaturisé
et moins cher à fabriquer car utilisant moins de métaux,
référencé BYB501.
Dans le même laps de temps, une version modernisée et
miniaturisée de calculateur APZ212-30 est conçue pour
"rentrer" dans ce nouveau type de mobilier. Il s'agit de
nouveaux calculateurs de modèle APZ212-30, quatre fois plus
puissants que le modèle précédent en termes de
puissance de calcul.
Ces nouveaux calculateurs APZ212-30 sont livrés avec les ultimes
Commutateurs AXE10 pour abonnés au réseau téléphonique
fixe mis en service en France et sont installés dans des baies
de mobilier technique de modèle BYB501.
Lorsqu'en Janvier 2000 la décision est prise de retirer rapidement
en moins de 3 ans et massivement les Commutateurs E10N1, ce seront
les derniers commutateurs AXE10 équipés de baies de
modèle BYB501 qui reprendront les abonnés des derniers
E10N1.
Certains Commutateurs AXE10, équipés de calculateurs
APZ212-20 à l'origine, verront leur calculateurs remplacés
ultérieurement en 2001 et 2002 par des calculateurs APZ212-30.
(au prix d'un changement de baies des calculateurs de BYB202 en BYB501.)
- Le second niveau comporte un ensemble de processeurs
régionaux (RP) (chargé d'accomplir certaines tâches
répétitives et d'accéder au Réseau de
Connexion), répartis dans les différents organes matériels
du commutateur interne.
- Au troisième niveau, le Réseau
de Connexion d'un Commutateur AXE10 est du type temporel mais est
formé de 3 étages : un étage d'entrée
temporel, un étage de sortie temporel, mais au milieu de ces
deux étages un étage spatial de technologie numérique,
utilisé afin de pouvoir assurer à moindre frais et à
moindres difficultés un brassage optimal entre les voies entrantes
et sortantes.
- Au quatrième niveau architectural,
nous avons les unités de raccordement d'abonnés d'un
commutateur AXE10 qui sont dénommées SSS pour Suscriber
Switching Stage. Chaque SSS peut héberger 2048 abonnés.
- Les cartes d'abonnés analogiques 8 voies sont regroupées
par 16 et constituent un module de commutation de lignes (LSM) pour
128 abonnés.
- Chaque LSM comprend donc 128 joncteurs d'abonnés, ainsi qu'une
unité d'essais chargée de tester les lignes et les joncteurs
d'abonnés.
De plus, concernant les LSM qui seraient raccordés à
des lignes analogiques à fort trafic, il existe une possibilité
technique (qui n'est pas exploitée en France) d’ajouter
des équipements supplémentaires afin de faciliter l'écoulement
du trafic téléphonique : 2 joncteurs spéciaux
éventuels directement raccordés au cœur de chaîne
en option peuvent être rajoutés couplés avec un
ensemble de 8 unités de réception de numérotation
à fréquences vocales supplémentaires.
- Ces LSM sont regroupés jusqu'au nombre maximum de 16 pour
former un commutateur numérique élémentaire de
2048 abonnés maximum. Suivant la capacité voulue du
commutateur, plusieurs LSM sont ensuite combinés entre eux
via un bus commun de commutation électronique temporelle.
Ce bus de commutation temporelle (TSB) permet à chaque LSM
d'accéder au cœur de chaîne et ce afin d'établir
les communications internes et externes au commutateur via le Réseau
de Connexion interne.
Dès son introduction en France, le système
AXE10 a fait l'objet d'adaptations exigées par l'Administration
des télécommunications pour être conforme aux
standards français en matière de normes et de caractéristiques
électriques, comme par exemple : l'envoi du courant alternatif
(et équilibré) de sonnerie à la fréquence
de 50Hz ; l'obligation de maintien de la réception de la numérotation
par impulsions (clavier décimal ou cadran téléphonique
administratif 1927) ; l'accroissement de la protection face aux surcharges
électriques externes causées par le couplage du réseau
électrique de distribution d'énergie ErDF ainsi qu'une
protection accrue contre les courts-circuits en ligne par la présence
de limiteurs de courant sur chaque voie d'abonné plus une présence
de résistances fusibles de sécurité protégeant
les étages supérieurs de toute propagation de dommages
et ce par la conception d'un modèle spécifique de cartes
de raccordement d'abonnés à 8 voies répondant
aux normes françaises connues pour être parmi les plus
sévères du monde.
Depuis l’introduction du système AXE10 en France, nous
sommes, en 2015, à la 4ème génération
de cartes analogiques.
À signaler que dans le réseau téléphonique
français, la possibilité de réaliser l'écoulement
direct du trafic entre les abonnés connectés dans le
même commutateur sans passer par le cœur de chaîne
(communications dites de voisinage direct) n’a pas été
retenue par l’Administration : en France toutes les communications
d'un Commutateur AXE10 passent obligatoirement par le cœur de
chaîne.

91 Commutateurs AXE10, utilisés uniquement
en commutateur d'abonnés en France, sont mis en service, l'utilisation
de l'AXE10 en centre de transit n'ayant pas été retenue
par l'administration.
- Le système AXE10 est capable de gérer jusqu'à
128.000 abonnés par cœur de chaîne.
- Le système AXE10 est capable d'écouler, selon le constructeur,
jusqu'à 800.000 appels à l'heure, en pleine charge.
(en réalité la valeur typique de 440.000 est retenue
pour le dimensionnement)
- Le prototype AXE10 commandé à Matra Ericsson Telecommunications
à la fin 1987, servant en outre à la mise au point aux
standards français est livré à l'Administration
des PTT le 30 janvier 1989, avec un seul mois de retard sur le planning
initialement prévu.
- Mis en test par le CNET à partir du 30 janvier 1989, puis
en fonctionnement "à vide" le 27 décembre
1989, ce Commutateur est ensuite mis en exploitation sur le réseau
public de l'État le 4 janvier 1990 - 8H00 - à Chaville,
en Île-de-France. CHAVILLE A4 ; (Capacité du prototype
32.000 abonnés)
- Le premier Commutateur de série AXE10 est mis en service
le 27 février 1991 à Cachan (Île-de-France) (CACHAN
2 AT1 ). Il est aussi le second Commutateur AXE10 de France. Suivront
notamment le 25 avril 1991 CLAMART 2 ET1 , le 28 mai 1991 LA COURNEUVE
2 ET1 (BB72), le 26 juin 1991 CHOISY-LE-ROI 2 AT1 ...
- Le premier Commutateur AXE10 de province est mis en service le 19
mars 1991 à Maisons Neuves - MAISONS NEUVES AXE (vers Lyon).
- Le premier Commutateur AXE10 de Paris intra-muros est mis en service
le 7 décembre 1993 (MÉNILMONTANT 2 AT1 ).
- Le Commutateur AXE10 le plus récent de Paris intra-muros
est mis en service le 29 octobre 1998 (VOLTAIRE 4 ET1).
- Le Commutateur AXE10 le plus récent d'Île-de-France
est mis en service à Sceaux le 24 novembre 1998 (ROBINSON 3
AT1).
- Le Commutateur AXE10 le plus récent de France équipé
de processeurs APZ212-20, en mobilier BYB202, est mis en service le
26 mai 1999 (MARSEILLE SAINTE-MARTHE AXE).
- Le premier des 10 Commutateurs AXE10 créé à
l'origine en mobilier BYB501 équipés de processeurs
APZ212-30 est mis en service le 15 juin 1999 (MULHOUSE EUROPE AXE
10)
- Le Commutateur AXE10 le plus récent de France est mis en
service à Niort le 21 novembre 2001 (NIORT CLOU BOUCHET 3).
- À noter que 20 Commutateurs créés à
l'origine en mobilier BYB202 et équipés de processeurs
APZ212-20 sont convertis en 2001 et 2002 en processeurs APZ212-30
au prix du changement du mobilier du cœur de chaîne en
mobilier BYB501. Ces modernisations sont rendues nécessaires
en cas de dépassement du seuil de 110.000 abonnés par
cœur de chaîne et/ou par le dépassement constaté
du seuil de 120.000 Tentatives d'Appel à l'Heure la plus Chargée
(après étude menée).
- Du fait de l'obsolescence des matériels initiaux de 1ère
génération BYB202 annoncée par Ericsson par la
cessation de fabrication des cartes adaptées aux dimensions
des baies BYB202, les dernières commandes d'extension de Commutateurs
équipés de processeurs APZ212-20, ou de conversion de
ces Commutateurs existants vers un nouveau cœur de chaîne
équipé de nouveaux processeurs APZ212-30 (nécessitant
tout de même certaines cartes d'adaptation livrables aux anciennes
dimensions du mobilier BYB202) doivent toutes être passées
avant la date limite du 30 septembre 2002.
- Le premier Commutateur AXE10 de France à être arrêté
le 18 novembre 2008 à Avignon-Le Pontet est LE PONTET FARGUES
AXE).
- Le premier Commutateur AXE10 de Paris intra-muros à être
arrêté le 31 mars 2009 est RASPAIL 5 AT1.
- Le premier Commutateur AXE10 d'Île-de-France à être
arrêté le 22 juin 2010 est ROBINSON 3 AT1.
(à ne pas confondre avec de système l'AXE Spatial mis
en service en fin d'année 1978 !)
AXE TRANSGATE 4 / CTI4G,
système Temporel présenté comme étant
de quatrième génération, utilisé en Centre
de Transit International de 4ème génération (NGN
- Next Generation Network). Il s'agit d'un système essentiellement
centralisé (tout en étant partiellement décentralisé).
Pour rappel, en France, les 3 premières
générations de Centres Internationaux automatiques furent
:
- 1ère génération : les 20 Commutateurs Électromécaniques
de type CROSSBAR PENTACONTA CIA, CLI et CLIV (dont CADET, CINAT, CATON...)
et 18 CROSSBAR CP400 CIA, CLI et CLIV
- 2ème génération : les 2 Commutateurs Semi-Électroniques
de type MÉTACONTA 11A (Paris & Reims)
- 3ème génération : les 17 commutateurs Électroniques
Temporels de type MT20CIA (13 pour la métropole, 4 pour les
D.O.M)
Ce commutateur a été présenté comme étant
de 4ème génération, car il est certes la 4ème
génération de Commutateurs internationaux. Mais à
titre général, l'AXE TRANSGATE 4 est bien un Commutateur
temporel de 3ème génération.
L' AXE TRANSGATE 4 est très similaire à
un Commutateur AXE10 temporel de 3ème génération.
Aussi, est-il classé dans la rubrique des Commutateurs électroniques
de 3ème génération.
En revanche, le système AXE TRANSGATE 4 est de dimension plus
compacte qu'un AXE10 classique, à puissance de traitement équivalente,
étant de conception sensiblement plus récente. En effet,
à partir de 1999, le mobilier AXE10 de 1er modèle (BYB202)
cesse d'être fabriqué par Ericsson (baies bleues). Il
est remplacé par du mobilier plus compact de référence
BYB501.
La structure de base d'un Commutateur AXE TRANSGATE
4 est en fait calquée sur le Commutateur AXE10, mais il est
spécialisé transit : il est donc dépourvu de
baies de cartes de raccordements d'abonnés. En lieu et place,
il permet le raccordement jusqu'à 4096 liaisons numériques
MIC à 2048 Kbit/s. (soit une capacité maximale de 122.880
voies de conversations en transit à pleine charge)
Modernisation oblige, un Commutateur AXE TRANSGATE
4 accepte aussi de brasser directement des entrées de jonctions
de fibres optiques ; chaque fibre optique remplaçant 63 liaisons
MIC numériques métalliques.
Au niveau de l’interface logicielle homme-machine,
le système AXE TRANSGATE 4 communique en langue française
(Thomson étant chargée de la francisation). En revanche,
tout comme son prédécesseur AXE Spatial, les codes de
commande utilisés pour communiquer avec le système sont
directement basés sur la langue anglaise ce qui hélas
n’est pas mnémotechnique pour les locuteurs français.
Tout comme dans le système AXE10, le système
de commande possède une structure à deux niveaux de
traitement logiciel. Le premier niveau est équipé de
deux processeurs centraux : le cœur de chaîne qui est constitué
par deux calculateurs APZ212-50 fonctionne en service normal en synchronisme,
c'est-à-dire en exécutant les mêmes tâches
en même temps par redondance, pour raison de sécurité.
Le second niveau comporte un ensemble de processeurs régionaux,
répartis dans les différents organes matériels
du Commutateur interne chargés notamment d'accéder au
Réseau de Connexion.
Le Réseau de Connexion d'un Commutateur AXE
TRANSGATE 4 est du type temporel mais est formé de 3 étages
: un étage d'entrée temporel, un étage de sortie
temporel, mais au milieu de ces deux étages un étage
spatial de technologie numérique, utilisé afin de pouvoir
assurer à moindre frais et à moindres difficultés
un brassage optimal entre les voies entrantes et sortantes.
Objectifs de l'implantation de CTI/4G :
Avec la fin du monopole téléphonique en France et
l'arrivée des opérateurs tiers (nationaux et internationaux,
des nouveaux systèmes de call-back), il est alors nécessaire
à partir de 1998 de réagir en réduisant substantiellement
le coût moyen de la minute téléphonique internationale,
afin pour l'opérateur France Télécom de préserver
sa marge, tout réduisant les prix facturés aux abonnés.
Avec l'implantation de 3 "Super Commutateurs" de transit
téléphonique de 4ème génération
à la place des 17 Commutateurs Internationaux de 3ème
génération, ceci entraîne une cascade d'effets
vertueux, tant financiers que techniques (mais moins au niveau de
l'emploi) :
Baisse du coût d'exploitation de la consommation
électrique globale du réseau de commutation, par la
réduction du nombre de commutateurs internationaux par 5,
Baisse des coûts de maintenance des Commutateurs, car moins
de Commutateurs à entretenir, et désormais plus récents
et encore plus fiabilisés,
Réduction des effectifs nécessaires à l'exploitation
et à la maintenance, donc réduction des coûts...
Simplification drastique de l'organisation du réseau, par l'élimination
de 2 niveaux hiérarchiques internationaux. En effet, la hiérarchie
de 3ème génération, était constituée
de 3 niveaux de Commutateurs MT20CIA car l'on ne savait pas faire
techniquement plus simple dans les années 1980. Avec les nouveaux
Commutateurs CTI4G, il n'existe désormais plus qu'un seul niveau
de Commutateurs internationaux.
De ce fait, les transmissions reliant les Commutateurs de Transit
National aux Commutateurs de Transit International se retrouvent simplifiées,
car il y a beaucoup moins de renvois d'un Commutateur international
à un autre (Le parcours d'une communication est plus direct,
"il ne tourne plus en rond").
Désormais, dès qu'une communication émanant du
Réseau Téléphonique Commuté National atteint
un des 3 Commutateurs de Transit International de 4ème génération,
celle-ci est immédiatement aiguillée vers son pays de
destination.
En général les communications internationales au départ
vers l'étranger parviennent d'un Commutateur de Transit National,
Mais les Commutateurs d'abonnés coutumiers d'un trafic téléphonique
international élevés sont directement reliés
à un ou plusieurs Commutateurs Internationaux CTI / 4G, ce
qui simplifie encore plus le parcours des communications, et réduit
encore plus les coûts globaux...
L'acheminement d'une communication, en plus d'en être simplifié,
en est de surcroît techniquement fiabilisé, ce qui permet
par ricochet de diminuer en conséquence les effectifs affectés
à la construction et à la maintenance des Transmissions
Numériques.
..
La libéralisation des télécommunications
tant nationales qu'internationales a de facto précipité
la fin des Commutateurs MT20 affectés au transit international,
qui, sinon, auraient aisément pu techniquement fonctionner
jusqu'en 2015-2020.
- Le 14 mai 1997, le Comité de Pilotage FTRSI
décide de mettre en construction puis en service 2 Commutateurs
de Transits Internationaux de 4ème Génération.
Un sera installé à Paris-Pastourelle et un second à
Marseille International.
- L'appel d'offres destiné à remplacer les Commutateurs
MT20 CIA de la précédente génération est
gagné par Matra Ericsson Telecommunications en 1998 (au détriment
d'Alcatel).
- Mis en construction d'abord à Paris-Pastourelle, le premier
Commutateur AXE TRANSGATE 4/CTI4G, PASTOURELLE 5 CTIP, est mis en
service le 13 septembre 1999.
- Les premières relations ouvertes à l'international
en système CTI4G sont l'Allemagne et la Suisse.
- Suivent dans la foulée les Centres Internationaux Automatiques
AXE TRANSGATE 4/CTI 4G REIMS-MURIGNY CITP4 le 6 Juillet 2000, puis
BAGNOLET 6 CTIP le 16 Juillet 2001.
- La mise en service projetée dès 1995, initialement
prévue pour Juin 1999, du Commutateur AXE TRANSGATE 4/CTI4G
de MARSEILLE 2 a finalement été annulée. En effet,
ce Commutateur a bel et bien existé, ayant fonctionné
à titre expérimental, mais a finalement été
démonté de Marseille puis remonté à Reims.
- Depuis 2008, ces 3 Commutateurs sont adaptés pour traiter,
en plus de la voix commutée (norme RTC), l'écoulement
du trafic Voix par le Protocole Internet (norme VoIP).
- 3 Commutateurs AXE TRANSGATE 4/CTI4G sont installés en France
et ont donc repris depuis le 9 décembre 2002 à 10H30,
tout le trafic téléphonique commuté entrant et
sortant du territoire métropolitain depuis l'arrêt total
des Commutateurs MT20CIA métropolitains à cette date
; ainsi que tout le trafic téléphonique international
commuté des DOM depuis l'arrêt total des Commutateurs
MT20CIA ultramarins le 20 mai 2003.
- Le premier Commutateur International Automatique AXE TRANSGATE 4/CTI4G
de France à être arrêté le 4 décembre
2018 à Reims, est REIMS-MURIGNY CITP4).
- Le second Commutateur International Automatique AXE TRANSGATE 4/CTI4G
de France à être arrêté le 1er mars 2022
à Paris, est PASTOURELLE 5 CTIP ).
- Le troisième et dernier Commutateur International Automatique
AXE TRANSGATE 4/CTI4G de France à être arrêté
le 3 mars 2022 à Paris, est BAGNOLET 6 CTIP ).

La page de Commutation Automatique Internationale au départ
de la France par autocommutateurs en technologie RTC, a pris fin le
3 mars 2022 et clôt cette page technologique débutée
le 24 novembre 1964 par la mise en service de PASTOURELLE 1 CIA 1
DÉPART - CADET (RT54).
Les communications téléphoniques internationales
sont désormais assurées par des machines informatiques
selon les technologies ALL-IP/VOIP.
sommaire
IV - Les systèmes électroniques de
type temporel de 4 ième génération déployés
en France sont les suivants :
Le Commutateur d’origine suédoise AXE
TRANSGATE 4, utilisé en France pour le trafic international,
bien que présenté « commercialement » comme
étant de 4ème génération ne peut pas être
réellement assimilé à un Commutateur de 4ème
génération.
En revanche, nous nous devons de préciser que le Commutateur
Électronique Temporel de 4ème génération
a bel et bien existé, sous forme de maquette. Il avait été
mis au point par Alcatel, dans l’année 2001 : il s’agit
du E10B3-HC4.
E10B3-HC4
Le Commutateur Électronique
Temporel de 4ème génération a bel et bien existé,
sous forme de maquette. Il avait été
mis au point par Alcatel, dans l’année 2001 : il s’agit
du E10B3-HC4.
Le Commutateur E10B3 de 4ème génération,
même s’il est toujours basé sur les Commutateurs
E10B3 de la génération antérieure, est équipé
d’un nouveau Réseau de ConneXion asynchrone de type HC4.
OCB283-MGC.
-Le Réseau de ConneXion HC4 est d’une
part encore plus puissant et miniaturisé que les Réseaux
de ConneXion antérieurs (RCX synchrone et HC2 et HC3 asynchrones)
et permet de créer des Commutateurs encore plus compacts et
puissants que les prédécesseurs,
-D’autre part, en plus de ce nouveau Réseau de ConneXion
HC4, les Commutateurs E10B3-HC4 intègrent directement dans
leur fonctionnement le système d’exploitation UNIX et
toute une batterie de protocoles IP Internet.
Donc il est tout de même nécessaire
de rappeler qu’Alcatel a bel et bien conçu de véritables
Commutateurs téléphoniques de 4ème génération,
qui, en plus de commuter temporellement les conversations téléphoniques
selon la norme RTC chez les abonnés comme cela se fait depuis
le 19 octobre 1913, a été capable de délivrer
directement, et sans intermédiaire, et sans équipements
supplémentaires dans les Centres Téléphoniques,
les protocoles IP haut débit de type ADSL directement chez
les abonnés.
- Et non, alors qu'existe LE commutateur de 4ème
génération capable de commuter simultanément
le téléphone classique et distribuer, sans équipements
intermédiaires supplémentaires, l’internet à
haut débit, ce modèle de Commutateur n’a pas été
déployé dans le réseau public en France.
- En France, il a été préféré,
avec le Plan TOP CAPEX révélé le 15 avril 2003,
de stopper toutes les commandes d'autocommutateurs, c'est à
dire de ne pas remplacer les Commutateurs électroniques temporels
de 2ème génération par des Commutateurs de 4ème
génération, mais d'attendre...
- De ce fait, Alcatel, qui avait pourtant inventé le Commutateur
du futur depuis 2001, et vu que cette nouvelle évolution n’a
pas été retenue en France à temps, a cessé
le développement, la conception, la fabrication et la commercialisation
de ce Commutateur de 4ème génération «
mort-né », ainsi que, dans la foulée, la fabrication
et la commercialisation de nouveaux Commutateurs E10B3 de 3ème
génération.
- De plus, depuis environ 2010, certaines pièces de rechange
des Commutateurs électroniques E10B3 de 3ème génération
ne sont plus fabriquées, comme le souligne la presse nationale
qui, sur ce point, semble dans le vrai.
sommaire
La situation du Réseau Téléphonique
Commuté, qui est subitement révélée au
grand public par la presse nationale depuis Février 2016 ne
semble pas le fruit du hasard : en cessant de remplacer à temps
les Commutateurs téléphoniques d’anciennes générations
par des Commutateurs nouvellement conçus, la fabrication des
Commutateurs téléphoniques par les industriels a cessé
vers 2006.
Le support technique jusqu'alors fourni par les industriels
qui fabriquaient ces Commutateurs cesse définitivement en 2008,
ne possédant même plus en leur sein la connaissance et
les compétences requises (les départs massifs en retraite,
pré-retraite et autres plans sociaux à répétition
ayant dissous leur propre filière). Depuis lors, ce sont les
équipes de commutants de France-Télécom Orange
qui, en complète autonomie, on maintenu avec succès
le Réseau Téléphonique Commuté de France.
Or, la France, comptait fin 2015 13 millions de
lignes téléphoniques détenues par des clients
qui souhaitent conserver une véritable ligne téléphonique
au fonctionnement le plus fiable possible qui ait été
conçu depuis l'invention de la téléphonie en
1876, et qui ne dépende pas de la présence, ou non,
de tension électrique EDF 230 volts dans leurs domiciles ou
locaux…
Que nous puissions lire (février 2016) dans
la presse nationale que le Réseau Téléphonique
Commuté daterait des années 1970 est de surcroît
complètement faux. À cela, il convient de rappeler qu'alors
qu'en 1970 le réseau de transmissions des télécommunications
intercentres associé au réseau téléphonique
commuté était presqu'exclusivement analogique en liaisons
par courants Basse Fréquence et/ou en multiplex analogique
(par ondes porteuses), le réseau de transmissions des télécommunications
est depuis 1995 intégralement en technologie numérique
multiplexée...
Il ne reste que quelques Commutateurs
électroniques temporels de 2ème génération,
mis en service entre 1984 et 1989 ; la grande majorité en exploitation,
de 3ème génération, ayant été mise
en fonctionnement entre 1990 et 2002, ce qui n’est pas non plus
un âge canonique pour des machines de haute qualité conçues
et fabriquées en France.
Si les Commutateurs électroniques temporels
de 4ème génération étaient enfin déployés,
il serait tout à fait possible de pouvoir continuer à
commercialiser pour ceux qui le souhaitent, de véritables lignes
téléphoniques fiables en technologie RTC, tout en permettant
de distribuer directement par ces mêmes commutateurs l’internet
à haut-débit via un réseau de cuivre qui a démontré
ses preuves à l'épreuve du temps, des catastrophes,
voire des guerres…
Ce choix n’a pas été retenu
il y a plus de 20 ans, et curieusement, voici que le Réseau
Téléphonique Commuté se retrouve depuis Février
2016 montré du doigt de manière assez « orientée
» dans une presse nationale qui en plus ne semble pas s’être
suffisamment documentée sur un sujet dont elle traite de manière
réductrice, alors qu’il est de première importance
et qu’il est l’apanage des seuls grands opérateurs
téléphoniques dans le monde.
2023 Avec la fin annoncée des lignes RTC, le nombre de lignes
téléphoniques classiques (analogiques/numériques)
poursuit sa chute, avec en moyenne 1 million d’abonnements en
moins par an.
Les revenus de la téléphonie fixe continuent pour leur
part de décroître et devraient atteindre 1,4 milliard
EUR en 2023 (contre 1,7 milliard EUR en 2022). La part de la téléphonie
fixe dans les revenus de détail des services de télécommunications
devrait atteindre 4,3 % à fin 2023.
Fin 2024 il reste encore 3,855 millions de téléphone
fixe sur le réseau cuivre (RTC)
Place au tout IP, c'est la fin
du RTC Réseau Télécommunications Commuté
et de la boucle locale.
sommaire