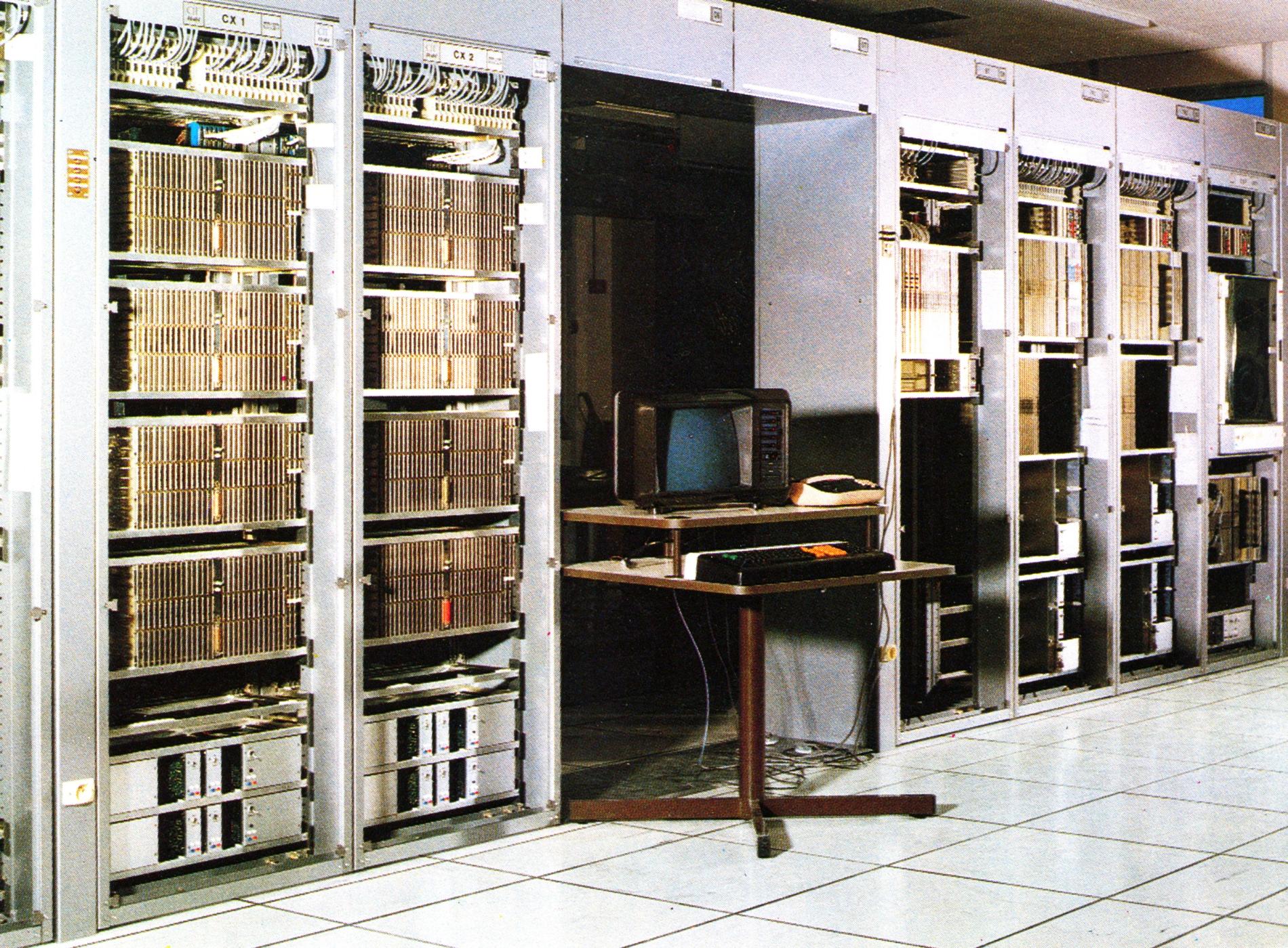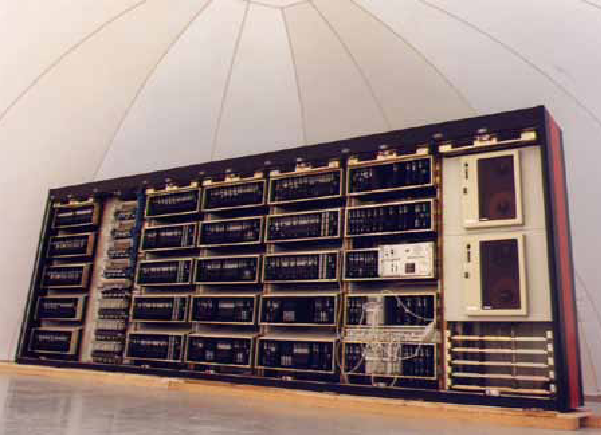sommaire
Parallélement, aux Etats Unis
1942 Dans les laboratoires Bell,
l'une des expériences de recherche d'avant-guerre a été
d'effectuer la commande électronique par "tube à
gaz" des selecteurs de cadres Crossbar.
Premier modèle 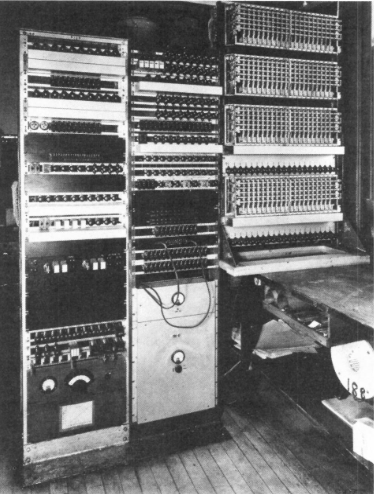 Modèle 2
Modèle 2 
Après la Seconde Guerre mondiale, cet effort
a été relancé en vue d'équiper un
petit bureau crossbar qui serait plus fiable que le système
précedent. Le développement a été réalisé
au sein du bureau d'études sous la supervision de F. A. Korn
de l'organisation de développement.
La conception du système a commencé en 1946. Le plan
du système était très similaire au précedent.
Le développement final a été abandonné
car ce système ne pouvait pas concurrencer économiquement
les centraux Strowger,Panel,Crossbar.
Dès 1942, des études ont été faites
sur la commutation temporelle, mais les systèmes utilisant
cette technique se sont avérés limités. En conséquence,
la plupart des efforts d'après-guerre se sont portés
sur la "commutation spatiale",
Sous la direction de W. D. Lewis, l'équipe de E. B. Ferrell,
W. A. Malthaner, C. A. Lovell, M. Karnaugh, W. A. MacNair, H. E. Vaughan,
J. D. Johannesen, D. B. James, J. R. Runyon, E. Bruce, N. D. Newby
et bien d'autres ont établi de nouvelles des idées et
des dispositifs de commutation, et a suscité l'intérêt
pour la commutation électronique non seulement dans les laboratoires
Bell, mais aussi dans le monde entier.
En 1945, Vaughan entreprit des travaux de recherche
sur un système expérimental de commutation automatique
à commande électronique appelé "ECASS",
un système à grande vitesse utilisant des tubes à
gaz à cathode froide, des interrupteurs à lames
et un poste téléphonique spécial.
Ce projet a été suivi quelques années plus tard
par des travaux sur un autre système de commutation expérimental
- Drum Information Assembler and Dispatcher - "DIAD".
techniques de balayage dans la commutation.
En 1949, de nombreux modèles avec ces concepts existaient
et stimulaient la réflexion de nombreux ingénieurs sur
les systèmes de commutation électroniques en général.
Un système de séparation temporelle à 100 lignes,
comme que l'on appelait alors division temporelle, a été
construit en 1950, et un système de division de fréquence
a été étudié. Des circuits de verrouillage
à transistors et, éventuellement, des points de croisement
ont été réalisés, des expériences
de réseau on été menées en 1951. Le stockage
sur (disque) "tambour magnétique" a été
utilisé dans le système DIAD en 1954 . Un système
de traducteur (sur disque magnétique) a été envisagé,
à la place d'un traducteur à carte perforées,
mais il n'a pas été jusqu'en production ...
En 1951, C. E. Brooks et son groupe d'ingénieurs système
à la "Bell Laboratories West Street" à New
York a commencé à définir les exigences d'un
bureau central électronique. Les anciens centraux téléphoniques
avaient besoin de remplacants plus modernes, et l'électronique
semblait offrir une opportunité économique et d'espace
importante. C'était une époque qui avait vu l'invention
du transistor et l'introduction de l'ordinateur électronique
à programme enregistré. De plus, les évolutions
technologiques très rapides commençaient tout juste
à rendre disponibles de nouveaux composants à haut débit
destinés à la commutation téléphonique.
Des centraux ou des sous-systèmes fonctionnels ont été
conçus, construits et testés par les ingénieurs
de Bell Labs dans le cadre de la recherche sur la commutation à
Murray Hill, New Jersey et du développement de la commutation
à West Street. Ces efforts ont été mis en parallèle
et soutenus par des innovations par les organisations de recherche
physique et de développement d'appareils électroniques
de Murray Hill. La conception d'ECASS et de DIAD a servi
de base à l'étude, mais l'innovation continue et l'évolution
des technologies orientaient déjà les choix pour les
appareils et les méthodes de fonctionnement du système
...
La décision est prise au milieu
des années 1950, de développer le système de
commutation électronique ESS. L'idée d'introduire
l'électronique en commutation n'est pas nouvelle et plusieurs
maquettes ont été réalisées aux Laboratoires
Bell depuis les années 1940.
En 1952, Vaughan devenu superviseur au département
de recherche sur la commutation, où il a mené des études
sur les utilisations des mémoires à transistors, ferroélectriques
et magnétiques à utiliser dans les systèmes logiques.
En 1955, il est nommé chef du département de
recherche sur la commutation. Ses travaux antérieurs sur ECASS,
DIAD et d'autres systèmes de commutation expérimentaux
ont ouvert la voie à des travaux importants sur un centre à
semi-conducteurs expérimental (ESSEX), qui a débuté
en 1955.
En septembre 1955, Lovell et Ketchledge décidèrent
de passer au contrôle par programmes enregistrés, Ces
unités appelées ESSEX pour un "Centre expérimental
à semi-conducteurs " simulent une partie du système
construit pour l'étude exploratoire des possibilités
d'intégration de la transmission et de la commutation à
l'aide de techniques PCM (modulation par impulsions et codage).
A cette date la conversion PCM est effectuée dans des "concentrateurs"
spéciaux proches d'un certain nombre de clients. Il
faut côté central, installer l'autre concentrateur pour
démoduler les conversations. Ce n'est pas encore satisfaisant
et viable. En raison des progrès limités de l'électronique
à l'époque (basés sur l'utilisation de tubes
à vide).
En 1957, la situation est nouvelle : le programme de construction
d'un commutateur entièrement électronique de type spatial
entre dans sa phase industrielle.
Deux conceptions techniques vont émerger de l'électronisation
des commutateurs : le spatial et le temporel. Schématiquement,
on peut distinguer deux opérations essentielles : la commande
et l'exécution de l'aiguillage des communications. Les deux
techniques ont recours pour la commande à des calculateurs
de type universels (avec de nombreuses variantes). En revanche, l'aiguillage
(réalisé par un réseau de connexion) est radicalement
différent : en spatial, le signal entrant par un circuit est
aiguillé vers un autre (sortie) par un réseau physique
dont le point de croisement est activé par un composant (diode
à gaz, relais, diode pnpn...). Dans la seconde, il n'y plus
de notion de circuit; une communication (une série de paquets
de bits) est aiguillée vers une sortie par des moyens purement
logiques (répartition temporelle).
La commutation des circuits téléphoniques doit se faire
à l'aide d'un composant spécifique, une diode à
gaz. Les américains mettent l'accent sur le cœur du système,
un calculateur de type universel - programmable - qui commande l'ensemble
des opérations effectuées par un central téléphonique.
Ces ingénieurs semblent surtout préoccupés par
les difficultés rencontrées dans la mise au point et
la fiabilité de certains éléments, notamment
les mémoires vives et permanentes. Les développeurs
américains soulignent leur visée : leur système
doit permettre d'intégrer aisément des améliorations
- sans de lourdes et coûteuses interventions matérielles
- par exemple offrir des fonctionnalités nouvelles, telles
la possibilité de numéros abrégés, le
transfert d'appels, des services du type lignes groupées, etc.,
une exigence qui répond, pensent-ils, à une forte attente
des abonnés américains, déjà très
nombreux et plus rompus à l'usage du téléphone
que les abonnés des autres pays (Europe, Japon).
En 1957-1958 Un modèle de laboratoire a été
assemblé et les premiers programmes de commutation téléphonique
ont été écrits et construit au Whippany, New
Jersey Laboratory. À ce moment-là, Morris,
dans l'Illinois, avait été sélectionné
pour le site d'essai sur le terrain, le système modèle
est devenu connu sous le nom de «pré-Morris».
Le réseau de commutation et le réseau concentrateur
associé fournissent les chemins fréquentiels voix permettant
d'interconnecter les lignes téléphoniques entre elles
et avec les jonctions et les signaux divers (sonnerie, tonalité,
etc.). L'élément de commutation est un tube à
gaz à cathode froide (photo ci dessous)
Il s'agit d'une diode remplie de néon utilisant une cathode
creuse pour obtenir une résistance négative. à
l'état conducteur. Cela tend à compenser les pertes
de transmission des transformateurs et d'autres éléments
dans le chemin de conversation. Ces tubes à gaz sont disposés
dans des racks.
L'application de la moitié de la tension de claquage sur un
fil d'entrée et un fil de sortie provoque l'allumage du tube
à gaz reliant ces fils et connecte les fils pour la transmission
de la parole. Un seul côté du circuit de transmission
est commuté, l'autre côté étant mis à
la terre. Un grand nombre de ces commutateurs sont connectés
ensemble pour former le réseau complet. Une connexion typique
se ferait par un tube dans un commutateur concentrateur, puis par
six tubes dans le réseau de commutation, et enfin par un tube
dans un commutateur concentrateur vers l'autre téléphone.
Les points de croisement des tubes gaz et les circuits de commande
sont assemblés dans des boîtiers enfichables qui sont
ensuite insérés dans l'armoire. Cela permet une maintenance
et une croissance faciles.
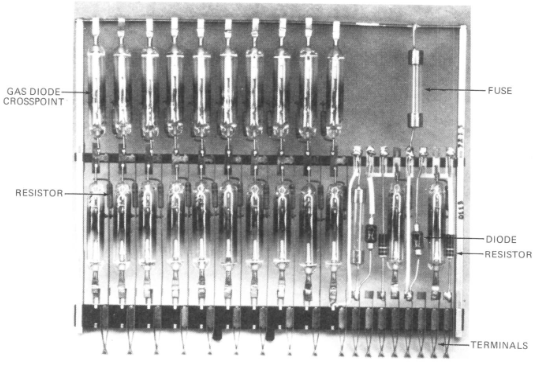 Rack
Rack 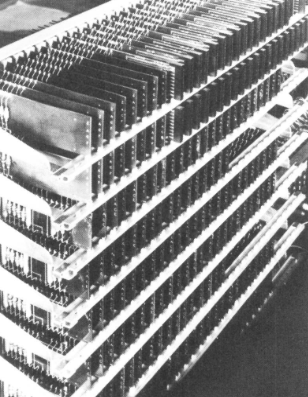
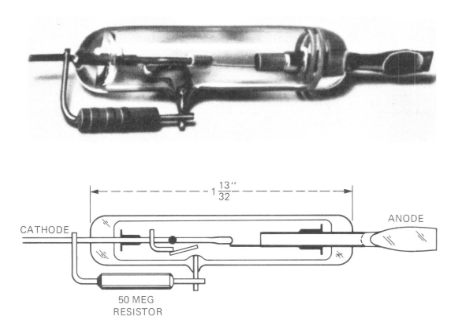
Circuits et connecteurs enfichables utilisés dans le système
de commutation électronique du modèle de laboratoire
du milieu des années 1950.
AT&T a créé des composants spécialement
conçus pour être utilisés dans ce type de système.
Voir le Brevet US2743316A
de 1953
1958 Le premier appel téléphonique a été
passé via ce système en mars. Les centres pré-Morris
et plus tard Morris utilisaient un système de commutation piloté
par des "tubes à gaz" . Grâce à
l'utilisation de la modulation par impulsions et codage (PCM), les
signaux sont convertis en impulsions numériques codées.
Ces impulsions sont transportées à grande vitesse vers
leurs destinations sur quelques lignes seulement et sont ensuite reconverties
en signaux standard pour la livraison.
Jugeant leur expérience solide,
estimant le développement de leur prototype suffisamment avancé,
évaluant leur avance technologique suffisante, les responsables
du projet ESS (Laboratoires Bell et Western Electric) décident
de réunir un symposium international privé du
4-6 mars 1957. Ils invitent les ingénieurs et chercheurs
de tous les exploitants ou fabricants de matériels avec lesquels
la Western Electric a des accords de brevets afin de leur présenter
en détails leur prototype, leurs choix techniques et technologiques,
dont trois ingénieurs français étaient présent.
Début 1959 les américains assistent à
la mise en service du central électronique à Morris
(Illinois)
Morris
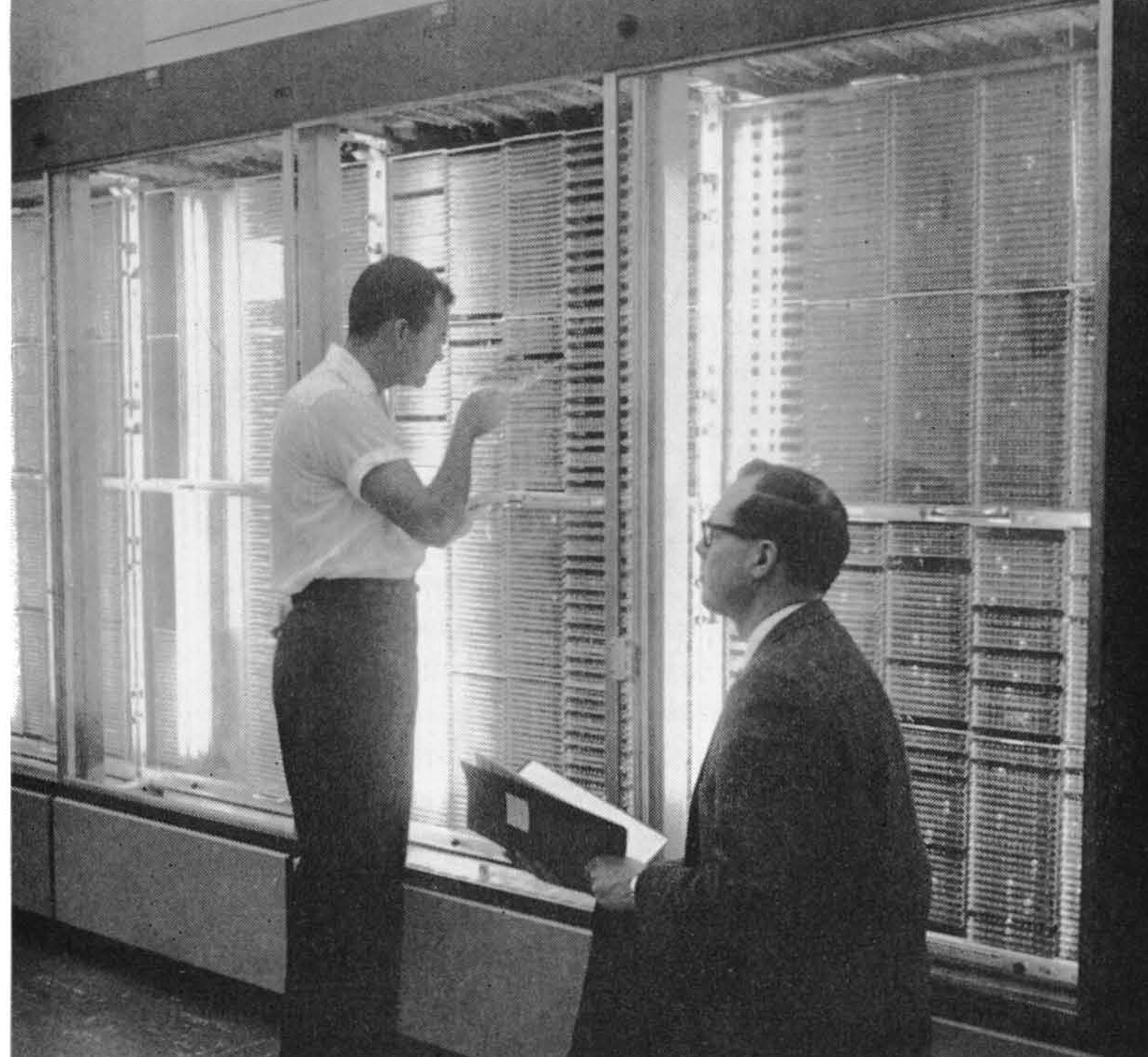
A droite, le réseaux de concentration et de distribution du
système Morris. Les lampes fluorescentes excitaient suffisamment
d'électrons libres pour que les tubes à gaz fonctionnent.
D.T. Osmonson vérifiant le fonctionnement d'un module de tube
à gaz dans le réseau de diodes du réseau.)
Le Poste téléphonique utilisé dans le procès
Morris. 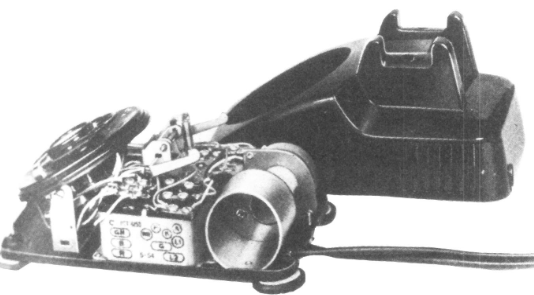
Le téléphone utilisait deux transistors dans un amplificateur
accordé pour détecter une fréquence de sonnerie
particulière et amplifier le signal pour piloter la sonnerie
miniature. Le circuit à transistor fourni une amplification
pour la sonnerie et la parole.
Un document complet et très détaillé est accéssible
à cette
adresse (cliquez sur le lien).
Entre 1960 et 1962 AT&T
a mené des essais sur le terrain d'un nouveau système
de commutation électronique qui utilisait une variété
de dispositifs et de concepts. La première version commerciale,
mise en service en 1965, est connue sous le nom de N°1 ESS.

Le système de commutation électronique n° 1 ESS
a été le premier central téléphonique
à commande par programme enregistré (SPC). Il a été
fabriqué par Western Electric et mis en service pour la première
fois à Succasunna , New Jersey , en mai 1965.
Le ESS 1 utilise 160 000 diodes, 55 000 transistors et 266 000 résistances,
condensateurs et autres composants. Ceux-ci étaient montés
sur des circuits imprimés enfichables uniques. Le ESS 1 , bien
qu'il ne s'agisse pas d'un commutateur "numérique",
puisque les appels étaient toujours traités dans un
format audio analogique à l'aide de relais Reed miniatures
dans un format matriciel de type barre transversale. Mais le principal
avantage était un nouveau concept appelé Stored Program
Control (SPC), qui permettait au commutateur d'avoir une mémoire
électronique. Cela a permis de nouvelles fonctionnalités
telles que l'appel en attente, le renvoi d'appel et la numérotation
abrégée. D'autres avantages étaient la possibilité
de modifier la "programmation" du commutateur en cas de
besoin pour modifier les paramètres (routages d'appels) et
d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires lors de
leur développement. Les commutateurs crossbar et pas à
pas existants fonctionnaient en temps réel et exécutaient
les commandes au fur et à mesure. Le ESS 1 pouvait stocker
tous les chiffres composés et agir en conséquence une
fois la numérotation terminée.
Début 1965, les systèmes PCM en exploitation comprenaient
environ 3000 groupes de 24 canaux de type T1, aux États-Unis.
Bell aura passé 10 ans et 500 millions de dollars pour développer
le système de commutation électronique numéro
1.
...
C'est seulement en 1976 qu'aboutit le projet No 4 ESS de
Vaughan, le premier central téléphonique temporel
public est ouvert à Chicago.

Mais bien avant
le centre de Chicago, à Perros-Guirec en 1969
le premier centre téléphonique temporel (du monde)
a été mis en service par le Cnet et Alcatel.
sommaire
Revenons en France après la fin de la guerre
1955, Trébeurden bénéficie de l’installation
d’une entreprise fabriquant des ballons-sondes pour la météorologie.
Elle produit des fournitures en matière plastique et de la
mécanique de précision pour l’électronique.
Il s’agit de la première activité en lien
avec l’électronique en Bretagne.
En juin 1955, une commission rédige, à la demande
du gouvernement Edgar Faure, un rapport précis sur les sites
des établissements publics de la région parisienne susceptibles
d’être décentralisés en province.
Seules les PTT (Postes, Télégraphe, Téléphone)
répondent favorablement.
En novembre 1956, un rapport sur la décentralisation
administrative propose plusieurs déconcentrations de services
de l’État, mais la plupart des responsables concernés
affirment que le maintien en région parisienne est indispensable.
A la fin des années 1950,
la découverte du transistor excitait l’imagination des
ingénieurs et les projets de " calculateurs " destinés
à remplacer les
machines comptables à cartes perforées (à relais
) voient le jour en particulier chez IBM et à la Compagnie
des Machines BULL. Dans les équipements de télécommunications,
ce sont les autocommutateurs qui ont besoin d’intelligence, mais
le réseau de connexion électromécanique (Crossbar
...) aimerait aussi évoluer.
Les laboratoires BELL aux USA, inventeurs du transistor, étaient
déjà au travail sur un futur autocommutateur électronique,
quand en 1957, Pierre Marzin, directeur du CNET, y envoie en mission
exploratoire quelques ingénieurs du CNET d’Issy-les-Moulineaux.
Mais quelles activités est-il
prévu de déléguer aux laboratoires de Lannion
? Il semble bien acquis que P. Marzin voulait faire de la recherche
sur l’espace un des points forts du nouveau centre .La création
du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) mit fin à
cette espérance. L’idée s’impose alors de
spécialiser Lannion dans les études dites soit d’avant-garde,
soit d’échéance à plus long terme.
Du 4 au 6 mars 1957 organisé
par AT&T se tient aux USA le tout premier Colloque de Commutation
Électronique (Electronic Switching Symposium)
à l'initiative des Laboratoires Bell, qui dans le domaine de
la commutation temporele ont été les leaders comme nous
l'avons vu.
Ce colloque auquel trois ingénieurs du CNET participent, racontent
à Pierre Marzin l'évolution récente de la commutation
téléphonique électronique aux États-Unis..
Cela agit comme un électrochoc en France.
Convaincu que l'électronique
était la voie à suivre pour développer la prochaine
génération de commutateur, le 25 mars 1957, Pierre
Marzin, créé le Département Recherches
sur les Machines Électroniques (RME) à
Issy-les-Moulineaux, comprenant deux sections: l’une orientée
calculateurs et technologies associées [circuits logiques,
mémoires vives, mémoires de masse (disques, bandes magnétiques
...), et l’autre orientée commutation avec deux thèmes:
le point de connexion et l’architecture de commande prenant en
compte les contraintes " temps réel " (point
très important vu les performances technologiques de l’époque.
La mission du RME était de créer un système de
commutation électronique. Louis Joseph Libois était
en charge de cette nouvelle division. En créant cette nouvelle
division, Marzin est allé à l'encontre de l'organigramme
de l'entreprise selon lequel la "division commutation téléphonique"
aurait dû être tâche de développer le nouveau
système de commutation. Au lieu de cela, Marzin confia la responsabilité
du programme à de nouveaux hommes issus de différentes
divisions.
Au début des années
1960, la technologie des semi-conducteurs progressait à
grands pas et les calculateurs électroniques sont devenus des
« Ordinateurs » qui disposent d’une certaine puissance
de traitement en temps réel, qui est l’une des caractéristiques
importante d’un système de commande d’un autocommutateur.
L’autre caractéristique est d’avoir un programme
de fonctionnement enregistré et donc facilement modifiable.
Quant au point de connexion à semi-conducteurs pour la réalisation
du réseau, les limites sont très vite apparues. En effet,
en plus du bilan de transmission qui n’était pas excellent,
il y avait les contraintes des interfaces avec le réseau existant:
ligne d’abonné alimentée en 48 volts, courant de
sonnerie d’une centaine de volts alternatifs, etc... On s’est
donc orienté vers des relais à tiges sous enveloppe
scellée, de plus faible dimension que les relais classiques,
commandés par des circuits électroniques et ayant de
bonnes caractéristiques de transmission.
Cronologique de la commutation éléctronique
française
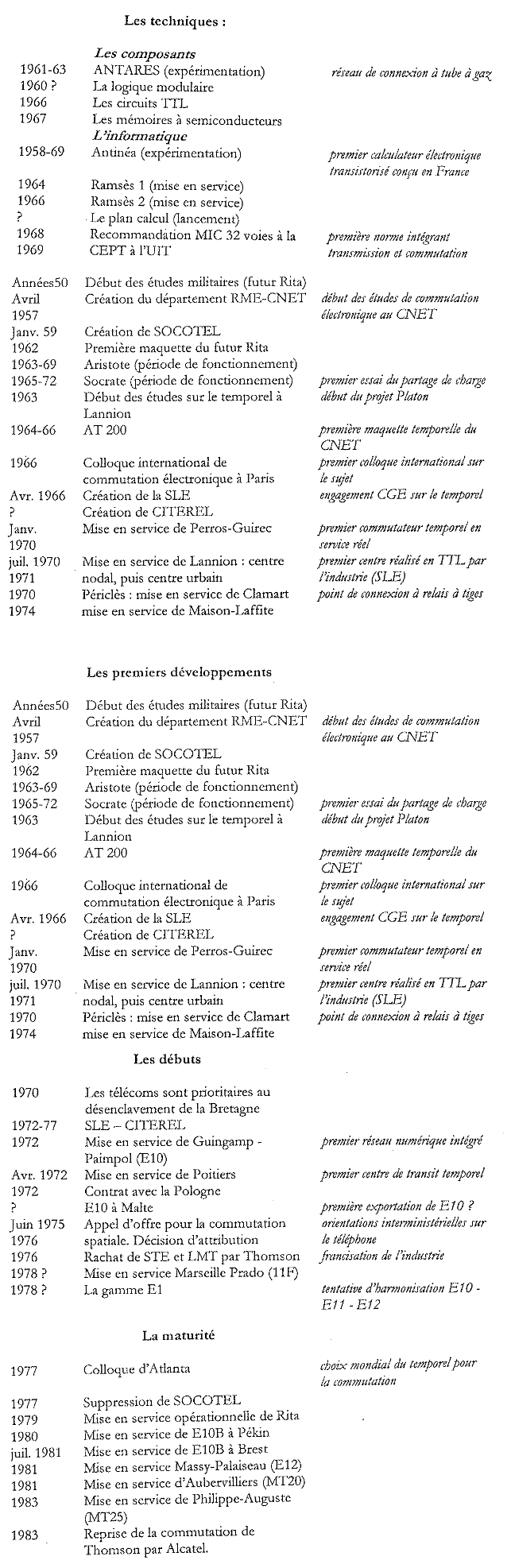
sommaire
L'ordinateur, la partie intelligente
:
On distingue soigneusement entre les calculateurs d'usage général
achetés (CAB 500, IBM 1620, CAE 9080, puis GE 635 avec Datanet
30 et deux GE 115 à Lannion et Paris) qui font leur apparition
et les calculateurs temps réel construits localement
pour le programme, dont le premier est Antinea (1958).
C'est une synthèse des travaux entrepris auparavant sur les
mémoires, notamment les mémoires mortes, et sur les
circuits à transistors.
Antinea fait partie de la nouvelle "génération"
des ordinateurs transistorisés. C'est surtout, de notre point
de vue, le premier calculateur électronique digital construit
et mis en service opérationnel par un laboratoire français
du secteur public .
Antinea sera connectée à une maquette d'autocommutateur,
baptisée Antares, et exécutera des programmes
à partir de 1960.
Le Chef du Département RME nommé
par P.Mazin est Louis-Joseph Libois, venant du Département
Faisceaux-Hertziens avec quelques collaborateurs dont André
Pinet, qui avaient « touché » aux multiplex temporels
dans les faisceaux hertziens.
André Pinet, le chef de projet possède
une bonne expérience dans des domaines variés, y compris
sur la commutation.
Sur le numérique il a été un pionnier en ayant
travaillé sur le codage PCM (Pulse Code Modulation), dès
1947, dans la ligne de l’invention d’Alec Reeves en 1938
au laboratoire LMT de Paris, puis dans une deuxième étape
à partir de 1958, au moment où on peut utiliser des
transistors pour faire des réalisations expérimentales.
Il est un chef de projet pragmatique qui donne des objectifs intermédiaires
et fait des choix pouvant être révisés plus tard,
en fonction de la disponibilité de nouveaux composants.
L'équipe RME est partie de la
recherche fondamentale afin d'explorer, sans a priori, une grande
variété de directions.
Sa première réalisation fut la construction de deux
prototypes, ANTINEA (1958-1960) et ANTARES (1961-1963), qui permirent
l'équipe pour évaluer le problème dans deux directions
principales
• Le bon usage des composants électroniques
• Les méthodes de conception de logiciels
Parallèlement, l'équipe a étudié les technologies
développées dans le monde anglophone. A la fin des années
1950, malgré le développement des transistors, le l'industrie
électronique reposait encore sur les tubes.
L’influence des Bell Labs est telle que les études de
R.M.E. s’orientent tout naturellement vers les mêmes structures
« spatiales ».
Dans ce contexte, les Britanniques ont décidé de construire
un central entièrement électronique à l'aide
de tubes. Leur prototype, surnommé "l'usine à
gaz", était extrêmement volumineux, nécessitait
un système de refroidissement par air et fonctionnait en deçà
des attentes. En conséquence, sa triste carrière s'est
terminée en 1963. Après cet échec coûteux,
les Britanniques sont restés en dehors du domaine de la commutation
électronique pendant les vingt années suivantes.
Comme nous l'avons expliqué, les Américains étaient
moins ambitieux, décidant d'explorer d'abord la "technologie
de division spatiale". Bell Labs a réussi et a choisi
Morris, Illinois, comme emplacement du premier système central
de ce type, qu'il a achevé en novembre 1960. AT&T a créé
des composants spécialement conçus pour être utilisés
dans ce type de système. Cette partie du projet était
l'une des plus coûteuses.
Mais ni le plan américain, trop cher, ni le plan britannique,
qui avait échoué, n'ont pu être adoptés
par CNET Grâce à ces différentes expériences,
les ingénieurs de RME ont décidé d'adopter ce
qu'ils estimaient être une démarche plus réaliste
: « La politique adoptée à cette époque
était d'essayer d'utiliser les composants qui étaient
censés devenir très largement utilisés à
l'avenir.
Cela signifiait qu'ils devaient suivre au plus près l'évolution
de la technologie informatique, sachant que ce marché deviendrait
rapidement le principal débouché des composants électroniques.
Pendant tout ce temps-là
(de 1957 à 1961), Pierre Marzin, profitant d’une incitation
gouvernementale à la décentralisation des organismes
publics, et avec l’appui en particulier de René Pléven,
premier ministre (on disait Président du Conseil) et député
des Côtes du Nord, décide d’implanter un deuxième
Centre de Recherche du CNET à LANNION. C’était
très courageux, mais Pierre Marzin était un fonceur
éclairé.
Au CNET à Issy-les-Moulineaux, il y avait très peu de
candidats pour Lannion, il y en avait plus pour une ville comme Grenoble
par exemple. On dit que Pierre Marzin avait fait un sondage: voulez-vous
aller à la mer ou à la montagne ? 80% ont répondu
la mer disait-il. Evidemment, ce sondage supposé n’a jamais
existé.
En 1960, un jeune ingénieur ENST (moins jeune qu’en sortant
de l’École car il venait de faire 30 mois de service militaire,
dont une partie en Algérie), natif de Ploubezre, Jean-Baptiste
Jacob, fait acte de candidature au CNET, en indiquant qu’il était
candidat pour Lannion (enfin un). Il rentre au CNET à Issy-les-Moulineaux
en juillet 1960, où il partage le bureau avec André
Pinet.
A partir de 1961, une petite équipe de volontaires pour Lannion
se constitue autour de Jean-Baptiste: un technicien originaire de
Lannion rentrant du service militaire, deux jeunes techniciens sortant
du cours de formation des PTT (rue Barrault).
Monsieur Libois avait accepté de devenir le responsable du
CNET à Lannion, en conservant la direction du département
RME. André Pinet s’était également déclaré
intéressé par Lannion.
En juin 1961, Monsieur Libois avait reçu dans son bureau André
Pinet et Jean-Baptiste Jacob, tous deux candidats pour Lannion, où
devaient se faire les recherches « long terme », conformément
aux orientations données par la direction du CNET. Monsieur
Libois avait un article d’un chercheur d’IBM qui donnait
un point de vue prospectif sur l’évolution des télécommunications
et de l’informatique (ou téléinformatique): il
voyait ces deux domaines évoluer vers la même technologie
numérique (parole, données ...). Monsieur Libois nous
indique qu’il partage ce point de vue et qu’à Lannion,
c’est ce type d’études à long terme qui allait
se faire: "vous allez travailler sur les systèmes de l'an
2000".
sommaire
En 1961 les bases théoriques de la commutation numérique
sont à peu près maitrisées, notamment avec les
apports du laboratoire LCT de l’avenue de Breteuil, lié
à la société LMT.
En effet en 1947 Maurice Deloraine, alors directeur technique
du groupe ITT, avait déposé le premier brevet de commutateur
numérique à répartition temporelle et
soutenu une thèse de Docteur-Ingénieur à Paris
sur ce thème.
Puis au sein du LCT, en 1948-50 Pierre Aigrain vérifie la faisabilité
d’une commutation analogique à répartition temporelle
avec modulation PAM (Pulse amplitude modulation) et enfin en 1958
le brevet E. Touraton-J-P. Le Corre, ingénieurs au LCT, complète
celui de M. Deloraine.
Contrairement à la commutation spatiale qui oriente les signaux
téléphoniques tels qu’ils lui sont transmis à
partir du microphone de l’appareil d’un utilisateur, la
commutation temporelle ne les aiguille qu’après les avoir
échantillonnés dans le temps et transformés en
combinaisons numériques selon le principe de la modulation
par impulsions codées (MIC). Cette transformation en numérique
permet d’utiliser un réseau de connexion intégralement
électronique et contourne donc les difficultés que rencontre
la commutation électronique spatiale à trouver un point
de connexion réellement satisfaisant . Malgré cet avantage,
la complexité technique, et donc le coût élevé
de l’opération, enlèvent apparemment toute chance
à la commutation temporelle, du moins au début des années
1960. Mais celle-ci peut retrouver un intérêt fondamental
dans la mesure où elle est transparente à ce système
de modulation par impulsions codées qui retient depuis longtemps
déjà l’intérêt des spécialistes
de la transmission.
Début 1963 C’est donc
au sein du département C.T.I. que commencent, les études
de commutation temporelle. répartis entre Issy-les-Moulineaux
et Lannion c'est ce que nous avons évoqué avant:
Deux études sont menées parallélement par les
équipes du CNET :
1 - système spatial et à commande centralisée
(devant aboutir à une industrialisation à court terme)
à Issy-les-Moulineaux.
2 - système temporel (à long terme) à Lannion,
Deux projets sont lancés en parallèle.
|
1964-66 Le premier système (maquette)
temporel est un autocommutateur privé de 200 lignes,
l’AT 200. Les échantillons de parole sont
seulement modulés en amplitude (M.I.A. donc sans codage)
et sont véhiculés
sur un multiplex de 32 voies, secouru en cas de besoin par un
autre multiplex identique.
La commande est constituée d’un multienregistreur
et d’un traducteur dont les données sont doublées
sur un ruban de papier perforé.
Le premier exemplaire est réalisé au C.N.E.T.
; le second est fabriqué par le laboratoire commun de
SO.CO.TEL.
(installé à Lannion) et envoyé à
l’exposition universelle de Montréal en 1967 où
il surprend les visiteurs des sociétés Bell des
États-Unis et du Canada.
|
 |
Les premiers succès
Le nombre de personnes impliquées dans le projet augmentant
continuellement, les premiers résultats semblaient encourageants.
Même si la commutation temporelle était l'objectif principal
à long terme, il était impossible de négliger
complètement la technologie spatiale. Ainsi, ces deux branches
ont été travaillées simultanément au cours
des années 1960, les premiers résultats se produisant
dans la technologie de division spatiale. Les résultats se
sont présentés sous la forme de deux prototypes qui
ont permis aux scientifiques du CNET d'explorer différentes
voies de développement et de tester de nombreuses solutions
différentes.
ARISTOTE devait être utilisé pour
mettre en place un système de grande capacité organisé
autour d'un processeur central et de plusieurs processeurs secondaires
périphériques. ARISTOTE était purement électronique,
le réseau de commutation étant constitué de matrices
de transistors. Son processeur central RAMSES avait été
développé à partir d'Antinéa.
(Antinea avait été connectéà
une maquette d'autocommutateur, baptisée Antares).
Avec le calculateur RAMSES , il s'agit d'étudier
un véritable prototype d'autocommutateur, sur lequel on pourra
commencer à expérimenter des nouveautés opérationnelles,
cad des services accessibles seulement aux commutateurs numériques.
Ramses comporte des tambours magnétiques, sur lesquels on stocke
les informations comptables relatives aux abonnés. Le prototype
sera installé à Lannion.
Un Ramses II sera ensuite réalisé, logiquement
semblable mais plus performant, pour l'équipement du CNET Paris.
Les deux Ramses, qui utilisent des tambours SEA et des bandes de la
Compagnie des Compteurs, resteront en service jusqu'en 1973.

Le Commutateur ARISTOTE est mis en service en exploitation réelle
sur le réseau téléphonique public le 10 février
1966 et ce jusqu'en 1969.
Jean-Baptiste Jacob arrivé
en 1961 à Lannion avec sa petite équipe qui s’était
un peu étoffée au cours de l’année et avec
trois sujets
Les études à mener :
- réaliser des schémas logiques du calculateur SOCRATE
, calculateur de commande de l’autocommutateur du même
nom,
- commencer la programmation de SOCRATE,
- qualifier des relais à tiges réalisés à
Issy-les-Moulineaux et étudier une carte matrice de connexion
à base de relais à tiges
Cela permet de tester fiabilité et performances des circuits,
et d'entraîner les personnels à la conception de systèmes
et à leur programmation.
En septembre 1962, André Pinet vient s’installer à
Lannion et bien sûr l’équipe de Jean-Baptiste a
grandi. D’autres personnes arrivent, en particulier l’équipe
qui étudie le convertisseur analogique - numérique.
Parallèlement, un effort particulier a été fait
pour développer de nouveaux logiciels.
Dans ce domaine, les chercheurs ont été surpris par
la complexité des problèmes qu'ils avaient à
résoudre et leur évaluation a pris beaucoup de temps.
Lorsqu'ils se sont produits, ces retards étaient dus à
une sous-estimation du temps qu'il faudrait pour écrire et
tester le logiciel.
SOCRATE était beaucoup plus traditionnel et reposait
essentiellement sur des composants à barre transversale. Son
objectif principal était de développer un nouveau logiciel
pour le système de contrôle. Il est doté d’un
réseau de connexion de type Crossbar CP400 piloté par
deux calculateurs spécialisés dénommés
multienregistreurs fonctionnant en « partage de charge »
comme dans les commutateurs électromécaniques. Ce principe,
adopté sur les conseils de P. Lucas, se distingue de celui
des Américains basé sur le « synchronisme »
des deux calculateurs.
Le département RME poursuivra son effort pour maintenir la
technologie de ses ordinateurs au meilleur niveau, d'abord avec RME.
X1, calculateur réalisé en TTL en vue d'un projet
Cheops de calculateur pour commutateurs, puis avec RME. X2, maquette
ECL destinée à des commutations plus rapides.
L’architecture d’un autocommutateur des années 1960
avait :
- un réseau de connexion spatial métallique (relais
à tige, Crossbar standard ou miniaturisé),
- une commande centralisée assurée par deux calculateurs
(spécifiques) fonctionnant soit en partage de charge soit en
micro synchronisme.
 Commutateur SOCRATE le 21 avril 1964, remonté à Lannion.
Commutateur SOCRATE le 21 avril 1964, remonté à Lannion.
elle période de recherche du CNET a commencé en 1965
et deux nouveaux prototypes ont été développés.
Le premier centre PERICLES (à
commutation spatiale) a été créé en association
avec les constructeurs et a conduit à l'installation en 1970
du premier central téléphonique à Clamart. Ce
système a formé la base du Metaconta développé
plus tard par LMT.


Commutateur PÉRICLÈS I Paris-Michelet, peu avant
sa mise en service. Carte composant la Matrice de Connexion des Commutateurs
PÉRICLÈS, réalisée à partir de
128 relais à tige et contacts scellés.
En même temps:
-les études de développement d’un relais à
tiges se poursuivent,
-les études d’un convertisseur analogique - numérique,
le COdeur DECodeur (CODEC) démarrent, car c’est
un élément de base pour un système numérique
de commutation temporelle. Cette étude est supervisée
par André Pinet .
ARISTOTE et SOCRATE étaient tous deux raccordés au réseau
de Lannion au milieu des années 1960.
Les principales décisions prises par CNET à la suite
de ces expériences ont influencé de manière décisive
le développement de la commutation électronique.
La mode étant à l’époque
de baptiser les projets de noms glorieux de l’Antiquité
(RAMSES, ARISTOTE, SOCRATE, etc.), c’est ainsi que l’illustre
PLATON (prototype lannionnais d’autocommutateur temporel
à organisation numérique) espère un futur aussi
prestigieux que son passé !
Très rapidement, l’organisation générale
du commutateur, c’est-à-dire la répartition des
différentes opérations à effectuer, est arrêtée
.
sommaire
Suite aux travaux et recherches principalement
sur le projet Antinéa Ramsés, loin de
Paris, et de leur hiérarchie, les ingénieurs du Cnet
se sentent libres d’essayer, d’oser. Ils lancent un pari
sur l’avenir, raconte Yves Bouvier, maître de conférences
à la Sorbonne Université et spécialiste de l’histoire
des Télécommunications.
Au lieu de travailler sur l’appareil de commutation téléphonique
de demain, ils décident de plancher sur celui d’après-
après-demain.
Le projet prend le nom de PLATON
, prototype lannionais d’autocommutateur temporel à
Organisation Numérique.
PLATON était complètement
différent. Conçu par Louis Joseph Libois, il était
basé sur les principes de la commutation numérique par
répartition dans le temps. Afin de créer un système
adapté à une fabrication commerciale, PLATON a été
conçu comme un système de faible capacité, basé
sur une architecture la plus simple possible, utilisant un minimum
de nouveaux types d'équipements. Néanmoins, son architecture
était révolutionnaire.
Les principes du design de Platon peuvent être vus par un œil
expert comme préfigurant deux tendances majeures qui allaient
prendre de plus en plus d'importance à partir de la fin des
années 1970 : la décentralisation des unités
de contrôle et l'utilisation de micro-ordinateurs à cette
fin.
On notera qu'au début des années 1970, lorsque Platon
était en cours de développement, les microprocesseurs
commençaient tout juste à apparaître et le terme
même de "microprocesseur " n'avait pas encore été
inventé.
sommaire
Retour au projet de décentralisation :
Pierre Marzin suggère l’idée
d’installer une antenne du Cnet (Centre national
d'études des télécommunications) à Lannion.
L’air, dit-il, y est très pur et la main d’œuvre
bretonne est excellente et abondante." Il obtient le feu vert
du gouvernement et des élus bretons !
« Un seul haut fonctionnaire a montré de la bonne volonté,
un seul a dit oui, Pierre Marzin, directeur du Cnet »,
déclare René Pléven, président du Comité
d’études et de liaison des intérêts bretons
(Célib), et aussi président du Conseil général
des Côtes-du-Nord, ancien président du Conseil, fréquemment
ministre .
Pierre Marzin confirme : « La région lannionaise convient
bien au projet » et l’on parle d’une première
tranche : un laboratoire de 500 chercheurs. L’aérodrome
de Lannion-Servel, à quelques mètres des terrains envisagés
pour l’installation du Cnet, constitue un argument essentiel
pour des transports rapides de personnes et de matériel. «
Automatiquement, les usines suivront », ajoute le Trégorrois.
Les communes concernées créent un syndicat pour aménager
les espaces industriels et de recherche.
Le 8 septembre 1960, le président de Gaulle visite le
centre de recherches en cours d’installation et déclare
: « Je viens de voir les prodromes de ce Cnet qui est certainement,
ou qui va être chez vous, une des plus belles choses au monde
et qui va certainement transformer sensiblement la figure et la nature
de votre ville et de votre région. Bien sûr, vous garderez
vos traditions ». Il conclut : « La Bretagne doit avancer
et la France doit l’y aider. »
En janvier 1961, le premier bâtiment est achevé.
Quelques mois après surviennent les décisions d’implantation
des premières usines privées : SLE-Citerel, LMT-Thomson,
LTT, etc.
La même année, la petite sous-préfecture et les
quatre communes voisines décident de fusionner, ce qui donne
à la nouvelle commune plus d’espace et de moyens financiers.
Prise en fin de IVe République, appliquée sous la Ve,
la décision de décentraliser le Cnet a permis l’installation
à Pleumeur-Bodou du Centre
Technique Spatial avec le radôme – un projet américain
! – puis d’autres antennes pour les liaisons transcontinentales
de téléphonie et d’images de télévision.
Le 5 juin 1961, à l’initiative du SIDIRL, M. Ambroise
Roux, Président de la Compagnie Générale
d’Electricité (CGE), accompagné
de MM. Pleven et Pierre Marzin, vient à Lannion examiner les
infrastructures et les possibilités de main d’œuvre
locale et d’hébergement.
La CGE achète 12 ha à la SEMAEB au tarif de 2
Francs le m2. Les laboratoires de Marcoussis occupent le site en 1964
et y développent des équipements de transmission (Répéteurs
Régénérateurs), des antennes et des stations
de réception des signaux émis par les satellites météorologiques.
Alors qu'à la fin des années
1960, il n’y avait que 4 millions de lignes téléphoniques
en France et que les centraux étaient électromécaniques,
le Cnet
travaillait pour la prochaine étape ; le tout numérique.
L’expression générique « commutation électronique
» s’oppose à « commutation électromécanique
», et traduit l’introduction à des degrés
très divers des technologies électroniques dans les
systèmes de commutation. Mais deux domaines doivent être
distingués : le point de connexion et les organes de commande.
Ce qui est commun à tous les systèmes
de commutation électronique qui furent développés,
c’est que la commande est électronique, qu’elle soit
à logique câblée ou programmée, le point
de connexion pouvant être électronique (spatial à
semi-conducteur ou temporel) ou électromécanique (relais
à tige, ou sélecteur Crossbar). Si la combinaison commande
programmée enregistrée (c’est-à-dire par
calculateur) et point de connexion temporel s’est finalement
imposée, toutes les autres combinaisons ont été
développées et peu ou prou installées dans les
réseaux de par le monde.
Pour
les télécommunications française, Alcatel est
le lien avec le Cnet de Lannion
 Visite du président de Gaulle.
Visite du président de Gaulle.
En octobre 1962, le président de Gaulle rend visite
au CNET. Il est reçu par Pierre Marzin, directeur, et principal
acteur du projet réussi de décentralisation de la recherche,
et par l'avocat Henri Blandin, maire de Lannion depuis mai 1961, partenaire
actif du projet au niveau municipal - Coll. Louis-Claude Duchesne
.
Le 23 octobre
1963, le CNET de Lannion est inauguré
par le ministre des PTT, Jacques Marette.
Le Centre National d’Études des
Télécommunications (CNET) de Lannion dont la création
remonte à avril 1959 (1962 pour la commutation téléphonique)
est devenu depuis le centre de Recherche et de Développement
de France Telecom (FT/R&D) ;
On inaugure le premier laboratoire du Cnet de Lannion
ainsi que les premiers laboratoires de la Société lannionnaise
d’électronique (groupe CGE).
 Ouvrières de l’électronique.
Ouvrières de l’électronique.
A partir de 1963, la SLE (société lannionnaise
d'électronique), du groupe CGE, s'installe dans le Trégor
et y développe des unités de production liés
essentiellement au développement du téléphone.
Cela fournit du travail à beaucoup de jeunes femmes, à
Lannion puis à Tréguier.
sommaire
Le projet PLATON
Le second projet concerne l’étude
d’un autocommutateur public de moyenne capacité.
La mode étant à l’époque de baptiser les
projets de noms glorieux de l’Antiquité (RAMSES, ARISTOTE,
SOCRATE, etc.), c’est ainsi que l’illustre PLATON
(prototype lannionnais d’autocommutateur temporel à organisation
numérique) espère un futur aussi prestigieux que son
passé ! Très rapidement, l’organisation générale
du commutateur, c’est-à-dire la répartition des
différentes opérations à effectuer, est arrêtée
.
La commutation temporelle
consiste à interconnecter deux voies qui se présentent
dans des multiplex de transmission à répartition
temporelle. Il s'agit de transférer dans une position temporelle
donnée d'un multiplex sortant donné, les informations
véhiculées par la position temporelle du multiplex
entrant qui correspond à la voie entrante indiquée.
Comme il n'y a aucune relation entre les positions temporelles
dans le multiplex entrant et dans le multiplex sortant (qui d'ailleurs
ne sont pas nécessairement synchrones), il ne suffit pas
d'ouvrir, par exemple, une porte rapide mettant les deux multiplex
en communication pendant 3,9 us, il faut effectuer en outre un
déphasage correspondant à la différence des
instants d'apparition des deux voies sur leurs multiplex de transmission
respectifs.
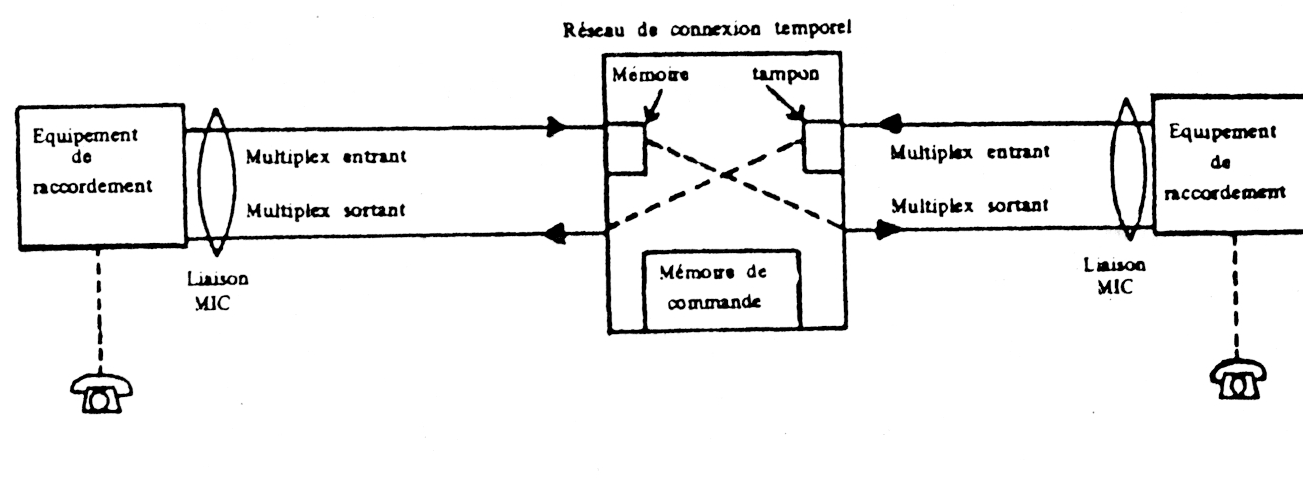
Le principe de la commutation temporelle revient à combiner
successivement deux types d'opération :
- un changement de position temporelle (opération de type
T), qui réalise le déphasage voulu en faisant séjourner
dans une mémoire temporaire le temps convenable les signaux
transportés par la voie entrante ;
- une commutation spatiale entre des multiplex rendus synchrones
(opération de type S) qui s'obtient en ouvrant des portes
logiques rapides permettant de transférer les signaux de
la voie entrante vers l'organe chargé de reconstituer le
multiplex de transmission sortant. Ces portes logiques sont des
points de connexion (au sens de la commutation spatiale) mais
commandés dynamiquement à une cadence égale
à celle des multiplex internes.
II apparaît que l'extrême vitesse de fonctionnement
de l'électronique et la modulation par impulsion et codage
font de la commutation une manipulation de signaux dans une dimension
essentiellement temporelle. Il s'agit de modifier la position
temporelle des signaux d'une voie MIC entrante. Pour cela, on
les fait séjourner un certain temps dans une mémoire.
Puis, quand ils se trouvent en phase avec le multiplex sortant,
on les injecte sur la voie correspondante. Par ailleurs, la notion
de blocage interne qui incarnait une des limites de la commutation
spatiale disparaît en commutation temporelle. Il ne s'agit
plus tant de rechercher des itinéraires et de commander
leur mise en place, en faisant coïncider un itinéraire
et une communication, mais de déphaser des ensembles, d'analyser
des signaux et de les concatener de nouveau .

|
Au printemps 1963, le projet PLATON
est lancé avec pour objectif, la réalisation d’une
maquette prouvant la faisabilité d’un réseau de
connexion
temporel y compris le CODEC. Le responsable du projet est André
Pinet.
Pour ce projet de réseau de connexion temporel, il fallait
une petite unité de commande capable de recevoir une numérotation
et de commander une connexion dans le réseau.
En septembre 1962, on célébrait à Clermont-Ferrand
le 300 ème anniversaire de la mort de Blaise Pascal, inventeur
en 1642 d’une machine arithmétique. Se tenait donc un
colloque traitant des techniques de calcul programmables sur calculateur
électronique. Le calcul électronique est évoqué
dans quelques-unes des interventions, mais ce qui retient l’attention
des deux ingénieurs de Lannion, c’est la présentation
d’un ordinateur par la société Packard Bell, fondée
aux Etats-Unis en 1926, d’abord fabricante de radios et qui a
trouvé le succès dans l'électronique militaire
et le marché de la télévision, puis est devenue
pionnière dans la fabrication d’ordinateurs.
L’ordinateur présenté est le célèbre
PB 250, commercialisé en 1961, l'un des derniers utilisateurs
de lignes à retard magnétostrictives en tant qu'élément
de sa mémoire. Packard Bell vendait son calculateur mais aussi
ses mémoires.
Le PB 250, qui a été
présenté par Packard Bell Computer Corporation lors
de la Western Joint Computer Conference en mai, est
le premier ordinateur avec ces deux caractéristiques. Ne
coûtant que 30 000 $, il peut rivaliser avec les machines
à grande échelle en termes de vitesse et de flexibilité.
Jusqu'à 40 000 opérations peuvent être effectuées
chaque seconde. Le temps d'addition est de 12 microsecondes, la
multiplication nécessite 276 microsecondes, tandis que
la division et la racine carrée prennent chacune 252 microsecondes.
De plus, les trois dernières opérations ont un temps
d'exécution variable, en fonction de la longueur des nombres.
Les temps indiqués sont pour un nombre composé de
21 bits et signe. Les opérations en virgule flottante avec
une mantisse 37 bits et une caractéristique 7 bits nécessitent
moins de trois millisecondes.
Outre la rapidité avec laquelle les opérations arithmétiques
peuvent être effectuées, la vitesse globale du PB
250 est également fonction d'une structure de commande
riche. Les 46 commandes incluent le transfert de blocs, la conversion
de Gray en binaire et le contrôle d'un système d'entrée/sortie
élaboré. La programmation est simple, avec des instructions
à adresse unique, une indexation des commandes et des opérations
automatiques à double précision. Le coût par
unité de réponse dépend de la facilité
de programmation ainsi que de la vitesse de calcul.
Le PB 250 est fourni avec un système de programmation symbolique
utilisant des codes d'instructions mnémoniques et une variété
de sous-programmes.
Les données et les commandes nécessaires au calcul
sont stockées dans une mémoire homogène.
Le support de stockage -- de 1808 mots dans l'ordinateur de base
-- est un ensemble de lignes à retard magnétostrictives
en acier au nickel le long desquelles se propagent des impulsions
acoustiques. A une extrémité de chacune de ces lignes
se trouve un dispositif d'écriture pour traduire l'énergie
électrique en énergie acoustique. A l'autre extrémité
de chaque ligne se trouve un dispositif de lecture pour retransformer
l'énergie acoustique en signaux électriques.
En réécrivant l'information stockée au fur
et à mesure de sa lecture, l'information circule en continu
sans altération à l'exception des altérations
qui résultent de l'exécution du programme informatique.
Un facteur de coût supplémentaire qui a souvent rendu
les petits ordinateurs peu pratiques est celui de l'extension
de la mémoire.
Les lignes à retard magnétostrictives, ainsi que
leurs circuits associés, sont montés sur des modules
gravés enfichables. La mémoire peut être étendue
à peu de frais à 16 000 mots par l'ajout de modules
similaires, et, en outre, ceux-ci peuvent être à
accès rapide ainsi que des lignes de stockage en vrac.
16 000 mots de stockage de base peuvent également être
ajoutés en externe, avec une entrée/sortie jusqu'à
85 000 mots par seconde. |
Le caculateur PB250 et sa console système
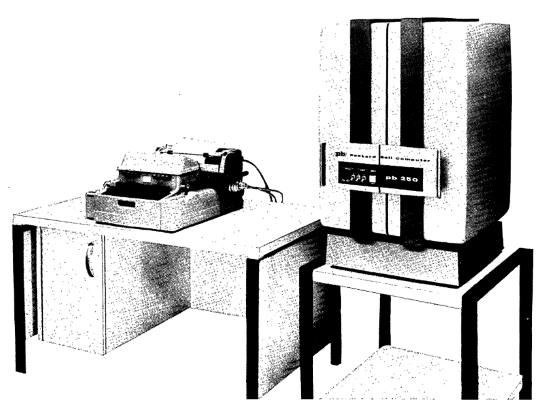
L'ordinateur central pesait 110 livres (50 kg).
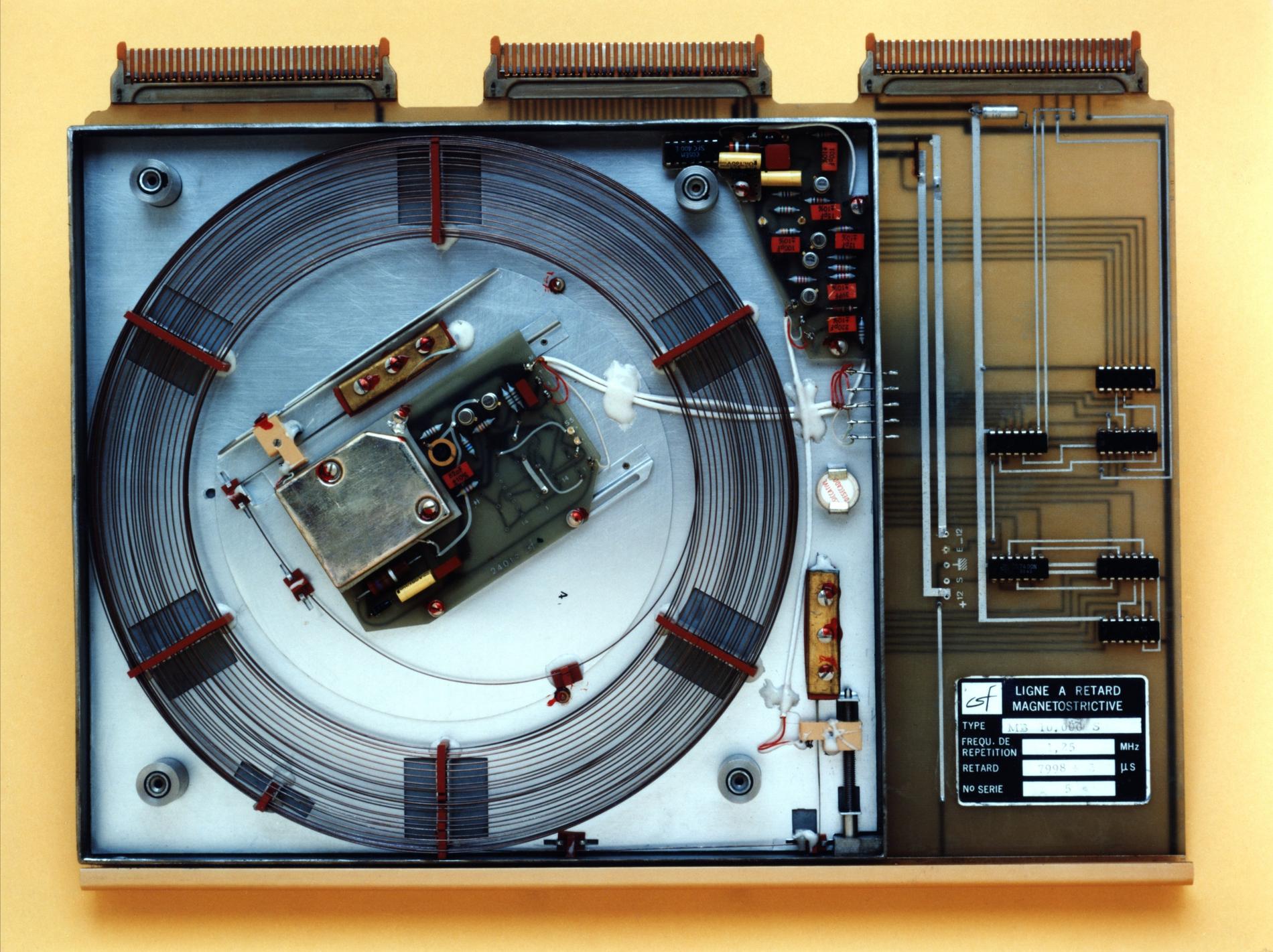 Ligne
à retard. Ligne
à retard.
La conception a commencé en novembre 1959.
L'ordinateur était conçu comme un composant dans
des systèmes à usage spécial, par exemple,
pour contrôler les centrales électriques.... entraînement
de sous-marins nucléaires ...
PB 250 a été licencié à SETI ( français
: Société européenne de traitement de l'information
, lit. 'Société européenne de traitement
de l'information').
|
Les informations d'entrée et de sortie
peuvent être traitées pendant le calcul.
L'entrée standard comprend une machine à écrire
alphanumérique, une perforatrice et un lecteur de bande
papier, une entrée et une sortie de bloc à grande
vitesse (2 mégacycles), 32 sorties de contrôle et
30 entrées de contrôle. Ce dernier fournit un moyen
de contrôler une large gamme d'équipements périphériques
et d'autres appareils. L'équipement de bande de papier
à grande vitesse et jusqu'à six gestionnaires de
bande magnétique sont des équipements en option.
Les bandes magnétiques utilisent le format de bande de
la série IBM 700, bien que n'importe quel code utilisant
jusqu'à huit canaux puisse être utilisé. |
André Pinet souligne que pour
les mémoires temporaires ou semi-permanentes, choisies sont
des lignes à retard utilisant le principe de la magnétostriction
: une impulsion électrique délivrée à
une extrémité d’un fil d’alliage métallique
est restituée à l’autre extrémité
avec un retard supposé constant et proportionnel à la
longueur de ce fil. Or, si les lignes utilisées pour l’échantillonnage
de la parole (donc avec un cycle de 125 microsecondes) sont assez
courtes pour rester stables, celles plus longues, et en l’occurrence
ici de huit millisecondes, qu’on adopte dans les multienregistreur,
traducteur et taxeur pour lesquels ce cycle de travail est suffisant
afin de traiter les événements téléphoniques
(par exemple la numérotation composée par un abonné)
ont un retard trop dépendant des variations de température
– et il suffit d’un décalage d’environ 400 nanosecondes
pour tronquer les informations. Le réglage répété
de ces lignes au moyen d’un tournevis, exécuté
parfois par le chef de laboratoiresous le regard à tout le
moins ironique de ses techniciens, constitue un criant anachronisme
face aux principes futuristes de la commutation temporelle. Les couloirs
des sous-sols du C.N.E.T./Lannion seront utilisés pour tester
la qualité des alliages constituant ces lignes longues. Mais,
ce sont les unités de raccordement
des lignes d’abonnés qui posent les problèmes les
plus aigus. En effet, aux habituelles fonctions logiques communes
à tout organe d’un commutateur, s’ajoute le traitement
des signaux vocaux spécifique aux techniques temporelles. Le
choix initial est fait de réaliser l’échantillonnage
de ces signaux dans chaque équipement de ligne d’abonné.
Au bout du compte, un tel équipement « malgré
ses multiples fonctions..., étant propre à chaque ligne
d’abonné, doit nécessairement être aussi
simple que possible pour ne pas avoir une incidence trop importante
sur le coût de l’installation »Jean-Baptiste Jacob,
avec un collègue participe au colloque Blaise Pascal, et au
retour de mission fait son compte-rendu à André Pinet,
compte-rendu dans lequel les caractéristiques du PB 250 sont
décrites et en particulier son prix très raisonnable.
André Pinet adopte le PB 250 comme machine de commande de la
maquette PLATON. Le bon de commande est lancé et la machine
arrive à Lannion au début de 1963.
Comme le projet SOCRATE a été repris
entièrement à Issy-les-Moulineaux, l’équipe
de programmation lannionnaise se trouve disponible pour la programmation
du PB 250. On s’aperçoit très vite que le PB 250
n’est pas adapté pour les traitements " temps réel
"comme la réception de la numérotation.
Jean-Baptiste Jacob propose à André Pinet de développer
une machine spécialisée dans la réception de
la numérotation (un périphérique du PB
250), utilisant une mémoire série à magnétostriction
à commander à Packard Bell .
Ce développement est lancé et au fur et à mesure,
on se rend compte que cette machine qu’on va appeler multienregistreur
a des propriétés intéressantes et finalement
va prendre en charge une grande partie du traitement d’appel.
Il a ainsi paru intelligent de développer des machines spécialisées:
le traducteur (mémoire de traduction à lignes à
retard et sa commande), le taxeur
(architecture voisine de celle du multienregistreur) et le PB 250
assurait les fonctions de supervision, un CTI en" herbe
".
Les organes chargés de piloter l’ensemble des opérations,
et en premier lieu une base de temps générale, horloge
générant et distribuant les différentes cadences
indispensables dans un système temporel. Quant aux organes
de commande proprement dits, leur organisation pose problème.
Les responsables ont pleinement conscience des difficultés
à surmonter pour programmer une machine chargée de toutes
les opérations d’un centre de commutation (dont toute
une partie exigeant le temps réel) et savent que les énormes
moyens mis en œuvre par les « Bell Labs » pour y
parvenir ne sont pas mobilisables au sein du C.N.E.T. ou de SO.CO.TEL.
C’est pourquoi L. J. Libois souhaite qu’on cherche une solution
amenant à une programmation moins lourde et moins onéreuse.
Après des réflexions menées en commun avec J.B.
Jacob et J. Vincent Carrefour (responsable du centre de calcul du
C.N.E.T. au sein du département C.T.I.), A. Pinet s’oriente
vers une commande dite répartie : les fonctions en temps réel
(établissement, taxation, rupture des communications) seront
exécutées par des petites unités spécialisées,
les fonctions de gestion et de maintenance dont la réalisation
est acceptable en temps différé seront à la charge
d’un calculateur de type universel. Celui-ci pourra alors être
commun à plusieurs commutateurs. Cette idée est très
facilement adoptée par M. Revel, responsable des études
sur les organes de commande ; il écrit que « comme beaucoup
d’autres à Lannion, j’étais un commutant faisant
de l’électronique et non pas, comme à Paris, un
informaticien faisant de la commutation ». En effet, lui-même
et la plupart des membres de son groupe sont des commutants issus
des techniques électromécaniques.
Tous se sentent armés (et motivés) pour concevoir des
ensembles logiques pilotés par un programme « câblé
» constitué d’instructions complexes adaptées
à la téléphonie. C’est ainsi que naît
le groupe de quatre organes constituant la commande de PLATON : le
marqueur assurant les échanges d’informations entre les
différents types d’organes, le multienregistreur pilotant
l’établissement et la rupture des communications, le traducteur
mémorisant les caractéristiques de tous les accès
au commutateur (lignes d’abonnés ou circuits) et le taxeur
chargé de calculer les taxes des conversations et de les imputer
aux comptes des abonnés concernés. La technique utilisée
est plus originale que le vocabulaire directement issu des commutateurs
électromécaniques.
C’est aussi dans l’unité de raccordement
d’abonnés que doit être réalisé le
codage numérique des échantillons de parole. La loi
de codage a été choisie après des « essais
téléphonométriques et des essais subjectifs d’opinions
», en l’occurrence celles des agents du département
C.T.I. venant apprécier dans une salle spéciale la restitution
plus ou moins fidèle de leur voix selon les différentes
expériences de codage. Mais la réalisation d’un
codeur respectant la loi retenue n’en reste pas moins très
difficile avec les composants disponibles : elle prévoit 128
valeurs différentes, c’est-à-dire 27, or il s’avère
difficile de dépasser 26.
Le cumul des difficultés techniques et économiques (les
unes réagissant d’ailleurs sur les autres) rencontrées
pour développer l’unité de raccordement d’abonnés
explique pourquoi c’est cette dernière qui connaîtra,
au cours du temps, le plus grand nombre de versions, très différentes
les unes des autres, parmi les organes constitutifs de PLATON et de
son successeur industriel E10.
Malgré ces contraintes, la première
maquette de laboratoire entièrement fabriquée au C.N.E.T./Lannion
est assemblée et fonctionne dès 1965. Certains problèmes
sont volontairement contournés dans l’attente de technologies
plus performantes.
Ainsi, les communications sont établies à travers le
réseau de connexion avec des intervalles de temps identiques
pour le demandeur et le demandé. En effet, les mémoires
(dites « tampons »), permettant d’y inscrire une
combinaison de parole codée au temps x affecté au demandeur
pour la lire au temps y affecté au demandé,ont un coût
encore prohibitif. Les instructions constituant le programme de fonctionnement
des organes de commande ne sont pas réalisées sur un
support mémoire aisé à modifier. Enfin, le calculateur
universel, dénommé Centre de Traitement des Informations
(C.T.I.), chargé des opérations de gestion et de maintenance
n’est pas jugé indispensable à ce stade de vérifications
des principes. Ce rôle est joué provisoirement par un
calculateur PB250 de Bull.
Les résultats obtenus sont considérés comme très
positifs ; la maquette PLATON fait maintenant partie du circuit
traditionnel suivi par les visiteurs officiels du C.N.E.T./Lannion.
Les responsables jugent donc possible et nécessaire d’engager
une seconde phase du projet devant aboutir à la mise en exploitation
réelle dans le réseau.
La mise en construction de la maquette débute
le 9 décembre 1965 et en Février 1966, deux "abonnés"
peuvent se parler à travers le Réseau de Connexion de
la maquette. A partir de là «dès
1965, était édité un premier projet sous forme
d’une note interne du CNET, avec tous les schémas de Platon
».
Mais quelles appréciations les experts portent-ils
sur cette première réalisation ?
La nature temporelle du système PLATON les laisse toujours
sceptiques quant à la possibilité de réaliser
à court terme des réseaux de connexion de capacité
suffisante. Le surcoût apporté par le passage «
fréquences vocales-modulation par impulsions codées
» au niveau des étages d’abonnés leur paraît
également impossible à compenser par les économies
attendues par ailleurs de l’électronique.
Mais ils sont encore beaucoup plus réservés, et le terme
est sans doute faible, sur la structure qui a été choisie
pour les organes de commande. Comment peut-on se priver de la souplesse
des programmes enregistrés (modifiables par une simple relation
homme-machine, sans intervention « physique ») gérés
par des calculateurs au sein desquels sont centralisées toutes
les fonctions ? Pourquoi prendre une autre option que les Bell Labs
et A.T.T. qui, à la même époque (1965), mettent
en service réel à Succasunna le prototype de l’ESS1
piloté par deux calculateurs synchrones ?
On juge indélicat de rappeler qu’on ne maîtrise
absolument pas la conception de programmes aussi vastes pour lesquels
les Bell Labs ont consacré des moyens absolument exceptionnels
et un temps ayant dépassé, tout aussi exceptionnellement,
les prévisions.
Aussi, la conclusion de l’article de présentation du projet
dans le numéro 12 de Commutation et Electronique de mars 1966
consacret-elle à peine 15 % de sa longueur à rappeler
les avantages attendus de la commutation temporelle, « en particulier
ceux qui concernent le faible encombrement des installations, l’absence
de bruit, la qualité du service due à l’extrême
rapidité d’exécution des opérations, la
souplesse du système quant à la possibilité de
traiter des informations de natures diverses (téléphonie,
transmission de données, etc.) ».
Le reste de cette conclusion sert à justifier la séparation
qui a été faite entre fonctions de commutation et fonctions
d’exploitation. Les premières, nécessairement exécutées
sans défaillances et en temps réel « sont réalisées
à l’aide de sous ensembles spécialisés dont
la pluralité, ..., place le système dans les meilleures
conditions pour assurer un service ininterrompu ». alors qu’«
il ne faut pas oublier que la centralisation des fonctions dans un
organe unique accroît les difficultés d’assurer
un service sans défaillances, lesquelles ne peuvent d’ailleurs
généralement être surmontées qu’au
prix d’une augmentation notable du matériel ».
Il n’est pas omis de rappeler combien la commande centralisée,
obligatoire dans sa totalité, quelle que soit la capacité
initiale du commutateur, est économiquement pénalisante
pour les installations de dimension modeste. Par contre « La
centralisation de certaines fonctions liées à l’exploitation
dans un organe à programme enregistré mis à la
disposition de plusieurs centres de commutation nous paraît
être une solution avantageuse... ».
La longueur du plaidoyer en faveur d’une commande répartie
montre bien qu’elle est en totale opposition avec les idées
des années 1960, toutes favorables à la commande centralisée,
ne serait-ce que par conformisme avec ce que font les Bell Labs.
Peu de spécialistes (y compris sans doute parmi les responsables
de ce choix) auraient pensé qu’elle puisse s’imposer
à terme. C’est pourtant ce qui s’est produit (essentiellement
à cause du développement des microprocesseurs), et c’est
bien du mérite pour certains experts de reconnaître en
1990 que « cette structure décentralisée, très
en avance sur son temps, s’est révélée être
un bon choix lorsque sont apparus les microprocesseurs, et c’est
maintenant une caractéristique « dernier cri »
dont se vantent tous les constructeurs modernes de commutation »
C’est donc à cause de cette organisation, qui évite
les difficultés de la programmation lourde, que PLATON a réussi
et que le système E10 s’est imposé dès les
années 1970. C’est en tout cas la thèse adoptée
par plusieurs acteurs du projet, en particulier par J.N. Méreur
(futur directeur des programmes au C.N.E.T.), jeune ingénieur
alors chargé d’en favoriser le développement auprès
des services exploitants. La nature temporelle du système,
pourtant beaucoup plus innovante, ne sera pleinement appréciée
qu’une dizaine d’années plus tard. Peut-être
a-t-il fallu qu’A. Pinet se réfère à son
riche passé de chercheur pour qu’il ne se montre pas trop
surpris par le fait qu’un choix « par défaut »
(la commande répartie) se soit montré prépondérant
dans le succès rapide de son idée originale (la commutation
temporelle) .
La maquette réalisée à partir de ces choix fonctionne
bien et la fonction sans blocage est implantée, sur laquelle
André Pinet avait pris des brevets
vers 1960...
sommaire
André Pinet confirme le choix de l’architecture
décentralisée, d’une part en maintenant le
choix de calculateurs répartis et spécialisés
pour assurer les fonctions de marqueur, d’enregistreur, de traducteur
et de taxeur (solution inspirée des commutateurs « crossbar
» de type électromécanique), et d'autre part en
choisissant la solution d’un échange synchronisé
d’informations entre les mémoires circulantes. Cette solution
matérielle efficace permet de réduire la programmation,
mais est peu évolutive. Il sait qu’il est à contre-courant
de la vision des Bell Labs, qui privilégie une architecture
centralisée, qu’il connait bien, car juste avant de venir
à Lannion il a fait un séjour de longue durée
au sein des équipes travaillant sur la famille des commutateurs
électroniques ESS (Electronic switching systems). Il a bien
compris qu’une architecture centralisée nécessite
une programmation hors de portée du CNET.
Un autre choix effectué en 1963 est celui
du multiplexage à 32 voies, dicté par une vision
d’avenir du « tout binaire », alors qu’américains
et japonais travaillent sur la base de 24 voies, suivant une vision
conservatrice venant du multiplexage de voies analogiques.
Ce choix du 32 voies, validé par la Direction Générale
des Télécommunications, est proposé à
l’ensemble des administrations européennes via la CEPT.
L’accord européen sur cette norme est obtenu en fin 1968
et l’UIT en 1969 reconnait les deux normes européennes
et américaines. La reconnaissance mondiale de cette norme conforte
le CNET Lannion dans ses choix pour aller vers la réalisation
d’un réseau numérique complet.
André Pinet est bien conscient que le projet PLATON
est considéré à l’époque comme un
projet aventureux. Aussi il se concentre sur la réalisation
technique, qui est un plongeon dans l’inconnu, au moins dans
quatre domaines techniques : numérisation des signaux de parole
basée sur un échantillonnage et une quantification,
mise en œuvre de la connexion temporelle, réalisation
des organes de commande en temps réel du commutateur (établissement,
taxation, rupture des communications), et mise en œuvre de la
gestion informatique.
Après des travaux préliminaires
en 1962, il fixe en 1963 l’objectif d’une maquette de laboratoire
complète pour 1965 avec certaines simplifications, largement
en deçà de l’objectif final. Ainsi il choisit d’assurer
la connexion temporelle avec des signaux de parole modulés
en PAM1 (Pulse Amplitude Modulation) de façon à attendre
les premiers circuits intégrés, qui sont annoncés
par les fabricants de semi-conducteurs, notamment Texas Instruments.
Compte tenu de l’état technologique des
circuits intégrés en 1965, les composants de technique
DTL sont retenus pour le projet.
En 1965-1967 André Pinet et son équipe
se trouvent confrontés à différents choix avant
de se lancer dans la dernière phase du projet.
Le premier choix est celui des circuits intégrés, notamment
pour le codage PCM. En 1965 les seuls circuits intégrés
disponibles sont de type DTL à base de diodes, fabriqués
notamment par Fairchild. Ils apparaissent trop lents.
Comme le raconte plus tard L-J Libois, « Grâce
aux relations industrielles de la CGE, nous [le CNET] avons pu disposer
des tout premiers circuits TTL de Texas Instruments ». Ces circuits
TTL, à base de transistors, sont nettement plus rapides. Leur
emploi s’imposa en 1967.
(Lire une magnifique synthèse
de Louis Joseph Libois)
sommaire
Revenons à la CGE. En 1965, l'établissement
de Lannion se limite à 37 personnes dont 6 ingénieurs,
12 agents techniques, 7 mécaniciens et 7 câbleuses. La
croissance de la future SLE est d'abord très lente.
A son début, sa mission consiste à effectuer des études
sur les transmissions numériques et les antennes avant que
ne soient lancées celles concernant la commutation temporelle.
Pendant ce temps, la CIT développe ses usines de commutateurs
électromécaniques à Vélizy, Cherbourg,
Saintes, La Rochelle, un terrain pour une nouvelle usine à
Rennes est même acheté.
Un seul bâtiment de la CGE existe, le bâtiment 2, le long
de la route de Perros-Guirec et c'est aussi la période des
premières annonces et des premières implantations :
- En 1964, annonce de l’implantation des Lignes Télégraphiques
et Téléphoniques (LTT) sur une superficie de 6 à
10 ha pour des ateliers de fabrication avec promesse de 120 emplois
fin 1965, 250 fin 1966, 600 emplois fin 1969. Ouverture de l'atelier
pilote en 1965.
- La SAT a acquis 5 ha et démarre la construction de 3000 m2
d’atelier pour 120 emplois fin 1965.
- En 1965, ouverture de l’atelier pilote LTT.
C’est dans la Note Technique Interne NTI/39 datée
du 21 Juillet 1965 intitulée « Projet d’installation
d’un ensemble de commutation temporelle intégré
au réseau téléphonique général
dans la zone de Lannion-projet PLATON » qu’A. Pinet
décrivait la structure du futur système et définissait
les éléments à mettre en œuvre pour l’introduire
dans le réseau de Lannion à la place des équipements
existants.
La réalisation de ce projet ne pouvait se concrétiser
sans la participation d’un industriel. P. Marzin sut convaincre
A.Roux (président de la CGE) de se lancer dans l’aventure
en usant du seul argument dont il disposait : au travers de l’avance
prise par le C.N.E.T. dans le domaine des techniques temporelles,
la C.I.T. Compagnie Industrielle des Télécommunications,
faisant partie du groupe C.G.E., tenait sa seule chance, celle-ci
fût-elle mince, de s’émanciper de la tutelle qu’elle
subissait dans le secteur de la commutation – la C.I.T. fabriquait
du matériel Crossbar CP400 sous licence Ericsson. A. Roux jugea
vraisemblablement que le pari méritait d’être tenté,
d’autant plus que si la réussite impliquait des conséquences
considérables – elles seront énormes – pour
la C.I.T. , un éventuel échec ne pouvait mettre en péril
cette société. C’est ainsi que fut créée
la SLE (Société Lannionaise d’Electronique) au
début de 1966. Il est évident que la toute nouvelle
S.L.E. ne possèdait pas les compétences nécessaires
en commutation, temporelle ou non ; elle ne pouvait guère y
remédier qu’en puisant au sein du C.N.E.T., la direction
de cet organisme étant d’accord dans un souci de réalisme.
Ainsi L.J. Libois écrit-il que « Pour ma part, je pensais
que la solution la plus efficace était de transférer
non seulement des dossiers, mais aussi des hommes et même les
meilleurs »( !). Plusieurs ingénieurs du C.N.E.T furent
donc sollicités et acceptèrent les propositions de la
S.L.E..
Début 1966, la CIT contribue
au projet PLATON,
et au cours de l’été, quelques personnes du centre
de développement parisien de la CIT - Commutation arrivent
à la SLE à Lannion, ainsi qu’une équipe
de développement de liaisons MIC.
Pendant ce temps, Monsieur Libois, conscient que la meilleure méthode
pour faire du transfert de connaissances et de technologies est de
transférer quelques personnes, encourage discrètement
quelques ingénieurs à sauter la haie qui sépare
le CNET de la SLE.
C’est ainsi que le 1er octobre 1966, François Tallégas
et Jean-Baptiste Jacob prennent leur élan et arrivent à
la SLE (François Tallégas comme Directeur Technique).
Il faut distinguer J.B. Jacob, jamais à cours d’idées,
qui jouera un rôle majeur dans la conception du système
temporel de deuxième génération (E10B ou E10N1)
et bien sûr F. Tallégas, alors ingénieur au département
R.T.B. (transmission) qui, ayant fait part dans les mois précédents
à L.J. Libois de son désir d’évoluer vers
la recherche en commutation, se retrouva directeur de la S.L.E. à
la fin de 1966 .
Au sein du personnel fonctionnaire du C.N.E.T. imprégné
d’une forte culture de service public, certains ressentent de
l’amertume et s’élèvent contre le «
cadeau » fait à des intérêts privés.
Entre 1966 et 1969, une réussite de PLATON apparaît encore
bien lointaine à la majorité du personnel, si bien qu’il
est difficile de distinguer, dans l’opposition à cette
aide à l’industrie, entre conception de l’intérêt
public et frustration de chercheurs se voyant privés (très
partiellement) d’un « jouet » de laboratoire.
La maquette pré-industrielle à réaliser
avant exploitation réelle conserve la même répartition
de fonctions entre les différents organes que celle de la première
maquette. Mais l’évolution technologique est considérable.
Tous les ensembles logiques sont constitués avec des circuits
intégrés TTL Texas (après un échec cuisant
d’une maquette réalisée en cicuits intégrés
DTL beaucoup trop lents). Le réseau de connexion sans blocage
dispose de circuits MSI (middle scale integration). La mémoire-programme
de 1 024 mots du multienregistreur est encore constituée de
matrices à diodes mais une mémoire à couplage
inductif de 2 048 mots est à l’étude à l’AOIP,
autre constructeur associé au projet.
Un autre élément va s’avérer fondamental
: L.J.Libois et A. Pinet réussissent à convaincre leurs
collègues du Département Transmission du C.N.E.T. de
s’orienter à partir de la mi-1967 vers l’étude
d’un système MIC à 32 voies (25) partagées
chacune en 8 éléments binaires . Le bien-fondé
de leurs arguments, mais aussi leur qualité d’«
anciens » de ce département, ont dû leur faciliter
la tâche. Il n’empêche qu’il faut porter au
crédit des transmetteurs le fait d’avoir pris en compte
l’intérêt général. Cette norme 32
voies/8 eb sera adoptée par l’Europe en 1968 grâce
aux
efforts conjugués des Français et des Allemands, et
reconnue en1969 par l’Union Internationale des Télécommunications.
Les différents sous-ensembles de PLATON sont fournis à
un exemplaire par l’A.O.I.P. et la S.L.E. au C.N.E.T./Lannion
tout au long de l’année 1968. Ils sont d’abord testés
dans les laboratoires où ils ont été conçus,
le plus souvent en collaboration avec un représentant de l’industriel
dont la présence facilite grandement la prise en compte des
corrections (inévitables) à apporter sur les versions
suivantes.
Ils sont ensuite assemblés, toujours dans un local du C.N.E.T.,
pour constituer le commutateur prototype appelé « maquette
probatoire (PL1) »
sommaire
De la recherche à l'industrie
Afin de permettre à la France de prendre une avance industrielle
internationale, le CNET décidede contourner l'étape
de division spatiale et de développer directement la technologie
de division temporelle. Mais, même si PLATON et la technologie
de la division temporelle ont prouvé leur faisabilité,
il restait encore à couvrir le décalage temporel entre
le prototype et la production.
Une entreprise française pour un transfert de technologie
français
Le CNET a décidé de conduire l'industrie française
à l'indépendance À cette fin, le centre a demandé
à la CIT de produire le nouveau système. Les dirigeants
de cette entreprise relativement petite ont d'abord été
réticents à se lancer dans le projet, qui concernait
un domaine complètement nouveau. Mais l'offre était
si belle qu'il était impossible de refuser. En tant que filiale
de la Compagnie générale d'électricité
(CGE), la CIT a également dû tenir compte de l'avis d'Ambroise
Roux. Roux, qui était président de la CGE, était
très favorable au projet, d'abord en raison des bénéfices
qui seraient générés, et ensuite parce que le
caractère « gaulliste » de l'ambition industrielle
coïncidait avec ses convictions politiques. Une filiale de la
Cll : La Société Lanionnaise d'Electronique (SLE), créée
à Lannion à la fin des années 1960, était
l'organisation idéale pour assumer la partie la plus difficile
du projet : le transfert de la technologie d'un laboratoire d'Etat
à un entreprise privée. D'une part, aucun des ingénieurs
travaillant pour CIT n'avait les connaissances ou les compétences
nécessaires pour travailler efficacement avec la nouvelle technologie.
Par conséquent, SLE, qui était une petite entreprise,
a pu agir comme une interface entre CNET et la CIT.
Pendant la période de développement de PLATON, les ingénieurs
de SLE ont été étroitement impliqués dans
les travaux de CNET.
L'industrialisation
Dans la dernière phase de développement, les ingénieurs
de CNET en charge du projet, avec la bénédiction du
directeur de CNET, ont "déserté" et rejoint
SLE. Cette dernière partie du projet consistait en l'adaptation
des spécifications techniques aux standards du marché.
Le choix de nouveaux composants électroniques et de nouveaux
développements logiciels ont conduit au système EI0A.
Une usine spécialement conçue pour produire le système
est installée à Lannion en 1972. En 1975, sa capacité
de production annuelle atteint 200 000 lignes. +Le produit était
prêt. Il ne restait plus qu'au PTT de l'acheter.
Cependant, pour remonter un peu dans le temps, au cours des années
1960 et 1970, le niveau de développement du réseau téléphonique
français est passé d'un problème à un
scandale. L'humoriste Fernand Reynaud a écrit un sketch à
succès intitulé « Le 22 à Asnières
» qui pointait du doigt la situation malheureuse des abonnés
français. On disait : « En France, la moitié de
la population attend d'avoir le téléphone, l'autre moitié
attend d'avoir la tonalité. En conséquence, le président
Pompidou a décidé de mettre un terme à la situation.
La détermination de Bernard Esambert, conseiller du président,
et l'action d'Yves Guena, ministre des PTT, ont contribué à
lancer un plan puissant. Parallèlement la promotion de Pierre
Marzin de la direction du CNET (où il est remplacé par
Louis Joseph Libois) à la direction de l'administration des
télécommunications montre que l'avenir du réseau
national reposera sur la technologie française. Selon le plan,
la réorganisation serait à la fois structurelle et financière,
mais l'effort financier était si énorme que le budget
n'a pas été en mesure de le soutenir. Le gouvernement
a donc dû contracter un emprunt afin de poursuivre le financement.
La décision principale a été prise en 1969 et
quatre sociétés ont été créées
pour organiser ces prêts :
FINEXTEL (February 1970)
CODETEL Ganuary 1971)
AGRITEL Gune 1972)
CREDITEL (October 1972)
sommaire
Au CNET, la réalisation de mémoires à lignes
à retard magnétostrictives destinées au projet
PLATON était en cours depuis plusieurs mois, et c’est
Yves Samoël qui pilote l’opération.
A ce stade du développement d’un système de commutation
qu’on espérait industrialiser, il fallait y associer des
industriels.
L’AOIP est assez vite associée au développement
de l’unité de raccordement d’abonnés: l’équipement
de modulation d’abonnés (EMA).
Les années 1966-67 sont à la fois des
années de tâtonnement dans le choix des circuits intégrés
et de la mise en place d’un partenariat CNET-CGE. La réalisation
de la maquette probatoire de commutateur numérique se
trouve retardée d’un an et fonctionne début 1969,
ce qui permet le lancement industriel des premiers prototypes prévus
à Lannion et Perros-Guirec.
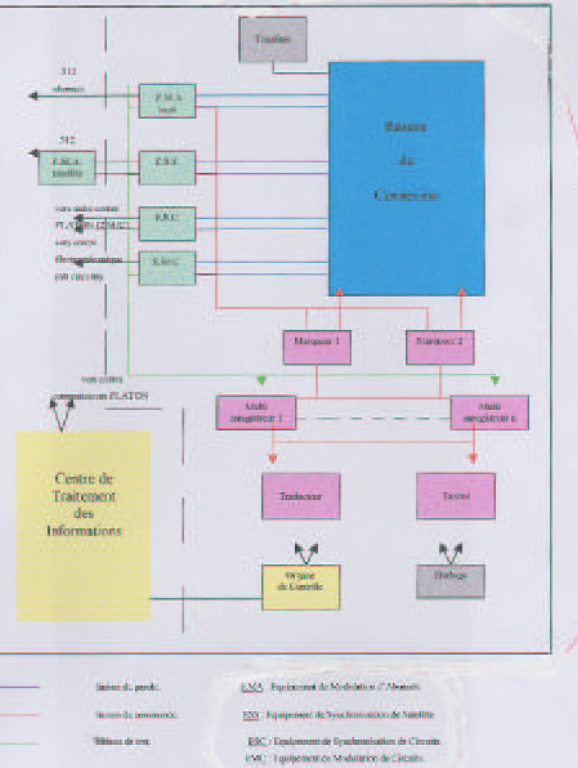 Diagramme simplifié de PLATON
Diagramme simplifié de PLATON
André Pinet et son équipe n’ont qu’un objectif,
celui de mettre le plus vite possible en fonctionnement des commutateurs
sur le territoire numérique du Trégor, même si
la voie explorée pourrait se révéler une impasse
à long terme.
Ce choix sera chanceux, car l’apparition des microprocesseurs
dans les années 70 changera la donne.
Et en 1990 P. Lucas pourra écrire : « cette structure
décentralisée, très en avance sur son temps,
s’est révélée être un bon choix lorsque
sont apparus les microprocesseurs, et c’est maintenant une caractéristique
« dernier cri » dont se vantent tous les constructeurs
modernes de commutation ».
Le choix d’une architecture décentralisée, qui
a été « le fruit d’observations et d’expérimentations
terre à terre et non pas le fruit de réflexions intellectuelles
», comme le note plus tard J-B Jacob, se révèle
donc comme une pleine réussite.
Lorsque l’AOIP choisit d’installer
un site en province en 1966, elle ne choisit pas Guingamp par
hasard.
Entre Morlaix et Tréguier, le Trégor devient, petit
à petit, une véritable plaque tournante de l’électronique
et des télécommunications en France, alors que quelques
années auparavant, le secteur était un désert
en matière de téléphonie. Guingamp n’échappe
donc pas au phénomène avec l’installation de
l’AOIP. Mais la proximité du Cnet n'explique pas tout
:
La présence des chercheurs et ingénieurs
ne fut que la première étape de la mutation industrielle
du Trégor. Ces mêmes groupes industriels privés
qui avaient créé des laboratoires décidèrent
la construction d’importantes usines de fabrication de matériels
téléphoniques dans la région. Les sites de
Lannion, Guingamp, Tréguier furent ainsi choisis pour trois
raisons : les aides à l’implantation en Province,
la proximité des centres de recherche, et la présence
d’une main-d’œuvre féminine abondante…
L’industrie électrique et électronique, qui
employait 200 personnes en Bretagne en 1960, passa à 12
800 en 1981, dont 5 500 dans les seules Côtes-du-Nord. Accompagnant
cette industrialisation rapide, un Institut Universitaire Technologique
fut créé à Lannion en 1969 ainsi qu’un
centre régional d’instruction des PTT.
L’usine LMT construite en avril 1967 employait 500 personnes
dont 98 % étaient d’origine bretonne. L’usine
LTT employait 950 personnes, celles de la SLE et de la SAT 650
personnes chacune. L’AOIP avait deux usines, l’une à
Guingamp avec 1 000 employés et l’autre à Morlaix
avec 305 personnes. Ces établissements avaient tous vu
le jour entre 1964 et 1967.
En vingt ans, le développement économique du Trégor
se traduisit par un doublement de la population de l’agglomération
de Lannion. En 1961, la fusion de cinq communes créa le
« grand Lannion », véritable concrétisation
du changement d’échelle des activités. Le cadre
administratif communal s’adaptait ainsi à la croissance
de l’agglomération. |
A la fin de l’année 1966, le CNET, reconnaissant
les avantages d'une nouvelle famille de circuits intégrés,
propose que la SLE développe les organes de commande et les
fabrique pour le commutateur de Perros-Guirec, qui serait
installé un peu plus tard que le commutateur de Lannion.
Pendant les années de développement de PLATON,
la coopération des équipes du CNET et de la SLE est
exemplaire du sommet à la base, et les succès de mise
en service des commutateurs de Perros-Guirec et de Lannion soudent
encore plus les liens entre les personnels.
Cette coopération entre le CNET Lannion et la SLE, puis
plus tard CIT devenue ALCATEL, va continuer des années et
permettre à l’industrie française des Télécommunications
de devenir l’une des premières du monde et de faire évoluer
le réseau de télécommunications français
vers l’un des plus modernes qui soit . L'effectif de la SLE est
de 80 personnes en 1966, 180 en 1968, 200 en 1969 et 1970, 450 en
1971.
Les commutateurs de Perros-Guirec et de Lannion ont
montré des performances assez encourageantes pour faire prendre
la décision de lancer la fabrication d’une présérie
de commutateurs PLATON que l’on va désormais appeler E10.
Cette décision a sans doute été facilitée
par le fait que Pierre Marzin était depuis 1968 directeur de
la DGT (Direction Générale des Télécommunications),
responsable de l’équipement et de l’exploitation
du réseau français.
Les deux premiers sites retenus sont Guingamp et Paimpol, dépendant
de la Direction Régionale de Rennes dont le Directeur était
Roger Légaré, également un fonceur éclairé.
Paréllement le MIC développe
son réseau
- En Mars 1966, la première liaison numérique métallique
expérimentale MIC à 36 voies temporelles plésiochrones
par câble souterrain est mise en service, en exploitation réelle,
entre Paris-Bonne Nouvelle et Chaville (78).
- Le 1er novembre 1969, la première liaison numérique
temporelle plésiochrone par Faisceau Hertzien sur MIC 256 voies
est mise en service en Basse-Normandie entre deux Tours Hertziennes
(Caen et Saint-Martin-de-Chaulieu), pour relier à la ville
de Caen (Centre de Transit) les villes de Vire, Flers et Condé-sur-Noireau
en liaisons numériques par Faisceau Hertzien sur MIC "32
voies" (qui sont en réalité des MIC 36 voies
adaptés en 32 voies, les MIC 32 voies standardisés étant
alors en cours de finalisation et non encore disponibles dans l'industrie).
- En Septembre 1975, une première liaison numérique
métallique plésiochrone en exploitation normale au départ
de Paris est mise en service à Paris Inter Archives (bâtiment
Pastourelle II),
- En Septembre 1976, une première liaison numérique
métallique expérimentale est mise en service entre Rennes
et Châteaubriant en technologie plésiochrone 140 Mbit/s
(TN4) - 139,264 Mbit/s exactement, soit 1920 voies téléphoniques.
Suivra en 1970, la première liaison numérique MIC
à 32 voies temporelles plésiochrones par câble
métallique souterrain est mise en service, en exploitation
réelle, entre Saint-Pol-de-Léon et Cléder, dans
le département du Finistère.
Cette technologie est bien au point et est essentielle dans les futurs
centres numériques du projet Platon.
sommaire
La
révolution E10 (abréviation : E
pour Électronique car 100% électronique, projet n°10)
Il porte un nom un peu barbare, E 10. Mais quand il voit le
jour, il est le premier commutateur
téléphonique numérique au monde.
le prototype conçu par le CNET a été ensuite
développé et industrialisé par la Société
Lannionnaise d’Electronique (SLE).
Il permet de relier bien davantage de lignes que les anciens modèles,
façon "Vous avez demandé le 22 à Asnières
?". .
Au cours de l’été 1967,
le CNET commençait la mise au point de ses équipements
et rencontrait beaucoup de difficultés dues à la technologie
DTL.
L’organisation du projet de « Réseau Numérique
Intégré » a donc été revue:
- on adopte la technologie TTL et les cartes de circuits imprimés
de grand format préconisées par la SLE,
- il n’y a plus qu’un seul projet comprenant les personnes
du CNET et de la SLE avec une répartition des taches en fonction
des compétences de chacun,
- les EMA sont toujours développées par l’AOIP
sous le contrôle du CNET
Début 1969, la SLE société
Lannionnaise d’Electronique, filiale du Centre de Recherche de
la CGE de Marcoussis, comprend un peu plus de 300 personnes. Le directeur
est M.Grobois, le directeur des laboratoires de Commutation et de
Transmission F. Tallegas, le directeur industriel, E. Escoula.
L’activité de la société est tournée
vers plusieurs domaines :
- Des activités d’études et de développements
:
- Un laboratoire d’étude et de développement, de
réalisation dans le domaine des antennes et des stations de
poursuite de satellite météo (M. Arzul), rattaché
à la Direction Industrielle.
- Des laboratoires d’étude et de développement
dans le domaine des transmissions dirigés par MM. Garnier,
Baudin.
- Des laboratoires d’étude et de développement
dans le domaine de la commutation, travaillant sur la maquette Platon
- Des Services coopérants qui comprennent essentiellement :
- Un bureau d’études d’environ 50 personnes comportant
3 sections correspondant aux activités des laboratoires : commutation,
transmission, météo.
- Un atelier de fabrication comprenant essentiellement des équipements
de mécanique, de tôlerie (M. Val) et une section câblage
(M. Madec) dont l’activité est essentiellement tournée
vers la fabrication à l’unité des stations de poursuite
et de réception d’images de couverture nuageuse et infrarouge
pour le compte des services de la Météo.
-Un service de contrôle et plateforme (M. Gandon)
-Un Secrétariat Général (M. Mathieu)
-Un service du personnel (M. Lelchat)
-Un service achats (M. Balthazar )
Le projet Périclès de commutation
spatiale à commande centralisée annonce le
passage au stade industriel en 1969
Produit par la Socotel, société de production
alliant CIT Alcatel et Ericsson, l'autocommutateur sera installé
à Clamart. La commutation utilise des relais Reed,
les deux calculateurs sont des 32 bits, avec 16 à 64 Kmots
de mémoire à tores controlée par bit de parité,
cycle 600 ns, dont 10K pour les programmes temps réel sont
protégés en écriture. Il y a aussi un bootstrap
de 1000 mots en mémoire morte à couplage inductif à
cycle 1 µs. L'adressage des programmes utilise un CO 16 bits
et des ruptures de séquence absolues, pour atteindre des instructions
qui paraissent fournir trois microopérations et un incrément
d'adresse ; l'adressage des données est différentiel,
les incréments valides se situant entre + et - 7 inclus.
Le bloc de calcul travaille sur 12 bits. Les périphériques,
manipulés à travers des registres externes de 32 bits,
comprennent des explorateurs de lignes et des distributeurs, ainsi
que deux téléimprimeurs et un tambour magnétique
de 64 Kmots organisé en secteurs.
Le logiciel temps réel comporte trois cycles d'exploration,
de durées 10, 100 et 400 ms ; toutes les sources de signaux
sont explorées à chaque cycle de 10 ms.
Périclès ne fut pas industrialisé.
sommaire
En coopération avec SLE au CNET, la maquette
expérimentale, de Commutation Temporelle
composée du minimum d'organes nécessaires, est opérationnelle
au mois d'Avril 1969 et permet de valider l'ensemble des cartes
composant chaque organe ainsi que la structure de la machine en fonctionnement
dynamique.
Le calculateur gère les communications à travers des
paires de lignes à retard à magnétostriction,
fonctionnant à 1,25 MHz et contenant 66 mots de 80 bits. Chaque
communication utilise un mot dans chaque ligne de la paire, de sorte
que l'ordinateur dispose de 160 bits d'information par transaction,
sur lesquels il revient 240 fois par seconde en gérant 66 communications.
Si un standard est capable d'établir plus de 66 communications
simultanées, on peut ajouter d'autres paires de lignes.
Dans cette phase initiale, il n’a pas été
jugé utile (ou possible) de rechercher sur le marché
le calculateur universel chargé, au deuxième niveau,
des opérations de supervision et d’exploitation, le Centre
de Traitement des Informations (C.T.I.). C’est donc le calculateur
RAMSES 1, conçu au C.N.E.T./R.M.E., qui assume le rôle
de C.T.I. pour le projet PLATON avec des programmes écrits
au C.N.E.T/Lannion.
Ce travail en commun a abouti à la mise en
service d’abord du commutateur de Perros-Guirec en décembre
1969. (au répartiteur, il y avait un ensemble de relais
qui permettaient de rebasculer les lignes d’abonnés sur
le système électromécanique en cas de besoin
).
Après une semaine de fonctionnement, pendant laquelle les observations
faites ont permis de suggérer quelques adaptations et modifications,
les lignes d’abonnés ont été basculées
sur le système électromécanique.
Pendant ces années de développement
du projet PLATON, la coopération des équipes du CNET
et de la SLE a été exemplaire du sommet à la
base et les bons résultats des mises en service des commutateurs
de Perros et de Lannion ont soudé encore plus les hommes.
Cette coopération entre le CNET-Lannion et la SLE, puis la
CIT devenue ALCATEL a continué les années suivantes
et a permis à l'industrie française des télécommunications
(qui fabriquait du Crossbar sous licence Ericsson ) de devenir l’une
des premières du monde et de faire évoluer le réseau
de France-Télécom vers l’un des plus moderne du
monde.
Commutateur prototype n°1 PLATON de Perros-Guirec Poste
mis en service le 6 janvier 1970, premier Commutateur téléphonique
Électronique Temporel du monde. Il sera mis hors service le
10 avril 1979 -
Dans le cas de PLATON I - Perros-Guirec, les travées sont en
forme de L, avec ce coude caractéristique à 90°.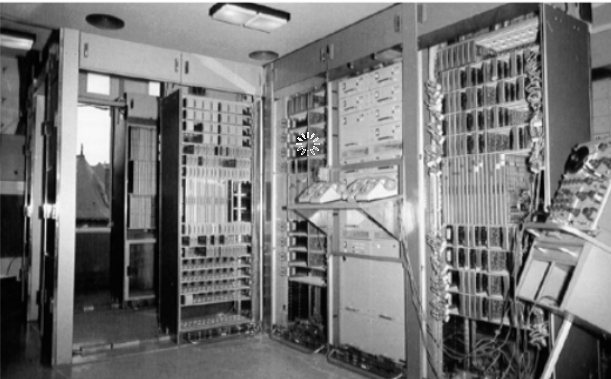


Les
téléimprimeurs ou terminaux d’exploitation - maintenance
sont des Teletype US ASR33 (les caractères sont portées
par une roue)
- Le premier prototype achevé celui de Perros-Guirec.
est le plus simple, Il est mis en service en janvier 1970 avec
plusieurs centaines d’abonnés. Il a une
capacité de gérer 800 abonnés
- Le Centre de Traitement des Informations (CTI) est un calculateur
de type RAMSES I conçu par le CNET.
- Le premier appel téléphonique expérimental
entre deux « abonnés tests » de ce même Commutateur
prototype est établi le 30 juillet 1969.
- Le premier appel téléphonique expérimental
sortant à destination d’un Commutateur téléphonique
du réseau est émis le 4 septembre 1969.
- Le premier appel téléphonique expérimental
entrant en provenance d’un Commutateur téléphonique
du réseau est reçu le 8 septembre 1969.
- Premier essai de mise en service temporaire, sur le réseau
téléphonique public, du premier Commutateur temporel
d'abonnés au monde, en France, à Perros-Guirec le 6
janvier 1970.
- L’inauguration du Commutateur PLATON par le Directeur Régional
des Télécommunications de Rennes, Roger Légaré
a lieu le 26 janvier 1970.
- Le basculage définitif des abonnés sur le commutateur
PLATON est effectif le 13 mars 1970 après stabilisation du
prototype par corrections diverses.
L’exploitation réelle met rapidement en
évidence les points faibles du système. Ceux-ci se situent
pour l’essentiel, et ce n’est pas une grande surprise pour
les concepteurs, au niveau des composants analogiques et des mémoires.
Pierre Marzin aimait dire en plaisantant que les plaintes de son boucher
sur les problèmes de connexion l'avaient informé des
problèmes de développement quelques jours avant les
rapports de ses ingénieurs.
L’équipement d’abonné, très complexe,
présente quelques faiblesses ; la plus mal perçue par
les abonnés est due aux thyristors qui commandent l’envoi
de sonnerie : trop sensibles aux moindres variations de leur environnement,
ils se déclenchent à tort, provoquant ainsi des tintements
répétés sur la sonnette des postes d’abonnés.
Quant à la qualité de la parole après codage
et décodage, bien que jugée bonne, elle est nettement
inférieure à celle prévue par la théorie.
On a conscience qu’il faudra rechercher des composants plus performants.
Les mémoires utilisées dans les organes centraux sont
des lignes à retard à magnétostriction. Celles-ci
confirment leur caractère fantasque, caractère amplifié
par les variations de température. Les conséquences
s’avèrent particulièrement pénalisantes
en cas de perturbation des mémoires de traduction qu’il
faut alors régénérer à partir du C.T.I.
En revanche, les ensembles logiques en circuits intégrés
T.T.L. confirment leur grande fiabilité. Tout au plus constate-t-on
quelques fautes intermittentes dans le réseau de connexion
dont la température de certains composants (supposés
fonctionner à 65 °) atteint 60 °, bien que de l’air
frais à 12 ° soit soufflé sur les bâtis. Un
tri plus rigoureux de ces composants est mis en œuvre.
En guise de conclusion (très provisoire), le rapport de mise
en service de Perros-Guirec indique qu’après quatre mois
d’exploitation réelle les problèmes évoqués
ont été réglés, à l’exception
de celui des lignes à retard dont le remplacement par des registres
à décalage M.O.S.6 est prévu dans un proche avenir.
La presse a rendu compte de cette première mondiale que représente
la mise en service réel d’un commutateur temporel, en
insistant toujours sur le fait qu’il s’agit du « téléphone
de l’an 2000 » comme l’indique Ouest-France du 29
septembre 1969 en relatant la visite du chantier de Perros-Guirec
par R. Galley (ministre des P.T.T.).
Quant aux quelque sept cents abonnés de Perros-Guirec, ils
vivent l’expérience avec une relative indifférence
; ils apprécient peu les tintements de sonnerie des premiers
jours d’exploitation et sont également déconcertés
par la rapidité d’obtention des tonalités d’invitation
à numéroter et de retour d’appel, habitués
qu’ils sont à la lenteur du vieux Système SRCT.
À partir du Commutateur PLATON, tous les Commutateurs
électroniques de type temporel sont capables d'accepter la
numérotation depuis l'abonné de départ en fréquences
vocales (DTMF) en plus d'accepter la numérotation à
impulsions décimales en vigueur en France depuis 1913.
sommaire
Après ces études sur les centraux, le
CNET ne s'arrète pas de travailler, et dans le domaine qui
nous concerne, on peut citer les lignes MIC et le réseau
Cyclade.
Les lignes MIC correspondent à la gestion, en commutation
temporelle, des lignes à grande distance, en commençant
par l'axe Paris/Bretagne.
Le module minimum est ici une voie de 2 Mbit/s, assurant le multiplexage
de 32 lignes téléphoniques standard échantillonnées
en 64 Kbauds : le CCSA sera, en 1971, le premier utilisateur non PTT
de ce dispositif.
Le réseau Cyclade est une étude de l' IRIA (Pouzin),
cherchant à introduire en France la commutation de paquets.
Le CNET est partie prenante de cette expérience qui intéressera
progressivement plusieurs groupes de calculateurs, dont ceux du CCSA
et ceux de l' IRISA (la version rennaise de l' IRIA). Ce sera le réseau
TRANSPAC, plus tard renforcé
d'un TRANSMIC.
Dans les années qui suivent, Cyclades sera une réussite
et ses principes seront adoptés par le CNET puis par le Ministère
des Télécom qui installera le réseau Transpac.
L'INRIA essaimera vers Rennes (IRISA) et vers Sophia Antipolis, où
seront installés des noeuds Transpac.
A la SLE au printemps 1970, le central de Perros-Guirec
vient d’être mis en service avec succès. Le CNET
décide de fêter l’évènement avec un
certain nombre de personnes de la SLE.
Quelques dessinateurs sont invités, après tout ce n’est
que justice ! Par contre, personne des ateliers n’est invité,
alors qu’ils ont tous beaucoup travaillé pour sortir les
équipements. Il eût été convenable d’y
inviter quelques représentants. Cela passe très mal.
Il y a comme un vent de révolte qui souffle au sein de la Direction
Industrielle.
Le repas officiel devant se dérouler au Yaudet, la DI sous
l’impulsion de son patron M. Piriou décide d’organiser
dans l’autre restaurant du Yaudet ce que nous appellerons l’Anti-Platon.
Cette soirée au Yaudet sera animée par une bande de
joyeux drilles qui mettront un point d’honneur à mettre
une ambiance autre que celle du repas officiel. Evidemment, cela va
contribuer à refroidir les relations déjà un
peu crispées entre la DT et les équipes de la DI.
Le CNET Lannion
en plein apprentissage
Le CNET Lannion, ne manquait
pas de candidats, pour une bonne part des bretons des PTT souhaitant
revenir en Bretagne, ce qui aboutit à un taux de 60 % des effectifs
d’origine bretonne à la fin des années 60. Mais
leur formation et leur expérience ne correspondaient que partiellement
aux besoins du CNET. Cette situation était apparue dès
1962 au Radôme de Pleumeur-Bodou. Jean-Pierre Colin, directeur
du site de Pleumeur-Bodou dans les années 80, l’a décrite
plus tard de la façon suivante. « Un personnel hétéroclite
et peu formé : beaucoup d’équipements à
mettre en œuvre étaient complètement inconnus du
personnel nommé à Pleumeur-Bodou. Il y aurait eu matière
à une formation longue et rigoureuse, ce qui s’est fait
évidemment plusieurs années après. Donc c’était
la « formation sur le tas » et d’une manière
très accélérée. Heureusement...chacun
y mettait du sien avec sa compétence et son dévouement...Personne
ne comptait les heures passées, ce qui importait, c’était
le résultat! »
Durant les années 60 différentes
sources de recrutement pour les ingénieurs et techniciens ont
été activées.
La source principale était tout simplement celle des fonctionnaires
des PTT. Du côté des inspecteurs principaux, inspecteurs
et contrôleurs, et autres grades notamment administratifs, des
candidatures sont venues de toute la France, ce qui a provoqué
un certain embouteillage sur les listes d’attente. Mais le plus
souvent les inspecteurs et contrôleurs avaient une formation
électromécanique, alors que les besoins se situaient
dans le traitement du signal numérique, l’informatique,
les hyperfréquences...
En ce qui concerne les techniciens contractuels il y avait des difficultés
à en recruter avec une bonne formation, car en 1962 les IUT
n’existaient pas. Quant aux sections de BTS elles étaient
peu nombreuses. Par contre du côté des Armées,
il y avait des militaires formés notamment en radio qui pouvaient
être disponibles au moment de leur reconversion vers le secteur
civil. En Bretagne la Marine était au premier rang et ainsi
en 1962 l’Ecole de Maistrance de Brest (section radio) était
le seul établissement formant des électroniciens.
L’usine CSF de Brest, fondée en 1962, en a directement
profité.
Pour les ingénieurs, durant ces années 60 la principale
source de formation est l’ENST qui forme à la fois des
ingénieurs du corps des télécommunications et
des ingénieurs dits « civils », embauchés
au CNET sous contrat. Ainsi une trentaine d’ingénieurs
du corps des
télécommunications est arrivée dans les années
60 et 70. Plusieurs font partie des pionniers de la commutation, notamment
Jacques Pouliquen, J. Vincent-Carrefour et Jean-Noël Méreur.
F. Tallégas a un parcours un peu différent, puisque
pendant ses cinq années au CNET Lannion, avant de rejoindre
la SLE, il fait des recherches dans le domaine de la transmission.
Du côté des ingénieurs contractuels les pionniers
sont J-B Jacob, M. Revel et Daniel Hardy. Ce dernier pendant la période
PLATON travaille successivement sur la signalisation sémaphore,
puis sur les organes de commande.
Les Ecoles formant des ingénieurs dans les domaines de l’électronique
et de l’informatique sont encore peu nombreuses : Supélec,
ISEP (Institut supérieur d’électronique de Paris),
ISEN (Institut supérieur d’électronique du nord)
et ESEO (Ecole supérieure d’électronique de l’ouest),
ESME (Ecole supérieure...électronique), ENSERB (Ecole
nationale supérieure d’électronique et radio de
Bordeaux)... Ces écoles font un effort pour moderniser leur
enseignement. A Supélec à partir de 1961 Grémillet,
un jeune chercheur du centre de recherche de Corbeville, fait un cours
sur les transistors et leur utilisation. Au même moment les
modulations par impulsions sont enseignées par S Albagli. De
son côté Elie Roubine, normalien, tout en étant
professeur de la Faculté des sciences de Paris s’implique
aussi fortement à Supélec. Il s’intéresse
aux applications des mathématiques à l’électronique
et aux télécommunications. Un de ses anciens élèves
de Supélec, Michel Henry, chercheur au CNET Lannion pendant
plus de trente ans, apporte son témoignage en 2016 : «
Elie Roubine est certainement l’un des professeurs de Supélec
qui m’a le plus captivé..., c’était surtout
un
enseignant de très grand talent, tant il mettait de conviction
dans ce qu’il professait. Je me suis débarrassé
de l’ensemble de mes documents de Supélec il y a déjà
bien longtemps, sauf deux : le tome 1 de “lignes et antennes
“ et un poly à couverture grise de Supélec intitulé
“introduction à la théorie de la communication”
et daté de 1968 ; les deux évidemment de E. Roubine.
Les deux m’ont longtemps été utiles». A partir
de son cours à Supélec Elie Roubine publie chez Masson
en 1970 un ouvrage en trois tomes, intitulé « Théorie
de la communication », qui fait référence pour
de nombreux chercheurs.
Il fallait aussi être attractif pour recruter les ingénieurs
et chercheurs formés en France. Or la Bretagne souffrait à
l’époque d’un déficit d’image. F.Tallégas,
futur directeur technique de CIT, alors jeune ingénieur au
département transmission du CNET à Issy les Moulineaux,
s’était entendu dire par l’un de ses aînés
: « vous voulez partir à Lannion, vous avez tort. Dans
un an ce centre sera transformé en colonie de vacances ! ».
De plus les chercheurs et ingénieurs avec de l’expérience
étaient très peu nombreux. André Pinet avait
attiré à Lannion un seul membre de son équipe
d’Issy-les-Moulineaux : Raymond Gouttebel. Et parmi les ingénieurs
travaillant directement sur PLATON, un seul avait acquis une expérience
industrielle avant de rejoindre le CNET : Maurice Revel à LMT.
L-J Libois et A. Pinet, conscients
de la situation, ont trouvé deux parades. La première
est de soutenir un programme ambitieux de création d’établissements
de formation en Bretagne. En formation initiale deux initiatives sont
prises rapidement : la création de l’INSA (1966) à
Rennes et la création des IUT de Rennes (1966) et de Lannion
(1970), avec des départements correspondants aux besoins de
formation en électronique et en informatique. Les premiers
diplômés de l’INSA arriveront à Lannion en
1971. Les IUT bretons commenceront à fournir des candidats
au moment où la SLE à Lannion fera des embauches massives.
L’effort sera aussi porté sur la formation continue, par
exemple mise en place d’un cours de techniciens en hyperfréquences
en 1972 au CNET Lannion.
La seconde parade, visant plus le court terme, a été
de préférer, pour le projet Platon, des solutions simples
risquant de faire appel à des techniciens pour les installations,
les réglages et les corrections, plutôt que des solutions
plus élaborées, nécessitant plus d’ingénieurs
de conception. Notamment les cartes avec ligne à retard à
magnétostriction étaient instables. Il fallait chaque
matin resynchroniser de nombreuses cartes avec un tournevis et un
oscilloscope. Et la marche forcée, imposée par Pierre
Marzin, augmentait le besoin de plus de techniciens pour mener plusieurs
installations en parallèle
.
sommaire
Numérisation
du Trégor-Goëlo
Les commutateurs de Perros-Guirec et de Lannion ont montré
des performances assez encourageantes pour faire prendre la décision
de lancer la fabrication d’une présérie de commutateurs
PLATON.
Les deux premiers sites retenus sont Guingamp et Paimpol, dépendant
de la Direction
Régionale de Rennes dont le Directeur était Roger Légaré,
également un fonceur éclairé.
Avec une présérie, la notion de coût du produit
prend de l’importance. Il se trouve que l’EMA, compte tenu
de l’état de la technologie, était un équipement
très coûteux. La SLE propose donc une autre unité
de raccordement d’abonnés: le CSA, constitué d’un
étage de concentration spatiale utilisant des relais à
tiges, suivi d’un équipement MIC de conversion analogique-numérique
en modules de 30 voies. Cette proposition a été acceptée.
Désormais la SLE avait la maîtrise complète du
produit.
Disons, cependant, que l’étude du CSA avait commencé
à la SLE à l’été 1969, et qu’à
cette occasion, en plus du réseau de concentration, la SLE
avait réfléchi à l’utilisation de nouveaux
composants TTL offrant des possibilités intéressantes;
les composants qu’on appelait les LSI (large scale integration)
étaient de plus en plus intégrés.
On disposait ainsi d‘un circuit de calcul (additionneur) de 4
bits et d’une mémoire 64 bits intégrant son circuit
d’adressage. D’où l’idée de définir
un processeur, ayant une architecture adaptée au « traitement
temps réel » des fonctions de commutation. On lui donna
le nom de code: Elément Logique Standard (ELS), signature légèrement
cryptée de la SLE. Dans nos objectifs, il était destiné
à remplacer les logiques câblées et spécifiques
des différents organes de commande du E10 .
Même si la technologie est loin d’être stabilisée
l’objectif du CNET, n’est pas de se limiter à la
seule fonction de commutation numérique, mais de numériser
un territoire entier, à la fois pour enrichir l’expérimentation
et pour en faire une vitrine. C’est le Trégor qui est
choisi.
Malgré de nombreux retards dans la fourniture
des équipements et donc une trop brève mise au point,
le commutateur temporel Lannion III se substitue à Lannion
II le 16 juin 1970 en présence de Robert Galley, ministre
des P.T.T.
Si le nombre d’abonnés locaux raccordés est faible
(environ 600), il reste que Lannion III (comme Lannion II précédemment)
fait transiter tous les appels vers ou de l’extérieur
pour tout le groupement de Lannion. La charge de trafic correspond
à peu près à celle de 4 000 abonnés urbains
; mais surtout un blocage prolongé ou un fonctionnement dégradé
du système ne pourrait passer inaperçu de l’ensemble
du réseau français, et encore plus en période
estivale.
Aussi, l’événement est-il assez largement traité
par la presse, le ton des articles laissant deviner qu’ils sont
à peu près le reflet de communiqués venant du
C.N.E.T. ou de la Direction Régionale de Bretagne. Le 12 juin
1970, Ouest-France annonce, dans la page « Côtes-du-Nord
» que « Mardi, à Lannion, M. Galley, ministre des
P.T.T., mettra en service le téléphone de demain ».
L’article se termine sur une note optimiste puisque « ce
prototype sera en service dans tout un secteur Ouest avant de s’étendre
sur la France et l’étranger ». Dans l’édition
du 16 juin du même journal, la Direction Régionale promet
une obtention plus rapide de la tonalité et pour plus tard
l’accès aux postes à clavier et à des services
nouveaux (ceux commercialisés de nos jours sous le nom de «
services confort »).
Enfin, le 17 juin 1970, toujours dans Ouest-France, il est dit que
« via PLATON, les deux ministres, Messieurs Galley et Pléven,
ont échangé une communication téléphonique
entre Lannion et Paris ».
En réalité, l’été 1970 constitue
pour Lannion III ce qu’un euphémisme désigne comme
une « période assez délicate de rodage ».
Faute d’un temps suffisant, les nombreux essais nécessaires
pour tester les différentes configurations n’ont pu être
effectués. Il faut y remédier par une présence
quasi-permanente sur le site d’ingénieurs et techniciens
du C.N.E.T., y compris le dimanche. Quelques plannings de vacances
estivales ont même dû être modifiés, ce qui
n’est guère habituel au sein d’un organisme normalement
protégé des contraintes qu’impose la permanence
du service. L’activité dans la salle du commutateur Lannion
III est à peu près aussi forte la nuit que le jour.
Il faut en effet profiter de la période nocturne de trafic
presque nul pour réaliser les corrections les plus urgentes.
Grâce aux efforts de tous, la situation se stabilise et la période
difficile s’achève sans qu’elle ait donné
lieu à des réactions aiguës de la part des abonnés.
Le commutateur Lannion IV, remplaçant du commutateur
SRCT Lannion I pour desservir les quelque neuf cents abonnés
de la ville, est mis en service sans difficulté particulière
le 18 juin 1971.
En inaugurant Lannion IV, P. Marzin (devenu Directeur Général
des Télécommunications en avril 1968) annonce que toutes
les Côtes-du-Nord seront équipées avec le système
PLATON. En cette même occasion, E. Julier (Directeur du C.N.E.T./Lannion
remplaçant L. J. Libois devenu Directeur du C.N.E.T. au départ
de P. Marzin.) dit que « Perros-Guirec fut un acte de foi, Lannion
III un acte d’espérance et Lannion IV un acte de charité
»... (sans doute pour rappeler à la Direction Régionale
de Bretagne que le C.N.E.T. avait presque tout payé).
L’équipement intégral du groupement de Lannion
en système temporel se poursuit jusqu’à la fin
de 1972 en remplaçant progressivement les centres locaux électromécaniques
par des satellites électroniques.
Deux centres satellites temporels de 500 abonnés de
Plestin-les-Grèves et Saint-Michel-en-Grèves,
reliés au Commutateur nodal de Lannion III, seront mis en exploitation
en Mai 1971.
Un bilan établi à l’automne 1971
met en évidence l’intérêt de l’exploitation
centralisée au C.T.I. et la fiabilité des ensembles
logiques et indique que des solutions de remplacement sont en cours
pour pallier la faiblesse relative des circuits analogiques (équipements
d’abonnés, codeurs, décodeurs, lignes à
retard à magnétostriction). « Les résultats
obtenus et les améliorations... permettent d’affirmer
que l’exploitation du système sera satisfaisante à
la fois sur le plan technique et sur le plan économique...
» .
La volonté des décideurs de démontrer rapidement
la viabilité et l’intérêt des systèmes
temporels associés à la transmission MIC n’a été
possible que grâce à deux facteurs. Le premier est la
présence permanente sur le site d’ingénieurs et
techniciens du C.N.E.T. très expérimentés et
disposant de plus auprès d’eux des concepteurs capables
de trouver une solution rapide aux défauts constatés.
La motivation des uns comme des autres a été à
la mesure de leur désir de prouver qu’un centre de recherches
pouvait être aussi performant à Lannion qu’à
Paris. Le second facteur tient aux exigences très relatives
des abonnés à cette époque, habitués qu’ils
étaient au service certes permanent, mais très peu efficace,
que leur fournissait le réseau téléphonique.
Le pari PLATON serait impossible de nos jours car les performances
actuelles du réseau combinées aux conditions de concurrence
ne laissent guère de place pour une éventuelle indulgence
des clients.
sommaire
Le "Plan Calcul"
était un plan gouvernemental français lancé en
1966 par le général De Gaulle sur l'impulsion de Michel
Debré, destiné à assurer l'indépendance
du pays en matière de gros ordinateurs.
La
CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique) créée
en 1966, aidé financiérement par le gouvernement selon
le Plan Calcul, avait abordé le domaine des ordinateurs industriels
avec des matériels de la série 90, et diffuse depuis
les ordinateurs 10010 et 10020 qui lui permettent d’occuper
la première place en Europe parmi les constructeurs de ce type
de machine. A la fin de 1970, deux cents 10010 et cent 10020 seront
en service en France ou à l’étranger.
Dès 1968 le premier CTI Centre
de Traitement des Informations à
l'étude, utilisa le Modèle 10010
(assembleur ASTROL et le FORTRAN).
 le CTI Modèle CII 10010, du Commutateur Prototype PLATON
Lannion III.
le CTI Modèle CII 10010, du Commutateur Prototype PLATON
Lannion III.
Le calculateur 10010 (CII), avec un disque dur de 128 k octets, permet
de créer les coordonnées des abonnés dans le
commutateur et de stocker la taxation des appels de plusieurs commutateurs.
CII avec le plan calcul se limitera à une fabrication du 10010
en OEM , mais relança en septembre 1969 le système sous
le nom de Iris 10 dans des configurations "packagées".
Sous ce nom générique, la CII offre des systèmes
complets, intégrant dans une conception unique un ensemble
de matériels comprenant un ordinateur CII 10 010 et les programmes
d'exploitation correspondants.
Pierre Marzin avait dit au nouveau directeur régional
des télécommunications, R. Légaré
: « tu feras Paimpol, Guingamp, Lannion...en électronique...
» . Cette mise en exploitation a été une grande
aventure, menée par trois partenaires : le CNET,
la SLE et la Direction Régionale des Télécommunications
de Bretagne : « Le délai - c’était pour
1972 - ça faisait moins de deux ans. Il fallait une plate-forme
d’équipements en service réel qui serve de vitrine
au plan national, mais surtout au plan international ».
Avec le partenaire
Alcatel, la numérisation du Trégor commence par
les centraux de Lannion.
Le commutateur Lannion III, le premier centre nodal avec plusieurs
codes de signalisation, est le plus difficile à mettre en œuvre.
« En réalité, l’été 1970 constitue
pour Lannion III ce qu’un euphémisme désigne comme
une « période assez délicate de rodage ».
Faute d’un temps suffisant, les nombreux essais nécessaires
pour tester les différentes configurations n’ont pu être
effectués. Il faut y remédier par une présence
quasi-permanente sur le site d’ingénieurs et techniciens
du CNET, y compris le dimanche...L’activité dans la salle
du commutateur Lannion III est à peu près aussi forte
la nuit que le jour. Il faut en effet profiter de la période
nocturne de trafic presque nul pour réaliser les corrections
les plus urgentes. Grâce aux efforts de tous, la situation se
stabilise ».
A l’été
1970, la SLE propose au CNET l’utilisation de cet ELS dans
le CSA, ainsi que dans les équipements de raccordement et de
synchronisation des circuits MIC (GSM et GSS), pour les installations
de Guingamp et de Paimpol. L’accord a été obtenu
très rapidement.
A la SLE nous avons aussi pris la décision de remplacer les
lignes à magnétostriction par des mémoires à
registres à décalage MOS de 1024 bits qui apportaient
une bien meilleure qualité de service. En rentrant de vacances,
nous étions donc au pied du mur; il a fallu développer
tous ces équipements dans des délais très courts
puisque Guingamp et Paimpol devaient être mis en service à
la fin de l’année 1971. Il fallait pendant ces quelques
mois: développer, tester, valider, fabriquer et mettre en service.
Nous étions une petite structure, certaines procédures
se chevauchaient nécessairement et la qualité s’en
ressentait sans doute un peu.
Au
niveau architectural et fonctionnel
:
Le premier sous-réseau du Commutateur PLATON,
qui n’est, rappelons-le, qu’un prototype, est équipé
d’un unique Traducteur (TR), d’un seul Taxeur (TX) et de
2 Multienregistreurs (MR) (nombre de Multienregistreurs extensible
à 8 si nécessaire). Ces 3 organes constituent l’organe
de commande du Commutateur. Il est également pourvu de 2 Marqueurs
(MQ).
- Le Traducteur (TR) stocke le routage des conversations téléphoniques
suivant les abonnés demandés.
- Les 2 Multienregistreurs (MR) assurent le déroulement et
le séquencement de l'établissement en temps réel
des communications et leur arrêt.
- Le Taxeur (TX) est chargé d'établir et de comptabiliser
les taxes des conversations pour chaque abonné en temps réel.
- Les 2 Marqueurs (MQ) assurent l'interface entre l’organe de
commande constitué et les Unités de Raccordement d'Abonnés
de 1ère génération, nommés Équipements
de Modulation d’Abonnés (EMA) et les circuits de sortie
(raccordés au reste du réseau téléphonique)
nommés Équipements de Modulation de Circuits (EMC),
via le Réseau de Connexion (CX). Les
matrices d'expansion/concentration des CSA sont réalisées
avec des relais reed à 3 contacts : 2 contacts pour le transports
des conversations analogiques et 1 contact de maintien électrique
(même principe que pour le commutateur semi-électronique
spatial PÉRICLÈS).
- Le Réseau de Connexion (CX), dans un Commutateur PLATON est
100% de type temporel, à un seul étage, de type T, d'une
capacité de 32 Unités de Sélection, capable de
commuter un maximum de 64 multiplex numériques MIC.
- Chaque EMA peut héberger 511 abonnés (la position
Zéro étant impossible).
- Chaque EMC peut être relié à 62 circuits de
transit.
- Est également présent un Organe de Contrôle
(OC) chargé des opérations de test et de maintenance
du système.
Le second sous-réseau du premier prototype PLATON
est assuré par le Centre de Traitement des Informations (CTI),
qui est constitué par un calculateur RAMSES I créé
par le CNET, chargé de gérer, en différé
dans le cadre du service normal, le Commutateur. (Ce calculateur est
remplacé quelques mois plus tard par un CII-10010, plus puissant).
L’équivalent
de la duplication de certains organes de commande est théoriquement
assuré dans le Commutateur PLATON : en cas de panne du Traducteur
(TR) ou du Taxeur (TX), la fonction défaillante peut-être
reprise en secours par le Centre de Traitement des Informations (CTI)
associé à l’Organe de Contrôle (OC) qui peuvent
ainsi suppléer en temps réel à certaines avaries
partielles du Commutateur.
Le commutateur Lannion IV est installé beaucoup plus
facilement en juin 1971 .
sommaire
1971 A la SLE La prise de conscience
La réalisation des circuits imprimés se fait par collage
de rubans autocollants et de pastilles noires sur un support du film
transparent. La densification des pistes (passage d’une piste
entre deux pastilles), ainsi que l’avènement du trou métallisé
nécessitant le perçage avant gravure, rendent très
difficile, voire impossible, la réalisation des circuits imprimés.
Il est alors envisagé de digitaliser les positionnements des
pastilles et le tracé des pistes.
Cela nécessite l’investissement d’un photoplotter
capable de réaliser de tels films et ce dans un environnement
contrôlé.
Le choix est assez vite fait entre le fabricant Gerber et le français
Secme. On choisira français pour des raisons de prix et de
SAV.
Le matériel sera implanté au sein du labo photo dépendant
du Bureau d’études.
Une visite effectuée au centre de Bull à Angers nous
fait prendre conscience de la nécessité de travailler
en atmosphère contrôlée en température
et surtout en hygrométrie (55% +/- 5%) . Il faudra donc refaire
complètement l’ensemble des salles qui deviendront avec
difficulté des salles grises (La société Rineau
réalisatrice ne respectera jamais le cahier des charges, rendant
la production de films difficile surtout pendant la période
d’été). Il faudra plus tard recasser entièrement
l’ensemble des salles.
Les ennuis commencent avec la réalisation des centraux de Guingamp
et de Paimpol en 1972.
L’effet de la montée en quantité de cartes et de
bâtis produits met en évidence les défauts précédemment
masqués :
- courts-circuits sur les cartes
- erreurs d’implantation de composants
- erreurs de câblage sur les fonds de panier
- non optimisation des nappes de câbles
- flèches sur les plateaux rainurés SOCOTEL
- différents aspects des bâtis (gris martelé)
- différences de couleur (couleur vieil or imposée par
le client) sur les bandeaux de cartes
- etc...
La première prise de conscience de la nécessité
de penser à un développement industriel viendra de la
séparation du Bureau d’Etudes en deux entités :
- Le BE en Direction Technique qui continuera à créer
les plans de définition du produit.
- Le BEI rattaché à la Direction Industrielle qui aura
pour mission de fournir aux ateliers les données (essentiellement
des plans à ce moment) nécessaires à l’exécution
des ordres de fabrication. A ce titre, lui sont rattachés le
labo photo et le photoplotter, élément vital de la fabrication
de circuits imprimés.
Pour autant, les ateliers ne disposent toujours pas de services méthodes
pour l’étude des procédés de fabrication
et des gammes, la Direction Industrielle n’en ressentant pas
le besoin.
Tout au plus, sur l’insistance de certaines personnes, se dotera-t-on
d’une machine du type ORMIG pour générer en une
seule fois l’ordre de lancement (OF), le bon de sortie magasin,
certaines gammes de fabrication mais tout ceci est encore manuel.
Constitution de l’équipe de méthodes industrielles
en 1972
Le hasard fait quelquefois bien les choses : la Direction Industrielle
récupère un ingénieur embauché initialement
par la Direction Technique mais dont le profil et l’expérience
semblent mieux convenir à la Direction Industrielle : il s’agit
de M. Demoury qui sera bientôt rejoint par deux autres ingénieurs
venant également de Bull, à Angers : MM. Le Masson et
Thomas, puis d’un technicien chimiste, M. Tran Van Hut.
Cette équipe forte de son expérience en production va
dupliquer et adapter les procédés en application chez
Bull.
En fait, sa première tâche va être de constituer
le projet de transfert de technologie industrielle à la Pologne,
et donc de constituer « ex nihilo » et de façon
détaillée, des notices relatives aux procédés
et aux procédures de fabrication, de contrôle et de test
sur des équipements pas forcément tous essayés.
Mais paradoxalement, ce travail financé par le projet export
contribuera à l’organisation des futurs ateliers de Tréguier
et sera d’une importance vitale pour les transferts ultérieurs
de technologie.
La décision de réaliser sur le Trégor une unité
de production d’autocommutateurs de type E10, obtenue de la Direction
Industrielle de la CIT (sur forte incitation de la Direction de la
CGE), va permettre de mettre en œuvre les solutions retenues
par le Service Industrialisation.
Le site choisi sera celui de Tréguier où une partie
de la production a déjà été implantée
dans l’ancien hospice de façon à soulager le site
de Lannion. Ce site n’a rien de rationnel puisque le processus
de fabrication des cartes équipées se fait sur plusieurs
niveaux en empruntant des escaliers vermoulus.
La nouvelle unité de production est annoncée pour une
capacité de 100 000 lignes (en fait elle atteindra 200 000
lignes).
Fait exceptionnel, l’usine de Convenant Vraz sera conçue
à partir de rien, en plein champ, et autour du produit et de
son processus de fabrication (ce cas de figure ne se renouvelleramalheureusement
plus).
Les services d’industrialisation joueront beaucoup aux «
legos techniques » pour maquetter les ateliers.
Pendant ce temps, des contraintes industrielles seront rédigées
et acceptées non sans âpres discussions par les Services
Techniques. Elles porteront essentiellement sur les contraintes d’implantation
des composants découlant des procédés industriels
de gravure des circuits imprimés et d’implantation des
composants.
Des campagnes de réimplantation seront organisées en
vue de supprimer des Ordres de Corrections sur les cartes les plus
critiques .
L’intendance doit suivre : Une unité
de production aussi performante soit-elle ne saurait fonctionner sans
approvisionnements et sans données de production : le BEI créé
au début des années 70 va voir son rôle précisé.
Une décision de l’Administration va bouleverser les modes
d’acheminement des documents par l’obligation de réaliser
des archives sur support microfilm au format de 35mm. Ce format était
jusque là peu utilisé, le microfilm est inséré
dans une carte perforée permettant le tri rapide des documents
avec un niveau de qualité correct puisque les dossiers originaux
sont récents. Cette technologie, récente pour l’époque,
va bouleverser la gestion documentaire.
-Le BEI va changer d’appellation pour devenir le GID (Gestion
des Données Industrielles). Ses fonctions au fil des mois devront
s’étoffer et suivre l’évolution du produit
et de son développement.
-L’absence de DAO oblige à vérifier la cohérence
des dossiers réalisés par les équipes de conception
: les erreurs sont fréquentes entre les nomenclatures et les
schémas.
-Les lancements en production sont maintenant informatisés
sur un calculateur PDP11 de DEC, avec un logiciel du type MRP. Il
faut donc en urgence établir des règles de codification
des articles et saisir les nomenclatures codifiées (pour mémoire,
elles seront saisies « n » fois en fonction des divers
logiciels de gestion de production qui vont se succéder du
fait des changements de système de gestion).
-Les documents sont microfilmés dès le feu vert de cohérence,
encartés et diffusés sous forme de microfilm ou de papier
aux demandeurs (usines ou autre services). Cette activité fonctionne
comme un centre de frais avec facturation aux demandeurs.
-Le microfilm permet de mettre rapidement à disposition des
unités les documents.
L’articulation de la documentation imposée par la norme
SOCOTEL ZAZ 4101 facilitera la gestion et la codification des pièces
issues de plans. C’est ainsi que les centres de production se
dotent d’une structure analogue au GID en jouant en local le
même rôle. Ce mode de fonctionnement sera une partie intégrante
de la plupart des contrats de transfert de technologie.
-Rapidement, il faudra également diffuser aux usines les supports
de données des équipements de câblage et de test,
essentiellement des rubans perforés et des disquettes, avec
le contrôle intégral et la constitution d’équipements
alors inexistants, la plupart des équipements se contentant
d’effectuer des contrôles de bits de parité.
-Devant le nombre de références, le nombre de destinataires,
le niveau de détail demandé (au plan près), la
nécessité de facturer la prestation, il devient nécessaire
d’informatiser cette fonction. Devant le peu d’intérêt
manifesté par les équipes informatiques du Centre Technique,
il a bien fallu se débrouiller avec les moyens du bord. Après
d’âpres discussions, l’autorisation est obtenue de
louer un calculateur Bull qui assurera la formation informatique des
responsables et celle des opérateurs.
sommaire
La décision de mettre
en service Guingamp est prise le Lundi de Pentecôte au soir
devant un verre de bière.
L’ensemble du personnel d’installation SLE, assisté
de quelques personnes des Etudes de la SLE et du CNET, travaille ce
Lundi de Pentecôte et se réunit en soirée dans
le café (restaurant de la Place de Verdun à Guingamp
pour partie des acteurs, café à Pontrieux pour les responsables,
peu importe, les deux lieux sont sur la rivière le Trieux)
pour une réunion d’avancement du chantier. Au vu de la
situation, F.Tallegas propose à R.Légaré de travailler
la nuit du lundi, de se reposer le mardi soir et de basculer le trafic
sur le E10 le mercredi soir.
Ce plan est adopté et réalisé après un
dîner en commun dans ce restaurant.
Le
premier Commutateur E10N4 prototype (équipé d'Unités
de Raccordement d'Abonnés de type CSA à mini relais
à contacts scellés) est mis en service en France le
24 mai 1972 à Guingamp (Guingamp Centre 1 (CN21)). (Sa
Mise hors service interviendra le 11 juin 1980).
Ce produit E10 Niveau 4 est installé à Guingamp et aux
centres satellites comme Bégard, Pontrieux, Lanvollon,
Bourbriac, Callac, Belle-Isle en Terre), mis en service dans
la nuit du 24 au 25 Mai 1972, et Paimpol (avec des centres
satellites comme Bréhat), mis en service dans la nuit du 30
Juin au 1er Juillet 1972, avec une qualité de service équivalente
à celle du Crossbar; ces deux premiers sites dépendent
de la Direction Régionale des Télécommunications
de Rennes dont le Directeur est Roger Légaré, également
un fonceur éclairé.
 Le Commutateur Prototype E10N4 - PLATON
- Guingamp
Le Commutateur Prototype E10N4 - PLATON
- Guingamp
Au premier plan, dans la première travée, 3 baies de
Concentrateurs Spatiaux-temporels d'Abonnés (CSA), qui portent
les cartes d'abonné.
Un second perfectionnement important
est le remplacement des cartes mémoire à Lignes à
Retard Magnétostrictive par des cartes à Registres à
Décalages conçues à partir de circuits intégrés
de type TTL, ce qui permet de stabiliser et de fiabiliser facilement
le fonctionnement des Commutateurs.
Le second et dernier prototype E10N4 - PLATON de Paimpol est
mis en service le 30 juin 1972 et Hors Service le 11 juin 1980
.
Chaque
CTI est équipé, en ce qui concerne les premiers commutateurs
de la présérie installés entre 1972 et 1975,
d'un calculateur Mitra 15 de la société SEMS.
 Centre de Traitement des Informations de type MITRA 15.
Centre de Traitement des Informations de type MITRA 15.
Ultérieurement, tous les Commutateurs E10N4 installés
en France seront ensuite convertis en commutateurs E10N3 au niveau
fonctionnel, grâce au remplacement de leur Centre de Traitement
des Informations (CTI) par un calculateur Mitra 125.
Les
deux premiers Commutateurs E10N4 - PLATON Prototypes de Guingamp et
de Paimpol ainsi que les trois prototypes PLATON et l'ensemble des
satellites déjà mis en service précédemment,
constituent alors le premier Réseau Local Intégré
entièrement maillé en technologie temporelle dans
le monde.
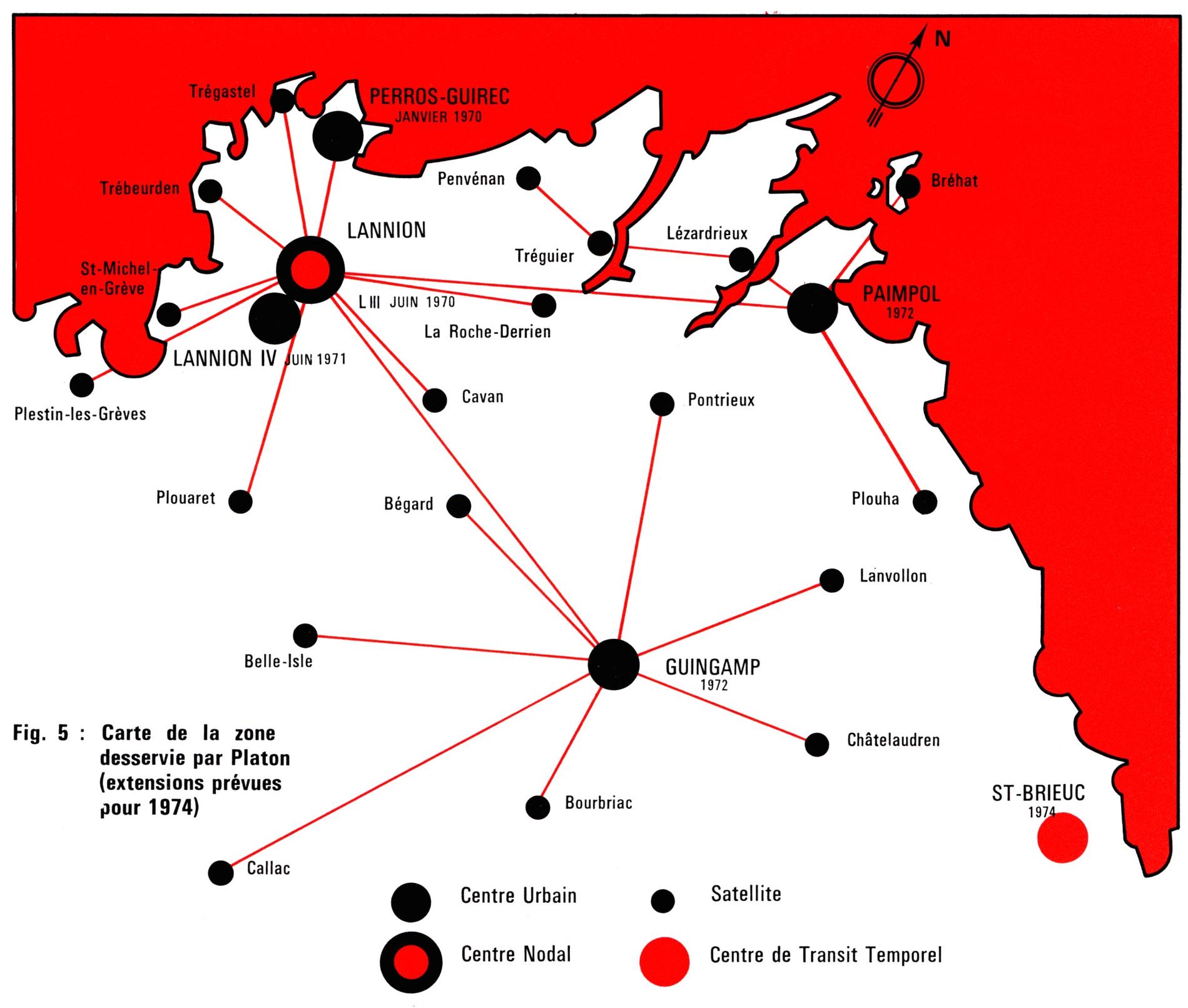
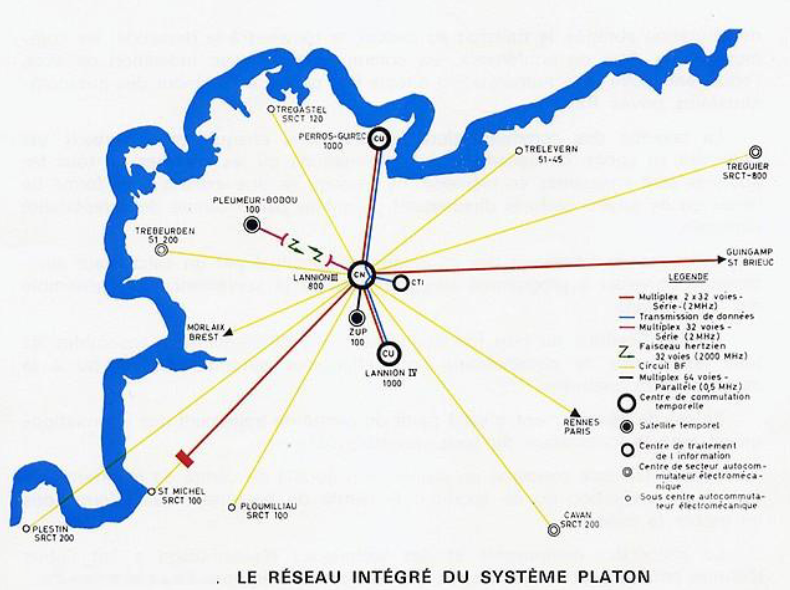
Le
Commutateur E10N4 marque le début de la mise en industrialisation
du projet PLATON, mais voit aussi ses caractéristiques améliorées.
Notamment, les Commutateurs E10N4 voient leur Réseau de Connexion
supporter jusqu'à 15.000 abonnés, sous 64 Unités
de Sélection, pour un trafic de 1.200 erlangs.
Aussi en 1972, le Telsat 15000
est le premier modem (2 Mbauds) de technologie MIC réalisé
pour le compte du CNET, qui inaugure ce nouveau mode de transmission
numérique sur la ligne Paris - Bretagne. Le SCTI en sera le
premier client, à travers le Centre de Calcul Scientifique
de l' Armement.
et
de Ericsson Electronique. La nouvelle société comporte
2 établissements, celui de Lannion et celui de Boulogne-Billancourt
qui se
consacre au développement du E12, système temporel qui
équipera quelques centres de transit. L'effectif de Lannion
est de 640 personnes en 1972, 880 personnes en 1973, 1000 personnes
en 1974 et 1200 personnes en 1977. Le rythme des nouvelles embauches
est important.
A partir de fin 1972 et en 1973, on a commencé à parler
exportation et nouveaux cahiers des charges. De plus, la filiale de
CIT, la société TELIC qui fabriquait et commercialisait
des commutateurs privés électromécaniques de
petite et de moyenne capacité, avait des demandes de commutateurs
de grande capacité (2000 à 4000 lignes), avec des fonctions
Centrex . Par ailleurs, la technique numérique intéressait
des grandes
sociétés (banques, assurances, etc..).
La filiale TELIC nous demande donc d’adapter le système
E10 au traitement des commutateurs privés de grande capacité.
Il est apparu que les organes de commande n’étaient pas
adaptables pour le traitement assez sophistiqué des fonctions
des commutateurs privés de grande capacité.
Les directions de la SLE et de la CIT ont pris la décision
de financer le développement d’une nouvelle génération
d’organes de commande, non sans en avoir informé la direction
du CNET-Lannion.
Cette nouvelle génération d’organes de commande
a été définie et développée à
partir du processeur ELS qui utilise une mémoire centrale TTL
de 256 kbits comprenant le circuit d'accès.
Après la première étape du réseau
du Trégor, achevée à la fin 1972, la SLE
assure la réalisation d’équipements pour différents
sites avec raccordements d’abonnés dans l’ouest de
la France : Sablé et la Flèche en 1973,
Poitiers en 1974. Puis il s’agit aussi de centres de transit
: Saint-Brieuc en 1975 et au Jardin des Tuileries à Paris en
1977 (8 commutateurs maillés).
Durant cette période La SLE procède à des améliorations
technologiques et industrielles et obtient de meilleures performances.
La réalisation des autres commutateurs
de la présérie et quelques autres s’est faite avec
les mêmes dossiers de fabrication.
Le Commutateur E10N4- La Flèche-sur-Sarthe
1 est mis en service le 6 avril 1973. Il est le premier de la présérie
E10N4.
- S'ensuit le Commutateur E10N4 - Poitiers-Grailly 2 (PT11) mis en
service le 22 juin 1973.
Le premier Commutateur E10N4 mis en service
en tant que Centre Nodal est mis en service à Rennes, (Rennes-Lavoisier
2 le 27 mars 1975.
Un Centre Nodal est en réalité un Centre de Transit
terminal pour abonnés ruraux : il est à la fois un centre
d'abonnés et un centre de transit...
Le premier Commutateur E10N4 exporté à l'étranger
sera mis en service en Pologne, à Winogrady, en 1975.
Très vite, le E10 commencera à
s’exporter aussi au Maroc, Egypte, Côte d’Ivoire...
les commandes à l’international représentent 15%
en 1976, 28% en 1977. Quatre ans plus tard, deux millions de lignes
E10 sont en service dans le monde.
Ainsi après avoir atteint en 1971 le NIVEAU
4, suivant la classification de France Télécom de l’époque,
la SLE a atteint le NIVEAU 3 en 1975, qui était de fait le
E10A dans la classification E10.
Comme ces machines doivent traiter un nombre important
d’appels, il était indispensable de définir quelques
algorithmes de traitement que le programmeur devait prendre en compte
dans le développement des programmes de façon à
optimiser la capacité de traitement de la commande. Une petite
équipe de une (Georges Fiche) puis deux personnes a été
chargée de l’évaluation des capacités de
traitement d’appel, ce qui a permis
au système E10 d’être assez performant dans ce domaine
vis à vis de ses concurrents et sans doute d’être
le système le plus puissant dans ce domaine.
Le premier commutateur privé CITEDIS (CIT-E10) a été
mis en service à la Tour Winterthur de la Défense en
1974.
Après cette mise en service, la SLE reprend les discussions
avec le CNET, les informant des difficultés (impossibilité)
de répondre aux cahiers des charges export avec le E10 tel
qu’il était. Convaincu, le projet a donc démarré
pour un système de commande basé sur la commande CITEDIS
et qui est baptisé E10-76 car devant aboutir en 1976 pour une
mise en service.
Mais en 1974, après l’élection du Président
Giscard d’ Estaing, Gérard Théry est nommé
DGT en remplacement de monsieur Libois. Une petite révolution
(de grands changements) intervient à la DGT et au CNET. La
DGT rédige un nouveau cahier des charges pour les autocommutateurs
électroniques, ce sont les NEF.
Un appel d’offres international est lancé en 1976, pour
des commutateurs à matrice de connexion analogique (spatial
) à commande centralisée.
La CIT répond en association avec un constructeur japonais,
mais bien sûr n’est pas retenue.
La vie industrielle du E10A continue tranquillement et la CIT vend
toujours du Crossbar à la DGT.
169 Commutateurs d'abonnés E10N3+E10N4
ont été installés en France, dont 14 en Île-de-France,
y compris Paris intra-muros.
À partir de 1976, après la baisse de
prix des composants électroniques, les baies de raccordement
d'abonnés EMA de 2ème génération entièrement
électroniques, à base de nouveaux circuits intégrés
hybrides ou monolithiques, deviennent abordables et seuls seront installés
ultérieurement des Commutateurs E10N3 équipés
de cette technologie EMA 2G.
En 1978, lors d’un congrès de télécommunications
aux USA, il est apparu pour la majorité de la communauté
des commutants du monde que seuls les systèmes numériques
ont de l’avenir. La plupart des cahiers des charges à
l’export exigent des systèmes numériques.
Le projet du E10-76 est relancé avec des objectifs plus ambitieux;
ce sera le E10-B,
mis en service en 1979 au Mexique et en 1981 à Brest. Il est
équipé d’une nouvelle unité de raccordement
d’abonnés: le CSE (carte d’abonnés assurant
l’interface « courant fort »: 48 volts, courant d’appel,
protections; et un réseau de concentration des signaux de parole
à semi-conducteurs ; et un prix très compétitif).
sommaire
Le développement du système E10 et
la réflexion sur les systèmes futurs
En 1970, le projet PLATON bénéficie d’un préjugé
favorable dans le système hiérarchique des télécommunications.
En effet, en avril 1968, le Lannionnais P. Marzin est nommé
Directeur Général et L.J. Libois lui succéde
à la tête du C.N.E.T. De plus, en 1969, le responsable
de la commutation à la Direction Générale, R.
Légaré, ferme défenseur de PLATON, devient Directeur
Régional de Bretagne.. C’est pourquoi, sous l’impulsion
combinée de R. Légaré et A. Pinet, un jeune ingénieur
du C.N.E.T./Lannion (J.N. Méreur) établit, en collaboration
avec les services de la Direction Régionale, un projet d’automatisation
en système E10 de la « zone blanche » bretonne,
c’est-à-dire de l’intérieur de la région,
depuis Châteaulin jusqu’à Vitré.
Le choix de cette zone se justifie par plusieurs critères :
la faible densité téléphonique et la structure
rurale très éclatée permettent au système
E10 de soutenir la comparaison, sur le plan économique, avec
les systèmes Crossbar, sous réserve d’établir
des bilans globaux incluant non seulement les investissements en commutation,
mais aussi en bâtiments et en transmission ; la capacité
maximale du système à cette époque (8 000 à
9 000 abonnés) semble aussi bien correspondre au développement
attendu à moyen terme dans les groupements téléphoniques
de cette zone.
Enfin, le résultat « ne risquait pas trop de perturber
le réseau téléphonique français ! »
et « les bénéfices pouvaient être importants
: démonstration du bien-fondé des techniques d’avenir
et libération des dépendances ancestrales en matière
de commutation ».
Il est prévu que le Centre de Traitement des Informations (C.T.I.)
puisse assurer la gestion de cinq commutateurs au maximum, sous réserve
que ceux-ci ne soient pas trop éloignés de ce C.T.I.
afin que les délais d’intervention du personnel de maintenance
ne deviennent pas prohibitifs. C’est pour cette raison que le
projet breton est conduit à envisager un C.T.I. localisé
à Carhaix (Finistère) gérant le commutateur E10
de Carhaix, ceux de Quimperlé et Châteaulin (Finistère),
mais aussi ceux de Rostrenen (Côtes-du-Nord) et du Faouët
(Morbihan). De même, le C.T.I. de Ploërmel (Morbihan) doit
prendre en charge Loudéac (Côtes-du-Nord), Montfort et
Redon (Ille-et-Vilaine). Cette organisation, qui fait preuve d’un
courageux mépris des frontières administratives, aurait
à coup sûr engendré quelques conflits entre les
différentes administrations préfectorales. En définitive,
le projet breton d’automatisation en système E10 est limité
aux Côtes-du-Nord par la Direction Générale, hormis
les groupements de Saint-Brieuc et Dinan dont l’équipement
en Crossbar est déjà amorcé. Les groupements
de Guingamp et Paimpol sont programmés en système E10
pour une mise en service en 1972 avec un raccordement sur le C.T.I.
de Lannion. Ceux de Loudéac, Lamballe et Rostrenen sont prévus
pour 1973 et 1974, leur C.T.I. de gestion étant implanté
à Saint-Brieuc. La décision de réduire la zone
bretonne équipée en temporel s’explique par une
juste
appréciation de la capacité de production et d’installation
de la société S.L.E. Ceci rassure l’état-major
de la Direction Régionale qui appréhendait, non sans
raison, qu’un programme E10 trop ambitieux ne soit une source
de retard dans l’automatisation de la Bretagne.
Mais les projets de développement de la commutation temporelle
ne s’arrêtentpas à la Bretagne. Le C.N.E.T./Lannion
et la S.L.E. invitent à Lannion les états majors des
directions régionales du grand Ouest pour leur exposer les
avantages des réseaux intégrés et leur faire
visiter ensuite les installations en service dans la zone de Lannion
pour consolider l’argumentation. Le système E10 ne manque
certes pas d’atouts pour équiper les zones semi-rurales,
même s’il est discutable d’affirmer que « l’étude
et la définition du système E10 ont été
entreprises dès l’origine dans l’optique de la desserte
des zones à faible densité téléphonique...
» en réalité, la capacité du système,
8 000 abonnés bientôt portée à 16 000 abonnés,
est trop faible pour desservir des grandes zones urbaines car une
gestion rationnelle d’un grand réseau impose de limiter
au maximum le nombre de commutateurs et donc que chacun d’eux
ait la plus grande capacité possible. Le système E10
permet des gains importants sur les volumes et les surfaces des salles
de commutation (dans un rapport de un à quatre environ pour
le commutateur principal et de un à cinq pour les satellites)
; les temps d’installation des équipements sont très
réduits par rapport à l’électromécanique.
L’utilisation de la transmission MIC s’avère souvent
très intéressante dans les zones éclatées
car elle permet de retarder des investissements en nouveaux câbles
; le système E10, transparent à ce type de transmission,
comble alors totalement ou partiellement son handicap économique
face aux techniques spatiales. Enfin, l’électronique (spatiale
ou temporelle) fait espérer, du moins à moyen terme,
des gains sur les effectifs de maintenance, une souplesse d’exploitation
incontestable au moyen de relations « homme-machine »,
et l’offre de services nouveaux aux abonnés.
Cependant, le système exige des installations de conditionnement
d’air plus onéreuses que celles de l’électromécanique.
Sur un autre plan, la formation du personnel de maintenance n’est
pas normalisée et reste par la force des choses entre les mains
du C.N.E.T./Lannion qui promet d’ailleurs aux directions régionales
– la promesse sera tenue – l’assistance de ses spécialistes
aussi longtemps qu’elle s’avérera nécessaire
et que le système n’aura pas atteint sa maturité.
Au plan économique, la technique temporelle supporte le poids
de la transposition des fréquences vocales en combinaisons
numériques codées, ce qui rend les unités de
raccordement d’abonnés ou de circuits particulièrement
onéreuses.
Consciente de ce handicap, la société S.L.E. entame
dès 1970 l’étude et le développement de
nouvelles unités au coût moins élevé. Pour
remplacer les équipements de modulation d’abonnés
(E.M.A.), la S.L.E. définit deux modèles de concentrateurs
spatio-temporels. Dans l’un, le C.S.A., les cinq cent douze abonnés
sont reliés aux entrées d’un concentrateur constitué
de relais à tiges (contacts scellés) dont les soixante-quatre
sorties accèdent à deux systèmes MIC (de chacun
trente voies). Dans l’autre, le C.S.B., on utilise un matériel
très employé pour l’automatisation des zones rurales,
le concentrateur Télic (filiale de C.I.T.). Aussi bien dans
le C.S.A. que dans le C.S.B., on a donc repoussé l’échantillonnage
et la conversion analogique/numérique à l’entrée
du système MIC et on utilise d’ailleurs pour cette conversion
le même matériel que celui mis au point par les transmetteurs,
ce qui participe à une diminution des coûts par augmentation
des commandes et à une normalisation toujours intéressante
au niveau des performances et de la gestion techniques.
Pour gérer les circuits, la S.L.E. développe trois organes
dits groupes de synchronisation à logique doublée (pour
assurer la sécurité), chacun d’eux pouvant traiter
quatre modules de synchronisation, soit vers les satellites (M.S.S.),
soit vers d’autres commutateurs temporels (M.S.C.), soit vers
des commutateurs électromécaniques (M.S.M.). Dans ce
dernier cas, la conversion numérique/analogique est assurée
dans des équipements d’extrémité MIC (TNE1)
du système normalisé par les transmetteurs.
Les commutateurs E10, succédant aux prototypes PLATON de la
zone de Lannion,vont donc être dotés d’unités
périphériques différentes. L’objectif principal
a été une diminution des coûts. Mais on espère
aussi, au moyen du concentrateur spatial du C.S.A. ou du passif Télic
du C.S.B., éliminer les défaillances du complexe équipement
d’abonné de l’E.M.A. On n’est là qu’à
un palier dans le traitement d’un problème récurrent
dans la technique temporelle.
Les arguments lannionnais associés aux avantages du système
E10 réussissent à convaincre les Directions Régionales
de Nantes, Rouen et Poitiers d’adopter la technique temporelle
pour certains de leurs projets. Tous ceux-ci, élaborés
en 1970 et 1971, s’étaleront dans le temps de 1972 (Guingamp,
Paimpol) à 1977 (La Ferté-Bernard) pour leur mise en
service. Ils reçoivent l’aval de la Direction Générale,
nécessairement prudente face à un produit sans équivalence
dans le monde des télécommunications. Pour s’assurer
un volume de production plus significatif mais aussi pour profiter
de son avance dans le domaine temporel et s’imposer ainsi à
l’exportation, la S.L.E. mène une action internationale
non dénuée de succès puisqu’elle obtient
des marchés, en Pologne et en Egypte en particulier. En fait,
c’est la réussite de la mise en exploitation de Guingamp
(opération sans précédent : automatisation de
70 communes simultanément) qui, malgré quelques difficultés
initiales, a donné confiance dans le nouveau système.
Et c’est ainsi que, fin 1978, on comptait 64 centraux E10 en
exploitation dans le réseau français avec 430 000 abonnés
auxquels il convient d’ajouter les 2 centres de transit de Saint-Brieuc
et surtout de Paris-Tuileries.
L'introduction dans le réseau d’un sytème temporel
provoque un tel bouleversement dans les méthodes de gestion
et de maintenance qu’elle a obligé le C.N.E.T./Lannion
a s’impliquer d’une façon totalement inhabituelle
dans son aide aux services d’exploitation : formation des techniciens,
organisation du système d’échanges de cartes électroniques
défaillantes, équipe d’intervention pour réaliser
des ordres de correction. Quelques années ont été
nécessaires pour que l’ensemble de ces tâches soient
reprises par la Direction de la Production de la Direction Générale.
À partir de la mi-1969, la Direction du C.N.E.T.
doit gérer deux situations réagissant l’une sur
l’autre : il faut d’une part participer à la préparation
du VIèm Plan (1971-1975) en définissant les axes de
recherche et de développement dans le domaine des télécommunications
; et d’autre part il importe de réorganiser en conséquence
les équipes de chercheurs en commutation, ceux-ci ayant atteint
un palier au niveau conceptuel, même s’ils sont en parallèle
très sollicités par les expérimentations en cours,
encore plus à Lannion avec le projet PLATON qu’à
Paris avec le projet PERICLES.
Équiper le réseau national d’un système
unique est un vœu permanent de la Direction Générale
des Télécommunications (et sans doute de toute so-
ciété exploitante en situation de monopole). Le sujet
avait déjà donné lieu à des débats
houleux en 1957 à l’occasion du choix d’un (ou de
plusieurs) systèmes Crossbar. La note C.N.E.T. DD/DR/38 de
février 1970, intitulée « la commutation électronique
dans le VIèm Plan » reflète la pensée du
conseiller du Directeur du C.N.E.T. en commutation (P. Lucas), identique
à celle de l’état-major du département R.M.E.
à Issy-les-Moulineaux (J. Dondoux, chef du département).
Après avoir rappelé qu’au plan mondial «
...une certaine convergence se dessine dans les grands choix techniques
; la commande par une paire de calculateurs à programme enregistré
est utilisée le plus souvent... » , elle confirme que
le programme du C.N.E.T. dans le cadre du VIèm Plan doit avoir
pour objectif de permettre au Directeur Général des
Télécommunications de disposer « ...des éléments
techniques et économiques pour choisir en 1973 le système
unique de commutation électronique qui équipera le réseau
» . Il est précisé qu’« un tel système
est essentiellement caractérisé par les calculateurs
qu’il utilise » et que « les autres choix, qui polarisent
quelquefois l’attention, comme celui entre commutation spatiale
et commutation temporelle sont en définitive moins importants
» . Ces termes ne peuvent que laisser perplexe l’état-major
de l’équipe PLATON qui a pris des options totalement opposées.
Et le fait que quelques mois plus tard L.J. Libois nomme A. Pinet
responsable des groupes d’études du futur système
E1 ne fait pas disparaître les différences de conception
; pour A. Pinet, « la première option de base, retenue
pour le système E1, réside dans la nature temporelle
de la connexion pour la commutation de circuits » et il ne s’attarde
pas sur ce que doit être la connexion pour les centres d’abonnés,
sinon pour accepter qu’elle puisse être « spatiale
pour les étages de raccordement d’abonnés »
et il confirme l’option PLATON de « la répartition
des fonctions de commande entre deux niveaux de centres (unités
de commutation et unités de gestion) » . P. Lucas, quant
à lui, présente un bloc diagramme du système
E1 conforme aux idées émises par A. Pinet. Mais le texte
d’accompagnement précise que « la vieille querelle
des technologies (spatiale contre temporelle) est maintenant dépassée.
L’apport essentiel de la commutation électronique est
... la centralisation de la commande dans les calculateurs à
programme enregistré » .
Mais la raison principale de l’impossibilité à
définir un système unique tient en réalité
à la composition de l’industrie française en commutation
; H. Bustarret, chef du Service des Programmes et des Affaires Industrielles
du C.N.E.T., dans un article paru dans le numéro 67 de l’Echo
des Recherches (janvier 1972) et intitulé « Pour une
politique industrielle des télécommunications »
(p. 38 à 47) explique que le choix du système unique
ne peut se faire qu’au bénéfice d’un seul
des 2 groupes concurrents face à face : la CIT d’une part,
les filiales ITT (LMT et CGCT) d’autre
part. Et comment envisager que la CIT se priverait de la chance d’autonomie
acquise avec l’avance obtenue en temporel grâce à
PLATON/E10 ? Les quelques divergences d’ordre technique au sein
du C.N.E.T. pèsent peu en regard des énormes enjeux
industriels et financiers que représente le marché mondial
de la commutation électronique. Et l’espoir d’un
système unique va définitivement disparaître avec
les bouleversements que va subir le domaine des télécommunications
françaises dans la décennie suivante.
Les incertitudes crées par les changements
de politique et d’organisation des télécommunications
(1975-1977)
À l’automne 1974, G.Théry devient Directeur Général
des Télécommunications.
Obtenant une plus grande autonomie, il fait adopter au début
de 1975 le « Plan de Rattrapage du Téléphone »
qui prévoit un programme de financement de 105 milliards de
francs associé à l’objectif ambitieux de «
doubler le parc de lignes principales en cinq ans. Pour cela, il va
falloir installer dans les quatre années à venir autant
d’équipements téléphoniques qu’il en
avait été installé dans les quarante dernières
années » .
Pour réussir, une nouvelle politique industrielle est décidée,
dans le but de provoquer une plus grande concurrence entre fournisseurs.
À cet effet, une Direction des Affaires Industrielles et Internationales
(D.A.I.I.) est créée à la fin de 1974 et le C.N.E.T.,
dont les liens avec l’industrie ont été jugés
trop étroits, est placé sous la tutelle de cette nouvelle
direction « chargée de définir les objectifs industriels
» . Le C.N.E.T. doit s’éloigner « des études
de systèmes pour prendre plus étroitement en compte
les domaines de recherche et d’étude d’applications,
en appui à l’exploitation » . Le choc est rudement
ressenti au C.N.E.T., surtout au niveau de son état-major.
La DAII décide alors le 21 Juin 1975 de lancer une consultation
internationale pour la fourniture de systèmes en commutation
électronique spatiale. Le retentissement est considérable,
aussi bien sur le plan français que sur le plan mondial : alors
que la S.L.E. retenait l’attention avec son système E10,
la Direction Générale donne soudain l’impression
qu’elle hésite à s’engager franchement dans
la filière temporelle, ce qui incite les exploitants étrangers
intéressés par E10 à s’interroger sur le
bienfondé de leur choix. Le résultat de la consultation
est donné le 13 mai 1976 par un communiqué de N. Ségard,
Secrétaire d’État aux P.T.T. ; il annonce que M.
le Président de la République a décidé
:
– de confirmer la priorité accordée à la
« filière » française du tout électronique
(système temporel) qui constitue la technologie du téléphone
de
demain,
– de retenir le Métaconta développé en France
par I.T.T. et l’Axe présenté par Ericsson (systèmes
spatiaux) pour l’équipement du réseau télépho-
nique français »
Après une argumentation essayant d’effacer l’évidente
contradiction que contiennent ces deux phrases juxtaposées,
N. Ségard en arrive à ce qui constitue vraisemblablement
le principal objectif poursuivi :
... « mettre en œuvre une politique industrielle française
recherchant :
– la création en France des bases d’une saine concurrence
entre les fournisseurs de l’Administration,
– la volonté politique de recréer une industrie
française du téléphone dont les centres de décision
seront purement nationaux.
Les choix qui ont été faits entraînent la prise
de contrôle par Thomson-CSF des sociétés L.M.T.
et Ericsson-France ».
Cette « francisation » de l’industrie met en fait
Thomson dans une situation très difficile avec la gestion ou
le développement simultané de 5 systèmes de commutation
hérités de L.M.T. et Ericsson. Le nouveau groupe ne
parvient pas à les maîtriser et 6 ans plus tard cède
à la CGE toutes ses activités de télécommunications
civiles.
L’orientation irréversible vers la commutation temporelle
à partir de 1977
L’inquiétude créée par le choix «
spatial » de 1976 ne peut que redoubler les efforts de la CIT
pour mettre au point son système temporel E10B (ou E10N1) de
2èm génération. L’architecture générale
du E10B est fortement inspirée de celle du E10A, en particulier
par sa commande répartie et à deux niveaux, mais la
technologie à base de microprocesseurs et les logiciels sont
entièrement nouveaux. La sécurité de fonctionnement,
mais surtout la sécurité de gestion sont très
supérieures à celles du « vieux » E10A.
Et sa capacité maximale d’environ 35 000 abonnés
lui permet de viser le marché des grandes unités urbaines.
La réalisation des commutateurs temporels de deuxième
génération pouvant atteindre de grandes capacités
est rendue possible grâce aux progrès phénoménaux
de la micro-électronique à partir de 1975. La densité
d’intégration augmente suivant une courbe exponentielle
(dite loi de Moore) et rend les microprocesseurs de plus en plus performants,
les coûts évoluant selon une courbe inverse. En 1965,
un boîtier incluant 100 portes logiques coûtait environ
200 francs de 1978 ; en 1975, un boîtier de 10 000 portes logiques
avait la même valeur marchande ; la densité d’intégration
avait augmenté dans un rapport 100 alors que le coût
de la porte diminuait dans ce même rapport ; et la vitesse de
réaction passait de six à une nanoseconde .
Un premier exemplaire du E10B est commandé pour Brest dès
1977. Il sera mis en service en Juin 1981 après celui de Pékin
(fin 1980). Mais dès 1979 les prévisions de commande
s’infléchissent en faveur du temporel . Et la poussée
irrésistible des techniques numériques est mise en pleine
lumière à l’occasion du colloque international
de commutation (CIC 1979 ISS) tenu à Paris du 7 au 11 mai 1979.
Dans le compte-rendu très dense qu’il en fait , P. Lucas
note dans son introduction que ce colloque « ... a surtout marqué
le basculement inexorable et sans doute définitif vers la commutation
numérique et les réseaux intégrés... »
et qu’« une autre tendance importante, suscitée
par l’arrivée des microprocesseurs sur le marché,
concerne les structures de commande décentralisées,
par opposition avec la tendance centralisatrice qui dominait depuis
l’ESS1 ».
Il note que « ce rapide survol de l’évolution générale
met en évidence le caractère profondément original
des choix techniques français et le fait que les principes
retenus étaient en avance de plusieurs années sur l’évolution
actuelle. C’est en effet dès 1970 que la France a misé
sur la commutation temporelle dans le réseau local avec le
système E10, à structure décentralisée,
solution dont l’intérêt se découvre maintenant
».
La pente est alors irréversible et en 1986 le réseau
français est déjà équipé à
54 % de commutateurs numériques, très en avance sur
le reste du monde ; en effet, si la Bell a pris le virage temporel
dés 1976 pour les centres de transit, elle ne développe
son système ESS5 pour abonnés qu’à partir
du début des années 1980. Et la CIT se retrouve en position
très dominante, sinon monopoliste, sur le marché mondial
de la commutation entièrement électronique.
Conclusion
Au terme des recherches entreprises au début des années
1960, deux acquis furent incontestables, même si sans doute
aujourd’hui quelque peu dépassés :
– l’avance prise par la France dans la numérisation
d’un réseau public de télécommunications
devenant ainsi sans doute le plus moderne du monde, en partant pourtant
d’une situation de crise qui donnait lieu à des commentaires
apitoyés mais à tout le moins ironiques de la part de
nos partenaires occidentaux.
– la création d’un puissant groupe industriel français
des télécommunications exportateur de matériels
mais aussi de compétences, alors qu’auparavant les fabricants
français de ce domaine étaient traditionnellement sous
la tutelle financière et technologique de grandes sociétés
étrangères.
Toute recherche est maintenant collective. Il est cependant indispensable
de rappeler l’apport fondamental de :
Pierre Marzin à l’origine d’une décentralisation
audacieuse.
Louis Joseph Libois qui perçut qu’« il fallait s’écarter
de la voie américaine, celle de l’électronique
spatiale analogique, pour se lancer dans la commutation électronique
temporelle numérique .
André Pinet « le père de PLATON », qui sut
donner confiance à ses équipes, parfois découragées
par une technologie pas encore à la hauteur des idées
et qui fit preuve de ténacité pour défendre les
avantages d’un réseau numérique intégré,
ouverture vers le réseau multiservices de l’avenir.
On notera que, curieusement, les trois hommes qui ont donné
l’impulsion décisive au démarrage de la commutation
temporelle ont fait l’essentiel de leur carrière de chercheurs
dans les techniques de transmission
sommaire
Le E10 vu côté intégration
Au début des années 70, le produit
E10A se cherche encore; pour Alcatel l’industrialisation
commence à peine.
L’exemple des liaisons haut de baies illustre ce propos. Elles
relient les organes et sont redéfinies pour chaque commutateur.
Madame Ferette de l’ingénierie dessine d’énormes
tableaux représentant ces liaisons et les emplacements des
amplificateurs associés. Ces véritables ouvrages d’art
définissent les câblages à effectuer par le personnel
chantier, sur des supports métalliques, eux mêmes fabriqués
à la demande. Nous réussirons plus tard à standardiser
ces liaisons et leurs chemins de câbles grâce au système
«racbat», dont nous confierons la fabrication aux ateliers
d’handicapés de Lannion, puisque nous ne pouvons pas émettre
le «dossier de fabrication», nécessaire pour une
production par la D.I..Il faut dire que le passage au nouveau système
de raccordement est facilité, malgré quelques réticences
du côté du C.N.E.T., par l'adoption des faux-planchers,
à partir de Sablé et la Flèche. La nouvelle disposition,
idée du D.R.C., supprime, en effet, les tunnels de ventilation
sur lesquels reposent les baies, ainsi que les chemins de câbles
les plus chargés: ceux qui transportent l'énergie et
ceux qui supportent les raccordements au répartiteur. Tous
les câbles cheminent désormais dans un faux-plancher
où l'air est en légère surpression et refroidi.
La priorité n'est pas encore la réduction des coûts
! Les bâtis ont des flasques en inox de qualité, avec
un poli miroir; ils sont dotés d'orifices d'accrochage des
alvéoles de forme carrée, usinés au centième
de millimètre. C'est tellement plus simple que de percer des
trous ronds ! Les faces avant de ces armoires sont en plastique thermoformé,
d'une fragilité exceptionnelle. Elles sont dotées de
propriétés electrostatiques telles que les femmes de
ménage, en astiquant ces nids à poussière, effacent
invontairement le contenu des mémoires de traduction. C'est
en tout cas ce qui nous arrive à Fleury sur Andelle, une demi-heure
avant l'arrivée du ministre qui inaugurait le commutateur.
Il fallut être rapide, et discret, pour que J. Lecanuet puisse
passer son coup de fil symbolique.
Une autre préoccupation est le flux continu des ordres de corrections
(O.C.s).
La doctrine du département chargé des études
des matériels: le Département Hardware, (D.H.) est simple:
tout O.C. qui sort de ses bureaux est immédiatement applicable
à tout le matériel, qu’il soit en service ou non.
Cette dictature des O.C.s, qui pénalise le Département
Industriel autant que les réalisateurs (il faut créer
un atelier qui dépasse les cent personnes spécialisées
uniquement dans les O.C.s ), ne peut pas durer bien longtemps. Après
avoir reçu le six centième O.C. pour le seul Groupe
de Synchronisation de Multiplex (G.S.M.) nous partons à l’assaut
de D.H.. Après une chaude bagarre nous obtenons le regroupement
des O.C.s en lots, qui conduit un peu plus tard à la définition
des états techniques, puis des paliers et des versions recouvrant
à la fois le matériel et le logiciel. Le nombre des
O.C.s ne diminue pas, mais leur gestion en est grandement facilitée,
beaucoup grâce à J. Heurteur .
Les O.C.s, générés pendant les quelques mois
que durent un chantier, nous conduisent à former des techniciens
de chantier spécialisés dans leur exécution:
les «O.C.s men», champions de la pince coupante, des cutters,
des fers à souder, et du collage des fils sur les cartes. Bien
sûr, les clients prétendent que ces tortures diminuent
la fiabilité des cartes; nos discours pour atténuer
cette critique sont peu crédibles. L’Administration réussit
néanmoins à nous imposer un nombre maximum de 10 fils
par cartes ainsi qu‘un nombre limité de soudures par dm2
(Cette habitude coûteuse va durer jusqu’aux contrats de
Pékin, les chinois ne tolérant aucun fil sur les cartes).
L’Administration française connaît bien les ordres
de correction, qui ont cours évidemment aussi dans les technologies
électromécaniques (où ils sont d‘une exécution
plus aisée). Les méthodes de gestion existent, il faut
nous y plier. Une commission C.N.E.T.- S.C.T.T.-S.L.E. est créée
dès la mise en service de Guingamp-Paimpol. Elle se réunit
chaque mois et décide de l’application des O.C.s ainsi
que de la responsabilité du fournisseur pour chacun d‘entre
eux. D.R.C. représente la société dans cette
commission. Le but du jeu est, bien sûr, pour nous, d’éviter
que ces O.C. ne nous coûtent trop cher, car leur application
est rétroactive et concerne aussi les commutateurs déjà
en service, à la charge de la S.L.E., si elle est reconnue
responsable. Assez vite, nous réussissons à bloquer
les applications des O.C.s jusqu’à ce qu’une extension
nous conduise à revenir sur le site concerné. Mais il
faut gérer chaque site et savoir, à tout moment, pour
chaque central, quels O.C.s, ou groupe d’O.C.s., sont exécutés
ou non. Une nouvelle tâche pour l’ingénierie .
L'Intégration ; la mise au point en plateforme
L’état du matériel en sortie de fabrication est
parfois loin de celui de la mise en service; il faut créer,
au sein de D.R.C., une plate forme de mise au point (la M.A.P.), dirigée
par M. Ferette. Ce nouveau service monte, pour chaque central, une
maquette représentative, afin de la faire fonctionner, au moyen
de lanceurs d’appels «les pondeuses» puis de simulateurs
capables de saturer le système: les SIMAT. Ainsi, après
avoir appliqué les fameux O.C.s. (ceux que la D.I. n’avait
pas eu le temps d'appliquer) et y avoir introduit les logiciels spécifiques,
des essais complets peuvent être conduits. Ce n’est qu’après
avoir vérifié un fonctionnement suffisant que le matériel
est démonté, emballé et expédié
sur les sites.
Ces expéditions, pour un site donné, sont nombreuses,
elles s’étalent sur plusieurs mois, jusqu’à
la remise au contrôle du client. Des raisons multiples expliquent
ces pratiques coûteuses: les propres insuffisances des réalisateurs,
la pauvreté en moyens de contrôle en production, au moins
au début, mais aussi l’organisation de la fabrication,
qui, pour diminuer ses coûts, lançe des campagnes de
fabrication des cartes répétitives, au détriment
des cartes en faible nombre. Dans cette longue liste il ne faut pas
oublier le temps nécessaire à l’application des
O.C.s en fabrication comme en plate-forme. Les transports en France
se font par la route, mais à l’export ce sera presque
toujours l’avion !
L’évolution rapide des matériels et logiciels,
ainsi que la diversité des configurations imposent le maintien
de ces mises au point, en dehors de la fabrication, pendant de nombreuses
années. Cela crée un besoin de maquettes qui ne peut
être satisfait que par des prélèvements temporaires
sur le matériel des affaires, car il n’est pas question
d’investir dans un matériel destiné à l’obsolescence
à court terme, tant l‘évolution de nos matériels
est rapide.
Devenue une modeste unité de production de matériel,
la S.L.E. doit accepter la présence obligatoire d’un contrôleur
de l’administration. Il est très jaloux de ses prérogatives;
D.R.C. est son interlocuteur officiel et nous devons lui consacrer
beaucoup de temps. Il vient, bien sûr, d’unités
de production de commutateurs électromécaniques; nos
méthodes de fabrication et de test le déroutent passablement;
il nous faut faire preuve de beaucoup de pédagogie et de psychologie.
Mais il est le maître de la procédure dite «Surcouf»
qui déclenche le paiement de la partie matérielle des
contrats !
Le contrôleur P.T.T. a besoin d’un interlocuteur. De plus,
peu à peu, les équipements proviennent d’usines
différentes, avec des habitudes différentes; les matériels
achetés, qui ne sont pas de notre fabrication, supposent un
contrôle d’entrée par nos soins; et même nos
propres productions peuvent présenter certaines lacunes, des
O.C.s mal exécutés par exemple. Bref, de multiples raisons
nous conduisent bientôt à nous doter d’une petite
équipe de contrôle D.R.C.. J.P. Chapelain en est le responsable;
il le restera longtemps, agissant toujours avec justesse et pondération
.
Petit à petit, nous passons de la phase prototype à
celle de la pré-série et nous devons nous couler dans
les habitudes de notre client D.G.T.. Il faut se plier au «contrôle
des prix». Il s’agit de constituer et de faire vivre un
bordereau de prix, ce qui permet l’écriture des marchés
et le calcul du prix définitif des commutateurs “tels
que construit” lors de l’application de la procédure
de «récollement». C’est encore le département
qui devient
l’interlocuteur du service de contrôle des prix (C.N.E.T.
Issy les Moulineaux). Bien entendu cette activité, conduite
par J.Michel, est supervisée de très près par
le Directeur Général: F.X. Montjean.
Comment faire ? La C.I.T. Transmission est, dans la famille de la
S.L.E., l’organisme dont les produits sont les plus proches des
nôtres. Nous allons donc à l’école des "spécialistes",
rue Saint-Charles, avant de poursuivre nos "études”
à Villarceaux. Bien entendu, cette activité concerne
la totalité des travaux de la société liés
à la production . Que d’heures de discussions (l’unité
pour la main d’oeuvre est le centième d’heure) avec
des contrôleurs de bonne composition mais qui ont tout leur
temps, entre deux avions, à chacun de leurs fréquents
passages à Lannion. L’attrait de la nouveauté sans
doute !
SIMAT : simulateur d’abonnés
composé d’un calculateur PDP8 de Digital Equipment
et d’un coffret de cartes joncteurs capables de simuler des
abonnés analogiques à cadran ou à clavier
multifréquence; quelques instructions sont rentrées
par le technicien directement aux clés du PDP8 pour activer
la lecture des bandes perforées comportant le logiciel
de simulation d’appels; le terminal associé à
cette machine est une ASR33.
Le SIMAT est initialement développé par LMT, puis
repris par SOCOTEL et ensuite fabriqué par Clemessy.
Le premier SIMAT de la SLE est acheté, vers 1972, suite
à l’installation par les services « chantiers
» des commutateurs E10 dans les villes de Sablé et
de La Flèche.
En effet, en France, le contrôle des installations par le
SCTT se faisant à l’aide du SIMAT, la SLE se voit
obligée d’acquérir un SIMAT pour faire des
essais au préalable dans les mêmes conditions.
Avantages : puissant et redoutable lorsqu’il lance tous les
appels en rafale; il simule parfaitement la numérotation
Multifréquence et est très efficace pour valider
les Récepteurs de Fréquences des commutateurs.
Inconvénients : interface Z spécifique France (NEF),
coûteux à l’achat, très volumineux, il
nécessite un conducteur et une voiture Citroën ID19
break pour son transport ; l’historique des appels imprimé
au fil de l’eau sur un listing papier et un blocage du trafic
du commutateur en début de nuit consomme tout le rouleau
de papier de l’ASR33 en quelques heures.
Pour pallier partie des inconvénients, une version allégée,
plus compacte, est développée par la suite sous
le nom de MINISIMAT |
SATAN : simulateur d’abonnés
analogiques fabriqué par Alcatel CIT; son calculateur
est la logique réserve d’une URA (typiquement un CSE);
cette logique réserve est vue hors service de la logique
pilote qui écoule seule le trafic dans l’URA; un terminal
est raccordé à la carte processeur de la logique
réserve pour y charger le programme de simulation.
Avantages : non tributaire de l’interface Z, implanté
dans la logique réserve, pas de matériel à
transporter pour simuler les appels, donc pas de problème
de transport ni de douane à l’étranger et pas
de limitation en nombre de simulateurs d’appels pour les
essais en charge, puisque chaque URA peut supporter un SATAN.
Une version coffret indépendante de l’URA est aussi
développée (avec l’interface Z 600 ohms de
la France).
Inconvénients : la logique de commande «opérationnelle»
signale en alarme sa logique réserve, ne fait pas de basculement
périodique ou sur faute en charge et donne une fausse idée
de sa charge réelle puisqu’elle ne dialogue pas avec
sa logique réserve |
sommaire
1974
Le CNET est réorganisé
L’avènement d’un nouveau président, Valéry
Giscard d’Estaing provoque la mise en place » d’une
nouvelle équipe de la DGT en juillet 1974.
Un nouveau directeur G. Théry est nommé à la
tête de la DGT, décide de la mise en place d’une
direction industrielle, appelée DAI, et nomme son Directeur,
Jean-Pierre Souviron. On lui adjoindra assez rapidement la responsabilité
des affaires internationales et il deviendra ainsi le DAII des
Télécommunications. Il prend des décisions importantes
dans le domaine industriel, que nous examinerons ci-dessous, et il
cherche à redéfinir le rôle du CNET devant permettre
une relance de ses activités de recherche. Il part d’un
constat sévère : « Je considère que la
recherche au sein du CNET en novembre 1974 était mauvaise :
les ingénieurs du CNET au lieu de faire de la recherche eux-mêmes,
la faisaient faire par des industriels grâce des crédits
d’études ».
Certes une bonne partie des travaux du CNET sont des contributions
au développement industriel, mais à Lannion en particulier
plusieurs projets de recherche sont menés en amont des développements
industriels. Le positionnement en amont du projet Platon, jusqu’en
1972, a été emblématique. Mais il n’a pas
été le seul. Les recherches engagées sur une
transmission à un débit de 560 Mbit/s, un très
haut débit pour l’époque sont menées d’abord
sur un plan théorique : travaux de théorie des communications
de Michel Joindot appliqués à un canal à 40 GHz
via un guide d’ondes circulaire de 50 mm de diamètre.
Par ailleurs le CNET Lannion réalise les maquettes de toute
la partie « numérique et fréquence intermédiaire
», y compris l’appareillage de caractérisation,
introuvable à cette époque, notamment un générateur
numérique pseudo-aléatoire et un analyseur de canal
de transmission à large bande. Puis il assure l’intégration
d’ensemble du numérique au millimétrique.
Un transfert technologique, sur le modèle du transfert PLATON,
est engagé. « En ce qui concerne les équipements
en fréquence intermédiaire et en bande de base numérique,
le développement industriel débute en 1973-74.
L’équipe du CNET Lannion transfère tout son
savoir-faire à des équipes de la CIT et de la SAT,
qui lui sont proches, car installées à Lannion.
Ces deux équipes industrielles travaillent dans une certaine
coopération, avec une dose d’émulation, et en lien
avec le CNET Lannion, responsable des marchés d’études
et rédacteur des spécifications techniques des sous-ensembles
»
Maurice Acx (SAT Lannion),
Claude Aillet (SLE-Citerel) et Ph. Dupuis (CNET) présentent
une communication commune intitulée « IF and baseband
circuit design and repeater performances » lors de la Conférence
internationale sur le guide d’ondes circulaire de Londres en
novembre 1976. Lors de cette Conférence il a été
confirmé que l’avancée rapide des recherches sur
les fibres optiques constituait une forte menace pour le guide d’ondes.
Effectivement le guide d’onde circulaire n’aura aucune application
industrielle, néanmoins ces travaux amèneront le développement
des activités de transmission numérique sur le pôle
lannionais.
La réorganisation du CNET se fera progressivement et aboutira
en 1979 à la constitution de centres, disposant d’une
certaine autonomie et on peut considérer que l’action
de la DGT à des effets positifs sur les deux centres de Lannion.
Elle va permettre de relancer les équipes, toujours mobilisées
sur le numérique, le « grand projet » de Lannion,
enrichi dans les années 1980 par des recherches à la
fois sur les nouveaux services numériques, les nouvelles formes
de réseaux (RNIS, ATM...) et sur les fibres optiques,
considérées comme l’avenir des transmissions. Il
n’est pas certain que le centre d’Issy-les-Moulineaux ait
bénéficié du même effet de relance.
sommaire
Période de flottement industriel (1974-77)
La DGT veut concentrer l’effort industriel sur la commutation
spatiale, ce qui de fait remet en cause la commutation numérique.
Par ailleurs elle soutient Thomson-CSF, comme concurrent du Groupe
CGE, et cherchera à reprendre des filiales françaises
des groupes étrangers Ericsson et ITT. Cette période
de flottement intervient dans cet environnement industriel en pleine
transformation.
En octobre et novembre 1974 la grève du CNET Lannion, menée
dans le cadre d’un mouvement général des PTT contre
la Réforme en cours et largement suivie, a été
rapportée dans un article du journal le Monde, écrit
par Dominique Verguèse, journaliste des questions scientifiques.
Certes « à l’appel des syndicats le personnel
du CNET de Lannion et d’Issy-les-Moulineaux proteste contre la
réorganisation récente de la direction générale
des télécommunications, qui restreint assez sensiblement
la mission du CNET»...
Mais en fait une bonne partie des ingénieurs et techniciens
en grève à Lannion sont plus préoccupés
par le contenu de la nouvelle politique industrielle, que par les
questions d’organisation de la DGT et du CNET. Dominique Verguèse
se fait écho de cette préoccupation en écrivant
dans un paragraphe intitulé « La guerre des filières
» : Devant le retard pris par la France la direction générale
des télécommunications, animée par M. Libois
avait décidé de brûler les étapes...pour
passer plus rapidement aux centraux de l’avenir, les centraux
électroniques à commutation temporelle, étudiés
par la CIT.
Le CNET s’était donc fait le champion de la commutation
temporelle en s’appuyant sur l’industrie française...
Le nouveau gouvernement marque son hésitation à poursuivre
une politique nationale de développement technologique coûteuse,
qui requiert un soutien à long terme ».
En avril 1975 Dominique Verguèse est revenue sur la question
de la commutation numérique et a conclu son article de la façon
suivante « Si la politique menée jusqu’ici [la
politique industrielle des Télécoms] est infléchie,
il faudrait éviter de ruiner les efforts de ces quinze dernières
années et éviter de jeter le bébé avec
l’eau du bain ». Cette phrase sonnait juste. Le «
bébé » était la commutation numérique.
A la mobilisation politique, qui va de soi puisque le sénateur-maire
de Lannion est Pierre Marzin, s’ajoute la mobilisation syndicale.
Ces interventions sont effectuées notamment auprès des
secrétaires d’état aux PTT. Le 28 février
1975 le secrétaire d’Etat Aymar Achille-Fould est venu
à Lannion et a passé un long moment, notamment avec
André Pinet, devant des équipements E10, en déclarant
« je suis venu sur place pour m’informer des soucis
et des inquiétudes du CNET et des industriels de la région
».
Le 11 septembre 1975 Aymar Achille-Fould reçoit dans son bureau
une délégation CFDT, comprenant un représentant
du CNET Lannion. « Parmi les sujets discutés il a été
question assez longuement du CNET et de la politique industrielle.
Achille-Fould ne comprend pas pourquoi le CNET s’inquiète
autant de son avenir, alors que les problèmes posés
sont à l’extérieur et non à l’intérieur
du CNET ». A. Achille-Fould peu de temps après en janvier
1976 quitta son poste de Secrétaire d’Etat, sans doute
en raison de son désaccord sur la stratégie industrielle
de la DGT. On lui reprocha un potentiel conflit d’intérêt,
celui de la présence d’un beau-frère comme salarié
du groupe Philips, mais ce ne sera pas le seul potentiel conflit d’intérêt
au sommet de l’Etat, puisque le Directeur de Thomson Télécom
sera Philippe Giscard d’Estaing, cousin du Président.
En 1975 la DGT lance un appel d’offres international
sur la commutation spatiale.
Les deux offres les plus attractives pour la DGT sont le système
AXE d’Ericsson France et
le Metaconta d’ITT.
En décembre 1975 J-P Souviron commença à entreprendre
des démarches pour convaincre Ericsson et ITT d’accepter
le contrôle de leurs filiales françaises (respectivement
Ericsson France et LMT) par Thomson avec comme contrepartie des commandes
importantes de leurs systèmes de technologies spatiales.
Les choix de la DGT lors de cet appel d’offres provoquent une
première fracture.
La SLE-Citerel, victime co-latérale, est dissoute, ce qui
provoque l’arrêt d’une coopération active de
20 ans entre le groupe CGE et les Suédois. Georges Pébereau,
Président de la CGE (1982-1986) déclarera six ans plus
tard à la presse : « Je verse des larmes de sang sur
les conditions dans lesquelles ont été rompus les accords
entre CIT et LM Ericsson »
 Vue aérienne des établissements de Lannion.
Vue aérienne des établissements de Lannion.
sommaire
Filiation
numérique
La
CIT-ALCATEL, En Juillet 1977, la CIT-Alcatel absorbe
la SLE-CITEREL (après s'être éloignée de
EricssonFrance).
Le développement logiciel du produit qui devient E10 Niveau
3 ou E10A est transféré à Vélizy, siège
de la CIT commutation.
En 1978, la CIT-Alcatel emploie 1100 personnes à Lannion. La
fusion avec la CIT et le volume croissant des fabrications provoquent
des modifications dans les activités du site de Lannion, comme
la fabrication des circuits imprimés sous-traitée désormais
à l'établissement CIT de Coutances. Les convertisseurs
d'énergie sont bientôt achetés à des sociétés
extérieures. Il s'ensuit le départ des spécialistes
concernés. Les
calculateurs 10010, supports des CTI, sont achetés à
CIT Transmission puis remplacés par des MITRA achetés
à la SEMS.
Les
choix effectués par la DGT en décembre 1975 provoquent
l’intégration de la SLE-Citerel dans la CIT, qui est effective
en 1977.
En fait la CIT s’appelle CIT-Alcatel, depuis que les activités
d’Alcatel, regroupant les activités de télécommunications
et électronique de la Société SACM (environ 5
000 salariés) ont été fusionnées avec
celles de la CIT en 1968.
Comme l’a indiqué Pierre Suard : « pendant longtemps
la filiale de la CGE s’appela encore CIT et non CIT-Alcatel ».
A Lannion pour se différencier on afficha nettement le nom
entier CIT-Alcatel. Il faut dire que les racines de l’établissement
de Lannion étaient extérieures à la CIT, dont
l’image technologique était mitigée, comme le reconnaissait
plus tard son directeur Pierre Suard : " [au début des
années 1980] CIT n’était pas très dynamique
pour développer les équipements des nouveaux systèmes
comme ceux des réseaux de télévision câblée
ou des systèmes de transmission optique .
Dans une certaine mesure l’établissement de Lannion pouvait
davantage se reconnaitre dans une filiation avec Alcatel, spécialiste
de l’électronique rapide et du numérique dès
les années 1950 pour des applications militaires et civiles,
sous la responsabilité notamment de Pierre Herreng.
Celui-ci faisait partie, avec A. Blanc-Lapierre, Grivet et Goudet
(Directeur du LCT), du groupe des quatre Normaliens, qui ont joué
un rôle important dans le renouveau de la recherche académique
et industrielle en France dans le secteur Electronique et Télécom,
au lendemain de la deuxième guerre mondiale.
Travaillant sur les systèmes de transmission par modulation
codée (les MIC), la SACM mène ses recherches
en étroite collaboration avec le CNET. Ses interlocuteurs sont
en particulier M. Libois...
Au cours des années 1950 quatre systèmes de «
MIC » sont réalisés, débouchant sur des
réalisations comme un multiplex à 12 voies en modulation
en delta transistorisé réalisé pour le CNET.
Ce multiplex fait l’objet d’une commercialisation au début
des années 1960.
Méconnaissance et ambiguïté de la DGT
A partir de décembre 1975 la DGT cherche à concrétiser
les choix de la commutation spatiale et du rachat de LMT et Ericsson
France par Thomson, dans un contexte où certains n’hésitaient
pas à dévaloriser les travaux de la SLE Citerel, comme
l’a rapporté en 1981 l’historienne Catherine Bertho
: « il fut une époque où personne ne croyait au
temporel... la CIT depuis dix ans s’affaire au chevet d’un
prototype dénommé E10 développé en liaison
avec le CNET.» Il fallait que E10 soit bien « souffreteux
» pour qu’on s’affaire à son chevet depuis
dix ans !
Dans le même temps en 1976 un concurrent sérieux est
apparu. « Thomson en rachetant LMT a trouvé dans les
tiroirs les plans d’un central temporel, plus ou moins à
l’insu de la maison mère. La chose peut sembler incroyable».
En fait les travaux menés par LMT n’étaient pas
que des plans dans des tiroirs, car une première expérimentation
elle avait été effectuée en 1973. Et les observateurs
avertis connaissaient les travaux, menés sur le numérique
(codage, commutation temporelle) dans le laboratoire LMT de l’avenue
de Breteuil, par André Clavier,
Maurice Deloraine et Pierre Aigrain à la fin des années
1940, et par Touraton et Le Corre61 à la fin des années
1950.
J-P Souviron avait découvert alors l’orgueil des équipes
LMT, comme il l’a rapporté plus tard lors d’un colloque
le 1997 : « Le groupe Thomson, après 1976, avait pris
le contrôle de deux sociétés, une filiale d’ITT
et une filiale d’Ericsson. L’équipe technologique
de LMT...était orgueilleuse...et avait développé
en secret un système temporel...Le groupe Thomson en avait
un merveilleux qui était l’AXE et grâce aux
accords d’exportation avait obtenu, de façon un peu musclée,
presque la moitié du monde en exportation en AXE, la Russie,
le Brésil...
LMT et ses équipes étaient humiliées. Il leur
était insupportable d’imaginer que la petite Ericsson
allait prendre chez Thomson le leadership de la commutation et de
la commutation temporelle en particulier.
Les équipes de LMT ont donc proposé le développement
accéléré du système MT ». L’orgueil
d’une équipe technologique peut être mauvais conseiller
pour des développements industriels.
La méconnaissance de travaux scientifiques, reconnus internationalement
(publications, symposiums, brevets), a joué un rôle dans
les décisions de la DGT.
Lors du colloque de 1997 Jean-Pierre Bouyssonie, PDG de Thomson-CSF
de 1976 à 1981, complète le point de vue de J-P Souviron
: « Le problème était complexe. L’AXE était
temporisable, nous le savions, et les gens d’Ericsson y travaillaient
un peu mais lentement, car ils ne pensaient pas que le temporel irait
vite. Ils restaient sur le spatial électronique.
Il y avait d’autre part une réticence, très nette,
à nous donner l’autorisation de vendre à l’exportation
un Axe temporel.
Le journaliste du Monde Jean-Michel Quatrepoint a indiqué :
« Le communiqué de Norbert Segard du jeudi 13 mai 1976...n’était
pas très clair...on prenait du temporel mais aussi le Métaconta
d’ITT, on mélangeait les commandes».
L’ambiguïté se maintient tout au long de 1976 et
1977. En octobre 1976 lors du symposium ISS à Kyoto, «
au moment où presque tous les experts mondiaux étaient
sur le point de virer de bord vers la commutation temporelle, je me
souviens combien [P. Lucas] était révulsé à
l’idée d’avoir reçu des directives de n’afficher
qu’une seule religion, celle de la commutation spatiale, alors
que tout le monde virait de bord», indique J-P Poitevin, ancien
directeur du CNET, aussi lors du colloque de 1997. Ce point de vue
est corroboré par J-M Quatrepoint : « j’ai une note
confidentielle rédigée par une personne du CNET [qui
écrit] il est dommage que la France ait donné [à
Kyoto] l’impression d’avoir opté pour le Métaconta,
c’est nuisible pour le temporel ».
Un an plus tard, le changement de cap de la DGT est radical. «
A Atlanta en 1977, Gérard Théry annonce que de gros
centraux électroniques temporels français seront disponibles
à très courte échéance. Cette fois-ci
on partira à la bataille avec deux groupes français.»
Lors de cette Conférence d’Atlanta en octobre 1977 la
communauté scientifique internationale des télécommunications
s’accorde à penser que le numérique est arrivé
à maturité et va s’imposer rapidement. André
Pinet est récompensé de ses travaux par une médaille
des IEEE, une médaille que très peu de scientifiques
français ont reçu durant les trente dernières
années du 20ème siècle.
Ainsi la réussite de Platon est pleinement reconnue par les
chercheurs américains et européens. “In 1970, an
experimental system “Platon” served all 50 000 suscribers
in the Lannion area. On the basis of the experiment, the system E10
was introduced into the French network in 1972.”
Comment la SLE-Citerel a-t-elle vécu ces années 1975-1977
? J-B Jacob affirme plus tard, « La vie industrielle du [commutateur
E10A] continue tranquillement..». Certes les travaux de la SLE-Citerel
se poursuivent sereinement dans cette période d’incertitudes
grâce d’une part à la direction de CIT-Alcatel,
qui « maintient avec fermeté son engagement dans la commutation
temporelle» et d’autre part au soutien de l’environnement
local. Mais en 1976 au moment où il aurait été
bon de donner un coup d’accélérateur, cela n’a
pas pu être fait.
Développement industriel de l’E10B
conforme aux NEF
En 1977 l’établissement de Lannion, grâce notamment
au renouvellement de contrats d’études par la DGT, poursuit
son effort sur le développement des commutateurs de deuxième
génération, l’E10 B.
L’organe de commande, basé sur le processeur ELS à
base de circuits intégrés Texas Instruments, utilisé
pour les centraux privés CITEDIS dès 1975, est
adapté pour assurer des capacités de commutation plus
importantes.
Les informations d’exploitation et de fonctionnement sont traitées
sur un ordinateur, qui assure la fonction de Centre de traitement
des informations (CTI) d’un commutateur ou d’un groupe
de commutateurs.
Il se trouve qu’en 1977 la DGT a renforcé son contrôle
des performances des commutateurs en éditant des Normes d’Exploitation
et de Fonctionnement (NEF), au moment où commençait
le développement industriel de l’E10B.
L’établissement de Lannion a alors le souci de se conformer
aux NEF, ce qui nécessite beaucoup d’efforts pour mettre
en place les alarmes imposées, assurer la continuité
de la facturation en cas de perte de la liaison avec le CTI, gérer
les fichiers de traduction et les abonnés...
LES
Centraux privés CITEDIS
Document de Jean-Paul Colas
A l’origine, E10 était l’appellation des équipements
de commutation téléphonique numérique, développés
en étroite collaboration entre le CNET et la CIT, pour
la réalisation d’autocommutateurs publics français.
L’appellation CITEDIS, désignant initialement les
application dérivées de E10 pour les autocommutateurs
publics exports et privés (PABX et PBX), a été
très rapidement restreinte à ces derniers.
1 – Winterthur
Le premier PABX CITEDIS a été commandé par
la compagnie d’assurances Winterthur pour la desserte de
ses services dans sa tour éponyme du quartier de La Défense.
La capacité à installer était de 1400 postes,
avec extension possible à 1700 postes. Le choix du client
était résolument moderne :
- totalité des postes à numérotation multifréquence.
- mise à disposition de double-appel, filtrage, renvois,
conférence à trois, conférence à auditeurs
multiples. .
- possibilité d’appel de correspondants intérieurs
et extérieurs par listes de numéros abrégés.
- fonctions d’opératrice commandées par pupitres
sans manipulation de joncteurs.
- centralisation des fonctions d’exploitation, de gestion
et de supervision.
Peu après la mise en service de « Winterthur »,
deux autocommutateurs CITEDIS ont été commandés
à l’étranger, pour les aéroports
d’Amman en Jordanie et de Bagdad en Irak. Les
caractéristiques nouvelles étaient celles de PBX
:
- raccordement des postes de différentes entités
indépendantes, d’une part la direction de l’aéroport
et ses multiples services annexes (sécurité, police,
etc...), d’autre part les compagnies d’aviation.
- intégration dans le réseau téléphonique
public (raccordement à un ou plusieurs autocommutateurs
d’abonnés ou de transit).
2 – RATP
Quelque temps plus tard, une autre possibilité, dérivée
des autocommutateurs E10, a été utilisée
pour la connexion sur un même CITEDIS des postes de deux
importantes stations de la RATP.
Initialement, la RATP avait lancé un appel d’offres
pour deux PABX devant desservir chacun
une station de métro parisien. Après une réponse
conforme à la demande, CIT a proposé un PABX unique
dont les postes de l’une des stations étaient raccordés
par concentrateurs satellites : les liaisons avec l’autocommutateur
s’effectuaient par liaisons MIC installées dans les
tunnels du domaine RATP (par cela, elles ne contrevenaient pas
aux règles d’exclusivité du réseau public).
La comparaison de coût entre celui d’un CITEDIS et
celui de deux PABX de la concurrence fut décisive pour
le choix du CITEDIS.
Le nombre de postes de toute station RATP n’étant
que de quelques centaines, ce choix ouvrait aussi la possibilité
de rattachement d’autres satellites à cet autocommutateur.
3 – Assemblée Nationale
Au début de l’année 1980, la questure de l’Assemblée
Nationale décida le renouvellement de son autocommutateur.
Après consultation des différents constructeurs,
la sélection conduisit au choix entre un autocommutateur
directement géré par ordinateur et le CITEDIS.
Compte tenu des besoins d’une capacité de l’ordre
de 1000 postes, la proposition de base de notre concurrent était
sensiblement plus basse que la nôtre.
Par contre, pour éviter un coût d’exploitation
incontrôlable, la demande du client était que les
appels extérieurs des utilisateurs (députés,
assistants, etc...) leur soient facturés à l’exception
de ceux vers les abonnés du département de leur
circonscription et de Paris intra-muros.
Pour la réalisation de cette fonction, notre concurrent
proposait le raccordement des postes par l’intermédiaire
de boîtiers individuels sachant effectuer cette analyse.
En dehors du développement du boîtier, cette solution
comportait plusieurs inconvénients :
- l’intervention directe sur le boîtier en cas de changement
de titulaire ou simplement de sa localisation.
- l’éventuel manque de disponibilité ultérieure
de ce produit en cas de panne ou d’extension des besoins.
- le coût global de ces boîtiers, de l’ordre
de 600, excédait alors à lui seul le coût
de l’autocommutateur lui-même.
Par contre, pour le CITEDIS, cette fonction pouvait être
réalisée simplement par la mise à disposition
aux différents postes concernés de la fonction de
numérotation abrégée incomplète :
-le titulaire du poste, après composition du préfixe
de numérotation abrégée incomplète
(par exemple : #), compose les six derniers chiffres du correspondant
recherché de son département.
-la disponibilité de cette fonction était immédiate
sans coût de développement, avec une totale possibilité
d’extension ultérieure.
Le choix du client fut donc en faveur du CITEDIS.
L’ironie de l’histoire est que, peu avant l’installation
de l’autocommutateur, on apprit que les règles d’exploitation
avaient été changées et qu’aucun poste
n’était plus soumis à facturation individuelle.
4 – Villepinte
Après l’installation de plus d’une vingtaine
d’autocommutateurs CITEDIS de moyenne capacité (1000
à 2000 postes) desservant les sièges sociaux de
banques et de diverses sociétés à fort trafic,
un autre défi a été l’appel d’offre
pour l’équipement du Palais des Expositions de Villepinte
par un central de type PBX, d’une capacité de l’ordre
de 5000 postes.
La caractéristique nouvelle était la souplesse d’adaptation
à des configurations d’organisation propres à
chaque nouvelle exposition.
Certaines pouvaient comporter plusieurs centaines de stands indépendants
et de capacités très diverses. Une même société
pouvait être localisée en un seul stand ou dispersée
en plusieurs sites.
A l’encontre des PABX, hormis les échanges entre les
personnels d’une même société et quelques
appels avec les services généraux de l’exposition,
le trafic était très majoritairement échangé
avec l’extérieur de l’exposition. Cela avait
conduit à permettre l’accès direct des appels
sortants, sans composition de préfixe. Pour les appels
locaux, les exposants disposaient alors de la facilité
de listes de numéros abrégés.
Par la suite, les fonctions nécessaires aux autocommutateurs
privés ont été introduites dans le produit
standard E10 |
Les relations
avec les spécificateurs, appartenant au CNET Paris, n’étaient
pas toujours faciles. Ainsi l’établissement de Lannion
a pu avoir l’impression que les spécifications, au moins
initialement, étaient dérivées des systèmes
spatiaux AXE et 11F et favorables à ces systèmes. Cependant
on peut considérer que cet effort pour respecter les NEF a
eu un effet positif sur le plan de la qualité de fonctionnement
et d’exploitation du E10B.
Dans la même période CIT-Alcatel Lannion développe
deux équipements complémentaires.
- Le premier est un concentrateur satellite CSE avec deux ou quatre
circuits MIC assurant la liaison avec le commutateur auquel il est
raccordé. Il fonctionne avec un microprocesseur Intel 8085
et est mis en service à la fin de 1980.
- Le second est un centre satellite numérique (CSN), permettant
de raccorder des voies analogiques et numériques à un
commutateur E10.
Ce projet est dirigé par J-B Jacob. Il bénéficie
d’un apport extérieur, celui de trois ingénieurs
de la jeune société américaine Digital Switch,
qui avaient rejoint Alcatel et qui étaient informés
du développement pour le raccordement numérique d’abonnés
« de trois composants essentiels : un codec, un brasseur d’intervalles
de temps, un microprocesseur 4 bits, s’interfaçant naturellement
avec les deux autres composants et qui pouvait traiter un canal commun
de signalisation».
La faisabilité du CSN devenait assurée. Le microprocesseur
utilisé est le 80186 d’Intel.
Le CSN est présenté à la Conférence internationale
ISS de Florence en 1984. J-B Jacob indique « Nous avons eu deux
ou trois questions de Mr Joel ... C’était bien la première
fois que les Bell Labs s’intéressaient au système
E10 au cours d’une Conférence ISS. Nous n’étions
pas les seuls à trouver cette architecture séduisante
». Les premiers CSN sont mis en service en 1986.
 Un des tous premiers CSN mis en service.
Un des tous premiers CSN mis en service.
Tous ces efforts de développement permettent à Alcatel
de fabriquer en série dès 1981 des commutateurs E10B,
qui dans la classification de France Télécom est du
NIVEAU 1, six ans après E10A, classé NIVEAU 3.
De plus CIT-Alcatel a la possibilité d’adapter ses commutateurs
à la grande variété des réseaux déjà
installés, car elle avait accumulé de l’expérience
en s’étant frotté dès 1975 aux marchés
à l’exportation.
« Le prototype de Brest [E10B] fut livré avec 13 mois
de retard et mis en service le 16 juin 1981, [alors que le prototype
MT25] fut finalement livré avec un retard de 12 mois fin août
1981... le Groupement commutation du CNET écrivit alors»
: « Thomson aura mis environ un an de moins que CIT pour développer
un autocommutateur de grande capacité (3 ans pour le MT25 contre
4 ans pour le E10B) ». Ce point de vue du CNET Paris, peu étayé
et partial, est nuancé par G. Théry. « Si j'observe
les phases de développement des systèmes de commutation
temporelle français MT20-MT25 ou E10-E12, je constate une complète
similitude dans les délais. Depuis la date du lancement jusqu'aux
dates de mise en service.
Les périodes de développement des systèmes E10
et MT20 sont donc parfaitement superposables. Il n'y a pas de surprise,
et il n'y a pas lieu aujourd'hui de douter du succès du MT20,
pas plus en tout cas que nous n'avons douté, il y a deux ans,
du succès du E10, dans sa version de deuxième génération
dite E10B. Par ailleurs, le MT20 compense ce décalage dans
le temps par une légère supériorité technologique
sur le E10».
426 Commutateurs E10N1 sont installés
en France, dont 35 en Île-de-France inclus 2 dans Paris
intra-muros et dont les 18 en Outre-mer. (soit plus que les 416 cités
dans les sources habituelles... et ce, sans comptabiliser les E10N1
provisoires en remorque utilisés çà et là
en cas de panne de commutateur existant, ou dans l'attente d'une mise
en service d'un nouveau commutateur à venir.)
Les Commutateurs E10N1 seront les premiers à
supporter en France les abonnés de type Numéris (RNIS)
à partir du 21 septembre 1987 à Brest puis en Île-de-France
à partir du 3 août 1988.
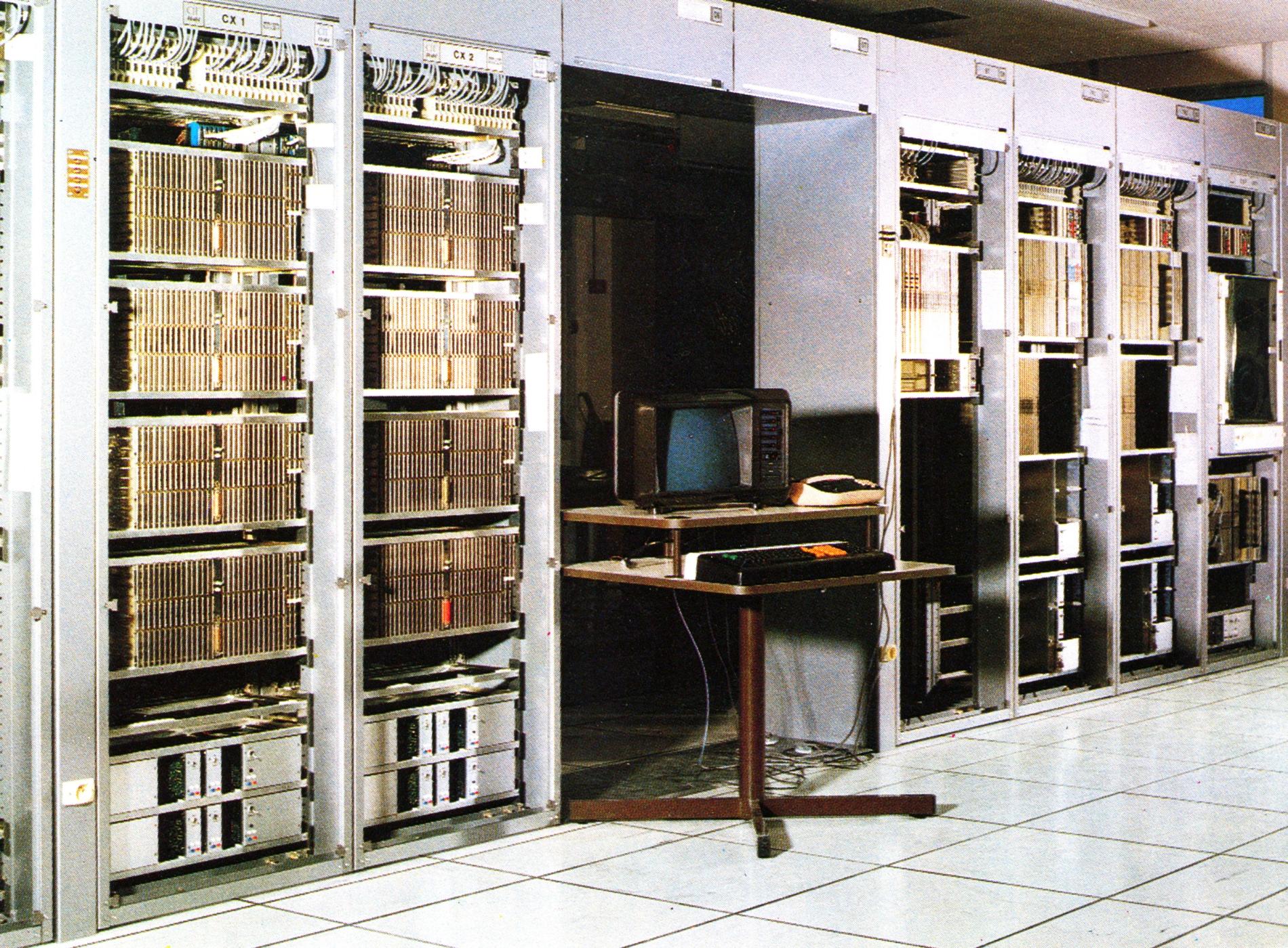

Commutateur E10N1 prototype BREST-CENTRE 3 (QU67), alors en expérimentation
courant 1980. mis en service le 16 juin 1981 - hors service le
19 mars 2002. A droite, le centre de Traitement des Informations de
Saumur, équipé d'un ordinateur MITRA 225.
sommaire
Développements
d’URA par AOIP et THOMSON
L’AOIP, fabricant sous licence de commutateurs Crossbar avait
fondé deux usines de fabrication à Guingamp et à
Morlaix, dans l’environnement proche de Lannion. Cette entreprise
participait au groupement Socotel et pouvait mener certaines études
en commutation même si ses moyens de R&D étaient
limités. C’est ainsi que le CNET avait décidé
de lui attribuer l’étude des raccordements d’abonnés,
tout en apportant son soutien
pour la conception. C’est ainsi que l’AOIP met au point
un EMA (Equipement de Modulation d’Abonnés) de
première génération.
Elle poursuit ce travail et « 1976 voit l’aboutissement
des études d’un EMA de deuxième génération
menées par l’AOIP et le CNET.
Cet EMA bénéficie des progrès réalisés
en micro-électronique (microprocesseurs, circuits intégrés
spécifiques pour des fonctions analogique».
Ces études de l’AOIP sont financées par la DGT.
CIT-Alcatel n’apprécie guère cette « décision...
prise par [l’administration] de confier le développement
et la fabrication d’équipements d’abonnés
à l’AOIP. Il nous faut donc gérer ce pseudo sous-traitant».
L’AOIP rencontre des difficultés dans l’industrialisation
de cet équipement et compte poursuivre ses études sur
l’EMA en 1977 et 1978. La DAII décide de faire appel à
Thomson. « On a imposé à Thomson de choisir une
unité de raccordement fabriquée par l’AOIP, cette
coopérative ouvrière sympathique ». Curieusement,
dans une situation de chassé-croisé, c’est Thomson
TCT qui est amené à se positionner pour maintenir cet
EMA, dont le nom devient URA2G. CIT-Alcatel avait entre-temps développé
son propre URA, appelé CSE (voir ci-dessus).
En 1979 la DGT impose à CIT Alcatel Lannion de reprendre l’établissement
de Guingamp, son « pseudo sous-traitant », et à
Thomson de reprendre l’établissement de Morlaix.
Le développement des logiciels prend de l’importance.
A partir de la fin des années 1970 les logiciels prennent de
plus en plus d’importance et pour y faire face le nombre d’ingénieurs
informaticiens augmente sensiblement dans l’établissement
de Lannion.
La production de logiciels - « fabriquer du code » - exige
des équipes nombreuses, ce qui impose de bien s’organiser.
Une division Software (DS) à Lannion est mise en place au côté
de la division Hardware (le matériel). Il faut faire des choix
de langage de programmation et de compilateur, de recours ou non à
un assembleur...Il s’agit aussi d’assurer une bonne gestion
des logiciels de façon à corriger rapidement des erreurs
et à permettre des évolutions.
C’est ainsi par exemple que le logiciel du CTI est découpé
sous-ensembles appelés IME (Image Mémoire Exécutable)
et celui du CSN en OL (organes logiciels). En cas d’intervention
sur un sous-ensemble, seul ce sous-ensemble est re-fabriqué.
Cette technique évite le recours aux patches et simplifie la
gestion du logiciel. « L’OL rassemble les modules de logiciel
réalisant une fonction élémentaire et maitrisés
par une ou quelques personnes. L’OL est une unité de fabrication
du logiciel »
sommaire
Exportation (1979-1985)
A partir de 1980 l’exportation de commutateurs E10 est plus facile,
car il s’agit de la version E10B plus mature, avec CSE et microprocesseurs.
Le volume des commandes augmente fortement. Alcatel signe des commandes
(Yémen, Maurice, Liban, Ouganda Chili, Mexique, Jordanie, Maroc...)
et aussi des licences (Irlande, Afrique du Sud). Il faut aussi mentionner
le grand contrat de l’Inde avec licence, qui a été
négocié en 1982 et qui prévoyait un transfert
technologique associé à la construction de deux usines.
Alcatel ne manque pas de difficultés à résoudre
pour convaincre les clients et affronter les concurrents. Il apparait
de façon inattendue que le principal concurrent est paradoxalement
Thomson avec son commutateur MT 25... Les équipes Thomson-CSF
avaient acquis une bonne expérience à l’exportation
notamment dans les domaines du spatial et des faisceaux hertziens
et montrent de l’agressivité dès 1978, dans la
période où elles étaient concurrentes d’Alcatel.
Mais à partir de 1983 la fusion devient à l’ordre
du jour.
Les ingénieurs d’Alcatel et Thomson se sont assez rapidement
engagés dans la coopération technique, les commerciaux
ont mis plus de temps pour enterrer la hache de guerre commerciale.
Ainsi les situations d’affrontement commercial se sont multipliées.
Dans certains pays (Chili, Liban...) l’affrontement est resté
limité, car les clients ont partagé les commandes entre
les deux industriels français. Par exemple au Liban comme le
raconte Pierre Le Dantec. « Nous aurons la joie de recevoir
la commande de quatre E10 supplémentaires, remplaçant
autant de MT [trop en retard pour la livraison] pour le compte de
notre rival du moment, nous sauvons la mise de notre futur associé
! ». La concurrence a été plus rude en Finlande
et aussi en Egypte, où après une première installation
par Alcatel d’un central E10, Thomson obtint en 1979 le marché
du renouvellement du réseau égyptien, en établissant
un partenariat
avec Siemens et en prenant le pas sur une proposition de fournisseurs
américains (Western Electric, GTE...), tout en torpillant la
proposition Alcatel, soutenue par la DGT90...
Pour mener à bien leurs activités d’exportation
les équipes de Lannion emménagent à Tréguier
en 1984 et développent un ensemble de missions : ingénierie
sur les sites des clients et aussi pour préparer en amont les
adaptations logicielles prenant en compte les spécificités
des réseaux des clients, regroupement et assemblage de tous
les équipements, expédition, management des équipes
chantiers, assistance des clients qui aboutit à la création
d’un service de téléassistance par téléphone,
documentation, formation des personnels des clients... La Division
de Réalisation EXport (DREX), fondée en 1979 et dirigée
par P. Le Dantec, connait ainsi une forte expansion tout en coopérant
étroitement avec la DRC (Direction de Réalisation des
Centraux de commutation).
La téléassistance, mise en place vers 1984, a
constitué un service important pour les clients étrangers.
« Nous pouvons organiser à Tréguier un espace
qui regroupe les maquettes des affaires en cours... Ces maquettes
servent à reproduire les défauts qui sont signalés
par les chantiers et les exploitants, mais aussi à prendre
la main à distance sur les commutateurs de nos clients, bien
entendu avec leur autorisation, pour établir un télédiagnostic,
voire pour tenter une intervention à distance...Les décalages
horaires nous conduisent à organiser une présence 24h/24
avec des astreintes à domicile».
Le service de formation, créé à Lannion en 1972
d’abord pour les nouveaux embauchés de la SLE, très
nombreux à cette époque, est transféré
à Tréguier en 1975 et orientera ses efforts principalement
vers les personnels des clients étrangers.
Développement des activités transmissions
Au sein de la CGE, les activités de transmissions étaient
concentrées à Villarceaux pour les systèmes de
transmissions analogiques (12 MHz et 60 MHz et multiplexages associés),
les seuls utilisés jusqu’à la fin des années
1970. A partir de 1976 l’équipe lannionaise, forte de
son expérience acquise lors des développements sur les
équipements en fréquence intermédiaire du guide
d’onde circulaire, développe une gamme complète
de systèmes de transmissions à 140 Mbit/s sur câble
coaxial 1,2/4,4 mm et à 560 Mbit/s sur câble coaxial
2,6/9,5mm, puis 2,8/10,2mm, conjointement avec les équipes
locales de la SAT pour ce dernier système. Cette gamme de produits
permettra de numériser le réseau interurbain français
(RIC), dont la première liaison de Paris à Reims sera
inaugurée le 19 décembre 1984.
Alcatel remportera de remarquables succès à l’exportation
avec cette gamme de produits, entre autres la numérisation
du réseau de câbles analogiques d’AT&T aux USA,
au milieu des années 1980, ce qui vaudra à l’équipe
lannionaise de remporter en 1982 le grand prix technique de la CGE
: le prix Azaria du nom du fondateur de la CGE.
La fabrication de ces équipements de transmissions numériques
à haut débit était assurée par l’usine
d’Ormes.
De son côté le laboratoire d’étude de LTT
(groupe Thomson), avait développé un système
de transmission numérique à 140 Mbits/s qui remportera
également un brillant succès en Australie. Il faut noter
que l’investissement intellectuel, acquis pour ces développements
au sein d’Alcatel à Lannion, sera grandement mis à
profit dans les années 1990 pour la mise au point des systèmes
de transmissions sur fibres optiques tant dans les domaines terrestres
que sous-marins.
Les difficultés de Thomson provoquent la fusion des activités
des deux groupes français.
La nouvelle donne imposée par la DGT en 1976 a pu faire croire
que la Thomson était le grand gagnant. Mais Thomson doit à
la fois continuer à fabriquer des matériels de conception
ancienne, CP400 et Pentaconta dont le pic de production est atteint
en 1977, adapter deux techniques d’origine étrangère
les commutateurs AXE et Metaconta, abandonnés dès 1983
et est amené à soutenir le développement du commutateur
numérique MT 25 dès 1977.
En 1982 la crise industrielle de fabrication des commutateurs met
les deux groupes nationalisés dans une position difficile.
Ils ne peuvent plus que compter sur eux-mêmes, les partenariats
avec des groupes étrangers étant rompus. Ericsson se
retire entièrement de France, et ceci pour la deuxième
fois de son histoire, car un premier retrait était intervenu
dans les années 1930. Le Groupe ITT reste bien présent
en Europe, mais principalement à travers ses filiales Bell
Anvers et SEL Stuttgart.
Dans la « nouvelle donne » de la numérisation des
Télécommunications, les forces de R&D de Thomson
Télécom sont plutôt impressionnantes. Elles regroupent
à la fois dans le secteur de la commutation des anciennes équipes
STE (Colombes, Cergy-Pontoise) et LMT (Boulogne, Orvault, Lannion)
devenues Thomson-CSF-Téléphone (TCT) et dans le secteur
des transmissions des anciennes équipes LTT (intégrées
à la Thomson-CSF) pour les transmissions par câble et
de Thomson-CSF DFH (Division Faisceaux Hertziens.
En face les forces de la CGE sont réduites. En dehors de l’établissement
de Lannion peu de R&D est engagé dans le numérique
au sein de la CGE, y compris dans la transmission.
Très vite, dès que la nationalisation des deux groupes
est engagée (1983), la fusion des activités de télécommunications
de Thomson et d’Alcatel est actée. Elle sera achevée
en 1985.
Elle s’inscrit dans une nouvelle répartition des activités
entre les deux groupes, qui ne couvrent pas que les télécommunications,
mais aussi les composants, l’électronique militaire, le
spatial (satellites, stations terriennes), le radiotéléphone.
Pour les télécoms le choix se porte sur une absorption
de TCT et des faisceaux hertziens (DFH) par Alcatel.
sommaire
Deux années de convergence (1984-1986)
Au moment de la fusion TCT-Alcatel en 1985 les équipes de R&D,
qui ont achevé la mise sur les rails de l’E10B et du MT25
travaillent sur des nouveaux produits : E10-5 pour Alcatel et MT35
pour TCT. Mais l’heure est à la convergence.
La première étape de cette convergence est une étape
de réflexion, menée par la filiale commune ATD (Alcatel
Thomson Développement) animée par Paul Gourlay (Lannionnais).
« En 1985 ATD prend à son compte les résultats
de l’étude ECRINS [menée à Lannion par le
CNET et Alcatel] et réfléchit à la faisabilité
en conservant les objectifs de l’étude initiale mais en
tentant de réduire les coûts [de R&D] par la filiation
avec un système existant. C’est le projet ATU (Alcatel
Thomson Unifié) »
La filiation à l’existant se traduit pour l’essentiel
par la prise en compte de trois faits principaux. D’abord des
équipements de raccordement d’abonnés sont en voie
de finalisation : le CSN d’Alcatel et l’URN de TCT développée
à partir du MT35. Ensuite le commutateur E10B n’a un avenir
que si son organe de commande est modernisé en utilisant des
microprocesseurs beaucoup plus rapides. Enfin la chaine de traitement
X83 de conception TCT, dédiée à la commutation
numérique et utilisant des microprocesseurs Motorola 68000,
présente une architecture originale.
Le groupe de travail « convergence » de ATD prend des
décisions lors de séminaires de plusieurs journées,
qui ont pu être appelés « conclaves », car
tous les participants ont été confinés dans un
hôtel, y compris la nuit et même pour les locaux. Le premier
conclave a eu lieu en fin 1984 à l’hôtel Ramada
de Vélizy et a duré cinq jours. D’une part le CSN
est préféré à l’URN, car il peut
assurer une part importante de la convergence entre le E10 et le MT25.
Il fait l’objet de quelques adaptations pour fonctionner pleinement
avec un MT25.
D’autre part le MT35, dont un seul exemplaire avait été
déployé, est sacrifié au profit du E10-5.
Le second conclave, qui a lieu au Grand-Hôtel de Perros-Guirec
les 5 et 6 juin 1986, commence par un examen des propositions des
deux équipes : « Côté MT J-P Poindron parle
de reprise de certains matériels pour l’optimisation des
coûts et l’accroissement des performances. Côté
E10, J-P Posloux et Michel Ruvoën présentent à
leur tour les possibilités d’évolution [entre autres]
:
-Refonte des organes de commande du E10 à partir des cartes
processeur et mémoire du X83 à base de 68020
-Emulation de l’ELS sur 68020
-Portage du CTI sur X83, avec duplication de sa commande...
L’ampleur des annonces au-delà du portage du logiciel,
a fait l’effet d’une bombe dans les milieux d’origine
MT. Au travers de quelques sourires en coin, on sent dans l’assistance
un mélange de scepticisme, d’inquiétude et de soulagement
:
-Scepticisme : comment E10, un produit réputé vieillot,
peut-il ainsi évoluer ?
-Inquiétude : Et si c’était possible ? Le E10 pourrait
être le support du produit du futur au détriment du MT,
qui semble pourtant un produit plus moderne.
-Soulagement : On aura peut-être notre produit de convergence,
au-delà de toute espérance ! »
A la fin du séminaire il est décidé de poursuivre
le cheminement de la démarche sur la base de ce qui a été
proposé par l’équipe E10 et fin juillet la direction
Générale entérine la décision de développer
à Lannion le nouvel organe de commande OCB283 sur la
base de la chaine de traitement X83, développé
par Thomson.
Ce développement à Lannion sera soutenu par des anciens
ingénieurs d’Ericsson, notamment Alain Morelieras, ancien
du site de Boulogne et venu à la CIT Vélizy. En complément
de cette décision le projet E10-S et sa version évoluée
E10-5 sont abandonnés, notamment en raison de la difficulté
de pénétrer le marché américain.
1986 Les arbitrages
entre lignes de produits sont l'objet d'âpres discussions et
se concluent par la mise en œuvre d’un nouveau projet pour
faire évoluer le commutateur E10B en s’appuyant sur les
compétences des deux entreprises maintenant fusionnées.
Les objectifs sont les suivants :
• Disposer d’une nouvelle architecture matérielle
conforme à l’état de l’art
• Ouvrir le système à des évolutions fonctionnelles
• Conserver les logiciels d’application existants
• Accroître la capacité de raccordement d’abonnés
et de traitement des appels
Le projet donnera ainsi naissance à la troisième génération
du système E10 (E10 OCB283) déployée dès
1990.
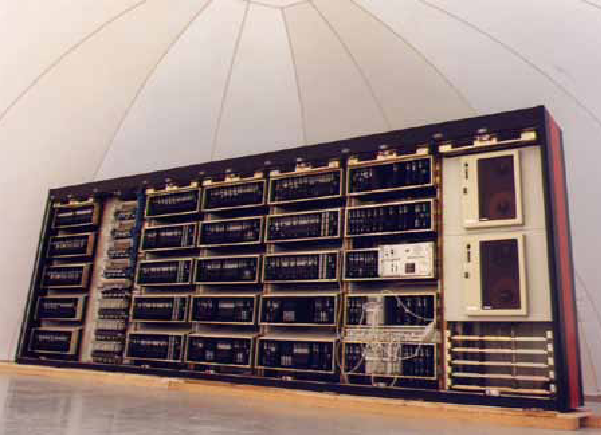
Maquette de l’OCB283 en cours d’essais climatiques et de
sensibilité électromagnétique (dans le dôme)
La conception des nouveaux logiciels requiert alors une véritable
formation d’informaticiens et nécessite de faire face
au défi majeur de la reconversion du personnel à ces
technologies.
Le produit résultant étonne le marché par ses
capacités, sa modularité et ses performances :
• Capacité de 2048 MIC
• 100 000 lignes d’abonnés
Rapidement, les clients des générations précédentes
sont convaincus de l’intérêt de cette nouvelle version
pour faire croître et moderniser leur réseau. De nombreux
nouveaux clients sont conquis et, dans plusieurs pays, la vente de
commutateurs s’accompagnera bientôt d’un transfert
de technologie avec création de filiales.
Le produit E10 OCB283 sera mis en service en Chine en 1990,
en Pologne et à Karachi au Pakistan en octobre 1991, puis à
Brest fin 1991.
Fin 1991, ce produit sera aussi expérimenté avec succès
à Concarneau comme élément de commutation
du réseau mobile.
Il est ensuite généralisé à l’ensemble
des grands contrats à l’exportation et aux commutateurs
mobiles .
Achèvement de la fusion
Sur le plan du développement technique la fusion est plutôt
positive.
Il n’y pas eu trop de de pertes de temps, ce qui a permis la
prise de décisions sur la convergence E10 / MT avant la reprise
des activités Télécoms d’ITT, effective
au début de 1987.
Les équipes TCT et Alcatel, notamment TCT Orvault et Alcatel
Lannion, ont appris à coopérer. Et le bon équilibre
entre CIT-Alcatel (Lannion) et TCT est symbolisée par le binôme
Gourlay-Tournier. Tous les deux sont nommés à un poste
de direction pour les activités de commutation de la nouvelle
Alcatel, le premier comme Directeur Technique, le second comme directeur
du Développement.
Cependant rapidement le second prend de l’ascendant au sein de
la Direction.
Les activités de R&D de commutation sont redéployées
sur les trois sites de Vélizy, de Lannion et Orvault avec un
abandon du site de Boulogne.95 En 1986 les travaux de rénovation
de la commande du E10B sont entrepris avec l’objectif d’aboutir
à un « E10B à base d’OCB283 ».
Dès 1988 cet E10 de la troisième génération
fait l’objet d’offres commerciales à l’export,
qui aboutissent à des commandes ne pouvant être satisfaites
qu’en 1991.
La fusion aboutit en 1986 à la mise en place d’un management
d’Alcatel recomposé, « melting pot » de cultures
variées, qui se répartit les rôles.
La culture Thomson TCT prend une part prépondérante.
Elle est le produit des trois cultures LMT, Ericsson France et Thomson-CSF,
qui se sont mélangées entre 1978 et 1983 au sein de
TCT avant de s’intégrer dans Alcatel.
Le Directeur Général d’Alcatel-CIT est P. Guichet,
d’origine Thomson-CSF Espace. Ainsi la Direction du développement
est prise en main par Ch. Tournier, un ancien LMT, qui imprime sa
marque dans la définition des lignes de produits.
La Direction industrielle est assurée par un ancien d’Ericsson-France,
qui décide de concentrer la fabrication pour la commutation
dans deux usines, celles de Cherbourg et d’Eu. La Direction du
Commerce internationale est l’affaire des anciens de la branche
faisceaux Hertziens de Thomson-CSF.
Il reste la Direction Scientifique pour la commutation, prise en main
par F.Tallégas, ancien directeur de la SLE. La « vieille
CIT » est très peu présente après le départ
de C. Fayard.
Comme l’indique Michel Ruvoen en 2006, ancien de la SLE, «
la nouvelle organisation de la Direction Technique, mise en place
en 1986, a pour effet, entre autres, de faire « prendre la mayonnaise
» entre les différentes équipes et les différentes
cultures. Thomson [TCT] a déjà une expérience
des fusions (Ericsson, LMT, LCT..) et leurs équipes sont déjà
aguerries. Ce n’est pas le cas des équipes CIT Lannion
qui ont jusque-là grandi dans le « cocon familial ».
Donc à Lannion la petite équipe de Thomson [agrandie
à près d’une centaine de personnes pendant la période
Thomson] vient s’installer dans les locaux de CIT et arrive avec
un formalisme et des procédures que CIT Lannion ne connait
pas... La contrepartie a été que le fonctionnement est
devenu beaucoup plus lourd. Avec le recul, c’est pourtant un
mal nécessaire pour faire travailler ensemble toutes les parties
».
La mise en place de cette organisation coïncide avec la
privatisation d’Alcatel-Alsthom.
Georges Pébereau cède la place de PDG durant l’été
1987 à P. Suard, qui écrit plus tard : « Un vrai
patron fut nommé à CIT : Pierre Guichet.
Ce fut à lui d’agir dans le cadre de l’organisation
du nouvel Alcatel. [C’était] un homme d’action, de
caractère et d’expérience ».
Ce remplacement provoquera des regrets. P. Le Dantec indique plus
tard : « P. Guichet est nommé à la Direction Générale.
C. Fayard nous quitte discrètement. Nous le regretterons ».
De son côté Paul Gourlay prend sa retraite vers 1993.
Durant les années 1980 compliquées de fusion, il a montré
beaucoup de qualités : compétence, écoute de
ses équipes, vision stratégique, Il a été
ainsi un grand manager, qui cherchait en premier à motiver
ses équipes.
sommaire
La crise de la fabrication industrielle (1977-1986)
La
nébuleuse des usines de fabrication CIT
Jusqu’en 1960 la CIT est restée concentrée en région
parisienne, dans la proximité des deux établissements
de son site historique du 15ème arrondissement, la commutation
rue Emeriau et la transmission rue Keller. « Dotée de
9 établissements en 1966, la CIT en compte 22 en 1971
et 31 en 1975, soit en moyenne une création de plus de deux
établissements par an. Ouverte en 1976 l’usine d’Orléans
constitue le 32ème établissement de l’ensemble
CIT-Alcatel». En particulier entre 1956 et 1961 la CIT fonde
plusieurs établissements, d’abord en commutation
avec les usines d’Aix les Bains et de Pontarlier, puis en transmission
à Montargis et rue de Villarceaux à Nozay, pas loin
du laboratoire CGE de Marcoussis. L’usine de Lannion est fondée
en 1966. En 1968 la CIT reprend cinq usines venant d’Alcatel,
dont celle d’Annecy, et par ailleurs l’usine de Cherbourg
construite par la CGE pour la fabrication de semi-conducteurs et qui
n’avait plus d’emploi après la cession de cette activité
à RTC. A partir de 1969 c’est le tour des créations
de Vélizy, Saintes... et parmi les dernières Tréguier,
Coutances et Ormes, près d’Orléans Au total CIT
est bien à la tête de 32 établissements en 1976.
Durant cette forte croissance il n’y a pas de véritable
stratégie industrielle, déterminée à partir
de prévisions approfondies. On reste dans les schémas
industriels du passé avec le maintien du cloisonnement entre
la transmission et la commutation, des hésitations sur la fabrication
des composants. L’avènement de l’électronique
numérique n’est pas prise en compte : accroissement des
investissements de production, réduction de la fabrication
matérielle et beaucoup de programmation (« produire du
code »). Ces évolutions accroissent les besoins de formation
professionnelle.
Il n’y a pas non plus de stratégie territoriale prenant
en compte l’environnement, notamment les compétences industrielles
et les possibilités de formation. Les usines sont dispersées
dans de nombreuses régions, à l’exception du sud
en dessous de la ligne Bordeaux-Grenoble, qui ne semble pas intéresser
la CIT. Peut-être la CIT a-t-elle choisi le site de Pontarlier,
car placé en Franche-Comté, région reconnue dans
le secteur de la mécanique de précision ? Peut-être
a-t-elle choisi Cherbourg en raison de la proximité du pôle
Philips des semi-conducteurs à Caen, la CGE et Philips cherchant
à coopérer dans ce domaine ?
La
reconversion de l’usine de Saintes
Après les bons résultats de l’usine de Convenant
Vraz de Tréguier, les reconversions des usines CIT vont se
poursuivre. La suivante est celle de Saintes. Le cadre, l’usine
en elle même, la qualité et la motivation des équipes
en place vont rendre cette mission agréable. Seul point noir,
la distance !
Pour s’y rendre, 2 solutions sont possibles :
-la voiture, départ la veille, nuit d’hôtel à
La Rochelle ou à Saintes.
-l’avion de la jeune compagnie aérienne Brit Air, son
pilote en chapeau mou et son chien. Là encore, deux solutions
:
-atterrissage à Royan, location de voiture et une heure de
route pour Saintes, inversement le soir.
-atterrissage à Saintes sur aérodrome militaire et partiellement
civil.
Cette solution nous met à pied d’œuvre mais comme
nous allons le voir elle est très risquée.
La base de Saintes dépendant de Cognac, le plan de vol doit
être déposé en temps voulu ce qui a été
fait. Atterrissage sans problème à Saintes après
un survol de la maison du pilote au-dessus de la Charente. Apparemment,
il y a quelques échanges radio entre le pilote et ce qui sert
de tour de contrôle. Les militaires n’étant pas
prévenus du vol maintiennent l’avion en bout de piste
et n’autorisent pas le roulage de l’avion sur la partie
civile de l’aérodrome.
Nous restons donc dans l’appareil. Après d’âpres
échanges, les passagers sont autorisés à débarquer
mais le pilote reste « aux mains des militaires » comme
« otage ».
Après avoir effectué notre journée de travail,
retour le soir ; nous retrouvons le pilote qui est resté à
la base. Nous ne saurons pas s’il a été mis au
« gnouf ».
Décollage en grande pompe, les militaires tout heureux d’avoir
sans doute un peu de mouvement vont se livrer à un exercice
incendie et nous décollons escortés par tous les véhicules
d’incendie.
Vol de retour cap nord. Je suis, comme d’habitude, au siège
du co-pilote et le vol me semble long. Je vois le pilote soucieux,
il consulte fréquemment ses cartes et refait des points sur
ses balises ; il finit par sortir sa règle CRAS (ou l’équivalent
en aviation). Il finit par me confesser que nous sommes au dessus
de Nantes depuis 30mn et que nous ne progressons que lentement car
nous avons un vent de 200km/h dans le nez .Il va donc modifier son
altitude après autorisation et nous nous poserons à
Lannion avec une heure de retard, fatigués par cette dure journée.
Après la mise en route de l’usine de Saintes qui par sa
configuration représentait une duplication de Tréguier
Convenant Vraz - un seul hall d’assemblage et donc un flux de
production facilement gérable - une toute autre mission attend
les équipes industrielles de Lannion.
Il s’agit en effet de reconvertir l’usine de Cherbourg à
la production du E10, et donc de passer de l’électromécanique
au tout électronique avec tout ce que cela comporte en terme
de méthodes différentes mais aussi de modification en
terme de culture de la part des équipes en place. L’implantation
des bâtiments en plusieurs halls complique l’organisation
du flux de production.
A cet effet, une équipe permanente de la Direction Industrielle
de Lannion est présente en semaine. Les trajets se font par
voie aérienne par la jeune compagnie Brit Air.
A cette navette hebdomadaire s’ajoutent des missions ponctuelles
qui se font en semaine toujours par la Brit Air et son remarquable
pilote au chapeau mou, son cache col, mais sans son chien.
C’est ainsi qu’un beau matin, nous voilà au départ
de Lannion pour la journée. Au moment de partir, le pilote
se rend compte que la porte de l’appareil ne s’ouvre plus
de l’intérieur. Il n’est pas question de décoller.
Par radio, le pilote demande alors au contrôleur de la tour
de venir nous ouvrir pour que nous puissions descendre.
Le démontage de la poignée accepté, non sans
réticence, par le pilote amène à la conclusion
que par suite de l’usure, les cannelures de celle-ci ne crochent
plus dans celles de l’axe du mécanisme de la porte. J.
Heurteur propose alors au pilote de meuler la poignée de la
porte pour rattraper les cannelures encore utilisables. Cette proposition
qui relève du bricolage incompatible avec les procédures
de l’Aviation Civile recueille auprès du pilote un accueil
pour le moins réservé. J. Heurteur fait un saut à
son domicile et revient avec la poignée rectifiée. Après
mise en place et vérification de l’efficacité,
le pilote consent à décoller.
Le trajet se passe sans dommage jusqu’à l’atterrissage
à Cherbourg. La piste de l’aéroport est orientée
NO/SE et comme il souffle un vent NO donc de face, le pilote n’arrive
pas à poser l’appareil qui continue à voler, nous
voyons ainsi passer l’aérogare. Finalement à force
de tirer sur le manche, l’avion décroche et finit par
« apponter ».
Après la journée de travail, décollage à
la nuit tombée. Comme nous sommes vendredi l’équipe
de Lannion doit décoller à son tour pour le week-end.
Et bien sûr, un des moteurs refuse de partir et ils devront
passer la nuit à Cherbourg.
Quant à nous, le décollage se passe sans problème
hormis le grand détour nécessaire pour ne pas survoler
La Hague, interdite de survol. Météo agitée,
ciel de traîne avec des cumulonimbus décelables au radar
; il faut donc slalomer entre eux. Quelque part au dessus des Iles
anglo-normandes, les ailes commencent à se couvrir de givre
que les dégivreurs pneumatiques des bords d’attaque désagrègent
en craquements peu rassurants. La situation ne s’arrangeant pas,
le pilote décide de descendre, nous survolons dans la pénombre
une mer grise et blanche.
Atterrissage à Lannion par l’ouest, redoutable vent de
travers et d’un coup de palonnier en finale, l’avion se
pose.
Bref, une journée sans histoire finalement !
Activités techniques dans les usines de fabrication
Schématiquement pour la CIT, comme pour les autres fabricants
de matériel téléphonique, on peut dire qu’il
existe deux modèles d’usines.
Le premier est celui de l’usine à mono-activité
(condensateurs, circuits imprimés, montage-câblage d’équipements
cross-bar...) sans technicité et sans investissements importants.
Le second est celui d’une usine avec un service technique, notamment
orienté sur les tests, et d’un service méthode
qualifié permettant de s’adapter à de nouveaux
modes de fabrication.
Pendant les années 1960-70 la CIT est restée sur le
premier modèle, alors que LMT a évolué en ouvrant
en 1972 l’usine d’Orvault. « Une décentralisation
de la direction des fabrications de la division téléphonie
et des services d’études de commutation téléphonique
permettra à l’usine d’Orvault de disposer de l’infrastructure
technique nécessaire au niveau technologique du système
E11.
Après la création du centre de
Lannion, deux équipes du CNET quelque peu en compétition
se sont trouvées à travailler sur la commutation
électronique : l’équipe de Lannion sur le projet
de commutateur temporel à commande distribuée Platon,
et l’équipe d’Issy-les-Moulineaux sur un projet
de commutation spatiale à commande centralisée dénommé
Périclès, qui fut mis en service au central
Michelet à Clamart.
- Le projet Platon, avec sa structure de cœur temporel
et concentrateurs distants, visait à couvrir les zones
peu denses, en profitant des économies permises par l’intégration
commutation temporelle/transmission numérique. Il fut industrialisé
par la SLE (Société lannionnaise d’électronique),
filiale de la CIT, sous le nom de système E10, dont la
tête de série fut mise en service à Poitiers.
- Le projet Périclès visait à couvrir
les besoins des grands centres urbains. Il ne fut pas industrialisé,
mais ses enseignements conduisirent au système E11
(puis 11F), dont la tête de série fut mise en service
à Athis-Mons.
La compétition entre les deux équipes ne fut pas
tant une compétition entre nature du point de connexion,
tout le monde étant d’accord sur le fait qu’à
terme les progrès dans l’intégration des composants
assureraient le succès des réseaux de connexion
temporels, mais sur la structure de la commande. Les Lannionnais
n’ont pas, au début, cru à la commande par
des calculateurs de type universel, mais par des calculateurs
très spécialisés, alors que les équipes
d’Issy ont compris très rapidement que le poids des
investissements en logiciel allait devenir prépondérant
et que donc il était nécessaire d’utiliser
les outils développés par l’industrie du software
(méthodes de spécifications, langages de programmation
de haut niveau, etc.) De fait, le logiciel des commutateurs électroniques
a vite représenté des millions d’instructions,
et des centaines « d’homme x ans » de programmation,
et à chaque génération technologique des
calculateurs, ce logiciel était porté sur les nouvelles
machines .
La réforme du CNET de 1970, en créant des «
secteurs » technologiques transcentres, dont le secteur
commutation, a mis les deux équipes sous les ordres d’une
même hiérarchie, et a permis une certaine convergence,
en définissant une gamme de systèmes, répondant
aux mêmes spécifications fonctionnelles, mais technologiquement
différentes, pour s’adapter aux divers besoins du
réseau : E10 (temporel, commande distribuée) pour
les petits centres d’abonnés, E11 (spatial, commande
centralisée) pour les gros centres urbains, E12 (temporel,
commande centralisée) pour les centres de transit. Les
restructurations industrielles ont fait quelque peu éclater
ce schéma, et sont restés le E10 (qui, après
plusieurs générations successives, est devenu commutateur
de très grande capacité) et la gamme MT20 (transit)/MT25
(abonnés), dérivée du point de vue du logiciel
du E11 via le 11F, mais à réseau de commutation
temporel. En effet, en 1978, à une conférence à
Atlanta, la DGT a annoncé officiellement qu’elle faisait
le choix du tout temporel pour son réseau. Mais pour des
considérations industrielles et de développement,
des commutateurs électroniques spatiaux ont encore été
commandés pendant plusieurs années après
cette date. |
Environ
200 personnes seront concernées par cette « décentralisation
des cerveaux », dont plus de la moitié seront des ingénieurs
et des cadres ». Cette mutation de l’établissement
d’Orvault est effectivement réalisée en 1975.
Une activité, pouvant être décentralisée
dans une usine de fabrication, est celle de la réalisation
de bancs de test. Dans les années 1973-76 cette activité
a plusieurs acteurs dans l’écosystème de Lannion
: le CNET et le laboratoire du groupement Socotel, les industriels
SLE et LMT.
Ainsi LMT « en collaboration étroite avec le CNET...a
mis au point le simulateur d’appels téléphoniques
(SIMAT) pour le contrôle du fonctionnement des centraux publics.
» De son côté la SLE-Citerel développe le
testeur Oracle de cartes logiques « dans le prolongement d’un
testeur développé en interne par le CNET.» SLE-Citerel
lance l’étude d’une machine de test des cartes analogiques,
appelée Arcouest, « après une visite au CNET de
la machine AOIP. » Au total SLE Citerel développe une
quinzaine d’équipements de test dans des domaines très
variés : test de composants électroniques, test de cartes
électroniques, tests logiciels, tests fonctionnels de l’ensemble
du commutateur.
Tardivement en 1976 la CIT ouvre une nouvelle usine de fabrication
en commutation à Ormes près d’Orléans et
lui confie de nouvelles tâches. « Le centre [d’Ormes]
met au point les méthodes de fabrication, réalise les
outillages spéciaux et les avant-séries, définit
enfin les méthodes de contrôle et réalise les
bancs et programmes de tests automatiques destinés aux usines
de série et aux clients étrangers » L’usine
d’Ormes se positionne pour concurrencer la machine Arcouest de
Lannion. En mai 1977 la « décision politique de F. Tallegas
[est] de prendre la solution Ormes... l’étude Arcouest
est arrêtée !
Il s’ensuit une année de galère avec les bancs
d’Ormes (Pretest, BF, Final, Mael).» Pas tellement surprenant,
car on sait que la conception et la réalisation de bancs de
test ne s’improvisent pas. Pour réussir il vaut mieux
confier ces tâches à une équipe expérimentée
qui dispose de partenaires dans son environnement.
La crise de l’emploi industriel dans les télécoms
Dans le courant de l’année 1975 certains signes avant-coureurs
ne trompent pas. Deux industriels renoncent à l’implantation
de nouvelles usines : LMT à Redon et à Vannes, AOIP
à Carhaix. Même si la CIT s’obstine à ouvrir
son établissement d’Ormes, LMT et Ericsson décident
des premières réductions d’effectifs dans certaines
de leurs usines.
Ainsi dès novembre 1975 la CFDT « exprime ses craintes...Verra-t-on
dans trois ou cinq années des usines bretonnes fermer leurs
portes ?» et demande un plan donnant « des garanties sur
le développement de la commutation temporelle (maintien du
potentiel d’études et de développement de la SLE
et du CNET Lannion, développement de la fabrication des centraux
E10 en Bretagne » et permettant une « transformation progressive
de l’activité des usines fabriquant des centraux électromécaniques
avec formation du personnel sur place »
Pierre
Marzin, bien dans sa manière, se dit alors « excédé
par « certains syndicalistes qui racontent n’importe quoi
sur la situation de l’emploi à Lannion »...mais
ne cache pourtant pas les problèmes qui se posent autour de
la sauvegarde de l’emploi dans l’électronique ».
Dans son rapport du 23 novembre 1975 auprès de la commission
des Postes et Télécommunications du Sénat, Pierre
Marzin indique « il y aurait une reconversion de la commutation
électromécanique en commutation électronique
affectant 20 000 personnes, ce qui ne manquera pas de poser un problème
difficile sur le plan local [à Lannion et Guingamp]... M. le
Sénateur-Maire envisage donc des transformations nécessaires
dans les
industries concernées et croit de son devoir d’alerter
le ministère sur cette situation [M.Norbert Segard] ».
De façon plus lapidaire Pierre Marzin en mai 1976 déclare
« des bobos dans deux ans ».
De nouveau en juin 1976 la CFDT précise : « Maintenant
on nous déclare que 50 000 emplois seront créés
dans les cinq ans à venir [prévisions du 7ème
Plan pour le secteur de l’Electronique et des Télécoms]
Quel crédit accorder à cette prévision...même
si les effectifs se maintenaient globalement dans le secteur des Télécoms
?...Certaines usines pourraient se retrouver dans des situations difficiles
assez rapidement [en raison d’une] augmentation de la productivité
par évolution technologique (la commutation électronique
permettrait une productivité deux à trois supérieure
à celle de la commutation Crossbar). Lannion est loin de Paris...peut-être
pourrait-on dire que les signaux d’alertes lannionnais n’étaient
pas
diffusés en dehors de la Bretagne. Pourtant ils étaient
bien transmis lors des audiences syndicales à la DGT, lors
de débats au Sénat par les interventions de P. Marzin,
et lors de visites de ministres en Bretagne.
La première alerte officielle d’une prochaine crise de
l’emploi dans les télécoms a été
lancée par la DATAR à l’été 1978
: « Un rapport établi par la DATAR permit de mesurer
l’ampleur des suppressions de postes prévues par l’industrie
[des télécommunications] ». Cette prise de conscience
des pouvoirs publics était bien tardive.
A l’automne 1978 les premières grèves pour le maintien
de l’emploi éclatent en Bretagne,
notamment dans les établissements AOIP et LTT. Début
avril 1979 la prise de conscience des Pouvoirs publics permet la mise
en place de mesures pour réduire le choc des suppressions d’emploi.
Les élections présidentielles de 1981 et les nationalisations
de Thomson et Alcatel viendront différer les échéances.
Ainsi le choc des fermetures d’usines a lieu principalement en
1983-86.
Face à la crise dans le secteur de la commutation
La fusion Thomson-Alcatel, dont le principe est acquis en 1983, avec
en plus la reprise de l’AOIP Guingamp en pleine débâcle,
accroit fortement la tâche de la gestion de crise, qui retombe
sur Alcatel. Treize établissements venant de Thomson TCT, dont
en commutation, qu’Alcatel doivent être gérés
en plus. Et on peut y ajouter les établissements de la CGE
absorbés un peu plus tard, provenant d’Alcatel Cables
et d’ABS (Alcatel Business Sytems), la branche de la téléphonie
privée. Au total ce « périmètre d’Alcatel
de 1983», commutation et transmission confondus, regroupe une
cinquantaine d’établissements sur le territoire français.
Les décisions prises de 1983 à 1986 par la direction
Alcatel dans le domaine de la commutation provoque la fermeture de
sept usines : CIT La Rochelle, CIT Bezons, CIT Saint Rémy de
Maurienne, LMT Lannion, AOIP Guingamp, Thomson-TCT Saint Nicolas d’Aliermont
et CIT Tréguier. Plus tard en 1987-88, « on commence
même à voir les prémices de la future concentration
à Eu, et l’abandon progressif de Cherbourg». Cette
concentration vers l’usine d’Eu se concrétisera assez
rapidement.
Des établissements connaissent des réductions fortes
d’effectifs sans perspective à moyen ou long terme : Cherbourg,
Pontarlier. D’autres font l’objet de reconversions partielles
en bénéficiant de transferts venant d’usines, qui
ferment : usine de Saintes bénéficiant de transferts
venant de Bezons et la Rochelle, Aix les Bains avec un transfert venant
de Saint-Jean de Maurienne.
Trois autres usines bretonnes de fabrication dans la commutation connaissent
des sorts divers.
L’AOIP Morlaix ne rentre pas dans le périmètre
d’Alcatel et est rattachée à la Thomson-CSF Brest
comme filiale, appelée Morlaix Electronique. Elle amorce une
reconversion vers la fabrication de sous-ensembles radars, qui ne
durera pas très longtemps car elle est cédée
en 1994 à une PME du Trégor, la société
Help en situation proche de la liquidation judiciaire.
Cela se termine par une deuxième reprise et au final une fermeture.
Ericsson Brest rentre dans Alcatel, pas du côté Alcatel-CIT,
mais dans la branche Alcatel Business Systems (ABS), appelée
auparavant Alcatel Télic. Enfin CGCT Rennes (700 salariés),
restée ITT jusqu’en 1987, est bien esseulée lors
de la fusion de ITT avec Alcatel et sera reprise par Matra avant de
disparaitre plus tard.
Dans le Trégor la disparition des trois usines de fabrication
d’équipement est un choc important, se traduisant par
près de 2000 suppressions d’emploi, qui pourront être
étalées sur une période d’environ six ans.
La gestion sociale des licenciements va prendre en compte toutes les
opportunités de reconversion en nombre réduit, car le
niveau de formation est généralement limité,
particulièrement pour les salariés de Guingamp. Il est
de plus largement fait appel aux retraites anticipées, Les
différents plans sociaux sont indirectement coordonnés.
J-P Meulin cadre de direction de LMT-Thomson après avoir connu
la fermeture de son établissement en
1983, poursuivra sa carrière professionnelle à Alcatel
Tréguier, où il est chargé de la gestion du plan
social de l’AOIP Guingamp et enfin sera nommé directeur
de l’usine de Tréguier en 1988 et sera amené à
assurer sa fermeture.
De son côté l’établissement d’Orvault
tire son épingle du jeu en raison de la fermeture de l’établissement
historique de LMT Boulogne et de la présence d’un service
de développement industriel. A partir de 1990 des études
concernant le E10 sont affectées à Orvault, ce qui permet
d’amorcer des partenariats avec Lannion.
Face à la crise du secteur de la transmission
Durant les années 1980 il est encore pertinent de séparer
la transmission et la commutation.
En commutation la fabrication est de moins en moins matérialisée
au profit d’une production dématérialisée,
la « production de code », la valeur ajoutée matérielle
étant déportée principalement vers les fabricants
de semi-conducteurs à haute intégration. En transmission
on fabrique des câbles et il faut réaliser des fonctions
microondes et optiques toujours matérialisées, conservant
de la valeur ajoutée. Mais les frontières se réduisent
et on raisonne de plus en plus en réseaux. Les raccordements
d’abonnés prennent de l’importance, notamment pour
les communications mobiles, et ils mélangent à la fois
des fonctions de transmission, de multiplexage et de routage numériques..
Dans le secteur des équipements de la transmission, avant 1983,
la R&D était localisée du côté Alcatel
principalement à Villarceaux et un peu à Lannion, spécialisé
sur les fonctions numérique à haut débit en transmission
optique, et du côté LTT à Conflans Sainte Honorine.
La fabrication était répartie dans les usines de Montargis,
Troyes et Villarceaux du côté Alcatel et dans les usines
de Lannion et de Conflans du côté LTT. Cette dernière
est l’usine historique LTT, considérée comme «
désuète et à moitié vide, un univers qui
tient plus du Zola du XIXème siècle que d’un laboratoire
de recherche du XXème siècle», Rapidement les
décisions prises par Jacques Imbert, d’origine Thomson-CSF,
aboutissent à la fermeture des usines de Troyes, Montargis
et Conflans.
En 1985 la fabrication de LTT Lannion est réunie à l’activité
de R&D Transmission d’Alcatel Lannion. Ceci est d’autant
plus facile à réaliser qu’il suffit d’abattre
un simple grillage pour réunir les deux sites. A la Direction
technique de la transmission à Lannion, Christian Magnien,
ancien de CGA, cherche à diversifier les activités,
mais il n’est guère soutenu. Une poursuite de l’activité
microondes de LTT aurait pu être poursuivie, mais là
aussi il aurait fallu se tourner vers des clients potentiels à
l’extérieur d’Alcatel.
Inévitablement il y aura une érosion continue des effectifs
dans les années suivantes, le plus souvent par des mises en
retraite anticipées. Ainsi LTT-Alcatel Lannion passe de 1124
salariés (1983) à 690 salariés (1992). Par ailleurs
la SAT Lannion, appartenant au groupe SAGEM et engagée dans
le développement industriel et la fabrication d’équipements
de transmission numérique par câble et faisceau hertzien,
connait la même érosion.
Du côté des câbleries LTT celle de Lannion est
fermée en 1985, après une douzaine d’années
de fonctionnement. Celle de Dinard est rattachée aux Câbles
de Lyon et accroit son activité avec une année record
en 1992 (175 salariés)116, juste avant une chute rapide aboutissant
en 1996 à sa fermeture. Proche de la Bretagne le site majeur
LMT de Laval (jusqu’à 2 500 salariés) est éclaté
en trois établissements. L’un est cédé à
la société de sous-traitance électronique Cofidur,
le second à Thomson-CSF, le troisième (moins de 40 %)
reste dans le périmètre d’Alcatel. Mais les activités
de ce dernier sont réduites et les effectifs diminuent assez
rapidement.
En 1993 P.Suard s’en inquiète « La direction
d’Alcatel n’était pas favorable à ce que le
Groupe entreprenne la fabrication de ces nouveaux produits [téléphones
mobiles]... Mais l’enjeu me paraissait de taille : ce marché
semblait appelé à un grand développement et le
maintien de l’usine de Laval en dépendait.... il fallait
préparer la reconversion de l’usine de Laval».
L’usine de Laval est bien engagée dans ce type de fabrication,
qui atteindra annuellement plusieurs millions de téléphones
mobiles à la fin des années 1990.
sommaire
Relance dans le Trégor
Pendant la crise des activités de fabrication, les activités
de R&D de France Télécom et d’Alcatel à
Lannion sont maintenues et confirmées, ce qui jouera un rôle
important pour l’avenir. Aussi le Trégor s’organise
pour faire face à cette situation d’abord en essayant
d’amortir socialement les effets de la suppression de 2500 emplois,
en comptant ceux de la transmission, et en soutenant la création
d’emplois dans des PME, certaines de sous-traitance, fondées
pour la reprise d’activités délaissées par
des grands groupes, d’autres dans l’innovation de produits
et services.
Pour accompagner cet effort de développement les pouvoirs publics
se mobilisent. D’une part l’Etat décide la création
d’une école d’ingénieurs et d’autre part
les communes du Trégor mettent en place l’ADIT (Agence
de Développement Industriel du Trégor). L’Ecole
nationale supérieure des sciences appliquées et de la
technologie (ENSSAT) démarre à Lannion en 1986, portée
par « l’équipe de direction de l’IUT de Lannion,
qui avait été renforcée durant ses premières
années par des jeunes enseignants-chercheurs formés
(doctorat et post-doctorat) dans les meilleurs pôles technologiques
français et attirés en Bretagne dans la mouvance de
Michel Métivier, fondateur de l’IRISA [à Rennes].
Ainsi Jacques Wolf et Jean
Seguin, formés à Grenoble, et Michel Corazza, formé
à Toulouse» constituent l’équipe de direction
de la nouvelle école, qui met en place trois options : informatique,
électronique et photonique.
Cette école d’ingénieurs est largement soutenue
par France Télécom et Alcatel, qui permettent à
leurs ingénieurs d’assurer des enseignements, de préparer
des travaux pratiques et d’encadrer des stages.
Mouvement de créations de PME
Dans les années 1960 la seule PME présente dans le Trégor
était la société Ercor, créée à
Trébeurden en 1955 avant la décentralisation du CNET
par l’ancien directeur technique de la société
parisienne Metrox, sous-traitante en fabrication électronique
pour l’instrumentation scientifique et pour les applications
météorologiques.
Dans cette période de 1983-87 quatre PME notamment sont créées
avec la participation active d’ingénieurs d’Alcatel
et de France Télécom.
Novatech est fondée en 1985 en lien avec la fermeture de LMT-TCT
Lannion. Le fondateur est Jean-Yves Le Guillerm, qui a assuré
pour Thomson TCT la responsabilité du transfert technologique
de la fabrication du commutateur MT25, notamment vers l’URSS.
Durant les premières années l’effectif de Novatech
est d’une trentaine de salariés dans la production électronique
(assemblage, intégration, test...).
BEC (Bobinage & Electronique Comtois) est né en 1987 à
Pontarlier de la rencontre de Claude Dussouillez, issu de la commutation
téléphonique Alcatel, et de Pierre Vimont, issu de la
transmission téléphonique LTT, pour fournir des composants
bobinés à des grands groupes.
Les produits propres de BEC, en particulier pour le ferroviaires (TGV
Sud-Est...) ont été développés à
partir de différents savoirs faires, notamment de France Télécom
(exploitation d’un brevet CNET). Cependant comme l’a exprimé
Claude Dussouillez« BEC reste vulnérable sur le plan
financier (faiblesse du fonds de roulement) ». En 1997 les effectifs
de BEC sont de 99 personnes, dont près d’un tiers à
Lannion. En 2001 BEC reprend l’activité bobinage de la
Sagem Lannion avec 28 salariés. Mais les commandes des grands
groupes (Alcatel, Sagem) diminuent chaque année et BEC cesse
son activité à Lannion en fin 2003.
Elios Informatique est fondée en 1983 par une équipe
d’informaticiens du CNET Lannion.
Premier essaimage de l’ensemble du CNET, elle se développera
jusqu’à atteindre une centaine de salariés et sera
reprise par une SSII au départ de son fondateur et directeur,
Denis Salembier, vers 2005.
Dans le domaine des réseaux et services télécom
la société Prescom peut être considérée
comme une référence. Jeune société, fondée
au sud de Paris en 1982, elle avait développé un pont
téléphonique analogique pour audioconférence.
Son fondateur, Philippe Parment, ayant eu connaissance d’un Livre
Blanc du CNET présentant en 1985 différentes études,
pouvant faire l’objet d’un transfert technologique vers
des PME, a été amené à créer une
antenne R&D à Lannion en 1987. Il a attiré un chercheur
du CNET, Frédéric Zurcher, et plusieurs ingénieurs
d’Alcatel. Cette équipe d’une douzaine d’ingénieurs
installée à Lannion et menée par Yves Le Damany,
a transformé le pont analogique en un pont numérique,
qui a obtenu un franc succès. Prescom est devenu ainsi vers
2000 le leader français dans le domaine de la numérisation
des salles de commandement de la Police et des salles d’opération
des SAMU et Pompiers, ainsi que des Cross du littoral français.
Un ensemble de brevets a été déposé et
« quatre conventions Cifre ont été signées
par le CNET avec Prescom entre 1987 et 1995 et deux de ces docteurs
sont encore présents dans cette entreprise aujourd’hui».
Actuellement Prescom est toujours dans une bonne dynamique.
sommaire
Déréglementation et nouveaux services (1987-1997)
Reprise par Alcatel des activités télécoms
d’ITT en Europe
En 1987 Alcatel connait un nouveau tournant dans une période,
qui est celle de la dérèglementation des Télécommunications
et qui concerne d’abord les Etats-Unis.
Le
groupe AT&T, groupe privé avait rassemblé jusqu’à
un million de salariés avec des activités industrielles
de fabrication (Western Electric) et des activités d’exploitation
des réseaux locaux et du réseau national américain.
Il avait disposé d’un monopole de fait.
La dérèglementation américaine connait plusieurs
étapes. La première étape en 1984 a abouti à
mise en place de sept compagnies régionales (Bell Operating Companies),
issues d’AT&T.
La nouvelle société AT&T conserve les activités
d’opérateur des réseaux inter-états, et les
activités industrielles, y compris le centre de recherche des
« Bell Labs ». Lors de la deuxième étape les
réseaux inter-états sont ouverts à la concurrence,
en premier aux sociétés MCI et Sprint. Enfin en février
1996 les deux branches AT&T Network et AT&T Technologies (Western
Electric) se séparent. La seconde prend le nom de Lucent.
En
Europe la règlementation des Télécoms évolue
suivant les directives de l’Union européenne.
En France l’opérateur France Télécom
est privatisé en 1997 et plus tard prendra le nom de sa
filiale Orange.
Un mouvement de concentration des industriels équipementiers,
aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe, devient inévitable.
Certains grands groupes de Télécommunications connaissent
des années difficiles dès les années 1980 avec
le passage au numérique et la déréglementation.
Plus tard à l’ère Internet et en raison de la concurrence
asiatique les difficultés se poursuivront et la majorité
des grands acteurs équipementiers des années 1970 seront
progressivement éliminés.
Vers 1985 ce mouvement d’élimination concerne le groupe
équipementier américain GTE. Puis le groupe ITT doit
se restructurer et envisage la cession de la majorité de ses
activités télécoms, principalement européennes.
Il connait en effet des pertes de marché, a des difficultés
d’organisation et peine à finaliser et à imposer
son Système 12, commutateur numérique conçu principalement
au centre de Stuttgart de sa filiale SEL (Standard Electric Lorenz).
Enfin plusieurs de ses usines, notamment de la filiale espagnole SESA,
sont menacées.
Le S12 a été un élément important des
négociations en 1986. Il est apparu qu’il y avait des
différences de conception majeures entre les commutateurs E10/MT
et S12, moins avancé dans son développement et qu’il
restait des incertitudes sur les performances comparées.
Mais ce qui a prévalu a été la stratégie
commerciale. Pour conserver les parts de marché acquises de
longue date par ITT dans un ensemble de pays, notamment en Allemagne,
Belgique, Espagne, Italie,... il fallait maintenir le S12, ce qui
a abouti à une partition géographique entre ce système
et E10. La reprise d’ITT par Alcatel est effective sur ces bases
en janvier 1987. De plus E10 S est abandonné et le MT20 est
maintenu seulement pour les centres de transit internationaux.
Fin 88, suite à l’absorption de l’activité
téléphone de Thomson, ALCATEL possède deux centres
industriels : l’un à Cherbourg, l’autre à
Eu hérité de Thomson. Bien sûr, il apparaît
évident, suite à l’échec commercial de la
ligne MT de Thomson, qu’il y a un centre en trop.
Le choix va se porter sur l’usine de Eu pour des raisons
qui peuvent apparaître irrationnelles dans la mesure où
Cherbourg possède le savoir faire E10. Mais l’usine de
Eu se trouve dans un secteur économiquement en difficulté,
les bâtiments sont plus rationnels (un seul hall de montage)
et le Directeur Industriel (J.Y. Fizellier) est un ancien directeur
de Eu !
Bien sûr, ce transfert de production ne se fera pas sans transfert
de personnel de Cherbourg, à commencer par le Directeur (Y.
Derrien) qui prendra la direction de Eu, apportant le savoir faire
E10 et sa culture industrielle différente de la culture de
Eu.
Un peu d’historique : Le centre industriel de Eu,a été
créé en 1966, et va connaître successivement les
diverses cultures Ericsson, ITT, Thomson. Il possède de ce
fait une organisation très structurée proche d’une
usine des années 70 :
-l’économat vient de fermer
-il existe au sein d’un service formation remarquablement structuré
une école de formation, point de passage obligé pour
les opératrices.
-le service des Ressources Humaines joue encore un rôle prépondérant.
-les liens de l’établissement avec son environnement sont
quasi inexistants.
L’adaptation au E10 : L’arrivée des équipes
d’ingénieurs et de techniciens de Cherbourg (60 personnes
environ), sous la direction de leur directeur, va entraîner
des bouleversements dans les techniques de production et de management
:
-réactivité aux évolutions de produit.
-réorganisation des lignes de production en vue d’optimiser
les flux de circulation du produit.
-mise en valeur des lignes de production, Eu devenant la vitrine du
savoir faire ALCATEL comme le prouveront la cadence des visites de
délégations étrangères (une par semaine
pendant 1 à 2 ans).
-sensibilisation à la notion d’assurance qualité
de l’ensemble du personnel.
-visites de centres industriels pour la maîtrise et l’encadrement
d’atelier (Bull à Angers,
Renault à Sandouville, PSA à Rennes).
-journées Portes Ouvertes pour l’ensemble des familles
(une première depuis la création en 1966).
-organisation d’une journée technologique au château
de Eu pour le compte de la Direction Industrielle d’ALCATEL
sommaire
Une gestion performante des données des réseaux à
base de E10 grâce aux ateliers AGL
Au début des années 1990 l’établissement
Alcatel de Lannion a pris conscience de la forte croissance des volumes
de données dans les réseaux téléphoniques,
notamment pour gérer et mettre à jour les logiciels.
Des moyens importants ont été mobilisés. Jusqu’à
400 ingénieurs et techniciens, répartis dans plusieurs
sites en France et à l’étranger, dont 250 pour
le traitement d’appel, ont été affectés
à ces développements.
Ainsi du début de la mise en place des commutateurs E10 jusqu’à
2004, cinq millions de lignes source de logiciels en 2004 ont été
créés et maintenus.
Les données de réseaux se répartissent en trois
parts.
- Ce sont d’abord celles des systèmes mis en place par
Alcatel, concernant à la fois les matériels avec toutes
leurs références et les logiciels sous la forme de modules
logiciels.
- Ensuite ce sont les données des opérateurs, clients
d’Alcatel, par exemple la taxation, les données de régulation
de trafic lors d’évènements,... souvent propres
à chaque pays.
- Enfin les données de chaque site de commutation, par exemple
la liste des abonnés, sont aussi à gérer.
De plus il faut pouvoir disposer de ces données suivant trois
langues (français, anglais et espagnol).
L’objectif est de faciliter les mises à jour et corrections.
« Afin d’éviter des interventions incessantes sur
les sites au fil des ordres de correction, il fut décidé
de regrouper et d’appliquer en accord avec l’administration
ces ordres de correction par palier». Etablir de tels paliers
est apparu suffisamment important pour mettre en place une procédure
de décision associant les équipes impliquées.
“Chaque développement (par exemple un nouveau palier E10)
se fait dans le cadre d’un projet... Avant chaque réunion
de coordination était émis un document dit de palier,
définissant pour chaque organe les constituants et leur niveau
technique respectif, examiné durant les séances. »
Cette organisation rigoureuse montrera son efficacité et permettra
de progresser au fil des années 1990. “Dès la mi-96
[il apparait la] nécessité de réduire les temps
de développement et d’accroître la périodicité
des paliers fonctionnels . »
Pour assurer tous ces développements l’établissement
de Lannion a décidé de faire appel aux Ateliers de Génie
logiciel (AGL).
Ces ateliers permettent de mettre en commun des modules utilisables
par l’ensemble des développeurs et surtout de pouvoir
les sélectionner automatiquement avec la bonne version pour
fabriquer le logiciel livrable destiné à un commutateur
d’un client tel qu’Orange ou SFR ou Telkom SA ou Telcom
IRL... Ainsi pour chaque projet un administrateur AGL définit
l'environnement de travail des personnels travaillant sur le projet.
Les modules de logiciels ou données sont appelés de
façon transparente pour le développeur, le dégageant
de nombreuses contraintes qu'il ne maitrisait pas forcément
et limitant les risques d'erreurs.
A la fin des années 1970, pour répondre aux besoins
des développeurs, un premier atelier logiciel est conçu
en interne à Lannion sous le nom de SDL (Système de
Développement de Logiciel) avec comme calculateur central un
IRIS 80. Ce calculateur sera assez rapidement remplacé par
un IBM nettement plus puissant qui permettra, toujours en interne
de mettre au
point un AGL appelé VM/SE (Virtual Machine Software Engineering).
Cet atelier, conçu par J-P Posloux et B. Nicolas, est adapté
pour « la gestion de gros logiciels évolutifs et comportant
des fabrications sur mesure pour les différents clients...
[Puis] VM/SE évolue vers une architecture client-serveur prenant
le nom de Benchcom...
A partir de l’année 2000 enfin, apparait dans E10 un nouvel
AGL, Clearcase, « best seller », également de l’industrie
informatique. »
Les premiers AGL fonctionnent de façon centralisés avec
le raccordement des stations de travail à un seul ordinateur
de grande capacité en local. Mais un besoin nouveau, celui
d’AGL décentralisés, apparait pour les développements
E10 dans les années 1990 en raison de l’effort d’exportation
d’Alcatel et du choix d’une politique de décentralisation
des développements logiciels.
Cela qui conduit à la création de CTE (Centre Technique
Export) dans huit pays, dont trois en Europe (Roumanie, Pologne et
Irlande), trois en Asie (Inde, Pakistan et VietNam) et deux en Afrique
(Maroc et République Sud Africaine). Le plus important est
celui de Timisoara en Roumanie, qui aura jusqu’à 200 salariés.
Du côté français les trois sites de Lannion, Orvault
et Vélizy sont concernés. Un nouvel AGL est mis en place
de façon décentralisée, dans un premier temps
avec des PC et des transmissions à faible débit. Dans
un deuxième temps en 1995, un AGL évolué, sous
le nom X/SE, comporte un réseau, basé sur le système
Unix AIX d’IBM et des stations de travail RS6000.
Les travaux de développement logiciel sont répartis
entre les trois sites français et les CTE, spécialisés.
Ainsi le traitement pour la signalisation CCITT n°7 et progressivement
tout le logiciel E10 est affecté au centre de Timisoara, le
traitement pour les appels mobile (partie HLR) au centre de Bandon
près de Cork et pour une part la Nouvelle Architecture (NA)
de traitement d’appel au centre de Boksburg, près de Prétoria.
Les développements de la Nouvelle Architecture, démarrés
en 1992, ont été répartis entre Lannion, Orvault,
Timisoara et temporairement Boksburg. « Les coûts initiaux,
déjà élevés ont continué à
augmenter, obligeant le Directeur Technique Adjoint J. Demure, à
provoquer une découpe en étapes du projet. Il faudra
10 ans pour la réaliser complètement. Au final cela
fonctionne plutôt bien, mais pas dans les couts et délais
attendus. »
sommaire
Commutation numérique et nouveaux services : données
et téléphonie
mobile
Durant les années 1990 les activités de commutation
numérique se diversifient pour assurer des services de données
à bande étroite.
Les réseaux RNIS
(Réseau numérique à intégration de services)
constituent la première approche avec la mise en œuvre
de nouveaux services de bout en bout appelés Numéris,
à des débits allant de 64 à 384 kbit/s.
« L’année 1987 est aussi marquée par les
premières expérimentations dans les réseaux publics
de la commutation RNIS (ou ISDN en anglais), première génération
de transmission simultanée de voix et de données : France
Télécom le fit dans les Côtes d’Armor avec
un central E10 fourni par CIT et la Bundespost à Stuttgart
et Hanovre sur des centraux S12 fournis par SEL ».
L’accès au réseau RNIS se fait facilement en raccordant
les abonnés sur des CSN, associés à des commutateurs
E10.
La pénétration du RNIS est un processus considéré
comme lent. « A la fin de 1991 on compte près de 40 000
accès... France Télécom en prévoit 500
000 en 1995130 ». Il s’agit essentiellement d’une
clientèle professionnelle.
L’interet pour les PME est de disposer d’un accès
primaire (30 voies) pour raccorder leurs PABX. « L’ouverture
vers les abonnés résidentiels est attendue à
plus long terme». Mais avec quels terminaux chez ces abonnés
?
France Télécom évoque notamment des terminaux
de télécopieur, visioconférence, de borne multimédia...
Un effort d’harmonisation est effectué au niveau européen,
permettant d’avoir une couverture européenne RNIS vers
1995.
Aucun pays européen ne connait une pénétration
plus forte qu’en France.
Les Simulateurs
d’abonnés RNIS pour
les commutateurs E10
L’objectif des simulateurs d’abonnés RNIS est
soit de valider les échanges de protocole LAPD, soit de
simuler la signalisation émise et reçue sur l’interface
Accès de base (famille des cartes TABN du CSN : Accès
de Base RNIS 2B+D à 144 kb/s) et primaire (famille des
cartes TADP du CSN : Accès à Débit Primaire
30B+D à 2Mb/s):
- Simulateur SANUM : Simulateur d’abonné Numériques
Deux versions du SANUM sont élaborées :
La première en simulation fonctionnelle pour vérifier
l'acceptation du protocole RNIS par E10 et traquer la défense
du système face aux erreurs de protocole, cela au moyen
de milliers de fiches d'essais écrites au fur et à
mesure des évolutions du protocole RNIS: VN1, VN2, ...
VN6, VN7...
La seconde en simulation de trafic, pour vérifier la tenue
en charge du commutateur E10.
D’un point de vue matériel, le SANUM se compose alors
d’un coffret UCSI équipé des cartes UC du CSN
et d’un ou plusieurs coffrets GTS, image des CN du CSN mais
équipé de cartes spécifiques simulant l’accès
de base ou l’accès primaire RNIS (Cartes TABNS et
TADPS)
Chaque coffret GTS peut simuler jusqu’à 32 accès
de base et le SANUM Trafic peut piloter 4 GTS soit 128 accès
de base.
Ces simulateurs sont développés sur « marchés
d’études » de France Télécom à
partir de 1986 pour les essais et la validation des différentes
étapes du RNIS sur E10, car de tels appareils ne sont pas
disponibles sur le marché à ce moment-là.
Avantage : disponibles aussi vite que la fonction dans le commutateur
E10.
Inconvénient : comportent les mêmes erreurs d’interprétations
de protocole de signalisation que dans le commutateur E10.
- Simulateur d’ITA RNIS : parfois apporté par
un autre constructeur intéressé par la validation
de son produit en terme de protocole; pour Alcatel CIT, ces essais
d’interconnexion sont très instructifs car ils permettent
de valider la réalisation du protocole
conformément aux spécifications.
Avantage : parfait pour valider la réalisation du protocole
de signalisation dans les deux équipements.
Inconvénients : les autres constructeurs, une fois leur
équipement validé, ne sont plus volontaires pour
réaliser ces interconnexions et veulent faire payer le
prêt de leur équipement et technicien pour la durée
des essais du commutateur. |
sommaire
Un autre domaine des transmissions de données est celui
des réseaux privés pour entreprises.
La PME OST (Ouest Standard Télématique), une des premières
PME fondées en Bretagne dans le domaine électronique
et télécom, est installée en 1980 par son fondateur
Tao Lane à Cesson-Sévigné.
Elle cherche à s’imposer sur ce nouveau marché
des entreprises avec la technologie de la transmission de paquets
de données suivant la norme X25, utilisée
dans le réseau Transpac.
Son activité grandit rapidement et en 1986 elle a déjà
installé près de 2000 équipements, correspondant
à la mise en place d’une centaine de réseaux. Ses
effectifs grandissent progressivement : 104 en 1986, 320 en 1992.
Mais OST est « confrontée à des difficultés
de développement avec un exercice 1995-1996 déficitaire»
et n’a pas les moyens d’investir, pour maintenir son avance,
dans les réseaux asynchrones à haut débit, notamment
ATM.
La société OST est reprise en 1996 par la jeune société
canadienne Newbridge Networks, qui a été fondée
en Ontario en 1986 par un ingénieur d’origine galloise.
En effet cette société qui a connu une croissance rapide
pour atteindre 3000 salariés, cherche à se développer
en Europe.
Le marché des équipements d’infrastructures de
téléphonie mobile a pris beaucoup d’importance
dans les années 1990 et une étape importante a été
franchie, lorsque les opérateurs et les industriels européens
se sont mis d’accord sur les normes GSM de 1ère
génération puis de 2ème génération
pour des réseaux numérique de communications cellulaires
avec des mobiles.
Les premiers réseaux GSM sont mis en exploitation en 1992.
Ericsson s’intéresse très tôt au GSM en partenariat
avec Matra. “Matra and Ericsson also began working together in
1987 to develop and market GSM. This partnership was unsuccessful,
however, and in 1992, Ericsson supplied a GSM network to France directly”.“
Dès l’apparition de la norme GSM...Alcatel entreprit d’abord
en consortium avec AEG et Nokia, puis seul, un vaste programme de
développement, qui portera ses fruits en premier dans les installations
fixes et plus tard dans les téléphones portables le
segment des installations fixes comprenait deux parts : la partie
radio... [et] la partie commutation qui assure l’interface avec
le réseau fixe pour l’acheminement des communications
ainsi que la gestion des abonnés mobiles» .
- D’un côté Nokia s’implique très fortement
sur les terminaux du GSM. Il devient ainsi le premier fabricant mondial
de terminaux mobiles, mais s’intéresse aussi aux infrastructures
de réseaux, où il obtient en 2000 une part du marché
mondial d’environ 11%.
- De l’autre côté Alcatel suit aussi la voie de
s’investir fortement dans la fabrication de terminaux mobiles
et assure également le développement d’équipements
d’infrastructures, sans investissements importants, en adaptant
les commutateurs MT, puis E10.
Cette adaptation, aux réseaux mobiles des deux premières
générations du GSM, est assez aisée, car le service
à assurer reste un service téléphonique. Ainsi
dès la fin 1991 Alcatel commercialise des commutateurs E10
pour les réseaux GSM.
Transmission et raccordements d’abonnés fixes
Un acteur important de la relance du secteur transmission d’Alcatel
dans les années 1990 est Jean Jerphagnon, qui avant de rejoindre
Alcatel en 1985 avait fait sa carrière au CNET dont six ans
comme Directeur du centre Lannion B, regroupant les recherches sur
les composants et la transmission. « Au plan de l’organisation,
d’abord, Jean Jerphagnon arrive à fédérer,
en moins de deux ans, les équipes, jusque-là rivales,
de trois origines : celles de Villarceaux plutôt spécialisées
dans les équipements traditionnels de lignes sur cuivre à
grandes distances (y compris les équipements sous-marins),
celles de Lannion plutôt spécialisées dans le
développement des équipements sur fibres optiques et
les équipements spéciaux numériques, et enfin
celles de Conflans spécialisées dans les vidéotransmissions.»
Les travaux de R&D sur les câbles sous-marins sont prioritaires
car Alcatel, en reprenant l’ancienne filiale STC d’ITT en
Angleterre, est devenu leader mondial des câbles sous-marins.
Les centres européens de R&D sont actifs notamment pour
les transmissions ADSL sur lignes de cuivre et pour les composants
optiques à Stuttgart. Jean Jerphagnon participe à la
décision de transférer l’activité de R&D
sur le codage/modulation à haut débit numérique
de Lannion à Villarceaux. Cette décision est compensée
par une participation du site de Lannion aux fabrications de composants
optiques d’Alcatel Optronics,
Cette relance des activités de transmission est effectuée
avec une vision modernisée de l’innovation industrielle,
« Il n’est pas question pour Jean Jerphagnon de ne considérer
que les grandes entreprises. Il sait que les PME-PMI sont l’ossature
de notre économie, que les start-up sont les grandes entreprises
de demain, et que le transfert de technologie aux différents
stades de la chaîne de production est essentiel pour moderniser
les process de production».
sommaire
Crise de 1996-97
Cette crise est provoquée par les difficultés rencontrées
par les opérateurs de réseaux télécoms,
qui se sont engagés dans le rachat de concurrents et qui n’ont
plus la capacité financière à investir dans les
infrastructures.
Après le grand mouvement des années 1982-86 et un combat
continu pour réduire les effets de la suppression progressive
des activités de transmission à Lannion, l’annonce
d’un plan social important provoque une forte réaction
en 1996-97.
Pour la première fois les salariés d’Alcatel prennent
conscience que l’établissement de Lannion pourrait disparaitre.
Une grande manifestation réunit 15 000 participants à
Lannion le 16 novembre 1996. Cette manifestation locale est suivie
d’une manifestation nationale devant le siège d’Alcatel
à Paris.
La participation des Lannionais est forte grâce à l’affrètement
d’un TGV. L’action a été continue durant les
mois suivants jusqu’à une nouvelle manifestation à
Lannion le 22 novembre 1997. Ces mobilisations et les négociations
avec la direction de l’entreprise, principalement au sein du
Comité Central d’Entreprise et du CE de Lannion, ont permis
de limiter les effets du plan social, notamment en favorisant les
départs en pré-retraite.
Néanmoins, les activités de fabrication ont été
arrêtées à Lannion et les activités de
R&D ont été maintenues. Enfin une association, fédérant
les représentants syndicaux du Trégor avec la participation
de personnes qualifiées est mise en place en février
1997 sous le nom de « Trégor Debout » et jouera
un rôle important en 2001-2004 : information et interpellation
des acteurs politiques français et européen sur les
enjeux de politique industrielle du secteur Télécom
en Europe, les enjeux en terme d’emploi, de souveraineté
et de sécurité des réseaux.
sommaire
Les travaux de R&D sur l’ATM
dans les années 1990
Rappelons en bref que le mode de transfert asynchrone ATM
est une technique orientée-connexion; une entête de cellules
(53 octets) utilise une identifiant de circuit virtuel, établi
en début d'appel; il est composé du couple : VPI (Virtual
Path Identifier), VCI (Virtual Channel Identifier).
« A l’origine, les recherches qui ont débouché
sur l’ATM ont été conduites dans la perspective
de combiner les avantages de la commutation de circuits (délai
de transmission constant et capacité garantie) avec ceux offerts
par la commutation de paquets (souplesse et efficacité pour
les trafics aléatoires).
Ces recherches ont impliqué de nombreuses équipes de
R&D d’opérateurs avec comme leader le CNET de Lannion».
Au CNET Lannion Jean-Pierre Coudreuse est le leader reconnu de 1980
à 1995 d’une équipe talentueuse dont on peut citer
les noms d’Alain Thomas, Michel Servel, Pierre Boyer...
Poussée par cette équipe du CNET Lannion, la normalisation
à l'UIT-T (ex-CCITT), définit les normes pour un «
RNIS large bande », basée sur une solution complète
de réseau ATM avec applications distribuées, capable
de transporter la voix, la vidéo et les données.
L'ambition est alors d'utiliser cette nouvelle technologie non seulement
pour les réseaux dorsaux, mais de bout en bout jusqu'à
l'application d'usager dans le réseau local (normalisation
de l'émulation de LAN en 1997).
L'ATM Forum est créé en 1991 en Californie. «
Cette association a regroupé plus de 700 membres, constructeurs
et opérateurs, qui paient chacun leur cotisation annuelle,
et s’est très vite étendue au monde entier».
Sylvie Ritzenthaler, alors ingénieure à la société
rennaise OST, participe à la direction des activités
européennes de l’ATM Forum et organise à Rennes,
annuellement de 1994 à 1998, la manifestation internationale
« ATM Developments », qui réunit jusqu’à
600 auditeurs. De façon générale l’ATM Forum
œuvre pour l'implantation rapide de l'ATM dans des produits et
répondre aux besoins des marchés.
Et à cette époque en 1991 France-Télécom
est confiant : « Les systèmes de commutation de la décennie
2000 seront les systèmes à débits variables de
la technique temporelle asynchrone ATM».
Alcatel entreprend des développements industriels de l’ATM
suivant deux voies.
Le premier développement se fait avec la volonté de
mener des études communes sur les deux produits E10 et S12.
« Pas moins de sept filiales d’Alcatel, dont Alcatel-CIT
de Lannion, coopèrent pour définir une architecture
ATM de bout en bout » dans la continuité des travaux
du CNET Lannion. En trois ans une maquette de démonstration
est réalisée en vue du salon TELECOM 91 de Genève.
« Sur 14 stands, Alcatel démontre un même module
ATM avec des interfonctionnements large bande / bande étroite
vers le E10 et le S12140 ». Cette maquette permet aussi d’offrir
des services vidéo, dont une TV-HD avec des raccordements en
liaisons optiques à 155 Mbit/s jusque chez l’usager.
Au début des années 1990, et en parallèle des
développements E10MM, Alcatel lance, à Lannion (équipes
de G. Le Bihan et de G. Onno), le développement d'un commutateur
pour ATM (le système 1000AX), avec TRT-Philips et sous
l'égide du CNET. Le 1000AX est un système modulaire
s'appuyant sur un niveau physique PDH, ouvert au SDH européen
et au Sonet américain, et bâti autour d'une matrice de
connexion ATM. Ce système connecte des liaisons allant jusqu'à
150 Mbit/s par port. Le système 1000AX est conçu pour
s’insérer dans le réseau public; un réseau
pilote est défini en 1990 par le CNET entre Lannion, Rennes
et Paris, le réseau BREHAT. Le réseau BREHAT se veut
conforme strictement aux standards ITU-T, sans tenir compte des simplifications
envisagées par l'ATM Forum. Il offre des services de bout en
bout comme par exemple l'interconnexion de réseaux locaux ;
les essais sont menés en 1994 et le réseau BREHAT est
étendu à quinze pays européens.
Mais il n’y a pas de suite industrielle chez les deux industriels
partenaires du projet.
D’une part la branche Télécom du groupe Philips
est en grande difficulté. TRT-Philips Lannion est repris par
Lucent en 1996.
D’autre part Alcatel change de Directeur aussi en 1996.
Pierre Suard passe la main à Serge Tchuruk.
Site
de M. Pierre Suard, ancien Président du Groupe Alcatel-Alsthom,
qui décrit ce qui lui est arrivé.
L'idée de mettre une couche ATM sous IP semble encore une direction
normale. Ceci nécessite la segmentation des paquets en cellules
à l'entrée et le ré-assemblage en sortie, rôle
du niveau AAL5 (ATM Adaptation Layer) conçu pour supporter
IP.
De plus, pour les niveaux supérieurs, la volonté est
de coller au modèle OSI (services de session et de présentation),
et les normes mettent du temps à sortir. Les implémentations
sont perçues par le monde IP complexes donc coûteuses.
Avènement de la société Cisco
La jeune société américaine CISCO Systems, fondée
en 1985 à San Francisco est l’acteur le plus important
du développement des réseaux dorsaux IP. «
Cisco Systems a été le pionnier du développement
du routeur, le matériel de commutation nécessaire pour
ces réseaux publics et privés en pleine croissance.
L'évolution de cette entreprise fournit un autre exemple classique
des avantages du premier arrivé. Cisco a été
créé en décembre 1984 par une équipe mari
et femme de Stanford qui avait aidé un réseau local
pour l'université.
Ils ont présenté leur premier produit, un routeur
TCP/IP, en 1986 pour les utilisateurs d'Arpanet.
Au mois de juillet suivant, les systèmes Cisco n'avaient encore
que huit employés. En 1988 vient la création d'une première
base d'apprentissage.
Alors les fondateurs font appel à deux personnes extérieures
expérimentées, Donald T. Valentine et John Morgridge,
pour renforcer le capital de l’entreprise et organiser ses actions
de marketing. Leur prise en main de l’entreprise provoque le
départ des deux fondateurs en 1990.
À partir de 1988, Cisco a rapidement dépassé
ses clients initiaux, ceux qui utilisaient les protocoles TPC/IP et
les ordinateurs basés sur Unix pour les communications Internet.
En développant des routeurs hautes performances à un
prix raisonnable, Cisco a pu s'assurer un marché primaire plus
vaste, celui des grandes entreprises construisant leur réseau
interne - local puis étendu.
En 1993, Cisco était le premier fournisseur mondial de routeurs
pour les réseaux privés ainsi que pour Internet.
À ce moment-là, ses dirigeants travaillaient avec IBM,
Microsoft et Novell pour améliorer les performances de leurs
produits. Au cours de ces années, les ventes et les revenus
de Cisco ont grimpé en flèche.
De 1991 à 1995 en quatre ans le chiffre d’affaires annuel
de Cisco est multiplié par dix et atteint 1 milliard d’euros.
L’exploitation du protocole TCP, qui date de 1974, se généralise
y compris dans les systèmes de base des ordinateurs, aux terminaisons
du réseau. Ainsi dans ces années 1990, l'IP résidentiel
croît très vite, le routeur IP, malgré sa mémoire
tampon indispensable, devient un équipement de commutation
intermédiaire difficilement contournable.
sommaire
Avènement des réseaux à large bande (1997-2005)
L’année 1997 constitue un tournant. La déréglementation
des télécommunications est effective en Europe.
La privatisation de France Télécom est réalisée
par le gouvernement Balladur et confirmée par le gouvernement
Jospin.
Le CNET, centre de recherche public, s’arrête après
53 ans d’existence.
Ses activités sont intégrées dans France Télécom,
sous le nom provisoire de FT R&D, Acquisition de Newbridge
par Alcatel
Acteur traditionnel du transport de la voix, Alcatel avait pris du
retard dans le transport de données.
Pour redresser la barre M. Tchuruk a choisi d’acheter ses technologies
outre-Atlantique à partir de 1998. Ainsi Alcatel acquiert plusieurs
sociétés américaines, dont DSC communications.
Puis en février 2000 Alcatel fait l’acquisition de la
société canadienne Newbridge, qui avait repris la PME
rennaise OST trois ans auparavant . Cette acquisition se fait par
échange d’actions à partir d’une valorisation
de Newbridge de 7 milliards de dollars.
Serge Tchuruk indique en février 2000 : « Newbridge occupe...
une place prépondérante dans la technologie ATM qui
permet aux opérateurs traditionnels de s’adapter au monde
Internet.
Cette technologie est d’origine française, puisqu’elle
a été développée par le CNET dans les
années 80.
Mais c’est une entreprise américaine qui a su le mieux
en tirer parti, grâce au développement plus précoce
aux Etats-Unis des réseaux de données. L’origine
française de l’ATM est bien reconnue en Amérique
du Nord, notamment par la société scientifique IEEE,
qui a décerné en 1997 à J-P Coudreuse le «
Sumner Award », sponsorisé maintenant par Nokia Bell
Labs. Eric E. Sumner, pionnier du numérique à partir
de 1952, a mené une carrière brillante aux Bell Labs
à la fois en commutation et en transmission, entre autres en
étant responsable en 1962 du développement industriel
du premier équipement numérique installé dans
le monde : le « T1 carrier system ».
Un peu après son décès en 1993 l’IEEE a
créé ce « Sumner Award ». J-P Coudreuse
a eu l’honneur d’être le premier à recevoir
ce prix et vingt ans après il est le seul Français à
avoir été ainsi distingué. Sylvie Ritzenthaler
précise en 2004 : L’Europe et la France en particulier
étaient à la pointe de la technologie ATM...Cependant
les premiers développements industriels se firent au Canada
et aux Etats-Unis !
En effet dès le début de 1994 le commutateur 36150 de
l’entreprise canadienne Newbridge occupa la place de leader du
marché des commutateurs.
En 1990 le Canadien avait engagé des études avec le
centre de recherche de l’opérateur BCTEL à Vancouver.
En 1994 le 36150 avait déjà été livré
en 360 exemplaires à plus de 80 clients, opérateurs
pour la plupart. Newbridge n’est pas la seule start-up américaine
à vendre des systèmes ATM vers 1994. Entre autres la
société Bay Networks, basée à la fois
à San Francisco et à Boston, est aussi présente
sur ce marché. Elle fait l’objet d’une reprise par
Northern Télécom, le grand équipementier canadien,
dix-huit mois avant celle de Newbridge et avec la même valorisation
financière.
Alcatel s’intéresse par ailleurs au savoir-faire de
Newbridge dans le domaine de l’ADSL :
Dans l’ADSL, qui permet la transmission rapide d’informations
sur des lignes téléphoniques classiques, Alcatel, qui
est déjà numéro un mondial, acquiert des technologies
supplémentaires pour le cœur des réseaux des opérateurs
et dans la transmission vidéo.
Développements industriels à Alcatel Lannion
Alcatel Lannion à partir de 1997 a mené des travaux
visant à placer une matrice ATM dans les organes de commande
OCB283, pas pour un transport ATM de bout en bout dans le réseau
téléphonique, mais pour remplacer la matrice de connexion
64 kbit/s. Il s’agissait ainsi d’augmenter la capacité
de connexion du commutateur et de réduire en clientèle
les coûts et l’encombrement du produit; ces évolutions
ont engendré l’OCB283 HC151.
C’est la matrice de commutation de cette « démo
de Genève » qui deviendra ensuite la matrice de commutation
d’une quatrième génération de E10 : l’OCB283
HC...tirant parti de la technologie de la matrice de commutation ATM
et de l’intégration des terminaisons SDH...
Le produit E10 OCB283 HC, dénommé commercialement
E10MM sera installé pour la première fois à
Mitry-Mory en 2001.
La capacité du système E10 MM monte jusqu'à 100
000 abonnés et 16 000 liaisons MIC.
Les ingénieurs de Lannion prennent conscience que l’IP
pourrait s’introduire et prendre la main dans la téléphonie.
Notamment J-Y Marjou indique : Dès le Symposium ISS de Birmingham
(7 à 12 mai 2000) auquel je participais, il était évident
que le téléphone IP était devenu une réalité.
» Il apparait à tous qu’il n’y a pas d’autres
possibilités que de s’ouvrir à l’IP et de
s’y adapter.
L’architecture de E10 à 4 niveaux (Exploitation / traitement
d’appel / matrice de connexion/unités de raccordement)
pouvait convenir a un monde IP comportant Serveurs d’exploitation
/ serveurs d’appel / réseaux IP / Media Gateways. La matrice
de connexion disparaissait donc, remplacée par le réseau
IP.
A partir de 2003, le commutateur E10 a été capable de
s’interfacer avec un réseau IP.
Les media internes de communication (Token Ring) ont été
remplacés par un réseau Ethernet. Le CSN a été
adapté à l’interface IP, notamment en y introduisant
l’interface d’accès H.248, basée sur la mise
en paquets de la voix. Une nouvelle machine logique appelée
MGI (Media Gateway Interface), intervenant dans la chaine de traitement
d’appels, a permis le dialogue H248 avec les passerelles IP.
La chaine de connexion MIC et la matrice de connexion n’étaient
plus concernées par les appels. IP. Ces évolutions ont
engendré l’OCB283 MGC154.
Noter que cette introduction en 2004 de l’interface H248 (interface
de contrôle de Media Gateway basée sur IP et sur la mise
en paquets de la voix) dans le CSN a permis de raccorder celui-ci
au S12. Ceci n’avait pas pu être fait dans les années
1990...
L’IP s’impose
Dès la fin des années 1990 l’IP s’impose dans
de nombreux secteurs. D’abord l’explosion des ordinateurs
personnels, qui intervient en 1990 avec la succès de Windows
3 de Microsoft, a provoqué celle des services Internet, notamment
grâce au navigateur Explorer 2.0 de Microsoft (1996). Le nombre
de 100 millions d’Internautes est atteint en 2000. L’IP
de bout en bout et multimédias avec des capacités croissantes
fait son chemin.
En 1998 le conseil régional de Bretagne lance un appel d’offres
à opérateurs télécoms pour la réalisation
et l’exploitation d’un réseau, appelé Mégalis,
regroupant les établissements publics de la région (Universités,
centres de recherche, établissements hospitaliers...). Le dépouillement
de cet appel est effectué en fin d’année et le
Conseil régional retient l’offre de France Télécom,
basée sur des routeurs IP de Cisco.
Pourtant initialement, le protocole IP, protocole de niveau réseau
(au sens du modèle hiérarchisé OSI), a des lacunes.
La transmission par paquets des données est faite 'au mieux';
la transmission se fait sans connexion, par plusieurs
routes et par conséquent le séquencement
des paquets n'est pas garanti.
La communication de paquets s'oppose à un concept de base du
réseau téléphonique numérique qui, elle,
repose sur un circuit dédié à chaque connexion.
Le contrôle de flux est inexistant avec IP.
Poussée notamment par Cisco, une nouvelle couche de communication
va permettre de s'affranchir de la technique ATM, en particulier à
l'accès pour les réseaux virtuels privés (VPN).
C'est le MPLS (Multi Protocol Label Switching), standardisé
en 2001; il offre un service orienté connexion;
une étiquette de route se substituant à une adresse
dans le réseau.
Plusieurs protocoles peuvent être supportés par MPLS
: Ipv4 et IPv6, Relai de trame (Frame-relay), Ethernet,
ATM, et la voix (VoIP).
Les ingénieurs de Cisco France indiquent en 2002 : «
Avec l’architecture MPLS, les partisans de IP et ceux de l’ATM
devraient se retrouver puisque cette architecture tend à intégrer
les avantages de la commutation « hardware » de paquets
de l’ATM et ceux du routage de couche 3 des réseaux IP.
L’architecture MPLS cherche également à découpler
l’information de commande requise pour transférer un paquet,
du transfert lui-même.
Ce
découplage fournit la base technologique permettant de nouvelles
approches en matière d’extension de services, comme l’ingénierie
du trafic, la qualité de service ou encore la protection automatique
d’éléments de réseau.
Comment expliquer cette domination de l’IP sur l’ATM
?
Différents acteurs ont donné leur avis. L’équipe
de Cisco France écrit dans le livre « Réseaux
» édité en 2002 : « L’ATM a souffert
dans sa définition d’une double approche, celle de l’UIT
et celle de l’ATM Forum : ainsi pour le plan d’adressage,
l’UIT a reconduit le plan E.164 défini pour le RNIS tandis
que l’ATM Forum a adopté le plan AESA/NSAP relevant d’une
approche orientée informatique. Il faut aussi reconnaitre que
l’ATM a été victime du développement industriel
souvent en retard par rapport à l’état de l’art
des spécifications... L’ATM ne sert donc plus qu’à
adapter d’autres protocoles dont IP».
De son côté en 2013 J-P Coudreuse écrit : «
Les Télécoms n’ont vu venir ni l’avènement
du microordinateur dans la sphère privée que préfigurait
le minitel, ni la place d’intercesseur que prendrait le logiciel
entre l’outil et l’usage, ni au cœur de tout cela une
mutation culturelle de grande ampleur avec l’abandon de tout
engagement de qualité, de fiabilité, de pérennité.
L’intelligence du terminal permettait de s’affranchir d’une
qualité de réseau...On allait troquer un mode «
terminal rudimentaire- réseau intelligent » pour un mode
« terminal intelligent-réseau rudimentaire »
Pour imposer l’ATM, au moins pour les réseaux d’opérateurs
à large bande avec des objectifs ambitieux de qualité
et de sécurité, il aurait fallu en 1994 poursuivre et
même amplifier l’effort de développent industriel
immédiatement après le projet Bréhat et dans
sa continuité.
Cela n’a pas été fait et c’est en vain qu’Alcatel
a repris l’activité de Newbridge en 2000. Il était
trop tard.
A ce moment-là en 1999-2000 la crise « dite de la bulle
Internet » est provoquée par une croissance démesurée
de certains secteurs de l’industrie du numérique et des
télécoms, notamment la photonique où la croissance
annuelle des chiffres d’affaires peut dépasser le taux
de 100 %. Elle est alimentée par la spéculation boursière
(mise en bourse de start-up, rachat d’entreprises,...jusqu’au
blanchiment d’argent).
L’éclatement de cette bulle intervient en 2001-2002.
Après cet éclatement Alcatel Rennes poursuit trois activités.
- La première activité à Cesson-Sévigné
concerne les DSLAM dans le cadre d’une coopération associant
les établissements d’Anvers (100 personnes), de Rennes
(50 personnes) et de Stuttgart (30 personnes).
- La seconde, aussi à Cesson-Sévigné est orientée
vers les réseaux d’entreprise.
- Enfin la troisième, celle des vidéocommunications
(une centaine de personnes), est menée dans le cadre de la
filiale Alcatel TITN et fonctionne comme une SSII à Saint-Grégoire.
Quant aux terminaux ADSL, pouvant être intégrés
notamment dans les « box » des abonnés, Alcatel
revend à Thomson Mutltimédia Rennes (TMM) cette activité,
venant de Newbridge, et transfère une soixantaine de personnes.
En France, il a été préféré,
avec le Plan TOP CAPEX révélé le 15 avril
2003, de stopper toutes les commandes d'autocommutateurs, c'est à
dire de ne pas remplacer les Commutateurs électroniques temporels
de 2ème génération par des Commutateurs de 4ème
génération, mais d'attendre...
Place au tout IP,
sommaire
L'INTRODUCTION MOUVEMENTÉE MAIS RÉUSSIE DE L'OCB283
AU PAKISTAN Document de Jacques Prévot
En 1990, afin de moderniser son réseau de télécommunications,
l’Administration Pakistanaise des Télécommunications
(PTCL) avait décidé de faire un test comparatif InSitu
des principaux systèmes de commutation numérique de
dernière génération existants sur le marché.
Alcatel avait fait une offre avec la nouvelle version du E10, l’OCB
283, et avait remporté un contrat pour la fourniture de 49.500
lignes à Karachi. Siemens et Ericsson
obtinrent l’équivalent, respectivement sur Islamabad-Rawalpindi
et Lahore (jusqu’alors
Siemens était pratiquement en position de monopole).
Le délai de mise en service pour Alcatel était de fin
mars 1991. Dans son programme électoral, le premier Ministre
Nawas Sharif nouvellement élu avait promis de développer
et de moderniser le réseau téléphonique pakistanais
qui en avait grandement besoin. A cette époque, le délai
d’attente pour avoir une ligne téléphonique variait
entre un et trois ans, voire plus, dans les grandes villes comme Karachi,
Islamabad ou Lahore et c’était même pire dans les
villes de province. Le réseau et les centraux électromécaniques
de Karachi étaient complètement saturés.
Les difficultés de mise en service de l’ OCB 283
Le matériel OCB 283 et les CSN avaient été expédiés,
le matériel était installé dans les différents
sites pour mi-février mais le logiciel spécifique Pakistan
OCB 283 n’était pas prêt !
Fin février, Alcatel envoyait une mission pour informer le
« Telecommunications’ Secretary » (Ministre des Télécom)
du retard de la mise en service des 49.500 lignes et tenter d’en
expliquer les raisons (en fait, pour masquer les retards de développement,
les prétextes officiellement invoqués étaient
la spécificité du logiciel Pakistan et surtout la première
interconnexion en signalisation N°7 des centraux Alcatel avec
des centraux Siemens).
En dépit des arguments techniques, le « Secretary »
ne voulut rien entendre et informa Alcatel que si la date limite du
31 mars pour la mise en service des 49.500 lignes n’était
pas respectée, PTCL romprait le contrat et mettrait officiellement
Alcatel sur liste noire avec diffusion de l’information dans
la presse mondiale spécialisée, ce qui aurait pour conséquence
directe de compromettre le futur de l’OCB283 sur le marché
export. Les OCB 283 du Pakistan devaient être les premiers OCB
à être mis en service avec exploitation commerciale dans
un réseau existant. La disponibilité du logiciel étant
prévue au mieux en juillet 91, il était donc impossible
de mettre les OCB en service à la date contractuelle. Le
« Secretary » a laissé deux heures à la
mission Alcatel pour proposer une solution quiconvienne.
La solution provisoire aves les conteneurs
Il a alors été décidé, après un
dimensionnement fait sur un coin de table, de proposer d’envoyer
2 cœurs de chaîne E10B en conteneur qui étaient
disponibles à Tréguier et d’y raccorder les CSN
en distant, la capacité de la solution provisoire proposée
étant dans ce cas légèrement inférieure
à celle du contrat d’environ 1500 abonnés. Finalement,
le « Secretary » a accepté la solution proposée
à condition que le délai de fin mars soit tenu !
Pour tenir ces délais, Alcatel a dû affréter un
Boeing 747 d’Air France pour acheminer les 2 conteneurs et mobiliser
tous les moyens disponibles pour réaliser ce pari et c’est
avec un jour d’avance que la mise en service dans le réseau
a été effectuée.

Par ce succès, Alcatel a marqué des points dans les
esprits de PTCL qui ne croyaient pas l’exploit possible ! Les
soucis ne faisaient que commencer car au fur et à mesure du
raccordement des abonnés sur les CSN, le réseau devenait
de plus en plus saturé et les liaisons inter-centraux étaient
incapables d’écouler le trafic. La qualité de service
se dégradait de plus en plus et, fin juin, le réseau
devenait impossible à maintenir en dépit de l’intervention
permanente (jour et nuit) du personnel de maintenance d’Alcatel
et de PTCL.
Le réseau de Karachi était coupé par moment en
deux, les abonnés des centraux existants ne pouvaient plus
appeler les abonnés raccordés sur les centraux Alcatel.
PTCL rejetait la faute sur Alcatel qui, étant le dernier à
rentrer dans le réseau de Karachi, devait faire tout ce qui
était nécessaire pour s’interfacer dans le réseau
existant.
En juillet, une mission technique d’Alcatel Lannion est arrivée
à Karachi avec de gros moyens de mesure et de test afin de
comprendre le ou les problèmes. Les recherches s’orientèrent
principalement sur les particularités liées au logiciel
et à sa signalisation spécifique ce qui permit de corriger
un certain nombre d'erreurs mineures mais les problèmes principaux
demeuraient et, pendant ce temps là, les équipes de
maintenance passaient leur temps à débloquer le réseau
par des commandes manuelles.
Après comparaison et vérification de la conformité
du logiciel du Pakistan E10B avec les spécifications du cahier
des charges de PTCL, la seule source de recherche des fautes restantes
était la vérification de la conformité de la
signalisation émise par les centraux déjà installés
dans le réseau ! Ce qui permit de découvrir que les
centraux Siemens travaillant en signalisation N°7 ne respectaient
pas les spécifications du cahier des charges de PTCL.
Alcatel fit une campagne de mesure très complète car
PTCL refusait d’accepter la conclusion des tests. Il a même
fallu, à la demande du Directeur de projet de PTCL Karachi,
utiliser un testeur de signalisation de PTCL et de Siemens pour prouver,
enregistrements à Edition 2 08/04/2016 3
l’appui, que notre analyse du problème était exacte.
C’est finalement lors d’une réunion à la direction
générale de PTCL à Islamabad que le représentant
de Siemens a reconnu que le problème était bien de leur
fait : à l’établissement d’une communication,
les centraux Siemens connectés aux centraux Alcatel en signalisation
N°7 envoyaient le signal de la première taxe au lieu du
signal de réponse et, de ce fait, le central Alcatel, ne recevant
pas le signal attendu, bloquait le circuit, le considérant
en faute conformément aux spécifications.
Après avoir reconnu sa faute, Siemens demanda à PTCL
un délai de deux mois pour développer et mettre en œuvre
la mise en conformité de son logiciel dans le réseau.
Cela permit à Alcatel d’augmenter considérablement
sa crédibilité chez PTCL et de démontrer son
professionnalisme. Ce laps de temps fut mis à profit pour continuer
à apporter des corrections au logiciel et préparer les
basculements des OCB 283. Après les corrections faites par
Siemens, le réseau de Karachi fonctionna correctement et le
basculement des cœurs de chaîne OCB 283 commença
en septembre 91. L’opération provisoire en conteneur,
en plus de sauver le contrat et la crédibilité d’Alcatel,
aura permis de débugger le logiciel Pakistan et peut-être
d’éviter de mettre en doute le logiciel OCB283 au vu des
problèmes mentionnés dans ce qui précède.
Les contrats suivants, la création de la filiale APL
La crédibilité acquise par Alcatel chez PTCL permit
la signature dans la foulée d’un contrat de 120.000 lignes,
puis d’un très gros contrat BLT (Built Lease & Transfer)
de 300.000 lignes extensible à 600.000 lignes, comprenant la
fourniture et l’installation des autocommutateurs, des moyens
de transmission, du réseau d’abonnés et des fibres
optiques. En parallèle, Alcatel en partenariat avec PTCL et
le groupe Aga Khan créait « Alcatel Pakistan Limited
» et implantait à Islamabad une usine de fabrication
et un centre de développement de logiciel, devenant ainsi un
fournisseur préférentiel de PTCL au même titre
que Siemens.
Quatre centres régionaux de maintenance étaient créés
dans les différentes provinces en plus de celui de Karachi
afin de permettre l’assistance technique à PTCL nécessaire
à l’exploitation et à la maintenance. Puis en 1996,
les activités de réalisation (Ingénierie, Installation,
Support, Réparation) furent transférées de Karachi
à Islamabad. Seul restait à Karachi le centre régional
de maintenance.
Dans un premier temps, en 1994, Alcatel Pakistan Limited (APL) s’implantait
dans un bâtiment provisoire à la périphérie
d’Islamabad afin de pouvoir commencer les recrutements, la formation
et débuter l’assemblage de certaines parties des centraux
téléphoniques. Les éléments arrivaient
de France sous forme de SKD (Semi Knocked Down) ce qui permettait
de profiter des tarifs douaniers préférentiels pour
les matériels importés. Parallèlement, un centre
de développement de logiciel (CTE) était créé
dans des locaux provisoires en plein centre d’Islamabad. En 1995,
la première pierre de la future usine fut posée en présence
de M. Suard, ces locaux devant regrouper toutes les activités
d’APL, y compris le CTE. Ils furent officiellement inaugurés
en 1998.
La présence et l’influence d’Alcatel commencèrent
à décliner dès 1999 avec l’arrivée
sur le marché pakistanais du mobile (GSM) et des centraux de
petites capacités des sociétés chinoises ZTE
et Huawei. Ces sociétés réussirent à remporter
plusieurs appels d’offres grâce aux aides accordées
par le gouvernement chinois et également du fait de l’influence
politique exercée par le gouvernement chinois sur le gouvernement
pakistanais dans le
conflit indo-pakistanais.
En 2012, le parc comportait 127 commutateurs OCB283 et 5 commutateurs
E10 MM .
sommaire
Lucent Technologies en Bretagne dès 1996
Dans le même temps AT&T Technologies cherche à prendre
position en France dans le domaine des réseaux d’entreprises
et décide d’installer un laboratoire de R&D à
Rennes, qui prend le nom de Lucent BCS. Sous la direction du jeune
ingénieur américain John Rosinski ce laboratoire atteint
un effectif de 57 salariés en 2000 et sera fermé vers
2002.
Lucent s’installe aussi à Lannion en 1996, à la
suite de la décision de Philips d’abandonner les télécoms
au profit de Lucent. Ainsi en France Lucent reprend un bon millier
de salariés de TRT filiale ancienne de Philips, répartis
sur trois sites: une partie des services du Plessis Robinson, l’usine
de fabrication de Rouen et le laboratoire d’études de
Lannion, dirigé par Maurice Le Dohr de 1971 à 1996.
Lors de son absorption par Lucent Technologies les effectifs du laboratoire
Philips-TRT de Lannion sont de 177 salariés et prestataires.
« Avec l’arrivée de Lucent en 1996, le site s’engage
dans le développement de composants spécifiques (ASIC)
pour les accès radio 3G ...
Une nouvelle croissance, par embauches et intégration de nombreux
prestataires, est engagée pour atteindre 220 personnes en 1999
». Le laboratoire est dirigé successivement par Jean-Philippe
Macqueron, Gérard le Cam, Zdenek Picel et Pascal Butel, ces
ingénieurs étant issus de TRT Plessis-Robinson et Rouen.
En 2002 l’activité de l’équipe ASIC porte
sur des développements UMTS, principalement le traitement
de la parole, la gestion du canal (adaptation du débit) et
les turbo-codes. En particulier un partenariat avec l’Ecole d’ingénieurs
Télécom Bretagne, inventeur des turbos codes faisant
l’objet d’une reconnaissance internationale, facilite leur
introduction dans la 3G.
Le client pilote de Lucent Lannion pour la station de base UMTS est
l’opérateur espagnol Telefonica. Des contacts sont tissés
avec les équipes américaines, allemandes et australiennes.
Lucent procède à deux restructurations de son laboratoire
à Lannion en 2000 et 2001, conduisant à des réductions
d’effectifs. La seconde comporte une cession de l’activité
MPMP de raccordements fixes par voie radio à la société
Canadienne SR Telecom (une quinzaine de personnes), activité
qui se poursuivra pendant trois ans à Lannion. « Ainsi
l’effectif redescendra à 60 personnes fin 2001..., puis
à 35 personnes en 2006».
Cette présence de dix ans de Lucent à Lannion a constitué
une nouvelle étape des liens et des échanges entre les
Bell Labs, tout particulièrement le site de Murray-Hill et
le CNET Lannion. Les débuts de ces liens sont anciens puisqu’ils
datent principalement de Telstar en 1962. Et notamment deux responsables
du CNET Lannion ont fait des séjours prolongés aux Bell
Labs : André Pinet pendant un an en 1961, Jean Jerphagnon pendant
deux ans en 1968-70 à Murray-Hill.
Ces liens ont d’ailleurs été célébrés
en juillet 2002 lors du quarantième anniversaire de la première
transmission transatlantique de la télévision via le
satellite Telstar entre la station d’Andover et celles de Goonhilly
(UK) et de Pleumeur-Bodou, près de Lannion, station jumelle
de celle d’Andover, conçue et installée par les
Bell Labs. "Jeudi 11 juillet, Lucent diffusera une émission
commémorant le 40e anniversaire du satellite Telstar... L'émission
sera diffusée sur les sites américains de Lucent"
. Tous les employés du site de Lannion de Lucent le reçurent
aussi. Et une plaque commémorative “Milestone IEEE »
a été placée devant le grand radôme protégeant
l’antenne, toujours bien en place.
Travaux de R&D pour le GSM 3G
Du
côté des réseaux mobiles, à partir des
années 2000, le site de Lannion devient progressivement le
centre majeur des activités de commutation Mobile 3G en prenant
la responsabilité du développement de deux machines
du réseau mobile: le HLR (Home Location Register) puis
le RCP (Radio Control Point).
Sur le plan fonctionnel, les évolutions concerneront le module
de traitement de signalisation 3G ATM.
Sur le plan technologique, entre 2004 et 2006, le logiciel du HLR
est porté sur la plateforme TOMIX. Ce portage s’accompagne
de la mise en œuvre d’une base de données relationnelle
du commerce.
Cette opération a bénéficié de l’expertise
acquise auparavant à Lannion lors :
- du portage du logiciel du E10 réalisé dès 1987
- de la mise en œuvre de bases de données à l’occasion
du projet de
migration du traducteur (base de données du E10) en 1998.
Au travers de cette opération et de son prolongement (le HSS,
Home Subscriber Server), le site de Lannion a acquis une expertise
en SDM (Subscriber Data Management), incontournable au sein d’Alcatel-Lucent.
Du côté des réseaux fixes, le produit E10 continue
d’évoluer également sur les plans technologique
et fonctionnel.
La vente des commutateurs E10 pour les réseaux mobiles 2G connait
une croissance forte de 1996 à 2002, l’année où
les ventes de commutateurs pour le mobile dépassent celles
pour le fixe.
Vers 2000 les établissements Alcatel s’engagent dans le
développement des équipements d’infrastructure
3G-UMTS en se partageant les travaux de développement de la
façon suivante. L’établissement de Lannion reprend
le développement du HLR (Home location Register). Vélizy
prend en charge les tâches radio. De son côté l’établissement
d’Orvault participe au développement du SSP (Service Switching
Point) en utilisant l’organe de commande OCB283 de la gamme E10.
Quant aux essais d’intégration d’ensemble ils se
font tantôt à Vélizy, tantôt à Lannion.
Mais la Direction d’Alcatel-CIT lors du CCE en novembre 2002
confirme « le faible positionnement d’Alcatel... dans l’investissement
nécessaire pour lancer les réseaux UMTS » et poursuit
en indiquant : « Alcatel se positionne pour un démarrage
progressif de l’UMTS d’où un engagement faible dans
le premier tour d’attribution des contrats. Au travers de la
mise à disposition de réseaux pilotes, Alcatel-CIT supporte
seul le poids des investissements UMTS». Alcatel-CIT est ainsi
largement devancé, pour le développement des réseaux
d’infrastructures 3G-UMTS de communication mobile par les deux
nouveaux leaders Européens : Ericsson et Nokia.
Le premier, Ericsson, « est capable de fournir à la fois
des systèmes numériques en TDMA et CDMA. Ericsson a
été, de ce fait, l’un des tout premiers promoteurs
des systèmes cellulaires de troisième génération
(UMTS)».
De son côté « la société Nokia est
maintenant spécialisée dans les télécommunications
mobiles. Fournisseur d’infrastructures de réseaux cellulaires
dans le monde entier, Nokia est surtout [en 2000] le premier fabricant
mondial de terminaux mobiles...Cette situation pourrait changer au
cours des années 2001 et 2002, la groupe ayant connu d’importants
succès sur les premiers contrats d’infrastructures UMTS».
Pour compléter cette présentation on peut ajouter la
présence à Rennes d’un laboratoire de R&D de
la société japonaise Mitsubishi. Fondé en 1995
dans la mouvance d’une usine de fabrication de radiotéléphones
GSM située à Etrelles, à une trentaine de kilomètres
de Rennes, ce laboratoire d’une quarantaine de salariés
a été placé sous la responsabilité de
J-P Coudreuse, après son départ du CNET Lannion. Il
a d’abord mené des développements sur les communications
GSM 3G et des recherches à plus long terme sur les réseaux
numériques à large bande. Il a notamment mis l’accent
sur les protocoles de communication numérique et la sécurité
des réseaux et, après la fermeture de l’usine d’Etrelles
en 2003, a poursuivi ses travaux en élargissant ses activités
vers les énergies renouvelables à partir de 2008.
sommaire
Transformer Alcatel en entreprise sans usine
En juin 2001, Serge Tchuruk, le PDG d'Alcatel, lance à Londres
sa fameuse petite phrase : "Nous souhaitons être, très
bientôt, une entreprise sans usine...Alcatel, dit-il, doit passer
de 120 à 12 usines en 18 mois".
Le moment où Tchuruk lance son appel est celui où il
a confirmation de l’ampleur de l’éclatement de la
« bulle Internet », bulle qui a produit des fortes surcapacités
de production notamment dans deux secteurs : la fabrication des téléphones
mobiles et la transmission optique. Il reconnait l’ampleur de
la crise au début 2001 pour la téléphonie mobile
et à l’été 2001 pour les activités
de transmission optique.
Un journaliste du Monde note : « M. Tchuruk a longtemps tenté
de minimiser la crise, avant de reconnaître son ampleur sans
précédent».
Le retard de la direction d’Alcatel pour comprendre l’ampleur
de la crise peut être chiffré à un an pour la
téléphonie mobile et à six mois pour la transmission
optique.
A partir de 2001 S. Tchuruk décide ainsi d’accélérer
le rythme des fermetures d’usines dans tous les pays où
Alcatel est installé. Il va ainsi multiplier les cessions d’activités,
une solution qui avait été testée par son prédécesseur
en 1993 pour l’usine de Pontarlier. La cession de
l’activité connecteurs (300 salariés) à
Framatome Connectors n’avait donné à ces salariés
qu’un répit provisoire. S. Tchuruk s’adresse ainsi
à des sociétés américaines de sous-traitance
électronique, à travers leurs filiales françaises.
C’est le cas pour Alcatel à Laval, qui chute brutalement
dans la fabrication de téléphones mobiles et qui est
cédée à Flextronics. Alcatel Tourlaville, spécialisée
dans la fabrication d’équipements de faisceaux hertziens
est cédée à Sanmina, Alcatel Brest, qui fabriquait
des équipements de télécoms privés (division
Alcatel Business Systems), est cédée à Jabil.
Ces trois établissements, cédés durant l’année
2002, y gagnent un répit : très court pour Flextronics
(2 ans), assez long pour Sanmina (6 ans) et encore plus long pour
Jabil Brest (12 ans).
Pour trois autres usines une reprise est négociée avec
la participation des cadres et des partenaires s’associant au
projet. L’usine de Saintes, spécialisée dans la
fabrication d’armoires pour les équipements de commutation
avec un effectif de 750 personnes à son pic d’activité,
est reprise par le Groupe Metal Decoupe (GMD) de Saint Etienne avec
un effectif de 350 salariés et prend le nom de Saintronic.
Elle se maintient avec un effectif de 200/250 personnes jusqu’en
2016, l’année de sa cessation d’activités.
L’usine de Coutances a été rachetée par
cinq de ses cadres en 2003 et prend le nom d’Elvia PCB qui a
poursuivi ses activités avec près de 200 salariés
dans le domaine des circuits imprimés. Suite à des reprises
d’activités dans l’Ouest et le Loiret, elle est à
la tête aujourd’hui d’un groupe spécialisé
dans les circuits imprimés d’environ 500 salariés.
L’usine d’Annecy suit un parcours très différent.
Dès son origine elle se situe dans le domaine des appareils
de physique et se spécialise dans les pompes à vide,
notamment pour les grandes usines de fabrication de semi-conducteurs.
Elle devient filiale d’Alcatel sous le nom d’Alcatel Vacuum
et poursuit vers 2000 son effort de R&D171 pour améliorer
les performances de ses pompes à vide notamment pour l’usine
ST Microelectronics à Crolles, pas très loin d’Annecy.
Repris en 2010 par la société Pfeiffer Vacuum, le leader
allemand dans ce domaine du vide, l’établissement d’Annecy
a remonté aujourd’hui ses effectifs à 600 salariés
et est dans une bonne dynamique.
En Bretagne Matra, qui avait repris l’usine de Pont de Buis,
fondée pour la fabrication de postes téléphoniques
et dont les effectifs avaient atteint 750 salariés, s’était
lancé dans la fabrication de téléphones mobiles
avec au moins sept lignes de production, comme Alcatel à Laval
et Sagem à Fougères, sans compter Mitsubishi près
de Rennes. Dès 2002 Matra cède.l’usine de Pont
de Buis à la filiale française de la société
américaine Solectron. L’équipe de direction accepte
de conserver sa place dans l’usine. Mais Solectron se désengage
au bout d’à peine deux ans. Trouver un repreneur n’est
pas facile. L’entreprise Novatech de Lannion, essaimage de Thomson
TCT propose de reprendre 200 salariés avec leurs cadres. Cet
effectif est maintenu aujourd’hui.
Au début des années 2000 la chute des effectifs d’Alcatel
a été brutale, en particulier pour ses établissements
français.
De 2000 à 2004 « en France, l'effectif est tombé
de 35 000 à 19 000 salariés». Le chiffre indiqué
de 35 000 pour la France inclut les filiales d’Alcatel. La plupart
de celles-ci sont cédées : Nexans (câbles, 2 000
salariés en France), Answare (informatique, 900 salariés
à Massy), activité des composants (1200 cédé
à ST Microelectronics), secteur réseau d’entreprises
(2 900 en France, cédé à Platinum), Optronics
(Nozay, 800 salariés), filiale des batteries SAFT (1800 à
Bordeaux, Poitiers). Hors la cession de ces filiales la chute est
moins brutale, de 25 000 à 19 000.
« Grâce à la signature d’un accord de méthode,
les syndicats CFDT, CGC, et CFTC sont parvenus à limiter les
fermetures de sites et les licenciements ‘secs’.La phrase
de S. Tchuruk en 2001 "Nous souhaitons être, très
bientôt, une entreprise sans usine... » a été
beaucoup discutée en France à l’époque.
Elle est encore couramment citée aujourd’hui, notamment
dans la Revue de l’Electricité et de l’Electronique
(REE).
Alcatel en Europe et Lucent aux Etats-Unis dans la même spirale
Au début des années 2000 la situation d’Alcatel
est assez délicate.
Pour les réseaux dorsaux Alcatel avait choisi l’ATM, qui
est supplanté par l’IP soutenu par le dynamisme américain
des entreprises de la Silicon Valley, avec des perfectionnements majeurs,
notamment les versions IPv4 et IPv6.
La reprise de la société Newbridge par Alcatel apparait
moins productive que prévu.
Dans le domaine des réseaux mobiles l’engagement d’Alcatel
sur l’UMTS reste assez mou et les développements de la
radio 3G sont mal maitrisés par l’établissement
de Vélizy, qui en est responsable.
Dans les réseaux optiques Alcatel CIT a privilégié
les réseaux sous-marins en raison de son positionnement de
leader mondial et pour les applications terrestres Alcatel NV a laissé
le leadership à Stuttgart au sein du groupe.
Pour les accès ADSL Alcatel est bien positionné, mais
au profit de la Bell Anvers et de Stuttgart.
Dans la spirale baissière de réductions des effectifs,
associées à des baisses des parts de marché,
la société américaine Lucent n’est pas dans
une meilleure position. « Lucent Technologies a été
créée en 1996 à partir du démantèlement
d’AT&T et regroupe les activités systèmes et
technologies de ce dernier. La société a été
le leader mondial de l’industrie des équipements de réseaux
de télécommunications jusqu’en 1999. Au cours de
l’année 2000 l’annonce de la baisse de ses parts
de marché, simultanément avec la publication de correctifs
sur les comptes 1999... a entrainé Lucent Technologies dans
une spirale boursière [à la baisse]. Le seul secteur
sur lequel le groupe américain est absent est celui des terminaux
mobiles, activité qui a été abandonnée
au début de l’année 1999 après l’échec
du partenariat avec Philips». Pour combler son retard sur les
réseaux de données et de l’IP, Lucent a fait l’acquisition
de la jeune société Ascend pour 20 milliards de dollars
à la fin 1998.
A son apogée ATT Technologies a eu jusqu’à 250
000 salariés, répartis dans une trentaine d’établissements.
Parmi ces établissements, dans le domaine de la commutation,
l’usine majeure de Columbus fondée en 1957 avait regroupé
12 000 salariés à son pic d’activités dans
les années 1970, dont un millier était rattaché
aux Bell Laboratories. Une seconde usine pour la commutation, établie
à Oklahoma, avait atteint un peu plus de 6 000 salariés
à son pic d’activités. Les deux usines sont cédées
en 2001, avec 6 000 salariés au total, au sous-traitant Celestica,
tout en conservant certaines activités de laboratoire. En 2006
les activités de fabrication sont définitivement arrêtées
dans ces deux usines. A Columbus tous les bâtiments de fabrication
sont rasés en 2014.
Dans l’héritage centralisateur de la CIT les établissements
parisiens ont gardé un statut privilégié, notamment
celui de Vélizy, gros établissement ayant regroupé
jusqu’à 4000 salariés avec des activités
de direction, d’études, de fabrication de chantiers extérieurs
et qui n’hésite pas à faire de la récupération
sur ce qui se fait de mieux dans les établissements régionaux.
De leur côté les deux établissements bretons d’Orvault
et de Lannion affichent une certaine solidarité (certains anciens
parlent même de symbiose) vis-à-vis « de Vélizy,
considéré comme « trop gros », ingérable,
avec un turn-over qui complique les travaux de R&D et avec des
coûts élevés notamment pour les locaux. Les deux
établissements de Lannion et Orvault assurent des travaux en
commun notamment sur le commutateur E10B OCB283, dont la capacité
est de 16 000 MIC. A Orvault ce sont 300 personnes, qui travaillent
sur ce commutateur.
Pour mener en commun ces travaux des personnes des deux sites, distants
de 270 km, se déplacent chaque semaine pendant des périodes
plus ou moins longues. C’est ainsi qu’en 2002 sept navettes
par voiture sont organisées en début et fin de semaine,
dont les deux tiers à partir de Nantes vers Lannion. Pour assurer
son avenir Orvault cherche une identité et envisage de devenir
le spécialiste de l’architecture des réseaux NGN
(New Generation Network).
sommaire
Emergence de l’industrie chinoise
Le comité européen des syndicats Alcatel a pris l’initiative
d’organiser un voyage en Chine, qui s’est déroulé
en avril 2005. Un rapport de ce voyage a été diffusé
par la CFDT Alcatel.
Le Groupe Huawei (24 000 Salariés, dont 11 000 dans la R&D),
dirigé par un ancien général de l’ALP (Armée
de Libération Populaire), mène une politique agressive
de conquête de parts de marché. C’est l’un
des premiers concurrents d’Alcatel... Huawei investit dans tous
les pays du Monde : pour tirer sa croissance et développer
ses exportations, le groupe suscite, répond à des appels
d’offre dans tous les pays d’Afrique (Togo, Algérie...),
en Amérique latine (Argentine, Vénézuela...),
mais aussi en Europe pour France Télécom, 9 Telecom,
Deutsch Telekom, British Telecom...Huawei développe des technologies
basiques qui répondent à la majeure partie des besoins
des opérateurs. Il sera prêt pour les technologies 3G.
L’entreprise bénéficie comme d’autres des
ressources de chercheurs payés par l’Etat dans des universités.
Le siège social est installé sur un campus impressionnant
par sa taille. Huawei a fait de son show room une vitrine qu’il
veut spectaculaire...Huawei vise à être l’un des
premiers constructeurs mondiaux d’équipements de télécoms.
Dans cette stratégie, les dirigeants sont fortement soutenus
par le gouvernement chinois.
Avant notre voyage, nous avions le sentiment que nos premiers concurrents
étaient Lucent, Nortel aux USA, Ericsson et Siemens en Europe.
Huawei, à nos yeux, faisaient partie du deuxième cercle.
Depuis ce voyage, nous devons inscrire Huawei dans le cercle des premiers
concurrents mondiaux d’Alcatel .
Dans les années qui ont suivi ce voyage, l’entreprise
Huawei a commencé par casser les prix des commutateurs, puis
est montée en puissance à partir de 2010 et est devenu
un concurrent très compétitif aussi bien sur les performances
que sur les prix.
De la fusion d’Alcatel et Lucent à Nokia (2006-2015)
Relance des activités GSM 3G dès 2006 et débuts
des travaux sur la 4G
L’intégration de l’équipe Lucent de Lannion
est en quelque sorte providentielle pour Alcatel Lannion.
- D’une part les membres de cette équipe ont passé
dix années chez Lucent et connaissent bien la façon
de travailler des ingénieurs américains de Lucent.
- D’autre part ils ont acquis une expérience du meilleur
niveau dans un domaine important, celui de la radio des infrastructures
GSM,
Au moment de la fusion d’Alcatel et de Lucent il apparait bien
qu’en « ratant le virage de la 3G Alcatel-Lucent a perdu
la confiance de ses principaux clients.
La nouvelle Direction d’Alcatel-Lucent prend des décisions
énergiques.
L’établissement d’Alcatel à Vélizy,
défaillant, est écarté des études radio.
L’activité radio 3G de la société canadienne
Nortel est acquise pour apporter un complément de compétences.
Enfin les études radio 3G sont affectées à l’établissement
de Lannion. «Stratégiquement il est décidé
de conserver le produit provenant de Nortel et de le faire évoluer
en bénéficiant des avancées du Modem du produit
de Lucent.
Ce choix constitue le point de départ de l’accroissement
des équipes travaillant sur la partie radio à Lannion...
En plus des 35 personnes ex-Lucent qui développent le principal
composant matériel de la carte Modem, une partie des développeurs
ex-Alcatel participe au développement logiciel. En 2007 environ
80 ingénieurs travaillent sur cette nouvelle carte Modem. .
Vers 2007 le centre de Lannion « commence à travailler
sur un démonstrateur dans la nouvelle norme du réseau
mobile LTE (GSM 4G), toujours sur la partie modem, mais avec d’autres
équipes localisées à Villarceaux et Murray Hill
aux Etats-Unis.
Les développements s’intensifient de 2008 à 2010
pour aboutir à un produit qui est commercialisé chez
l’opérateur Verizon aux Etats-Unis.
Verizon ouvre le premier réseau commercial LTE avec des équipements
Alcatel-Lucent (l’un de ses deux fournisseurs), le 5 décembre
2010.
Ces développements sur le LTE se traduisent par une nouvelle
croissance des effectifs travaillant sur le wireless (3G UMTS et 4G
LTE). Cela représente environ 130 personnes. »
La technologie LTE, aux normes américaines, n'est pas une technologie
4G au sens strict. C'est la version suivante, LTE-Advanced, qui sera
la plus proche de la technologie 4G européenne.
sommaire
Une
cinquième génération voit le jour intégrant
:
- Sur le plan technologique, une communication interne basée
sur Ethernet et le noyau Linux avec pour objectif, d’une
part, de gérer les obsolescences de composants tout en accroissant
les performances et, d’autre part, d’ouvrir le produit à
des sous-ensembles (logiciels ou matériels) du commerce.
- Sur le plan fonctionnel, une fonction MGC (Media Gateway Controller)
avec pour objectif de permettre une migration en douceur du parc des
opérateurs de téléphonie vers le monde IP et
les interfaces associées (architecture IMS).
Le produit résultant, dénommé commercialement
5060 MGC 10, peut remplacer jusqu'à une dizaine de commutateurs
de troisième génération et sera vendu à
une quinzaine d’opérateurs.
Dernière
évolution en date, en juin 2014, le site de Lannion inaugure
le « centre d’Excellence SDM ». Ce centre s’appuie
sur un environnement dédié et sécurisé
permettant d’atteindre des capacités équivalentes
voire supérieures à celles des solutions SDM déployées
chez nos clients majeurs.

Large bande, routage IP Réseaux NGN
« En 2006, le produit E10 est en service dans 113 pays,
3210 commutateurs sont installés chez 215 opérateurs
de télécommunications, raccordant 90 millions de lignes
fixes, 22 millions de circuits et 106 millions d’abonnés
mobiles.
Les demandes d’évolution deviennent alors limitées.
Les responsables des lignes de produits décident les ultimes
évolutions et en informent les clients».
De 1966 à 2006 l’effort de R&D a été
mené de façon continue pendant quarante ans.
Une nouvelle époque apparait avec la convergence des
réseaux de transport, basée sur le protocole IP,
aboutissant à la mise en place d’un « backbone (une
dorsale) unique capable de transporter à la fois des informations
de type voix et de type données et d’offrir de même
façon des services voix-données fixe ou mobile».
L’architecture NGN, avec séparation des plans de
commutation et de traitement d’appel, est mise en œuvre.
Le site concepteur de la NGN Alcatel n’est pas l’établissement
de Lannion, mais celui-ci participe au développement du contrôle
d’appel.
En 2005 Alcatel acquiert l’entreprise américaine Spatial
Wireless (225 salariés). Cette acquisition avait pour but de
permettre « de prendre une longueur d’avance par rapport
aux technologies traditionnelles de commutation mobile en fournissant
une technologie de réseaux de nouvelle génération
(NGN) déjà commercialement disponible et conçue
pour être prête pour les évolutions de réseau
de type IMS (IP Multimedia Subsystems) ». Ph. Saint-Aubin est
détaché dans l’entreprise Spatial Wireless pendant
deux ans pour assurer les liaisons entre cette entreprise et Alcatel
en France.
Convergence des voix et données
La convergence des voix et données conduit à une nouvelle
architecture de réseau, appelée IMS (IP Multimédia
Subsystem). « Dans l’architecture IMS les fonctions sont
réparties et localisées dans le réseau au mieux
des besoins :
-La voix subit un traitement particulier dans des nœuds dénommés
passerelles (ou Média Gateway).
-Les nouveaux services multimédias et les besoins en trafic
ont conduit à distinguer un plan de contrôle (établissement
des appels, traitement des services...) et un plan usager (échange
d’information) et ont nécessité de créer
un type de nœud dédié au plan de contrôle,
appelé serveur d’appel.
-Le besoin d’interfonctionnement de ce réseau «
convergé » avec le réseau téléphonique
classique nécessite une fonction MGCF (Media Gateway Control
Function).
Elle a pour objectif d’assurer l’interconnexion avec les
réseaux et systèmes existants,...systèmes datant
parfois de plusieurs dizaines d’années».
L’architecture réseau IMS (IP Multimedia Subsystem) a
pris corps; cette fois la chaine de traitement d’appels de l’OCB
n’était plus adaptée au réseau téléphonique.
L’objectif de l’architecture IMS était d’intégrer
les appels mobiles et fixes et là l’architecture
mobile apportait par exemple une base données centralisée
HLR, plus universelle que le Traducteur E10, fonction qui est devenu
le HSS dans l’architecture IMS.
Chaque bloc fonctionnel (en raccourci chaque ML) du commutateur se
trouvait ainsi localisé à un endroit quelconque du réseau
et mis en commun pour les besoins du fixe et du mobile.
C’est ainsi que plusieurs produits, notamment le 5060 MGC10 et
le manager de données des abonnés 8650 SDM ont été
développés à Lannion dans ce nouveau cadre d’un
réseau unique voix et données.
Le commutateur E10 conservait une petite place, celle de faire l’interface
avec les commutateurs RTC existants et est devenu ainsi un des blocs
fonctionnels de l’architecture IMS.
Les grands opérateurs, comme Orange ont programmé la
fermeture
de toutes leurs lignes RTC au début des années
2020. Ce sera la fin définitive d’une belle aventure,
celle des commutateurs E10.
sommaire
Nokia
reprend les deux sites de Villarceaux et de Lannion en janvier 2016.
Au fil des années le site de Lannion a fait la connaissance
de plusieurs groupes internationaux. Ce sont en effet deux groupes
américains (AT&T et Cisco) et quatre groupes européens
(Ericsson, Philips, Pirelli et Siemens) qui ont été
implantés sur le site pendant des durées plus ou moins
longues. Pour Ericsson c’était récent vers 2010,
quand cette société avait fait l’acquisition de
l’établissement de Lannion de la société
Devoteam, lui-même étant une reprise en 2004 de l’établissement
de Lannion de Siemens, fondé en 1999.
Nokia était moins connu en Bretagne. La prise d’une licence
par Nokia, concernant le commutateur E10A en 1977, n’a pas eu
de suite. Dans les années 1990 Nokia se fait connaitre, lors
de l’apparition de la norme GSM, en participant à un consortium
à trois, Nokia, AEG et Alcatel, qui n’a pas duré
longtemps.
Dans le jeu international des années 2000, alors qu’en
2005 Alcatel s’est tourné vers Lucent, Nokia s’est
associé en 2007 avec Siemens en créant une filiale commune
Nokia Siemens Network, reprise par Nokia seul en 2013 après
une profonde restructuration. Dans le même temps, après
avoir été le leader mondial des téléphones
mobiles pendant plus de cinq ans,
Nokia rate le passage aux smart-phones et vend sa division de téléphones
mobiles.
Alors Nokia passe à l’étape suivante et engage
la négociation pour le rachat d’Alcatel-Lucent.
En 2015, le finlandais Nokia rachète Alcatel Lucent.
Le ministre de l’économie de l’époque, Emmanuel
Macron se réjouit du mariage : "les centres de recherche
et développement seront maintenus et développés
avec des perspectives d’embauche et d’investissements. C’est
une bonne opération, une opération d’avenir."
La
fusion est annoncée en avril 2015. Elle est effective le 1er
janvier 2016.
Pendant que Nokia et Siemens nettoient leurs portefeuilles,
Alcatel-Lucent peine à orchestrer sa fusion. A sa tête,
le binôme Serge Tchuruk-Pat Russo ne fonctionne pas, et les
cultures ont du mal à se mélanger. C’est le moment
que choisit le chinois Huawei pour porter l’estocade, en imposant
ses équipements 2G, 3G et bientôt 4G, à la fois
bon marché et performants. En 2008, Alcatel-Lucent vaut moins
qu’Alcatel seul avant la fusion. Depuis,
le groupe a accumulé les pertes et enchaîné les
plans de restructuration. Michel Combes qui a succédé
à Ben Verwaayen il y a deux ans, a continué de réduire
les coûts mais aussi à recentrer l’entreprise sur
quelques métiers porteurs pour réinscrire le groupe
dans une dynamique de croissance. Il a visiblement compris que sans
allié, Alcatel-Lucent resterait trop faible.
La fusion se fait sur les bases de ce qui avait été
décidé en octobre 2013 par la Direction d’Alcatel
: fermeture de plusieurs sites (Rennes et Toulouse) et projets de
cession d’Orvault, Eu et Ormes. Aujourd’hui Nokia France
rassemble près de 4 000 salariés.
Ainsi
de la cinquantaine d’établissements Alcatel en France
vers 1983 il n’en reste plus que trois, repris par deux groupes
européens : Villarceaux et Lannion repris par le groupe finlandais
Nokia, Annecy repris par le groupe allemand Pfeiffer Vacuum. Il reste
aussi trois essaimages réussis dans la sous-traitance électronique
(aujourd’hui environ 1400 salariés au total) : Cofidur
(Laval, Cherbourg...), Novatech Technologies (Lannion, Pont de Buis),
Elvia PCB (Coutances).
Des décisions qui passent difficilement
Dans les moments de crise la solidarité syndicale ne s’exprime
pas toujours facilement. Dans son livre publié en 2002 Pierre
Suard se souvient « d’une confrontation [le 14 avril 1985]
avec les organisations syndicales, les responsables politiques, le
cabinet du ministre et la direction générale des Télécommunications,
au sujet des projets sociaux [de la Direction de la CIT] en Bretagne...CIT
ne devait pas licencier, mais aucune solution [n’était
proposée]...Personne n’avait envie de changer quoi que
ce soit au plan industriel de CIT, mais certains participants «
de la base » venus de Bretagne espéraient, peut-être
sincèrement, un résultat concret. Ils ont dû être
meurtris de se voir si mal soutenus par « les leurs »
à Paris.
Les participants de la base, venus de Lannion, sont effectivement
meurtris. « Cette négociation finale au Ministère
de l’Industrie déçoit et laisse beaucoup de rancœurs
aux syndicalistes : « roulés dans la farine » dit
la CGT, « aucune avancée » renchérit la
CFDT... ».
En 2014 le dernier plan de restructuration d’Alcatel-Lucent avant
son rachat par Nokia pose de nouveau la question de la solidarité
syndicale. Alcatel-Lucent « n’avait cessé alors
de perdre du terrain, accumulant des pertes, ratant les tournants
technologiques. Les plans de restructurations successifs n’y
ont rien fait. « Orvault se fait déplumer », avaient
protesté les salariés, déjà, en 2012.
Orvault est mort. Toulouse, Rennes, aussi. « Ce n’est pas
pour rien qu’on a quitté les villes les plus attractives
et gardé Lannion. » Cette syndicaliste de la première
heure a une lecture plutôt cynique du plan : « Ainsi,
le groupe était sûr de se séparer d’un maximum
de salariés »... Le maire d’Orvault ne décolère
pas. « L’État et la
Région n’ont pas été à la hauteur
», tacle Joseph Parpaillon, l’élu divers droite.
Il s’emporte contre Emmanuel Macron, qui a annoncé cet
été la création d’une plateforme dédiée
au numérique à Lannion. Le vent a tourné, les
Bretons [de Lannion] ont gagné. »
Une première réponse à ces critiques concerne
les relations entre établissements et l’action syndicale.
Lors de l’histoire commune des deux sites de Lannion et d’Orvault
on peut citer des transferts qui ont été favorables
à la Loire-Atlantique : les transferts d’études
sur E10 de Lannion à Orvault au début des années
1980 dans un climat de bonne coopération entre les deux sites,
le transfert de RFS Lannion (une centaine d’emplois) de Lannion
à Trignac en Loire-Atlantique vers 2002. Il est à noter
de plus que les représentants syndicaux des salariés
d’Alcatel, dans les phases d’internationalisation d’Alcatel
NV et d’Alcatel-Lucent ont su se coordonner pour assurer une
représentation exemplaire au niveau du Comité d’Entreprise
Européen. Alcatel Lannion y a été particulièrement
actif, car plusieurs de ses représentants (P.Saint-Aubin, H.
Lassalle) y ont siégé pendant plusieurs années.
P. Saint Aubin en a été de ce CCE européen notamment
dans la période où la direction d’Alcatel NV fermait
des usines en Espagne et en Italie. P. Saint-Aubin indique : «
J’ai été secrétaire du CE européen
de 2009 à 2012. Hervé a succédé à
un Orvaltais JB Triquet comme délégué central
d’Alcatel Lucent et C. Le Bouhart de Lannion a été
secrétaire du CCE d’Alcatel Lucent de 2008 à 2014.
Les tensions entre sites sont restées gérables et elles
concernaient plutôt effectivement la rivalité Paris /
Province.
Le
site d’Alcatel dans le Trégor a compté plus de
4 000 personnes, demain, ils seront moins de 400.
En Septembre 2020 Le président
de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard a poussé
un coup de gueule sur BFM TV sur la situation de Nokia à Lannion,
où la suppression de 402 emplois a été annoncée
fin juin (la moitié des effectifs). Il veut mettre dans la
balance l’annulation de la vente d’Alcatel à Nokia,
ainsi que la restitution des brevets, des technologies et des contrats.
- Mettons dans la balance l’annulation de la vente d’Alcatel
à Nokia. On nous avait promis des emplois et de l’excellence
à Lannion.
- Nous bretons nous nous sentons trompés.
- Vous voulez partir ? Rendez nous les brevets, les technologies,
les contrats !
.
sommaire
Dynamique territoriale
Pour répondre aux critiques sur le manque d’attractivité
de la technopole de Lannion, il n’est pas mauvais de préciser
différents aspects de la dynamique territoriale du pôle
de Lannion.
Depuis les années 1960 les deux piliers de ce pôle sont
France Télécom, aujourd’hui Orange, et Alcatel,
aujourd’hui Nokia.
Le site Orange de Lannion, Orange Labs pour la recherche a maintenant
une longue histoire. Les équipes ont pu se renouveler, notamment
avec l’arrivée de jeunes générations de
jeunes chercheurs dans les années 1990 pour remplacer les anciens,
mais aussi en se réorganisant régulièrement et
en suscitant une mobilité interne et aussi externe à
l’établissement. « Tout au long de son existence,
le centre de Lannion a pu ainsi se renouveler... Avec le recul on
peut dire que des opérations de mobilité [des personnes]
préparées localement et finalement choisies comme en
1979 et en 1997 ont eu un effet positif sur le long terme et sont
en tous points préférables à la mobilité
forcée, que la direction d’Orange a voulu imposer en 200
.
En venant à Lannion en 2013 Stéphane Richard, le Président
d’Orange a souligné que le site de Lannion était
devenu le « plus grand laboratoire d’innovation
du Groupe Orange. » Et il a insisté sur l’innovation
en exprimant le souhait « qu’on soit capable, à
la manière dont les géants (Google ou Apple) le font,
d’ouvrir des passerelles avec l’extérieur [et il
a ajouté] « Je voudrais faire [de Lannion] un pôle
numérique très ouvert sur l’extérieur. Je
l’imagine comme un site où des mètres carrés
seront réservés à des étudiants, des développeurs,
des PME partenaires, des start-up...Je suis un militant de l’Open
innovation ».
Entre Nokia et Orange les relations sont d’abord des relations
de fournisseur à acheteur, ce qui n’empêche pas
que des passerelles locales entre les deux puissent être localement
établies, notamment dans le cadre de projets européens
et aussi régionaux, à travers des dispositifs comme
le Pôle Images et réseaux ou l’IRT B-com.
Plus largement le pôle de Lannion, qui s’est établi
comme Technopôle sous le nom de Lannion Anticipa, en
compagnie de six autres pôles bretons, est largement partie
prenante de toutes les actions menées en faveur de l’innovation
technologique dans le domaine télécom et Numérique,
qui impliquent les établissements de l’ESR (Enseignement
Supérieur et Recherche) de Bretagne. Le déploiement
de cet l’ESR numérique en Bretagne a été
présentée dans un chapitre intitulé « De
la vocation électronique de la Bretagne à l’ESR
numérique » du livre « Les mutations de l’enseignement
et de la recherche en Bretagne (1945-2015) . La conclusion de ce chapitre
indique : « Ce secteur [du numérique] avait besoin d’un
ESR fort dans ses deux fonctions de formation professionnelle et de
recherche. Les universités se sont mobilisées et une
douzaine d’écoles d’ingénieurs ont été
fondées en Bretagne. Malgré une tradition industrielle
plus faible et des moyens plus réduits que ceux des grands
pôles Technologiques, Ile de France, Grenoble ou Toulouse, la
Bretagne a réussi à faire face. Elle peut continuer
dans cette voie si l’esprit de coopération entre acteurs
régionaux se maintient et si le réseau, constitué
des trois métropoles de Rennes, Nantes et Brest, associées
à des pôles moyens, notamment Lannion, Lorient et Vannes,
se renforce.»
Présence dans la Technopole Lannion Anticipa d’une quarantaine
de PME, créées durant les trente dernières années.
Fin de l’âge d’or de l’export
et renforcement de la R&D à Nokia Lannion
L’arrivée de Nokia en 2016 a provoqué une redistribution
des activités de l’établissement de Lannion, aboutissant
à la suppression des activités de soutien à l’export
d’une part au renforcement de la R&D d’autre part.
L’aventure de l’export est résumée par Ph
Saint-Aubin en quelques phrases. « On est à la fin de
l’âge d’or de l’export chez Alcatel Lannion.
Les équipes se rendaient sur les cinq continents, supervisaient
les réseaux et accueillaient massivement visiteurs et stagiaires
étrangers. Plusieurs centaines d’emplois. Les sites parisiens
mieux placés géographiquement vont prendre peu à
peu le relais avant de perdre du terrain eux aussi après les
fusions Lucent, puis surtout Nokia qui ont fortement réduit
le rôle de la France198 ». Cet âge d’or est
celui des
années 1980, prolongé durant les années 1990.
Rappelons que l’Institut de formation d’Alcatel (IFA) de
Lannion a connu une période de démarrage d’une
dizaine d’années pendant laquelle il a accueilli des stagiaires
Polonais, Maltais, Mexicains, Finlandais, Ivoiriens, Sud-Africains...
pour des formations sur l’E10A et l’E10B . Les pionniers
ont été notamment Michel Menez, Henry Corbé,
François Jollé et Jean-Paul Lovat,
On peut dire que cet Institut de formation est entré dans son
âge d’or vers 1985, sous la direction de Michel Perroche,
puis de Alain Hubermann, et y est resté pendant une quinzaine
d’années. En 1989 à la suite du transfert des activités
du centre parisien de Saint Ouen à Lannion, l’année
même de la fondation d’Alcatel University, il augmente
fortement ses activités et voit passer 71 nationalités
de 1990 à 2000. La formation pratique se fait dans les locaux
de l’institut, puis sur les sites d’installations. Comme
l’indique plus tard des anciens de l’IFA de Lannion : «
Nous ne sommes pas des exploitants, notre expérience d’opérateur
se limite à celle du personnel du service chantier. En faisant
participer le personnel du client
aux essais de mise en service, nous réussissons néanmoins
à le décomplexer devant desmatériels tout nouveaux».
A la fin des années 1990 il assure des transferts de compétence
dans le domaine de la formation entre autres dans le cadre de trois
opérations de transferts. La première au VietNam est
la création d’un centre de formation E10 au sein de l’Université
des Télécoms d’Hanoï. La seconde en Malaisie
permet la création d’une filière de formation E10
à l’école supérieure des Télécoms
de Kulua Lumpur. La troisième au Sénégal, est
une coopération avec l’Institut National des Télécoms
pour la mise en place d’un système complet de formation
pour les futurs ingénieurs télécoms.
Les activités de R&D sur le site de Nokia Lannion ont été
en croissance durant ces trois dernières années et atteignent
maintenant 50 % des effectifs. Elles sont regroupées sous la
bannière de « Nokia Bell Labs », un intitulé
prestigieux, qui a pleinement son sens pour les deux sites français
de Villarceaux et Lannion. Le premier défi à affronter
est celui d’être attractif pour faire venir à Lannion
des chercheurs expérimentés et des jeunes chercheurs
qualifiés et motivés.
sommaire
Retour sur le choix de l’optronique comme
nouveau vecteur industrialisant
Alors que le CNET avait, depuis le milieu des années 1960,
profondément façonné le tissu industriel régional
en privilégiant la coopération avec les grands groupes
industriels dans le domaine de la téléphonie, les années
1980 furent celles d’une inversion de cette politique. Partant
d’une technologie d’avenir dans laquelle le laboratoire
de Lannion était en pointe, les fibres optiques, le
CNET joua la carte des PME et de l’essaimage.
Ainsi, un nouveau pôle innovant, centré sur l’optronique
(ou opto-électronique), devait prendre le relais des réseaux
numériques.
Le CNET voyait toutefois son rôle profondément modifié
puisqu’il devait financer des études (aux PME Kerelec
et Grenat par exemple) et assurer une expertise auprès des
industriels afin de faciliter les transferts technologiques. En 1984,
le Trégor avait déjà été retenu
comme région d’expérimentation pour un réseau
de vidéocommunication. La même année, un vidéodisque
optique, mis au point par le CNET, présentait les attraits
touristiques de la région. Grâce à « l’autoroute
électronique de l’Ouest », qui était une
liaison par faisceaux hertziens numériques à haut débit,
un réseau visiophonique interne du CNET put être mis
en place entre Lannion et Issy-les-Moulineaux.
Le symbole politique de cette nouvelle orientation fut assurément
la visite, le 7 octobre 1985, du Président de la République
François Mitterrand qui annonça la création
d’une école d’ingénieurs ainsi que l’octroi
d’une aide de 10 millions de francs pour le Trégor.
Des primes à l’aménagement du territoire pouvaient
également être accordées au cas par cas. L’école
d’ingénieurs, l’ENSSAT (École nationale
supérieure de sciences appliquées et de technologie),
fut créée en 1986. Cette école hébergeait
le Centre régional d’innovation et de transfert technologique,
association créée en novembre 1985 et financée
dans le cadre du contrat de plan État-région pour la
mise au point de spécifications techniques. En formant des
ingénieurs en optronique, directement au contact du CNET et
des entreprises privées dès leurs années de formation,
l’objectif poursuivi était la constitution d’une
génération d’ingénieurs spécialisés
au service de l’industrie locale. L’investissement dans
la « matière grise » avait pour finalité
la création d’emplois industriels régionaux.
Parallèlement, plusieurs dispositifs d’aide à la
création d’entreprise furent institués. Le projet
CELTT, lancé en avril 1985, visait à favoriser la création
d’entreprises à fort contenu technologique à partir
des centres d’enseignement et de recherches. L’ADIT (Agence
de développement industriel du Trégor) devait être
une pépinière d’entreprises mais apporta surtout
son soutien aux essaimages des ingénieurs du CNET et d’Alcatel.
Les entreprises Novatech, à Ploumilliau, et PECI, à
Perros-Guirec, furent ainsi créées par essaimage de
cadres de CIT-Alcatel. La création d’une « nursery
» par la chambre de commerce consistait dans la mise à
disposition de locaux au faible loyer pour les nouvelles PME. De fréquentes
réunions quadripartites, regroupant autour d’une même
table les industriels, les syndicats, l’État et le CNET,
permirent une réelle concertation entre les acteurs. Symbole
de cette mise en place sur l’agenda politique, tant régional
que national, un groupe de travail interministériel «
Trégor », en charge de l’ensemble des questions
de reconversion, fut constitué et présidé par
Pierre-Yves Schwartz, ingénieur en chef des télécommunications.
soutient, depuis sa création en 1984 et dans l’espace
plus vaste des régions Bretagne et Pays de la Loire, le millier
d’entreprises du secteur des télécommunications,
notamment par des formations.
La réponse à la crise sociale et à ses enjeux
politiques évidents prit donc la forme d’un partenariat
entre les pouvoirs publics locaux, les industriels privés et
le CNET pour transformer, selon les vues technologiques de l’organisme
public de recherche, le pôle innovant de Lannion en un tissu
régional innovant de PME dans l’optronique.
Cette politique reposait sur une double sous-traitance : de la recherche
par le CNET qui eût toutefois quelques difficultés à
entrer dans son nouveau rôle d’expertise, et de la fabrication
par CIT-Alcatel. Renouveler le pôle innovant en densifiant le
tissu économique local, préserver l’emploi et susciter
des créations dans des secteurs d’avenir, tels étaient
les objectifs de cette vaste mobilisation en faveur des PME.
Les limites des choix imposés
En privilégiant l’optronique, le CNET plaçait un
ensemble de petites entreprises dans son cheminement technologique.
La « path dependency », souvent évoquée
par les historiens des techniques à la suite de Paul David,
se doublait dans le cas présent d’une dépendance
institutionnelle. Les PME, suscitées dans le contexte de la
crise du milieu des années 1980, n’avaient aucune véritable
autonomie commerciale. Au terme des premiers contrats, la situation
devint difficile, voire critique, pour un certain nombre d’entre
elles. Non seulement les sous-traitants durent supporter davantage
de contraintes et assurer la flexibilité de leur production,
mais le rapport Alcatel-PME en faisait parfois davantage des unités
externalisées de production que de véritables sous-traitants
avec un pouvoir de négociation.
La première moitié des années 1990 fut ainsi
marquée par une situation de crise latente. Après être
devenu le leader mondial des équipements de télécommunications
en 1992, le groupe Alcatel-Alsthom connut plusieurs années
de sévère concurrence au niveau mondial de la part d’Ericsson,
Motorola et Lucent Technologies . La suppression de plus de 1 000
emplois dans l’usine CIT-Alcatel en 1996 provoqua une mobilisation
sans précédent de la population : en novembre, une manifestation
de 20 000 personnes défila dans les rues de Lannion.
Les start-up de l’optique et la crise de
2001
Entre 1996 et 2001, la région de Lannion, portée par
les PME et par la technologie des composants optiques, vécut
pourtant une nouvelle période faste. Ces PME n’avaient
pas été créées comme de simples entreprises
sous-traitantes mais disposaient d’une autonomie des marchés
et d’une agressivité commerciale qui leur permettait tout
à la fois de valoriser les compétences locales, en technologies
et en main-d’œuvre, et de rechercher des marchés.
À partir de ce moment-là, les entreprises de Lannion
vécurent au rythme du marché mondial et non plus des
seules commandes publiques nationales. Un réseau de firmes
succéda, tant pour la recherche que pour la production, à
la polarisation CNET-Alcatel.
En 1996, le parc industriel Pégase comptait 54 PME employant
900 salariés. Deux ans plus tard, 72 entreprises et 1 200 salariés
y étaient recensés. L’ANPE locale avait pour souci,
au cours de ces années, de répondre aux demandes d’embauche
des opérateurs en optique (Lucent Technologies, ex-TRT Philips,
Alcatel Optronics), avec principalement des techniciens, mais aussi
des ingénieurs. En ce qui concerne les start-up, l’exemple
de Highwave Opticals Technologies est révélateur : entreprise
créée en avril 1998 par la reprise d’une usine
Cisco et spécialisée dans les composants optiques, qui
employa près de 1 000 personnes en contrat à durée
indéterminée dans ses sites de Lannion, Trégastel
et Cesson-Sévigné. Une petite société,
Corvis-Algety, essaimée du CNET et intégrée dans
le groupe américain Corvis, employait plus de 300 ingénieurs
et techniciens. Optocom Innovation, créée en 1997 et
rapidement renommée Keopsys, concevait des composants optiques
grâce à une centaine d’employés.
Dans cette phase d’expansion, les entreprises, grandes ou petites,
trouvèrent d’excellentes conditions d’implantation
: ingénieurs formés localement, main-d’œuvre
qualifiée, réseau de communication performant, émulation…
Les PME employaient plus de 2000 personnes à la fin de la décennie
1990 et 20 % des ingénieurs de l’ENSSAT trouvaient un
emploi dans les entreprises du Trégor. La présence des
firmes de renommée mondiale telles que Siemens, Philips et
Lucent Technologies confirmait la capacité du Trégor
à sédimenter les activités pour produire un terreau
favorable à l’innovation. Mais, la nouvelle grande crise
de 2001 a fait resurgir les craintes des licenciements massifs des
années 1980. La perte de 2000 emplois à Lannion, en
deux ans, confirmait largement cette crainte. Toutes ces sociétés
ont été atteintes de plein fouet en 2001 car le segment
optique a été le plus touché . Highwave Opticals
Technologies, avec ses 900 salariés, annonça en juillet
2001, un plan social de 540 suppressions d’emploi. Corvis-Algety,
fabricant de fibres optiques, supprima 137 des 169 emplois de son
usine de Lannion. Keopsys, concepteur et fabricant de composants optiques,
supprima 60 des 90 postes entre septembre 2001 et avril 2002 .
Lucent Technologies réduisit ses effectifs à Lannion
de 200 à 60 techniciens et ingénieurs. De nouvelles
manifestations, regroupant 5 000 personnes le 13 octobre 2001 et 6
000 le 23 novembre 2002, témoignaient de l’inquiétude
de la population. Si certains postes furent un temps conservés,
ils le furent dans le double objectif de maintenir une activité
plus conforme au marché (après l’éclatement
de la « bulle ») et de conserver certains ingénieurs
dans l’hypothèse d’une reprise prochaine des activités.
Espace structuré par les technologies que les chercheurs locaux
mettaient au point, la région de Lannion fut assurément
façonnée à l’image des télécommunications.
Non seulement le rythme social du Trégor suivit celui des innovations
technologiques, avec ses ruptures, ses crises et ses reprises, mais
les solutions proposées pour surmonter les temps difficiles
le furent par des organismes et entreprises du secteur des télécommunications.
Les pouvoirs politiques locaux (commune, département, région)
donnèrent les impulsions nécessaires, coordonnèrent
les actions, gérèrent les crédits à partir
des années 1980. Même si, dans un premier temps, la création
des PME se limita à une simple sous-traitance, les efforts
volontaristes de renouvellement ne furent pas vains. Ce n’est
que depuis une dizaine d’années que cet espace régional,
en raison de la fin de la toute-puissance du CNET, s’inséra
pleinement dans la géographie mondiale de la recherche industrielle.
Trois échelles d’action se sont succédé
dans la construction de cet espace industriel : le cadre national
pour le projet initial de décentralisation et la politique
volontariste d’innovation dans le domaine de la téléphonie,
le cadre régional pour le traitement social de la crise et
la mise en œuvre d’initiatives en faveur des PME, le cadre
international pour l’insertion dans l’espace mondial de
la recherche. Plus qu’une succession, c’est une accumulation
de générations d’entreprises et de technologies
qui densifia l’espace industriel en multipliant les intervenants,
les interlocuteurs, les financements. Bénéficiant toujours
d’une forte attractivité touristique, le Trégor
reste, en ce qui concerne les activités industrielles, singulièrement
marqué par la mono-industrie des télécommunications.
En quarante ans, celle-ci n’a pas disparu mais elle s’est
considérablement complexifiée et a pu, se faisant, se
pérenniser.
sommaire
Retour sur la Fusion d'Alcatel et Lucent, du Rachat
par Nokia
Lors du rachat, la répartition actionnariale était de
60 % pour Alcatel, et de 40 % pour Lucent.
Le rachat est autorisé après de longs examens par les
autorités, notamment américaines, qui donneront leurs
accords (Le Comité américain des investissements étrangers
(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), qui
évalue l'implication des fusions et des acquisitions sur la
sécurité nationale des États-Unis, a examiné
le dossier pendant 75 jours). Concrètement, les deux fabricants
ont décidé que les contrats de Lucent avec les agences
gouvernementales américaines, et les Bell Labs seront détenus
par une filiale américaine séparée, LGS Innovations
LLC, et indépendante, gérée par un conseil d'administration
composé des trois Américains agréés par
le gouvernement.
La direction du groupe est alors confiée à un tandem
franco-américain composé de Serge Tchuruk et Patricia
Russo.
En 2006, Alcatel-Lucent acquiert des activités
3G/UMTS de Nortel.
En 2007, le groupe est secoué par un conflit social majeur
à la suite de l'annonce d'importantes suppressions d'emplois.
La société perd 12 500 emplois sur 79 000.
Des milliers de salariés d'Alcatel-Lucent dont des représentants
des différentes entités européennes sont venus
manifester à Paris le 15 mars 2007 de la place de la Bourse
à la rue de La Boétie, où se situait le siège
de l'entreprise, contre les 12 500 suppressions d'emplois annoncées.
En 2007, Alcatel-Lucent acquiert Tropic Networks, NetDevices, Tamblin
et Thompson Advisory Group. En 2008, il acquiert Motive.
En 2008, Alcatel-Lucent annonce une alliance, vite abandonnée,
avec NEC pour concurrencer Ericsson, Huawei ou ZTE en investissant
dans le développement d'équipements de téléphonie
mobile en technologie LTE.
Devant les mauvais résultats du groupe et une fusion qualifiée
d'échec, Serge Tchuruk et Patricia Russo, en plein conflit
managérial, qui leur a fait prendre avec trop de retard le
virage de la 3G vers la 4G, annoncent leur départ de la tête
du groupe, le 29 juillet 2008.
Alcatel-Lucent est encore bien placé dans les réseaux
fixes (numéro 1 dans l'ADSL et les réseaux optiques)
mais est affaibli dans les domaines en forte croissance des réseaux
mobiles (nouvelles générations 3G et 4G) et les services
Changement de direction suite à mauvais résultats
2008.
En 2008 également, la présidence non-exécutive
est confiée à Philippe Camus (qui est déjà
installé aux États-Unis) et la direction du groupe est
confiée à Ben Verwaayen, ancien directeur général
de British Telecom (en 1997, il était vice-président international,
directeur général adjoint et vice-président du
comité de direction au sein du groupe Lucent Technologies) .
En 2009, Alcatel-Lucent cède sa participation dans Thales à
Dassault Aviation.
En octobre 2009, la société se sépare de 1 000
salariés sur les 10 500 situés en France.
En 2010, avec 15,99 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Alcatel-Lucent
est encore le troisième fournisseur mondial en réseaux
de télécommunications, derrière Ericsson, Huawei
et devant Nokia Siemens Networks.
Les groupes occidentaux ont vu leurs parts de marché en Asie
s'effriter et ont assisté à la montée en puissance
du groupe chinois Huawei sur les marchés émergents et
occidentaux.
En 2011, Alcatel-Lucent cède son activité de centre d’appels
téléphoniques à la société Genesys.
En octobre 2012, elle annonce la suppression de 1 430 emplois en France.
Selon le quotidien Le Monde, la société aurait perdu 800
millions d'euros par an entre 2003 et 2013, ce qui contraint Alcatel-Lucent
à gager ses 29 000 brevets pour obtenir 2 milliards d'euros de
prêts auprès des banques Goldman Sachs et Crédit
suisse. Une décision qui fait craindre au gouvernement français
qu'Alcatel-Lucent ne perde la propriété de ses brevets
estimés à 5 milliards d'euros.
Nouvelle direction et restructuration (avril 2013 à août
2015)
Au mois de février 2013, Alcatel-Lucent annonce le changement
de directeur général et la nomination de Michel Combes29.
Celui-ci prend ses fonctions le 1er avril 2013.
Michel Combes veut repositionner Alcatel-Lucent en un des leaders mondiaux
des télécoms et des réseaux, notamment via ses
activités dans le « cloud computing », l’IP
et le très haut débit (THD) mobile et fixe.
Il décide en juin 2013 de restructurer le groupe par la mise
en œuvre du « plan Shift », pour faire face à
une baisse du chiffre d'affaires depuis 2008 et à un endettement
important à des taux d'intérêt élevés,
dont les échéances de remboursement en capital se rapprochent.
Selon Michel Combes : « Le patriotisme économique n’est
pas un gros mot », « J’ai hérité d’une
entreprise qui était dans une situation de quasi-faillite. Ma
priorité initiale, c’était de rétablir Alcatel-Lucent,
de le remettre dans le jeu ».
En 2013, Alcatel-Lucent signe un accord avec Qualcomm dans le secteur
des small cells.
La même année, Alcatel-Lucent signe un contrat avec Telefónica
pour l’Espagne et avec China Mobile pour la 4G en Chine.
Le 23 décembre 2013, Alcatel-Lucent réintègre le
CAC 40, un an après l'avoir quitté au profit de Gemalto,
et y remplace ST Microelectronics.
Au mois de février 2014, lors du Mobile World Congres, Alcatel
et Intel nouent un partenariat dans le cloud, l’un des axes majeurs
du plan Shift. Cet accord vise notamment à développer
une offre pour servir le marché de l’Internet des objets.
Le 31 mars 2014, Alcatel conclut la vente de la filiale LGS Innovations
LLC à une société américaine détenue
par le groupe Madison Dearborn Partners, pour un prix au comptant de
81 millions d’euros.
En mai 2014, Alcatel cède son entité spécialisée
dans la cybersécurité au groupe Thales, chef de file des
industries liées à la défense. Cette acquisition
s’accompagne d’un partenariat entre les deux groupes.
Au début de l’été Alcatel-Lucent annonce l’ouverture
prochaine d’un nouveau centre de recherche (Bell Labs) à
Tel Aviv, en Israël, centré sur la recherche sur le cloud
et les nouveaux défis de l’évolution des réseaux
de télécommunications.
Le 19 juin 2014, Alcatel-Lucent annonce un partenariat commercial et
technique avec EBlink, une start-up en plein essor dans le domaine du
mobile. Ce partenariat vise à étendre les capacités
du groupe dans les réseaux d'accès mobile très
haut débit 4G LTE et les small cells.
Le 15 avril 2015, Alcatel-Lucent annonce son rachat par le géant
finlandais des télécommunications Nokia, les deux groupes
vont fusionner sous direction Nokia.
Les actionnaires de Nokia détiendront 66,5 % de la nouvelle structure
et ceux d'Alcatel-Lucent 33,5 %. Le siège social sera situé
à Espoo, en Finlande. Le président du conseil d'administration
et le directeur général resteront ceux de Nokia. Le nouvel
ensemble aura près de 120 000 employés pour un chiffre
d'affaires d'environ 25 milliards d'euros. Michel Combes démissionne
à la suite de la négociation de l'accord avec Nokia permettant
à celle-ci d’acquérir Alcatel-Lucent.
Michel Combes explique que les équipes françaises joueront
« un rôle primordial » : « Le pilotage mondial
de l’innovation et de la recherche se fera depuis la France »,
détaille-t-il. « Ce projet va même renforcer l’emploi
en France ». Selon lui, 500 emplois vont être créés
dans la recherche et développement en plus des 2 000 qui existent
déjà en France.
« Face aux marchés concurrents que sont la Chine ou les
États-Unis, la France n'a pas l'envergure suffisante pour s'imposer
sur le plan industriel. Pour Philippe Camus, c'est à l'échelle
européenne que des fleurons industriels peuvent se distinguer.
« Il faut accepter que des champions européens se créent
et ils ne sont pas tous d’origine française. » ».
En 2020, cinq ans après l'acquisition par Nokia, les effectifs
en France sont mis en relation avec le chiffre d'affaires local (5,8
% du CA Mondial) du groupe Nokia et sont réduits d'un tiers par
la suppression de 1233 postes touchant la R&D.
Séparation de la branche Alcatel-Lucent Entreprise
Début octobre 2014, Alcatel-Lucent vend sa division Entreprise,
valorisée à 268 millions d'euros, à China Huaxin,
en conservant 15 % de participation. Cette division devient une société
indépendante sous le nom d'ALE International, mais conserve le
droit d'utiliser le nom Alcatel-Lucent Entreprise jusqu'en 2018 et Alcatel-Lucent
garde des relations privilégiées avec son ancienne filiale.
Plan Shift .
Au mois de juin 2013, Michel Combes présente un plan stratégique
pour sauver Alcatel-Lucent. Ce plan à trois ans comprend plusieurs
volets qui sont détaillés le 8 octobre 2013 par le nouveau
directeur général.
Stratégie : Transformer le généraliste des équipements
de télécommunications en un spécialiste des réseaux
internet, du Cloud et du « très haut débit »
;
Finances : Une économie de 1 Mds € par an d’ici 2015
;
Réorganisation : Une réduction nette de 10 000 postes
dans le monde d’ici fin 2015 (15 000 suppressions de poste sur
72 000 et la promesse de création de 5 000 postes par ailleurs)
fermeture de la moitié des sites existants. Les suppressions
salariales sont de 4 100 personnes en Europe-Afrique-Moyen-Orient, de
3 800 en Asie-Pacifique et de 2 100 en Amérique.
En France, le groupe avait envisagé la suppression
de 900 postes, mais le nombre de postes supprimés devrait s’établir
au-dessous de 700. Par ailleurs, Alcatel-Lucent va se séparer
d'environ 170 ingénieurs travaillant sur la 4G au profit d'Altran.
En France, le plan inclut les fermetures des sites de Toulouse, Rennes
et Orvault, la vente des sites d'Eu en Seine-Maritime et d'Ormes dans
le Loiret, et des investissements à Nozay dans l'Essonne et
à Lannion dans les Côtes-d'Armor.
Dans le cadre du projet de diminution de la dette et de l’extension
de sa maturité, Alcatel-Lucent a engagé au mois de juin
2014 une nouvelle émission d'obligations convertibles. En particulier,
Alcatel-Lucent va rembourser l'emprunt obtenu auprès de Goldman
Sachs et du Crédit Suisse gagé sur ses brevets, ce qui
lui rend un élément de liberté stratégique.
Lors de l’Assemblée générale du groupe qui
s’est tenue le 28 mai 2014, Michel Combes est revenu sur les
premières avancées du plan Shift avec notamment : 363
millions d’euros d’économie en 2013, une amélioration
de 3,9 point de la marge brute et enfin un effort renforcé
au niveau des investissements de R&D sur les technologies d’avenir.
Lors de la polémique sur le départ de
Michel Combes, un inventaire de son action à la tête
d'Alcatel-Lucent permet de dégager les points suivants :
la suppression de 10 000 postes dans le monde (soit 15 % des effectifs)
si l'on tient compte des 5 000 créations de postes promises
;
le cours de bourse a été multiplié par trois,
passant de moins de 1 € à son arrivée à
3 € le 31 août 2015 ;
la direction considère que Michel Combes a permis de sauver
la société de la faillite ;
la purge dans les effectifs a permis le rachat par Nokia pour 15,6
milliards d'euros.
Rachat par Nokia (avril 2015 à octobre 2016)
En avril 2015, Nokia annonce un projet de rachat
d'Alcatel-Lucent. Il se fera par le biais d'échanges d'actions
: 0,55 action Nokia contre 1 action Alcatel-Lucent. Au cours de l'action
Nokia le 15 avril 2015, le groupe Alcatel-Lucent est valorisé
à 15,6 milliards d'euros.
Le 18 novembre 2015, Nokia lance une OPE sur Alcatel-Lucent.
Le 7 janvier 2016, Nokia annonce détenir 76,31 % du capital
d'Alcatel-Lucent. Le 14 janvier 2016, Nokia rouvre son offre sur le
capital d'Alcatel-Lucent jusqu'au 3 février 2016 dans l'objectif
d'acquérir au moins 95 % des actions et de pouvoir retirer
le titre du marché boursier; seulement 91,25 % du capital est
apporté lors de la clôture de cette offre le 5 février
2016.
À la mi-juin 2016, Nokia a acquis plus de 95 % des droits de
vote et du capital, lui permettant d'initier une offre publique de
retrait auprès de l'AMF pour une finalisation prévue
courant octobre 2016. Alcatel-Lucent devient une simple filiale de
Nokia.
Le 2 novembre 2016, l'action d'Alcatel-Lucent est radiée d'Euronext
Paris à la suite de l'offre publique de retrait.
Le 5 février 2019, la filiale française de Nokia Networks
(Alcatel-Lucent International) est fusionnée avec Nokia Solutions
and Networks France et cette dernière est dissoute.
À aucun moment, il n'a été envisagé l'usage
du décret no 2014-479 en date du 16 mai 2014 qui étend,
en particulier, aux télécommunications les pouvoirs
du décret no 2005-1739, donnant la possibilité au gouvernement
de mettre un veto sur des investissements étrangers qui portent
atteintes aux intérêts stratégiques de la France.
En juin 2022, un jugement du tribunal administratif de Paris donne
droit aux représentants syndicaux CFE-CGC et CGT « d'accéder
aux lettres d'engagements négociés avec l'État
français lors du rachat d'Alcatel-Lucent en 2016 » par
Nokia. Ce qui devrait permettre de vérifier les contreparties
sur l'emploi contenues dans l'accord en dépit du secret des
affaires allégué.
Juillet 2022
Alcatel Lucent Enterprise renouvelle son ancrage alsacien
Alcatel Lucent Enterprise a inauguré
son nouveau site de 7 300 m2 au sein du parc d’innovation à
Illkirch-Graffenstaden, dans l’agglomération strasbourgeoise.
La société spécialisée dans les services
et solutions de communication des entreprises renouvelle ainsi son
ancrage historique en Alsace.
sommaire
Plainte d’Alcatel-Lucent contre Microsoft
pour violation de brevets
En 2002 - Lucent Technologies saisit un tribunal d'une plainte contre
des fabricants Dell et Gateway qui, selon ses dires, avec certaines
applications auraient violé des brevets déposés
par son centre de recherche "Bell Labs" en 1994 et 1997,
relatifs à la technologie musicale numérique MP3. Microsoft
se joint à la procédure s'estimant mis en cause du fait
de l'utilisation de MP3 dans son logiciel Windows Media Player.
Novembre 2006 - Alcatel saisit un tribunal au Texas d'une plainte
contre Microsoft qui, selon ses dires, aurait violé sept de
ses brevets. Des négociations sont menées en parallèle
afin de tenter de trouver un accord à l'amiable.
Fin 2006 - Alcatel et Lucent Technologies fusionnent donnant naissance
à Alcatel-Lucent
Janvier 2007 - Devant le tribunal californien, Alcatel-Lucent exige
une réparation de 2 milliards de dollars pour usage non autorisé
d'un brevet ex-Lucent dans le décodeur audio MP3 de Windows
Media Player
Février 2007 - Devant un jury fédéral américain
de San Diego en Californie, Microsoft est reconnu coupable d'avoir
violé les brevets MP3 d'Alcatel-Lucent et est condamné
à verser à l'équipementier franco-américain
des dommages s'élevant à 1,52 milliard de dollars, bien
moins que ce qu'Alcatel-Lucent réclamait dans ses dernières
conclusions (4,5 milliards de dollars). Microsoft indique dans un
communiqué qu'il étudie l'éventualité
de faire appel du jugement. L'éditeur a fait valoir dans sa
défense qu'il avait déjà versé 16 millions
de dollars de droits à l'institut allemand Fraunhofer, «
reconnu par l'industrie comme le détenteur légitime
du brevet ». Selon le secrétaire général
adjoint de Microsoft, cette décision peut conduire à
générer des poursuites contre des centaines d'autres
sociétés qui ont acheté au Fraunhofer le droit
d'utiliser le MP3. Alcatel-Lucent en réponse indique qu'il
n'a pas engagé de procédure contre d'autres sociétés,
sans exclure pour autant cette possibilité à l'avenir.
Le même tribunal doit examiner séparément d'autres
plaintes contre Microsoft relatif à des brevets de codecs pour
la voix et pour la compression de la vidéo, technologies utilisées
de manière illicite par Microsoft, selon les dires d'Alcatel-Lucent,
dans la console de jeux Xbox. À l'inverse, Microsoft poursuit
Alcatel-Lucent dans une affaire relative à ses logiciels de
messagerie unifiée.
Mars 2007 - Le jury fédéral de San Diego rejette la
plainte d'Alcatel-Lucent en estimant que Microsoft n'a pas violé
un brevet de reconnaissance vocale appartenant à l'équipementier
franco-américain. Ce dernier déclare qu'il va faire
appel. Dans l'autre affaire relative au litige sur MP3, Microsoft
décide de faire appel, ce qui suspend tout versement. Par ailleurs,
une plainte déposée en février par Microsoft
contre Alcatel-Lucent pour atteinte au droit des brevets est examinée
par la Commission du commerce international (ITC) des États-Unis.
Certaines technologies d'Alcatel-Lucent sont menacées d’être
interdites à l'importation aux États-Unis.
Mai 2007 - La cour suprême des États-Unis casse un jugement
en appel datant de juillet 2005 et qui donnait raison à AT&T.
Microsoft se voyait reprocher d'avoir incorporé de manière
illicite dans Windows un des brevets de reconnaissance vocale de AT&T.
Ce dernier avait exigé des réparations proportionnellement
aux ventes de Windows aux États-Unis et aussi dans le reste
du monde. Les deux sociétés avaient conclu une entente
pour la partie des ventes aux États-Unis, mais pour la partie
des ventes à l'international ont débattu de leur différend
au niveau de Cour suprême. Cette décision fait jurisprudence
pour tous les produits logiciels exportés hors des États-Unis.
Ceci signifie aussi que Microsoft va probablement s'appuyer sur cette
décision et peut-être gagner en appel contre Alcatel-Lucent
dans l'affaire des brevets relatifs à MP3.
Août 2007 - La décision du tribunal de San Diego de février
2007 condamnant Microsoft à payer 1,5 milliard de dollars d'amende
(affaire des brevets MP3) est annulée par une cour d'appel
californienne.
Décembre 2008 - Alcatel-Lucent et Microsoft ont annoncé
avoir conclu un accord sur l'ensemble des litiges en cours, sauf un,
concernant le brevet « Day »
sommaire
LES OUTILS LOGICIELS
|
L’objectif de cette contribution est de décrire
l’évolution des outils qui ont permis de passer
des instructions écrites par les développeurs
de programmes logiciels aux informations enregistrées
dans les mémoires du commutateur téléphonique
E10 et qui ont permis aussi l’informatisation de la documentation
ou la gestion du matériel.
Pour simplifier la présentation des outils logiciels,
la contribution range les évolutions dans un nombre réduit
de grandes étapes assimilables par un maximum de lecteurs.
1 – Prémices
Avant 1976, la production du logiciel du Commutateur
E10 ne fait pas appel, sauf quelques cas, à un calculateur
central.
On distingue schématiquement :
- Le logiciel du CTI : le développeur perfore
les instructions de son programme sur une machine à perforer
les cartes, puis fait la compilation et l’édition
de liens du programme résultant directement sur la machine
cible 10010 ou MITRA 15 puis MITRA225; la hantise du développeur
est de voir chuter les cartes perforées de son bac ou
même de permuter des cartes qui feront échouer
la compilation ; le logiciel exécutable sort sur ruban
perforé puis sur bande magnétique (la galette)
et est chargé et conservé sur le disque du CTI.
- Le logiciel des Organes de Commande et des Unités
de Raccordement : le développeur code les instructions
de son programme directement en instructions de la machine cible.
Le programme se présente sous forme de diodes soudées
sur une carte « Mémoire-Programme » dans
une matrice lignes/colonnes. Le développeur doit avoir
une connaissance très fine du fonctionnement de la machine.
Les corrections font appel au fer à souder et au multimètre
pour déceler les diodes à l’envers ou les
courts-circuits. La machine ne nécessite pas de chargement
de logiciel ; elle est immédiatement opérationnelle
dès la mise sous tension (plus tard, la technologie évoluant,
les diodes seront
remplacées par des mémoires PROM et REPROM).
- Les cas particuliers : par exemple le calcul des filtres numériques
(reconnaissance des tonalités et de la signalisation
multifréquence entre les
commutateurs) fait appel à un logiciel écrit en
langage FORTRAN. Les données sont portées par
des cartes perforées et traitées la nuit sur le
calculateur du CNET. Plus tard le PDP11 de l’équipe
de test sera également utilisé.
Différents outils et évolutions apparaissent progressivement.
Ainsi :
- En 1974, l’équipe machines de test développe
un traducteur d’instructions de l’ ELS (le processeur
des Unités de Raccordement). Ce programme est écrit
en Fortran et s’exécute sur le PDP11 qui pilote
également le testeur de cartes logiques Oracle. Un ruban
perforé est généré sur PDP11 avec
la description des cartes à diodes MPD2. Ce ruban est
ensuite utilisé comme données d’entrée
:
o du programme de test des cartes MPD (sur Oracle ou Becmad)
o d’un programme qui génère les données
de traçage des « DRM » ; ce DRM faisait partie
du dossier élaboré par le bureau d’études
o de la machine d’aide à l’insertion des diodes
qui était utilisée par la Direction Industrielle.
Il s’agissait d’une table qui venait éclairer
tour à tour les emplacements à équiper
d’une diode. Cette insertion était manuelle.
- A partir de 1974, l’ELS est utilisé également
comme processeur pour les organes de commande dans CITEDIS (commutateur
privé) puis dans E10-B. Le volume du logiciel étant
nettement plus conséquent, il est développé
un langage d’assemblage pour les fonctions de service (une
instruction assembleur pour une instruction ELS) et un macro-langage
pour le traitement d’appel (une macro-instruction générant
plusieurs instructions ELS). Le développeur peut s’affranchir
dans une certaine mesure de la connaissance fine de l’architecture
de la machine et la lecture des programmes est facilitée
par l’utilisation de symboles. Un assembleur et un macro-assembleur
ELS sont développés par l’équipe de
SLE-Citerel à Boulogne. Ces programmes s’exécutent
sur un IRIS80 situé à Boulogne. L’accès
à cette machine se fait via un « terminal lourd
» muni d’un lecteur de cartes perforées et
d’un perforateurde ruban.
- Progressivement les matrices à diodes sont remplacées
par des mémoires REPROM et pendant la mise au point du
logiciel en maquette par des mémoires vives (outil CHARME,
composé des cartes ANG et LIC). La chaine de production
se rapproche de celle du CTI. Le développeur ELS perfore
ses cartes, lance un assemblage au CDC (Centre de Calcul) et
récupère bande et listing.
Mais on a encore gardé l'esprit "diodes", ce
qui fait qu'il n'est pas rare de voir certains faire quelques
« patchs » sur la bande avec la pointe d'un compas
ou d’un fer à souder - crime de lèse-majesté
: ceci ne se fait pas au CTI !!!.
- A partir de 1978, les Unités de Raccordement tournent
sur des microprocesseurs du commerce et le développement
du logiciel se fait sur une machine INTELLECT qui produit un
fichier chargeable sur disquette.
- Plus tard, nous avons connu le support K7 Texas puis les disquettes.
Et enfin la révolution avec l'avènement des PC,
après une courte apparition des MDS en maquette (MDS
d'INTEL, permettant de faire bien plus que les développements
pour les processeurs du même nom!!!)
Le logiciel est en assembleur pour les organes de commande et
les Unités de raccordement et en CPL1 puis en CHILL pour
le CTI à l’occasion du marché chinois en
1986.
Dans cette période, le développeur se déplace
physiquement près de la machine à perforer et
de la machine cible pour le test de son programme.
Les outils de mise au point ont évolué depuis
les fameux pupitres jusqu’aux MDS et PC ; sans compter
les simulateurs d’environnement.
A propos des pupitres, qui ne se souvient du fameux pupitre
ELS ? Le soir, quand la lumière baissait, ces pupitres
faisaient l'admiration des visiteurs, avec leurs centaines de
diodes LED (rouges bien sûr, c'était la seule couleur
existante), qui n'arrêtaient pas de clignoter dans tous
les sens. A cette époque, les traces n'existaient pas
encore, il fallait se satisfaire du "Traceur" et du
"Codeur d'arrêt" offerts par le pupitre. Mais
un metteur au point expérimenté, pouvait se rendre
compte de la bonne marche de son programme, uniquement en voyant
clignoter les LED du pupitre ; cette facilité disparaît
plus tard lors de l’introduction des tests en ligne de
parité de mémoire vive (RAM), tests qui tournent
sans arrêt.
Vers 1976, le site de Lannion est doté d’un calculateur
central IRIS80 placé au rez-de-chaussée du bâtiment
2. La climatisation de la salle fait appel à l’eau
de la « piscine » (le bassin situé au niveau
de l’entrée historique de la SLE entre les bâtiments
1 et 2). De ce fait la température de l’eau de la
piscine s’élève, laissant apparaitre des
algues vertes (tiens déjà !).
Le développeur met ses cartes dans sa case près
du calculateur, un opérateur passe son travail (job)
et le développeur récupère plus tard le
listing et son programme sur bande magnétique.
Plus tard, vers 1980, chaque développeur dispose dans
son bureau d’un terminal sans intelligence (un écran
et un clavier), une console VM/CMS qui lui permet d’écrire
dans un fichier informatique.
A cette époque, la multiplicité des clients et
des variantes de logiciel impose de gérer l’évolution
:
- de la structure du réseau (abonnés isolés,
centre d’affaire),
- des besoins (facilités)
- et l’intégration du traitement des données
Par ailleurs, l’évolution des technologies (intégration
des composants, développement du hardware, séparation
firmware / logiciel, capacités mémoire, performances
des processeurs) d’une part et l’évolution
de la normalisation des télécommunications et
la standardisation des
protocoles d’autre part vont conduire en parallèle
à une évolution de l’architecture matérielle
et à une explosion du volume de logiciel dont les conséquences
directes seront une croissance du nombre de sites de développements
et du nombre de développeurs ainsi qu’une augmentation
du nombre de versions du logiciel à maintenir et traiter
simultanément.
Ces contraintes donnent naissance à deux spécialités
du génie logiciel :
- la gestion de configuration chargée de définir
l’enchaînement et le contenu fonctionnel des versions
- les ateliers de génie logiciel chargés de gérer
les modules logiciels
Nous allons nous intéresser plus particulièrement
aux ateliers de génie logiciel.
2 – L’atelier de génie de Logiciel SDL 1976-1987
Le développement de l’informatique a essentiellement
commencé par la mise au point de machines offrant des
capacités de calcul et de mémoire de plus en plus
importantes (loi de Moore).
Mais le développement du logiciel est resté longtemps
archaïque, sans offre d’atelier intégré
sur le marché.
Les premiers balbutiements de gestion de logiciel ont été
réalisés par l’apparition de la notion d’update,
la saisie étant alors réalisée à
partir de cartes qui avaient la fâcheuse tendance de bourrer
dans les lecteurs ou de se mélanger pendant les transports
et manipulations.
L’update permettait d’identifier les cartes modifiées
et de ne manipuler que celles-ci.
Avec l’update, la notion de patch est apparue, les évolutions
pouvant être réintégrées dans le
source, c'est-à-dire donnant la possibilité de
recréer un nouvel ensemble de cartes mis à jour.
Le passage de la saisie sur cartes perforées à
la saisie par des terminaux, le développement de bibliothèques
de programme et l’arrivée de base de données
ont permis des avancées dans le domaine de la gestion
et ont abouti à la création de réels ateliers
de génie logiciel.
Compte tenu du manque d’offre, des solutions internes ont
été développées.
Un premier atelier de génie de logiciel est développé
en interne et baptisé Système de Développement
de Logiciel (SDL) ; il permet de nommer les modules logiciels,
de leur attribuer une version et de les rattacher à une
arborescence pour qu’ils utilisent les « inclus »
et les outils de génération de code spécifiques
à leur version.
Les messages échangés entre machines sur les bus
de communication du commutateur, jusqu’à cette date
dessinés graphiquement sur du papier, sont alors codés
comme des « inclus ».
Premier atelier CSE, début du CSN :
Ce premier atelier a été développé
sur la base de bibliothèques de programmes, à
chaque version est associée une bibliothèque qui
évolue en numéro d’édition.
La correction d’anomalies et l’introduction d’évolutions
impliquent de gérer en parallèle plusieurs bibliothèques.
La documentation est écrite sous DCF.
Le matériel est géré sous GP.
3 – L’atelier de génie logiciel VM/SE
Le calculateur central devient de plus en plus gros pour répondre
aux besoins des développeurs. L’IRIS80 laisse place
à un IBM dont le volume de mémoire de travail
(RAM), le volume disque et la puissance de calcul (puissance
UC) ne cessent de croître.
Le logiciel de développement des Unités de raccordement
est dorénavant écrit en PLM (le langage de haut
niveau adapté aux microprocesseurs).
Dans cette période, le logiciel du commutateur E10 est
majoritairement en langage évolué ou de haut niveau
(langage CHILL, PLM puis C ...), le logiciel est compilé
et mis au point sur machine hôte, à savoir le calculateur
central.
La plupart des travaux sont possibles depuis le bureau du développeur
à partir de son terminal VM/CMS.
L’environnement de développement, c'est-à-dire
la gestion de configuration logicielle, se fait sous VM/SE VM/SE
(Virtual Machine Software Engineering 1986).
Nota : VM est un OS (Operating System) IBM qui affecte à
chaque utilisateur un espace mémoire, un espace disque
et des ressources UC.
Le premier véritable atelier de génie logiciel
apparaît avec l’abandon des patchs techniques qui
s’avèrent non adaptés lorsque le cycle de
développement s’accélère : le nombre
de patchs à intégrer pour la version suivante
devient important et l’effort nécessaire pour obtenir
un produit stable lors de l’intégration des patchs
devient prohibitif.
La technique de modification du code source et la refabrication
systématique des produits est adoptée.
La maîtrise du logiciel ne signifie pas simplement maîtriser
l’évolution des sources, il est aussi nécessaire
d’y intégrer les outils qui évoluent également
du fait du développement de l’informatique qui introduit
les compilateurs, éditeurs de liens,... nécessaires.
Ceci provoque l’abandon des outils « maison »
et induit, du fait de l’obsolescence plus rapide de ces
produits, des évolutions à prendre en compte.
Certaines versions de ces outils introduisent des incompatibilités
avec les produits fabriqués à l’aide de la
version précédente.
Les outils du commerce ayant une vocation universelle comportent
de nombreuses options allant du format du listing aux options
de génération du code (adressage absolu, relatif
, binaire plus ou moins optimisé, plus ou moins compact,....).
Laisser la maitrise de ces options à chaque développeur
est une source potentielle de problèmes, les différentes
incompatibilités pouvant être découvertes
en phase de fabrication du logiciel, en phase de tests unitaires,
en phase d’intégration, en phase de validation ou
même sur des produits en service.
Le coût de la correction de ces incompatibilités
peut donc s’avérer très important.
La simple taille d’un listing peut varier de 1 à
10 en fonction des options choisies, ceci peut induire des volumes
considérables d’espace disque, surtout lorsque le
nombre d’objets se compte par milliers.
Pour éviter ces sources d’aléas, VM/SE intègre
une notion de procédure de fabrication qui permet à
partir d’un objet A de générer un objet B
en utilisant un outil (compilateur, éditeur, linker,
...) avec un ensemble d’attributs prédéfinis.
Le cycle de vie des logiciels comporte plusieurs étapes:
spécification, codage, fabrication, tests unitaires,
tests d’intégration, de validation. Le logiciel
d’une étape fonctionnelle (palier) est souvent développé
sous forme de plusieurs lots successifs jusqu’à
complétude des fonctions de cette étape. Compte
tenu des volumes logiciels, le nombre de développeurs
est important (il a été au maximum de 400, à
confirmer) et plusieurs développeurs peuvent intervenir
sur un même logiciel. La production du logiciel doit donc
gérer des états de partage et d’avancement.
VM/SE intègre donc un attribut d’état des
objets qui va de la propriété d’un objet
associée à un ou plusieurs individus au partage
des objets.
Le développeur manipule des sources qui sont compilées,
regroupées en modules, eux-mêmes regroupés
en exécutables, puis en archives puis en logiciel chargeable
sur la machine cible.
D’une version à une autre, le nombre de sources
qui sont modifiées pour cause d’évolution
fonctionnelle ou correction d’anomalies est variable.
Compte tenu de la méthode utilisée la version
n+1 comportera x logiciels issus des versions antérieures
et y issus de la version n+1.
La notion de version est associée à la gestion
de configuration qui définit en fonction des évolutions
fonctionnelles et des lots de correction le contenu de ces versions.
En termes VM/SE, la gestion de configuration est associée
aux relations de domaines qui permettent d’hériter
de l’ensemble des modules issus des versions antérieures.
La gestion de configuration et la maîtrise du produit
nécessitent de connaître la liste exhaustive des
composants logiciels du produit.
Pour satisfaire cette exigence, VM/SE est construit autour d’une
base de données relationnelle.
Chaque objet est identifié par :
- son nom
- son genre (associé à la procédure de
fabrication)
- sa version (liée à la gestion de configuration)
- son édition
- son itération
- son état (créé, validé, livré,
intégré, validé, archivé).
Les objets sont : les sources, les binaires, les exécutables,
les archives, les chargeables, les procédures de fabrication.
Un objet peut avoir des attributs (listing, ......) associés
à des genres secondaires.
La base de données relationnelle permet de connaître
tous les composants d’un objet fabriqué via une
procédure de fabrication. En terme VM/SE, il s’agit
de la liste de dépendance d’un produit depuis l’objet
hiérarchique le plus complexe jusqu’au plus simple
:
le code source.
VM/SE intègre également une notion de dépendance
ascendante qui permet d’identifier tous les objets qui
comportent un objet donné.
De même, il est possible d’identifier tous les objets
fabriqués à l’aide d’une procédure
de fabrication.
La construction de ces dépendances s’appuie sur
les relations de domaine.
Ces facilités permettent donc à partir de l’évolution
d’un source d’identifier tous les objets concernés
et le cas échéant de les refabriquer en maîtrisant
leur composition.
VM/SE intègre également des procédures
de livraison qui permettent de partager des sous-ensembles du
produit.
Cette facilité est utilisée pour réaliser
du développement multi-site, l’inconvénient
est que chaque site doit posséder un IBM tournant sous
le système VM.
Enfin VM/SE intègre des facilités d’archivage
et restauration qui permettent le retrait et le rechargement
d’anciennes versions, ce qui optimise la gestion des espaces
disques.
Limites de VM/SE
- VM n’offre pas d’interfaces graphiques, ces interfaces
s’avèrent utiles et nécessaires en particulier
pour les outils de spécification, de tests.
- Les outils de spécification et d’analyse objets
ne sont pas supportés.
- Le raccordement de stations de compilation est laborieux et
les protocoles de gestion de ces stations déportées
sont peu évolués.
- Chaque site de développement doit posséder un
système VM.
4 – L’AGL décentralisé
Pour faire face à l’accroissement du besoin en ressources
informatiques et aussi pour permettre aux développeurs
des Centres Techniques à l’Export (CTE) de produire
leur logiciels, le calculateur central est réduit et
complété par des serveurs de développement.
Leur nombre prolifère: MacroMR commun à Lannion
partagé avec le CTE Inde, MacroMR applications export
à Orvault partagé avec le CTE Pakistan, UTC à
Nantes partagée avec la Roumanie, NA à Lannion
partagée avec Orvault et avec la RSA, Serveur des Essais
de validation,...
Les terminaux des développeurs sont des Workstations
puis des PC standards moins onéreux et plus équipés
en outils informatiques puisque le langage C se généralise
pour le logiciel.
L’architecture matérielle des ressources informatiques
ne résout pas tous les cas d’utilisation car les
conduits informatiques entre la France et les CTE ont un faible
débit, aussi les développeurs des CTE ne travaillent
pas directement dans le serveur cible mais sur une copie locale
dans leur site. Leur production est ensuite rapatriée
dans le serveur dédié en France qui est utilisé
comme source pour les livraisons.
Les logiciels de la NA (Nouvelle Architecture du Traitement
d’Appel) sont écrits en LDS, langage graphique,
qui est transformé en instructions par l’outil informatique
GEODE pour donner du LDS PR, transformé à son
tour par l’outil informatique SOLANGE pour donner un source
en langage C.
L’environnement de développement, c'est-à-dire
la gestion de configuration logicielle se fait sous BENCHCOM.
Pendant longtemps, jusqu’en 2000, les livraisons conduisent
le développeur à porter son logiciel sur une bande
magnétique jusqu’au CTI ou à l’OM qui
le charge dans le commutateur.
La documentation est écrite en DCF et centralisée
sous VIDOC.
Pour pallier ces contraintes et faire face au nombre croissant
de sites de développement (Lannion, Nantes, Vélizy,
Afrique du Sud, Roumanie, Inde, Vietnam), la création
d’un nouvel atelier de génie logiciel fonctionnant
sous Unix et sur des stations de travail est lancée.
Les avantages de cet atelier sont :
- La prise en compte du mode graphique
- La disponibilité des ressources UC, disque et mémoire
sur chaque poste de travail
- La disponibilité des outils sous Unix
- La facilité d’équipements de nouveaux centres
de développement qui ne nécessitent qu’un
serveur et quelques stations de travail.
- La prise en compte du développement des réseaux.
Le système choisi est le système Unix AIX d’IBM
qui fonctionne sur des stations RS6000.
Le nouvel atelier de génie logiciel se nomme X/SE (1995
à consolider)
X/SE comporte les mêmes fonctionnalités que VM/SE,
bénéficie des avantages du « downsizing
» qui permet de s’adapter facilement aux évolutions
des équipes de développement et aux besoins en
espace disque et puissance.
Faute de crédits, X/SE s’avèrera être
un simple portage de VM/SE du monde VM au monde UNIX. X/SE ne
bénéficiera pas de toutes les capacités
offertes par UNIX, ni de celles offertes par l’évolution
des bases de données relationnelles
Les inconvénients de X/SE sont :
- Le rythme d’évolution des matériels, des
outils
- La gestion du parc des stations de travail, le coût
de ces dernières.
Suite à un choix basé sur des questions de coûts
des stations de travail développeurs, celles-ci seront
abandonnées et remplacées par des PC fonctionnant
sous Windows NT, puis XP.
Les PC sous Windows ne supportant pas tous les outils, des stations
UNIX dédiées seront conservées.
Faute de financement et de volonté et du fait de l’évolution
d’Alcatel, X/SE qui sera resté un produit maison
CIT, sera abandonné au profit d’un outil du commerce
ClearCase.
Malgré le nombre d’objets (plusieurs millions),
le volume et le nombre de relations de la base de données,
les espaces disques VM/SE et X/SE ont été des
outils robustes et fiables qui ont supporté sans difficulté
les évolutions de système et l’augmentation
du nombre de développeurs.
5 – L’atelier de génie de Logiciel Clearcase
La première activité du E10 à utiliser
Clearcase est l’écriture des essais automatiques.
Le langage JAVA ou UML est utilisé pour le DHA et pour
le logiciel SMB de gestion des serveurs INCS2.
L’environnement de développement, c'est-à-dire
la gestion de configuration logicielle se fait sous Clearcase.
Dans cette période, un effort est fait pour introduire
du langage orienté objet dans le logiciel du commutateur
E10.
6 – Conclusion
Voilà dans quel environnement sont nées les 5
millions de ligne source (hors commentaires) qui rendaient les
commutateurs E10 aptes à servir les besoins téléphoniques
des abonnés dans différents pays du monde en mi
2004.
Les serveurs de développement étaient un premier
pas vers les serveurs HTTP du Web du monde Internet où
les langages PHP, bases de données MySQL ont pris le
relais des premiers langages évolués.
|
sommaire
ALCATEL SOUS UN AUTRE ANGLE
Pierre Le Dantec dans un document "La réalisation
de contrats" nous résume dans la suite de cette page,
presque vingt années d’aventures avec les équipes
de réalisations export d’ALCATEL.
En 1988, nous (les équipes d'Alcatel) avions déjà
travaillé dans environ 80 pays….
J’ai cité certaines personnes. Il aurait fallu citer tout
le monde. Que ceux qui ne se trouvent pas nommés dans ce récit
veuillent bien me pardonner.
Je crois avoir toujours rencontré, chez tous ceux que j’ai
eu l’honneur de diriger, une réelle bonne volonté.
Chaque fois que j’ai dû faire appel à tel ou tel
en particulier, j’ai toujours eu la réponse que j’attendais.
Je voudrais, ici, puisque l’occasion m’en est donnée,
remercier du fond du coeur tous ceux et toutes celles qui ont travaillé
avec moi.
Je ne peux pas clore cette brève évocation de mes années
de “réalisateur”sans exprimer également mes
sincères remerciements à F. Tallégas qui, tout
en nous laissant une grande liberté, n'a jamais manqué
de nous soutenir.
Il était temps pour moi de dire merci,… il n’aura
échappé à personne que beaucoup de ceux que j'ai
cités nous ont déjà quittés. C’est
à eux que vont mes dernières pensées dans cette
évocation de la magnifique histoire des équipes de réalisations
export du Trégor, comme de Vélizy.
Bien d’autres évènements ont encore touchés
les “réalisateurs” jusqu’à ce jour, je
compte sur mes successeurs, ou d’autres, pour les évoquer.
Il existe encore, grâce à Dieu, de nombreuses fonctions,
nées du temps de D.R.C. et de D.R.EX, abritées à
Lannion, c’est aussi sans doute grâce aux efforts auxquels
nous avons tous participé.
P. Le Dantec
La SLE-CITEREL est créée en octobre 1972
par la fusion de la SLE (66%) et de la CITEREL (33%), elle-même
filiale commune de CIT-Alcatel et de Ericsson Electronique. La nouvelle
société comporte 2 établissements, celui de Lannion
et celui de Boulogne-Billancourt qui se
consacre au développement du E12, système temporel qui
équipera quelques centres de transit. L'effectif de Lannion
est de 640 personnes en 1972, 880 personnes en 1973, 1000 personnes
en 1974 et 1200 personnes en 1977. Le rythme des nouvelles embauches
est important.
La SLE-Citerel fonde l’usine pilote pour les
équipements E 10 en dehors de Lannion, mais pas très
loin à une quinzaine de kilomètres à Tréguier,
en fonction de sollicitations du député local.
Des commandes à l’exportation interviennent très
tôt, ce que n’avait jamais obtenu la CIT. En 1977, lors
de l’intégration de la SLE dans la CIT la part des exportations
atteint déjà 23 % de la vente totale de centraux E10.
La SLE est amenée dès 1974 à faire son apprentissage
pour l’exportation.
De façon un peu inattendue, la SLE obtient rapidement un contrat
de la part de la Pologne consistant d’abord dans la livraison
d’un central E10 et son installation dans la banlieue de Varsovie
et ensuite d’un transfert technologique vers l’usine de
Poznan de la société polonaise Télétra,
organisée sur le modèle de l’usine de Tréguier.
Le second contrat concerne la fourniture d’un central E10 à
Alexandrie en Egypte. Ce contrat est réalisé en trois
mois vers 1977 avec le soutien de la DGT.
ommaire
1975, une année de transition
En 1975, il apparaît que l’aventure numérique va
bouleverser en profondeur les télécommunications françaises
d’abord, et sans doute celles des autres pays. Trois évènements
peuvent en témoigner: la commande du commutateur nodal de Rennes,
la mise en service du commutateur de transit des Tuileries et le contrat
Pologne.
Le Nodal de Rennes (commutateur de transit urbain, avec
des abonnés -1975)
La D.R.T. de Rennes, notre fidèle alliée, a décidé
la création d’un nodal E10A. Pour éviter la pose
de nouveaux câbles, elle a prévu de numériser
la totalité des liaisons avec les commutateurs de l’agglomération
(ce qui permet de multiplier par trente la capacité des cables).
Un matin, je reçois un coup de fil de D. Goby, un ancien du
C.N.E.T. Lannion, pour m’annoncer qu’il a fait ses comptes
et que les économies sur la partie transmission, grâce
à la numérisation, compensent le surcoût de la
partie proprement commutation. C’est la première fois
que E10 rivalise en prix avec l’électromécanique,
et devient un vrai concurrent des anciennes technologies.
Le commutateur de Transit des Tuileries (1974-1976)
Oui mais, comment ces nouveaux commutateurs vont-ils se comporter
dans un environnement complexe, celui d’une grande ville, Paris
par exemple ? Pour répondre à cette question, la D.G.T.
nous attribue un commutateur de transit E10 (trois commutateurs pour
les circuits arrivée et trois pour les circuits départ).
Il se situe aux Tuileries, côté Seine, en relation avec
la totalité des commutateurs de la région parisienne.
Certains disent : “c’est un piège !” Sinon un
piège, c’est sûrement un test ! Qu’est donc
cette S.L.E., toute petite société bretonne, avec ce
produit pour le moins innovant ? Pour le savoir, Gérard Théry,
le nouveau directeur régional de Paris intra-muros, (futur
D.G.T.) nous invite aux Tuileries et
nous présente le complexe téléphonique enterré
sous les jardins: impressionnant, un hectare de téléphone
sur deux étages, équipé essentiellement en technologie
électromécanique Pentaconta, dont un commutateur de
transit destiné, entre autres fonctions, à nous suppléer
en cas d’échec….voilà qui rassure !
Où peut bien se situer le piège ? Nous ne tardons pas
à le savoir. Le réseau parisien est, à cette
époque, constitué de commutateurs électromécaniques
de nombreux types: Pentaconta, Rotary7A,7B1, R6 et même Strowger…Chaque
central est géré par des équipes de commutants
qui établissent les circuits nécessaires entre deux
commutateurs, au fur et à mesure des besoins, donc depuis de
nombreuses années. Les liaisons ne fonctionnent pas toujours
à la première tentative, et, parfois, une panne nécessite
de changer un joncteur. Les techniciens ont donc l’habitude de
«torturer» un peu les lames des relais pour arriver au
bon fonctionnement. Il y a bien des tolérances sur le papier,
mais on
en sort fréquemment, sans rien en dire, pourvu que «ça
marche». E10 gère ses joncteurs au moyen de logiciels
communs à tous les circuits de même type, basés
sur les tolérances théoriques. Nous nous trouvons donc
devant la perspective de devoir faire modifier les réglages
d’un grand nombre des circuits qui transitent dans Paris. Il
faut faire sortir de leurs habitudes, et de leur quiétude,
des centaines de personnes, afin qu’elles interviennent sur des
organes qui, pour elles, fonctionnent parfaitement. Nous risquons
une «révolte anti-E10» des commutants !
Nous réussissons à faire notre allié du chef
de centre de Bonne Nouvelle. Bonne Nouvelle est alors le plus gros
centre parisien, fait autorité dans le réseau, et possède
la majorité des Edition types de commutateurs. Nous nous mettons
d’accord pour débuter nos mises au point exclusivement
avec ce centre, dont le responsable accepte de sensibiliser son personnel
à la nécessité de faire un petit effort. Cette
étape franchie avec succès, il est facile de répondre,
le cas échéant, aux interlocuteurs des autres centres:
«mais ça marche avec Bonne Nouvelle !». Cette petite
manoeuvre nous permet de passer les tests avec succès.
Nous commençons, aux Tuileries, à élargir le
panel de nos clients; c’est ainsi qu’il nous faut avoir
l’accord de l’architecte en chef du musée du Louvre
sur la couleur des faux planchers, nous devons accepter un beau vert
émeraude granité, ce, sans supplément de prix
!
Le Contrat Pologne (1974-1976)
Nous nous retrouvons à la fois compétitifs et performants
dans un réseau complexe, nous sommes donc capables d’affronter
les difficultés de l’export. C’est en tout cas l’opinion
des polonais dont la société Télétra,
de Poznan, signe notre premier contrat de transfert de technologie.
Quel est le rôle de D.R.C. dans cette affaire ?
Dans le contrat Pologne figure la fourniture, l’installation
et la mise en service du central de Vinogrady, un faubourg de Varsovie.
C’est un succès.
De même que la Direction Industrielle, nous devons, nous aussi,
livrer nos méthodes, nos listes d’outillages, nos coûts
prévisionnels d’ingénierie, de plate-forme et de
chantier et les moyens de les calculer , la documentation chantier,
celle du futur client, donc d‘exploitation et de maintenance.
Il faut mettre un peu d’ordre !
C’est à cette époque que nous commençons
à définir, puis à utiliser, avant de les exporter,
les fiches de configuration. Elles précisent la composition
de chaque baie, et ses différentes modularités. Elles
permettent une simplification importante dans les activités
projets, lancements en production et chiffrages de toutes sortes.Nous
prenons la décision de détacher à Poznan un de
nos meilleurs spécialistes de la plateforme, M Pensec. Il revient,
quelques mois plus tard, avec une médaille du type «meilleur
ouvrier communiste» qui lui confère le droit de rentrer
dans l’usine de Télétra sans contrôle. Il
revient aussi avec une solide expérience de la vie dans les
démocraties populaires. Tout se passe bien; nous aurons même
la joie, en 1990, de renouer avec Télétra des relations
très amicales à l’occasion d’un nouveau contrat
de cession de licence.
Evidemment, la conséquence la plus spectaculaire de ce contrat
Pologne est la création à Minihy-Tréguier de
l’unité de production de Convenant Vraz, inaugurée
le 19/06/75, elle est le clone de ce que nous devons réaliser
en Pologne. Le D.R.C. héritera un peu plus tard de ses bâtiments
et nous en reparlerons .
L’activité export démarre très fort, cette
même année 1975. Avec ce contrat Pologne, il faut aussi
nous préparer à l’installation des commutateurs
de Malte et de Fez que nous devons mettre en service, l’année
suivante. C’est un peu avant cette époque que se constitue
le Groupe des Projets Techniques (G.P.T.), sous la direction de J.
Nutall puis de J.C. Hue. (groupe avec lequel nous aurons de fréquents
contacts, puisque la Direction nous demandera, sagement, de valider
les estimations de G.P.T. concernant nos propres prestations). Nous
élaborerons ensemble des règles de dimensionnement,
qui seront régulièrement révisées.
De nouveaux problèmes surgissent: outre les questions liées
aux méthodes de mises en service, que nous avons évoquées
plus haut, il faut définir des emballages résistants,
se préoccuper des questions liées aux douanes tant françaises
qu’étrangères, (nous découvrons par exemple
qu‘il est interdit d‘importer des chiffons au Maroc). Nous
devons définir des lots de maintenance, pour nos clients et
pour nos chantiers. Nous évitons au
mieux les retours, même sous douanes (ce qui impose un atelier
ouvert aux contrôles douaniers). Nous mettons au point avec
les douanes des procédures d’échange standard,
car les colis doivent avoir les mêmes contenus à chacun
des passages en douanes.
Les relations avec le personnel des clients
Nous avons également à faire face à la formation
du personnel client, domaine nouveau, qui ne se pose pas avec les
télécommunications françaises, qui sont parfaitement
organisées à cet égard.
Bien entendu, tout commence par la formation théorique, qui
est dispensée par les soins de F. Jollé, recruté
à cette fin, avec le concours de M. Menez. La S.L.E. loue des
locaux tout à fait appropriés: ceux de l’ancien
hospice des vieillards de Tréguier, autrefois tenu par des
religieuses, qui ont laissé quelques porte-manteaux faits de
tibias humains fichés dans le mur du vestiaire. Voilà
qui incite au sérieux…..
La formation pratique se fait ensuite sur les sites. Nous ne sommes
pas des exploitants, notre expérience d’opérateur
se limite à celle du personnel du service chantier. En faisant
participer le personnel du client aux essais de mises en service,
nous réussissons néanmoins à le décomplexer
devant des matériels tout nouveaux. Il faut à tout prix
que leur "entraînement" soit suffisant pour éviter
la panique qui peut saisir tel ou tel de ces
techniciens clients devant une panne; surtout s’ils sont dirigés
par des chefs terrorisés à l'idée qu'un ministre
ne soit mis au courant d’un problème.
Des relations s’établissent entre les techniciens S.L.E.
et le personnel d’exploitation des clients. Très rapidement
l’idée germe du dépannage par téléphone.
C’est pour le personnel exploitant une bouée de sauvetage
essentielle, d‘autant qu’il peut obtenir quelqu’un
de confiance et qu’il connaît. C’est l’origine
du service de télé-assistance, créé à
côté des maquettes, sur lequel nous reviendrons. Il implique
l’obligation d’astreintes à domicile permettant de
répondre 24 heures sur 24 à toute demande.
La Documentation
La documentation prévue par l’administration française
est considérable, (la C.I.T. est, à cette époque,
le premier imprimeur de France). Nous appliquant les règles
de l’électromécanique, la D.G.T. nous impose de
livrer, en trois exemplaires, tout ce qui peut être nécessaire
pour faire modifier, par le personnel d’exploitation, supposé
compétent, aussi bien le matériel que le logiciel.
Cette documentation gigantesque est exclusivement descriptive et n’a
que peu d’intérêt pour l‘exploitant. Ce dernier
a surtout besoin d‘un genre de mode d’emploi, que nous avons
mis au point sous la forme des «fiches opérateurs»:
une opération par fiche, par exemple: comment créer
un nouvel abonné ? Il n’est pas question, en tout cas,
de livrer à l’export le modèle «type Administration».
Cette dernière résout le problème «mode
d’emploi» par le biais de sa formation E10, qui n’est
pas accessible à nos clients. Notre documentation, à
base de fiches d’opérateurs, est aussi simple et didactique
que possible et bien adaptée au produit et à sa mise
en oeuvre.(plus tard elle sera livrée avec le logiciel du centre
de Traitement des Informations, C.T.I.). C’est d’ailleurs
cette documentation que nous finirons par livrer à l’administration
française quand elle sera convaincue de l’utilité
de notre méthode; (après Bourg en Bresse).
Il nous faut aussi traduire en anglais ces documents, (et les présenter
de même sur le C.T.I.). Petit problème, peuvent penser
certains, mais assez vite nous nous rendons compte que notre propre
vocabulaire français n’est ni constant ni précis
et que selon l’origine des documents, le même mot ne signifie
pas tout à fait la même chose. Il faut pourtant se faire
comprendre ! Nous allons traîner ce boulet longtemps, même
après que l’on aura confié le problème à
un anglophone de naissance.
sommaire
Les Douanes
Les relations avec les douanes se passent de la meilleure façon.
Nous choisissons un transitaire en douanes paimpolais: l’Agence
Maritime de l’Ouest (dont le fondateur a été, avant
la guerre de 1914, le grand père de L. Le Merdy). C’est
tout naturellement que les déclarations, pour le
matériel client comme pour nos outillages, se passent à
Paimpol. Les affaires export ayant pris un peu plus tard de l’importance,
nous sommes devenus, et de loin, le principal «client»
de ce bureau des douanes de Paimpol. Même lorsque le matériel
partira directement, nos déclarations continueront à
se faire à Paimpol. Nous y avons intérêt, (puisque
les contrôles se font sur papier), et les douaniers paimpolais
aussi, puisque leur avancement se fait sur place, la hiérarchie
et l’effectif d’un bureau de douanes étant fonction
du chiffre d’affaires qui y transitent. Ce sont les douaniers
de Saint-Brieuc qui sont jaloux ! Nous avons, par ailleurs, eu, un
peu plus tard, quelques difficultés avec les spécialistes
en douanes de la C.I.T., qui ne comprennent pas que nous ne passions
pas par Roissy !
Les conditions d’expatriation
Il faut, aussi, définir les conditions de départ du
personnel à l’étranger, comment se loger ? se nourrir
? se préoccuper des familles, de l’école française
pour les enfants, définir les indemnités, les sursalaires,
trouver des règles pour chaque cas . Peu à peu, au sein
du service chantier, se constitue une cellule qui se spécialise
dans ces tâches. Je ne parle pas de la nécessité
de susciter des volontariats !
F.X. Montjean fait venir J. L’Huillier qu’il a connu à
la C.G.A. et qui a un peu l’expérience de l’export
(il a dirigé le chantier du centre de tri postal de Mexico).
Il prend la direction du service chantier et son expérience
dans la gestion des expatriés nous est très utile. Plus
tard, nous comprendrons qu’il faut nous coordonner sur cette
question avec Vélizy et avec le département Transmission;
les décisions se prendront alors en réunion au siège,
rue Emeriau.
Le passage cadre
L’évolution des carrières, notamment celles des
collaborateurs, nous préoccupe.
L’établissement de Lannion organise, pour la première
fois, un examen de passage cadre.
Un programme est défini, une période de préparation
fixée, un appel aux candidats émis. Chacun s’attendait
à une victoire écrasante des agents des équipes
de développement. Surprise, c’est un collaborateur de
D.R.C. qui arrive en tête (il est vite récupéré
par les équipes de développement logiciel). Chaque année,
un examen analogue sera organisé. Quand nous serons à
Minihy-Tréguier, je n’imposerai aux candidats que des
épreuves de français tant il me paraît important
pour un cadre de savoir rédiger et exposer clairement ce qu’il
pense, tandis que les connaissances techniques sont déjà
largement développées par le simple fait de l‘activité
quotidienne. Chaque année quelques agents techniques accéderont
ainsi au statut de cadre.
Mais cette année 75 nous réservait encore deux surprises,
l’évolution et les velléités de notre principal
client et celles de notre maison mère.
Diviser pour régner ?
Comment l’Administration va-t-elle gérer ce nouveau système,
alors que la décision d'arrêter les créations
de commutateurs électromécaniques est prise discrètement
? Il faut, pour éviter des problèmes, sociaux notamment,
que d'autres sociétés de l’industrie française
des télécommunications soient associées à
l’aventure. C’est ainsi que la décision est prise
de confier le développement et la fabrication d’équipements
d’abonnés (E.M.A.) à l’A.O.I.P. Il nous faut
donc gérer ce pseudo sous-traitant. L’Administration a
en effet décrété que nous sommes les «ensembliers»,
responsables des marchés. Nous devons associer les nouveaux
venus aux prévisions de charges, à nos méthodes
de gestion, les informer sur les méthodes concernant les O.C.s,
et surveiller de près l’avancement de leur fabrication.
Cela nécessite de nombreux contacts avec l’A.O.I.P., auxquels
participe bientôt la C.I.T.
Dans le même esprit, il est question de confier à la
S.A.T. la production des groupes de gestion de multiplex; ce projet
n’ira pas jusqu’à son terme. Les ateliers de l’Administration,
(la D.C.M.E.), décident d’installer eux mêmes des
unités de raccordement d’abonnés, en commençant
par quelques satellites d'extension….. Cette volonté dure
quelques mois avant de s’éteindre, elle aussi. On craint,
pendant un moment, qu’il n’y ait pas assez de travail pour
tout le monde.
A l'inverse, la S.L.E., souhaite évidemment posséder
la maîtrise de tous les aspects du système, condition
indispensable à sa crédibilité à l’export.
La bataille dure jusqu’à l’apparition de notre C.S.E.,
développé entièrement sur fonds propres et mis
au point bien avant les E.M.A.. Cette provocation réussie met
fin à la question, en entrainant la disparition de l’A.O.I.P.
de notre secteur d’activité, et le rachat de l‘usine
de Guingamp.
Enfin, devant le succès de E10 et du Citédis, l’Administration
se met en tête de nous faire réaliser un Centrex: Colisée,
un genre nouveau, mi-privé, mi-public, installé dans
une tour, il pouvait à la fois jouer le rôle d’un
central public et avoir les fonctions d’un central privé
desservant plusieurs sociétés. Cela nous prend beaucoup
de temps, pour seulement deux ou trois exemplaires.
sommaire
La CIT-ALCATEL, En Juillet 1977, la CIT-Alcatel absorbe
la SLE-CITEREL (après s'être éloignée de
EricssonFrance).
Le développement logiciel du produit qui devient E10 Niveau
3 ou E10A est transféré à Vélizy, siège
de la CIT commutation.
En 1978, la CIT-Alcatel emploie 1100 personnes à Lannion. La
fusion avec la CIT et le volume croissant des fabrications provoquent
des modifications dans les activités du site de Lannion, comme
la fabrication des circuits imprimés sous-traitée désormais
à l'établissement CIT de Coutances. Les convertisseurs
d'énergie sont bientôt achetés à des sociétés
extérieures. Il s'ensuit le départ des spécialistes
concernés. Les
calculateurs 10010, supports des CTI, sont achetés à
CIT Transmission puis remplacés par des MITRA achetés
à la SEMS.
Les premières fusions
Notre maison mère prend conscience aussi, cette année
là, qu’il va falloir tenir compte de la situation nouvelle
qu’engendre le succès du E10.
Dans un premier temps, une première fusion nous concerne. Celle
avec la CITEREL, filiale commune de C.I.T. et d’Ericsson France
(1975) qui travaille sur un projet de commutateur numériques
E12.
|
E12 (abréviation
pour Électronique projet n°12)
(licence Alcatel époque CGE) C'est un autre système
dérivé aussi du prototype PLATON. Temporel de
seconde génération, de capacité double
que les Commutateurs E10N3 de la même époque..
Le système E12 est mis en étude à partir
de 1971 par le biais de la création d’une filiale
commune CITEREL entre CIT-Alcatel et Ericsson-France. L'ambition
de départ des ingénieurs était de constituer
un Commutateur dont l'organe central de calcul pourrait fonctionner
entre 40 et 50 années sans jamais s'arrêter d'assurer
son service. Hélas, les effectifs des équipes
chargées de concevoir ce système n'étaient
pas assez nombreux et le projet prit trop de retard et fut doublé
par d'autres systèmes.
Le système E12 devait constituer le premier « réseau
intelligent » et offrir des services améliorés
par rapport à tout ce qui se faisait jusques alors. Tout
système E12 pourrait être utilisé en Commutateur
d'abonnés où il serait capable de gérer
50.000 abonnés par cœur de chaîne, mais cet
usage n’est finalement pas retenu, au profit de la famille
E10 puis MT25. Le système E12 est
utilisé en Centre de Transit Interburbain (E12CTI) où
il est capable de gérer jusqu'à 49.552 circuits
de transit par cœur de chaîne. Deux Commutateurs
de transit E12 ont en outre été reconvertis et
utilisés pour les numéros Libre Appel dès
1985 (les numéros verts / appels gratuits) puis deux
autres pour la Carte Pastel dès le début 1989.
(Ce que l'on nommera le Réseau Intelligent).
|
Ces commutateurs sont devenus les centres de transit
de l‘Administration.
Nous devenons la S.L.E.-CITEREL, dotée d’un établissement
à Boulogne, dans lequel le D.R.C. a bientôt une base arrière
(à moins que ce ne soit une base avancée).
Nous sommes donc, à cette époque, également un
petit peu Ericsson-France. Comment refuser à cette dernière
le droit de fabriquer quelques unités de raccordement d'abonnés
?
Voilà donc encore un fournisseur de plus ! Nous allons à
Cergy-Pontoise, dans l’usine Ericsson pour juger de la qualité
des productions et aussi pour leur faire part de nos méthodes
de mises au point.
Cette phase est très courte, car rattrapée par la suivante:
celle de la fusion S.L.E.-CITEREL avec la C.I.T., ce qui implique, bien
entendu, le rachat par C.I.T. de la part d’Ericsson dans l’ensemble
S.L.E.-CITEREL et l’abandon des velléités des suédois
de participer au programme E10 via Ericsson-France.
La fusion de C.I.T. avec la S.L.E.-CITEREL est préparée
très soigneusement par notre maison mère. Tout d’abord
il s’agit, pour C.I.T., de prendre connaissance du produit et de
bien maîtriser toutes les phases de son élaboration: toute
la C.I.T. retourne à l’école. C’est, en 1976,
notre second transfert de technologie. C.I.T. embauche, de jeunes directeurs
animent la «task-force» chargée de réussir
l’introduction de ce nouveau système dans la vieille maison.
Des objectifs sont fixés: la production et la mise en service
d’une maquette, puis celle d’un premier central à Barentin,
en Normandie (mis en service en 1976). Pour que les équipes fassent
plus ample connaissance, C.I.T. organise de grandes agapes de
séduction, une quinzaine de cadres, parmi les responsables de
D.R.C., est invitée à visiter l’usine électromécanique
de La Rochelle, la première que beaucoup d’entre-nous découvrent.
Ensuite, un grand déjeuner précède la visite du
central E10 de Poitiers, que nous avons restauré, après
que C.I.T. nous eut épaulé, comme je l’ai expliqué
plus haut.
Que pouvait bien signifier une telle prévenance ? Peut-on penser
qu’à cette époque, C.I.T. envisage la fusion des
équipes de réalisation ? Je le crois personnellement,
d’autant que chacun sent bien alors que, la fusion faite, il est
bien difficile de laisser coexister deux équipes de réalisation.
Comme nous allons le voir, l’export va nous permettre de sauvegarder
notre indépendance et notre présence à Lannion.
En attendant, nous nous partageons, avec C.I.T., les marchés
E10 de l’administration française, la part de la C.I.T.
prenant de l’ampleur, la nôtre restant à peu près
constante.
Nous conservons, bien sûr, tous les prototypes et l’export,
(affaires difficiles), que notre organisation et notre appartenance
à la Direction Technique nous permettent de traiter convenablement.
(du reste C.I.T. a assez peu d'expérience à l'export,
certaines ont laissé un mauvais souvenir, notamment aux financiers
du groupe).
C.I.T. nous ouvre son entrepôt de Cosne-sur-Loire; nous y déposons
notre matériel et nos outillages, quand les surfaces disponibles
se font rares dans le Trégor. C’est aussi la région
du Sancerre; certains mettent cette opportunité à profit,
suivant en cela l’exemple deséquipes C.I.T..
La S.L.E.-CITEREL a de plus en plus d'ambitions à l‘export,
elle se constitue une direction commerciale export (D.EX) dont L.Companyo
prend la tête. Cette nouvelle direction a en charge les prospections
commerciales, la gestion des réseaux et des agents, les questions
financières dont, en particulier, le recouvrement des factures.
D.R.C. a doncbeaucoup de relations avec cette nouvelle direction qui
trouve à s’abriter dans les locaux ex-CITEREL de Boulogne.
Alexandrie
Une des premières conséquences des efforts de la S.L.E.
à l'export est l’obtention du contrat d’Alexandrie,
notre premier «coup de poing» ! Il s’agit, en effet,
de mettre en service ce commutateur égyptien en trois mois,
condition impérative. Nous avons évidemment donné
notre accord à ce délai ultracourt. Le matériel
est prélevé sur des affaires qui perdent leur rang dans
le planning de sortie de fabrication, sans conséquence visible
pour leur client destinataire. Une équipe est spécialement
montée: suivant immédiatement les installations et les
câbleurs, les techniciens de mise au point sont accompagnés
par le personnel de développement des spécificités
égyptiennes; plus tard nous appellerons cela les «customer’s
applications». Quelques modifications sur les programmes du
multienregistreur, du traducteur…, mais surtout sur la signalisation
sont nécessaires, sans oublier les Groupes d’Adaptation
de Signalisation, les fameux “GAS”.
Le maximum des mises au point est exécuté sur place,
donc immédiatement testé et corrigé, si nécessaire
(le Circus, notre enregistreur-simulateur «maison»
de signalisation téléphonique, nous aide beaucoup).
Cela évite maints allers et retours, donne le goût des
chantiers export à certains «développeurs»
qui y continueront leur carrière. Trois mois plus tard, nous
mettons en service. Le jour de l’inauguration, G.Pébereau,
à l’époque Directeur Général du groupe,
qui s’est déplacé, nous avoue qu’il ne nous
avait pas cru capables de tenir notre pari. Ce jour là, nous
avons acquis une bonne position pour participer au développement
du réseau égyptien.
Malheureusement, l’aventure d’Alexandrie se paie aussi par
la noyade d’un jeune ingénieur de l’ingénierie:
P. Auzou. Sur une plage dangereuse de l’ouest de la ville, des
rouleaux l’emportent au large d’où, malgré
ses qualités de nageur, il ne peut revenir. Il n’est pas
seul dans cette baignade, deux ou trois autres ont eu plus de chance.
Ce décès dû à l’absence de signalisation,
sauf en arabe, sur cette plage, nous affecte tous profondément
et nous sommes nombreux à ses obsèques à Morlaix.
L'enregistreur-simulateur CIRCUS
Dans ce cas, la signalisation entre E10 et le commutateur adjacent
est portée par l’IT16 du MIC. Le transcodage de la
signalisation dans le commutateur E10 est fait en partie dans
les GAS dont l’objectif est de réduire le nombre de
variantes de signalisation dans le commutateur E10.
Pour valider les GAS mais aussi la réalisation des protocoles
de signalisations et des compléments de service dans le
commutateur, un simulateur est développé par Alcatel-CIT
sous le nom de CIRCUS .
Le CIRCUS est très vite opérationnel :
- pour la simulation d’un appel dès le E10 niveau
2 et utilisé de façon intensive en plateforme pour
la validation des protocoles de signalisation avec les GAS,
- sur site pour collecter la vraie réalisation des protocoles
de signalisation des commutateurs électromécaniques
d’un pays auxquels le commutateur E10 vendu doit s’interconnecter
dès son installation sur site (les protocoles réels
étaient presque toujours différents des spécifications
données par le client dans les cahiers des charges).
Le CIRCUS R2 est adapté rapidement aux signalisations multifréquences
(MF et R2) par l’adjonction d’une carte adéquate. |
sommaire
L’époque de la fusion S.L.E.-CITEREL - CIT (1977)
Cette fusion, après l’important
effort d’adaptation de C.I.T., est effective en 1977. Elle a
de nombreuses conséquences pour la S.L.E. et D.R.C.
Les premiers pas en commun
Après la fabrication et la mise en service de la maquette de
Vélizy, puis celles de son premier central à Barentin
en 1976, C.I.T. décide d'absorber sa filiale S.L.E.-CITEREL.
La première conséquence est le départ de notre
directeur général. F. X. Montjean est nommé Directeur
Général adjoint de C.I.T. Commutation et, entre autres
choses, chargé des questions liées aux installations.
Cela n’est pas, pour nous, sans importance. F.Tallegas devient
Directeur de l’établissement de Lannion et également
Directeur Technique de la nouvelle C.I.T. commutation.
La partie industrielle est absorbée par C.I.T., E Escoula se
voit donc privé de fonction. Il nous quitte. Nous le retrouvons
à Marsactel d’où il nous vend, avec d’autres
quincailleries téléphoniques, des réglettes de
raccordement de lignes d’abonnés bien adaptées
à nos problèmes export.
(Parallèlement, à Colombes, L.M.T. fusionne avec Ericsson-France,
pour engendrer Thomson Téléphones.)
La première répartition des tâches, entre Vélizy
et Lannion, confie à D.R.C., qui reste au sein de la Direction
Technique, la responsabilité des prototypes France et export.
(la Direction des Centraux Publics, qui deviendra le Département
des Opérations Nationales (D.O.N.) recevant la charge des E10
de série pour la France et bien entendu conservant la responsabilité
des commutateurs électromécaniques.)
F.X. Montjean crée à Vélizy, à la même
époque, deux directions nouvelles: la D.EX, avec L. Companyo,
qui regroupe les activités commerciales et financières,
et la D.R.EX chargée des opérations export de série
E10, mais aussi Janus (Indonésie, Afrique du Sud…) sous
la direction de M. Renaud.
Qu’allons nous devenir si les opérations export sont conduites
depuis Paris ?
Nous devons, M. Renaud et moi, décider si telle opération
est une opération de série ou non. Il faut bien avouer
que bien peu d’affaires à cette date, à l’export,
peuvent être qualifiées de série. Nous obtenons,
par pays, la commande de un, deux ou trois commutateurs dans le meilleur
des cas…Les systèmes diffèrent beaucoup d’un
pays à l’autre. Nous finissons par nous entendre sur le
«partage du monde» dans un célèbre traité
connu sous le nom de «traité de la Boursidière»
(immeuble où C.I.T. louait des bureaux, à côté
de Vélizy).
Sentant bien que le personnel disponible à Vélizy est
encore novice sur E10, F.X.Montjean entreprend à Lannion une
campagne de séduction auprès du personnel. Il promet
une «explosion de carrière» à ceux qui le
rejoindront. Quelques uns se laisseront tenter….et certains d’entre
eux reverront Lannion après quelques années parisiennes
!
La proximité des équipes de développement et
l’appartenance à la Direction Technique ont toujours été
un indéniable avantage pour les équipes de D.R.C. et
pour celles qui leur succèderont. Les clients ont toujours
apprécié les interlocuteurs informés que nous
leur présentions. J’ai été le témoin,
plus tard, de l’enlisement de Northern au Maroc, qui mit plus
de deux années à résoudre des problèmes
de signalisation, tant il était difficile au personnel du site
de dialoguer avec ses services techniques.
Dans ces années 1978-1980 certaines opérations sortent
un peu de l’ordinaire. Les affaires Mexique, Irlande, Yémen,
Afrique du sud, Liban, sont chacune l’occasion d’un progrès
dans notre expérience d’exportateurs.
Le Mexique et la formation client
Parmi les conséquences de notre absorption, il y a la suppression
de l’équipe de formation théorique. Adieu l’hospice
de Tréguier, vive l’établissement de Saint-Ouen
qui abrite déjà le service de formation de la C.I.T..
Auparavant, en 1978, F. Jollé a la chance d’avoir pour
élèves une bonne douzaine de Mexicains, dont il s’occupe
merveilleusement;…. qui laissent un souvenir impérissable
dans le Trégor. Ils séjournent environ six mois chez
nous, avant d‘aller, en 1979, exploiter le nouveau commutateur
de Tlahuac-Milpa-Alta, dans la banlieue sud de Mexico… Pensions-nous
! Ils quittent Lannion en nous laissant rassurés sur la future
équipe d’exploitation; ils ont reçu la meilleure
formation possible. Cette formation est délicate puisque le
contrat Mexique prévoit la fourniture d’un central unique
en son genre: le niveau 2, qui emprunte beaucoup au E10 niveau 1,
lequel est en cours de développement. F. Jollé doit
faire quelques
acrobaties, mais la satisfaction des spécificités mexicaines
passe par le nouveau produit.
Les cours se terminent à peu près à la date d’ouverture
du chantier, juste au moment de la reprise de la formation par la
C.I.T.. L’administration mexicaine (Telmex) est très consciencieuse.
Soucieuse d’avoir des services au courant de ce nouveau système,
inédit sur son continent et si différent de ce qui y
existait jusqu‘alors, elle nous a détaché en formation
un ingénieur de chaque service.
Le chantier ouvert, nous découvrons qu’aucun des stagiaires
pour lesquels nous nous étions donné tant de peine n’est
disponible pour l'exploitation: ils ont tous rejoint leur service
d’origine. Raté ! F. Jollé, devenu ingénieur
d’affaires Mexique, doit organiser, sur place, une
formation pour une nouvelle équipe d'exploitants.
La leçon de cette histoire est que nous ferons désormais
très attention à l’organisation de nos clients
et que nous nous efforcerons de leur poser les bonnes questions avant
d'agir.
D’ailleurs, dans la suite de nos aventures, nous découvrons
que la localisation à Saint-Ouen de ce service de formation
est une mauvaise idée. Aux portes de Paris, et du métro,
quelle belle occasion de s’offrir des vacances parisiennes aux
frais de la C.I.T. ! Nous découvrirons très vite que
nos stagiaires sont fils ou neveux de ministres et qu’ils n’éprouvent
aucun intérêt pour les cours que nous leur prodiguons.
D’ailleurs, rentrés dans leurs pays, ils auront bien d’autres
activités que celle de faire fonctionner un commutateur, si
moderne soit-il.
Cette tendance est assez systématique, quel que soit le pays
client. Par ailleurs, comment refuser un stage pour son neveu à
celui qui nous signe le contrat ? La solution sera trouvée:
le retour à Lannion de ce service formation, qui deviendra
l'I.F.A. (Institut de Formation d'Alcatel). Malgré tous ses
charmes, le Trégor est moins attractif et plus propice au travail
que la place Pigalle à quelques stations de métro !
Les stagiaires sont, depuis lors, beaucoup plus proches des besoins
de l'exploitation. Notre "punition" est de continuer à
nous occuper de ces stagiaires; M. Clec’h nous y aidera beaucoup.
Nous allons bientôt découvrir que la meilleure formation
consiste, après une formation théorique, à entraîner
les futurs exploitants au moyen d’un chantier école (une
maquette est nécessaire) puis à utiliser ce personnel
pendant la phase de mise en service. Pour les distraire le week-end
et pour leurs déplacements dans le Trégor, J. L’Huillier
mettra à leur disposition, quelques voitures des chantiers
(4L). (Les chinois ne sachant pas conduire seront équipés
de bicyclettes).
Nous aurons la surprise de découvrir certains lundis matin
que nos stagiaires sont allés à Londres, d’autres
à Lourdes !
Il faut noter que la formation adaptée aux cessions de licence
n'a jamais quitté Lannion, conduite, après le départ
de F. Jollé, par M. Menez dans les locaux de l'ancien hôpital
de Lannion à Kerampont. Mais c'est une promotion, elle a quitté
un hospice pour un hôpital !
Ce retour à Lannion des activités formation va perdurer.
Aujourd’hui on parle à Lannion d’"Alcatel University"
comme une des grandes retombées locales des travaux conjoints
d’Alcatel et du…..C.N.E.T., voire de P. Marzin lui même.
L'affaire Mexique inaugure une pratique qui va être reconduite
d'affaire en affaire. Devant les besoins considérables de communications,
tant professionnelles que personnelles, nos «gars de chantiers»
réussissent à séduire certains de leurs camarades
des équipes de développement. Ils mettent ensemble au
point une modification temporaire (pendant la durée des travaux
sur site) qui permet de téléphoner gratuitement de France
vers les sites et inversement, à l'insu des exploitants; c'est
un peu malhonnête mais tellement économique !
A propos de ces conversations entre les sites et Lannion, ou plus
tard Tréguier, il faut dire que nous craignons parfois que
certains de nos clients ne nous écoutent. Quand les informations
doivent être confidentielles et qu'il nous faut protéger
quelques petits secrets, les échanges se font alors en Breton......
Un petit retour sur l’organisation
Quels sont les clients, correspondants de nos responsables sur site
? Au début de nos affaires export, nous pensions que nous allions
trouver des organisations assez semblables à ce que nous connaissions
en France. Nous nous rendons assez vite compte que nos interlocuteurs
sur site se situent à haut niveau. Parfois le Directeur Général
des télécoms, souvent le Directeur de la Commutation,
(ils ont pris des risques en choisissant un système numérique
et un réseau intégré et ils surveillent donc
de près tout ce qui se passe).
Nous devons leur présenter des ingénieurs compétents
sous peine de discréditer toute la compagnie. Nous avons donc
sur site des responsables de travaux câblage, installation,
mise en service chapeautés par un ingénieur, responsable
technique du site. Il nous faut choisir ces ingénieurs afin
qu’ils soient capables d’aborder n’importe quel aspect
des problèmes posés par l’introduction d’un
nouveau système dans le réseau local, et de donner à
l'occasion quelques conseils judicieux. Ils sont aussi les interlocuteurs
des responsables de la base arrière trégoroise. Le service
des travaux extérieurs gère ce personnel.
Nous verrons même, un peu plus tard, un responsable de chantier
devenir l’interlocuteur unique d’un président de
république africaine et de son attaché militaire dans
une affaire dite de «monitoring» !….
L’Irlande
Encore une affaire de cession de licence, au profit de la filiale
que nous créons avec la société Guiness (bien
connue: «Guiness is good for you»). Une unité de
production et de réalisation sera créée à
Bandon dans la région de Cork. En attendant, nous devons démarrer
l’installation des premiers commutateurs. Nous faisons l’inventaire
de nos anglophones, ils sont peu nombreux. Nous passons alors un contrat
avec Man-Power
Irlande pour qu’il nous fournisse des techniciens électroniciens
que nous allons former, utiliser sur nos chantiers, pour les faire
embaucher enfin par notre filiale A.I.L.(Alcatel Ireland Limited)
quand elle sera en état de le faire.
Cette mesure s’avèrera payante car nous avons pu doter
la filiale de personnel compétent dès sa création.
Cette dernière saura d’ailleurs répondre à
nos demandes d’emprunt de spécialistes chaque fois que
nous aurons besoin d’un technicien parlant vraiment bien l’anglais
(l'entraide celtique). Plus tard, nous emprunterons aussi des opératrices
téléphoniques irlandaises, pour Tréguier, pendant
que certaines des nôtres iront perfectionner leur anglais, dans
la même fonction, à Bandon.
Le Yémen (1980-1984)
Le Yémen est notre premier client E10 niveau 1. L’application
Yémen dérive évidemment du produit développé
pour la D.G.T. Bien entendu, elle doit attendre que celui-ci soit
au point pour prétendre voir le jour. En cas de conflit, la
Direction Technique privilégie toujours notre
client principal, tant pis pour l‘export !
Il s’agit d’une refonte complète: logiques dupliquées,
nouvelles unités de raccordement d'abonnés, nos Concentrateurs
Satellites Electroniques (C.S.E.), capacité accrue……nous
allons être en retard. Il y a bien, comme d’habitude, quelques
problèmes pour la livraison des bâtiments. Nous gagnons
ainsi quelques mois. Notre client est pressé, le ministre yéménite
est un fou d’électronique ! Il voudrait bien s’occuper
lui même de ces nouveaux jouets !
Comment faire ? Nous tentons de simplifier temporairement le produit
commandé en écartant des développements en cours
tout ce qui ne nous paraît pas indispensable immédiatement
pour l’exploitant. (d‘ailleurs, les cahiers des charges
sont remplis, en général, de clauses sans grande utilité
locale, mais qui servent à montrer que l‘auteur est au
courant des dernières nouveautés; il faut néanmoins,
sur chaque point, être «compliant»). Cela arrange
un peu nos affaires. Néanmoins, P. Gourlayvient me conseiller
d’annoncer un retard important au client.
Je ne suis pas son conseil, nous faisons comme si, cela nous coûtera
un technicien en permanence dans chacun des trois commutateurs, dont
les mises en service sont simultanées, pendant environ un an.
Au total, le client sera satisfait, et le Yémen est mis en
service une année avant Brest, le prototype français
du niveau1.
Quel impact aurait eu sur nos prises de commandes l’annonce d’un
retard d’une année ?
Notre avenir à l’export aurait pu être différent.
Tout est bien qui finit bien !
Nous aurons en dehors du système quelques problèmes.
Un seul exemple: il fallait fournir à nos clients des imprimantes
qui impriment l’arabe et nous n’étions pas vraiment
des spécialistes de la question. Un jour, on m’informe
que nos imprimantes écrivent l’arabe comme le français,
de gauche à droite, il faut un miroir pour déchiffrer
les textes !
Par ailleurs, les développements liés à ces nouveaux
E10 incluent un système de localisation d'avaries. Cet outil
précieux pour nos clients et nos équipes prend le nom
très mnémotechnique en français, à défaut
d'être original, de «locavar». Il est capable de
désigner un groupe de quelques cartes parmi lesquelles se trouve
celle qui présente le défaut. Plus tard, avec les O.C.B.
283, le locavar sera capable de désigner la carte en
panne. C'est merveilleux !
sommaire
L’Afrique du Sud (1982-1986…)
C’est notre troisième contrat de transfert de technologie
à l‘export, qui s’accompagne, comme pour les premiers,
de quelques commutateurs sous notre responsabilité. Toutefois
le fournisseur, vu des «South African Post Offices» (le
S.A.P.O.), est notre associé Teltech (qui deviendra Alcatel
Altech Technologies). L’Afrique du Sud est en pleine crise de
l’apartheid; ses avions ne peuvent plus survoler l‘Afrique.
L’embargo international la menace. Le S.A.P.O. exige de prendre
la connaissance parfaite du produit pour pouvoir éventuellement
le faire évoluer lui même. Une dizaine d’ingénieurs
sont détachés à Lannion, pendant une année
pleine; ils plongent dans tous les arcanes des différents logiciels.
Grâce à l’effort consenti et malgré la gêne
engendrée pour les équipes de développement,
tout se passe au mieux. Nos équipes doivent faire face à
un client extrêmement compétent et exigeant. Cela nous
fait le plus grand bien. Nous sommes conduits à détacher
un ingénieur pour être le correspondant de la compagnie
chez notre licencié. Il sera toutefois placé sous l’autorité
des équipes de Vélizy. Cependant les difficultés
de fonctionnement des liaisons M.I.C. nous sont imputées, le
climat se tend. Il faut démontrer que les parafoudres de protection
de ces liaisons, qui sont des fournitures sud africaines, sont insuffisants
pour tenir sous les orages monstrueux que connaît le pays. Nous
fournissons les nouveaux parafoudres (à ionisation) tout juste
développés par l’administration des P.T.T. et non
encore en service, qui résolvent le problème. Nous avons
encore eu de la chance.
Le Liban (1982-1985)
Après un appel d’offre international, les libanais décident
de confier la rénovation de leur réseau aux français,
moitié en E10 et moitié en MT20 (qui sera plus tard
rebaptisé E10MT).
Le Liban est le siège d’une guerre civile; voilà
encore une expérience inédite. Les seigneurs de la guerre
se partagent le pays. Comme il faut bien qu’ils vivent, ils prélèvent
des taxes, manu militari, chaque fois que du matériel entre
ou sort de leur zone. Rien de tel n’était prévu
ni au projet ni au contrat !
La première fois que je me rends au Liban, le responsable C.I.T.
vient me chercher à l’aéroport. En voiture, je
trouve la route en bien mauvais état: «c’est plein
de nids de poules !». Il me répond avec le plus grand
calme: «ce sont des trous d’obus».
Nous recrutons du personnel libanais, parlant bien le français.
Il se fait la main sur nos chantiers en France avant de retourner
chez lui où nous avons créé une filiale de droit
local pour le gérer. Nous limitons bien entendu la présence
de nos nationaux dans un pays où tout peut arriver.
Nous sous-traitons le montage et le câblage à une entreprise
locale, propriété de notre agent. A ne plus recommencer
! Ce dernier se croit tout permis: ses équipes, par exemple,
laissent rouler, sans protection, les tourets de câbles sur
les nez des marches d’ escaliers.
La plupart sont brisés. Je dois me fâcher tout rouge
et parler de la rupture de notre contrat, il me menace d’aller
se plaindre à G. Pébereau .«Allez-y !» lui
dis-je.
Tout rentre dans l’ordre avec cet «agent sous-traitant»,
mais les difficultés s’accumulent.
Nous ne pouvons plus débarquer notre matériel à
Beyrouth; il faut aller à Jounié, moins bien équipé.
Les bâtiments ne sont pas prêts. Les libanais ne nous
paient que s'il y a des recettes venant des abonnés; mais les
satellites restent stockés dans leurs caisses d'emballage.
Nous devons limiter nos expéditions et trouver des zones de
stockage qui, par miracle, n’ont jamais été bombardées
… Les retards sont tels qu’il faut prolonger la période
de validité du crédit acheteur au delà de 1984.
Thomson Téléphones, de son coté, peine à
sortir son produit, bien qu’il soit, comme nous, favorisé
par le retard des bâtiments. Nous aurons la joie de recevoir
la commande de quatre E10 supplémentaires, remplaçant
autant de M.T. pour le compte de notre rival du moment, nous sauvons
la mise de notre futur associé !
Finalement, le réseau libanais est mis en service partiellement,
le 14 Janvier 1982. Les mises en service suivantes se dérouleront
au gré des opportunités offertes par les quelques trêves
qui ponctuent cette abominable guerre civile. Le mérite en
revient à notre responsable de la filiale J.J. Cornély,
qui a toujours gardé un calme olympien, malgré les difficultés
et les dangers.
Nous avons mis le doigt dans la création de filiales, notre
«parc» de filiales va croître et nous obliger un
peu plus tard à nous organiser pour les gérer.
L' Ouganda (1985)
Nos commerçants n'arrêtent pas de dénicher de
nouveaux pays aux réseaux téléphoniques déficients.
En 1983, c'est le tour de l'Ouganda, deux nouveaux commutateurs sont
prévus dans la banlieue de la capitale Kampala.
Il faut dire deux mots de la situation locale, même si cela
diminue un peu le mérite de nos commerçants, dans un
pays où peu de concurrents se précipitent. Indépendante
depuis 1962, cette ancienne colonie britannique est le siège
d'une lutte sans merci entre les populations du sud, les «Baganda»
(Bantous), et celles du nord de type nilotique. Suivent la dictature
d'Idi Amin Dada, puis l'invasion des armées tanzaniennes. Bref,
nous devons exécuter ce contrat au milieu d'une atroce guerre
civile. Notre courageuse équipe de chantier est dirigée
par M. Radier qui part avec sa famille pour Kampala. Les travaux avancent
de plus en plus péniblement. Les cadavres jonchent parfois
les rues; c'est ce que découvrent les enfants Radier en allant
à l'école. Aux combattants se mêlent des bandes
de pillards, ce sont eux que notre personnel redoute le plus. Les
combats s'amplifiant, je demande que les familles rentrent au plus
vite.
Que dit le Quai d'Orsay ?: «Il vaut mieux rapatrier votre personnel,
ne laissez sur place que le strict minimum» Que dit la Direction
du Personnel ?: « faites pour le mieux, ne prenez pas de risques».
Je m'entretiens avec M Radier et lui dis en substance: « Vous
êtes, sur place, le mieux placé pour apprécier
la situation; je vous laisse décider de l'opportunité
du repli, quand vous voudrez.»
Peu après, je reçois de M. Radier une demande d'achat
pour un pistolet mitrailleur. Que faire ? Si j'accepte, et qu'il s'en
serve en provoquant quelques dégâts, que peut-il se passer
?
Si je refuse, et qu'il lui arrive quelque chose, je me le reprocherai
toujours. Je décide de lui faire confiance et de signer la
demande d'achat. Une nuit, il devra tirer une rafale en l'air,pour
faire fuir une bande de pillards qui l'auraient sans doute assassiné
pour le voler.
Le chantier doit être interrompu; des commandos de l'armée
britannique se chargent d'évacuer tous les occidentaux, donc
toute notre équipe...Je n'ai plus jamais entendu parler de
ce pistolet mitrailleur qui doit toujours être immobilisé
dans les comptes de la compagnie
sommaire
La période des grands contrats
La Jordanie (1982-1984)
Peu à peu les clients souhaitent que les ensembliers que nous
sommes en train de devenir, leur livrent des zones téléphoniques
clés en main.
Cela implique que nous livrions et mettions en service non seulement
le commutateur lui même, les équipements de transmission,(
notamment des quantités impressionnantes de terminaux numériques
(T.N.E.), à installer souvent dans les commutateurs distants),
mais aussi les ateliers d'énergie, les groupes électrogènes,
les installations de climatisation. Nous irons, plus tard, jusqu'à
fournir les réseaux d’abonnés, la transmission
et même les
bâtiments… Tout cela, complique d’abord les offres,
(le Groupe des Projets Techniques est maintenant dirigé par
J.C. Hue) le travail de l’ingénierie, celui des équipes
chantier… Ce sont les équipes de la D.R.EX de Vélizy
qui prennent d’abord la direction de ces affaires. Dans
un premier temps, nous agissons comme le sous-traitant commutation.
La D.R.EX de Vélizy s’organise pour répondre à
ces nouvelles exigences, elle se spécialise principalement
dans ce qui s’appellera le «Hors Commut». C’est
B. Macé, un ancien du Janus, qui rassemble les moyens nécessaires.
La séparation des tâches avec D.R.C.sur les sites n’est
toutefois pas si facile à organiser; les monteurs-câbleurs
(les expatriés comme la main d’oeuvre locale) peuvent
câbler, outre le commutateur, les ateliers d’énergie,
les répartiteurs….mais aussi, monter les installations
de climatisation, raccorder les groupes électrogènes….Une
filiale locale est nécessaire pour administrer tout ce monde.
Mais la commutation demeure toujours le domaine qui pose le plus de
problèmes au client, de ce fait le représentant de D.R.C.
est souvent son interlocuteur préféré. Le responsable
D.R.EX en prend ombrage, M.Renaud et moi devons veiller au grain.
Malgré ces quelques problèmes, l’affaire Jordanie
se déroule bien, même si elle réserve quelques
surprises. Par exemple: nous avions à fournir l’annuaire
téléphonique, voilà qui ne paraît pas être
spécialement compliqué, même s’il doit être
fourni en arabe. Mais nous nous apercevrons que les rues ne portent
pas de nom et que les maisons n’ont pas de numéro, sans
parler des nombreuses homonymies. Il faut passer par des descriptions
de la rue, pour localiser nos futurs abonnés. Je n’ai
jamais su s’il y avait eu, en fin de compte, beaucoup d’erreurs.
Toutefois, il apparaît bientôt que l’export de série,
dévolu à la D.R.EX, n’est pas vraiment au rendez-vous
des plans de charges.
Encore un peu d’organisation !
Un soir de 1979, F. Tallégas entre dans mon bureau, un télex
à la main, «une bombe !» me dit-il. F.X. Montjean
propose la fusion des équipes de D.R.C. et de D.R.EX pour ce
qui est de la commutation et la création de la Division Systèmes
Internationale (D.S.I.) pour le reste. Un peu plus tard sera également
créé le Groupe Industriel et des Licences (G.I.L.) qui
prendra la gestion des filiales Irlande et Afrique du sud, où
nous devons compter avec nos partenaires, Guiness et Teltech. Au même
moment apparaît aussi la Direction des Affaires Internationales
(D.A.I.), qui remplace la D.EX., et qui hérite de son directeur:
L. Companyo.
Je profite de cette évocation de la D.A.I. pour rappeler rapidement
son histoire: Elle va peu à peu abandonner son rôle opérationnel
pour se consacrer à la prospection, à la gestion des
réseaux, des agents et de tout ce que cela implique, c’est
à dire tout ce qui touche plus ou moins au monde politique
tant français qu’étranger, aux nombreux réseaux
d'influence, au milieu desquels il lui faudra naviguer en faisant
les bons choix. Dans les années 80, elle deviendra Alcatel
Trade Internationnal, A.T.I., qui s’impliquera dans l’ensemble
des activités de la compagnie. Cette tâche n’est
pas la plus facile, notre développement à l’export
lui doit beaucoup, et donc en particulier à L Companyo et à
ses fidèles adjoints P. Noettinger et J. Sidotti. Ce développement
n‘aurait pu se faire sans leur action..
Bien entendu, nous acceptons de nous charger de la totalité
de l’export, partie commutation, cela simplifie beaucoup les
choses. De surcroît, nous sommes plus rassurés quant
à notre futur lannionnais, qui demeure une question toujours
vivante, même si elle n’est pas souvent exprimée
!
Une petite partie de D.R.C. ne nous suivra pas, elle demeurera un
support pour les équipes du D.O.N. (Département des
Opérations Nationales), et évoluera progressivement
vers la fonction validation système. Nous aurons de nombreux
contacts au fur et à mesure du développement de nos
produits avec ce qui reste du D.R.C. de nos débuts.
Mais il nous faut nous charger des équipes parisiennes. Comment
va s’appeler le nouvel ensemble ? Pour éviter de traumatiser
nos futurs collègues, je décide de conserver l’appellation
: D.R.EX. Nos bretons ne s’en choqueront pas.
L’intégration des services de travaux s’effectue
facilement, (les deux entités, sont essentiellement constituées
d’expatriés). Peu importe l’unité de rattachement.
Pour l’ingénierie, c’est un peu plus délicat,
une partie seulement accepte de venir à Lannion; il faut partager
les tâches du mieux possible. Les ingénieurs d’affaires
seront indifféremment lannionnais ou parisiens. Tout se passe
bien, à condition que certains d’entre nous passent un
peu plus de temps à Paris. Ce qui, malgré tout est assez
supportable, deux à trois jours par semaine, grâce à
la liaison aérienne Lannion-Orly.
DSI et DREX demeurent très proches, même dans l’esprit
de la direction, puisque nos budgets sont discutés en commun.
Avec le personnel, géré par Vélizy, nous héritons
également du parc hétérogène de CIT, entre
autres: les Janus installés en Indonésie qui continuent
à générer des contrats abondants de pièces
détachées, un commutateur télégraphique
“crossbar” traversé par un obus à Beyrouth,
dont le technicien en charge sur place, (un français bien sûr)
s’efforce seul depuis deux ans, d’obtenir les pièces
détachées nécessaires à un minimum de
fonctionnement. Ce commutateur est unique dans le pays. On peut parler
à son sujet de trafic partagé entre…..les différents
belligérants. A noter également les Janus des chemins
de fer Sud Africains, avec des signalisations en code arythmique.
Un seul agent technique désespéré, caché
dans un bureau à Teltech, est chargé de mettre à
jour la documentation client. Les nombreuses modifications apportées
au système par les équipes chantier, rentrées
depuis deux ans, n’ayant pu être reportées dans
la montagne des plans, ce solitaire était sacrifié aux
exigences du client. Nous irons le délivrer.
Ces opérations Janus nous amènent une bonne douzaine
de britanniques, embauchés quelques années auparavant
par la C.I.T., pour des contrats en pays anglophone. Nous saurons
les utiliser. Certains sont d’ailleurs toujours en Bretagne.
Nous affinons nos relations internes. Nous inventons les “Fiches
de Lancement de Travaux export”. Elles précisent les travaux
de développement à imputer sur les affaires de la D.R.EX,
(applications nécessaires à nos clients, souvent dissemblables
d’une affaire à l‘autre). La direction des usines
nous réclame des prévisions de charges. Pour répondre
à cette requête, nous nouons des contacts de plus en
plus étroits avec les commerçants de la D.EX. Le couple
Le Jop-Chapuzot fonctionne très bien et nous pouvons fournir
des prévisions de plus en plus correctes. Des statistiques,
en effet, commencent à pouvoir être établies:
sur la pondération des prises de commandes espérées,
sur l’étalement des affaires dans le temps. Nous rationalisons
aussi l’ensemble de nos relations avec la direction des fabrications,
(le nouveau directeur en est M de Peyret). Les principaux problèmes
demeurent cependant, comme la dispersion des sorties fabrication pour
une même affaire qui s'étalent sur plusieurs mois !
Nous commençons à nous interroger sur l’informatisation
de la D.R.EX. Est-il possible de diminuer nos coûts grâce
à ce moyen nouveau ? La D.R.EX est notamment en relation avec
la Direction Technique, celle des fabrications, la comptabilité,
la D.S.I.. Chacune de ces Directions a élaboré son propre
système informatique, il répond parfois aux besoins
de la Direction concernée, mais ne se préoccupe généralement
pas du besoin des autres Directions, (poids de l’histoire, nombrilisme...).
Ces systèmes sont évidemment incompatibles. Il faudrait
que nous puissions communiquer avec tous. Nous allons mettre plusieurs
années avant d’y parvenir. La pugnacité de P. Larmor
fera mieux que les tentatives
diverses suscitées au fil des années (dont un contrat
signé avec un consultant prestigieux: Mac Donnel- Douglas,
par un grand administratif).
Les Mobidix
L’administration des P.T.T., mettant à profit le peu de
volume occupé par les commutateurs E10, se découvre
des besoins de commutateurs mobiles. Nous devons, pendant une période
assez longue, installer des organes centraux, des C.S.E., des ateliers
d’énergie, des répartiteurs dans des containeurs
ou des remorques fournies par l’administration. On nous explique
qu’avoir un commutateur mobile capable de suivre le tour
de France et de suppléer aux insuffisances rencontrées
dans certaines villes étapes est de la première importance.
Nos commutateurs sur roulettes doivent aussi constituer des moyens
de secours, en cas d’incendie par exemple. Voilà qui nous
touche beaucoup, nous avons l’expérience ! Quelques années
plus tard nous utiliserons une de ces remorques dans une opération
de grande importance à l’export, j’y reviendrai
sommaire
Sofrecom et le S.C.T.T.
La période de notre fusion avec C.I.T. s’achève;
après Malte, la Pologne, l’Egypte, le Maroc, nous avons
introduit nos commutateurs au Mexique, au Yémen, au Qatar,
à Sri Lanka, en Afrique du Sud, au Gabon, en Irlande, au Liban,
en Jordanie, en Tunisie.
Ici ou là, nous voyons apparaître la société
Sofrecom, une émanation de la D.G.T. (il existe d’autres
sociétés comparables, provenant de différents
ministères, dans d’autres activités, le rail, l’armement…).
Par contrat avec nos clients, elle se propose de les conseiller tout
au long de nos opérations, depuis l’appel d’offres
jusqu’à la remise au contrôle et même ensuite
pour l’exploitation et la maintenance. Assez souvent, ces conseillers,
qui sortent depuis peu de l’administration qui les a détachés,
sont persuadés que les règles françaises sont
universelles, bien que ce soit loin d’être le cas. Parfois,
nous en rencontrons qui s’imaginent aussi devoir protéger
le "pauvre client", devant les ambitions et la soif de profit
de nos sociétés capitalistes. Nous devons naviguer entre
ces écueils qui ne nous crédibilisent pas toujours aux
yeux de nos clients. Nous ne pouvons pas, pour autant, nous fâcher
avec ces sociétés, animées d'une bonne volonté
évidente.
Sofrecom est surtout une société écran qui permet
de commercialiser les prestations effectuées par les services
de l’administration (formation, contrôle, conseil...).
Cette prétention ne fait pas l’affaire de nos commerciaux,
dans la mesure où ces prestations sont imputées sur
les mêmes protocoles financiers que nos propres affaires, renchérissant
le coût de l’opération et diminuant notre part dans
le total.
Le Service du Contrôle Technique des Télécommunications
(S.C.T.T.) est très concerné par l'action de Sofrecom.
Nous le connaissons bien puisqu’il a participé à
toutes nos opérations de «jeunesse» en France,
(nous avons même embauché certains de ses agents contractuels).
Outre le contrôle en usine, (dont nous avons dit quelques mots),
nous le trouvons désormais sur nos sites à l’export,
en assistance aux équipes contrôle du client qu’il
a parfois formées au préalable. Le grand défaut,
que nous n’avons jamais pu complètement contrer, est que
ses actions se font dans l’ignorance totale de nos contrats.
Comment en effet expliquer aux agents du S.C.T.T., tous issus sans
transition des différentes D.R.T., toutes les subtilités
de nos approches ainsi que les différences importantes que
les réseaux de nos clients peuvent présenter par rapport
au réseau téléphonique idéal français.
Les dirigeants souhaitent participer à la rédaction
des cahiers de recette, et à leur validation, opération
que nous effectuons sur maquette et que nous avons toujours considérée
comme une question entre le client et nous. Ils prétendent
imposer les fiches de recette S.C.T.T. (une centaine), souhaitent
donner leur avis sur les clauses contractuelles, et parlent même
d’écrire des Normes et Spécification de Service
(N.S.S.) à intégrer à nos contrats exports….
En Inde, ils contestent nos calculs de trafic, et annoncent que nos
C.S.E. ne font que 86 Erlangs au lieu de 98 comme prévu au
marché. Petit problème avec nos clients, que Y. Samoël
doit désamorcer en expliquant bien d’où viennent
ses chiffres (de la différence dans les caractéristiques
des trafics français et indien). Malgré tout, la suspicion
est bien lente à se dissiper, d’autant que les ingénieurs
du S.C.T.T. contestataires restent en place des mois durant, et nous,
nous avons tellement besoin de la confiance de nos clients !
Nous en venons à l’idée de devoir former aux problèmes
de l’export les intervenants de Sofrecom et du S.C.T.T.; heureusement
nous n’irons pas jusque là. En 1985 nous devrons, néanmoins,
leur désigner J.J.Vialla comme interface. A cette époque
la recette de nos commutateurs libanais est bloquée par l’absence
de leurs experts…
Nos clients ne sont plus tout à fait les mêmes……
Nous avons été habitués au début de nos
activités à avoir un client majeur qui ne comptait pas
sur nous pour régler ses problèmes. Nous sommes donc
assez surpris de rencontrer des clients d’un nouveau type, qui
laissent à la chance le soin de résoudre les difficultés
qui naissent à la marge de ce qui est strictement la commutation
et la transmission associée. Par exemple, nous découvrons,
au dernier moment, que rien n’est prévu pour
dépouiller la taxation et émettre des factures. Ceci
nous conduit à quelques improvisations ou mesures transitoires,
hasardeuses et coûteuses à la fois.
Peut-être aurions nous dû nous rapprocher davantage de
ce qui allait devenir France Télécom. Il nous aurait
fallu mieux traiter les besoins additionnels de nos clients, notamment
dans le cas des contrats clés en mains. Ces clients sont parfois
sans beaucoup d’expérience, dotés de personnels
sous-payés qui, exerçant un ou plusieurs autres métiers
par nécessité, limitent leurs heures de présence
sur les sites. Je pense notamment à l’organisation des
centres, à la gestion des opératrices, à la gestion
des alarmes extérieures à notre système, aux
moyens nécessaires au dépouillement des bandes magnétiques
de taxation (comme je l’ai dit plus haut), à la gestion
des lignes d’abonnés, sièges de raccordements multiples,
parfois transitoires, de courants parasites allant parfois au delà
de 220 volts etc… Deux mondes se rencontrent, des exemples le
démontrent:
Ces problèmes de lignes d’abonnés me valent un
voyage en urgence au Sri-Lanka, où l’exploitant se plaint
de la fragilité de nos équipements. Ses plaintes remontent
jusqu'à New Dehli où nous sommes dans la dernière
phase de la négociation de notre première affaire en
Inde: l’usine de Mankapur (500.000 lignes/an), et pour la D.R.EX
le commutateur de Bombay- Worli, premier de la série,…danger
mortel ! C’est à Colombo que je découvre, en me
promenant simplement dans la rue, et en observant le cheminement des
lignes d’abonnés, où se situe le problème.
Naturellement, nos cartes d’abonnés ne résistent
pas aux agressions de ce réseau où la «débrouille»
des habitants, avec la complicité des exploitants, conduit
à de multiples tensions parasites mortelles pour nos cartes,
conçues pour un réseau discipliné. Nos clients
ont inventé depuis longtemps le support commun pour la distribution
électrique et téléphonique, et les lignes partagées
!
Les cinghalais acceptent un contrôle préalable au raccordement
de leurs abonnés; nous devons refuser bon nombre de lignes
dangereuses et contraindre le personnel à les réparer,
puis, bien sûr, aller expliquer tout ceci aux indiens.
Un peu plus tard, pour diminuer les problèmes, nous embaucherons
et formerons deux techniciens cinghalais, qui interviendront sur l’exploitation
et la maintenance, avec rapport technique transmis systématiquement
au directeur général des P.T.T. En quelque sorte c’est
nous qui payons l’exploitant !
C’est une administration très pauvre, les interventions
sur les C.S.E. distants nécessitent une voiture, il faudra
que nous nous en «occupions».
Sri-Lanka me fournit encore un exemple qui met en évidence
notre naïveté occidentale. Bien entendu, ces marchés
sont toujours accompagnés de cahiers des charges très
précis, donnant en particulier toute information utile sur
l'environnement local. C'est ainsi que la tension du réseau
électrique est donnée: 220 Volts plus ou moins 10%.
Arrivant sur le site, nos équipes ne tardent pas à découvrir
que si la tension nominale est bien de 220 Volts, ses variations la
font se situer entre 110 et 380 Volts. Bien entendu, il nous faut
remédier au défaut en approvisionnant, en toute hâte
et à nos frais, une collection d'autotransformateurs qui règlent
le problème.
Lors d'un entretien avec le directeur Général des Télécommunications
du pays je lui dis: « c'est dommage que vous n'ayez pas mis
vos spécifications techniques à jour, concernant les
caractéristiques de votre réseau électrique».
Sa réponse fut pleine d'enseignements: « oui, mais vous
vous seriez moqués de nous; d'ailleurs, les japonais connaissent
très bien l'instabilité de notre secteur et les téléviseurs
qu'ils nous vendent sont conçus pour y faire face».
Je me suis trouvé naïf à une autre occasion, il
est vrai que c'était au tout début des opérations
à l'export. Nous avons terminé le premier E10 du Maroc
à Fez, et je me rends dans cette superbe ville pour me rendre
compte un peu des choses. L'autocommutateur de Fez comporte trois
satellites dans l'Atlas environnant (Sefrou, Immouzer et Ifrane).
Sur la route qui y conduit, je m'efforce de suivre le parcours des
liaisons M.I.C. Après un certain temps, ne voyant aucun accès
aux chambres qui abritent les répéteurs, j'interroge
mon accompagnateur, un des responsables télécoms de
la région de Fez: « mais où sont donc les accès
aux répéteurs ?». Désignant un vaste espace
recouvert de gravillons il me répond:
- «quelque part là-dessous».- «combien de
temps vous faudra-t-il pour changer un répéteur défaillant
?»,- «deux ou trois jours». Je ne parviens pas à
obtenir plus d'information ou d'explication de mon interlocuteur.
Il juge que la situation est satisfaisante, malgré ce que je
peux lui dire sur ce qui se passe en France, où, dans un tel
cas, chaque minute compte.
C'est en passant à Rabat que l'explication m'est fournie par
le conseiller français du ministère à qui je
fais part de mon étonnement: «Si l'on avait organisé
des trappes de visite pour ces répéteurs, immédiatement
repérables, elles auraient attiré la convoitise des
pourvoyeurs en cuivre des nombreux dinandiers de la région
qui se seraient fait un plaisir de transformer nos câbles en
plateaux vendus dans les souks». On ne pense jamais à
tout !
Un peu plus tard, les chiliens, équipés du M.T., le
système concurrent de Thomson, nous menacent de saisir la caution
de bonne fin, au motif de la mortalité excessive des cartes
d’abonnés. Je me retrouve rapidement dans un avion avec
R. Gufflet, le commercial de la zone. A Santiago, je découvre
un client compétent, mais une rapide enquête me révèle
que les agents des lignes, continuent ce qu’ils ont toujours
fait, et «électrocutent»
consciencieusement nos malheureuses cartes d’abonnés,
sous prétexte de tester les lignes.
Naturellement, les services de la commutation, nos clients, n’ont
rien dit au service des lignes de l’existence dans le système,
de moyens de test bien plus pratiques et plus efficaces que la méthode
du «bon vieux temps» qui utilise le 220 volts. La caution
ne sera pas saisie !
Je n'irai pas jusqu'à parler de choc des civilisations, comme
dans un ouvrage récent et célèbre, mais quand
même de grande différence culturelle; en prendre conscience
aide beaucoup à l'efficacité. A l'export, on n'en sait
jamais assez sur les clients, leur pays et son histoire, leurs habitudes;
on sous-estime souvent leur fierté (quand il ne s'agit pas
de nationalisme), il convient de rester toujours très modeste
et respectueux de leur façon de
penser. ......
sommaire
L’arrivée à Convenant Vraz (Tréguier)
1983
Convenant Vraz est le nom d’une ancienne ferme située
dans la commune de Minihy, qui jouxte Tréguier. C’est
dans cette commune que se trouve la maison natale de Saint-Yves, au
manoir de Kermartin, non loin de Convenant Vraz, tout un symbole !
C’est aussi là que F.X. Montjean a choisi, avec la bénédiction
d’A. Roux, de construire l’unité de production de
E10A, clone de l’usine de Poznan, comme on l’a vu plus haut.
Dès 1981, avec le développement des contrats export,
le besoin de surfaces pour D.R.C./D.R.EX. commence à se faire
sentir. La fusion avec la C.I.T. a fait disparaître le service
formation de Lannion; les locaux de l’hospice, sis sur une place
de Tréguier, sont devenus libres. Ils ont d’abord été
occupés par la Direction Industrielle qui y a installé,
malgré l’inadaptation de ces vieux locaux, une chaîne
de câblage de bâtis, en attendant de
rejoindre à Convenant Vraz le reste de la production. Nous
réussissons, alors, à convaincre la Direction des Chantiers
de s’installer dans ces locaux de l’hospice: deux grands
bâtiments de deux étages séparés par une
cour dotée de locaux annexes. J. L’Huillier a le triste
sentiment qu’on a un peu exilé son service, ne l’éloigne-t-on
pas pour mieux s’en séparer ? (sentiment partagé
par certains de ses collaborateurs). Il existe pourtant quelques compensations
comme le «restaurant-cantine» qui sert une excellente
tête de veau tous les mardis. Impensable à la cantine
de Lannion ! Que de visiteurs le mardi matin !
Dès la mi 82, il devient évident que la D.R.EX devra
un jour prochain s’installer à Tréguier (j’utiliserai
Tréguier au lieu et place de Minihy ou de Convenant Vraz).
D’ailleurs, c’est déjà le cas pour le Groupe
des Projets Industriels (G.P.I.). En effet l’activité
de production locale migre progressivement vers les usines de la C.I.T.,
sa disparition est prévue dans les deux années à
venir, le personnel ex-S.L.E., lié à la production devra
être reconverti !
Les matériels de nos contrats (50 bâtis par semaine en
1982) proviennent de nombreuses usines: Guingamp, Cherbourg, Vélizy,
Saintes, Eu, Montargis, Ormes, Chambéry, Bezons, sans oublier
les usines de la S.E.M.S. et celles de nos autres sous-traitants:
énergie et bientôt climatisation, ateliers d'énergie,
groupes électrogènes, sans oublier les S.K.D. (pour
“Semi Knock Down)”…. Un regroupement avant expédition
s’impose, il se fera à Tréguier, et pendant la
phase transitoire partiellement à Cosne sur Loire.
Une partie du personnel de production sera progressivement affecté
à une unité nouvelle, l’U.T.E. (Unité de
Transport et d’Emballage) Pour l‘accueillir, un troisième
bâtiment devra être construit. Ses 2.000m2 s’ajouteront
aux 2.000 m2 déjà construits pour la Direction des
Fabrications dont nous allons hériter. Peu après, devant
l’accroissement du volume des livraisons et le retard de certains
bâtiments de nos clients, une surface de stockage additionnelle
de 1000 m2 deviendra nécessaire; elle sera édifiée
par la municipalité et louée par nos soins. Une caisserie
très moderne fournira nos caisses «export» (Elles
doivent répondre aux normes internationales afin de pouvoir
être placées dans des containeurs qui voyagent généralement
sur le pont des bateaux, et sont soumis à des agressions multiples:
les emballages doivent être étanches et le rester pendant
plusieurs mois, même dans des conditions tropicales).
Une autre partie du personnel de production sera reprise par G.P.I.;
le reste sera intégré à l’établissement
ou à la D.R.EX (50 personnes), comme ingénieurs, techniciens,
secrétaires ou standardistes. Tous ces changements sont, bien
entendu, accompagnés des formations aux nouveaux postes; chacun
y mettra beaucoup de bonne volonté, malgré les difficultés,
pour réussir des adaptations pas toujours évidentes.
Le personnel de la D.R.EX n’est pas non plus très heureux
de devoir s’éloigner de Lannion, où le plus grand
nombre a organisé sa vie de famille. Un sondage discret nous
révèle que 85% sont hostiles au mouvement, les 20 kms
de Lannion à Tréguier font peur !
Une campagne de persuasion s’impose. Quelques années plus
tard, je crois savoir que le retour à Lannion provoquera aussi
des réactions. C’est sans doute un effet de la loi sur
la résistance au changement.
Plusieurs problèmes sont à résoudre avant notre
arrivée; le plus visible, mais non le plus simple, est celui
de la transformation d’une grande plateforme conçue pour
abriter des activités de fabrication en une zone de bureaux.
Les fenêtres se trouvent sur une partie de la périphérie,
des «skydoms» procurent un éclairage limité
au centre de cette surface. Nous décidons de créer des
bureaux paysagers avec des cloisons à mi-hauteur transparentes
afin que, de chaque bureau, il soit possible de voir l’extérieur.
C’est une innovation pour notre personnel qui critique cette
disposition, il est vrai que la plupart d’entre nous passe une
grande partie de son temps au téléphone et que les qualités
acoustiques de notre
aménagement ne sont pas évidentes. Il nous faut d’ailleurs
faire installer une demi douzaine de lignes téléphoniques
supplémentaires, un câble spécial est tiré
depuis Paimpol.
Nous avons de plus en plus de «chantiers école»,
et donc des stagiaires assez nombreux. Où peut-on les loger
? Il y a bien quelques communautés religieuses à Tréguier
qui ne demanderaient pas mieux que de se transformer en hôtel,
mais finalement nous continuerons à utiliser les services de
Lannion.
Les aménagements débutent en janvier 1983; le personnel
arrive entre juillet et décembre de la même année.
Au début 1984, nous sommes tous à Tréguier.
Peu à peu, comme nous le verrons, le site devient un centre
entièrement dévolu à l’export. Il est évident,
pour tous, que nous sommes dans des enjeux de concurrence internationale
et que pour survivre, la qualité du produit ne fait pas tout,
il nous faut nous battre et nous classer parmi les meilleurs. Cela
donne à l’établissement un esprit spécifique
très positif où le souci et le respect des clients sont
très présents. Les aléas, nombreux, sont surmontés
grâce aux initiatives de l’ensemble du personnel. Malgré
tout, les allègements d’effectifs que nous allons vivre,
la fusion avec Thomson Téléphones, ressuscitent la crainte
d’un déplacement de notre activité vers la région
parisienne. Cette perspective, sans fondement à cette époque,
finit par empoisonner l’atmosphère. Comment réagir
? Je décide de menues dépenses qui vont modifier le
climat; je fais dessiner des parterres et planter des fleurs : azalées,
rhododendrons, bruyères et quelques arbustes, derrière
les bâtiments, nous créons un verger avec des cerisiers
et des noyers; au mois de mai, l’établissement devient
magnifique et le moral revient.
Tout visiteur étranger voit ses couleurs au sommet d’un
mât, quand il arrive. Ce geste de considération contribue
à faciliter nos relations (naturellement, le drapeau breton
n’est pas oublié). L’été nous organisons
des repas sur les pelouses …quelques photos en témoignent.
Un seul ronchon: le voisin cultivateur dont les choux fleurs sont
dévorés par les nombreux lapins qui s’abritent
sur notre terrain, où ils ne sont pas chassés. Je prends
contact avec le garde-chasse qui accepte de me débarrasser
des lapins et de les échanger contre des chevreuils qui ne
passent pas sous les grilles de clôture. Mais je serai parti
avant que ce rêve ne se réalise…
Faisant suite aux groupes d’industrialisation
et des licences (G.I.L.) (Afrique du Sud, Irlande), en Juin 1983 naît
le D.O.I., Département des Opérations Internationales,
responsable de tous les contrats export. Il est dirigé par
J. Curvale.
Jusqu’à cette date, cette responsabilité était
partagée entre les Directions techniques et industrielles.
La création de ce nouveau Département, pendant du Département
des Opérations Nationales, résulte de la croissance
de l’activité export et du besoin de disposer de services
commerciaux bien structurés par secteurs géographiques,
comme de la nécessité de la gestion des bureaux, des
succursales et des filiales à l'étranger.
Bien entendu, la Direction Technique est nécessairement très
impliquée dans cette activité export: conceptions, développements,
disponibilités des produits, planification et développement
des spécificités techniques de nos clients, analyse
et réponses aux appels d’offres ne peuvent trouver de
réponse qu’en son sein. Mais quid de la D.R.EX ? J. Curvale
demande que la D.R.EX soit intégrée au D.O.I.
Il semble à tous ceux de Tréguier, que, outre l’intérêt
de conserver des relations franches avec les «développeurs»,
avoir un patron breton en Bretagne peut nous éviter des aspirations
parisiennes. C. Fayard tranche en notre faveur: nous conservons le
monopole de nos prestations. Pour les grosses affaires comme l'Inde
ou la Chine, le responsable d'affaire sera D.O.I., il nous sous-traitera
nos propres prestations. D.O.I. délèguera à la
D.R.EX la direction des petites affaires. J’accepte un double
reporting. La Division Système International intègre
le nouveau département.
Nous nous mettrons d’accord sur différents points, comme
la gestion des conditions d’expatriation que revendique le D.O.I.,
l’élaboration de méthodes générales
de vente. Elles sont destinées à éviter les difficultés
liées à l’imagination débordante de nos
commerçants, prêts, et c’est bien naturel, à
accepter à peu près n’importe quoi, pourvu que
le client signe le contrat. Le département transmission s’associera
d’ailleurs à cette réflexion qui va durer !
Cette organisation tiendra deux années, c’est une durée
normale entre deux organisations. Pendant ces deux ans, nous aurons
de très bonnes relations avec nos amis du D.O.I.
sommaire
Quelle est la situation de la compagnie ?
Ces efforts d’organisation de l’export se justifient d’autant
plus que la survie de la compagnie en dépend. En effet l’administration
des P.T.T. a réussi à combler le déficit téléphonique
du pays; ses commandes annuelles vont plonger de 2,5 à 1,2
millions de lignes. Il nous faut donc absolument nous tourner vers
l’international, et si possible grossir, d’où les
accords avec Thomson Téléphones. Le financement de nos
opérations par des crédits d’origine française
est très limité. Cela conduit à envisager des
implantations industrielles dans d’autres pays européens
(on voit là l’origine de la fusion avec I.T.T.). Si l’on
pouvait au moins réussir une superbe percée sur le marché
U.S. ! (d’où les efforts sur le E10 five,( nous alimentons
Alcatel U.S.en matériels), et le développement du E10S).
Le salut peut aussi venir de succès aux Indes ou en Chine.
Nous subissons une pressionconsidérable; les essais systèmes
effectués par les Indiens à Bombay-Worli doivent conduire
à la qualification du E10 pour le réseau indien. Dans
ce contexte, la réussite est capitale.
Ces essais vont durer plusieurs mois. G. Chevalier va les conduire
avec brio, mais l’inquiétude de certains chefs est perceptible.
Bombay-Worli -(1984-1985)
Il faut nous préparer soigneusement; nous ferons une validation
du système à Tréguier avec toutes les applications
proprement indiennes. Puis nous répèterons ces essais
à Bombay, avec des contrôles de performances, en compagnie
des clients et du S.C.T.T.
Suivront la «test period» puis la « running in period»
qui vont durer 6 mois avec des mesures de fiabilité. Nous validerons
aussi le cahier de recette qui sera applicable à tous les autres
commutateurs produits en France ou en Inde, ainsi que les règles
de dimensionnement adaptées aux spécifications indiennes.
De même, nous devrons développer un système de
collecte des données de traduction, des consignes en cas d’incident…
Pendant tout ce temps, les demandes du client pleuvent, souvent pour
des problèmes connexes, comme la gestion des alarmes d’énergie
ou de la transmission. Que faire des lignes d’abonnés
sièges de potentiels parasites ? Quelles sont les consignes
en cas d’incident, par exemple blocage du C.T.I.(Centre de traitement
des informations) ?
Parmi les tortures spécifiquement indiennes figure le «monkey
typing», c’est à dire la frappe du singe: imaginons
un singe devant le C.T.I., déchaîné sur le clavier,
le système ne doit pas se «planter». Or, à
Bombay, une femme de ménage, en laissant tomber son balai sur
le précieux clavier a réussi le coup du singe, le C.T.I.
ne répond plus……Ce qui n’empêche pas notre
client d’exiger 64 terminaux, alors que le système n’en
prévoit que 32...
Nous devrons lui donner satisfaction après une longue résistance.
Un jour, une tempête s’élève: les abonnés
raccordés sur des C.S.E. distants sont complètement
coupés de téléphone, lorsque la liaison M.I.C.
est interrompue. Il n’y a même plus de communication locale
à l’intérieur d’un même village ! …Voilà
qui va nous servir pour le C.S.N. (Centre Satellite Numérique)
en cours de développement; nous devrons installer un retour
automatique en communication locale, en cas de coupure de la liaison
M.I.C.
Les indiens ont un sens aigu du détail, sans doute l'ont-ils
hérité des britanniques. Ceux-là ont laissé
des traces profondes; un seul exemple: un jour, en visite aux usines
de I.T.I. (Indian Téléphones Industries) à Bengalore,
avec F. Tallégas nous sommes reçus par notre agent,
ex brigadier général, au cercle militaire. Dans le hall
un immense portrait de Wellington nous acceuille, c'est dur pour des
français !
Ce n’est qu’en avril 1985 que nous verrons la connexion
au réseau. Mais tout s’est bien passé, les indiens
parlent d’un second contrat……..
Quoi de neuf à la D.R.EX ?
Bombay n’est pas tout. La D.R.EX de Vélizy s’insère
dans notre dispositif, nous lui confions des tâches spécifiques:
D. Roselier crée le service des petites commandes (S.A.P.C.),
la multiplication de nos clients fait que leurs demandes génèrent
un flux de plus en plus important de produits consommables, introuvables
dans les pays clients. Bien sûr, c’est toujours urgent,
et bien sûr aussi, difficile de se faire payer…Ce service
couvre aussi les besoins de nos clients plus anciens qui ont acheté
du CP400, du Janus, des commutateurs “crossbar” télégraphiques,
et même un AXE (à Madagascar), fruit des bonnes relations
temporaires avec Ericsson. Les compétences du nouveau service
couvrent les produits transmission comme ceux de D.S.I.., objets de
nos contrats, et les mouvements liés aux réparation
des cartes.
D’autres s’occupent de définir des ateliers de réparations,
basés sur les probabilités de pannes de chacune des
cartes… Le retour en France des cartes en panne est en effet
un vrai problème (le transport, les douanes…); il vaut
mieux vendre au client un atelier de réparation, avec un jeu
de cartes en volant, qui évite 90% des retours (un échange
standard avec l'Inde dure 3 mois). Associés à ces ateliers,
nous définissons des «lots tampons» propriété
du service des travaux extérieurs, «les chantiers»,
qui évitent aussi le retour des cartes en panne pendant la
phase de mise en service.
En effet, les performances de la D.R.EX inquiètent: nos dépenses
représentent 140% des prévisions des projets (D.R.P.).
Nous recrutons un contrôleur de gestion, il est basé
à Vélizy.
C. Sarcy entreprend de définir une structure comptable de la
D.R.EX, cela prendra un peu de temps, plus tard, quand nous serons
à Tréguier nous aurons notre propre comptabilité
dirigée par S. Le Borgne. Nous finirons alors par avoir un
suivi permanent de l'évolution de nos dépenses sur affaires,
des présentations régulières faites par les ingénieurs
d’affaires: leurs bilans, les analyses des résultats,
les risques encourus (pénalités, pertes à terminaison…),
les «reste à faire».
Nous nous interrogeons sur l’origine de ces dérives.
Il y a beaucoup d’optimisme au moment des projets, surtout sur
le temps nécessaire à l’exécution des affaires.
Les bâtiments, quand ils sont à la charge des clients,
sont généralement en retard, s’agissant du commutateur
lui-même, ce retard nous arrange souvent, mais l’absence
de bâtiments pour les satellites nous bloque dans les pays bien
au delà de nos prévisions.
La pression des commerçants, au moment des offres, pour la
réduction des coûts, est systématique, elle est
de même fort importante pour donner satisfaction aux demandes
du client pendant la phase d'exécution.
Mais nous découvrons des dépenses qui ne sont jamais
budgétées, comme le transport des matériels de
la Transmission, l‘importance des heures de manutention, (sans
parler des moyens parfois inexistants sur les sites; une cassette
qui m’est destinée, me le démontre sur un site
népalais dans les contreforts de l’Himalaya), certains
achats, les surcoûts des transports liés à la
dispersion des livraisons, l'assistance technique gratuite dispensée
aux clients insuffisamment préparés…Il faudra beaucoup
de temps pour mettre d'accord les prévisions et les constats,
même après l’arrivée de Thomson…Nous
constituerons une petite équipe autour de L. Dubranna pour
affiner nos devis et nos catalogues de prestations.
Nous découvrons également que les comptables de la compagnie,
prudents, avaient cumulé, sans concertation, au fil des affaires,
200 millions de francs de provisions, qui n’avaient plus aucune
justification. Cela fait du bien au résultat de cette année-là.
Tout cela a quand même des conséquences positives: «on»
nous accorde quelques crédits, dits d’études libres.
Nous pourrons faire développer quelques outils spécifiques
pour les chantiers et l’ingéniérie. Ce dont nous
nous félicitons le plus est un simulateur d’appels (S.A.T.A.N.)
qui ne nécessite que quelques cartes à insérer
dans un C.S.E. et qui évite le transport , par avion, des SIMATs.
Ces énormes machines ne supportent pas les descentes d‘avion
souvent brutales. De même, un P.C. nous permet désormais
de saisir les données des sites et de les traiter localement
pour introduction dans les traducteurs. Auparavant il fallait faire
revenir les données à Lannion pour les traiter en centre
de calcul. Un configurateur de commutateur devient disponible sur
le C.T.I.; de même un simulateur de fonctionnement, en fait
un commutateur fictif sur le C.T.I., (qui peut en gérer 6),
permet à l'exploitant de se faire la main, sans risques…
C’est aussi à cette époque que se construit vraiment
la téléassistance aux clients.
Profitant de nos surfaces providentielles, nous pouvons organiser
à Tréguier, un espace qui regroupe les maquettes des
affaires en cours, ainsi qu’un C.T.I. Ces maquettes servent à
reproduire les défauts qui sont signalés par les chantiers
et les exploitants, mais aussi à prendre la main à distance
sur les commutateurs de nos clients, bien entendu avec leur autorisation,
pour établir un télédiagnostic, voire pour tenter
une intervention à distance.
Nous essayons de vendre ce service, sans grand succès (les
crédits qui seraient nécessaires aux clients désargentés
pour satisfaire à l’entretien et à la maintenance
des équipements, sont malheureusement inexistants, ils n'intéressent
ni les banques, ni le ministère des finances). Par contre,
nos ingénieurs et techniciens sont sollicités quotidiennement,
cet outil devient un accompagnement indispensable pour les agents
de nos clients insuffisamment familiarisés avec nos machines.
Cela nous permet de nous dégager plus facilement des sites.
Les décalages horaires nous conduisent à organiser une
présence 24h/24 avec des astreintes à domicile.
La téléassistance va même séduire la Direction
Générale qui, plus tard, trouvant là un excellent
argument de vente, voudra en avoir une à Vélizy . Elle
servira à prouver aux visiteurs, éventuels acheteurs,
combien la compagnie prend soin de ses clients.
Le Service Après Vente (S.A.V.) se constitue à Tréguier;
son catalogue est riche de 800 rubriques commutation, 100 S.E.M.S.,
150 Transmission, et quelques autres pour un total de 1200 “items”.
Plus tard nous le fusionnerons avec le S.A.P.C., quand ce dernier
sera transféré de Vélizy à Tréguier.
L’informatique de la D.R.EX, progresse un peu, en ce qui concerne
tout au moins nos besoins internes. Les connexions avec les informatiques
des services de production, de comptabilité générale,…restent
toujours à l’état d’espoirs malgré
les aides extérieures. La solution développée
par P. Larmor pour la D.R.EX. finira par s'imposer à l'ensemble
de la compagnie.
Les problèmes techniques se multipliant avec les affaires,
l’éloignement de Lannion, (malgré les excellentes
relations), l’entrée en scène des équipes
techniques de Vélizy, l’augmentation du nombre de systèmes
(nous sommes très impliqués dans les évaluations
des coûts de mise en oeuvre du E10S) nous conduisent à
regrouper sous la dénomination de Services Techniques Centraux
(S.T.C.) des activités assez diverses, en complément
des fonctions d‘interlocuteur de la Direction Technique:
- le bureau plan travaille en étroite liaison avec les services
commerciaux, nos propres services, comme avec tous nos fournisseurs.
Il élabore, grâce à des méthodes statistiques,
comme je l’ai dit plus haut, des plans de charges glissants pluriannuels
assez exacts, utiles à tous. Il est dirigé par R Le
Jop puis par P Rupert.
-l’informatique D.R.EX produit des configurations pour les principaux
systèmes, informatise les lancements, génère
les logiciels des sites, les dossiers d’installation, les métrages,
toutes fonctions qui allègent le travail de l’ingéniérie.
-la formation conçoit et fait exécuter par le C.C.I.
de St Ouen, (puis de Lannion) les cours théoriques et les stages
pratiques des exploitants-clients dans tous les domaines nécessaires,
y compris à la D.R.EX. Il en contrôle l’exécution
et le coût.
-la qualité, l’équipe chargée des produits
nouveaux, la gestion technique des produits installés, le support
à l’exploitation et à la maintenance de nos systèmes
sont aussi regroupés dans ces services .
-Ces services abritent aussi les responsables techniques d’affaires
qui viennent en aide aux ingénieurs en charge des contrats;
ils sont placés sous la direction de D.Guyomard.
La Chine (1984…)
L'énumération "incomplète"précédente
montre que bien des choses ont évolué depuis nos débuts;
notre organisation est devenue complexe. Nous sommes plus aguerris;
les contrats se multiplient. La Chine en est le plus bel exemple:
Pékin en E10B au palier 10, avec les premiers C.S.N., le langage
Chill, des tables d’opératrices type Sysope venant de
chez Thomson, les premières signalisation en C.C.I.T.T. n°7,
un produit capable d’un million de tentatives d’appels à
l’heure chargée, et de raccorder 2048 M.I.C.s. C’est
sans doute l’affaire où les problèmes techniques
et de développement ont été le plus imbriqués
avec la réalisation. Le nombre de paliers techniques, de versions,
les modifications des matériels, (avec le concours du client)
ont été nombreux pendant l'exécution du contrat.
L’équipe de la DREX doit sans cesse expliquer pourquoi
telle ou telle fonction attendue par BTA ( Beijing Télécom
Administration) n’est pas encore là, tout en obtenant
des centres techniques les modifications minimales, pour que l’exploitant
n’éprouve pas trop de difficultés (il y aura toutefois
trop de mises à niveau qui nécessiteront la coupure
du trafic). Il faut aussi faire attention à “sauver la
mise” des responsables chinois qui pourraient être critiqués,
voire plus, par leur hiérarchie, d’autant qu’il leur
arrive de faire des déclarations à la presse, sans nous
consulter. (comme 28.000 abonnés à la fin 1985 alors
que nos C.S.N. ne battent pas encore de l'aile en ce joli mois de
mai).
Le vocabulaire est très important. Les réunions durent
parfois quinze jours afin que chacun puisse présenter un compte
rendu, la tête haute. Nous sommes tous obligés de monter
au filet, y compris F. Tallégas. Nous devons compenser nos
défaillances, (elles sont nombreuses), car presque tout, à
Pékin, est une première, les blocages des C.S.N., ou
des C.T.I. , ou de la Transmission nous contraignent à réagir
très vite…On rêve aussi de Canton en E10S, (si tout
se passe bien au Rwanda ).
Mais la Chine est une aventure en soi, qui mérite d’être
comptée par les acteurs eux-mêmes. Après avoir
souffert dans les H.L.M. chinois du quartier Fa Tou, J.P. Lemaire
va prendre la direction des opérations sur le site; il réussira
à créer un excellent climat avec le client, je peux
même dire à faire naître des amitiés entre
nous, chinois et bretons ! On ira jusqu’à leur enseigner
les danses bretonnes.
C’est dans cet esprit que nous recevons à Paris les équipes
de B.T.A.(Beijing Télécoms Administration) Mais, alors
que nous sommes bien perçus à Pékin, nous sommes
piégés par le 14 juillet 1989... En juillet de cette
année, se tient en France une de nos réunions avec B.T.A.,
un des nombreux "high level meetings". Des fêtes somptueuses
sont prévues pour le bicentenaire de la révolution française,
parmi lesquelles un défilé grandiose sur les Champs
Elysées. Comment ne pas inviter nos visiteurs à ce défilé?
Nous leur promettons donc qu’ils assisteront à ce spectacle,
suscitant chez eux un intérêt bien visible.
Peu après avoir lancé cette invitation, nous découvrons
le programme de ce défilé… Il s’ouvre par
un char des dissidents de la république populaire de Chine
qui évoque la répression des étudiants sur la
place Tien an Men à Pékin du début Juin de cette
même année; les blindés écrasent "le
printemps de Pékin". Parmi nos invités, nous distinguons
des opinions qui semblent un peu différer (autant que nous
puissions en juger), mais il y a des marxistes convaincus, comme celui
qui nous demandera de le conduire au mur des fédérés
au père Lachaise. Comment faire?… Nous décidons
de revenir sur notre promesse et de leur proposer un spectacle différent:
la remontée de la Seine par une flotte composée des
plus grands voiliers du monde, à Rouen, manifestation qui participe
également de la célébration de l’anniversaire
de la révolution française et qui ne nous semble pas
devoir se produire de sitôt en Chine. Mais nous nous heurtons
à leur déception; il faut leur forcer la main pour les
emmener à Rouen ce 14 juillet. Ils ne comprendront que le soir,
à leur hôtel,en regardant la télévision.
Ils auront le bon goût de ne pas trop nous en vouloir…….
Mais revenons aux milieu des années 80…
sommaire
L’Epoque de la fusion avec Thomson Téléphones
(1984-1985)
La fusion et ses conséquences
C'est vers 1983 que l'on commence vraiment à parler de la fusion
avec Thomson Téléphones. Elle va prendre beaucoup de
temps. En novembre, on examine comment modifier l'organisation pour
préparer la fusion, un plan détaillé est prévu
avec pour objectif: mi-85. Comme je l'ai dit plus haut, il faut absolument
que nous nous développions à l'export. La nouvelle organisation
devra en tenir compte.
Je vais essayer de relater les principales étapes de cette
fusion qui va malheureusement s’accompagner de plans sociaux.
Je ne peux oublier combien ces opérations sont pénibles
et combien elles ont créé de difficultés au personnel
concerné, et parfois engendré des drames. Il faut rendre
hommage à tous ces sacrifiés qui, eux aussi, et malgré
eux, ont contribué au succès de notre aventure commune.
C'est fin 84 que la Direction Générale décide
de transférer à Tréguier, pour la mi 85, l'intégralité
de la D.R.EX de Vélizy. Cette mesure s'accompagne d'une réduction
de nos effectifs qui va être facilitée par ces déplacements
géographiques. L'effectif total de Tréguier va perdre
89 personnes et descendre à 573 (383 D.R.EX, 54 établissement,
42 G.P.I., 59 U.T.E., et 35 pour ce qui reste de la production). C'est
D. Langeron qui, à Vélizy, avant de venir dans le Trégor,
cherchera, avec succès, à "reclasser" les
44 qui ne veulent pas venir à Tréguier. L. Le Merdy
jouera le même rôle pour ceux qui vont quitter Tréguier.
Un bureau emploi est créé à cet effet, des espoirs
de créations de postes sur la zone industrielle
existent. Il faut s’occuper de chacun en particulier, l’aider
à résoudre le problème que nous lui posons et
surtout ne pas perdre sa confiance. Le DOI est lui aussi touché:
d’un total, avec la DREX, de 1.029 personnes à fin 85,
il doit se réduire à 840 à fin 87.
La fusion se poursuit pendant ce temps. La procédure légale
est engagée par la réunion des deux comités d’entreprise
à la fin septembre 85. La fusion sera effective le 31 décembre
1985. Elle concernera au total trente sociétés.
J.P.Meulin venant de L.M.T. Lannion, qui disparaît dans la fusion,
arrive à Tréguier, où il me remplacera, plus
tard, comme chef d'établissement.
Le nouvel ensemble aura un chiffre d’affaire de 7 milliards de
francs, y compris une part export totale de 2 milliards.
C’est aussi à cette époque que l’unité
de production de Guingamp est condamnée, (comme L.T.T. et T.C.T.)
et que nos premiers contacts avec Thomson conduisent à viser
deux pôles pour réaliser la fusion des équipes
export: l’un à Vélizy, l'autre à Tréguier.
Notre établissement doit regrouper à terme tout ce qui
concerne les réalisations, y compris le Service de l'Ingénierie
d'Environnement (S.I.E.) qui sera rattaché à la D.R.EX.
après avoir reçu les effectifs correspondants de Thomson.
Mais attention à ne pas le casser en route; en effet de nombreuses
défections s'annoncent, et B.Macé hésite, J.
Curvale finit par le rassurer. ! Nous venons de réussir à
créer le centre des Réalisations Internationales d'Alcatel
commutation à Convenant Vraz, c’est en tout cas ce que
nous indiquons sur les panneaux de signalisation qui permettent de
nous trouver, au milieu des prairies et des champs !
Les "cartes" commencent à s’abattre, bien entendu
les questions de personnes compliquent un peu les choses. Côté
Thomson, quelques "poids lourds" font de la résistance,
d’autres espèrent des améliorations dans le fonctionnement
car, à l’export ils ont trop souffert des "diktats"
de la Direction Technique Thomson qui leur imposait ses vues sans
discussion. Ils souffrent du Liban, d’Athènes…Nous
préparons des nominations croisées, des responsables
C.I.T. seront nommés à Thomson et inversement. C’est
mon cas et celui de J.M. Busy-Debat le 1er juin 1985. Ce dernier va
prendre, sous ma direction, le groupe des grands contrats, destiné
à remplacer la Division Système Internationale, responsable
des
réalisations en Inde, Irak, Jordanie, Egypte, Syrie, Afrique
du sud, Irlande, Liban et Chine.
Peu à peu tous ces contrats seront gérés directement
par la D.R.EX, en liaison avec les établissements locaux. Le
groupe des grands contrats disparaîtra (il renaitra en 1988),
J.M.Busy-Debat deviendra mon adjoint parisien, conservant ses ingénieurs
responsables d’affaires, qui seront intégrés dans
la nouvelle D.R.EX de Vélizy. Plus tard, J.M. Busy-Debat se
trouvera une affectation en dehors du D.O.I.. Environ la moitié
des effectifs sédentaires des réalisations de Colombes
viendra à Tréguier. P. Guichet est nommé à
la Direction Générale, C. Fayard nous quitte discrètement.
Nous le regretterons.
Il nous faut harmoniser les statuts des itinérants, prévoir
des surfaces tant à Vélizy qu’à Tréguier,
nous préoccuper des moyens pour faire les offres concernant
Thomson et le hors commutation, établir un tableau de bord
commun aux deux activités. Certains, ailleurs, doivent commencer
à réfléchir à une politique “produit
unitaire”, d’autres définir les conditions des transferts
de personnel. Le 13 juin 1985 sont annoncées l’ intégration
de D.R.EX dans le D.O.I., (et celle du S.I.E. dans D.R.EX); le 24
juin Thomson annonce le regroupement de ses réalisations avec
D.R.EX à Tréguier, sous deux ans maximum, mais les chantiers
viennent tout de suite, de même le groupe des projets industriels
est rattaché au D.O.I.. On fusionne également les établissements
d’Egypte et du Liban (J.J.Cornely nous quittant, est remplacé
par un local de Thomson :M. Haddad.).
E. Fouques vient à Tréguier, où il va diriger
le service des travaux extérieurs qui résulte de la
fusion. J. L’Huillier sera mon adjoint opérationnel à
Tréguier, un peu le pendant de J.M.Busy-Debat.
Le Département des Opérations Nationales déménage,
lui aussi, de Vélizy à la Verrière. (toute proche).
Les usines de mécanique et de connectique rejoindront la future
branche “composants”.
F. Tallégas devient Directeur Général Adjoint
de la branche commutation, P. Gourlay directeur technique avec un
directeur du développement ex-Thomson : C. Tournier qui a autorité
sur les centres techniques. Le Directeur des Produits sera F. Viard,
celui du marketing, A Le Bihan, et celui des affaires sociales, M.
Malapert. Les projets techniques (G.P.T.) dépendent désormais
de C. Tournier. C’est M. Garnier qui dirigera l’établissement
de Lannion. Voilà pour l’essentiel des changements qui
nous touchent de près. Il y en a d’autres…..et ce
n’est pas fini.
Nationalisation, privatisation (1981-1986-1987)
Après les élections présidentielles de 1981,
la compagnie est nationalisée. Viennent les élections
législatives de 1986 et le changement de majorité avec
la première période de cohabitation: nous sommes privatisés.
Ces changements sont sans incidence sur notre quotidien, cependant
nos présidents nous quittent. A chaque fois, leur sagesse a
prévu quelqu’un capable de reprendre le flambeau. A. Roux,
qui aimait tant le Trégor, au point de s’y faire enterrer,
avait G. Pébereau en réserve et ce dernier avait demandé
à P Suard de se tenir près à le remplacer. C'est
ce qui arrive en juillet 86.
G. Pébereau nous fait ses adieux par un communiqué où
il précise que la C.G.E., bientôt Alcatel, avait à
son arrivée, 18 années auparavant, un chiffre d’affaires
de 4,5 milliards de Francs et qu’à son départ nous
en sommes à 28,3 milliards.
Avant de partir, il nous révèle les accords qu’il
vient de «conclure avec I.T.T., d’une part, et A.T.T. et
Philips d’autre part», accords qui «débouchent
sur l’une des plus importantes opérations jamais réalisées»,
et qui doivent conduire à une «position de leader»
dans le monde des télécoms. Nous pensons tous que cela
n'aurait pu être si E10 n'avait pas réussi sa percée.
A quelques uns, il explique les raisons de ces grandes manoeuvres:
la taille critique pour la commutation se situerait à 8% du
marché mondial; seuls, après l‘apport de Thomson,
nous n’en avons que la moitié. Pour perdurer, il faut
donc grossir. Les accords vont nous le permettre et nous placer au
2ème rang mondial, avec12 %. Par ailleurs, I.T.T. possède
des marchés captifs dans toute l’Europe qui sont très
complémentaires des nôtres (31% en Allemagne, 80% en
Belgique, 75% en Espagne…). Le système 12, avec des variantes,
est déjà adopté par 20 pays, et A.T.T. va nous
ouvrir les Etats-Unis. La finalisation de ces accords sera longue,
prévient-il, et… sans lui. J. Curvale est appelé
rue Emeriau pour s’occuper de cette nouvelle fusion, et P.Caizergues
le remplace début 1987, la compagnie n’a plus trop besoin
de lui pour réussir la conquête des U.S.; le E10 Five
a peut-être vécu. (Voilà qui nous touche cette
fois de près).
Parallèlement, comme je l’ai dit, P. Suard va prendre
la présidence. Quelques jours avant, il entreprend une tournée
des établissements et vient donc à Tréguier le
2 Juillet. Nous lui présentons, tout l’après-midi,
le détail de nos activités. (F. Sampermans qui l'accompagne
seule et gère son emploi du temps, lui avait pourtant promis
une baignade en fin de journée à Trébeurden où
il a son hôtel). J’ai peur de l’ennuyer par trop de
longueurs, mais il a le bon goût de ne pas s’en plaindre
et dîne avec tous les chefs de service de la D.R.EX, le soir,
à Perros-Guirec. Je crois, bien qu’il évite tout
commentaire, qu’il est au fond assez satisfait de trouver un
établissement bien sensibilisé à l’export
et à ses difficultés, tout en regrettant que nous ne
soyons pas à Lannion. D’ailleurs, plus tard, à
au moins deux reprises, il m’en fera la remarque…Et, ce
déménagement finira par arriver. Les petits établissements
sont réputés onéreux !
Naturellement il s’adresse aux cadres pour leur annoncer que
nous devrons comprimer nos effectifs pour rester compétitifs.
Nous sortons d’un plan social, il va falloir recommencer, et
P. Guichet va s'en occuper activement. Le D.O.I. perd en effet, cette
année là, centmillions de francs de résultat..
Quelques effets collatéraux
P. Caizergues, en arrivant, obtient que le Groupe des projets techniques
soit intégré au D.O.I.. Toute l’équipe G.P.T.
de Lannion est donc mutée à Tréguier. Après
avoir préparé son arrivée, nous l’accueillons,
à la fin de l’été 87. Nous décidons
de fusionner les anciens services techniques de la D.R.EX avec les
projets. Il existe en effet pas mal de préoccupations communes
entre les activités de S.T.C. et celles de G.P.T. En ce qui
me
concerne, je trouve cette modification de l’organigramme positive.
Nous allons pouvoir orienter les responsables des offres vers des
fonctions de chefs de projets, dans le sens classique du terme, c’est-à-dire
des équipes plus proches des réalisateurs, avec l’espoir
de faire exécuter le contrat par celui qui en a fait le projet.
J. C. Hue prend la responsabilité de la nouvelle équipe
qui devient la Direction des Offres et des Services Techniques du
D.O.I. (D.O.S.T.). C’est l’occasion de redéfinir
ses missions, concernant les affaires, la prise en charge des produits
nouveaux, les aides au fonctionnement des services. Nous précisons
nos nouvelles interfaces avec la Direction Technique, qui s’engage
à nous livrer des produits validés, y compris quand
il s’agit de mises à paliers, (procédure dite des
100 "coups"). De notre côté les chantiers fournissent
désormais des rapports d’anomalies que la nouvelle D.O.S.T.
analyse et fait suivre, si besoin, à la D.T., avant de répondre
aux auteurs.
Les offres liées aux matériels ou aux prestations hors
commutation sont désormais élaborées par les
chefs de projets D.O.S.T., avec l'accord de l'ingéniérie.
Ce n’est pas forcément très facile; nous avons,
en effet, 139 fournisseurs extérieurs; pour une affaire type
comme celle de Gambie, nos coûts se partagent: 40% commutation,
7% transmission, 36% bâtiments et 17% environnement (les groupes
électrogènes, la climatisation…). Seuls les bâtiments
sont confiés à la petite équipe de M. Bouzid
(un ami de P. Guichet) qui est installée à Vélizy
et qui voudrait bien étendre ses prérogatives à
l’ensemble du “hors commutation”; B. Macé ne
se sent pas toujours à l'aise. M. Bouzid a parfaitement réussi
les bâtiments du contrat 11F d’Alexandrie (2 milliards
de francs), et la pose des câbles d’abonnés dans
la ville, grâce à une sous-traitance à l’armée
égyptienne. C’est un concurrent sérieux.
sommaire
L’après -fusion avec Thomson
Cette période concerne, évidemment, la préparation
des modifications qui vont suivre les accords avec I.T.T. Cette préparation
est longue et se passe à très haut niveau à Bruxelles
et rue Emeriau. Je n’y ai pas participé, et n'ai pas vécu
les incidences qui vont en résulter. Je laisse donc à
d’autres le soin de conter les conséquences sur nos équipes
de cette énorme opération qui va bouleverser le paysage
des industries des Télécoms en Europe.
En ce qui me concerne, je note seulement, depuis que nous sommes D.O.I.,
un triplement de mes besoins en cahiers de notes, ce qui semble signifier
un triplement des réunions où je suis convié,
ou que j'organise moi-même.
Le nouveau plan social (87-88)
Avant la fusion avec Thomson, la compagnie espérait que le
chiffre d’affaires export cumulé se situerait aux alentours
de deux milliards de francs. La réalité va être
différente. Le chiffre d’affaires de la D.R.EX de 1.229
millions de francs en 1986, tombe à 850 en 1987.
L’informatique, peu à peu, permet des gains de productivité
importants. Nos métiers changent. L’existence de succursales,
de filiales ou simplement d’établissements stables, rend
possible l’utilisation de plus en plus importante de la main
d’oeuvre locale. Nos personnels sur site doivent donc d'abord
encadrer, former, conseiller, superviser, transférer leur savoir
faire….et faire remonter toutes les difficultés qu’ils
rencontrent. L’ingénierie essaie de promouvoir des hommes
sachant accomplir sur place l’ensemble de ses tâches, pourtant
très diverses; il est de plus en plus question de réaliser
certains travaux d'ingénierie sur les sites où notre
présence dure. Tous ces facteurs vont dans le même sens:
la réduction des
effectifs.
Il faut, tout à la fois, préparer des licenciements
et savoir rassurer le personnel indispensable. Nous facilitons les
départs volontaires qui n’imposent pas de consultation
du comité d’établissement, nous recherchons des
transactions à l'amiable; tous les chefs de service sont mobilisés.
La méthode fonctionne, nos effectifs diminuent: les responsables
d’affaires passent, pour l’ensemble Vélizy et Tréguier,
pendant l’année 1987, de 106 à 65 personnes, les
services centraux de 73 à 55, les chantiers de 314 à
240. G.P.T. lui même perd 10 personnes, G.P.I., le Groupe des
Projets Industriels, qui est basé à Tréguier,
perd 16 personnes.
Nous ne sommes pas les seuls concernés, le C.C.I., centre de
formation de Saint-Ouen va être remplacé par une filiale:
l'institut de formation Alcatel (I.F.A.) et transféré
à Lannion.
Soguintel, l’unité de production de Guingamp va être
vendue par appartements. On commence même à voir les
prémices de la future concentration de la production à
Eu, et l'abandon progressif de Cherbourg.
Pourtant ces efforts restent insuffisants; fin avril 1987, M. Malapert
nous annonce: «Tréguier doit encore passer de 863 personnes
à 562 ». Que faire? Si on laisse la révolte se
développer, ce sera tout l’établissement qui risque
de disparaître. Il faut donc sauver ce que l’on peut sauver.
L. Le Merdy et J.P. Meulin vont être à Tréguier
les maîtres de manoeuvre.
Bien sûr, la manoeuvre ne concerne pas que notre modeste établissement.
P. Guichet nous explique:
« la stratégie tous azimuts à l’export est
finie, la majorité des pays ont fait leur choix de système,
la chute du dollar n’arrange pas nos affaires. Nous avons perdu
notre avance, il faut privilégier le fond de commerce. Nous
arrêtons notre politique d’entrée aux U.S. La course
technologique lancée par A.T.T. pour se garder le marché
des sociétés issues de Bell (les B.O.C.), coûte
très cher. Nos résultats sont la moitié de ce
qu’il faudrait, il faut serrer la gestion à fond»
La société qui va suivre la fusion avec I.T.T. devra
gérer 3 lignes de produits: E10B, E10MT, et S12. (l’objectif
serait d’évoluer vers un seul produit d’ici 15 années).
On abandonne le système E10S, il va falloir, malgré
toute l’énergie dépensée, retransformer
nos marchés et nos installations en cours en E10B.
Bien entendu, il faut adapter nos effectifs aux charges, baisser les
prix de revient des ventes, se préparer à la dérégulation
irréversible des marchés préparée par
Bruxelles et parles services américains.
Un comité central d’entreprise est convoqué pour
le 3 juin 1987. Treize établissements sont concernés.
Les comités d’établissements seront tenus pendant
le mois de juillet. Il faut encore susciter des départs volontaires,
le bilan sera fait fin octobre…Nous mobilisons toutes nos forces:
«tout le monde doit chercher du travail à tout le monde».
Nous obtenons que les primes de départs soient majorées
pour tenter d’éviter les «licenciements secs».
Il n’y aura bientôt plus qu’une seule usine, le regroupement
du matériel dans le Trégor ne s’impose plus, l’U.T.E.,
dont nous étions fiers à Tréguier, va disparaître.
Son personnel, soit nous quitte pour monter une entreprise de caisserie,
en rachetant les équipements de l’U.T.E, soit est repris
par les sociétés de transport qui vont bénéficier
de marchés de la compagnie.
J’ai rencontré depuis des marins trégorois qui
m’ont dit quel plaisir ils avaient à lire "Convenant
Vraz" sur les caisses qu’ils devaient transporter à
l’autre bout du monde. Ce bon temps est fini.
Nous ne négligeons rien pour atteindre l’objectif, avec
le minimum de douleur: cabinet d’”outplacement”, convention
avec l’A.N.P.E. qui nous communique les postes ouverts à
sa connaissance, jour par jour, avec l’A.F.P.A. qui dispensera
les formations nécessaires. Nous avons aussi un cabinet de
réorientation, un conseiller financier pour ceux que la création
d’entreprise tenterait…Notre cellule pour l’emploi
ne se limite pas à signaler les postes disponibles, elle va
jusqu’au placement des personnes.
Certains se lancent dans des créations d’entreprises,…Une
entreprise de montage cablage, que nous ferons travailler, une crêperie,
une mercerie, une gérance de grande surface, l’hôtellerie,
une unité de fabrication de cuisines, et même… un
élevage d‘escargots…
Fin août, nous entrevoyons 80% du résultat. Peut-être
est-ce dû à certains raisonnements comme celui que me
confie un père de famille: «je suis jeune, j’ai
trente cinq ans, mon épouse ne travaille pas, j’ai 2 enfants,
je considère que je prends plus de risques en restant qu’en
partant». "On" en profite, "on" nous demande,
fin septembre, de faire 30 départs additionnels à Tréguier.
Nous réussirons à éviter les "licenciements
secs". Mais, que de souffrances ! Le D.O.I. passe ainsi de 905
à 612 et la D.R.EX., avec G.P.T., de 743 à 506 personnes.
Au moins avons-nous sauvé nos missions dans le Trégor.
P. Guichet, en effet, déclare en janvier 88: «il n’y
aura pas de remise en cause de la localisation des activités
».
J’ai peut-être abusé de la patience du lecteur;
évoquant ces périodes pénibles, mais il ne faut
pas oublier que ces sacrifices font aussi partie de notre histoire,
même s’ils ont été dus aux fluctuations des
marchés, de la technologie, et des accords industriels.
sommaire
Le E400
L'aventure du E400, bien que tout à fait distincte de celle
du E10, s'y rattache par ses acteurs, sa technologie, et le fait qu'elle
ait été considérée, pendant un moment
comme un moyen de pénétration dans des pays susceptibles
de nous acheter du E10. C'est pourquoi j'ai pensé qu'elle devait
avoir sa petite place ici.
Le développement du réseau téléphonique
français a conduit au changement du plan de numérotation
national. Pour créer de nouveaux abonnés, il fallait
des numéros de téléphones disponibles. L’opération
devait se faire en une seule nuit. L’administration des P.T.T.
chargea donc la compagnie de développer un système électronique
capable de se substituer instantanément aux traducteurs et
aux taxeurs électromécaniques. L’ homogénéité
du réseau français minimisait les études, (ce
modèle nous a peut-être abusés). Les travaux d’adjonction
des équipements nécessaires durèrent deux années.
Le moment venu, après une campagne de sensibilisation télévisée,
l’opération se déroula merveilleusement bien, en
quelques heures !
Pourquoi ne pas en profiter pour faire de nouvelles affaires à
l’export ?
Nous tentons l’Union Soviétique. Visiblement, ces messieurs
n’étaient pas du tout concernés par le problème,
malgré les efforts du responsable France-Télécom
du changement de plan de numérotation que nous avions convié
à nous accompagner. Les questions portaient sur le système,
le réseau de connexion…mais pas sur le changement de plan
de numérotation. Peut-être parce qu’il n’y
avait en face de nous aucun spécialiste du
réseau, bref ce fut un voyage pour rien. Nous eûmes davantage
de chance avec les mexicains qui voulaient obtenir plus de souplesse
dans l‘exploitation de leur réseau.
Ce réseau mexicain est très disparate, (plus que nous
le pensions), mais nous comptons bien nous incruster au Mexique grâce
à ce produit original. Nous envisageons même une collaboration
avec Indetel, la filiale d’I.T.T. dans ce pays. Cette société
ne nous voit pas revenir avec beaucoup de bienveillance; elle ne se
mobilisera pas beaucoup pour nous faciliter la tâche.
Il faut développer ou adapter nos produits pour les nombreuses
villes où nous devons intervenir; les commutateurs ne sont
pas au même état technique d’une ville à
l’autre de ce vaste pays. Et pour certaines villes comme Morelia,
la capitale de l’état du Michoacan, nous nous trouvons
devant quatre systèmes différents, sans compter les
variantes. Cela nous coûte beaucoup en études, supportées
vaillamment par le technique de Vélizy…Mais quels beaux
voyages ! C’est ainsi qu’un week-end, sur la plage d’Acapulco,
qui est un de nos sites, nos bretons découvrent qu’ils
sont assis à côté du président des bretons
du Mexique. Quelle fête…le monde est si petit !
sommaire
Adieu la D.R.EX !
F. Tallégas m'avait un peu alerté, quelques jours auparavant,
mais je ne pensais pas assister à pareille attaque, ce 25 mars
1988, quand P. Guichet nous réunit, F.Tallégas, P. Caizergues,
J.C. Hue, M. Bouzid, E. Fouques et moi.
Voilà quelque temps que la D.R.EX. et G.P.T. ont rejoint le
D.O.I.. P. Guichet s'impatiente en attendant une réorganisation
qui améliore les coûts, surtout au niveau des prévisions
en vue des offres. «Nous n'avons pas pu réduire de 50
% les prix de revient de l'environnement, (autre vocable pour parler
du “hors commut”) il faut que l'environnement tombe à
moins de mille francs la ligne installée». Selon lui,
c'est donc le coût de l'environnement qui est la cause de la
baisse des prises de commandes.
L'ingénierie est dirigée, depuis son retour à
Lannion, par B. Macé, qui continue à gérer, au
mieux, les questions d'environnement. Ce service est la cible de M.
Bouzid qui prétend qu'il travaille sur des domaines en dehors
de sa compétence. Cela explique ce manque de compétitivité.
D'après M. Bouzid, il faut donc confier à sa petite
équipe cette responsabilité et le problème disparaîtra.
P.Guichet ira dans son sens, pendant plusieurs années,... mais,
tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse
!
P. Guichet ne veut plus entendre parler d'ingéniérie:
il faut regrouper dans une Direction des Réalisations Internationales
(la D.R.I.), les chantiers, les ingénieurs d'affaires, ainsi
que la fraction de l'ingéniérie qui travaille en direct
sur les affaires.
Il ajoute: «L'après-vente ne marche pas, il faut créer
un service après-vente qui n'ait rien à voir avec l'avant-vente,
qui soit au même niveau et qui soit situé en partie à
Paris»
Le D.O.I. doit être composé d'une Direction Commerciale
avec J.J.Vialla, d'une Direction Technico-commerciale (l'ex D.O.S.T.)
avec J.C. Hue, d'une Direction des Réalisations avec E. Fouques
et enfin d'une Direction de l'après-vente avec B. Macé.
(Ce qui reste de l'ingénierie sera désormais placé
sous la direction de G. Cloâtre).
Quant à moi, je me retrouve adjoint de P. Caizergues pour m'occuper
des grosses affaires, des filiales, et... encore un peu de l'établissement
de Tréguier.
C'est ainsi que j'ai vu disparaître, avec regret, la D.R.EX,
désormais éclatée. La nouvelle organisation va
fonctionner dès le mois de juin et certains ingénieurs
d'affaires seront même satisfaits de l'accroissement de leur
responsabilité et de leur pouvoir sur le déroulement
des affaires.
.
Le "coup de poing" du Mali (illustration de la maîtrise
acquise par les équipes) Le 15 août 1988, dans la matinée,
je reçois chez moi, à Perros-Guirec, un coup de fil
de P. Duchateaux, le commercial Afrique, «l’unique commutateur
de transit international du Mali vient de brûler cette nuit,
à Bamako. Ce pays est coupé du reste du monde, j’ai
été prévenu par le Quai d’Orsay qui a reçu
un appel au secours par radio. Que pouvons nous faire?».
Je passe mon 15 août au téléphone. Vers le soir
une piste se dégage. Tout d’abord, nous connaissons les
codes de signalisations à utiliser, notre bibliothèque
de programmes en recèle plusieurs. Nous pouvons faire fabriquer
les G.A.S. nécessaires. France-Télécom est d’accord
pour nous prêter, (ainsi qu'aux Maliens), une de ses remorques
Mobidix dont j’ai parlé plus haut. Il y avait aussi des
abonnés sur ce commutateur, il faudra donc installer quelques
C.S.E.
Il faut consolider tous ces espoirs. Dès le 16 août,
les techniciens du centre technique de Lannion, chargés de
l’étude du problème puis des modifications indispensables,
s’envolent vers Bamako.
Si les matériels en caisse peuvent être expédiés
par les moyens classiques, il n’en est pas de même de la
remorque. Nos logisticiens se mettent à la recherche d’un
avion. Le Gupi d’ Airbus, qui transporte des éléments
de carlingue d’Hambourg à Toulouse, est trop petit.
Cette remorque fait 4 mètres de haut et pèse 15 tonnes.
Après une recherche, nous finissons par nous arrêter
sur un avion d’une compagnie britannique, Heavy Lift, qui dispose
d’une soute de… 4,06 mètres. Il existe un programme
informatique qui simule les opérations de chargement, la simulation
conclut que l’opération est peut-être possible,
sans qu’on nous le garantisse, mais cet avion est le plus gros
que nous ayons trouvé, alors ?….
Le 24 août, l’avion se pose sur l’aéroport
de Brest, en même temps que la remorque arrive. Le chargement
s’avère difficile, il faut démonter les roues.
La remorque rentre dans la soute en roulant sur ses essieux. Le commandant
de bord ordonne la fermeture de la trappe, va-elle se fermer?…
Oui,… mais les témoins racontent que, une fois la trappe
verrouillée, il ne reste que 2 millimètres de jeu.
Le 25 août l’avion arrive à Bamako.
Notre chef de mission, M. Prado, qui accompagne la précieuse
remorque, avec un caméraman d’Alcatel, est attendu sur
l’aéroport par l’ambassadeur de France, le ministre
des Postes et Télécommunications du Mali et toute une
cohorte d’officiels dont de nombreux et inévitables militaires.
M.Prado improvise un discours, pour répondre aux souhaits de
bienvenue du ministre, qui se félicite de l’exemplarité
de cette coopération Nord-Sud !….
Tout s’achève heureusement pour le ministre,(peut-être
bien que son portefeuille était en jeu…).La remorque roule
vers sa place,proche du malheureux commutateur incendié, encadrée
par la police motocycliste, toutes sirènes hurlantes.
Le 26 août à 13 heures 30, les raccordements de câbles,
préparés par l’équipe de J. Nabonne, déjà
sur place, peuvent débuter.
Le 28 août, le complément de matériel arrive par
l’avion cargo d’U.T.A., en même temps qu’une
deuxième équipe de techniciens. Le 29, les raccordements
sont terminés. Le 30 août à 0 heure les communications
internationales sont rétablies, le Mali n'est plus coupé
du monde.
Cette opération "coup de poing" (plus tard le vocable
deviendra, sous l'influence de certains, revenus des U.S., "crash
program") est la plus spectaculaire que j’ai vécue.
Elle démontre la maîtrise acquise par les équipes
de Lannion, comme de Tréguier, au fil des années.
Un film a été tiré de cette aventure, à
la gloire des équipes d’Alcatel. Je reprocherais à
ce film d’ignorer le travail du personnel de la direction technique.
Le caméraman d’Alcatel ne devait pas avoir l’habitude
du travail indispensable mais obscur des techniciens lannionnais.
Dans cette affaire, la dimension sensationnelle ne se révélait
que lors de la solution de nos problèmes logistiques, et pourtant
!
sommaire
Lexique
AFPA Association formation professionnelle des adultes
A.I.L. Alcatel Irland Limited
Altech Société de télécom sud africaine
A.M.O. Agence Maritime de l'Ouest, notre courtier en Douane
ANPE Association nationale pour l’emploi
AOIP Association des ouvriers en instruments de précision,
avait une activité télécom
ATI Alcatel Trade International
ATT American Téléphone and télégraph
AXE Commutateur développé par Ericsson Suède
BOC Bell Operating compagnies, Sociétés résultantes
du démantellement de la Cie Bell
BTA Beijing télécom administration
CCI Centre de formation CIT de st Ouen
CCITT Comité consultatif International des télécommunications
CFDT Confédération française du travail
CGA Compagnie générale d’automatismes, une société
du groupe CGE
CGE Compagnie générale d’électricité,
va devenir Alcatel
Chill Langage informatique préconisé par le CCITT pour
l’écriture des logiciels de commutation
CIT Compagnie industrielle des télécommunications, société
du groupe CGE, puis Alcatel
CITEREL
CIT-Ericsson-electronique
CNET Centre national d’études des télécommunications
CSA Concentrateur de ligne d’abonnés satellite de typeA
CSB Concentrateur satellite de type B, raccordait les Télics
CSE Concentrateur satellite électronique, remplacera les CSA
et CSB
CSN Centre satellite numérique, remplacera les CSE
CTI Centre de traitement des informations
DAI Direction des affaires internationales qui remplace la DEX
D.C.M.E. Direction Centrale du Matériel..., en fait des ateliers
des P.T.T. basés à Lorient
DEX Direction commerciale export
DGT Direction générale des Télécoms (administration)
Le DGT Le directeur général des télécoms
(administration)
D.I. Direction Industrielle
DMM Division de développement des matériels
DOI Département des opérations internationales
DON Département des opérations nationales
DOST Direction des offres et des services techniques (du DOI)
DRC Département des réalisations de centraux (commutateurs)
DREX Division de réalisation export
DRT Direction régionale des télécoms (administration)
DSI Division système internationale, sera absorbée par
DOI DREX
E10A Première génération de commutateurs électroniques
E10B Deuxième génération de commutateurs électroniques
E10 five Commutateur développé pour les réseaux
nord américains
E10 cinq Devait être un commutateur de remplacement du E10B
E10MT Commutateur développé par Thomson, après
la fusion fut organisé pour recevoir des CSN, voir MT20
E10S Synthèse inachevée des E10five et des E10cinq
EMA Equipement de modulation d’abonnés, développé
par AOIP, concurrent malheureux du CSE
Erlang Unité de mesure du trafic téléphonique
GAS Groupe d’adaptation des signalisations entre centraux de
différents types ou générations
GPI Groupe des projets industriels, passera de la direction industrielle
au DOI
GPT Groupe des projets techniques, passera de la direction technique
au DOI
GSM Groupe de synchronisation des multiplex, (regroupement de circuits
téléphoniques)
ITT International téléphone and télégraph
Janus Système de commutation développé par CIT
avant la fusion avec SLE
LMT Société le matériel téléphonique,
sera absorbée par Thomson Téléphones
MAP Opération de mise au point, en plateforme
MIC Système de modulation et de codage permettant à
32 voies téléphoniques d’emprunter le même
circuit physique
MT20 Voir E10MT
Northern Northern télécoms: Société canadienne
de télécommunications
NSM Banque Neuflise-Schlumberger- Mallet
NSS Normes et spécifications de service, cahier des charges
de l’administration française
OC Ordre de Correction
Pentacont Système de commutation électromécanique
crossbar
P.T.T. Administration française des postes et télécommunications,
deviendra la société France-Télécom.
Rotary Système de commutation électromécanique
SAPC Service des approvisionnements et des petites commandes (DREX)
SAPO South african postoffice
S.A.T. Société Anonyme des Télécommunications,
une société du groupe Sagem
Satan Simulateur d'appels téléphoniques utilisant un
CSE comme outil de base
SAV Service après vente
SCTT Service du contrôle des télécommunications
(administration)
S.E.M.S. Société qui nous a fourni en O.E.M. tous nos
calculateurs Mitra
SIE Service d’ingénierie d’environnement (DREX)
SIMAT Simulateur d’appels téléphoniques
S.L.E. Société Lannionnaise d'Electronique
Sofrecom Société française de télécoms
(administration)
Strowger Système de commutation électromécanique
Teletra Société de télécommunications
polonaise (Poznan)
Telmex Téléphonos de Mexico (Administration mexicaine)
Teltech Société sud africaine qui deviendra Alcatel
Altech Technologies
TNE Terminal Numérique d'Extrêmité, permet de
concentrer sur un MIC 30 circuitsclassiques
U.R.A. Unité de Raccordement d'Abonnés
11F Système de commutation à commande centralisée
développé par Thomson Téléphones
sommaire
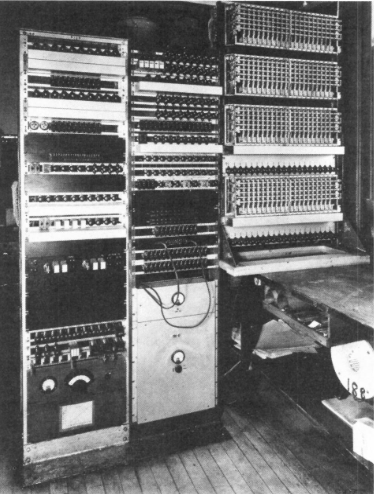 Modèle 2
Modèle 2 
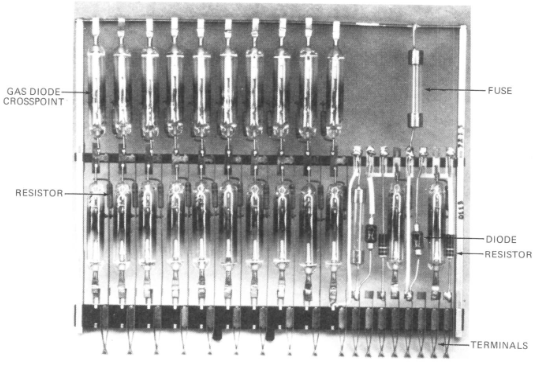
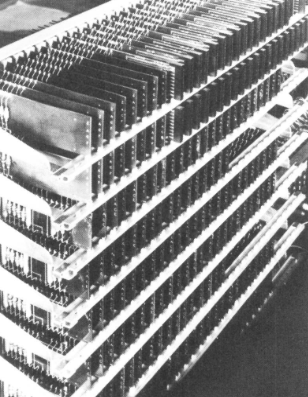
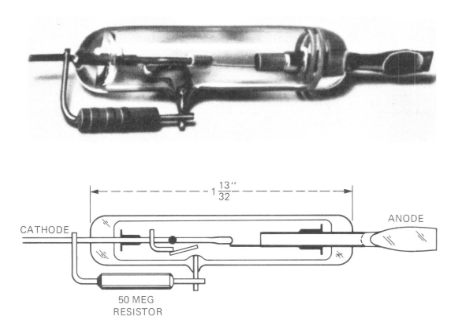

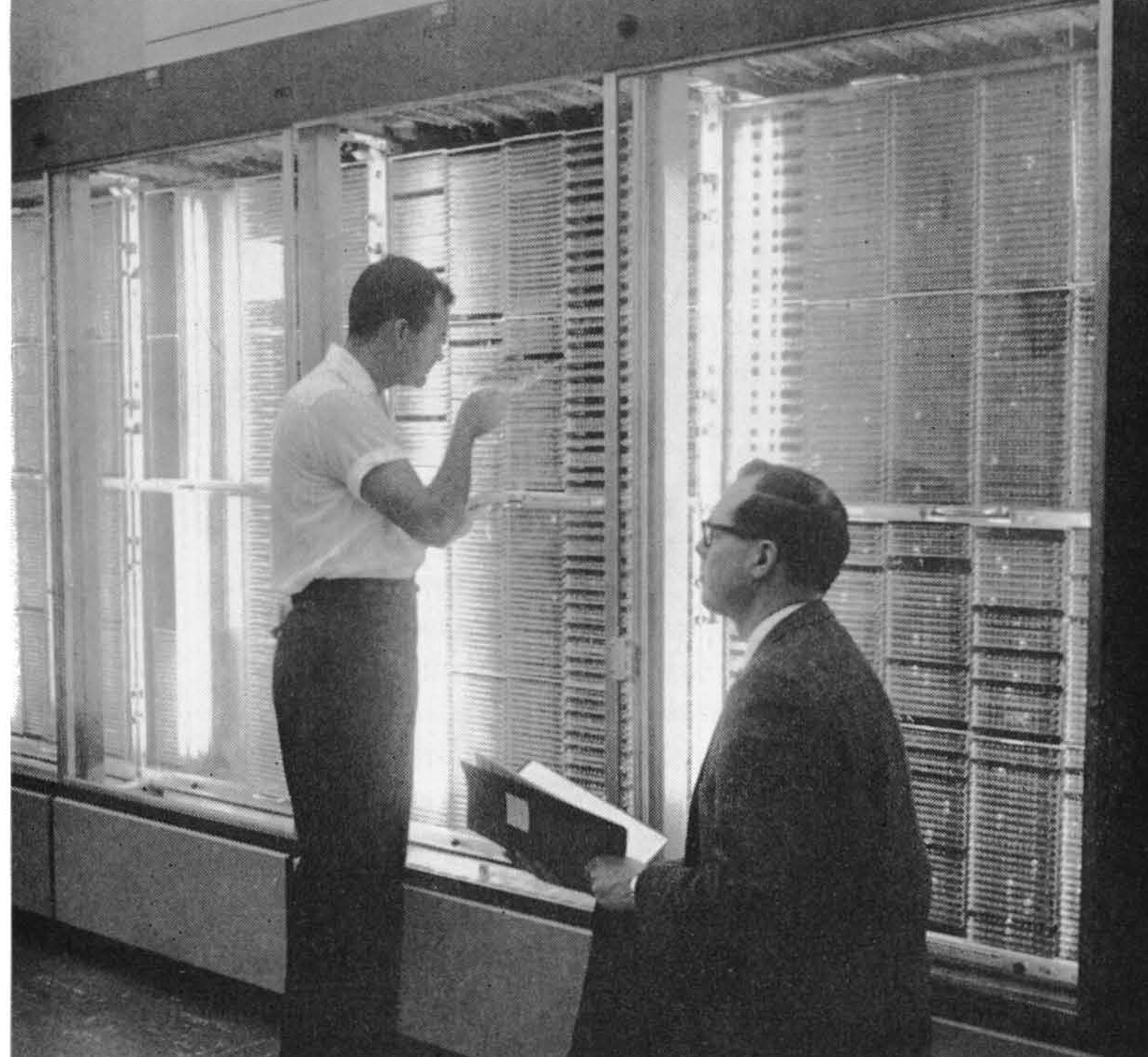
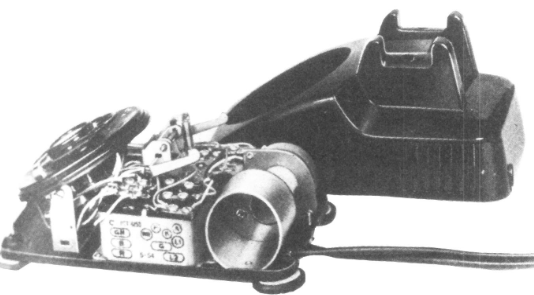


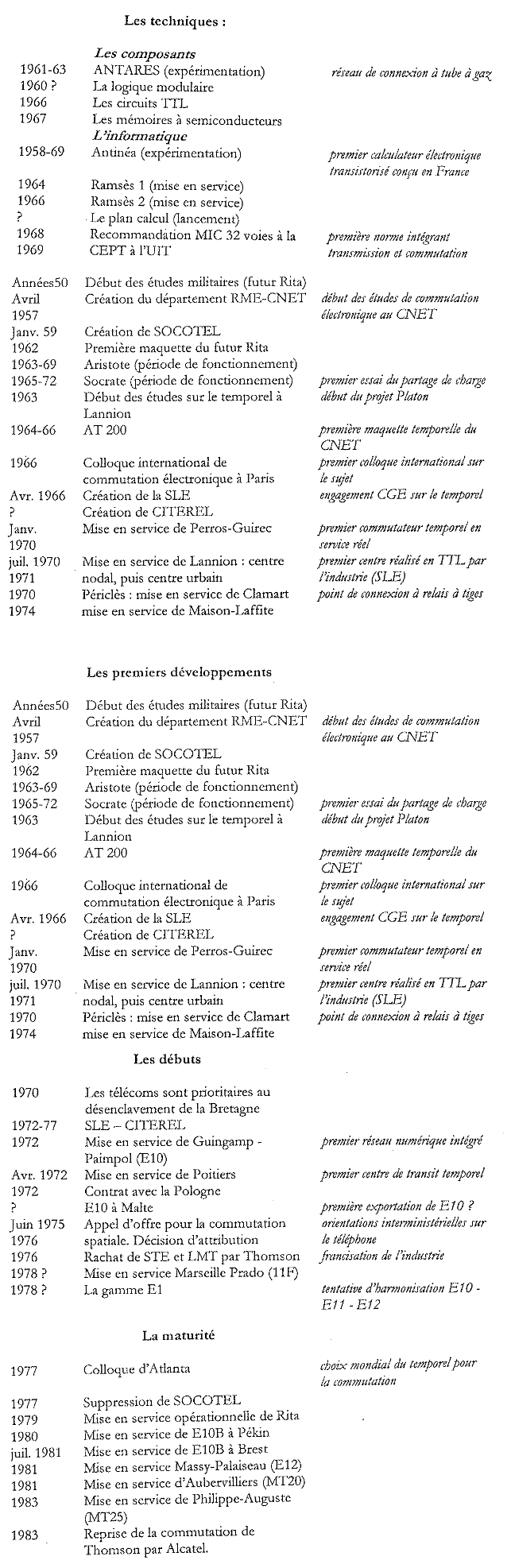





 Visite du président de Gaulle.
Visite du président de Gaulle.  Ouvrières de l’électronique.
Ouvrières de l’électronique. 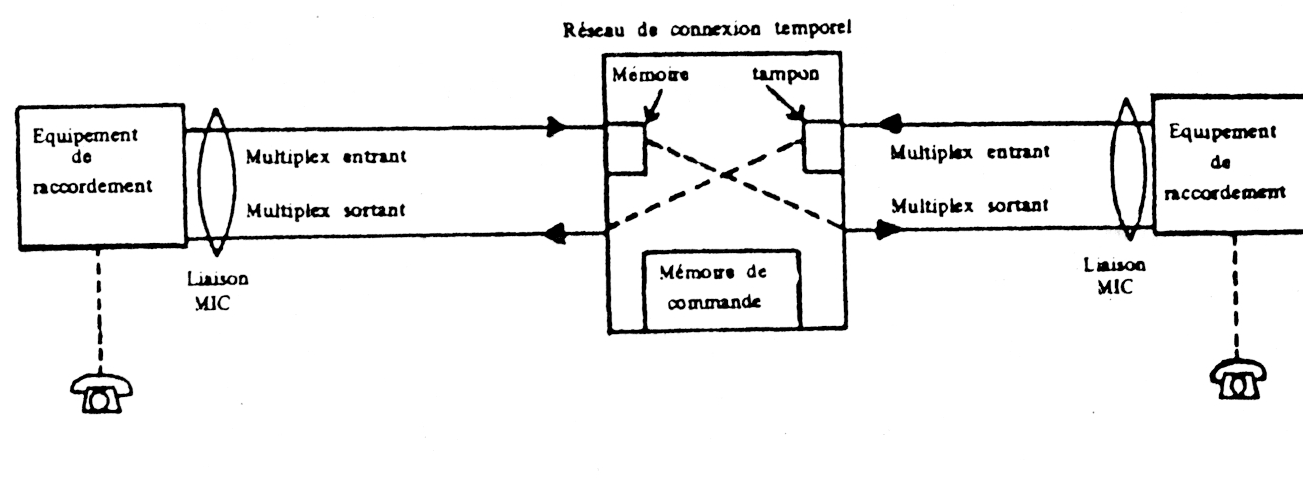

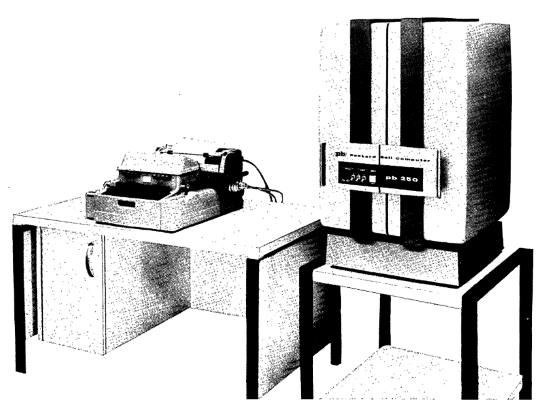
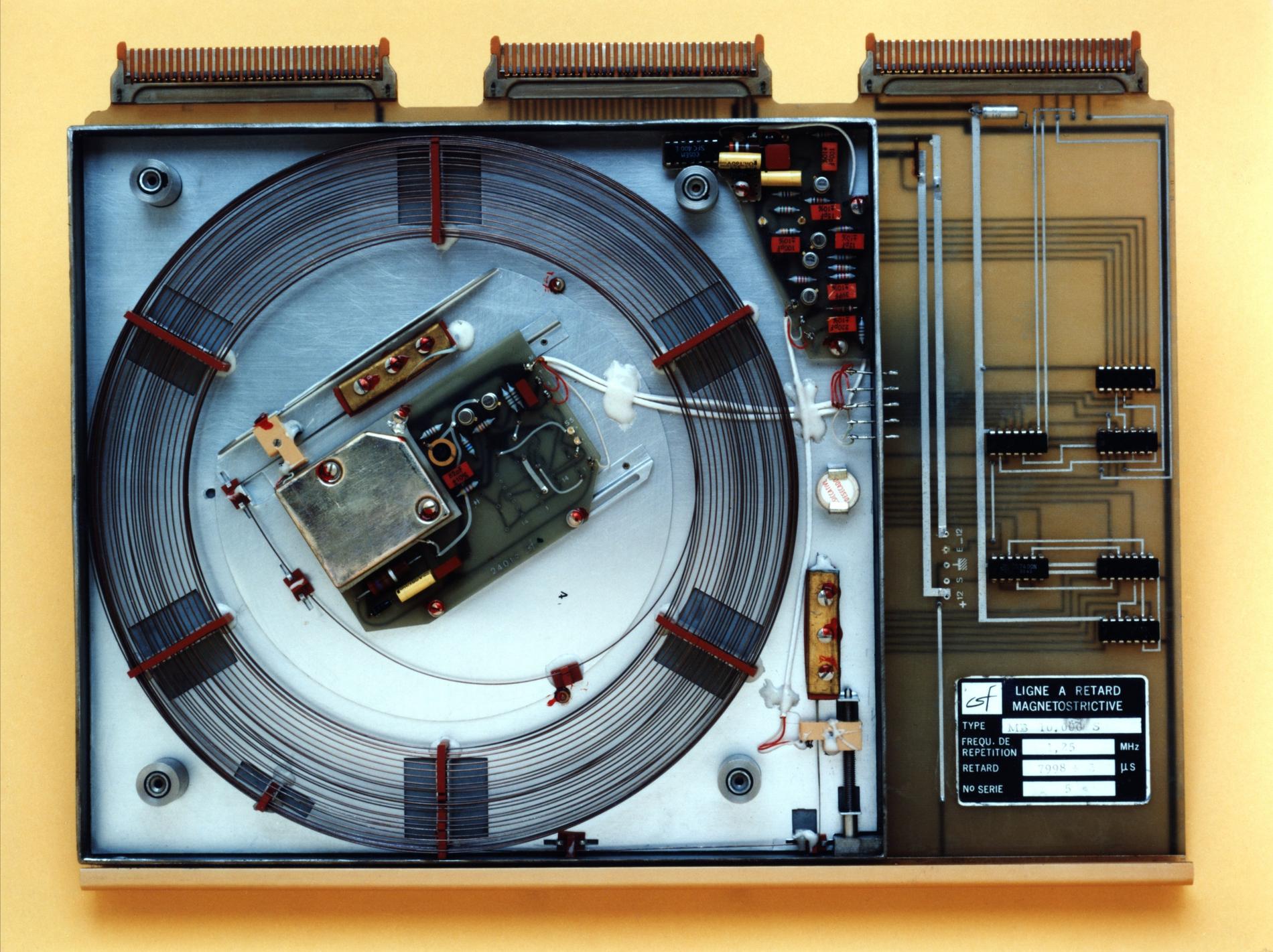
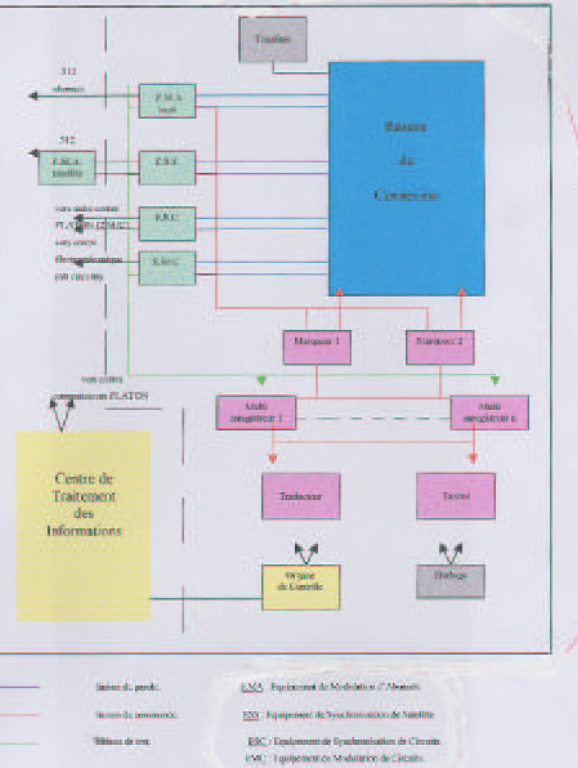 Diagramme simplifié de PLATON
Diagramme simplifié de PLATON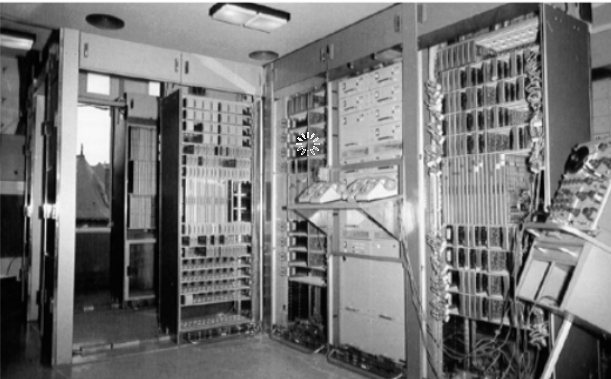





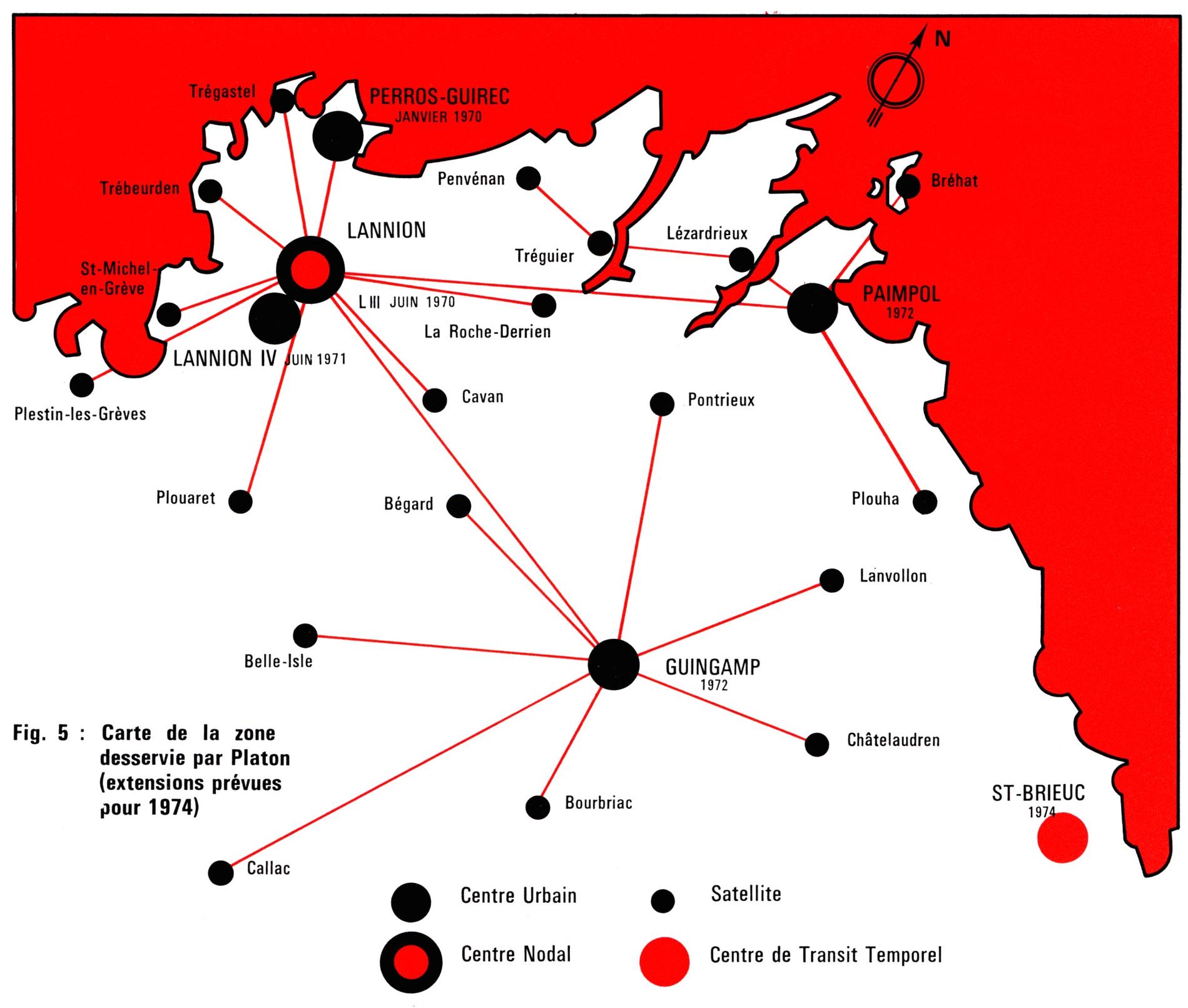
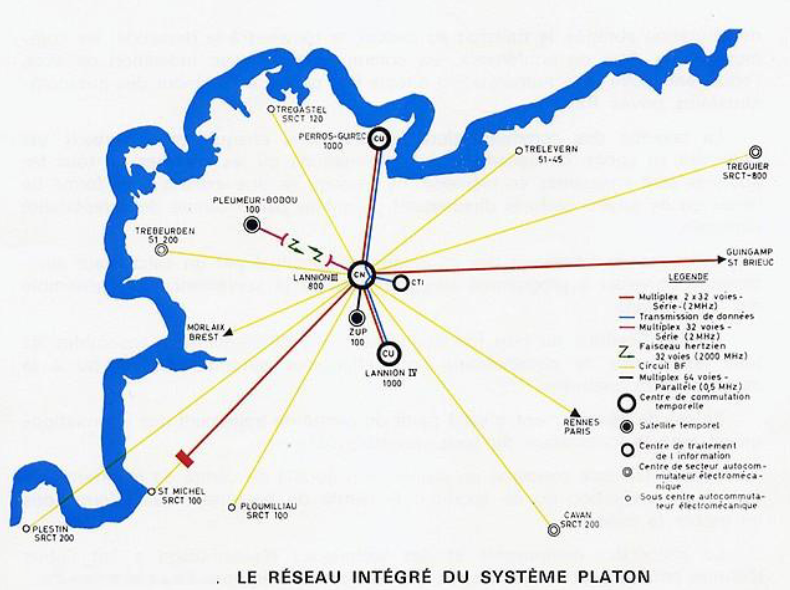
 Vue aérienne des établissements de Lannion.
Vue aérienne des établissements de Lannion.