KELLOGG
Milo Kellogg 
Milo Kellogg est né à Rodman, dans l'État de New
York, en 1849 et a obtenu ses diplômes d'AB et d'AM à l'Université
de Rochester en 1870. Il a commencé sa carrière dans les
communications téléphoniques en 1872 et a été
un pionnier dans la conception, le développement et la production
d'appareils et de circuits. Il était inventeur, superviseur,
surintendant, directeur général et président. Il
était une personne aux nombreux talents exceptionnels et en effet
un génie inventif.
En 1872, il rejoint la Western Electric Company et devient directeur général en 1882. Il devient ensuite président de la Central Union Company et de la Cumberland Telephone Company. Entre 1888 et 1890, il établit les spécifications des systèmes de commutation magnéto-multiples et dépose près de 150 demandes de brevet au bureau des brevets.
En 1897, Milo Kellogg fonde et devient le premier président de Kellogg Switchboard & Supply. En 1898, le premier standard téléphonique à 800 lignes est installé. En 1899, Milo Kellogg établit un record national en déposant 125 brevets en une seule journée. En 1905, il obtient le brevet du « Grabaphone ». Véritable génie inventeur, il est le pionnier de la téléphonie. Il décède en 1909
Si Elisha Gray est le génie
sous-estimé de l’histoire du téléphone américain,
l’obscurité de Milo Kellogg doit être considérée
au moins deux fois plus injuste. Pour un homme autrefois considéré
comme « synonyme de l’histoire téléphonique
du pays », Kellogg a depuis vu sa réputation enterrée
par le temps et son nom usurpé dans la culture par ces vendeurs
de corn flakes de Battle Creek.
Alors, que savons-nous vraiment du fondateur de la Kellogg
Switchboard & Supply Company en 1897 ?
D’abord, il n’était ni un précurseur
ni un personnage secondaire dans la naissance de l’industrie moderne
des télécommunications. Milo Kellogg était là
dès le début, travaillant directement avec Elisha Gray
lui-même dans la jeune entreprise qui allait bientôt devenir
Western Electric .
Il était arrivé à Chicago en 1870, six ans avant
la délivrance du premier brevet de téléphone américain,
à l’âge de 21 ans, tout juste sorti de l’Université
de Rochester.
En 1872, il rejoint la Western Electric Company et devient directeur
général en 1882.
Dans les bureaux de Gray et d’Enos Barton, Kellogg a rapidement
trouvé sa place, bricolant des circuits et changeant peu à
peu le monde. Il était là, en tant que directeur de la
fabrication, lorsque Gray est entré en guerre avec Alexander
Graham Bell pour ces droits de brevet vitaux
sur les téléphones en 1876, et il était toujours
sur place lorsque Western Electric a été racheté
par la victorieuse Bell Company en 1882.
Kellogg inventa même un standard téléphonique
qui allait devenir la référence de Bell pendant des années
(voir en fin de page). Mais au fil du temps, les vieilles rivalités
ont perduré. L’American Bell Telephone Company était,
à bien des égards, l’empire du mal de cette époque,
et Kellogg se lassa bientôt de ses maîtres monopoleurs.
En 1889, à l’âge de 40 ans, il quitta Western Electric
et entra hardiment dans les rangs indépendants, occupant des
postes de direction au sein de la Great Southern
Telephone & Telegraph Co. et de la Central
Union Telephone Co. de Chicago. Son principal objectif, cependant,
restait davantage la recherche et la science que le côté
commercial des choses. La seule façon de renverser un géant
de la technologie comme Bell, il le comprenait parfaitement, était
de les surpasser en technologie.
Kellogg était devenu le maître incontesté
du standard téléphonique et avait aidé d'innombrables
opérateurs indépendants à obtenir des systèmes
téléphoniques de qualité et durables, en particulier
dans les petites villes qui n'étaient pas sous la coupe de Bell.
Ces efforts n'ont fait qu'augmenter lorsque de nombreux brevets téléphoniques
originaux de Bell ont commencé à expirer en 1893.
Au cours des années suivantes, Milo Kellogg a accumulé
près de 150 brevets, soit plus que Gray et Bell n’en ont
accumulés au cours de toute leur carrière. Il a également
marqué un tournant majeur dans l’industrie lorsqu’en
1897, il a aidé la Kinloch Telephone Co. de Saint-Louis (alors
la quatrième plus grande ville du pays) à mettre en place
un système de central téléphonique municipal totalement
indépendant et sans précédent, brisant ainsi l’ancien
monopole de Bell dans la ville.
« Le système Kinloch, dont la construction
a débuté le 1er mars 1897, sera opérationnel dans
les 30 jours », rapportait le St. Louis Dispatch du 4 septembre
1898. « Le système Kinloch est réputé pour
son tableau de distribution amélioré. Il n’en existe
pas d’autre de semblable au monde, car il vient d’être
inventé. Milo G. Kellogg de Chicago en est l’inventeur.
Il a également inventé le tableau de distribution utilisé
par la compagnie Bell.

« Le principal point de supériorité revendiqué pour le nouveau standard Kellogg est qu'il est entièrement « central », supprimant entièrement les sous-stations et évitant ainsi la nécessité d'appeler « Main », « Sydney », etc.
En 1897, Milo Kellogg fonde et devient
le premier président de Kellogg Switchboard
& Supply.

En 1898, le premier standard téléphonique à 800
lignes est installé.
« Le standard téléphonique de Kinloch a une capacité
de 20 000 téléphones, soit le plus grand standard téléphonique
au monde.
« Une autre caractéristique qui plaît beaucoup plus
directement au public est la réduction notable des prix…
environ la moitié des anciens prix en vigueur. »
Le projet Kinloch
a été le point de départ de la nouvelle Kellogg
Switchboard & Supply Company, alors basée dans une ancienne
école de Highland Park, dans l’Illinois. Beaucoup doutaient
qu’une petite entreprise naissante puisse assurer la production
et l’installation du système de St. Louis, mais une fois
le projet lancé sans accroc, des contrats similaires ont rapidement
suivi à Cleveland, Philadelphie, Buffalo, Los Angeles et finalement
à l’étranger. Les vannes du mouvement des téléphones
« indépendants » étaient alors ouvertes.


« Milo Gifford Kellogg a ouvert la voie au fabricant de téléphones
indépendant », a noté plus tard le magazine Chicago
Engineer .
En 1899, Milo Kellogg établit un record national en déposant
125 brevets en une seule journée.
En 1905, il obtient le brevet du « Grabaphone ».
Véritable génie inventeur, il est le pionnier de la
téléphonie.
Kellogg Switchboard & Supply menace bientôt la domination
d'AT&T en vendant ses standards « à multiplexage
» de qualité supérieure aux nouvelles compagnies
de téléphone indépendantes du pays. Après
que Kellogg tombe gravement malade en 1901,
AT&T achète secrètement ses actions dans Kellogg
Switchboard au fiduciaire temporaire de M. Kellogg.
La Cour suprême de l'Illinois annula l'acquisition clandestine
en 1909 et Milo Kellogg reprit le contrôle de sa société
après huit ans de propriété fantôme par
AT&T. Kellogg décède en 1909.
En juin 1903, grâce à une
action en justice intentée par des actionnaires minoritaires
pour faire annuler la vente, l'industrie découvrit le fait
surprenant que M. DeWolf avait vendu Kellogg à la Bell Company,
qui en fait était la propriété de Bell depuis
environ 18 mois. Bell avait acheté les actions Kellogg à
M. DeWolf en s'engageant à garder secrets les faits de la vente
et à continuer à diriger l'entreprise. L'objectif était
simple. On souhaitait doter les sociétés indépendantes
d'appareils Kellogg. Certaines des pièces les plus vitales
de ces appareils étaient à l'époque l'objet d'un
procès pour violation de brevet intenté par Bell et
sa société de fabrication, Western Electric. Bell contrôlant
secrètement Kellogg, il ne restait plus qu'à se défendre
contre ces procès en brevets, à rendre un jugement en
faveur de Bell et à saisir l'appareil contrefaisant, forçant
ainsi des dizaines de sociétés indépendantes
à fermer boutique, avec des millions investis dans des usines,
et à faire renaître le « trust » Bell.
Buffalo et Los Angeles, les deux plus grandes
sociétés indépendantes, furent prises au piège
lorsque Kellogg obtint le contrat de fourniture de leur équipement.
Cependant, lors de la signature des contrats, des rumeurs concernant
la vente de Kellogg à Bell devinrent courantes. M. Kellogg,
qui, plutôt que de mourir, recouvrait la santé, entendit
ces rumeurs et confronta M. DeWolf, qui admit les faits. Après
l'échec des efforts de M. Kellogg pour racheter ses actions,
même avec un gros bénéfice pour Bell, les actionnaires
minoritaires furent informés et une action en justice fut intentée
pour faire annuler la vente. Le tribunal de première instance
statua en faveur des plaignants, mais la cour d'appel annula la décision.
Cependant, la Cour suprême de l'Illinois confirma la décision
du tribunal de première instance et Bell fut battue. Ce n'est
cependant qu'en 1909 que la décision finale fut rendue. Cette
même année, Milo G. Kellogg décéda et la
présidence de la Kellogg Switchboard and Supply Company passa
à son fils, Leroy D. Kellogg.
Après la mort de M. Kellogg la même année, Kellogg
Switchboard continua de croître, fournissant finalement des
équipements à Western Electric d'AT&T.
La Kellogg Switchboard and Supply Company resta
une société totalement indépendante jusqu'en
1951, date à laquelle IT & T en acquit le contrôle
et une fusion complète fut réalisée en 1952.
Elle fut rapidement rebaptisée ITT Kellogg et de nombreuses
opérations de fabrication de téléphones d'ITT
furent transférées vers l'usine Kellogg de Cicero Avenue
en 1959, où 1 000 personnes étaient employées.
Au milieu des années 1930, la
Kellogg Co employait encore environ 400 résidents de la région
de Chicago.
L'entrée de l'entreprise dans le secteur de la téléphonie
à cadran en 1939 stimula les ventes, qui atteignirent 10 millions
de dollars au milieu des années 1940.
Toutes les opérations d'ITT Kellogg à Chicago ont été
transférées dans le Tennessee en 1962. ITT Kellogg a
changé son nom en ITT Telecommunications en 1965 et a été
vendue à une société française, Alcatel,
à la fin des années 1980.
La gamme de téléphones
Les premiers téléphones de
Kellogg étaient du même style que les téléphones
Western Electric qui s'étaient révélés populaires
et durables au cours des premières années. Grâce
à son expertise en ingénierie, il était capable
de produire des pièces qui, à bien des égards,
étaient techniquement meilleures que celles de Western Electric.
Les premiers téléphones étaient des téléphones
muraux à deux boîtiers de style américain, de grande
taille et de forme carrée. Kellogg n'a jamais utilisé
l'émetteur Blake avec son boîtier séparé,
donc les téléphones à trois boîtiers ne faisaient
pas partie de leur gamme.

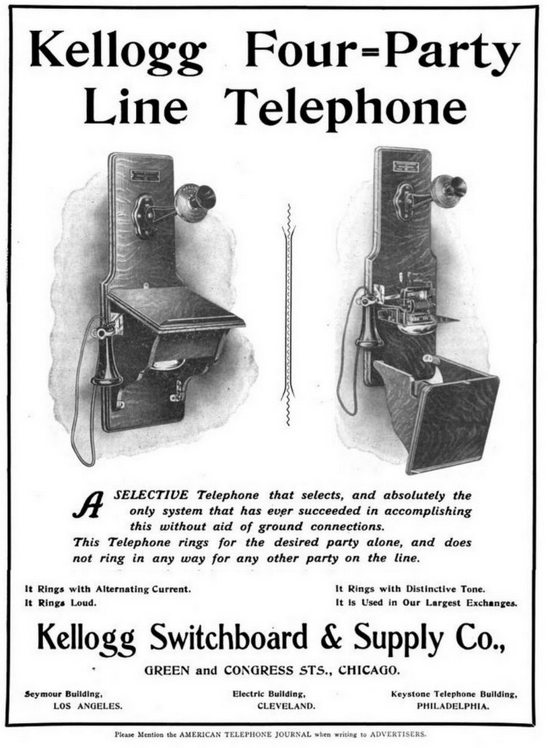
Leur émetteur a été conçu par M. WW Dean
et progressivement modifié par les ingénieurs de la société.
Bien que superficiellement similaire à l'émetteur White
Solid Back, Dean avait son récipient à granulés
de carbone fixé directement au diaphragme. Cela donnait un émetteur
qui aurait pu être supérieur en fiabilité à
celui de White. Cela aurait été un argument de vente utile
pour Kellogg. Les compagnies de téléphone indépendantes
couvraient souvent de vastes zones de terres agricoles et il pouvait
falloir un certain temps pour qu'un technicien se rende sur place en
cas de panne, la fiabilité était donc importante pour
ces entreprises. L'émetteur, la bobine et le bras ont été
incorporés dans une seule unité appelée triplet
à mesure que les processus de production s'amélioraient.
Le récepteur Kellogg était également similaire
à celui de Bell, mais il était lui aussi conçu
dans un souci de fiabilité et de durabilité. L'assemblage
de l'aimant était enfilé dans le boîtier et le cordon
était ancré par un cordon de décharge de traction
séparé pour soulager les fils en cas de chute du récepteur.
Le support de l'émetteur était en acier pressé
dans un design plutôt galbé en forme de « feuille
de trèfle », qui contrastait avec le support rectangulaire
simple de Western Electric.


A gauche Modèle 2536. Notez le support du bras de l'émetteur
en acier embouti de Kellogg.
Au centre: Modèle 2884, une version simplifiée avec une
finition plus basique.
A droite un modèle alternatif de téléphone à
magnéto, dans le style « pierre tombale » moins populaire.
Comme beaucoup de ses clients travaillaient dans des
zones rurales isolées où les lignes partagées étaient
le seul moyen économique de fournir un service, Kellogg a mis
au point un système de sonnerie pour les lignes partagées
qui utilisait quatre fréquences de sonnerie différentes.
Chaque téléphone de la ligne
partagée pouvait avoir sa sonnerie réglée mécaniquement
et électriquement pour ne sonner que sur une seule fréquence,
éliminant ainsi le besoin de sonneries en code Morse comme celles
utilisées sur de nombreuses lignes partagées dans le monde.
Le système a été progressivement amélioré
jusqu'à ce qu'une ligne à dix abonnés puisse être
prise en charge. Dans une dernière avancée, deux sonneries
codées ont été introduites pour permettre la gestion
d'une ligne à vingt abonnés.
Téléphones Kellogg Switchboard & Supply Co.
La société a également produit un petit téléphone
"chandelier" qui s'est avéré populaire non seulement
auprès des sociétés indépendantes américaines,
mais également auprès d'un certain nombre d'administrations
étrangères. Le téléphone a subi un certain
nombre de modifications au cours de son existence. Il a commencé
avec un récepteur à terminal extérieur, mis à
jour vers le récepteur scellé comme illustré à
gauche, et enfin, le manchon en bakélite sur l'axe a été
remplacé par une finition en acier peint de base comme illustré
ci dessous.
 1899
1899 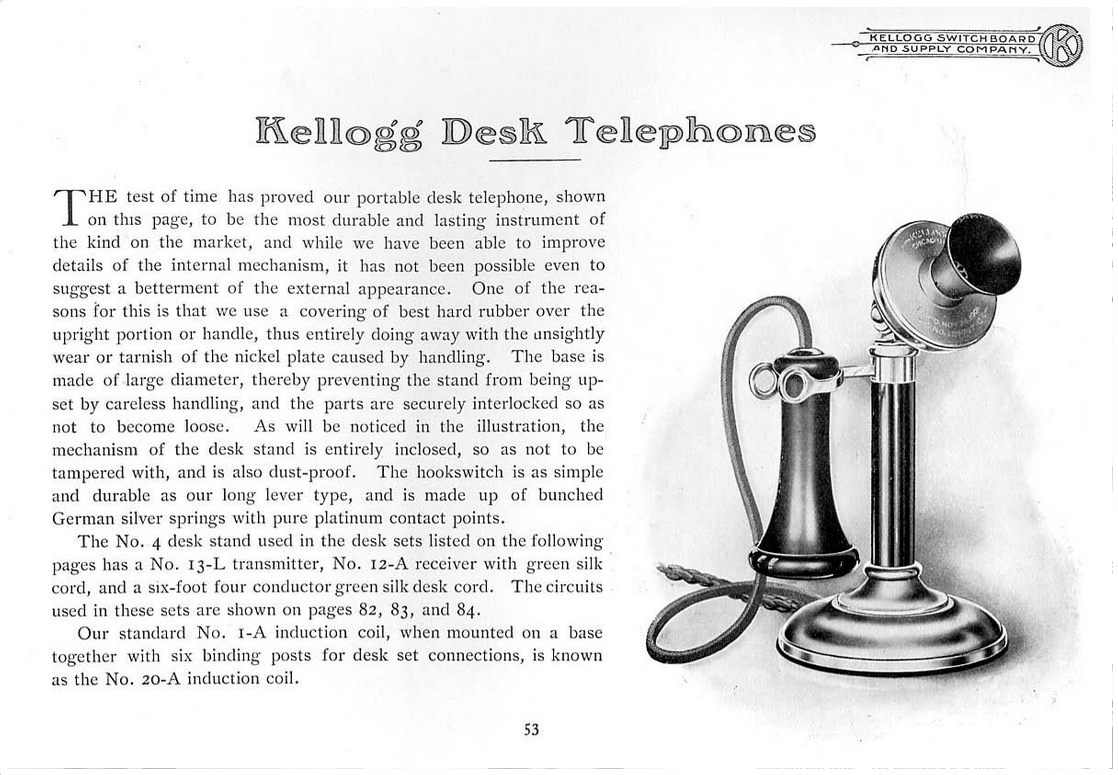
 1902
1902
Premier support de bureau à colonne Kellogg avec une base en
fonte très lourde. L'équipement Kellogg était supérieur
à la plupart des autres fournisseurs indépendants et a
fait de Kellogg l'un des meilleurs fournisseurs d'équipements
pour concurrencer les téléphones Bell.
 1905
1905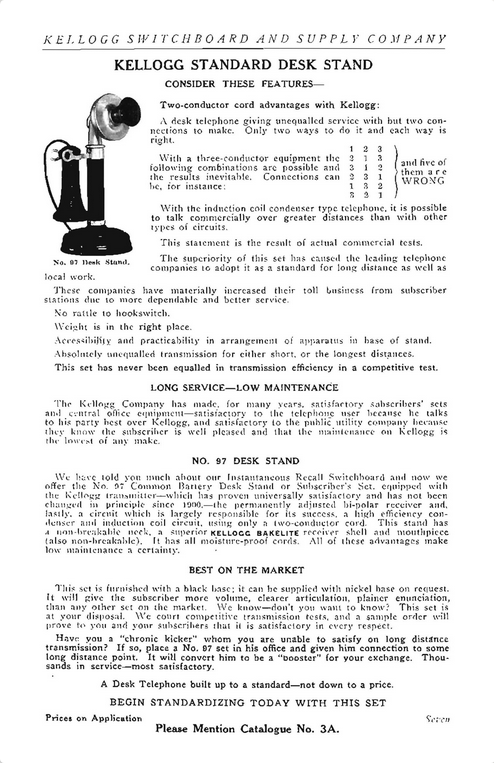
 1910
1910 1912 Audiophone
1912 Audiophone
 1912
1912  1912
Postal Long Distance
1912
Postal Long Distance  1912
1912
 1913
1913
Le modèle 1913 : il s'agit d'un téléphone très
spécial. Fabriqué par Kellogg pour la National Cash Register
Company.
Ce téléphone était utilisé dans un grand
magasin de New York en 1913. Un appareil en fonte (fabriqué par
la National Cash Register Company) est fixé au téléphone
et abritait un télétype et un ruban. Le téléphone
était utilisé au comptoir de vente au détail. Lorsqu'un
client souhaitait effectuer un achat à crédit, le vendeur
décrochait le téléphone, appelait le service de
crédit et demandait l'approbation du client. Le service de crédit
approuvait le crédit du client et activait le télétype
pour imprimer un reçu de crédit.
Ce téléphone était populaire dans les grands magasins,
principalement entre 1912 et 1913. L'avant de l'émetteur porte
les noms « Kellogg » et « National Cash Register ».
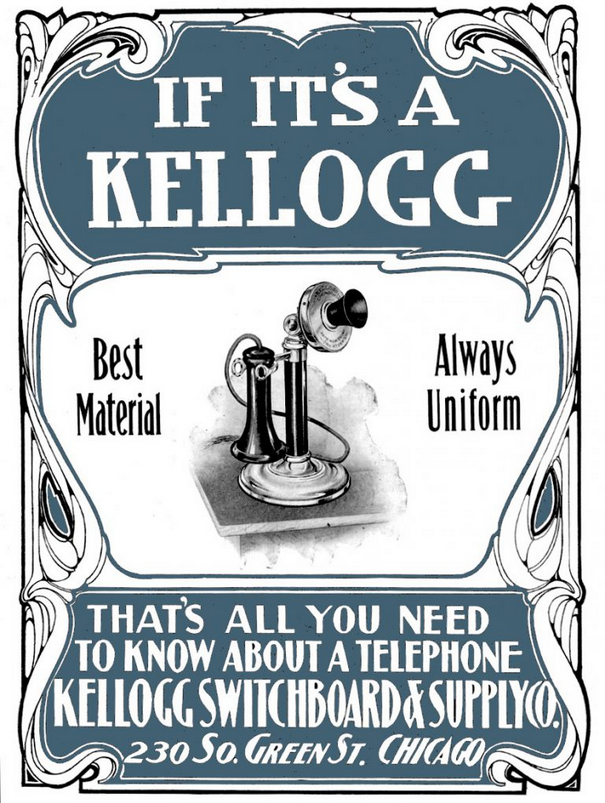
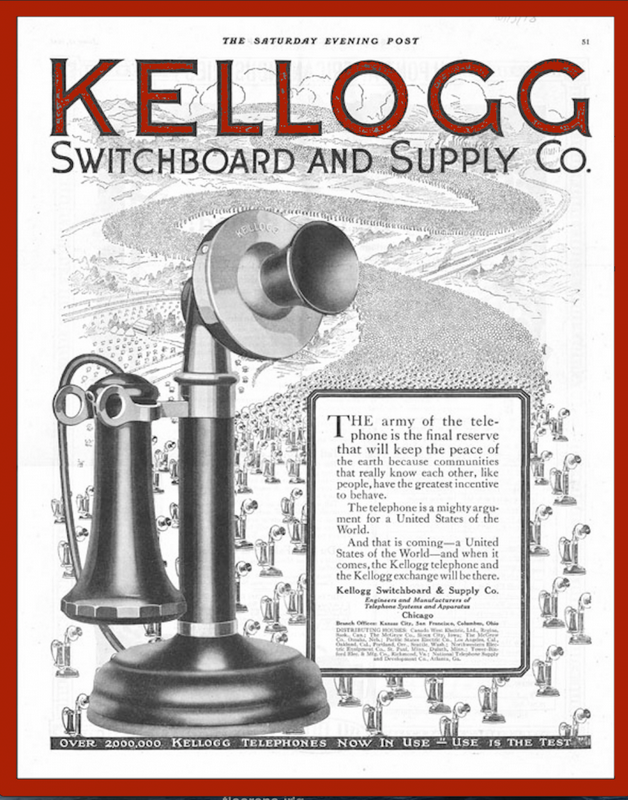
Publicité Kellogg de 1902 dans l'American Telephone Journal
En 1908, LM Ericsson a ouvert une nouvelle usine à Buffalo. Un
nouveau style de téléphone est né de cette alliance.
Kellogg l'a appelé le Grabaphhone.


Au centre : Grabaphone original répertorié dans le catalogue
de 1910 sous le nom de « Microtelephone ».
À droite : Premier modèle « Ericsson », commercialisé
par Ericsson, Kellogg et plus tard par Federal.
À gauche : modèle final entièrement réalisé
par Kellogg. A droite :
version automatique
A droite :
version automatique
En 1905, Kellogg présenta le premier téléphone à combiné fabriqué par un fabricant américain. Il s'agissait d'un téléphone compact destiné à tirer parti des nouveaux standards à batterie centrale, qui éliminaient le besoin de piles encombrantes dans le téléphone du client. Il s'agissait d'une alternative plus moderne au téléphone à chandelier. Ils l'appelèrent d'abord le Microtelephone, mais le nom fut rapidement changé en GrabAPhone. Au départ, le téléphone était principalement construit à partir de leurs propres pièces et d'un combiné Ericsson. Dans le modèle ultérieur F111, ils semblent avoir utilisé la base d'un téléphone à chandelier Ericsson, un support et un combiné Ericsson. La tige était recouverte d'un manchon en bakélite, qu'ils appelèrent « Kellite », comme celui utilisé sur leur téléphone à chandelier. Les marques Ericsson ou Kellogg se trouvent sur ce manchon en bakélite, il semble donc que le téléphone soit le fruit d'une coopération. En un an environ, la base du GrabAPhone fut remplacée par une base adaptée du chandelier F118 de Kellogg. Kellogg utilisa progressivement de plus en plus de ses propres pièces au fur et à mesure que le téléphone s'avéra efficace. Le combiné Ericsson a été remodelé sur des lignes moins élaborées, les terminaux étant fermés et les supports arrondis substitués aux supports à piliers d'Ericsson. Vers 1912, le support Ericsson avait été remplacé par un support en acier embouti plus simple, avec une finition en nickel plaqué. À la fin de la Première Guerre mondiale, la plaque de nickel avait disparu et l'ensemble du téléphone était désormais fini en noir japon, une finition en émail cuit. En 1918, l'usine Ericsson a fermé et Kellogg a acheté de nombreuses pièces et matrices.
Le GrabAPhone avait ses faiblesses. L'émetteur était vertical en utilisation, il ne donnait donc pas un signal aussi fort qu'un émetteur dans lequel le son était appliqué directement au diaphragme. La coupelle sur l'embouchure surmontait en partie ce problème. Le signal plus faible réduisait cependant un peu le son local (le son local se produit lorsque le signal de l'émetteur est renvoyé vers le récepteur). Il utilisait également une "bobine de retardement", qui réduisait le son local du signal déjà plus faible. Le montage de l'émetteur de manière à ce qu'il soit vertical en utilisation normale aidait à réduire le tassement des granules de carbone, ce qui était donc un avantage.
 Kellogg 1906
Kellogg 1906
En 1932, George Eaton, un ingénieur de Kellogg, a breveté
un émetteur « non positionnel » qui a résolu
les problèmes d'emballage et a fait des combinés une proposition
simple et sans problème pour Kellogg. Ce brevet a rapidement
été concédé sous licence à d'autres
fabricants en concurrence avec Western Electric et a marqué la
fin de l'émetteur/récepteur séparé aux États-Unis.

A Gauche : Téléphone de bureau modèle 725. An centre
: Masterphone modèle 700. A droite : Modèle 925 auto Masterphone.
À partir de la fin de la Première Guerre mondiale, les
relations entre American Bell et les compagnies de téléphone
indépendantes se sont quelque peu apaisées. Le réseau
Bell s'est concentré sur l'amélioration de son service
face à l'hostilité croissante du public concernant les
prix et la qualité. Les compagnies indépendantes ont continué
à croître régulièrement. La dépression
a provoqué une accalmie dans le développement, mais Kellogg
en est sortie avec une nouvelle gamme de téléphones utilisant
un nouveau composé - la bakélite . Les premiers téléphones
entièrement moulés ont été introduits vers
1933. Leur téléphone de bureau F725 et leur téléphone
chandelier F301 ont également marqué leur entrée
dans les nouveaux téléphones automatiques. Ils ont ajouté
un système de commutation automatique, le Relaymatic, à
leur gamme en 1939. Ils ont ajouté le Crossbar d'Ericssons à
la gamme en 1950. Leur gamme de téléphones Masterphone
F700, F900 et F730 est un classique de la période Art déco.
 Un autre
téléphone des années 1930 était le petit
boîtier mural. Il était intégré dans un boîtier
de sonnerie mural modifié et servait bien de poste CB (batterie
centrale) ou de poste mural pour voiture. Il était construit
en bois, mais plus tard, ce matériau a cédé la
place à l'économie de l'acier embouti. Il a rempli sa
fonction jusqu'à l'introduction des téléphones
muraux en bakélite, et a continué à être
produit pour être utilisé dans les zones à fort
trafic.
Un autre
téléphone des années 1930 était le petit
boîtier mural. Il était intégré dans un boîtier
de sonnerie mural modifié et servait bien de poste CB (batterie
centrale) ou de poste mural pour voiture. Il était construit
en bois, mais plus tard, ce matériau a cédé la
place à l'économie de l'acier embouti. Il a rempli sa
fonction jusqu'à l'introduction des téléphones
muraux en bakélite, et a continué à être
produit pour être utilisé dans les zones à fort
trafic.
 La Série
1000 « RedBar »
La Série
1000 « RedBar »
Les téléphones de Bell (aujourd'hui AT&T)
ont de nouveau commencé à suivre les modèles de
Bell. Les téléphones de la série 1000 Masterphone
de 1947 ont commencé à ressembler aux téléphones
en bakélite de tous les autres, car la conception du téléphone
s'est installée dans sa forme la plus efficace. Le 1000 avait
une barre rouge vif intégrée au support pour activer le
crochet commutateur, ce qui est devenu connu sous le nom de téléphone
Redbar. Le 1000 était disponible en versions CB, auto ou magnéto,
marquant la tendance vers un style universel. La construction interne
a été conçue pour faciliter le changement vers
une version différente pour le technicien. La correction de l'effet
local pouvait être optimisée manuellement avec un réglage
par tournevis. Les capsules de l'émetteur et du récepteur
étaient simplement installées avec des fixations à
encliquetage. Un modèle mural a également été
produit en bakélite pour la première fois. Les téléphones
étaient fournis avec une gamme de cadrans adaptés aux
nombreux systèmes d'exploitation utilisés aux États-Unis
(numérique uniquement, alphanumérique, numérique
plus « O » pour opérateur). D'autres cadrans, y compris
les versions Western Electric, ont été fournis plus tard
dans l'histoire du téléphone. De petites quantités
de téléphones ont également été moulées
en aluminium pour les endroits où l'utilisation est intensive
(et les abus). Le modèle est resté en production avec
des variations continues pendant sept ans.
Kellog 1956 
 Kellogg K500
Kellogg K500
Après la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise
a commencé à perdre son identité.
En 1951, International Telephone and Telegraph (ITT) a racheté
l'entreprise et en est devenu le propriétaire exclusif l'année
suivante. L'entreprise est devenue ITT Kellogg.
Le gouvernement américain intenta une action
en justice contre AT&T (la société Bell) pour infraction
à la loi antitrust. En 1951, AT&T accepta de partager ses
modèles de téléphones et ses brevets avec ses concurrents.
Il n'y avait plus aucun intérêt à concevoir ses
propres téléphones, alors Kellogg construisit les téléphones
de bureau et muraux standard de la série 500 de modèle
WE à partir de 1954, avec seulement son nom gravé dans
le plastique pour montrer l'origine. ITT fusionna Kellogg avec une autre
de ses sociétés, Federal Telephone & Radio Corp, et
le nom fut changé en ITT Telecommunications. Le nom Kellogg n'était
plus qu'un souvenir historique. Presque. En 1989, ITT vendit ses sociétés
de télécommunications à Alcatel. En 1992, Alcatel
vendit à son tour son activité d'équipement téléphonique
à un syndicat d'investisseurs qui baptisa leur nouvelle société
Cortelco Kellogg. Le « Kellogg » a depuis été
à nouveau supprimé du nom, mais cela montre à quel
point il est difficile de garder un homme bon sous contrôle.
Et pour un perfectionniste comme Kellogg, ouvrir la voie signifiait littéralement marcher dans les pas de ses employés et s'assurer que tout était installé selon ses normes précises. Frank Taubeler, un ouvrier du système Kinloch, a plus tard partagé ses souvenirs de son patron dans l'édition du Golden Anniversary du bulletin d'information de l'entreprise, le Kellogg Messenger .
« Il allait et venait d’un bout à l’autre
de la pièce », se souvient Taubeler. « C’était
un personnage très imposant. Rien n’échappait à
son regard. M. Kellogg était un homme profondément démocrate
et il gagna rapidement la confiance et le respect de ceux qui travaillaient
pour lui. Je ne peux m’empêcher de réaliser aujourd’hui
à quel point ces moments ont été importants pour
lui : le plus grand échange aux États-Unis et le premier
pas dans la cause de l’Independent. »
Le livre Manufacturing and Wholesale Industries of Chicago , publié
20 ans après le projet Kinloch, a salué les efforts de la
société Kellogg comme ayant « révolutionné
l'industrie du téléphone ».
« Ce furent les premiers téléphones et standards téléphoniques
indépendants et ils ont aidé tous les téléphonistes
à connaître un meilleur appareil. C’est la société
Kellogg qui a inventé et mis à la disposition des utilisateurs
de téléphones des petites villes et des métropoles
des systèmes de lignes partagées
économiques.
C’est la société Kellogg qui, il y a dix-huit ans,
a produit l’émetteur Kellogg grâce auquel des millions
de personnes communiquent aujourd’hui, pratiquement sans changement.
»
Alors oui, Milo Kellogg, un jeune génie, un inventeur,
un chef d’entreprise et, surtout, un rebelle. Comme dans toute histoire
de rebelles, celle-ci comprendra toutefois un chapitre dans lequel l’empire
contre-attaque.
À l'intérieur de l'usine
« L'appareillage de la Kellogg Switchboard & Supply Company
a acquis une réputation enviable, et l'entreprise s'est vu décerner
la seule médaille d'or pour les mérites de ses « appareils
et systèmes » par l'Exposition panaméricaine. La politique
libérale de l'entreprise a attiré à son service les
meilleurs experts, expérimentateurs et mécaniciens qualifiés
que l'on puisse trouver dans ce pays. »
— Profitable Advertising, janvier 1902
En 1899, l'entreprise Milo Kellogg a pu abandonner son
école de fortune et déménager dans une usine plus
moderne au centre-ville, au 231 S. Green Street, à l'angle de Congress
Street (un terrain désormais occupé par l'autoroute 290).
L'année suivante, l'usine employait 800 ouvriers : 624 hommes,
156 femmes et 20 enfants de moins de 16 ans. La croissance se poursuivant,
deux bâtiments supplémentaires ont été achetés
sur Peoria Street et Harrison Street.

Usine à Green St. et Congress, siège social de Kellogg de
1899 à 1914 .
Dans un article de 1903 paru dans le Magazine of Business , l'agent d'achat
de Kellogg, Charles P. Belden, a présenté la structure organisationnelle
de l'opération Kellogg, sans équivalent dans la façon
dont elle produisait presque tous les composants d'un système téléphonique
moderne.
« On peut se faire une idée de la complexité des détails
impliqués dans cette activité en considérant que
900 types distincts d'appareils finis sont codés et fabriqués.
Ces appareils sont composés d'unités ou de « pièces
détachées » au nombre de 4 128 et nécessitent
4 034 dessins ou plans différents pour guider le travail de fabrication.
« L’entreprise est divisée en quinze départements
différents, chacun étant sous la responsabilité d’un
contremaître. Grâce à l’application d’un
système, l’entreprise vise à décharger ces contremaîtres
de tout travail de détail et à leur permettre ainsi de consacrer
tout leur temps et leur énergie à ce qui leur appartient
: la production. »
Différents départements de l'usine Kellogg de Green Street,
1904

Comme indiqué ci-dessus, Kellogg disposait d'usines entières
consacrées à tout, depuis les départements de presses
à poinçonner et de machines à vis jusqu'au perçage,
à la fabrication d'outils, à l'assemblage de générateurs,
à l'isolation de fils magnétiques et au tressage de cordons.
Il y avait aussi, et c’est remarquable, un département
« laboratoire et expérimentation », dirigé par
certains des ingénieurs les plus éminents du secteur, dont
Francis W. Dunbar, diplômé du MIT, Kempster B. Miller, diplômé
de Cornell, William W. Dean, ancien électricien en chef de Bell,
et William Kaisling, ancien collègue de Nikola Tesla. Un autre
diplômé de Cornell, JG Brobeck, était responsable
de la salle d’essai, et chaque appareil produit dans l’usine
de Chicago devait soi-disant obtenir son approbation finale avant d’être
expédié.
À l'intérieur du laboratoire de recherche de Kellogg en
1901. De gauche à droite : J. Henry Lendi, JC Neely, William W.
Dean, Francis W. Dunbar, Kempster B. Miller, WA Taylor et RH Manson .
« Dans la fabrication des téléphones, nous n’avons
épargné aucun effort pour produire un téléphone
durable, efficace et aussi parfait que la meilleure montre », affirmait
un bulletin de Kellogg de 1902. « La demande d’instruments
de première classe devient de plus en plus universelle, et c’est
à cette demande que nous souhaitons répondre. Pour tenter
de produire un instrument de la plus haute efficacité, nous avons
fait tout ce que l’habileté, l’argent ou l’expérience
pouvaient faire.
« L’objectif de la société Kellogg est de produire les meilleurs appareils téléphoniques au monde : les meilleurs en termes de conception, de fabrication et de finition, de qualité et, par conséquent, les meilleurs en termes de résultats obtenus. Nous sommes convaincus que nous n’avons pas manqué à cet objectif avec notre gamme d’appareils téléphoniques. Les appareils parleront d’eux-mêmes. »
sommaire
L'Empire contre-attaque
Alors que son entreprise prenait son essor, Milo Kellogg
tomba malade vers la fin de l’année 1901. Il n’avait
que 52 ans, mais la maladie était suffisamment grave pour qu’il
soit contraint de se retirer en Californie et de confier la direction
de l’entreprise à son beau-frère de confiance, Wallace
L. DeWolf. Au cours de l’année suivante, les affaires continuèrent
sur une trajectoire ascendante et lorsque Milo se rétablit par
surprise et retourna à Chicago, tout semblait être rentré
dans l’ordre. Il y avait juste un petit problème. Le bon vieux
Wallace, en fin de compte, était un DeWolf déguisé
en mouton.

En janvier 1902, quelques semaines après que Milo Kellogg se soit
retiré de l'entreprise, DeWolf avait commis l'impensable.
Présumant peut-être que son beau-frère serait de toute
façon bientôt mort, il avait vendu la totalité des
parts de Milo dans la Kellogg Company à la Western Electric Company,
contrôlée par Bell .
Il s'agissait d'une trahison sournoise, quelque part entre Lando et Judas,
et sa malveillance n'était qu'amplifiée par le fait que
l'accord était tenu secret par toutes les parties impliquées.
Personne chez Kellogg Company, y compris Milo lui-même, n'a été
informé de la vente, pas plus que les médias ou les clients.
C’était un coup incroyable pour Bell / AT&T
/ Western Electric, une force impériale cherchant à reprendre
son monopole téléphonique une fois pour toutes. Non seulement
ils avaient absorbé leur plus grand concurrent, mais en gardant
l’acquisition secrète, ils avaient désormais la possibilité
d’influencer directement toute une série de cas juridiques
cruciaux en cours.
Pendant des années, Bell avait accusé Milo Kellogg de contrefaçon
de brevet sur certains composants de son appareil. Désormais, en
possédant sa société, ils pouvaient porter ces accusations
devant les tribunaux et présenter une défense intentionnellement
maigre à l’opposition. C’est comme jouer à un
jeu vidéo lorsque vous avez les deux manettes en main. Bell était
en position d’écraser complètement Kellogg et son héritage
à l’avenir.
 C’était un coup
incroyable pour Bell / AT&T / Western Electric, une force impériale
cherchant à reprendre son monopole téléphonique une
fois pour toutes. Non seulement ils avaient absorbé leur plus grand
concurrent, mais en gardant l’acquisition secrète, ils avaient
désormais la possibilité d’influencer directement toute
une série de cas juridiques cruciaux en cours. Pendant des années,
Bell avait accusé Milo Kellogg de contrefaçon de brevet
sur certains composants de son appareil. Désormais, en possédant
sa société, ils pouvaient porter ces accusations devant
les tribunaux et présenter une défense intentionnellement
maigre à l’opposition. C’est comme jouer à un
jeu vidéo lorsque vous avez les deux manettes en main. Bell était
en position d’écraser complètement Kellogg et son héritage
à l’avenir.
C’était un coup
incroyable pour Bell / AT&T / Western Electric, une force impériale
cherchant à reprendre son monopole téléphonique une
fois pour toutes. Non seulement ils avaient absorbé leur plus grand
concurrent, mais en gardant l’acquisition secrète, ils avaient
désormais la possibilité d’influencer directement toute
une série de cas juridiques cruciaux en cours. Pendant des années,
Bell avait accusé Milo Kellogg de contrefaçon de brevet
sur certains composants de son appareil. Désormais, en possédant
sa société, ils pouvaient porter ces accusations devant
les tribunaux et présenter une défense intentionnellement
maigre à l’opposition. C’est comme jouer à un
jeu vidéo lorsque vous avez les deux manettes en main. Bell était
en position d’écraser complètement Kellogg et son héritage
à l’avenir.
Ce que personne ne semblait avoir prévu, c'était le retour de Milo Kellogg, qui avait sombré dans l'agonie. À l'été 1902, il apprit enfin la trahison de DeWolf et prit immédiatement des mesures pour tenter de résoudre la situation. Il négocia pendant des mois avec son ancien collègue de Western Electric, Enos Barton, pour racheter les actions vendues et reprendre sa place légitime de propriétaire de Kellogg Switchboard & Supply. Peut-être que si Elisha Gray n'était pas décédé un an plus tôt, les vétérans du téléphone auraient pu trouver une solution plus amicale. Au lieu de cela, Barton coupa court à toutes les négociations.
Au printemps 1903, la nouvelle de la situation précaire
avait finalement atteint un public plus large et les actionnaires minoritaires
(c'est-à-dire les partisans de Milo) n'avaient d'autre choix que
de porter plainte contre Bell, AT&T et Western Electric. Ils pensaient
que l'objectif ultime de Bell était de dissoudre entièrement
la Kellogg Company et ils obtinrent une injonction du tribunal pour empêcher
une telle action.
Les actionnaires minoritaires de Kellogg ont publié une déclaration
le 10 juin 1903, essayant d'assurer aux clients fidèles que la
victoire serait imminente.
« Le procès intenté par les actionnaires minoritaires
de la société Kellogg n’est pas seulement dans l’intérêt
de ces actionnaires, mais avant tout dans l’intérêt
des clients de la société Kellogg. Les avocats les plus
éminents disponibles ont été retenus et les actionnaires
minoritaires sont convaincus que les intérêts de Bell seront
définitivement interdits d’influencer la gestion de la société
Kellogg, et également que la vente des actions sera annulée
et que M. Kellogg sera réintégré dans la direction
active.
« La situation actuelle est telle que les clients de la société
Kellogg peuvent désormais être assurés que leurs intérêts
seront pleinement protégés par la société
Kellogg sous son ancienne direction. »
Malheureusement, les choses ne furent pas aussi simples. La bataille juridique
pour reprendre le contrôle de l'entreprise et de ses brevets se
poursuivit encore six ans, faisant des ravages parmi tous les acteurs
concernés.
Entre-temps, ayant perdu le pouvoir sur ses propres opérations,
Kellogg perdit rapidement la faveur de nombreux de ses employés.
En 1903, la même année que le premier procès, une
grève massive organisée par le syndicat Brass Molders Union
Local 83 et l'International Brotherhood of Teamsters tourna mal. Les nouveaux
patrons de Kellogg, le Bell Telephone Trust, refusèrent de négocier
avec les grévistes, et les piqueteurs frustrés se tournèrent
bientôt vers la violence.

Des ouvriers en grève se rassemblent devant l'usine Kellogg, 1903
Pendant une grande partie de l’été
2003, les scènes qui se déroulaient devant l’usine
de Green Street ont fait la une des journaux nationaux. Plusieurs personnes
ont été tuées lors des affrontements qui faisaient
rage entre des syndicalistes, des routiers non syndiqués et des
policiers.
Le 17 juillet, le Quad-City Times de Davenport, dans l’Iowa, a fait
état d’une foule de 500 hommes et garçons devant l’usine,
ce que l’on a appelé un « élément sans
foi ni loi ».
« Une foule en colère a saccagé hier soir le rez-de-chaussée
du bâtiment de la société Kellogg Switchboard and
Supply, à l’angle des rues West Congress et Green, autour
duquel la grève et les émeutes se succèdent depuis
plusieurs jours. Les 17 fenêtres vitrées du premier étage
ont été brisées à coups de pierres, et les
émeutiers furieux n’ont cessé de s’agiter que
lorsque la plupart des petites fenêtres des deuxième et troisième
étages ont été brisées. »
Le Chicago Tribune a plus tard qualifié ce soulèvement ouvrier
de plus violent depuis près d'une décennie. Mais il s'est
avéré qu'il n'avait pas abouti. La société
Kellogg, contrôlée par Bell, a tout simplement éliminé
et remplacé 90 % de ses employés. Nous ne saurons jamais
comment les choses auraient pu tourner avec un Milo Kellogg indépendant
toujours au pouvoir.
Lorsque la Cour suprême de l'Illinois a finalement accordé à Milo la pleine propriété majoritaire de l'entreprise en février 1909, il ne lui restait que peu de temps pour en profiter. Il est décédé plus tard cet automne-là à l'âge de 60 ans, et son fils Leroy D. Kellogg a pris les rênes. Wallace DeWolf, soit dit en passant, a continué à poursuivre sa passion pour l'art, et a fini par exposer certaines de ses propres peintures et gravures à l'Art Institute of Chicago.
Kellogg Switchboard & Supply restera une entreprise indépendante jusqu'à sa vente environ quatre décennies plus tard.
Innovant jusqu'au bout
Après les bouleversements extrêmes de ces
premières années, un sentiment de stabilité revint
dans les années 1910.
Les fils de Milo, Leroy et James G. Kellogg, poursuivirent la vision de
leur père et l'entreprise resta à l'avant-garde de l'industrie,
même si dépasser AT&T et Western Electric n'était
jamais vraiment envisageable.
De la Première à la Seconde Guerre mondiale,
Kellogg est restée fidèle à ses racines de fournisseur
de services téléphoniques indépendants, le plus grand
fabricant de ce type au monde. Elle était considérée
comme une pionnière dans de nombreux domaines, ayant introduit
les premiers panneaux de signalisation à lampe, les premiers téléphones
à berceau aux États-Unis (le Grab-A-Phone) et, plus tard,
le premier émetteur non positionnel. L'entreprise a également
reconstruit sa réputation à partir de zéro, en ouvrant
une nouvelle usine géante de 13 acres au 1020-1070 West Adams Street
en 1914, où elle s'est davantage souciée des demandes des
employés et des clients.

L'ancienne usine Kellogg au 1060 W. Adams St., années 1920 par
rapport à aujourd'hui (transformée en condos)
En 1926, un bulletin de vente invitait les téléphonistes indépendants à venir à Chicago et à visiter les locaux de l'entreprise pour voir de première main ce qu'ils obtiendraient avec Kellogg.
« Les ingénieurs seront ravis de discuter de vos problèmes et de vous parler de certaines des réalisations de Kellogg dans le domaine du développement de la téléphonie. Les autres services seront ravis de discuter de vos besoins en téléphonie et en installations extérieures. Partout dans le bureau, vous trouverez une attitude amicale et une volonté de vous aider à résoudre vos problèmes. C'est l'esprit Kellogg.
« Nous allions ensuite à l’usine. Nous
voyions des dizaines de machines à vis produire automatiquement
de petites pièces. Nous voyions des batteries de presses découper
d’autres pièces et former certaines des plus grandes. Nous
assistions à la finition et au placage de toutes sortes de pièces.
Nous voyions les presses mouler les coques et les capuchons des récepteurs.
Chaque département fabriquait quelque chose, aussi petit soit-il,
qui devenait une partie de votre équipement.
« Vous seriez probablement impressionné par les inspections
minutieuses effectuées sur toutes les opérations. Tout doit
être conforme aux normes Kellogg, sinon tout est mis de côté.
« Le service d’assemblage serait tranquille après le
bourdonnement et le rugissement des autres services. Ici, vous verriez
les artisans soigneusement formés construire sous vos yeux le tableau
électrique lui-même, leurs mains expertes assemblant rapidement
les différentes pièces et assemblages. Vous seriez émerveillé
par la quantité de matériaux qui entre dans la fabrication
du tableau électrique dans un espace si petit, tout en laissant
beaucoup de place pour un accès facile. Vous quitteriez ce service
avec un sentiment de confiance et une compréhension des raisons
pour lesquelles les tableaux électriques Kellogg sont toujours
efficaces. »
sommaire
Comme la plupart des autres entreprises, Kellogg a dû se réorganiser dans les années 1930, et tout le monde n’en est pas sorti indemne. Leroy Kellogg, par exemple, s’est suicidé en 1933, après avoir quitté la direction de l’entreprise des années plus tôt et s’être retrouvé ruiné financièrement. Son frère James G. et son neveu James H. sont toutefois restés très impliqués dans l’entreprise et ont pu à la fois réduire les coûts et accélérer la production en déménageant dans une usine plus moderne, à un seul étage, dans le Clearing Industrial District en 1938 (au 6650 S. Cicero Ave.). Ce faisant, les 17 départements de Kellogg ont été rationalisés en six.
« Le service d’assemblage serait tranquille après le bourdonnement et le rugissement des autres services. Ici, vous verriez les artisans soigneusement formés construire sous vos yeux le tableau électrique lui-même, leurs mains expertes assemblant rapidement les différentes pièces et assemblages. Vous seriez émerveillé par la quantité de matériaux qui entre dans la fabrication du tableau électrique dans un espace si petit, tout en laissant beaucoup de place pour un accès facile. Vous quitteriez ce service avec un sentiment de confiance et une compréhension des raisons pour lesquelles les tableaux électriques Kellogg sont toujours efficaces. »
Comme la plupart des autres entreprises, Kellogg a dû
se réorganiser dans les années 1930, et tout le monde n’en
est pas sorti indemne. Leroy Kellogg, par exemple, s’est suicidé
en 1933, après avoir quitté la direction de l’entreprise
des années plus tôt et s’être retrouvé
ruiné financièrement. Son frère James G. et son neveu
James H. sont toutefois restés très impliqués dans
l’entreprise et ont pu à la fois réduire les coûts
et accélérer la production en déménageant
dans une usine plus moderne, à un seul étage, dans le Clearing
Industrial District en 1938 (au 6650 S. Cicero Ave.). Ce faisant, les
17 départements de Kellogg ont été rationalisés
en six.

L'usine Kellogg's Clearing District au 6650 S. Cicero Ave., son siège
social de 1938 à 1962
Comme lors de la Première Guerre mondiale, Kellogg consacra la majeure partie de ses ressources au gouvernement américain pendant la Seconde Guerre mondiale, en fabriquant des postes de campagne, des microphones, des téléphones, des récepteurs et des standards téléphoniques pour l'armée et la marine. Au moins 800 employés de l'entreprise, venus de tout le pays, partirent également au front.
À la fin de la guerre, l’effectif de Chicago
atteignit à nouveau 1 000 personnes, et Kellogg affirma qu’il
y avait plus de 31 millions de téléphones de marque «
K » aux États-Unis seulement. L’usine de Cicero Avenue
fut agrandie de 50 000 pieds carrés supplémentaires en 1946
et, avec le président de troisième génération
James H. Kellogg désormais aux commandes, la production fut multipliée
par trois au cours des premiers mois de 1947 par rapport à l’année
précédente.


George Ernst (à gauche), un employé de Kellogg qui a rejoint
le département de mouture sous Milo Kellogg en 1898, présente
un téléphone en or au président de troisième
génération James H. Kellogg, dans le cadre du cinquantième
anniversaire de l'entreprise en 1947.
Après que James H. Kellogg eut vendu la majorité de ses actions à ITT au début des années 1950, le drapeau blanc fut effectivement hissé sur la vieille guerre d'indépendance. Malgré cela, la nouvelle société resta une institution à Chicago pendant une décennie supplémentaire. Outre l'usine de Cicero de 400 000 pieds carrés, il y avait une grande usine d'ingénierie des systèmes au 500 N. Pulaski et des installations plus petites au 6000 W. 51st St. et au 5959 S. Harlem Ave.
Plusieurs générations se sont écoulées depuis les derniers jours de Kellogg à Chicago, mais l'entreprise mérite d'être considérée comme une branche importante de l'arbre évolutif des communications mondiales. Il est évident qu'il faut toujours hésiter à juger la véritable philosophie d'une entreprise en fonction du contenu de ses publicités, mais si vous lisez suffisamment de documents dans les archives de Kellogg, vous aurez l'impression que ses opérateurs considéraient réellement la croissance des télécommunications comme une noble vocation, plutôt que comme un simple métier.
« Un téléphone complet n’est
au mieux qu’une combinaison de bois, d’acier et de cuivre »,
pouvait-on lire dans l’introduction de l’édition de mai
1921 du bulletin d’information de Kellogg, Telephone Facts . «
Un millier de standards complets, tout en représentant de vastes
réalisations mentales et physiques, ne sont en eux-mêmes
que des exemples de conception technique, de perfection mécanique
et de fabrication de haute qualité.
« Mais si l’on prend deux téléphones et que l’on
les relie par un standard, on obtient une situation totalement différente.
On a alors quelque chose de bien plus qu’un simple appareil, car
il s’agit de la vie elle-même. »



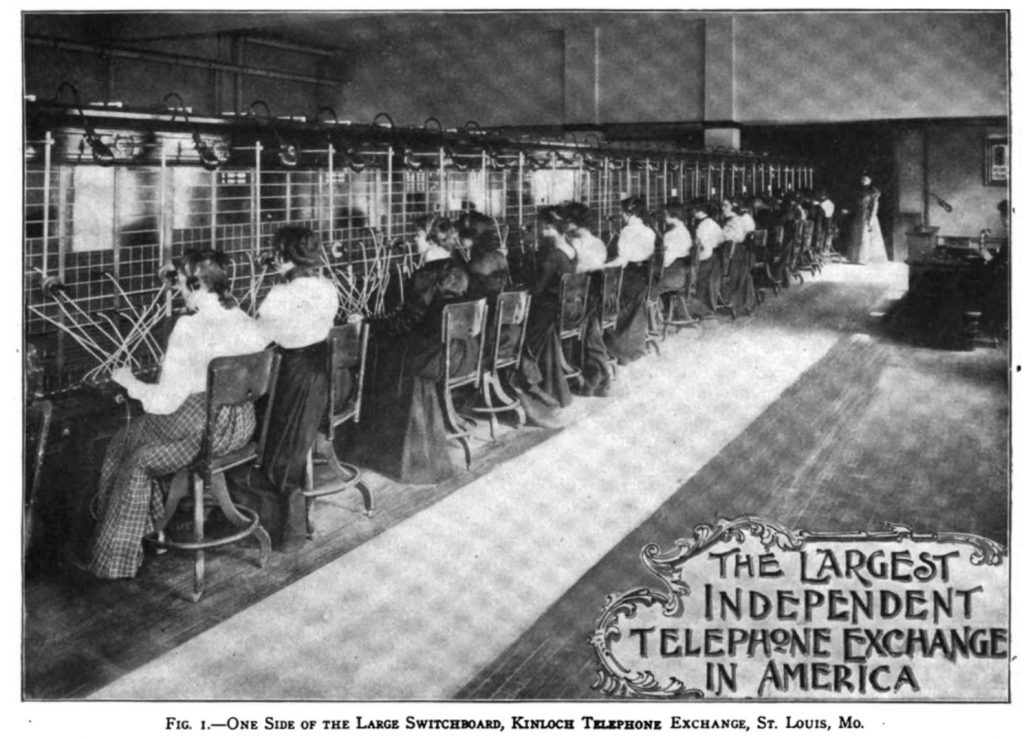
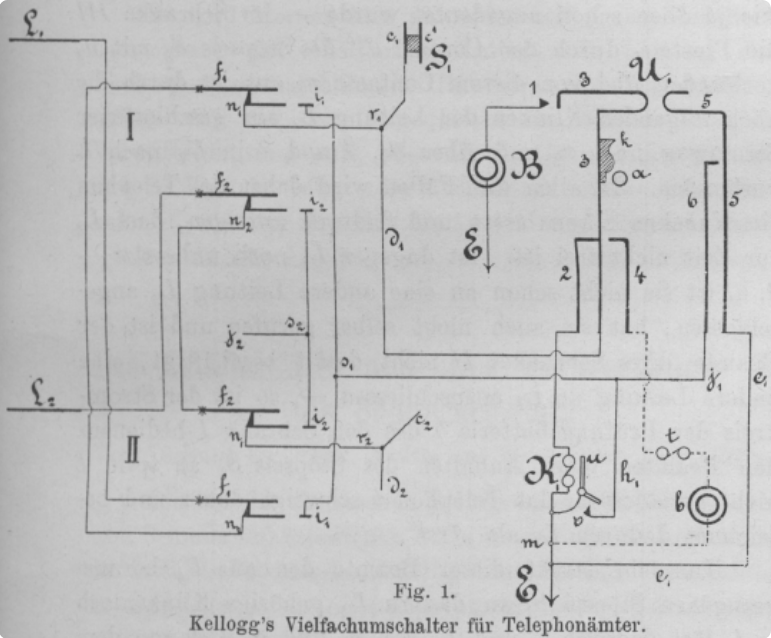
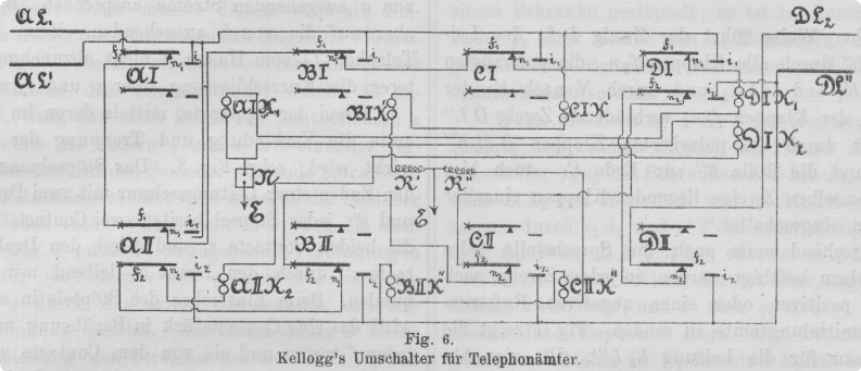 Fig 6
Fig 6 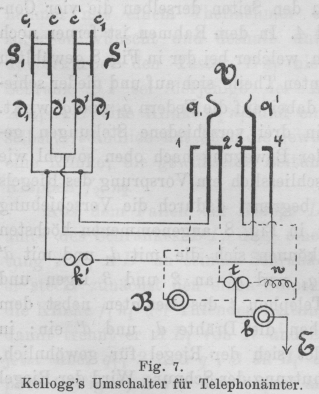 Fig. 7.
Fig. 7.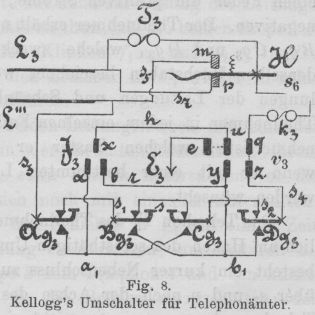 Fig. 8.
Fig. 8.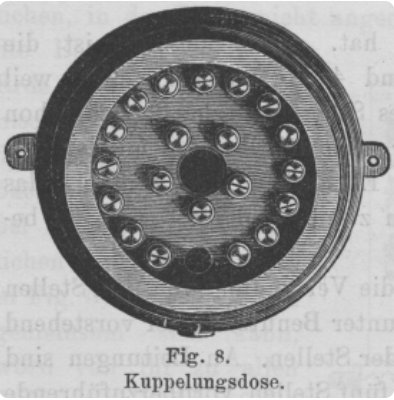 Fig. 2. Multi-interrupteur
de Kellogg.
Fig. 2. Multi-interrupteur
de Kellogg.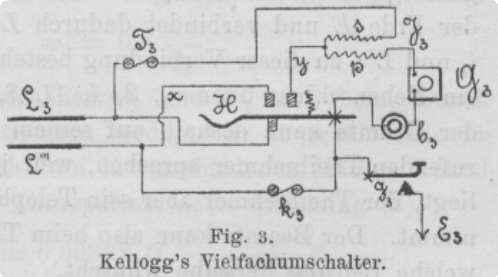 Fig. 3
Fig. 3 Fig. 5
Fig. 5