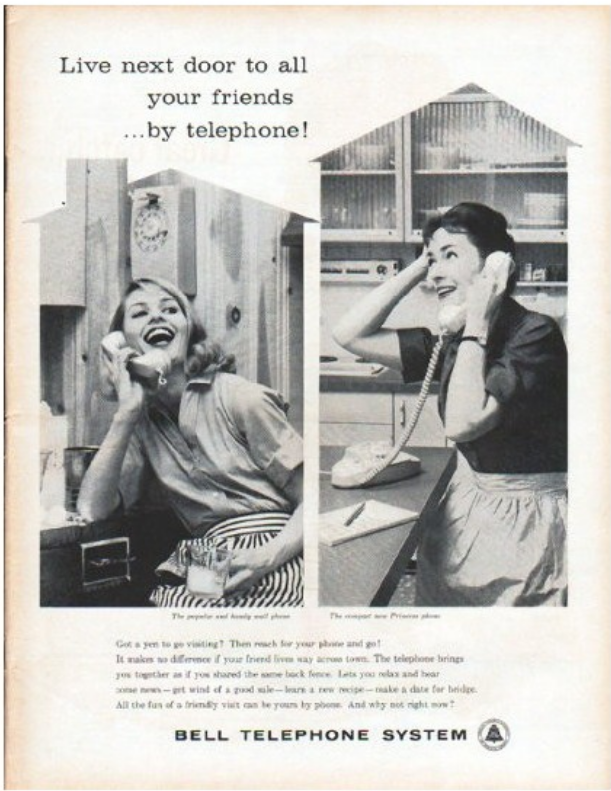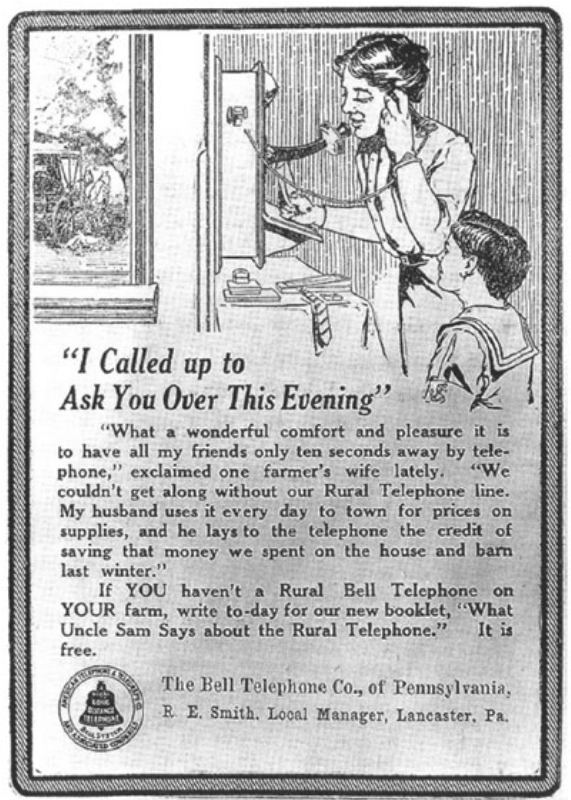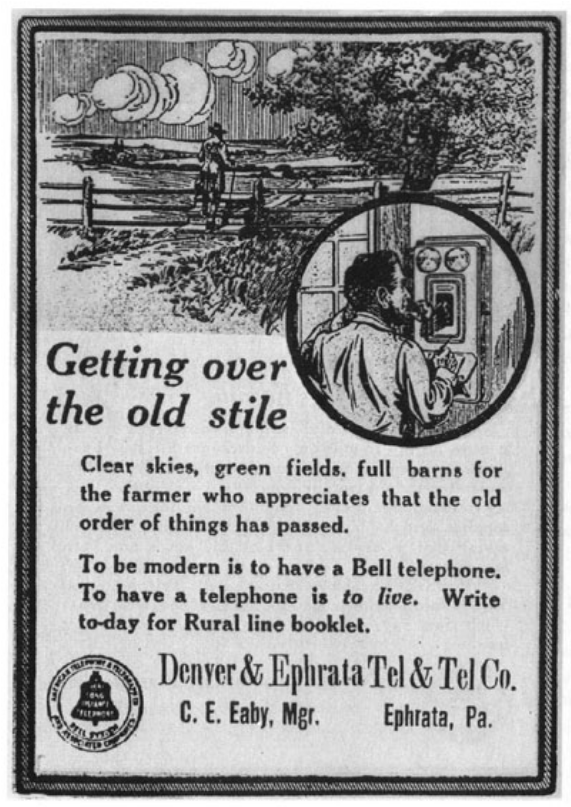1880-1940 L'industrie du téléphone découvre la sociabilité au USA
Pr Claude S. Fischer Professeur de Sociologie à l'Université de Californie à Berkeley (1)
Résumé
Les promoteurs du téléphone déterminèrent
une fois et pour toutes pendant les quatre premières décennies
de la diffusion de cet appareil dans la population, qu'étant
le fils du télégraphe, son usage était naturellement
le même: il n'était donc surtout pas fait pour le papotage.
A travers l'histoire de la publicité pour le téléphone
aux U.S.A., on démontrera que cette appréciation
erronée de l'usage d'une technique nouvelle fut contrée
immédiatement par les réactions des usagers et qu'au bout
du compte, malgré les réticences des industriels de Bell
et de leurs vendeurs, ce sont les consommateurs, et eux seuls, qui ont
fait du téléphone un instrument de sociabilité
dans ce monde moderne, où, malgré une plus grande mobilité,
les déplacements d'agrément sont devenus difficiles.
Les promoteurs d'une technologie nouvelle ne savent donc pas nécessairement
ce que sera l'utilisation finale de celle-ci, tandis que les équipes
de vente, sur le terrain, sont parfois prisonnières d'idées
préconçues: ce sont autant de freins à l'expansion
d'une innovation.
Le refrain familier "Reach out, reach out and touch
someone" (2 ) a fait partie d'une grande
campagne publicitaire lancée par American
Telephone and Telegraph's (AT&T's) pour
promouvoir l'utilisation du téléphone dans les conversations
personnelles. ( traduction "Tendez la main, tendez la main et
touchez quelqu'un")
L'industrie du téléphone n'a pas toujours oeuvré
dans ce sens: pendant des lustres, elle en était plutôt
à décourager une telle sociabilité. La "découverte"
de ce marché illustre parfaitement comment les contraintes structurelles
et culturelles et l'attente du public agissent les unes sur les autres
pour modeler la diffusion d'une technologie. Alors que les historiens
ont corrigé les notions simplistes de "technologie autonome"
en montrant comment les technologies sont produites, nous en savons
beaucoup moins sur celles qui sont nées de l'utilisation des
consommateurs. Nous prenons trop souvent ces utilisations pour acquises
(spécialement pour les produits de consommation), comme si elles
étaient tout droit dérivées de la nature de la
nouvelle technologie ou dictées par ses inventeurs (3).
Dans le cas du téléphone, les utilisations
initiales suggérées par ses promoteurs étaient
déterminées - toutes considérations économiques
et techniques mises à part - par son héritage culturel:
le téléphone était le fils du télégraphe.
Cependant, les abonnés utilisèrent le téléphone
pour "bavarder" malgré d'inlassables tentatives des
compagnies pour les décourager.
Dans les années 20, l'industrie du téléphone cessa
de résister à cette pratique, l'admit comme un fait accompli
et répondit au moins en partie au besoin de cette utilisation
décidée par les consommateurs.
Après avoir retracé l'histoire du téléphone
jusqu'en 1940, cet article décrira les changements dans les utilisations
vues par les promoteurs et les changements dans l'attitude de ceux-
ci vis à vis des relations sociales encouragées par le
téléphone. Les explications de ces changements seront
ensuite passées en revue. (4)
Une Brève histoire du Téléphone
Deux ans après l'attribution de son brevet à
A.G. Bell en 1876, il y avait environ 10000 téléphones
aux Etats-Unis et des disputes féroces au sujet des permis d'exploitation
de ceux-ci. La Compagnie Bell (plus tard AT&T)
en sortit gagnante et établit son monopole sur le pays. Le nombre
des souscripteurs augmenta rapidement et celui des téléphones
tripla entre 1880 et 1884.
La croissance ralentit pendant les années suivantes, mais le
nombre d'appareils totalisa 266000 en 1893 (5).
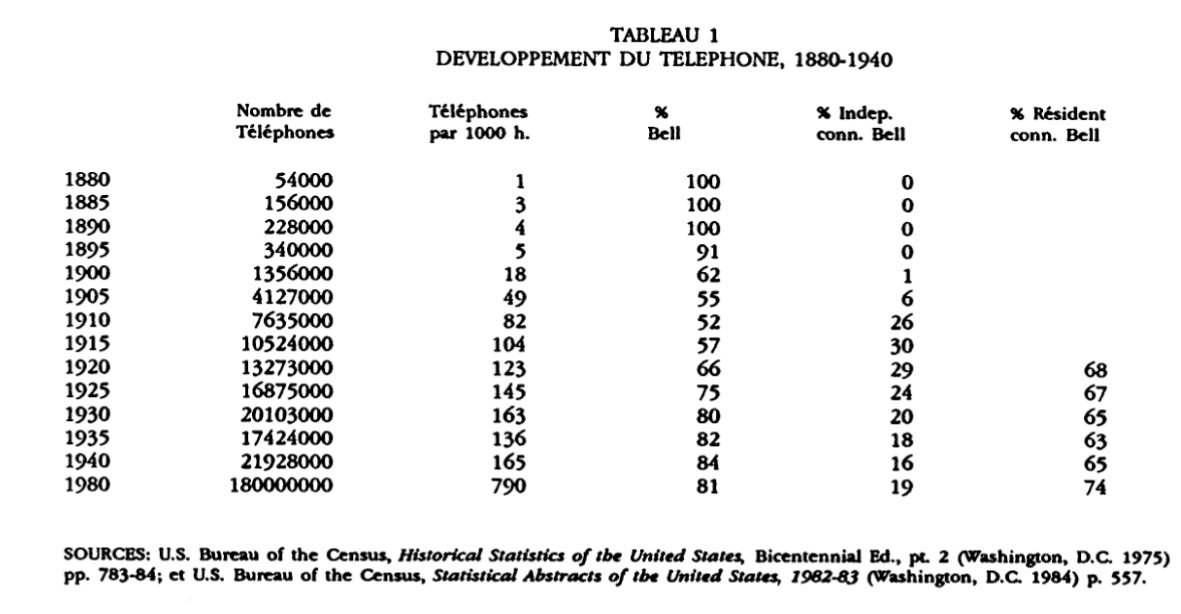
Comme moyen de communication à interrégional,
le téléphone menaça rapidement le télégraphe.
En effet, au cours des premiers affrontements que Bell eut à
engager, la compagnie des téléphones dut donner des compensations
financières à la Western Union pour les pertes qu'elle
lui faisait subir. Dans les communications locales, la téléphonie
supplanta très vite les efforts naissants pour créer des
systèmes d'échanges par signaux (à l'exception
des téléscripteurs). Pendant le monopole Bell, avant 1894,
le service du téléphone consistait à la base d'une
ligne individuelle pour lequel le client payait un abonnement annuel
fixe, lui permettant un nombre illimité d'appels dans la zone
d'échange. Le tarif des abonnements était très
variable et dépendait du volume des échanges. Il chuta
au milieu des années 90, peut-être par anticipation de
la compétition à venir.
En 1895, l'abonnement moyen pour une habitation
était de 4,66 dollars (13% du salaire moyen d'un ouvrier) et
demeura assez haut, surtout dans les grandes villes
(le prix à Manhattan était de 10,41 dollars par mois en
1894) (6). A l'expiration de la licence d'origine, en 1893-94, des milliers
de vendeurs de téléphone, des sociétés,
des coopératives, se lancèrent sur le marché. Bien
qu'ils se développèrent dans des zones que Bell avait
ignoré, il y eut quelques cas de compétition acharnée
qui entraînèrent les prix vers le bas et contribuèrent
à la diffusion du téléphone: entre 1893 et 1902,
le nombre des appareils fut multiplié par neuf, alors que dans
les neuf précédentes années, il n'avait fait que
doubler (7).
Bell se défendit vivement contre la compétition,
utilisant la guerre des prix, les confrontations au niveau politique
et d'autres tactiques agressives, essayant de toucher les clients à
moindre potentiel en installant des téléphones collectifs
moins chers, des appareils à sous et un service "à
l'appel". Pourtant, Bell avait perdu la moitié du marché
en 1907.
Après, une nouvelle direction, sous l'égide
de Theodore N. Vail, l'homme qui eut le plus
d'influence dans l'histoire du téléphone aux U.SA, Bell
changea de stratégie. Au lieu de cette expansion à tout
crin, AT&T racheta ses compétiteurs où cela était
possible et céda les territoires où la rentabilité
était négative. Avec un contrôle fiscal plus ferme
et des incertitudes dans la répartition de son capital, AT&T
vit son taux de croissance décliner (8). Pendant ce temps, les
"indépendants" ne pouvaient se développer au-
delà de leurs petites villes d'origine, en partie parce qu'ils
étaient incapables de construire leurs propres lignes longue-distance
et étaient coupés de la ville de New-York, contrôlée
par Bell. Certains d'entre eux n'étaient pas compétitifs
parce que mal financés et fournissaient des services insuffisants.
D'autres acceptaient, ou même sollicitaient d'être rachetés
par AT&T ou ses alliés. En 1912, Bell regagna 6% du marché.
Pendant l'ère de la compétition, l'industrie offrit aux
clients une grande variété de services comme le téléphone
collectif et le tarif des abonnements de Bell pour la clientèle
privée en 1909 était en moyenne un peu au-dessous de 2
dollars par mois (soit 4 pour cent du salaire moyen) (9). La surface
des échanges locaux et les services fournis variaient grandement,
mais les coûts chutaient régulièrement et la liste
des abonnés s'allongea. Les tarifs de base changèrent
peu jusqu'à la Deuxième Guerre Mondiale (bien que les
prix sur les appels interrégionaux se soient effondrés
à cette époque).
Menacés de campagnes anti-trust par le
gouvernement fédéral, AT&T accepta fin 1913 de donner
une forme légale aux arrangements de cohabitation passes avec
les indépendants locaux. Sur plusieurs années, le service
local du téléphone fut divisé en monopoles régionaux
fixes. Le système moderne à l'échelon fédéral
où Bell domine le service local et contrôle totalement
le service interrégional - fut essentiellement structuré
au début des années 20 et resta en place jusqu'en 1984.
La croissance astronomique du nombre de téléphones
pendant l'ère pré-Vail (un taux annuel composé
de 23% par tête de 1893 à 1907) devint plus simplement
un taux de croissance très sain (4% entre 1907 et 1929). Le système
fut consolidé et techniquement amélioré. Vers 1929,
42 % des foyers avaient le téléphone
aux États-Unis. Pendant la Dépression, ce chiffre tomba
à 31% (1933) puis rebondit à 37% des foyers (1940).
sommaire
Stratégies de Vente
L'industrie du téléphone croyait,
comme le Président Vail en témoigna en 1909, que le public
devait être éduqué... pour comprendre la nécessité
et les avantages du téléphone" (10). Et Bell se félicita
de son succès dans une publicité titré: "montrer
la voie": Bell "eut à inventer l'usage du téléphone
dans les affaires et convaincre les gens de son utilité... [Bell]
créa l'habitude du téléphone dans des villes comme
New York ou Chicago... développa à partir de rien un besoin
en téléphones et ensuite, le fournit.." (11).
"Éduquer le public" signifiait très typiquement
faire de la publicité, du porte-à-porte et développer
les relations publiques. Dans les premières années, ces
efforts incluaient des campagnes d'information pour faire connaître
l'existence du téléphone, montrer aux gens comment s'en
servir et encourager de courtoises conversations téléphoniques
(12). Quand la menace de nationalisation devint sérieuse les
publicités encouragèrent fermement les électeurs
à se manifester vivement en faveur de Bell. (13)
Pour trouver des clients payants, la première question que les vendeurs avaient à se poser: "Quel usage peut-on donner à cette machine?" ne trouvait pas à l'époque de réponses évidentes. Pendant les vingt-cinq premières années, les campagnes commerciales utilisaient largement les vendeurs à domicile, les petites notices d'information, des histoires "de faits divers" fournies à des rédacteurs de journaux (nombre d'entre eux étaient alors abonnés gratuitement ou utilisateurs avantages) et glissées innocemment dans les colonnes des quotidiens, des démonstrations publiques et des prises de contact directes avec les hommes d'affaires. Quant aux utilisations, et cela de façon assez naturelle, les vendeurs les tirèrent des applications étendues du télégraphe. Par exemple, en 1877 à New Haven, où les premiers échanges téléphoniques avaient eu lieu, un circulaire stipulait que "votre femme peut passer commande de votre dîner, d'un taxi ou demander au médecin de venir, etc.. tout cela par le téléphone et sans avoir à quitter la maison ou faire appel à un domestique ou un messager." (peu de succès...).(14) Dans cet usage, le téléphone était en compétition avec le télégraphe local qui offrait les mêmes avantages à leurs abonnés ou avec les systèmes de télégraphes imprimeurs, véritable "courrier électronique". (15) Le téléphone eut cependant le dessus.
Pendant cette période et dans les années
suivantes, ceux qui avaient la charge de commercialiser le téléphone
cherchèrent de nouvelles utilisations pour renforcer celles qui
étaient issues du télégraphe. Ils offrirent ainsi
bulletins météo, dates de concerts, résultats des
sport et les horaires des trains ! Pendant des dizaines d'années,
les vendeurs recherchèrent de nouvelles applications: des informations,
du sport, de la musique, une veille téléphonique et ainsi
de suite ! Les magazines de l'industrie publièrent de nombreuses
histoires de téléphones utilisés pour vendre des
produits, pour prévenir les pompiers des feux de forêt,
pour bercer bébé à distance ou pousser les électeurs
à aller voter. Et pourtant, les employés de la compagnie
attribuaient la faiblesse de la demande au fait qu'on n'avait pas appris
au client "ce qu'il pouvait faire de son téléphone".(16)
Dans les deux premières dizaines d'années du vingtième
siècle, la promotion du téléphone devint professionnellement
plus "moderne" (17). AT&T engagea une agence de Boston
pour développer la "publicité libre" et plus
tard, débaucha son directeur, J.D. Ellsworth. L'agence commença
des campagnes de publicité nationales et fournit les compagnies
Bell locales en copies de leurs réclames pour les journaux régionaux.
Certaines publicités étaient implicitement concurrentielles
(appuyant par exemple sur le fait que Bell avait un service interrégional)
et la plupart étaient des promotions-maison orientées
pour donner au public une image favorable de Bell. La publicité
d'encouragement à la vente impliquait des dessins, peintures,
des slogans et des textes écrits pour rendre l'usage du téléphone
(et pas seulement la technologie) attirant La quantité et le
type de publicité variait - surtout chez Bell - en fonction de
la concurrence, des stocks disponibles et des questions politiques.
(18)
De 1900 environ jusqu'à la Première Guerre Mondiale, l'agence
de publicité de Bell vanta les mérites du téléphone
en glissant des "faits divers" sur le téléphone
dans les journaux d'intérêt local: vie
agricole, vie paroissiale, gazettes d'hôtel et autres publications
du même style.(19)
Les grandes campagnes nationales qui commencèrent vers 1910 s'adressaient
essentiellement aux hommes d'affaires, affirmant que le téléphone
faisait grande impression sur les clients et faisait gagner du temps
au bureau comme à la maison. Elle rappelait souvent la commodité
du téléphone pour l'emploi du temps et pour garder le
contact avec le bureau pendant les vacances.
Le deuxième thème majeur était
l'administration de la maison.
Le cru 1910 dressait une liste détaillée de suggestions:
les abonnées pouvaient téléphoner à leur
couturière, leur fleuriste, au théâtre, dans les
restaurants, les clubs, leur agence de location, leur marchand de charbon,
les écoles et ainsi de suite. D'autres utilisations étaient
également suggérées comme la transmission de messages
d'une urgence très modérée (un homme d'affaires
appelant chez lui pour annoncer son retard, appel au plombier), ou d'invitations
(à une soirée impromptue ou pour trouver un quatrième
à un bridge). Les thèmes mondains ("rendre visite"
à un parent par téléphone, appeler chez soi pendant
un voyage d'affaires, ou "garder le contact avec les amis et les
parents") apparaissaient aussi, mais étaient plus rares
et presque toujours envisagés comme un message rapide, une invitation,
l'annonce qu'on est bien arrivé - plutôt qu'une conversation.
Quelques publicités faisaient également remarquer la modernité
du téléphone ("c'est dans le vent!").
Mais les utilisations principales suggérées dans les premières
publicités concernaient les affaires et la maison; la vie mondaine
y était rarement abordée. (20)
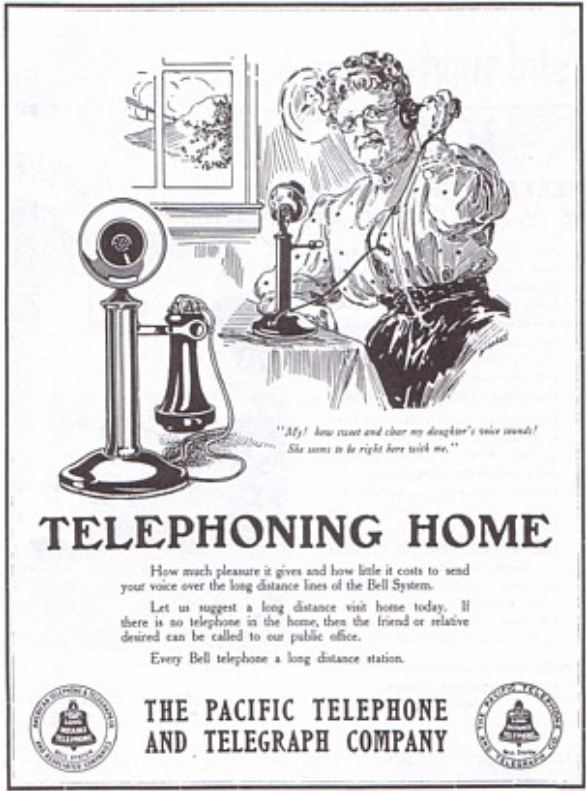 |
Publicité courante de 1915 montrant les aspects sociaux du téléphone .
Se connecter avec plus de gens Les compagnies de téléphone ont
fait la promotion du téléphone auprès des
entreprises pour accroître leur efficacité, gagner
du temps et impressionner leurs clients. Un manuel destiné
aux vendeurs de téléphones datant de 1904 suggère
des raisons pour lesquelles les clients résidentiels devraient
installer un téléphone : |
Avec le déclin de la compétition et l'accroissement
de la législation dans les années 10, Bell développa
encore plus les relations publiques et pressa les compagnies locales
de suivre cette politique. AT&T laissa de plus en plus services
et utilisations de base de la publicité aux filiales, bien qu'une
grande quantité du matériel venait toujours de New York
et le volume de cette publicité déclina. Le matériel
venant de Pacific Telephone and Telegraph (PT&T), apparemment un
annonceur de première taille parmi les différentes compagnies
Bell, donne une indication sur la substance de la publicité "pour
la consommation" pendant cette période.
(21)
Les publicités de PT&T pour 1914 et 1915 comptent, à
part les notices d'information et les dythirambes sur le téléphone,
quelques suggestions aux hommes d'affaires (par exemple "Vous,
le pêcheur invétéré que ces chaudes journées
de printemps entraînent sur vos courants favoris... vous pouvez
régler vos affaires avant de partir, vous assurer des conditions
de pêche, faire vos réservations et toujours garder le
contact avec le bureau et la maison"). Plusieurs publicités
faisaient mention de la maison ou des femmes, comme celles qui suggéraient
que les postes supplémentaires ajoutent à la sécurité
et celles qui encouragaient à faire les courses par téléphone.
Une seule publicité dans cet ensemble envisageait clairement
une conversation amicale: une dame d'âge vénérable
parle au téléphone, une vue bucolique visible par la fenêtre
derrière elle: "Mon Dieu que la voix de ma fille est douce
et claire! On dirait qu'elle est juste à côté de
moil" Le texte dit: "Pourquoi se refuser une visite interrégional
à la maison aujourd'hui?" Mais ce type de publicité
était inhabituel.
Pendant et juste après la Première Guerre
Mondiale, il n'y eut guère de promotion du téléphone,
puisque l'industrie se débattait pour satisfaire la demande.
La publicité s'employa plutôt à calmer l'irritation
du client devant les délais de livraison. Vers le milieu des
années 20 seulement, l'attention de AT&T et des compagnies
Bell se réorienta - pour la première fois depuis des années
- vers la vente. (22)
Bell devint alors un très gros annonceur et ses dirigeants discutèrent
activement de ces efforts. Les campagnes étaient axées
sur des services "chers" comme les appels interrégionaux
et les postes supplémentaires; la "psychologie" moderne
influença les thèmes publicitaires et les dirigeants de
Bell devinrent de plus en plus sensibles à la compétition
venue des autres biens de consommation. L'orientation vers un téléphone
mondain s'accentua, surtout dans le cadre du marché de la interrégional.
Aux Etats-Unis, la publicité sur ce type de service visait encore
dans sa grande majorité le marché des affaires, mais le
téléphone comme moyen de "rendre visite" apparut
alors de plus en plus fréquemment. Bell Canada, pour une raison
inconnue, porta ses efforts beaucoup plus sur les liens familiaux. Deux
messages typiques des deux décennies suivantes
dans les annonces publicitaires de Bell Canada datent de 1921: "Pourquoi
les coups de téléphone de nuit sont- ils appréciés?".
"Comme ça serait bien d'entendre la voix de Maman ce soir,
pensa-t-il parce qu'il y a des moments où on est bien seul dans
la grande ville"; et "c'est maintenant un rendez-vous hebdomadaire,
ces charmantes conversations intimes. Les distances n'existent plus
et pendant quelques minutes chaque jeudi soir, les voix familières
racontent les petites histoires de famille qu'on est tous les deux si
contents d'entendre". Pendant cette époque, on donnait comme
tuyau aux vendeurs de fournir à leur clients des listes des numéros
de téléphone de leurs contacts extérieurs à
la ville.
Dans les années 1920, l'industrie publicitaire
développa aussi les techniques dites "d'atmosphère",
laissant le produit de côté et s'attachant beaucoup plus
aux effets sur la vie du client (23) Un glissement similaire commença
peut- être dans la publicité de Bell: "La Southwestern
Bell Telephone Company a décidé en 1923 qu'il s'agit de
la vente de quelque chose de plus vital que la distance, la rapidité
et la précision... Le téléphone... met presque
[les. gens] face à face. Cest le substitut parfait au contact
personnel. Donc, le but fondamental de la publicité actuelle
est de vendre leurs voix aux clients de la compagnie à leur juste
prix, de les aider à réaliser que "Votre Voix, c'est
Vous...", d'amener les abonnés à penser au téléphone
quand ils pensent aux amis lointains ou aux parents..." (24) Cette
attitude n'était apparemment qu'un présage, car pendant
la quasi-totalité des années 20, le thème de l'instrument
de contact social était largement réservé aux longues
distances et n'apparaissait pas dans les très nombreuses publicités
des services courants.
Les vendeurs de Bell passèrent l'essentiel
des années 20 à vendre des services domestiques: les postes
supplémentaires, des lignes collectives, des services interrégionaux
à leurs abonnés habituels, plutôt que de trouver
de nouveaux clients. Les tarifs de base pour l'habitant étaient
en moyenne de deux à trois dollars par mois (environ 2% du salaire
moyen d'un ouvrier), ce qui ne changeait rien par rapport à la
décennie précédente et les dirigeants de Bell ne
trouvaient pas que la recherche de nouveaux abonnés apporterait
un profit justifiant une organisation sérieuse.
(25)
Le thème publicitaire, dans ce domaine, resta donc celui des
années précédentes. PT&T soutint que les téléphones
privés, et surtout les postes supplémentaires, étaient
utiles pour les urgences, pour la commodité ("Ne ratez pas
une invitation!", "Appelez votre femme pour qu'elle mette
un couvert de plus au dîner...") et pour éviter l'ennui
d'appeler depuis le poste d'un voisin, ainsi que pour l'usage professionnel
classique. Un manuel de vente de Bell Canada pour 1928 classait l'usage
domestique en premier et les invitations mondaines en second pour la
vente du service de base. (26)
Puis, vers la fin des années 20, les dirigeants
de Bell - aiguillonnés peut-être par l'humiliante réalité
que, pour la première fois, les familles américaines préféraient
d'abord l'automobile, le gaz et l'électricité à
un abonnement au téléphone - choisirent une stratégie
plus agressive. Ils rassemblèrent une équipe de vente
très motivée et présentèrent le téléphone
comme une source de "confort et de commodité": laissant
de côté l'aspect pratique, ils usèrent des thèmes
plus psychologiques et sensuels des publicités de l'automobile.
Ils ne se centrèrent pas seulement sur l'amélioration
des services des abonnés déjà acquis, mais cherchèrent
à atteindre ces propriétaires de voitures, ces abonnes
à l'électricité sans téléphone. Et
le caractère social de ce dernier devint l'ingrédient-clef
de cette nouvelle stratégie de vente. (27)
Cependant, avant que "le confort et la commodité"
ne fassent leur chemin, la Dépression fit dégringoler
encore une fois les efforts de l'industrie au minimum de base: les abonnés
rendaient leurs lignes. Les compagnies Bell montèrent alors des
campagnes pour sauver les raccordements privés en mobilisant
tous les employés pour vendre ou sauver des relais téléphoniques
sur leurs heures personnelles (un programme qui avait commencé
avant le Krach), accroissant les effectifs des vendeurs, adressant la
publicité aux abonnés de base, et en lançant des
campagnes de porte à porte pour "sauver" des lignes
ou récupérer les "non-utilisateurs" dans certains
endroits. (28) Les "boniments" suggérés par
PT&T à ses employés incluaient la commodité
(par exemple, éviter d'aller jusqu'au marché), éviter
l'humiliation d'emprunter la ligne de son voisin
ou simplement, être "moderne". Les vendeurs, pourtant,
semblaient plus enclins à fonder leur tactique sur les utilisations
d'urgences ce qui était assez efficace aurpès des parents
de jeunes enfants, et suggéraient même que les offres d'emploi
pourraient venir via le téléphone. Avoir un téléphone
pour garder le contact avec les amis et la famille était un angle
d'attaque moins privilégié. Un demi-siècle après
l'invention de A.G. Bell, les représentants de la compagnie ne
vendaient pas le service téléphonique en lui- même
mais devaient convaincre les clients potentiels qu'ils avaient besoin
d'un téléphone dans leur propre maison. (29)
Pendant la Dépression, la publicité pour les services interrégionaux continua, utilisant le thème du travail ou celui de la famille et des amitiés, mais la publicité pour les services de base s'adressant aux "non-utilisateurs" et aux éventuels déconnectés devint beaucoup plus fréquente que dans les vingt années précédentes. L'argument principal pour le service local était le côté pratique - les cas d'urgence, en particulier - mais les conversations sociales étaient pour une fois évoquées comme jamais auparavant. Dans une réclame de 1932, on voyait quatre personnes assises autour d'une femme parlant dans un téléphone. "Passez chez nous!" dit le texte. "Les amis qui sont reliés par le téléphone s'amusent bien." Une publicité de 1934 de Bell Canada montre un couple qui vient juste de se réabonner et qui témoigne: "On a perdu le contact avec tous nos amis et on regrettait les bonnes occasions qu'on a maintenant retrouvées". En 1935, une publicité demandait: "Avez-vous jamais observé quelqu'un qui téléphone à un ami ? Avez-vous remarqué ses lèvres qui sourient à tout moment..? " Et en 1939: "On pense à l'autre, on prend le téléphone et tout va bien." Une publicité de AT&T de 1937 nous rappelle que "le téléphone est vital pour les urgences, mais ce n'est pas tout... Le chemin de l'amitié suit souvent son fil". Ces motifs familiaux et amicaux, plus fréquents et francs dans les années 30, présagent bien des couplets publicitaires d'aujourd'hui comme "... une voix familière, comme la poule au pot/est bonne pour votre santé/Décrochez le combiné, décrochez-le et appelez quelqu'un..." (30)
Cette brève chronologie est largement tirée
de documents d'archives et non de publicités
actuellement imprimées.
Cependant, une étude systématique de deux journaux de
Californie du Nord confirme l'impression d'une augmentation des thèmes
socio-mondains. A part un encart de 1911 faisant référence
à l'isolement des femmes de fermiers, la première annonce
de ce type dans VAntiocb Ledger apparût en 1929, s'adressant aux
parents: "Aucune fille n'aime faire tapisserie". Elle fut
suivie en 1930 par des annonces pour les services de base (téléphone
local): "Laissez rentrer vos amis chez vous", et "Appelez
vos parents aujourd'hui!" En 1911, les publicités dans le
Marin (County) Journal montraient l'aspect pratique du téléphone
pour les touristes.
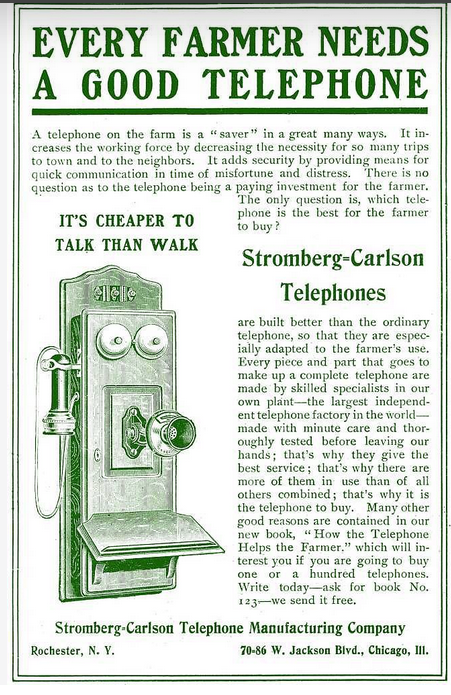
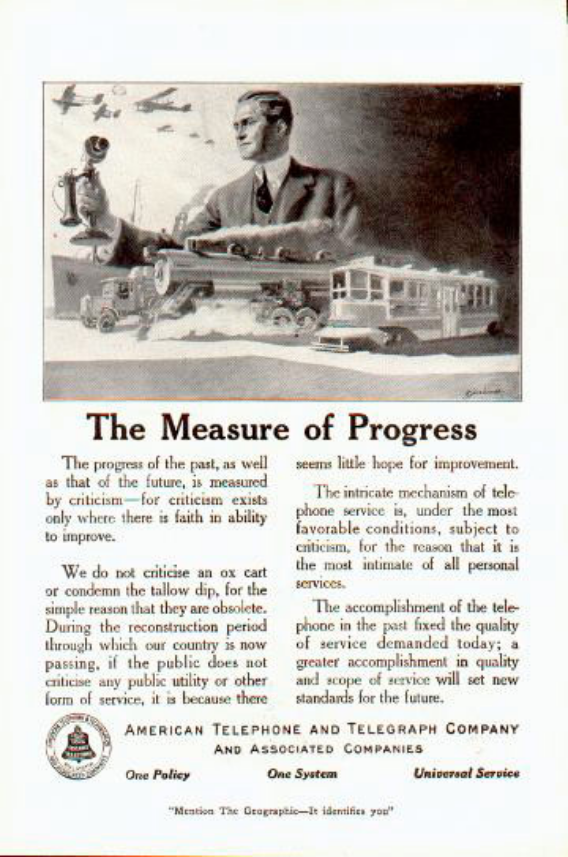
La sociabilité devint un thème majeur pour
les publicités du service local et du service interrégional
dans les années 20 et 30 avec des suggestions du type: "Élargissez
le cercle de vos amis" (1927). "Votre voix part en visite
chez vos amis des villes voisines" et "Appelez votre grand-
mère" (1935), ou bien encore: "J'ai pris le téléphone
parce que c'était pratique, je n'aurais jamais pensé que
c'était aussi amusant!" (1940). (31)
L'émergence de l'aspect sociable apparaît aussi dans les
guides des représentants en téléphone. Un manuel
d'instructions de 1904 présente beaucoup d'arguments de vente
mais un seul paragraphe évoque la vie domestique. Ce paragraphe
décrit les façons dont le téléphone épargne
le temps et le travail de la maîtresse de maison, contribue au
bon fonctionnement du borne et sauve les utilisateurs dans les moments
d'urgence, mais la seule utilisation conviviale envisagée est
de prendre le téléphone pour "inviter un ami, leur
dire de ne pas venir, leur dire de se presser ou leur retourner une
invitation". La conversation pour la joie de converser n'est même
pas mentionnée. Un mémorandum de 1931 aux représentants
intitulé "Votre Téléphone" est, d'un
autre côté, plein de petits trucs pour vendre et encourager
l'utilisation du téléphone personnel. Le premier chapitre
et le plus long commence s'intitule "Favoriser l'amitié".
"Votre téléphone maintiendra vivantes et actives
vos relations amicales. De vraies amitiés sont trop rares et
trop précieuses pour être brisées quand vous ou
vos amis quittez la ville. La correspondance sauve les apparences pendant
un certain temps mais les amitiés ne se nourrissent pas seulement
de longues lettres.
Quand vous ne pouvez pas rendre visite en personne,
téléphonez de temps en temps. Un appel maintiendra remarquablement
l'intimité. Il n'y a pas besoin que vos amis sortent de votre
vie quand ils retounent loin chez eux". Un manuel de 1935 met en
avant les aspects pratiques du téléphone, mais insiste
aussi sur "l'importance sociale" de l'appareil pour épargner
aux utilisateurs d'être laissés pour compte par leurs amis
qui ne peuvent plus [les] joindre facilement". (32)
Ce compte-rendu, jusqu'ici, couvre la publicité
du réseau Bell. Moins connu, et peut-être moins important,
est la publicité des compagnies indépendantes parce qu'elle
ressemble pour l'essentiel à celle de Bell, tout en se montrant
plus sensible aux liens sociaux parmi leurs clients ruraux. (33)
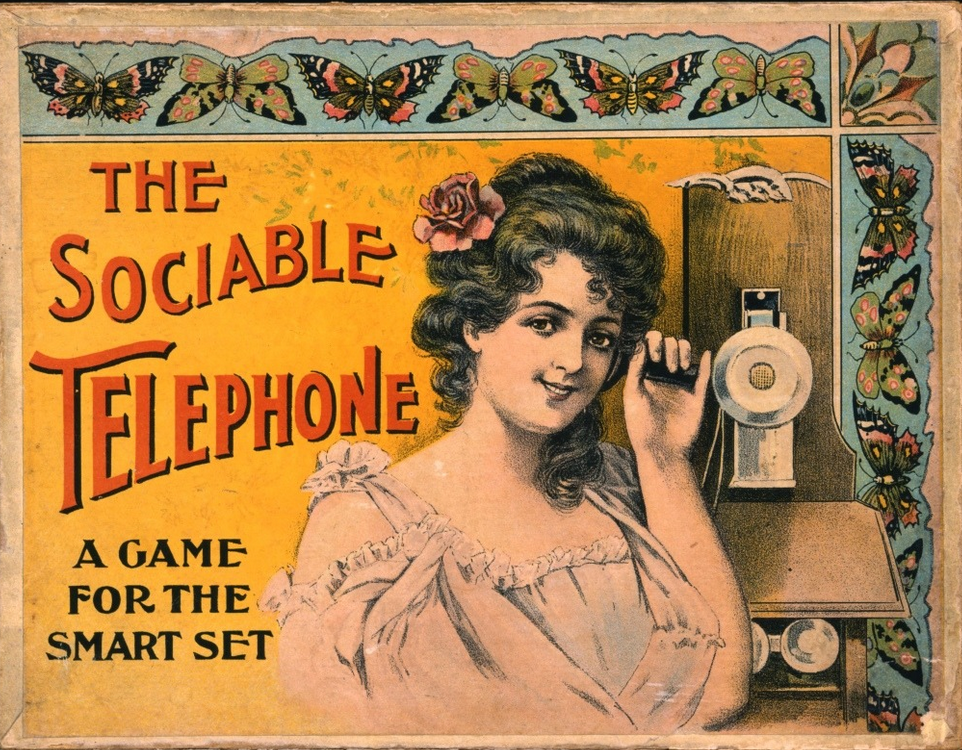 “The Sociable Telephone”
card game, 1902.
“The Sociable Telephone”
card game, 1902.
Excellent jeu de société pour 2 à 5 joueurs,
avec une durée de jeu moyenne de seulement 30 minutes. Un jeu
conçu pour enseigner une bonne interaction sociale, les joueurs
reliés par un « téléphone » posent
des questions auxquelles répondent des phrases sur les cartes
de jeu.
En somme, la variété du matériel
de vente met en valeur un glissement similaire. Depuis les débuts
jusqu'au milieu des années 20 environ, l'industrie a vendu le
service téléphonique comme un instrument pratique pour
les affaires et les problèmes domestiques avec quelques mentions
occasionnelles sur son usage social, et cela très largement dans
le contexte de brèves conversations. Plus tard, les arguments
de vente, pour les appels locaux et interrégionaux, montrèrent
d'abord les utilisations sociales, incluant l'idée que le téléphone
pouvait être utilisé pour la conversation (la voix rend
visite") avec les amis et la famille. Alors qu'il serait salutaire
pour différentes raisons de confirmer ce compte-rendu impressionniste
à l'aide de statistiques sûres, il est difficile de dessiner
un exemple précis du message publicitaire et des boniments des
représentants pendant plus de soixante ans. (Par exemple, nous
n'avons pas un "univers" publicitaire défini Les unités
de calcul appropriées sont-elles les messages spécifiquement
imprimés, ou les campagnes publicitaires ? Comment traiter les
copies ? Ou les publicités dans les villes voisines ? Doivent-ils
inclure les histoires cachées dans les journaux, les encarts
publicitaires sur les notes de téléphone, les panneaux
d'affichage et autres ? Les publicités générées
localement doivent-elles être incluses ? Et que faire des publicités
nationales non utilisées par les filiales locales ? Par ailleurs,
nous n'avons pas une "population" clairement
définie de publicités. Les collections disponibles sont
fragmentaires, bien souvent présélectionnées pour
diverses raisons).
Un effort dans cette direction apparaît dans le tableau 2, dans
lequel le nombre de publicités "sociales" montre un
net accroissement, à la fois absolu et relatif.

Sources : Les publicités dans l'Antioch Ledger ont été
rassemblées et classées de 1906 à 1940 par Barbara
Loomis; celle du Marin Journal
ont été classées de 1900 à 1940 par John
Chan. La collection de Bell Canada se trouve dans les classeurs de la
BELL CAN HIST.; la
collection de Pacific se trouve au San Francisco Pioneer Museum. La
collection de ATAT viennent des ATT ARCH, botte 1317. D'autres,
incomplètes collections ont été utilisées
pour l'étude mais n'ont pas été comptées
car pas aussi systématiquement classées. L'auteur est
responsable du classement.
NOTE: Les décomptes entre parenthèses excluent systématiquement
toutes les publicités des services interrégionaux. De
façon générale,
chaque publicité avait son thème dominant. Quand plus
d'un thème semblait d'un poids égal, la publicité
a été comptée dans les deux
catégories. "Social, sociabilité" fait référence
à l'usage du téléphone pour les contacts personnels,
"Joyeux Noël et Bonne Année", invitations
et conversations entre amis ou entre membres de la famille indus, (il
faut noter qu'induré de brefs messages dans cette catégorie
fait de
cette analyse un test assez conservateur de l'argument qu'il y a eu
un glissement des thèmes de sociabilité). "Affaires
et hommes d'affaires"
fait référence à l'utilisation spécifique
du téléphone pour les affaires, le travail et les publicités
l'adressant généralement aux hommes
d'affaires, par exemple que "le téléphone donnera
du poids à un entrepreneur". "Maison et commodité"
inclut l'usage du téléphone pour
l'organisation domestique, la commodité personnelle (par exemple
"inutile de vous mouiller, réseivcz vos tickets de théâtre"),
et pour les
urgences, comme la maladie ou un cambriolage. "Relations publiques,
autres" rassemble la publicité de base, d'information (comment
utiliser
votre téléphone"), et les publicités diverses.
L'indice le plus conservateur est peut-être le rapport entre les
publidtées "sociales-locales" et
"domestiques-locales". (Les publicités destinées
au monde du travail se déplacent vers les magazines spécialisés
au fil des années; les
publicités d'information publique fluctuent au gré des
événements politiques; et les publicités sur l'interrégional
peuvent être
intrinsèquement sociales). Dans l'Antioch Ledger, ce taux change
de 1/5 à 4/3; dans le Marin Journal de 1/12 à l/l; et
pour les publicités
de Bell Canada, de 1/14 à 1,5/1. Même ces taux sous-estiment
le glissement pour diverses raisons. D'abord, parce que j'ai été
plus attentif
aux publicités sociales qu'à d'autres et plus consciencieux
encore sur ceux des premiers temps que pour toutes les autres catégories.
Ensuite,
parce que la catégorie "maison" s'est développée
au cours de la dernière période par un grand nombre de
publiâtes vantant les mérites du
poste supplémentaire. Troisièmement, la nature des publiâtes
de sociabilité comptées dans ce tableau change. Les premières
suggéraient
d'utiliser le téléphone pour les fêtes, les invitations
mais pas pour la conversation. A quelques rares exceptions, seules les
dernières parlent
d'amitié et de "rapports humains", suggérant
ainsi le bavardage.
sommaire
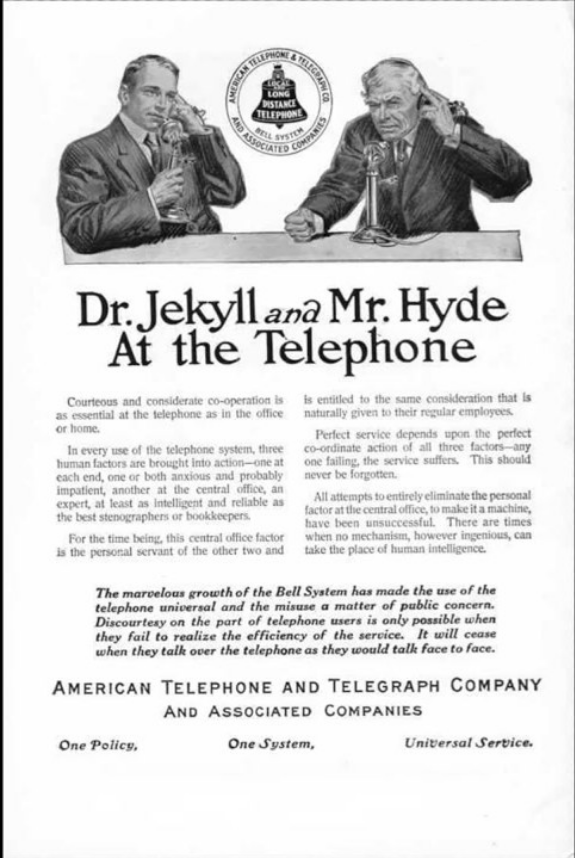

Attitudes de l'Industrie envers la Sociabilité
Ce changement dans la publicité reflétait apparemment un changement dans les certitudes que les hommes de l'industrie avaient sur le téléphone. Alexander Graham Bell lui-même avait envisagé le bavardage mondain grâce à son invention. Il avait prédit qu'un jour, Madame Smith passerait une heure au téléphone avec Madame Brown "pour joyeusement., débiner Madame Robinson".34 Mais pendant des dizaines d'années, peu de ses successeurs avaient eu ce don de visionnaire.
Au contraire, les vendeurs de téléphone des premiers temps s'affrontèrent avec leurs clients au sujet de ces conversations sociales, les décrivant comme "frivoles" ou "inutiles". Par exemple, une annonce de 1881 se plaignait en ces termes: "Le fait que les abonnés soient libres d'utiliser le téléphone librement sans encourir de dépenses additionnelles [à cause des tarifs locaux de base] a conduit à la transmission d'un grand nombre de communications d'un caractère totalement superflu". (35) En 1909, un directeur local de Seattle écouta quelques exemples de conversations personnelles et détermina que 20% des appels étaient des commandes à des magasins et autres entreprises, 20% venaient d'abonnés téléphonant à leurs bureaux, 15% étaient des invitations et 30% étaient de "purs bavardages" - un taux égal à ceux des autres villes. Le souci de ce directeur était de réduire ce dernier "usage inutile". Une tactique utilisée pour cela, en plus des campagnes "éducatives" sur le bon usage du téléphone, fut de placer des limites de temps aux appels (dans son étude, l'appel moyen durait sept minutes). Les limites de temps étaient souvent un effort explicite pour décourager les gens qui insistaient pour bavarder alors qu'il y avait des "affaires" à traiter. (36)
Quelques rares industriels, croyant en une téléphonie plus "populiste", essayèrent cependant d'encourager ces usages. E.J. Hall, qui sortait de Yale et qui était à l'origine responsable d'une usine familiale de briques réfractaires, créa en 1880 le premier "service à temps facturé" (à impulsions) à Buffalo en 1880 et plus tard, devint un vice-président d'AT&T. Plaidant pour des tarifs plus bas, Hall défendit également les appels "futiles", arguant du fait qu'ils ajoutaient à la valeur d'usage du système. Mais l'isolement évident d'hommes comme Hall souligne la vision anti-sociable dominante d'avant 14. (37) L'opinion officielle à AT&T se rapprocha des idées de Hall vers la fin des années 20, quand les directeurs firent une déclaration modifiant complètement la philosophie générale du téléphone: alors qu'ils l'avaient toujours vu comme une nécessité pratique, ils réalisaient maintenant qu'il s'agissait plutôt d'un "luxe, d'une commodité et d'un confort" et que sa valeur lui venait aussi de son utilisation "futile". En 1928, le Vice-Président de la Publicité A.W. Page, qui venait de ce milieu et était entré un an auparavant à AT&T, fut même plus direct dans ses critiques à l'égard de ces concepts révolus: "II y a eu aussi le point de vue [chez Bell et dans le public] qu'il ne fallait pas utiliser le téléphone pour les conversations frivoles. C'est aussi commercial que si un vendeur d'automobile proclamait: 'Ne prenez cette voiture que si vous avez des courses importantes à faire'. Nous devons admettre que le public connaît parfaitement le caractère nécessaire du téléphone, qu'il n'est jamais vu comme un jouet, surtout à la maison." Le mot d'ordre de Bell fut alors de vendre les services téléphoniques comme un élément "de commodité et de confort" et un outil de conversation. (38) Bien que ce changement d'opinion fut le plus visible pour Bell, une évolution similaire est visible dans les pages du journal des compagnies indépendantes, 'Telephony' et spécialement en ce qui concerne les clients ruraux. Car en effet, les premiers conflits sur le téléphone comme instrument de sociabilité furent les plus vifs dans les campagnes. Pendant l'ère du monopole, les compagnies Bell ignorèrent de façon générale cette demande rurale. Sa force et sa vitalité devint évidente dans les deux premières décennies de ce siècle, quand, proportionnellement, plus de fermes que de maisons urbaines obtinrent le téléphone, les premières en large partie des petites compagnies fermières ou des coopératives locales. La sociabilité de l'invention encourageait les souscriptions et irritait les représentants non- Bell.
Le Recensement des Téléphones de 1907 reconnaissait que dans les zones de fermes isolées, "la vie de la communauté serait impossible sans cet instrument de communication toujours accessible..." La solitude et l'insécurité ressentie par les femmes de fermiers dans les conditions qui régnaient avant son arrivée disparurent et les conditions pour la création d'une solidarité locale furent ainsi créées." D'autres enquêtes officielles furent témoins des mêmes résultats. (39) Les responsables locaux s'appesantissait aussi sur la sociabilité. L'un d'eux travaillant pour un indépendant, déclarait: "Quand on a commencé, les fermiers pensaient qu'ils n'avaient pas besoin du téléphone... Maintenant, on ne pourrait pas le leur retirer. Leurs femmes ne nous laisseraient pas faire, même si les hommes étaient d'accord. Socialement, le téléphone a été un don de Dieu. Les femmes du comté gardent le contact entre elles et avec leurs occupations sociales largement de nature paroissiales." (40)
Bien que les campagnes de vente épisodiques aux
fermiers insistaient sur les avantages pratiques du téléphone
comme de recevoir les prix des marchés, les bulletins météorologiques
ou de demander de l'aide, l'industrie du téléphone utilisait
plus souvent le thème de la sociabilité avec eux qu'avec
le public en général. PT&T fit, par exemple, en 1911
une série de publicités où le thème principal
était les cas d'urgence, l'information et les économies
d'argent Mais une publicité additionnelle vantait "bénédiction
pour la femme du fermier... qui soulage de la monotonie de l'existence.
Elle NE PEUT PAS être isolée avec Bell..." (4) Et
malgré tout, les professionnels du téléphone qui
traitaient avec les fermiers, luttaient contre l'utilisation des lignes
pour les conversations privées, en tout cas dans les premières
années. Les pages de Telephony étaient remplies de plaintes
contre ceux-ci qui, entre autres, encombraient les lignes de leurs bavardages.
Une plus grande compréhension de la valeur
de la sociabilité téléphonique pour les fermiers
émergea plus tard. Un compte-rendu de 1931 sur les activités
publicitaires en milieu rural mettait en avant l'utilisation professionnelle,
mais notait aussi que dans les dernières
années, l'emphase avait été mise sur l'utilité
du téléphone "dans les activités de tous les
jours... les passages obligés de la vie rurale". Un article
de 1932 dans le Bell Telephone Quarterly note que "l'usage du téléphone
dans un but social en zone rurale est fondamentalement important".
Ironiquement, en 1938, un indépendant proclama que le thème
était dépassé en tant qu'argument de vente parce
que l'automobile et d'autres techniques avaient déjà considérablement
diminué l'isolement des fermiers !
Comme le suggèrent certains passages, la question était lié au sexe des interlocuteurs... Quand les représentants d'avant la Première Guerre Mondiale utilisaient les activités féminines dans leurs publicités, ils envisageaient d'habitude la gestion de la maison, la sécurité et les cas d'urgence. Il est apparent cependant que les femmes - citadines comme rurales avaient trouvé le téléphone utile pour les contacts sociaux. (43) Quand les hommes de l'industrie du téléphone critiquaient le bavardage au téléphone, ils se référaient presque toujours à l'interlocuteur comme "elle". Plus tard, dans les années 30, les appels explicites à la sociabilité mirent l'emphase sur "elle": les publicités ne montraient que des femmes! On peut donc en gros établir un parallèle entre le glissement des encarts publicitaires vers la sociabilité et le changement d'attitude dans l'industrie du téléphone de l'irritation à la reconnaissance des conversations sociales comme faisant partie du "confort, de la commodité et du luxe" de cette invention.
sommaire
Explications économiques
Pourquoi les compagnies de téléphone furent-
elles si réticentes et tardives dans cette reconnaissance ?
Il y a plusieurs réponses possibles, qui ne s'excluent pas les
unes les autres. La plus évidente est qu'il n'y avait aucun profit
immédiat dans cette utilisation, mais un profit différé.
Les compagnies de téléphone, et
spécialement Bell, affirmaient que le secteur privé de
leur commerce était marginal, voire même déficitaire,
si on le mesurait par rapport au coût de chaque instrument et
que le service professionnel avait servi à subventionner le service
privé local. La validité de cet
argument reste à débattre. Néanmoins, la certitude
que le service "résidentiel" n'était pas rentable
demeurait très répandue, spécialement chez les
installateurs des lignes, et décourageait les ventes intensives
chez le particulier. De temps en temps, Bell manquait d'argent pour
construire les lignes nécessaires pour répondre à
la demande des particuliers. (44) Ces contraintes semblaient occasionnellement
motiver les ordres de New York de ne faire de la publicité pour
le service "particulier" que dans les zones où les
lignes existaient déjà et étaient non saturées.
(45) Et, parfois, il y avait incompatibilité technique entre
la qualité du service à laquelle Bell avait habitué
ses clients professionnels et la qualité que les particuliers
étaient prêts à payer. Dans ces conditions, Bell
préférait se centrer sur la classe affaire, qui payait
des tarifs plus élevés, achetait des équipements
supplémentaires et utilisait l'interrégional.
Pourtant, quand ils s'adressaient aux particuliers,
pourquoi les vendeurs n'employèrent-ils pas le thème de
la sociabilité avant les années 20, se reposant autant
sur les usages pratiques ? Le thème représentait après
tout un marché peut- être élastique et encore vierge.
Ayant servi ceux qui étaient sensibles aux questions pratiques
- et à partir de la Première Guerre Mondiale, tout le
monde les connaissait - les vendeurs purent penser qu'une poursuite
de l'expansion dépendait de la vente de "nouvelles"
utilisations sociales du téléphone; (47) Ou encore, qu'ils
avaient fait le plein du marché - 42% des foyers américains
en 1930 et ils déplacèrent leur attention vers l'encouragement
à l'utilisation, spécialement sur les lignes à
impulsions. Nous avons vu combien les incitations aux appels interrégionaux
invoquaient le thème de la famille et des amis. Mais cette explication
ne suffit pas: elle ne permet de pas de comprendre pourquoi les thèmes
de la sociabilité continuèrent pendant la Dépression
alors que l'industrie du téléphone s'attachait de nouveau
à la simple tâche de garder ses abonnés et aussi
pourquoi l'attitude interne de l'industrie changea également.
La réponse est peut-être dans la structure des tarifs. Initialement, les compagnies avaient un tarif de base pour un service uniquement interurbain mais quantitativement illimité. Dans un tel système, le nombre et la longueur des appels ne coûtaient rien à l'abonné mais cela ne faisait pas l'affaire du prestateur: une telle conversation mobilisait le temps de l'opérateur et, en occupant la ligne, décourageait d'autres appels. Certains industriels du téléphone blâmaient même le système du tarif de base, qui encourageait ces appels "superflus". (48) Décourager la "visite" par téléphone était donc logique. Le tarif fixe fut maintenu pendant toute cette période, et notamment pour les petites conversations téléphoniques, mais Bell et d'autres instituèrent un "service à impulsions" en totalité ou en partie faisant payer une somme supplémentaire par appel - dans les plus grandes villes pendant la période de compétition. A St Louis en 1898, par exemple, un téléphone à quatre postes coûtait 45 dollars par an pour 600 appels par an, plus 8 cents l'appel au-delà des 600. (49) Ce système permettait aux compagnies du téléphone de réduire le prix de base des abonnements et ainsi, d'attirer les consommateurs qui voulaient seulement se servir occasionnellement du téléphone.
Les dirigeants de Bell n'étaient pas d'accord sur ces questions de tarif calculé au temps d'utilisation. Certains y voyaient un moyen économique rationnel de faire payer l'abonné en fonction de son utilisation. D'autres le voyaient comme un moyen de réduire les appels "sans importance" comme l'usage du téléphone par des non-abonnés. D'autres encore, moins nombreux, comme E.J. Hall, le voyaient comme un moyen de recruter des masses de petits utilisateurs. L'industrie aurait pu considérer la conversation sociale comme bienvenue s'ils avaient pu faire payer suffisamment l'usage pour rattraper la perte des appels non aboutis ou pour les frustrations des autres abonnés. En principe, avec le service au temps d'utilisation, cela pouvait se faire (comme pour les services interrégionaux où le compteur fonctionnait à la minute). Bien qu'un système mécanique de comptage du temps n'était apparemment pas disponible à cette époque, une sorte de comptage existait quand même en principe, puisque le tarif d'un appel interurbain de type "message" était défini comme durant 5 minutes ou une fraction de 5 minutes. Ainsi, "une visite" téléphonique de 20 minutes aurait dû coûter 4 "messages". Dans un système comme celui-ci, les compagnies auraient pu exploiter économiquement la sociabilité et l'auraient encouragée. (50)
Cependant, le passage du tarif fixe au tarif minuté
ne semble pas expliquer le glissement qui s'est fait dans les années
20 vers la sociabilité. Déterminer l'impact du service
à l'impulsion sur les abonnés habitants des villes est
difficile parce que les horaires liés aux tarifs variaient du
tout au tout d'une ville à l'autre, même dans le même
état Mais l'explication n'est pas là... Déjà
en 1904, 96% des habitants de Denver bénéficiaient d'un
central à impulsions et en 1905, 90% de ceux de Brooklyn, New
York (alors qu'à Los Angeles, les habitants continuaient à
payer un prix fixe).51 II y a peu d'indices que les systèmes
tarifaires aient été modifiés de façon significative
dans les 25 ans qui suivirent alors que les thèmes de sociabilité
émergeaient.
A l'inverse, le tarif fixe persista dans les petits
échanges au-delà des années 30. Plus encore, les
thèmes de sociabilité apparurent plus souvent dans les
campagnes de vente en milieu rural que dans les zones urbaines, malgré
le fait que les campagnes restèrent dans le système du
fixe mensuel.
Bien que le souci de voir les lignes et les standardistes
occupées à perte contribua à la résistance
de l'industrie face à la sociabilité, cela ne peut constituer
une explication à cette attitude ou, plus particulièrement,
au momentum du changement.
Explications techniques
Les portes-parole de l'industrie de la première époque nous auraient probablement exposé que des considérations purement techniques expliquaient le désir de limiter les visites" téléphoniques. Les conversations trop longues monopolisaient les lignes collectives. Cest pour cela que les compagnies, s'abritant souvent derrière la pression de certains types d'usagers, encourageaient et installaient - ou cherchaient la permission légale d'installer - des limites de temps sur les appels. Mais là encore, ce n'est pas une explication du glissement vers la sociabilité, parce que jusque vers 1930, 40 à 50% des téléphones principaux de Bell dans presque toutes les grandes villes étaient encore collectifs, une proportion qui n'avait guère changée depuis 1915. (52)
Un problème lié était la surcharge des lignes payantes dans les communications interrégionales, notamment celles des villages et des petites villes. Les coopératives rurales se plaignaient des compagnies commerciales qui ne les fournissaient qu'avec une ligne unique entre chaque ville et ces compagnies résistaient en faisant valoir qu'elles étaient sous-payées pour ce service. Cette connexion à ligne unique créait une bonne raison de supprimer les "bavardages", au moins dans les zones rurales. Mais cela n'explique pas le changement d'attitude non plus. Le goulot d'étranglement ne fut résolu que bien après le glissement des ventes, quand il fut possible de faire passer plusieurs appels sur la même ligne. (53)
Le développement des échanges lointains
peut aussi expliquer l'accroissement des ventes dans le domaine de la
sociabilité. Tout le long de la période couverte dans
cet article, la technologie fit de rapides progrès, les tarifs
interrégionaux d'AT&T chutèrent et ses coûts
même plus encore. La motivation majeure des abonnés résidentiels
désirant le service interrégional était de contacter
les amis et la famille. En plus, la tarification en dépassement
était bien gérée et répercutée sur
le client Encore une fois, tout en participant probablement à
l'accroissement de la fréquence des thèmes de sociabilité,
les appels interrégionaux semblent insuffisants pour expliquer
le changement Ils s'élevèrent par rapport à tous
les appels, de 2,5% en 1900 à 3,2% en 1920 et 4,1% en 1930, puis
tombèrent à 3,3% en 1940. Ils n'atteignirent les 5% que
dans les années 60. Plus important encore, le glissement vers
la sociabilité apparaît dans les campagnes de vente des
services à tarif fixe et pour encourager l'utilisation locale,
tout comme dans les publicités pour les appels interrégionaux.
(Voir tableau 2).
Explications culturelles
Alors que les considérations techniques et économiques étayèrent sans aucun doute l'attitude de l'industrie vis à vis de la sociabilité, aucunes d'elles ne semblent suffisantes pour expliquer le changement historique. Une partie de l'explication se trouve probablement dans les convictions culturelles des gens du téléphone.
D'une certaine façon, l'industrie du téléphone était la descendante directe de l'industrie du télégraphe. Les instruments étaient assez semblables et les développement techniques s'appliquaient aux deux. Les gens qui développèrent, construirent et vendirent le téléphone venaient de façon prédominante du télégraphe. Théodore Vail lui-même était d'une famille liée au télégraphe et commença sa carrière comme télégraphiste. Au contraire, EJ. Hall et A.W. Page, parmi les supporters de "l'inutile" n'avaient aucun lien avec le télégraphe, tout comme J.L Sabin, un homme de la même inclination. Beaucoup de compagnies de téléphones avaient commencé dans les opérations télégraphiques. Et même, en 1880, Western Union faillit même supplanter Bell dans sa position. L'organisation de la Western Union servit jusqu'à un certain point comme modèle pour Bell Telephone. L'utilisation du téléphone remplaça souvent directement l'utilisation du télégraphe. Même le langage utilisé pour parler du téléphone révélait ses origines. Par exemple, une des premières publicités affirmait que le téléphone était "le télégraphe le meilleur marché du monde". Les appels téléphoniques étaient nommés pendant longtemps "messages". De fait, le télégraphe américain, finalement, servit fort peu pour les messages sociaux, même brefs.55 Rien d'étonnant dans ce cas à ce que les utilisations du téléphone suivissent largement pendant des dizaines d'années celles du télégraphe: communiqués d'affaires, ordres, messages d'urgence et commandes. Dans ce contexte, les responsables de l'industrie considéraient avec raison le téléphone "de visite" comme un abus, une "futilisation" du service. Les documents internes montrent bien que la plupart des dirigeants du téléphone voyaient cette technologie comme un instrument d'affaires et une commodité pour la classe moyenne. Ils affirmaient qu'on devait vendre avec vigueur sur la base de ces avantages marginaux, et croyaient que les gens n'avaient aucun besoin "naturel" d'un téléphone - et que la plupart d'entre eux n'en auraient jamais l'usage (les classes rurales et ouvrières). Les clients devaient donc être "éduqués".56 Le Vice-Président d'AT&T Page réagissait précisément contre cette vision de télégraphiste dans sa défense de la conversation frivole datée de 1928. Pendant la même conférence, il condamna aussi l'effet psychologique des publicités pour le téléphone qui comparaient explicitement l'instrument au télégraphe. (57)
Je suggérerai que les dirigeants de l'industrie ignorèrent pendant longtemps ou réprimèrent la sociabilité au téléphone pour l'essentiel parce que ces conversations ne correspondaient pas à l'idée qu'ils se faisaient de l'utilisation de cette technologie. Après des dizaines d'années d'obstination de la part des abonnés, et probablement poussée par la concurrence des nouvelles technologies comme la voiture ou la radio, l'industrie dut se résoudre à adopter la sociabilité comme un moyen d'exploiter le téléphone.
Cet argument signifie qu'un retard d'une génération a été pris à cause d'un malentendu entre les abonnés et la façon dont ils utilisaient le téléphone et les industriels et la façon dont ils pensaient qu'il le serait Une variante de cet argument (proposée par plusieurs lecteurs de cet article) suggère qu'il n'y avait pas de malentendu, que l'attitude de l'industrie et sa publicité reflétait justement les pratiques du public. La stratégie de vente changea vers le milieu des années 20 parce qu'en fait, les gens utilisaient plus le téléphone de cette façon que d'une autre. Cet accroissement de la "visite téléphonique" eut peut-être lieu pour une ou plusieurs raisons: la chute du coût réel, un progression du nombre des abonnés disponibles pour téléphoner, une transmission de la voix plus claire, des instruments plus confortables (du téléphone mural au combiné "français"), les tarifs à l'impulsion, une intimité plus grande grâce à l'automatique. La commercialisation suivit ainsi l'usage. Répondre à cet argument de façon complète, demanderait des preuves détaillées sur l'utilisation du téléphone en dépassement horaire. Nous ne disposons pas de matériau pour cela. Dans les souvenirs des gens de l'époque, on ne bavardait pas autant au téléphone dans "l'ancien temps" mais on ne peut évidemment pas spécifier dans quelles proportions ni nous dire quand changèrent les habitudes.58 D'un autre côté, les anecdotes, les commentaires des contemporains et les fragments de données commerciales (par exemple l'étude" de 1909 à Seattle) font penser que les interlocuteurs privés faisaient déjà des "visites téléphoniques" régulières avant le milieu des années 1920, quelque soit l'étiquette donnée à ces appels, et ils étaient au moins égaux en nombre à ceux concernant la "gestion de la maison". La publicité de cette période poussait presque uniquement à un usage pratique et ignorait ou réprimait l'utilisation sociale.
Le changement d'utilisation par les abonnés pourrait avoir aidé à presser le changement dans la publicité, bien qu'il n'y en ait pas de preuve directe dans les archives de l'industrie. Longtemps, un certain malentendu exista pourtant entre l'utilisation réelle et la commercialisation. Son origine apparaît comme culturelle dans une large mesure.
Cette explication devient encore plus plausible si l'on fait une comparaison avec le cas parallèle de l'automobile. Les premiers producteurs d'autos étaient d'anciens fabriquants de bicyclettes qui avaient appris leurs techniques de production et leur stratégie de commercialisation (par exemple le système des concessionnaires, les modèles annuels) pendant la grande folie du cycle dans les années 1890. Tout comme la bicyclette autrefois, l'automobile devait être un jouet pour les riches. Les premières campagnes de vente l'envisageaient comme un instrument de loisir pour la promenade, le tourisme et la course. Un publicitaire se demandait même en 1906 si "l'automobile devait être un caprice comme la bicyclette ou un facteur durable dans l'industrie du pays". (59)
Les utilisations pratiques de l'automobile furent perçues très vite dans l'industrie. Spécialement après le succès de la Ford modèle T, la publicité commença à insister sur les thèmes de l'utilité et de la sociabilité, en particulier sur le fait que les familles pouvaient être renforcées par les voyages ensemble. Les publicitaires tout comme les observateurs indépendants se félicitaient du rôle de l'automobile pour briser l'isolement et accroître la vie des communautés. (60) Comme avec le téléphone, les vendeurs d'automobiles suivirent largement une stratégie commerciale fondée sur l'expérience de la technologie "mère"; ils soulignèrent une série d'utilisations limitée et familières à tous; et il leur fallut se faire aux usages plus larges et plus populaires. Les producteurs d'automobiles apprirent simplement plus vite.
Il ne fait pas de doute que d'autres changements sociaux contribuèrent aussi à ce que j'ai appelé la découverte de la sociabilité et des explications différentes peuvent être trouvées. L'une d'entre elles, très importante, a trait à l'évolution dans la publicité. Les tactiques publicitaires, comme il a été noté plus tôt, évoluèrent vers des thèmes "plus doux" avec une plus grande emphase sur les charmes d'un objet, sur le plaisir plutôt que sur les aspects - pratiques d'un produit Elles focalisèrent également de façon croissante sur les femmes en tant que consommatrices principales et les femmes furent plus tard associées à la sociabilité téléphonique. (61) Les patrons d'AT&T ont peut-être été lents à adopter ces nouvelles tactiques, en partie parce que leur agence de publicité, N.W. Ayer, était particulièrement conservatrice. Mais dans cette analyse, la publicité pour le téléphone suivit en général la publicité de base peut-être partiellement parce que les patrons d'AT&T attribuaient le succès de l'automobile et d'autres technologies à cette forme de commercialisation. (62)
Cependant, demeurent ces preuves circonstanciées et directes en faveur de la perte d'influence des traditions du télégraphe sur l'industrie du téléphone, sous l'influence des pratiques du public.
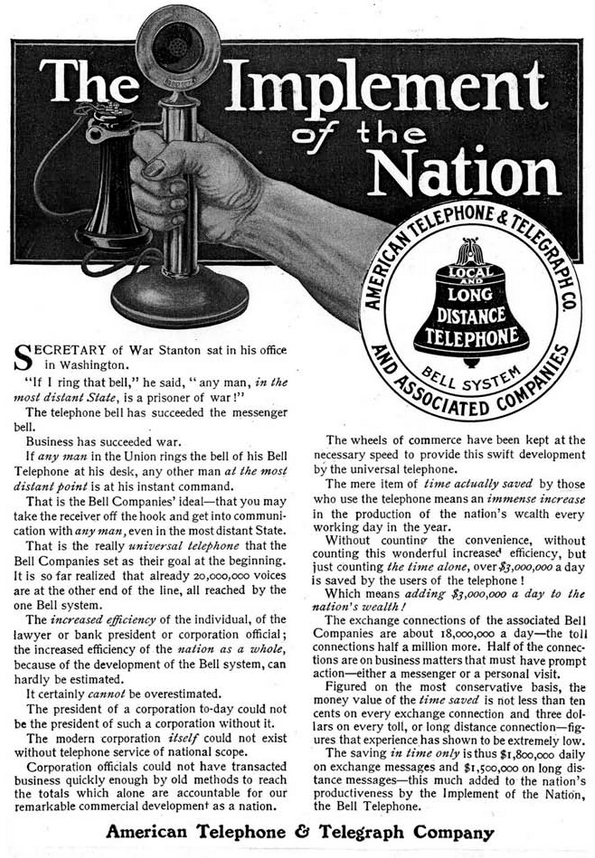
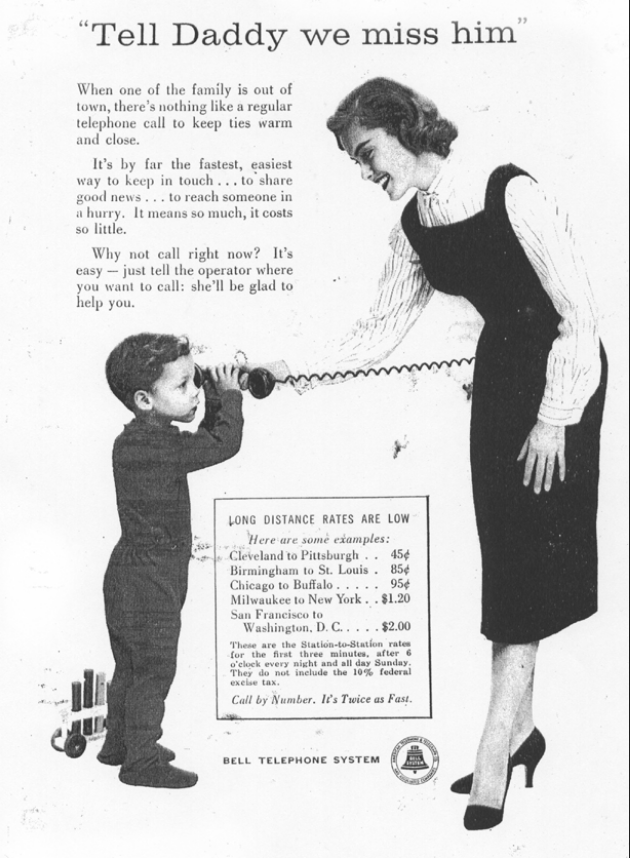
sommaire
Conclusion
Aujourd'hui, la plupart des appels téléphoniques
privés sont destinés -aux amis ou à la famille,
souvent pour le plaisir de la conversation. Il a pu également
en être ainsi il y a deux ou trois générations aussi.
(63) Aujourd'hui, l'industrie du téléphone encourage ces
appels; il y a soixante- quinze ans, elle les décourageait. Les
vendeurs de téléphones affirmaient alors que le téléphone
privé était indispensable pour les urgences; cette fonction
est maintenant tenue pour évidente. Les vendeurs affirmaient
que le téléphone était utile pour faire le marché;
cette fonction persiste ("Laissez vos doigts marcher...")
mais cela n'a jamais paru vraiment très
important aux abonnés privés. (64)
La fonction de sociabilité semble tellement importante et évidente
aujourd'hui, et pourtant, l'industrie l'ignora et résista contre
elle pendant la première moitié de son histoire. L'histoire
de la façon dont l'industrie du téléphone découvrit
la sociabilité apporte quelques leçons sur la compréhension
de la nature de la diffusion des technologies. Elle laisse supposer
que les promoteurs d'une technologie ne savent pas nécessairement
quelle sera l'utilisation finale de celle-ci; qu'ils cherchent les problèmes
et les "besoins" pour laquelle leur technologie
apporte une réponse (cf. les ordinateurs personnels); mais que
les consommateurs peuvent eux-mêmes déterminer finalement
les usages à la place du promoteur. Et il dut admettre aussi
que, dans la promotion d'une technologie nouvelle, les vendeurs sont
prisonniers non seulement des propriétés techniques et
économiques de celle-ci, mais aussi d'une interprétation
de son usage déterminée par les origines de cette invention
et par celle des vendeurs, une contrainte culturelle qui peut perdurer
et rester très forte.
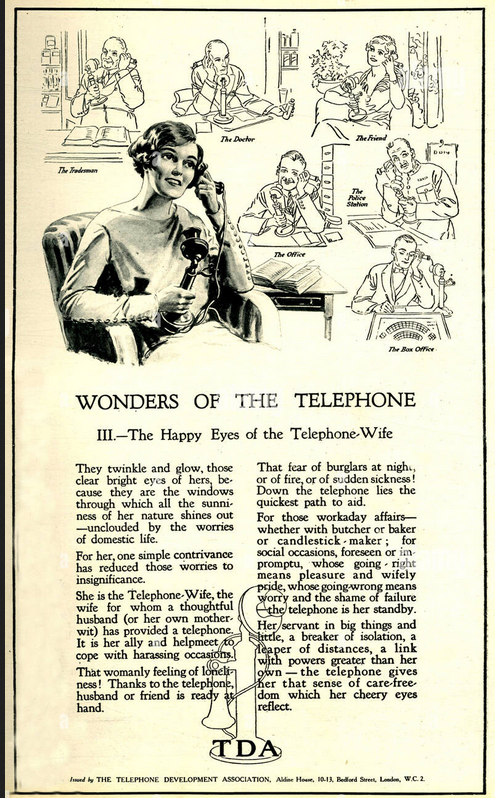
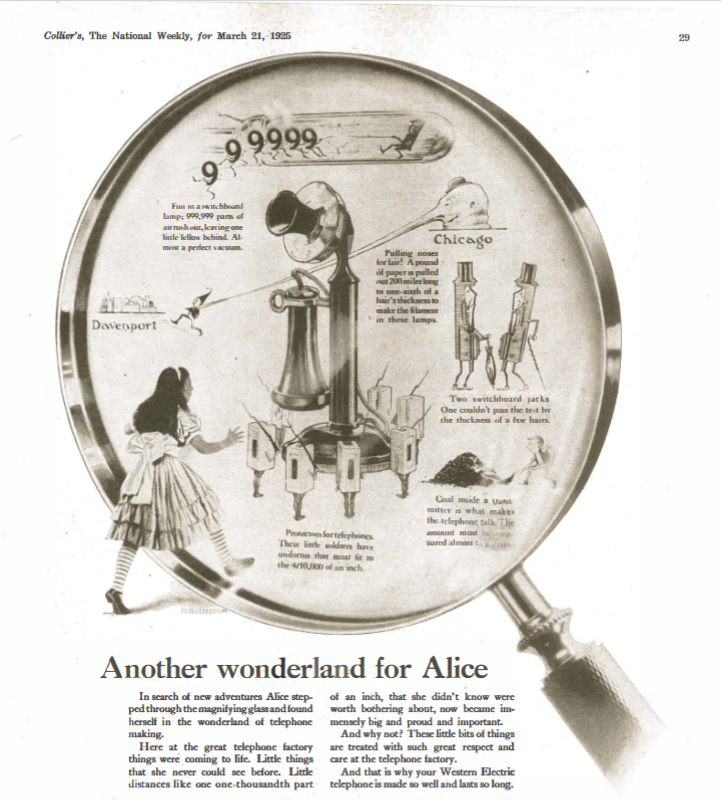
NOTES
1. Une partie des documents présentés
dans cet article est issue d'un article présenté à
la Social Science History Association, Washington D.C., en Octobre 1983.
Les recherches ont reçu une aide financière du National
Endowment for the Humanities (bourse RO-20612), de la National Science
Foundation (bourse SES83-O93O1), la Russel Sage Foundation et le Committee
on Research, Université de Californie, Berkeley. La suite des
travaux fut conduite au Center for Advanced Study in the Behavorial
Sciences, Stanford, Californie, avec le soutien financier de l'Andrew
W. Mellon Foundation. Les recherches d'archives furent facilitées
par l'assistance généreuse de gens de l'industrie du téléphone:
à AT&T, Robert Lewis, Robert Carnet et Mildred Ettlinger;
au San Francisco Museum Pioneer Telephone Museum, Don Thrall, Ken Rolin
et Norm Hawker; au Museum of Indépendant Telephony, Peggy Chronister;
à Pacific Bell, Robert Deward; à Bell Canada Historical,
Stephanie Sykes et Nina Bederian-Gardner; à Illinois Bell, Rita
Lapka; John A. Fleckner au National Museum of American History nous
aida aussi. Nos remerciements i ce qui furent interrogés pour
cet article: Tom Winburn, Stan Damkroger, George Hawk Hurst, C. Duncan
Hutton, Fred Johnson, Charles Morrish et Frank Pamphilon. Plusieurs
assistants contribuèrent à ce travail: Melanie Archer,
John Chan (qui dirigea les interviews), Steve Derné, Keith Dierkx,
Molly Haggard, Barbara Loomis et Mary Waters. Plusieurs lecteurs commentèrent
ce texte dans ses premières versions: Victoria Bonnell, Paul
Burstein, Glenn Carroll, Bernard Finn, Robert Garnet, Roland Marchand,
Michael Schudson, John Staudenmaier, S.J., Ann Swidler, Joel Tarr, Landgon
Winner ainsi que les auditeurs de la présentation de cet article.
2. littéralement: "Attrapez, attrapez le combiné
et gardez le contact!" (N.d.T.)
3. Voir C.S. Fischer: "Studying Technology and Social Life",
pp. 284-301 dans High Tecbonology, Space and Society: Emerging Trends,
éd. M. Castelis (Beverly Hills, Californie 1985). Pour un exemple
récent d'une étude traitant des consommateurs et des ventes,
voir M. Rose, "Urban Environment and Technological Innovation:
Energy choices in Denver and Kansas City, 1900- 1940," Technology
and Culture 25 (Juillet 1984): 503-39.
4. Les sources principales de cet article font appel aux revues
internes des industries du téléphone et de la publicité;
les rapports internes des compagnies de téléphone, la
correspondance, les collections de publicités et d'autres documents
venant d'abord de AT&T et de Pacific Telephone (PT&T); de mémoires
et histoires des compagnies publiées à titre privé;
les études gouvernementales, les études de recherche et
enquêtes; ainsi que plusieurs entrevues effectuées par
John Chan d'anciens employés de compagnies de téléphone
à la retraite et ayant travaillé dans la commercialisation.
Les archives les plus utilisées dans cet article sont les Historical
Archives d'AT&T, New York (abrégés par la suite en
AT&T ARCH) et le Pioneer Telephone Museum (SF PION MU) et quelques
documents venant du Museum of Indépendant Telephony, Abilene
(MU IND TEL); Bell Canada Historical, Montreal (BELL CAN HIST); Illinois
Bell Information Center, Chicago (ILL BELL INFO); and the N.W. Ayer
Collection of Advertisements et le Warshaw Collection of Business Americana,
National Museum of American History, Smithsonian Institution, Washington
D.C.. La bibliographie de l'histoire sociale du téléphone
est bizarrement très courte, surtout si on la compare avec celle
des technologies plus récentes comme l'automobile ou la télévision.
D existe des chroniques au niveau industriel ou commercial mais le coté
consommateur n'a pas été abordé. Pour quelques
sources de base, voir J.W. Stehman, The Financial History of the American
Telephone and Telegraph Compagny (Boston, 1925); AN. Hokombe, Public
Ownership of Telephones on the Continent of Europe (Cambridge, Mass.
1911); H.B. MacMeal, The Story of Independent Telephony (Chicago: Independent
Pioneer Telephone Association, 1934); J.L. Walsh, Connecticut Pioneers
in Telephony (New Haven, Conn.: Morris F. Tyler Chapter of the Telephone
Pioners of America, 1950); J. Brooks, Telephone: The First Hundred Years
(New York, 1976); A. Hibbard, Hello-Goodbye: My Story of Telephone Pioneering
(Chicago, 1941); Robert Collins, A Voice from Afar: The History of Telecommunications
in Canada (Toronto, 1977); R.L. Mahon, "The Telephone in Chicago"
ILL BELL INFO, MS, ca 1955; J.C. Rippey, Goodby, Central; Hello, World:
A Centennial History of Northwestern Bell (Omaha, Nebr.: Northwestern
Bell 1975); G.W. Brock, The Telecommunications Industry. The dynamics
of Market Structure (Cambridge, Mass, 1981); I. de S. Pool, Forecasting
the Telephone (Norwood, N.J., 1983); R.W. Garnet, The Telephone Enterprise:
The Evolution of the Bell System's Horizontal Structure, 1876-1909 (Baltimore,
1985); R-A. Atwood, Telephony and Its Cultural Meanings in
Southeastern Iowa, 1900-1917" (Ph.D. diss, University of Iowa,
1984); Lana Fay Rakow, "Gender, Communication and The Techonology:
A Case Study of Women and the Telephone" (Ph.D. diss., University
of Illinois at Urbana-Champaign 1987); and I. de S. Pool éd.,
The Social Impact of the Telephone (Cambridge, Mass., 1977). ? faut
noter bien sûr que AT&T, Bell ainsi que les noms d'entreprises
similaires se réfèrent à ces compagnies •
et leurs ancêtres directs jusqu'à la réorganisation
de l'industrie des Etats-Unis au 1er Janvier 1984.
5. Statistiques d'AT&T , Events in Telecommunications History (New
York: AT&T 1979), p-6; U.S. Bureau of Census (BOC), Historical Statistics
of the United States, Bicentennial Ed., pt 2 (Washington D.C. 1975),
pp 783-84).
6. Les tarife sont mentionnés de façon très désordonnée.
Pour ces chiffres, voir BOC, Telephone and Telegraphs 1902, Special
Reports, Department of Commerce and Labor (Washington D.C. 1906), p.
53; and 1909 Annual Report of AT&T (New York, 1910), p. 28. Les
taux de salaire sont donnés dans Historical Statistics (n"3
ci-dessus), tables D735-38.
7. BOC, Telephones, 1902 (n°4 d-dessus); Federal Communications
Commissions (FCC), Proposed Report: Telephone Investigation (Washington
D.C. 1938), p. 147. AT&T a toujours officiellement contesté
cette interprétation; voir par exemple, 1909 Annual Report of
AT&T pp. 26-28.
8. Voir par exempte Annual Report of AT&T, 1907-10-, et FCC, Proposed
Report (n°5 ci-dessus), pp 153-154. Sur les arrangements avec la
compétition, voir par exemple Rippey (n°2 ci-dessus), pp
143 et suivantes.
9- 1909 Annual Report of AT&T, p. 28. Le tarif minimal pour une
ligne collective pour quatre foyers en ville allait de 3 dollars par
mois à New York (environ 6% du salaire moyen d'un employé
d'usine) à 1,50 dollars à Los Angeles (environ 3% du salaire)
et moins encore dans les petites localités dotées de systèmes
mutuels; voir BOC, Telephones and Telegraphs and Municipal Electric
Fire-Alarm and Police-Patrol Signaling Systems, 1912 (Washington D.C.
1915); et Historical Statistics (ns 3 ci-dessus), table D74O.
10. Témoignage du 9 Décembre 1909 devant l'Etat de New
York, Report of the Committee of the Senate and Assembly Appointed to
Investigate Telephone and Telegraph Companies (Albany 1910), p 398.
11. Ayer Collection of AT&T Advertisements, Collection of Business
Americana, National Museum of American History, Smithsonian Institution.
12. Voir par exemple Pacific Telephone Magazine (Magazine des employés
du PT&T, abrégé id en PAC TEL MAG), 1907- 1940, passim;
les publiâtes de 1914 dans le carton de la SF PION MU étiqueté
"Advertising"; MU IND TEL "Scrapbook" de la Southern
Indiana Telephone Company; les publicités des annuaires de l'époque:
"Educating the Public to the Proper Use of the Telephone",
Telephony 64 (21 Juin 1913): 32-33; "Swearing over the Telephone",
Telephony 9 (1905): 418; et "Advertising and Publidty -1906-1910",
carton 1317, AT&T ARCH.
13- Au sujet de la promotion de l'image de marque de AT&T, voir
R. Marchand, "Creating the Corporate Soul: The Origins of Corporate
Image Advertising in America" (article présenté devant
('Organization of American Historians, 1980), et NX. Griese, "AT&T:
1908 Origins of the Nation's Oldest Continuous Institutional Advertising
Campaign", Journal of Advertising 6 (Summer 1977): 18-24. FCC,
Proposed Report (n. 5 d-dessus) présente un chapitre sur les
"relations publiques". Voir aussi N.R. Danielian, AT&T:
The Story of Industrial Conquest (New York 1939), chap. 13. Pour une
défense des relations publiques de AT&T, voir A.W. Page,
The Bell Telephone System (New York 1941). Parmi les efforts publidtaires,
il y avait des histoires "vraies", des dons à la Presse,
des cadeaux aux reporters et aux politiciens (documents dans l'AT&T
ARCH). Et dans un cas particulier et plutôt comique en 1920, AT&T
essaya frénétiquement et apparemment sans succès
de faire pression sur Hal Roach pour qu'il coupe les séquences
burlesques d'un central en pleine hystérie dans un film de Harold
Lloyd qu'il produisait (voir dossier "Correspondence-E.S. Wilson,
V.P. AT&T", SF PION MU).
14. Walsh (n° 2 d-dessus) p. 47.
15. S. Schmidt, "The Telephone comes to Pittsburgh" (thèse
de maîtrise, Université de Pittsburgh 1948); Pool Porecasting(n.2
d-dessus, p. 30; D. Goodman, "Early Electrical Communications and
the City: Applications of the Telegraph in Nineteenth- Century Urban
America" (article non publié, Department of Social Sciences,
Carnegie-Mellon University, n.d., remerciements à Joel Tarr);
et "Telephone History of Dundee, Ontario". Archives Munidpales,
BELL CAN HIST.
16. Sur les services particuliers et les informations, voir Walsh (n°2
d-dessus) p. 206; S.H. Aronson, "Bell's Electrical Toy: What's
the Use? The Sociology of Early Telephone Usage", pp 15-39, and
I. de S. Pool, éd., Social Impact(n°2 d-dessus); "Broadening
The Possible Market", Printer's Ink 74 (9 Mars 1911); G.O. Steel,
"Advertising The Telephone" Printets Ink 51 (2 Avril 1905):
14-17. et F.P. Valentine, "Some phases of the Commercial Job",
Bell Telephone Quarterly 5 (Janvier 1926): 34- 43. Pour l'illustration
des utilisations voir par exemple PAC TEL MAG (Octobre 1907), p. 6 (Janvier
19?), p. 9 (Décembre 1912), p. 23, et (Octobre 1920), p. 44;
et le magazine indépendant Telephony, par exemple l'index jusqu'au
vol. 71 (1916) et Telephony fait la liste les points suivants sous "Telephone,
novel uses of: grades universitaires conferrés par téléphone,
envoi de remorqueurs dans le service portuaire, profondeur mesurée
par téléphone, téléphoner d'un aéroplane".
Sur les regrets de n'avoir pas éduqué le public, voir
les dtations de H.B. Young circa 1929, pp 91. 100 dans "Publidty
Conferences - Bell System- 1921-34", carton 1310 AT&T ARCH,
mais des commentaires analogues apparaissent dans les années
antérieures, de même que des revendications positives comme
celle de Vail en 1909-
17. Le débat suivant utilise largement
l'examen des collections de publicités dans les archives mentionnées
en n°2. L'espace ne permet pas plus de quelques exemples sur une
source de plusieurs centaines d'affiches. Voir notamment les fichiers
appelés "Advertising and Publicity" à AT&T
ARCH; au SF PION MU, les classeurs étiquettes "Advertising"
et "Publicity Bureau" au BELL CAN HIST, "Scrapbooks";
au ILL BELL INFO, "AT&T Advertising" et les microfilms
384B, "Adver."; et à la Collection Ayer (n°9 ci-dessus),
les séries AT&T.
18. Pour des commentaires plus spécifiques, voir Mahon (n°2
ci-dessus), par exemple pp. 79-89; les déclarations du Vice-
Président chargé de la Publicité, A.W. Page dans
"Bell System Commercial Conference, 1930", microfilm 368B,
ILL BELL INFO; et les déclarations de l'Ingénieur Commercial
K.S. McHugh dans "Bell System General Commercial Conference on
Sales Matters, 1931", microfilm 368B, ILL BELL INFO. Sur les origines
de la publicité à domicile, voir N.L. Griese, "1908
Origins" (n°ll ci-dessus)
19. Voir cette correspondance dans "Advertising and Publicity •
Bell System • 1906-1910, classeur I, carton 1317, AT&T ARCH.
Certains rapports précisent que des milliers d'histoires furent
placées dans des centaines de publications. Apparemment, aucune
campagne publicitaire nationale ne fut conduite avant cette époque;
la stratégie de marketing de Bell semblait largement confinée
â la compétition sur les prix et les services. Voir N.C.
Kingsbury, "Results from the American Telephone's National Campaign",
Printers' Ink (Juin 29, 1916): 182-84.
20. En plus de la collection de publicités, voir A.P. Reynolds,
"Selling a Telephone" (à un homme d'affaires), Telephony
12 (1906): 280-81; id., "The Telephone in Retail Business",
Printers' Ink 61 (Novembre 27, 1907): 3-8; et "Bell Encourages
Shopping by Telephone", ibid., vol 70 (Janvier 19, 1910).
21. Lettre du Vice-Président d'AT&T Reagan au Président
de PT&T H.D. Pillsbury, 4 Mars 1929 dans "Advertising",
SF PION MU; WJ. Phillips, "The How, What, When and Why of Telephone
Advertising", conférence donnée le 7 Juillet 1926,
dans ibid.; et "Advertising Conference -Bell System* 1916",
carton 1310, AT&T ARCH, p. 44.
22. Voir n. 16 d-dessus.
23. D. Pope, The Making of Modern Advertising (New York, 1983); S. Fox,
The Mirror Makers: A History of American Advertising and Its Creators
(New York, 1984); M. Schudson, Advertising: The Uneasy Persuasion (New
York, 1984), pp. 60 & suhr.; R. Marchand, Advertising The American
Dream: Making Way for Modernity, 1929-1940 (Berkeley, Calif., 1985);
et R. Pollay, "The Subsiding Sizzle: A Descriptive History of Print
Advertising, 1900-1980," Journ at of Marketing 49 (Été
1985):
24- 37. 24. W. B. Edwards, "Tearing Down Old Copy Gods", Printers'
Ink 123 (26 Avril 1923): 65-66.
25. Sur les tarifs, voir W.F. Gray, "Typical Schedules for Rates
of Exchange Services", et les débats afférents dans
"Bell System General Commercial Engineers' Conference, 1924",
microfilm 364B, ILL BELL INFO.
26. Bell Telephone Company of Canada, "Selling Service on the Job",
circa 1928, cat 12223, BELL CAN HIST.
27. Les déclarations, spécialement de la part des Vice-Présidents
d'AT&T Page et Gherardi pendant la "General Commercial Conference,
1928", et "Bell System General Commercial Conference, 1930",
tous les deux sur microfilm 368B, EL BELL INFO, exprimaient l'avis que
les téléphones devaient faire partie du "style de
vie" des clients, et n'être pas seulement des. instruments
pratiques. On trouve de nombreux échos des slogans de "confort
et commodité" dans les échelons inférieurs
de Bell pendant cette période.
28. Voir A. Fancher, "Every Employee Is a Salesman for American
Telephone and Telegraph', Sales Management 28 (26 Février 1931):
45-71, 472; "Bell Conferences", 1928 et 1930 (n°25 ci-dessus),
not. LJ. BilHngslcy, "Presentation of Disconnections", dans
la Conférence de 1930; Pacemaker, un magazine de vente pour PT&T,
circa 1928-31, SF PION MU; et Telephony, passim 1931-36.
29. PT&T Pacemaker, entrevues entre John Chan et des directeurs
de l'industrie a la retraite dans le nord de la Californie; voir aussi
J.E. Harrel, "Residential Exchange Sales in New England Southern
Area", dans "Bell Conference 1931", (?°1? ci- dessus),
pp 67 et suivantes.
30. D y a quelques variations dans la collection de publicité
que j'ai examiné. Illinois Bell's, pendant la Dépression,
utilisait des publicités identiques à celles de la génération
antérieure.
31. Ces journaux furent examinés comme partie d'une étude
plus large de l'histoire sociale du téléphone qui incluera
des études de cas dans trois communautés nord-californienne
de 1890 à 1940.
32. Central Union Telephone Company Contracts Department, Instructions
and Information for Solicitors, 1904, ILL BELL INFO. Notons que Centrai
Union a été, au moins jusqu'à 1903, le courtier
le plus entreprenant de tous les filiales de Bell. Illinois Bell Commercial
Department, Sales Manual 1931, microfilm, ILL BELL INFO. Ohio Bell Telephone
Company, "How You Can Sell Telephones", 1935, dossier "Salesmanship".
BELL CAN HIST.
33- Jusqu'en 1894, les compagnies indépendantes
n'existaient pas. Pendant des années, par la suite, elles essayèrent
en général de remplir la demande des petites villes et
des villages que Bell avait mal desservis. Ailleurs, elles firent de
la publicité en compétition avec Bell. Néanmoins,
les publicitaires exhortaient les indépendants à utiliser
"la vente par imprimés" pour encourager les services
locaux et les utilisations plus vastes. Voir, par exemple, J.A. Schoell,
"Advertising and Other Thoughts of the Small Town Man", Telephony
70 (10 Juin 1916): 40-41; R.D. Mock, séries "Fundamental
Principles of the Telephone Business: Part V, Telephone Advertising",
dans ibid, volume 71 (22 Juillet-21 Novembre 1916); D. Hughes, "Rigth
Now Is the Time to Sell Service", ibid. 104 (10 Juin 1933): 14-15;
et L. M. Berry, "Helpful Hints for Selling Service", ibid.
108 (2 Février 1935): 7-10. Voir aussi Kellog Company, "A
New Business Campaign for " (Chicago: Kellog, 1929), MU IND TEL.
34. Cité par Aronson, "Electrical Toy" (nol4 ci-dessus).
35. Annonces proposées par la National Capitol Telephone Company
dans une lettre au quartier-général de Bell, le 20 Janvier
1881, boîte 1213, AT&T ARCH. Dans la même veine, le
Président de Bell Canada confessait aux alentours de 1890, être
incapable de stopper le développement des "conversations
futiles"; voir Collins, A Voice (n°2 ci-dessus), p 124. Les
autorités françaises étaient aussi exaspérées
par l'utilisation non sérieuse de l'appareil; voir ? Bertho,
Télégraphes et téléphones (Paris 1980),
pp. 244-45.
36. ?.?. Judson, "Unprofitable Traffic - What Shall Be Done with
It ? Telephony 18 (11 Décembre 1909): 644-47, et PAC TEL MAG
3 (3 Janvier 1910): 7. ? écrit également: "le téléphone
va au-delà de ce pourquoi il a été fait et c'est
un fait bien réel qu'un grand pourcentage des téléphones
aujourd'hui fonctionnant en location fixe est utilisé beaucoup
plus pour l'amusement, la récréation et les conversations
de salon que pour le travail et les nécessités- quotidiennes"
(p. 645). MacMeal, Independent (n°2 ci-dessus), p. 240, signale
une campagne réussie en 1922 pour décourager les pipelettes
par des lettres et des publicités. De façon très
typique, les appels étaient • au moins officiellement -
limités à cinq minutes en de nombreux endroits, bien qu'il
n'est pas très clairement montré comment cette réglementation
était mise en application.
37. La philosophie de Hall est évidente dans la correspondance
sur le "service à impulsions" avant 1900, boîte
1127, AT&T ARCH. Des dizaines d'années plus tard, il continuait
à promouvoir l'idée dans une lettre à E.M. Burgess,
de la Colorado Telephone Company, 30 Mars 1905, boîte 1309. AT&T
ARCH, avançant même que les standardistes devraient arrêter
de refuser les appels d'entants et devraient même encourager des
utilisations aussi "futiles". Les informations biographiques
viennent d'une notice nécrologique dans AT&T ARCH. Un autre
populiste, encore plus vigoureux même, était John L Sabin,
de PT&T et de la Chicago Telephone Co.; voir Manon (n°2 ci-dessus),
pp 29 et suivantes.
38. A.W. Page, "Public Relations and Sales", "General
Commercial Conférence, 1928", p. 5, microfilm 368B, ILL
BELL INFO. Voir aussi les déclarations du Vice-Président
Gherardi et d'autres pendant cette même conférence et celtes
afférentes de la même période. Sur Page et les changements
qu'il provoqua, voir G.J. Griswold, "How AT&T Public Relations
Politicoes Developed", Public Relations Quarterly 12 (Automne 1967):
7-16; et Marchland, Advertising (n. 21 ci-dessus), pp. 117*20.
39. BOC, Special Reports: Telephones: 1907 (Washington D.C. 1910), pp
77*78; voir aussi UJS. Congress, Senate, Country Life Commission, 60th
Cong. 2d sess., 1909, S. Doc. 705; et F.E. Ward, The Parm Woman's Problems,
Circulaire USDA 148 (Washington D.C. 1920). Voir aussi C.S. Fischer,
"The Revolution in Rural Telephony", Journal of Social History
(en cours d'impression).
40. Cité dans R.F. Kemp, Telephones in Country Homes", Telephony
9 (Juin 1905): 433. Un article de 1909 établit que "l'usage
principale des téléphones dans les fermes a été
essentiellement social... Les téléphones sont plus souvent
et plus longuement occupés pour des conversations de voisinage
que pour toute autre raison". La conclusion de l'article est que
les souscripteurs donnent une très grande importance au fait
de pouvoir parler à quelqu'un. Voir G.R. Johnston, "Some
Aspects of Rural Telephony", Telephony 17 (8 Mai 1909): $42. Voir
aussi R.L. Tomblen, "Recent Changes in Agriculture as Revealed
by the Census", Bell Telephone Quarterly 9 (Octobre 1932): 334-50;
et J. West (C. Withers), Plainsville, U.SA. (New York, 1945), p. 10.
41. Cette série de publicités PT&T apparut dans le
Antiocb (Calif.) Ledger en 1911. Pour quelques exemples et débats
sur les stratégies de vente aux fermiers, voir Western Electric,
"How to Build Rural Unes", n.d., "Rural Telephone Service",
1944- 46?, carton 1310, AT&T ARCH; Stromberg-Carlson Telephone Manufacturing
Company, Téléphone Facts for Farmers (Rochester, N.Y.
1903), Washaw Collection, Smithsonian Institution; "Facts regarding
the Rural Telephone" Telephony 9 (Avril 1905): 303. Dans le Printers'Ink,
"The Western Electric", 65 (23 Décembre 1908): 3-7;
FX Cleary, "Selling to the Rural District", 70 (23 Février
1910): 11-12; "Western Electric Getting Farmers to Install Phones",
76 (27 Juillet 1911): 20-25; et H.C. Slemin, "Papers to Meet Trust'
Competition", 78 (18 Janvier 1912): 28.
42. R.T. Barrett, "Selling Telephones to Farmers by Talking about
Tomatoes", Printers' Ink (5 Novembre 1931): 49-50; Tomblen (n*38
ci-dessus); et J.D. Holland, Telephone Service Essential to Progressive
Farm Home", Telephony 114 (19 Février 1938): 17-20. Voir
aussi C.S. Fischer, Technology's Retreat: The Decline of Rural Telephones,
1920-1940", Social Science History (en cours d'impression).
43- Une étude de 1925 sur les attitudes de la femme envers les
appareils ménagers, commandée par la Fédération
Générale des Clubs de Femmes, montrait que les dames interrogées
préféraient l'automobile et le téléphone
à l'eau courante; voir M. Sherman, "What Women Want in Their
Homes", Woman Home Companion 52 (Novembre 1925): 28, 97-98. Une
étude de recensement sur 500.000 foyers dans le milieu des années
20 rapporta que le téléphone était considéré
comme un appareil de première importance car, avec l'automobile
et la radio, "il offrait à la femme au foyer un échappatoire
à la monotonie qui avait rendu folles tant d'entre elles auparavant";
rapporté dans Voice Telephone Magazine, organe interne de United
Communications, Décembre 1925, p. 3, MU IND TEL. Un de nos interlocuteurs,
qui vendit des téléphones au porte-à-porte dans
les années trente, disait que les femmes étaient attirées
d'abord par la possibilité de parler avec famille et amis (-ies),
deuxièmement pour les rendez-vous et les
achats et troisièmement pour les urgences, alors que, pour les
hommes, l'emploi et les affaires passaient en premier. Voir aussi Rakow,
"Gender" (n°2 ci-dessus) et C.S. Fischer, "Women
and the Telephone, 1890-1940"," communication donnée
à l'American Sociological Association, 1987.
44. Voir par exemple J.W. Sichter, "Separations Procedures in the
Telephone Industry", mémoire P 77-2, Harvard University
Program on Information Resources (Cambridge, Mass. 1977); Public Utility
Digest, 193Os-194Os, passim; "Will Your Phone Rates Double?"
Consumer Reports (Mars 1984): 154-56. Les interlocuteurs de Chan dans
l'industrie croyaient à ce subventionnement croisé tout
comme, apparemment, les commerciaux de AT&T; voir diverses "Conférences"
citées ci-dessus, AT&T ARCH et ILL BELL INFO.
45. Par exemple, le responsable commercial C.P. Morrill écrivait
en 1914 que "nous ne cherchons pas activement de nouveaux abonnés
sauf dans quelques endroits où la compétition rend la
chose nécessaire. La vente active est impossible à cause
de la rapidité du développement sur la côte Pacifique".
D encourageait aussi la vente de lignes communes dans les zones congestionnées,
des lignes individuelles i la place de lignes communes ailleurs, de*
postes supplémentaires, plus d'appels, la publicité dans
les annuaires, plutôt que d'étendre l'interurbain sur de
nouveaux territoires; voir PAC TEL MAG 7 (1914): 13- 16. Et, en 1924,
les directeurs commerciaux de Bell décidèrent d'éviter
de démarcher dans les régions quand il y aurait nécessité
de développer le réseau, pour reporter les efforts sur
les appels et services interrégionaux, spécialement pour
les gros utilisateurs professionnels; voir correspondance de B. Gherardi,
vice-président, AT&T, à G.E. McFarland, président,
PT&T, 14 Juillet 1924 et 26 Novembre 1924, classeur 24 "282-Conferences",
SF PION MU et échange de lettres avec McFarland, 10 et 20 Mai
1924, classeur "Correspondence-B. Gherardi," SF PION MU.
46. L'histoire de la bourse de Chicago à l'époque de John
L. Sabin illustre parfaitement la question. Voir R. Garnet, "The
Central Union Telephone Company", boîte 1080, AT&T ARCH.
47. Ce argument fut suggéré par John Chan à partir
des interviews.
48. Voir n°33, 34. Cest aussi la logique de la toute récente
campagne de New York Telephone Co. pour encourager les appels sociaux:
la publicité n'est pas diffusée dans le nord de l'Etat
où les abonnés ont tendance à avoir le tarif fixe.
H n'y a donc aucun profit à leur proposer des coups de fil inutiles."
(voir "New Pitch", n°28 ci-dessus).
49- Lettre au Président d'AT&T Hudson, 27 Décembre
1898, boîte 1284, AT&T ARCH. Sur le service à l'unité
en général, voir "Measured Service Rates", boîtes
1127, 1213, 1287, 1309. AT&T ARCH; F.H. Bethell, "The Message
Rate", repr. 1913, AT&T ARCH; H.B. Stroud, "Measured Telephone
Service", Telephony 6 (Septembre 1903): 153-56, et (Octobre 1903):
236-38; et J.E. Kingsbury, The Telephone and Telephone Exchanges (Londres
1915), pp. 469-80.
50. Théodore Vail affirmait en 1909 que le comptage mécanique
du temps était impossible (témoignage à une commission
de l'Etat de New York, voir n°8 ci-dessus). Voir aussi Judson (n°34
ci-dessus), p. 647. En 1928, un ingénieur suggéra de facturer
au-delà des 5 minutes et déclara que le matériel
permettant de gérer le temps supplémentaire était
maintenant disponible; voir L.B. Wilson, "Report on Commercial
Operations, 1927", dans "General Commercial Conference, 1928",
p. 28, microfilm 368B, ?? BELL INFO. Sur la limite des 5 minutes, voir
"Measured Services", boîte 1127, AT&T ARCH; et Bell
Canada, The First Century of Service (Montréal 1980), p. 4. H
est difficile de connaître le degré de sévérité
des standardiste» en matière de dépassements mais
Bell ne fut jamais connu pour son laxisme dans ce domaine.
51. Denver, lettre de E.J. Hall à E.W. Burgess, 1905, boîte
1309, AT&T ARCH; Brooklyn: BOC, Telephones, 1902 (n°4 ci- dessus);
Los Angeles: "Telephones on the Pacific Coast, 1878-2923",
boîte 1045, AT&T ARCH.
52. Sur les prétentions des compagnies, voir par exemple "Limiting
Party line Conversations", Telephony 66, (22 Mai 1914): 21; et
MacMeal (n°2 ci-dessus), p. 224. Pour les données sur les
lignes collectives, comparer les statistiques dans la lettre de J.P.
Davis à A. Cochrane, 2 Avril 1901, boîte 1312, AT&T
ARCH à celles entre B. Gherardi et F.B. Jewett, "Telephone
Communications System of the United States", Bell System Technical
Journal 1 (Janvier 1930): 1-100. Les premières montrent, par
exemple, qu'en 1901, dans les cinq villes ayant le plus d'abonnés,
une moyenne de 31% étaient des lignes collectives. Pour ces cinq
villes en 1929, le pourcentage était de 36. Sur les réseaux
plus petits, les proportions étaient encore plus grandes. Voir
aussi "Supplemental Telephone Statistics, PT&T", "Correspondence
-DuBois", SF PION MU. Le cas de Bell Canada ne parvient pas à
étayer l'explication des lignes communes. Tous les téléphones
de Montréal et Toronto étaient virtuellement individuels
jusqu'en 1920.
53. "Les courants porteurs" permirent de multiples conversations
sur la même ligne. Les premiers furent développés
en 1918 mais pendant de nombreux années, ils furent limités
aux lignes interrégionales, et non aux lignes locales payantes.
Voir par exemple R. ???, "Some Distinguished Characteristics of
the Telephone Business", Bell Telephone Quarterly 6 (Janvier 1927):
47-51, spécialement pp. 49-50; et R.C. Boyd, J.D. Howard, Jr.,
et L. Pederson, "A New Carrier System for Rural Service",
Bell System Technical Journal 26, (Mars 1957): 349-90. Les premières
lignes à courant porteur furent établies au Canada en
1928 après que la sociabilité ait émergé
en tant que thème vendeur; voir Bell Canada, First Century, n°
46, p. 28.
54. BOC, Historical Statistics (n°3 ci-dessus), p. 783-
55. Sur les origines télégraphiques des premiers dirigeants
du téléphone, voir par exemple A.B. Paine, Theodore N.
Vail (New York, 1929); Rippey (n°2 ci-dessus); et W. Patten, Pioneering
the Telephone in Canada (Montreal: Telephone Pioneers, 1926). D est
intéressant de constater que c'était vrai chez Bell et
dans toutes les opérations majeures. Mais les dirigeants des
compagnies des petites villes étaient généralement
des hommes d'affaires et des fermiers; voir On the Line (Madison, Wisconsin
State Telephone Association, 1985). Sur Western Union et Bell, voir
G.D. Smith, The Anatomy of a Business Strategy: Bell, Western Electric
and the Origins of the American Telephone Industry (Baltimore, 1985).
Le "télégraphe le meilleur marché" apparaît
dans une feuille de Buffalo du 13 Novembre 1880, boîte 1127, AT&T
ARCH. Sur l'usage peu fréquent du télégraphe pour
les messages sociaux, voir R.B. DuBoff, "Business Demand and Development
of the Telegraph in the United States, 1844- 1860", Business History
Review 54 (Hiver 1980): 459-79.
56. Dans les premiers temps, Vail s'attendait à ce que le niveau
de développement le plus élevé fût un téléphone
pour cent habitants; en 1880, il y avait 4 téléphones
pour cent personnes à certains endroits; voir Garnet (n°2
ci-dessus), p. 133, n°3. Le taux moyen de 1 téléphone
pour cent Américains fut atteint avant 1900 (voir tableau 1).
En 1905, une estimation de Bell donnait 20 téléphones
pour 100 Américains comme le chiffre de saturation et que cela
pouvait même apparaître comme déraisonnable; voir
"Estimated Telephone Development, 1905-1920", lettre de S.H.
Mildram, AT&T, à W.S. Allen, AT&T, 22 Mai 1905, boîte
1364, AT&T ARCH. La date de saturation était prévue
pour 1920. Cette estimation était optimiste dans son taux prévu
de diffusion - 20% ne fut atteint qu'en 1945 - mais très pessimiste
sur le niveau projeté de diffusion. Ce niveau fut doublé
en I960 et triplé en 1980. On lit dans les documents de Bell
dans la fin des années 20, le souci que l'automobile et d'autres
nouvelles technologies puissent nuire à la diffusion du téléphone.
Pourtant, même à l'époque, il ne semble pas y avoir
la moindre supposition que le téléphone puisse toucher
la presque totalité des foyers américains comme l'électricité
ou la radio.
57. Page 53 dans L.B. Wilson (prés.)» "Promoting Greater
Toll Service", "General Commercial Conférence, 1928",
microfilm 368B, ILL BELL INFO.
58. Ces déclarations sont fondées sur des narrations orales
rapportées par Rakow (n°2 ci-dessus) et que l'on retrouve
dans plusieurs entrevues effectuées pour son projet à
San Rafael, Californie, par John Chan. Voir aussi Fischer, "Women"
(n°41).
59. Sur l'histoire de l'automobile: J.B. Rae, The American Automobile:
A Brief History (Chicago, 1965); id., Tbe Road and Car in American Life
(Cambridge, Mass., 1971); JJ. Flink, America Adopts tbe Automobile,
1895-1910 (Cambridge, Mass., 1970); id., Tbe Car Culture (Cambridge,
Mass., 1976) and J.-P. Bardou, J.-J. Chanaron, P. Fridenson and J.M.
Laux, Tbe Automobile Revolution, trans. J.M. Laux (Chapel Hill, N.C.
1982). Le publicitaire était J.H. Newmark, "Have Automobile
Been Wrongly Advertised?", Printers'Ink 86 (5 Février 1914):
70-72; Voir aussi id., "The line of Progress in Automobile Advertising",
ibid., 105, (26 Décembre 1918): 97-102.
60. G.L. Sullivan, "Forces That Are Reshaping a Big Market",
Printer's Ink 92 (29 Juillet 1915): 26-28. Newmark (n°57 ci- dessus,
p. 97) écrivit en 1918 "qu'il a fallu un quart de siècle
pour que les industriels découvrent qu'ils fabriquent un objet
fonctionnel". Une étude, en 1930, montre que, dans les ménages,
80% des dépenses de voiture étaient consacrées
"à la vie familiale"; voir D. Monroe et al., "Family
Income and Expenditures. Five Regions, 2 Partie, Family Expenditures",
Consumer Purchases Study, Farm Series, Bureau of Home Economics, Misc.
Pub. 465 (Washington D.C., 1941), pp. 34-36. Egalement l'enquête
de 1925 sur l'attitude des femmes i l'égard des appareils ménagers
(n°4l d-dessus). L'auteur du rapport, la Présidente de la
Fédération Mary Sherman, conclut qu'avant "l'installation
des toilettes ou des lavabos à la maison, l'achat de l'automobile
ou le raccordement au téléphone sont prioritaires parce
que la femme au foyer essaye d'échapper à la monotonie
plutôt qu'à la corvée dans son existence",
(p. 98). Voir aussi Country life et Ward (n*37 ci-dessus); E. de S.
Brunner et J.H. Kolb, Rural Social Trends (New York, 1933); et F.R.
Allen, "The Automobile", pp. 107-32 dans F.R. Allen et al.,
Technology and Social Change (New York, 1957).
61. H faut se souvenir qu'avant, les femmes étaient aussi présentes
dans les publicités téléphoniques utilisant les
thèmes des urgences, de la sécurité et du marché.
62. Sur les changements dans la publicité, voir les sources citées
en n°21 ci-dessus. Les commentaires sur le conservatisme de N.W.
Ayer sont de Roland Marchand (contribution personnelle).
63. H est difficile d'établir avec précision à
quel usage les gens destinent le téléphone. Quelques études
suggèrent que la plupart des appels sont • et de loin •
faits pour des raisons sociales à des amis, à la famille
mais cela ne veut pas dire que ces gens s'abonnent pour cette raison.
Voir Field Research Corporation, Residence Customer Usage and Démographie
Characteristics Study: Summary, effectué pour Pacific Bell, 1985
(avec la permission de R. Somer, Pacific Bell); B.D. Singer, Social
Functions of tbe Telephone (Palo Alto, Calif., R&E Associates, 1981),
spécialement p. 20; M. Mayer, "The Telephone and the Uses
of Time", in Pool, Social Impact (n*2 ci-dessus), pp. 225-45; et
A.H. Wurtzel et ? Turner, "Latent Functions of the Telephone",
ibid., pp. 246-61.
64. Une enquête de 1934 trouve qu'au téléphone jusqu'à
50% des femmes étaient "favorables" au marché
par téléphone. 0 faut supposer pourtant qu'il y en a moins
pour agir ainsi; voir J.M. Shaw, "Buying by Telephone at Department
Stores", Bell Telephone Quarterly 13 (Juillet 1934): 267-88; et
c'est vrai malgré l'emphase mise par la publicité sur
cette utilisation. Voir aussi Fischer, "Women" (n°4l ci-dessus).
sommaire
Pour terminer cette étude, je vous recommande le livre de Claude
S. Fischer, qui est un sociologue américain et professeur de
sociologie à l' Université de Californie à Berkeley.
Il a travaillé sur l'histoire sociale américaine, en commençant
par une étude sur la place du téléphone dans la
vie sociale. Il a publié en 1992 le livre America Calling:
A Social History of the Telephone to 1940.
Dans ce livre, il présente la première histoire sociale
de cette technologie vitale mais peu étudiée. Il examine
comment les Américains l'ont rencontrée, testée
et finalement adoptée avec enthousiasme.
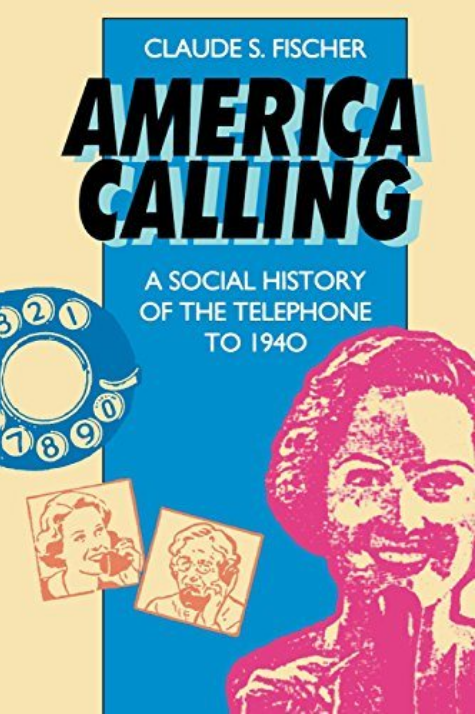
Fischer commence par critiquer les méthodes historiographiques
prédominantes. Selon lui, l’approche moderne (modernisme,
modernité), qui se concentre sur la technologie du XIXe et du
début du XXe siècle, contient trop d’hypothèses.
Selon lui, la modernité suppose que les changements économiques,
sociaux et psychologiques se produisent simultanément. Fischer
rejette également l’idée d’utiliser le déterminisme
technologique pour analyser le téléphone. Fischer considère
que les déterministes durs, ceux qui croient que la technologie
évolue indépendamment de l’influence sociale, sont
trop mécaniques. Les déterministes mous, en revanche,
croient qu’il existe une interaction entre les forces technologiques
et sociales, mais Fischer estime que cette approche repose trop sur
l’imagerie.
Après avoir passé en revue les approches
historiographiques, Fischer s'est finalement décidé à
utiliser un modèle constructiviste « heuristique de l'utilisateur
» pour étudier l'histoire du téléphone. Cette
approche est unique et bien définie. Au lieu de se concentrer
sur le téléphone en tant qu'artefact technologique ou
sur le système téléphonique, Fischer considère
le téléphone du point de vue du consommateur privé.
Le thème principal est que le consommateur décide en fin
de compte des utilisations d'une technologie qui prédomineront.
Ce thème est largement soutenu par des documents industriels,
des publicités et des analyses quantitatives.
L'analyse des preuves de Fischer offre plusieurs
éclairages importants sur les aspects sociaux des technologies
de communication. La période de l'étude, de 1875 à
1940, a été choisie parce que le téléphone
était considéré comme une technologie émergente
aux États-Unis à cette époque. Alexander Graham
Bell a reçu la majorité de ses brevets en 1875 et a commencé
à commercialiser le téléphone. En 1940, la plupart
des familles de la classe moyenne aux États-Unis avaient adopté
le téléphone. Cette méthode d'analyse peut aider
les enseignants en technologie à comprendre les complexités
d'une technologie de communication émergente et fournir des informations
précieuses sur cet appareil courant.
Fischer classe le téléphone comme
une technologie « transcendant l'espace » et établit
des liens intéressants avec d'autres technologies. Il mentionne
l'ordinateur domestique, mais ne l'utilise pas comme outil d'analyse
majeur. Au lieu de cela, l'automobile est utilisée comme point
de comparaison car sa période de développement, son marketing
et ses influences sociales étaient similaires à celles
du téléphone. Bien que cette comparaison soit parfois
un peu tirée par les cheveux, Fischer utilise souvent des preuves
statistiques pour étayer ce lien.
Les méthodes de recherche utilisées
dans cet ouvrage offrent aux enseignants en technologie un excellent
exemple de recherche à méthodes mixtes. Comme l'a suggéré
Petrina ( 1998 ), la recherche en éducation technologique doit
être alignée sur la recherche en éducation générale
et en STS. L'utilisation par Fischer de méthodes quantitatives
et qualitatives fournit un excellent modèle de recherche post-positiviste.
L'analyse statistique et les études de cas sont toutes deux utilisées
efficacement par Fischer pour étayer son thème principal.
Les données recueillies auprès des
compagnies de téléphone, ainsi que les publicités
dans les journaux et les magazines, sont utilisées pour démontrer
comment le téléphone a été adopté
dans la vie quotidienne. Cette analyse de contenu montre clairement
comment la direction des compagnies de téléphone a modifié
la publicité au cours des années 1920 pour refléter
les demandes du consommateur privé. Avant ce changement, les
dirigeants commercialisaient le téléphone comme un outil
pratique plutôt que social. Lorsqu'elles ont réalisé
que de plus en plus d'Américains achetaient des automobiles au
lieu de téléphones, les compagnies de téléphone
ont modifié leurs stratégies de marketing pour refléter
l'utilisation prédominante de leur produit.
Fischer utilise des statistiques (analyse de régression)
issues des registres des électeurs et des recensements comme
deuxième méthode pour étayer son modèle
« heuristique de l'utilisateur ». Bien que la technique
d'échantillonnage soit discutable quant à l'utilisation
sélective de certains documents, l'analyse se prête bien
au thème général selon lequel le consommateur décide
en fin de compte des utilisations d'une technologie qui prédomineront.
Les méthodes statistiques utilisées démontrent
les modèles de marketing ainsi que les modèles nationaux
et locaux de diffusion. La majorité des données statistiques
sont placées dans les huit annexes et constituent l'un des grands
avantages d' America Calling: A Social History of the Telephone to 1940.
Ce format ajoute non seulement à la lisibilité du texte,
mais crée également une référence rapide
pour les données statistiques et techniques.
La troisième méthode de recherche
de Fischer, l'étude de cas, montre comment le téléphone
a été adopté dans la vie quotidienne. Trois villes
du nord de la Californie ont été étudiées
pour montrer les différences entre la diffusion du téléphone
et celle de l'automobile. Les relevés téléphoniques
et gouvernementaux, ainsi que les journaux locaux, ont été
utilisés dans les études de cas. Il est intéressant
de noter que ces études de cas corroborent les statistiques nationales
sur la diffusion. À ce stade, Fischer fait un excellent travail
en réunissant les trois méthodes d'enquête. Il n'arrive
pas à des conclusions profondes, mais la discussion soutient
clairement le thème selon lequel le consommateur décide
en fin de compte des utilisations d'une technologie qui prédomineront.
America Calling: A Social History of the Telephone
to 1940 a été récompensé dans le domaine
des STS et mérite l'attention des enseignants en technologie.
La discussion de Fischer sur les méthodes historiographiques,
les perspectives sur les technologies de la communication et l'utilisation
de la recherche positiviste et post-positiviste peut être un excellent
modèle pour les chercheurs en éducation technologique.
Brusic ( 1992 ) illustre comment l'éducation technologique favorise
les objectifs des STS, mais nous devons également poser la question
réciproque : comment les STS peuvent-ils favoriser les objectifs
de l'éducation technologique ? America Calling: A Social History
of the Telephone to 1940 est un excellent ouvrage de recherche historique
qui peut offrir d'importantes perspectives STS pour l'éducation
technologique.
Voici un article extrait des chapitres 4, 5 et 8 de l'ouvrage
« America Calling, a Social History of the Telephone to 1940 »
et traduit de l'américain par Florence HERBULOT.
APPELS PRIVES, SIGNIFICATIONS INDIVIDUELLES
Un vieil homme habitant Antioch en Californie raconte qu'étant jeune, avant la Première Guerre mondiale, il se rendait quelquefois à cheval chez un de ses riches voisins. « Un jour, pendant le déjeuner, le téléphone a sonné. C'était un téléphone manuel à magnéto qu'on venait d'installer. M. Henry a répondu, il était tout heureux : "Je viens de parler avec Concord ! Aussi clair que si je parlais avec quelqu'un dans cette pièce !" disait-il. Il était quand même obligé de hurler dans l'appareil... Moi, je n'étais pas terriblement impressionné. J'ai toujours considéré que l'innovation et le progrès allaient de soi. Mais c'était quand même une sacrée machine. » L'excitation de M. Henry aussi bien que le détachement de notre interlocuteur montrent combien les réactions personnelles au téléphone peuvent varier, en même temps que les conséquences individuelles.
Nous allons tenter, dans cet article, d'évaluer
comment les Américains ont utilisé le téléphone
durant la première moitié du XXe siècle et quelle
en était pour eux la signification personnelle.
On a beaucoup discuté sur cette signification. Les industriels
affirmaient que le téléphone apporte la puissance et préserve
la vie de famille ; les critiques prétendaient que la sonnerie
du téléphone est mauvaise pour les nerfs et détruit
l'intimité ; le gourou des médias, Marshall McLuhan, traçait
un portrait de la transcendance électronique ; et récemment,
une essayiste, qui note que les oreilles qui reçoivent les appels
sont des orifices, fait une analyse freudienne du téléphone
(1).
Comment effectuer une modeste étude de psychologie
historique du téléphone ? Comment surprendre les conversations
de personnes disparues depuis longtemps et en soupeser les implications
- implications qu'elles-mêmes n'ont peut-être pas entièrement
appréciées ?
Nous disposons de quelques techniques. L'une d'elles consiste à
exploiter les documents dont nous disposons sur les premiers utilisateurs
du téléphone, une autre à consulter des enquêtes
auprès d'usagers actuels du téléphone. Cette seconde
technique ne doit pourtant être appliquée qu'avec beaucoup
de précautions car la sociopsychologie du téléphone
a sans doute changé avec le temps, tandis que l'abonnement devenait
une nécessité et non plus un luxe. Mais faute de preuves
comparables issues du passé, la recherche actuelle complète
notre compréhension. Une troisième technique consiste
à exploiter les souvenirs de personnes d'un certain âge.
En dehors des deux analyses de témoignages
oraux déjà publiées, la présente étude
exploite largement trente-cinq entretiens effectués vers 1985
avec des résidents de trois villes. Nous avons bavardé
avec des hommes et avec des femmes dont les dates de naissance s'échelonnaient
entre 1888 et 1917. Les témoignages oraux ne sont pas des fenêtres
magiques ouvrant sur le passé, mais ils nous fournissent une
information que l'on ne peut trouver ailleurs (2).
Pour simplifier, j'ai divisé la discussion sur les implications
personnelles du téléphone en deux grandes catégories,
sociale et psychologique. Avoir le téléphone modifiait-il
d'une manière quelconque les relations sociales ? Cela modifiait-il
ce que les historiens français appellent « mentalité
» ? Ces questions en appellent une autre : modifier par rapport
à quoi ? Certains auteurs estiment que l'on peut parfaitement
comparer le téléphone à la correspondance par lettres.
Pourtant, la plupart des conversations étaient et restent d'ordre
tout a fait local. Dans la plupart des cas, la comparaison s'établit
surtout entre le téléphone et la conversation face à
face. On peut aussi établir la comparaison avec l'automobile.
Autre précision indispensable pour cette étude des questions
sociales et psychologiques, n'oublions pas que nous étudions
les implications aux Etats-Unis. Il existe une bibliographie réduite
mais intéressante qui fait état de différences
nationales dans ? utilisation du téléphone - par exemple,
les Grecs appellent plus souvent que les Britanniques pour des conversations
de sociabilité, et les Français plus souvent que les Américains
(3).
(1) RONNELL, 1989, 95 et suiv., 265. Ce traitement
littéraire complexe aboutit à bien d'autres implications
quant au téléphone, qui se situent presque toutes dans
un domaine différent de celui de la présente étude.
Voir aussi HALTMAN, 1990.
(2) John CHAN a interrogé dix personnes
de San Rafael, Laura Weide, onze personnes d'Antioch, Lisa Rhode, treize
personnes de Palo Álto, et j'ai moi-même rencontré
une femme âgée de Palo Alto. La procédure appliquée
variait un peu selon les villes. John Chan a utilisé certaines
relations personnelles pour découvrir les anciens de San Rafael.
Laura Weide et Lisa Rhode ont eu recours à des contacts institutionnels
tels que les pasteurs et les sociétés historiques pour
trouver des interlocuteurs à Antioch et à Palo Alto. Au
fil des entretiens, nous nous sommes concentrés sur les souvenirs
d'enfance de nos interlocuteurs touchant au téléphone
et à l'automobile. Chacun des enquêteurs enregistrait les
conversations puis résumait par écrit les principaux commentaires.
Je m'appuie sur ces résumés. Si la plupart de nos répondants
ont grandi à proximité de ces trois villes, beaucoup ont
passé une partie de leur jeunesse dans des villages et des fermes
environnants. Notre échantillon est un peu biaisé, comme
on peut s'y attendre avec des personnes ayant appartenu dans leur enfance
aux classes moyennes et donc à des familles ayant le téléphone.
C'est en partie à cause de ce biais caractéristique des
témoignages oraux qu'il faut considérer avec quelques
réserves les preuves apportées. C'est aussi une raison
de ne pas utiliser ces entretiens pour faire des comparaisons entre
les villes. De plus, comme les expériences individuelles sont
très différentes, nos interlocuteurs apportent des opinions
très diverses sur la situation générale à
leur époque. Par exemple, le fils de l'un des principaux hommes
d'affaires d'Antioch déclare que «le téléphone
était à peu près universel » vers 1922 alors
que les données de notre recensement font apparaître que
30 % seulement des habitants d'Antioch étaient abonnés.
Une femme de Palo Alto se souvient que les femmes ne conduisaient pas,
alors que d'autres décrivent avec fierté combien elles-mêmes
et leurs mères aimaient conduire. De plus, l'âge avancé
de nos interlocuteurs - certains avaient près de cent ans - suffit
à expliquer certaines contradictions dans leurs souvenirs. Enfin,
les récits sont influencés par le présent : les
jugements touchant au passé sont fondés en partie sur
la période contemporaine. Par exemple, on nous a souvent dit
que les « visites » par téléphone étaient
peu courantes par rapport à aujourd'hui. En dépit de toutes
ces réserves, les personnes âgées auxquelles nous
avons parlé nous ont apporté un coup d'œil précieux
sur le passé, et nous les remercions du temps qu'elles nous ont
consacré.
(3) SMANOU, 1989, CARROLL, 1988, chapitre 6. (4) MCLUHAN, 1964, 225
; MARCHAND, 1985, 12.
sommaire
Téléphone et vie sociale
D'après les publicités AT & T, le téléphone favorise « les relations étroites dans une société personnalisée » et « fournit simultanément un moyen de surmonter la distance en rétablissant des contacts interpersonnels simples et immédiats ». L'opinion de Marshal McLuhan est à peu près la même : « Avec l'électricité, nous rétablissons partout des relations de personne à personne comme à l'échelle du plus petit village », (la terminologie employée, « rétablir », « reconstituer », souligne comme l'indique Roland Marchand que certains observateurs considèrent la technologie moderne comme un moyen de revenir à un passé idéal (4). D'autres enthousiastes rattachent le téléphone à la vie de famille. Dans un essai rédigé pour un magazine AT & T, Margaret Mead disserte sur les capacités du téléphone à rapprocher les familles. Un certain nombre de chansons sentimentales de la fin du XIXe siècle brodent sur le téléphone : c'est le cas par exemple de ballades intitulées « Kissing Papa Thro's the Telephone », « Love by Telephone » et « Hello, Is This Heaven ? Is Grandpa There ? ». Nombre de commentateurs - responsables administratifs, porte- parole de l'industrie, auteurs d'articles de magazines populaires (dont certains sans aucun doute incités par les publicitaires) - vantent le téléphone comme moyen d'alléger l'isolement en milieu rural (5). Mais d'autres sont moins favorables. L'un des soucis a toujours été que le téléphone, en permettant à chacun de remplacer les rencontres face à face par des communications électroniques, n'aboutisse à un semblant de relations « réelles ». Un récit publié en 1893 prédit ce que sera l'Amérique en 1993 : les familles vivront dans des maisons dispersées, n'ayant que des voisins de « sentiments et qualités » comparables, effectueront leur travail par des moyens électroniques et ne se rencontreront qu'à l'occasion des cérémonies (les futuristes qui nous annoncent aujourd'hui un pays de « cottages électroniques » dispersés ne sont après tout pas si inventifs). Ce que beaucoup reprochent à ce voisinage téléphonique est qu'il constitue un « type de collectivité plus vaste mais moins profond ». Un sociologue de la technique, Ron Wes- trum, a récemment affirmé que « la venue du téléphone a entamé la destruction des processus sociaux... Les gens en sont venus à accepter la séparation physique du moment que le contact pouvait être maintenu par le téléphone. Mais le contact téléphonique n'est pas comme une présence et crée une autre sorte de société... ».
Un souci connexe est que les relations téléphoniques
manquent, par essence, d'authenticité et risquent, si elles deviennent
coutumières, de nuire aux autres interactions. Le sociologue
Peter Berger, par exemple, affirme :
« L'utilisation habituelle du téléphone
implique aussi l'apprentissage d'un style particulier
de relations avec autrui - un style impersonnel, précis, marqué
par une certaine civilité superficielle. La question clé
est la suivante : ces habitudes spécifiques se diffusent-elles
dans d'autres domaines de l'existence, tels que les relations non téléphoniques
avec d'autres personnes ? La réponse est presque certainement
positive. Un seul problème, comment, et dans quelle mesure (6)
? »
Une autre inquiétude est de voir le téléphone
autoriser trop d'interactions sociales ou de la mauvaise espèce.
En 1899, un Anglais note que le jour où chaque foyer pourra appeler
tous les autres doit être craint « par le citoyen sain et
raisonnable ». Un professeur américain fulmine, en 1929
:
« Nous sommes essentiellement à la
merci de nos voisins qui disposent pour nous atteindre de facilités
inconnues des Grecs anciens ou même de nos grands-parents. Grâce
au téléphone, à l'automobile et aux inventions
de cette espèce, nos voisins ont le pouvoir de transformer nos
loisirs en une série d'interruptions, et plus ils ont de loisirs,
plus ils deviennent actifs pour détruire les nôtres. »
Malcolm Willey et Stuart Rice concluent aussi que «
l'isolement personnel - ? inaccessibilité aux appels d autrui
pour accaparer notre attention - est de plus en plus rare et, lorsqu'on
le souhaite, de plus en plus difficile à obtenir ». Les
agresseurs les plus répandus sont les vendeurs par téléphone.
Un lecteur écrit, en 1937, au « Reader's Digest »
pour se plaindre qu'il n'y ait « pas une pièce dans la
maison si intime qu'ils ne puissent y pénétrer par téléphone
(7) ». Pour certains, la mauvaise espèce
de sociabilité téléphonique inclut les bavardages
et les cancans, « les échanges de potins entre femmes sottes
» (nous reparlerons des femmes un peu plus loin). En réalité,
bien des gens, à l'intérieur comme à l'extérieur
de l'industrie du téléphone considéraient les conversations
« inutiles » comme une invasion insupportable du foyer.
De même, certains s'inquiétaient de voir le téléphone
autoriser les indiscrétions, surtout entre femmes non surveillées
et hommes étrangers, conduire à des contacts inappropriés
de la part de personnes de classes inférieures, ou simplement
ouvrir à n'importe qui l'accès à la famille. Les
gens s'inquiétaient aussi du risque d'indiscrétion de
la part de ceux qui pouvaient surprendre une conversation, qu'ils soient
dans la même pièce, qu'ils écoutent sur une ligne
partagée, qu'il s'agisse d'opérateurs trop curieux ou
de fonctionnaires (8).
La nouvelle technologie que représente le téléphone
offre-t-elle donc un moyen de construire une collectivité plus
large et plus riche ? Ou s'agit-il d'un dispositif séducteur
qui va finalement appauvrir la vie sociale ? Ou des deux à la
fois ? Les documents historiques dont on dispose ne permettent pas de
résoudre toutes les nuances de cette argumentation. Nous pouvons
cependant évaluer si oui ou non, et avec quels résultats
apparents, les gens utilisent le téléphone à des
fins de sociabilité. D'abord, dans quelle mesure les usagers
du téléphone l'utilisent-ils pour la conversation et pour
entretenir des relations sociales ?
(5) MEAD, 1976, 12-14. Robert COLLINS, 1977, 141-142,
a décompté plus de 650 chansons axées sur le téléphone
écrites entre 1877 et 1937. A propos des articles de magazines,
cf. WEINSTEIN, 1976. Parmi les commissions gouvernementales, citons
celle du Sénat des Etats-Unis : Report of the Country Life Commission.
Des commentaires industriels paraissaient régulièrement
dans Telephony. Cf. aussi, POOL, 1983, 129-31.
(6) L'article rédigé en 1893 a été publié
dans « Cosmopolitan » et repris par Marvin, 1989, 201-2
; « Plus vaste mais moins profond » est extrait de Abbott,
1987, 163 ; WESTRUM, 1983, 273 ; la citation de Berger est extraite
de « The Heretical Imperative », 1989, 6-7 ; cf. aussi Strasser,
1982, 305.
(7) Chambers Journal, « The Telephone », 310 ; le professeur
Jacks est cité dans LUNDBERG et al., 1934 (cf. aussi un autre
professeur : Schlesinger, 1933, 97 ; WILLEY et RICE, 1933, 203 ; H.
SMITH, 1937, « Intrusion by Telephone », 34. Un chroniqueur
parlant de la téléphonie en Australie affirme qu'au contraire
de ce qui se produit au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, les Australiens
ne sont pas tourmentés par le problème des intrusions
téléphoniques (MOYAL, 1984, 147)
(8) Les « potins » viennent
de l'ouvrage d'ANTRIM, 1909, 126. Cf. aussi BENNETT, 1912, et la discussion
du chapitre 3. Sur les contacts inappropriés, cf. par exemple
Marvin, 1989, 67 et suiv. ; Kern, 1976, 215. Sur l'indiscrétion,
cf. Marvin, 1989, 128 et suivantes ; J. Katz, 1988 ; Pool, 1983, FORECASTING,
139-41. Margaret MEAD 1976, 13, prétend cependant que le téléphone
renforce l'intimité par comparaison aux conversations habituelles.
(9) Voir dans ce numéro WURTZEL et TURNER, « Les fonctions
latentes du téléphone » (NDLR).
Les études effectuées depuis trente ans laissent entendre que les gens aujourd'hui téléphonent de leur foyer plutôt pour des raisons sociales ou vaguement personnelles que pour des raisons pratiques. Les recherches d'AT&T font apparaître que la moitié des appels d'un domicile quelconque sont dirigés vers cinq numéros seulement, ce qui indique l'organisation de conversations répétées avec un petit cercle d'amis et de membres de la famille. En 1975, à New York, un incendie mit en panne des milliers de téléphones privés pendant trois semaines. Lors d'une étude postérieure, la plupart des répondants affirmèrent que ce qui leur manquait le plus c'était de pouvoir appeler ou recevoir des appels de leurs amis et parents (9). D'après un sondage de 1985, les Californiens estiment que près des trois quarts des appels locaux passés depuis la maison sont de cet ordre (contre un huitième seulement pour les affaires du foyer). Parmi les Américains interrogés en 1982 sur leurs activités de loisirs, près de la moitié parlent au téléphone avec des amis ou des parents à peu près tous les jours - soit un peu moins que le nombre de personnes qui regardent la télévision ou lisent un journal chaque jour, mais plus que ceux qui font du sport, lisent des livres, font des courses, boivent de l'alcool, ou ont des relations sexuelles quotidiennes. Aujourd'hui, dans les autres nations même en voie de développement, la plupart des appels sont dirigés vers les amis ou la famille (10).
En ce qui concerne notre période nous disposons d'une recherche effectuée à Seattle en 1909 par écoute téléphonique. Sur l'ensemble des appels interceptés, 30 % étaient « des bavardages inutiles », 15 % des invitations et 20 % des appels de la maison au bureau - sans doute, pour une partie, de la femme à son mari. A peu près la moitié renferment donc un certain contenu social, à une époque où à peine un tiers des foyers de Seattle avait le téléphone. De plus, ces appels duraient en moyenne 7 minutes (à comparer avec environ 4 minutes aujourd'hui), ce qui permet également de penser à une conversation. (11)
Faute d'évaluation statistique fiable pour les
appels de nature sociale dans les premières années, nous
devons utiliser les commentaires contemporains et les souvenirs
des gens âgés. Pour les premières décennies
du XXe siècle, les témoignages les plus remarquables et
les plus cohérents indiquent que les populations rurales, et
en particulier les femmes d'agriculteurs, dépendaient totalement
du téléphone pour leurs relations sociales, du moins jusqu'à
ce qu'elles deviennent propriétaires d'automobiles. Ces femmes
utilisaient le téléphone pour rompre leur isolement, organiser
les activités collectives, se tenir au courant des nouvelles,
aider leurs enfants à se faire des amis, etc.
Les observateurs affirment toujours que le téléphone était
un soutien indispensable aux relations sociales - et même à
la santé mentale - des femmes habitant des maisons très
éloignées les unes des autres (12). Les industriels sont
au nombre de ces observateurs. Par exemple, la North Electric Company
écrit en 1905 : « Le mal et l'oppression
de la solitude imposée aux femmes sont éliminés.
» La même année, un responsable d'une compagnie de
téléphone de ? Ohio écrit : « Quand nous
avons commencé... les fermiers pensaient qu'ils pouvaient vivre
sans le téléphone... aujourd'hui on ne pourrait plus les
en priver. Les femmes ne nous laisseraient pas faire, même si
les hommes y consentaient. Socialement, le téléphone est
un don du ciel. Les femmes de la campagne restent en contact les unes
avec les autres, et avec leurs activités communautaires qui sont
principalement de nature religieuse (13). »
Les enquêtes administratives déplorent l'isolement et l'ennui de la vie rurale pour les femmes, mais indiquent que le téléphone - et l'automobile - sont des moyens d'assurer une vie collective (14).
(10) Appels adressés à cinq numéros
: MAYER, 1977, 228. Les constatations pour la Californie sont extraites
de Field Research Corporation, Residence Customer Usage, 40-43. L'enquête
sur les loisirs vient de United Media Enterprises. Where does the time
go ?, tableau 2.1. Des conversations téléphoniques quotidiennes
ou presque avec les amis ou la famille sont annoncées par 45
%, la télévision par 72 %, la lecture de journaux par
70 %, la musique par 46 %, le sport par 35 %, la lecture pour le plaisir
par 24 %, les courses par 6 %, la boisson par 9 % et le sexe par 1 1
%. Le même tableau montre aussi que 33 % des répondants
affirment ne jamais écrire de lettres à leurs amis ou
à leur famille, mais 3 % seulement ne parlent jamais avec eux
par téléphone. Les parents célibataires et les
adolescents sont les usagers les plus fréquents du téléphone,
les couples travaillant tous les deux et les couples sans enfants sont
les moins fréquents (ibid., tableau 2.2). Une enquête suisse
estime que la moitié des appels sont dirigés vers la famille
ou les amis (JEANNIN et al., « Pratiques et représentations
télécommunicationnelles des ménages suisses ».
Dans une vaste étude effectuée à Lyon, on a demandé
à plusieurs centaines de personnes de tenir un journal de leurs
appels en les caractérisant individuellement. Les chercheurs
ont classé les appels en deux catégories, fonctionnelle
et relationnelle. En fréquence, les appels relationnels (bavardages,
prise de nouvelles familiales, etc.) ne représentent qu'environ
45 % du nombre des appels. En temps, ils en représentent 60 %.
Les auteurs concluent à la destruction définitive du «
mythe du téléphone convivial ». Les résultats
de cette étude sont peut-être différents d'autres
résultats pour des raisons culturelles ou de mesure (CLAISSE
et ROWE, « The Telephone in Question »). SAUNDERS et al.,
1983, fournissent les données d'enquêtes effectuées
dans quatre pays en voie de développement où la proportion
d'appels à la famille ou aux amis varie entre 40 % en Thaïlande
rurale et 69 % au Chili urbain. (Le chiffre pour le Royaume-Uni est
de 74 %.) Pour les appels faits à partir de téléphones
publics, la proportion en direction des amis et de la famille varie
de 2 à 76 % selon le pays (page 222). On notera que ces auteurs
s'efforcent de souligner la valeur économique du téléphone
pour les pays en voie de développement. Cf. aussi SAUNDERS et
WAR- FORD, « Evaluation of Telephone Projects in Less Developed
Countries ». Cf. aussi SINGER, 1981, et Synge et al., 1982.
On ne sait pas exactement combien d'appels et combien de temps les gens
consacraient à des conversations sociales, toutefois cette fonction
est tout à fait apparente dans les régions rurales - même
si elle n'est pas la raison primordiale de la prise d'un abonnement
(15). Mais pour les habitants des villes on ne dispose guère
de témoignages comparables.
(11) JUDSON, 1909. L'évaluation de ce tiers des foyers de
Seattle provient de statistiques indiquant qu'il y avait un téléphone
résidentiel pour neuf résidents de Seattle en 1914 (Item
248-6, lettre de F.C. Phelps, dans le dossier « Correspondance
Du Bois », TPCM). D'après les données de Judson,
la longueur moyenne de l'appel était d'environ 7,5 minutes et
la longueur médiane d'environ 5 minutes. Une étude à
l'échelle de l'Etat effectuée par AT&T ces dernières
années indique une moyenne de 4,25 minutes et une médiane
d'environ 1,5. Une comparaison historique plus précise consisterait
peut-être à mettre cette durée d'appel en regard
des données provenant de villes qui ont aujourd'hui des tarifs
forfaitaires, comme Seattle l'avait probablement à l'époque.
Leur moyenne courante est d'environ 5,4 minutes, soit encore près
de 30 % de moins que le chiffre pour Seattle (MAYER, 1977, « The
Telephone and the Uses of Time », 228-29). Si les appels plus
longs de 1909 indiquent peut-être une conversation plus prolongée,
cela peut être aussi le reflet d'une plus grande difficulté
à s'entendre. Dans l'un ou l'autre cas, si la sociabilité
n'était vraiment pas en cause, nous devrions constater pour cette
époque des appels nettement plus brefs.
(12) Cette affirmation a été répétée
jusqu'à l'exagération dans toute la bibliographie concernant
le téléphone. Par exemple, dans son histoire de la téléphonie,
BROOKS, 1976, 94, écrit : « A la fin des années
1880, le téléphone commençait à sauver la
santé mentale des fermières éloignées en
atténuant leur sentiment d'isolement. » Et pourtant, à
la fin des années 1880, bien peu de fermes, et en fait aucune
ferme éloignée, n'avait le téléphone.
(13) North Electric : Telephony, "Facts Regarding the Rural Telephone";
Ohio Company: KEMP, 1905, 433.
(14) Cf. US Bureau of the Census, 1907, 78; US Senate, 45 et suiv.;
US Department of Agriculture, 11-14; WARD, 1920, 6-7.
(15) Cf. une fois de plus les citations concernant les fermiers dans
la note 13, ainsi que les témoignages répétés
provenant de sources industrielles. Ann MOYAL, 1984 b, 22-25, cite les
fermières australiennes faisant des déclarations similaires
dans les années 80.
La plupart des trente-cinq habitants de Californie du Nord que nous avons interrogés se souvenaient d'une utilisation considérable du téléphone à des fins de sociabilité. Deux d'entre eux avaient été standardistes dans leur jeunesse. L'un, un homme de San Rafael, né en 1902, rapporte que la plupart des appels qu'il connectait étaient d'ordre personnel plutôt que professionnel. Une femme de San Rafael, née en 1903, qui avait tenu un standard de campagne, raconte que bien souvent les gens se faisaient des « visites » par téléphone. Une femme de Palo Alto, née en 1892, était la fille d'un médecin de San Francisco. On lui avait appris à ne pas « encombrer la ligne » pour ne pas empêcher la réception des appels d'urgence et pourtant elle téléphonait fréquemment à ses amis. Rentrant de l'école à pied avec une camarade qu'elle quittait au coin de la rue, elle se rappelle qu'aussitôt elle lui passait un coup de téléphone. D'autres, surtout de Palo Alto, nous ont raconté qu'ils utilisaient souvent le téléphone étant enfants. Un homme né en 1893 se souvient que peu de ses amis avaient le téléphone dans les premières années du siècle mais qu'il appelait régulièrement ceux qui l'avaient. Un autre, né en 1908, nous a raconté : « J'utilisais le téléphone pour parler à mon père à son bureau, appeler les garçons avec lesquels je jouais, appeler une fille pour lui fixer un rendez-vous. » Une femme née l'année suivante déclare : « J'ai l'impression que nous avons toujours eu le téléphone. Ma mère comme moi nous l'utilisions, surtout pour bavarder avec des amis. » Une femme de San Rafael, née en 1907, raconte que sa mère et son père utilisaient peu le téléphone mais que les enfants s'en servaient régulièrement pour bavarder avec leurs copains. D'autres se souviennent d'usages sociaux du téléphone en arrivant à l'âge des relations amoureuses ou de leur première installation personnelle. Au nombre de ceux- ci on trouve en particulier, une femme de Palo Alto, née en 1900, dont le père avait interdit la présence d'un téléphone dans la maison où elle avait passé son enfance. Un homme de San Rafael, né en 1908, se souvient qu'étant jeune homme, il s'en servait pour organiser ses sorties et qu'après son mariage sa femme appelait les magasins pour passer ses commandes et bavarder avec ses amis et sa famille.
D'autres, ayant des souvenirs de « visites » par téléphone, affirment que c'était quelqu'un d'autre dans la famille qui le faisait, en général leur mère, leur sœur, leur femme. Une femme d'Antioch, née en 1908, raconte que sa mère appelait régulièrement ses amies pour bavarder. « Une dame en particulier, tous les matins à 9 heures, pour se raconter ce qui se passait. » Un homme de San Rafael, né en 1909, relate que sa famille se fit installer le téléphone vers 1915 et que sa sœur tenait de longues conversations, mais que lui- même ne l'utilisait que pour ses affaires ou pour prendre des rendez-vous. Un homme d'Antioch, né en 1911, raconte que sa famille avait le téléphone à partir de 1920. Il ne l'utilisait pas beaucoup, puisqu'il vivait à proximité de ses amis, et son père s'en servait surtout pour appeler le bureau. Mais sa mère et sa sœur en faisaient grand usage : « Maman bavardait pendant des heures, assise sur le tabouret de piano... Mon père disait, "Raccroche et va leur faire une visite". C'était probablement un excellent moyen pour tuer le temps. Moi, je ne croyais pas aux longues conversations téléphoniques, mais chacun avait son opinion. »
Une minorité des personnes interrogées décrit les appels d'ordre social comme limités. Quelques-uns, assez rares, n'ont pas eu de téléphone avant l'âge adulte. D'autres disent qu'on les empêchait de bavarder par téléphone ou que cela ne les intéressait pas. La fille d'un médecin de Palo Alto, née en 1907, nous a raconté que personne n'utilisait beaucoup le téléphone dans son enfance car il fallait laisser la ligne libre pour les appels médicaux. Une femme ayant grandi dans la campagne aux environs d'Antioch rappelle : «Je n'avais pas le droit d'y toucher. "Ne bavarde pas avec ça et n'y touche pas !" Je pense que je ne m'en servais pas beaucoup. Les enfants ne discutaient pas par téléphone parce qu'il pouvait y avoir un message important à recevoir et il ne fallait pas occuper la ligne. Nous avions un téléphone, c'était pour ma mère parce qu'elle pouvait appeler l'épicier ou le boucher, leur dire ce qu'elle voulait et ils le lui livraient. »
Quelques autres se décrivent, comme le dit une femme d'Antioch, née en 1911, comme n'étant « pas amateur de téléphone ». Sa famille, propriétaire d'une laiterie, était abonnée au téléphone et ses amis aussi, mais elle n'appelait pas beaucoup. Elle leur faisait des visites impromptues et ne sortait guère, de sorte qu'elle n'en avait pas vraiment l'usage. Beaucoup, et peut-être la plupart de ceux qui disent n'avoir pas utilisé le téléphone, l'associent pourtant à une fonction de sociabilité, comme cette femme que nous venons de citer. Elle pouvait rendre visite à ses amis et n'avait donc pas besoin de les appeler. Une femme de San Rafael, née en 1902, raconte que ses parents utilisaient peu leur téléphone car ils ne parlaient pas anglais. Quand elle se fut installée ailleurs, d'abord comme étudiante puis en tant que professeur, elle donnait fort peu de coups de téléphone car elle ne connaissait pratiquement personne dans ces nouvelles villes. Après son mariage, son mari et elle, peu sociables, s'en servirent. Une femme de Palo Alto, née en 1895, avait passé une partie de son enfance à San José. Son père téléphonait souvent pour des raisons professionnelles, mais elle déclare : « Je n'avais pas de bons amis à San José, je n'étais donc pas particulièrement intéressée par le téléphone. » Dans les souvenirs de ce genre, l'usage du téléphone est lié à l'amitié.
Bon nombre de nos interviewés établissent une comparaison entre les « visites par téléphone » de leur jeunesse et le flot de paroles actuel. Une femme d'Antioch, née en 1903, dit : « Nous ne dépendions certainement pas du téléphone comme on le fait aujourd'hui... Non, le téléphone n'était pas autant utilisé. On s'en allait voir les gens et leur rendre visite en personne. » Pour certains, la conversation d'ordre social ne se développa qu'au cours des années. Une femme de San Rafael, née en 1910, raconte qu'au contraire des gens actuels sa famille n'utilisait pas beaucoup le téléphone à des fins sociales, même si l'on s'en servait pour organiser ses rendez- vous. Elle indique que la conversation était limitée lorsque peu de gens avaient le téléphone. A mesure que le nombre d'abonnés a augmenté, les appels sociaux se sont multipliés. Ils augmentèrent aussi quand ses frères et sœurs quittèrent la maison, sa mère s' efforçant de rester en contact avec eux. Un homme de San Rafael, né en 1913, se rappelle que les conversations téléphoniques avec des amis étaient rares au début des années 30, mais se sont multipliées à mesure que la vie sociale s'amplifiait. Après son mariage, l'accroissement s'est poursuivi, mais sans atteindre, dit-il, le niveau actuel de fréquence et de longueur des conversations.
Les diverses femmes âgées interrogées par Lana Rakow dans le Wisconsin rural avaient des souvenirs comparables. Quelques-unes ont indiqué que les gens n'utilisaient pas autant le téléphone qu'aujourd'hui, surtout pour bavarder : « On utilise beaucoup plus le téléphone aujourd'hui. C'était quelque chose de très commode dans les premières années, quand j'étais trop occupée à élever les enfants, faire le jardin, les conserves et tout ça. On s'en servait comme ses inventeurs l'avaient prévu, pour vous aider au fil de la journée. En fait, je n'aime pas beaucoup prendre mon téléphone et faire une visite, mais c'est en partie ce qui se passe dans l'autre sens, c'est peut-être pour cela que je ne le fais pas. »
Dans ses débuts, le téléphone, avec les lignes partagées et la mauvaise qualité du son, était un instrument pratique et non social. C'est pourquoi, racontent les personnes interrogées par Rakow, cela n'a pas manqué beaucoup à ceux qui ont perdu leur abonnement au moment de la grande dépression. De plus, « les femmes à cette époque n'avaient pas autant de temps à consacrer au téléphone que nous en avons aujourd'hui », dit l'une d'elles. « Je suis sûre que ma mère se sentait seule parfois, mais la pauvre avait tellement de travail. » Mais même ceux qui minimisent l'utilisation du téléphone lui accordent un certain rôle social : « Je ne me servais pas beaucoup du téléphone à l'époque, nous dit une fermière, seulement pour bavarder avec les voisines. » Une autre rappelle que « les femmes à cette époque n'avaient pas le temps de téléphoner comme nous l'avons aujourd'hui... mais (maman) et Mme B. ne se perdaient pas de vue et bavardaient... ». Une femme ayant été opératrice en milieu rural se rappelle la nécessité d'imposer une limite de 10 minutes aux abonnés des lignes partagées (16).
Les femmes interrogées par Rakow se plaignent couramment de « bavardes » notoires qui utilisaient à tort le téléphone pour de longues conversations « juste pour passer en revue tout ce qui se passait dans la région. Elles n'avaient pas la radio. Elles n'avaient rien que le téléphone ou un vieux journal ayant toujours un ou deux jours de retard... Pour ceux qui aimaient utiliser le téléphone pour entretenir les relations avec d'autres personnes, ce fut une amélioration considérable de notre mode de vie » (17). Les répondantes de Rakow considèrent les bavardes d'hier et d'aujourd'hui comme suspectes sur le plan moral et mettent leur point d'honneur à préciser qu'elles étaient différentes. N'oublions pas que les compagnies du téléphone, du moins jusqu'à la fin des années 20, précisaient que l'instrument était destiné aux affaires de la maison et non aux bavardages « frivoles ».
On ne sait pas pourquoi les répondantes de Rakow accordent apparemment moins de rôle social au téléphone que les personnes que nous avons pu interroger à An- tioch, Palo Alto et San Rafael. Les différences proviennent peut-être de la région, du pays, de l'accès au téléphone ou de la méthode d'enquête (18). Quoi qu'il en soit, les femmes du Wisconsin et leur famille utilisaient régulièrement le téléphone à des fins dépassant les besoins pratiques, même si c'était dans une moindre mesure que les Californiennes.
La plupart des femmes âgées de milieu rural ayant fourni un témoignage oral dans le cadre d'un projet historique sur ? Indiana ont parlé de sociabilité téléphonique. Une minorité seulement affirme avoir limité ses appels aux nécessités pratiques. Deux ont dit qu'elles « s'amusaient » au téléphone. L'une d'elles rapporte : « Quand les hommes arrivaient et avaient besoin d'utiliser le téléphone, si quelqu'un était en train de parler, ils se contentaient de faire marcher la sonnette et de dire "J'ai besoin du téléphone", alors les femmes s'arrêtaient, les laissaient s'en servir, et puis se rappelaient. Elles pouvaient à nouveau en disposer (19). »
Pour résumer, les gens d'autrefois faisaient manifestement des usages variés du téléphone, comme aujourd'hui, et peut-être plus encore. Certains le dédaignaient ou n'y voyaient qu'un appareil destiné aux questions « sérieuses ». D'autres « aimaient » le téléphone et bavardaient librement par cet intermédiaire, mais ils étaient sans doute moins nombreux qu'à l'heure actuelle. Le plus frappant est cependant de constater que les gens s'appelaient souvent pour des raisons sociales, et fréquemment pour une simple « visite », dès 1910. Mais peut-être ce terme de « gens » n'est-il pas suffisamment précis. Les citations rapportées ici à propos de l'attitude commerciale de l'industrie du téléphone suggèrent que le terme le plus approprié ici serait « les femmes ».
(16) RAKOW, 1987, 218, 160-61, 159, 230 et 210.
(17) RAKOW, 1987, 207.
(18) J'ai fait appel pour la Californie du Nord à trois enquêteurs
différents dont deux ne sont pas intervenus ailleurs dans l'ensemble
du projet (cf. note 2 ci-dessus). Et je me suis efforcé de garantir
que les questions concernant le téléphone soient neutres
en évitant les questions directives.
(19) ARNOLD, 1985, 144-53 ; la citation figure page 153.
sommaire
Les femmes et le téléphone
Commentaire préalable : ce sujet est un thème de controverse. Des ouvrages de Mark Twain jusqu'aux dessins humoristiques actuels du « New Yorker », les femmes et le téléphone est un sujet de plaisanteries. Pour beaucoup, et sans aucun doute pour les dirigeants des débuts de l'industrie téléphonique, le bavardage au téléphone représentait « une nouvelle folie féminine ». Les sociologues ne sont pas de cet avis. La conversation et même les potins jouent un rôle important dans les processus sociaux, en contribuant à l'entretien des réseaux et à la construction des collectivités (21). Quiconque écarterait ce sujet en le jugeant négligeable ou sexiste ne ferait que reprendre l'attitude des industriels, journalistes et autres critiques de sexe masculin qui ? écartent sans tenir compte du sérieux avec lequel les femmes abordent la conversation.
Les Nord-Américains sont persuadés que les femmes parlent plus au téléphone que les hommes : il se trouve que ce stéréotype est correct. L'industrie du téléphone a toujours associé les femmes avec cet appareil. Pour les spécialistes du tournant du siècle, « les femmes bavardes et leurs conversations électriques frivoles sur des sujets personnels sans intérêt s'opposent aux conversations efficaces, professionnelles et orientées vers le travail des hommes d'affaires et des professionnels » (22). Des études récentes établissent une corrélation plus fiable entre les femmes et l'usage du téléphone. Des recherches effectuées pour l'essentiel par AT&T montrent que les Américaines actuelles ont plus de chances d'avoir un téléphone chez elles que les hommes, que le nombre de femmes ou d'adolescentes d'un foyer permet de prévoir mieux que le nombre d'hommes la fréquence des appels, et que ce sont les femmes qui font le plus grand nombre d'appels longue distance à partir de leur domicile. Une enquête australienne a montré que les femmes font des appels téléphoniques plus prolongés que les hommes. Une grande étude française a constaté que les femmes passent beaucoup plus de temps que les hommes au téléphone, quel que soit leur statut professionnel. Une enquête anglaise montre que les femmes appellent leurs parents et amis beaucoup plus souvent que les hommes. Une enquête effectuée dans l'Ontario chez les gens âgés de 40 ans et plus a montré que les femmes ont deux ou trois fois plus de chances d'appeler leurs amis que les hommes. Une enquête sur les gens âgés de New York a permis de constater que les conversations téléphoniques entre une personne âgée et son aide sont plus courantes si l'une ou l'autre est une femme. Une étude des réseaux sociaux de Toronto a établi une corrélation entre la fréquence des appels et la proportion de femmes constituant le réseau (23). Toutes ces études confirment que les femmes actuelles sont de beaucoup plus grandes utilisatrices du téléphone privé que les hommes.
Pour en revenir à l'époque de cette étude,
les questionnaires de budget-temps remplis par des New-Yorkais habitant
les faubourgs avant la Seconde Guerre mondiale révèlent
que les femmes déclarent consacrer quatre fois plus de temps
au téléphone que les hommes (24). Les études sur
les ménages entre 1900 et 1936, l'enquête nationale sur
le niveau de vie de 1918, ainsi que l'étude des familles rurales
de Dubuque County (1924) conduisent à une conclusion semblable
: plus la proportion de femmes adultes dans une maison est importante,
plus cette maison avait de chances d'avoir un téléphone
(25).
Ses entretiens dans le Wisconsin rural ont permis
à Lana Rakow de conclure que « hommes et femmes perçoivent
généralement le téléphone comme faisant
partie du domaine féminin » (26). Nos interviewés
ont également associé le plus souvent les femmes au téléphone.
Il est vrai que certains hommes se souvenaient d'avoir bavardé
avec leurs amis et pris des rendez- vous par téléphone.
Un homme de San Rafael, né en 1914, rappelle que son père
extrêmement grégaire appelait souvent ses amis connus à
l'église. Pourtant, la plupart des souvenirs rattachent les femmes
au téléphone. D'autres éléments de preuves
suggèrent même que les hommes éprouvaient une certaine
timidité face au téléphone, et que leurs épouses
faisaient en général les appels pour le compte de leurs
maris (27).
Que signifie donc toute cette activité téléphonique
des femmes ?
Ann Moyal a récemment interviewé plus de 200 femmes australiennes
à ce propos. Elle conclut que les femmes dans toutes les régions
du pays « attachent une grande importance aux conversations téléphoniques
et à leur rôle essentiel dans leurs affaires personnelles
» et que le téléphone est « un engin important
pour la famille, la sollicitude, l'amitié, le soutien, les activités
bénévoles et les contacts avec le monde en général
» (28).
Dans quelle mesure cette description s'applique-t-elle aux premières
années du téléphone en Amérique du Nord
?
Quand les vendeurs de téléphone
commencèrent à commercialiser cet appareil pour des usages
domestiques, ils firent la promotion d'une vision particulière
de la manière dont les femmes devaient s'en servir. Jusque dans
les années 20, leur suggestion majeure était que la femme,
« directeur général » du foyer, devait téléphoner
pour commander biens et services. Cette approche correspondait à
l'image de la ménagère-administrateur qui commençait
à apparaître dans la publicité et dans l'économie
ménagère (29). Les entreprises stimulaient aussi cet emploi
par l'autre extrémité en encourageant les commerçants
à organiser, à inviter, à faire la publicité
de la commande par téléphone (30). Les industriels considéraient
comme un problème les conversations féminines avec des
amis ou des membres de la famille, objet de tant de moqueries, et ils
cherchèrent d'abord à le faire disparaître. Mais
dès la fin des années 20 et dans
les années 30, la publicité du téléphone
se mit de plus en plus à décrire des femmes utilisant
l'appareil pour entretenir des contacts sociaux et même pour la
conversation.
(20) Cette section abrège mais aussi met à
jour les travaux de C. FISCHER, 1988. « Gender and the Residential
Telephone » ; on trouvera dans l'article lui-même des détails
théoriques et empiriques plus étendus.
(21) Cf. par exemple R. PAINE, 1967 ; Di LEONARDO, 1984, 194 et suiv.
; SPACKS, 1986.
(22) MARVIN, 1989, 23.
(23) Sur les études AT&T, cf. WOLFE, 1979 ; MAYER, 1977,
231 ; BRANDON 1982, chapitre 1 et ARLEN, 1980, 46-47. Enquête
australienne : rapporté chez Steffens, 1990, 176. L'enquête
française a constaté par exemple que les femmes salariées
de classe ouvrière avaient trois fois plus d'appels par semaine
et y passaient quatre fois plus de temps que les hommes salariés
de classe ouvrière (CLAISSE et ROWE, 1988. Etude anglaise : WIL-
MOTT, 1987, 28-29. Ontario : SYNGE. New York : LITWAK, 1985, 4 P 1982.
Annexe C4. Dans une autre étude sur les personnes âgées,
traitant des grands-parents, CHERLIN et FURSTENBERG, 1986, 116, ont
découvert que les grands-parents maternels parlaient au téléphone
à leurs petits-enfants une fois et plus souvent que les grands-parents
du côté paternel. Les auteurs attribuent cette différence
à la fréquence avec laquelle les mères appellent
leurs parents. Toronto : WELMANN, 1989.
(24) SOROKIN et BERGER, 1939, 52.
(25) En 1910, par exemple, dans nos trois villes, 12 % des ménages
dont le chef de famille était un homme célibataire avaient
le téléphone (n = 33), cette proportion étant de
28 % pour les ménages avec mari et femme mais sans fille adulte
(n = 229) et de 44 % pour les ménages avec mari, femme et une
fille adulte au moins (n = 27). L'analyse des données urbaines
de 1900 à 1936 indique que la présence des femmes augmentait
de façon modeste les chances d'avoir un téléphone,
tous les autres facteurs étant constants. Dans les données
de Dubuque, 60 % des ménages ayant pour chef un homme célibataire
(n = 72) avaient le téléphone, contre 72 % des ménages
avec mari et femme et 6 sur 7 des ménages (86 %) avec mari, femme
et une autre femme adulte. Les analyses de régression logique
suggèrent que l'effet des femmes sur les abonnements au téléphone
dans le comté de Dubuque était réel et important.
L'analyse de l'enquête 1918-1919 du Bureau of Labor Statistics
constate que la présence d'adultes supplémentaires dans
un ménage réduit les chances d'avoir un téléphone,
mais cette réduction est due aux adultes de sexe masculin. La
proportion de femmes est donc un indice indépendant des chances
d'abonnements téléphoniques, que l'on retrouve dans toutes
les séries de données.
(26) RAKOW, 1987, 142.
(27) Une enquête effectuée dans les années 30 auprès
de 27 familles agricoles « caractéristiques » de
l'Iowa a découvert que les femmes faisaient 60 % des appels,
y compris beaucoup concernant les affaires de la ferme (BOR- MAN, 1936).
Une enquête rurale dans l'Indiana effectuée dans les années
40 auprès de 166 abonnés donne l'explication suivante
de cette situation : « C'étaient les femmes qui utilisaient
le plus souvent le téléphone. Les hommes disaient qu'ils
n'aimaient pas s'en servir, ils demandaient donc aux femmes d'appeler
pour eux. » ROBERTSON et AMSTUTZ, 1949, 18 ; cf. aussi RAKOW,
1987, 169-70.
(28) MOYAL, 1989 a, 288 ; cf. aussi MOYAL, 1989 b.
(29) MARCHAND, Advertising ; COWAN, More Work.
(30) Cf. par exemple Printers' Ink, 1910 et SHAW, 1934.
En fait, à quelles fins les femmes américaines
utilisaient-elles le téléphone entre 1900 et 1940 ?
Sans aucun doute, pour beaucoup, comme les industriels l'avaient imaginé,
c'est-à-dire pour les cas d'urgence et pour faire des achats.
Mais certaines preuves suggèrent que la plupart des femmes ne
faisaient qu'occasionnellement des commandes par téléphone.
L'enquête effectuée par Bell dans les années 30
implique même que moins de la moitié des femmes aimaient
commander par téléphone (31). Aucun des nombreux ouvrages
contemporains de conseils sur la gestion des ménages que nous
avons consultés pour cette étude ne préconise l'utilisation
du téléphone pour faire ses courses. L'un, écrit
par un auteur populaire, Christine Fredrick, la déconseille même
: « L'habitude du téléphone encourage l'ignorance
des caractéristiques des produits et de leurs prix... »
(32). Si plusieurs de nos interviewées se souviennent qu'elles-mêmes
ou leurs mères commandaient leur épicerie par téléphone,
la plupart n'en ont pas fait mention (33).
Si les femmes d'il y a quelques générations commençaient à acquérir une « affinité » pour le téléphone mais ne ployaient guère dans la gestion de leur foyer, à quoi leur servait-il ? La conversation avec la famille et les amis, telle est la réponse que le chercheur canadien Michèle Martin tire d'un examen des publicités, articles de journaux et rapports industriels contemporains. En dépit des efforts des compagnies pour orienter leur utilisation du téléphone, les femmes en faisaient à leur tête - « activités délinquantes » - et se servaient surtout du téléphone pour faire leurs visites (34).
Des preuves plus concrètes de cette assertion nous sont fournies par une étude inhabituelle auprès des ménagères, effectuée en 1930. Dans le cadre d'une enquête très générale, quoique peu systématique, sur la manière dont les femmes passent leur temps, des économistes du gouvernement avaient demandé aux anciennes élèves de « Seven Sister » de remplir des questionnaires budget-temps. Les formulaires encourageaient les femmes à rendre compte de toutes leurs activités sur une semaine complète (35). J'ai sélectionné au hasard et étudié les formulaires remplis par 62 interviewées pour un total de 250 jours. Ces 250 formulaires n'indiquaient que 83 appels téléphoniques. Comme la plupart de ces femmes de situation relativement élevée avaient très probablement le téléphone, ce chiffre très faible indique que, pour la majorité d'entre elles, téléphoner était un événement non remarquable qui ne méritait paš d'être noté (une seule femme a indiqué qu'elle utilisait le téléphone de sa voisine). Sur les appels téléphoniques indiqués, 30 à 50 % concernaient apparemment des commandes de biens et de services, et 30 à 50 % des questions personnelles ou sociales. Sur tous les appels notés, donnés ou reçus, 25 à 40 % étaient d'ordre commercial et 30 à 50 % d'ordre social. Cela représente sans doute une évaluation prudente de la fréquence des « appels sociaux » (36).
(31) Dans la documentation diffusée aux vendeurs
en 1933, Bell Company affirme que plus de 50 % des ménagères
de Washington « préfèrent faire leurs courses par
téléphone plutôt qu'en personne » (Printers'
Ink. 1933). Une enquête Bell de 1930 auprès de 4 500 ménages
d'une seule ville a constaté que 40 % des abonnés étaient
« disposés » à acheter par téléphone,
mais dans une autre enquête, une faible majorité de 800
abonnés a répondu oui à la question : « Aimez-
vous faire vos courses par téléphone ? » D'après
la même source, les commandes téléphoniques représentent
juste 50 % des affaires dans les grands magasins les plus importants
(SHAW, 1934). Compte tenu de l'intérêt que la compagnie
de téléphone pouvait avoir à exagérer les
chiffres, il nous faut conclure que jusque dans les années 30,
seule une minorité de femmes faisait des courses par téléphone.
(32) FREDRICK, 1919, 329. J'ai également étudié
les indices de Gilbreth, 1927 (connue surtout pour « Treize à
la douzaine ») ; BALDERSTON, 1921 ; BAXTER, 1913 et NISBITT, 1918.
Cf. aussi STRASSER, 1989, 265-67.
(33) Ann MOYAL, 1989 b, 10, a constaté que le télé-achat
n'était pas populaire parmi son échantillon 1988 de femmes
australiennes.
(34) Michèle MARTIN, 1988. « Allô ! central »
dans cette livraison de « Réseaux ».
(35) Les formulaires et les documents connexes sont archivés
Box 653, Record Group 176, Bureau of Human Nutrition and Home Economies,
« Use of Time on Farms Study, 1925-1930 », Washington National
Records Center, Suitland, MD. En dépit du titre, les données
brutes qui ont survécu ne proviennent pas de fermes mais essentiellement
d'un échantillon sélectionné de ménagères
de zones urbaines et suburbaines. C'est Barbara LOOMIS qui m'a signalé
ces documents. Pour un résumé des données, cf.
KNEELAND (1929) et US Department of Agriculture (1944). Cet échantillon
est manifestement non représentatif de la généralité
des femmes américaines et les données sont vulnérables
à de nombreuses erreurs concernant ce qui nous intéresse
et en particulier une réduction délibérée
du nombre des appels indiqués. Quoi qu'il en soit, les formulaires
nous fournissent une indication rare sur les habitudes quotidiennes
des femmes de classe moyenne supérieure voici plus d'un demi-siècle,
sous une forme plus systématique et plus complète que
les agendas auxquels se réfèrent nombre d'historiens.
Nous avons déjà vu que les femmes de fermiers utilisaient le téléphone pour entretenir leurs activités sociales et créer des liens collectifs dans les régions rurales. Dans les régions urbaines, les femmes de classe moyenne et supérieure utilisaient aussi le téléphone pour des activités d'organisation, comme les membres du Women's Business and Professional Club de Palo Alto (37). Les jeunes habitantes des villes l'utilisaient aussi pour discuter avec leurs amoureux, comme l'ont indiqué certaines de nos répondantes. Dans les entretiens en Indiana, une femme rappelle : « Nous étions les seules du voisinage à avoir le téléphone et nos voisins les plus proches avaient plusieurs filles qui recevaient beaucoup d'appels. J'ouvrais la fenêtre, je poussais un cri et elles arrivaient à
toute vitesse. » En 1930, la rubrique sur les bonnes manières dans un journal mettait en garde « Patty » : « Pour être sûre que son amoureux "la respecte et l'admire", elle ne l'appelle pas pendant les heures de travail... et (à la maison) elle ne doit pas l'exposer aux railleries de sa famille en lui imposant des conversations téléphoniques d'une longueur ridicule. » En 1934, la compagnie des téléphones de Palo Alto dut ajouter un standard à Stanford Union car, « avec 80 femmes y résidant, l'encombrement téléphonique était tel pendant les heures à rendez-vous, aux alentours du déjeuner et du dîner, que le service en était ralenti » (38).
Les preuves dont nous disposons indiquent que les femmes appelaient plus souvent pour des raisons de sociabilité - organiser des rencontres sociales et faire la conversation - que pour d'autres raisons, surtout après les premières années du téléphone et surtout sur les lignes privées (c'est-à-dire non collectives) (39). Cela confirme le stéréotype selon lequel les femmes ont plus d'affinité pour le téléphone que les hommes, en particulier en ce qui concerne la conversation. A quoi correspond donc cette différence liée au sexe ?
(36) Comme les répondantes citaient fréquemment
les appels téléphoniques sans donner d'explications ou
fort peu, je n'ai pu qu'évaluer les portions de ces diverses
catégories. L'évaluation basse prend pour hypothèse
que les appels ne rentrent dans la catégorie sociale que s'ils
sont explicitement indiqués comme tels (par exemple « appeler
une amie ») alors que l'évaluation haute s'appuie sur des
hypothèses plus hardies (par exemple un appel non expliqué
donné après 18 heures est considéré comme
d'ordre social). La plupart des déviations plausibles des données
auraient tendu à réduire le nombre des appels d'ordre
social : cette étude a été effectuée pour
voir quelle était l'ampleur du travail assumé par les
femmes au foyer ; les instructions données aux interviewées
impliquaient clairement que l'intérêt essentiel de l'enquête
était de noter toutes les activités ménagères
; l'échantillon est constitué de femmes actives et aisées
(beaucoup ayant un travail à temps partiel, bénévole
ou rémunéré), exactement le type de femmes généralement
trop occupées pour bavarder au téléphone ; le souci
de prestige évident dans certaines réponses (une femme
indique par exemple que ses lectures du soir se font en grec, une autre
dans le domaine de la psychologie) en conduisit sans doute une bonne
partie à minimiser les « visites par téléphone,
apparemment frivoles. D"autre part, le travail impliqué
par la réponse à ce questionnaire a peut-être conduit
à sélectionner trop de femmes ayant du temps libre (les
achats par téléphone n'ont sans doute pas été
minimisés, simplement parce qu'ils étaient courants ;
on trouve très fréquemment l'indication d'achats personnels,
en moyenne une fois tous les deux jours). En résumé, il
est raisonnable de penser que, même parmi ces femmes de classe
moyenne supérieure et sans doute femmes d'intérieur qualifiées,
la sociabilité représentait l'usage le plus courant du
téléphone
(37) Une étude des « femmes de la bonne société
» de Chicago a constaté qu'en 1985 un quart de celles qui
participaient à des groupes réformateurs avaient le téléphone
contre moins de 1 % des habitants de Chicago en général
; en 1905, 66 % des femmes activistes avaient le téléphone
contre 3 % des habitants de Chicago. L'auteur de l'étude constate
que les femmes membres de clubs ont adopté très vite le
téléphone et suggère que ce fut peut-être
un des facteurs essentiels dans l'augmentation des activités
civiques des femmes de Chicago (ROSHER, 1968, 110). (38) Indiana : E.
ARNOLD, 1985, 145 ; « Patty » : RICHARDSON, 1930 ; Stanford
: Palo Alto Times, 15 novembre 1934. Sur les relations amoureuses par
téléphone, cf. ROTHMAN, 1984, 233 et suiv.
(39) L'étude française citée plus haut a constaté
que les femmes appelaient beaucoup plus souvent pour des raisons relationnelles
et les hommes pour des raisons fonctionnelles (CLAISSE et ROWE, 1988).
Trois réponses paraissent plausibles. D'abord, les femmes modernes sont plus isolées du contact des adultes pendant la journée que les hommes, elles se sont donc emparées du téléphone pour rompre leur isolement (40). Ensuite, les devoirs d'une femme mariée comprennent en général un rôle de gestion sociale - prendre des rendez-vous, préparer les festivités, se tenir informée de la santé de la famille et des amis, les informer de ce qui se passe dans la famille ; les hommes négligent ce genre de tâche. D'ailleurs, le plus souvent c'est l'épouse qui entretient la communication avec la famille de son mari aussi bien qu'avec la sienne. Selon Rakow, « parler au téléphone est un travail que font les femmes pour entretenir le tissu collectif... » (41). Enfin, les femmes nord-américaines sont plus à l'aise au téléphone que les hommes nord-américains car elles sont en général plus sociables qu'eux. La recherche a montré que, si l'on met de côté leurs possibilités plus limitées de contact social, les femmes sont plus adaptées socialement et plus intimes au téléphone que les hommes, quelles qu'en soient les raisons - constitution psychologique, structure sociale, expériences d'enfance ou normes culturelles. Le téléphone correspond donc mieux au style caractéristique d'interaction personnelle des femmes que des hommes (42), Pour souligner ce point, certaines preuves indiquent que les avantages des femmes sur les hommes en matière de sociabilité sont plus grands pour les contacts téléphoniques que pour l'interaction face à face (43).
D'après certains, les femmes, en utilisant
le téléphone pour accomplir leurs tâches de secrétaire
de la vie sociale de la famille, se sont enfoncées plus profondément
encore dans ce rôle chrono- phage (44). Il n'existe cependant
guère de preuves que ce type de tâche ait pris aux femmes
plus ou moins de temps à cause du téléphone. Quelques
femmes ont dit à Lana Rakow que la possession d'un téléphone
les rendait vulnérables aux demandes d'aide - conseiller, réconforter,
organiser, etc. La charge de travail de la confidente peut effectivement
s'être élargie. Mais pour les demandeuses, le renforcement
de cette possibilité d'obtenir une aide fut sans doute un bienfait.
Il est probable que l'utilisation du téléphone a facilité
l'œuvre sociale qu'hommes et femmes attendaient des femmes, que
cela fût juste ou non. Nous ne pouvons calculer un bilan des réconforts
et des charges sans disposer de plus de preuves comparatives sous la
forme de données montrant par exemple que, dans des lieux comparables
dépourvus de téléphone, les charges sociales des
femmes étaient plus ou moins lourdes.
La conclusion la plus raisonnable que l'on puisse en tirer est que depuis
les premières décennies du XXe siècle, les femmes
ont utilisé le téléphone, et souvent pour faire
ce qu'elles aiment plus que les hommes : la conversation.
Les témoignages et autres preuves suggèrent que les gens
considèrent l'utilisation du téléphone plus souvent
comme un plaisir que comme une épreuve, sentiment exprimé
par les femmes plus souvent que par les hommes
(45). Ann Moyal parle d'une « culture féminine pénétrante
du téléphone dans laquelle les relations avec la famille,
l'entretien des sentiments, le soutien à la collectivité
et la culture de sollicitude propre aux femmes forment un élément
dynamique, clé de notre société... »
Nous voici donc devant le cas d'une machine, si souvent identifiée
au genre masculin par sa nature, dont les hommes s'écartent fréquemment
mais que les femmes ont agressivement récupérée
à leurs propres fins. Michèle Martin tire une conclusion
supplémentaire : « Les femmes abonnées ont été
largement responsables du développement d'une culture du téléphone,
en renforçant son utilisation à des fins sociables »
(46).
(40) C'est par exemple l'explication donnée par Michèle
MARTIN.
(41) RAKOW, 1987, 297 ; cf. aussi Moyal, 1989 b. Di LEONARDO, 1984,
194 et suivantes ; ROSS, 1983. STEPHENS, 1990, entre autres.
(42) Sur la sociabilité, cf. par exemple FISCHER, et OLIKER 1983.
HOYT et BABCHUK, 1983. ? FISCHER, 1988, pour un développement
plus complet de cette argumentation.
(43) Cf. WELLMAN, 1989 ; CHERLIN et FURSTENBERG, 1986. (Les contacts
téléphoniques avec les petits enfants sont plus importants
du côté des grands-parents maternels que du côté
des grands-parents paternels, mais cette proportion ne se retrouve pas
dans les visites personnelles) ; LITWAK, 1983 (la différence
selon le sexe dans les contacts téléphoniques entre les
gens âgés et leurs aides est supérieure aux différences
selon le sexe dans les contacts face à face) ; SYNGE ET AL.,
1982 (si les femmes ont une fois et demie plus de chances que les hommes
de voir leurs amis face à face, elles ont deux à trois
fois plus de chances de leur téléphoner) ; WILL- MOTT,
1987, 28-29 (si les femmes écrivent à leurs parents et
à leurs amis plus souvent que les hommes, la différence
est encore plus grande lorsqu'il s'agit du téléphone).
(44) Certains analystes des travaux ménagers estiment que toute
modification qui rend un rôle caractéristiquement féminin
plus facile à accomplir donne aux femmes plus de capacités,
de bonne volonté et d'obligation à poursuivre ce rôle.
Cf. par exemple McGAW, 1982, et ROTHSCHILD, 1983. Pour un traitement
plus nuancé de cette argumentation, cf. COW AN, 1983. Cf. aussi
la discussion dans ? FISCHER, 1988.
(45) Lana RAKOW, qui reste sceptique quant à cette technologie,
écrit : « En dépit des pratiques sociales qui renforcent
les différences selon le sexe à l'échelle quotidienne,
nous ne pouvons ignorer le plaisir, la consolation et le compagnonnage
que beaucoup de femmes tirent du téléphone. Du fait qu'elles
sont en général moins mobiles, moins indépendantes
sur le plan financier et plus souvent isolées des autres adultes
que les hommes, beaucoup de femmes ont trouvé dans le téléphone
une ligne de vie les reliant à leurs mères, leurs sœurs
et leurs amis... Nous ne pouvons donc écarter le téléphone
en tant qu'autre source d'oppression des femmes, mais tout en reconnaissant
le rôle compliqué qu'il a eu sur le plan mouvant de l'idéologie
et de l'expérience liée au sexe » (1987,81).
(46) MOYAL 1989 b, 25 : MARTIN, 1991,171,
sommaire
La nature de la sociabilité téléphonique
Si les Américains du Nord, avant la Seconde Guerre
mondiale - et surtout les femmes - utilisaient essentiellement le téléphone
privé pour des appels sociaux, en quoi cet usage a-t-il affecté
la nature de leurs relations sociales ? Le téléphone a-t-
il par exemple remplacé les conversations face à face
? Les urbanistes aujourd'hui expriment en général cette
question, le plus souvent par rapport au monde des affaires, sous la
forme du compromis « communication/transport » : le service
du téléphone réduit-il les déplacements
individuels en permettant aux hommes d'affaires d'accomplir les mêmes
tâches par téléphone ? Ou ces appels ont-ils en
fait augmenté les déplacements en engendrant un plus grand
nombre d'affaires ? (47).
Notre intérêt est plus proche de celui des Knights of Columbus
: « Le téléphone rend-il les
hommes... paresseux ? Le téléphone brise-t-il... l'ancienne
pratique de la visite aux amis ? » Pour être plus précis,
l'adoption du téléphone entre 1890 et 1940 a-t-il conduit
les Américains à adopter une ou plusieurs des trois coutumes
suivantes : premièrement, les gens ont-ils remplacé les
visites par le téléphone, de sorte qu'au total leurs relations
sociales sont restées les mêmes mais se sont faites en
plus grande proportion par le téléphone ? Deuxièmement,
les gens ont-ils eu par téléphone des conversations qu'ils
n'auraient pas eues du tout autrement, ce qui les a conduits à
compléter par un plus grand nombre de conversations un nombre
constant de visites personnelles ? Troisièmement, les gens, stimulés
et aidés par les appels téléphoniques, ont-ils
fait plus de visites personnelles qu'ils ne l'auraient fait autrement
? (48).
La première hypothèse (remplacement des visites personnelles par les contacts téléphoniques) possède une forme faible et une forme forte. La forme faible postule que les gens sont devenus paresseux et ont commencé à appeler au téléphone leurs voisins et leurs amis au lieu d'aller les voir. D'après la forme forte, le fait d'avoir le téléphone a encouragé les gens à vivre plus loin les uns des autres. Par exemple, une fille devenue adulte pouvait s'installer en ville en laissant vivre à la ferme ses parents âgés dès qu'elle avait la possibilité de les joindre par téléphone. Les fragments de preuves dont nous disposons correspondent mieux à la première forme, la plus faible, selon laquelle les gens remplaçaient les visites par des appels téléphoniques.
(47) Cf. par exemple FALK et ABLER, 1980 « Intercommunications,
Distance and Geographical Theory » ; POOL 1977a ; SALOMON 1985.
(48) II existe une autre possibilité, logique mais peu probable
: que les appels téléphoniques aient perturbé les
relations sociales au point que la totalité des contacts (personnels
plus téléphoniques) ait diminué.
D'après les Lynd, les relations de voisinage auraient diminué à Middletown au cours de la période achevée en 1924, et le téléphone en serait en partie responsable. Plusieurs femmes qu'ils ont interrogées parlent d'une réduction du nombre de visites, soit au cours de leur vie d'adulte, soit par comparaison avec l'époque de leur mère. Deux de ces femmes attribuent cette diminution au fait d'avoir des enfants, d'autres à l'indépendance croissante des uns et des autres, ou aux clubs sociaux, mais quelques-unes font allusion au téléphone. L'une remarque : « Au lieu d'aller voir quelqu'un comme les gens en avaient l'habitude, aujourd'hui on se contente de téléphoner. » Une autre note : « Quand le téléphone est arrivé, il prenait beaucoup de temps parce qu'on était tout à coup à portée de beaucoup plus de gens, mais il a permis d'économiser tout le temps perdu jusque-là avec les femmes qui vous tombaient dessus pendant qu'on s'efforçait d'abattre le travail de la matinée » (49). Dans un contexte différent, certains observateurs estiment que le téléphone a réduit la fréquence des visites en ville des fermiers et donc leur participation à la collectivité (50).
Nos informateurs âgés de Californie du Nord établissent une image plus complexe des rapports entre appels téléphoniques et visites. Plusieurs nous ont dit qu'au début du XXe siècle le téléphone a remplacé les visites impromptues. Une femme d'An- tioch, née en 1903, et citée plus haut, affirme : « Nous ne dépendions pas du téléphone comme vous aujourd'hui... Non, on ne s'en servait pas autant, on allait voir les gens et leur rendre visite en personne. » Un homme d'Antioch rappelle à propos des années 20 « Les voisins et les amis venaient souvent faire un tour en passant à cette époque, on n'avait donc pas besoin du téléphone. » Et une autre femme d'Antioch, née en 1915, se rappelle de visites
téléphoniques entre sa famille habitant un ranch et ses grands-parents habitant la ville : « Ils s'appelaient les uns les autres. C'était plus facile à faire que de parcourir cinq milles juste pour un petit bonjour. » Ces commentaires laissent entendre que l'appel téléphonique remplaçait la conversation face à face et que, peut-être, le fait d'avoir le téléphone mit un frein aux visites personnelles (51).
D'après d'autres interviewés, le téléphone aurait permis d'augmenter le nombre total des conversations. Certains se rappellent qu'étant jeunes ils appelaient fréquemment leurs amis. (Aujourd'hui l'un des appels les plus courants est celui qu'échangent des adolescents qui viennent de se quitter à la sortie de l'école (52) exactement comme cela se passait il y a quatre-vingts ans et comme nous l'a raconté la fille du médecin de San Francisco.) De même, un certain nombre se souvenait d'avoir entendu leur mère bavarder régulièrement avec ses voisines au téléphone. Si quelques-uns de ces bavardages remplaçaient peut-être des visites, il s'agissait sans doute bien souvent de conversations qui n'auraient pas eu lieu autrement. Quelques-unes de nos interviewées ont aussi noté que leur mère se servait plus du téléphone à partir du moment où ses enfants quittaient la maison. C'est-à-dire qu'une mère pouvait ainsi parler à des enfants adultes qu'elle voyait peu souvent. La perception courante selon laquelle le téléphone aurait aidé à briser l'isolation des femmes de la campagne implique aussi que ces appels se soient ajoutés à l'ensemble des rapports sociaux. De plus, beaucoup d'appels longue distance sont certainement des conversations qui n'auraient pas eu lieu sans le téléphone.
(49) LYND et LYND 1929, 273-75, citations extraites
de la page 275.
(50) ATWOOD, 1984, 360-61. De même, Michèle MARTIN suggère
qu'en élargissant les contextes sociaux des femmes à la
maison, le téléphone « pouvait avoir réduit
les possibilités de sociabilité hors de la maison offertes
aux femmes ». (MARTIN, 1991, 165).
(51) On pourrait aussi affirmer que des raisons extérieures (par
exemple plus d'engagements professionnels) conduisirent les gens à
réduire leurs visites personnelles et à les remplacer
par le téléphone. L'appel téléphonique aurait
donc été la réaction à la réduction
des visites, et non sa cause. Une telle affirmation serait difficile
à démontrer.
(52) MAYER, 1977, 234.
Enfin, les souvenirs d'utilisation du téléphone pour organiser des rendez-vous, des rencontres ou des voyages suggèrent que le téléphone pouvait faciliter les rencontres personnelles, même s'il n'en était pas la source. Ces gens auraient probablement trouvé d'autres moyens de s'organiser, mais, sans le téléphone, beaucoup de rencontres n'auraient sans doute pas eu lieu. Dans le même ordre d'idées, une femme de San Rafael née en 1907 a fait le commentaire suivant : comme tout le monde savait conduire, il fallait passer un coup de fil pour être sûr de rencontrer chez elles les personnes que l'on allait voir.
Les trois types de rapports entre appels téléphoniques
et visites semblent être apparus au cours de la période
qui nous intéresse.
Les visites par téléphone se sont substituées à
certaines visites personnelles ; les gens faisaient ou recevaient des
appels alors qu'ils n'auraient pas pu ou n'auraient pas voulu rencontrer
leurs interlocuteurs en personne ; et ils utilisaient le téléphone
pour organiser des rencontres. Nous ne pouvons mesurer à partir
de ces récits le volume relatif de chacun de ces trois changements,
mais le bilan ferait apparaître une constance ou une augmentation
du nombre total des contacts.
Les recherches récentes ont permis d'évaluer la situation respective des communications et des transports dans les interactions personnelles. Quelques études font apparaître une substitution croisée du téléphone et des visites. Par exemple, dans l'enquête auprès des abonnés de New York ayant été temporairement privés de téléphone en 1975, 34 % indiquent des visites plus fréquentes pendant cette interruption. Après l'effondrement d'un pont entre deux parties de la ville de Hobart, en Tasmánie, les appels téléphoniques ont augmenté (53). Mais dans d'autres études effectuées aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Chili, les abonnés au téléphone annoncent un plus grand nombre total de contacts sociaux que ceux qui ne l'ont pas ; les abonnés font des visites et écrivent des lettres plus souvent que les non- abonnés. Ces corrélations confirment l'hypothèse selon laquelle l'utilisation du téléphone multiplie toutes les formes de contacts (54).
Le téléphone a-t-il donc « détruit... la vieille habitude des visites » ? C'est une conclusion trop forte. L'utilisation du téléphone a sans doute apporté une modification modérée des pratiques de visite au cours de la première moitié du siècle. Les gens ont abandonné certaines visites qu'ils auraient faites et en particulier les visites impromptues. L'habitude, pratiquée dans une certaine élite, de « faire des visites », carte en main, à des jours et heures précis où l'on restait chez soi était sans doute en déclin de toute façon. Les utilisateurs du téléphone ont modifié le caractère des autres visites en téléphonant pour arranger et confirmer leurs rendez-vous. Enfin, il est probable que les gens ont pris l'habitude d'utiliser le téléphone pour des choses qu'ils n'auraient pas faites, en particulier prendre rendez-vous dans des lieux publics. Le téléphone a donc eu un effet peut-être limité sur les visites mais il a surtout apporté une grande différence dans les possibilités d'organiser des rendez- vous hors de chez soi. De plus, les différents types de populations ont réagi de manières diverses. Nous ne saurons jamais si le nombre total des conversations face à face avec des gens extérieurs à la maison a diminué à cause du téléphone, mais il est beaucoup plus probable que le volume total des conversations d'ordre social ait connu une augmentation notable. Le téléphone fut probablement à l'origine d'une augmentation de tous les types de conversations.
(53) WURTZEL et TURNER (voir dans ce numéro),
1987, 254 ; LEE, 1980. William MICHELSON a constaté lors d'une
enquête effectuée à Toronto que les gens ont tendance
à téléphoner plus souvent pendant l'hiver qu'au
printemps, sans doute parce qu'ils utilisent le téléphone
pour éviter de se déplacer par temps froid (MICHEL- SON,
1971).
(54) Les études britanniques et chiliennes font apparaître
que les gens ayant le téléphone ou l'utilisant plus ont
un plus grand nombre de contacts de toutes sortes (Grande-Bretagne :
CLARK et UNWIN, 1981, et C. MILLER, 1980 ; Chili : WELLENIUS, 1977 et
1978). L'étude effectuée aux Etats-Unis a permis de constater
que les gens qui passent des appels longue distance écrivent
aussi plus souvent et rendent plus souvent visite à leurs correspondants
lointains (rapporté dans MAHAN, 1979). Ces études doivent
évidemment être prises avec une certaine prudence, la corrélation
entre le téléphone et les autres formes de contacts pouvant
être due à des traits de personnalité. Mais Barry
WELLMAN, dans ses données sur le Canada, fait apparaître
une association partielle forte et positive entre le téléphone
et les contacts face à face, les autres types de relations restant
constants (WELLMAN, 1989, tableau 8). Dans l'étude effectuée
auprès des grands-parents, ceux qui appellent le plus souvent
font aussi plus de visites, ce qui suggère une synergie entre
les deux modes de contact (CHERLIN et FURSTENBERG, 1986, 1 15-116).
Quelques-unes des preuves nous orientent toutefois vers la version forte de l'argument de substitution, selon lequel la disponibilité du téléphone aurait, au cours des ans, encouragé les gens à vivre plus loin les uns des autres, avec une transformation obligatoire des relations face à face en relations téléphoniques, présumées plus faibles. Tel est par exemple le reproche exprimé par le sociologue Ron Westrum : les techniques de communication « autorisent la destruction de la collectivité car elles encouragent... les relations à distance » (55). Nous n'avons aucune preuve que le téléphone ait encouragé la séparation (la mobilité résidentielle aux Etats-Unis a en fait diminué depuis cent et quelques années) (56). Aucun de nos interviewés n'a indiqué une telle tendance, mais peut-être n'y ont-ils pas pensé. Nos preuves n'apportent non plus aucun éclaircissement sur l'hypothèse opposée, selon laquelle les gens se seraient éloignés pour d'autres raisons, par exemple la recherche d'emploi, le téléphone permettant le maintien de relations qui, sans lui, auraient disparu.
Quoi qu'il en soit, l'hypothèse selon laquelle une bonne part des rencontres face à face sont devenues téléphoniques conduit à craindre que ce type de relation manque de profondeur sur le plan émotif. Même un publicitaire travaillant pour une compagnie de téléphone n'oserait affirmer que l'appel téléphonique apporte autant d'intimité que le contact visuel ou physique, ou qu'une amitié par téléphone peut être aussi profonde que lorsqu'on partage des repas, des promenades, ou que l'on est simplement côte à côte. Mais il ne s'agit pas de savoir si une conversation téléphonique est aussi riche qu'une conversation face à face : ce n'est probablement pas le cas (57). Il s'agit de savoir si le téléphone permet d'entretenir des relations ou n'apporte qu'une intimité « inauthentique » ? Malcolm Willey et Stuart Rice, analystes pleins de sang- froid, s'inquiètent de voir les contacts sociaux devenir brefs et impersonnels (sous l'effet du téléphone et de l'automobile) et estiment que cela entraîne une perte « de ces valeurs inhérentes aux discussions personnelles plus intimes, prolongées à loisir » (58).
Quelle que soit l'importance de ce problème, nous ne sommes pas en mesure de le résoudre directement avec les preuves disponibles. Les études récentes montrent que les gens disent se trouver « plus proches » des amis et parents qui vivent à plus grande distance que de leurs relations proches, même lorsqu'ils les voient régulièrement. Si chacun dépend des personnes qui se trouvent à proximité pour un certain type de sociabilité et d'assistance pratique, on s'adresse aussi souvent aux parents et amis lointains pour obtenir une assistance émotive et pratique dans les moments critiques. Finalement, les Américains disent qu'ils préfèrent une certaine distance entre eux et leurs amis (59).
Les principaux critiques affirment cependant que, même si les gens estiment avoir des relations intimes honnêtes et profondes, ils ne se rendent pas compte que les rapports établis par téléphone manquent de telles qualités et sont « inauthentiques ». Il est donc impossible de résoudre cette question à partir des témoignages personnels. Et pourtant, nous ne disposons pas de grand-chose d'autre. Lana Rakow conclut de ses entretiens : « Même pour ceux qui utilisent le téléphone pour le compagnonnage et la conversation, il n'est pas toujours considéré comme un remplacement approprié du bavardage face à face. » La formule « pas toujours » implique que ses répondants le considèrent habituellement comme approprié. A l'occasion d'une enquête effectuée au Canada auprès d'utilisateurs du téléphone d'âge moyen ou avancé, environ les deux tiers des plus de cinquante-cinq ans ont été tout à fait d'accord avec la formule : « J'ai le sentiment que je n'ai qu'à soulever le combiné pour me trouver au milieu de ma famille. » Parmi le groupe de cinquante-quatre ans et moins, 55 % des femmes mais 37 % seulement des hommes étaient du même avis. Les personnes interrogées en Australie par Ann Moyal estiment que « le téléphone joue un role clé et continu dans la construction des relations amicales et familiales (60) ».
(55) WESTRUM, 1991.
(56) Les Américains de la moitié ou de la fin du XXe siècle
changent de maison moins souvent que ceux des générations
précédentes. Peut-être les déménagements
ont-ils tendance à être à plus grande distance qu'autrefois,
mais ce n'est pas certain (cf. L. LONG, 1988 ; C. FISCHER, 1991 a).
Les Américains se sont cependant éloignés de leur
travail (cf. par exemple JACKSON, 1985, annexe).
(57) Les études expérimentales indiquent que les communications
uniquement vocales sont ressenties comme plus distantes sur le plan
psychologique que les communications visuelles (RUTTER, 1987). La plupart
des répondants à l'enquête effectuée par
Synge et al., 1982, en Ontario, déclarent qu'une conversation
par téléphone est moins personnelle qu'une conversation
face à face. D'autre part, beaucoup des femmes ayant répondu
à l'enquête effectuée par MO Y AL, 1989 a, en Australie,
estiment que les conversations téléphoniques avec des
amis sont plus franches et plus intimes que les conversations face à
face.
(58) WILLEY et RICE, 1933, 202. Ils sont nombreux, ceux qui affirment
que le téléphone est source d'aliénation et d'inauthenticité.
L'historienne Susan STRASSER, par exemple, affirme : « La société
américaine du XIXe siècle, au moins aussi mobile que celle
d'aujourd'hui, ne disposait pas d'une telle technologie (le téléphone)
; bien des gens déménageaient à des milliers de
kilomètres sans imaginer qu'ils pourraient un jour voir ou entendre
à nouveau leurs amis et leurs parents. Quand ils atteignaient
leur nouvelle résidence, ils liaient gratuitement des relations
nouvelles, au fil des jours ; les femmes, en mettant leur linge à
sécher dans leur jardin, faisaient connaissance avec leurs voisines,
qui comblaient certains des besoins auxquels le téléphone
répond si mal » (1982, 305).
(59) Sur la distance entre les gens et le sentiment de
rapprochement, cf. FISCHER et al., 1977, chapitre 9 ; ? FISCHER, 1982
b, chapitre 13 ; C. FISCHER, 1982 a ; WELLMAN, 1979. A l'occasion d'une
petite enquête effectuée en Californie du Nord, les gens
ont répondu en général qu'ils n'aimeraient pas
que leurs amis vivent à la porte à côté,
mais préfèrent les savoir à portée de voiture
(SILVERMAN, 1981).
(60) RAKOW 1987, 159 ; SYNGE et al., 1982 ; MOYAL, 1989a, 284 et 1989b.
Pour évaluer la qualité des relations sociales voici plus d'un demi-siècle, il faut s'appuyer sur les témoignages personnels plus encore que ne l'ont fait les études récentes. Nos interviewés n'ont jamais firmé qu'ils avaient jugé les relations téléphoniques insatisfaisantes dans les années 20 et 30. Certains critiquaient l'excès de bavardages inutiles au téléphone, mais aucun n'a critiqué l'authenticité des relations téléphoniques (il est vrai toutefois que nous n'avons pas approfondi avec eux cette question particulière). C'est là un problème qui attend des recherches plus subtiles.
Enfin, que dire des inconvénients d'un excès de sociabilité - une maison submergée d'appels téléphoniques ou le fait que n'importe qui puisse entendre vos conversations ? Les gens très occupés, les journalistes et, dans ses dernières années, Alexander Graham Bell lui-même, se plaignent d'être dérangés par le téléphone. Lillian Gilbreth, experte en efficacité ménagère, encourage les femmes à organiser leur vie pour éviter les appels téléphoniques ou vivre autour d'eux. (61) Toutefois, les gens ordinaires semblaient avoir peu de reproches de ce genre à exprimer pour les années couvertes par cette étude. Quelques femmes ont dit à Lana Rakow qu'elles se trouvaient obligées d'écouter les problèmes d'autres femmes parce qu'elles étaient atteignables par téléphone. Une femme de Middletown citée plus haut a raconté que les gens s'adressaient à elle parce qu'elle était disponible (mais elle a aussi déclaré que cette interruption valait mieux qu'une visite impromptue) (62), mais les récriminations sur de telles intrusions ne sont pas apparues dans les souvenirs généraux sur les premiers emplois du téléphone, cités précédemment, ou dans nos propres entretiens. Les appels non désirés ne posaient pas non plus beaucoup de problèmes aux spécialistes des bonnes manières ; ils s'inquiétaient plus d'un « bavardage » excessif lors d'appels désirés (le souci provoqué par les appels non désirés pourrait évidemment être plus fort aujourd'hui).
Les indiscrétions, par ailleurs, étaient une source d'inquiétude fréquente, surtout sur les lignes rurales. Dès le début du téléphone, les utilisateurs exprimèrent le souci d'être entendus, d'abord et tout simplement par les autres personnes présentes dans la même pièce, car il fallait parler fort, mais aussi par les opérateurs ou les autres abonnés d'une ligne partagée (63). Plusieurs femmes d'agriculteurs de l'Indiana se rappellent joyeusement comment elles écoutaient sur les lignes des fermes : « J'étais aussi indiscrète que tout le monde mais j'apprenais des tas de choses », dit l'une. Une autre commente : « C'est vrai, nous faisions des visites par téléphone et puis nous écoutions les conversations des autres. C'était très amusant. Tout le monde savait ce qui se passait et ce que tous les voisins faisaient. » Une des non-répondantes se rappelle que sa tante, opératrice du standard local, écoutait « toutes les conversations ». Une autre relate, par manière de plaisanterie, que, si sa famille n'appelait pas beaucoup, elle utilisait énormément le téléphone pour écouter les autres.
L'indiscrétion sur les lignes rurales provoqua
beaucoup de tapage. Ce fut sans doute l'un des éléments
majeurs dans le cas le plus spectaculaire de controverse suscitée
par le téléphone : la décision des amish de Pennsylvanie
de refuser cet appareil. D'après un récit :
« ... Ensuite, deux femmes se mirent à
bavarder d'une autre par téléphone et celle-ci avait aussi
son appareil décroché et posé, elle entendait tout
ce que les autres disaient, cela fit un beau tapage et vint jusqu'à
l'église pour que l'affaire soit éclaircie, alors les
évêques et les pasteurs décidèrent, s'il
doit être utilisé de cette façon, nous préférons
ne pas l'avoir » (64).
Nous pouvons dire en résumé que les Américains du début du XXe siècle n'utilisaient pas le téléphone pour recréer le système de relations personnelles du temps de l'innocence, en dépit des convictions de Marshall McLuhan, des réformateurs de la vie rurale, et des rédacteurs de publicité de AT&T. Toutefois, l'adoption du téléphone encouragea sans doute les gens à avoir des conversations personnelles plus fréquentes avec leurs amis et leurs familles qu'ils n'en avaient l'habitude jusque-là, même si cela conduisit à écourter certaines visites. Entretenir des relations personnelles par téléphone était sans doute chose rare avant le début du XXe siècle, mais devint courant dans les classes moyennes et dans les populations agricoles à partir de 1910 ou 1920. Ce genre de conversation prit une ampleur énorme après le milieu du siècle, époque où le téléphone devint presque universel. Aujourd'hui encore, certains Américains, et en particulier les hommes, ne sont pas devenus des familiers du téléphone et l'utilisent rarement pour bavarder. Sans doute une petite proportion haïssait-elle le téléphone dans ses débuts : c'est peut-être encore le cas pour certains aujourd'hui.
Les femmes des classes moyennes et les fermières entretenaient plus souvent des relations par téléphone ; c'est probablement pour elles que cette technologie représenta la plus grande transformation de leur existence. (Les femmes des classes laborieuses habitant les villes ne faisaient pas à cette époque partie des gros usagers du téléphone et nous connaissons peu de choses sur la manière dont elles l'utilisaient.) Si une conversation téléphonique ne remplace pas une rencontre face à face, bien des gens semblent y avoir trouvé une manière satisfaisante - et parfois la seule - de rester « en contact ». L'authenticité des relations fondées sur le téléphone est beaucoup plus difficile à évaluer, mais affirmer son authenticité n'est pour l'instant qu'une hypothèse, hypothèse que la plupart des usagers ne font d'ailleurs pas. Sous un angle plus large, nous ne disposons pas des preuves nécessaires pour juger si les gens, conscients de l'utilité du téléphone pour maintenir une certaine proximité-sociale, ont de ce fait choisi de mettre une distance physique entre eux-mêmes et leur famille et leurs amis.
(61) Kenneth HALTMAN cite plusieurs articles du New
York Times dont les auteurs se plaignent de l'intrusion du téléphone,
et un autre daté de 1922 révélant que BELL lui-même
ne voulut jamais avoir le téléphone dans son bureau (HALTMAN,
1990, 343 ; GILBRETH, 1927, 79-81).
(62) RAKOW, 1987, 175 ; LYND et LYND, 1929, 275 n.
(63) Cf. KATZ 1988 ; MARTIN, 1987, 128, 279, 370, 380.
(64) Récit de première main cité par UMBLE, 1989.
Un certain nombre de technologies domestiques se répandirent dans les foyers américains au XXe siècle. Ralentis en partie par la Grande Dépression, le téléphone et l'automobile n'ont pas connu une diffusion aussi rapide que les appareils électriques et électroniques.
sommaire
La psychologie du téléphone
Quelles sont les conséquences psychologiques du téléphone ?
Certains analystes affirment qu'il fait naître
un sentiment de pouvoir - comme l'affirme AT&T (65) - ou d'aliénation,
ou même de sexualité infantile. Les caractères psychologiques
du téléphone ont changé au fil de l'histoire. D'après
John Brooks, les auteurs littéraires et de théâtre
utilisaient le téléphone comme symbole de sophistication
et d'émerveillement avant la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite
comme symbole de menace, de violence et d'impuissance (par exemple,
un téléphone posé sur la scène, comme un
fusil, exposé au premier acte se déclenche avant le rideau
final) (66). Nous allons envisager deux thèmes psychologiques
courants avant 1940 : rapidement, le téléphone en tant
qu'emblème de modernité et ensuite, plus longuement, le
téléphone en tant que source de tension.
Etre moderne
Les publicitaires affirmaient que le téléphone indiquait et produisait une qualité psychologique de modernité. En 1905, une publicité disait aux femmes : « Etre moderne, c'est épargner son temps et ses nerfs en téléphonant ». Pour une publicité de 1909, l'affichette Bell System accrochée près des téléphones payants est
« L'enseigne de la civilisation ». Dans les publicités d'autres produits, la scène comprend souvent un téléphone pour associer ces produits à la modernité et à la puissance. D'autres gens rattachaient le téléphone à la modernité : les communautés amish et mennonite se divisèrent à propos du téléphone en partie parce qu'il menaçait de les mettre trop en contact avec le monde moderne (67).
Quelque-uns de nos interviewés ont décrit le téléphone en termes suggérant la crainte. L'homme d'Antioch cité au début de cet article indique un sentiment de ce genre. Un homme de Palo Alto, né en 1892, rappelle : « Je me souviens encore de l'installation du premier téléphone chez un voisin. Tout le monde était si anxieux de parler au téléphone. » Une femme de Palo Alto, née en 1895, nous a également dit : « Je me souviens nettement du jour où nous avons eu le téléphone. C'était quelque chose ! » Toutefois, les plus jeunes de nos interviewés et surtout ceux qui ont été élevés en ville montrent plus de nonchalance. Ils sont plus enclins à dire, comme une femme de Palo Alto née en 1909 : « J'ai l'impression qu'on a toujours eu le téléphone. » Une femme d'Antioch née en 1903 note : « Le téléphone n'était pas une affaire si merveilleuse. Ce n'était pas comme si on n'en avait jamais vu. Ils en avaient à la boutique ou chez les voisins. »
D'après nos interviewés, le téléphone
était courant, sauf peut-être dans les foyers ruraux, en
Californie du Nord, à partir de 1910. Il n'effrayait ou n'étonnait
personne et ne symbolisait rien de spécial pour les abonnés
si ce n'est peut-être une certaine aisance. D'ailleurs, les journaux
locaux cessèrent vite de s'intéresser au téléphone.
A certains niveaux, la relation entre téléphone et modernité
subsista probablement, subtile et inconsciente, mais exploitable par
les publicitaires. Une cuisine avec téléphone semblait
plus moderne qu'une cuisine sans téléphone. Les preuves
dont nous disposons suggèrent cependant qu'à partir de
1910 bien peu d'Américains jugeaient le téléphone
spectaculaire.
Le téléphone connut une diffusion rapide dès l'apparition
de la concurrence en 1893, mais sa croissance se ralentit quand AT&T
reprit le contrôle après le retour de Theodore Vail en
1907. Dès 1925, l'automobile avait dépassé le téléphone
dans sa diffusion auprès des ménages américains.
(Source : United States Bureau of the Census, 1975.)
(65) Par exemple, une publicité de 1909 intitulée
« The Sixth Sense - the Power of Personal Projection » (Le
sixième sens - le pouvoir de projection personnelle) explique
aux hommes d'affaires que le téléphone « prolonge
votre personnalité jusqu'à ses limites extrêmes
». Une autre, la même année, dit : « Si n'importe
quel homme dans l'Union fait sonner sur son bureau son téléphone
BELL, n'importe quel autre homme, à la plus grande distance possible,
est instantanément à ses ordres. » (Collection Ayer,
National Museum of American History).
(66) BROOKS, 1977 ; cf. aussi WISENER, 1984.
(67) Annonce extraite de « Advertising and Publicity 1906-1910,
Folder I », Box 13-17, AT et THA. Le téléphone en
tant que symbole de la publicité : MARCHAND, 1985, 169, 190,
209, 238-47 ; les mennonites : AT- WOOD, 1984, 326-47 et UMBLE, 1989.
Cf. aussi ATWOOD 1984, 83, sur la manière dont la compagnie des
téléphones de l'Iowa utilisait le thème de la modernité
dans sa stratégie de vente.
Rythme, tension et anxiété
Le téléphone, comme le notent certains observateurs, accéléra le rythme de vie, obligea les gens à être en alerte et suscita de ce fait un sentiment durable de tension. En 1919, un journaliste britannique déclare : « L'utilisation du téléphone laisse peu de place à la réflexion, n'améliore pas le caractère, et engendre une fébrilité qui n'est pas favorable au bonheur domestique et au confort. » Un auteur financé par AT&T écrit en 1910 que le téléphone fait la vie « plus tendue, alerte, vivante. » En 1976, dans son histoire de AT&T, John Brooks affirme que les premiers téléphones « créaient une nouvelle habitude d'esprit - l'habitude d'être tendu et en alerte, de demander et d'attendre des résultats immédiats, que ce soient en affaires, en amour ou dans les autres formes de relations sociales » (68). Ces jugements correspondent à une réalité intuitive (et seront approuvés avec emphase par les personnes occupées qui se sentent débordées par les appels téléphoniques). Si les gens deviennent anxieux lorsqu'ils sont impatients que leur correspondant réponde à leur appel, ou sont constamment sur les nerfs parce que leur téléphone peut sonner à tout moment, ils sont probablement plus tendus qu'ils ne le seraient sans téléphone. Nous sommes aujourd'hui familiarisés avec ce genre de personnes qui cherchent à se mettre en vacances de téléphone. Mais quelles preuves avons-nous pour confirmer Thypothèse que le téléphone créa une tension chez les Américains de la première moitié du siècle ?
Nous pouvons étudier les commentaires des anciens pour y trouver des expressions d'anxiété ou d'irritabilité liées au téléphone. Une femme âgée de ? Indiana rappelle que le téléphone « me faisait peur » et une autre que sa mère avait peur du téléphone car elle avait été frappée par la foudre. Deux femmes de Hoosier déclarent simplement qu'elles n'aimaient pas le téléphone et ne l'utilisaient qu'en cas de nécessité. Quelques-unes de nos répondantes expriment un certain dédain pour le téléphone - « Je ne suis pas une personne à téléphone » - mais sans que l'on puisse déterminer si cela reflète une tension. Une femme de San Rafael, née en 1902, raconte que son mari n'aimait pas le téléphone et qu'il avait horreur qu'elle-même ou ses enfants soient en train de l'utiliser quand il revenait de son travail mais, là non plus, on ne sait pas si ce déplaisir provenait de sa nervosité ou d'une autre source. Sur les trois douzaines de personnes que nous avons interviewées, seules ces quelques-unes ont fait des commentaires pouvant laisser entendre que le téléphone provoquait de l'anxiété. Pour la plupart, la tension n'est pas un élément important des souvenirs touchant au téléphone.
L'une des causes de cette tension pourrait être
la crainte de recevoir de mauvaises nouvelles. Une femme a dit à
Lana Rakow qu'au cours de la Première Guerre mondiale les gens
qui n'avaient pas reçu récemment de nouvelles de leurs
fils mobilisés en Europe avaient horreur d'entendre sonner le
téléphone. Une enquête AT&T a constaté
que les gens âgés trouvent désagréable la
sonnerie du téléphone car ils craignent qu'elle ne leur
apporte de mauvaises nouvelles. Pourtant, dans la même étude,
des gens d'âge moyen et les jeunes jugent cette sonnerie stimulante
car elle « promet de mettre fin à l'ennui » (69).
Il semble que les comptes rendus expriment plus souvent des commentaires
de cette sorte. Une femme de ? Indiana déclare : « Nous
en étions très amateurs ; il nous amusait beaucoup. »
Une autre dit en écho : « Nous adorions le téléphone
» (70). Quelques-unes de nos interviewées élevées
dans des fermes appréciaient dans le téléphone
un sentiment de sécurité accru. Un homme d'Antioch, né
en 1911, s'extasie :
« On pouvait s'appeler d'un ranch à
l'autre et obtenir le service téléphonique en ville. J'en
étais stupéfait. Mon père ouvrait le téléphone
et me le faisait regarder. Il ouvrait la boîte pour mémoriser
les couleurs - des couleurs magnifiques - qui identifiaient les circuits.
Et il essayait de me l'expliquer. »
Pourcentage de foyers ayant le téléphone,
1902-1940.
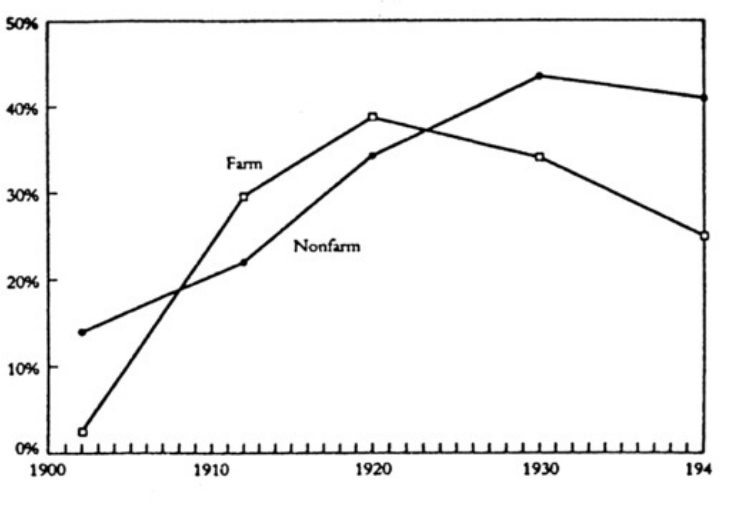
L'histoire particulière du téléphone
dans les fermes aux Etats-Unis se traduit ici par une croissance relativement
rapide jusqu'en 1920 et un déclin rapide ensuite.
Ces commentaires positifs sont nettement plus nombreux que ceux qui expriment de l'anxiété.
L'une des rares études systématiques effectuées
dans les années 30 s'est attachée à étudier
les sentiments exprimés à l'égard de trois formes
de communications. Une société d'étude de marché,
dont on ne connaît pas la source de financement, a interrogé
200 hommes et femmes de quatre villes américaines. Les enquêteurs
ont d'abord demandé aux interviewés ce qu'ils pensaient
que les gens en général éprouvaient, et ce qu'eux-mêmes
ressentaient à l'égard des télégrammes,
du téléphone et des lettres (les réponses à
la question générale et à la question personnelle
étaient les mêmes). La question clé était
: « Sans tenir compte de frais ou du temps, pensez-vous que certaines
personnes soient légèrement mal à l'aise ou hésitent
d'une manière quelconque à... (La liste ci-dessous donne
les pourcentages de réponses affirmatives :)
- Faire un appel téléphonique 33
%
- Recevoir un appel téléphonique 33 %
- Envoyer un télégramme 42 %
- Recevoir un télégramme 62 %
- Ecrire des lettres 70 %
- Recevoir des lettres 8 %
Sur les 66 personnes ayant exprimé un certain malaise quand il s'agissait de faire des appels téléphoniques, près de la moitié se plaignent qu'il soit difficile d'entendre ou de se faire entendre, ou encore d'autres problèmes de services tels que la difficulté à atteindre les interlocuteurs ; 28 % sont intimidés ou ne savent pas quoi dire et 15 % trouvent que l'appel est une perte de temps car les gens parlent trop. Sur les 66 personnes qui se sont dites mal à l'aise de recevoir un appel téléphonique, plusieurs se sont plaintes de mal entendre, plusieurs étaient intimidées quand il s'agissait de parler au téléphone et 38 ont déclaré que c'est « une perte de temps, ennuyeux, dérangeant » (le rapport a regroupé ces trois derniers commentaires). D'après la meilleure estimation, mois de 20 % des 200 personnes interrogées ont exprimé une anxiété à propos de l'utilisation du téléphone. Si l'on y ajoute les intimidés, c'est peut-être 25 %, ou plus, qui expriment une certaine tension à propos de l'usage du téléphone (71). Par contre, la plupart des gens n'aiment pas recevoir des télégrammes parce qu'ils craignent des mauvaises nouvelles ; beaucoup ont horreur d'envoyer des télégrammes pour ne pas faire peur à leur destinataire ; et la plupart détestent écrire des lettres en raison du temps et de l'effort nécessaires ou parce qu'ils ne savent pas bien s'exprimer. Bien peu objectent à recevoir des lettres. Lorsqu'on leur demande leur mode de communication préféré, les répondants classent l'appel téléphonique en premier et l'écriture d'une lettre en dernier (notons toutefois que cette enquête a été effectuée vers la fin de notre période d'étude et peut donc refléter une familiarisation tardive avec le téléphone (72).
(68) Chamber's Journal, 1989 : CASSON, 1910, 231
; BROOKS, 1976, 117-18 ; cf. aussi S. KERN, 1976, 91.
(69) Indiana : E. ARNOLD, 1985, 146-53 ; RAKOW, 1987, 231 ; AT&T
: MAYER, 1977, 232. On ne peut déterminer si les gens plus âgés
expriment plus de nervosité à propos du téléphone
parce que le téléphone était nouveau dans leur
jeunesse ou en raison de leur âge, un plus grand nombre de leurs
amis pouvant être malades, par exemple.
(70) E. ARNOLD, 1985, 146-47.
(71) Je prends pour hypothèse que les plaintes sur la qualité
du son, les opérateurs, le bavardage intempestif des autres,
si elles expriment l'irritation, ne démontrent pas le genre d'anxiété
émotive qui est l'objet de cette discussion.
(72) SALES Management 1937.
Nous pouvons aussi envisager quelques enquêtes récentes, mais avec certaines réserves en raison de l'évolution probable des réactions au téléphone, à mesure que cette technologie est devenue plus courante cette technologie est devenue plus courante. Nous avons déjà parlé de l'enquête AT & T au cours de laquelle les interviewés jeunes et d'âge moyen ont déclaré que la sonnerie du téléphone était stimulante.
Evaluation des coûts du téléphone
et de l'automobile en pourcentage du salaire d'un ouvrier
dans l'industrie.
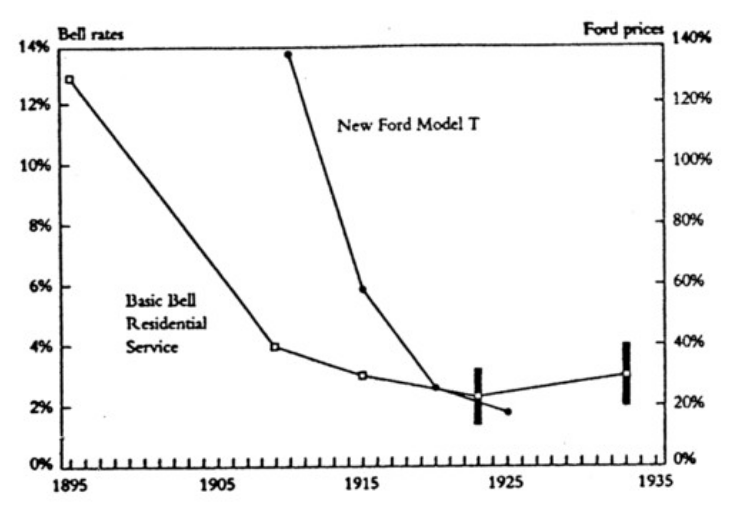
Après 1915, le coût des abonnements
téléphoniques s'est stabilisé mais les coûts
liés à la propriété d'une automobile ont
continué de baisser nettement. C'est au cours de cette période
que les Américains des classes ouvrières ont eu plutôt
tendance à acheter une voiture qu'à s'abonner au téléphone.
Benjamin Singer a demandé à 138 résidents de London (Ontario) comment ils réagissaient quand le téléphone sonne à l'heure du repas. 44 % déclarent que cela leur est égal, 15 % sont un peu agacés, et 9 % se mettent en colère. Pour les appels qui les dérangent devant la télévision, moins de 10 % annoncent de l'irritation. Pour en revenir à ce que nous avons dit plus haut, c'est un nombre beaucoup plus important, 30 % des répondants, qui expriment des objections à propos des visites inattendues. Les appels au milieu de la nuit, toutefois, en dérangent ou en mettent en colère 63 %. A la question sur les inconvénients du téléphone, environ la moitié signalent les interruptions ou les appels indésirables. D'une manière générale, même si le dérangement et les appels à un mauvais moment sont considérés comme des problèmes, nos répondants n'ont exprimé qu'une irritation modérée à ce propos (73).
Nous pouvons à nouveau consulter les entretiens effectués à Manhattan avec 190 personnes ayant été privées de téléphone pendant trois semaines en 1975. La grande majorité déclarent s'être senties mal à l'aise, isolées, impuissantes et frustrées. Pourtant, près de la moitié affirment que « la vie était moins agitée ». Une minorité substantielle, par conséquent, estime qu'avoir le téléphone rend la vie plus agitée et en même temps renforce leur maîtrise sur leur existence. (Chose ironique, après avoir rapporté ces constatations, les auteurs concluent que, « s'il peut réduire la solitude et le malaise, la contribution probable (du téléphone) au malaise de la personnalisation urbaine ne doit pas être sous-estimée » - sans apporter aucune preuve à l'appui pour démontrer ce qu'est « le malaise de la dépersonnalisation urbaine) (74).
Nous pouvons combiner ces éléments en
quelques essais de conclusion.
La plupart des gens considèrent le téléphone comme
un accélérateur de la vie sociale, ce qui est un autre
moyen de dire que le téléphone rompt l'isolement et augmente
les contacts sociaux. Une minorité estime que le téléphone
sert trop bien cette fonction. Ce sont ceux qui se plaignent de trop
de potins, d'appels non désirés, ou, comme certains patriarches,
de ce que leurs femmes et leurs enfants bavardent trop. La plupart ont
sans doute le sentiment que la sonnerie du téléphone,
en dehors du fait qu'elle interrompt leurs activités (comme le
feraient des visiteurs), peut aussi apporter de mauvaises nouvelles
ou des requêtes ennuyeuses. Pourtant, très peu semblent
être constamment en alerte, l'oreille tendue vers le téléphone
- le même nombre sans doute que ceux qui attendraient dans l'anxiété
que l'on frappe à la porte. Certains Américains non seulement
n'aiment pas parler au téléphone, mais estiment la présence
même de l'appareil perturbante : pourtant, ce n'est apparemment
qu'une petite minorité (75). Peut-être quelques personnes
parmi les plus âgées éprouvent-elles une anxiété
à propos du téléphone, mais la plupart des gens
- d'après nos entretiens, la quasi-totalité des personnes
nées depuis le début du siècle - semblent y trouver
un confort ou même du plaisir. (Un chercheur australien a suggéré
qu'un appel téléphonique renforce aussi ? amour-propre
de celui qui le reçoit ; il montre que quelqu'un se soucie de
vous) (76). Le sociologue Sidney Aronson a sans doute exprimé
le sentiment de la plupart des Américains en suggérant
que le téléphone débouche, au total, sur «
une réduction de la solitude et de l'anxiété, un
sentiment accru de sécurité psychologique et même
physique (77). Dans son livre When Old Technologies Were New, Carolyn
Marvin raconte avec quelle admiration certaines personnes du XIXe siècle
considéraient les nouveaux appareils électriques, y compris
le téléphone (78). Il est possible que pendant les vingt
premières années, à l'époque où peu
d'Américains avaient un téléphone chez eux, cet
appareil ait été entouré de ce genre d'aura. A
l'époque où les automobiles étaient les jouets
des riches, pendant la première décennie du nouveau siècle,
elles étaient aussi, sans doute, chargées d'un symbolisme
considérable. Mais quand le téléphone devint courant
dans les foyers des classes moyennes - dans les années 10 et
le début des années 20, du moins en dehors des Etats du
Sud - il perdit son prestige (le manque d'intérêt des spécialistes
en sciences sociales à l'égard des études sur le
téléphone est un témoignage supplémentaire
de la disparition de ce charisme). L'automobile, quoique aussi répandue
que le téléphone vers 1920, ne devint pas si facilement
ordinaire. C'était un gros investissement, qui exigeait des soins
et une alimentation coûteux, que l'on trouvait sous des étiquettes
diverses avec une grande variété de tailles, de formes
et de couleurs - différenciation constamment soulignée
par les publicitaires - et qui servait à toutes sortes de tâches.
Pourtant, elle aussi fut rapidement considérée comme une
chose acquise par la plupart des personnes des classes moyennes. Ces
technologies, et le téléphone plus encore, perdirent très
vite leur mystique et devinrent deux outils courants de la vie privée
la plus prosaïque.
(73) MAYER, 1977, SINGER, 1981, 62-63, 26, 14-15.
(74) WURTZEL et TURNER, 1977, 253, 256.
(Voir dans ce numéro, NDLR.)
(75) Aujourd'hui peut-être, et auparavant aussi, ceux qui se plaignent
le plus d'être dérangés par les appels téléphoniques
sont ceux qui ont un horaire déjà chargé. Si nombre
d'écrivains se situent probablement dans ce groupe - comme l'auteur
de ce livre et beaucoup de ses lecteurs aussi - ils ne représentent
pas nécessairement la généralité du peuple
américain.
(76) NOBLE, 1989.
|
LA DIFFUSION DU TELEPHONE AUX ETATS-UNIS Destiné initialement au Nord urbanisé, c'est pourtant dans l'Ouest et le Middle West que le téléphone a connu sa diffusion la plus rapide. Les fermiers étaient plus disposés à s'abonner que les citadins, du moins dans les deux premières décennies du siècle, mais beaucoup abandonnèrent ensuite le téléphone. L'automobile suivit le même schéma géographique mais elle dépassa très vite le téléphone. Les fermiers achetèrent des voitures, et les conservèrent. La plupart des Américains ruraux découvrirent, demandèrent et mirent au point des services téléphoniques conçus pour eux. Tandis que les compagnies de téléphone s'efforçaient de créer le besoin chez les citadins, les familles agricoles prenaient conscience de l'utilité pratique et sociale de ce dispositif. Pour l'obtenir, elles accomplirent des efforts collectifs inhabituels. Ces usagers du téléphone n'étaient pas simplement les récepteurs passifs de manipulations commerciales (malgré les convictions des vendeurs), mais ils agirent comme agents pour eux-mêmes. C'est ainsi que l'Amérique rurale déclencha la diffusion spatiale de cette innovation. Toutefois, quand les frais de la téléphonie rurale augmentèrent après 1920 - augmentation des tarifs, perte d'intérêt des compagnies commerciales, difficultés économiques de l'époque -, beaucoup de fermiers l'abandonnèrent. Ils disposaient à présent, pour répondre à une partie des mêmes besoins, d'autres solutions que le service téléphonique souvent irritant : l'automobile et la radio, en particulier. Le téléphone à usage privé se répandit de l'élite à la classe moyenne (sauf dans les Etats du Sud) à partir de 1920, mais sa diffusion auprès de la classe ouvrière urbaine fut ralentie. En fait, les habitants des villes, même à faible revenu, utilisaient le téléphone dans les drugstores, les bars et chez leurs voisins. Mais les ménages de la classe ouvrière ne s'abonnèrent pas en aussi grand nombre qu'on aurait pu s'y attendre, alors qu'ils dépensaient parfois beaucoup plus pour d'autres biens de consommation et en particulier l'automobile. Cette dernière dépassa rapidement le téléphone dans le budget des ménages ouvriers. Le fait que le niveau de revenu ait été l'élément déterminant d'un abonnement téléphonique pour les ménages urbains américains n'a rien qui puisse surprendre. Mais on peut s'étonner que cette situation se soit maintenue presque aussi fortement pendant quarante ans. La diffusion du téléphone du haut en bas des classes sociales semble avoir stagné au cours des premières décennies du XXe siècle, contrairement à la diffusion de l'automobile : sur ce plan, les Américains des classes ouvrières comblèrent très vite l'espace qui les séparait des classes moyennes, dans les années 20. On peut proposer plusieurs explications de la diffusion relativement lente du téléphone. Certaines concernent les technologies elles-mêmes : le téléphone était peut-être un achat dont le rapport qualité-prix (et donc l'attrait) était moins grand que celui de l'automobile par exemple. Certaines concernent la commercialisation : le scepticisme de l'industrie du téléphone à propos du marché des classes ouvrières comme des agriculteurs conduisit peut-être ce secteur à manquer des possibilités de vente. Mais dans cette voie l'on aboutit à un cercle vicieux : est-ce le scepticisme de l'industrie qui retarda la diffusion, ou la mollesse des ventes qui découragea l'industrie ? On dispose probablement d'assez de preuves pour déterminer que ces deux effets entrèrent en jeu, mais il ne faut pas sous-estimer le rôle des décisions commerciales. Enfin, ces forces opéraient au sein d'une économie politique, surtout dans le domaine des subventions gouvernementales, plus favorable à la diffusion de masse de l'automobile que du téléphone. |
Dans les années 10 et 20, les Américains
utilisaient surtout leur téléphone privé à
des fins de sociabilité. Ce n'était pas totalement vrai
pour tout le monde : pour les femmes plus que
pour les nommes, pour les jeunes plus que pour les gens âgés,
pour les personnes grégaires plus que pour les timides. Quel
est le mode de communication que le téléphone remplaça
chez les Américains ?
En dehors d'une chute dans les télégrammes et les missives
livrées à la main, le téléphone réduisit
sans doute les visites impromptues. Mais, en même temps, le téléphone
facilita l'organisation des autres types de rencontres. Au total, l'appel
téléphonique déboucha probablement sur des conversations
sociales plus étendues qu'auparavant, et avec plus de monde.
Peut-être ces appels remplacèrent-ils des visites ou des
bavardages prolongés avec les membres de la famille, à
moins qu'ils n'aient simplement occupé un temps que les gens
auraient passé seuls. Quelques personnes semblent regretter la
perte de contacts face à face qu'ils attribuent au téléphone,
mais elles sont minoritaires.
L'automobile fit en fait un sort plus cruel à
la vie sociale. Les Américains riches l'utilisèrent pour
remplacer la voiture à cheval dans les deux premières
décennies du nouveau siècle. Comme les Américains
de classe moyenne et même les fermiers, ils adoptèrent
l'automobile à la place du train pour faire des voyages. A partir
de 1920, beaucoup de gens des classes moyennes urbaines avaient abandonné
le tramway au profit de l'automobile pour aller à leur travail
ou faire leurs courses en ville. Certains observateurs estiment que
la conduite automobile élimina aussi d'autres activités
telles que l'église, les veillées en famille autour du
feu et l'habitude de se courtiser sous la véranda (79).
Les preuves disponibles laissent entendre qu'avant la Seconde Guerre
mondiale les familles propriétaires de voitures faisaient cet
achat et utilisaient leur automobile surtout pour des raisons de loisirs
et de sociabilité. Ces activités ont sans aucun doute
éliminé d'autres formes de voir des amis lointains au
lieu de rendre visite à ses voisins - mais la conduite semble
avoir au total ajouté aux activités sociales.
C'est en ce sens que le téléphone comme l'automobile étaient, avant la Seconde Guerre mondiale et dans leurs usages privés, des « technologies de sociabilité » (et donc peut-être de ce fait typiquement « féminines »). Leur utilisation eut pour résultat net de renforcer l'ampleur des activités sociales et de la sorte d'accélérer la vie sociale. La plupart des gens semblent avoir accueilli favorablement cette évolution, du moins consciemment.
(77) ARONSON, Téléphone et société.
(Voir dans cette livraison de Réseaux NDLR.)
(78) MARVIN, 1989, cf. aussi NYE, 1990, sur les réactions à
d'autres aspects de l'électricité.
(79) Une étude effectuée à partir de questionnaires
budget-temps n'a pas permis aux chercheurs de trouver la preuve que
la diffusion de l'automobile - au contraire de celle de la télévision
- ait modifié de façon importante la manière dont
les gens passaient le temps (ROBINSON et CONVERSE, 1972).
|
UNE ETUDE DE LA DIFFUSION DU TELEPHONE DANS TROIS VILLE DE CALIFORNIE (80) Dans la première décennie du siècle,
le téléphone privé était un outil
de travail pour certains et une petite faiblesse pour quelques
résidents de Palo Alto, San Rafael et Antioch. Vers la
fin des années 20, le téléphone était
devenu un élément normal quoique non encore Ouniversel
de la vie des classes moyennes. Pourtant, il n'était pas
encore apparu dans beaucoup de foyers ouvriers (par contre, l'automobile
se répandait rapidement dans l'ensemble de la classe ouvrière
des Etats-Unis) (81). (80) La socio-historienne Ewa MORAWSKA relate
que les familles d'immigrants du début du XXe siècle,
en venant s'installer dans les faubourgs de Johnstown (Pennsylvanie),
s'abonnaient au téléphone pour rester en contact
avec leurs parents et leurs amis de leur ancien voisinage (communications
personnelles). Une autre explication pourrait être que les
résidents des faubourgs étaient plus souvent «
modernes » sur le plan culturel (explication suggérée
par Mark ROSE dans une communication personnelle). |
Notre thème de recherche serait plus spectaculaire si nous pouvions impliquer le téléphone dans ? apparition de certains aspects de la modernité psychologique - la rationalité, l'angoisse, l'anxiété, la déshu- manisation, etc. Les faits disponibles, indiquant que les Américains ont intégré le téléphone à leur vie quotidienne, ne semblent pas se prêter à cette exploitation. Mais il y a quelque chose de plus profond à voir les gens comme des participants actifs, assimilant dans leur existence une transformation matérielle majeure. Sans aucun doute, ces existences y ont subi des transformations, mais qui furent pour la plupart le produit conscient de l'emploi des choses par les hommes, et non pas la prise de contrôle des hommes par les choses.
Traduit de l'américain par Florence HERBULOT
sommaire