L'Afrique
Occidentale Française AOF
L'Afrique-Occidentale française était
un gouvernement général regroupant au sein d'une même
fédération huit colonies françaises d'Afrique
de l'Ouest entre 1895 et 1958.
Avant de parler des Postes Télégraphes
et Téléphones dans les anciennes colonies françaises
afrcaines, retraçons en l'historique.
1364 - Deux navires normands fondent le port de Petit-Dieppe
sur la côte de la Sierra Leone. Un commerce florissant
du poivre et de l’ivoire s’instaure.
1659 - Fondation de Saint-Louis (Sénégal).
Un comptoir pour la traite des esclaves, à l’embouchure
du fleuve Sénégal sur la côte Atlantique, est
baptisé Saint-Louis, en hommage au roi de France. Au XVIIIe
siècle, la cité compte 7 000 habitants.
1857 - Création des Tirailleurs sénégalais.
Louis Faidherbe met en place des unités d’infanterie,
au sein de l’armée coloniale, constituées de soldats
africains noirs. Elles prennent le nom du pays qui les a vu naître.
Entre 1870 et 1880, l'exploration du continent progresse. Celle-ci
est souvent conduite par des missionnaires catholiques en quête
d'évangélisation.
|
Les républicains au pouvoir à
Paris depuis 1870 voient la colonisation comme une revanche
sur la défaite de Sedan et la perte de l'Alsace-Lorraine.
La mission Congo-Nil du capitaine MarchandSous
l'égide de Jules Ferry et de ses successeurs, la République
française se lance à corps perdu dans la conquête
des dernières terres insoumises du globe (Indochine,
Afrique noire, Tunisie...), prenant même pour cela le
risque d'entrer en guerre contre l'Angleterre (Fachoda) ou l'Allemagne
(Tanger).
Au demeurant, la conquête du continent
africain se révèle peu coûteuse en dépit
de résistances locales bien réelles même
si elle donne lieu à des crimes de guerre comme ceux
de la colonne Voulet-Chanoine. Les pertes
africaines s'élèvent à plusieurs dizaines
de milliers de personnes (combats, mauvais traitements...).
Beaucoup plus nombreuses sont les victimes du travail forcé,
en particulier dans le Congo belge et en Afrique équatoriale
française.
Du fait d'une natalité insuffisante, la France ne peut
quant à elle envisager de peupler ses colonies. Elle se
contente d'offrir à ses entreprises des avantages douaniers
dans le commerce avec les colonies. Elle multiplie aussi les
infrastructures (ports, routes, voies ferrées) et pour
cela impose aux indigènes le travail forcé, une
forme de corvée inspirée de l'Ancien Régime. Il
faudra attendre 1946 pour qu'il soit aboli à l'initiative
du ministre Félix Houphouët-Boigny.
|
Dans un premier temps, les Européens restent
aux frontières de l'Afrique, sur les côtes océanes,
ne s'aventurant pas àlíintÈrieur des terres.
Ce n'est quí à partir de la fin du XIXe siécle,
qu'ils síengagent dans la conquête territoriale du continent.
Si en 1880, à peine un dixiéme du continent noir etait
sous contrôle europÈen, vingt ans plus tard, seuls l'Ethiopie,
le Maroc (conquis en 1912) et le Libéria y échappaient.
Entre-temps, les puissances
occidentales s'entendent, lors de la conférence de Berlin (1884-1884),
sur la répartition du continent.
L'Afrique coloniale
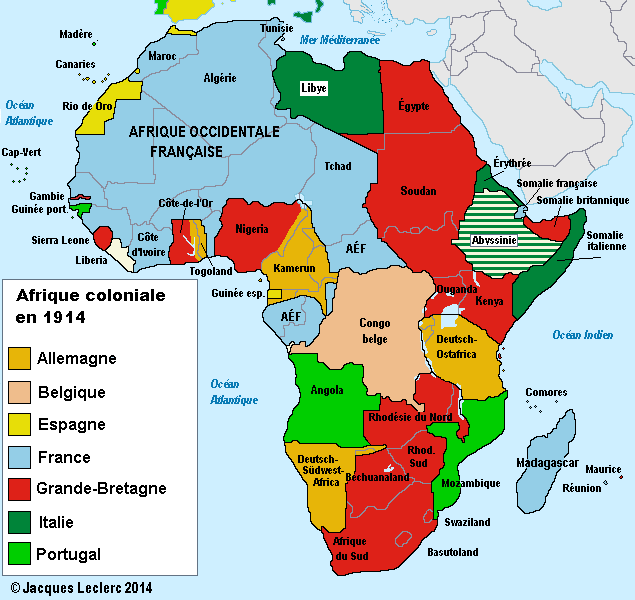
1879-1881 - A la conquête
du Congo.
Savorgnan de Brazza explore l’Afrique centrale. Il obtient la
signature du roi Makoko, qui accepte la souveraineté française
sur son royaume et l’établissement d’une mission
qui deviendra Brazzaville (actuelle capitale de la République
du Congo).
1884-1885 - Conférence de Berlin.
Le 15 novembre 1884, le chancelier allemand Bismarck ouvre à
Berlin une conférence qui doit en premier lieu régler
les oppositions à propos du Congo mais, plus largement, son
but est de régler les différents coloniaux, de jeter
les bases du partage du continent en évitant le risque de guerre
Quatorze pays européens s’entendent pour se partager l’Afrique
et fixer les règles de la colonisation.
Les signataires rappellent que la traite négrière y
est interdite et s’engagent à contribuer à son
extinction.
1894 - Naissance du ministère des Colonies
Afin de centraliser la gestion des colonies françaises, un
ministère est créé.
Au même moment, l’Ecole coloniale s’intalle rue de
l’Observatoire, à Paris, afin de former les cadres de
l’administration. Le premier ministre des Colonies, Ernest Boulanger,
nommé le 20 mars, est remplacé deux mois plus tard par
Théophile Delcassé, proche de Jules Ferry.
À sa création en 1895, l'A.O.F. ne compte que
quatre États (colonies déjà existantes) : le
Sénégal, le Soudan français (devenu
le Mali),, la Guinée française et la Côte
d'Ivoire. Elle continuera à s'étendre, et après
son extension à six États en 1904, elle regroupera huit
pays en 1922 avec l'intégration de quatre autres pays : la
Mauritanie, la Haute-Volta (devenue le Burkina Faso),
le Niger et le Dahomey (devenu le Bénin)et ses
dépendances
Son chef-lieu était Saint-Louis (Sénégal)
jusqu'en 1902, puis Dakar (Sénégal).
À son apogée en 1958 (année de
sa disparition), cette fédération de colonies françaises
de l'Afrique de l'Ouest s'étendra sur près de 4,7 millions
de km² (8 fois la métropole), constituant plus d'un tiers
de la superficie terrestre du Second Empire colonial français
(13,5 millions de km²).
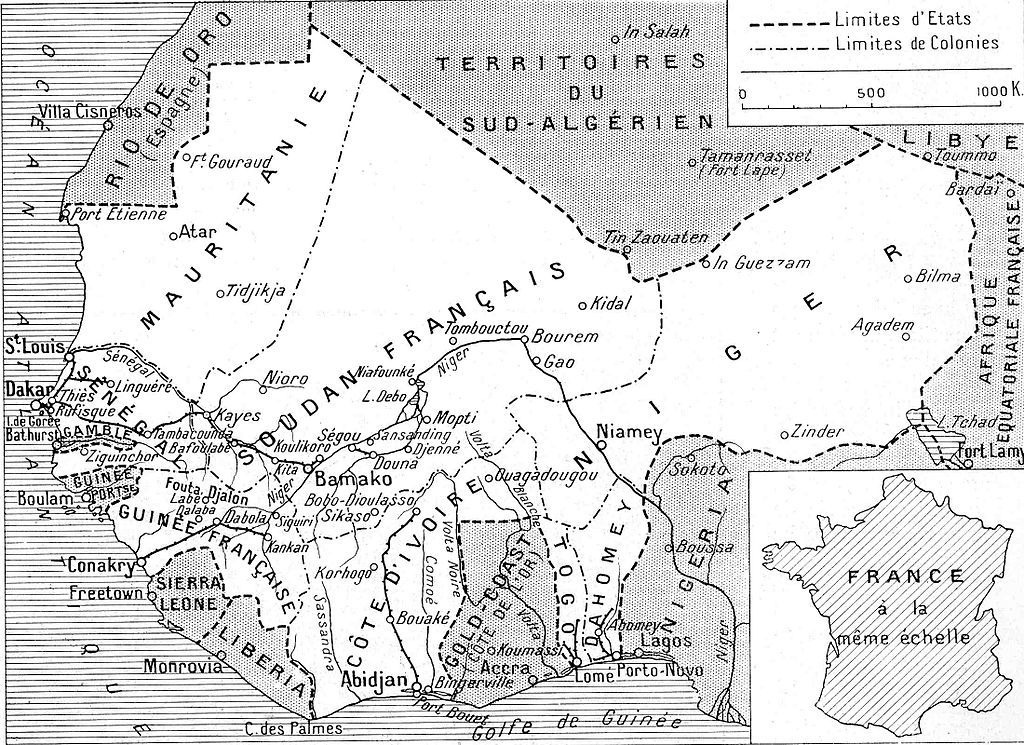 L'AOF en 1936
L'AOF en 1936
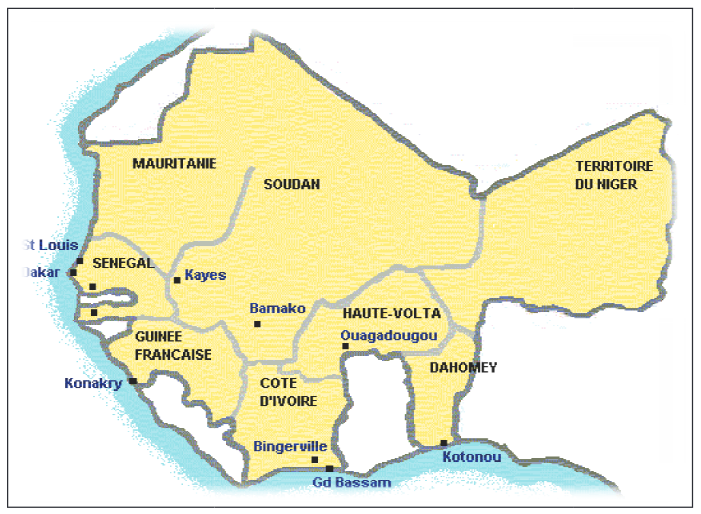
1898 - Crise de Fachoda : La «course aux drapeaux »
entre les nations européennes sur le continent africain aboutit
à un grave incident diplomatique entre la France et la Grande-Bretagne,
dans un poste avancé de l’actuel Soudan.
Puis en 1919 - Après la Première
Guerre mondiale, le Togo et le Cameroun, deux anciennes
colonies allemandes, sont désormais administrées par
la France, sous mandat de la Société des Nations
(SDN).
Cette même année, les possessions du Haut-Sénégal
sont divisées pour donner naissance à trois nouvelles
colonies, la Haute-Volta (devenu le Burkina Faso), le Niger
et le Soudan français (devenu le Mali).
1921, un recensement attribue 12 283 000 habitants
à l'Afrique-Occidentale française, sans le Togo (673 000 habitants).
1944 - Conférence de Brazzaville
Organisée par le Comité français de la Libération
nationale et le général de Gaulle, afin de déterminer
le rôle et l’avenir de l’empire français, la
réunion aboutit à la création de l’Union
française. Désormais les ressortissants de la métropole,
des colonies et des protectorats ont tous le même statut de
citoyens. Le code de l’indigénat est aboli.
1947 - Insurrection de Madagascar
Le soulèvement, accompagné de massacres de colons et
de Malgaches non-indépendantistes, est impitoyablement réprimé
par l’armée française. Le nombre exact de victimes
(entre 30 000 et 100 000 morts) de cette répression fait encore
débat.
1955 - Emeutes au Cameroun
En mai, des manifestations anticolonialistes éclatent dans
les grandes villes du pays. Ces émeutes, sévèrement
réprimées, provoquent plusieurs centaines de morts.
L’Union des populations du Cameroun (UPC), le parti indépendantiste
dirigé par Ruben Um Nyobé, est alors interdit. Ses leaders
persécutés forment une armée clandestine. En
1958, des soldats français tueront Ruben Um Nyobé réfugié
dans le maquis.
1956 - Un pas vers l’autonomie
La loi-cadre Defferre, du nom du ministre de l’Outre-mer, propose
une série de réformes destinées à amener
les territoires d’outre-mer à gérer démocratiquement
leurs propres affaires. Cette nouvelle législation crée
dans les territoires d’outre-mer des Conseils de gouvernement,
qui seront élus au suffrage universel et permettront au pouvoir
exécutif local d’être plus autonome vis-à-vis
de la métropole.
1958 - La Guinée devient indépendante
La colonie française vote non au référendum instituant
la Communauté française (une organisation politique
entre la France et les Etats de son empire colonial, alors en voie
de décolonisation, destinée à remplacer l’Union
française). Le général de Gaulle, président
de la République française, fait évacuer aussitôt
les Français présents sur place. Sékou Touré
est élu premier président de la République démocratique
de Guiné.
1960 - L’année des indépendances
Un vent de liberté souffle sur le continent : le Cameroun s’affranchit
le 1er janvier, suivi par le Togo en avril, le Soudan français
(actuel Mali), le Sénégal et Madagascar en juin. C’est
ensuite au Dahomey (actuel Bénin), au Niger, à la Haute-Volta
(actuel Burkina Faso), à la Côte d’Ivoire, au Tchad,
à la République centra fricaine, au Congo- Brazzaville
de proclammer leur indépendance. Le Gabon fait de même
en août, et la Mauritanie aussi, en novembre.
Pour comprendre en détail les diverses transformations
des frontières de l'AOF, je vous renvoie sur la thèse
de Moïse Sandouno :
"Une
histoire des frontières guinéennes (années 1880-2010)
: héritage colonial, négociation et conflictualité"
sommaire
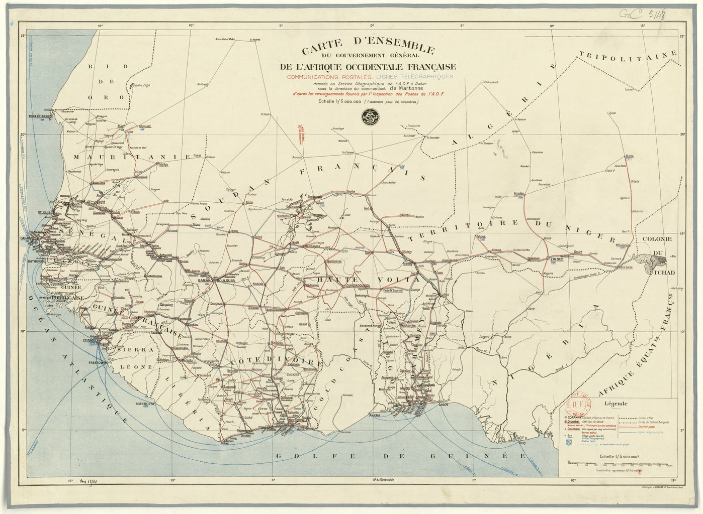
Carte d’ensemble des communications postales et des lignes télégraphiques
de l’AOF en 1923,
La télédensité en Afrique
est passée de moins de 0,5 ligne pour 100 habitants dans
les années 90 à plus de 8 lignes pour 100
habitants en fin 2003 ; l’Afrique comptait fin 2003
plus de 73 millions d’abonnés pour une population d’environ
842 millions d’habitants.
Postes Télégraphes
Téléphones des colonies Françaises Par
Sophie Dulucq
|
Nous attendons le courrier de
France ”. Communications et circulation des nouvelles en
Afrique coloniale française (XIXe-XXe siècle)
De fait, la mise en place de communications modernes dans les
empires coloniaux du XIX e siècle a contribué
à nourrir la geste coloniale, que l’on songe par
exemple aux colonisateurs néerlandais se glorifiant d’avoir
construit une grande route de poste (Grote Postweg) à
Java dans les années 1808-1811.
|
Dans un poème de 1886 à
la gloire du service des postes des Indes britanniques,
Rudyard Kipling chante les louanges des intrépides
facteurs chargés de sacs postaux, les coursiers
— véritables héros « à
la sandale légère » — bravent
les torrents en crue, effarouchent les tigres et demeurent
impavides au milieu des tempêtes.
« Au nom de l’impératrice », le
courrier acheminé par la route, the overland mail,
doit être délivré sans délai
aux quatre coins du territoire.
Si le ton de Kipling semble aujourd’hui bien suranné,
c’est que ses accents lyriques relèvent d’un
autre temps, celui des discours triomphalistes sur la
« mission civilisatrice ».
|
In the name of the Empress
of India, make way,
O Lords of the Jungle, wherever you roam.
The woods are astir at the close of the day–
We exiles are waiting for letters from Home.
Let the robber retreat –let the tiger turn tail–
In the Name of the Empress, the Overland Mail!
With a jingle of bells as the dusk gathers in,
He turns to the foot-path that heads up the hill–
The bags on his back and a cloth round his chin,
And, tucked in his waist-belt, the Post Office bill:–
“Despatched on this date, as received by the rail,
“Per runner, two bags of the Overland Mail.”
Is the torrent in spate? He must ford it or swim.
Has the rain wrecked the road? He must climb by the cliff.
Does the tempest cry halt? What are tempests to him?
The Service admits not a “but” or and “if.”
While the breath’s in his mouth, he must bear without
fail,
In the Name of the Empress, the Overland Mail.
From aloe to rose-oak, from rose-oak to fir,
From level to upland, from upland to crest,
From rice-field to rock-ridge, from rock-ridge to spur,
Fly the soft sandalled feet, strains the brawny brown
chest.
From rail to ravine –to the peak from the vale–
Up, up through the night goes the Overland Mail.
There’s a speck on the hillside, a dot on the road–
A jingle of bells on the foot-path below–
There’s a scuffle above in the monkey’s abode–
The world is awake, and the clouds are aglow.
For the great Sun himself must attend to the hail:–
“In the name of the Empress, the Overland Mail!”
Rudyard Kipling, “The Overland Mail (Foot-Service
to the Hills)”,
Departmental Ditties and Other Verses, 1886.
|
Les services postaux des colonies
françaises n’ont quant à eux jamais trouvé
leur poète et leur panégyriste.
Pour autant, comme dans le Raj ou aux Indes néerlandaises,
leur mise en place a constitué une étape majeure
dans le maillage des territoires de l’empire français
et dans la fourniture d’outils modernes de domination.
Il n’est que de feuilleter le catalogue philatélique
Yvert ou de naviguer sur les sites en ligne de collectionneurs
de timbres et de cartes postales pour exhumer quelques aspects
du passé des postes et télécommunications
dans les anciennes colonies françaises.
Cette étude propose de se concentrer d’abord sur
le cas de l’Afrique occidentale, en reconstituant les étapes
de la genèse des communications dans cet ensemble de
territoires et la création d’un personnel ad hoc.
Comme l’ont démontré la thèse récente
d’Annick Lacroi consacrée à l’administration
des postes dans l’Algérie coloniale ou les travaux
de Fanny Dufétel-Viste sur la Reichspost au Togo allemand,
l’étude des communications fournit une porte d’entrée
dans une histoire de l’État en situation coloniale
; mais elle permet également d’esquisser une histoire
des pratiques sociales et culturelles des populations concernées.
Dans cette optique, la lecture d’un article de David Edgerton
centré sur l’appropriation des nouvelles technologies
par les acteurs sociaux a été particulièrement
stimulante : en histoire des sciences et des techniques, il
faut dépasser la tentation de faire une simple état
des lieux des innovations et s’intéresser aux «
technologies en usage » (technology in use), c’est-à-dire
à l’apprivoisement ou au rejet qu’elles ont
pu susciter, à leurs situations concrètes d’utilisation,
aux éventuels détournements dont elles ont fait
l’objet — bref, il faut les resituer dans un panorama
historique complet centré sur les pratiques réelles
des utilisateurs. Roland Wenzlhuemer, dans une étude
qui retrace l’histoire du télégraphe et sa
part dans la mondialisation du XIX e siècle5 , martèle
lui aussi l’idée qu’une technologie nouvelle
ne peut être étudiée indépendamment
de ses usages, eux-mêmes façonnés par les
mobiles, les exigences et les actions des utilisateurs. D’où
l’attention qu’il convient de porter aux contextes
de développement des nouveaux moyens de communications.
L’étude de l’implantation du télégraphe
dans l’Inde britannique — qui occupe une part importante
du livre de Wenzlhuemer — met ainsi en évidence
la place des objectifs et des acteurs impériaux dans
le développement de la télégraphie et des
échanges mondiaux, ainsi que le poids respectif qu’occupaient
la Grande-Bretagne et l’Inde au XIX e siècle. L’auteur
insiste également sur les transformations culturelles
(nouveaux rapports à l’espace et au temps, autre
manière de faire circuler et de consommer l’information,
nouveaux usages linguistiques — l’invention du «
style télégraphique », par exemple) qu’induit
une nouvelle technique de communication complexe, et sur l’apparition
d’usages qui n’avaient pas nécessairement été
anticipés par ses concepteurs6 .
Dans le cadre restreint de ce texte, nous souhaitons intégrer
dans l’histoire des communications en Afrique coloniale
cette dimension attentive, autant que faire se peut, aux acteurs
: les individus qui espèrent du courrier ou en expédient
au loin ; tous ceux qui apprennent l’usage de la lettre,
du
télégraphe et du téléphone ; les
personnels des postes (piétons, facteurs, receveurs,
télégraphistes...) qui ont graduellement constitué
un groupe social important et parfois revendicatif en Afrique
française.
Le titre donné au présent article — «
Nous attendons le courrier de France »— a été
inspiré par la complainte lancinante sous la plume de
ceux qui consignaient au jour le jour leurs expériences
de vie en Afrique subsaharienne (soldats, administrateurs, voyageurs,
simples témoins) : l’attente, le poids de distance
tissent la morne trame des jours dans les provinces reculées
de l’empire. Mais un tel titre n’épuise pas
la totalité des objectifs de cette étude, qui
souhaite dépasser le seul cercle des Européens
connectés à leur hiérarchie par le télégraphe,
ou reliés à la métropole par des lettres
et par l’abonnement à quelques journaux. On aurait
ainsi pu (et peut-être dû) mettre dans la bouche
d’un commerçant sénégalais ou d’un
tirailleur voltaïque des années 1930 des phrases
sensiblement différentes : « J’attends un
mandat-poste de Dakar », « J’attends un colis
postal d’Abidjan ». Ces phrases auraient attesté
l’importance prise dans les colonies africaines par la
circulation de l’information, outil de contrôle et
de
gestion des territoires conçu dans une matrice militaro-administrative,
et d’abord à l’usage exclusif des Européens,
mais progressivement intégré par diverses catégories
de population.
sommaire
DU PIÉTON AU TÉLÉPHONISTE
: LA CONSTITUTION DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS (ANNÉES
1850 – ANNÉES 1950). L’EXEMPLE DE L'AFRIQUE
OCCIDENTALE
La mise en place précoce de la poste aux lettres
L’historiographie des empires lie étroitement mondialisation,
progrès technologique, expansion du capitalisme, interconnexion
et « médiatisation » du monde et des ensembles
impériaux8 . Les progrès des techniques de communication
ont été d’une valeur inestimable sur le plan
stratégique et administratif pour tous ceux qui avaient
besoin de contrôler des territoires reculés, des
troupes stationnées au loin ou des navires marchands
opérant à l’échelle du monde .
Le développement des communications en Afrique coloniale
française ne fait pas exception à ce schéma
et c’est sans grande surprise que l’on observe la
mise en place des premiers éléments d’un
réseau au Sénégal, dès l’époque
moderne.
Comme le soulignent des travaux déjà anciens comme
ceux de Bathj Niang, le déploiement des services postaux
en Afrique française, puis des liaisons télégraphiques,
« s’inscrit dans la logique de l’entreprise
coloniale qui vise, d’une part, à s’assurer
le contrôle militaro-administratif de territoires en cours
d’intégration dans l’empire, en vue d’y
faire régner l’ordre colonial et, d’autre part,
à faciliter les communications permettant d’en exploiter
les ressources » :
Jusqu’à l’occupation des territoires correspondant
au Sénégal contemporain par les Européens,
« il n’existe pas d’administration postale chargée
de l’acheminement du courrier. À l’échelle
des différentes concentrations humaines, l’information
est transmise par le biais de messagers à pied, voire,
pour l’annonce de certains événements, par
le biais du tambour. Sur les grandes distances, les nouvelles
ordinaires circulent par l’intermédiaire des voyageurs
et des commerçants, tandis que les pouvoirs en place
recourent à des cavaliers afin de véhiculer les
informations liées au contrôle des territoires
sur lesquels ils exercent leur souveraineté. Le premier
système moderne de communications est mis en place au
XVII E siècle durant la période précédant
la conquête coloniale.
En effet, les premières relations postales avec la France
sont établies en 1626, date à laquelle les navires
des commerçants dieppois et rouennais touchent les côtes
sénégalaises. Ce n’est qu’après
l’installation d’un représentant officiel du
roi de France, vers 1782, puis le début de l’occupation
de l’intérieur du pays, qu’un service postal
embryonnaire est créé. »
Mais c’est surtout à partir de la fin des années
1870 que le Sénégal devient la tête de pont
d’un système de communications modernes étendu
peu à peu à l’ensemble de l’Afrique
de l’Ouest. L’objectif de départ est de relier
Saint-Louis aux différents points du territoire jouant
un rôle administratif,
militaire ou économique. Le transport des missives «
repose principalement sur le courrier piéton, qui fonctionne
grâce à des porteurs convoyant des sacs de dépêches
sur des distances de trente à trente cinq kilomètres
». « Sur certains axes, le transport du courrier
est assuré par d’autres moyens tels que le chemin
de fer entre Saint-Louis et Dakar, les bateaux à vapeur
sur les voies fluviales entre Dakar et Gorée, la poste
par chameaux entre Saint-Louis et Gandiole, ainsi que le train
des équipages dont la vocation est essentiellement militaire.
Les communications avec la France, qui jouent un rôle
critique puisque c’est dans la métropole que se
prennent toutes les décisions d’importance relatives
à la colonie, sont assurées par des navires opérant
principalement à partir des ports de Bordeaux et de Marseille.
Le dénominateur commun à tous ces systèmes
de communication est leur lenteur et leur manque de fiabilité
qui font que le courrier met des jours, des semaines, voire
des mois, avant d’arriver à destination, lorsqu’il
ne se détériore pas ou ne se perd pas en cours
de route. » En 1884, différents services postaux
et télégraphiques sont fondus en un Office sénégalais
des Postes et Télégraphes ; en 1903 est créée
une Inspection des Postes et Télégraphes de l’Afrique
Occidentale Française, à
plusieurs reprises remaniée et repensée, tandis
qu’en AEF et à Madagascar, la construction des premiers
réseaux postaux s’échelonne entre les années
1890 et 1914.
sommaire
Dès le XIX e siècle, on commence à construire
des bureaux de poste, d’abord à Saint-Louis et Dakar
et dans les principales villes côtières —
Abidjan, Cotonou, etc. —, mais aussi, peu à peu,
vers l’intérieur du continent . Les constructions
de bâtiments des PTT se multiplient, bâtiments parfois
magnifiques dans les grandes villes, comme en attestent de nombreuses
cartes postales anciennes ou la photographie ci-dessous prise
en 1948, représentant l’hôtel des Postes de
Bamako érigé en 1914.
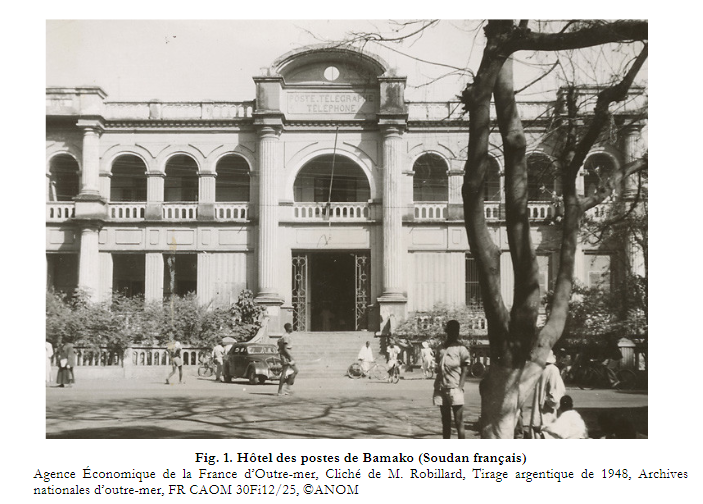
D’autres images, disponibles dans la base Ulysse des Archives
nationales d’Outre-Mer, donnent à voir certains
bâtiments de poste plus modestes, qu’il s’agisse
de petits bureaux urbains ou ruraux .
sommaire
Contexte de
l'AOF Afrique Occidentale Française
Le Sénégal
Ce n'est qu'après l'installation d'un
représentant officiel du Roi de France, vers 1782, puis
le début de l'occupation de l'intérieur du pays,
qu'un service postal embryonnaire est créé. Cependant,
il faut attendre 1879 pour qu'une véritable organisation
postale soit mise en place au Sénégal.
Son principal objectif est de relier Saint-Louis aux différents
points du territoire jouant un rôle administratif, militaire
ou économique. Elle repose principalement sur le courrier
piéton qui fonctionne grâce à des porteurs
convoyant des sacs de dépêches sur des distances
de trente à trente-cinq kilomètres
 Le palais
du gouverneur de l'A.O.F., d'abord installé à
St Louis puis à Dakar (Sénégal) Le palais
du gouverneur de l'A.O.F., d'abord installé à
St Louis puis à Dakar (Sénégal)
Les progrès du télégraphe
Afin de remédier aux aléas et à la lenteur
du transport de courrier postal au Sénégal, «
l’Administration coloniale décide de recourir au
télégraphe électrique dont la première
ligne a été inaugurée en France en 1844
.
Le télégraphe, qui à l’origine était
un moyen de communication militaire, est en effet devenu un
puissant instrument de gouvernement au service de l’administration
[...]. Il n’est donc pas surprenant que les autorités
françaises, confrontées à des problèmes
de communication et d’administration du territoire sénégalais,
décident de l’utiliser dans le cadre de l’entreprise
coloniale ».
Une première ligne télégraphique expérimentale
est édifiée en 1859 entre Saint-Louis et Gandiole.
« Le service connaît un tel succès auprès
des autorités politiques et des milieux économiques
que les autorités décident de généraliser
son utilisation. Le premier chantier d’envergure
porte sur la construction, entre 1861 et 1862, d’une ligne
télégraphique reliant Saint-Louis à Gorée
en passant par Dakar. Ces trois villes sont, en effet, avec
Rufisque, au cœur du dispositif colonial français
et constitueront, à partir de 1872 pour Saint-Louis et
Gorée puis à partir de 1880 pour Rufisque et 1887
pour Dakar, les célèbres “Quatre communes”
dont les habitants ont la particularité de posséder
la citoyenneté française ».
La région du Fleuve, la Petite côte, le Sine-Saloum,
le Baol et la Casamance sont « progressivement équipées,
au point qu’en 1900 le réseau télégraphique
est long de 3 196 kilomètres et couvre tous les points
du territoire »
.
Comme pour le réseau postal, la pénétration
des régions de l’intérieur de l’ensemble
de l’AOF est rapide entre 1890 et 1905. Au nord, il atteint
Tombouctou en 1899 . L’année d’avant, comme
l’écrit le jeune capitaine Émile Dussaulx
à sa famille le 11 février 1898, il a relié
le pays mossi à Dakar :
« J'apprends que la ligne vient d'aboutir à Ouagadougou.
La pose de ce fil de 700 kilomètres, en pays hostile
sur une grande partie de son parcours et en une région
dont la conquête a été des plus superficielles,
est une merveille d'effort et de persévérance.
» .
Pour les liaisons par voie télégraphique avec
la métropole, les Français disposent de l’offre
de câbles sous-marins développée par les
Britanniques depuis plusieurs décennies : à la
fin du XIX e siècle, les Anglais contrôlaient en
effet, par le biais de compagnies privées de télégraphie
sous-marine, « les deux-tiers des câbles mondiaux
», si bien que « la France n’eut pas besoin
de poser des câbles jusqu’en Afrique occidentale,
ni à madagascar. On se contentait de câbles courts
de “cabotage télégraphique” rattachant
ces colonies au réseau mondial anglais » .
En 1902, c’est grâce à l’achat des câbles
britanniques de la West African que sont mis en liaison Dakar,
Conakry, Grand Bassam, Cotonou puis
Libreville. Cette dépendance aux équipement britanniques
suscite bien évidemment des inquiétudes et la
France tente de s’en affranchir en s’alliant avec
d’autres partenaires (pose d’un câble sous-marin,
sur subvention des gouvernements français et portugais,
entre Cadix et Saint-Paul de Loanda ; collaboration franco-allemande
pour poser des câbles vers l’Afrique occidentale).
En 1905, enfin, un câble direct relie Dakar à Brest
pour la liaison rapide avec Paris. À cette même
date, le réseau télégraphique aofien dessert
désormais 160 bureaux des PTT et atteint les 18 626 kilomètres
.
Une carte des communications postales et des lignes télégraphiques
dressée en 1923, « d'après les renseignements
fournis par l'inspection des postes », par le Service
géographique de l’AOF sous la direction du commandant
de Martonne, fournit un aperçu éclairant sur le
maillage du territoire de la fédération, tel qu’il
a été constitué et enrichi considérablement
depuis trois quarts de siècle.
sommaire
La naissance du téléphone
C’est également autour de 1900 que commence à
poindre une nouvelle technologie, le téléphone,
qui pénètre en Afrique sous l’égide
de l’armée. Les premiers réseaux urbains
sont implantés à Saint-Louis dès 1901
(47 abonnés), Dakar (42 abonnés) et Rufisque
(14 abonnés), avec un très lent développement
ultérieur.
Dans les années 1900-1910, « le
parc d’utilisateurs se limite à une centaine d'abonnés
[...]. Les investissements publics étant entièrement
à la charge des colonies, le réseau téléphonique
reste à un stade embryonnaire pendant plusieurs décennies
» .
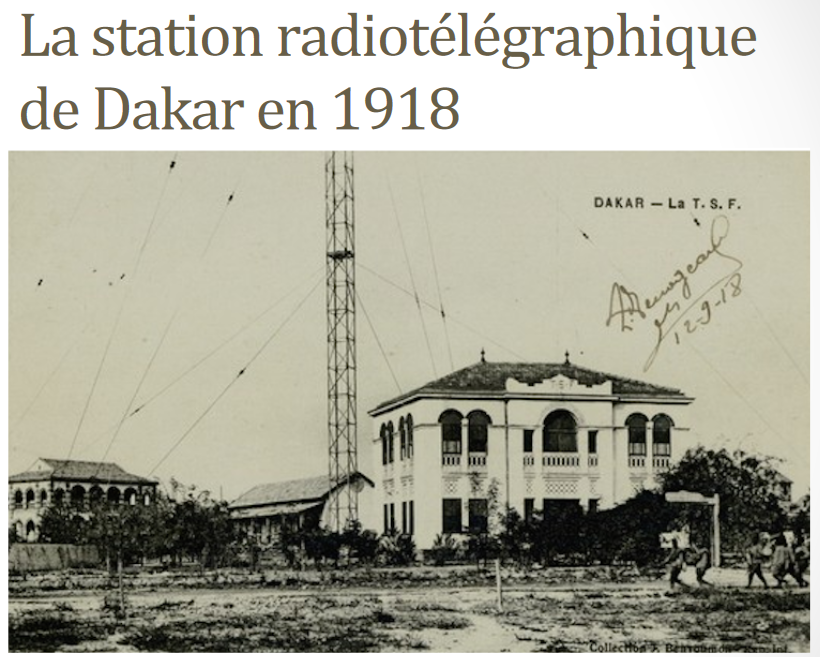
Une rupture intervient en 1943 avec la construction du
central téléphonique automatique de Dakar-Ponty,
d’une capacité de 900 lignes.
Ce central de Dakar-Ponty voit « ses capacités
passer à :
2 000 lignes en 1948,
3 000 en 1950, auxquelles viennent s'ajouter
6 000 en 1953 dont 3000 lignes supplémentaires
avec la construction du central téléphonique de
Dakar-Médina »
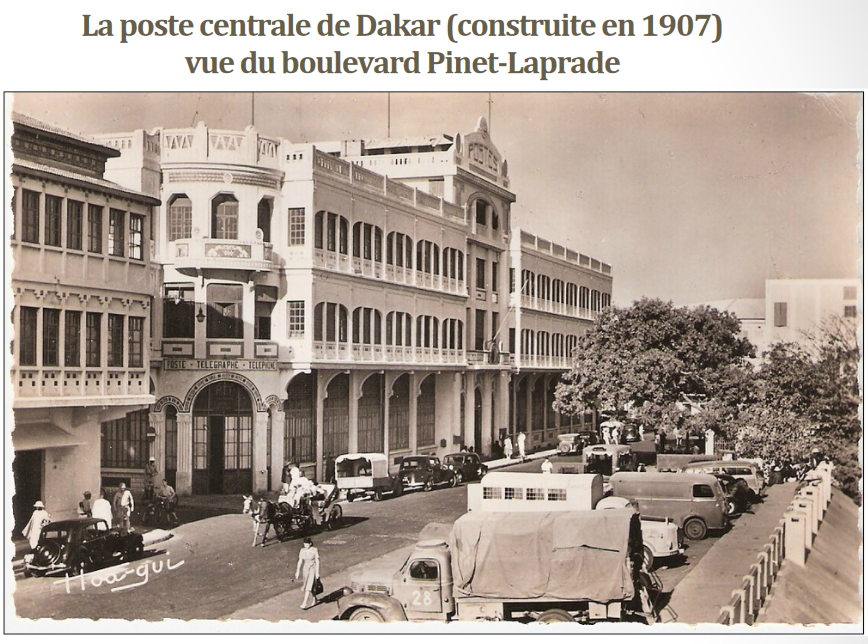
Un réseau téléphonique opérationnel
est donc progressivement bâti, sur un modèle en
grande partie extraverti (les communications internationales
et inter-impériales passent par Paris) et centre/périphérie,
avec concentration des réseaux dans les « zones
utiles » pour le projet colonial.
Il « suit fidèlement le tracé du réseau
des points névralgiques sur les plans économique
et de la présence militaire » .
Après la Seconde Guerre mondiale, mal entretenu
et vite obsolète, ce réseau nécessite
une politique globale de rénovation, ainsi que des
investissements pour l’étendre ; ces équipements
sont menés dans le cadre des grands travaux prévus
par les plans de développement du FIDES (Fonds d’Investissement
pour le Développement Économique et Social) .
On améliore réseaux télégraphique
et téléphonique, de même que l’on développe
la radiodiffusion.
En 1956, quelques années avant les indépendances,
on dénombre pour toute la l’AOF 324 centraux
téléphoniques, pour un total de 14
000
abonnés, tandis que se multiplient les lignes
publiques dans les principaux bureaux de poste de la fédération
.
Pour autant, au moment des indépendances, l’état
global des équipements de télécommunications
est préoccupant, en grande partie parce qu’ils sont
sous-dimensionnés par rapport aux besoins grandissants
d’une population en pleine expansion, mais aussi parce
qu’ils n’ont guère été
modernisés.
Tous les centres et points ayant
une importance économique appréciable sont pourvus
d'un bureau de poste (277 dans l'A. O. F.); les dépêches
sont transportées par les moyens les plus variés.
Le câble sous-marin de Brest à Dakar va jusqu'à
Cotonou en touchant à Conakry, Grand-Bassam et Lomé
au Togo. Il permet, grâce aux 23.278 kilomètres
de lignes télégraphiques terrestres, de communiquer
avec toutes les colonies de l'A. O. F. et dans chaque colonie
avec presque tous les chefs-lieux de cercle. Un grand poste
de T. S. F., à Rufisque, communique chaque jour avec
la France, ainsi qu'un autre se trouvant à Bamako. Des
postes secondaires de T. S. F. se trouvent à Zinder,
Agadès, Tahoua, Bilma, N'Guigmi, Kidal, Port-Etienne,
Conakry, Moronvia (Libéria), Tabou, Tombouctou, Akar,
Chinguetti, Bassam,Cotonou, Araouan, Dakar.
Le téléphone existe dans les principales villes
et au Sénégal un réseau interurbain relie
les villes principales entre elles.
sommaire
DES COURRIERS ET DES HOMMES
Communiquer au sein des ensembles coloniaux ou entre les colonies
et la métropole est, dès l’origine, une nécessité
pour l’armée et pour l’administration. On vient
de le voir, les structures des communications constituées
aux XIX e et au XX e siècles l’ont été
en adéquation avec les fonctions qu’on leur assignait
à l’époque : contrôler plus aisément
les territoires ; les connecter aux centres de décision
coloniaux et à Paris ; relier les agents européens
à leur hiérarchie (militaires, fonctionnaires)
ou à leur partenaires d’affaires (commerçants,
entrepreneurs).
Mais ces outils sont aussi à envisager dans leur environnement
social et culturel : en contexte colonial, recevoir une lettre
de sa famille lointaine est, pour un jeune Français affecté
au fin fond de l’AEF ou de l’AOF, une expérience
très différente que celle qu’il pouvait vivre
en France, quand il relevait sa boîte aux lettres à
Nancy ou à Marseille. Le rapport à la lecture,
à l’écriture, à la correspondance
et, plus profondément, le rapport au temps, à
la distance, à l’absence, à la solitude,
à la famille, à la mère patrie changent
du tout au tout. Pour analyser ces spécificités,
deux correspondances de jeunes militaires ont été
mobilisées : celle d’un officier, Émile Dussaulx,
né en 1870, affecté au Soudan français
entre 1894 et 1898 ; celle de Léon Mercier, né
en 1873, sous-officier en poste au Tchad de 1901 à 1903
. Ces deux correspondances d’« acteurs sans qualités
» , reliés au reste du monde essentiellement par
le fil de l’écriture, permettent de saisir de l’intérieur
les pratiques épistolaires en contexte colonial et de
comprendre à quel point le courrier, sous toutes ses
formes, a constitué un lien vital. Pour le militaire
solitaire, les lettres, les dépêches, les télégrammes
assurent le lien à la chaîne de commandement, à
l’actualité française et internationale,
mais surtout à la sphère de l’intime, de
l’affectif : à la famille restée en métropole.
Les correspondances de Dussaulx et de Mercier — et toutes
les autres qu’il est possible de consulter — fourmillent
de considérations sur le nombre des lettres reçues
et envoyées, les horaires de départ du courrier,
les aléas de son acheminement. Elles donnent aussi à
voir la dimension concrète du fonctionnement des communications,
l’une pour l’Afrique occidentale des années
1890, l’autre pour l’Afrique équatoriale des
années 1900..
Envoyer et recevoir des nouvelles
Tout commence par la rédaction d’adresses fonctionnelles,
que l’on réactualise à mesure des changements
d’affectation, pour un courrier qui voyage franco de port
pour les militaires, comme le précise Dussaulx : «
Écrivez-moi toujours aux Tirailleurs soudanais et non
à Couroussa, ma destination pouvant changer d’un
jour à l’autre. N’affranchissez plus vos lettres.
» ; « J’oublie toujours de dire de ne pas affranchir
les lettres et de me les adresser aux Tirailleurs soudanais,
Soudan français, et non pas Sénégal. »
Mercier quant à lui indique à sa famille deux
adresses à partir desquelles sa hiérarchie pourra
lui faire suivre les lettres, quelle que soit son affectation
: en septembre 1901, « Léon Mercier, sous-officier,
Bataillon du Tchad par Brazzaville, Congo français, À
suivre » ; puis en novembre de la même année
: « Territoire militaire du Tchad, Mercier Léon,
sergent au bataillon de Tirailleurs du Tchad à Goulfeï
(Bas-Chari), par Brazzaville (Congo français), Via Matadi,
À suivre, pas de timbre » .
Un service des postes s’est progressivement structuré
au gré de la conquête et des nécessités
coloniales dans toute l’Afrique française, même
si sa pénétration est plus tardive et moins efficace
dans ce qui va devenir, après 1910, l’AEF. Des liaisons
régulières sont mises en place, avec deux à
trois départs par mois selon les endroits. Mercier écrit
ainsi, le 11 octobre 1901 : « Je ne sais quand un porteur
quittera Gribingui avec le courrier, peut-être dans 15
jours [...] » . Comme dans le poème de Kipling,
l’acheminement des missives et des paquets se fait grâce
à une noria de « piétons » et de «
porteurs », parfois de « distributeurs et vaguemestres
des corps militaires » souvent mal payés et forcés
de voyager à longue distance. Dans les années
1870, certains sont encore payés à la pièce
(à la lettre délivrée), même si la
plupart sont salariés .
On sous-estime, faute de sources éloquentes, les fatigues
et les épreuves que traverse ce petit personnel qui franchit
de vastes étendues pour transporter le courrier à
destination. Maurice Delafosse, en 1909, leur rend un bref hommage
dans un essai fameux sur les servitudes de la vie coloniale
:
« Du fond de l’ombre a surgi un homme qui se montre
tout à coup dans le cercle de clarté répandu
par les photophores, et, avec un halètement de fatigue,
il se débarrasse de son fardeau, un grand sac de toile
bourré de paquets. Tout le monde s’est levé.
Broussard [nom générique donné par Delafosse
aux coloniaux] s’est emparé d’un couteau et
hâtivement coupe les liens qui ferment le sac un camarade
saisit le sac par le fond et, le tirant à lui d’un
coup sec, en répand le contenu sur le sol de la salle
à manger ; un autre procède au dépouillement,
laissant d’abord de côté les journaux pour
faire le tri des lettres et des cartes postales parfois plus
chères que les lettres, dont il appelle à haute
voix les destinataires. Et tout de suite, on
n’entend plus qu’un bruit d’enveloppes violemment
déchirées, de papier froissé, de pages
nerveusement tournées. Les visages se rassérènent,
les bouches se distendent, les yeux deviennent rieurs, parfois
humides une bouffée d’air de France a soufflé
sur ces exilés, leur apportant un peu de vrai bonheur.
Et dans leur émotion, ils ont oublié le pauvre
instrument de leur joie, ce modeste facteur de brousse qui a
fait en cinq jours et à pied 200 ou 250 kilomètres
pour apporter ce sac de dépêches, et qui, accroupi
sur le sol, attend qu’on veuille bien songer à lui.
»
Ces piétons transportent non seulement des missives,
mais aussi des journaux et des colis emplis de produits variés.
Le 30 juillet 1901, depuis Brazzaville, Mercier passe commande
à son cousin : « Bien que le courrier ne parte
que le 11, c’est-à-dire en même temps que
nous, mais en sens inverse, je profite du courage que j’ai
en ce moment pour t’emplir ces quatre pages et te dire
que la santé est bonne [...]
Enfin j’en regratte une autre [lettre] : voilà,
je ne sais si je t’ai causé de me faire un colis
postal avec des Prévert, légumes séchés
par compression et qui font de bonnes tambouilles, si tu peux
t’en procurer, ainsi que des graines potagères,
ça ferait ma balle. J’espère que tu me feras
de bonnes longues lettres et que tu y joindras les vieux journaux
de tes abonnements. » Plus tard, il réclame : «
Joins au journal une pipe ou deux, mets les cartes sous pli
recommandé, ajoute au postal des papiers à cigarette,
fais un petit colis de cigares ronds. N’oublie pas les
journaux. Avec tous ces journaux, je serai le plus heureux des
blancs, je te ferai cadeau de ma chéchia en revenant
! Aussitôt que l’Almanach Hachette 1902 paraîtra,
envoie-le moi. »
. Et les demandes continuent au fil de la correspondance, à
mesure que gagne l’ennui: « Je ne compte que sur
tes lettres et journaux pour me faire prendre mon séjour
de misère en patience. Allons ne te fais pas tirer l’oreille,
vas-y, fends-toi de quelques vieux journaux à un croc,
de quelques
fournis rigolards avec une chiée de femmes à demi
à poil, de quelques potages Prévert, par courrier,
et tu seras un chic type ! Tu ferais bien aussi de m’envoyer
les deux planches de cartes du Tchad [...] » .
Dussaulx, de son côté, réclame des journaux
(même périmés, précise-t-il), des
produits chimiques pour ses photographies... Il énumère
le contenu d’un colis parvenu le 24 décembre 1897
: « Le courrier de France nous arrivait ce matin entre
la poire et le fromage. Reçu : mes journaux, le journal
de Maria [sa sœur] du 3 septembre au 17, le photographie
de la noce de Pauline, un bouquin. Je ne sais lequel des deux
a été le plus réconfortant de mon courrier
personnel ou du courrier officiel qui me dirige sur Bandiagara
[...] » .
C’est qu’en effet, les missives privées ne
sont qu’un des éléments des nouvelles qui
circulent ; le courrier officiel et les ordres du commandement
sont transmis par dépêches, envoyées par
télégraphe ou par piétons. Au Sénégal,
au XIX e siècle, ces derniers n’avaient en général
pas d’uniforme, mais une médaille en métal
indiquant : « courriers du gouvernement français
d’un côté, en arabe de l’autre »
.
Dussaulx évoque régulièrement les dépêches
du gouverneur : en juillet 1894, une communication officielle
envoyée de Dakar annonce la mort du président
de la République, Sadi Carnot, assassiné par l’anarchiste
Caserio. Il se tient par ailleurs au courant des nouvelles du
monde via les journaux — qu’il reçoit avec
des semaines, voire des mois, de retard — ou des «
havas » — dépêches de l’agence
du même nom diffusés dans toute l’AOF : il
apprend par ce canal, en juillet 1894, que le choléra
sévit en Russie. Quinze ans plus tard, au Tchad, Mercier
est moins bien connecté au monde et ne reçoit
la presse, expédiée par son cousin, qu’avec
six mois de délai (17 avril 1902 : « J’ai
reçu tes journaux datés de décembre, merci.
» ).
Si les courriers sont, pour les militaires, franco de port,
il n’en va pas de même d’autres modes de communications
plus coûteux. Envoyer un télégramme est
durablement réservé à la seule administration
coloniale.
Le téléphone, à partir de 1900,
est trop cher pour les appels intercontinentaux des simples
particuliers et, pour les appels locaux, n’est longtemps
utilisé que par une élite urbaine, principalement
pour ses affaires. De façon tout à fait exceptionnelle,
en février 1898, Dussaulx profite de l'installation récente
du télégraphe en pays mossi pour câbler
à sa famille la nouvelle de son arrivée en bonne
santé. Il ajoute : « C'est un luxe que je ne m'offrirai
pas souvent ; mais cette fois, ça vaut la peine. »
Le texte de son télégramme, conservé dans
la correspondance, est évidemment très laconique
: « Arrivé Ouagadougou 14 février. Bonne
santé ».
Déplorer les aléas de l’acheminement, la
disparition de certains colis, est un leitmotiv sous la plume
des épistoliers. De fait, malgré toute la bonne
volonté du monde, les délais sont extrêmement
longs. Il faut ainsi 21 jours de route ou de navigation entre
Saint-Louis-du-Sénégal et Médine, sur le
Haut-Fleuve, dans les années 1860. Dussaulx, au milieu
des années 1890, se retrouve en poste à Couroussa
(actuelle Guinée) ; son courrier transite depuis Saint-Louis
par Kayes, au Soudan français, avant de le rejoindre
en Haute-Guinée : « Vous devez cependant vous apercevoir
que vos courriers mettent 40 jours pour arriver à destination.
Je pense qu’à partir d’aujourd’hui, les
bateaux à vapeur qui remontent jusqu’à Kayes,
grâce à la crue des eaux [après la saison
des pluies], nous permettront aux uns et aux autres des nouvelles
plus fraîches d’au moins une dizaine de jours. Les
piétons mettent en saison sèche 12 jours de Kayes
à Saint-Louis. Les grands vapeurs mettent 2 jours, les
petits 6 jours. Mais le service postal se poursuit évidemment
par piétons de Kayes à Couroussa. Ceux-ci mettent
environ 25 jours pour faire ce trajet. »
Mercier, isolé dans le Kanem en 1902, écrit le
8 octobre : « Cette lettre doit te parvenir vers le 15
février »
. Comme on le voit, quinze ans auparavant, en Afrique occidentale,
Dussaulx était mieux loti que lui... Divers accidents
peuvent venir perturber l’acheminement : « Pas de
veine, je viens de dépouiller le courrier de France et
rien n’arrive à mon adresse, mais une note du service
des Postes de plus bas me dit : “ Un procès-verbal
de Fort-Archambault fait connaître que le courrier a chaviré
sur le Gribingui, un hippopotame ayant renversé la pirogue
qui le transportait. Le sergent Deleurme qui l’escortait
n’a retrouvé les lettres que le lendemain à
une grande distance de l’accident. Bon nombre de lettres,
journaux, colis, etc. sont perdus.” Tu vois, ces lettres
qui nous feraient tant plaisir, ces légumes secs pressés
que l’on reçoit en colis et toutes sortes de bonnes
choses (je ne parle pas pour moi puisqu’on ne pense pas
à ma purée), par quelles péripéties
ils passent avant d’arriver [...] ! »
Ailleurs, ce peut être l’état de guerre ou
des circonstances locales qui expliquent les perturbations,
comme lorsque que Dussaulx évoque, en février
1898, les attaques journalières des populations contre
la nouvelle ligne télégraphique achevant la liaison
Kayes-Ouagadougou : « La construction de la ligne télégraphique
qui se poursuit en ce moment sur cette route a nécessité
déjà le passage de nombreux convois, qui se sont
frayés le chemin à coups de fusil. Le fil est
coupé presque journellement. »
En mars 1895, Dussaulx donne par ailleurs des précisions
sur les manquements plus généraux des services
postaux : « Rien toujours de mes deux courriers, or je
ne puis supposer que vous ayez pour un motif quelconque gardé
le silence pendant un aussi long intervalle. Des colis postaux
me sont annoncés depuis plus de deux mois et je n’en
vois pas la queue d’un. En revanche, les rares courriers
qui m’arrivent à des dates irrégulières
portent les timbres variés des postes de Bammako [sic],
Koundou, Ségou, Bissandougou, apostilles significatives
et fantaisistes qui mettent en évidence ou l’incurie
du service des postes, ou celle du régiment qui néglige
de mettre à jour les mutations. »
Les destinataires craignent aussi les larcins, possibles selon
eux à toutes les étapes du voyage. Les colis arriveront,
écrit Mercier, « si ces bons employés des
postes, des collègues ou des civils ne les barbotent
pas ; ce qui arrive souvent ici, hélas ! » . À
moins qu’il ne s’agisse des piétons eux-mêmes
qui désertent : « J’espère que vous
recevez toujours régulièrement ce que je vous
adresse ; on dit que certains courrier, trouvant la route longue
et difficile, déposent dans la brousse leur paquet de
correspondance et filent dans une direction inconnue sans ordre
de route. »
Pire encore — et sans qu’il soit vraiment possible
de départager la rumeur et la réalité —,
les deux militaires redoutent l’interception de leurs courriers
par les autorités : « On dit aussi qu’un certain
cabinet noir fonctionne à Kayes assez régulièrement
» écrit Dussaulx, tandis que Mercier sonde son
cousin : « Mes lettres sont toujours cachetées
marque M, tu me diras si elles ont été ouvertes
» . Le principe de l’inviolabilité du courrier
et du télégraphe est pourtant proclamé
de façon officielle pour l’ensemble du courrier
postal et des communications télégraphiques dès
la mise en place des services postaux au Sénégal,
et réitéré à plusieurs reprises
au début du XX e siècle pour toute l’Afrique
française .
Un demi-siècle ans plus tard, l’état
du réseau téléphonique n’est pas non
plus excellent et les rares usagers privés qui
y sont reliés ne voient leurs appels aboutir qu’après
maintes tentatives.
Sur 5 000 appels passés de Dakar vers Saint-Louis à
la fin des années 1950, il faut réessayer plusieurs
fois, et souvent attendre longtemps avant de parvenir à
passer un coup de téléphone : 1 300 appels (26
%) prennent une demi-heure avant de joindre le correspondant,
450 (9 %) une heure, et 50 (1 %) nécessitaient une attente
de quatre heures avant le succès de la mise en communication.
Comme le souligne Oumar Kane, ces statistiques concernant les
deux plus grandes villes de colonie peuvent donner une idée
du faible taux de réussite pour les appels passés
entre villes moins importantes, ou au sein de la fédération
d’AOF — sans parler même des appels vers la
métropole ou à l’internationa .
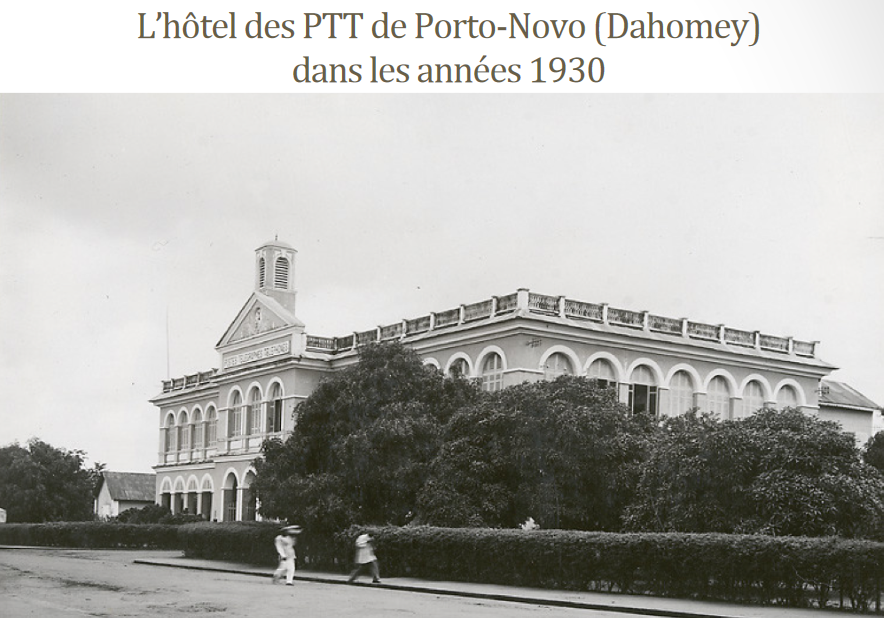
Apprivoiser l’attente, apprendre la frustration
Faire avec le silence des proches est donc le lot commun de
la plupart des Européens isolés.
L’administration et l’armée semblent d’ailleurs
avoir conscience qu’une circulation efficace des nouvelles
est une nécessité pour le moral de personnels
coloniaux, et notamment des militaires et des fonctionnaires.
Et de fait, être coupé des êtres chers est
une souffrance quotidienne. Maurice Delafosse décrit
fort bien cette préoccupation constante, que l’on
s’efforce, autant que faire se peut, de tenir secrète
vis-à-vis des autres :
« Broussard est marié, il est père de famille.
Il a dû quitter son foyer, plein bonheur, pour rejoindre
son poste, car on ne vit pas de l’air du temps et le métier
colonial, quoi qu’en disent certains, ne donne pas de grosses
rentes. Et il a dû partir seul, car dans le poste lointain
auquel il est affecté, malgré tous les progrès
matériels réalisés, il n’est pas possible
d’amener une femme ni de faire vivre une famille, et l’autorité
supérieure du reste n’autorise pas en général
le mari à s’y faire accompagner de sa femme. Le
voilà donc là-bas, en proie à une impression
de solitude qu’il n’avait pas ressentie encore. Il
n’est pas seulement solitaire, il est privé de ce
qui est désormais la moitié de lui-même.
Il vit dans l’angoisse des êtres chers laissés
en France, angoisse accrue par la pensée de celle qu’il
sait régner dans leurs esprits. Il apprend par cœur
le tableau des courriers, chose qu’il n’avait encore
jamais songé à faire. Il dépense des sommes
folles en télégrammes et lui, l’homme arriéré
que le progrès effraie un peu, se plaint des vices de
construction des lignes télégraphiques et de l’insuffisance
du réseau. Le moindre retard dans l’arrivée
du courrier de France le met dans un état d’énervement
fâcheux pour son entourage. Son travail se ressent de
cette perpétuelle inquiétude d’esprit, et
son caractère aussi.
Lorsqu’approche la date habituelle d’arrivée
du courrier, Broussard e sent pris d’une sorte d’énervement
difficile à combattre; et lorsque cette date s’est
écoulée sans qu’on ait signalé le
courrier attendu, l’énervement s’accroît,
il devient agressif, la moindre plaisanterie est prise du mauvais
côté, les grands chefs sont traités sans
respect, les réclamations apportées par les administrés
sont reportées ou remises à huitaine, et les boys
font bien de ne pas choisir malencontreusement cette période
pour casser une assiette ou un verre. Broussard, devant les
camarades, affecte un air détaché, il dit : «
Le courrier ? je m’en fiche ! je n’attends rien, moi,
personne ne m’écrit, et ça vaut bien mieux
ainsi. » Et chacun d’ailleurs en dit autant. Mais,
par une coïncidence surprenante, il se trouve que, après
être allés se promener l’un au jardin, l’autre
au village, l’un à l’est, l’autre à
l’ouest, tous se rencontrent en un même point, un
petit coteau d’où l’on domine un long morceau
de ruban gris qui est la route de France, la route par où
doit venir le piéton chargé des sacs postaux.
On se regarde en dessous, l’air moitié riant, moitié
bourru, et, ma foi ! puisque chacun s’est ainsi découvert,
pourquoi bouder plus longtemps contre ce que chacun ressent
au fond de lui-même tout en refusant de l’avouer
? Tous donc, d’un accord tacite descendent le coteau et
suivent la route en s’écartant du poste, jusqu’à
ce que la nuit tombe et empêche de distinguer quoi que
ce soit à dix pas. Alors, mélancoliquement, sans
un mot, on s’en revient, non sans se retourner chaque fois
que se produit un bruit ressemblant à celui d’un
pas sur le sol dur du sentier, puis on s’attable tristement
pour le repas du soir, sans grand appétit. Les boys savent
ce que c’est et glissent, silencieux, posant les plats
avec précaution.
Parfois, l’un des convives, en reposant son verre, traduit
le sentiment général d’une exclamation sourde
: Sale pays ! Tous ces yeux mornes penchés sur les assiettes
regardent en réalité bien plus loin ils regardent
par-delà la brousse et le désert, par-delà
la mer, vers la maison natale, vers la nappe blanche autour
de laquelle sont assis les vieux, ou les petits, ou la fiancée,
ou la femme, qui songent dans le même silence au fils,
au père, au fiancé, au mari lointain, dont les
nouvelles mettent si longtemps à venir et qui peut-être
à cette heure est seul, grelottant de fièvre sur
son lit de camp. »
On a bien du mal à se figurer l’attente interminable
que subissent certains, loin des grandes villes et les nœuds
de distribution des réseaux. Léon Mercier, affecté
depuis plusieurs mois dans le territoire militaire du Tchad,
écrit sa détresse à son cousin, en février
1902, depuis N’Gouri :
« Attention, je deviens morose : PAS UNE LETTRE DE FRANCE
DEPUIS 8 MOIS ; le reste je m’en fous, mais de cela pas
; je suis le seul sur terre qui ne crée pas de travail
au service des Postes !
Heureusement que les copains d’ici ont pitié de
moi et mes officiers aussi, ils m’envoient des journaux
que je dévore ! Enfin, avez-vous des entrailles de parents,
coquin de sort, ou êtes-vous tous en prison, que personne
ne songe à moi dans ce maudit petit coin de l’Afrique
! Moi je vous écris souvent, ça me console ; en
revanche vous vous dites touts, il peut bien crever celui-là
! [...] ».
Deux mois plus tard, il se lamente à nouveau : «
Moi j’écris très souvent, mais il est regrettable
qu’en 11 mois d’absence, j’aie juste reçu
une lettre de toi ET C’EST TOUT, aucune autre n’est
venue m’apporter un peu de baume au cœur ; c’est
une tristesse forcée. Dis-le à ma tante sans lui
faire de la peine, car de toute la terre je n’ai reçu
que ta lettre. » Et le 22 novembre de la même année,
on perçoit une inquiétude non dissimulée
: « Mon cher Pierre, comme le courrier n’est pas
encore arrivé et que je suis toujours dans l’inquiétude,
attendu que ta dernière lettre est datée de l’année
dernière (1901 et nous entrons en 1903), je ne sais su
je dois même me donner la peine d’écrire ;
malgré tout je le fais, mais avec le regret de voir toutes
mes épistoles rester sans réponse. S’il y
a un événement survenu chez toi ou chez mon oncle,
il ne faut pas craindre de me le dire ; je suis assez fort maintenant
pour recevoir n’importe quelle secousse. [...] Tu ne voudrais
pas croire, mon cher Pierre, comme ton silence me pèse,
ma tête s’égare et je désire combats
et misères pour chasser loin de moi de bien noires pensées.
Enfin, jamais rien ; chaque courrier ne compte pas pour moi,
et je me suis résolu si demain ou après, il n’y
avait rien pour moi, de cesser d’écrire et de demander
de vos nouvelles par le maire de Sedan. Il n’est pas admissible
de me laisser ainsi sans un mot des tiens ni de Victoire. »
La joie de recevoir des lettres est à proportion de ces
délais inouïs : « Lac Tchad, le 18 janvier
1903. Mon cher Pierre, voilà, c’est encore moi qui
écris, mais cette fois ce n’est plus le cœur
chargé, car j’ai reçu des nouvelles de Sedan,
du Fond de Givonne, du Tonkin, du Soudan, de l’intérieur
: jamais je n’ai eu si gros courrier et mon cœur déborde
cette fois. »
Dussaulx, lui aussi affecté dans un poste reculé
— même si ce n’est pas dans les mêmes
proportions que Mercier —, évoque dans maints passages
de sa correspondance avec ses sœurs et avec son cousin
les joies et les peines liées à l’arrivée
du « courrier de France » : « Comme tous les
courriers, celui du 20, qui arrivait aujourd’hui, avait
mis tout le monde en fête. Depuis quatre jours, j’attendais
avec une impatience que vous comprenez, et seul encore comme
la première fois, je ne reçois rien [...].
Dieu sait cependant si cela m’eût fait plaisir. Il
n’y a que ceux qui éprouvent ces déceptions
qui sont capables de comprendre combien elles sont amères
» (mars 1894). Ailleurs, il note : « J’ai reçu
vos lettres qui m’ont fait bien plaisir. N’oubliez
pas que l’arrivée du courrier de France est sur
ces terres lointaines la plus grande jouissance que l’on
puisse se procurer. » (juin 1894) ; « J’ai
reçu dans l’après-midi le courrier de France
; merci car cette fois personne ne m’a oublié. »
(juillet 1894) ; « Le courrier de France m’arrivait
ce soir à 2 heures. Il a transformé pour moi ce
jour de marasme en jour de fête. Merci à tous de
ne pas m’avoir oublié. J’ai consacré
toute mon après-midi à vous apprendre par cœur
» (août 1894).
Dans une lettre de septembre 1897, il évoque même
les trésors de stratégie qu’il déploie
pour faire durer le plaisir de la lecture : « Rien ne
me fait plus plaisir que ces larges feuilles sur lesquelles
je commence d’abord par m’attendrir en les examinant
de loin, les classant lentement dans l’ordre des dates,
ménageant le plaisir pour le faire durer plus longtemps.
»
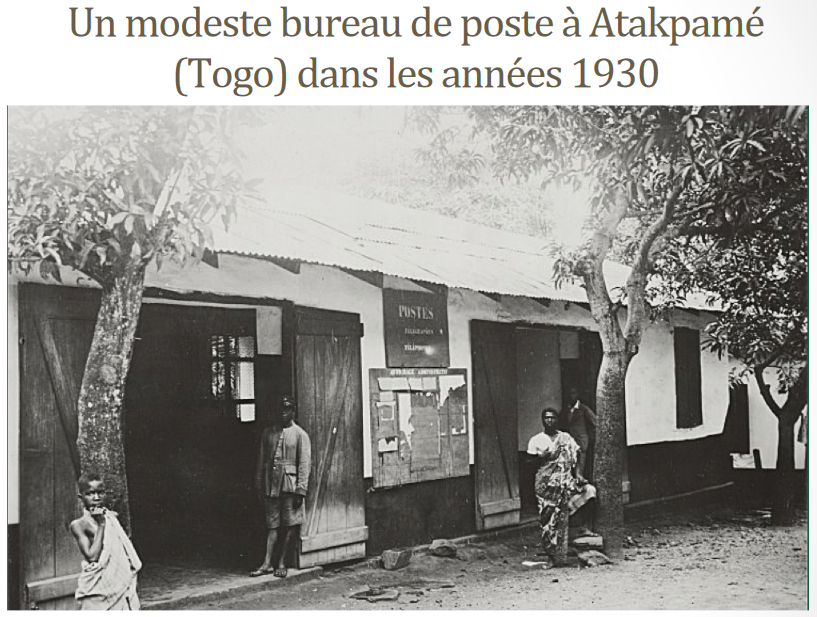
De nouvelles expériences d’écriture
Un cordon vital de lettres et de colis relie les coloniaux à
leurs familles. Avant même la Première Guerre mondiale
— à propos de laquelle divers travaux ont montré
l’importance de la correspondance pour les combattants
et leurs proches —, des jeunes gens de milieu parfois modeste
ont pris la plume journellement pour consigner les traits saillants
ou insignifiants de leur existence aux colonies. Comme pour
les poilus de 14-18, « l’écriture et la lecture
des lettres — le contenu de celles-ci peut être inquiétant,
mais seule l’absence de lettres est “vraiment déprimante”
— permettent [...] de conjurer la pesanteur » de
l’existence. À ce jour, l’historiographie n’a
pas produit d’étude d’ensemble sur ces correspondances
coloniales qui ont pourtant tissé la trame de la vie
de nombreux individus et leur ont permis de « tenir »
dans des conditions de fort isolement affectif et moral. Ils
y parlent de leur santé, toujours menacée sous
les Tropiques, du quotidien, de leurs états d’âme,
tout en se mettant évidemment en scène pour ne
pas trop inquiéter leurs proches. On observe déjà,
bien avant la Grande Guerre, un effacement des genres entre
récit pour soi, journal intime et correspondance classique
.
Dussaulx compose ainsi un journal épistolaire : ce faisant,
il mixe le « journal intime » et le « journal
de marche » ; ses lettres sont parfois personnelles (un
seul destinataire) mais le plus souvent collectives (adressées
à un cercle de lecteurs, et sont recopiées et
transmises au sein de la famille élargie. Mercier procède
de façon similaire : rédiger du courrier est aussi
une façon de tenir un journal, et il demande d’ailleurs
expressément à son cousin de les conserver pour
pouvoir, à son retour, les relire. Les lettres pour les
proches sont aussi des lettres pour soi. Tout cela instaure
un nouveau rapport à l’écriture, qui devient
une pratique quasi quotidienne. L’attente anxieuse du courrier
construit aussi un autre rapport au temps — distendu à
l’infini — et à l’espace africain —
mesuré en jours de marche, immensité à
franchir pour acheminer les courriers.
Ce nouveau rapport au courrier et à l’écriture
concerne aussi des catégories croissantes de la population
africaine, tenue de prendre sa part au « monde de papier
» dont l’emprise s’étend avec la colonisation.
La pratique épistolaire entre dans les mœurs, d’abord
dans les couches d’une population lettrée de plus
en plus nombreuse, dès le XIX e siècle, dans les
grandes villes du Sénégal, du Dahomey ou de la
Côte d’Ivoire : commerçants, avocats, journalistes,
instituteurs, etc., prennent eux aussi la plume et envoient
des lettres à leurs connaissances, à leurs clients,
aux administrations dont ils dépendent. Mais les plus
modestes commencent aussi à avoir un accès ne
serait-ce qu’indirect à l’écrit, par
le biais des
écrivains publics ou par l’entremise d’«
agents d’affaires » — ces lettrés qui
rédigent plaintes et courriers en contrepartie d’une
rémunération. De véritables professionnels
de l’écriture s’entremettent ainsi entre colonisés
illettrés et fonctionnaires, comme en attestent les requêtes
de justiciables devant les tribunaux coloniaux, ou les correspondances
adressées aux services des différents gouverneurs.
Petit à petit, recevoir une lettre ne constitue plus,
en ville, un événement. Surtout après la
2e Guerre mondiale, les citadins demandent l’attribution
de boîtes postales, dans un contexte où la distribution
du courrier par des facteurs (comme à Lomé par
exemple 75 ) reste exceptionnelle, et où seules sont
nommées les principales artères des centres urbains.
Le recours aux mandats-lettres et l’envoi de colis ou de
télégrammes entrent peu à peu dans les
mœurs, comme en atteste la construction de bureaux de poste
dans les quartiers des grandes villes ou dans les centres urbains
secondaires dès les années 1920-1930.
À Dakar, dans les années 1950, on peut téléphoner
à partir de dizaines de cabines publiques installées
dans les bureaux de la « grande poste » du boulevard
Pinet-Laprade, ou dans divers bureaux de quartier.
Comme souvent en histoire de la colonisation, la dissymétrie
des sources conduit à évoquer les pratiques des
colonisateurs davantage que celles des colonisés. À
propos des communications « modernes » abordées
dans cet article — familières dès le départ
aux colonisateurs, tandis qu’elles
durent être progressivement apprivoisées par les
populations colonisées —, le déséquilibre
est peut-être encore flagrant. Il est donc souhaitable
de conclure sur une note différente, en dirigeant un
peu mieux le projeteur sur des acteurs fondamentaux dans la
diffusion des communications en Afrique sous domination française
: les personnels africains.
Une source intéressante est disponible pour recueillir
des informations sur leur rôle et leur ressenti : un ensemble
d’entretiens avec des « anciens » de l’administration
des PTT du Togo, réalisés dans les années
1990. Plusieurs des personnes interrogées, nées
entre 1915 et 1930, étaient en activité à
la fin de la période coloniale et ont pour la plupart
eu de hautes responsabilités à la fin de leur
carrière. Le plus âgé, M. Dosseh, était
ainsi entré dans l’administration des PTT de l’AOF
en 1936, après avoir étudié dans la première
école supérieure fédérale des PTT
de l’AOF. Intégré, après avoir réussi
un concours en 1946, dans le cadre général des
PTT de la France d’Outre-mer, il occupe plusieurs postes
au Sénégal (1936-1951), au Dahomey (1952-1957),
puis au Togo jusqu’à sa retraite en 1967. Mémoire
et passeur de l’histoire postale ouest-africaine, il témoignait
des mutations des communications en Afrique occidentale, et
au Togo en particulier, de l’époque coloniale aux
indépendances : l’entrée de la colonie
dans l’Union postale universelle en 1888 ; la création
des services postaux et télégraphiques de la Reichspost
à l’époque allemande, à partir de
la fin des années 1880 ; l’édification du
premier bureau de poste de Lomé en 1890, puis la construction
de bureaux dans les principales villes du pays dès les
années 1920 ; la réorganisation du service des
PTT sous l’égide de la France en 1922 (avant une
réforme importante en 1949) ; le rôle des porteurs
à pied qui, durant plusieurs décennies, ont seuls
assuré l’acheminement des courriers ; le développement
du transport des sacs postaux par train et par camion dans les
années 1930 et 1940 ; l’arrivée de l’avion
dans les années 1950 ; le développement du réseau
téléphonique et l’installation du premier
central automatique en 1956 ; les débuts de l’africanisation
des cadres des PTT à partir des années 1950 ;
la suppression de la colonnade hispano-mauresque de l’Hôtel
des Postes, bâti en 1930 et qui donnait alors encore directement
sur la rue...
Cette mémoire, encore vive en 1996, raconte une histoire
partagée et réappropriée des communications
en Afrique francophone. Elle suggère aussi la progressive
banalisation, au bon sens du terme, des moyens de communication,
au fil de leur appropriation par les usagers africains.
|
sommaire
Projet d'une ligne télégraphique transsaharienne
destinée à desservir les possessions françaises
en Afrique ... Projet d'un réseau complémentaire de
télégraphie sans fil.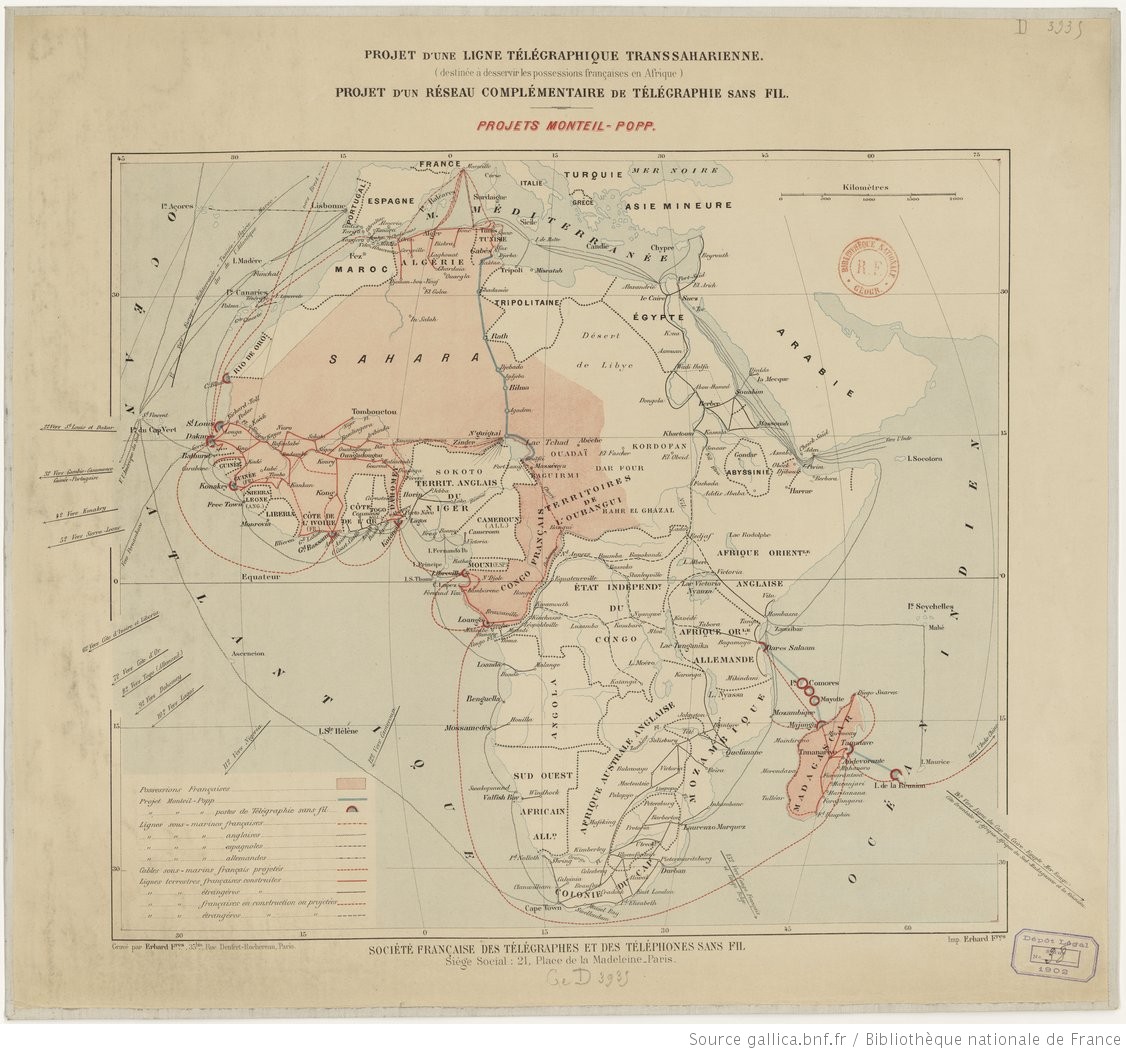
sommaire
Les travaux de construction de la ligne téléphonique
et du chemin de fer reliant Dakar-Kayes-Niger exigeaient une main-d'œuvre
abondante, recrutée
essentiellement parmi les Soninké. Le travail ëputsant
et la précarité des conditions d'existence entraînaient
un taux de mortalité élevé et l'intensité
de la violence des révoltes (Sembène 1957). Devant le
bouleversement économique, politique et social, les Africains
de l'AOF, longtemps après l'installation des Français,
disposaient de force et de volonté pour combattre pour leur
liberté et par conséquent pour une organisation africaine
de la société, de la culture. Dans leur recherche intérieure,
ils vont sans doute quérir le "pur" ou le "vrai"susceptible
de les aider à vivre.
Pour résoudre la crise occasionnée par
la colonisation française. une méthode très répandue
consistait à émigrer massivement, peut-être seulement
pour protester contre la dureté du régime colonial.
Les Africains de l'AOF préféraient fuir plutôt
que de subir des mesures qu'ils estimaient oppressives.et. humiliantes.
En 1916 et 1917\ plus de 12000 personnes quittèrent la Côte-d'Ivoire
pour la Gold Coast. ! la même époque. une émigration
importante intervient également du Sénégal vers
la Gambie, de la Haute-Volta vers la Gold Coast, et du Dahomey en
direction du Nigeria. Notons qu'entre 1882 et 1889 un grand nombre
de Peul des faubourgs de Saint-Louis émigrèrent vers
l'empire d'Ahmadou.
En fait, cette fuite peut être le symbole d'une fuite intérieure.
On estime à 62000 le nombre d'hommes qui ont fui l'AOF pendant
la guerre pour échapper au fouet, à la pendaison, au
recrutement, au travail forcé, à l'incendie de leur
village ou à d'autres menaces de l'administration coloniale.
Cette fuite peut être pour l'Africain de l'AOF l'expression
d'un conservatisme par rapport à la "civilisation"
dans laquelle il baigne avec la colonisation. Rester sur place et
subir la colonisation, c'est peut-être accepter à la
longue la "civilisation occidentale" et pàr conséquent
se convertir sinon au christianisme du moins à la culture européenne.
De la domination politique
à la domination économique : une histoire des
télécommunications au Sénégal
Par Olivier SAGNA
Dans l'entendement du grand public comme dans l'esprit de nombre
d'analystes qui s'intéressent aux problématiques
liées à l'émergence de la société
de l'information, les technologies de l'information et de la communication
(TIC) évoquent, par essence, le progrès scientifique
et technique, l’innovation, la nouveauté quand ce
ne sont pas les promesses du futur. Ce faisant, les uns et les
autres ont parfois tendance à oublier que les TIC possèdent
également une histoire qu'il est important de connaître
car elle détermine souvent le présent. Ainsi, la
configuration du réseau de télécommunications,
le rôle que jouent les TIC dans l'économie ainsi
que la place que l'État leur accorde dans la politique
de développement d’un pays ne peuvent se comprendre
sans se référer à l'histoire de leur déploiement.
Carrefour des routes maritimes reliant l'Europe, l'Afrique et
l'Amérique latine, escale aérienne entre l'Afrique
et les Amériques, finistère de l'Afrique de l'Ouest,
capitale de l'Afrique occidentale française (AOF), siège
de nombreuses organisations internationales, pays touristique,
le Sénégal est depuis longtemps impliqué
dans une multitude de relations dans lesquelles les télécommunications
ont occupé, et continuent d’occuper, une place prépondérante.
Nous appuyant sur une documentation diversifiée mêlant
travaux académiques, articles et ouvrages portant sur la
question, nous proposons de retracer la perspective historique
dans laquelle s’inscrit le développement des télécommunications
au Sénégal de la fin du XIXe siècle à
ce début de XXIe siècle en mettant l’accent
sur les permanences et les ruptures.
À l’origine fut le télégraphe
Jusqu'à l'occupation des territoires
correspondant au Sénégal contemporain par les
Européens, il n'existe pas d’administration postale
chargée de l’acheminement du courrier. À
l'échelle des différentes concentrations humaines,
l'information est transmise par le biais de messagers à
pied, voire, pour l'annonce de certains évènements,
par le biais du tambour. Sur les grandes distances, les nouvelles
ordinaires circulent par l'intermédiaire des voyageurs
et des commerçants tandis que les pouvoirs en place recourent
à des cavaliers afin de véhiculer les informations
liées au contrôle des territoires sur lesquels
ils exercent leur souveraineté .
Le premier système de communication moderne est mis en
place au XVIIe siècle durant la période précédant
la conquête coloniale.
En effet, les premières relations postales avec la France
sont établies en 1626, date à laquelle les navires
des commerçants dieppois et rouennais touchent les côtes
sénégalaises. Ce n'est qu'après l'installation
d'un représentant officiel du Roi de France, vers 1782,
puis le début de l'occupation de l'intérieur du
pays, qu'un service postal embryonnaire est créé.
Cependant, il faut attendre 1879 pour qu'une véritable
organisation postale soit mise en place au Sénégal
. Son principal objectif est de relier Saint-Louis aux différents
points du territoire jouant un rôle administratif, militaire
ou économique. Elle repose principalement sur le courrier
piéton qui fonctionne grâce à des porteurs
convoyant des sacs de dépêches sur des distances
de trente à trente-cinq kilomètres. Sur certains
axes, le transport du courrier est assuré par d'autres
moyens tels que le chemin de fer entre Saint-Louis et Dakar,
les bateaux à vapeur sur les voies fluviales entre Dakar
et Gorée, la poste par chameaux entre Saint-Louis et
Gandiole1 ainsi que le train des équipages dont la vocation
est essentiellement militaire. Les communications avec la France,
qui jouent un rôle critique puisque c'est dans la métropole
que se prennent toutes les décisions d'importance relatives
à la colonie, sont assurées par des navires opérant
principalement à partir des ports de Bordeaux et de Marseille.
Le dénominateur commun à tous ces systèmes
de communication est leur lenteur et leur manque de fiabilité
qui font que le courrier met des jours, des semaines, voire
des mois, avant d'arriver à destination lorsqu'il ne
se détériore pas ou ne se perd pas en cours de
route.
Afin de remédier à ce problème,
dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'Administration
coloniale décide de recourir au télégraphe
électrique dont la première ligne a été
inaugurée en France en 1844. Le télégraphe,
qui à l’origine était un moyen de communication
militaire, est en effet devenu un puissant instrument de gouvernement
au service de l'administration . Il n'est donc pas surprenant
que les autorités françaises, confrontées
à des problèmes de communication et d'administration
du territoire sénégalais, décident de l’utiliser
dans le cadre de l'entreprise coloniale.
C'est ainsi qu'en 1859, une ligne télégraphique
expérimentale est construite entre Saint-Louis et Gandiole.
Le service connaît un tel succès auprès
des autorités politiques comme des milieux économiques
que l'Administration coloniale décide de généraliser
son utilisation. Le premier chantier d'envergure porte sur la
construction, entre 1861 et 1862, d'une ligne télégraphique
reliant Saint-Louis à Gorée en passant par Dakar.
Ces trois villes sont, en effet, avec Rufisque, au cœur
du dispositif colonial français et constitueront, à
partir de 1872 pour Saint-Louis et Gorée puis à
partir de 1880 pour Rufisque et 1887 pour Dakar, les célèbres
« Quatre communes » dont les habitants
ont la particularité de posséder la citoyenneté
française. Progressivement, les régions du Fleuve,
de la Petite côte, du Sine-Saloum, du Baol et de la Casamance
sont équipées, au point qu'en 1900 le réseau
télégraphique est long de 3 196 kilomètres
et couvre tous les points du territoire sénégalais
ayant une importance administrative, militaire ou économique
Les bureaux de poste disposant du télégraphe
sont habilités à envoyer et recevoir des télégrammes,
tant officiels que privés, mais l'Administration coloniale
en est le principal utilisateur. Elle bénéficie
d'un droit de franchise qui lui permet d'envoyer gratuitement
des dépêches officielles et lui donne la priorité
pour l'envoi des télégrammes. Ce régime
préférentiel fait que les fonctionnaires privilégient
l'envoi de télégrammes par rapport au courrier
postal avec pour conséquence de peser négativement
sur la rentabilité économique du télégraphe.
Cependant, à partir de 1919, l'Administration coloniale
décide de privilégier l'exploitation commerciale
du télégraphe ce qui la conduit à supprimer
le droit de franchise dont elle bénéficiait auparavant
et l’oblige désormais à payer pour l’utilisation
des services télégraphiques.
Le déploiement du télégraphe
s'inscrit dans la logique de l'entreprise coloniale qui vise,
d'une part, à s'assurer le contrôle militaro-administratif
du territoire en vue d'y faire régner l'ordre colonial
et, d'autre part, à faciliter les communications permettant
d'exploiter ses ressources. De ce fait, en dehors des fonctionnaires
et des militaires coloniaux, les principaux utilisateurs du
télégraphe sont les commerçants et les
métis qui constituent un groupe social très influent
à Saint-Louis [Mbaye, 1980] et à Gorée.
Quant aux autochtones, ils en sont des utilisateurs marginaux,
maintenus qu'ils sont à la périphérie de
la société coloniale par le Code de l'indigénat.
Bien qu'ouverte aux usages privés, l'utilisation du télégraphe
reste contraignante du fait de la nécessité d’encoder
et de décoder les messages, ce qui limite l'expansion
de cet outil.
sommaire
La connexion au système mondial capitaliste
La modernisation des communications avec l'extérieur
prend place dans le dernier quart du XIXe siècle avec
la construction de câbles sous-marins reliant le Sénégal
au reste du monde. Le premier est installé en 1885 par
la Spanish Submarine Telegraph Company qui, dans le cadre de
la convention franco-espagnole du 2 mai 1884, pose un câble
reliant Cadix (Espagne) à Yoff (Sénégal)
en passant par Ténériffe (Canaries) et Saint Louis.
En 1886, ce câble est prolongé jusqu'à Luanda
(Angola) par la West African Telegraph Company , permettant
à la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Dahomey
et le Gabon d'être connectés à ce réseau.
En 1892, un troisième câble allant de Dakar à
Recife (Brésil) est déployé par la South
American Cable Company, reliant ainsi le Sénégal
à l'Amérique latine. Enfin, un câble allant
de Brest (France) à Dakar est construit en 1905 par la
Société industrielle des téléphones
(SIT) , assurant une certaine redondance au système et
permettant surtout à la France de s'affranchir du monopole
britannique sur les câbles sous-marins.
La construction d'un réseau télégraphique
local et de liens permanents entre la France et le Sénégal
symbolise la pérennisation de la connexion de l'Afrique
au système capitaliste mondial. Ces câbles arriment
en effet, au propre comme au figuré, le Sénégal,
pays de la périphérie, au cœur du système
capitaliste, à l’époque localisé en
Europe de l’Ouest. Ils contribuent notamment à organiser,
dominer, exploiter et influencer son économie au profit
de la métropole coloniale. En effet, bien qu’initié
au milieu du XVe siècle avec l'arrivée des premiers
navigateurs portugais, ce processus de domination n'a véritablement
pris forme qu'à partir du XVIIe siècle avec le
développement du commerce triangulaire. Il était
cependant fragile car les communications dépendaient
uniquement des navires assurant la liaison avec la métropole.
Cet amarrage du Sénégal à la France se
met en place durant la période qui précède
la naissance de l'Afrique occidentale française (AOF),
entité administrative dont l'avènement marque
la fin de la « conquête coloniale »
suite à l'anéantissement des dernières
résistances armées et le triomphe de l'ordre colonial
qui vise à « La mise en valeur des colonies ».
L'importance prise par les télécommunications
est d’ailleurs telle que les autorités coloniales
créent en 1903 une Inspection des postes et télégraphes
de l'AOF. Comme pour bien marquer les rapports asymétriques
existant entre le centre et la périphérie du système
colonial, la gestion des câbles sous-marins reliant le
Sénégal au reste du monde relève de la
métropole tandis que le réseau intérieur
desservant le Sénégal est du ressort de l'administration
locale.
sommaire
Du téléphone aux télécommunications
spatiales
Exploité commercialement en France à
partir de 1885 par la Société générale
des téléphones (SGT) et transformé en monopole
d'État à partir de 1889, le téléphone
est introduit au Sénégal en 1901.
À l'époque, le parc d'utilisateurs se limite à
une centaine d'abonnés répartis entre Saint-Louis,
Dakar et Rufisque .
Les investissements publics étant entièrement
à la charge des colonies, le réseau téléphonique
reste à un stade embryonnaire pendant plusieurs décennies.
Une première rupture s'opère en 1943
avec la construction du central téléphonique
automatique de Dakar-Ponty d'une capacité de
900 lignes.
Cependant, ce n'est qu'après la Seconde guerre mondiale,
grâce notamment au Fonds d'investissement pour le développement
économique et social des territoires d'outre-mer (FIDES),
que des moyens significatifs sont mobilisés en vue de
développer le réseau téléphonique.
C’est ainsi que le central de Dakar-Ponty voit ses capacités
passer à 2 000 lignes en 1948, puis à 3 000
en 1950 auxquelles viennent s'ajouter 3 000 lignes supplémentaires
en 1953 avec la construction du central téléphonique
de Dakar-Médina.
La dernière innovation de l'ère coloniale consiste
en l'introduction du télex en 1957.
Si des progrès notables ont été faits pour
développer les télécommunications au Sénégal,
force est de constater que le déploiement de l'infrastructure
s’est, pour l'essentiel, limité aux concentrations
urbaines et principalement à Dakar.

Juin 1960 la population sénégalaise se réjouissant
de la proclamation de leur indépendance.
En 1960, lorsque le Sénégal
accède à la souveraineté internationale,
les services de télécommunications passent sous
la tutelle de l'Office des postes et télécommunications
(OPT) et le pays se dote d'un Comité national de coordination
des télécommunications (CNCT).
Les statistiques établies l'année suivante indiquent
que le réseau téléphonique totalise
quelques 9 857 abonnés et comporte 109 lignes
à usage public sous forme de cabines téléphoniques
installées dans les bureaux de poste pour une population
de 3 557 989 habitants.
La répartition géographique des abonnés
révèle que 70 % des lignes principales sont
concentrées à Dakar et que 89 % des lignes
téléphoniques du pays sont situées dans
les centres urbains.
Malgré les nouvelles dynamiques politiques, économiques,
culturelles et sociales nées de l'indépendance,
le nombre d'abonnés progresse lentement et, en
1968, le Sénégal, dont la
population s’élève désormais à
4 195 353 habitants, atteint tout juste le seuil des
10 000 abonnés, dont 7 500 « privés »
et 2 500 « administratifs » .
En termes de répartition géographique, la région
du Cap-Vert, qui abrite la capitale du pays, concentre 81 %
des lignes privées et 47 % des lignes utilisées
par l'administration. La même polarisation se retrouve
à l'échelle des capitales régionales dont
la plupart détiennent entre les trois quarts et la moitié
des lignes installées dans leurs limites administratives.
La configuration du réseau est telle que les zones qui
n’abritent pas d’activités économiques
d'importance nationale s'en trouvent exclues et sa cartographie
montre qu’il couvre principalement la façade atlantique
qui constitue en quelque sorte le pays « utile ».
Paradoxalement, les télécommunications
internationales sont toujours gérées par l'ancienne
métropole via France Câbles et Radio (FCR).
Le schéma, également mis en place dans les autres
pays anciennement sous tutelle française, consiste pour
FCR à mettre en place les moyens nécessaires à
la création, au développement et à l’exploitation
des télécommunications internationales, en assumant
toutes les charges liées aux investissements comme aux
frais d’exploitation pour, en contrepartie, être
rémunéré sur la base d'une quote-part sur
les recettes générées par l’exploitation
du trafic acheminé, le solde revenant à l'État
sénégalais.
En 1968, l'État décide de séparer
la gestion des télécommunications nationales et
internationales en confiant ces dernières à la
société TéléSénégal,
société d’économie mixte, cogérée
par l'Office des postes et télécommunications
(OPT) pour le compte du Sénégal et par FCR pour
le compte de la France. Ce changement institutionnel est dicté
par l'apparition des télécommunications par satellite
qui, étant gérées à l'échelle
internationale par le consortium Intelsat pour les questions
opérationnelles sous la supervision de l’Union internationales
des télécommunications (UIT) pour l’allocation
des fréquences, font de chaque pays le pilote de son
propre système.
Dans ce cadre, une politique de modernisation des liaisons internationales
est entreprise avec la construction, en 1972, de la station
terrienne de télécommunications spatiales de Gandoul.
Première du genre sur le contient africain, elle conduit,
à partir de 1978, à l'automatisation des
communications internationales et du télex .
Ce dispositif est complété par la mise en service
des câbles sous-marins Antinéa entre le Sénégal
et le Maroc en 1977, Fraternité entre le Sénégal
et la Côte d'ivoire en 1978, Atlantis 1 entre le Sénégal
et le Brésil en 1982 et Atlantis 2 entre le Sénégal
et le Portugal en 1982.
sommaire
L'heure des premières réformes institutionnelles
La période allant de l'indépendance
au milieu des années 80 a vu le réseau de télécommunications
s’étendre dans les zones urbaines .
De son côté, l’architecture institutionnelle
du secteur a peu évolué si l'on excepte la nationalisation
de TéléSénégal. Cette décision
a été prise suite au constat fait par l’État
sénégalais que les télécommunications
internationales se développaient fortement sans qu’il
n'en retire un grand bénéfice. Le Sénégal
a alors entamé des négociations avec la France
à l'issue desquelles ses parts dans le capital de TéléSénégal
sont passées, dans un premier temps, de 26 % à
51 % en 1976. Finalement, ce processus a abouti à
la nationalisation de TéléSénégal
en 1981 avec le rachat, sur plusieurs années, et grâce
aux bénéfices dégagés par l'opérateur,
des 49 % encore détenus par FCR.
C’est dans ce contexte qu’Alassane Dialy Ndiaye, alors
directeur général de TéléSénégal,
rédige un rapport à l'attention du Président
de la République dans lequel il recommande de réunir
les télécommunications nationales et internationales
au sein d'une entité unique. Cette réflexion aboutit
en 1983 à l'organisation des Journées nationales
des télécommunications qui dressent un bilan peu
reluisant de la situation (seulement 20 500 lignes téléphoniques
pour huit millions d'habitants) et concluent à la nécessité
de séparer les activités postales de celles de
télécommunications.
En 1985, l'État lance la première grande réforme
de ce secteur qui débouche sur l'éclatement de
l'OPT avec la création, d'une part, de l'Office de la
poste et de la caisse d'épargne (OPCE) et, d'autre part,
de la Société nationale des télécommunications
du Sénégal (Sonatel). Par ailleurs, l'État
décide de donner la priorité au développement
des télécommunications dans le VIIe Plan de développement
économique et social (1985-1989) en fixant quatre objectifs
à la Sonatel à savoir
(1) développer une infrastructure hautement productive
et capable de stimuler l'activité économique nationale,
(2) améliorer l'accès aux télécommunications,
(3) faciliter le développement des banques de données
nationales et
(4) susciter l'implantation d'une industrie locale ou régionale
des télécommunications.
Autre décision prise par les autorités, celle
de mettre en œuvre un plan d'urgence et de rattrapage du
réseau national des télécommunications
afin de le moderniser et d'en étendre la couverture.
Cette politique s’inscrit dans le Plan d'action de Lagos
pour le développement économique de l'Afrique
(1980-2000), adopté par l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), qui accorde un rôle primordial aux télécommunications.
sommaire
La modernisation et la diversification des services
Cette politique porte ses fruits puisque le
nombre d’abonnés à la téléphonie
fixe est porté de 23 000 en 1985 à 116 000
en 1997 pour finalement atteindre les 200 000 abonnés
en 2000, soit une densité téléphonique
de 12 pour 1000 habitants , la plus élevée d'Afrique
de l'Ouest à l’exception du Cap-Vert. Cependant,
la couverture géographique du réseau est toujours
aussi inégale avec une concentration de près de
70 % des lignes dans la capitale. En 1991, la Sonatel créé
avec France Câbles et Radio (FCR) une filiale dénommée
Télécomplus9 dont la vocation est de développer
les produits et services liés aux TIC. À partir
de 1992, elle expérimente notamment, des « télécentres »
offrant des services de téléphonie, de télécopie
et de photocopie. L’expérience est un échec
car ces structures s’avèrent peu rentables mais
elle donne naissance à ce qui deviendra une véritable
« success story », à savoir les
télécentres privés. Lancés en 1993,
ils consistent en des espaces gérés et aménagés
par des sociétés privées qui, dans le cadre
d'un contrat signé avec la Sonatel, sont autorisées
à revendre des services de télécommunications
(téléphonie et télécopie). Répondant
au fort besoin de communication des Sénégalais,
leur nombre passe d'un peu plus d'une centaine en 1993 à
plus de 25 000 en 2006, créant des milliers d'emplois,
générant un important chiffre d'affaires et, surtout,
contribuant fortement à démocratiser l'accès
au téléphone. Cependant, à partir de 2007,
concurrencés par la téléphonie mobile,
ils perdent en intérêt pour les consommateurs et
en rentabilité pour leurs exploitants, ce qui entraîne
un mouvement de fermetures massives à tel point qu'en
décembre 2011, il en reste un peu moins de trois mille
dans l'ensemble du pays.
D’autres innovations interviennent comme la numérisation
complète du réseau de transmission et la mise
en service en 1988 de SENPAC, réseau de transmission
de données par paquets de type X25. Cette infrastructure
permet de lancer en 1994 les services vidéotex nationaux
(Vidéotel) et internationaux (Minitelnet). Cependant,
le Minitel ne rencontre guère de succès du fait
de la cherté du terminal et des frais de communications
mais également faute de l’existence d'une masse
critique de services utiles. Par contre, le kiosque audiotex
(télématique vocale), lancé en 1995 sous
le nom d’Infotel, est bien mieux accueilli du fait qu'il
ne nécessite pas l’acquisition d'un terminal spécifique,
présente une gamme de services plus étendue, permet
de contourner l’obstacle de l’analphabétisme
et intègre l’utilisation du wolof, qui joue le rôle
de lingua franca au Sénégal.
Fortement influencée par la politique
de France Télécom qui, à l'époque,
mise sur le Minitel, la Sonatel ne s’intéresse guère
au développement d'Internet. Les acteurs de certains
segments de la société, opérant notamment
dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche
ainsi que dans le milieu des organisations non gouvernementales
(ONG), sont obligés de trouver des solutions alternatives
pour accéder aux réseaux de messagerie électronique.
C'est ainsi que, dès la fin des années 80, l'ORSTOM11
installe un nœud du « Réseau intertropical
d'ordinateurs » (RIO) qui donne naissance au premier
système de messagerie électronique installé
au Sénégal. Quelques années plus tard,
c'est au tour d'Enda Tiers-Monde de mettre en place un nœud
du réseau GreenNet, créé par l’Alliance
for progressive communication (APC), qui offre des services
similaires aux ONG. Ces systèmes fonctionnent sur la
base de vacations pour l'envoi et la réception des messages
et ne permettent donc pas une communication en temps réel.
À l’occasion du Troisième sommet Africain/Africain-Américain
en mai 1995 à Dakar, la première connexion permanente
à Internet est réalisée, à titre
expérimental, avec l’installation d’un lien
VSAT d’un débit de 64 Kbps. Fortement médiatisée,
l’opération rencontre un vif succès et le
grand public, qui ne connaissait d’Internet que ce qu’en
disaient les médias, prend conscience des opportunités
offertes par cet outil.
La Sonatel est alors obligée de revoir sa position et
lance, en juillet 1995, un appel d’offres pour la mise
en place d’un point d’accès permanent à
Internet. En novembre 1995, la pression s’accentue avec
l’envoi au Président de la République d’un
mémorandum rédigé par un groupe d’universitaires,
demandant la connexion du Sénégal à Internet.
La question, qui n’était débattue que dans
des cercles restreints, gagne la sphère publique et le
Président Abdou Diouf annonce, dans son discours de fin
d’année à la nation, la connexion du Sénégal
à Internet pour le début de l’année
1996. Finalement, en mars 1996, la Sonatel met en service une
connexion permanente à Internet via une liaison d’un
débit de 64 kbps avec le satellite Intelsat 635 de la
société américaine MCI. Le mois suivant,
sa filiale Télécomplus commercialise les premiers
abonnements à Internet, marquant ainsi les débuts
de l’Internet public au Sénégal. Dans un
premier temps, les utilisateurs peuvent uniquement se connecter
via le réseau téléphonique commuté
(RTC) avec des débits ne dépassant pas les 64
kbps mais, en 2003, la Sonatel lance l'ADSL12, offrant des débits
qui seront progressivement portés de 128 kbps à
1 Mbps13. Cependant, quinze ans après l’arrivée
d’Internet, son taux de pénétration reste
faible puisqu’il ne concerne que 15,7 % de la population
confronté qu’il est à des obstacles qui ont
pour noms analphabétisme numérique, cherté
de l’équipement informatique, faible nombre d’applications
et de services utiles aux citoyens, rareté des contenus
locaux, etc.
sommaire
La fulgurante expansion de la téléphonie mobile
Cependant, l'innovation majeure est sans aucun
doute l'introduction de la téléphonie mobile en
septembre 1996 avec le lancement du réseau GSM Alizé
de la Sonatel. Au départ, le service n'attire guère
le grand public car son ticket d'entrée est particulièrement
cher. En effet, Alizé propose une formule post-payée
qui implique l'achat d'un téléphone portable et
le paiement de frais d'abonnement mensuels auxquels viennent
s'ajouter les frais de communication. Dans ces conditions, une
étude faite par l'Union internationale des télécommunications
(UIT) en 1998 prévoyait que le seuil des 30 000
abonnés ne serait atteint qu'en l'an 2000. En réalité,
l'année 2000 voit non seulement le nombre de clients
franchir la barre des 200 000 abonnés mais également
dépasser celui de la téléphonie fixe. Il
faut dire qu'entre temps, en avril 1999, un second opérateur,
Sentel, est arrivé sur le marché avec une formule
prépayée qui a obligé Alizé à
investir ce créneau qu'il avait négligé
dans un premier temps. La concurrence ayant fortement fait baisser
le prix des abonnements comme celui des communications, la croissance
du marché de la téléphonie mobile a pris
des proportions impressionnantes avec un million d'abonnés
en 2004, trois millions en 2006 et cinq millions en 2008. La
concurrence s’est encore accrue à partir de 2009
avec l’arrivée d’Expresso, portant en 2011
le nombre d’abonnés à 9 352 868
et le taux de pénétration de la population à
76,84 %, pendant que la téléphonie fixe ne compte
guère que 346 406 abonnés soit un taux de
pénétration de 2,85 %.
La progression du nombre d’abonnés s'accompagne
d'une expansion de la couverture géographique des réseaux
de téléphonie mobile.
C'est ainsi que le réseau, qui ne couvrait à l'origine
que Dakar, les principales villes du pays et quelques grands
axes routiers, couvre aujourd'hui plus de 90 % de la population
et 95 % des villages de plus de 500 habitants. De plus, nombre
d’innovations ont été apportées avec
notamment le lancement du GPRS16 par la Sonatel en décembre
2005 puis celui de la technologie EDGE17 à partir de
2006. En 2010, la 3G18 fait son apparition à l’initiative
d’Expresso, suivi en 2011 par la Sonatel, autorisant par
là même le développement de l’Internet
mobile. Parmi les facteurs qui concourent à l'expansion
de la téléphonie mobile, il faut également
citer les nombreuses promotions organisées par les opérateurs
qui contribuent à faire baisser le coût réel
des communications. Enfin, le prix des téléphones
portables a considérablement chuté et il est désormais
possible de trouver des appareils neufs à des prix très
abordables sans parler des opportunités offertes par
le marché des appareils d’occasion.
Tiré par le sous-secteur de la téléphonie
mobile, le secteur des télécommunications occupe
désormais une place déterminante dans l'économie
sénégalaise, tant du point de vue des investissements
consentis, du chiffre d'affaires réalisé, des
taxes et impôts versés que des emplois directs
et surtout indirects créés et du rôle transversal
qu'il joue dans la société. Si l’on se réfère
uniquement à la Sonatel, cette société
a investi entre 2000 et 2010 près de 961 milliards de
FCFA21, ce qui en fait le premier investisseur du pays. Son
chiffre d'affaires est passé de 126 milliards de FCFA
en 2000 à 599 milliards de FCFA en 2010 soit une progression
de plus de 375 % en un peu plus d'une décennie. À
travers les télécentres privés puis la
revente de recharges téléphoniques et la sous-traitance,
elle a créé des dizaines de milliers d’emplois.
Mieux, elle est devenue un groupe de télécommunications
international opérant en Guinée, en Guinée-Bissau
et au Mali.
Du point de vue de l’utilisation de ces
outils, malgré une fracture numérique réelle
recoupant la fracture sociale qui divise la société
sénégalaise, le temps est bien loin où
ils étaient réservés à une petite
minorité. Le téléphone s’est banalisé,
Internet est de plus en plus utilisé par l’État,
le secteur privé et les citoyens, le Web et les réseaux
sociaux sont devenus des extensions de la sphère publique
où naissent et se développent toute sorte de débats,
y compris les débats politiques, offrant ainsi de nouveaux
espaces à la liberté d’expression et aux
dynamiques citoyennes. Cela étant, ces éléments
« flatteurs » ne doivent pas être
l’arbre qui cache la forêt, à savoir la capture
du secteur des télécommunications par les multinationales
étrangères à l'occasion de sa libéralisation.
sommaire
Quand libéralisation rime avec dépossession
Bien gérée, non déficitaire,
ayant contribué à démocratiser l’accès
au téléphone notamment grâce aux télécentres,
même si la question de la téléphonie rurale
restait irrésolue, la Sonatel n'a pourtant pas échappé
à la vague de privatisations lancée au milieu
des années 80. Suite à la signature de l'Accord
général sur la commercialisation des services
(AGCS) en 1994, les autorités sénégalaises,
dont la politique économique était largement dictée
par la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international
(FMI) dans le cadre d'un Plan d'ajustement structurel (PAS),
ont adopté, en 1995, une loi permettant la privatisation
de la Sonatel. Elle a été complétée
par l'adoption d'un nouveau Code des télécommunications
qui a introduit une concurrence limitée dans le secteur
de la téléphonie mobile et une concurrence totale
dans celui des services à valeur ajoutée. En 1996,
un appel d’offres international pour la sélection
d’un « partenaire stratégique » a abouti
à la cession de 33 % du capital de la Sonatel à
France Télécom pour la somme de 70 milliards de
FCFA, 17,6 % étant vendus au grand public et à
des investisseurs institutionnels, 10 % réservés
aux travailleurs et retraités de la société
et 5 % à un opérateur africain. Cependant, en
1999, l'État vend 9 % de ses actions à France
Télécom et voit sa part dans le capital de la
Sonatel passer à 27,67 %, perdant ainsi toute capacité
d'exercer sa minorité de blocage au sein du conseil d'administration
et de peser sur les choix stratégiques.
Dans le sillage de cette privatisation, la prise
de contrôle progressive du secteur des télécommunications
par des firmes étrangères n’a fait que s'accentuer
au fur et à mesure que s'approfondissait le processus
de libéralisation de l'économie. Ainsi, en 1998,
le gouvernement a accordé une licence de téléphonie
mobile à Sentel, société dont le capital
était détenu à 75 % par la firme luxembourgeoise
Millicom International Cellular (MIC) et à 25 % par un
investisseur privé sénégalais. Cependant,
en mars 2006, MIC a racheté les parts de son partenaire,
devenant ainsi une société à capitaux et
intérêts entièrement étrangers. L'octroi
de la troisième licence de télécommunications
a renforcé la tendance à l'exclusion des nationaux
du secteur des télécommunications, pourtant l’un
des plus rentables de l’économie et l’un des
plus stratégiques pour le pays. En effet, malgré
la mobilisation de l'Organisation des professionnels des TIC
(OPTIC) qui avait exigé que l'État lui réserve
au moins 51 % des parts du capital de l'opérateur devant
être sélectionné, elle n'en obtiendra finalement
que 15 % bien qu'ayant entre-temps ramené ses prétentions
à 30 %.
La reprise en main du secteur des télécommunications
par des firmes étrangères ne s'est pas arrêtée
là. Elle s'est également attaquée aux symboles
que représentent les marques commerciales utilisées
localement par les opérateurs. Ainsi, la marque commerciale
Hello, sous laquelle Sentel avait développé ses
activités au Sénégal depuis avril 1999,
a-t-elle été abandonnée, en novembre 2005,
au profit du label Tigo utilisée par MIC à travers
le monde. Confirmant cette tendance à l'uniformisation
des marques au nom de la globalisation, le nom de l'opérateur
Sentel, officiellement titulaire de la licence de téléphonie
mobile, a progressivement disparu dans la politique de communication
de l'entreprise au profit de Tigo. Sur un plan subjectif, cela
a entraîné la dilution du caractère « national »
de l'opérateur puisque le vocable Sentel associait, aussi
bien en français qu'en wolof, les notions « Sénégal »
et « télécommunications ».
Une année plus tard, ce même processus a été
mis en œuvre par France Télécom avec le remplacement
des marques commerciales Alizé (téléphonie
mobile), Sentoo (Internet) et Keurgui TV (télévision
sur Internet) par la marque Orange . Le plus cocasse dans cette
affaire est que la Sonatel doit désormais s’acquitter
de « branding fees » pour être autorisée
à utiliser la marque Orange qui lui est imposée par
sa maison mère !
Toute marque à connotation nationale
ayant disparu du paysage des télécommunications,
la firme soudanaise Sudatel n'a même pas essayé
d'utiliser une marque faisant « couleur locale »
lors de son entrée sur le marché sénégalais
en janvier 2009, mais s’est contentée d'utiliser
Expresso, label utilisé par toutes les filiales étrangères
du groupe.
Cependant, la perte d’identité que
constitue la substitution de labels « globaux »
aux marques locales ne constitue qu’un épiphénomène
au regard du processus beaucoup plus fondamental de dépossession
et de domination économique qui s'est opéré
au nom de la privatisation des opérateurs historiques
et de la libéralisation de l'économie. La principale
conséquence de ces réformes est d’avoir fait
entièrement passer le secteur des télécommunications
sous la coupe d’opérateurs étrangers et principalement
sous celle de l'opérateur historique de l'ancienne puissance
coloniale . D'ailleurs, à l'occasion de la tentative
de l'État sénégalais de céder 9,87
% de ses actions à France Télécom qui aurait
alors détenu 52,2 % du capital de la Sonatel, les syndicats
de travailleurs n'ont pas hésité à dénoncer
une tentative de « recolonisation » des
télécommunications [AFP, 2009].
sommaire
Conclusion
Cent cinquante ans après la construction
de la première ligne télégraphique pour
les besoins de la domination coloniale, les télécommunications
jouent un rôle majeur dans le processus de développement
politique, économique, social et culturel du Sénégal.
Jadis réservées à une minorité,
elles sont désormais utilisées par la plupart
des secteurs d’activité et catégories sociales.
L’infrastructure, encore embryonnaire à la fin de
l’ère coloniale, a été considérablement
étendue et modernisée à travers la mise
en œuvre de politiques publiques qui ont accordé
une haute priorité au secteur. Les télécommunications
spatiales ont été introduites, les connexions
au réseau mondial des câbles sous-marins multipliées,
le réseau national numérisé et une large
gamme de services proposée. Les télécentres
puis la téléphonie mobile ont démocratisé
l’accès au téléphone, les cybercafés
puis l’Internet mobile ont popularisé l’utilisation
d’Internet. Contribuant pour plus de 7 % au PIB, les télécommunications
sont devenues l’un des moteurs de la croissance du pays
et l’Internet et les réseaux sociaux jouent un rôle
croissant dans la sphère publique et dans la vie quotidienne
des Sénégalais et des Sénégalaises.
Cependant, du fait des politiques libérales dictées
par les bailleurs de fonds, ce secteur, tout aussi stratégique
que rentable, échappe désormais au contrôle
des nationaux et les richesses qu’il génère
profitent essentiellement aux multinationales. Jadis outil de
la domination coloniale, les télécommunications
se sont donc transformées en l’un des principaux
instruments de la domination multiforme imposée au Sénégal
dans le cadre de la mondialisation capitaliste.
|
sommaire
Contexte
de l'AOF Afrique Occidentale Française et le Sénégal
La Côte d'Ivoire
|
Les télécommunications sur le
territoire qui deviendra la Côte d'Ivoire précèdent
en effet la naissance du pays : la première liaison
télégraphique est achevée en 1887 après
que le gouvernement français autorise la société
britannique Western African Telegraph Company à ouvrir
un bureau télégraphique à Grand-Bassam,
reliant ainsi le pays au câble sous-marin reliant
Dakar (Sénégal), Freetown (Sierra Leone), Monrovia
(Libéria), Accra (Ghana), Cotonou (Bénin) et Libreville(Gabon).
1893 Fondée au milieu du XIXe
siècle par l'amiral Mequet, la ville de Grand Bassam
est, de 1893 à 1899 le principal centre administratif
français.
En 1899 , le centre est transféré à Bingerville,
à la suite d'une épidémie de fièvre
jaune : sur les 60 Européens présents dans la
ville, 45 en décèderont. De nouvelle épidémies
auront également lieu entre 1900 et 1903.
1893 La ville de Grand-Bassam a accueilli le centre
de télégraphie sous-marine reliant le "territoire
de la Côte d'Ivoire" à Conakry , "territoire
de Guinée" d'une part, et à Cotonou , "territoire
du Dahomey" qui était la seule liaison ouverte sur
l'extérieur, de l'autre.
La station de câbles sous-marins, aussi dénommée
la « maison aux mille pieds », était
située après la sortie du pont qui traversait
la lagune, à gauche le long de la lagune et deuxième
rue sur la droite, et faisait face à une école
de sœurs.
C'est dans la station de câbles, construite à l'origine
par les Allemands, que se serait déroulée la première
messe. Cette « maison des câbles »,
d'une superficie de 400 m2, comportait un rez-de-chaussée
surélevé où se trouvaient les services
d'exploitation et un étage où logeaient le chef
de centre et sa famille. Le bureau de la poste y a été
installé en 1945 .
La première liaison télégraphique nationale
entre Grand-Bassam, Jacqueville et Grand-Lahou le long de la
côte est ouverte en octobre 1894.
En 1895, le premier service téléphonique
ivoirien est installé entre Grand-Bassam et Assinie (emplacement
du premier bureau de poste du pays), grâce à un
câble aérien de 50 kilomètres de long. Cette
même année, les deux villes sont reliées
à Alep et Jacqueville. Les premières lignes téléphoniques
urbaines du pays apparaissent à Grand-Bassam et Bingerville
en 1903 et à Abidjan en 1910 — qui bénéficie
du premier central téléphonique urbain du pays
(dix abonnés) — puis à Bouaké. Il
faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'adoption
de nouvelles politiques de valorisation des colonies, notamment
la création du FIDES (Fonds d'investissement pour le
développement économique et social) en 1946, pour
que l'équipement téléphonique reprenne
et s'étende au cœur du pays.
Le système postal et télégraphique
ivoirien s'est répandu à l'intérieur du
pays et le long de la côte jusqu'aux frontières
du Libéria et du Ghana, suivant le rythme et les sentiers
de la conquête, ainsi que l'exploitation du pays par la
force coloniale.
Le nord du pays est relié par télégraphe
à Dakar via Bamako (Mali), puis relié au reste
du pays en 1902.
En 1909, un accord est conclu pour établir une ligne
téléphonique entre Grand-Bassam et Accra.
En décembre 1905, il y avait 47
bureaux de poste, dont 33 offraient des services complets -
postaux et télégraphiques - et 6 offraient uniquement
un service téléphonique. A cette époque,
le câble télégraphique ivoirien mesurait
3 260 kilomètres.
Les premières liaisons radiotélégraphiques
avec les territoires voisins sont ouvertes en 1930, avec la
liaison de Bamako utilisée pour l'écoulement du
trafic vers la France.
Jusqu'en 1945, toutes les télécommunications intérieures
de la Côte d'Ivoire se faisaient par télégraphe.
Le centre d'émissions radioélectriques d'Akouedo-Bingerville
est installé en 1943, et en 1957 le centre de réception
radioélectrique d'Abidjan-Marcory est mis en service.
Ces deux centres assuraient la quasi-totalité des télécommunications
internationales de la Côte d'Ivoire.
Dans l'après-guerre, les liaisons
téléphoniques suivantes ont été
établies : Abidjan à Grand-Bassam (1949), Abidjan
à Dabou (1951), Abidjan à Agboville (1952) et
Dabou à Tiassalé, Gagnoa à Divo, Dimbokro
à Bongouanou et Agboville à Abengourou entre 1954
et 1959.
Les lignes urbaines de Dimbokro et d'Agboville sont construites
en 1954.
En 1955 le premier central téléphonique
automatique d'une capacité de 2 000 lignes est mis
en service à Abidjan. En 1958, une onde électromagnétique
est installée entre Abidjan et Aboisso.
Au cours des années 1950, des
liaisons téléphoniques sont établies avec
les pays voisins de la Côte d'Ivoire : Sénégal,
Soudan (actuel Mali), Haute-Volta (actuel Burkina Faso), Dahomey
(actuel Bénin), Togo, Ghana, Nigéria, Guinée,
et Mauritanie.
Une liaison radioélectrique directe a été
ouverte entre Abidjan et Paris en 1959.
Au moment de l'indépendance en 1960, le système
téléphonique national de la Côte d'Ivoire
était composé de 100 kilomètres d'ondes
électromagnétiques, 1 325 kilomètres de
câbles aériens et 125 kilomètres de câbles
souterrains.
Sur la scène internationale, on compte douze liaisons
africaines et une liaison avec l'Europe via Paris.
Le nombre d'abonnés au téléphone
passe de 591 en 1950 à 3 667 en 1960, ce qui représente
0,11 téléphone pour 100 habitants. Sur le nombre
total d'abonnés, 69,8 % étaient des résidents
d'Abidjan.
Le premier gouvernement ivoirien nommé
en 1959 comprenait un secrétaire d'État aux postes
et télécommunications. Le 1er avril de la même
année, un bureau pour ces services est créé
et les télécommunications internationales sont
confiées à la société française
France Câbles et Radio (FCR).
En août 1960, la Côte d'Ivoire obtient son indépendance
et le mois suivant est admise à l'UIT
(Union Internationale des Télécommunications).
Elle a continué à équiper son infrastructure
de télécommunications en mettant l'accent notamment
sur les liaisons internationales, ce qui traduisait clairement
sa volonté de s'insérer dans les systèmes
d'échanges internationaux. Le résultat de cet
accent a été l'émergence d'une économie
qui est encore considérée par certains comme étant
de nature extravertie. Par conséquent, les télécommunications
nationales ne sont pas considérées comme une priorité
nationale en Côte d'Ivoire : la décision a été
prise de longue date de développer les routes du pays
afin d'acheminer ses matières premières vers le
port d'Abidjan.
En 1970, il y avait 97 réseaux téléphoniques
urbains en Côte d'Ivoire (dont quatorze étaient
automatisés) et 17 000 abonnés au téléphone,
dont 75 % résidaient à Abidjan. A cette époque,
le pays était relié à presque tous les
pays africains et à plus de soixante autres pays dans
le monde. En 1975, le nombre d'abonnés dans le pays est
passé à 28 000, soit 0,4 téléphone
pour 100 habitants. Le plan 1976-1980 visait à avoir
1 téléphone pour 100 habitants, un objectif qui
n'avait toujours pas été atteint au milieu des
années 1990. Ce même plan prévoyait la numérisation
du réseau du pays, qui s'est finalement concrétisée
en 1979 avec l'installation du premier central téléphonique
électronique provisoire (un E-10 d'Alcatel).
En 1985, 54 675 abonnés étaient
enregistrés, ce qui porte le taux de pénétration
du pays à un peu moins de 0,6 téléphone
pour 100 habitants. Il y avait 68 380 abonnés en 1990,
soit 0,57 téléphone pour 100 habitants. La répartition
géographique des abonnés reflète fidèlement
la répartition des activités économiques
du payset la concentration urbaine de la population ivoirienne,
en particulier l'importance d'Abidjan. En 1977, par exemple,
74,7 % des abonnés au téléphone du pays
résidaient à Abidjan alors que Bouaké,
la deuxième ville, n'en comptait que 3,3 % et les autres
villes moins de 2 % chacune. L'importance d'Abidjan est restée
constante jusqu'au début des années 1990 : à
la fin de 1992, la proportion d'abonnés au téléphone
ivoiriens qui vivaient à Abidjan atteignait 75,2 % alors
que la ville elle-même ne comptait que 20 % de la population
du pays.
Même à l'intérieur d'Abidjan,
la couverture téléphonique est inégalement
répartie et reflète la répartition spatiale
des activités économiques et des classes sociales.
En effet, les zones téléphoniques à forte
densité regroupent les ambassades, les industries, les
services et les administrations, ainsi que les populations à
hauts revenus (Européens, Américains, Africains
aisés). C'est ainsi qu'une commune comme Cocody compte
14 517 abonnés pour 120 000 habitants alors que Yopougon
et Abobo ne comptent que 7 682 abonnés pour plus d'1
million d'habitants.
Jusqu'à ce que le projet de développement
1986-1990 prévoyait d'améliorer la couverture
téléphonique des zones rurales de la Côte
d'Ivoire, ces régions étaient presque entièrement
dépourvues de téléphones. L'objectif était
de désenclaver certaines sous-préfectures semi-rurales
et de gros villages particulièrement actifs sur le plan
agricole et commercial en leur offrant vingt lignes reliées
par ondes électromagnétiques numériques
aux centraux téléphoniques automatiques d'une
grande ville. L'abonnement était facturé au tiers
du prix du service en zone urbaine. L'engouement pour le projet
a dépassé les prévisions de l'ONT et a
démontré qu'un réel besoin existait.
Le téléphone est un enjeu social
important en Côte d'Ivoire, ce qui se reflète dans
le nombre de demandes d'abonnements téléphoniques
traitées et dans l'utilisation du réseau installé.
Comme l'a déclaré un ancien ministre des Postes
et Télégraphes de Côte d'Ivoire : «
L'afflux instantané de trafic sur les lignes dès
qu'une connexion est automatisée en dit long sur la volonté
des gens d'être reliés au réseau. 1
En 1982, il y avait 27 000 demandes non
satisfaites rien qu'à Abidjan, qui comptait un nombre
total d'abonnés de seulement 33 000. Ces pressions de
la demande ont conduit à des actions illégales,
à des fraudes, à des pots-de-vin et à l'utilisation
d'influences et de relations pour accéder à un
téléphone.
Afin d'augmenter l'accès au téléphone,
des cabines publiques à jetons apparaissent à
Abidjan en 1974. Malheureusement, elles sont rapidement détruites
par des vandales et remplacées en 1978 par des bureaux
de télécommunications qui restent ouverts jusqu'à
20 heures et sont gérés par des agents de l'ONT.
. Certaines cabines téléphoniques pour le service
télex ont également été mises à
la disposition du public. En raison de la forte demande de services
téléphoniques, certaines personnes ont même
transformé leurs lignes privées en téléphones
publics, facturant à leurs clients des tarifs plus élevés.
En 1988, l'ONT a installé 206 cabines téléphoniques
de fabrication suisse fonctionnant par cartes magnétiques
à Abidjan et ailleurs.
Au fil du temps, le trafic des appels internationaux
en Côte d'Ivoire a augmenté de façon spectaculaire,
passant de 161 253 minutes en 1961 à 975 392 en 1970
et enfin à 4 848 663 minutes en 1975. Les principales
destinations appelées étaient l'Europe de l'Ouest,
les États-Unis, le Liban, la Francophonie. Afrique et
Maroc. Le nombre d'appels sortants a toujours été
supérieur à celui des appels entrantspays qui
sert à nouveau à indiquer la nature extravertie
de l'économie ivoirienne. En 1965, par exemple, le rapport
des appels sortants aux appels entrants était de 204
304 à 152 338 ; en 1970, il passe de 621 622 (sortants)
à 353 770 (entrants) ; et a continué à
s'élargir encore en 1975, avec 3 360 801 appels sortants
contre 1 487 862 appels entrants.
Services télex et télégraphe
Le trafic du télégraphe en Côte d'Ivoire
est passé de 7 782 836 mots en 1960 à 22 406 491
en 1975. En 1965, le pays comptait soixante-dix-sept centres
télégraphiques, dont vingt-sept étaient
utilisés par la radiotéléphonie en code
Morse et cinquante par la télégraphie filaire.
L'évolution du trafic télégraphique
international de la Côte d'Ivoire se traduit par des fluctuations
sensibles d'une année sur l'autre. Ces fluctuations semblent
coïncider avec l'évolution du téléphone
et du télex : à mesure qu'ils augmentent leurs
extensions et leurs capacités grâce à de
nouvelles installations, le trafic pour le télégraphe
diminue et commence ensuite à augmenter progressivement.
Ce fut le cas en 1966-1967, en 1972 (année où
la première station internationale de télécommunications
ivoirienne fut desservie par satellite), puis en 1976 et 1977.
En ce qui concerne le télex, le réseau
du pays est relié au centre télex d'Abidjan, qui
est équipé d'un commutateur automatique de 1 000
directions et fonctionne depuis 1961. Après 1977, le
centre offrait huit connexions africaines, six européennes
(France , Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas et Suisse),
une liaison avec les États-Unis et vingt et une autres
liaisons (dont le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Brésil,
le Canada, le Mexique, l'Afrique du Sud, la Suède et
les ex-Union soviétique). Le nombre d'abonnés
au télex en Côte d'Ivoire est passé de 54
en 1961 à 320 en 1970 à 736 en 1975, et le trafic
est passé de 117 459 minutes en 1961 à 1 4767
020 en 1975.
Autres services
Dans les années 70, la croissance spectaculaire de
l'informatisation du pays crée une demande insistante
de circuits téléphoniques spécialisés
pour la transmission de données. Afin de répondre
à cette demande, qui avait été évaluée
au moyen d'enquêtes auprès des utilisateurs réels
et potentiels des services de téléinformatisation,
il fut décidé de développer un réseau
national de téléinformatisation appelé
SYTRAN (Transactional Systems), qui fut mis en service en mars
1978. Il consistait en le sous-réseau d'Abidjan, le sous-réseau
national (reliant les six capitales régionales et la
ville portuaire de San Pedro) et le sous-réseau international.
Le réseau de téléinformatisation SYTRANPAC
a été mis en service en 1989, relié au
reste du monde par NTI (Nœud de Transit International)
à Paris. Enfin, la Côte d'Ivoire'
Transmission internationale
En 1971, la Côte d'Ivoire devient membre d'Intelsat.
Le pays a installé sa première station terrestre
à Akakro en novembre 1972 avec soixante circuits pour
sept connexions. Une autre station terrestre a suivi en 1978,
donnant au pays la capacité de recevoir et de transmettre
simultanément deux programmes de télévision.
En 1978, la Côte d'Ivoire participe à
la réalisation du câble sous-marin reliant la France,
le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire
d'une capacité de 4 800 circuits de 4 kilohertz. Il a
ensuite été étendu au Nigeria en 1981.
Le câble a été connecté à
la liaison du système de câbles Atlantis en Amérique
du Sud, en Afrique et en Europe, puis a été associé
au projet régional Panaftel, qui visait à relier
les pays africains entre eux par ondes radio. . Grâce
à ces projets, la Côte d'Ivoire a été
rattachée aux deux tiers des pays de la CEDEAO (Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest).
Au niveau de la coopération régionale
et interafricaine, la Côte d'Ivoire est membre de plusieurs
organisations telles que l'UPAT (Union Panafricaine des Télécommunications),
l'UAPT (Union Africaine des Postes et des Télécommunications)
et la CAPTEAO (Conférence Administrative des Postes et
Télécommunications pour les États de l'Afrique
de l'Ouest). Le pays participe également aux activités
liées aux télécommunications par le biais
de la CEA (Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique) et de la CEDEAO. Grâce à ses divers
projets et associations de transmissions internationales, la
Côte d'Ivoire était en 1980 reliée à
113 autres pays par téléphone automatique.
Organisation institutionnelle et réglementaire
Le ministère des Postes et Télécommunications.
Depuis 1959, les télécommunications ivoiriennes
étaient sous la tutelle administrative d'un département
ministériel, d'un secrétaire d'État, puis
d'un ministère, tandis que sa gestion était laissée
à un office public, toujours sous la tutelle et le contrôle
technique du ministère. Le ministère (Ministère
des Postes et Télécommunications) est chargé
de la conception et de la mise en œuvre de la politique
et de la réglementation du secteur des télécommunications
et de la poste. Vers la fin des années 1970, le ministère
comprenait des directions telles que l'inspection générale,
l'OPT (Office des postes et télécommunications),
l'INTELCI (Société internationale des télécommunications
de Côte d'Ivoire), l'IBPT, les relations extérieures,
les services pédagogiques de la PT (Postes et télécommunications)
, la téléinformatisation et les réseaux
spécialisés. En outre,
Les Structures Opérationnelles
. De 1959 à 1964, le secteur des postes et télécommunications
de Côte d'Ivoire était constitué d'un établissement
public à caractère industriel et commercial doté
d'une ligne directrice et bénéficiant d'une autonomie
financière. Le 1er janvier 1965, elle devient un établissement
public à caractère administratif et est dotée
d'un budget distinct de celui du budget général
de l'État, à l'instar de projets similaires comme
la RTI.
En 1975, l'OPT voit le jour avec deux directions
autonomes : la Direction générale des postes (DGP)
et la Direction générale des télécommunications
(DGT), ainsi qu'un conseil d'administration dirigé par
le ministre du PT. Le code PT de 1976 a donné à
l'OPT le monopole d'Etat pour l'exploitation des services publics
de la poste et des télécommunications.
Les télécommunications internationales
ivoiriennes sont restées entre les mains de la société
française France Câbles et Radio (FCR) jusqu'en
1969, date à laquelle la société ivoirienne
de télécommunications internationales INTELCI
a été créée après plusieurs
années de négociations avec FCR. Le capital de
la société était composé de 10 millions
de francs français, dont 52 % étaient détenus
par l'État ivoirien et les 48 % restants par le FCR.
Le gouvernement ivoirien a porté sa participation
à 80 % en 1976 lorsque le capital a été
porté à 400 millions de francs français.
En 1981, INTELCI est devenue la propriété exclusive
du gouvernement avant d'être liquidée en 1984,
les télécommunications internationales étant
confiées à l'ONT.
Devant le succès commercial d'INTELCI
lié à son autonomie administrative, le gouvernement
ivoirien avait deux options : transformer la DGT en entreprise
publique ou intégrer INTELCI à l'OPT. En 1984,
le gouvernement décide de liquider l'INTELCI et de scinder
l'OPT en deux structures, l'ONP (Office National des Postes)
et l'ONT. Ce dernier est devenu un établissement public
à caractère industriel et commercial, appliquant
un monopole d'État à tous les services de télécommunications
nationaux et internationaux à l'exclusion de la diffusion
des images et du transport du son garantis par le RTL L'ONT
a bénéficié d'une plus grande autonomie
de gestion que la structure précédente , qui était
purement administratif. Il reste néanmoins soumis aux
règles de gestion des finances publiques : il ne pouvait
pas conclure de marchés sans l'accord de la direction
nationale des marchés publics du ministère de
l'Économie et des Finances. De plus, les décisions
d'investissement n'étaient pas toujours soumises à
des critères de rendement : des considérations
politiques entraient parfois en ligne de compte. En bref, l'ONT
n'avait ni la flexibilité ni l'indépendance administrative
nécessaires pour faire face aux exigences des services
modernes et des performances des télécommunications.
C'est à ce stade du développement
du secteur des télécommunications en Côte
d'Ivoire qu'une étude réalisée par la société
ouest-allemande de conseil en recherche des PTT DETECON (Deutsche
Telepost Consulting GmbH) au début des années
1990 a conclu qu'une évolution du statut juridique de
l'ONT était nécessaire . Trois ans plus tard,
cette structure juridique est mise en place.
Services et équipements de télécommunications
En 1997, les clients des télécommunications
en Côte d'Ivoire avaient accès à une gamme
diversifiée d'équipements comprenant le téléphone,
le télex, les équipements de transmission, les
équipements de téléinformatique et de télématique,
et d'autres services tels que les radiotéléphones
mobiles, le service de radio maritime et le service de télécopie.
Service téléphonique
En 1996, 144 villes et villages sont
raccordés au réseau téléphonique
grâce à 188 centraux téléphoniques,
satellites et systèmes téléphoniques ruraux,
bien que 25,7 % d'entre eux soient desservis par des centraux
manuels. Il existe 149 572 lignes disponibles, dont 76 % fonctionnent
sur le réseau numérique (contre 95 % en France).
Les abonnés sont au nombre de 103 456, soit 0,77 téléphone
pour 100 habitants (contre 0,67 en 1992), avec un nombre à
peu près équivalent de téléphones
secondaires. Parmi ces abonnés, 74,3% vivent à
Abidjan.
Il existe deux centres de transit internationaux
et un centre de transit national (CTN) situés à
Abidjan, sept centres de transit régionaux (Abengourou,
Abidjan, Bouaké, Daloa, Korhogo, Man et San Pedro) et
un centre de transit régional et national (Yamoussoukro)
, ainsi que deux services d'opérateur.
|
sommaire
Contexte
de l'AOF Afrique Occidentale Française
Le Niger
|
La colonie du Niger était une colonie
française intégrée à l’Afrique-Occidentale
française (AOF), couvrant une grande partie du territoire
de l'actuel État du Niger, ainsi qu'une partie du Mali,
du Burkina Faso et de Tchad.
Elle existait sous des diverses formes et divers noms de 1900
à 1960, mais a été organisé en tant
que Colonie du Niger de 1922 à 1958.
sommaire
Le 31 décembre 1946, les territoires militaires de N'Guigmi
et d'Agadez ont été cédées à
l'administration coloniale, ne laissant que le Cercle de Bilma
sous administration militaire. Cette zone, la plus éloignée
au nord-est rentrera sous administration civile en 1956.
En 1947, la Haute-Volta est reconstituée, et les Cercles
de Dori et Fada N'Gourma sont de nouveau cédés
à la Haute-Volta. Avec ce changement, les frontières
modernes du Niger ont été plus ou moins établis.
En 1958, l'Union française succède à la
Communauté française.
Après la guerre d'Algérie et la chute de la Quatrième
République, les colonies de l'Union française
deviennent pleinement indépendantes en 1960.
|
sommaire
Contexte
de l'AOF Afrique Occidentale Française
|
La Guinée
Espagnole
Les Espagnols n’ont jamais fait la moindre publicité
autour de leur œuvre africaine, aussi le public français
ignore-t-il à peu près tout des présides
de Ceuta et de Melilla, d’Ifni, du Rio-de-Oro ou Sahara
espagnol, de l’île de Fernando-Po et de la Guinée
espagnole, ensemble de territoires couvrant un peu moins de
300 000 kilomètres carrés et groupant environ
400 000 habitants.
Il est vrai que le développement
économique et social de ces pays qui ont cessé
d’être colonies en juillet 1960 pour devenir «
provinces espagnoles » est extrêmement récent
: la frontière de la Guinée n’a été
fixée, après accord avec les Français,
qu’en 1900, et l’installation effective des Espagnols
dans l’intérieur du pays n’a guère commencé
qu’en 1925-1926.
En Afrique noire, la possession espagnole
de Guinée équatoriale est constituée d’un
ensemble d’iles et d’une enclave continentale entre
le Cameroun et le Gabon. L’émancipation de ce territoire
se fait par étapes : fin de l’indigénat en
1959, régime de semi-autonomie en 1964, puis indépendance
en octobre 1968.
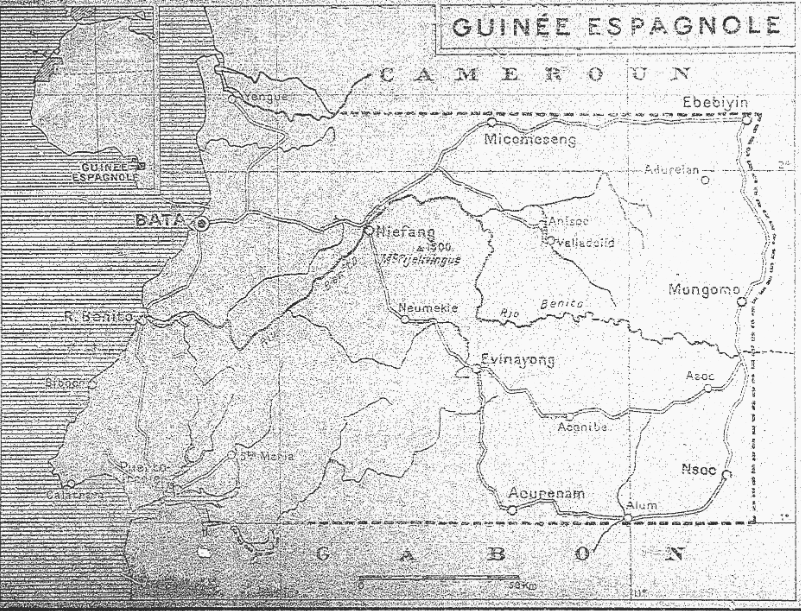 Agrandir Agrandir
Cependant, si nul ne conteste l’intérêt
économique restreint des « provinces espagnoles
» d’Afrique, celles-ci devraient néanmoins
retenir toute l’attention de ceux qui suivent au jour le
jour l’évolution politique du continent noir. Un
mouvement nationaliste qui possède de solides appuis
extérieurs se manifeste en Guinée espagnole, territoire
sur lequel la République gabonaise et la République
fédérale du Cameroun ont déjà certaines
revendications à formuler. D’autre part, Ifni et
le Sahara espagnol intéressent l’équilibre
de toute la partie occidentale du Sahara, et, à Rabat
comme à Nouakchott, on est très sensibilisé
à tout ce que les autorités de Madrid entreprennent
dans cette zone.
La
Guinée Française
La Guinée française
était une colonie de 1891 à 1946, puis un territoire
d'outre-mer français en Afrique de l'Ouest.
Le décret du 17 décembre 1891 a transformé
la colonie des « rivières du sud » en «
Guinée française ».
Le décret du 10 mars 1893 la démembre en trois
colonies : Guinée française, Côte
d'Ivoire et Bénin. Il faudra attendre 1899
pour que ses frontières soient fixées.
Elle faisait partie de l'Afrique-Occidentale française
(AOF) à partir de 1904.
Le pays se sépare de la France en 1958 à l'occasion
de l'indépendance prônée par le président
Ahmed Sékou Touré alors que les autres pays de
l'AOF deviendront indépendants en 1960.

Dans
ces années de colonisations, il y a peu de trace sur
l'installation et le déploiement des télécommunications
en Guinée Française.
Le Soudan accusait ouvertement la Guinée d'attirer les
produits, en particulier le caoutchouc, de la région
sud pour le plus grand développement et du port de Conakry
et des recettes douanières de la colonie. Cette liaison
de la région sud du Soudan avec la Guinée devenait
plus réelle avec l'achèvement d'une ligne télégraphique
entre Conakry et Farannah à la fin du premier trimestre
1897.
Avec la construction de la ligne de chamin de fer (1900-1914),
dès 1899 le capitaine Salesses suggérait de plus
d'établir un réseau télégraphique
qui permettrait la liaison avec le Soudan et la Côte d'Ivoire
et de ne plus avoir à payer des taxes aux Compagnies
de Câbles anglaises. Ce réseau avec la construction
en cours d'un câble de Saint- Louis à Oran de constituer
un tout des possessions françaises en Afrique occidentale.
Conakry.
Une voie ferrée relie Conakry à Kankan (662 km).
Il existe 3 500 km de routes praticables en tout temps et 7
000 km de routes en saison sèche ; 5 475 km de télégraphe
Les Îles de Los en Guinée (Conakry)
L'archipel fut occupé au début du XIXèmesiècle
par les Britanniques pour lutter contre la traite avant d'être
cédé, en 1904, à la France en échange
de droits de pêche à Terre-Neuve. En 1882, une
convention franco-anglaise reconnaissait les droits de la France
sur les « Rivières du Sud ",
Dès 1885 le « premier Lieutenant-Gouverneur des
Rivières du Sud» sur l'îlot Tumbo, à
l'extrémité de la presqu'île du Kaloum,
qui deviendra Conakry, pouvait disposer du câble télégraphique
installé par les Anglais mais s'en trouvait à
portée de canons. la réalisation de l'Entente
Cordiale permit de régler divers contentieux franco-britanniques.
C'est ainsi qu'en 1904, les îles de Los, devenues sans
intérêt maritime ni économique, furent cédées
à la France.
|
sommaire
Le soudan
Le Soudan est le plus grand pays d'Afrique
(Cœur de l'Afrique).
Ce vaste territoire mesure environ un million de kilomètres
carrés, principalement plat, 25 États qui constituent
8,5% de la superficie terrestre de l'Afrique. Plus de 70% de la
population vit dans de petites villes et des zones rurales.
1859 - Les télécommunications
sont introduites au Soudan, la 1ère liaison télégraphique
est ouverte entre Le Caire & Sawaken,
En 1866, pendant la domination
turque au Soudan, la ligne télégraphique fut construite
du nord au sud, via Wadi Halfa et Dongola, pour relier l'Égypte
au Soudan.
En 1870 La ligne a atteint Khartoum Bahri, puis à
Khartoum via un câble sous-fluvial dans le Nil Bleu.
Lors du déclenchement de la révolution mahdiste
en 1881 et lors du siège de Khartoum en 1885,
le Mahdi a coupé la ligne télégraphique
dans le cadre de sa stratégie militaire visant à
isoler l'ennemi du monde extérieur.
• 1892/1903 – Premier
central téléphonique au Soudan (Eldaba & Khartoum).
En 1894, la ligne télégraphique a été
restaurée en reliant Wadi Halfa au Caire, et Kassala,
Barbar et Swakin ont été reconnectés.
Et en 1897, une ligne télégraphique parallèle
au chemin de fer est construite. Toutes ces lignes télégraphiques
étaient administrées par les unités télégraphiques
militaires.
En 1897 les services
téléphoniques du Soudan, ont commencé
relativement tard par rapport aux services télégraphiques,
car les premiers ont commencé parallèlement à
la construction du chemin de fer.
En 1898, les départements du télégraphe
et de la poste ont été intégrés
en un seul et convertis en un département civil sous
le nom de Sudan Posts and Telegraphs avec son administration
confiée à MJS Liddell qui pendant son temps les
lignes du réseau télégraphique ont été
étendues à Fashoda dans le sud , en plus de construire
la ligne El Obeid via Ed Dueim, et Sennar vers Al Qadarif et
Kassala.
La longueur totale de ces lignes atteignait 3 200 milles et
desservait 38 bureaux télégraphiques.
À l'époque du major Moore, le système de
communication sans fil a été introduit au Soudan
avec le début de l'établissement d'un certain
nombre de stations à Joumbaila, El Nasir et Malakal.
sommaire
En 1902, le premier
central téléphonique ( standards manuel)
a été ouvert à Khartoum, (avec des
téléphones à Magneto),+
En 1904, deux sous-commutateurs ont été
établis à Omdurman et Bahri, un
dans chaque ville, et ils ont été interconnectés
par un câble sous-fluvial avec quatre sous-commutateurs
pour chaque ville.
Le nombre téléphoniques de lignes était
de 42 lignes. Les heures d'ouverture de la bourse étaient
de 8h00 à 13h30 et de 15h00 à 17h30 sauf le vendredi.
Le taux d'appel mensuel moyen a atteint 4 319 appels avec un
revenu total d'environ 660 livres.
L'année 1904 a vu l'établissement de lignes
de communication par l'administration du district de Dongola
entre Merowe et Korti, et entre Dongola et Al Khandaq.
En 1905, le nombre de lignes téléphoniques
a augmenté pour atteindre 48, et les heures de
fonctionnement du central téléphonique ont été
modifiées pour fonctionner plus longtemps pendant la
journée, en plus de fonctionner également le vendredi.
Le réseau téléphonique
s'est développé au cours des premières
années, mais dans la période qui a suivi la Première
Guerre mondiale, aucune initiative majeure n'a été
prise pour développer le système ou augmenter
le nombre d'abonnés
Une station télégraphique est implantée
à Port Soudan, en plus de relier Joumbaila à Addis-Abeba,
puis El Kurmuk et Wau entre 1918 et 1921.
En 1921, une importante station sans fil a
été établie à Khartoum avec une
puissance de 6 Kilowatt avec de hautes antennes.
En 1922 changement majeur,
lorsque le standard manuel (et téléphone
à magnéto) de Khartoum d'une capacité
de 150 lignes a été remplacé par
un système (B) avec une plus grande capacité de
600 lignes téléphoniques.
En mai 1924 Les standards d'Omdurman et de Wad
Medani ont été remplacés et le réseau
Gezira Scheme a été créé afin de
faciliter la surveillance du système d'irrigation, en
plus de l'amélioration de la ligne Mukwar-Wad Medani
.
En 1925, le standard téléphonique
de Khartoum Bahri a été retiré du service
et ses abonnés ont été transférés
au central de Khartoum via un nouveau câble sous-fluvial.
En 1927, un réseau téléphonique
au sud du Soudan a été établi par lequel
Malakal était connecté à Nonj
et Talowdi.
sommaire
En 1929, le nombre total des stations télégraphiques
atteignait 19 et comportaient 84 bureaux télégraphiques,
en plus des bureaux militaires mobiles qui représentaient
les principaux bureaux d'exploitation.
En 1931, une station téléphonique a été
établie entre Le Caire et Khartoum, en plus d'un certain
nombre de stations internes aux aéroports pour fournir
des informations et des directions aux avions.
En 1936, le service de météorologie est
rattaché au service de la poste et les travaux des lignes
principales avancent et atteignent Kosti.
En 1936 La même année, le central téléphonique
manuel de Khartoum est remplacé par un central
automatique, le premier au Soudan.
La capacité du central téléphonique Strowger
a atteint 900 lignes, et cette configuration s'est poursuivie
jusqu'en 1954.
Après la Seconde Guerre
mondiale, les services se sont développés pour
inclure les appels internationaux, mais le système a
de nouveau stagné après l'indépendance.
En 1946, le roi Farouk inaugure la ligne interurbaine
Khartoum-Le Caire.
La même année, le département est passé
à un fonctionnement sur une base commerciale et a annulé
les services gratuits pour les institutions gouvernementales,
ce qui a aidé le département à réaliser
un excédent budgétaire, pour la première
fois, de 400 livres.
La même année, les appels téléphoniques
internationaux ont été lancés avec les
îles britanniques, et en 1947, la fourniture de services
pour les appels internationaux vers la Palestine et la France
a commencé.
En 1948, les services d'appels internationaux couvraient
également les États-Unis d'Amérique, la
Grèce et la Suisse.
1950 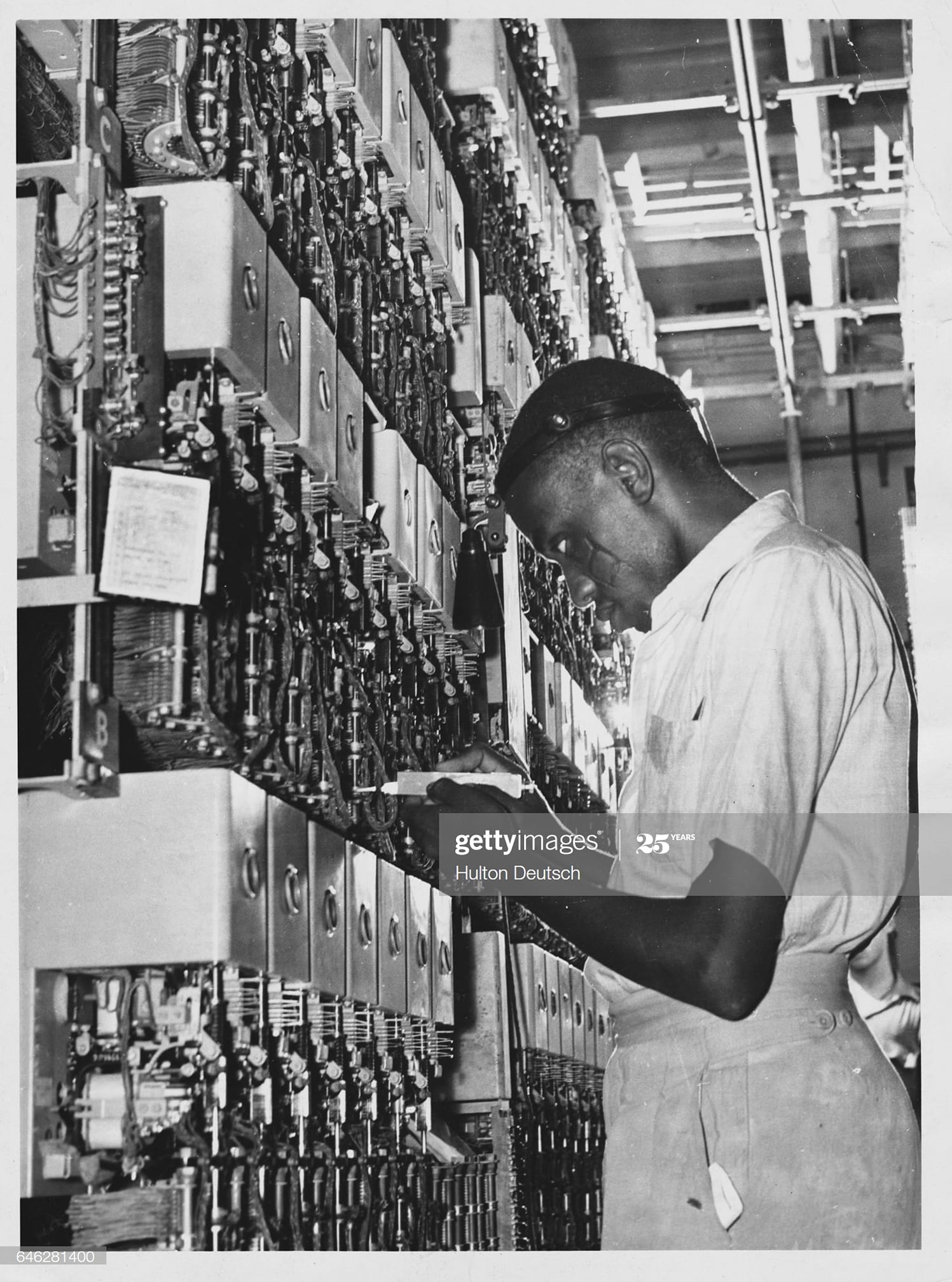 Un
homme au travail ajustant un sélecteur du central téléphonique
automatique de Khartoum au Soudan Un
homme au travail ajustant un sélecteur du central téléphonique
automatique de Khartoum au Soudan
En 1952, l'administration des services téléphoniques
est séparée de l'administration des ingénieurs.
Une administration distincte a été créée
pour s'occuper des tâches du département telles
que l'installation, l'annuaire téléphonique, les
salaires, la comptabilité et la formation.
Et en 1953, de nouvelles méthodes ont été
développées concernant les comptes téléphoniques
et l'introduction des calculatrices mécaniques pour la
première fois.
Au nord, Khartoum et une Afrique
blanche et musulmane, à Juba, au sud, une Afrique noire,
chrétienne et animiste.. Les deux régimes successifs
établis au Soudan après l'accession du pays à
l'indépendance en 1956 sont "morts du sud":
c'est en effet la guerre civile opposant le nord et le sud du
Soudan au lendemain de sa libération de la tutelle britannique
qui a causé leur chute.+
sommaire
En 1964, l'Institut des télécommunications
a été créé, anciennement connu sous
le nom d'institut de formation des ingénieurs.
En 1971, le Département des postes et télégraphes
a été séparé du Département
des communications filaires et sans fil; Radio et SUNA ont également
été séparés.
En 1974, la station satellite Um Haraz a été
créée.
Le 16/1/1987, un décret a été publié
pour créer la Corporation générale
des communications filaires et sans fil qui possédait,
au début de ses opérations, 85 centraux
téléphoniques manuels (modèle CB)
d'une capacité de 10 à 100 lignes dont la majorité
étaient en service depuis 1965, et une capacité
de 2 240 lignes.
Jusqu'en 1990, le nombre de lignes
fixes et les services fournis étaient extrêmement
limités, même par rapport à d'autres pays
de la région.
En 1991, par exemple, il n'y avait que 73 000 lignes
téléphoniques, dont les deux tiers se trouvaient
dans le Grand Khartoum.
Au cours des années 1990, cependant, le nombre de lignes
fixes a augmenté et en 2002, il y avait 672 000 lignes.
Le 13/9/1993, et conformément au programme triennal
de sauvetage économique (1990-1993), la Société
soudanaise des télécommunications (Sudatel)
a été créée en tant que société
par actions pour remplacer la Société générale
des communications filaires et sans fil.
En 1996, la Société
nationale des télécommunications (NTC)
a été créée dans le but d'agir en
tant qu'entité active qui assure la réglementation
de l'environnement des télécommunications et de
mettre en place les cadres juridiques, réglementaires
et législatifs pour promouvoir un climat sain pour un
concurrence libre et loyale.
En 1998, Sudatel
a introduit le service de téléphonie mobile au
Soudan et a mis en place une administration entièrement
dédiée à celui-ci, peu de temps avant de
se transformer en une société de télécommunications
distincte, indépendante de la ligne fixe, sous le nom
de Mobitel avec un partenariat qui engageait d'autres parties
.
En 2002, la deuxième licence a été
accordée à la société libanaise
Areeba marquant l'introduction d'un deuxième fournisseur
de services de téléphonie mobile sur le marché
soudanais, aux côtés de Mobitel.
En 2005, Areeba a été vendue à MTN-Afrique
du Sud.
En 2005, le groupe Sudatel
a vendu ses parts dans Mobitel
au groupe koweïtien Zain pour faire partie du groupe Zain.
En avril 2005, Canar a obtenu la licence pour devenir
le troisième fournisseur de services de téléphonie
fixe au Soudan, avec un portefeuille de services pour fournir
des services de téléphonie, de données
et d'Internet haut débit en utilisant les applications
de Next Generation Networks dans l'ensemble de ses réseaux.
, également connu sous le nom de NGN, basé sur
le protocole Internet IB, en plus d'autres technologies de pointe
pour fournir ses services, notamment les câbles à
fibres optiques et les réseaux sans fil.
En 2006, Sudatel
a lancé le réseau soudanais pour les services
de téléphonie mobile pour devenir le troisième
fournisseur de services de téléphonie mobile au
Soudan
Toutes les organisations créées pour fournir des
services de télécommunications appartenaient à
l'État.
Ils étaient, à toutes fins pratiques, des entités
avec peu ou pas d'autonomie opérationnelle et financière
et peu de contrôle sur leur propre destin. Malgré
de nombreux plans et efforts de développement, l'état
du secteur des télécommunications dans le pays
est resté extrêmement médiocre jusqu'en
1994.
À cette époque, le Soudan avait l'un des taux
de pénétration les plus bas (0,23%), même
selon les normes régionales.
sommaire
L'ère de la privatisation (1994 et au-delà)
Le programme triennal de sauvetage
économique (1990-1993), adopté par le gouvernement
du Soudan, met l'accent sur le rôle des télécommunications
dans le processus de développement socio-économique
et appelle à la suppression de l'environnement monopolistique
dans le secteur et à la participation des secteur privé
- qu'il soit local ou étranger - dans le secteur des
télécommunications ainsi que dans d'autres secteurs
pour pallier les déficits persistants d'investissement
et de performance.
À la suite de ce programme, la structure du secteur des
télécommunications dans le pays est actuellement
la suivante :
a) Le Ministère (Ministère de l'Information et
des Communications) : chargé des politiques et de la
législation.
b) Le Régulateur (National Telecom Corporation, NTC)
: chargé des fonctions de régulation.
c) Les opérateurs et prestataires de services agréés
: chargés de l'exploitation des réseaux agréés
et de la fourniture des services.
La libéralisation et la privatisation
du secteur des télécommunications, les politiques,
les réglementations et les plans adoptés par le
Gouvernement soudanais ont créé un environnement
politique favorable à la concurrence qui attire les capitaux
et a favorisé la mise en place d'une infrastructure moderne
entièrement numérique. dans le pays et a fourni
un climat propice à l'amélioration du développement
des technologies de l'information et des communications (TIC)
à l'échelle nationale.
La transformation et les réalisations observées
dans le secteur soudanais des télécommunications,
associées à l'utilisation croissante et diversifiée
des services des TIC, y compris ceux d'Internet et de ses applications,
ont fait du Soudan l'un des plus développés d'
Afrique , sinon du Moyen-Orient .. Mais le marché est
encore considéré comme vierge et d'énormes
opportunités d'investissement existent et vont exploser
avec la pleine réalisation de la paix et de la stabilité
dans tout le pays
Évolution du secteur
des télécommunications (1994 à septembre
2006)
Services fixes
SUDATEL _______________19 avril 1993 TDM/MPLS
____1 493 674 200 emplacements 411 000
CANAR (Mobilité Limitée) 11 octobre 2004
IP-MPLS/CDMA __ 250 000 5 emplacements 104 720
Croissance des communications fixes et mobiles
________________1994 2000 2004 2005 2006
Fixé Capacité x 1000 _150 _416 1500 1500 1500
Abonnés x 1000 _____64__386 1929 _680 _515
Mobile Capacité x 1000 ____20 1250 2000 4800
Abonnés x 1000 __________1 1050 1866 3370
Lignes principales : 425 000 lignes en
circulation, 101e au monde (2012). [3]
Cellulaire mobile : 27,7 millions, 38e au monde (2012
Internet
En 2011, l'accès à
Internet était largement disponible dans les zones urbaines,
mais limité par le manque d'infrastructures rurales.
Internautes : 12 millions d'internautes, 46ème mondial
; 21,0% de la population, 142e au monde (2012).
Haut débit fixe : 18 472 abonnements, 131e mondial ;
0,1% de la population, 172e au monde (2012).
Haut débit sans fil : 5,6 millions d'abonnements, 31ème
au monde ; 16,4% de la population, 78ème au monde (2012)
Hébergeurs Internet : 99, 211e au monde (2012).
IPv4 : 283 904 adresses allouées, moins de 0,05% du total
mondial, 6,3 adresses pour 1000 personnes (2012).
Le Soudan reconnaît ouvertement
le filtrage de contenu qui transgresse la moralité et
l'éthique publiques ou menace l'ordre.
L'autorité de régulation de l'État a créé
une unité spéciale pour surveiller et mettre en
œuvre la filtration ; cela cible principalement la
pornographie et, dans une moindre mesure, le contenu gay et
lesbien, les sites de rencontres, les tenues provocantes et
de nombreux sites Web anonymes et proxy.
|
sommaire
Contexte
de l'AOF Afrique Occidentale Française
Le
Mali ex Soudan Français
|
Enclavé en Afrique de l’Ouest, le
Mali est un État né de la décolonisation
survenue au début des années 1960.
Avec son vaste territoire s’étendant du désert
au Sahel et aux savanes méridionales plus humides, il
apparaît comme un espace intermédiaire entre le
monde des nomades sahariens et sahéliens et celui des
agriculteurs sédentaires établis sur les rives
du Niger et dans le sud.
Devenu le Soudan français du fait de la conquête
et de la colonisation entreprises à partir du Sénégal
dans les dernières décennies du XIXe siècle,
le pays est intégré à l’Afrique-Occidentale
française dont le cadre ne survit pas à la période
coloniale. .
Le territoire de l’actuelle république du Mali s’étend
sur 1 240 190 km2, soit une superficie plus de deux fois supérieure
à celle de la France, à peu près comparable
à celle de la république du Niger voisine.
le Mali se présente comme un espace de transition entre
les étendues sahariennes faiblement peuplées de
nomades Touareg au nord et les régions soudaniennes occupées
par les Noirs sédentaires du sud
1er février 1883 : Le Niger est
atteint par les Français et, peu après, Borgnis-Desbordes
établit un poste à Bamako
19 avril 1883 : Le télégraphe
atteint Bamako. Il atteint Bandiagara et Tombouctou en
1899, puis Sikasso en 1903.
...
1980 Etat des lieux des télécommunications
Au Mali, les services de téléommunications publiques
sont gères et exploites par l'Office des Postes et Telecommunications
(OPT) qui est placé
sous la tutelle du Ministere de l'Information et des Téléommunications.
L'OPT, entreprise d'état établie par décret
promulgué en 1960 et modifié en 1981, assure Ie
monopole des postes et télécommunications et est
responsable de l'expansion et de l'exploitation des services
des télécommunications, des postes et des services
financiers de la poste (mandats postaux, comptes cheques; postaux
et caisse d'épargne). Les tarifs appliques par L'OPT
sont fixés par arreté du ministre de tutelle.
En principe, l'OPT établit les concessions
d'utilisations des installations de télécommunications
non militaires dont il n'est pas propriétaire. Il est
toutefois de notoriete publique que bien des installations de
télécommunications privées sont exploitées
sans concession dans Ie pays. Etant donne qu'elles sont utilisées
pour assurer les services que l'OPT n'est pas en mesure de fournir
par ses propres moyens, et que la perte de revenus qui en découle
pour l'OPT n'est pas importante, l'OPT ne poursuit pas rigoureusement
la question, en dépit du fait que ces installations non
autorisées causent des interférences radio et
qu'elles constituent un gaspillage des ressources limitées
du pays.
Les installations de transmission pour les télécommunications
internationales du Mali sont exploitées par la Société
des Télécommunications Internationales du Mali
(TIM), une société dont Ie Gouvernment possede
65% du capital et la société framçaise
France Cable et Radio 35%.
la TIM est placée également sous la tutelle du
Ministere de l'Information et des télécommunications.
Aucune industrie de télécommunications de quelque
importance n'est implantée au Mali.
Acces au Service
Avec 4.700 raccordements téléphoniques
en service (LPR), la densité teélphonique
dans Ie pays était de 0,60 raccordements par 100 habitants
a fin 1980.
Cette densite figure parmi les plus basses du monde. Pour l'Afrique,
a l'exception de 1a Republique Sud Africaine, la densité
moyenne
correspondante est de 0,4; pour l' Asie, a l' exception du Japon
et de 1a Republique de Chine, elle atteint 0,9; pour l'Amérique
Latine 3,2, et pour
l'Amerique du Nord 32,0. Les densites telephoniques d'un certain
nombre de
pays sont données en Annexe L
La capitale, Bamako, avec environ 55% du nombre total des
raccordements, a une densité de seulement 0,4 raccordement
par 100 habitants.
A l"exception de Bamako et de dix autres vil1es importantes,
Ie reste du pays, ou réside 89% de 1a population, ne
dispose que de 780 raccordements te1ephoniques, ce qui donne
une densite de 0,01 raccordement pour 100 habitants dans ces
regions.
Non seulement la quasi totalite des raccordements d'abonnés
au téléphone est concentrée dans quelque
50 villes et localités importantes situées dans
les régions sud et ouest du pays, mais l'étendue
du réseau lnterurbain est tres limitée.
Sur la population totale du pays, seulement 17% vit dans des
régions ou l'on dispose d'un accés a une quelconque
installation de téléphone ou de télégraphie,
aussi desuéte soit elle; si l'on exclut Bamako, cette
proportion pour Ie pays n'est que de 11%.
Le partage administratif du pays comprend Ie district de Bamako
et sept régions. Les regions, a leur tour, sont divisées
en 46 cercles avec un total de 281 arrondissements et communes
indépendantes. Chacune des sept capitales régionales
dispose des services téléphonique et télégraphique,
bien que dans seulement deux d'entre elles Ie service puisse
etre consideré de qualité satisfaisante.
Sur les 46 chefs-lieux de cercles qui ne sont pas en même
temps de capitales régionales, 33 disposent du service
téléphonique, 3 n'ont que Ie service télégraphique
et 3 n'ont absolument aucun service. Sur un total de 281 arrondissements,
211 n'ont aucun service de télécommunications.
De plus, indépendamment des centres administratifs, il
existe d'importants centres pour les transports et Ie développement
agricole qui n'ont accés à aucun services des
télécommunications.
Seulement environ 80 téléphones publics sont
installes sur l'ensemble du Mali, dont 10 à Bamako.
Les telephones publics en dehors de Bamako sont tres peu utilisés,
principalement à cause de la médiocre qualité
du service interurbain offert aux usagers.
L'OPT éxploite 52 bureaux télégraphiques,
dont 3 sont situés dans des localites sans service téléphonique.
A une exception prés, toutes les installations telex
sont a Bamako .
Utilisation du Service
La distribution des abonnés au téléphone
par catégorie d'usagers varie dans une large mesure en
fonction du genre de communautés dans
lesquelles ils sont situés (tableau ci-dessous) En Pourcentage
d'Abonnés :
| Communaute |
Gouvernement Admin
Publics& Services |
Activité Commerciale
|
Résidence |
Autres |
| Bamako |
17,3 |
22,2 |
22,2 |
0,4 |
| Autres villes avec service
automatique |
27,5 |
20,7 |
51,0 |
0,8 |
| Autres villes |
35,8 |
25,2 |
37,3 |
1,7 |
| Zones rurales |
55,3 |
28,4 |
10,6 |
5,7 |
| Totalité du pays |
25,4 |
23,1 |
49,3 |
2,2 |
Des contr6les par echantillonages montrent que
pratiquement tous les téléphones résidentiels
dans les zones rurales et deux-tiers de ceux de
Bamako et d'autres zones urbaines sont principalement utilisés
pour affaires ou pour une activité professionnelle.
D'autres échantillonages montrent que les deux tiers
environ du trafic total de Bamako est local et un tiers est
du trafic interurbain et international. Dans les localites autres
que Bamako 25% du trafic est local et 75% interurbain et international.
Qualité de Service et Installations Existantes
Les installations de télécommunications
existantes sont décrites à l'annexe 3
Environ 70% du nombre total des téléphones installés
dans Ie pays sout raccordés a 5 centraux téléphoniques
automatiques; Ie reste à des centraux manuels. Les
centraux automatiques assurent un service de 24 heures, tandis
que les centraux manuels, à quelques exceptions prés,
n'assurent Ie service que pendant les heures de bureau, ce qui
est un service de niveau médiocre.
I1 est estiimé que plus de 95% du trafic local, environ
65% du trafic interurbain national et environ 20% du trafic
international sont ecoulés automatiquement.
Un échantillonage prélevé sur la période
du bimestre juillet/aout 1980 montre que 39,1% du montant facturé
a l'ensemble des abonnés du Mali
affecte les abonnés dits officiels et 60,9% les abonnés
dits privés.
Dans Ie cadre du premier projet de l'Association
(Credit 321-MLI) des centraux telephoniques automatiques
ont ete installés a Bamako, Segou, Kati
, Koulikoro et tous ont été interconnectés
par des faisceaux hertziens fiables. Ce qui a permis de diminuer
les difficultés rencontrées dans Ie passé
pour obtenir la tonalité de numérotage et pour
appeler les abonnés de ces localités. Toutefois,
bien des difficultés pratiques persistent, la plupart
d'entre elles sont causées par Ie manque de fiabilité
et Ie développement insuffisant des réseaux locaux
en service.
Grace aux travaux en cours, la qualité et la fiabilité
du réseau local de Bamako a éyé considerablement
ameliorée. Par conséquent, Ie nombre de raccordements
d'abonnés en dérangement pendant les périodes
les plus critiques de l'année a été réduit
de 200 à 400 par jour à environ 50.
Ce nombre de dérangements est encore bien trop élevé;
il est prévu de Ie diminuer davantage d'ici la fin de
l'année 1981.
Par suite d'un manque de ressources, les améliorations
de la fiabilité des réseaux locaux dans les autres
villes ne peuvent être apportées que dans Ie cadre
du second projet. Une conséquence de l'insuffisance des
réseaux locaux est que les abonnés avec centraux
domestiques ayant un trafic
intense a l'heure chargée ne peuvent pas obtenir davantage
de raccordements principaux au central public.
Comme les raccordements principaux existant en service sont
continuellement occupés pendant les heures de pointe,
des tentatives d'appels sont repetées sans succeé,
ce qui a pour consequence de surcharger les équipements
de commutation du central au dela de leur capacité et
de diminuer encore davantage les chances d'obtenir un appel
qui aboutit.
Cette situation également ne pourra etre rectifiée
que dans Ie cadre du second projet.
Un central telephonique automatique est également en
service a Sikasso qui est la capitale régionale
et Ie centre de la partie importante dupoint de vue agricole
située Ie plus au sud du pays.
Toutefois l'amélioration du service dont on s'attendait
a la mise en service de ce central ne s'est pas concretisée
par suite de la médiocre qualité de la liaison
Ie raccordant au réseau national.
Tous les autres centraux du pays sont a exploitation
manuelle, qui est d'une qualite de service inférieure
.
Les centraux manuels sont raccordés au réseau
national soit par des lignes aeriennes, soit par des liaisons
radio HF, ni les unes ni les autres n'étant satisfaisantes.
Les lignes aeriennes sont pour la plupart anciennes et n'ont
pas été conçues pour les liaisons à
longue distance pour lesquelles elles sont maintenant utilisées.
Les durées d'exploitation des liaisons HF sont limitées
de une demi-heure à quelques heures par jour, et même
au cours de ces brèves periodes, les liaisons sont frequemment
interrompues par des coupures du secteur de l'électricité
a l'une ou l'autre des extremités. Elles sont également
vulnérables aux interferences et aux perturbations atmospheriques.
Plus de 50% des demandes de communications destineesé
à être établies sur des liaisons radio HF
ont été annulées par suite de délais
d'attente excessifs. Pour les communications devant être
établies sur lignes aeriennes, Ie pourcentage d'annulation
varie entre 25 et 50% des demandes de communications. Ces chiffres
demontrent un service de qualité inferieure.
Le trafic international est établi par
des operatrices à l'exception d'environ 50% des appels
entre Ie Mali et la France qui sont établis automatiquement
(20% de tous les appels). Le trafic vers l'Algérie, l'Europe
et au dela est acheminé via des circuits par satellite
et vers les autres pays d'Afrique par circuits radio HF. Les
circuits internationaux HF comportent les mêmes limitations
que les circuits nationaux HF bien quIà un moindre degré
grace a tin personnel mieux formé et des équipements
meilleurs.
Les circuits par satellite sont fiables mais, pendant les heures
chargées, la demande dépasse la capacité
des installations disponibles, ce qui provoque de longs délais
d'attente. La TIM qui exploite ces installations à l'intention
d'augmenter leur capacité dans le courant de 1982.
Sur Ie total du trafic international, une proportion de 52%
est destinée aux pays frontaliers, notamment a la Cote
d'Ivoire (24%) et au Senegal (23%), et 45% environ a l'Europe.
En general, il n'est pas possible d'indiquer un délai
d'installation ferme lors du dépot d'une demande d'abonnement.
Les souscripteurs résidentiels doivent attendre au moins
deux a trois anneés, et de plu:s, a bien des endroits,
la qualité du service est médiocre au point de
dissuader les abonnés potentiels. En depit de ces faits,
les listes d'attente officielles contiennent plus de 1.800 demandes
enregistrées, dont 1.348 proviennent de Bamako (31 decembre
1980). De plus une demande latente émerge d'une zone
a une autre, au fur et a mesure que des travaux d'extension
sont entrepris et que les abonnes potentiels perçoivent
une augmentation de leurs chances d'obtenir un raccordement
téléphonique.
La principale raison pour laquelle la demande n'est pas satisfaite
provient d'un manque de lacets de câble disponibles.
Le Gouvernement a également exprimé une demande
generale de services dans differentes villes et localités
situées un peu partotut dans Ie pays. Au cours des dix
années écoulées, Ie nombre de raccordements
téléphoniques n'a augmenté que de 5,4%
par annee.
Les consultants engagés pour l'ingenierie des réseaux
locaux ont relevé que ce faible taux d' accroissement
est la conséquence d'un retard géneral dans l'expansion
des télécommunications dans Ie Sahel qui a suivi
la sécheresse du milieu de la décade 1970.
Pour Ie Mali, ils suggèrent une accéleration de
l'accroissement qui devrait passer de 5,4% a 13% par année,
pour rattraper Ie retard et pourvoir aux besoins de développement
économique et social du pays. lIs estiment la demande
totale a environ 10.000 racordements téléphoniques
à la fin de 1985 et a 16.000 en 1990, ce qui correspond
a un taux d'accroissement annuel de 10% à partir du seuil
de 1a demande actue:clement exprimée (nombre de raccordements
actuellement en service plus demande non satisfaite enregistrée).
Environ 85% de la demande devrait pouvoir etre satisfaite en
1985. Toutefois on s'attend à ce que Ie nombre de demandes
enregistrées sur les listes d'attente officielles dépassera
la capacité d'insta1lation annuelle de l'OPT au cours
de la periode 1981-85.
L'ordre de priorité pour l'installation
et Ie raccordement des nouvelles lignes d'abonnés tel
que donné ci-apres est respecté Ie mieux possible:
à l'exception des circuits vers l'Algérie qui
sont exploités par l'OPT. Ces circuits n'étaient
pas en service au moment du passage de la mission d'évaluation.
L'OPT envisagera également des mesures tarifaires propres
a canaliser la demande de nouveaux raccordements d'abonnes selon
les besoins dans Ie dessein d'atteindre les objectifs de développement
du Gouvernement.
L'actuel central telex d'une capacité de 168 raccordements
est complétement saturé depuis plus d'une année
et aucun raccordement additionnel
ne pourra être realisé avant que Ie nouveau central
inclu dans Ie second projet de télécommunications
soit mis en service. De ce fait l'OPT a refusé
d'accepter pour Ie moment des demandes d'abonnement au telex.
Par consequent, aucune liste d'attente officielle n'est tenue,
mais la demande
non satisfaite est actuellement estimée a environ 150-200
raccordements.
...
|
sommaire
Contexte
de l'AOF Afrique Occidentale Française
Le Benin ex Dahomey
|
La République du Bénin
(ex Dahomey) est située sur le golfe de Guinée.
Dès 1851, la France signe un traité commercial
et d'amitié avec le roi de Xogbonou (Porto-Novo) le roi
Toffa Ier, vassal du roi Glélé du Dahomey,
qui régna de 1858 à 1889.
Par les traités de 1868 et de 1878,
la région de Cotonou, située entre Ouidah, comptoir
portugais, et Porto-Novo, est cédée à la
France.
En 1883, le roi de Xogbonou (Porto-Novo),
souhaitant se protéger des visées expansionnistes
du Dahomey, signe un traité de protectorat avec la France.
Protectorat en 1884
L'un des rois les plus mythiques du royaume
du Dahomey, le très noble roi Béhanzin (ayant
pour emblème le requin) attaque en 1890 les Français
à Cotonou, garde pendant 73 jours des otages français,
puis assiège d'autres villages porto-noviens protégés
des Français. Il déclare même aux Français
de le laisser tranquille, défiant fièrement :
« Si vous voulez la guerre, je suis prêt. »
Détrôné, en fuite,
Béhanzin se rend de son propre chef indiquant à
ses derniers fidèles « de profiter de la conduite
véritablement étonnante de ces vainqueurs blancs
qui ne tuaient personne et n'emmenaient pas de prisonniers en
France. » Il est captif en janvier 1894, puis déporté
en Martinique.
À la suite de la conquête coloniale française,
les Établissements du Bénin, qui étaient
rattachés à la colonie du Sénégal
depuis juillet 1886, deviennent une colonie autonome en 1893,
avant de prendre le nom de colonie du Dahomey et dépendances
par un décret du 22 juin 1894. L’extension du nom
de Dahomey, qui ne désignait à l’origine
que le royaume du Dahomey, à l’ensemble de la colonie
répondait à la fois à une volonté
de justification et de glorification d’une conquête
relativement difficile, tout en évitant de possibles
amalgames avec les territoires du royaume du Bénin (1150-1897)
annexés par les Britanniques (sud-ouest de l’actuel
Nigeria).
Dans le Nord, le royaume bariba de Nikki, qui avait atteint
son apogée au XVIIIe siècle avant de se heurter
à l'expansionnisme du royaume nigérian d'Ilorin,
oppose une vive résistance à la colonisation française.
Le premier bureau de
poste a vu le jour le 1er juillet 1890 à Porto-Novo.
Au même moment, le service télégraphique
et téléphonique s’est développé
très tôt dans la bande côtière du
Dahomey grâce au système de radio maritime par
câbles sous-marins et des équipements de transmission
et de commutation mis en place pour permettre aux colonisateurs
d’être en relation permanente avec leurs colonies
et les navires qui se trouvaient en haute mer ou sur la côte.
Progressivement la métropole a étendu le service
public des PTT à certaines villes côtières
(Ouidah, Grand-Popo et Agoué) et à d’autres
villes à l’intérieur du territoire du Dahomey
où des bâtiments ont été construits
pour abriter des services postaux et téléphoniques.
En 1899, la colonie du Dahomey intégra
l'Afrique-Occidentale française
(AOF) au sein de l'Empire colonial français.
Les frontières furent établies d'un commun accord
avec le Royaume-Uni (fixé alors au Nigeria) et avec l'Allemagne
(présente alors au Togo).
La nouvelle colonie ne perd son autonomie
qu’en 1904 lors de son incorporation à l’Afrique-Occidentale
française (AOF).
Le Bénin a accédé à
l’indépendance complète le 1er août
1960, sous la dénomination de République
du Dahomey, avant de prendre en 1975 son nom actuel.
La Poste
Victor BALLOT alors, Administrateur français
chargé des Etablissements du Golfe de Guinée,
a institué au DAHOMEY un service public des « Postes,
Télégraphes et Téléphones »
(PTT) connu plus tard sous l’appellation de Service des
Postes et Télécommunications.
Dans cette optique, le premier bureau
de poste a vu le jour le 1er juillet 1890 à Porto-Novo.
Ce n'est qu'en 1893 que furent ouverts les bureaux de postes
d'Agoué et d'Ouidah.
Le bureau de poste de Porto-Novo quant à lui vît
ses portes s'ouvrir en 1894, le courrier postal s'étend
jusqu'à Savalou.
De 1897 à 1907, 14 nouveaux bureaux de poste étaient
installés. Ils étaient, à partir de Cotonou,
en relation avec Marseille, Dakar, Lomé, Lagos.
Puis, de 1905-1989 environ 92 autres bureaux de postes ont été
créés et équipés.
Les télécommunications
le service télégraphique et téléphonique
s’est développé très tôt dans
la bande côtière du Dahomey grâce au système
de radio maritime par câbles sous-marins et des équipements
de transmission et de commutation mis en place pour permettre
aux colonisateurs d’être en relation permanente avec
leurs colonies et les navires qui se trouvaient en haute mer
ou sur la côte.
En 1897, le service télégraphique se limitait
à la bande côtière en raison de la permanence
de la relation des colonisateurs avec les navires puisqu'ils
étaient des militaires.
De 1897 à 1907, le service télégraphique
national a connu également en cette période l'ouverture
des tronçons Cotonou-Lagos-Grand Bassam vers d'autres
pays.
...
Rallié à la France libre durant
la Seconde Guerre mondiale, le Dahomey devint, en 1946, un territoire
français d’outremer, puis, le 04 décembre
1958, un État autonome au sein de la Communauté
française.
Le pays accéda à l’indépendance le
1er août 1960 et entra, le mois suivant, aux Nations unies.
1962 Programme de modérnlsation des téIécomunications
- Central téIéphonique automatique de Cotonou.
- Liaison téIéphonlque bifilaire Parakou-Ma1an-
ville .'
- liaison téléphonique bifllaire Porto-Novo-frontière
Nigéria.
- Centraux téléphoniques des centres urbains secondaires.
Malgré les investissements réalisés
par l'OPT, ceux-ci étaient moindres puisque ne portant
que sur quelques liaisons télégraphiques.
Pour développer les services de la communication, l'Etat
en 1978 a procédé à la dotation en capital
et a autorisé la signature des conventions de prêts
et de subventions avec des bailleurs de fonds. Suite à
cela, l'OPT a réalisé en 1981 trois services centraux
à Cotonou en 1983 les services centraux de district et
en 1984 la station terrienne d'Abomey-Calavi pour le centre
de transit international. L'ampleur de ces activités
et la volonté de réussir de son personnel ont
fait de l'OPT une des rares sociétés de l'Etat
à gérer sans grande difficulté la crise
financière qui a secoué le Bénin de 1986
à 1989, bien qu'ayant trois milliards de francs de ces
avoirs gelés par la Banque Commerciale du Bénin.
Malgré l'essor que l'OPT a connu pendant cette période,
le redressement souhaité était loin d'être
atteint. De nouvelles réformes ont été
amorcées pour résoudre les problèmes d'ordre
administratif, financier, infrastructurel, commercial, relationnel
et technologique que connaissait la société.
...
Je n'ai pas d'autres traces sur l'installation
et le déploiement du téléphone au Benin.
|
sommaire
Contexte de l'AOF
Afrique Occidentale Française
Haute-Volta devenu le Burkina Faso
|
La Haute-Volta était une colonie de l’Afrique-Occidentale
française (AOF) établie le 1er mars 1919 à
partir des territoires qui formaient auparavant le Haut-Sénégal
et Niger et la Côte d'Ivoire.
La colonie fut dissoute le 5 septembre 1932 et chacune de ses
parties était administrée par la Côte-d’Ivoire,
le Soudan français et le Niger.
Après la Seconde Guerre mondiale, le
4 septembre 1947, la Haute-Volta fut recréée dans
ses frontières initiales comme territoire d'outre-mer
au sein de l'Union française.
Le 11 décembre 1958, elle fut reconstituée
comme une république autonome sous le nom de République
de Haute-Volta au sein de la Communauté française,
pour enfin prendre son indépendance totale le 5 août
1960.
La Haute-Volta prend le nom de Burkina Faso le 4 août
1984.
Dès 1898, la structuration
de ces territoires est totalement marquée du sceau des
militaires : fortifications, postes militaires et gîtes
d'étape jalonnent, avec les liaisons télégraphiques,
les itinéraires pédestres.
le Gouvernement ayant pris, en 1966, la décision
de réduire fortement les dépenses publiques, les
réalisations prévues dans le plan global de développement
et dans le programme des télécommunications ont
subi une compression. Quelques parties seulement de ce programme
ont été exécutées.
Depuis 1966, l'aide de la France a permis d 'acquérir
les équipement nécessaires aux renouvellements
et aux extensions de première urgence tels que
(a) du matériel de commutation à Ouagadougou
de façon a porter la capacité, en lignes et en
trafic, du central à 1000 lignes avec des positions
urbaines supplémentaires;
(b) un nouveau central automatique de 800 lignes à
Bobo-Dioulasso;
(c) des dispositifs a courants porteurs sur les lignes aériennes;
(d) du matériel pour liaisons VHF et radiocommunication;
et
(e) de petits commutateurs manuels destinée à
remplacer le matériel périmé dans les
villes de province. L'USAID a fourni une aide pour la construction
de nouvelles artères régionales en direction du
Niger et du Mali.
La majeure partie de ces travaux a été terminée
à la fin de 1968.
1968 Etat des lieux
La Haute-Volta est un pays de savanes et de terres arides, privé
d'accès à l'océan dont il est éloigné
de 800 km.
Elle compte 4.400.000 habitants et s'étend sur plus de
1.000 km d'est en ouest et de 500 km du nord au sud. En l'absence
de richesses minières exploitées, l'agriculture
est la principale ressource de ce pays dont le PIB par habitant
(50 dollars EU) est l'un des plus bas du monde.
Le pays est doté de 5 bureaux de services postaux et
financiers localisés à : Gaoua, Batié,
Diébougou, Dano et Dissin.
Le réseau téléphonique est articulé
autour d’un seul central téléphonique
automatique installé à Ouagadougou
, le reste est toujours en système manuel
vu le très petit nombre d'abonnés de ces autres
régions peu peuplées.
Le système de télécommunications
existant est très modeste et épouse étroitement
la répartition géographique des activités
économiques
et administratives. Il a test essentiellement développé
dans les deux villes principales de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
et entre elles, ainsi
qu'en direction de la frontière avec la Côte d'Ivoire,
le long de la ligne de chemin de fer d 'Abidjan. Les principales
routes et voies ferrées relient également ces
deux villes ou sont concentrés environ 80% des activités
administratives et commerciales et des transports, ainsi que
toute l'industrie du pays, qui représente 12% du PIB.
L'extension du réseau interurbain le long de cet axe
et dans les régions sud et nord-est, en direction des
pays voisins, a été associée au développement
des plantations, de l'agriculture et de l'élevage, activités
économiques les plus importantes du pays qui représentent
plus de 75% de ses exportations et quelque 60% du PiB.
La densité téléphonique (nombre de postes
par 100 habitants) est de 0,06, taux le plus faible d'Afrique.
Capacité des centres en lignes d'abcnnés (L)
et nombre de lignes principales d'acmnés en service (LP)
au 31 mai 1968
|
Ville
|
Type de centre
|
Capacité L
|
LP
|
|
| Ouagadougou |
Automatique. R6
|
1000
|
723
|
|
| Bobo-Dioulasso |
Batterie locale.
|
30 + 300
|
290
|
|
| Koudougou |
idem
|
10 + 50
|
41
|
|
| Ouahigouya |
idem
|
10 + 50
|
27
|
|
| Banfora |
idem
|
10 + 50
|
26
|
|
| Kaya |
idem
|
6 + 25
|
18
|
|
| Fada N'Gourma |
idem
|
6 + 25
|
10
|
|
| Deougou |
idem
|
3 + 17
|
10
|
|
| Diebougou |
idem
|
3 + 10
|
9
|
|
| Dori |
idem
|
3 + 10
|
8
|
|
| Tenkadogo |
idem
|
3 + 10
|
5
|
|
| Po |
idem
|
3 + 10
|
5
|
|
| Tougan |
idem
|
3 + 10
|
5
|
|
| Diapaga |
idem
|
2 + 6
|
5
|
|
| Koupela |
idem
|
3 + 10
|
4
|
|
| 1aga |
idem
|
3 + 10
|
4
|
|
| Yako |
idem
|
3 + 10
|
4
|
|
| Boromo |
idem
|
1 + 6
|
3
|
|
| Garango |
idem
|
1 + 6
|
3
|
|
| Gaoua |
idem
|
3 + 10
|
2
|
|
| Kombissiri |
idem
|
1 + 4
|
2
|
|
| Zorgho |
idem
|
2 + 6
|
2
|
|
| Mouna |
idem
|
1 + 4
|
2
|
|
| Kantchari |
idem
|
1 + 4
|
2
|
|
| Dano |
idem
|
1 + 4
|
2
|
|
| Batie |
idem
|
1 + 4
|
2
|
|
| Hounde |
idem
|
1 + 4
|
2
|
|
| Ziniare |
idem
|
1 + 4
|
2
|
|
Soit un total de 1224 LP
le 31 mai 1968, le service téléphonique local
comptait 2.980 postes téléphoniques de toute
nature, dont 1224 postes principaux.
Plus de 1.000 postes d 'abonnés étaient reliés
au centraux principaux de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso
et Koudougou; les 200 autres étaient situés
dans de petites villes ou centres administratifs de l'intérieur.
Le rapport entre le nombre total de postes téléphoniques
et le nombre de LP est d'environ 2,4. en janvier 1969 .
En outre, 34 bureaux de petites villes sont équipés
de commutateurs manuel, desservant une lgne principale et. parfois
2 à 3 lignes supplémentaires.
Sur le total des postes principaux, 59% (soit 723) étaient
raccordés au central téléphonique relativement
neuf de Ouagagadougou, qui est du type R6
de fabrication française à enregistreurs et a une
capacité de 1.000 lignes; les 4% restant étaient
raccordés à des centraux manuels à
batterie locale, à Bobo-Dioulasso, où le
central de 300 lignes est saturé, et dans environ 30 autres
villes du pays où de petits centraux équipés
de 4 à 50 lignes fonctionnent à temps partiel.
L'équipement existant a été
installé par l'administration coloniale française
et initialement exploité par elle, mais depuis 1960,
le développement en a été assuré
par l'ancienne administration des P&T avec l'entiére
assistance des services français de la coopération
qui relèvent du Ministère français des
Affaires Etrangéres. Les services essentiels sont dirigés
par du personnel français.
Les liaisons interurbaines consistent principalement en lignes
aériennes, équipées en partie de dispositifs
a courants porteurs.
Ces lignes ont une capacité limitée de L circuits
bifilaires au maximum sur la mêre artère et comprennent
environ 3.800 km à une paire de fils de
cuivre et 1.400 km à un fil de fer.
Les télécommunications internationales sont principalement
assurées par la compagnie France Câbles et Radio
(FCR), entreprise publique française, en vertu d'un accord
contractuel de 25 ans conclu en 1962 par le Gouvernement.
Le Département s'occupe également de 1'exploitation
technique des émetteurs de radiodiffusion sonore du 1iinistère
de l'Information.
On trouvera à l'Annexe 3 et sur la carte qui est jointe
de plus amples détails sur les installations existantes,
leur capacité de service et quelques travaux d'extension
en cours.
A l'exception des services internationaux de Ouagadougou,:
- Les installations existantes ne sont pas suffisantes pour
faire face au trafic actuel et de l'augmentation prévue
de la demande.
- Le réseau de câbles locaux est saturé
a Ouagadougou et, au rythme moyen actuel de 7 comunications
par jour et par abonné, égal a ceux observés
en Europe, le matériel de commutation existant est surchargé,
bien que 700 seulement des lignes disponibles soient raccordées.
- Le trafic interurbain entre les villes principales et avec
la Côte-d'Ivoire est encombré. Des circuits supplémentaires
sont nécessaires pour le trafic comuercial sur les principales
liaisons.
- Les installations existantes souffrent, en outre, d'un manque
d'entretien et nécessitent des améliorations pour
offrir une qualité minimale de service.
- Les bureaux vétustes et les lignes à un fil
de fer qui relient les villes de l'intérieur doivent
être renouvelés pour éviter de coûteuses
dépenses d'entretien et parer aux interruptions de service
avec ces localités.
Le réseau local de Ouagadougou se compose de câbles
souterrains prolongés, selon les besoins, par des câbles
portés ou des lignes ariennes.En
d'autres endroits, les réseaux sont entièrement
constitués par des lignes aériennes. Le réseau
local de Ouagadougou est complètement saturé et
doit
être reconstruit pour permettre le raccordement de nouveaux
abonnés de façon à utiliser pleinement
la capacité actuelle du central. Le réseau actuel
de lignes aériennes de Bobo-Dioulasso ne satisfait pas
aux normes de qualité exigées d'un service automatique
satisfaisant et doit être également reconstruit
.
Lrs liaisons à grande distance sont principalement des
lignes aériennes, dont une partie sont équipées
de systèmes à courants porteurs à 1, 3,
6 ou 12 voies. La liaison interurbaine la plus importante relie
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso en suivant la ligne du chemin
de fer d'Abidjan, et se compose actuellement dfune artère
à 4 fils de cuivre fournissant 17 circuits physiques
et à courants porteurs, ce qui est insuffisant pour répondre
à la demande actuelle. Une nouvelle artère aérienne
à une paire en cuivre a été construite
en 1966 sur les 400 km qui séparent Ouagadougou de la
frontière du liger, au titre d'un prolet régional'd'interconnexion
entrepris sous l'égide de l'USAID entre le Miger Niamey),
la Haute-Volta et le Mali (Bamako). Elle est équipée
de systèmes à courants porteurs à une voie
complétant le circuit physique. Du matériel de
même provenance a également été fourni
pour le parcours de 150 km qui sépare Bobo-Dioulasso
de la frontière malienne, mais l'installation doit attendre
l'octroi des crédits à fournir par le Gouvernement
pour les dépenses locales de construction. Une artère
composée de deux fils de cuivre aériens, qui suit
la ligne de chemins de fer d'Abidjan, est équipée
d'un système à courants porteurs à 6 voies
entre Bobo-Dioulasso et Bouaké en Côte-d'Ivoire.
Le reste du réseau aérien qui dessert l'intérieur
du pays consiste en 1100 km de lignes à deux fils de
cuivre et de 1.200 km de lignes à un fil de fer; ces
lignes sont complémentaires des artères principales
mentionnées précédemment.
En outre, un système radio VHF fonctionne entre Ouagadougou-Ouahigonya
et Tougan, couvrant une distance de 300 km; huit liaisons radio-électriques
à haute fréquence de faible puissance relient
les villes importantes à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
et sont utilisées pendant les heures de pointe et en
cas d'urgence lors des fréquentes interruptions des liaisons
de surface.
A l'exception de la ligne récemment construite à
destination de la frontière nigérienne, les lignes
aériennes et installations à grande distance existantes
souffrent en général du manque d'ertretîen
et de l'absence d'améliorations et de renouvellemnats
nécessaires pcur permettre la pleine
utilisation des systèmes modernes à courants porteurs
et offrir un service sûr et de bonne qualité.
Les lignes à un fil de fer sont périmées
et en mauvais état; elles ne fournissent même pas,dans
la majorité des cas, le minimm de service téléphonique
nécessire et doivent être converties pour éviter
une interruption complète des communications.
Les télécommunications internationales sont principalement
assurées par la Compagnie France Câble et Radio
(FCR), entreprise publique française, an vertu d'un accord
contractuel d'une durée de 25 ans conclu avec le Gouvernement
en 1962. Cet accord est analogue à ceux qu'ont signés
d'autres gouvernements des Etats francophones. Aux termes de
cet accord: (a) la FCR est propriétaire des équipements
nécessaires aux services téléphonique,
télégraphique et télex internationaux et
en assure l'exploitation à l'exception de certaines liaisons
avec les pays voisins ,ar radio et par lignes qui empruntent
des lignes de surface, telles que 1es circuits avec la Côte-d'Ivoire,
le JalU et le Niger mentionnés .
Les services des postes et télécmmnications
de l'ensemble de l'ancienne Afrique-Occidentale Française
remontent à la création, au dàbut du siècle,
de départements des Postes, Télégraphes
et Téléphones, qui étaient des services
publics de l'administration française placés sous
l'autorité du Haut-Commissaire pour l'Afrique-Occidentale
et des Gouverneur de chaque territoire.
Après la formation de divers Etats (Sénégal,
Daimy, Côte-d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Haute-Volta)
au sein de la Fédération, les services des P&T
des sept pays furent assurés par l'office des P&T
de l'Afrique-Occidentale qui avait son siège à
Dakar.
A la dissolution de cet office, vers la fin de 1959, les services
des P&T de Haute-Volta furent privés des avantages
de l'administration centrale
et du personnel qualifié nécessaire à la
création des services centraux inidipensables au pays.
les services existants furent intégrés dans les
services administratifs généraux. La responsabilité
et le contrôle financier des P&T furent transférés
au miinistère des Finances. Le minimum
de personnel français indispensable au fonctionnement
des services fut maintenu en fonction, les cadres et conseillers
supplémentaires nécessaires
furent fournis par les services français de la coopération
pour diriger et organiser le département.
Pendant huit ans (de 1960 à 1968) l'organisation des
services des P&T a donc présenté la structure
simple d'une administration publique. Lr Ministre responsable
déléguait au directeur des P&T les pouvoirs
techniques et admnistratifs nécessaires à la gestion
courante des services, qui étaient et sont toujours organisés
en trois divisions: les télécommnications qui
comprennent le télephone, le télégraphe,
le service télex et radio; les services postaux et financiers,
notanment les comptes de chéques postaux et la Caisse
dEpargne; et l'administration générale. Les téléconmications
étaient dirigées par des français et se
subdivisaient en une série de sections techniques d'exploitation.
Ceci devrait continuer un certain terps dans l'avenir inmédiat.
Les services n'ayant pas l'autonomie financière, il n'existait
pas de département financier ou comtable proprerent dit.
Les comptes taient incorporés dans le budgei national
et vérifiés par le contrbleur financier qui relve
du Ministre des Finances.
Dans le cadre de l'ancienne organisation, le fonctionnement,
le recrutement du personnel et le développement du département
des P&T ont beaucoup souffert des difficultés budgétaires
du Gouvernement. Malgrê l'excédent dégagé
par les opérations de téléconmumications
au cours des dernières années, le manque de crédits
budgétaires a fréquemment entraîné
des retards dans le règlement des dépenses courantes
d'exploitation et
d'entretien. Il était impossible de remplacer le personnel
des services des P&T muté ou démissionnaire,
les crédits budgétaires destinés au développement
étaient tout à fait insuffisants. les installations
et la qualité du service ont donc beaucoup souffert du
défaut d'entretien et de personnel qualifié. Pour
le moment, seule l'assistance technique fournie par le personnel
français maintenu en fonction aux divers échelons
de
l'organisation, empéche un effondrement, mais le personnel
exécute des tâches qui sont au-delà de ses
qualifications et de son expérience. Le
développement et le renouvellement des installations
est assuré essentiellement par la Fonds d'Aide et de
Coopération (FAC) de la France et par des contributions
bilatérales diverses, telles que celles accordées
par l'USAID pour des projets particuliers.
Pour assurer l'autonomie financière de
l'OPT, une organisation financière et comptable complète
devra être mise en place avec une assistance extérieure.
Actuellement, il nlexiste ni archives suffisantes, ni assise
commerciale pour les opérations de l'OPT. Les paramètres
et états
financiers de base ont été établis pour
le passé et pour l'avenir, et l'analyse financière
qui figure dans le présent rapport est la première
qui ait
été tentée pour les services des P&T
en Haute-Volta. Au sein de 1'OPT, l'effort de gestion commerciale
et les principaux engagements financiers
porteront sur les services de télécomuwnications
qui devront donc avoir une comptabilité séparée
de celle des services postaux. L'Etat a réglé
ses dettes antérieures et s'est engagé our 1'avenir
à payer sans délai et intégralement les
services de télécommunications qu'il utilise.
Dans ces conditions,l'OPTsera financièrement viable.
On prévoit que les besoins financiers du programme de
télécommunications de l'OPT pour 1969/1971 seront
couverts a raison de 54% par le crédit envisagé
de l'IDA, de 10, par le FAC et l'USAID, et le solde par l'autofinancement,
ce qui-constitue un plan de financement acceptable. On pense
d'autre part que la situation financiàre globale de l'OPT,
y compris celle du service des postes, s'améliorera pendant
la duréa du programme.
Le projet justifie l'octroi d'un crédit de l'IDA d'un
montant équivalant à 0,8 million de dollars EU
destiné à en permettre ltexécution entre
janvier 1969 et décembre 1971.
Le nouvel Office des Postes et Télécommunications.
En 1964, le Gouvernement de la Haute-Volta et les services français
de la coopération, qui administrent le FAC et l'assistance
technique au sein du ministère des Affaires Etrangères,
sont convenus d'entreprendre une étude pour la réorganisation
des services des P&T en Haute-Volta.
Vers la fin de 1966, un expert français des P&T a
remis un rapport sur l'état du département et
formulé des propositions détaillées pour
sa réorganisation en un office doté de la personnalité
civile et de l'autonomie financiare, sur le modèle d'offices
analogues existant dans dtautres pays
francophones d'Afrique de l'ouest et d'Afrique centrale. Lordonnance
créant le nouvel OPT, qui est entrée en vigueur
le ler janvier 1969, et le
décret précisant son organisation, son mode de
gestion et les pouvoirs de contrôle de ltEtat ont été
approuvés par le Conseil des Ministres en juin
1968. Les dispositions prévues suivent de près
les recommandations de l'expert français. Elles s'inspirent
également des suggestions formulées
par la mission et sont satisfaisantes.
D'autres dispositions réglementaires portant sur l'administration
financière de l'Office et ses relations avec le Ministère
des Finances ont été approuvées et sont
satisfaisantes, de même que la réglementation qui
définit lorganisation comptable de l'Office.
Ie principe fondamental qui a présidé à
la réorganisation était de créer un établissement
public responsable du service des postes et télécommunications,
doté d'une autonomie suffisante pour être géré
sur une base commerciale et avoir l'indépendance financière
sans recours excessif au budget de l'Etat. L'organisation qui
va être mise en place dans l'Office nouvellement créé
est satisfaisante du point de vue formel. A partir. des maigres
renseignements obtenus sur les opérations du passé,
et d'hypothèses raisonnables qui ont été
examinées avec les responsables locaux, les comptes d'exploitation
et les bilans passés et prévisionnels des P&T
ont été établis pour chaque service pris
à part et du point de vue global. Ces comptes montrent
qufavec l'organisation prévue de 1'OPT sera financièrement
viable.
Le Mnistre des Postes et Télécomrunications est
le président du Conseil d'Administration de 1'OPT.
A la fin de 1967, le personnel des P&T comptait au total
414 employés permanents et 132 employés temporaires.
Parmi le personnel
permanent, 264 étaient affectés aux services postaux
et 150 aux télécommunications.
Le Département exploitait 64 bureaux publics répartis
dans le pays, dont 18 ntoffraient que des services postaux.
Aucun changement majeur n'est intervenu en 1968. La plupart
des employés n'ont reçu qu'une formation rudimentaire,
de sorte que leur productivité est peu élevée.
Le manque de personnel d'encadrement et le niveau généralement
bas des qualifications entraînent dans certains secteurs
une insuffisance des services. Il importe donc de retenir aux
divers niveaux une assistance étrangère suffisante,
et il a été convenu au cours des négociations
que l'OPT prendra toutes les mesures nécessaires pour
assurer et maintenir un recrutement approprié du personnel
des télcommunications.
Les cadres administratifs et techniques sont formés à
l'étranger, pour la plupart au moyen de bourses d'études
dans des écoles spécialisées accordées
par la France, et les services français de la coopération
envisagent favorablement de poursuivre leur action dans ce domaine.
...
La majeure partie (quelque 73% ) des recettes totales nettes
des télécommunications proviennent des services
téléphoniques locaux et interurbains, et le reste
des services télégraphiques, du service télex
et des services internationaux. les services internationaux
avec les pays voisins sont assurés par lignes terrestres
et par radio. Les équipements nécessaires aux
autres comumications internationales sont toutefois fournis
en association avec la Compagnie France Câble et Radio
QCR), société concessionaire et les recettes provenant
de ces comunications sont partagées dans la proportion
de 40/60 . Cet accord est avantageux pour l'OPT, car la FCR
fournit tout l'équipement et supporteles charges d'exploitation.
...
La dette à long terma comprend un prêt de 46 millions
de francs CFA, montant restant à rembourser sur un prêt
à. 5% de 74 millions de francs CFA accordé par
la Caisse d'Epargne locale pour le financamant de divers travaux
d'équipeament, et un prit du Gouvernement français
à 3/4%
d'un montant de 38 millions de francs CFA destiné à
financer l'équipement du central automatique de Bobo-Dioulasso.
le prêt à 15 ans de la Caisse d'Epargne sera compltement
remboursé en 1976, et le prêt de longue durée
du Gouvernment français, en 1984 .
Une étude technico-conomdque des télécommunications,
portant sur un programme quinquennal de développement
a été exécutée en 1965 dans
le cadre du program français d'assistance technique.
L'étude comprenait aussi une prévision sur 20
ans du nombre probable des abonnés au téléphone
et des besoins en circuits interurbains. Comme il est d'usage
en ce doamine, les prévisions ont été fondées
sur une analyse détaillée de l'utilisation réelle
des services de télécousmmications par catégorie
et par groupe d'abonnés et sur l'examen de diverses tendances
sectorielles et
des taux de croissance prévus de la population, de I'activité
économique, et de l'utilisation des installations.
Le programme de télécommunications était
compatible avec le plan global de développement du pays.
Le rapport issu de l'étude recommandait une série
de travaux de construction à exécuter au cours
des cinq années suivantes, pour un montant total
équivalent à environ 4.,5 millions de dollars
EU. Les principaux travaux prévus étaient les
suivants: environ 3.000 lignes téléphoniques automatiques
dans les villes principales et les villes satellites voisines;
une liaison à 300 voies entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso;
une liaison à
60 voies avec la Cte-d'Ivoire; la reconstruction d'environ 2.000
km de lignes interurbaines aériennes en direction des
villes de l'intérieur et des pays voisins; un réseau
télex moderne; et enfin l'amélioration des liaisons
radio intérieures, et des bureaux existants.
Le Gouvernement a reconnsidéré
la partie du plan quinquennal qui reste à exécuter
et déterminé les travaux prioritaires. Ceux-ci
forment maintenant la base d'un prograne intérimaire
établi en fonction des ressources disponibles et du ralentissement
de la croissance économique, programe qui a été
soumis à la mission.
Le nouveau projet est conçu sur la base du programme
intérimaire. Il ne comporte que les éléments
appelés à être finaicés par le crédit
de l'IDA et les ressources propres de l'OPT. Le programe intérimaire
comprend les travaux prioritaires du plan quinqueanal primitif
qui restent à achever, une fois éliminés
les travaux coûteux tels que les artères interurbaines
à micro-ondes entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et
vers la Côte-d'Ivoire.
Ce programme réduit a fait l'objet d'un examen avec les
serviais français de la coopération et d'entretiens
avec la SOFRECOM, consultant français chargé des
études des principaux projets envisagés.
Le programme intérimaire vise à moderniser et
a étendre les réseaux urbains des régions
de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, et à convertir des
tronçons de lignes à un fil de fer, périmées
de l'intérieur; il comprendra une nouvelle ligne régionale
à destination du Togo ou du Dahomey, selon ce qui sera
décidé ultérieurement par le Conseil de
l'Entente. Des systèmes à courants porteurs de
faible capacité seront installés sur les lignes
interurbaines existantes aux endroits ou l'exige l'encombrement
du trafic; et d'une maniére générale, les
installations des bureaux provinciaux seront
remplacées ou rénovées pour améliorer
la qualité du service. Un petit central automatique
à 100 lignes sera aussi iastallé à Koudoufou
et divers équipements seront redistribuês de façon
à étendre le service a d'autres villes.
Un nouveau central automatique moderne du type crossbar
d'une capacité de 800 lignes est en cours d'installation
à Bobo-Dioulasso et devrait entrer en service
vers la fin de 1968.
On trouvera à l'Annexe h et sur la carte jointe de plus
amples détails sur les travaux de construction envisagés,
leur financement et leur coût
estimatif.
Le programme envisagé est sain sur le plan technique
et indispensable pour éviter un prochain effondrement
ou un dangereux déséquilibre des
télécommunications en Haute-Volta. Il est fait
appel pour sa préparation et son exécution à
l'aide nécessaire à la planification et à
l'engineering des
travaux. Une étude détaillée des réseaux
de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso est maintenant achevée;
elle a normalement fait suite à l'installation récente
de matériel de commutation dans ces deux villes.
Des experts français doivent également fournir
leur aide pour la construction et la réception des réseaux
de cables et de lignes aériennes qui constituent les
principaux travaux du projet. Le programme combine des travaux
de reconversion et d'extension étudiés et planifiés
de façon cohérente; son ampleur et le calendrier
d'exécution sont réalistes et satisfaisants .
...
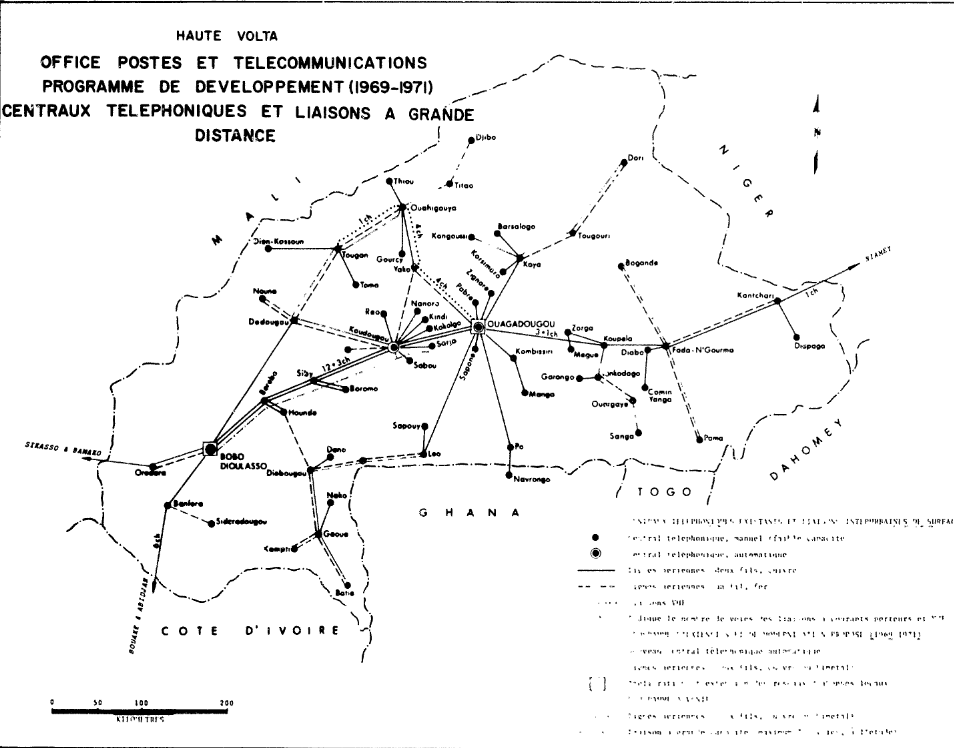
|
sommaire
Contexte
de l'AOF Afrique Occidentale Française
Le
Togo
|
En juillet 1884, l'explorateur allemand
Nachtigal débarque près d'Anécho ;
il signe des traités de protectorat avec les chefs de
Lomé, d'Anécho et de Porto Seguro. C'est lui qui
nomme le pays « Togo », d'après
un petit village de la côte.
La conquête allemande et le partage
franco-anglais
Dès 1885, les Allemands se heurtent
à la France. La conférence de Berlin accorde le
champ libre à l'Allemagne, et en 1885 et 1886 sont signées
des conventions respectivement avec les Français et les
Anglais, laissant aux Allemands le libre accès vers le
Niger.
La rivalité avec la France prend fin
en 1897 avec le traité de Paris qui fixe la frontière
avec le Dahomey. Avec la Grande-Bretagne, le sort d'une zone
neutre au niveau du moyen Togo demeure en suspens jusqu'au traité
des Samoa en 1899.
La capitale s'installe à Lomé en 1897 et des postes
sont créés à l'intérieur :
Sansanné-Mango en 1896, Atakpamé et Sokodé
en 1898.
La « pacification » totale
sera difficile, notamment dans le Nord (insurrection de 1897-1898
en pays konkomba). Le développement économique
démarre vite, notamment sous l'impulsion du gouverneur-comte
Zech : peu de plantations, mais prospection du sous-sol,
introduction de la culture du cacaoyer, du coton, du teck, création
d'un wharf à Lomé, construction de trois lignes
de chemin de fer, exportation d'huile de palme et de palmistes,
importation de cotonnades. Toutefois, le Nord n'est pas compris
dans ce vaste plan de mise en valeur.
En complément, lire l'étude
de Fanny Dufétel-Viste
TÉLÉGRAPHE
ET TÉLÉPHONE DANS LES COLONIES ALLEMANDES : ENTRE
CONCURRENCE ET COMPLÉMENTARITÉ
sommaire
Parmi les autres réalisations techniques allemandes remarquables,
figure la mise en place de communications postales, téléphoniques
et télégraphiques.
Ces installations ne relevaient pas de la compétence
des autorités coloniales du Togo, mais de la Direction
des Postes de l'Empire allemand. La mise en place du réseau
télégraphique ne fut donc pas prise en charge
par le Territoire, ce qui en soulagea considérablement
le budget. Mais, assurément. c'est l'Administration qui
profita le plus de l'installation d'un réseau de télécommunications
dans la colonie.
Une agence postale officielle fonctionna à Aného
à partir du 1er mars 1888 (reconnue le 1er juin par l'Union
postale universelle), puis à Lomé à partir
du 1er mars 1890 (agences confiées au fonctionnaire-à-tout-faire
qui avait la responsabilité de la douane de ces villes).
En 1894, les deux cités reçurent des postiers
allemands, Aného devenant "agence principale"
pour le Togo, fonction qui passa à Lomé le 15
janvier 1890, dans un beau bâtiment louéHamburgerstrasse.
Les liaisons télégraphique et téléphonique
Lomé - Petit-Popo avaient été installées
dès 1894.
(Si le service téléphonique fut ouvert au public
dès 1894, le télégraphe ne fut accessible
à tous qu'en 1907).
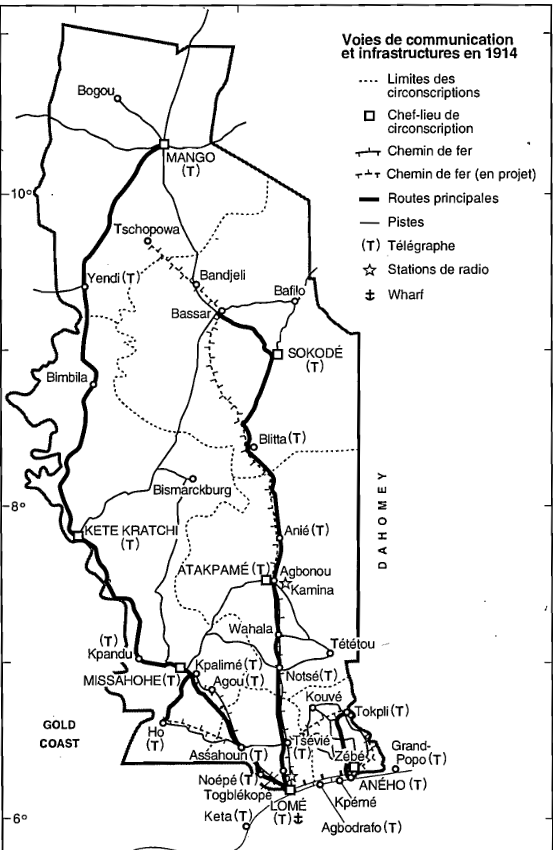
Dès 1895, une connexion fut établie avec
le réseau de la Gold Coast britannique, puis une autre
avec celui du Dahomey français.
1900 Au tournant du siècle, deux lignes télégraphiques
desservaient le Togo.
L'une reliait Lomé à Kpalimé (janvier 1903)
; elle fut prolongée jusqu'à Kpandu (1908), Kete-Kratchi
(1910), Yen di (1912), et atteignit enfin Mango, le bureau de
poste le plus septentrional, en mars 1913.
La deuxième ligne reliait Lomé à Notsé
(1905), puis elle fut prolongée jusqu'à Atakpamé
(1907) et Sokodé, son terminus (1909). En 1914, Lomé
était reliée par téléphone à
Aného, Kpalimé et Atakpamé, ainsi, bien
sur, qu'aux bureaux de poste intermédiaires.
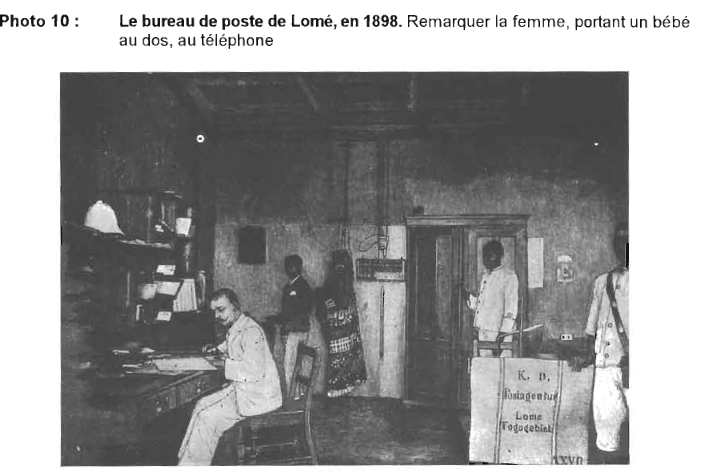
C'est au Sud que l'on trouvait la plupart des bureaux de poste
publics -il y en avait 13 à la fin de l'année
1913- dotés d'un service télégraphique.
La Poste employait 6 Allemands, 21 "fonctionnaires auxiliaires"
africains et 21 "agents subalternes" ; cela signifie
en clair que tous les
télégraphistes et la majorité des receveurs
de bureaux postaux étaient des Togolais. Si l'on considère
qu'en 1913, la poste togolaise avait acheminé 597 090
lettres, on peut en déduire, compte tenu du nombre réduit
des Européens (365), qu'un nombre considérable
de ces lettres ont été écrites par la population
togolaise.
La station radio-émettrice de Kamina
Pour rendre la colonie enfin indépendante des câbles
télégraphiques internationaux des colonies voisines,
Lomé fut reliée le 3 janvier 1913 au câble
sous-marin qui joignait l'Allemagne à l'Amérique
latine, en passant par le Liberia. En temps de guerre, ces câbles
pourraient être interrompus facilement. C'est la raison
pour laquelle le consortium industriel allemand Telefunken avait
reçu la mission de construire dans les colonies des stations
radio-émettrices transcontinentales.
On avait conçu un système qui couvrirait l'hémisphère
Sud, permettant à l'Allemagne de rester en contact avec
ses colonies d'Afrique, d'Asie et d'Océanie, ainsi qu'avec
sa marine de guerre et sa flotte marchande partout à
travers les océans. Sur le plan technique, le Togo et
le nord du Cameroun se trouvaient tous deux dans le rayon d'action
maximum (environ à 5 000 km) de l'émetteur de
Nauel1, dans les environs de Berlin. Mais le Nord-Cameroun était
d'accès difficile: on choisit le Togo. Ingénieur
pour le compte de Telefunken, l'inventeur d'un système
de radio en ondes longues, le baron autrichien Anton Codelli,
fit plusieurs missions exploratoires en Afrique, démontrant
au passage que la radio était, pour les colonies, bien
plus économique à 'entretenir que les fragiles
lignes télégraphiques.
Le 7 juillet 1911, il réussit, grâce à une
antenne soulevée par un ballon, à capter dans
les environs d'Atakpamé des signaux émis à
Nauen. Les
autorités allemandes retinrent comme site le village
de Kamina, à quelques kilomètres d'Atakpamé.
En effet, tous les éléments de la station émettrice
pouvaient être transportés commodément jusque
là grâce à la ligne ferroviaire Lomé
- Agbonou, et l'on n'avait qu'à construire une petite
voie de jonction avec Kamina. Les monteurs allemands installèrent,
sur un terrain d'une superficie de 48 ha, quatre pylônes
métalliques hauts de 120 m et trois de 75 m, qui portaient
des antennes se développant sur une longueur totale de
3 755 m. L'appareil émetteur avait une puissance de 100
kilowatts. Le courant électrique était produit
par une puissante usine génératrice fonctionnant
au bois, qu'alimentait en eau un petit barrage.
Fin juillet 1914, les installations de Kamina, qui, jusque-là,
ne pouvaient que recevoir, commençaient à émettre,
de telle sorte qu'elles allaient pouvoir remplir leur fonction
de relais en direction des stations de Douala (Cameroun), Windhuk
(actuelle Namibie) et Tabora (actuelle
Tanzanie) - mais là, les travaux n'étaient nulle
part suffisamment avancés pour qu'elles puissent envoyer
une réponse à Kamina. En vue des communications
radio avec les bateaux circulant dans l'Atlantique, on avait
installé une deuxième station, moins importante,
à Togblékopé, un peu
au nord de Lomé(2): cet emplacement avait été
choisi parce que, situé à 17 km de la côte,
il était ainsi hors de portée des canons d'éventuels
navires ennemis.
On se trouvait certes sur le sol de la colonie togolaise, mais
les stations émettrices de Kamina et de Togblekopé
bénéficiaient de l'extra-territorialité:
elles ne faisaient pas partie des infrastructures coloniales,
et ne relevaient en rien de la compétence des autorités
de Lomé. Alors que l'administration du Togo, qui en était
réduite à compter sous par sous, n'était
pas en mesure de réunir les fonds nécessaires
pour la construction d'une centrale électrique et de
l'adduction d'eau programmées à Lomé, des
moyens financiers quasi-illimités furent mis à
la disposition de la coûteuse station de Kamina, car elle
faisait partie d'une stratégie impériale à
l'échelle du monde entier.
Il n'est pas incompréhensible que, en août 1914,
von Doering, alors gouverneur par intérim, ait remis
intactes aux Alliés toutes les installations de l'administration
coloniale, mais qu'il ait fait démolir Kamina de fond
en comble, alors que la destruction de quelques machines suffisait
à la rendre inutilisable, conformément aux ordres
reçus de Berlin.
La capitulation Allemande
Au Togo, sans frontières immédiates avec
leurs principales autres colonies africaines - le Cameroun,
l’Afrique du Sud-ouest et l’Afrique orientale allemande
- les Allemands sont pris en tenailles entre les colonisateurs
britanniques et français.
La Grande Guerre voit les Alliés converger vers le Togo
et la reddition allemande est plus que rapide ; elle a
lieu dès le 27 août 1914, dans des conditions
peu glorieuses . En complément, lire l'étude
de Fanny Dufétel-Viste
TÉLÉGRAPHE
ET TÉLÉPHONE DANS LES COLONIES ALLEMANDES : ENTRE
CONCURRENCE ET COMPLÉMENTARITÉ
LE TOGO FRANCO-ANGLAIS
Dès août 1914, le Togo, qui n'est
défendu que par une police indigène, est le siège
d'opérations militaires menées par les Alliés
et suivies d'une reddition sans conditions le 26 août.
Français et Anglais se partagent le pays.
- Le partage des dépouilles et la nouvelle administration
.
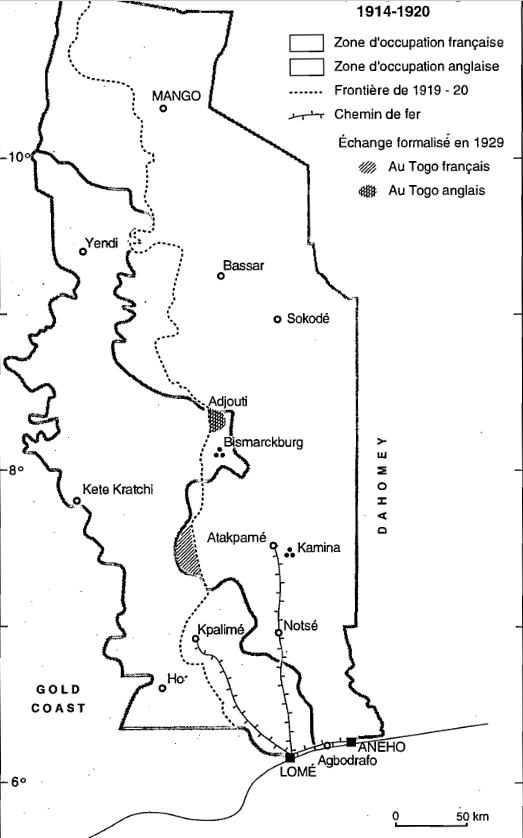 Les vainqueurs avaient conquis le Togo. Restait à l'administrer
à deux.
Les vainqueurs avaient conquis le Togo. Restait à l'administrer
à deux.
Dès le 27 aout,de retour à Lomé, les deux
chefs militaires, Bryant et Maroix, se mirent d'accord pour
le partage en zones d'occupation:
aux Anglais, les circonscriptions de Lomé, Missahohe
et Kete-Kratchi ;
aux Français celles d'Aného, Atakpamé,
Sokodé et Mango, hormis le pays dagomba, autourde Yendi,
qui tenait à son rattachement immédiat à
la Gold Coast.
Au sud, la frontière suivait lecours de Haho, laissant
Agbodrafo, Notsé et Atakpamé en zone françaiçe,
Lomé, Tsévie et Kpalimé aux Britanniques;
elle tronçonnait deux des trois voies ferrées.
Les 29 et 30 août, les deux gouverneurs, Clifford et Noufflard,
se réunirent dans le palais de leur malheureux collègue
Mecklenbourg et décidèrent des modalités
de l'occupation.
...
La convention du 10 juillet 1919 donne à
la France les deux tiers du pays, l'entier front de mer et Lomé,
tandis que la Grande-Bretagne obtient les riches terres de l'Ouest.
En 1922, des mandats de la Société des
Nations (SDN) sont attribués aux deux pays.
Le Togo français connaît d'abord
l'administration directe du ministère des Colonies, jusqu'en
1934, puis une sorte d'union personnelle avec le Dahomey
(gouverneur et chefs de service communs), et, enfin, en 1936,
l'intégration officielle dans l'Afrique-Occidentale française
(AOF).
En 1946, le gouvernement français
accepte de soumettre le territoire du Togo, ainsi que celui
du Cameroun, au régime international de tutelle, selon
un accord approuvé par l'Assemblée générale
de l'ONU le 13 décembre 1946.
Le 30 août 1956, la République autonome du Togo
est instituée.
En 1958 Ouverture du central téléphonique automatique
à Lomé avec 600 abonnés.
Le réseau téléphoniques était de
3500 km.
Le réseau télégraphique comptait 31 bureaux
et 1650 km de lignes.
La radio dsposait d'une station principale et 6 stations secondaires.
Ces réalisations permettent d'atteindre directement,
depuis 1982, tous les pays du monde.
|
sommaire
Contexte de l'AOF
Afrique Occidentale Française
La Mauritanie
|
La Mauritanie anciennement colonie de la Mauritanie,
désignant le territoire des « Maures », peuple
berbère, dans l'Antiquité, est un État
d'Afrique du Nord-Ouest. Sa superficie est de 1 030 700 km2
(classée 29ème) et elle se trouve en grande partie
dans le Sahara.
Elle possède une côte d'environ 800 km ouverte
sur l'océan Atlantique s'étirant de Ndiago au
sud jusqu'à Nouadhibou au nord et est est frontalière
de 3 pays (l'Algérie au nord-nord-est, le Mali à
l'est et au sud-sud-est et le Sénégal au sud-ouest)
ainsi que du Sahara occidental (territoire non autonome disputé
par le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique)
au nord. Sa capitale et plus grande ville est Nouakchott. Les
autres villes principales sont Nouadhibou, Kiffa, Kaédi,
Néma et Rosso.
Le territoire devient une colonie française
en 1903 et obtient son indépendance en 1960.
Le traité du 20 octobre
1891 entre Léon Fabert et le roi Ahmed Ould Sidi Ahmed,
roi de l'Adrar établit un protectorat français
sur la vaste région d'oasis étendue du Sénégal
au Sud-marocain. La colonisation française peut être
présentée selon la chronologie :
1902 : début de la pénétration coloniale
française.
1903 : la Mauritanie est placée sous protectorat de la
France.
1904 : rattachement de la rive droite du fleuve Sénégal
à la Mauritanie sous protectorat de la France ; arrêté
du 10 avril 1904 prononçant l'éclatement du cercle
de Kayhayzi et le rattachement de sa rive droite au nouveau
protectorat.
1920 : la Mauritanie est décrétée colonie
française.
1934 : fin de la résistance armée (deux ans après
la bataille d'Oum Tounsi qui eut lieu en août 1932).
1945 : la Mauritanie est élevée au statut de territoire
d’outre-mer de l’Union française.
1957 : la Mauritanie bénéficie de la loi-cadre
(dite loi Defferre).
1958 : devenue autonome, la République islamique est
proclamée le 28 novembre (dans la nouvelle mais éphémère
Communauté française qui remplace les anciennes
fédérations administratives de territoires de
l'Union française).
1960 : le 28 novembre, l’indépendance nationale
est octroyée en vertu des accords franco-mauritaniens
de restitution de souveraineté.
Il
n'y aura pratiquement pas de développement du pays, seulement
une domination militaire en s'appuyant sur les chefs traditionnels
afin de sécuriser le territoire (les antagonismes entre
les différentes tribus seront utilisés avec profit
par les Français).
Saint-Louis du Sénégal — capitale de l'AOF
et du Sénégal — fera donc office de capitale
administrative de la Mauritanie.
Il faudra attendre l'indépendance pour voir s'ériger
des installations portuaires ou des aéroports.
Durant cette période, les populations nomades s'appauvrissent.
sommaire
1880 Abdoul Boubakar, chef du Bosséa,
s'opposa à létablissement sur le fleuve et à
l'installation de la ligne télégraphique Saldé-Matam.
Le service postal est effectué mensuellement par des
vapeurs de Dakar à Port-Etienne, et deux fois par mois,
en toute saison, par voie fluviale, de Saint-Louis à
Dagana, Podor, Boghé, têtes d'étapes pour
Méderdra, Boutilimit, Aleg et le Tagant, et en hivernage
à Kaëdi el Bakel, d'où le courrier gagne
Sélibaby.
En 1906, fut commencée une ligne
télégraphique qui, partant d'Aéré,
sur le marigot de Doué (rive droite du Sénégal),
communiquait avec Boghé sur la rive gauche et, reliant
Boghé, Aleg, Mal, Guimi, Aguieurt. circulait à
travers le pays Brakna jusqu'au pied du massif du Tagant.
C'est à la construction de cette ligne que voulut s'opposer
Abou-Bakar, chef du Bosséa, région de la rive
gauche du Sénégal au sud de Saldé et de
Kaëdi, lequel à la fin du xix siècle, nous
avait déjà combattus avec l'aide des Ida ou Aïch
; mais il fut vite remis à la raison.
Depuis une autre ligne a été greffée
sur celle-ci, ligne qui va d'Aleg au poste de Boutilimit dans
le Trarza.
Après l'occupation du Tagant, une ligne
télégraphique se rattachant par le poste d'Aéré
(Sénégal) au réseau général,
fut mise en construction pour relier le Tagant à la région
du fleuve en passant par Moudjéria, Aguieurt, Guimi,
Mal, Aleg et Boghé et devant se prolonger jusqu'à
Tidjikdja.
Le télégraphe et le téléphone sont
installés dans le bureau de poste de Port-Etienne et
un réseau téléphonique relie entre
elles les installations officielles de Port-Étienne et
du cap Blanc.
La presqu'île du cap Blanc et la baie
du Lévrier, dans la région nord de la Mauritanie,
sont reliées au Sénégal par la télégraphie
sans fil. Le poste de Port-Etienne est en communication avec
celui de Rufisque qui relie le Sénégal à
l'Europe.
L'installation du poste de télégraphie
sans fil de Port Etienne, commencée en 1906, a été
terminée en 1908.
En outre, les spécialistes voient la possibilité
de faire parvenir au Sénégal des radiogrammes
de la Tour Eiffel, par l'intermédiaire de Casablanca
et les expériences ont été faites dès
le mois de mai 1909.
Des études avaient été ordonnées
en vue de la création des postes et des établissements
de Port-Étienne qui, commencés en 1906, étaient
terminés dès 1908.
A 1.800 mètres du fond de la baie du Repos, sur son mamelon
rocheux, un des points les plus élevés de la région,
le poste dresse une imposante masse de maçonnerie, construction
carrée qui comprend le logement des officiers et des
sous-officiers européens, les magasins, les cases en
paille qui servent d'abri aux tirailleurs indigènes.
Au sud-ouest du poste s'élève le bâtiment
de la Résidence et des ouvrages de défense. Du
poste, une route construite par les soins du Résident
conduit à la baie du Repos, et, non loin du poste, au
pied d'une falaise, on a élevé un bâtiment
rectangulaire où se trouve le bureau de poste avec les
installations du télégraphe et du téléphone.
A la pointe du cap Blanc, un phare entouré d'un mur élevé
qui clôt le chemin de ronde, a été mis en
service le 1er septembre 1908 ; sa belle tour s'élève
sur la terrasse d'un bâtiment carré qui contient
les logements des gardiens européens et de deux aides
indigènes, une chambre de passagers, une pièce
pour le télégraphe et le téléphone,
puis les magasins. La lanterne du phare est à vingt mètres
au-dessus du sol et à vingt-cinq mètres au-dessus
du niveau de la mer ; un feu à éclairs est visible
à dix-huit milles de distance ; c'est le seul qui existe
sur la côte depuis les Canaries jusqu'à Dakar,
peut-on dire, car le feu du cap Juby est si irrégulier
que les navires préfèrent n'en pas tenir compte.
Ce phare rend moins dangereux pour la navigation les abords
de la baie d'Arguin. Il a été construit uniquement
aux frais du gouvernement de l'Afrique Occidentale française.
Au cap Blanc aussi a été construit un sémaphore
qui le relie à Port-Étienne par communications
télégraphiques et téléphoniques.
Dès 1911, 7 stations de T.S.F. sont installées
sur le territoire de l’A.O.F. par la Télégraphie
Militaire. dont Port-Etienne .
Le développement de la T.S.F. va
permettre la mise en place du « premier réseau
en Afrique, avec l’installation des stations de Bizerte,
Fort-de-l’Eau, Oran et Casablanca. FERRIE, promu Commandant
après la Campagne du Maroc, s’occupe avec les Capitaines
BRENOT et FRACQUES de l’établissement de ce réseau
auquel s’ajoute les postes de Tombouctou, Port-Etienne,
Dakar, Konakry, Monrovia, Tabou, Grand-Bassam, Cotonou, Brazzaville
et Léopoldville. A ce réseau s’ajoute le
poste de Madagascar et les trois d’Indo-Chine (Saïgon,
Cap Saint-Jacques et Poulo-Condor) »
1921 A l'époque de la ligne française
du courrier de Casablanca à Dakar à travers le
Sahara insoumis, Port-Etienne estait un vieil établissement
français qui compte une demi-douzaine de bâtiments
et une population noire majoritaire.
Il y a les officiers blancs qui commandent la garnison noire,
le médecin civil, les habitants de la pêcherie,
les fonctionnaires de la station de télégraphie
sans fil.
Comparée à l'Union européenne,
Mauritanie est très en retard dans le développement
des télécommunications.
En 2021 lle comptait 6,57 millions de lignes. Parmi elles, on
comptait 6,51 millions de téléphones portables,
ce qui correspond à une moyenne de 1,4 par personne.
Dans l'UE, ce chiffre est de 1,2 téléphone portable
par personne.
|
sommaire
|
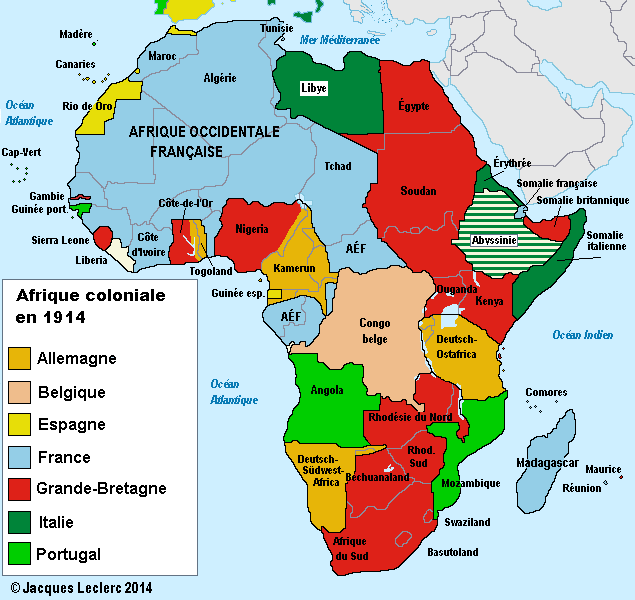
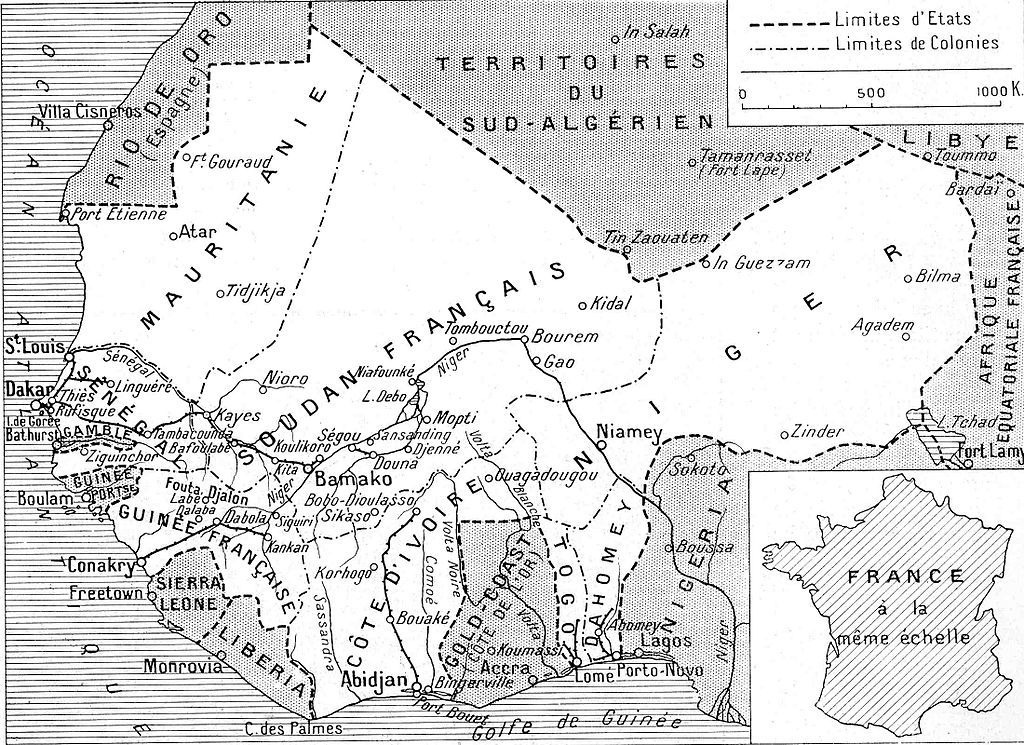
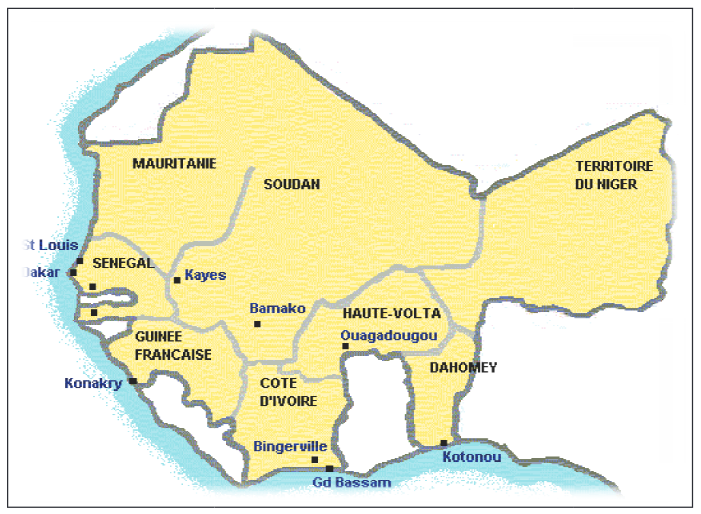
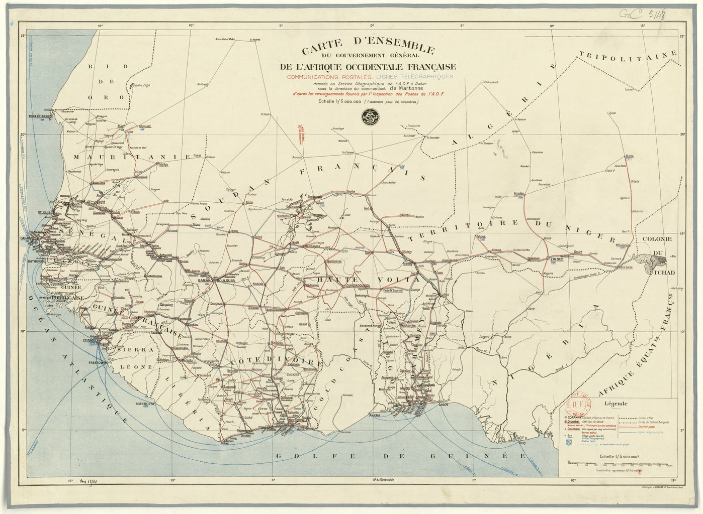
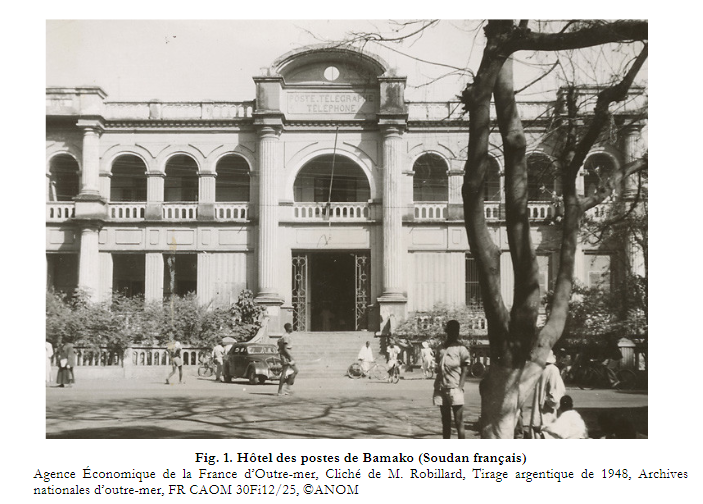
 Le palais
du gouverneur de l'A.O.F., d'abord installé à
St Louis puis à Dakar (Sénégal)
Le palais
du gouverneur de l'A.O.F., d'abord installé à
St Louis puis à Dakar (Sénégal) 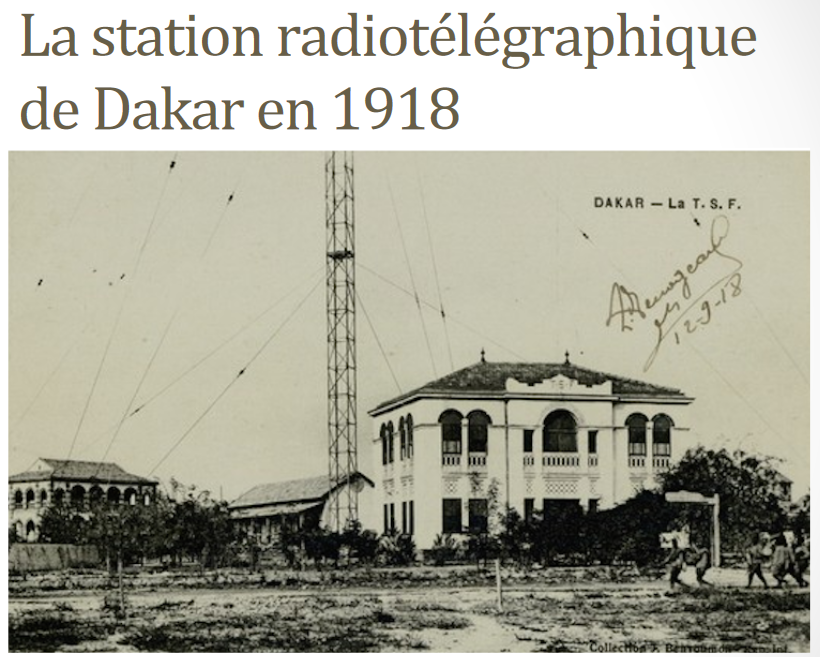
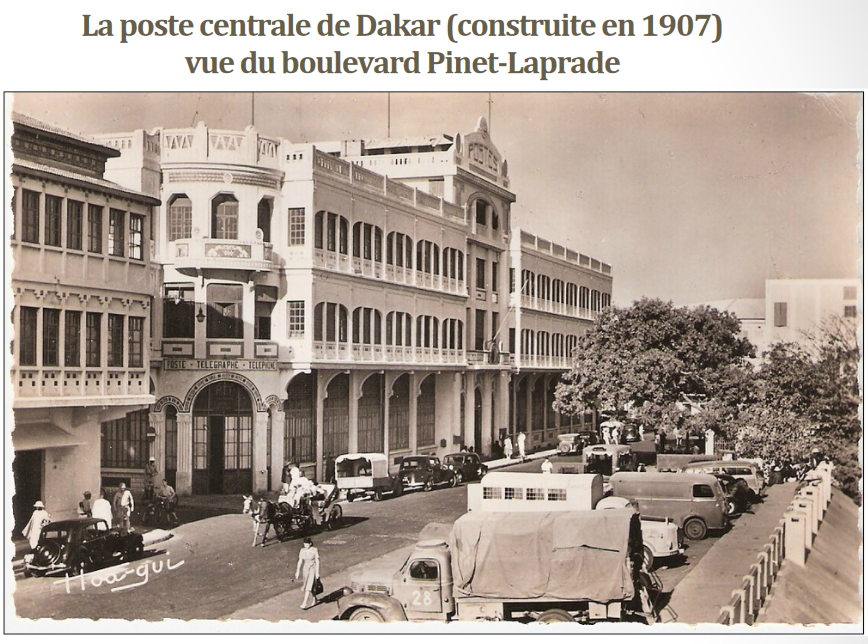
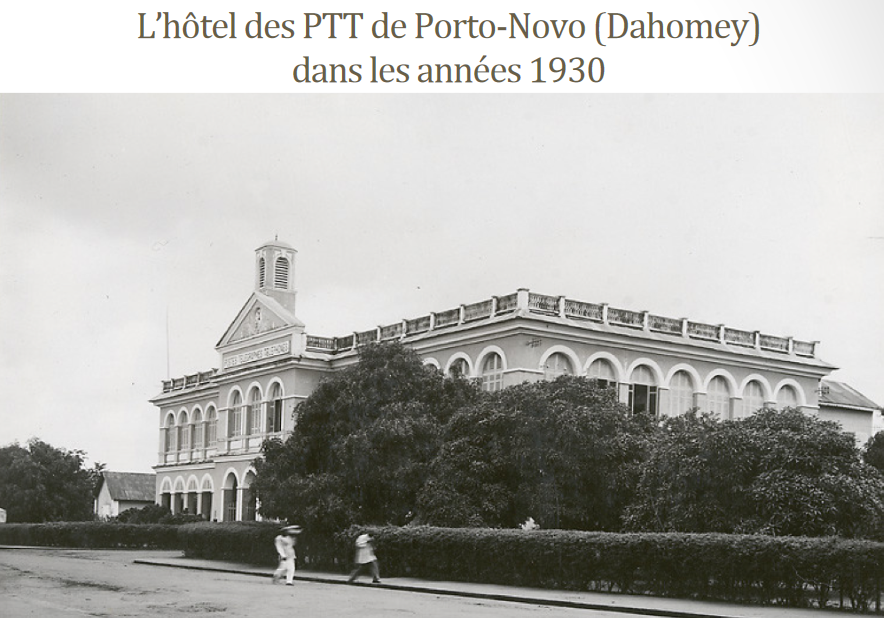
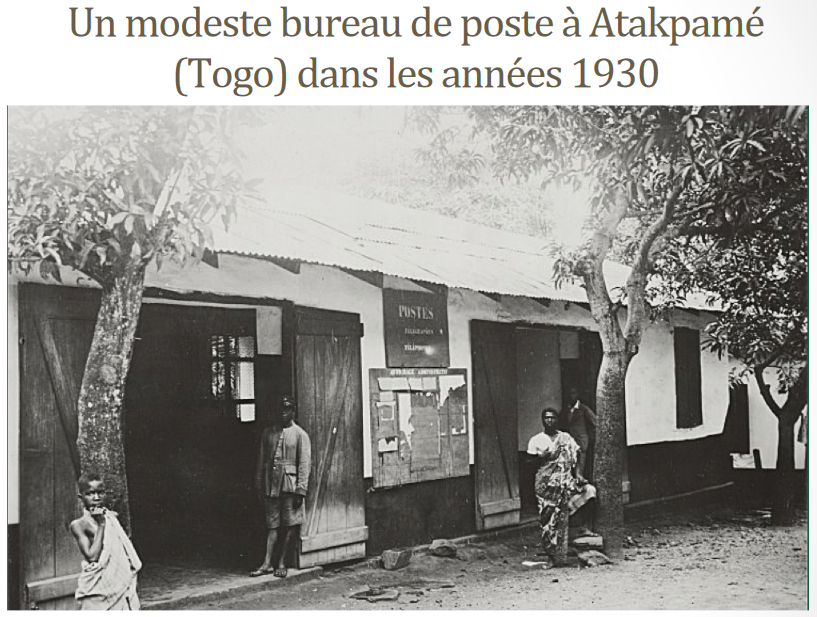
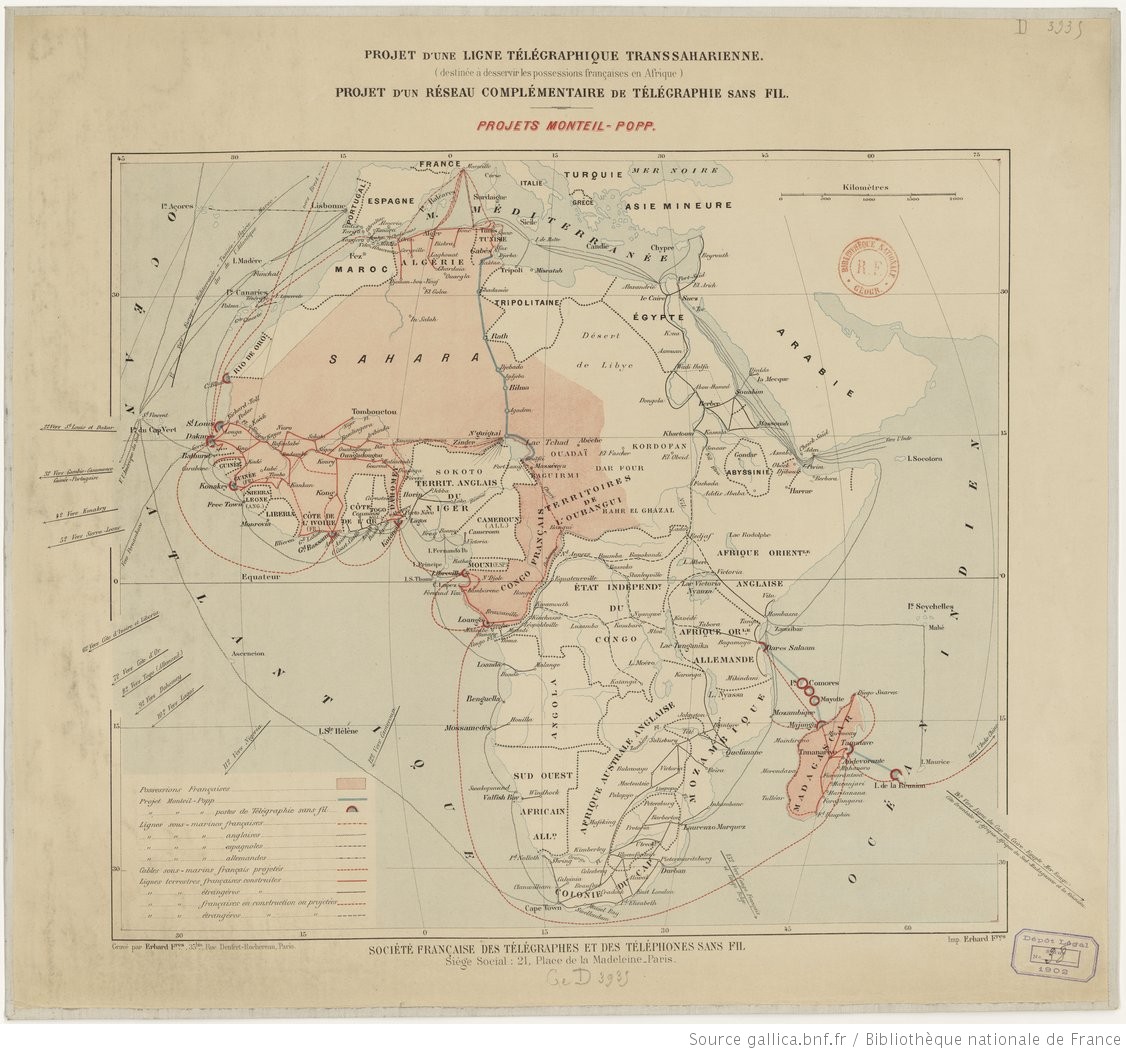

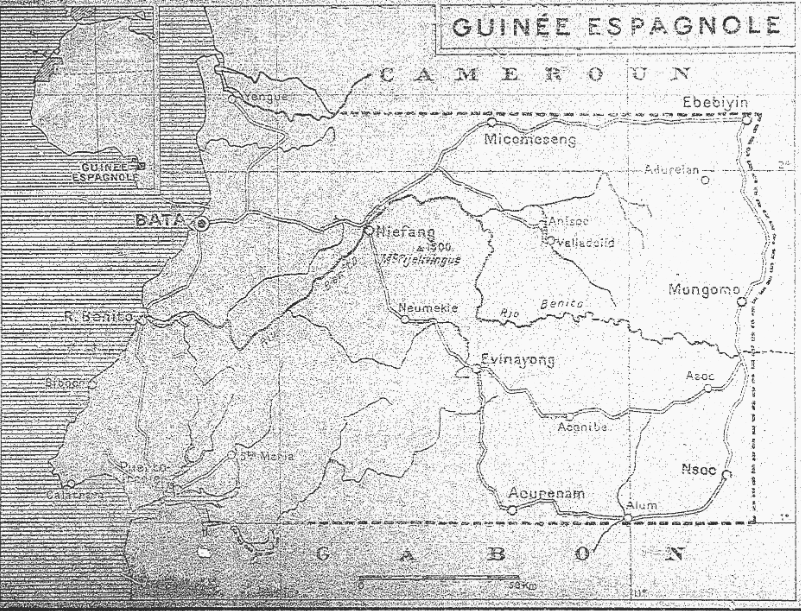 Agrandir
Agrandir
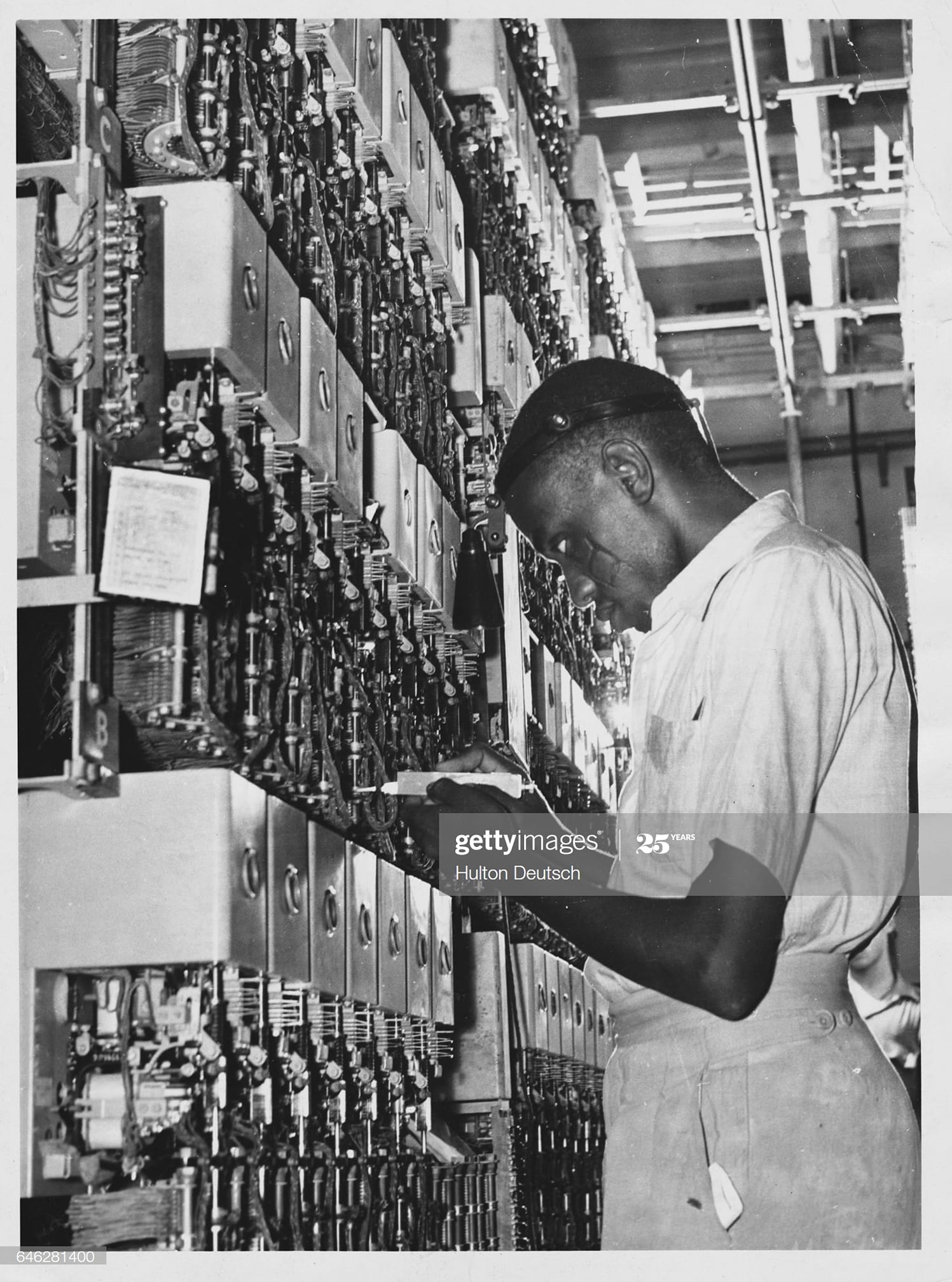 Un
homme au travail ajustant un sélecteur du central téléphonique
automatique de Khartoum au Soudan
Un
homme au travail ajustant un sélecteur du central téléphonique
automatique de Khartoum au Soudan 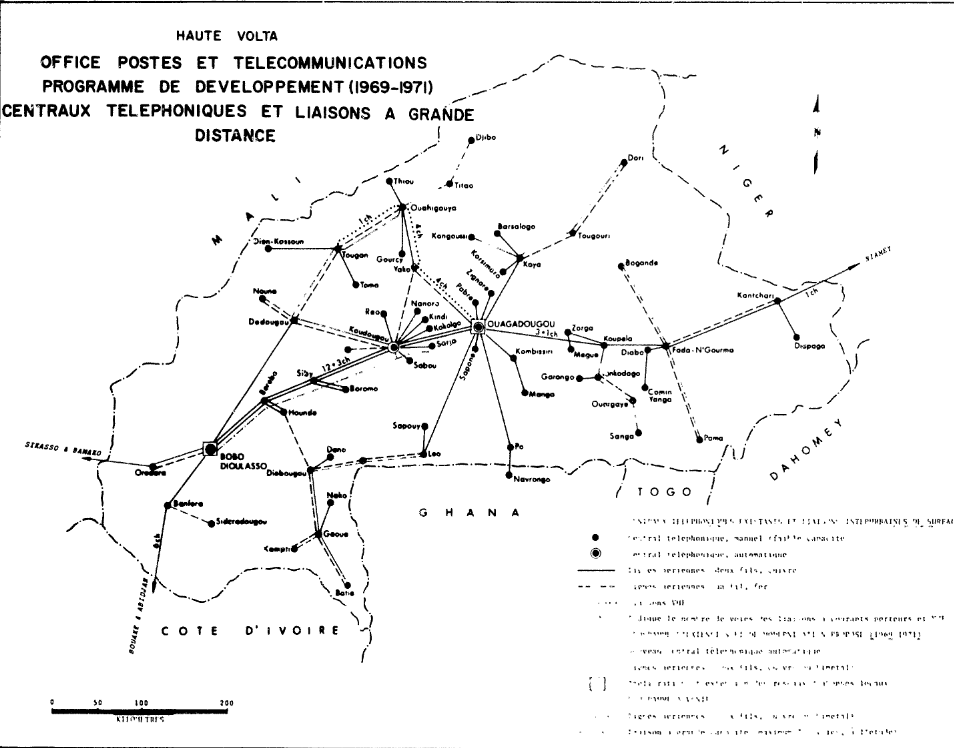
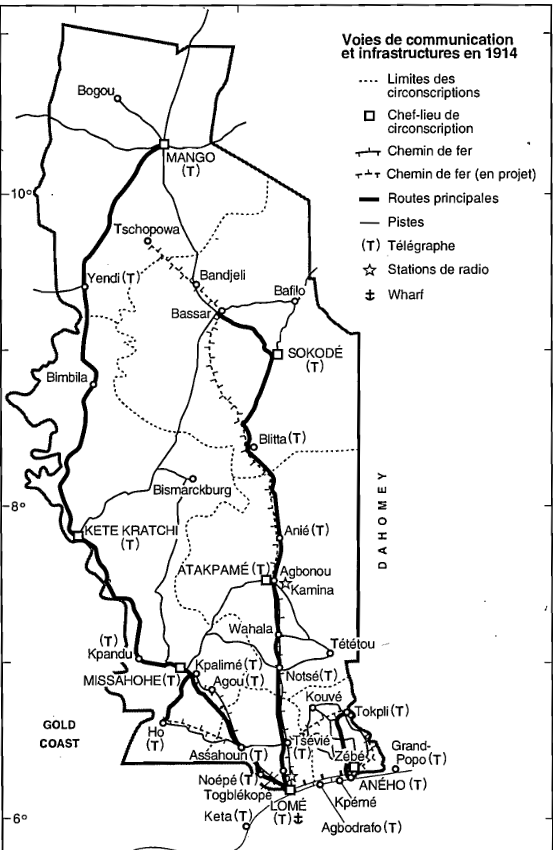
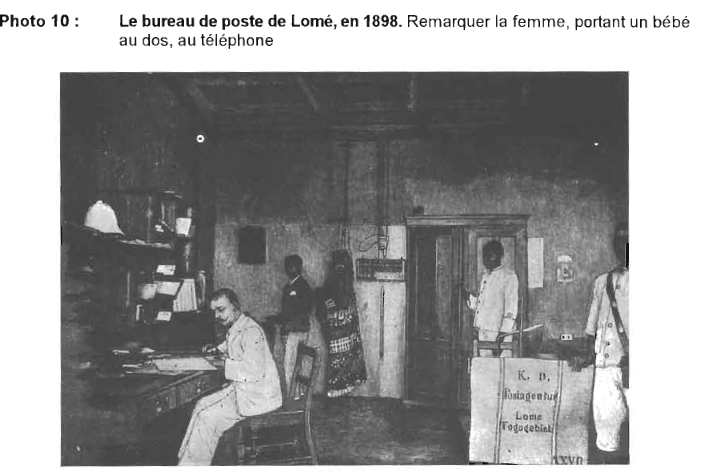
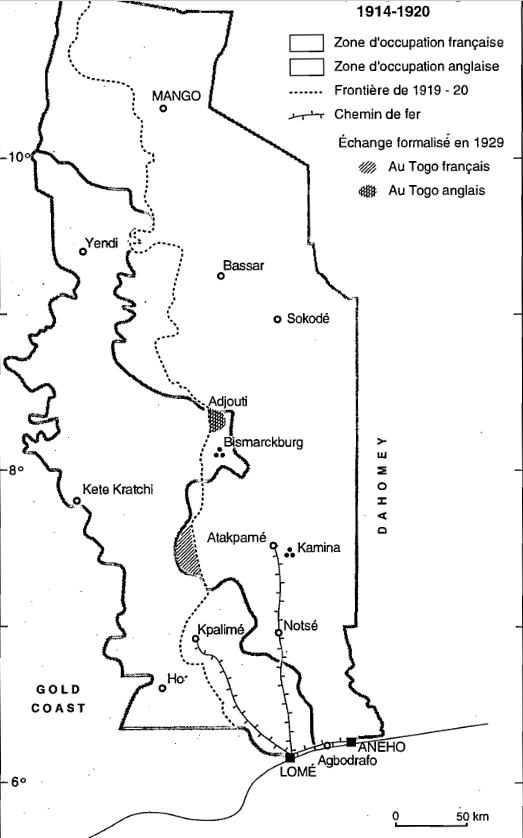 Les vainqueurs avaient conquis le Togo. Restait à l'administrer
à deux.
Les vainqueurs avaient conquis le Togo. Restait à l'administrer
à deux.