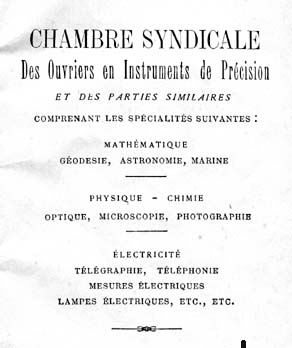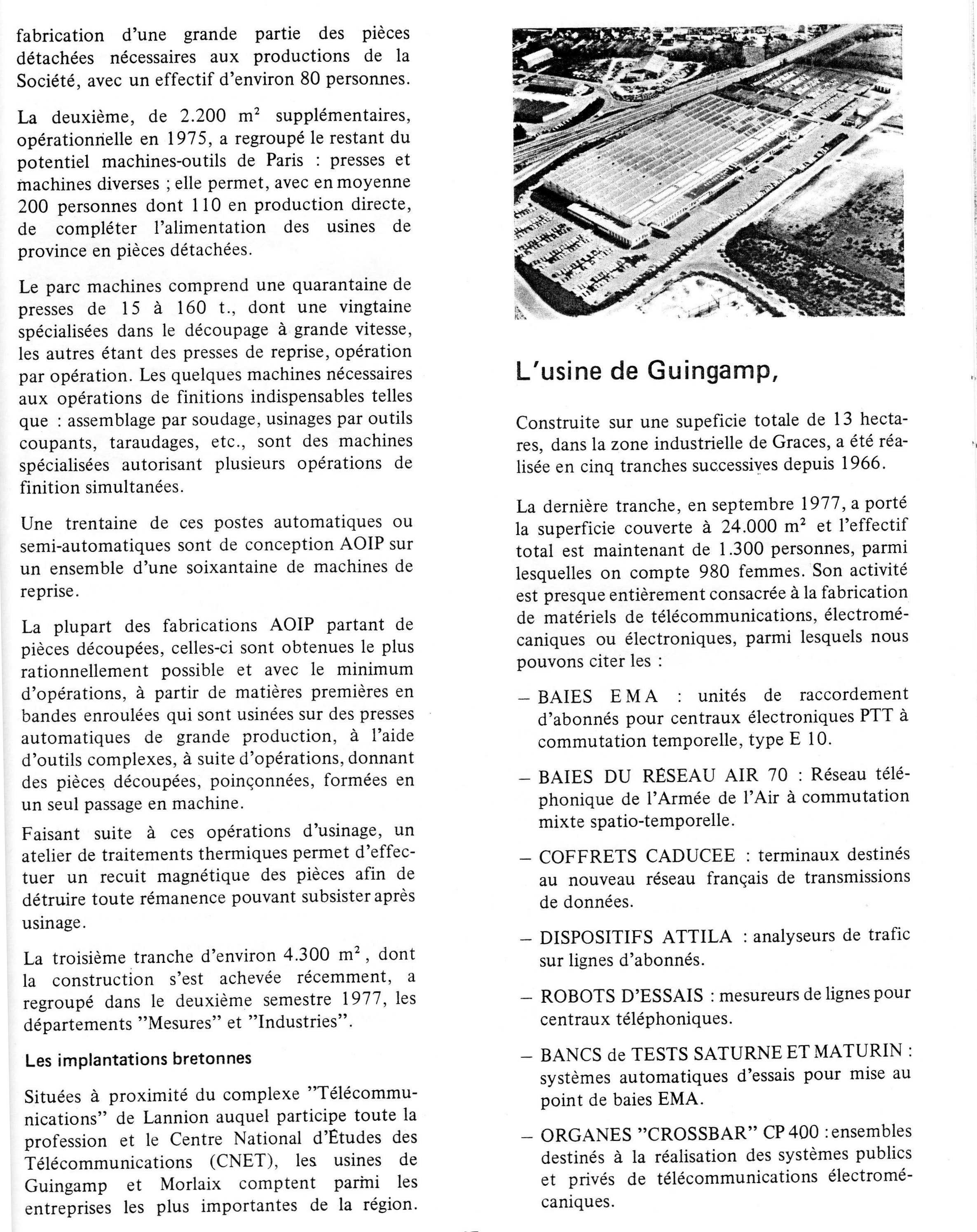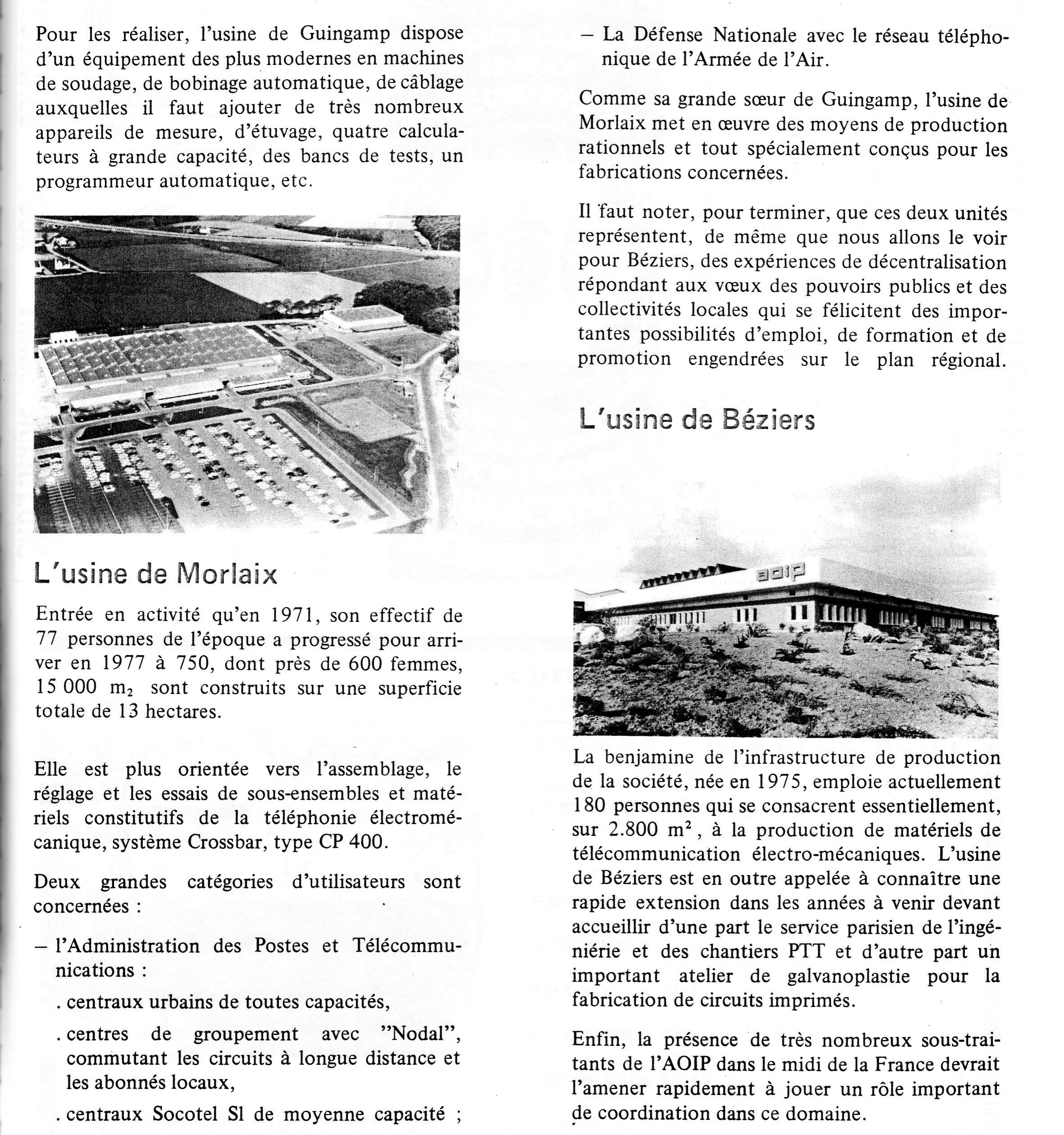A.O.I.P
Association des Ouvriers en Instruments de Précision.

En 1804 : apparition des premières Sociétés ouvrières
de secours mutualistes à Lyon.
En 1867 : la loi reconnaît les coopératives.
21 mars 1884, loi Waldeck-Rousseau : autorise le syndicat professionnel.
La liberté syndicale est enfin reconnue.
En 1884, création de la Chambre consultative des Associations
ouvrières de production (A.O.P.) regroupant, à l´origine,
29 coopératives.
Le 12 juillet 1892, les ouvriers de la corporation des ouvriers
en instruments de précision créent la “ Chambre
Syndicale des ouvriers en Instruments de Précision et des parties
similaires ”, suite à un différent entre le camarade
Charles VIARDOT et son patron.
A partir de 1893, ce syndicat publie un mensuel à
l'attention de ses adhérents : “ l'Eveil des Ouvriers
en Instruments de Précision ”.
Edmond Briat, le Secrétaire Général du syndicat,
publie un historique du syndicat dans la revue : Le Mouvement Socialiste,
en septembre 1899.
Du 23 au 28 septembre 1895, à LIMOGES, 75 délégués
représentants 28 fédérations, 18 bourses du travail,
126 syndicats non fédérés créent une organisation
unitaire et collective. La fédération nationale des
syndicats ne se joint pas à cette organisation, la fédération
nationale des bourses du travail, bien qu'à l'origine, reste
extérieure. Cette organisation prend le nom de Confédération
Générale du Travail. (C.G.T.)
Création de l'Association des Ouvriers en Instruments de Précision
et des Parties Similaires.
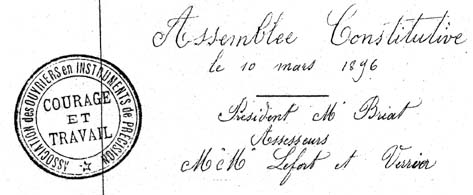
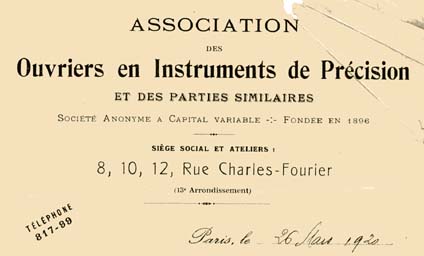
C'est dans cet état d'esprit que le syndicat
des Ouvriers en Instruments de Précision et des parties similaires
décide de créer une société à l'image
des idées qu'il défend. Naturellement celle-ci s'appellera
“ Association des Ouvriers en Instruments de Précision
et des parties similaires ”.
Comme on le voit sur le tampon, la devise est “ Courage et Travail
”.
Ce sont donc 48 membres qui, au cours de l'Assemblée Constitutive
du 10 mars 1896, participent à la création de la Scop.
“ Le citoyen Villa secrétaire de la chambre consultative
qui a bien voulu assister à la réunion prend la parole
et donne des renseignements sur la formation des associations ouvrières
et l'émancipation qu'elles pourrait prendre ainsi que les services
qu'elles pourront rendre ”.
Pendant plus de cinquante ans, on retrouvera souvent ce mode d'ordre
d' “ Emancipation par le travail ” et on parlera d' “
Atelier Social ”.
Le nom d'A.O.I.P. ne viendra que 30 ans plus tard.
On parlait plutôt d'A.O.P. qui a un double sens : Association
d'Ouvriers de Production (nom donné aux coopératives)
et Association d'Ouvriers de Précision. Les mots “ Instruments
de Précision ” prendront plus de sens après la
création de la Division Mesure.
sommaire
Créée, le 10 mars 1896 L’Association
des ouvriers en instruments de précision (AOIP) est une
coopérative ouvrière de production française,
dans le 14e arrondissement de Paris. 23 avenue du Maine avec les moyens
les plus restreints. C'est dans une salle du Café de l'Espérance,
23 avenue du Maine, qu'ont eu lieux les toutes premières assemblées
constitutives de la coopérative, en mars 1896.
Édouard Eugène BRIAT : Fondateur de
l'A.O.I.P
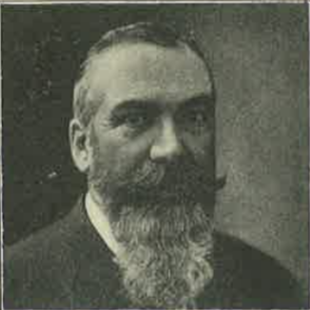
Mécanicien ; syndicaliste ; socialiste ; coopérateur.
fut membre de la coopérative de consommation de son quartier
« l’Avenir de Plaisance » ; il souhaitait
créer une coopérative de production d’instruments
de précision. Durant l’hiver de 1895-1896, il réussit
à réunir 80 de ses camarades syndiqués et, le
23 mars 1896, Briat est, avec 64 membres de son syndicat, le fondateur
de l'Association des Ouvriers en Instruments de Précision (A.O.I.P.)
en 1896. Il en sera le premier président et il en restera administrateur
jusqu'à la retraite.
 Charles
Viardot
Charles
Viardot  Edmond Martzel
Edmond Martzel
l’Association des ouvriers en instruments de précision
(AOIP) fut fondée avec Ch. Viardot comme directeur et
Edmond Martzel comme chef d’atelier. L’Avenir de
Plaisance soutint la jeune association ouvrière, dont un grand
nombre d’adhérents étaient également ses
propres sociétaires consommateurs, en lui faisant plusieurs
fois des prêts.
Briat fut également très actif sur le plan syndical.
Il participa au IXe congrès national corporatif — 3e de
la CGT — tenu à Toulouse (Haute-Garonne) en septembre
1897 et y représenta divers syndicats parisiens. Il assista
également au XIe congrès, Paris, septembre 1900 et au
XIVe congrès, Bourges, septembre 1904. Il représenta
la Bourse du Travail de Niort (Deux-Sèvres) à la conférence
de Bourges qui suivit, à Amiens, en octobre 1906, le XVe congrès
national corporatif (son nom ne figure que sur la liste des délégués
à la conférence).
Il donna cette définition du coopérateur : “ Le
coopérateur est un ouvrier éduqué et conscient
qui a fait un effort pour s’élever du salariat à
l’actionnariat, mais qui ne doit pas oublier que c’est le
syndicat professionnel qui a été le premier échelon
de son émancipation économique. Il doit donc rester
membre de son syndicat et ce syndicat doit être confédéré
à l’un des organismes centraux existants. ”. À
propos des ambitions de la Coopération du début du XXe
siècle, il explique : “ Notre action tend à
bouleverser une société basée sur vingt siècles
d’exploitation, d’égoïsme, pour lui substituer
une organisation fraternelle.
 Atelier rue de Vanves
Atelier rue de Vanves
Les débuts, s'ils furent audacieux, ne permirent d'enregistrer
d'abord que des résultats fort modestes : trois membres associés,
un atelier de quelques mètres carrés abritant quatre
machines au pied et à main. Les organisateurs ne se découragèrent
point et peu à peu virent leurs efforts couronnés de
succès. L'essor de l'association devait se manifester d'abord
par une extension progressive et continue des ateliers.
À la fin du XIXe siècle, 64 ouvriers
de la Chambre syndicale des ouvriers en instruments de précision
de Paris se réunissent pour créer leur entreprise. C'est
le secrétaire de cette chambre syndicale, Edmond Briat –
futur secrétaire général de la Chambre consultative
des associations ouvrières de production de 1907 à 1940
– qui en sera le premier président. La première
assemblée élit un certain Viardot comme premier
directeur.
Ses activités se concentrent dans les domaines
de la téléphonie et des marchés publics,
et comprennent :
- la fabrication d'appareils photo et de matériel cinématographique
,
- la fabrication de télégraphes et téléphones
(Marty 1910…),
- la fabrication et l'installation de centraux téléphoniques
(multiples),
- la fabrication d'appareils de mesure à aiguille, électroniques,
de boîtes de résistance (dont la fameuse « boîte
noire » connue des étudiants),
- la fabrication de matériel d'automatisme (démarreurs),
- la fabrication de matériel de navigation (gyrocompas),
- la fabrication de commutateus téléphoniques
automatiques
…
Dans ce site consacré au téléphone, je ne détaillerais
pas les activités autres, qui sont cependant importantes et
vitales pour l'entreprise.
1897 l'Administration des postes et télégraphes
passe sa première commande d'appareils Morse à l' A.O.I.P..
Cette première commande est importante pour son l'avenir car
elle entame une collaboration qui durera plus de 80 ans. Les commandes
ne cesseront de progresser si bien qu'à la fin de l'année
1899 l'administration des PTT devient le principal client de la jeune
coopérative.
1902 pour satisfaire aux demandes croissantes
de l'Administration, l'atelier social est transféré
6 impasse Léonie, dans des locaux beaucoup plus spacieux.
1904, pour la première fois, les bénéfices
sont importants puisqu'ils atteignent 10 % du chiffre d'affaires.
L'assemblée doit statuer sur leur
répartition. Le conseil d'administration propose de les distribuer
aux associés, mais l'assemblée n'est pas d'accord avec
cette proposition.

Dès 1905, l’AOIP est agréée par les PTT
eu égard à ses performances en téléphonie,
en 1906 l'Administration des Postes et télégraphes
admet L'A.O.I.P. sur la liste de ses fournisseurs pour les appareils
multiples à batterie centrale.
La coopérative doit équiper les villes de Rouen et Grenoble.
De plus, elle obtient une adjudication de tableaux standard de téléphone
à 100, 50 et 25 directions. Ceci représente un travail
important.
L’AOIP est à l’avant-garde sociale. Dès 1905,
elle pratique la journée de huit heures, adopte l’horaire
souple deux ans plus tard. L’AOIP se veut pure et dure : pas
de cadre, pas d’ingénieur, un salaire unique du directeur
à l’ouvrier. (Pas de femmes non plus…)
1906 installation du premier centre muliple à
Rouen
Le 4 avril 1907 le conseil d'administration décide d'acheter
un terrain de 3000 carré situé rue Charles Fourier dans
le 13 éme arrondissement.


Bâtiment de l'A.O.I.P., rue Charles Fourier vers 1930.
Les années qui suivent l'installation dans les nouveaux locaux
sont marqués par une progression assez spectaculaire.
En 1907, on procède aux premiers agrandissements, deux
ans plus tard l'A.O.I.P. double la superficie des terrains attenants
à ses usines. Plus récemment, un magasin d'exposition
est créé rue du Renard.
En 1907, l'AOIP comptait déjà 100 ouvriers s'installait.
En 1907, J.-B. Dumay qui avait succédé
l’année précédente à Vila comme secrétaire
de la Chambre consultative des associations ouvrières de production,
abandonna sa fonction. C’est Briat qui le remplaça ; en
1940, il fut mis à la retraite. En 1944, on le rappela et on
le remplaça au poste de secrétaire, pour peu de temps,
car, alors âgé de quatre-vingts ans, il désirait
le repos. Il était, depuis la fondation, administrateur de
l’AOIP. Il présidait la Banque des coopératives
de production créée en 1893.
1911 L'A.O.I.P. installe un standard multiple à Limoges
puis un autre à Nancy. Les années suivantes, ce sont
les villes de Calais, de Grenoble et de Belfort qui sont équipées.
Les commandes pour la téléphonie privée sont
également soutenues .
Une commande de 100 dynamos et 700 appareils, exige
la construction d'un atelier spécial, de hangar et l'agrandissement
du BE.
Un effort de publicité est alors entrepris, un catalogue des
divers appareils construits par la coopérative est adressé
aux entreprises privées
À la veille de la Première guerre mondiale, l'AOIP instaure
la semaine de cinq jours et demi.
1914 La prospérité s'accroît jusqu'à
la mobilisation avec comme conséquence immédiate, la
réduction brutale des effectifs de 183 en juillet à
54 fin août. En 1916 les effectifs sont redevenus 350.
La société sera longtemps à la pointe du progrès
social avec, notamment, un salaire unique du directeur à l'ouvrier,
et l'obligation d'être syndiqué pour se porter candidat
au sociétariat.
En 1917, une caisse de retraite et une école d'apprentissage
sont mises en place ; ces deux organes fonctionneront pendant plus
de 70 ans.
A la fin de la guerre l'administration des PTT passe immédiatement
des commandes importantes pour réduire le retard
considérable au niveau des équipements téléphonique.
1919, 2 appareils multiples sont installé, l'un à
Mulhouse et l'autre à Casablanca au Maroc. A la fin de la même
année , la société reçoit une commande
pour un équipement de 10 000 abonnés pour la ville de
Strasbourg.
Un catalogue général est édité et une
action publicitaire est entreprise.
Un magasin de vente des produits est ouvert à Paris , 11 rue
Charles Fourier et un autre à Strasbourg 16 rue du 22 novembre.
 Centres multiples batterie centrale installés en 25 ans.
Centres multiples batterie centrale installés en 25 ans.
Briat était en 1923 secrétaire général
de la Chambre consultative des associations ouvrières de production
dont Petrement Pierre* était président. Il fut vice-président
du conseil supérieur du Travail au ministère du Travail.
Candidat du Parti socialiste aux élections municipales complémentaires
de novembre 1921 qui eurent lieu à Paris dans le quartier de
la Santé, XIIIe arr., il obtint 254 voix et ne fut pas élu.
En 1924, création d'une division mesure électrique,
puis navigation (elle fabrique les gyrocompas pour la Marine nationale),
travaille pour la société électronique Marcel
Dassault.
De 1925 à 1940, Briat fut membre du Conseil
national économique.
La croissance est exponentiel et les effectifs croissent très
rapidement en 1929 et 1930 des appareils à batterie centrale
sont installés dans plus de 45 villes. A cette époque
L'A.O.I.P. construit son premier centrale téléphonique
automatique installé à Charleville (Mézières)
.

1927-28 Grâce à son bureau d'études,
L'A.O.I.P. prouve qu'elle s'adapte aux besoins du réseau téléphonique
national. La fabrication et l'installation de nouveaux centraux téléphoniques
type R6 sont
entreprises avec succès.
L'outillage pour cette fabrication est entièrement réalisé
par L'A.O.I.P. et exige des investissements de plusieurs million de
francs.
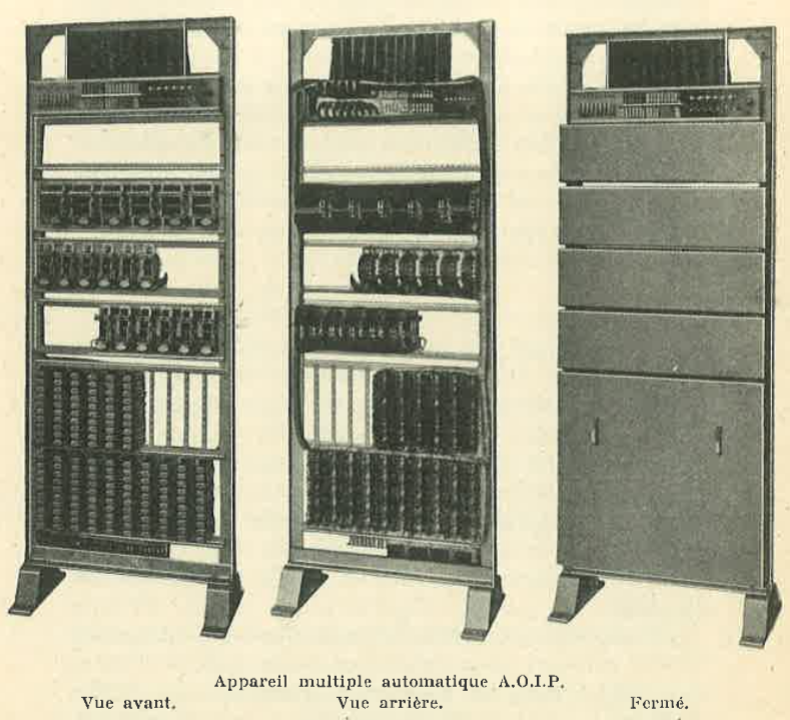 Appareil
mutltiple automatique
Appareil
mutltiple automatique
En 1930 A touts les salariés, une caisse de retraite,
constitué par prélèvement de 32% sur les bénéfices,
assure à 55 ans d'âge une retraite de plus de 58% du
salaire.
Au début de cette année-là, le développement
de sa production l'obligeait de construire de nouveaux ateliers.
Les travaux commencés en février 1931 étaient
terminés en décembre de la même année.
Ils portaient à 12.500 mètres carrés environ
la surface totale des locaux industries de l'association.
C'est en mars 1930 que l'AOIP se mit en rapport avec le bureau d'Etudes
industrielles " Techna ", qui lui était apparu particulièrement
qualifié pour concevoir et mener à bien les plans qu'elle
envisageait. Cet organisme absolument indépendant peut en effet
mettre à la disposition des intéressés tout un
corps d'ingénieurs et d'architectes spécialisés
dans les réalisations industrielles. La mission qui en l'occurrence
lui fut confiée exigeait en effet, par sa propre diversité,
la réunion des compétences les plus diverses.
La Société coopérative ouvrière "
l'Hirondelle" s'était vu confier l'entreprise générale
des bâtiments. Pendant près d'un semestre trois équipes
de huit heures dotées d'un éclairage puissant s'employèrent
sans relâche. L'ensemble de la construction, d'une harmonie
très sûre, forme une des plus belles usines et des plus
modernes de toute la région parisienne.
Le diamètre au départ des compteurs
mesure l'importance du réseau de distribution de gaz de l'usine
de l'A. O. I. P. Ce diamètre est de 110 mm. Chaque ouvrier,
en effet, doit avoir son brûleur individuel. En outre, certains
postes essentiels, tels que les étuves à vernis, doivent
être chauffés au gaz. Toutes les cuves des trains de
nickelage, de décapage, de découpage de l'ébonite
sont également munies de brûleurs à gaz. Cette
installation complexe et délicate a été .exécutée
de main de maître par l'Association des ouvriers plombiers,
couvreurs, zingueurs du département de la Seine, une société
coopérative qui a joué un rôle de poids dans l'histoire
de la coopération. Son directeur, M. Lejeune, président
de nombreuses organisations coopératives, a reçu la
croix à ce titre.
Le chauffage n'a pas été l'objet de moindres soins que
l'éclairage rationnellement calculé et distribué.
Des précautions particulières ont été
prises pour éviter l'impression si pénible du "
mur de glace " aux ouvriers travaillant devant les immenses châssis
vitrés. Les établis sont chauffés par dessous
à l'aide de tubes lisses. La ventilation n'a pas été
négligée. Les appareils aérothermes y pourvoient
en toute saison au moyen de prises d'air extérieures. Ce sont
les Etablissements Fayolle qui ont été chargés
de cette partie des aménagements. La chaufferie qu'ils ont
établie apparaît comme un modèle du genre. Cinq
chaudières du type" Idéal Classic H. F. "
peuvent indifféremment consommer du charbon ou du mazout. Leur
puissance totale installée est de 1.350.000 calories. Elles
sont équipées chacune d'un brûleur à mazout
" Quiet May " de la Société Chaleur et Froid.
La disposition des bâtiments qui viennent d'être
édifiés rue Charles-Fourier et les disponibilités
de terrain qui les environnent peuvent se prêter à toutes
les extensions que promettent à l'A. O. I. P. son organisation
sociale si remarquable et le succès constamment et légitimement
rencontré par ses efforts.
Dix-huit mois après, le ministre du travail inaugurait ces
constructions nouvelles et consacrait ainsi officiellement la réussite
de l'A.O.I.P. Le nombre des ouvriers adhérents s'est accru
d'année en année et, à l'heure actuelle, plus
de 550 sont employés chaque jour à l'usine.
Le chiffre d'affaires de l'association dépasse 30 millions
de francs.
Cet admirable développement est dû pour une bonne part
à l'heureuse gestion de l'A.O.I P., mais aussi à l'extension
que prend chaque jour l'usage du téléphone et à
l'effort poursuivi par l'État pour l'amélioration des
réseaux existants. Cela se traduit pour l'A.O.I.P. par des
commandes importantes et souvent renouvelées.
L'activité des dirigeants de l'association ne s'est pas bornée
aux aménagements professionnels. C'est ainsi que les bénéfices
réalisés ont permis la création successive d'un
service social, d'une caisse de secours, d'une maison de repos et
enfin d'un centre d'éducation à l'usage de nombreux
apprentis.
sommaire
Au plus fort de ses capacités, elle comprend
deux usines en Bretagne (Morlaix, Guingamp), une usine à Béziers,
une à Toulouse, une à Évry, le siège social
et une autre usine à Paris XIIIe, rue Charles-Fourier.
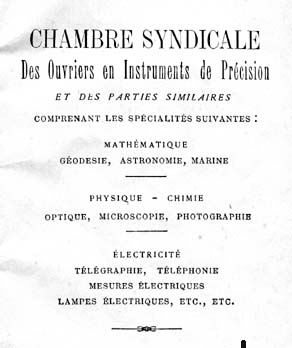
1938 La guerre se fait sentir à l´avance, la période
est tendue et les mobilisations commencent . Dans ce climat, le gouvernement
demande à certaines entreprises, dont l´A.O.I.P., de
prévoir une usine de repli : l´A.O.I.P. achètera
une usine à Saint-Cyr-sur-Loire (banlieue de Tours).
Le Conseil d´Administration a laissé un récit
complet de cette période où les décisions n´ont
pas été toujours comprises. Une partie des ouvriers
en age de combattre part en direction de l´usine de St-Cyr-sur-Loire.
Hasard ou préméditation, le gouvernement se replie aussi
sur Tours, ce qui va poser des problèmes de logement, avant
de continuer sur Bordeaux.
L´exode de l´A.O.I.P. s´arrêtera entre Brives
et Limoges. La fuite n´a plus de sens. Le matériel et
les hommes rentreront sur Paris en Août 1940, rejoindre ceux
qui étaient restés sur place pour garder l´usine.
L´usine parisienne redémarre. A partir de septembre,
c´est le retour des hommes mobilisés. L´effectif
est de 760 dont 23 femmes de prisonniers.Le camion 3T est transformé
au gazogène et la camionnette pour rouler à l´alcool.
L´usine de St-Cyr sur Loire, inutilisée, est mise en
vente. Une usine est aménagée à Viry-Châtillon
pour la fabrication de poudre de fer (8 personnes).
Avant guerre, l´A.O.I.P. travaillait pour les administrations
: PTT, SNCF, armée… ; en 1940 elle reprend avec ces mêmes
clients. Pour obtenir les marchés publiques, il faut constamment
maintenir ses habilitations (Arbiet). Le travail et la relative tranquillité
des travailleurs est à ce prix.
Certains associés refusent que les femmes occupent des postes
à responsabilités (chefs d´équipes,…)
1939 l´A.O.I.P. compte environ 825 salariés
dont 340 associés (sociétaires).
Se voulant une entreprise artisanale où il fait bon vivre entre
sociétaires, l’AOIP sort exsangue de la Seconde Guerre
mondiale.
Durant les années d'après guerre les
commandes des PTT sont rares, il faut se tourner vers la téléphonie
privée l'exportation et la diversification.
L'AOIP était chargé de fabriquer des commutateurs R6
et fournissait en 1954 le SRCT 500 lignes pour les centres EDF



En 1948, le ministère des Finances la renfloue
à hauteur de six millions d’anciens francs. Mais pose
trois conditions : plus de salaire unique, ouverture du sociétariat
à tous et obligation de prendre des directeurs extérieurs
aux sociétaires. La coopérative se normalise, perd son
esprit corporatiste mais s’ouvre aux femmes.
1958 L'A.O.I.P. s'associe avec CIT et
ERICSON.
La SO.CO.TEL., société d'économie
mixte est créée le 5 février 1959, groupe
l'État et les cinq grands constructeurs de matériel
de commutation télégraphique et téléphonique
:
Association des ouvriers et instruments de précision (A. O.
I. P.) ;
Compagnie générale de constructions téléphoniques
(C. G. C. T.) ;
Compagnie industrielle des télécommunications (C. I.
T.) ;
Le Matériel téléphonique (L. M. T.) ;
Société française des téléphones
Ericsson (S. T. E.).
Le but de cette société inter-constructeurs est d'étudier
ensemble l'electronisation des centraux téléphoniques.
Au début des années 60, l'état prend conscience
du retard de la France en matière de téléphonie
et lance au cours de plans successifs, un ambitieux programme de développement.
Cette décision va bouleverser la vie de la coopérative
qui va connaître pendant deux décennies une croissance
effrénée quelle ne va pas complètement maîtriser.
En 1960 L'A.O.I.P. prend la licence du système Crossbar
CP 400 d'ERICSSON


Ateliers de la rue du Moulin de la Pointe, montage des baies CP400,
et atelier de soudage.
1966 Création de l'établissement
de Guingamp
1971 Création de l'établissement de Morlaix
1975 l’AOIP va devenir la plus grande coopérative
ouvrière du monde, avec 4665 employés et 710 millions
de francs de chiffres d’affaires.
1978 Implantation à Toulouse des études de la
téléphonie
Deux ans avant Mai 68, les PTT demandent à l’AOIP d’augmenter
sa production de matériel téléphonique d’autant
que ses centrales Crossbar sont un succès technologique. De
750 personnes, en 1967, les effectifs cumulent à 4 665 sept
ans plus tard, avec la création d’usines à Guingamp,
Morlaix, Béziers, Toulouse, Rungis et Évry.
Le 20 mai 1968, à l’issu d’un vote à bulletin
secret, 75% des inscrits votent la grève avec occupation des
locaux.
1968 La Téléphonie absorbe la division Électronique.
Dans les années 1970, elle devient la
plus grande coopérative d'Europe, hors URSS, avec 4 600 salariés.
Elle commercialise ses produits sous les marques « Association
des ouvriers en instruments de précision », puis «
AOIP ».
Interrogée, en 1975, par la sociologue Danièle Linhart
(lire « l’Appel de la sirène » disponible
sur le Web), un ouvrier témoigne : « Une coopérative,
ça peut se comprendre quand il y a 40 ou 50 personnes, ça
représente la participation de chacun dans l’entreprise,
chacun sait qu’il ne travaille pas pour un patron, mais pour
le bien de lui-même et de l’entreprise... à l’AOIP
on ressent pas tellement tout ça, il y a des grèves
que normalement on devrait pas avoir dans une coopérative,
car on travaillerait contre son propre intérêt... Les
travailleurs se heurtent à une direction, et on a l’impression
qu’il y a un patron... simplement à l’AOIP, il y
a peut-être plus d’avantages. »
Un administrateur rétorque : « Pour faire du social,
il faut être rentable. »
Les intérimaires ne savent même pas qu’ils travaillent
dans une coopérative bien qu’ils notent une ambiance plus
détendue qu’ailleurs. « On n’a pas tout le
temps les chefs sur le dos comme dans les autres usines. » «
Ici, c’est pas comme ailleurs, on a le respect de la personne
humaine. » « On a la possibilité de circuler dans
la maison sans se faire rappeler à l’ordre par un supérieur
hiérarchique. »
Un jeune ajusteur-régleur a ces phrases bien senties : «
Ici, c’est comme dans toutes les maisons, je fais pas la différence…
à part une bonne camaraderie dans notre secteur. Mais le travail,
il est toujours pareil… On n’est pas considéré
comme des bêtes, mais comme des fourmis travailleuses, on fait
partie de la machine, on fait partie des meubles. »
Au décolletage, le turn-over est vertigineux, on travaille
dans l’huile. Une OS de 30 ans lâche : « C’est
surtout terrible pour les femmes qui sont coquettes, à cause
de l’odeur… »
Le spectre de Charles Fourier hante alors les ouvrières. Ne
lui prête-t-on pas l’invention du mot féminisme
?
En 1979, une décision ministérielle
partageant le marché des télécommunications entre
seulement deux entreprises, à savoir Thomson et CIT Alcatel,
manque de sonner le glas pour l'entreprise.
1980 Abandon de la" téléphonie publique
" cession de Guingamp et de Morlaix, les effectifs propres
diminuent de 3000 personnes; 1500 suppression d'emplois .
Elle redémarrera finalement avec les 1 500
salariés restants, en conservant ses départements de
téléphonie privée, automatisme, mesure, robotique
(AKR), circuits imprimés (Europe Circuits), etc. qui ne sont
pas détaillés sur ce site.
De 1979 à 2003, abandonnée par
les pouvoirs publics, malgré le nombre important de ministres
ayant auparavant défilé à la tribune des assemblées,
elle perdra petit à petit ses différentes activités,
ses biens immobiliers, ses salariés, pour arriver,
1981 Démarrage d'AKR (ex division "gyrocompas") Démarrage
de l'usine de circuits imprimés .
1984 Filialisation de "Europe circuits", usine de circuits
imprimés à Béziers.
1985 Charles Fourier est vendue, la téléphonie privée
est cédée à Jeumont-Schneider
1987 Filialisation des divisions Automatismes, Mesures et Services,
AKR est cédé à Krémlin.
5 janvier 1979. — M . Paul Balmigère Informe
M. le ministre de l'industrie des graves préoccupations actuelles
de l'ensemble des travailleurs de l' unité de production de
l 'AOIP de Béziers. Cette entreprise, 180 salariés
actuellement à Béziers, alors qu'un objectif de développement
de 1 500 emplois avait été prévu, a une importance
réelle dans l 'économie de la ville . Les suppressions
d'emplois planifiées actuellement dans la téléphonie
inquiètent le personnel de l 'entreprise et la population biterroise
. Il lui demande dune d 'étudier attentivement les différentes
propositions faites
par le syndicat de cette entreprise pour éviter des licenciements
catastrophiques : réduction de travail sans perte de salaire,
avancement de l'âge de la retraite, suppression du travail au
rendement, diversification des productions et passage à l 'électronique
avec le personnel actuellement en place. Prise en compte de la situation
locale de l'emploi, en particulier en ce qui concerne le taux de chômage
de la main-d 'oeuvre féminine.
Réponse . — Une réponse a été adressée
directement à l'honorable parlementaire
...
le 24 février 2003, devant le tribunal de commerce
d'Evry, à un plan de cession totale, désignant la reprise
de 66 personnes par le groupe Aasgard sous le nom d'AOIP sas.
sommaire

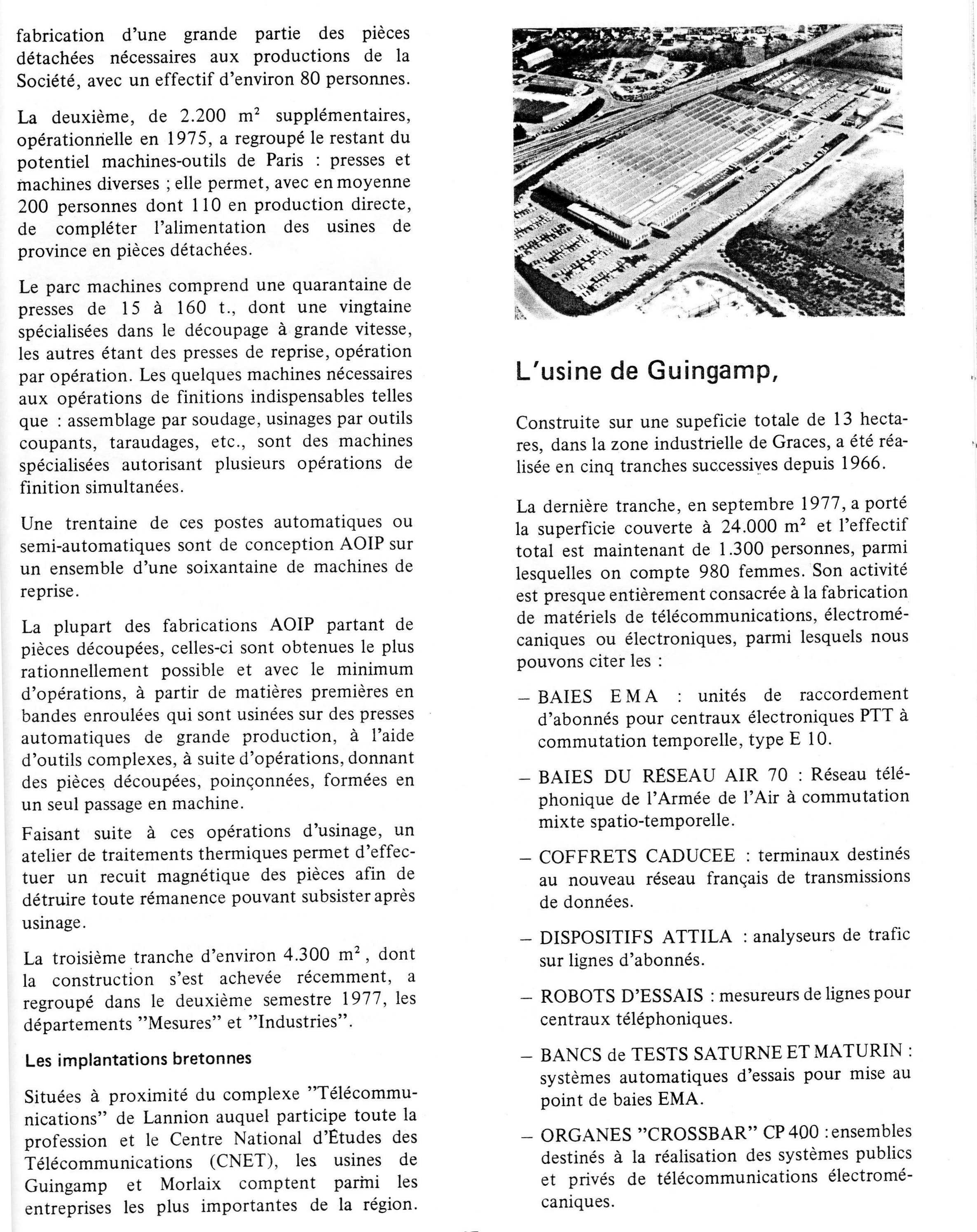
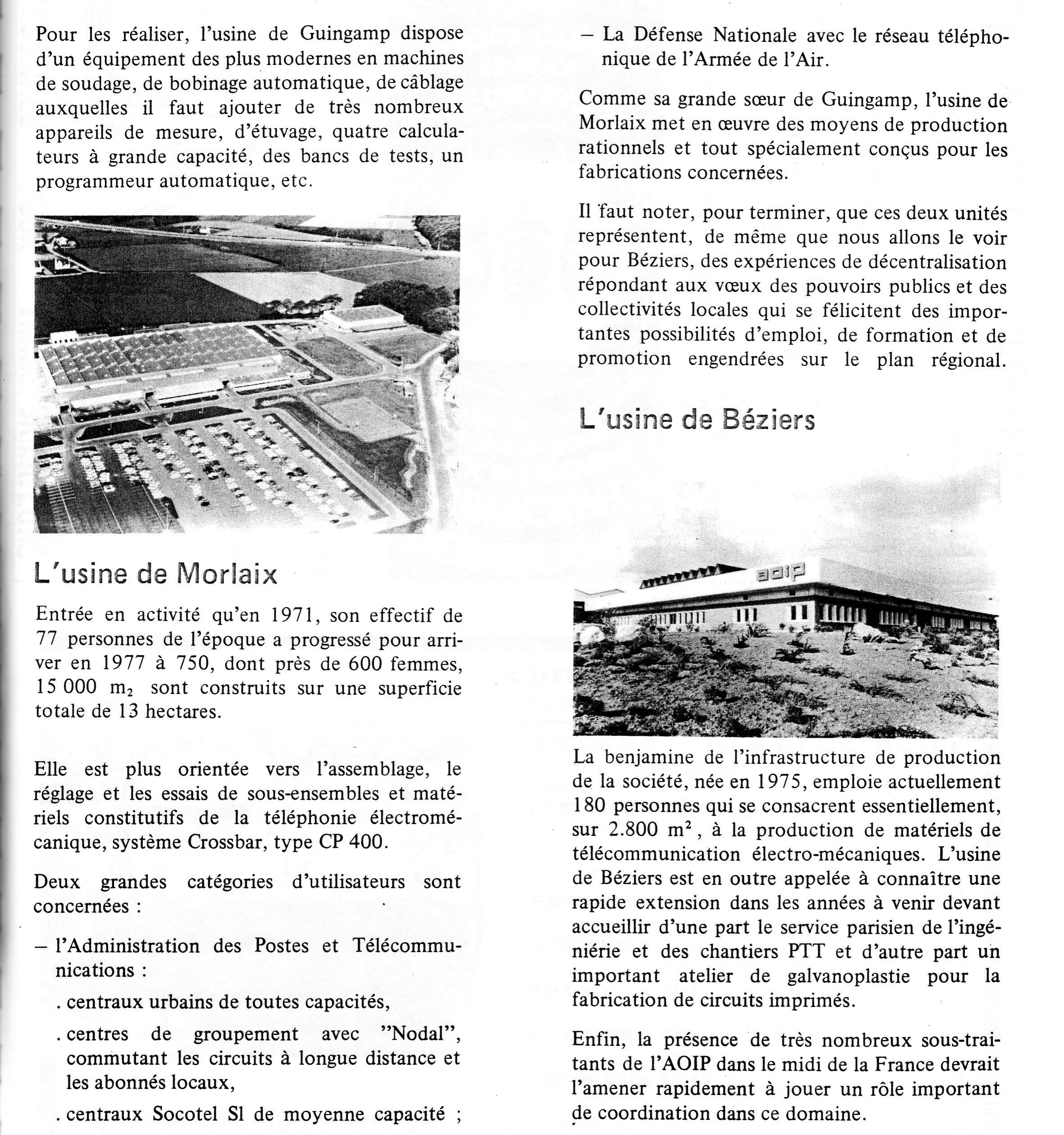
sommaire
Le matériel téléphonique
Les postes téléphoniques Les Marty 1910 sont
les premiers appareils du réseau de l'état intégrant
un appel magnétique (une magnéto). Ils sont aussi les
premiers répondant à un cahier des charges précis,
et sont ainsi produit en grande série par plusieurs sociétés.
Le modèle fabriqué par l'Association des Ouvriers en
Instruments de Précision (AOIP) est de loin le plus commun.

Les "Centres Multiples"
Dans les grands centraux téléphoniques du réseau
public, les petits commutateurs sont remplacés par des pupitres
opérateurs, ou keyboard. Il y a, en plus des clés, des
dicordes (câble dont les deux extrémités sont
munies d'une fiche Jack) destinés à connecter les abonnés.
On leur associe des tableaux de fiches complémentaires, les
multiples, pour rationaliser l'emploi des lignes. Il s'agit de tableaux
comprenant les volets d'appel et les fiches Jack de connexion. Un
dicorde peut être branché sur la ligne de l'abonné
et être renvoyé vers un multiple qu'une autre opératrice
connectera.
Les centres téléphoniques Crossbar CP400 et R6.
Les centres téléphoniques électroniques E10.
...
sommaire

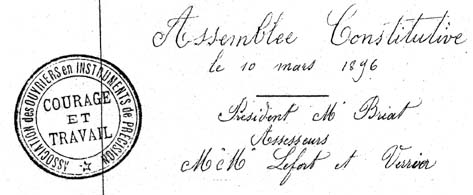
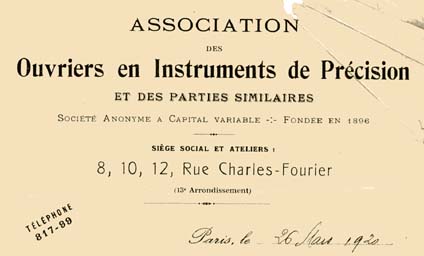
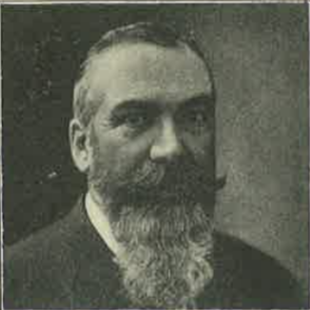
 Charles
Viardot
Charles
Viardot  Edmond Martzel
Edmond Martzel



 Centres multiples batterie centrale installés en 25 ans.
Centres multiples batterie centrale installés en 25 ans.
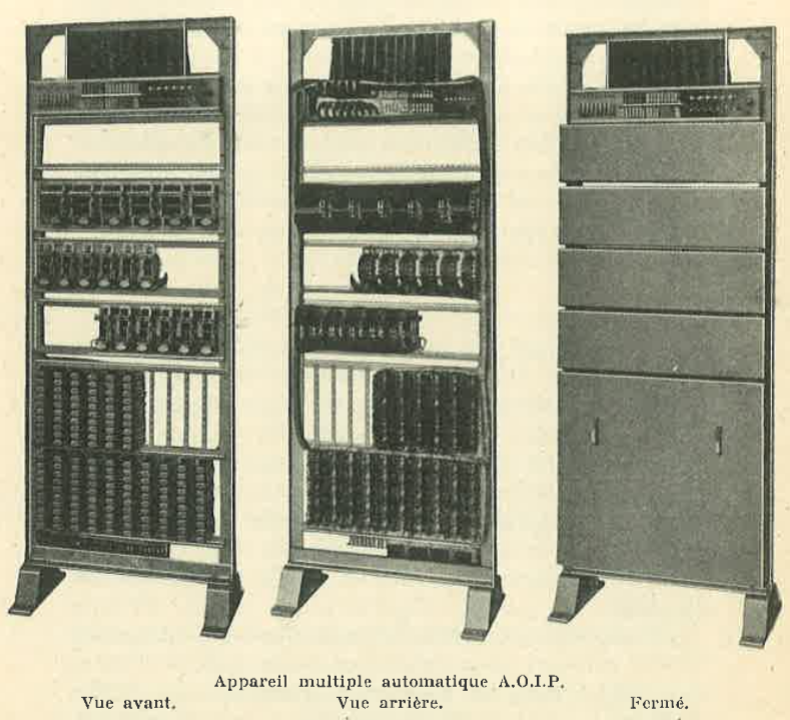 Appareil
mutltiple automatique
Appareil
mutltiple automatique