CANADA, AMÉRIQUE DU NORD
Les réseaux de communication avant le téléphone
Quelle est la nature des communications urbaines avant
la fin des années 1870 ?
Les services postaux et les services de messagerie.
D’entrée de jeu, c’est dans un
contexte colonial qu’il faut situer le développement des premiers
réseaux postaux.
Structuré dans un premier temps par les dirigeants du régime
français, le système postal couvre, sous le régime
britannique, une bonne partie du territoire du Bas-Canada.
Dès la fin du XVIIIe siècle, il relie déjà
les villes principales (Montréal, Québec, Trois-Rivières).
Les échanges entre ces villes et la métropole anglaise sont
prédominants ; ce qui explique la mise en place d’un réseau
postal relativement efficace entre Montréal et Londres. De plus,
à la même époque, on instaure un service mensuel de
distribution entre Montréal et New York. En fait, cette dernière
ville constitue le cœur de tout le réseau du continent nord-américain.
En étant directement connecté à celui de New York,
le service montréalais de distribution du courrier se trouve donc
incorporé dans un ensemble territorial étendu. D’ailleurs,
au début du XXe siècle, cette convergence du réseau
postal canadien vers Montréal fait la fierté des gens d’affaires.
Selon eux, l’importance et le développement d’une grande
ville peuvent se mesurer au nombre des affaires taitées par la
poste : « Or Montréal sur ce point est la ville qui fait
le plus d’affaires par la poste. »
L’histoire du service postal est liée de près
à celle des réseaux de transport et, par extension, à
la croissance des responsabilités étatiques.
Au XIXe siècle, l’État est devenu un élément
indispensable dans la transmission des informations et dans la mobilité
des personnes. Ses interventions dans le domaine des communications et
des transports obéissent néanmoins à des règles
particulières qui correspondent à certains principes mis
de l’avant par le libéralisme économique, notamment
le principe de la libre concurrence et celui du respect des initiatives
individuelles. C’est pourquoi on retrouve, concurremment au réseau
public, des réseaux privés de transmission des messages.
Ainsi, au fur et à mesure que les instances fédérale
et provinciale obtiennent de nouveaux pouvoirs, leur capacité d’intervention
s’accroît-elle. Il en va de même pour leurs obligations
relatives aux services publics qui se posent en termes de qualité
et d’accessibilité. En outre, le modèle du libéralisme
économique prédominant incite le secteur privé à
construire et à exploiter, en marge des instances publiques, des
réseaux de transport et de communication.
Les améliorations notables dans les transports
apparaissent surtout après les années 1850.
On crée alors des lignes de chemin de fer qui traversent le pays
et le continent. Ainsi, le réseau ferroviaire résout-il
en partie les difficultés de distribution des envois postaux. Bien
que plusieurs routes et lignes maritimes et ferroviaires convergent vers
Montréal, le service postal demeure irrégulier et, par conséquent,
peu fiable. Les longs délais dans la livraison du courrier constituent
le principal problème de ce service.
Le caractère incohérent du service
postal apparaît aussi dans les communications locales.
Avant les années 1870, les possibilités de communications
interpersonnelles, hormis les contacts face à face, sont très
limitées sur le territoire montréalais. Le premier bureau
de poste est ouvert en 1840 dans le quartier des affaires. En 1860, le
gouvernement canadien complète le réseau postal en installant
des boîtes aux lettres dans les rues5. Quoiqu’il introduise
une nouvelle forme d’échange, le courrier postal local n’acquiert
pas le statut d’outil de communication de masse. Il demeure un service
peu utilisé par la population. Ses principaux clients proviennent
du milieu des affaires qui y ont recours pour compléter leurs transactions
courantes : envoi de bordereaux de commande, de factures, correspondance
d’affaires générale, etc. La distribution de journaux
et de circulaires constitue aussi un usage qui accapare une bonne partie
du réseau postal.
Les principales qualités d’un service
de courrier postal recherchées par les gens d’affaires sont
la promptitude et la fiabilité.
La possibilité de joindre un grand nombre de personnes dans une
zone très étendue représente également un
atout incontestable : chaque adresse bénéficie de la livraison
du courrier. Par contre, selon certains témoignages, le système
postal local ne remplit manifestement pas les conditions d’efficacité
et de rapidité. Cette incapacité est encore plus apparente
dans les années 1920 alors que le nombre de lettres et de colis
expédiés quotidiennement à Montréal se situe
dans les centaines de milliers. Les doléances provenant du milieu
des affaires persistent : on réclame, entre autres, la «
construction d’édifices postaux à proximité
des gares pour permettre un service plus adéquat et rapide».
Il demeure difficile d’évaluer la qualité
et l’efficacité du service postal avant 1900. Mais les quelques
plaintes formulées par certains groupes, notamment celles provenant
des membres de la Chambre de commerce, précisent le nombre insuffisant
de boîtes aux lettres, « du moins dans certains quartiers
de la ville».
Pour répondre aux besoins croissants, on
inaugure en 1876 un nouvel hôtel des postes à l’angle
des rues Saint-François-Xavier et Saint-Jacques, en plein cœur
du quartier des affaires. Après 1900, on améliore nettement
la desserte du service. On ajoute au bureau central des succursales et
des comptoirs postaux. En 1900, on compte 20 bureaux de poste de quartier.
En 1914, 9 succursales et 80 comptoirs postaux desservent le territoire
de l’agglomération montréalaise. Le nombre de boîtes
aux lettres fait aussi l’objet d’une hausse importante durant
cette période : de 1900 à 1914, il passe de 180 à
568. Quant aux tarifs exigés, l’accroissement du service permet
de les diminuer considérablement.
Les améliorations continuelles de ce service
public réduisent, sans doute, les principales insatisfactions du
milieu des affaires. Pourtant, un service privé parallèle
est mis en place et offre à l’ensemble de la communauté
la possibilité d’échanger sa correspondance sans devoir
subir la lourdeur du service postal central.
Des propriétaires de chevaux et de diligences
mettent ainsi sur pied un service de courrier privé. Cette pratique,
que les autorités publiques tentent d’endiguer avec peu de
succès, s’était d’abord développée
à Londres. Vu la popularité de l’expérience
londonienne, le service privé de messagerie se propage rapidement
dans la plupart des grandes villes nord-américaines. Pour obtenir
une livraison plus rapide, les citadins n’hésitent pas à
recourir au service offert par les compagnies de messageries (express
service).
À Montréal, au début du XXe
siècle, ce service est offert depuis plusieurs décennies
et constitue alors un véritable système commercial : l’industrie
des messageries. Les principales compagnies qui offrent un tel service
disposent d’un grand nombre de véhicules et de chevaux. Plusieurs
centaines de charretiers recueillent sur une base quotidienne les lettres
et les colis chez autant de distributeurs situés en de nombreux
points dans la ville. Dans les gares ferroviaires, ces compagnies comptent
des centaines d’employés chargés du tri, de la distribution
et de l’expédition du courrier. Le service fourni par ces
« commissaires particuliers » semble correspondre davantage
aux attentes de la clientèle d’affaires montréalaise.
Dans la ville, le travail de messager occupe des
centaines de jeunes gens. Même après l’introduction
du télégraphe et du téléphone, la tâche
de messager conservera son importance et son attrait. Ces messagers au
service des entreprises de courrier encombrent les rues de la ville. Leur
affluence dans les artères principales risquerait même, aux
yeux de certains, de congestionner le centre des affaires. À l’ère
des gratte-ciel, leur présence pourrait aller jusqu’à
paralyser complètement la circulation à l’intérieur
des bâtiments « centralisateurs ». C’est du moins
l’un des arguments avancés par les promoteurs du téléphone
au début du XXe siècle. La livraison des messages par les
courriers privés rendrait les grands bâtiments non viables
sur le plan économique : la superficie de plancher réservée
à leurs déplacements serait disproportionnée par
rapport aux besoins spatiaux des autres activités. Solution à
ces problèmes, le service de téléphone aurait même
conduit à la construction des gratte-ciel — jamais vérifiée
empiriquement, cette hypothèse est cependant utilisée de
manière récurrente pour justifier les avantages du téléphone.
En fait, on constate que l’échange du
courrier s’accroît au fil des ans et cela malgré l’introduction
de nouveaux outils de communication qui pourraient le rendre inutile.
Ainsi est-on confronté à une situation de multiplication
des moyens de communication et de transport. Complémentaires, ces
divers réseaux de distribution de l’information participent
tous du même mouvement général : l’intensification,
d’une part, de la mobilité et des échanges dans la
ville et, d’autre part, des contacts sociaux qui résultent
de ces mouvements circulatoires.
Le réseau télégraphique
Par rapport au service postal, le réseau
télégraphique accélère nettement les échanges.
Dans la situation où les deux interlocuteurs possèdent un
appareil, le délai d’émission est presque aboli. Toutefois,
et c’est un cas fréquent, lorsqu’un seul des interlocuteurs
dispose d’un poste émetteur, la transmission des messages
exige toujours la présence d’un messager, porteur de télégramme.
La séparation entre le transport et la communication n’est
pas entière et le messager demeure indispensable. De plus, à
l’instar du réseau postal, le télégraphe est
d’abord conçu en fonction des besoins marchands et pour faciliter
le contrôle de l’État. La finalité première
de ce service n’est donc pas d’améliorer les communications
interpersonnelles.
Dès son origine, le service télégraphique
fait l’objet d’un intérêt soutenu des milieux financiers
montréalais. L’apanage de cette technologie par ce groupe
d’acteurs s’explique avant tout par sa nature commerciale. Par
conséquent, le principe qui préside à l’installation
des équipements télégraphiques se définit
en termes économiques. Montréal doit être en bonne
position par rapport aux grandes capitales financières. Il faut
le connecter notamment à Londres et à New York qui sont,
dans la seconde moitié du XIXe siècle, les principaux centres
d’attraction pour le trafic télégraphique. Les financiers
montréalais sont ainsi mis en contact avec ces marchés et
peuvent rapidement prendre connaissance des transactions commerciales.
À partir du moment où les communications
télégraphiques sont possibles sur de grandes distances,
on propose d’étendre le réseau à l’échelle
continentale. À cet égard, dans les années 1840,
les membres du conseil du Board of Trade examinent la possibilité
d’établir une liaison télégraphique raccordant
Montréal à Québec, Toronto et New York. Ce projet
collectif vise à renforcer la position de Montréal au sein
de l’économie canadienne et nord-américaine. Dans un
premier temps, le réseau télégraphique est pris en
main par des gens d’affaires montréalais. Mais certains investisseurs
et gestionnaires reliés à l’industrie télégraphique
montréalaise viennent aussi d’ailleurs. C’est le cas
notamment du premier directeur de la compagnie Montreal Telegraph invité
par les membres du Board of Trade : Orrin S. Wood. Celui-ci est un beau-frère
d’Ezra Cornell, homme d’affaires très actif aux États-Unis
dans le secteur des communications télégraphiques. Wood
vient à Montréal en 1847 pour diriger la construction du
premier réseau et assumer l’administration de Montreal Telegraph.
Les autres acteurs locaux qui prennent part à ce projet sont les
initiateurs des réseaux de transport ferroviaire et maritime, notamment
James Dakers, H. P. Dwight et Hugh Allan. On le voit bien, la propension
à investir dans les communications et les transports relève
de la volonté d’un groupe restreint d’acteurs économiques
de maîtriser les marchés montréalais et canadiens.
Mis en place pour relier les grandes villes, le
réseau télégraphique qui dessert Montréal
entretient très tôt des rapports institutionnels et économiques
avec celui du nord-est des États-Unis. En 1847, un premier câble
télégraphique, qui raccorde Montréal et Québec,
est installé par Montreal Telegraph. Dans les années 1840
et 1850, d’autres compagnies sont formées et offrent des liens
télégraphiques vers le sud des États-Unis, Toronto
et l’est du Québec. De courte durée, leurs activités
commerciales sont reprises par Montreal Telegraph. Tant et si bien que
la compagnie, qui exploite plusieurs lignes dans les années 1850,
est parvenue à construire un système à l’échelle
canadienne.
En plus d’être connectées au réseau
télégraphique étatsunien, les villes canadiennes
sont graduellement reliées aux métropoles européennes.
Un câble sous-marin, installé en 1866, permet d’entretenir
des contacts rapides avec les grandes villes britanniques. Les instigateurs
de la consolidation du réseau télégraphique recherchent
en priorité un moyen de communication comportant une dimension
stratégique, soit la surveillance des événements
qui se déroulent sur les territoires britanniques. Cette détermination
se reflète dans la structuration même du réseau.
Les autres grands utilisateurs du télégraphe
électrique sont les journaux et les entreprises ferroviaires. Une
étude de géographie historique a démontré
que les dépêches viennent surtout de Londres, qui assume
la direction de la colonie, et de Liverpool : deux villes britanniques
dont la classe politique et la classe d’affaires sont directement
concernées par l’utilisation d’un instrument de contrôle
fiable.
Quelques années plus tard, le service télégraphique
devient également utile à la circulation de l’information
à l’intérieur de la ville. Parallèlement aux
échanges commerciaux et journalistiques interurbains, des pratiques
de communications locales sont introduites de manière graduelle.
Le télégraphe d’alarme municipal
L’adoption du réseau téléphonique
s’inscrit dans un cadre urbanistique marqué par la présence
de divers instruments de communication. Certains recourent à l’électricité,
d’autres exigent des déplacements physiques. Quoique innovateur,
dans un premier temps, le téléphone est considéré
comme le prolongement d’un service existant : le service télégraphique
qui remplit, à l’intérieur de l’espace urbain,
de nombreuses fonctions.
Sa première fonction vise à combler
des besoins de plus en plus pressants de sûreté publique.
Avec l’implantation des réseaux de communication urbaine,
les services de sûreté publique sont en mesure de faire appel
à de nouveaux outils de contrôle dès la seconde moitié
du XIXe siècle.
À l’instar des grandes villes nord-américaines,
les autorités montréalaises adoptent le service télégraphique
pour permettre aux citadins d’alerter rapidement les postes de pompiers.
Suivant l’exemple des villes comme Boston, New York, Philadelphie,
Saint-Louis et Baltimore, qui sont équipées d’un tel
système, la Ville de Montréal fait appel à des spécialistes
étatsuniens. Elle confie ainsi la conception de son système
télégraphique d’alarme (Montreal fire alarm telegraph)
à la firme J. F. Kennard & Co. de Boston. Inauguré en
1863, ce service permet d’utiliser des postes-avertisseurs (fire
call boxes) connectés aux casernes de pompiers.
Au fil des ans, les nombreux appareils automatiques
servant à envoyer des signaux d’alarme sont installés
dans les lieux publics et privés : sur les trottoirs, dans les
gares, les hôpitaux, les manufactures, etc. Leur nombre est particulièrement
élevé dans le centre des affaires et près des districts
manufacturiers, là où le risque des conflagrations est plus
grand. De manière générale, ces systèmes permettent
un meilleur accès à différents services de sûreté
publique qui deviennent ainsi indispensables.
Quelques années plus tard, on relie également
le service de police au réseau télégraphique municipal.
Par contre, compte tenu de la nature différente du service de police
— complexité de l’information échangée
et plus grande mobilité des agents —, l’adoption du système
télégraphique y est plus lente. De ce point de vue, l’introduction
du téléphone répond à l’impératif
de la communication bidirectionnelle. De fait, la combinaison des technologies
télégraphique et téléphonique, qui permettent
d’émettre rapidement des signaux tout en offrant un échange
d’informations détaillées, est plus adaptée
aux exigences du service de police.
Ce nouveau réseau de communication interne
n’est pas sans conséquences pour l’administration municipale.
En assurant avec une attention accrue la protection de ses citoyens, elle
se trouve investie de nouvelles fonctions sociales. Dès lors, elle
doit revoir ses pratiques de fourniture des services urbains. Le système
technique n’est donc pas isolé du contexte sociopolitique
de sa mise en œuvre : en matière de lutte contre les incendies
et la criminalité, il entraîne aussi des effets sur la configuration
des composantes administratives municipales.
Dans ce contexte d’évolution des communications
intra-urbaines, des entreprises privées considèrent en élargir
l’offre et l’usage afin d’en faire, à terme, les
supports d’une nouvelle gamme de services. C’est le cas notamment
du service d’appel télégraphique.
Le service d'appel télégraphique
Le service d’appel télégraphique est,
sous certains aspects, analogue au téléphone.
Il est assumé à Montréal par l’entreprise Canadian
District Telegraph, mise sur pied dans les années 1870. Inauguré
la première fois à New York en 1872, ce service répond
à une demande urbaine précise : obtenir les services de
messagers. À l’instar du téléphone, il nécessite
chez l’abonné, comme seule installation, un appareil muni
d’une manivelle (un poste d’appel) relié par un câble
au central télégraphique. À Montréal, les
principaux bureaux de la compagnie sont situés au cœur du
centre des affaires, mais le service d’appel est également
offert dans les quartiers périphériques (ouest, est et uptown)
où l’on retrouve des comptoirs ouverts jour et nuit.
Après avoir fixé la manivelle vis-à-vis
du nom du service demandé, l’abonné appuie sur un bouton
qui transmet un signal au central avec lequel sa demeure est connectée.
Le central télégraphique transmet ensuite la commande. Outre
la pratique courante de faire venir un messager, la réservation
de voitures taxis ou encore le recours au service de police ou à
la brigade d’incendie sont des usages très appréciés
par les abonnés. Chaque abonné étant relié
au réseau municipal d’alarme par le biais d’un central,
on peut définir ce réseau intra-urbain de communication
comme un service auxiliaire au système d’alarme municipal.
La rapidité avec laquelle le service permet
d’établir une communication bidirectionnelle constitue un
net avantage par rapport aux messagers traditionnels. De plus, certains
commerçants et professionnels, notamment des médecins, sont
directement reliés au réseau. Lorsque les clients leur transmettent
un signal, un messager de la compagnie de télégraphe effectue
la liaison. On le voit, ce service n’est pas tout à fait aussi
rapide que le sera plus tard le téléphone. L’introduction
de ce dernier à la fin des années 1870 va d’ailleurs
concurrencer, voire supplanter, le réseau d’appel télégraphique.
Malgré son caractère quelque peu incommode,
ce système fait l’objet, selon toute vraisemblance, d’une
certaine popularité dans les grandes villes nord-américaines.
À Montréal, plusieurs centaines de maisons et places d’affaires
ainsi que la plupart des bâtiments publics et des églises
sont reliés au réseau local. En outre, les individus ont
la possibilité d’utiliser le service à partir des nombreux
postes publics installés dans la ville.
L’entreprise Canadian District Telegraph propose
aussi à ses abonnés un service de messagerie similaire à
celui offert par les bureaux de poste : envoi de lettres, de colis ou
de télégrammes. D’autres tâches peuvent également
être effectuées par les messagers à pied : accompagnement,
achats, courses, surveillance des chevaux, etc. Autrement dit, les messagers
sont mandataires de fonctions qui débordent souvent celles prescrites
par leur employeur.
De toutes les technologies de communication à
distance, celle du service d’appel télégraphique demeure
la plus comparable au téléphone. D’ailleurs, à
Montréal, c’est la compagnie Canadian District Telegraph qui
exploite le premier réseau téléphonique installé
en 1879. Ses dirigeants prennent alors l’initiative d’offrir
le nouveau service aux abonnés déjà munis d’un
poste d’appel pour l’utilisation du télégraphe.
Le marché du téléphone
se structure peu à peu autour des services offerts par le réseau
télégraphique.
À cet égard, le service de messagerie demeure populaire
auprès des citadins qui n’ont pas directement accès
au téléphone. Par exemple, en 1880, pour un tarif comparable
à ce qu’il en coûte pour expédier un télégramme
(entre 10 ? et 25 ? selon la distance de la course), la Compagnie de Téléphone
Bell met à la disposition des habitants des quartiers centraux
montréalais un service de messagerie. La tarification est basée
sur trois éléments : la distance parcourue, le temps employé
et la possibilité de réexpédier immédiatement
un message. Les clients peuvent aussi retenir le service d’un messager
pour plusieurs heures.
En tant que moyen de communication intra-urbaine,
la technologie du télégraphe est demeurée transitoire.
Le passage d’une technologie à une autre ne se fait pas soudainement.
Bien qu’il soit un moyen rapide de transmission des messages sur
des longues distances, le service télégraphique reste une
technologie spécialisée et, somme toute, peu répandue
dans la société. Par exemple, des restrictions limitent
sa diffusion à des fins de communication interpersonnelle : dans
le cas du télégraphe électrique utilisant le morse,
des connaissances techniques sont indispensables, dont la maîtrise
de ce code.
Aussi, le télégraphe ne rejoint-il pas, sinon
très peu, l’univers de la vie privée. De plus, compte
tenu du nombre d’actions comprises dans le processus d’appel
télégraphique, les délais de transmission demeurent
importants. Dans certains cas, un messager à pied est plus rapide
qu’un télégramme. Les actions multiples rattachées
à l’envoi, au décodage, à la réception
et parfois à la livraison des messages exigent des infrastructures
complexes et des coûts d’exploitation relativement élevés.
Par contre, dans d’autres cas, les avantages
sont évidents. Par exemple, le caractère confidentiel des
messages est mieux protégé car seuls quelques individus
ont les connaissances pour les décoder. La présence d’informations
écrites représente aussi un élément apprécié
par les principaux usagers du réseau télégraphique.
Les Montréalais ont accès à
un service de communication à distance dont les usages demeurent
spécifiques, voire exclusifs. Le télégraphe d’alarme
constitue tout de même un service public apprécié.
Indirectement, les citadins bénéficient aussi de l’emploi
du télégraphe par les agences de presse. En effet, les dépêches
expédiées promptement alimentent, sur des bases quotidienne
et hebdomadaire, les journaux qui sont alors les principaux moyens de
communication de masse.
Malgré leur diffusion restreinte à
l’intérieur de quelques groupes socio-économiques (les
financiers, les dirigeants politiques, l’administration municipale,
les agences de presse, etc.), les premiers outils de communication à
distance constituent une source d’information sur un certain nombre
d’éléments déterminants dans le développement
ultérieur du réseau téléphonique. L’introduction
de ces outils modifie le climat et la vision de l’ordre public. Progressivement
investies de tâches administratives, les autorités locales
élargissent leurs fonctions, notamment dans le domaine de la sûreté
publique. Derrière ce mouvement se profile un intérêt
clair pour projeter l’image d’un corps municipal en voie de
modernisation et soucieux de la sûreté de la population.
L’idée d’attirer et de protéger les investissements
est aussi sous-jacente au rôle accru que joue l’appareil administratif
municipal dans la gestion des services urbains.
C’est dans un contexte de métropolisation
qu’il faut tenter de comprendre la portée aménagiste
des réseaux techniques urbains, dont celui du téléphone.
Les promoteurs privés et publics cherchent alors à mettre
en place un aménagement apte à répondre aux nouvelles
exigences de la production et de la consommation de masse. On prend aussi
en compte la mobilité accrue des personnes et la diversification
des goûts en termes de milieux de vie. Il s’agit en fait d’une
importante phase de modernisation à l’intérieur de
laquelle priment de manière successive les impératifs suivants
: d’abord, la salubrité publique entre les années 1850
et les années 1900, quoique les exigences de la salubrité
demeurent encore d’actualité pendant plusieurs années
; ensuite, l’embellissement urbain qui est particulièrement
populaire au tournant du XXe siècle, et ce, jusqu’à
la veille de la Première Guerre mondiale ; enfin, l’efficacité
économique qui vient remplacer les préoccupations esthétiques.
Associées à l’idée de métropole,
les images de la ville contribuent à encourager les demandes pour
des instruments de communication à distance qui, dans certains
cas, vont au-delà de la simple utilité. Par contre, en dépit
des préférences manifestes pour des réseaux rapides
et efficaces de communication, il apparaît que la pertinence du
téléphone pour répondre aux besoins de communication
de l’agglomération montréalaise soit indéterminée.
L’attitude des planificateurs publics à l’endroit du
service demeure difficile à cerner, d’autant plus, comme on
le verra, qu’ils disposent de peu de moyens concrets pour diriger
les activités des opérateurs privés. Cela vient de
ce qu’ils n’arrivent pas à maîtriser les capacités
structurantes des réseaux techniques urbains. Les formes nouvelles
de la ville réticulée échappent en grande partie
aux acteurs publics concernés par l’aménagement urbain.
L'histoire du téléphone débute
l’été 1869, ou le révérend
Thomas Henderson, de Paris, en Ontario. encouragea Alexander
Melville Bell, à émigrer au Canada. Melville
Bell est le père d'Alexander Graham Bell l'inventeur du téléphone.

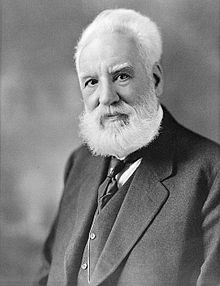

Melvile Bell père, Alexander
Graham Bell fils et Brantford la maison familliale
Alexander Melville Bell, né le 1er mars 1819 à
Édimbourg et mort le 7 août 1905 à Washington,
D.C. est un universitaire et chercheur dans le domaine de la phonétique
acoustique. De nationalité britannique expatrié aux
États-Unis, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'orthoépie
et l'élocution. Il est l'inventeur du livre Visible
Speech, une méthode créée afin d'enseigner
la parole aux sourds.
La famille Bell s’établit donc au
Canada en 1870, 94 Tutela Heights Road, Brantford Ontario C'est
ici, en juillet 1874, dans la maison de ses parents, qu'Alexander Graham
Bell conçut l'idée du téléphone,
Agraham.Bell, le fils s'établit aux
États-Unis d’Amérique un an plus tard,
ou il fonde en 1872 une école pour les malentendants
et débute ses travaux qui aboutiront au téléphone
comme on peut le lire dans la page Bell
rappel :
Aux USA, le Premier juillet 1875,
les essais de téléphone reprennent avec de nouveaux
appareils, le transmetteur équipé d'une menbrane
plus épaisse et d'une armature plus légère,
est installé au premier étage et est relié
au recepteur(gallow) posé au rez de chaussé.
Bell parle et chante au plus prêt de la membrane du transmetteur,
lorsqu'il fut interrompu par Watson tout exité "Monsieur
je vous ai entendu, faiblement, mais je vous ai entendu"
et Watson de répéter les mots qu'il a distingués.
Les deux hommes intervertissent les rôles , Bell colle son
oreille au récépteur, mais les résultats sont
décevants, Bell ne parvient pas à comprendre les mots
prononcés par Watson.
Puis Bell poursuivit ses travaux à
Brantford Canada en septembre 1875 .
À la suggestion du médecin de ses parents, il plaça
un mince disque de fer sur la membrane de parchemin et constata
que le son était devenu plus audible.
De retour à Boston plus tard ce mois-là, il commença
à préparer le mémoire descriptif de son invention
tandis que Watson perfectionnait l’appareil. Bell avait
déjà vendu les droits pour les États-Unis à
Hubbard et les deux hommes souhaitaient ardemment vendre les
droits pour l’étranger. Étant donné que
l’obtention d’un brevet en Grande-Bretagne était
essentielle et que ce brevet ne pouvait leur être accordé
si une autre demande était en instance d’acceptation
aux États-Unis, ils attendirent pour faire breveter leur
invention aux États-Unis.
Au début d’octobre 1875 , Bell retourna à
Brantford dans l’intention d’offrir les droits
à sir Hugh Allan , puissant financier et président
de la Compagnie du télégraphe de Montréal.
Mais le voisin de ses parents et propriétaire du Globe de
Toronto, George Brown ministre des États du Canada,
à qui il avait demandé de le recommander à
Allan, lui offrit d’acheter lui-même les droits. Il promit
également de déposer la demande de brevet en Grande-Bretagne
pendant son voyage à Londres, en février.
Bell remit à Brown le mémoire descriptif de son
invention à New York.
Brown et un associé s’assurèrent qu’il n’y
avait pas contrefaçon et déposèrent la demande
de Bell.
Brown, cependant, ne comprenait pas toute la portée des travaux
de Bell et semblait douter du caractère pratique de l’invention.
Sans l’avertir, il décida « de ne pas donner suite
à l’affaire ».
Le 29 décembre 1875 Bell apprenant que Mr Brown n'est
pas encore parti, lui fit une seconde visite à Toronto et
lui remit les dessins de son appareil, avec un mémoire
à l'appui de sa demande de brevet.
Peu après Noël, les deux hommes conclurent une
entente à Toronto et, le 25 janvier 1876, soit
la veille du départ, Brown, rencontre Bell et Hubbard
à New York pour une dernière mise au point embarque
pour l'Europe le lendemain.
Arrivé à Londres Mr Brown, soumet à des électriciens
le mémoire et les dessins de Bell, mais ces savants ne trouvèrent
pas que l'invention fût sérieuse, de sorte que M Brown
hésitait à faire la demande du brevet.
Bell écrivait lettres sur lettres à son compatriote,
pour le presser d'exécuter sa promesse. Survint un évenement
tragique, Bell reçut une dépêche télégraphique,
lui annonçant que le ministre du Canada M Brown, avait
été assassiné dans une rue de Londres.
Il est pourtant évident qu'en 19 jours Brown n'a pas pu faire
la traversée de l'atlantique et de se rendre à Londres
et de contacter un expert conformément à la loi anglaise
sur les brevets.
A cette nouvelle, M. Grabam Bell, renonçant
à prendre pour le moment son brevet en Europe, s'occupa de
le prendre, sans autre relard, en Amérique.
....
Le 7 mars 1876 , Bell devint
titulaire du brevet sur le téléphone aux USA.
sommaire
Entre temps Bell de retour à
Brandford au Canada passe l'été 1876
chez son père, et imagine qu'il serait mieux de faire une
communication un peu plus longue que entre deux pièces, et
comme réaliser soit même une ligne pour une expérience
serait trop couteuse, il en profite pofite pour écrire à
Toronto au directeur de Dominion Telegraph
Thomas Swinyard, pour louer penant une heure la ligne télégraphique
entre Brandford et Paris dans Ontario sur sur des lignes télégraphiques
de 8 km et 68 km de long.
La permission d'utiliser cette ligne télégraphique
a été accordée par Lewis B. McFarlane,
un responsable télégraphique, qui adoptera une activité
téléphonique en 1879, il deviendra président
de la Compagnie de téléphone Bell du Canada de 1915
à 1925.
Swinyard s'exclama " encore une tête brulée
", et ajouta à l'intention du du directeur de bureau
de Toronto Lewis McFarlane : "à classer au paniers"
. McFarlane finit par convaicre Swinyard et apporta le concours
de Dominion Telegraph pour l'expérience.
Bell se servit donc d’une ligne de la Compagnie de télégraphe,
qu’il brancha à la maison de son père avec du
fil métallique servant à consolider les tuyaux de
poêle.
le 3 août 1876 , le premier
appel interurbain au monde, depuis le magasin général
de Wallace Ellis à Mount Pleasant jusqu’à Tutelo
Heights, à quatre milles de là. Trois autres essais
sont faits de Brandford et Mount Pleasant à 5 km,
on récite des tirades, on chante .... tout marche.

 Premiers modèles de fabirication Bell
Premiers modèles de fabirication Bell
| Bell utilisait les fils télégraphiques
de la Dominion Telegraph
Company entre son bureau de Brantford et le bureau à
Paris. Comme la puissance de la batterie disponible à Brantford était trop faible pour les téléphones à membrane de Bell, la Dominion Telegraph Company lui fourni l'énergie à partir de Hamilton et de Toronto, en Ontario. Bell a branché son téléphone émétteur à membrane aux fils du bureau de Brantford, puis, le récepteur (sorte de boîte en fer) au bureau de Paris. Bell pouvait entendre les voix de Brantford grâce aux bobines électromagnétiques à haute résistance sur chaque extrémité de la ligne, les sons étaient transmis et reçus si distinctement que Bell pouvait reconnaître les voix des haut-parleurs. Le maire et tout le village écoutent pendant une heure Macbeth, puis l'heure de fin convenue arriva, et ils refusaient de quitter le bureau, il fallu télégraphier à la Dominion Telegraph Company pour demander une ralonge de temps sinon les fils auraient été débranchés. |
 |
L'article consacré au téléphone de Bell, explique comment construire un appareil, Voir page 163
C'est avec ce premier modèle de téléphone
que Bell équipera les premiers "Abonnés"
comme allons le voir.
sommaire
Les historiens Christopher Armstrong et H. V. Nelles
mentionnent que le service téléphonique est expérimenté
pour la première fois à Montréal en 1877 auprès
d’un groupe de religieux. Rassemblés dans le hall d’un
séminaire, les participants ont écouté un concert
transmis depuis une salle de musique. Toujours selon ces historiens,
les premiers téléphones en service à Montréal
relient un séminaire du centre-ville au cimetière
catholique situé chemin de la Côte-des-Neiges. Le téléphone
permet sans doute de mieux coordonner les activités tenues
dans deux secteurs assez éloignés, le cimetière
étant localisé à l’extérieur des
limites de la ville pour des raisons d’aménagement et
d’hygiène publique.
Officielemnt le 20 juin 1877 : Hugh Cossart Baker Jr. lance le premier service téléphonique du Canada à Hamilton Ontario.
 |
Hugh Cossart Baker découvre l'invention d'Alexander Graham Bell en 1877 à l'Exposition internationale de Philadelphie Il et décide de tester ce nouvel outil de communication à Hamilton, il. loue quatre téléphones Bell de premier modèle , afin que ses amis, partenaires aux échecs, puissent se contacter directement (autrement que par le télégraphe). Melville Bell (le père d'Alexander) vint à Hamilton et installa trois autres téléphones sur la ligne de télégraphe privée de Baker, dans les maisons de son ami C.D Cory, de la soeur de Cory et de J. R. Thompson. Les monteurs de lignes télégraphiques tirent la ligne unique de maison en maison à travers les toits, attachés aux arbres et à quelques poteaux de télégraphe bien situés |

Dessin paru dans La Presse du 27 janvier 1912 qui illustre le
premier réseau de téléphone
Aux Usa le 9 juillet 1877
Bell, Watson, Gardiner Hubbard et Thomas Sanders
avaient constitué à Boston une société
fidiciaire , la Bell Telephone Company. Hubbard
en devient l'administrateur
Le lendemain, Graham Bell concéda 75 % de ses droits canadiens
à son père et le reste 25 % à Charles Williams,
son fabricant d’équipement.
En échange Williams s'engage à fournir 1000 téléphones
à Melville Bell.
Le surlendemain Graham.Bell épouse Mabel Hubbard.
Côté Canada, Alexander Melville Bell nomma son ami
Thomas Henderson agent de son fils en Ontario.
Puis en août 1877, tous deux accordèrent à un promoteur
de tramways de Hamilton, Hugh Cossart Baker fils, l’autorisation
exclusive de louer des téléphones dans cette province.
Entretemps, Bell a pris un congé le 11 juillet
1877, pour épouser Mabel Hubbard, l'une de ses élèves
sourdes et fille de l'un de ses partenaires, Gardiner Greene Hubbard.
Le lendemain, Bell concéda 75 % de ses droits
canadiens à son père et le reste à Charles Williams
Jr. de Boston, Massachussetts, son fabricant d’équipement.
en échange, ce dernier doit fournir 1 000 téléphones
sans frais. Toutefois, après cette transaction, deux enjeux importants
apparaissent. D’abord, la demande en téléphones aux
États-Unis, téléphones pour lesquels M. Williams
avait été payé, devient tellement grande que ce dernier
prend du retard dans les commandes placées par Melville Bell. Ensuite,
les frais de douanes canadiennes que doit débourser Melville Bell
pour chaque téléphone fabriqué aux États-Unis
sont élevés. De plus, les lois concernant les brevets obligent
les Canadiens à cesser l’importation de téléphones
peu de temps après l’émission du brevet en 1877.
| Le 24
août 1877, le Bureau canadien des brevets
octroie un brevet d'invention pour le téléphone
à Alexander Graham Bell. Mais la législation canadienne stipule que les objets protégés par un brevet doivent être fabriqués au Canada après un an, ce qui aménera des soucis, nous en reparlerons. Le téléphone fit l’objet d’une première démonstration publique au Canada le 29 août 1877 ; Baker avait organisé l’événement. Après plusieurs essais réussis, une démonstration publique de l'installation a été organisée pour le 30 août 1877. Les quatre téléphones utilisés pour la manifestation publique du 30 août étaient les deuxièmes téléphones loués au Canada, au prix de 45 $ par an. Le premier contrat de location d’équipement téléphonique au Canada, signé le 18 octobre 1877 , portait sur une connexion entre le domicile de Baker et ceux de deux de ses collègues. A Ottawa, Baker installa une ligne entre le bureau du premier ministre Alexander Mackenzie et Rideau Hall, pour relier le bureau de la résidence du gouverneur général et le marquis de Dufferin. Baker à la tête d'une compagnie de chemin de fer, fait l'acquisistion d'une petite entreprise de télégraphie : la Hamilton District Telegraph essentielement pour relier des abonnées aux pompiers, à la police ... construit lui même un petit central rudimentaire . Il avait aussi demandé dès 1878 à la municipalité de Hamilton la permission de planter des poteaux. Ce sont les premiers abonnés de Hamilton du Canada. |
 |
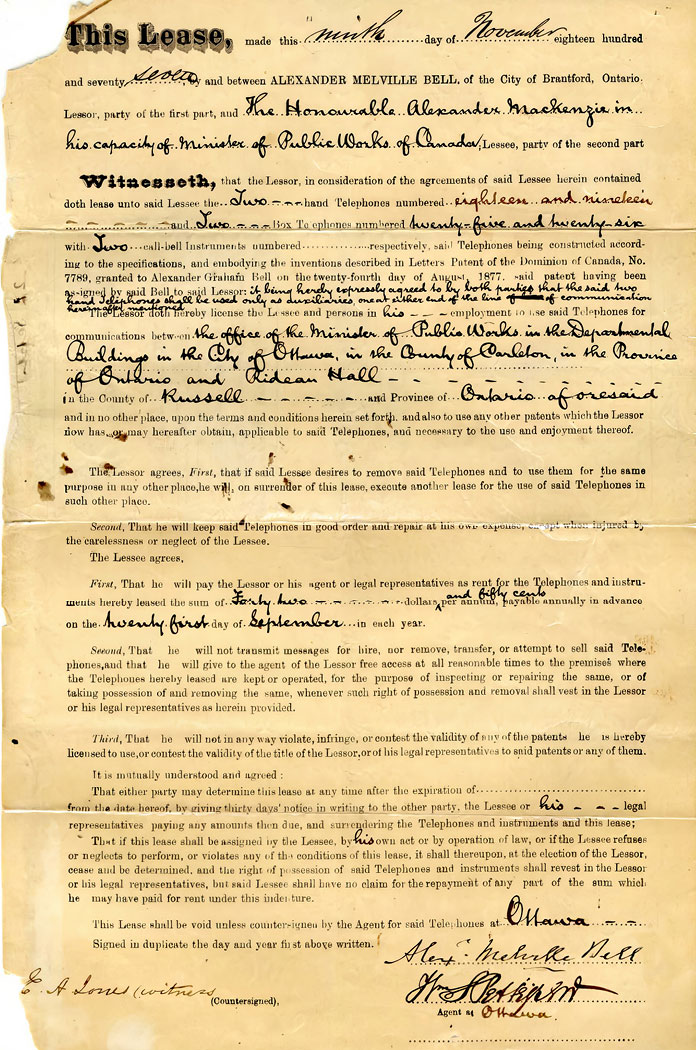
Contrat entre Melville Bell et l’honorable Alexander Mackenzie
pour la location de deux téléphones manuels en bois et deux
téléphones en forme de boîte.

Ce téléphone ressemblant à un appareil photographique
a été le premier téléphone utilisé
dans un cadre commercial. Deux de ces appareils, en plus de deux téléphones
manuels en bois, ont été les premiers à être
loués au Canada, reliant le bureau du premier ministre Alexander
Mackenzie à Rideau Hall à la résidence privée
du gouverneur général Lord Dufferin.
Bell peu de temps après annonce le Hand-Téléphone, modèle qui fera le tour du monde
 |
le succès est foudroyant.
Eté 1877 en Nouvelle-Écosse, lors d'une visite de mine Gardiner
Hubbard apporte une paire de téléphones qui furent installés
au fond de la mine et à la surface, c'est certainement la première
application commerciale du téléphone au Canada.
Hubbard était membre du conseil d'administration de Caledonia,
une compagnie minière de Cap Breton .
Alors que Melville Bell détient 75 % des droits
du brevet canadien, le reste est cédé à l’inventeur
Charles Williams Jr. de Boston, Massachussetts; en échange, ce
dernier doit fournir 1 000 téléphones sans frais.
Toutefois, après cette transaction, deux enjeux importants apparaissent.
- D’abord, la demande en téléphones aux États-Unis,
téléphones pour lesquels M. Williams avait été
payé, devient tellement grande que ce dernier prend du retard dans
les commandes placées par Melville Bell.
- Ensuite, les frais de douanes canadiennes que doit débourser
Melville Bell pour chaque téléphone fabriqué aux
États-Unis sont élevés. De plus, les lois concernant
les brevets obligent les Canadiens à cesser l’importation
de téléphones peu de temps après l’émission
du brevet en 1877.
Il est donc évident que les téléphones
doivent désormais être faits au Canada.
On décide que James Cowherd, un électricien de Brantford,
ira étudier la fabrication des téléphones à
l’atelier de M. Williams; en décembre 1878, M. Cowherd commence
à fabriquer ses propres appareils. Comme le nombre de commandes
augmente, ce dernier bâtit un nouvel atelier – le premier au
Canada consacré à la fabrication de téléphones.
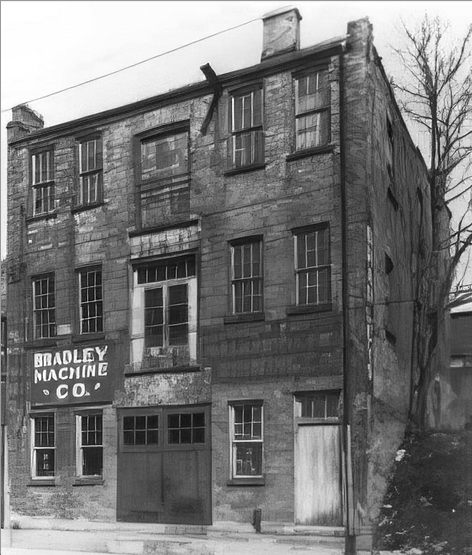
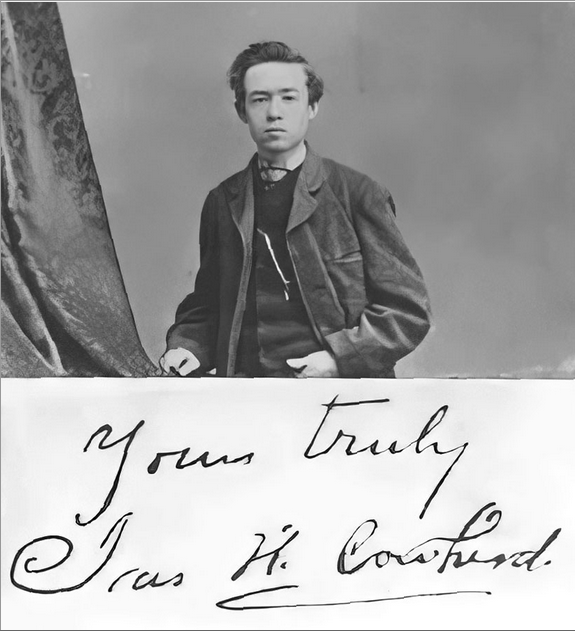 Portrait de James H. Cowherd, vers 1880
Portrait de James H. Cowherd, vers 1880
En 1878, James H. Cowherd bâtit le premier atelier canadien consacré
à la fabrication de téléphones. Cet atelier était
situé au 32, rue Wharf, à Brantford, en Ontario. Le bâtiment
fut démoli en 1992.
Le 15 décembre 1878, le premier téléphone
est officiellement testé, et c’est une réussite. Cette
même année, la ville d’Hamilton en reçoit la
première commande pour l’utilisation par la municipalité.
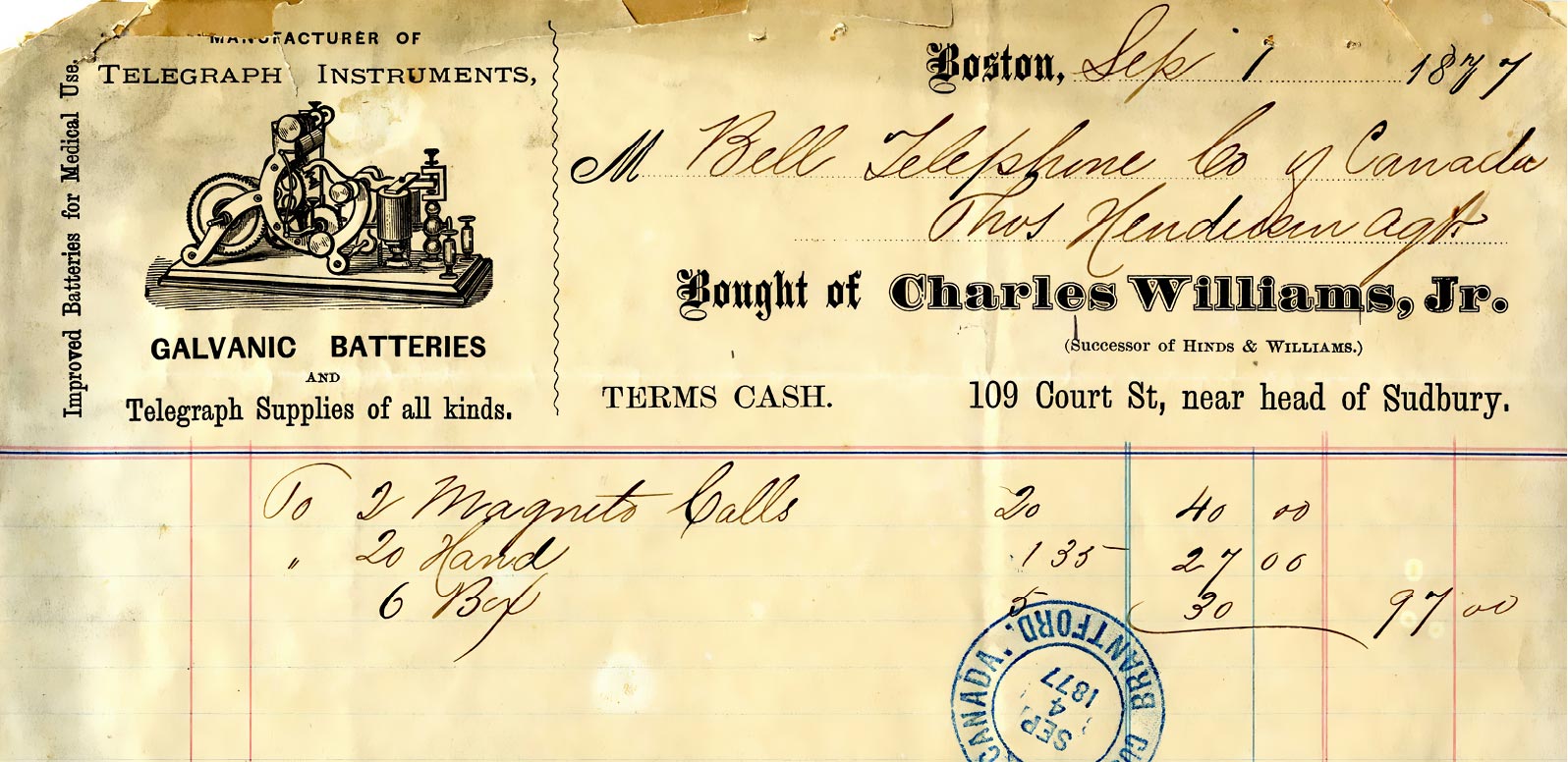
Facture originale d’équipement téléphonique
acheté par Thomas Henderson, agent principal de la Bell Telephone
Company of Canada, auprès de Charles Williams Jr., fabricant autorisé
pour la National Bell Telephone Company, 1877.
James H. Cowherd a continué de fabriquer des téléphones et des équipements accessoires pour La Compagnie de téléphone Bell du Canada jusqu’à son décès soudain en février 1881, à l’âge de 31 ans. Au cours de sa vie, il aura produit plus de 2 400 téléphones.
Le téléphone passe rapidement de curiosité
à objet du quotidien; en effet, de plus en plus d’utilisateurs
désirent communiquer entre eux.
Le premier central téléphonique au Canada (neuvième
au monde et premier à l’extérieur des États-Unis)
entre en fonction en 1878 à Hamilton, en Ontario. Le petit nombre
d’abonnés augmente sans cesse, et bientôt, il devient
possible de communiquer aux plus grandes villes du pays.

 Reproduction
du standatd d'Hamilton.
Reproduction
du standatd d'Hamilton.
15 juillet 1878 , Hugh Crossart Baker
établit le premier central téléphonique au Canada
à Hamilton, en Ontario, rue King et Hughson, au dernier étage
du bâtiment Hamilton Provident and Loan.
Les abonnés du central téléphonique d’Hamilton
utilisaient ce téléphone à main à la fois
comme transmetteur et récepteur, en le déplaçant
de la bouche à l’oreille pour parler ou écouter.
Le téléphoniste opérait un standard téléphonique
à sept lignes, avec dix abonnés par ligne.
Il s’agissait du premier central téléphonique de l’Empire
britannique et du deuxième en Amérique du Nord.
En décembre 1878 il y avait 40 abonnés à
Hamilton, et passera à 150 en avril 1879.
Le premier annuaire téléphonique du Canada (en forme de
livret), a été publié par la Toronto Despatch Company
en juin 1879.
Baker obtiendra de Melville Bell la permission les droits d'exploiter
le téléphone entre la baie la Baie Georgienne et le lac
Erié, y compris Hamilton.
Baker avait compris que l'avenir du téléphone passerait
par la création d'un réseau.

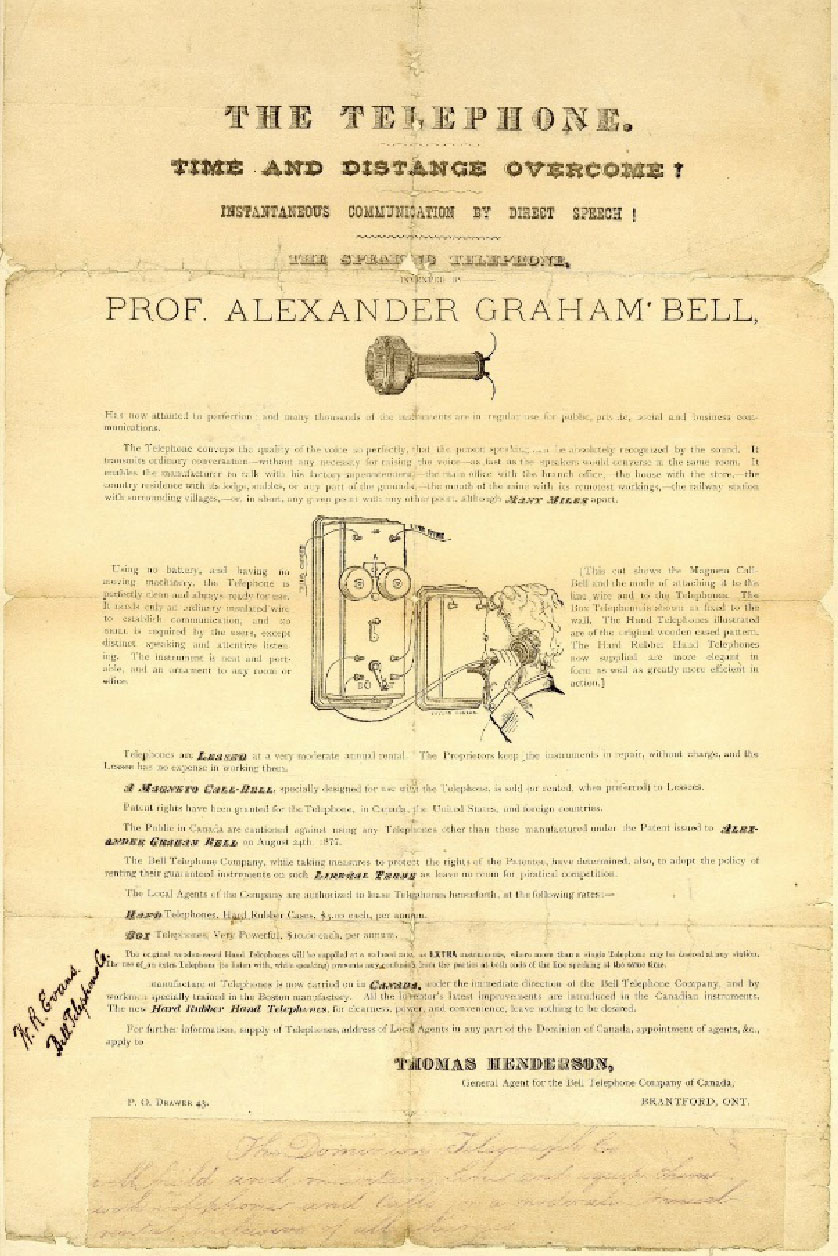
Annuaire de 1878. La publicité de
1879 illustre le nouveau téléphone mural, créé
dans le but de satisfaire aux utilisateurs qui perdaient des bouts de
conversation lorsqu’ils déplaçaient le transmetteur/récepteur
de la bouche à l’oreille.
Un autre exemple des premiers usages du téléphone
est celui du propriétaire d’une entreprise de camionnage (Shedden
Forwarding).
En 1878, à Monréal il décide de louer du professeur
Bell des appareils téléphoniques et fait installer une liaison
privée permanente entre ses bureaux, situés à l’angle
des rues Saint-Paul et Saint-Sulpice dans le quartier des affaires, et
ses entrepôts et écuries, localisés dans le quartier
Hochelaga. Agent principal pour la compagnie ferroviaire du Grand Tronc,
Shedden Forwarding devait assurer rapidement et avec efficacité
la coordination des activités de direction, de répartition,
d’expédition et d’entreposage.
Alors que Melville Bell détient 75 % des droits
du brevet canadien, le reste est cédé à l’inventeur
Charles Williams Jr. de Boston, Massachussetts; en échange, ce
dernier doit fournir 1 000 téléphones sans frais. Toutefois,
après cette transaction, deux enjeux importants apparaissent. D’abord,
la demande en téléphones aux États-Unis, téléphones
pour lesquels M. Williams avait été payé, devient
tellement grande que ce dernier prend du retard dans les commandes placées
par Melville Bell. Ensuite, les frais de douanes canadiennes que doit
débourser Melville Bell pour chaque téléphone fabriqué
aux États-Unis sont élevés. De plus, les lois concernant
les brevets obligent les Canadiens à cesser l’importation
de téléphones peu de temps après l’émission
du brevet en 1877.
Il est donc évident que les téléphones
doivent désormais être faits au Canada. On décide
que James Cowherd, un électricien de Brantford, ira étudier
la fabrication des téléphones à l’atelier de
M. Williams; en décembre 1878, M. Cowherd commence à fabriquer
ses propres appareils. Comme le nombre de commandes augmente, ce dernier
bâtit un nouvel atelier – le premier au Canada consacré
à la fabrication de téléphones. Le 15 décembre
1878, le premier téléphone à main en caoutchouc est
officiellement testé, et c’est une réussite. Cette
même année, la ville d’Hamilton en reçoit la
première commande pour l’utilisation par la municipalité.
James H. Cowherd a continué de fabriquer des téléphones et des équipements accessoires pour La Compagnie de téléphone Bell du Canada jusqu’à son décès soudain en février 1881, à l’âge de 31 ans. Au cours de sa vie, il aura produit plus de 2 400 téléphones.
Le téléphone passe rapidement de curiosité à objet du quotidien; en effet, de plus en plus d’utilisateurs désirent communiquer entre eux. Le premier central téléphonique au Canada (neuvième au monde et premier à l’extérieur des États-Unis) entre en fonction en 1878 à Hamilton, en Ontario. Le petit nombre d’abonnés augmente sans cesse, et bientôt, il devient possible de communiquer aux plus grandes villes du pays.
À la fin des années 1870, on retrouve à
Montréal un petit nombre de ces lignes téléphoniques
qui vont d’un point fixe à un autre. Exploité par un
individu ou une entreprise, ce type de système ne possède
pas les qualités d’un réseau, car sa capacité
d’interconnexion est inexistante. Peu commun, ce système à
deux unités indique néanmoins les raisons qui motivent sa
mise en service : il s’agit d’établir un lien direct
et permanent entre deux unités d’une même organisation,
que ce soit une résidence et une manufacture, une manufacture et
un entrepôt, ou encore, un cimetière et un presbytère.
Ce sont les cas de figures que nous révèlent les premiers
baux de location des appareils téléphoniques. Il semble
que le besoin de disposer d’un lien sûr est alors assez fort
pour que les systèmes privés trouvent une clientèle.
Dans ces quelques exemples recensés, on constate aussi que le facteur
d’éloignement est déterminant. Par contre, une chose
est certaine : ce n’est pas parce que la possibilité de disposer
d’un téléphone existe que les entrepreneurs choisissent
forcément de localiser leurs activités en des lieux éloignés
les uns des autres. Il est d’ailleurs significatif de constater qu’avant
l’introduction du téléphone, les premiers abonnés
mènent déjà leurs activités sur une base territoriale
fragmentée.
Pendant encore deux ans, le père de Bell,
Alexander Melville promut la commercialisation du téléphone
au Canada et rechercha des agents pour les autres provinces.
Lorsque le tout premier annuaire téléphonique de Toronto
a été publié le 8 juin 1879, le téléphone
était encore un gadget dernier cri qui n'avait été
breveté que trois ans plus tôt.
Les 56 entreprises et résidences répertoriées à
l'époque tiennent sur un grand total de six pages. Bien sûr,
il n'y avait pas encore de numéros - un opérateur en direct
devait connecter chaque appel entre les abonnés au téléphone.
Il était facile de voir pourquoi passer un appel rapide était
un peu compliqué à comprendre pour les résidents
à l'époque - à tel point que des instructions claires
sur la façon de le faire étaient incluses dans le livre.
"Laissez le téléphone reposer contre la lèvre
inférieure. Tout en écoutant, appuyez fermement le téléphone
contre l'oreille », indique-t-il. "Parlez lentement et distinctement,
avec une certaine force, mais pas d'un ton élevé."
"Donnez toujours à vos auditeurs suffisamment de temps pour
transférer le téléphone à leur oreille avant
de parler, et assurez-vous qu'une phrase est terminée avant de
répondre."
La Toronto Telephone Despatch Co. n'a duré que deux ans avant d'être
rachetée par la Bell Telephone Company of Canada, qui deviendra
plus tard la bien connue Bell Canada.
En 1879 deux centres sont installés à Halifax
: la Western Union en novembre avec des téléphones Edison
et Dominion Telegraph un mois plus tard avec des téléphones
Bell. En 1880 en Nouvelle Ecosse la Bell telephone rachète les
installations de Dominion Telegraph puis de la Western Union un an plus
tard.

Démonstration du téléphone à des journalistes
de Montréal en 1879, au bureau de la Dominion Telegraph Company,
où sera situé plus tard le premier central téléphonique
de La Compagnie de Téléphone Bell. Le standard téléphonique
était courbé autour de la pièce car la compagnie
avait donné ses dimensions en pouces, mais le fabriquant les avait
fournies en pieds.
sommaire
Le 29 avril 1880
fondé par Hugh Cossart Baker à Montréal,
par une loi fédérale, la Compagnie
de Téléphone Bell du Canada (par la suite Bell
Canada) reçoit, en vertu de sa charte, le droit de construire
des lignes téléphoniques le long des droits de passage
publics du Canada, ce qui est un privilège des plus précieux.
En vertu d'un contrat de licence conclu avec la compagnie
de téléphone America Bell
située aux États-Unis, Bell fabrique également
des téléphones et de l'équipement téléphonique,
une activité qui sera transférée à la
compagnie manufacturière Northern Electric
en 1895, qui, à son tour, deviendra la Northern
Electric Ltée (puis Nortel Networks) à la suite
d'une fusion avec la Imperial Wire and Cable en 1914.
Au début la Bell Canada fabriquait
les "Hand Téléphones" modèles
1877 aux Usa par C.Williams et louait 40 dollars la paire
de téléphone, certains obtenaient même des réductions
... c'était de l'improvisation.
Mais la législation canadienne stipule que les objets
protégés par un brevet doivent être fabriqués
au Canada après un an. De plus les droits de douane doublent
le prix de revient des appareils.
La situation devint critique surtout que du côté fabrication,
Williams était dans l'incapaité de livrer les 1000
appareils dus en échange de sa part des droits canadiens.
Il n'en livrera que à peine la moitié.
Melville Bell et Thomas Henderson doivent réagir, alors il
envoient un jeune quincailler James H. Cowherd suivre un
stage chez Williams à Boston.
En décembre 1878 de retour, Cowherd construit un hangar derrière
la boutique familliale à Brandfrod et commence à "fabriquer"
les premiers téléphones canadiens.
En fait les téléphones étaient fabriquées
à Boston et envoyées à Brandford pour y être
assemblés.
Ce fut le moyen de contourner la législation canadienne,
nuance importante car elle servira de base à l'annulation
des brevets canadiens quelques années plus tard.
En tout 2398 téléphones sortent du hangar de
montage de Cowherd qui en janvier 1881 décéde
en mettant fin à cette drôle d'aventure.
Bell et Handerson continent de prospecter timidement l'Ontario en
faisant du porte à porte, mais la comptabilité de
l'entreprise demeurait défaillante, de plus les problèmes
de maintenance et réparations croisaient avec le nombre de
clients.
Du coup, la province du Québec fut négligée,
deux villes seulement y furent derservies : Montréal et Québec.
En juin 1881, les actionnaires de la compagnie elisent Erastus Wiman
comme president. Ce dernier a pour objectif de reunir en une seule
compagnie tous les intérets télégraphiques
canadiens, tel qu'il l'explique aux actionnaires de la Montréal
Telegraph dans un courrier adresse a la compagnie en 1881 . Apres
quelques semaines d'intenses négociations, Wiman réussit
à convaincre, par un savant mélange de pression et
de menaces, les dirigeants et actionnaires de la Montreal Telegraph.
En aout 1881, deux accords sont signés par la Great North
Western Telegraph, le premier avec la Montreal Telegraph, le second
avec la Dominion Telegraph, le tout avec la bénédiction
de la Western Union Telegraph. A partir de ce moment-la, la Great
North Western Telegraph, soutenue financierement par la Western
Union Telegraph, contrôle et opère les réseaux
télégraphiques de la Montreal Telegraph et de la Dominion
Telegraph, pour une duree de 99 ans. Un nouveau monopole s'installe
alors sur les lignes telegraphiques
canadiennes, aux mains de la Western Union cette fois, directement
dans les Provinces Maritimes, indirectement via la Great North Western
Telegraph dans le reste du pays. La télégraphie canadienne
est désormais dominée par les intérets financiers
états-uniens. En ce qui concerne le téléphone,
les réseaux des deux compagnies sont rachetés a bas
prix par la toute recente Bell Telephone Company of Canada
Seulement deux ou trois entreprise suivèrent le modèle
de Baker, obtinrent un permis d'exploitation de Bell dont la Toronto
Telephone Despatch et de la York Telephone
Despatch fondées par Hugh Neilson
A Winnipeg un agent vendit quelques téléphones
mais n'installa pas de central. Les autres entreprises ignoraient
tout simplement les droits .
Au total seulement quelques villes furent équipées
entre le Québec, l'ontario, la nouvelle Ecosse, le Nouveau
Brunswick, le Manitoba et la Colombie britanique.
Au début de l’année 1880, on retrouve
à Montréal environ 250 abonnés au premier réseau
téléphonique géré par Dominion
Telegraph, l’entreprise qui deviendra quelques mois plus
tard la compagnie Bell. Parmi ces premiers abonnés, on dénombre
surtout des manufacturiers, des entrepreneurs, des négociants,
des financiers et quelques membres de la classe d’affaires. Selon
ses promoteurs locaux, les applications urbaines du nouveau service de
communication sont nombreuses et commodes.
Les communications d’affaires occupent une
place prédominante. D’ailleurs, l’extension de leurs
usages constitue l’une des raisons pour laquelle certaines entreprises
de téléphone sont mises sur pied (par exemple, la Compagnie
de Téléphone des Marchands de Montréal, établie
en 1892 grâce à l’initiative des membres de la Chambre
de commerce du district de Montréal). Les autres moyens d’échanges
reliés aux affaires ne subissent toutefois pas de déclin
parce que le téléphone est introduit. Il faut plutôt
parler de complémentarité, voire de convergence, entre les
divers instruments de communication locale.
Il n’en demeure pas moins que, face aux transformations
de l’espace urbain et à l’émergence de la notion
d’agglomération, le téléphone apporte des réponses
appropriées aux nouvelles conditions de la ville réticulée.
Il s’agit principalement d’un meilleur contrôle de la
transmission des messages, et d’un accroissement de la rapidité.
En effet, les systèmes existants de communications intra-urbaines
(la poste et les services des messageries) n’offrent pas ces avantages
avec autant de fiabilité et d’efficacité. En outre,
la portée de la téléphonie dépasse les seules
sphères de la vie économique (marchande, industrielle et
professionnelle) et illustre le caractère nouveau des effets de
l’éclatement de la ville traditionnelle sur la sphère
privée.
La réaction du gouvernement est en réalite une absence de
réaction. Le passage des compagnies canadiennes entre les mains
de la Western Union ne souleve pratiquement aucun debat. Quelques voix
s'elevent pour dénoncer la situation, principalement au Sénat,
mais sans aucun résultat. Ainsi, lors du passage de l'acte d'incorporation
de la Great North Western Telegraph, le sénateur liberal Robert
P.Haythorne s'inquiète de la clause autorisant la compagnie à
louer ou fusionner ses lignes, sans que cela ne suscite de débat.
La principale réaction a lieu en 1882, lorsque la Montreal Telegraph
demande une refonte de sa charte pour valider la location de ses lignes
a la Great North Western. L'acte passe sans probleme a la Chambre des
communes, mais se heurte à une vive opposition au Senat. Le senateur
liberal John C.Scott s'oppose au passage de Facte, s'insurgeant contre
le contrôle étranger sur les lignes canadiennes. II recoit
le soutien inattendu de Henry A. Kaulback, sénateur conservateur,
qui propose comme solution la nationalisation des lignes de télégraphe.
Le sénateur liberal Lawrence G. Power présente la refonte
de la charte comme étant une mesure équitable puisque les
nouveaux droits accordés a la Montreal Telegraph ont déjà
été accordes a la Great North Western et la Dominion Telegraph.
Le débat est clos par un vote autorisant le projet de loi . A partir
de ce moment-la, la position dominante de la Great North Western Telegraph
n'est plus discutée par les parlementaires.
sommaire
Comme ailleurs dans le monde de nombreux électriciens simplement
avec les explications trouvées dans l'article consacré au
téléphone de Bell, qui explique comment construire
un appareil ( Voir
page 163 le premier modèle), se mirent à fabriquer leurs
propres appareils
Thomas Ahearn télégraphiste qui à l’âge
de 22 ans, lit l'article de la revue Scientific American Débrouillard,
il décide de concevoir un système rudimentaire à
partir de deux boîtes de cigares, d’aimants et de fils, ainsi
que de lignes de télégraphe reliant Pembroke à Ottawa.
Ce fut le premier appel longue distance du pays
Ahearn a meme été menacé de
poursuites pour son utilisation non autorisée de la technique brevetée
de Bell, mais plus tardivement il sera nommé directeur du premier
bureau d'Ottawa de la société Bell.
Cyrille Duquet joailler fit parler de lui
 |
Cyrille Duquet, horloger,
joaillier, inventeur et homme politique, né le 31 mars
1841 à Québec, fils de Joseph Duquet, journalier,
et de Madeleine Therrien (Terrien) ; le 22 février 1865,
il épousa à Québec Adélaïde
Saint-Laurent, fille de Jean-Baptiste Saint-Laurent et d’Adélaïde
Gazzo (Gazeau), et ils eurent 16 enfants ; décédé
le 1er décembre 1922 au même endroit.
À l’âge de 13 ans, après
des études chez les Frères des écoles
chrétiennes, Cyrille Duquet entre comme apprenti chez
l’orfèvre Joseph-Prudent Gendron de la rue Saint-Jean
à Québec. Lorsque ce dernier décide de
déménager en 1862, l’apprentissage du jeune
Duquet s’achève. Sans hésiter, Duquet propose
au propriétaire de s’établir à son
compte au même endroit. L’affaire conclue, il partage
pendant un certain temps ses locaux avec Simon Levy, vendeur
en horlogerie et bijouterie. |
|
Vu dans Le Canadien, le 6
décembre 1877 , LE TELEPHONE À QUÉBEC |
|
Premier brevet 8371
que Duquet obtient le 1er février 1878
Voir le brevet  (photo ci contre une réplique) et le courrier associé |
 |
|
C’est toutefois avec son nouveau combiné
téléphonique (photo ci dessus) que Duquet acquiert
la notoriété. Ce qui est cependant bien établi, c’est
le brevet que Duquet obtienu, le 1er février
1878, pour des modifications « facilitant la transmission
du son et améliorant les propriétés acoustiques
» et surtout pour la conception d’un nouvel appareil
réunissant, sur une même planchette, l’émetteur
et le récepteur. |
C'est la fin de l'amateurisme, avec l'entrée
des deux poids lours de la télégraphie au Canada :
Montréal Telegraph et Dominium
Telegraph dans le marché de la téléphonie.
- la Montréal Telegraph de
Québec qui était en bon rapport avec la Western Electric
concurent de Bell, vend du téléphone de Edison de
bonne qualité mais pas très pratique,
- la Dominium Telegraph de Toronto
qui a toujours été en affaire avec Bell, deviendra
en février 1879 le representant attitré de melville
Bell et commercialisera ses appareils dans tout le Canada sauf Hamilton,
Toronto et York ou Melville Bell avait déja cédé
ses droits.
- Restait dans le jeux Lewis McFarlane directeur du bureau de Toronto
qui sera nommé diecteur de la division téléphone
de la Dominium Telegraph.
Ces deux entreprises investiront 75 000 dolards la première
annèe d'exploitation pour des revenus insignifiants, 1878-1880
la concurence est rude et domine le développement de cette
industrie.
Un gros inconvénient pour les abonnés d'une entreprise
qui ne pouvaient pas communiquer avec les abonnés de l'autre
entreprise.
Les appareils téléphoniques des années
1880 étaient grands, l’utilisateur devait tourner la
manivelle pour joindre la téléphoniste qui établissait
l’appel selon le nom de demandeur. Les numéros individuels
feront leur apparition en 1884. Les appareils Edison n'étaient
pas très pratique ...
Si la personne à rejoindre ne possédait pas de téléphone,
Bell envoyait un messager à son domicile, l’invitant
à venir prendre l’appel dans les bureaux de la compagnie.
Chaque matin, les clients recevaient un appel
de l’opératrice afin de s’assurer que leur service
fonctionnait correctement.
En concertation avec C.Williams, Melville Bell fixe le prix des
droits au Canada à 100 000 Dollars (côte établie
par les brevets en téléommunications). melville Bell
propose à la Dominium Telegraph
qui trouve que c'est trop cher, McFarlane l'estimait entre
5000 et 12 dollars. Duquet aussi contacté n'a pas
plus réunr plus de 3000 dollars, personne ne peut acheter
ses droits.
Graham Bell deamnde à Baker de secourir son père;
Baker , il se tourne vers les états unis pour conlure
un contrat en novembre 1879 avec la Western Union.
En 1879, comme Melville Bell veut se départir de son entreprise
naissante et qu’aucune compagnie canadienne n’est intéressée
par l’entreprise, Melville Bell vend son entreprise et les
droits canadiens reliés au brevet d'invention du téléphone
au National Bell Telephone de Boston.
.
Puis en mars 1880 William Forbes le nouveau président
de la National Bell, accepte d'acheter
les droits canadiens pour des raisons statégiques, car
le principal adversaire la Western Union aux Usa et aussi partenaire
de la Montreal Telegraph.
Puis Melville Bell quitte le conseil d'administration en juin 1880
pour rejoindre son fils et s'installer à Washington et retourne
à ses études des sourds-muets.
Le grand gagnant semble être Baker qui était
déjà le président de la Bell au Canada qui
rédigea en hiver 1879-80 la charte d'une nouvelle entreprise
qui devrait s'appeler la Bell Telephone Compagney Of Canada et commencera
la procédure d'incorporation, la nouvelle entreprise s'appelera
la Bell Telephone pour éviter
la confusion avec la Bell Telephone Compagny
des états unis.
sommaire
Baker qui n'avait pas l'envergure nécessaire pour
une entreprise de si grande échelle, c'est le Colonel
Forbes qui finit par recruter Charles Fleetford Sise
pour représenter les intérêts de la National
Bell au Canada.
 CHARLES FLEETFORD SISE
CHARLES FLEETFORD SISE |
Sise est un homme d’affaires,
né le 27 septembre 1834 à Portsmouth, New Hampshire,
sixième fils d’Edward Fleetford Sise, marchand commissionnaire
et propriétaire de navires, et d’Ann Mary Simes
; le 20 février 1860, il épousa à Mobile,
Alabama, Clara Bunker (décédée en 1872),
et ils eurent quatre filles, dont deux vécurent au delà
de la petite enfance, puis le 4 juin 1873, à Newburyport,
Massachusetts, Caroline Johnson Pettingell, et de ce second
mariage naquirent trois fils ; décédé le
9 avril 1918 à Montréal.
Charles Fleetford Sise fit des études seulement jusqu’à l’âge de 16 ans et entreprit en 1850 une carrière de marin à bord d’un navire appartenant à sa famille. Six ans plus tard, son père le nomma capitaine du navire marchand Annie Sise. C’est alors qu’il commença à tenir un journal de bord. Même une fois qu’il aurait cessé de naviguer, il continuerait, jusqu’à sa retraite en 1915, à noter de petits et grands événements dans des carnets qu’il appelait journaux de bord. Après avoir commandé durant plusieurs années des navires marchands qui sillonnaient le Pacifique et l’Atlantique et se rendaient en Australie, il interrompit temporairement sa vie nomade en 1860, l’année de son mariage, et fut associé durant trois ans à une maison de commerce et de courtage maritime à La Nouvelle-Orléans. |
| Né et élevé en Nouvelle-Angleterre,
Sise se rangea pourtant du côté des Sudistes lorsque
la guerre de Sécession éclata en 1861. On dit qu’il les soutint en tant qu’agent de renseignements, briseur de blocus et secrétaire particulier du président des États confédérés du Sud, Jefferson Davis, dont il était l’ami. Toujours discret sur ses activités du temps de guerre, il s’aliéna sa famille de la Nouvelle-Angleterre pendant un temps parce qu’il avait épousé la cause des sudistes, et la possibilité de mener une carrière stable d’homme d’affaires dans le nord-est des États-Unis lui fut pour ainsi dire interdite. Ces raisons expliquent en partie pourquoi il s’installerait un jour à Montréal. En 1863, Sise se rendit à Liverpool, en Angleterre, pour acquérir un navire au nom de l’entreprise de son beau-père, l’Alabama Steam Ship Company. L’année suivante, il fonda à Liverpool sa propre maison de transport maritime, de commerce et d’affrètement. En 1867, il rentra aux États-Unis et, nommé à nouveau capitaine de l’Annie Sise, se mit en route pour l’Australie. À son retour aux États-Unis l’année suivante, il trouva un emploi dans les assurances. Il travaillerait 11 ans dans ce secteur, dont quelque temps à titre de représentant américain de la Compagnie d’assurance royale canadienne de Montréal, dont Andrew Robertsonétait président. Toujours mal vu à cause de ses liens passés avec les Sudistes, Sise démissionna le 31 décembre 1879. En mars 1880, William H. Forbes, président de la National Bell Telephone Company de Boston, une des entreprises dont serait issue l’American Telephone and Telegraph Company (AT&T), prit Charles Sise comme agent spécial et le chargea de coordonner la prise de contrôle de la téléphonie canadienne par la National Bell. |
L'empire Bell, aura pour unique mandat et le seul pendant plusieurs décennies de commercialiser et de peaufiner les services liés à la téléphonie fixe (en élargissant notamment les réseaux de communications téléphoniques locaux en réseaux régionaux, nationaux, puis internationaux).
Le 29 avril 1880 la nouvelle entreprise reçoit une charte qui permettra de faire à peu près tout ... pas de tarif, pas de réglementation.
Le président William Roberson est désigné le 1er Juin 1880 lors de la première assemblée à Toronto. Roberson étranger aux télécommunication, neutre (et manipulable). Size devient le vice président et directeur général, il possède tous les pouvoirs.
Le conseil d'administrations qui compte huit membres dont trois américains : Forbes, Vail et Sise. Parmi les autres membres canadiens, l'illustre Joseph Tibaudeau sénateur et directeur de la banque national, qui devienfra aussi le président de la compagnie d'éléctricité à Montréal.
Le deal avec Roberson est qu'il imposa Montréal comme siège social de la socièté au détriment de Toronto.

|
Deux filiales canadiennes virent le jour en 1880
Fin 1880 Il y avait alors 150 employés et 2165 téléphones installés dont :
Sise était compétent et assez dure en affaires, les contrôles des coûts étaient permanents et il arriva à offrir un service comparable à ce qui se faisait aux Etas Unis mais 23 % moins cher. Au Canada, ce sont des hommes d'affaires de la ville de Hamilton qui sont les premiers abonnés canadiens du téléphone. Rapidement, l'élite commerciale des grandes villes canadiennes emboîte le pas. En 1880, Montréal, avec ses 546 appareils téléphoniques, est la plus « branchée » des villes au Canada. Dès 1881, Size avait acquis,
au nom de son employeur, « tout le matériel téléphonique
restant au Canada » – soit en tout 3 100 appareils. |
En 1898 à Québec, Bell se fait construire un édifice sur la rue Saint-Jean, au coin de la rue Sainte-Angèle.
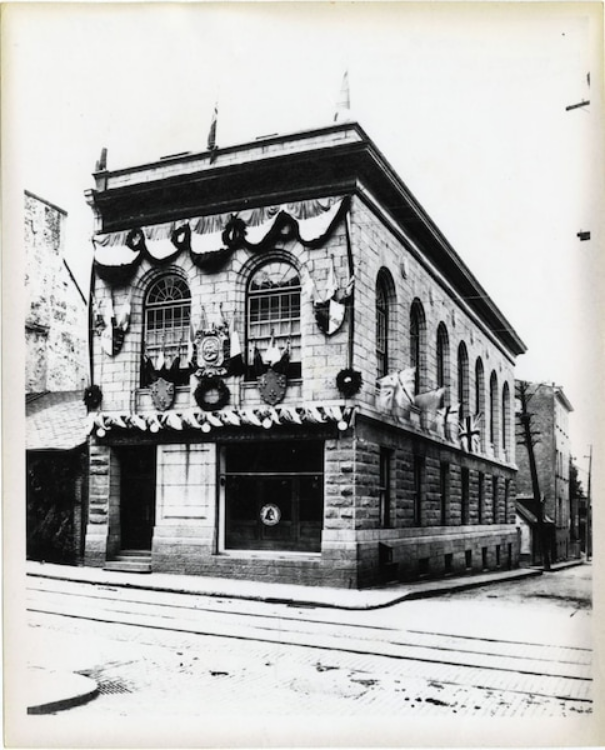
Plus tard, cet immeuble sera allongé en façade sur la rue Saint-Jean et il sera rehaussé d’un étage, et ce, en conservant le style initial. En 1951, le ministère de la Défense nationale en fait l’acquisition et y installe son centre de recrutement. Il y sera jusqu’en 2007 alors qu’on transforme l’édifice en lofts. Depuis 2010, le rez-de-chaussée est occupé par une pharmacie Jean-Coutu.
sommaire
En colombie britannique, le développemnt fut plus rapide.
Cette région ne dépendait du domaine de Bell. Terre
Neuve isolée du Canada par son statut de colonie britannique
constitue un cas à part.
C'est grâce à Robert Burns McMicking que le
téléphone arrive à Victoria sur l'île
de Vancouvert en 1878.
McMicking était un aventurier,chercheur d'or, participé
à la construction du télégraphe entre l'Amérique
et l'Europe (projet Overland), il devint le directeur de la compagnie
de télégraphe de la colombie britanique qui passa
sous contôle fédéral en 1871 avec la Confédération.
En 1878 McMicking directeur de Dominion Government
Telegraph écrivit à Melville Bell et Thomas
Henderson pour proposer ses services et répondirent en le
désignant représentant de Bell Telephone et en lui
envoyant une paire de téléphones.
McMicking relia son bureau au quotidient "Colonist" et
invita les notables de Victoria à utiliser cet équipement.
L'article publié dans le "Colonist" du 26 mars
1878 montre que l'opération fut un succès, les
gens chantèrent et sifflèrent et s'étonnèrent
de reconnaître la voix de leurs amis.
McMicking commença à faire la promotion pour louer
des appareils à la paire, mais les gens allaient plûtot
en ville à San Francisco cherher des téléphones
à meilleurs marché alors que McMicking ne pouvait
que louer ... quand il en avait car les appareils en provenance
de Montréal devait faire le détour par les Etats Unis
pour arriver à Vancouver.
Le pasteur Henderson convainquit McMicking que la solution
était d'installer un central téléphonique.
McMicking était en contradiction avec ses
activités téléphoniques de la compagnie fédérale.
C'était du travail au noir. McMicking démissionna
de la compagnie d'état pour lancer sa compagnie de téléphone.
En fait il a été renvoyé de la Dominion pour
irrégularité dans les comptes car il avait acheté
les premiers téléphones avec l'argent de l'administration.
Pas grave se dit McMicking, il commanda immédiatement de
l'équipement Bell à Montréal.
S'ensuivit une serie de quiproquos, d'erreurs et de malchances qui
souligne l'incompétence du duo Bell-Henderson.
Les téléphones n'arrivaient pas ou incomplets ou non
dédouanés, le mode d'emploi arrivait sans téléphones
et en plus la passation des pouvoirs à Sise fut éfféctuées
sans les instructions nécessaires et ce dernier remettra
en question les prétentions de McMicking au titre de représentant
de Bell en Colombie britannique .
Malgré les difficultés la première compagnie
de téléphone en Colombie britannique reçut
la charte de l'Assemblée législative provinciale le
8 mai 1880 sous le nom de Victoria and
Esquimalt Telephone.
En juillet 1879 l'équipement arrive enfin
et Victoria sera dotée d'un central téléphonique,
un des premiers au Canada et le troisième sur la côte
Ouest après San Francisco et Portland.
1879 les premiers téléphones de Colombie britannique
continentale sont installés par un missionnaire anglican
dans un village de pêcheurs indiens au nom de Metlakatla.
La ligne était installée entre le magasin et la scierie
de ce missionnaire et raccordé aussi à quelques huttes
à son petit réseau.
Ce village devenu Prince Rupert était la seule ville de Colombie
britannique à posséder un service municipal (sous
le nom de CityWest).
Le lien Bell et Victoria and Esquimalt
Telephone cessa en 1889 quand l'entreprise insulaire acheta
à Bell les droits sur le téléphone.
Sur le continent avec l'arrivée du Canadian Pacific à
Port Moody, une ligne est est construite entre New Westminster et
Port Moody en 1883, an an après un central téléphonique
est installé à Westminster avec une nouvelle compagnie
la Westminster and Port Moody Telephone.
En 1885 la ligne sera étendue à Granville avec un
central le 6 avril 1886. Le nom de la compagnie change pour s'appeler
New Westminster and Burrard Inlet Telephone. Ce jour Granville s'appellera
Vancouvert. Malheureusemnt quelques semaines après, un incendie
détruit la ville, mais le central téléphonique
a pu être sauvé.
En 1891 . la New Westminster and Burrard Inlet Telephone avait créé
Vernon and Nelson Telephone pour desservir l'intérirur de
la province.
En juin 1898, la New Westminster and Burrard Inlet Telephone fut
vendu à des interêts britaniques à un immigrand
anglais William Farell.
La New Westminster and Burrard Inlet Telephone végétait
à Victoria et comme l'axe économique se déplaçait
vers le continent, en 1889 la population de Vancouvert dépassa
celle de Victoria, c'est cette année que la New Westminster
and Burrard Inlet Telephone acheta Victoria and Esquimalt Telephone.
McMicking resta directeur mais le pouvoir était passé
aux mains des hommes de Vancouvert.
Le docteur Lefevre qui était vice président de la
New Westminster and Burrard Inlet Telephone qui n'avait jamais accepté
la vente à des interêts britanique et encore moins
le pouvoir effetua un coup de force. En 1902 il se rendit en Grande
Bretagne il parvint à neutraliser les propiétaires
en les divisants et fi une offre d'achat qui lui permit d'obtenir
une majorité d'actions. En 1903 il amalgama toutes ses compagnies
de téléphones sous le non de Vernon and Nelson Telephone.
en 1904 elle s'appelera la British Columbia Telephone Compagny.
Presque tous les téphones de Columbia britannique sont désormais
regroupés, puis en 1904 un câble fut posé entre
Victoria et le continent à Bellingham.
Comme la loi de l'Etat de Washington interdisait à un étranger
de posséder un service public, Lefevre créa une compagnie
américaine détenue par un ami de Farell sous le nom
d'International Telephone Compagny, Lefevre en quelques années
avait créé un véritable réseau téléphonique
en Colombie britannique.
|
Tarif de La compagnie de téléphone "Victoria & Esquimalt Telephone Co", crée en mai 1880 par la British Columbia Telephone Company |
sommaire
À la fin du 19e siècle, Bell vendit ses activités dans l’Atlantique dans les trois provinces maritimes, où de nombreuses petites sociétés indépendantes exerçaient leurs activités et devenaient par la suite la propriété de trois sociétés provinciales.
Terre-Neuve-et-Labrador s'est jointe au Canada avec plusieurs sociétés privées et une opération gouvernementale transférée sous le contrôle des Chemins de fer nationaux du Canada.
A Terre-Neuve : La situation est différente car Melville Bell n'avait pas déposé de demande de brevets dans cette colonie britanique.
En 1878, les touts premièrs téléphones furent installés sur une ligne privée, entre Saint Jean au poste de météorologie et le domicile du mître du poste météo.
Bell tentera d'obtenir un permis exclusif d'exploitation du téléphone, mais se heurta à l'Anglo-American Telegraph, entreprise fondée par Frederic Gisborne et rebaptisée Cyrus Field dans les année 1850 qui avait reçu les aurorisations gouvernementales de l'exlusivité de l'exploitation du télégraphe pour 50 ans. Son directeur Graham MacKay pensait que le téléphone allait concurencer le télégraphe dans les communications transatlantiques et soutiendra que le monopole d'Anglo-American couvrait toutes les communiations électriques et obtiendra gain de cause.
Bell dut alors composer avec Anglo-American, Sise convaincra MacKay que le téléphone n'allait pas menacer le télégraphe et cédera ses brevets contre une redevance.
En 1885 le premier central téléphonique fut ouvert à Saint Jean par l' Anglo-American Telegraph.
En 1881, la Compagnie
de téléphone Bell du Canada procède
à son premier appel interurbain entre Toronto et Hamilton,
mais le coût des travaux faillit menacer la compagnie à
la faillite, l'expérience ne se renouvellera pas de sitôt.
A cet époque l'interurbain n'est pas rentable.
Vers la fin de 1882, cette compagnie comptait environ 4500
abonnés au téléphone des réseaux étaient
établis dans une centaine de villes.
La Chambre du Parlement du Dominion et les nouveaux bureaux départementaux
sont tous reliés par téléphone au bureau central
de Québec.
En 1882, la Canadian Telephone Company
s’intégra à la Compagnie
canadienne de téléphone Bell en
achetant presque tous les brevets de la Canadian Telephone.
Cette dernière, dont Robertson était président
et Sise vice-président, semblait avoir le champ libre
en matière de téléphonie canadienne : une charte
fédérale l’habilitait à étendre
son réseau dans tout le pays, et elle avait acquis la quasi-totalité
des installations et brevets téléphoniques.
En plus, selon une entente avec la compagnie américaine,
l’entreprise canadienne toucherait les droits canadiens de
tous les brevets que la compagnie américaine obtiendrait
au Canada.
La tutelle des Etats Unis sur Bell Telephone aura duré
deux ans. Il ne faut pas voir dans cette émancipation
rapide, l'aboutissement d'une vision politique. Size était
étranger à la problématique nationale canadienne,
par contre il voulait être le seul mâtre à bord
de son entreprise.
Le manque de matériel constituait un problème permanent
car à la mort de Cowherd début 1881 avait désorganisé
l'approvisionnement du marché et son remplaçant n'était
pas à la hauteur de la mission. Size attendit trop longtemps
pour prendre une décision
En juillet 1882, la compagnie met sur pied une équipe
de trois personnes chargées de la fabrication de téléphones;
nommé Mechanical Department, à Montréal
rue Craig, cette équipe deviendra "The
Northern Electric and Manufacturing Company" en 1895,
puis sera renommée Northern Electric, Northern Telecom, Nortel
Networks et finalement Nortel ; cette compagnie comptait
35 000 employés à la fin de 2005.
Au 1" janvier 1883, il y avait 866 abonnés à
Montréal; 525 à Toronto; 250 à Ottawa; 240
à Québec; etc., etc.
Modèles Blake Bell 

En 1884 l’Île-du-Prince-Édouard , Bell repésenté
par Robert Angus réuni 30 abonnés nécessaires
pour justifier l'ouverture d'un petit cental téléphonique.
Les gens d'affaires décident de construire eux mêmes
un réseau rudimentaire sur l'île avec du fil nu suspendu
sans poteaux ...
sommaire
La crise couve, manque de capitaux, pénétration sélective
des marchés, les zones rurales sont délaissées,c'est
la contestation du monopole Bell.
Des villages s'équipent eux mêmes, des médecins
de campagnes les seuls à avoir les capacités scientifiques
firent installer leurs cabinets les pharmacies et leurs patients
et parfois créérent de petites compagnies.
Ailleurs ce sont les municipalités qui mirent en place un
service téléphonique public, tout comme le gaz ou
l'eau.
C'est ainsi qu'à Toronto une petite usine fut créée
par l'enreprise Toronto Telephone manufacturing
Compagny, afin de réponse aux besoins des laissés
pour contre.
Cette entreprise attaqua même la Bell Telephone se basant
sur deux principes :
- la fabrication des appareils doit être au Canada
- Bell refusait de vendre ses appareils et se bornait à les
louer, contrirement la loi au Canada
Le ministère de l'agriculture donna raison à la
Toronto Telephone manufacturing Compagny, les brevets de
Bell furent annulés en janvier 1885.
Première conséquence : repli de Bell Telephone au
Québec très peuplé, l'ouest Manitoba Alberta
Saskatchewan ...
Conscient que la perte de ce brevet menaçait le monopole
de Bell, Sise prépara la compagnie à soutenir
la concurrence.
Il concentra les opérations en vendant les installations
de l’Île-du-Prince-Édouard en 1885 (Affaire conclue
pour 1500 dollards et 40 actions de la nouvelle compagnie), puis
celles de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick en 1888–1889,
et en abandonnant en 1889 des liaisons avec des entreprises amies
mais indépendantes en Colombie-Britannique.
Renoncer à ces territoires semblait devoir permettre à
la compagnie d’affronter ses rivales au cœur du pays.
Nouvelle-Écosse sous la direction de Sise,
Bell s’empressa de construire des lignes interurbaines afin d’avoir
l’avantage sur la concurrence locale, inaugurant ainsi plus d’un
siècle de controverse sur les interconnexions téléphoniques
Toujours sous la direction de Sise, Bell s’engagea
dans d’impitoyables batailles tarifaires là où elle
avait des concurrents directs.
Par exemple, à Peterborough, à Port Arthur (Thunder Bay)
et à Dundas, en Ontario, elle offrit le service téléphonique
gratuitement jusqu’à ce qu’elle ait éliminé
ses concurrents.
À Winnipeg, Sise mit furtivement sur pied la People’s Telephone
Company, qui pratiquait des prix inférieurs à ceux de Bell
et de sa vraie rivale. Quand cette rivale s’écroula au début
de 1886, la People’s Telephone disparut elle aussi ; Bell
se retrouva alors seule et put revenir à ses anciens prix. D’autres
batailles tarifaires eurent lieu à Montréal et à
Sherbrooke, dans la province de Québec.
En 1887 des hommes d'affaires de Halifax avec un capital autorisé
de 50 000 dollars, créent la Nova Scotia
Telephone Compagny pour relier rapidement Halifax à Truro
New Glasqow, Pictou et Amherst . Il fallait à tout prix éviter
que Bell ait le temps de réagir.
Puis de nouveaux entrepreneurs prospétèrent les quelques
300 abonnés de Bell pour leur offrir de nouveaux services. La Hants
and Halifax Telephone et la Parrsboro Telephones furent rachetées,
opération symbolique car ces deux entreprisent n'engendraient peu
d'activité.
Le capital autorisé passa à 100 000 dollars, tout était
prêt pour installer les centraux dans les principales ville de la
Nouvelle Ecosse et affronter la Bell Telephone.
Novembre 1887 une lettre de Sise retourne la situation :
Sise offrait de vendre les installations de Bell en Nouvelle Ecosse
et chose curieuse au Nouveau Brunswick pour 50 000 dollars, 65
000 dollars en actions et l'engagement d'acheter à prix égal,
de l'équipement à Bell plutôt que celui des concurents.
Pour sceller le tout, Bell aurait deux représentants de plein droit
au conseil d(administration de la nouvelle compagnie.
La proposition fut accéptée, la guerre du téléphone
n'eut pas lieu.
En février 1888 Nova Scotia Telephone prit possession des
installations Bell dans les deux provinces, on y comptait 539 abonnés
sur quatre centraux téléphoniques.
Nova Scotia Telephone augmente de plus en plus son capital,
réduisant la partiipation de Bell qui avait glissé de 14
% . Sise avait réussi en Nouvelle Ecosse une décolonisation
en douceur, la bonne entente entre parties était telle que le vérificateur
de Bell fit le voyage d'Halifax afin d'aider la nouvelle entreprise à
mettre au point des proédures comptables et salariales à
celles en vigueur à Montréal.
Bell Telephone et Nova Scotia Telephone coopérent harmonieusement
jusqu'en 1999 au sein d'Aliant, filiale de Bell Canada.
Au New Brunswick ce n'était pas le cas lors de la
prise en main par Nova Scotia Telephone, ils ne voulurent plus être
à la remorque de Halifax ou Montréal. Pouratnt en décembre
1879 Western Union ouvre à Saint Jeau le premier central téléphonique
de brevet Edison. Quelques jours plus tard Domion Telegraph ouvre aussi
un centre téléphonique de brevet Bell et comme à
Halifax, à Saint Jean les deux centres sont totalement incompatibles
... Ce n'est qu'en 1881 que Bell Telephone dépêcha Lewis
MacFarlane (futur président) qui reprit la succession pour
fusionner les deux entreprises. C'était la première assisgnation
à Bell Telephone . MacFarlane fut arrêté mis en prison
une nuit et rentra à Montréal.
Début 1888, même méthode à l'Ile du
Prince Edouard et en Nouvelle Ecosse , des hommes d'affaires créent
la New Brunswick Telephone Compagny, l'éxclusivité de l'exploitation
fut accordée par l'assemblée législative en mars
1888 .
| L’Île-du-Prince-Édouard
a connu plus que sa part de premières en technologie des communications.
Il s’agissait de progrès nés du fait que nous étions
une île isolée du continent nord-américain. Il
s’agissait peut-être d’une petite entreprise sur la
scène mondiale, mais elle était bel et bien innovatrice.
Tous les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard
devraient être très fiers des réalisations passées
de notre compagnie de téléphone et se tourner vers l'avenir
avec Bell Aliant. Les premiers câbles télégraphiques posés à destination et en provenance de l'Île-du-Prince-Édouard, ont servi de base aux câbles téléphoniques ultérieurs, dont le premier a été posé en 1910. Plus tard, les communications par micro-ondes sont devenues le premier choix de l'Île. Le 20 novembre 1852 Frederic Newton Gisborne, ingénieur et électricien, né à Broughton, Lancashire, Angleterre, posa le premier câble océanique de ce côté de l'Atlantique, reliant Carleton Head, Île-du-Prince-Édouard, avec Cape Tormentine, Nouveau-Brunswick, sur une distance de 14 milles par eau. Ce câble était utilisé pour la télégraphie. Ce câble sous-marin fut le premier câble sous-marin en Amérique du Nord et précéda de quatre ans la ligne vers Terre-Neuve puis vers l'Angleterre. Le câble de 1852 a été posé par le bateau à vapeur à roues latérales « Ellen Gisborne » (du nom de l'épouse de Gisborne) et a fonctionné pendant une période relativement courte. La plus grande importance de ce câble est qu'il a prouvé la viabilité des connexions par câble et a jeté les bases des futurs câbles télégraphiques et téléphoniques. Les améliorations futures dans la conception des câbles et les techniques de pose ont rendu le service plus fiable. 1856, 10 août - Le bateau à vapeur Victoria se rend à l'Île-du-Prince-Édouard et pose un nouveau câble télégraphique depuis Tormentine pour la New York Newfoundland and London Telegraph Co. 1866, octobre - le vapeur Medway et le vapeur Terrible posent un nouveau câble télégraphique de Carleton Head au cap Tormentine sous l'observation de Cyrus Field. Un article du New York Times publié le 30 septembre 1866 disait : « M. Field est arrivé ici cet après-midi en provenance de Shediac, après avoir rencontré le Medway et le Terrible dans le détroit de Northumberland, occupé à poser un nouveau câble entre le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard. » 2e article du New York Times, 5 octobre 1866 : « Un autre câble sous-marin - le câble posé à travers le détroit de Northumberland - Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, le jeudi 4 octobre. Le câble traversant le détroit de Northumberland, reliant le Nouveau-Brunswick à l'Île-du-Prince-Édouard, a été posé avec succès par le paquebot Medway mardi dernier. Le Medway et le Terrible ont ensuite immédiatement pris la direction de l'Angleterre. En 1910, un câble téléphonique
expérimental privé à circuit unique a été
posé entre Wood Island et Pictou, en Nouvelle-Écosse,
pour desservir la FB McCurdy and Company, un courtier en valeurs
mobilières basé à Halifax. McCurdy a établi
la ligne expérimentale pour relier ses bureaux d'Halifax
et de l'Île-du-Prince-Édouard. Vers 1925, à Quebec le nombre d'abonnés
atteint 10 000. On uniformise donc les numéros de téléphone
qui auront tous désormais cinq chiffres. 
Lorsque l'interrupteur a été mis hors service, la majeure partie a été mise au rebut sauf ce qui n'avait pas été transporté à Terre-Neuve pour être utilisé comme pièces de rechange pour des équipements similaires. En 1948, le premier système commercial à micro-ondes au monde a été installé entre Tea Hill près de Charlottetown et Fraser's Mountain près de New Glasgow en utilisant un équipement de modulation de temps d'impulsion développé par la Federal Electric Company du New Jersey donnant 23 canaux, pour remplacer le système souvent peu fiable. liaisons sous-marines vers l'Île-du-Prince-Édouard. Ce site se trouvait à proximité de
l'actuel 13 Upper Tea Hill Crescent à Stratford. La propriété
du site de la tour a été cédée à
la ville de Stratford pour être utilisée comme parc
vers 2000, et la ville a fait démolir le bâtiment
quelques années plus tard, car il devenait un lieu de rencontre
pour les adolescents et des problèmes de sécurité
ont conduit à son retrait. La tour H d'origine a été
supprimée il y a environ 20 ans pour la même raison.
Sur la propriété, à côté de
son emplacement d'origine, se trouve une tour/répéteur
de la GRC. La popularité du téléphone est telle que vers 1951, le nombre d'abonnés dans la région de Québec atteint les 100 000. Ce phénomène se produit déjà partout dans le monde depuis un moment. On doit forcément augmenter le nombre de chiffres du numéro de téléphone, mais on craint que les gens aient de la difficulté à se souvenir de six ou sept chiffres. On introduit alors un mot au début du numéro dont les deux premières lettres correspondront à des chiffres. Les numéros sont en effet plus faciles à mémoriser ainsi et c'est l'apparition des lettres sur le cadran du téléphone. Le mot correspond au nom du central auquel l'abonné est relié. En 1956, nous pouvons affirmer avec une certaine certitude que le câble MT&T n'était plus en service, car des sources d'Island Tel affirment qu'à la suite de la tempête de verglas de 1956 , la liaison micro-ondes depuis Tea Hill assurait la seule communication téléphonique hors service. À cette époque, des poteaux tombés dans l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard empêchaient l'utilisation de la liaison Egmont. À la suite de la tempête de verglas
de 1956, un système a été installé de
Fraser Mountain, en Nouvelle-Écosse, à Charlottetown,
à Hazel Grove, Summerside, Egmont, puis à Moncton,
au Nouveau-Brunswick. Ce système a permis d'enlever de nombreux
kilomètres de poteaux et de câbles à péage
endommagés par la tempête. et a assuré que la
liaison Egmont resterait active même si une autre tempête
de verglas comme celle de 1956 se reproduisait. 1968 - Le 18 août 1968, un système Lenkurt 71F à 120 canaux a étendu le réseau depuis la baie d'Egmont via O'Leary. Lenkurt était une filiale de GTE spécialisée dans les micro-ondes. Photo de Terry Biddlecombe. 1970 - Un nouveau système de circuits 960 est installé entre Nutby Mountain, en Nouvelle-Écosse, et l'aérogare de Churchill, à l'Île-du-Prince-Édouard. De là, le signal a été retransmis à Charlottetown. C'était un Lenkurt 878 2 Ghz. Système 960 canaux. 1973 - La partie Charlottetown du système Collins ci-dessus a été remplacée par un système micro-ondes Lenkurt 878 960 canaux. La raison en était de répondre à la demande suscitée par le déménagement des opérations interurbaines de Summerside à Charlottetown. 1974 - La partie Summerside-Egmont est remplacée par un système Lenkurt à 450 canaux. 1979 - Deux systèmes Lenkurt 878C3 sont installés entre Nutby Mountain, en Nouvelle-Écosse. à Tea Hill pour transmettre les signaux de télévision à Island Cablevision. 1979 - Extension du réseau jusqu'à Churchill, Île-du-Prince-Édouard, à partir de Nutby Mountain, Nouvelle-Écosse. en utilisant un 2 GHz. Système Lenkurt 878C3. De plus, en 1979, le site de la baie Egmont a été mis hors service et remplacé par la nouvelle liaison à 130 canaux entre Murray River, à l'Île-du-Prince-Édouard, et Fraser Mountain, en Nouvelle-Écosse. Cette nouvelle liaison a ouvert deux ans avant la mise hors service d'Egmont et a été inaugurée le 8 février 1977. Ce système était alimenté par un système Lenkurt 71F à 120 canaux fonctionnant à 2 Ghz. 24 canaux étaient réservés aux besoins futurs et aux urgences. Photo de Terry Biddlecombe. 1986 - Une nouvelle route numérique est construite avec 672 circuits de Charlottetown, à Seal River jusqu'à Hardwood Hill, en Nouvelle-Écosse, puis à Fraser's Mountain, et enfin à Halifax. Le développement des micro-ondes s'est poursuivi
à l'Île-du-Prince-Édouard afin de fournir davantage
de liaisons avec le continent et, en fait, dans toute l'Île,
avec un nombre croissant de liaisons et des stations plus puissantes. 1985 - Le câble à fibre optique fait ses débuts à l'Île-du-Prince-Édouard avec une longueur de 25,6 km. lien de Charlottetown à Seal River offrant des parcours de parole pour 2016. Une deuxième piste a été installée entre Seal River et Montague, offrant 672 voies vocales. 2004 - Bragg Communications (Eastlink) installe un câble sous-marin à fibre optique de 56 kilomètres traversant le détroit de Northumberland, de Graham's Pond, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Port Hood, en Nouvelle-Écosse. L'installation a été réalisée par IT International Telecom et le navire Alcatel-Lucent « Île de Batz ». |
Nova scotia Telephone réagira vite et adopte une
charte fédérale sous le nom de Nova Scotia and New Brunswick
Telephone. Les autorités faisant trainer les choses et finalement
la charte fédérale ne sera pas accordée. Entre temps
la New Brunswick Telephone avait ouvert des centres téléphoniques
dans les principales villes, déclanchant une guerre des prix ...
La situation devint vite incontrôlable.
Nova scotia Telephone fit appel à Sise qui vint sur place et exposa
la théorie de Vail sur l'occupation du territoire et suggère
de construire une ligne entre les provinces de Amherst et Moncton ...
Rien n'y fit , il fallut se résoudre à vendre.
Bell racheta les installations de la New Brunswick Telephone au New Brunswick
et les revenda à la New Brunswick Telephone en 1889 pour 50 000
dollars, moitié en argent moitié en actions soit une participation
de 31 % .
Tout comme en Nouvelle Ecosse, la nouvelle compagnie nommera deux représentants
de Bell au conseil d'administration.
Le réseau de Bell Nova Scotia Telephone au Nouveau Brunswick compta
quatre centres téléphoniques pour 520 abonnés.
Bilan : la perte de la Nouvelle Ecosse et du Nouveau Brunswick enleva
1200 abonnés à Bell
Le repli de bell Telephone sur le Québec l'Ontario et l'Ouset est
relatif, le gros de la population du Canada est concentrée sur
le Québec et l'Ontario.
Bell continera à fournir les équipements pour l'Ile Edouard
Nouvelle Ecosse et le Nouvea Brunswick. Mais la pénuerie de capitaux
continue de freiner la pénétration du téléphone
de façon discriminatoire.
Bell privilégia les grandes villes ou le taux de rendement est
intéressant, contrairement aux campagnes, Le mécontentement
dans la majeure partie du Canada menace l'existance du monopole de Bell
.

1889 La toute première facture du service téléphonique
de la chambre élective du Parlement provincial.
Celle-ci a été envoyée par la Bell Telephone
Company of Canada (aujourd’hui Bell Canada) à l’honorable
Félix-Gabriel Marchand, alors qu’il siégeait
comme premier ministre du Québec.
En 1890 Size prend la présidence de la socièté
(jusqu'en 1915).
En 1892, une loi spéciale est adoptée au Parlement
canadien qui stipule que toute augmentation des tarifs téléphoniques
doit au préalable être approuvée par le gouverneur
en conseil; cet événement marque le début de
la réglementation de la téléphonie au Canada.
Durant les années 1880, 1890 et 1900, les
caractéristiques de la clientèle de Bell demeurent
à peu près les mêmes : manufacturiers, commerçants,
gens d’affaires, familles fortunées, notables, institutions.
La progression comparée des abonnés d’affaires
et résidentiels permet de souligner un rythme différentiel
dans les deux cas. Ainsi, on constate que le marché d’affaires
est plus rapidement saturé. C’est pourquoi, à
partir de la fin des années 1910, Bell se tourne davantage
vers le milieu résidentiel et met en œuvre une politique
commerciale active destinée spécifiquement à
cette clientèle. Au cours des années 1920, on peut
observer un changement dans la proportion des abonnés : le
pourcentage de la clientèle résidentielle gagne du
terrain pour atteindre 50 % des utilisateurs. Toutefois, pour accroître
ses revenus, Bell préfère augmenter la consommation
du service téléphonique auprès de ses abonnés
plutôt que de recruter de nouvelles clientèles, jusque-là
plus ou moins étrangères à la culture téléphonique.
Par exemple, l’entreprise propose à ses clients résidentiels
la location d’un deuxième appareil.
13 avril 1900
Un centre téléphonique à batteries centrales
est installé à Ottawa, en Ontario. Les batteries
sont retirées de chez le client
Au lieu de tourner la manivelle du téléphone pour
obtenir la téléphoniste, le client n’a qu’à
soulever le récepteur pour parler à l'opératrice.
En 1900 le
service de base résidentiel coutait 30-35 dollars pour Montreal
Toranto et de 50-55 dollars pour le marché d'affaires alors
qu'à New York il était de 240 dollars. Cela parce
que en 1885 le gouvernement annula les brevets de Bell ce qui créa
un début de conurrence et incita à la baisse des tarifs
pour le téléphone. Aux Etats Unis les brevets resterons
en vigueur jusqu'en 1893-94.
Sise privilégia le marché d'affaires : les entreprises
d'abord, les foyers ensuite. Démarche qui resta car c'est
au marché d'affaires qu'il appartient d'amortir les coûts.
De même les villes auront la priorité sur la campagne
jusqu'au tournat du siècle lors du déferlement d'émigrands
vers l'Ouest. Une masse d'agriulteurs sans fortune exigerons et
obtiendront le téléphone, ils briseront les barrières
géographique et sociale qui faisait obstacle à ladiffusion
de cette nouvelle tehnologie. Ils provoqueront même une grave
crise économique de la Bell Telephone.
L’achat de concessions exclusives des municipalités
était un autre moyen de détruire la concurrence :
en 1905, Bell en avait déjà acheté 30,
et elle en acquit 40 autres de 1905 à 1910.
En échange de la garantie d’un monopole local, Bell
versait un droit de concession à chaque municipalité
et offrait souvent un certain nombre d’appareils gratuitement.
Elle consentait à ne pas augmenter ses tarifs pendant une
période déterminée ; ce fut le seul contrôle
réel auquel ses tarifs furent soumis durant plusieurs années.
Sise imagina une autre tactique pour vaincre la concurrence
: signer, avec les sociétés ferroviaires, des contrats
donnant à Bell le droit exclusif de placer des appareils
téléphoniques dans les gares et de construire des
lignes téléphoniques le long des voies ferrées.
Pour les compagnies de téléphone concurrentes, être
exclues des gares leur infligeait un dur coup : par exemple, les
marchands ne pouvaient pas se servir de téléphones
indépendants pour se renseigner sur l’arrivée
des marchandises.
Parfois, les sociétés ferroviaires elles-mêmes
en souffraient. Ainsi, à Fort William (Thunder Bay, Ontario),
le conseil municipal, qui exploitait un service téléphonique
en concurrence avec Bell, riposta en interdisant à celle-ci
d’installer des appareils au poste de police et au poste de
pompiers. Les employés du chemin de fer ne pouvaient pas
communiquer rapidement avec ces postes, même en cas d’urgence.
Au début du xxe siècle, Bell inspirait une insatisfaction
si générale et une animosité telle que le Parlement
recevait par centaines des pétitions dans lesquelles des
municipalités, des comtés et des particuliers réclamaient
un resserrement du contrôle gouvernemental.
Sous la direction de William Douw Lighthall, l’Union des municipalités
canadiennes recommandait l’étatisation des systèmes
téléphoniques.
En mars 1905, comme le mécontentement ne cessait de
croître, le premier ministre, sir Wilfrid Laurier, confia
à un comité spécial des Communes présidé
par le maître général des Postes, sir William
Mulock, le mandat d’enquêter et de faire rapport sur
la situation.
Devant cette tournure imprévue des événements,
Sise, alors âgé de 70 ans, écourta des vacances
en Europe pour accourir à la défense de Bell.
sommaire
Non seulement Sise engagea-t-il une équipe
d’avocats et de témoins experts prestigieux et politiquement
influents, mais il soutint Bell d’autres manières –
en présentant lui-même un témoignage long et
passionné devant le comité et en exerçant des
pressions en coulisse.
Les renseignements recueillis par le comité prouvaient que
l’entreprise exigeait des tarifs élevés dans
les territoires où elle détenait un monopole, qu’elle
se livrait à des pratiques impitoyables là où
elle avait des concurrents et que, d’une façon générale,
il n’y avait pas de service dans les régions rurales.
Malgré tout, Sise parvint à convaincre le comité
de ne pas faire de recommandations et de se contenter de publier
intégralement la transcription de ses travaux, ce qui eut
pour effet de rendre tout l’exercice quasi inutile.
Laurier mit fin à l’enquête sur le téléphone
à la veille de la fin de la session parlementaire en juillet.
Les pouvoirs de réglementer Bell furent délégués
au Conseil des commissaires des chemins de fer en 1906.
La solution de Laurier à la controverse du
téléphone ne plut pas dans les Prairies : en 1908–1909,
les trois gouvernements provinciaux achetèrent les installations
de Bell.
Pendant un temps, dans l’espoir d’apaiser le ressentiment
des gens de l’Ouest, Sise avait envisagé de confier
ces installations à une filiale, la North American Telegraph
Company, mais il finit par se résigner à la provincialisation.
L’achat des installations par les gouvernements
provinciaux améliora sans nul doute la rentabilité
de Bell, car il lui permit de se concentrer sur les marchés
les plus populeux et les plus potentiellement lucratifs.
En plus, une fois confiné à l’Ontario et au Québec,
Sise put se consacrer au développement des activités
manufacturières. Bell avait commencé à
fabriquer de l’équipement en 1881, mais pas
suffisamment pour conjurer la décision du commissaire des
brevets en 1885.
Puis, en 1895, Sise avait convaincu Bell de fonder la Northern
Electric and Manufacturing Company. Cette société
s’était mise à produire des articles fabriqués
auparavant par Bell avec l’autorisation de l’American
Telephone and Telegraph. Quatre ans plus tard, Sise vendit à
Bell, pour la somme de 500 000 $, une entreprise montréalaise
qui avait aussi fourni de l’équipement à Bell
et dans laquelle il avait des intérêts majoritaires,
la Wire and Cable Company.
Ces manipulations organisationnelles ennuyaient la
direction de la Western Electric, la filiale de l’American
Telephone and Telegraph qui fournissait l’équipement
à Bell. En 1901, Bell s’apprêtait à réduire
ses commandes à la Western Electric, qui était exclue
d’autres marchés canadiens à cause d’une
entente antérieure selon laquelle elle ne devait pas faire
directement concurrence à Bell. La Western Electric avait
de l’influence sur Sise, car sa société mère
était en même temps le plus gros actionnaire de Bell.
En plus, en vertu de l’entente de 1880, la Western Electric
fournissait à Bell tous les brevets obtenus au Canada. C’est
dans ce contexte que, pour apaiser les tensions, Sise accepta que
la Western Electric acquière au cours des années suivantes
des intérêts minoritaires mais substantiels dans la
Northern Electric and Manufacturing Company et dans la Wire and
Cable Company. En 1914, quand Bell fusionna ces deux filiales manufacturières
pour former une nouvelle entreprise nommée Northern Electric
Company, la Western Electric acquit 43,6 % des actions ; Bell et
ses dirigeants canadiens souscrirent le reste, soit 56,4 %. Ce schéma
de propriété persista jusqu’à la fin des
années 1950. Il permit à la Northern Electric de se
servir des brevets et maquettes de la Western Electric, mais retarda
ses progrès dans l’innovation.
Par ailleurs, Sise mit au point les arrangements
par lesquels Bell fit des interconnexions avec des compagnies indépendantes
après l’entrée en vigueur de la réglementation
en 1906. En vertu des modifications apportées cette année-là
à l’Acte des chemins de fer, le Conseil des commissaires
des chemins de fer pouvait ordonner des raccordements entre ces
compagnies locales et les lignes interurbaines de Bell « à
telle condition rétributive que la Commission juge[ait] juste
et à propos ». Bell accepta que certaines compagnies
indépendantes se raccordent à ses lignes interurbaines
sans recourir au conseil. Cependant, les soi-disant « compagnies
concurrentes » se virent refuser de faire des interconnexions
et durent présenter leur cause au conseil. Par une série
de décisions, les commissaires déclarèrent
que les compagnies qui se présentaient devant eux pour demander
des raccordements devraient dédommager Bell pour la perte
de clientèle locale et pour les frais des raccordements.
Ces décisions étaient si désavantageuses
que, au début des années 1920, il ne restait plus
de compagnies « concurrentes ».
Sise était tout d’une pièce, mais il avait une personnalité incomplète, et c’était peut-être un solitaire. Autocrate énergique et méticuleux, il se tenait à l’écart des employés, à qui il inspirait généralement la plus grande loyauté et le plus grand respect. Envers les concurrents, il était froid et calculateur, voire impitoyable. Envers les gouvernements, il pouvait être irritant et, à l’occasion, sournois. Bien qu’il ait appartenu au Club St James et au Club Mont-Royal de Montréal, cet homme tranquille et austère trouvait repos et détente surtout chez lui. Il y faisait régner l’ordre et la discipline et n’était pas très proche de ses enfants ; d’ailleurs, il avait de 40 à 45 ans de plus que ses fils issus de son second mariage. Il lisait beaucoup mais n’avait pas d’autres passe-temps, tant il était absorbé par la défense et l’avancement de la compagnie qu’il avait formée.
Sise dirigea personnellement les activités
de la Compagnie canadienne de téléphone Bell durant
35 ans, d’abord à titre d’agent spécial
en 1880, puis, de 1880 à 1890, de vice-président et
directeur administratif, puis finalement, de 1890 à 1915,
de président et directeur administratif.

Sise de 1915 à son décès en 1918, il fut président
du conseil d’administration de Bell.
Toutefois, son influence persista au delà de sa retraite
et de sa mort, car, comme l’a dit un historien du xxe siècle,
il « colonisa la compagnie avec ses protégés
». Lewis Brown McFarlane, que Sise était allé
chercher à la Compagnie de télégraphe de la
Puissance en 1880, lui succéda à la présidence
en 1915, détint ce poste jusqu’en 1925 et fut président
du conseil d’administration de 1925 à 1930.
Le fils aîné de Sise, nommé aussi Charles Fleetford,
entra au conseil d’administration de la compagnie en 1913.
Nommé président de l’entreprise en 1925 à
la suite de McFarlane, il exerça cette fonction jusqu’en
1944 et occupa aussi, entre autres, un poste d’administrateur
à la Northern Electric Company.
Les autres fils de Sise, Edward Fleetford et Paul Fleetford, furent
placés au conseil d’administration de la Northern Electric
en 1911 ; Edward Fleetford fut nommé président de
cette entreprise en 1914 et Paul Fleetford lui succéda en
1924.
La famille Sise domina donc la Compagnie canadienne de téléphone
Bell durant deux générations, de 1880 à 1944.
Montréal, La Ville contre les poteaux
et les fils
 Édifice Bell de la rue Saint-Jean en 1908,
Édifice Bell de la rue Saint-Jean en 1908,
|
En même temps que Bell élabore sa propre vision du réseau et du service téléphoniques — faisant appel à une rationalité limitée et à une conception étanche de la nouvelle technologie et de ses applications —, diverses formes d’opposition sont mises de l’avant par des acteurs locaux concernés par l’aménagement urbain, principalement les gestionnaires et les élus municipaux ainsi que les membres des mouvements associatifs. Réclamant une plus grande part d’autonomie dans le champ sociopolitique eu égard au développement et à la gestion des services publics, ils tentent de faire valoir la légitimité de leur point de vue et de leurs intérêts. Voulant élargir la marge de manoeuvre de l’administration municipale par rapport à ces services, les gestionnaires publics suggèrent une vision de l’aménagement urbain qui se démarque de celle des opérateurs privés. Des arrangements institutionnels plus conformes à leurs attentes sont négociés avec les exploitants du service téléphonique. Au fil des ans, les diverses interventions des pouvoirs publics montréalais — principalement l’administration municipale — sont parvenues à infléchir les pratiques de Bell. Malgré leur portée limitée, ces tentatives n’ont pas moins contribué à redéfinir le cadre de l’action collective. Au cours de la période étudiée,
la nature des rapports entre les gestionnaires publics de
l’espace urbain et les opérateurs privés
du téléphone s’est modifiée. Dans
un premier temps, c’est-à-dire à partir
de l’introduction du service de Bell en 1880, et ce,
jusqu’en 1906, on peut considérer qu’il s’agit
là d’une sous-période d’expérimentations.
Sur les plans juridique et institutionnel, les gestionnaires
municipaux sont alors confrontés à de nouveaux
enjeux : présence physique des infrastructures, modalités
de tarification du service, projet de municipalisation du
téléphone. D’entrée
de jeu, on peut dire que les équipements du réseau
téléphonique ne font pas seuls l’objet
de critiques sévères de la part des collectivités
locales. En effet, à partir de la seconde moitié
du XIXe siècle, la diffusion de l’ensemble des
nouveaux services de transport et de communication donne lieu
à des oppositions animées entre, d’une
part, les administrations municipales et, d’autre part,
les distributeurs privés de services. On est ici loin
des représentations de la ville moderne et efficace
telles que véhiculées par le discours et l’iconographie
publicitaires. En fait, on observe un décalage considérable
entre les images idéalisées de la ville mises
de l’avant par les opérateurs privés de
réseaux et la réalité urbaine telle que
vécue par les habitants des quartiers centraux et que
reflète en bonne partie la position des gestionnaires
publics locaux. Au cours des années
1880, certaines associations qui représentent des groupes
de citoyens préoccupés par les problèmes
d’aménagement, de transport et de communication
s’inquiètent de ce que la municipalité
n’ait aucun pouvoir juridique pour contrôler le
développement du réseau téléphonique.
Elles réclament notamment une réglementation
plus stricte de l’insertion physique des équipements
téléphoniques. C’est le cas de la Chambre
de commerce qui affirme, en 1889, que les poteaux et les fils
« gênent le commerce et la circulation publique».
Ainsi, les représentants de cette association demandent-ils
aux membres du Comité des chemins et au Département
en Loi de la Cité de Montréal de prévoir,
dans la charte de la Ville, de nouvelles dispositions obligeant
les entreprises de services publics à enfouir leurs
équipements. L’année suivante, un amendement
à la Charte de la Cité de Montréal autorise,
du moins théoriquement, l’administration municipale
à intervenir et à encadrer l’action des
opérateurs privés . En 1890, l’année où la
Ville se voit dotée de nouveaux pouvoirs juridiques
lui permettant d’obliger les compagnies à enfouir
leurs équipements, Bell obtient la permission d’installer
un conduit souterrain rue Sainte-Catherine, entre les rues
de la Montagne et Saint-Christophe4. Les années suivantes,
une bonne partie des équipements de Bell localisés
dans le quartier des affaires et dans le quartier Saint-Antoine
(nommé aussi secteur Uptown) sont enterrés grâce
à cette disposition. En 1891, le premier
tronçon des travaux d’enfouissement de Bell est
terminé6. Toutefois, les nouvelles dispositions normatives
municipales autorisant la construction du réseau téléphonique
ne sont guère plus restrictives qu’auparavant.
Dans plusieurs quartiers centraux, les innombrables poteaux
plantés sur le trottoir et l’enchevêtrement
de fils qui obstruent l’espace aérien offrent
un aspect aussi chaotique. L’opinion rendue par les avocats de la
Ville à la suite du rapport préparé par
l’expert étatsunien illustre l’état
d’impuissance dans lequel se trouve l’administration
municipale. Afin d’y pallier, on suggère d’introduire
un nouveau règlement municipal qui ferait en sorte
que la Ville puisse exercer elle-même
les prérogatives qui lui sont garanties par sa Charte,
à savoir : le droit de forcer toutes personnes, compagnies
ou corporations possédant des franchises ou ayant des
droits acquis dans les rues de Montréal, de placer
sous terre Leurs tuyaux, conduits et fils conducteurs. Malgré les objections des entreprises
privées, le Conseil municipal adopte en octobre 1905
le règlement no 343 « relatif à l’enlèvement
des poteaux et à l’enfouissement des fils ».
Selon ce règlement, il est désormais interdit
de poser des poteaux et de suspendre
des fils conducteurs le long ou à travers aucune rue,
allée et place publique dans la Cité de Montréal.
Tous les poteaux déjà érigés et
les fils conducteurs déjà suspendus devront
être enlevés, et lesdits fils conducteurs devront
être placés dans des conduites souterraines.
Évoquée dès la toute fin des années 1870 lors de l’introduction du téléphone, la question du contrôle des rues en rapport avec les infrastructures est à nouveau soulevée en 1905. Cela survient lors d’une Commission parlementaire spéciale mise sur pied pour examiner l’industrie du téléphone au Canada, la Commission Mulock. Le sentiment d’insatisfaction face au service exprimé par les municipalités locales atteint alors un point culminant, et ce, à l’échelle du pays. Ce mouvement d’opposition incite le gouvernement canadien à considérer de plus près la question. Au cours de cette même année, le Parlement canadien reçoit une pétition de 195 municipalités et comtés dans laquelle les signataires demandent que les compagnies de téléphone soient soumises à la juridiction municipale afin que les administrations locales puissent contrôler l’installation des poteaux et des câbles. L’Union des municipalités canadiennes, récemment constituée, envoie une pétition exigeant que le service téléphonique soit distribué par l’État puisque, selon ses représentants, le service téléphonique est devenu un élément indispensable au bien-être socioéconomique des citoyens. Formée sous
le gouvernement Laurier et dirigée par Sir William
Mulock, alors en charge des services postaux canadiens, cette
Commission parlementaire a pour mandat de formuler des recommandations
relatives à la tarification et à la réglementation
du service téléphonique. Dans les transcriptions
des audiences tenues devant les commissaires, les enjeux que
représente le téléphone pour les municipalités
ressortent clairement. Les retombées
de la Commission parlementaire ne jouent pas en faveur des
municipalités. Sa seule décision majeure concerne
la surveillance de la tarification du service téléphonique.
Désormais, c’est la Commission des chemins de
fer qui assumera cette tâche. À partir de 1906,
les tarifs du service commencent à être soumis
à l’approbation de cette Commission qui doit veiller
à réduire les écarts entre les tarifs
à l’échelle canadienne. C’est dire
qu’à chaque fois que Bell voudra réviser
ses tarifs, ses dirigeants devront dorénavant se présenter
devant la Commission des chemins de fer pour justifier leur
hausse. L’entreprise devra alors fournir des rapports
détaillés de ses activités financières
et prouver que ses demandes sont raisonnables. En d’autres
termes, la compagnie devra démontrer que les demandes
de hausse tarifaire n’ont pas pour seul but de favoriser
les actionnaires. Les nouvelles dispositions adoptées
obligent aussi Bell à se soumettre à la réglementation
municipale, à condition toutefois que les responsables
locaux ne retardent pas intentionnellement la pose de nouvelles
lignes. En 1908, au retour d’un voyage en Europe où il a été très impressionné par les rues dégagées de la capitale française, le maire Louis Payette (en poste de 1908 à 1910) met sur pied une nouvelle Commission spéciale qui se penche sur les conduits souterrains. C’est qu’au cours de l’année précédente, un rapport présenté en juin par la Canadian Fire Underwriters Association a démontré la nécessité d’enfouir les équipements électriques compte tenu des dangers d’incendie qu’ils représentent. Selon ce rapport, Montréal serait l’un des pires exemples d’encombrement dû à la trop grande quantité de fils et de poteaux, ce qui augmenterait d’autant les risques d’incendie provoqués par les courts-circuits. À l’instar de la Commission municipale
des conduits souterrains de 1903 dont la retombée est,
comme on l’a vu, une réglementation locale non
respectée, la nouvelle Commission a pour mandat de
mettre en place les moyens nécessaires pour procéder
à l’élimination des poteaux et des fils
qui défigurent le paysage urbain. L’idée
est similaire à celle du projet précédent
: à l’aide d’un prêt 5 millions de
dollars amorti sur une période de 40 ans et consenti
par le gouvernement provincial, la Ville veut construire un
réseau de conduits destiné à accueillir
tous les fils électriques, télégraphiques
et téléphoniques de la métropole. Les
entreprises seraient obligées d’y installer leurs
équipements et de verser des redevances à la
Ville. On le voit bien, c’est par rapport à
l’enjeu général de la domanialité
et à l’enjeu spécifique de la construction
de mécanismes de conciliation des intérêts
publics et des intérêts privés que les
acteurs locaux abordent la question du service téléphonique.
S’appuyant, d’une part, sur une certaine conception
du pouvoir local et faisant appel, d’autre part, à
une vision volontariste de la gestion de la ville, l’administration
municipale propose plusieurs projets dont l’objectif
premier est d’encadrer les formes du développement
urbain. En 1911, la Ville veut
à nouveau régler une fois pour toutes la question
des poteaux et des fils. James John Edmund Guerin, un réformiste
anglophone, occupe alors le poste de maire. Le Bureau des
commissaires demande au Conseil municipal de voter en faveur
des dépenses encourues par la mise sur pied d’une
nouvelle Commission — celle des services électriques
de la Ville de Montréal — chargée de préparer
un autre plan d’enfouissement des fils. Dans le quotidien
La Presse, on peut lire ce commentaire quant aux espoirs que
suscite l’annonce de la création de cette Commission
: « Nous pouvons enfin espérer que Montréal
verra disparaître les nombreux fils électriques
qui forment un dangereux réseau au-dessus de la tête
des citoyens dans presque toutes les rues de la ville. »
Au même moment, d’autres titres d’articles
de journaux annoncent la disparition des fils, tout au moins
le long de certaines artères du centre-ville. Ce projet
de 1911 aura pourtant un succès mitigé puisque
certaines entreprises concernées, notamment Bell, ne
jugent pas bon d’y installer leurs équipements. Bien avant que la Ville
de Montréal élabore des plans en vue d’exercer
un certain contrôle sur la prolifération des
poteaux et des fils téléphoniques, d’autres
municipalités de l’île sont parvenues assez
tôt à mettre en oeuvre des plans d’enfouissement.
Ainsi, des municipalités de la proche banlieue, comme
Outremont et Westmount, ont « pris l’initiative
» ; elles ont été « les premières
villes à donner l’exemple». Le succès
de ces opérations de construction de conduits souterrains
qui accueillent les fils de téléphone, d’électricité
et de transport en commun trahit manifestement la présence
d’une communauté plus homogène quant à
sa composition sociale et à ses intérêts.
Ses membres sont certes plus favorables aux activités
des entreprises privées puisqu’ils sont non seulement
des abonnés aux services, mais surtout des actionnaires
des compagnies qui les distribuent. En somme, dans ce contexte,
l’existence d’intérêts communs représente
des conditions favorables pour l’extension des réseaux
(droits de passage sur les propriétés privées
plus aisément obtenus, collaboration des entreprises
privées, marge de manoeuvre financière plus
grande de la part des administrations municipales, etc.).
De plus, les opérateurs des réseaux partagent
la même vision de la ville que celle à laquelle
adhèrent les citoyens et les élus : un espace
où le confort moderne est diffusé d’une
manière sûre, efficace, discrète et invisible. Au tournant du XXe siècle, le service téléphonique semble envahir littéralement le paysage urbain. Mais avec les années, ces équipements s’intègrent peu à peu à la réalité quotidienne des citadins. On s’y habitue. Les poteaux et les fils demeurent omniprésents, mais on ne les perçoit plus comme des éléments gênants. Il n’en reste pas moins que l’introduction de nouveaux équipements suscite encore des réactions négatives de la part des autorités municipales. 1910 les fils envahissent les rues |
Poste Northern 317AH  Table à 165 lignes
Table à 165 lignes  293A à batterie centrale
293A à batterie centrale 
sommaire
En 1910, l’abonnement au téléphone est un peu
plus répandu, bien que toujours lié à la richesse
et au statut professionnel. Quelques années plus tard, les
mêmes tendances persistent. C’est ce que démontre
une étude intitulée Zanesville and 39 other American
Communities (A Study of Markets and of the Telephone as a Market
Index), commanditée en 1927 par le périodique The
Literary Digest9. Portant sur les pratiques de consommation téléphonique
dans les familles étatsuniennes, cet ouvrage vise à
distinguer les différentes catégories d’abonnés
ainsi que leur pouvoir d’achat. Les auteurs de l’étude
concluent que l’individu le plus susceptible d’avoir un
téléphone chez lui a atteint un certain niveau de
revenus et appartient aux groupes suivants : dirigeants d’entreprise,
professionnels, négociants, cadres.
La capacité d’assimiler la technologie du téléphone
dépend donc du statut social élevé des ménages
qui leur permet d’acquérir plus rapidement les nouveaux
services. En fait, il n’y a là rien d’étonnant.
D’autant plus que l’on peut ramener ces constats à
des questions de revenus : les plus nantis consomment d’abord
les services et les produits les plus récents. Bref, le taux
de pénétration du téléphone dépend
des goûts et des caractéristiques des consommateurs
et non pas seulement de l’offre.
Dans une étude sur la diffusion sociale du téléphone
au centre du Canada et plus particulièrement à Kingston
en Ontario, Robert Pike10 estime que les consommateurs optent pour
le service car ils apprécient les avantages de la communication
bidirectionnelle et instantanée. De plus, selon lui, il faut
aussi tenir compte des motivations moins tangibles comme le prestige
et l’attrait que représente l’utilisation d’un
instrument moderne et novateur. Ainsi, le choix d’avoir recours
au nouveau service est-il aussi commandé par le désir
de se distinguer.
En ce qui a trait à la clientèle d’affaires à
Montréal, au début du siècle, ce sont surtout
les commerçants, les manufacturiers et les institutions financières
qui profitent du service. Lors des premières années
de la diffusion du service, ses principaux clients sont les manufactures
et les commerces, les entreprises qui œuvrent dans les transports
et les communications (compagnies ferroviaires et maritimes, taxis,
journaux), les services financiers, (banques, bourse, maisons de
courtage) et les services professionnels (architectes, notaires,
avocats). Même si le téléphone peut être
à l’occasion un objet de consommation ostentatoire,
on peut faire l’hypothèse qu’à l’instar
des abonnés à Kingston, c’est surtout pour des
raisons instrumentales que la plupart des abonnés d’affaires
montréalais retiennent le service offert par les entreprises
de téléphone.
Avant 1900, l’abonnement au téléphone demeure
un phénomène marginal dans les ménages. Cependant,
il représente un atout certain pour les gens d’affaires,
puisqu’il leur permet de communiquer depuis leur domicile avec
leur lieu de travail ou encore avec des clients. Cette situation
est relativement fréquente en 1880.
Lors de son introduction et jusqu’à
la fin des années 1900, le téléphone est donc
utilisé par une clientèle commerciale et d’affaires
de la ville-centre. En fait, au tout début, les clients les
plus importants sont ceux du service télégraphique.
À Montréal, la localisation centrale est aussi une
variable déterminante. En effet, les avantages intra-urbains
des communications téléphoniques demeurent nombreux
(tarifs fixes, possibilité de joindre un grand nombre d’abonnés,
rapidité du service, etc.)
Les premières années de l’histoire de l’usage
du téléphone sont marquées par la prédominance
des industriels, des commerçants et des professionnels. La
communauté des financiers et des banquiers est aussi très
intéressée par le nouvel outil de communication à
distance. De manière générale, de 1900 à
1910, la consommation du téléphone dans l’agglomération
montréalaise donne une certaine image de l’attrait pour
cette nouvelle technologie. Un des traits les plus frappants est
l’importante progression du service.
La décennie suivante — entre 1910 et
1920 — présente des conditions différentes. Par
rapport au dynamisme de l’urbanisation, on constate que la
consommation du téléphone évolue moins vite.
C’est que les années de guerre ont eu des effets sur
l’offre du service. De plus, aux lendemains de la Première
Guerre mondiale, l’essor du téléphone urbain
atteint une ampleur que les dirigeants et les ingénieurs
de Bell n’avaient pas prévue correctement. On est ici
en présence d’une situation particulière : Bell
n’arrive pas à combler la demande. Elle est en quelque
sorte victime de la popularité du service qu’elle offre.
Et dans certains secteurs de l’agglomération qui ont
connu une croissance démographique forte, la demande pour
les connexions surpasse la capacité de commutation —
tâche effectuée par les standardistes. Compte tenu
du nombre impressionnant de lignes qu’elles contrôlent,
il leur devient de plus en plus difficile d’acheminer tous
les appels. Ce qui nuit à la qualité du service.
Le 14 fevrier 1916, le Canada celebre en grande pompe la premiere
communication telephonique transcontinentale entre Montreal et Vancouver.
La voix a vaincu la distance et le telephone, des lors, a definitivement
relegue le telegraphe au second plan dans les telecommunications
modernes. Entre ces deux bornes, notre these couvrira done pres
de sept decennies d'histoire institutionnelle et technologique.
L’automatisation s’avère un moyen efficace
pour surmonter ces problèmes.
Ainsi, dans la seconde moitié des années 1920, la
mise en place des commutateurs automatiques se traduit-elle par
une hausse importante des abonnés résidentiels dans
certains quartiers suburbains. En même temps, le service est
de plus en plus répandu auprès de la classe moyenne.
La dernière décennie (1920-1930) est
marquée par la poursuite de la progression des abonnements.
Toutefois, au cours de la dernière année recensée,
un certain ralentissement commence à se manifester. Cette
baisse est due à la crise économique de 1929. Bien
que la période retenue ne nous permette pas de mesurer avec
précision l’importance du phénomène, des
études postérieures démontrent que le taux
de pénétration du service téléphonique
atteint seulement après la Seconde Guerre mondiale un niveau
comparable au plus fort taux, celui de la fin des années
1920.
La commutation automatique et l'introduction
des postes téléphoniques à cadran
La technologie de commutation automatique
est introduite aux États-Unis et en Europe dès les
années 1900.
- Dans les années 1890, le tout premier système
de commutation téléphonique automatique d'Almon
Strowger devenait de plus en plus connu, et il devenait
évident que la commutation automatique allait être
indispensable pour répondre au volume d'appels en évolution
dans le monde entier.
Dans un contexte de succès précoce aux États-Unis
du ststème Strowger, il était inévitable que
les administrations d'exploitation téléphonique d'autres
pays s'intéressent aux avantages de l'équipement Strowger
Automatic. Le système a fait sa première apparition
à l'étranger à Londres en 1898 - un standard
d'exposition d'une capacité de 200 lignes. Un an plus tard,
la poste allemande a acheté un système de 400 lignes
qu'elle a installé pour le service public à Berlin.
Ces deux installations ont été les premiers précurseurs
de la pénétration mondiale qui allait bientôt
se produire.
Le Canada, Cuba et l'Australie ont été parmi les premiers
pays à reconnaître les multiples avantages du système
Strowger et à l'adopter à grande échelle.
Au Canada, une tentative fut faite de fabriquer à Montréal
des commutateurs Strowger.
Une compagnie au nom de Automatic Telephone
and Electric Cie of Canada émit en 1893 des prospectus
financiers à l'intention de ses futurs actionnaires qui portaient
le sous titre ambitieux "Survival of the first".
Les aprentis darwainistes instalérent la même année
quelques commutateurs à Terrebonne au Québec ainsi
qu'à London, Seaforth, Mitchel et Arnprior en Ontario, puis
à Woodstock au Nouveau-Brunswick.
Ces experiences furent de courte durée à cause de
l'amateurisme des compagnies exploitatntes. En 1908, àTerrebonne
par exemple le système Strowger fonctionna jusqy'à
la première pluie, la mauvaise isolation des fils aériens
provoqua un court circuit qui endommagea les batteries du central
!!!
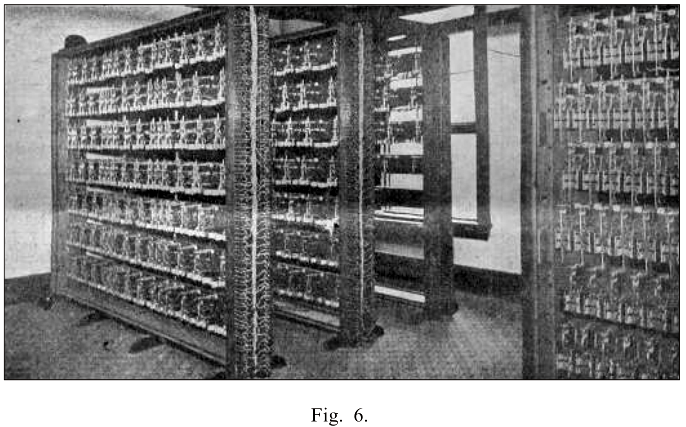 Système
Strowger
Système
Strowger
La photo montre l'utilisation de l'appareil dans un bureau ; les
appareils de commutation sont placés sur des étagères
où ils sont accessibles de tous les côtés. L'aménagement
prend ainsi peu de place, même pour les grands bureaux.
Le premier central automatique à fonctionner de façon
permanente fut celui de Whitehouse dans le Yukon, la ruée
vers l'or avait attiré dans le grand nord John Wyley, un
ancien employé de Stowger à Chicago. Il fonda la Yukon
Electric Compagny en 1901, puis il fit de même
à Saskatoon.
- D'autres inventeurs se mettent au travail avec
plus ou moins de succès comme Romaine
Callender, qui appartient à l'entourage de
Bell et qui a breveté divers commutateurs automatiques entre
1892 et 1896 avec 3 series de brevets. les premières expériences
réussies se passe à New-York en 1895 avec des modèles
en bois désignés : Brandford Exchange ou de
Callender Exchange.
 Callender l'inventeur de Brandford
Callender l'inventeur de Brandford
Callender quite le Canada en 1896 pour en Angleterre
fonder la Callender Rapid Telephone Compagny
Son système a finalement échoué, mais il a
inspiré deux de ses jeunes employés, George
et James Lorimer, à poursuivre les expériences.
Après des difficultés financières, lls fondent
leur propre entreprise, la Canadian Machine
Telephone, en 1897 à Peterborough,
en Ontario.
Leur premier essai était le développement
du système Callender Exchange . Il a été
installé à Troy, Ohio en 1897.
Les faiblesses du système Callender étaient évidentes,
les trois frères l'ont revisé au point qu'il ressemblait
vaguement au concept original.
En avril 1900, ils font breveter le système et se
sentent prêts à le commercialiser. Ils transformèrent
leur petit atelier dans la ville voisine de Piqua en un atelier
de production sous le nom de American Machine Telephone.
Brevets des frères Lorimer 1020211 et 1294285
et 1294285 

 Système Lorimer
Système Lorimer
Un commutateur de plusieurs centaines de lignes fut exposé
à Ottawa pendant deux mois,F.Dagger rédigea un rapport
à l'intention de l'hotel de ville de Torronto recommandant
un essai dans l'espoir de recevoir un contrat municipal. Hélas
la ville abandona le projet.
Des commutateurs furent installés à Peterborough ou
était installée l'usine de fabrication et à
Bratford ou se trouvait l'ancien établissement Callender.
En 1908 ils intallèrent d'autres systèmes à
Burford, Saint-George et Lindsay, toujours en Ontario mais ne firent
aucune vente aux Etats+-Unis.
En 1906, Edmonton Telephones avait passé une commande Lorimer,
mais elle ne parvint pas à en prendre livraison, l'entreprise
étant incapable de livrer un modèle adapté
aux besoins du client. Après deux ans d'attente, la municipalité
se rallia à l solution Strowgze , Automatic Electric obtint
le contrat et installa le central en deux mois. Devant le professionalismede
Strowger les frères Lorimer faisaient figure d'amateurs.
Désormais, les téléphonistes ne
sont plus indispensables pour acheminer les communications locales.
Dans les journaux de l'époque on annonce : " L'abonné
pourra se dispenser des opératrices ".
Il faudra attendre la nationalisationd= du téléphone
dans les les trois provinces des Prairies, soit 1908-09 pour que la
commutation automatique arrive à maturité au Canada.
1901 Nous devons garder en mémoire, que
l’émission d’amateur a débuté au Canada
dès l’origine de la T.S.F., faisant suite aux essais de
Guglielmo MARCONI entre la station de Poldhu, en Angleterre, et celle
de Signal Hill à Terre-Neuve..
« C’est à Signal Hill, que le 12 décembre
1901, Guglielmo MARCONI reçut le premier signal transatlantique
sans fil. Il s’agissait simplement des trois points de la lettre
« S » en morse, envoyés depuis Poldhu, en Angleterre,
à 3 500 km de distance. L’exploit de MARCONI montra les
possibilités inouïes de son système de communication
sans fil et inaugura l’ère des télécommunications
modernes à travers le monde… »
En 1913 la première pelletée de terre a été soulevée pour la construction de l'édifice voué à devenir le plus grand de sa catégorie dans tout l'Empire britannique. L'Usine de la rue Shearer 1920 -1940 Montréal
| Il a ouvert ses portes
en 1915 pour accueillir l'usine de fabrication de la Imperial
Wire and Cable suivant sa fusion avec la Northern Electric.
Au fil des ans les ateliers situés à l'usine de Guy et Notre-Dame y ont été déménagés. Sa superficie a atteint près d'un million de pieds carrés après les agrandissements en 1926, 1929 et 1930.  Il
est constitué de six ailes de huit étages et dix
d'un ou deux étages. Il a été construit
pour durer, il repose sur 5 151 piliers et possède 11
millions de briques. Il n'y a que le revêtement en bois
franc des planchers qui soit combustible. Les portes coupe-feu
pour accéder aux escaliers sont composées d'une
plaque d'acier d'un quart de pouce renforcé de cornières
de deux pouces sur son périmètre et de trois diagonales. Il
est constitué de six ailes de huit étages et dix
d'un ou deux étages. Il a été construit
pour durer, il repose sur 5 151 piliers et possède 11
millions de briques. Il n'y a que le revêtement en bois
franc des planchers qui soit combustible. Les portes coupe-feu
pour accéder aux escaliers sont composées d'une
plaque d'acier d'un quart de pouce renforcé de cornières
de deux pouces sur son périmètre et de trois diagonales. |
Des turbines actionnées à la vapeur à haute pression généraient l'électricité du complexe jusqu'en 1930, la vapeur à la sortie des turbines servait au chauffage. L'entretien de l'édifice était hors pair, l'auteur se rappelle pendant une panne électrique le lancement de la génératrice d'urgence en moins de 20 secondes pour fournir le courant d'urgence. L'immeuble abritait une grande variété de machinerie utilisée pour fabriquer pratiquement tous les composants nécessaires pour produire le matériel et les équipements téléphoniques. On y fabriquait des fils petits comme de cheveux jusqu'à de gros câbles électriques de six pouces de diamètre. Toutes les variétés de vis étaient usinés, les pièces de métal y étaient formées par des presses pour être ensuite usinées et plaquées, son atelier de placage était le plus important de Montréal. Une énorme quantité de munitions et du matériel de communication ont été fabriqués pendant les Première et Deuxième Guerres mondiales. Plus de 9 000 employés y travaillaient pendant les années 1940 pour répondre à l'effort de la guerre. L'usine de la rue Shearer était connue comme la maison-mère parce que c'est d'elle qu'essaima le personnel qui a démarré les autres établissements de la compagnie au Canada et ailleurs dans le monde. Northern Electric, Northern Telecom et enfin Nortel a occupé plus de 50 immeubles uniquement dans la région de Montréal. |
sommaire
Entre 1880 et les années
1920, les standardistes remplissent un rôle indispensable
dans les communications téléphoniques locales.
En 1907, 400 téléphonistes font la grève à
Toronto pour obtenir de meilleures conditions de travail.

Annonce publicitaire L'empressement à Satisfaire
La technologie des communications a continué
de progresser rapidement dans les années 1920, et les publicités
de Bell sont restées axées sur l'éducation
du public sur les dernières innovations, y compris les services
interurbains et commutés. M. Neill, du service commercial
de Bell, a déclaré: «Nous devons informer les
gens sur notre entreprise et leur faire savoir le rôle clé
que nous jouons dans la vie de la communauté. Nous devons
continuer à faire de la publicité pour enseigner la
valeur du service téléphonique ». Une nouvelle
campagne avec le slogan : « Plus vous en savez sur le téléphone,
mieux il vous servira » visait à éclairer les
gens sur la complexité du système téléphonique
et à demander également la coopération du public
pour assurer un service de qualité. En plus des journaux,
Bell a commencé à faire de la publicité dans
d'autres formats, y compris des affichages dans des magasins importants.
Bell a également ouvert nos bureaux au public dans le cadre
de la « Semaine du téléphone », organisant
des événements spéciaux dans plusieurs villes.

Au cours des années 1920, la popularité croissante
du service interurbain a conduit à plusieurs nouvelles opportunités
publicitaires. C.E. Fortier, le directeur de la publicité
de Bell à l'époque, a écrit : « L'entreprise
envisage de tirer parti de tous les moyens disponibles pour faire
de la publicité pour le téléphone en tant que
serviteur du public, et le service interurbain est un domaine qui
n'a pas encore fait ses preuves. D'importantes campagnes publicitaires
ont été lancées pour mettre en valeur le service
interurbain de Bell. Bien que la première campagne d'envergure
s'adressait au grand public, l'entreprise a par la suite adopté
une approche spécifique s'adressant aux gens d'affaires de
diverses industries.

Les publicités de l'époque posaient la question :
pourquoi n'avoir qu'un seul téléphone chez soi quand
on peut en avoir un autre dans la cuisine ou dans la chambre à
un prix abordable ? – avec le message que monter et descendre
les escaliers en courant peut être "épuisant et
chronophage". À Noël 1921, Bell a lancé
sa première campagne axée sur la commodité
des postes téléphoniques supplémentaires -
des téléphones supplémentaires câblés
sur la même ligne téléphonique.
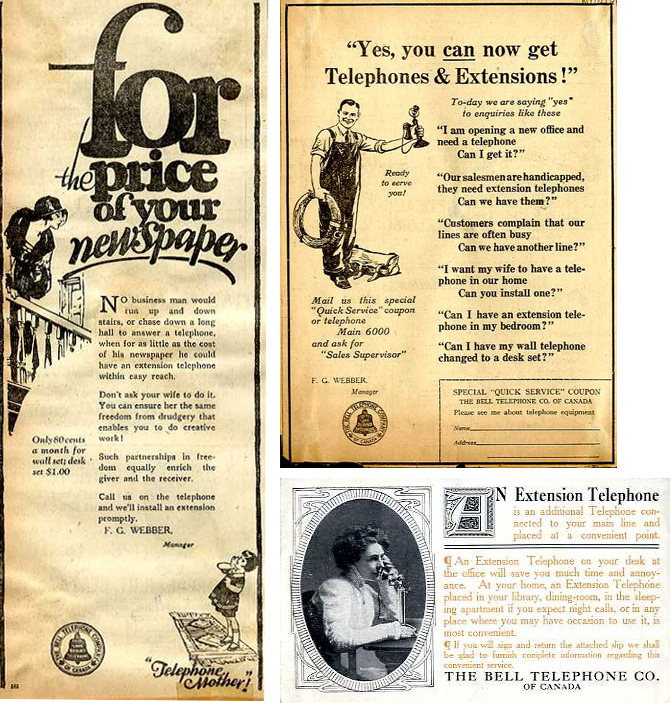
La décennie a également marqué
un tournant majeur dans l'histoire technologique de Bell avec l'introduction
du service commuté, officiellement lancé le 19 juillet
1924 au bureau de Bell Grover à Toronto. Passer d'un système
manuel à un système de numérotation était
un changement radical pour le public à l'époque, nécessitant
de vastes campagnes de publicité et de relations publiques
pour faire passer le mot, y compris des didacticiels publics et
des publicités imprimées. À la fin de 1926,
Bell avait 6 centraux téléphoniques en service, desservant
60 000 clients.

Au début des années 1920, les téléphonistes
de Bell du Québec et de l'Ontario recevaient environ 140
000 appels « à l'heure de la journée »
- tous les jours ! À partir de février 1923, des publicités
sont nécessaires pour informer les abonnés qu'ils
ne peuvent plus appeler un central de Bell pour demander l'heure,
car c'est « encombrant pour nos opérateurs et préjudiciable
au service » des autres clients. Quelques années plus
tard, pour accélérer les appels locaux, il a également
été décidé que les opérateurs
ne devaient plus répéter le numéro que leur
avait fourni l'abonné, mais plutôt accuser réception
de l'information par un court « merci ».

Pour les abonnés, les téléphonistes
ou standardistes personnifient à la fois les entreprises
de téléphone et le service. Tandis que le service
télégraphique nécessitant certaines connaissances
techniques est assuré par de jeunes hommes, le service téléphonique
est défini comme un emploi féminin. Pourquoi les entreprises
préfèrent-elles engager des femmes comme téléphonistes
? À cette époque, différentes raisons sont
avancées : " clarté de la voix ", "
politesse ", " patience ", " acuité visuelle
". En bref, des qualités et des aptitudes considérées
par les dirigeants des entreprises téléphoniques comme
propres aux femmes. Plusieurs jeunes femmes issues de la classe
ouvrière sont engagées comme téléphonistes,
ce qui constitue pour elles un avancement social.
Les entreprises de téléphone préfèrent
engager des jeunes filles célibataires. En 1907, à
Toronto, leur salaire est de 25 dollars par mois pour des semaines
de travail de 48 heures (les téléphonistes travaillent
six jours par semaine)
Le métier de téléphoniste
est très exigeant. Obligée de preuve d'une concentration
et d'une politesse à toute épreuve, la téléphoniste
doit en outre porter un lourd casque d'écoute, accomplir
des gestes répétitifs et redire des phrases apprises
par coeur durant sa journée de travail marquée par
une cadence effrénée aux heures de pointe.
sommaire
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la forte demande
pour le téléphone force les entreprises à adopter
cette nouvelle technologie.
Dans les années 1920, les changements technologiques touchant
la téléphonie locale transforment les procédures
à suivre.
Avec les nouveaux centraux automatiques, l'abonné utilise
un appareil à cadran qui effectue le travail de recherche
de l'interlocuteur qu'il désire joindre.
 modèle 51AL
modèle 51AL  modèle 20B
modèle 20B
À l'été de 1924, les premiers commutateurs
automatiques Strowger
sur le territoire desservi par Bell sont mis en service au central
Grover à Toronto.
Les premiers centraux téléphoniques manuels de Toronto
étaient reconnus par un nom de central et un bloc de numéros
de ligne à quatre chiffres. Le « GRover exchange »
à Kingston Road et Main Street à East Toronto est
devenu le premier central téléphonique automatique
canadien en 1924.
L'avènement de cette nouvelle technologie fait l'objet d'une
campagne d'éducation car les utilisateurs doivent apprendre
à se familiariser avec la composition et le téléphone
à cadran. Les numéros étaient composés
de deux lettres et quatre chiffres (2L+4N). Grover 1234 a été
composé GR-1234 (ou 47-1234).
 23, rue Main, juste au nord de Kingston Road. Le Bell Telephone
of Canada Grover Exchange Building, site du premier central téléphonique
automatique du Canada. juillet 1924
23, rue Main, juste au nord de Kingston Road. Le Bell Telephone
of Canada Grover Exchange Building, site du premier central téléphonique
automatique du Canada. juillet 1924
19 juillet 1924 Le service Dial est inauguré à
Toronto, en Ontario. Les représentants de Bell Canada appellent
les clients pour les aviser du changement; d'autres rencontrent
des membres de la communauté pour leur enseigner le bon usage
du cadran. Les opérateurs sont également formés
à l'utilisation de la nouvelle technologie.

A Bell representative demonstrates dial service to Toronto
firemen, ON, 1924
Avec l’automatisation, on assiste à
un mouvement de centralisation : il apparaît avantageux sur
le plan économique de regrouper plusieurs unités de
commutation, soit environ 10 000 lignes. Inauguré en
1925, le central automatique Strowger
de Montréal qui respecte ces nouveaux critères
d’aménagement est le Lancaster. Suivront les villes
de Vancouver, Toronto et Winnipeg ...
Plis tard, pour faciliter la demande mondiale importante et croissante
d'équipements téléphoniques Strowger Automatic,
il a été créé sous la direction de l'organisation
mère Automatic Electric à Chicago, un groupe d'entreprises
de fabrication affiliées avec des usines au Canada, en Belgique
et en Italie.
sommaire
L'Association du téléphone du Canada
est créée en 1920. Elle est remplacée par le
Réseau téléphonique transcanadien en 1931,
puis par l'Alliance Stantor en 1992.
1927 Création de Québec-Téléphone,
ses clients sont parmi les tout premiers au Canada à avoir
accès au service téléphonique via des lignes
individuelles uniquement.
3 octobre 1927 Inauguration du service téléphonique
commercial transatlantique par les premiers ministres W.L. Mackenzie
King (Canada) et Stanley Baldwin (Grande-Bretagne).
1928 Premier appel interurbain entre l'Alberta et l'outre-mer.
Années 1920 et 1930 SaskTel a continué d'améliorer
ses services tout au long des années 1920 et 1930, devenant
l'un des membres fondateurs du réseau téléphonique
national TransCanada (TCTS), qui a ensuite changé son nom
pour Telecom Canada et est maintenant connu sous le nom de Stentor.
31 juillet 1932 Le gouverneur général du Canada,
le comte de Bessborough, inaugure le réseau téléphonique
transcanadien (TCTS), offrant un service téléphonique
d'un océan à l'autre sur toutes les lignes canadiennes.
26 avril 1945 Bell Canada installe son millionième
téléphone, soixante-cinq ans après sa constitution
en société. .
Après la guerre 39 45, à cause
des restrictions imposées par celle-ci, les demandes de service
téléphonique étaient énormes.
Northern Electric répondit à la demande en produisant
de plus en plus de câbles. Le volume était tellement
grand que la capacité de fabrication ne suffisait plus, alors
une nouvelle usine a été construite à Lachine
dans la banlieue de Montréal.
Cette usine fabriqua des millions de pieds de câble pour remplir
toutes les commandes.
L'isolateur au papier enroulait lâchement
l'isolant sur les fils avant qu'ils soient torsadés en paires.
Les paires devaient être torsadées pour empêcher
la diaphonie, c'est-à-dire l'induction d'une conversation
téléphonique d'une paire à une autre.
Le papier a servi comme isolant depuis le début de la fabrication
des câbles, malgré qu'il ait été essentiellement
déplacé par la pulpe de papier et le plastique il
sert encore pour les câbles sous-marins.
Aux lendemains de la Première Guerre mondiale,
le taux de croissance des abonnements au téléphone
atteint de nouveaux sommets.
D’après les statistiques internationales compilées
chaque année par AT&T, le marché montréalais
de la téléphonie se classe en 1929 au 12e rang à
l’échelle mondiale. Le taux de pénétration
y est toutefois moindre que dans l’autre grande ville canadienne,
Toronto. Alors qu’on retrouve à Toronto 27,5 téléphones
pour 100 habitants, Montréal n’en compte que 18,9. Cet
écart est sans doute le reflet des différences de
niveaux de richesse prévalant dans les deux agglomérations.
Il témoigne également de la différence dans
la taille des ménages, les familles montréalaises
étant composées de plus d’individus.
Malgré cet écart, il n’en demeure
pas moins qu’à l’échelle internationale,
Montréal n’est pas en retard par rapport à un
échantillon de grandes villes. En 1929, les villes étatsuniennes
ont pris une avance très importante sur les principales métropoles
européennes. Stockholm constitue toutefois une exception.
On peut noter que Montréal évolue plus ou moins en
parallèle avec des villes de pays nordiques, comme Copenhague
et Oslo. Quant aux métropoles européennes, comme Paris,
Berlin, Londres, Amsterdam et Glasgow, la diffusion du téléphone
y est beaucoup plus faible. Cette progression différentielle
du taux d’abonnement selon les pays fait appel à divers
facteurs. Aux États-Unis, les dirigeants d’AT&T
insistent sur la corrélation forte entre le niveau d’abonnement
et la gestion privée du service téléphonique.
On peut aussi mentionner comme éléments-clés
de la rapide progression du service en Amérique du Nord,
la capacité des entreprises à combler rapidement la
demande croissante, de même que l’établissement,
dès le départ, du principe du nombre illimité
d’appels locaux à tarifs fixes, même si ce coût
est resté relativement élevé.
En réalité, il est difficile de s’en remettre
à un seul facteur pour expliquer l’implantation et le
développement du service téléphonique dans
certains milieux urbains. Outre des obstacles de nature institutionnelle
et juridique mis en évidence par plusieurs chercheurs —
en particulier dans le cas français—, des conditions
sociales et économiques permettent de comprendre le retard
de l’Europe sur les États-Unis. À cet égard,
certains ont souligné le caractère particulier de
l’urbanisation et de l’industrialisation. Ces processus
sont perçus de manière différente des deux
côtés de l’Atlantique. Ils sont aussi fortement
marqués par des différences nationales.
Compte tenu de sa position privilégiée
à l’intérieur de l’organisation industrielle
nord-américaine, la ville de Montréal — en particulier
son cœur financier et industriel —, illustre la réussite
d’un programme d’implantation d’infrastructures téléphoniques.
Si la vitalité économique a stimulé la demande
sociale et le marché de la téléphonie, le cadre
politico-institutionnel a aussi joué un rôle important.
En effet, pour un opérateur de réseau, il est indispensable
d’avoir l’accord de la municipalité pour obtenir
des droits de passage et utiliser les voies publiques. C’est
dire que des conditions favorables aux projets d’équipement
doivent être en place pour l’implantation du réseau.
L’étude des marchés et de l’adoption
progressive du service dans la sphère privée et dans
les sphères professionnelles et marchandes éclaire
peu sur les conceptions, les images et les modes d’appréhension
de la réalité que suscite la téléphonie
urbaine entre 1880 et 1930.
Afin de comprendre la culture téléphonique véhiculée
et diffusée au cours de cette période, il importe
de considérer de plus près les thèmes consacrés
à l’un des principaux domaines où la téléphonie
est parvenue à s’imposer et qui retenait déjà
l’attention par son caractère inédit et prometteur
: la ville réticulée.
28 juin 1947 Bell Canada lance le premier
service de téléphonie mobile commercial au Canada.
Le Toronto Globe & Mail est le premier abonné à
profiter de l'offre de service pour une couverture rapide sur place
des événements d'actualité.
19 janvier 1953 Bell Canada fournit la première liaison
télévisuelle permanente entre deux pays pour acheminer
des programmes américains de Buffalo, New York, à
la Canadian Broadcasting Corporation à Toronto. Le 14 mai
de la même année, les téléspectateurs
de Toronto (CBLT) et de Montréal (CBFT) peuvent visionner
simultanément pour la première fois la même
émission en direct.
1953 AUTOMATIC
ELECTRIC (Canada) Limited est la filiale canadienne de
fabrication d'Automatic Electric Company.
Son usine moderne de Brockville, en Ontario, produit une grande
variété de téléphones, de cadrans téléphoniques,
de relais et une gamme complète de tableaux de distribution
automatiques Strowger et d'équipements accessoires.
Les opérations de fabrication du groupe Automatic Electric
au Canada ont commencé en 1930 avec l'acquisition de Phillips
Electrical Works, Limited, Brockville, Ontario, qui à l'époque
se consacrait exclusivement à la fabrication d'une gamme
complète de conducteurs et de câbles en cuivre pour
les communications, l'alimentation, et les domaines des transports.
En 1935, un ajout a été fait à l'usine de Phillips
pour assurer la fabrication de téléphones, d'équipements
de commutation automatique et manuel et d'autres appareils de communication.
Au cours des années qui ont suivi, cette opération
a été progressivement élargie pour répondre
aux besoins en croissance rapide des compagnies de téléphone
et des administrations canadiennes.

L'usine de Brockville, Ontario, d'Automatic Electric (Canada) 1953
Limited, illustrée ici, occupe 125 000 pieds carrés
de surface au sol et est conçue de telle sorte que le bâtiment
peut être agrandi jusqu'à 500 000 pieds carrés.
Le bâtiment est situé dans le quartier de Schofield
Hill, à l'ouest du boulevard Strowger. Le bâtiment
entièrement moderne de Toronto, illustré ici, abrite
le siège social, le bureau des ventes de Toronto et l'entrepôt
central d'Automatic Electric Sales (Canada) Limited.



Une des unités centrales de la British Columbia Telephone
Company installée à Vancouver, en Colombie-Britannique.
En mai 1953, la filiale canadienne d'Automatic vend ses installations
de fabrication de fils et de câbles dans le but de se concentrer
uniquement sur la production d'équipements de communication
et de commande électrique. Cela a été suivi
par l'organisation de l'actuelle entreprise de fabrication canadienne
et la construction d'une nouvelle usine de fabrication.
Après un examen attentif de plusieurs emplacements possibles,
un site de 33 acres à Brockville a été sélectionné.
L'usine d'un million et demi de dollars a démarré
le 5 août 1953 et a été officiellement inaugurée
le 22 septembre 1954. Elle est de conception très moderne
et combine les dernières techniques architecturales et de
production.
Située au cœur de la plus grande section industrielle
du Canada, Automatic Electric (Canada) 1953 Limited est toutefois
devenue la première nouvelle industrie à ouvrir ses
portes dans la vallée du Saint-Laurent après la finalisation
des plans de la Voie maritime du Saint-Laurent.
Un point d'intérêt dans le développement de
l'usine automatique dans ce domaine était la dénomination
du boulevard Strowger, un geste de l'esprit de coopération
entre les responsables de l'entreprise et de la société,
en l'honneur de la mémoire d'Almon B. Strowger.
Automatic Electric a toujours été étroitement
liée à l'industrie du téléphone du Canada,
qui comprend plus de 2800 entreprises indépendantes et systèmes
gouvernementaux provinciaux ainsi que la Compagnie de téléphone
Bell du Canada. L'équipement de commutation automatique Strowger
est utilisé principalement par les trois groupes. Les ventes
et la distribution des produits Automatic Electric au Canada sont
assurées par une société associée, Automatic
Electric Sales (Canada) Limited, dont le siège social et
l'entrepôt principal sont à Toronto, ainsi que des
succursales, des entrepôts et des agents à d'autres
endroits pour offrir un service complet à sa liste croissante
de clients dans le Dominion.
sommaire
1954 le Système Crossbar
Ericsson


LM Ericsson a vendu au Canada des commutateurs crossbar
ruraux, urbains, et de transit.
1962 Contrat signé avec COTC, Teleglobe Canada,
pour la fourniture et l'installation à Montréal, Vancouver
et Hawaï, de centraux tête de ligne automatiques de type
ARM Crossbar, utilisés pour les échanges téléphoniques
et de télex internationaux. À la suite de cette installation,
tous les télex et les communications téléphoniques
canadiens passent par les centraux Ericsson.
Le 1er décembre 1977, LM Ericsson employait 54
personnes au Canada. A des fins de comparaison, on a indiqué
que 1es ventes de LM Ericsson aux Etats-Unis se sont é1evées
en 1976 a 12,1 millions de dollars.
LM Ericsson ne fabrique pas de materiel de telecommunication au Canada
bien qu'elle y fasse Ie montage de certains produits et l'adaptation
de certaines pieces d'equipement. Elle dispose d'installations pour
enseigner aux clients Ie fonctionnement et l'entretien du materiel.
Dans Ie domaine du matériel de télcommunication,
LM Ericsson offre au Canada des postes téléphoniques,
des PBX et des interphones. Les PBX incorporent des techniques de commutation
crossbar, et les divers produits peuvent servir dans des installations
de 50 a 9 000 lignes. Le plus gros des PBX offre aussi Ie centrex. La
compagnie prevoyait produire un PBX éléctronique en 1979,
d'une capacité maximum de 100 lignes. Les interphones de LM Ericsson
peuvent être raccordés à jusqu'a 5 000 stations..
À Québec, jusqu'en 1958, le nombre de
centraux passera d'un à huit. Les noms des centraux (ou exchanges
en anglais) raviveront certainement en vous des souvenirs :
1951 : Lafontaine - LA ou 52 (Québec)
1952 : Montcalm - MO ou 66 (Giffard et Beauport)
1953 : Marquette - MA ou 62 (Charlesbourg)
1953 : Murray - MU ou 68 (haute-ville)
1953 : Terminus - TE ou 83 (Lévis)
1956 : Victoria - VI ou 84 (Loretteville)
1958 : Olympia - OL ou 65 (Sainte-Foy)
19?? : Trinité - TR ou 87 (Ancienne-Lorette)
sommaire
8 juillet 1956 Bell Canada inaugure la composition directe
à distance, permettant aux clients de composer certains de
leurs propres appels interurbains sans l'aide d'un téléphoniste.
1957 SaskTel achève sa partie du premier système
de relais radio micro-ondes transcanadien. Avec ce système,
les programmes de télévision en direct sur le réseau
pourraient être transmis d'un océan à l'autre.
Cela a contribué à créer la tradition derrière
des émissions nationales comme "Hockey Night in Canada".
18 juin 1958 Le rêve du président de Bell Canada,
Thomas Eadie, d'un réseau hertzien entièrement canadien
se réalise à cette date. Le réseau de liaisons
hertziennes de 6 400 kilomètres, le plus long au monde, transporte
des conversations téléphoniques, des messages téléimprimeurs
et des signaux de télévision.
1958 L'Alberta Government Telephones Commission est créée,
mettant fin à la gestion gouvernementale directe du système
provincial.
1er mai 1960 La fonction All Number Calling (numéros
de téléphone à 7 chiffres) est introduite sur
le territoire de Bell Canada. Les premiers à bénéficier
de ces nouveaux numéros sont les abonnés d'Ormstown
et de Franklin-Centre, Québec.
15 mars 1962 La Compagnie de téléphone Bell
du Canada est la première compagnie de téléphone
au monde à offrir un service de télécopie commercial
Montréal "Le réseau dans la ville"
| La constitution du monopole de Bell À la fin du XIXe siècle, Montréal
passe pour une ville bien pourvue en réseaux de communication
locale. Dès les années 1840, les gens d’affaires
et les gestionnaires urbains ont eu l’occasion d’utiliser
différents systèmes électriques de transmission
à distance des communications. Malgré ces innovations
technologiques, il n’en reste pas moins que plusieurs
acteurs socio-économiques réclament une amélioration
des services. En 1879, l’introduction du téléphone
marque un essor qualitatif important. Ses avantages sont évidents,
quoique plusieurs observateurs de la scène urbaine
en doutent. En outre, comme il a été mentionné
précédemment, d’autres formes de communication
coexistent pendant plusieurs décennies. Les concepts et les instruments nécessaires
à cette organisation proviennent en grande partie de
l’expérience. Aussi, ne pourront-ils être
développés que quelques années après
l’introduction du service. Aux lendemains de la Première
Guerre mondiale, les efforts de normalisation et de rationalisation
du système mis en œuvre par les producteurs privés
donnent des résultats évidents : la capacité
d’écoulement des flux téléphoniques
s’intensifie, la diversité des marchés
est mieux prise en considération et le nombre d’abonnés
franchit de nouveaux seuils. Bref, la maîtrise de la
gestion de l’offre et de la demande donne un nouvel élan
au service téléphonique. Cependant, même si l’opinion publique
s’oppose à la constitution de monopoles, dans
le cas du service téléphonique, les avantages
procurés par cette situation sont manifestes. Afin
de bénéficier des qualités réticulaires
du service, c’est-à-dire d’une desserte qui
offre une capacité d’interconnexion, les abonnés
peuvent tirer profit de la présence d’une seule
entreprise centralisatrice. Le fait qu’il y ait un réseau
unique peut aussi leur permettre de joindre un plus grand
nombre d’interlocuteurs. En revanche, la multiplication
des compagnies signifie, la plupart du temps, le dédoublement
des réseaux et des équipements. De plus, l’augmentation
du nombre de compagnies qui offrent le service de téléphone
a pour effet d’accroître les problèmes causés
par la prolifération des poteaux et des fils dans l’espace
urbain. Pour autant, un contexte monopolistique
n’est pas exempt de difficultés. Compte tenu de
leur position captive, les consommateurs sont ainsi susceptibles
d’écoper de tarifs élevés et d’un
service dont la qualité est parfois discutable. Tout au long de la période étudiée,
les différentes formes de relations — sur le plan
des affaires, des échanges d’informations techniques
et administratives, ou des rapports interpersonnels —
au sein de la classe d’affaires révèlent
donc que le pouvoir économique est rattaché
de près au pouvoir technique. De plus, le rapprochement
hâtif avec les promoteurs des États-Unis, le
dynamisme manifesté par les entrepreneurs locaux, l’importance
des capitaux auxquels ils ont accès, la complaisance
des milieux politiques, l’autonomie des opérateurs
du réseau dans la production des équipements
constituent autant d’éléments qui contribuent
à promouvoir une vision homogène et des représentations
conséquentes du côté des initiateurs du
téléphone. Une fois bien établis dans
leur milieu d’accueil, ils sont en mesure d’implanter
leur propre conception du réseau. Cela inclut les modalités
de desserte et les caractéristiques des clientèles
visées. Plus loin, on verra aussi que la culture organisationnelle
ainsi qu’une certaine vision des relations publiques
constituent des enjeux importants. |
Comme principal fournisseur de service public, Bell
a occupé une place prépondérante dans le développement
urbain de la métropole. Son rôle renvoie d’entrée
de jeu à son statut de fournisseur de service public. Dès
les années 1900, les dirigeants de Bell ont procédé
à l’intégration des réseaux locaux afin
d’établir un seul système. En approvisionnant
le lucratif marché de la téléphonie urbaine,
l’entreprise est parvenue, après quelques années
de concurrence, à maintenir sa position prépondérante
dans l’évolution du service montréalais, voire
canadien. À partir du moment où sa position hégémonique
était assurée, elle a construit et exploité
le réseau de téléphone local et interurbain.
Elle a fixé les modalités de sa distribution. Elle
a élaboré une conception de la rentabilité
appropriée à son développement. Enfin, elle
a participé à la définition de la notion même
de service public et de son caractère indispensable.
La place occupée par le téléphone
et ses opérateurs privés dans l’histoire des
communications à Montréal mérite aussi d’être
soulignée. À cet égard, Bell est un acteur
incontournable. Il participe à l’expansion de l’agglomération,
tant par son action concrète — ses projets d’extension,
par exemple — que par ses activités promotionnelles
relatives à la mise en forme d’une vision idéalisée
de l’environnement urbain et suburbain.
Jusqu’à la fin de la décennie
des années 1900, le personnage principal de l’industrie
du téléphone demeure le dirigeant. Pour atteindre
ses visées expansionnistes, il combine habilement des tactiques
et des stratégies à la fois techniques, financières
et politiques. À partir du moment où le monopole du
service est assuré, protéger l’image de marque
de l’entreprise et rejoindre de nouvelles clientèles
devient l’apanage des entrepreneurs. Ainsi, après le
dirigeant, c’est la figure de l’agent qui émerge.
C’est lui, désormais, qui occupe une fonction de premier
plan, jouant un rôle d’interface entre les techniciens
et les clients. Par conséquent, c’est le vendeur/représentant,
placé au centre de la relation, qui effectue le rattachement
de la sphère technique à la sphère sociale.
En d’autres termes, même si les
stratégies de Bell ont été contestées
à certaines occasions par les acteurs locaux, elles se sont
avérées une véritable réussite. Au cours
de la période étudiée, un compromis sociopolitique
a pu être construit autour de l’idée que le service
téléphonique local était indispensable. Dès
lors, il apparaît que le modèle du service public dans
le domaine de la téléphonie — modèle cependant
remis en question depuis le début des années 19902
— a pris forme avant 1930.
Une indication de ce caractère essentiel
— on peut même parler de dépendance de la vie
urbaine à l’endroit du réseau téléphonique
— vient de la croissance fulgurante des abonnements au service
résidentiel et d’affaires aux lendemains de la Seconde
Guerre mondiale. Il faut rappeler à ce propos qu’entre
1945 et 1961, le nombre d’appareils en service dans les résidences
de l’agglomération montréalaise est passé
de 148 479 à 606 507, soit une augmentation de l’ordre
de 309 %, ce qui représente en moyenne, pour l’île
de Montréal, 35 appareils pour 100 habitants.
En ce qui a trait au service d’affaires,
le nombre d’appareils connectés au réseau a presque
triplé au cours de cette même période, passant
de 94 351 à 271 453 appareils3. À partir de la seconde
moitié des années 1940, après une période
de croissance lente entre 1930 et 1944, Bell a profité, d’une
part, des investissements effectués dans la seconde moitié
des années 1920 pour moderniser son réseau et, d’autre
part, de ses efforts promotionnels visant à stimuler la vente
du service. Ainsi, il apparaît que le succès de l’entreprise
provient de la qualité de son réseau et de l’efficacité
de ses campagnes de relations publiques et de promotion.
| La planification chez Bell Avant les années 1910, on a du mal à saisir avec précision les intentions de Bell. Son orientation, ses choix, sa stratégie par rapport au développement du réseau téléphonique sont difficiles à cerner. Toutefois, après la Première Guerre mondiale, l’entreprise présente, au moins sur le plan technique, une image plus claire de son système de production et de distribution. Ses méthodes de mise en marché sont aussi plus élaborées et mieux adaptées aux diverses clientèles, voire aux divers modes de consommation. Les secteurs de la ville qui offrent une clientèle d’affaires et une clientèle résidentielle fortunée constituent sans conteste des cibles privilégiées. Peu portés à tenter des expériences sur des marchés indéterminés, les dirigeants de Bell s’en tiennent aux secteurs d’emblée profitables. Cela contribue à renforcer les choix sociaux de l’entreprise, ce qui se répercute sur l’offre du service. Un élément important du développement
du réseau téléphonique renvoie à
l’approche générale qui se dégage
des projets d’extension aux lendemains de la Première
Guerre mondiale. Il s’agit d’une nouvelle approche
planificatrice mise en œuvre pour, d’une part, moderniser
l’offre du service et, d’autre part, déterminer
avec plus de certitude les besoins futurs. À partir du début des années
1920, à la suite de l’expérience acquise
lors de la première phase de développement,
les exploitants privés font appel de manière
explicite au modèle rationnel pour encadrer l’ensemble
des activités rattachées à l’offre
du service. Il en résulte la mise en place d’une
bureaucratie gestionnaire qui va de pair avec un renforcement
de l’idéologie techniciste. Au nombre des documents cartographiques conservés au Service historique de la compagnie montréalaise, on retrouve différents plans usuels de la ville et de l’île. Ceux-ci font sans doute partie des outils de planification auxquels avaient recours les opérateurs du réseau. De manière générale, ces plans aident à saisir les grands axes de développement urbain. Ils permettent aussi de repérer les rythmes de construction, les projets de lotissement et l’ouverture des nouvelles rues, la qualité des constructions — les matériaux étant parfois spécifiés — et, de fait, la valeur des bâtiments. Ainsi, ces documents sont-ils utiles pour identifier les zones potentielles à aménager en termes d’infrastructures et d’équipements. L’idée de planifier le réseau
à long terme (sur une période de 20 à
30 ans) se trouve énoncée dès le début
des années 1910 dans les discours des ingénieurs
d’AT&T. Sans doute inspirés par les valeurs
et les préoccupations propres à la planification
urbaine, ils insistent sur la nécessité d’appréhender
le système téléphonique dans sa totalité,
tout en tenant compte d’une multiplicité de facteurs
externes qui sont à même d’en influencer
l’organisation. L’approche planificatrice qui en
découle doit nécessairement être englobante
(comprehensive) De fait, la modernisation et la rationalisation
du réseau prennent l’allure d’un processus
de planification continue par opposition à un plan
figé ou définitif. Afin de faire face aux ajustements
fréquents exigés par la conjoncture et par des
changements circonstanciels — l’introduction de
nouvelles technologies ou encore une demande accrue —,
les dirigeants de Bell utilisent des méthodes de prévision
de plus en plus précises. De plus, une agglomération urbaine
conçue en fonction des principes du modèle rationnel
correspond à l’image d’une ville efficace
et prospère, tout en reprenant à son compte
les valeurs modernistes de salubrité, de beauté
et de confort : Afin de composer avec la complexité
de la réalité, toutes les instances (c’est-à-dire
les différents services de Bell) sont soumises aux
exigences de la démarche de la planification rationnelle
et tenues de coordonner leurs activités. Sur un plan
opérationnel, cette démarche a pour effet de
réduire à quelques règles technico-économiques
le fonctionnement du marché. Le réseau téléphonique étant considéré, par ses concepteurs, comme un organisme en évolution, le plan directeur guidant son développement est davantage vu comme un processus que comme un idéal à atteindre. L’utilité de la planification se résume dans la réduction des incertitudes relatives aux variables suivantes : croissance démographique, distribution spatiale des ménages, tendances d’urbanisation, nature des activités urbaines. À cet égard, le zonage représente, pour les planificateurs, un outil approprié puisqu’il permet de déterminer à l’avance la localisation des activités. On peut comprendre pourquoi les exploitants privés des réseaux techniques urbains ont sur-le-champ été favorables à une ségrégation des activités dans l’espace. Il reste qu’en dernière analyse,
c’est la nature des liens unissant les groupes d’intérêt
(community of interest) qui constitue le fondement de la planification
du réseau téléphonique. Dès lors,
par des démarches analytiques et prospectives, les
planificateurs examinent les besoins de communication des
diverses communautés et les rapports qu’elles
sont susceptibles d’entretenir avec des groupes plus
ou moins lointains : Les planificateurs font certes appel au discours
scientifique, mais leur objectivité est d’emblée
biaisée par la manière dont ils appréhendent
les relations entre les groupes qu’ils souhaitent brancher
au réseau. La connexion des ménages, des entreprises
et des institutions situés en territoire montréalais
s’effectue en fonction des affinités économiques
et socioculturelles qu’ils partagent : langue, appartenance
sociale (déterminée en fonction de leur revenu
moyen), quartiers, activités. On peut parler ici d’une
recomposition sélective des communautés eu égard
aux habitudes de communication. Les études de marché Si les élus municipaux et les planificateurs
urbains contrôlent peu les forces à l’œuvre
dans le processus de développement urbain, en revanche,
les exploitants des réseaux techniques sont, eux, habilités
à prédire les besoins, compte tenu des données
fournies par les études de marché sur lesquelles
ils appuient leurs projets d’extension. L’empirisme
de ces études s’inscrit dans le cadre d’une
vision globale qui propose une interprétation de la
croissance urbaine : Cette enquête propose une vision future
des pratiques de consommation téléphonique.
Une telle anticipation de l’évolution des besoins
implique que Bell fasse des hypothèses par rapport
aux investissements qu’exigent la construction de nouveaux
équipements, les coûts d’exploitation et
les modalités de tarification. À cet égard,
on pense en termes de tarification puisqu’elle fixe le
degré d’accessibilité sociale au réseau. Lorsque les enquêteurs comparent les
données sur les types d’habitation et les taux
d’abonnement au téléphone, le lien entre
le niveau de richesse des ménages et la souscription
au service est flagrant. Parmi les plus grands consommateurs
du service, on retrouve les familles qui dépensent
le plus pour se loger. Les chiffres vont en décroissant
lorsqu’il s’agit des groupes les moins fortunés. En comparaison avec l’attitude de la
compagnie qui prévalait au début des années
1900 à l’endroit de la clientèle francophone
de la métropole, on peut parler ici d’un revirement
de point de vue. C’est que le niveau de vie des francophones
s’est accru de manière significative entre 1901
et 1921, notamment en raison du recul de la mortalité.
La part des groupes qui ne sont pas d’origine française
ou britannique a aussi beaucoup progressé au cours
de cette même période : en 1921, elle atteint
12,9 % dans la ville de Montréal. Néanmoins,
son pouvoir d’achat est limité. Bell en tient
donc peu compte. La réalité sociospatiale est
un des thèmes essentiels des enquêtes effectuées
par Bell. On évalue les tendances et les processus
particuliers que revêt le développement urbain
: déconcentration des activités de production,
nouvelles stratégies résidentielles, concentration
des activités de direction, etc. En décortiquant
ainsi la réalité montréalaise, Bell compose
un système de relations entre les secteurs plus ou
moins hiérarchisés aux points de vue social
et fonctionnel. Suivant les secteurs d’activités
et les catégories sociales qui animent les zones inventoriées,
on fixe la personnalité des clientèles et le
potentiel téléphonique. On prend aussi en considération
une variable technique, à savoir la capacité
accrue d’écoulement des flux téléphoniques
fournie par les équipements de commutation. Le marché « H », incluant
le quartier Saint-Antoine situé près du mont
Royal — connu aussi sous le nom de Golden Square Mile
—, présente des caractéristiques et des
possibilités de développement bien différentes
de celles de la zone précédente puisque 87,9
% des familles sont abonnées au téléphone
: Bell a pour stratégie de continuer
à fournir un service de qualité, conforme aux
exigences des clients du quartier, notamment le maintien des
lignes téléphoniques individuelles par opposition
aux lignes partagées. Comme le montre le tableau ci desous, les pourcentages d’abonnés que Bell prévoit pour 1945 à l’échelle du territoire étudié, bien que supérieurs par rapport à 1924, demeurent conservateurs dans le cas des ménages et des commerces de quartier. Pourcentage d'abonnés en fonction du type de service
De manière plus précise, elle estime que le marché situé à l’intérieur des limites de la ville de Montréal va passer de 41,5 % en 1924 à 57,3 % en 1945. Quant aux villes de banlieue comprises dans l’enquête (Westmount, Outremont, Verdun, LaSalle, Saint-Pierre, Montréal-Ouest, Côte-Saint-Luc, Hampstead, Mont-Royal, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Saint-Michel-de-Laval, Saint-Léonard-de-Port-Maurice, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Laval-de-Montréal), elles présentent des possibilités d’extension un peu plus importantes : alors qu’en 1924, 58 % des ménages qui habitent ces localités ont le service téléphonique, Bell prévoit qu’en 1945 plus de 75 % des familles suburbaines seront abonnées. Bien entendu, ces chiffres représentent une moyenne qui tend à masquer les écarts considérables entre le taux d’abonnement des familles de Westmount (atteignant 93,3 % en 1924) et celui des quelque 611 familles qui habitent Montréal-Nord (on y retrouve 7,2 % d’abonnés en 1924). Il n’en demeure pas moins que les familles de la banlieue sont les plus prometteuses quant aux possibilités d’extension du réseau. D’ailleurs, les efforts de promotion visant le marché résidentiel suburbain s’expriment clairement dans les documents produits par la suite. Dans les faits, par contre, la consommation suburbaine du téléphone ne va pas de soi. Souvent, il faut attendre que les familles soient établies en banlieue et que les réseaux de transport y soient en service pour que le niveau d’abonnement augmente. Le téléphone devient alors, à l’instar des autres services offerts par les réseaux techniques urbains, un élément indispensable de communication et de désenclavement. Pour mieux comprendre les stratégies
résidentielles, Bell a recours à des informations
cartographiques qui lui permettent d’obtenir instantanément
une vision d’ensemble du marché. Il faut rappeler
que le territoire à l’étude inclut les
portions urbanisées de l’île et les zones
résidentielles des noyaux villageois. Certaines portions
de ce territoire sont occupées par des terres agricoles.
Une série de points d’urbanisation sont toutefois
visibles et renseignent les planificateurs du réseau
montréalais sur les axes probables de développement. Cependant, à Montréal, les districts
les plus densément peuplés sont occupés
par des familles ouvrières, lesquelles ne disposent
pas des revenus nécessaires pour s’abonner au
service. Parmi les endroits où sont établies
le plus grand nombre de familles, on retrouve les secteurs
industriels, notamment Hochelaga et Maisonneuve. Le centre
des affaires — qui correspond au secteur du Vieux-Montréal
— est quasi inhabité. Outre les secteurs largement sous-urbanisés de l’île, Bell doit aussi tenir compte de la présence de plusieurs zones peu rentables puisqu’elles ne sont pas disponibles pour la desserte du service résidentiel. Elles sont occupées par des parcs et des cimetières (les parcs du Mont-Royal, Lafontaine, Maisonneuve, les cimetières Notre-Dame-des-Neiges et Mount Royal), par des activités industrielles (les zones limitrophes au canal Lachine et aux voies ferrées), par des fonctions institutionnelles (le domaine de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu, la prison de Bordeaux) et des emprises ferroviaires (les cours de triage) ou portuaires. Avec le recul, on peut dire que, tout en appréhendant
les obstacles physicospatiaux propres au territoire montréalais
ainsi que les contraintes matérielles des ménages,
les ingénieurs de la compagnie sont parvenus à
prédire les comportements de la clientèle. Toutefois,
les difficultés économiques des années
1930 remettent en question la validité des informations
recueillies, car le pouvoir d’achat des ménages
a été réduit de manière significative.
On observe alors un déclin — le premier dans l’histoire
de Bell — des abonnements au téléphone. Au fil des années, la connaissance poussée du territoire montréalais, de ses potentiels et de ses restrictions en termes d’extension du réseau téléphonique a joué un rôle important. Les pratiques d’enquête et de collecte de données avaient en effet une dimension utilitaire indéniable. La capacité de prédire les besoins téléphoniques de la métropole, en faisant confiance à la planification rationnelle, est ainsi devenue un élément stratégique pour le développement du réseau. |
sommaire
L'accès aux designs des Bell Labs américains
prit fin au début des années 1960.
Northern Electric établit ses propres laboratoires de recherche
pour concevoir des produits qui satisfirent les besoins du marché
canadien plutôt que d'y adapter les produits américains.
|
En 1968, La Compagnie de Téléphone Bell du Canada est renommée Bell Canada. Canada atlantique Quebec et Ontario Alberta, Manitoba et Saskatchewan Le nord du canada |
Le
réseau de Bell comptait deux sociétés principales
dans l’industrie téléphonique au Canada: Bell
Canada en tant que société d’exploitation
régionale (affiliée à AT & T, avec une
participation d’environ 39%) et Northern
Electric en tant que fabricant d’équipement (affiliée
à Western Electric , avec une participation d'environ 44%).
La compagnie de téléphone Bell du Canada et Northern
Electric étaient structurées de la même façon
au Canada que les parties analogues du réseau de Bell aux
États-Unis;
Dans le cadre du décret
de consentement signé en 1956 pour résoudre le litige
antitrust intenté en 1949 par le ministère de la Justice
des États-Unis, AT & T et le système Bell se sont
dessaisis de Northern Electric en 1956.
Durant les années 1970 et 1980, le partenariat étroit
entre Bell Canada et Northern
Telecom a permis aux deux compagnies de devenir des chefs de file
mondiaux dans leur domaine respectif. Ainsi, Bell Canada a été
la première compagnie au monde à implanter un réseau
commercial de communications numériques et la première
compagnie à implanter un réseau commercial de communication
par paquets, Datapac, basé sur le Datagramme. De son côté,
Northern Telecom est devenu le chef de file dans le développement
et la fabrication d’équipement de commutation et de
transmission numérique.
Par contre, durant la
même période, les tentatives de Bell Canada de se diversifier
dans les domaines de l’énergie, de l’immobilier
et de l’informatique ont échoué.
En 1974, le concept des magasins «
Téléboutique » est lancé avec l'ouverture
des magasins de Longueuil (Québec), de Sherbrooke (Québec)
et de Guelph (Ontario).
Logo de Bell de 1977 au 7 décembre 1994.
En 1980, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) ouvre la concurrence dans le marché des appareils téléphoniques.
En 1983, par une transaction complexe, Bell Canada crée le groupe d'exploitation BCE, devient membre de ce groupe et place certaines de ses filiales dont Northern Telecom dans le groupe; tous les actionnaires de Bell Canada deviennent des actionnaires de BCE.
Un important mouvement de grève est
déclenché au matin du 27 juin 1988 à
Bell Canada. 20 000 employés affiliés au Syndicat
des travailleurs en communication cessent le travail pour protester
contre la politique de salaire, le régime de retraite et
la politique de sous-traitance de l'entreprise, alors que la précédente
convention collective avait expiré en novembre 1987.
La grève fut la plus longue de l'histoire de Bell Canada
(16 semaines) et ne s'acheva que le 21 octobre 1988
avec la signature d'un accord de trois ans qui porte sur des augmentations
de salaire et des améliorations au régime de retraite.
Ce mouvement de grève est également marqué
par de nombreux sabotages à l'été 1988. Des
bris de câbles sont commis à partir du début
du mois de juillet touchant de nombreuses régions comme Saint-Jérôme,
Lanaudière, Joliette, l'Outaouais au Québec mais aussi
Toronto, Barrie et Pembroke en Ontario. Les cadres non grévistes
de Bell Canada sont mis à contribution pour restaurer le
service.
Au début des années 1990, fortes de plus de
7 millions d’abonnés du téléphone
en Ontario, au Québec et dans les Territoires du Nord-Ouest,
Bell Canada et la société mère créée
par elle en 1983, les Entreprises Bell Canada Inc. (EBC), contrôleraient
près d’une centaine de filiales et emploieraient presque
120 000 personnes.
Par ses recettes et ses bénéfices, les Entreprises
Bell Canada Inc. se rangerait régulièrement parmi
les trois plus importantes sociétés canadiennes.
Durant les années 1990, BCE s’est aventuré sur
le terrain de la convergence en acquérant des journaux, des
chaînes de télévision, des compagnies de services
informatiques et des compagnies de télécommunications
hors de son territoire traditionnel.
En 1992, le CRTC ouvre la concurrence dans
l'interurbain.
En 1997, le CRTC ouvre la concurrence dans le service local.
En 1998, le CRTC ouvre la concurrence
dans les téléphones publics; depuis cette date, toutes
les activités de Bell Canada sont soumises à la concurrence.
BCE se départ de sa participation dans Nortel. BCE investit
massivement dans une stratégie de convergence numérique
en faisant les acquisitions de Téléglobe, CTV, TQS
et du Globe and Mail.
En 2000-2001, certains de ces investissements se sont avérés
néfastes. Depuis 2001, BCE se recentre avec succès
sur ses activités de télécommunications.
En 2001, avec l'effondrement de la
bulle des technologies de l'information, plusieurs des investissements
récents de BCE perdent une très grande partie de leur
valeur. BCE se départ alors de Téléglobe et
entreprend un recentrage sur ses activités traditionnelles
de télécommunications.
Cette nouvelle stratégie amènera le consortium à
se départir de ses avoirs dans CGI, CTV, TQS et le Globe
and Mail au cours des années suivantes.
En 2005, BCE fonde Bell Solution d'affaire
et fait son entrée dans les TI avec l'aqusition de plusieurs
entreprises en TI dont Nexxlink et Charron Système au Québec.
BCE devient une des plus grandes compagnie de TIC au Canada.
En 2006, BCE annonce son intention
de faire comme plusieurs autres compagnies et de se transformer
en fiducie de revenus, mais le gouvernement fédéral
bloque ce plan en changeant la loi sur les fiducies de revenus.
En 2006, BCE employait 60 000 personnes et a généré
des revenus de 20 milliards de dollars.
En 2007, l'entreprise comptait 55 000 employés dont 17 000
au Québec, pour un chiffre d'affaires de 17,7 milliards de
dollars. BCE investissait pour 1,4 milliard de dollars et employait
426 ingénieurs, ce qui en faisait le 10e plus grand employeur
d'ingénieurs au Québec
En 2007, les services professionnels de Bell Solution d'affaire sont intégrés à l'intérieur de Bell le reste est vendu.
En 2008, BCE déménage son siège social au 1, Carrefour Alexander-Graham-Bell. île des sœurs. Le Campus Bell est certifier LEED.8 BCE annonce q'elle serait vendu à Teachers. George Cope arrive au pouvoir et lance un plan d'exécution de 100 jours. L'offre d'achat par Teachers est retirée.
Le 2 mars 2009, Bell achète la chaîne
de magasins La Source.
Le 22 juin 2009, BCE participe à
l'achat du Canadien de Montréal à la hauteur de 18%.
En 2010, BCE devient l'unique propriétaire de CTV.
En 2011, implantation de la fibre optique
FTTH et IPTV dans la ville de Québec.
Le 9 décembre 2011, Bell Canada et
Rogers achètent les Maple Leaf Sports & Entertainement
(MLSE), le consortium sportif qui détient notamment les Maple
Leafs de Toronto (LNH), les Raptors de Toronto (NBA), le Toronto
FC (soccer) et le Air Canada Centre. Les deux compagnies, Bell et
Rogers, investissent plus de 533 millions chacune11.
Le 16 mars 2012, Astral a annoncé
la vente de l’entreprise à BCE, une transaction d’environ
3,38 milliar ds $.
Le 18 octobre 2012, La demande a été
refusée par le CRTC. Un mois plus tard une nouvelle demande
est déposé par Bell.
Le 27 juin 2013, Le CRTC autorise la vente à BCE mais sous certaine condition.
En juillet 2014, BCE annonce l'acquisition des participations dans Bell Aliant qu'il ne détenait pas, soit 47 % des parts de l'entreprise, pour 3,95 milliards de dollars canadiens.
Du côté de DRUMMONDVILLE
Le télégraphe : Dans notre
région, la première ligne fut installée sur la
ligne Richmond-Lévis du Grand Tronc, en 1855, avant de s’étendre
aux autres centres régionaux. En 1863, un habitant d’Arthabaska
écrivait que les nouvelles mettaient moins de temps à
arriver de France que de Montréal quinze ans plus tôt !
Le système n’est pourtant pas sans
faille : on constate de nombreux bris de service, notamment lors de
grands vents, destruction de fils ou d’instruments par la foudre
et même, en 1859, des pannes importantes eurent lieu à
la suite d’une tempête solaire et d’aurores boréales
spectaculaires qui firent sauter les circuits électriques !
De toute façon, le coût d’envoyer
un message privé était prohibitif pour la plupart des
citoyens. On payait au mot (d’où le style dit « télégraphique
») et on s’en tenait donc à l’essentiel pour
des messages réservés aux choses sérieuses : messages
d’affaire, avis de décès, etc.
Le téléphone : La filiale canadienne de l’entreprise s’impose comme principal fournisseur vers 1880 et la compagnie du Grand Tronc entreprend de relier ses stations ferroviaires et ses bureaux par ce nouveau moyen de communication. Le système est entièrement manuel : tous les appels passent par une centrale et une téléphoniste établit la communication entre les usagers. La nouvelle technologie intéresse surtout les gens d’affaire car l’abonnement annuel coûte 15$, ce qui est hors de portée de la grande majorité des habitants.
Cependant, pour étendre le réseau au-delà
des stations de chemin de fer, les hommes d’affaire durent souvent
investir leur temps et leur argent.
En 1884, à Victoriaville, Achille Gagnon fait poser à
ses frais les premiers poteaux de téléphone. Deux marchands,
Paul Tourigny et W.C. Houle, font installer une ligne entre Victoriaville
et Warwick. Progressivement, la compagnie Bell achètera la plupart
des entreprises locales de téléphonie dans les années
1890. Ces efforts dispersés ne sont pas sans inconvénients
: Durham-sud obtient sa ligne en 1894 mais on ne peut y téléphoner
à Arthabaska car, là-bas, le réseau appartient
à Bell alors que celui de Durham appartient encore à un
indépendant ! Les réseaux privés ne sont pas intégrés
à un réseau plus vaste. Les appareils téléphoniques
se trouvent encore essentiellement dans les gares, commerces, les bureaux
de poste et autres lieux d’affaire. Seule une élite possède
un appareil à la maison, surtout dans les villes car les campagnes
ne sont souvent pas desservies. Les appels doivent encore passer par
une centrale : il est impossible d’appeler quelqu’un directement.
Les appareils sont pourvus d’une manivelle. En la tournant on déclenche
une sonnerie qui alerte une opératrice qui répond. On
lui donne alors le nom et l’adresse de la personne à joindre
et celle-ci établit le contact. De plus, il faut appeler pendant
les heures de travail de la centrale : elles n’ont souvent pas
de personnel de nuit. Impossible donc, de faire un appel urgent à
minuit ou une heure du matin si la centrale locale est fermée.
Les numéros de téléphone qu’on
signale avec un cadran à roulette ne se généralise
que dans les années 30.
Pour les utiliser il faut une centrale automatisée. À
Drummondville, il y en aura une en 1937, la première dans la
région.
Dans la décennie qui suit les entreprises de téléphone
procéderont progressivement à la mise à niveau
de leur technologie. Ce sera plus long dans les campagnes. Le canton
de Warwick ne sera rejoint par ces nouveaux équipements qu’en
1958.
Il devient alors possible à tous de téléphoner
à un parent ou un ami pour prendre des nouvelles…ou en donner!
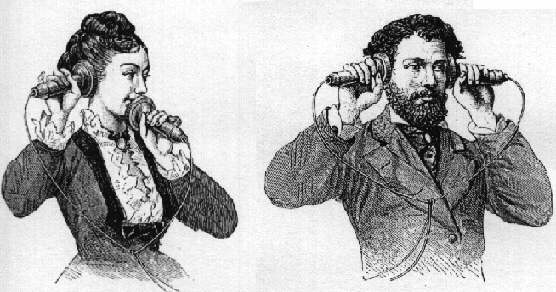




 Usine Northern
Usine Northern 
 (Agrandir
(Agrandir Liste
de 1880
Liste
de 1880


 Premier
siège social de Bell, rue Notre-Dame, 1895
Premier
siège social de Bell, rue Notre-Dame, 1895





