Emploi du téléphone
dans les chemins de fer.
La télégraphie
1837 est une date , très importante pour l’exploitation
ferroviaire car, sans le télégraphe, l’augmentation
de puissance des locomotives et, donc, de leur vitesse aurait été
mal utilisée faute d’un échange rapide d’informations
de sécurité (début du cantonnement par l’espace)
et de régulation entre les gares, échange nécessité
également par l’augmentation du trafic.
A la fin de la première moitié du XIXème siècle,
le réseau de chemins de fer poursuit un développement
soutenu qui nécessite de mettre en place des dispositifs de sécurité
pour réguler le trafic et éviter les collisions. Le télégraphe
à cadran mis au point par Louis-Clément Breguet, performant
et facile d’utilisation, va rapidement devenir indispensable à
l’exploitation de la plupart des lignes européennes
Avant 1845, année où le télégraphe
est mis en service pour la première fois dans le monde ferroviaire
français entre Paris et Rouen, les trains partaient comme
des navires en mer, et on n’avait plus aucune nouvelle. Chaque
chef de gare, chaque cantonnier, chaque agent, ne sait que ce si se
passe dans son champ de vision immédiat et ne peut anticiper
qu’en fermant un signal, et, en cas d’accident, ne peut rien
empêcher. La présence du télégraphiste dans
chaque gare va donner au chemin de fer des yeux et des oreilles, et
une bouche pour parler. La sécurité et la fluidité
du trafic vont faire un immense bond en avant.
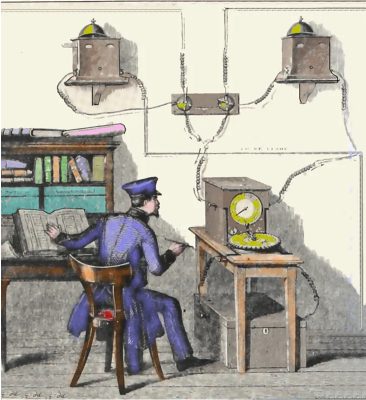
En France, c’est en 1845, pour la ligne Paris-Mantes, qu’est
installé le premier système de communication à
base d’impulsions électriques (Breguet et Foy). La même
année, sur Paris – Saint-Germain, un premier télégraphe
Morse est installé, c’est la naissance des télécoms
ferroviaires françaises.
A propos du télégraphe, une
anecdote mérite d’être rapportée : en 1844
M. Clarke, ingénieur au PO (Poste Office Britanique), rend compte
devant le conseil d’administration de deux informations : Arago
a présenté au Collège de France le système
Wheatstone auquel il est favorable, et lui-même, à
l’invitation de Brunel (patron du Great Western, Londres-Bristol),
a constaté les progrès considérables faits dans
son utilisation pratique pour la régulation et la signalisation
ferrovière. Il propose donc l’équipement
de la ligne de Paris à Orléans pour un coût
d’environ 2 000 F du km. Le conseil approuve et accorde 3 000 F
! Cet ingénieur d’origine irlandaise a été
tué, à son bureau de la place Valhubert, par une balle
perdue en 1848.
En France, dès 1847, le télégraphe électromécanique
Régnault équipa de nombreux postes de signaux.
Il permettait d’annoncer le train à la gare suivante ou
de rendre la voie de gare à gare . Parmi les autres appareils
et systèmes visant à ce même objectif et qui virent
le jour vers le milieu du 19e siècle, on peut citer certains
équipements qui étaient encore en fonction dans les années
50 sur certaines lignes secondaires :
- les cloches électriques. Un code simple était utilisé:
deux coups annonçaient un train de sens pair; trois coups pour
un train de sens impair;
- les appareils Jousselin dérivés du télégraphe
Breguet
La transmission d’information se faisait en positionnant une aiguille
sur un cadran d’horloge où les heures étaient remplacées
par des messages élémentaires. Sur un cadran identique,
une aiguille prenait la position homologue, dans le bureau distant De
la sorte, l’information parvenait à son destinataire.
La simplicité des appareils télégraphiques et leur
facilité d’utilisation sont primordiales pour que n’importe
quel employé ou même un étranger au service puisse
envoyer ou recevoir un message en cas de nécessité, en
particulier pour prévenir tout risque d’accident sur la
ligne.
Chaque station possède son poste de télégraphe
qui se compose d’un manipulateur comportant un cadran alphabétique
en laiton. Le fonctionnement de l’appareil est dit pas à
pas, c’est-à-dire que le message est envoyé lettre
par lettre en tournant la manivelle toujours dans le même sens
et en s’arrêtant successivement sur chaque lettre à
transmettre. Un habile dispositif d’horlogerie associe à
chaque lettre un jeu spécifique d’impulsions électriques
de telle façon qu’à la lettre indiquée par
la manivelle de l’émetteur corresponde à distance
la même lettre sur le récepteur. L’employé
au poste récepteur reconstitue le message en notant chaque lettre.
La vitesse de transmission peut atteindre cent lettres par minute.
Vers 1848 Louis Breguet mettait à son tour un appareil
à cadran pas à pas au point.
 Télégraphe
Breguet pas à pas
Télégraphe
Breguet pas à pas

Dès les années 1850, le chemin de fer a tellement besoin
du télégraphe pour assurer le mouvement des trains, leur
sécurité, la fluidité du trafic que dès
que la moindre panne du télégraphe se produit, les employés
de la compagnie de chemins de fer doivent immédiatement mettre
à la disposition du télégraphique une locomotive
prête au départ pour lui permettre d’aller voir ce
qui se passe, réparer le fil, et rétablir les communications.
Les règlements de 1858 imposent le télégraphe dans
toutes les gares, les dépôts, les ateliers, les cabines
d’aiguillage, dans tous les bâtiments, dans tous les lieux
actifs. Les pouvoirs publics tiennent à régler d’office
les techniques mises en œuvre et le rôle de chaque agent.
Tout est prévu, jusque dans le moindre détail.
Outre l’équipement télégraphique de chaque
station, le conducteur de train est muni d’un système de
télégraphe mobile, véritable poste ambulant qu’il
peut brancher sur la ligne, pour lui permettre de signaler un fait imprévu,
comme un arrêt forcé sur la voie.
Provoquées par le développement rapide des chemins de
fer dans le monde entier, les commandes de télégraphes
à cadran affluent à la Maison Breguet, venant des pays
d’Europe, mais aussi du Brésil et même du Japon...
En 1852, le télégraphe, qui se développe rapidement,
est mis à la disposition des voyageurs (le réseau public
ne verra le jour qu’en 1856).
La Téléphonie
Après 1845, l’étape importante est l’apparition
du téléphone venu des États-Unis (système
Bell) et dès 1880 on recense gare du Nord, par
exemple, 43 postes reliés à un commutateur manuel.
Ensuite, et jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale,
on assiste essentiellement, du point de vue ferroviaire, à la
construction de milliers de kilomètres d’artères
aériennes.
Pendant un siècle, télégraphie et téléphonie
vont modeler le paysage français, marquant le tracé des
voies ferrées encadrées généralement par
une artère double et une artère simple, exploitées
par les PTT et les chemins de fer.
Les circuits supportés par ces artères étaient
« basse fréquence », sans courants porteurs et sans
amplificateurs, d’où l’utilisation de fils de cuivre
de section importante et, pour les grandes distances, du télégraphe
exclusivement.
L’équilibrage électrique des circuits, par groupe
de quatre fils, était très soigné, permettant l’adjonction
de circuits dits « fantômes ». À noter que,
dès 1911, ces circuits supportaient parfois une distribution
centralisée de l’heure.
Les grandes compagnies de chemin de fer
1859, conventions ferroviaires État-compagnies : à
l’inspiration du duc de Morny, les lignes concédées
sont réparties en six grandes compagnies : - Compagnie
de Paris-Lyon-Méditerranée - Compagnie d'Orléans
- Compagnie du Midi - Compagnie du Nord - Compagnie de l'Est et Compagnie
de l'Ouest.
1878, nationalisation des réseaux ferroviaires des Charentes
(naissance du réseau de l'État).
17 juillet 1879, loi adoptant le plan Freycinet qui prévoit
un programme de travaux destiné à porter le réseau
ferré d'intérêt général de 29 600
kilomètres environ (dont 21 300 en exploitation) à 38
300, en y incorporant 8 800 km de lignes nouvelles à construire
(incluant 2 500 km de lignes d'intérêt local déjà
concédées). Ce plan qui devait permettre de desservir
toutes les sous-préfectures fut quasiment achevé en 1914.
20 novembre 1883, loi portant approbation des conventions avec les six
grandes compagnies.
1882 La PLM ou Paris-Lyon-Méditerranée (de
1882 à la fin de la 2ème guerre mondiale).
Dès 1870, c’est-à-dire avant l’apparition du téléphone articulant, M. Varley avait imaginé un système destiné à transmettre les sons musicaux concurremment avec les signaux télégraphiques Morse par la superposition d’ondulations électriques rapides et alternées perceptibles à l’oreille, mais u ayant aucun pouvoir mécanique ou chimique sur les courants télégraphiques.
1877 Le problème de l’appropriation
des lignes, soit à la télégraphie et à la
téléphonie simultanées, soit à la téléphonie
multiple, s’est posé peu de temps après la découverte
du téléphone de Bell et fut aussitôt mis à
l’étude.
Les premiers essais du professeur Karl Zetzsche, faits à Dresde
en 1877, qui déterminèrent la portée d’un
appareil téléphonique sur des fils télégraphiques,
amenèrent aussitôt à rechercher jusqu’à
quel point la téléphonie et la télégraphie
simultanées étaient possibles sur un seul fil sans gêne
réciproque. Zetzsche s’occupa de ce problème dès
cette époque et, pendant l’année 1878 même,
il publia plusieurs de ses recherches.
Un des dispositifs de Zetzsche est, dans son principe, indiqué
par la figure 1. Aux extrémités d’une ligne télégraphique
L1L2, dans les bureaux P et O, se trouvent respectivement les appareils
Morse M1 et M2, les batteries télégraphiques Bt et B2
et les postes téléphoniques F1 et F2 ; ces différents
organes sont montés en série. Les manipulateurs Tj et
T2 sont connectés à la ligne et aux batteries, de telle
façon que, par la manipulation, le circuit de ligne ne soit pas
interrompu, mais que seulement la batterie correspondante soit mise
en court circuit, ce qui diminue l’intensité du courant
de ligne.
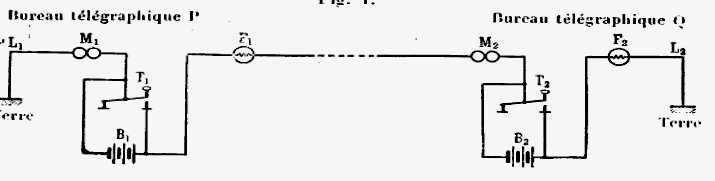
Ce montage est dit à courant différentiel . Zetzsche a
donc réalisé pour les courants téléphoniques
un circuit fermé avec la terre comme conducteur de retour, et
cela indépendamment des appareils télégraphiques,
qui peuvent transmettre ou non sur la ligne. Le seul changement qui
se produise dans le circuit téléphonique est dû
à la résistance intérieure de la batterie, qui
disparaît de la résistance totale chaque fois que le maniplulateur
est abaissé. On n’avait pas encore remarqué que la
self-induction des électro-aimants Morse était nuisible
à la transmission des courants téléphoniques :
alors encore au début de la téléphonie, on s’occupa
principalement de montrer qu’il était possible de faire
passer simultanément sur un seul fd un courant télégraphique
et un courant téléphonique et que1 chacun de ceux-ci était
capable d’agir séparément sur un récepteur
approprié.
Les recherches de Zetzsche se bornèrent à ce dispositif
et à quelques autres qui n’étaient guère plus
susceptibles de développement; il faut cependant dire que, dès
cette époque, d’autres dispositifs furent découverts
par application des essais d’Elisha Gray sur l’émission
et la réception simultanées de courant continu et alternatif.
En l’année 1881 encore, Zetzsche exprimait l’espoir
de réaliser la transmission simultanée d’un télégramme
et d’une conversation sur un conducteur télégraphique
par sitnple mise en série des appareils télégraphiques
et téléphoniques. Après cétte époque,
Zetzsche, lui-même, ne travailla plus à la solution de
ce problème.
Le second problème, la transmission simultanée sur une
seule ligne de plusieurs conversations sans troubles réciproques,
se présenta, lorsqu’on voulut réunir par des lignes
interurbaines plusieurs réseaux téléphoniques locaux.
Ce ne furent pas des considérations techniques ou scientifiques
qui déterminèrent ces recherches, comme dans le cas des
expériences de Zetzsche, mais bien des raisons économiques.
Comme on était alors impuissant à combattre l’induction
des courants téléphoniques d’une ligne sur l’autre,
on pensait ne pouvoir placer un très grand nombre de lignes sur
les mêmes appuis sans qu’il en résultât des
troubles dans les conversations : il paraissait donc nécessaire
de pouvoir réaliser plusieurs voies de communications avec peu
de conducteurs, voire même avec un seul. Afin de réduire
les frais d’installations dans une certaine mesure, le conseiller
intime supérieur Elsasser, de Berlin, proposa en 1885 un montage
à l’aide duquel deux communications pouvaient être
échangées simultanément sur chaque ligne . Le premier
montage d’Elsasser est représenté par la figure suivante
:
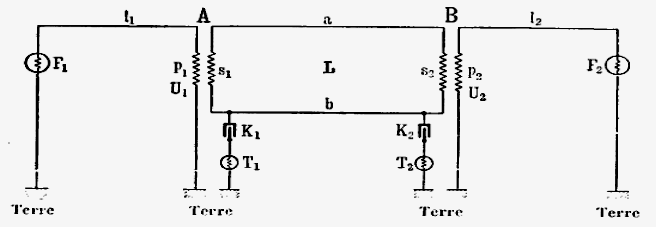
Le circuit bifilaire L, allant du bureau téléphonique
A au bureau B est fermé ses deux extrémités par
les secondaires S1 et s2 des transformateurs téléphoniques
U1 et U2. Les enroulements primaires des mêmes transformateurs
p1 et p2 sont insérés dans les circuits unifilaires d’abonnés
l1 et l2 ; F1, et F2 sont les postes de deux abonnés. Un deuxième
groupe d’appareils téléphoniques T1 et T2 est réuni
par l’intermédiaire des condensateurs K1 et K2, avec l’une
des branches du circuit (dans le cas présent, L,).
Avec ce montage, des postes d’abonnés quelconques, F du
réseau local A et F, du réseau local B, peuvent entrer
en communication ; par lespostes Tt et T2, Elsasser proposait de transmettre
seulement les communications téléphoniques des bureaux
A et B. Les deux couples d’appareils, Ft F2 et T1 T,, ne sont pas
indépendants l’un de l’autre. En effet, les courants
émis par l’appareil T1 ne sont pas uniquement transmis par
le conducteur L mais ils se dérivent aussi par la bobine de U1,
le conducteur L et la bobine s2 de U2 vers l’appareil T2 et réciproquement.
Il y a par conséquent transmission de ces courants des enroulements
s1 et s2 sur les enroulements p1 et p2 et les communications de service
peuvent donc être entendues des postes F1 et F2 ; les conversations
des abonnés seraient alors troublées par celles du service.
De plus, les communications entre T1 et T2 pouvaient être reçues
dans les récepteurs de T1 et T2, dès que l’isolement
de la ligne ne restait pas très élevé dans les
deux fils de la ligne. Les courants émis par T1 et T2 provoquaient
également de l’induction sur les circuits téléphoniques
doubles, équipés de la même manière et montés
sur les mêmes appuis. Enfin, il était possible avec ce
montage, malgré un bon isolement et l’emploi des condensateurs
K, et K2, d’avoir des bruits provenant de courants telluriques
dans le circuit bifilaire; ces bruits gênaient les conversations
et rendaient absolument vain l’emploi du double conducteur ...
Tel était la situation de la cohabitation du télégraphe
et du téléphone.
En 1880 on doit à un ingénieur
des télégraphes belges, M.
Van Rysselberghe, d’importantes recherches pour préserver
les fils télégraphiques de l’influence perturbatrice
des courants induits, résultant du voisinage des fils télégraphiques.
Il concoit un tel réseau pour toute la Belgique et ce concept
a aussi été adopté dans les réseaux de chemins
de fer Français comme nous allons le découvrir.
1889-1893 EMPLOI DU TELEPHONE DANS LES CHEMINS DE
FER
PAR MM. G. DUMONT et E. BERNHEIM
APPLICATIONS DIVERSES DE TÉLÉPHONE ET INSTALLATIONS
Dès linvention du téléphone par Graham Bell, en
1876, on pensa que les chemins de fer pourraient utilement employer
cet appareil pour la transmission facile et prompte des ordres, des
renseignements, des indications de toute nature qui doivent s’échanger
constamment entre le personnel des gares et de la ligne.
Il est évident qu’une conversation par téléphone
demande beaucoup moins de temps que le passage d’une dépêche
parle télégraphe, et que l’usage de cet instrument
n’exige aucune éducation spéciale.
Cependant, ce n’est que depuis quelques années que l’emploi
du téléphone a été franchement adopté
par les Compagnies. Son usage se développe rapidement et tend
à se généraliser. Le moment nous semble donc bien
choisi pour faire connaître à la Société
quels sont les services que le téléphone rend actuellement
et quels sont ceux qu’il peut rendre ; dans quelles conditions
il doit être installé et, enfin, quels sont les types d’appareils
les plus perfectionnés dont la pratique a sanctionné l’emploi.
Nous traiterons les deux premiers points de ce programme, laissant à
notre collègue, M. Bernheim, le soin de vous présenter
les divers systèmes de téléphone et de vous renseigner
sur leur mode de fonctionnement, les particularités de leur construction
et les avantages qu’ils présentent pour telle ou telle application.
sommaire
Il existe deux catégories d’appareils : le téléphone
magnétique et le micro téléphone.
Le téléphone magnétique imaginé par Bell
est merveilleux de simplicité, mais ilne permet de correspondre
distinctement qu’à une distance relativement faible.
En le combinant avec le microphone de Hughes, on a créé
le microtéléphone qui, plus compliqué, il est vrai,
que le téléphone magnétique, est incomparablement
plus puissant et est le seul à employer pour le service téléphonique
des chemins de fer, à part quelques exceptions, par exemple,
sur de petites lignes à trafic restreint et à stations
très rapprochées.
Le principal inconvénient que présente le microtéléphone,
c’est la nécessité d’employer des piles; le
téléphone BeL peut, au contraire, s’installer sans
cet accessoire, les appels se faisant alors par sonnerie magnétique.
C’est là un avantage évident qui a paru tellement
important que de nombreux inventeurs ont cherché pendant bien
des années à modifier le téléphone magnétique
de Bell pour le rendre plus puissant. La question a été
travaillée sous toutes ses faces et finalement on n’a rien
inventé de mieux que l’appareil primitif.
Ces recherches n’ont cependant pas été inutiles,
car elles ont fourni une série de renseignements précieux
sur l’influence que peut avoir sur le rendement de l’appareil
l’épaisseur, la dimension, la forme de la plaque vibrante,
la force et les dimensions de l’aimant qui forme le noyau de l'électro,
le diamètre et la longueur à donner au fil de la bobine,
les dimensions et les formes les plus convenables pour la boîte
de résonnance, etc., etc.
Ces renseignements, ces études si patientes et si complètes
ont été de la pJus grande utilité pour les constructeurs
qui sont maintenant arrivés à livrer des téléphones
de faibles dimensions, d’une grande légèreté,
d’un prix modique et donnant le rendement maximum que l’on
est en droit de demander à ces appareils.
Les téléphones magnétiques fabriqués par
la Société Générale des Téléphones,
généralement employés en France, ne pèsent
pas plus de 294 g.
Les téléphones étudiés par M. Mercadier
ont un diamètre de 3 cm et pèsent seulement 50 g.
Enfin, on fait des téléphones à boîtes d'aluminium
dont le poids est de 113 g.
Tous ces téléphones peuvent servir de récepteurs
pour les postes microtéléphoniques dont il nous paraît
utile d’indiquer les organes essentiels et le mode de fonctionnement.
Le microphone H (fig. 1,
PL 88) est constitué par deux ou plusieurs charbons placés
les uns au contact des autres et montés sous une plaque vibrante
devant laquelle on parle. Lorsque cette plaque est animée d’un
mouvement vibratoire, il en résulte au contact des charbons des
pressions variables qui modifient le courant de pile P dans le circuit
duquel ils sont intercalés. On a ainsi un circuit primaire (représenté
sur la figure par un trait ponctué) dont le régime se
trouve modifié par la parole. Dans ce circuit est intercalée
une bobine d’induction B dont le gros fil est parcouru par le courant
primaire. Les variations d’intensité de ce courant ont pour
résultat de produire dans le fil fin de la bobine des courants
d’induction qui passent dans la ligne (à simple ou à
double fil) aboutissant à un poste récepteur installé
d’une façon identique à celle du poste transmetteur.
Dans cette ligne, représentée sur la figure par un trait
interrompu, sont montés en tension les téléphones
magnétiques récepteurs R et RL Le schéma qui,ne
donne pas les organes accessoires tels que commutateurs, sonneries d’appel,
etc., permet de se rendre facilement compte de la marche des courants
dans les deux postes en correspondance. Les courants induits engendrés
dans la bobine B, arrivant dans les téléphones récepteurs
de chacun des deux postes y produisent des variations dans l’état
magnétique des noyaux aimantés, par suite des modifications
dans la force attractive que ces aimants exercent sur les plaques métalliques
des téléphones. Ces plaques se mettent à vibrer
à l’unisson des plaques microphoniques et reproduisent les
sons émis devant celles-ci. .
Ce schéma permet de comprendre également que s’il
existe parallèlement aux fils téléphoniques un
conducteur F, placé à peu de distance et dans lequel passent
des courants variables, ces courants produiront dans les fils de la
ligne téléphonique des courants d’induction qui,
arrivant dans les téléphones récepteurs des deux
postes, modifieront l’état magnétique de leurs aimants
et donneront lieu à des vibrations plus ou moins intenses dans
les plaques ; on percevra donc des sons anormaux qui viendront gêner
la transmission, ainsi que nous le verrons plus loin.
La figure de principe que nous avons cru utile de donner pour la compréhension
du fonctionnement de deux postes microtéléphoniques en
correspondance montre que le système est simple et que les appareils
sont peu compliqués. Leur rendement et leur bon fonctionnement
dépendent des proportions données à tous les organes
et de la bonne exécution de leurs différentes parties,
Notre collègue, M. Bernheim, vous décrira ces organes
en détail et vous pourrez constater par l’examen des divers
spécimens mis sous vos yeux que les constructeurs sont maintenant
arrivés à des types ne laissant rien à désirer
et se dérangeant fort rarement.
Il importe maintenant d’examiner l’influence que la longueur,
le diamètre des conducteurs et le métal dont ils sont
formés exercent sur la perception des sons articulés.
On peut converser téléphoniquement en employant une ligne
télégraphique ordinaire, c’est-à-dire une
ligne aérienne en fil de fer de 3 ou de 4 mm de diamètre,
à un seul conducteur, le retour se faisant par la terre.
C’est ce que l’on a tenté de faire tout d’abord,
car il était naturel d’utiliser les lignes existantes.
On trouve dans les ouvrages spéciaux la relation de nombreuses
expériences exécutées sur des lignes de cette nature
tant en France qu’à l’étranger ; nous pensons
qu’il est intéressant de vous faire part du résultat
de nos propres expériences.
Nous avons pu téléphoner entre deux stations réunies
par un fil télégraphique de 3 mm de diamètre en
fer, et de 140 km de longueur sans coupure, avec retour par la terre,
en employant des microtéléphones, système Àder,
du type ordinaire et des piles Leclanché.
On percevait encore des membres de phrases à 166 km de distance
en employant également un conducteur unique en fer de 3 mm de
diamètre, au moyen des mêmes appareils.
Nous avons expérimenté dans les mêmes conditions
les téléphones de M. Mercadier qui ont donné des
résultats un peu plus satisfaisants.
Mais une conversation suivie eût été bien difficile
pour des personnes n’ayant pas une bonne oreille ou manquant d’habitude.
De plusieurs essais répétés à diverses époques
de l’année et par différents temps, de façon
à pouvoir apprécier si l’état atmosphérique
(pluie, sécheresse, froid, chaleur, etc.) en modifiait les résultats,
il résulte que la transmission téléphonique, à
l’aide d’appareils du modèle courant, ne peut se faire
pratiquement, au moyen des conducteurs télégraphiques
en fer ordinaires, avec retour par la terre qu’à une distance
maximum de 25 à 30 km.
Il s’agit ici, bien entendu, de téléphones installés
dans des gares, c’est-à-dire dans des endroits forcément
bruyants, placés simplement dans des bureaux et non dans des
cabines téléphoniques.
On peut donc facilement annexer un appareil microtéléphonique
à l’appareil télégraphique dans les postes
desservis par les fils omnibus pour permettre à ces postes télégraphiques
de converser, si on juge utile de créer ce mode de correspondance
supplémentaire ; mais on ne pourrait utiliser les fils directs
pour mettre en relation l’administration centrale des grands réseaux
des chemins de fer français, situées toutes à Paris,
avec le personnel supérieur des sections d’exploitation
de ces réseaux, en résidence dans des villes dont la plupart
sont à de grandes distances de Paris.
L’impossibilité de correspondre téléphoniquement
à grande distance sur les lignes télégraphiques
en fer à un seul conducteur tient à plusieurs causes,
savoir :
1° A la trop grande résistance électrique du fer qui
constitue ces lignes.
Le fil de fer de 3 mm de diamètre a une résistance kilométrique
de 18 ohms, tandis qu’un fil de bronze phosphoreux de 1,6 mm de
diamètre à 95 0/0 n’a dans les mêmes conditions
qu’une résistance de 8,46 ohms.
2° A la trop grande capacité électrostatique du fer.
Cette capacité pour un fil de fer de 3 mm de diamètre
est de 0,01 microfarad par kilomètre, tandis que celle du fil
de bronze phosphoreux de 1,6 mm de diamètre à 95 0/0 est
seulement de 0,005.
3° A la grande self-induction du fer.
Cette self-induction par rapport à celle du cuivre est près
de six fois plus grande.
4° A l’emploi de la terre comme fil de retour.
Ce qui a pour conséquence de permettre aux courants telluriques
de passer à certains moments dans les conducteurs et de gêner
ainsi la propagation des courants téléphoniques.
5° Enfin à l’induction des fils télégraphiques
voisins de celui affecté au service des téléphones.
Cette dernière cause a une grande importance.
Nous avons déjà fait remarquer que les courants télégraphiques
circulant dans un fil placé parallèlement et à
peu de distance d’un fil téléphonique, déterminent
dans ce dernier des courants induits qui produisent dans les téléphones/
un crépitement très intense, semblable à celui
que produit la graisse en ébullition, et qui, pour cette raison,
a été fort justement désigné sous le nom
de friture.
Ce bruit rend fort difficile la perception des paroles transmises et,
à certains moments, rend même cette perception absolument
impossible.
Il est évident que si l’on parvenait à éliminer
ou du moins à atténuer l’induction des fils télégraphiques
voisins de celui affecté au téléphone, on pourrait
reculer la limite de 30 km assignée ci-dessus pour une bonne
transmission sur. une ligne à un seul conducteur, en fer, de
3 mm de diamètre.
Tel a été le problème que se sont posé
beaucoup d’inventeurs et qui a été résolu
avec un certain succès par M. Van Rysselbergbe en Belgique et
par M. Gwozdeff en Russie.
sommaire
Le système de M. Van Rysselbergbe repose sur le principe suivant
:
Lorsqu’on supprime la brusquerie des émissions et des extinctions
des courants, ceux-ci deviennent inauditibies au téléphone.
Il s’agissait donc de substituer aux courants brusquement émis
et brusquement interrompus par les appareils télégraphiques,
des courants graduels, c’est-à-dire qui vont crescendo en
commençant et decrescendo en finissant.
Cette gradation qui a lieu dans un laps de temps inappréciable
s’obtient par l’intercalation dans le circuit de petits électroaimants
graduateurs, ou encore en mettant sur la ligne des condensateurs faisant
l’office de dérivateurs, ou enfin en combinant des électro-aimants
avec des condensateurs afin d’obtenir des résultats plus
parfaits.
Condensateurs et électro-aimants agissent alors comme réservoirs
d’électricité absorbant une certaine quantité
de courant, quantité qu’ils restituent à la rupture
du circuit.
A cerlains moments de la journée la transmission s’eüectuait
beaucoup plus facilement dans un sens que dans l’autre, tandis
qu’à certains autres moments, au contraire les communications
devenaient plus faciles dans le sens opposé. Ces ditlérences
avaient évidemment une certaine corrélation avec le sens
des courants telluriques qui passaient dans les conducteurs reliant
les deux postes en correspondance.
L’inventeur a d’ailleurs caractérisé le rôle
de ces organes en disant qu’ils agissent à l’égard
des courants électriques comme les réservoirs à
air dans les pompes d’incendie : ce sont des poches qui se vident
et se remplissent graduellement, enlevant ainsi toute brusquerie dans
les changements de pression électrique. Sous l’influence
de courants gradués de cette façon, la membrane du téléphone
fléchit bien encore, mais ne vibre plus, et dès lors ne
donne plus de son au passage du courant télégraphique.
En d’autres termes, les courants télégraphiques deviennent
complètement silencieux, inauditibles, qu’ils soient directs,
induits ou dérivés.
En complétant le système anti-inducteur par une autre
catégorie d’appareils, le système Van Rysselberghe
permet de téléphoner et télégraphier simultanément
sur les mêmes fils. Il est bien entendu qu’on ne peut pas
en général se servir des fils télégraphiques
existants, les lignes téléphoniques exigeant des conditions
particulières de conductibilité. Donc, l’application
du système Van Risselberghe nécessite, au préalable,
l’établissement d’une ligne soit en bronze silicieux,
soit en fil d’acier ou de fer galvanisé de diamètre
assez important.
Ce système fonctionne : il est appliqué sur une assez
grande échelle en Belgique
; il a été essayé dans d’autres pays, mais
il exige, comme on l’a vu, la réfection de la ligne et la
modification de tous les postes télégraphiques sans exception,
ce qui entraîne à des dépenses fort grandes et d’un
ordre comparable à celles que nécessiteraient l’établissement
d’une ligne téléphonique spéciale et l’usage
de deux lignes, l’un pour le téléphone, l’autre
pour le télégraphe ; aussi a-t-on jugé dans bien
des cas qu’il vaut mieux avoir recours à ce dernier moyen.
On pourrait encore opposer au système Van Rysselberghe une autre
critique assez grave : c’est de retarder la vitesse de manipulation
du télégraphe Morse et d’être inefficace pour
l’extinction des bruits d’induction produits par la manipulation
des appareils multiples (Baudot, Wheatstone, etc.) employés,
non sur les réseaux des voies ferrées, mais sur les lignes
de l’administration des télégraphes.
Telles sont les raisons pour lesquelles le système après
essai entre Paris et Bruxelles sur les lignes de l’État
n’a pas été adopté ; ces raisons suffisent
également, croyons-nous, pour enlever au système toute
chance d’être appliqué sur les lignes du réseau
télégraphique des Compagnies de chemins de fer français.
Le système Gwozdeff présente quelque analogie avec
celui de M. Van Rysselherghe ; il est caractérisé
également par l’emploi de condensateurs, mais de capacités
très différentes alors que ceux du système Van
Rysselherghe sont de même capacité.
Ainsi M. Gwozdeff donne au condensateur du microphone une capacité
de 1 à 10 microfarads, et à celui du téléphone
une capacité de 0,02 à 0,023 microfarad , soit une capacité
40 à 50 fois moindre.
On fait usage aussi de déchargeurs analogues à une clef
Morse pour éviter la charge de la ligne pendant le passage des
courants téléphoniques, et ensuite sa décharge,
ce qui rend moins brusque la diminution de l’oscillation électrique.
Enfin, certains perfectionnements ont été apportés
aux microphones dans le but de les approprier aux transmissions à
grande distance.
Les premiers essais du système datent de 1888-89; ils ont eu
lieu sur la ligne télégraphique du chemin de fer Rybinsk-Bologoë.
On a pu converser à 294 km sur un conducteur en fer et, pendant
le travail sur cette ligne, des appareils télégraphiques
étaient continuellement en jeu.
Si nous insistons sur ce système de téléphonie,
c’est que les chemins de fer russes de Kozloff-Voronège-Rostov
et de Saint-Pétersbourg-Varsovie l’ont installé pour
les besoins de leur service.
On correspond ainsi téléphoniquement :
De Saint-Pétersbourg à Pskov,- à une distance de
284 km,
De Saint-Pétersbourg à Louga (138 km),
Entre Saint-Pétersbourg et Alexandrowka et à Gatschina.
De plus, entre Saint-Pétersbourg et Alexandrowka, on a installé
onze postes téléphoniques de pleine voie desservis par
un fil unique spécial ; chaque poste comprend un microphone et
deux téléphones récepteurs.
Les gardiens sont appelés aux téléphones par un
rugissement spécial que produisent ces appareils sous l’influence
de courants d’induction lancés à travers la ligne
entière par le circuit secondaire d’une bobine de Rhumkorff
au moyen d’interruptions réitérées du courant
de son circuit primaire. Le gardien ainsi appelé,s’informe
quelle est la station qui veut correspondre avec lui : Saint-Pétersbourg
ou Alexandrowka.
Enfin, sur les chemins de fer russes pourvus de ces installations téléphoniques,
on peut converser au moyen de postes téléphoniques portatifs
d’un point quelconque de la ligne avec les stations voisines.
Ainsi, sur certaines lignes de chemins de fer russes on a réalisé
la transmission acoustique à des distances de plusieurs centaines
de kilomètres au moyen des conducteurs télégraphiques
ordinaires. Pour les conversations à grande distance, on a réuni
en boucle deux conducteurs télégraphiques.
Nous ne connaissons aucune installation de ce genre sur les chemins
de fer français et, ainsi que nous le faisions^remarquer plus
haut, l’administration des télégraphes n’a pas
cru devoir adopter les systèmes anti-inducteurs pour l’utilisation
de son réseau télégraphique lorsqu’elle a
eu à créer la téléphonie interurbaine. Elle
a préféré poser des lignes spéciales en
cuivre de haute conductibilité permettant de correspondre très
nettement à des distances considérables (par exemple de
Paris à Marseille, distantes de 863 km), et qui ne nécessitent
pas la modification de tous les postes télégraphiques.
Nous pensons que cette mesure radicale est en effet la meilleure et
qu’elle devra être imitée par les Compagnies de chemins
de fer si elles jugent utile de créer un réseau téléphonique.
sommaire
Mais, comme ces conducteurs téléphoniques sont posés
sur les poteaux supportant déjà des fils télégraphiques
et sont, par conséquent, à de faibles distances de ces
fils, il faut éviter les effets d’induction dont il a été
parlé.
Il existe pour cela un moyen fort simple et complètement efficace
consistant à constituer la ligne téléphonique de
deux conducteurs et de les croiser alternativement à des distances
déterminées.
Il est facile de démontrer que dans ces conditions on réussit
à annuler l’induction d’un conducteur télégraphique
A sur les conducteurs téléphoniques voisins B et G (fig.
2, PL 88).
Supposons que ce conducteur A soit distant de longueurs d et d' des
fils téléphoniques B et G tendus parallèlement.
Pendant sa période variable, le courant télégraphique
engendre dans chaque fil téléphonique une force électromotrice
proportionnelle :
1° A la longueur sur laquelle l’action inductrice se produit
;
2° Au coefficient d’induction mutuelle par unité de
longueur des deux fils considérés ;
3° A la vitesse de variation d’intensité du courant
inducteur.
Si donc nous appelons :
Eb et Ec les forces électromotrices d’induction du fil télégraphique
A avec chacun des fils B et G ;
L la longueur de ces fils depuis l’origine jusqu’au premier
point de croisement;
Mb et Mc les coefficients d’induction mutuelle par unité
de longueur de chacun des fils B et C ;
di/dt la vitesse de variation d’intensité du courant inducteur
; Nous aurons (fig. 3, PL
88)
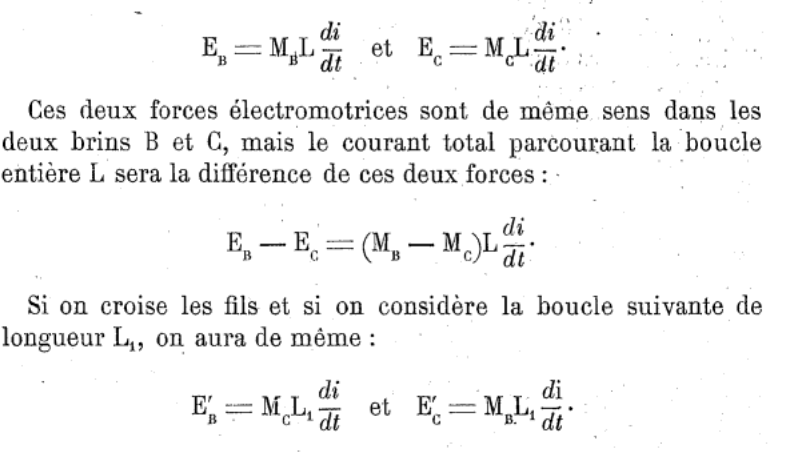
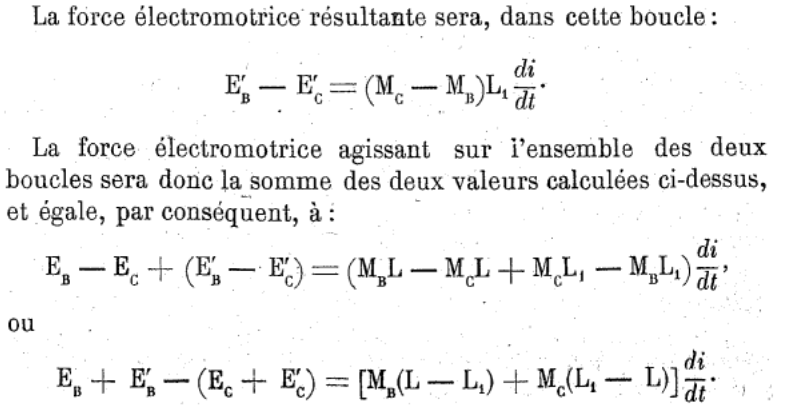
Cette équation montre que la force électromotrice résultante
sera nulle lorsque, les longueurs L et L, seront égales, étant
bien entendu que d’un bout à l'autre de la ligne les deux
brins du circuit induit se trouvent dans les mêmes conditions
électriques, c’est-à-dire ont le même isolement,
la même capacité et la même self-induction.
L’isolement et la résistance kilométrique seront
sensiblement les mêmes pour les deux fils, ainsi que leur capacité,
puisque ces fils sont généralement à une distance
de 6 à 8 m du sol et de 0,40 m à 0,50 m l’un de l’autre.
Il suffit donc d’équilibrer le coefficient de self-induction
dans les deux fils induits ; c’est à quoi on arrive facilement
en intercalant convenablement dans chacun d’eux les postes téléphoniques.
Si on considère par exemple une ligne à deux conducteurs
f et f' (fig. 4, PL 88)
desservant deux postes téléphoniques intermédiaires
entre ses deux postes terminus, soit au total quatre postes, et si on
suppose que cette ligne téléphonique soit placée
à côté de deux conducteurs télégraphiques,
l’un AB, continu sur tout le parcours, l’autre CD, prenant
terre en D, ou divergeant en ce point, on devra disposer les choses
comme l’indique le croquis.
En croisant les fils téléphoniques au milieu de CD on
annulera l’induction du fil CD et de la partie AE du fil AB ; en
les croisant de nouveau à mi-distance des points D et B, on équilibrera
le restant de la ligne téléphonique par rapport à
la. partie EB du fil AB.
En pratique il est prudent de multiplier les croisements et on a obtenu
de bons résultats en les installant tous les 500 m. En admettant
ce dernier chiffre, connaissant le nombre de sections délimitées
par l’arrivée, le départ ou la mise sur terre de
fils télégraphiques, et remarquant enfin que sur chaque
section partielle on devra avoir un nombre impair de croisements afin
de pouvoir les espacer sur des longueurs égales dans chaque section,
on pourra connaître immédiatement la distance approximative
de chacun de ces croisements en divisant la longueur de la section par
500.
Si le quotient est un nombre impair, le chiffre pourra être admis,
s’il est pair on l’augmentera d’une unité et le
nombre de croisements étant ainsi déterminé, une
nouvelle division par ce nombre de la longueur linéaire de la
section donnera leur distance (1).
(1) Exemple : On a une ligne téléphonique à
deux conducteurs parallèles à trois fils télégraphiques
ayant respectivement 2 300, 3 800 et 8 400 m de longueur. (fig.5,
PL 88).On devra installer entre A et B un nombre de croisements
égal à 230/500 = 4,6, soit 5
Si on avait parallèlement à ce circuit téléphonique
un deuxième circuit téléphonique, on considérerait
celui-ci comme formant un circuit télégraphique de sections
égales à celles déterminées par les croisements
et on agirait à l’égard de ce circuit comme on l’a
fait à l’égard du circuit télégraphique
ÂBCD.
Le croisement se fait très simplement à l’aide d’isolateurs
ordinaires, ainsi que le montre la figure fig.6,
PL 88.
Ainsi, pour les installations téléphoniques des chemins
de fer, quelle que soit d’ailleurs l’importance de l’installation,
nous pensons qu’il est de beaucoup préférable de
recourir à des lignes à deux conducteurs en bronze de
0,0015 m de diamètre, dans le cas où on ne peut se servir
de poteaux existants et dans celui où on utilise les poteaux
d’une ligne télégraphique existante. Les tableaux
suivants permettent de se rendre compte de la différence des
prix qui existent dans ces deux cas entre la ligne téléphonique
à deux conducteurs et celle à un seul conducteur.
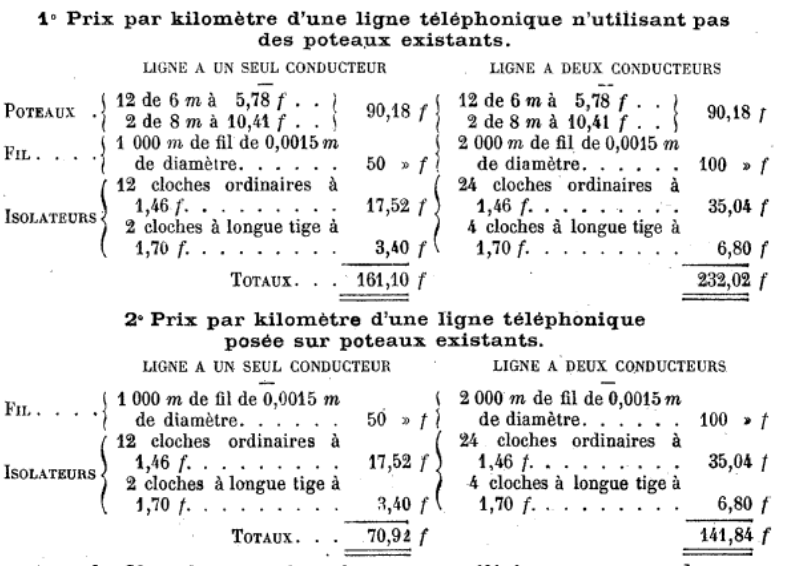
Avec le fil en bronze phosphoreux ou silicieux on peut admettre des
portées de 90, 100 et même 120 m.
Il est utile de faire remarquer cependant que ce fil présente
un inconvénient : il a une grande affinité pour le givre
et se recouvre en hiver d’une couche de glace atteignant parfois
plusieurs centimètres de diamètre, ce qui occasionne une
surcharge anormale et cause la rupture du conducteur. (Cette affinité
est probablement due à la grande conductibilité calorifique
du cuivre, qui atteint presque sept fois celle du fer.)
Cet inconvénient, grave dans les pays froids (et qui est encore
augmenté par ce fait que la contraction du fil de bronze est
plus grande que celle du fil de fer) peut être atténué
en prenant du fil ayant seulement 30 0/0 de conductibilité électrique
(au lieu de 95 0/0 qui est la conductibilité ordinairement admise),
ce qui permet d’employer un bronze dont la résistance mécanique
est double de celle du bronze à 95 0/0.
Ceci posé, nous allons passer en revue les emplois du téléphone
:
1 ° Dans les grandes Compagnies de chemins de fer ;
2° Dans les Compagnies secondaires.
sommaire
I. — EMPLOI DU TÉLÉPHONE DANS LES GRANDES COMPAGNIES
DE CHEMINS DE FER
Depuis quelques années, les grandes Compagnies de chemins de
fer emploient le téléphone dans une assez large mesure
et sont disposées, croyons-nous, à l’étendre
encore davantage.
On peut classer ces applications en cinq catégories, savoir :
1 ° Application du téléphone pour les communications
intérieures ;
2° Relations avec les réseaux urbains et les particuliers
;
3° Relations dans les gares et leurs dépendances ;
4° Relations de gares à gares ;
5° Relations des agents de la voie et des trains avec les gares,
ou des agents de la voie entre eux.
4° Application du téléphone pour les communications
intérieures
1° Le téléphone existe maintenant, pour les relations
intérieures, dans les bâtiments d’administration des
grands réseaux français, à Paris, et dans les principales
gares, siège d’inspections régionales. Il y rend
d’incontestables services au point de vue de la célérité
et de la commodité. ,
Le réseau intérieur comprend généralement
un poste central desservi par un employé mettant en relation
lés bureaux qui ont besoin d’entrer en communication. Cette
organisation n’offre rien de particulier ; il n’y a donc pas
lieu d’insister.
2° Relations avec les réseaux urbains et les particuliers
Les Compagnies de chemins de fer ont intérêt à se
relier aux réseaux urbains. A Paris notamment, les différents
services des administrations centrales sont en relation, par le téléphone,
avec les abonnés du réseau et peuvent traiter rapidement
les affaires, en évitant souvent une correspondance écrite
et des courses d’agents.
Certaines gares sont également reliées au réseau
urbain de la localité qu’elles desservent et peuvent, par
conséquent, recevoir directement de leurs clients les demandes
de wagons ou de renseignements qui leur sont faites.
Ici, le téléphone facilite singulièrement les relations
entre les Compagnies et les expéditeurs ou destinataires de marchandises
; aussi le système est-il largement employé à l’étranger.
En France, on ne peut citer que des applications beaucoup plus restreintes,
dans des villes d’une certaine importance, car le taux beaucoup
trop élevé des abonnements impose aux Compagnies l’obligation
de restreindre le nombre des installations.
Dans certains cas, de grands usiniers font, à leurs frais, l’installation
d’appareils entre leurs bureaux et la gare avec laquelle ils sont
journellement en rapport. Les Compagnies de chemins de fer se prêtent
à ces sortes d’installations qui sont très utiles
aux industriels.
3° Relations dans les gares et leurs dépendances
Dans les gares, on fait usage' actuellement du téléphone
pour relier le chef de service avec les bureaux de la gare aux marchandises,
les différents- postes d’aiguilleurs, le dépôt
des machines, les ateliers, etc., et pour mettre en relation directe
ces différents postes entre eux.
Certaines gares sont donc maintenant pourvues d’un véritable
réseau téléphonique, avec un poste central et quelquefois
des postes secondaires à plusieurs directions, permettant d’échanger
une foule de renseignements utiles et même de donner des ordres
ri intéressant pas directement la sécurité de V
exploitation.
Les dépêches téléphonées qui peuvent
engager la responsabilité de ceux qui les transmettent et de
ceux qui les reçoivent doivent être inscrites sur un registre
spécial qui tient lieu du procès-verbal télégraphique
et elles sont, de plus, collationnées.
Dans les installations téléphoniques ayant pour but d’établir
une correspondance entre les divers postes d’une même gare,
il s’agit de faire une distinction nette entre ceux de ces postes
qui servent à l’échange de dépêches
proprement dites, c’est-à-dire à demander des renseignements
ou à transmettre des ordres ou des-explications relatifs aux
détails du service, et ceux qui sont exclusivement destinés
à transmettre phoniquement des ordres relatifs à l’entrée
ou à la sortie des trains et à la manœuvre des signaux
et des aiguilles.
Dans ce dernier cas qui se présente, par exemple, lorsqu’on
crée une relation entre une cabine Saxby et un poste d’aiguilleurs,
le téléphone remplace un appareil à voyants ou
à signaux acoustiques et doit être considéré
comme tel. Il n’est donc pas à proprement parler un appareil
télégraphique lorsqu’il est affecté à
cet usage spécial.
4° Relations de gares a gares
Les Compagnies du Nord et de l’Est ont été les premières,
en France, à remplacer les appareils télégraphiques
Bréguet à signaux fugitifs, seuls en usage autrefois sur
les chemins de fer, par des télégraphes Morse écrivants,
dans le but d’augmenter la sécurité en établissant
nettement les responsabilités de ceux qui transmettent des ordres
importants et de ceux qui les reçoivent.
Cet exemple a été suivi depuis par la Compagnie de P.-L.-M.
et par la Compagnie de l’Ouest qui a actuellement opéré
cette transformation dans les deux tiers de ses postes télégraphiques.
Seule, la Compagnie de Paris à Orléans a persévéré
dans l’emploi, exclusif du télégraphe à cadran.
Cette condition de responsabilité, dans l’expédition
des dépêches intéressant la sécurité,
a donc paru suffisamment importante pour justifier des dépenses
assez considérables et pour passer sur les difficultés
résultant de l’obligation d’enseigner aux agents la
manipulation du télégraphe Morse.
A vrai dire, cette manipulation, qui peut paraître plus difficile
au premier abord que celle du télégraphe Bréguet,
s’apprend assez, promptement, ainsi que l’expérience
l’a démontré ; d’autre part, la lecture des
bandes Morse qui portent les signaux transmis est incomparablement plus
aisée que celle du télégraphe à cadran,
puisque l’aiguille de ce dernier appareil s’arrêtant
sur chaque lettre ou sur chaque chiffre pendant un temps extrêmement
court, le lecteur doit, pour ainsi dire, saisir au vol le signal qui
lui est transmis et se rappeler les lettres qui ont passé. D’où,
une contention d’esprit et une attention fort grande qui sont une
cause de fatigue. Enfin, avec le télégraphe à cadran
il serait certainement impossible d’assurer un service aussi tendu
que l’exige actuellement l’activité de la circulation
des trains sur certaines lignes.
Ainsi se trouverait justifié l’usage du télégraphe
Morse, abstraction faite de la question de sécurité.
Il est naturel que les Compagnies qui font exclusivement usage du télégraphe
à cadran à signaux fugitifs et qui considèrent
ce mode de transmission comme présentant sufïisaniment de
sécurité, songent à y substituer le téléphone
qui est un moyen de correspondance incontestablement plus rapide. Toutefois,
le téléphone présente un inconvénient qu’il
est bon de signaler et qui peut avoir son importance dans le cas qui
nous occupe : certains sons se transmettent mal et peuvent prêter
à équivoque ou même à fausse interprétation
; certains nombres, notamment, ont même consonnance, par exemple
10 et 6,1 et 20, et il est à craindre que même en collationnant
la dépêche on ne relève pas l’erreur.
Malgré cela, il y a actuellement une tendance de la part de certaines
administrations à généraliser l’emploi du
téléphone, même lorsqu’il s’agit de transmettre
des ordres importants. En faisant abstraction des petites lignes d’intérêt
local, où le service se fait en navette et où, à
la rigueur, on pourrait se passer de tout système de correspondance,
on peut citer des lignes à faible trafic, il est vrai, mais sur
lesquelles il peut y avoir des changements de croisement, où
on a adopté le téléphone.
Au point de vue purement technique, la substitution du téléphone
au télégraphe sur les grandes lignes rencontrerait des
difficultés de plusieurs ordres : les conducteurs à fil
unique, en fer, servant actuellement au télégraphe sont
insuffisants à assurer une bonne communication téléphonique
entre des gares assez éloignées les unes des autres, d’abord
à cause des différentes raisons que nous avons données
au début de cette note, et ensuite à cause de la proximité
de nombreux conducteurs servant aux appareils de contrôle de toutes
natures, qui sont posés la plupart du temps sur les mêmes
poteaux. Il faudrait donc établir des lignes spéciales
à double fil pour assurer, dans de bonnes conditions, les communications
téléphoniques et la dépense qui résulterait
de l’établissement de ces conducteurs serait grande.
Sans préjuger de l’avenir, notre opinion personnelle est
donc que sur les lignes à grand trafic, le téléphone
peut être une annexe très utile du télégraphe
Morse, mais ne saurait le remplacer entièrement.
Nous pouvons citer un cas où le téléphone, considéré
comme auxiliaire du télégraphe, rend des services importants,
en décrivant l’installation réalisée sur la
ligne de Vincennes, dans chacune des gares comprises entre Paris-Bastille
et La Varenne.
On fait usage des fils télégraphiques existants et l’installation
est caractérisée par ce fait que les postes doivent constamment
rester sur télégraphe. La relation téléphonique
n’est établie que sur un signal conventionnel passé
au Morse. Dans ces conditions, les appareils d’appel du téléphone
n’ont plus raison d’être, puisque l’appel se fait
par la sonnerie du poste télégraphique.
La disposition d’un poste intermédiaire quelconque, représentée
par le schéma (fig.
7, PI. 88), est la suivante :
La borne du manipulateur et la borne de réception du commutateur
de lignes, au lieu d’être reliées directement, sont
mises en communication par l’intermédiaire du téléphone,
lorsque son récepteur de droite maintient le crochet commutateur
abaissé. Les relations télégraphiques peuvent donc
avoir lieu comme si rien n’avait été changé
au dispositif primitif du poste télégraphique.
Si le poste de gauche Pt veut parler avec le poste P, il demande à
ce dernier de se placer au téléphone ; cette demande étant
faite par télégraphe, la fiche du commutateur de lignes
de chacun de ces postes est sur réception. Les choses restant
dans cet état, l’agent se porte au téléphone
et décroche les deux récepteurs ; il isole par ce seul
fait l’appareil Morse et peut engager la conversation avec son
voisin. Pendant ce temps, le poste de droite P2 peut néanmoins
attaquer le poste P dont la sonnerie déclenche. La conversation
terminée, les récepteurs sont replacés sur leurs
crochets et l’appareil Morse rentre dans le circuit, le téléphone
se trouvant à son tour isolé. L’agent n’a plus
qu’à remettre la fiche du commutateur sur sonnerie, absolument
comme s’il venait de recevoir une. dépêche par télégraphe.
L’installation faite dans ces conditions ne change en rien les
habitudes du personnel, ce qui est important, et, dans aucun cas, la
communication télégraphique ne peut être interrompue,
puisque les récepteurs téléphoniques doivent forcément
être replacés sur leurs crochets.
La mise en service d’appareils téléphoniques concurremment
avec le Morse a donné d’excellents résultats sur
la ligne de Vincennes, où les stations sont très rapprochées
les unes des autres (1 500 m en moyenne). Il arrivait, en effet, qu’une
dépêche transmise par télégraphe exigeait
pour parvenir d’une gare voisine, un temps plus long que n’en
mettait un train pour effectuer le trajet. Aussi, dans la pratique,
les communications urgentes qui n’intéressaient pas directement
la sécurité ou qui n’engageaient pas la responsabilité
de la Compagnie étaient-elles faites par correspondance écrite.
Depuis que l’on dispose du téléphone, on s’en
sert pour passer les dépêches concernant :
Les demandes de matériel,
Les avis de prises de route,
La répartition du matériel,
Les renforcements de trains,
Les compartiments à réserver,
Les colis en plus ou moins,
Les demandes de remplacements d’agents,
Les interruptions ou les défauts dans le fonctionnement des appareils
télégraphiques, signaux, aiguilles, horloges, etc. (dépêches
au chef de district, au contrôleur du télégraphe,
ou aux ouvriers de l’entretien),
Et généralement toutes les dépêches n’intéressant
pas la sécurité ou la circulation des trains.
Toutes ces dépêches sont collationnées et inscrites
sur un registre spécial.
Toutes les dépêches ayant un caractère officiel
ainsi que les télégrammes privés sont, comme par
le passé, transmis télégraphiquement .
En cas d’urgence, par exemple pour signaler des wagons en dérive
ou un accident quelconque, pour demander le secours, pour annoncer un
retard de train, la mise en marche d’un train facultatif ou extraordinaire.,
on peut faire usage du] téléphone ; mais la dépêche
téléphonée doit être confirmée dans
le plus bref délai possible par le télégraphe.
Bien entendu, en cas d’interruption momentanée du service
sur une des voies, toutes les dépêches relatives soit à
l’organisation d’un service de voie unique, soit à
la'circulation des trains ou machines sur voie unique, ne sont exécutoires
qu’autant qu’elles ont été transmises par le
télégraphe. Toutes les prescriptions que nous venons d’énoncer
ont été consignées dans un ordre de service adressé
à toutes les gares intéressées,
5° Relations des agents de la voie et des trains avec les gares
ou des agents de la voie entre eux
Certaines Compagnies ont installé, depuis longtemps déjà,
des postes télégraphiques en pleine voie, de distance
en distance, pour permettre aux agents des trains de demander du secours
aux stations voisines en cas d’accident ; mais ce système
implique l’obligation d’avoir des agents de trains sachant
se servir du télégraphe .
Dans certaines autres Compagnies, on a utilisé dans le même
but des postes télégraphiques portatifs ; mais ce système
n’est pas pratique parce qu’il exige pour son installation
des agents spéciaux et que cette installation cause, dans la*plupart
des cas, une interruption dans la transmission des dépêches.
On a alors songé à remplacer le télégraphe
par le téléphone et à employer, soit des postes
de secours répartis de distance en distance le long de la voie,
soit des postes téléphoniques portatifs.
Nous trouvons un exemple du premier système à la Compagnie
du Nord, qui emploie, à titre d’essai, sur certaines de
ses grandes lignes, des postes téléphoniques de secours
permanents, et qui en a, également installé sur plusieurs
lignes à faible trafic. Cette installation nécessite,
Bien entendu, l’annexion aux postes télégraphiques
des stations, de récepteurs téléphoniques. On s’est
servi, pour ces essais, de récepteurs et de transmetteurs du
type Ader, modèle réduit.
La Compagnie d’Orléans a également installé,
sur certaines sections, des téléphones aux postes des
gardes-barrières, pour permettre à ces derniers de communiquer
avec les gares voisines.
Ces installations, faites jusqu’à présent au double
fil, comprennent :
1° Pour la gare, un poste magnétique fixe composé
d’un téléphone transmetteur, de deux téléphones
récepteurs, d’un appel magnétique à manivelle
et d’un paratonnerre à pointes (modèle spécial
étudié par la Compagnie d’Orléans) portant
une manette pour mettre la ligne à la terre en cas d’orage.
Le tout est monté sur un panneau avec crochet commutateur et
crochet fixe, ainsi que le montre la figure 8,
PL 88.
La sonnerie magnétique est toujours actionnée aû
départ par l’appel magnétique, ce qui permet de constater
le départ du courant à la sortie du poste.
Le tableau central (système Sieur) est muni d’annonciateurs
et de commutateurs du modèle ordinairement employé pour
les installations bourgeoises.
2° Au poste de garde-barrière, l’installation est en
tout point semblable à la précédente (1).
Les transmetteurs magnétiques sont munis d’une sorte d’embouchure
dans laquelle il faut parler, ce qui donne lieu à quelques plaintes,
surtout quand plusieurs agents doivent se servir de l’appareil.
Pour les faibles distances, le téléphone purement magnétique
donne de bons résultats ; mais pour les grandes distances, la
perception des sons devient difficile, les transmetteurs ayant une puissance
insuffisante.
Les postes téléphoniques portatifs sont en usage sur certaines
petites lignes exclusivement exploitées par téléphone,
ainsi que nous le verrons plus loin ; mais nous trouvons également
un •exemple de cette application sur les grandes lignes du réseau
des chemins de fer autrichiens.
On emploie sur ces lignes un téléphone de campagne du
système Gattinger qui, paraît-il, peut être installé
en quelques minutes sur un point quelconque de la voie, même par
des agents ne possédant aucune instruction technique. Son emploi
n’interrompt pas la communication télégraphique entre
les stations. Enfin, il paraît que ce téléphone
dont nous regrettons de ne pouvoir donner une description détaillée,
ni les dessins, permet, dans •des conditions favorables, de correspondre
même à 50 km de distance à l’aide des fils
télégraphiques directs.
Nous avons dit qu’on employait des postes téléphoniques
portatifs sur certaines petites lignes : le poste en essai sur la petite
ligne d’Anvin à Calais par exemple, se compose d’un
bouton d’appel, d’un microphone, d’un téléphone
d’une sonnerie à grande résistance, d’un commutateur
de dérivation pour la sonnerie et le téléphone,
et de dix éléments de pile Leclanché. Le tout est
contenu dans une boîte de 0,33 mtde hauteur, de 0,30 m de largeur,
de 0,20 m de profondeur, du poids total de 10 kg.
Il est d’autres applications que l’on peut signaler comme
pouvant peut-être rendre service dans certaines circonstances.
(1) La figure 8, PI. 88
donne le schéma de montage d’un poste de gare à trois
directions, en relation avec des postes de gardes-barrières.
C’est la mise en relation temporaire de deux points donnés
soit sur la voie, soit d’une partie d’une gare aune autre
de cette même gare.
Le problème peut être résolu de deux façons
: soit par l’emploi d’un câble volant, soit par l’emploi
d’un fil posé à l’avance et auquel il suffit
de se relier pour communiquer.
Nous pensons qu’il est intéressant de relater ici une expérience
que nous avons faite dans le courant de l’année 1892, et
qui prouve que la première solution du problème n’offre
aucune difficulté.
Nous avons téléphoné avec une grande netteté
à l’aide de téléphones magnétiques
Ader, à 1 000 et à 1 500 m de distance, en employant un
conducteur unique formé d’un fil bi-métallique nu
de 0,0006 m de diamètre simplement posé sur le sol. Le
retour se faisait parla terre prise au rail. Les appels se produisaient
à l’aide de sonneries magnétiques.
On ne pouvait d’ailleurs songer à faire usage, dans cette
circonstance, de sonneries actionnées par des courants de pile
; un fil posé sur le sol étant évidemment dans
des conditions d’isolement des plus défectueux et ne pouvant
servir à la transmission de signaux électriques qu’à
la condition d’employer des courants de haute tension.
On avait placé à chaque extrémité de la
ligne deux récepteurs Ader n° 3, en dérivation sur
la sonnerie magnétique, de façon à s’exonérer
de toute manœuvre de commutateur; l’un de ces téléphones
servait de transmetteur, l’autre de récepteur.
Dans ces conditions, l’installation était d’une grande
simplicité.
Le fil bi-métallique est constitué d’une âme
en acier entourée de cuivre pur, ce qui permet d’obterdr
à la fois une grande conductibilité électrique
et une grande résistance à la traction (75 à 80
kg par millimètre carré).
Ce fil était enroulé sur un dévidoir muni d’une
poignée ; le déroulement sur le sol se fait à la
vitesse d’un homme marchant au pas. Pour le relèvement du
fil, à l’issue de l’expérience, la poignée
du dévidoir était assujettie, à l’aide de
crochets spéciaux, à un plastron, et l’enroulement
s’opérait rapidement par l’homme qui cheminait en donnant
un mouveüient de rotation à l’arbre de la bobine, à
l’aide d’une manivelle montée sur cet arbre.
Le relèvement d’une ligne de 1 km a été effectué
par un homme inexpérimenté en quinze minutes.
On possède ainsi un moyen simple et peu coûteux d’établir
une communication temporaire par sonneries magnétiques et par
téléphone entre deux chantiers espacés sur la voie
de 1 à 3 km, ce qui peut présenter, dans certains cas,
un intérêt réel.
Notre regretté collègue, M. de Branville, qui s’est
beaucoup occupé des applications de la téléphonie
au service militaire et qui, avec M. Aubry, a construit des postes magnétiques
portatifs très pratiques, s’était préoccupé
de l’établissement de lignes volantes pour créer
des communications temporaires. Il avait fait construire à cet
effet un câble à un conducteur composé d’une
torsade de sept fils de bronze, recouverte d’une couche isolante
de caoutchouc pur, d’une enveloppe protectrice formée de
deux guipages en sens contraire, de fils de coton et d’un enduit
hydrofuge.
Il existe deux modèles de câbles ainsi constitués,
dont le tableau ci-après donne les principales dimensions, les
poids, les résistances et la conductibilité
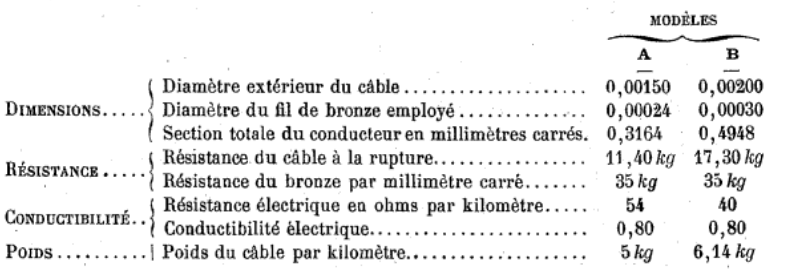
Ces câbles sont légers, comme on le voit, et un seul opérateur
peut facilement dévider une bobine de 500 m de ce conducteur.
On réunit les extrémités de chaque longueur de
câble de 500 m, au moyen d’un serre-flls à deux bornes.
S’il s’agit maintenant de communiquer temporairement entre
deux points désignés d’avance, il est plus simple
d’établir une ligne à conducteur unique entre ces
deux points et de faire aboutir ce conducteur, à ses deux extrémités,
à une prise de contact. On peut ainsi installer rapidement un
poste portatif et établir la communication dans un espace de
temps très court.
La principale condition à remplir, c’est d’avoir un
poste portatif peu coûteux et d’un poids très restreint.
C’est dans ce but que nous avons combiné l’appareil
dont la figure 9, PL 88
donne les vues en coupes et en plan.
Il se compose d’une boîte renfermant un appareildouble Berthon-Ader,
une sonnerie trembleuse de petite dimension, un bouton-poussoir, une
bobine d’induction et un commutateur. Le tout ne pèse que
2,400 kg. Eu dehors de la boîte sont fixés, d’uue
part, deux crochets-conjoncteurs servant à prendre communication
avec la ligne et la terre au moyen d’une clef spéciale attachée
à un cordon souple ; d’autre part, trois autres crochets
de même forme servant à relier la pile à l’appareil.
La pile est complètement indépendante et peut être
composée d’éléments secs facilement transportables
ou d’éléments Leclanché ordinaires que l’on
trouve dans toutes les gares.
On possède, comme on le voit, le moyen de réaliser tous
les genres de communication possibles entre les divers postes des gares,
de gare à gare, et d’un point quelconque de la voie avec
un autre point de la voie ou avec les postes télégraphiques
voisins.
En terminant cette revue des principaux emplois du téléphone
aux grands réseaux des chemins de fer, nous ferons remarquer
que les applications sont peut-être plus étendues à
l’étranger qu’en France. Ainsi, en Angleterre, les
différents postes de block-system sont reliés téléphoniquement
et peuvent ainsi échanger des avis du genre de ceux dont nous
donnons la liste :
Annonce de la nature du train qui a passé devant le poste.
Avis d’arrêter un train signalé par le poste en amont
comme ayant une portière ouverte, un signal de queue éteint,
un chargement dérangé et offrant du danger, etc.
Rectification d’une erreur dans l’indication delà nature
d’un train donnée par la sonnerie du bloc.
Notification au signaleur d’avant de garer un train pour laisser
passer un train plus important.
Indication préalable à une cabine placée en avant
d’une bifurcation de la direction à donner au train arrivant,
afin d’éviter tout retard dans la préparation de
la voie.
Secours à demander aux stations en cas d’accidents de toute
nature.
Demande, au dépôt de machines d’une machine de secours.
Transmission de l’heure aux postes situés en pleine voie.
Annonce d’un dérangement survenu dans les appareils du bloek-system,
etc., etc.
sommaire
1889-1893 État actuel de la téléphonie sur les
grands réseaux français.
Ainsi que nous venons de le montrer, par l’examen des principales
applications déjà réalisées sur les grands
réseaux français et par l’énoncé de
celles qui pourront être réalisées plus tard, le
téléphone est destiné à jouer un rôle
important dans l’exploitation des voies ferrées. Le nombre
des appareils actuellement en service a considérablement augmenté
depuis qnelques années. Ainsi, à l’occasion d’une
communication faite en 1889 à la Société Internationale
des Électriciens sur les applications de l’électricité
à l’exploitation des voies ferrées, nous avions recherché
quels étaient, à cette époque, les nombres de postes
télégraphiques et de postes téléphoniques,
Nous avions trouvé qu’il existait sur les sept grands réseaux
français environ :
5 000 postes télégraphiques ;
700 postes téléphoniques.
Le nombre de ces derniers était, par conséquent, sept
fois moindre que celui des postes télégraphiques.
Depuis 1889 le nombre des postes télégraphiques en service
n’a pas sensiblement augmenté ; il n’en est pas de
même de celui des postes téléphoniques, et la situation
actuelle est approximativement la suivante :
5 200 postes télégraphiques ;
1 210 postes téléphoniques.
Ces derniers ne sont plus qu’en nombre 4,3 fois moindre que les
postes télégraphiques.
On a généralement reconnu la nécessité du
double fil. Les Compagnies duv Nord, de P.-L.-M,, de l’Est et d’Orléans
qui avaient tout d’abord installé leurs téléphones
au simple fil, ont adopté les lignes à deux conducteurs
en fil de bronze silicieux ou phosphoreux de 1,5 à 2 mm de diamètre,
à 98 0/0 de conductibilité, sauf dans le cas où
ces postes sont placés sur les sections de ligne à faible
trafic, dans les stations, haltes, etc., auquel cas ils sont reliés
sur le fil télégraphique omnibus généralement
constitué d’un seul conducteur en fer de 3 mm de diamètre.
Il en est de même de ceux de ces postes placés en pleine
voie et qui servent de postes de secours, et enfin des postes téléphoniques
annexés au télégraphe, ainsi que nous en avons
donné un exemple en décrivant les installations réalisées
sur une partie de la ligne de Yincennes.
La Compagnie de l’Ouest et celle du Midi ont conservé pour
toutes leurs communications téléphoniques de gares le
simple conducteur en fer de 3 mm de diamètre avec retour par
la terre.
sommaire
IL — EMPLOI DU TÉLÉPHONE DANS LES COMPAGNIES SECONDAIRES
Nous avons vu que, sur les grands réseaux, l’emploi du téléphone
est soumis à certaines restrictions et ne peut être substitué
au télégraphe Morse pour assurer la transmission de tous
les ordres et avis intéressant la sécurité de l’exploitation.
Il n’en est pas de même pour les petites lignes. Il est maintenant
admis que, dans ce cas particulier, le téléphone peut
remplacer complètement le télégraphe, l’exploitation
de ces lignes se faisant dans des conditions spéciales.
Le télégraphe à cadran et encore moins le télégraphe
Morse, qui exigent des installations coûteuses, ne conviennent
aux lignes à faible trafic ne desservant que des localités
peu importantes, où les stations ne sont que de simples haltes
situées souvent en face d’estaminets dont les tenanciers
doivent assurer le service de l’échange des marchandises.
Il fallait quelque chose de plus simple, de plus expéditif que
le télégraphe, d’un fonctionnement sur et néanmoins
à la portée des agents peu instruits appelés à
en faire usage. Le téléphone répond seul à
ces exigences.
Nous donnerons comme exemples l’applicalion faite :
1° En Belgique, sur les chemins de fer à petite section ;
2° En France, sur le réseau de la Compagnie Meusienne de
chemins de fer.
Application du téléphone sur les chemins de fer
belges à petite section.
M. Piérard, Ingénieur des télégraphes, à
Bruxelles, a publié une étude intéressante sur
l’application du téléphone aux chemins de fer belges
à petite section ; c’est de cette étude que nous
avons extrait les renseignements qui suivent :
Cet Ingénieur fait remarquer que le téléphone a
été appliqué systématiquement, pour la première
fois, le long des voies ferrées à l’usage exclusif
des besoins du service de ces voies, en Belgique.
La figure 10, PL 88 donne le tracé
des lignes téléphoniques desservant les tramways du Nord
d’Anvers et du Sud de Bréda.
Sur les chemins de fer économiques belges, les stations sont
généralement de simples haltes, sans bâtiment ou
locaux spéciaux. Un café voisin dé la halte constitue
la station. C’est donc généralement dans une salle
réservée du café, qu’est installé le
téléphone. Ce dernier est enfermé dans une boîte
munie d’une serrure.
Chaque poste comporte un microphone, deux téléphones récepteurs
et une sonnerie magnéto-électrique pour les appels.
Tous les postes d’une même ligne sont montés en série
sur un seul circuit, ce qui présente plus d’avantages qu’un
montage en dérivation, car avec ce système on n’a
besoin d’avoir qu’un seul type d’appareils.
L’expérience a montré qu’il était possible
d’embrocher jusqu’à
12 postes dans le même circuit sans rendre la réception
téléphonique trop précaire et que l’on pouvait
même converser pratiquement entre les postes terminus d’une
ligne de 59 km de longueur comprenant 18 postes.
Quand les circuits sont fortement chargés, les postes intermédiaires
communiquent entre eux dans de très bonnes conditions ; la communication
devient d’autant moins bonne qu’on approche davantage des
extrémités.
Les signaux d’appel des divers postes embrochés ont été
constitués par des roulements de sonnerie combinés suivant
le code Morse, c’est-à-dire par une succession de sonneries
brèves et longues.
Les préposés se rendent à leur appareil seulement
quand c’est leur poste qu’on appelle.
La trop grande complication des appels n’est pas à craindre,
puisque avec deux signaux (une brève et une longue) etuDe seule
répétition on a 2 signaux ; avec deux répétitions,
on a 4 signaux ; avec trois répétitions' on a 8 signaux,
soit en tout 2+4+8 = 14 signaux, ce qui est largement suffisant puisque
le nombre des postes embrochés atteint au plus 12.
En résumé, on peut traiter une succession de postes téléphoniques
comme des postes télégraphiques desservis par un fil omnibus,
et on peut, dans certains cas, réunir par des fils directs les
postes principaux, ce qui a pour double avantage d’améliorer
la transmission entre cès postes principaux et de permettre des
communications au cas où l’un des circuits viendrait à
être inter-rompu.
On peut objecter à ce système qu’il permet à
tous les postes d’écouter les communications qui s’échangent
entre deux d’entre eux, mais comme il ne s’agit ici que de
messages de service sans intérêt pour les tierces personnes,
cet inconvénient n’est pas grave.
Les appareils sont montés au simple fil par mesure d’économie
; on emploie le double fil seulement quand la chaussée empruntée
par le chemin de fer vicinal est longée par des fils télégraphiques;
on évite alors l’induction en croisant les deux conducteurs,
comme nous l’avons expliqué plus haut.
On avait fait usage, dès le début, de fils de fer de 0,003
m de diamètre, mais on emploie maintenant le fil de bronze phosphoreux
de 0,0016 m de diamètre à 95 0/0 de conductibilité,
avec lequel on peut avoir des portées de 90 à 120 m. Nous
avons signalé l’inconvénient que présente
ce fil dans les pays froids ; pendant l’hiver, il se recouvre d’une
couche épaisse de glace qui amène sa rupture; aussi, en
Belgique, l’a-t-on remplacé par du fil de bronze à
30 0/0 seulement de conductibilité électrique, ayant une
résistance mécanique double de celle du fil à 95
0/0 de conductibilité électrique.
Un autre inconvénient du fil de bronze, qu’il est intéressant
de signaler, c’est qu’il tente les voleurs ; ceux-ci n’hésitent
pas à couper les lignes pour s’approprier un métal
qui vaut 2,50 f le kilogramme ; aussi a-t-on imaginé d’oxyder
le bronze pour lui donner l’apparence de l’acier.
Il est également assez curieux de noter que des personnes malveillantes
cassent, à coups de pierre, les isolateurs des lignes téléphoniques,
lesquels étant en porcelaine blanche se voient facilement et
constituent un but facile à atteindre. On a donc remplacé
ces isolateurs par d’autres colorés en gris au moyen d’un
silicate approprié faisant partie de l’émail des
cloches. On a constaté que ces nouveaux isolateurs étaient
bien moins fréquemment brisés que ceux en porcelaine blanche.
Sur les lignes où cette substitution ne suffit pas à empêcher
les bris, on en est réduit à employer des isolateurs blindés,
constitués par une simple cloche en porcelaine recouverte extérieurement
par une cloche en fonte malléable galvanisée, fixée
au moyen de plâtre.
Les quatre lignes téléphoniques du réseau aboutissent
toutes à Merxem, où est installé un poste central
; la ligne de Lillo se détache de celle de Bergen op Zoom, à
la première station après Merxem, ainsi que le montre
la carte.
La station de Merxem, ainsi que la station tête de ligne de la
ligne de Lille sont pourvues de postes téléphoniques à
plusieurs directions, ayant par conséquent un tableau avec annonciateurs
et commutateurs.
Il est inutile de donner ici une description détaillée
des organes de ces postes, notre collègue, M. Bernheim, devant
vous montrer tout à l’heure les dispositions à l’aide
desquelles on réalise la mise en communication de diverses lignes
aboutissant à un poste central.
Sur les voies ferrées pourvues de postes téléphoniques
en Belgique, les distances de ces postes sont en moyenne de 3 250 m.
Le nombre total des postes existant sur les chemins de fer éco-nomiques
belges est de d 97 ; la longueur totale des lignes est de 1 088,318
km, dont 275,397 km en fils de fer et 812,921 km en ûls de bronze.
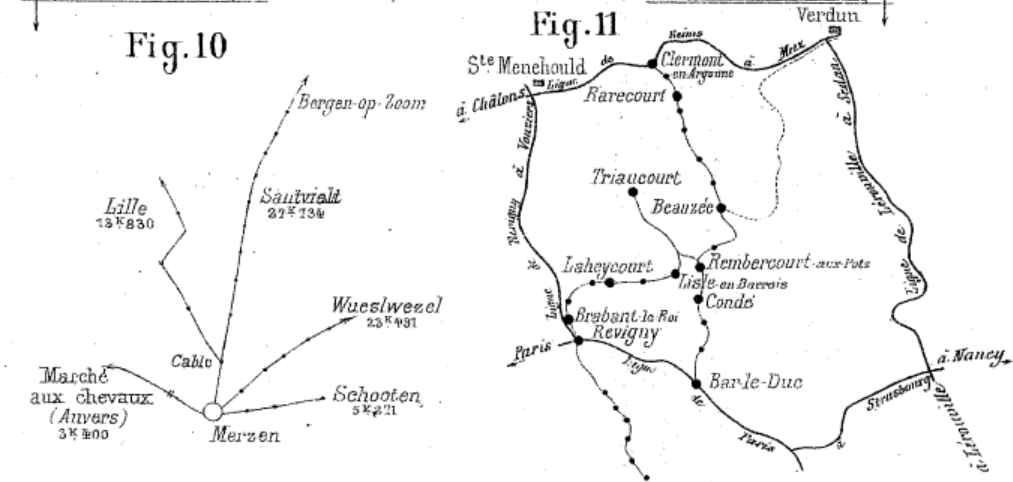
Application du téléphone sur les chemins de fer
à voie étroite de la Meuse (France).
Un deuxième exemple d’application du téléphone
à l’exploitation des petites lignes nous est fourni par
la Compagnie Meusienne de chemins de fer, dont le siège social
est à Bar-le-Duc.
Cette Compagnie a un réseau de 155 km, comprenant trois lignes
:
1° La ligne de Bar-le-Duc àVaubecourt et Clermont, en Argonne;
2° La ligne de Beauzée à Verdun (en construction)
;
3° La ligne d’Haironville à Triaucourt, dont la figure
11, Pl. 88 donne le tracé.
Les lignes actuellement en exploitation ont une longueur totale de 117
km. '
Le téléphone est exclusivement employé sur ces
lignes, sauf sur la section de Revigny à Haironviile, d’une
longueur de 27 km.
Le siège de l’administration est relié à l’ensemble
du réseau. Les gares principales (marquées sur la carte
par un gros point noir) possèdent, seules des postes; ceux-ci
au nombre de onze pour un développement de.lignes de 91 km.
Les postes téléphoniques, exclusivement magnétiques,
sont montés en série sur un seul conducteur constitué
d’un fil de fer de 3 mm de diamètre. *
La figure 12, PL 88 donne
le schéma de montage d'un posté intermédiaire auquel
aboutissent les deux lignes de droite et de gauche. Le poste intermédiaire
se compose d’un téléphone transmetteur, de deux téléphones
récepteurs, et d’un appel mixte, c’est-à-dire
d’un appel phonique et d’un appel par sonnerie magnétique.
Ces deux sortes d’appel se font en imprimant un mouvement de rotation
rapide, à l’aide d’une manivelle, à une petite
machine magnéto dont le courant réagit sur une sonnerie
polarisée, située dans le poste correspondant, lorsqu’on
appuie sur un bouton. Si, au contraire, on imprime le mouvement de rotation
à la magnéto en pressant sur un autre bouton, comme on
fait tourner en même temps une roue à interruptions, on
provoque dans le récepteur du poste correspondant une série
de vibrations qui sont amplifiées par un cornet.
Le poste intermédiaire, auquel aboutissent les deux lignes, susdites,
est également muni de deux annonciateurs à sonnerie de
pile ordinaire. Ces annonciateurs sont disposés de telle sorte
que le poste intermédiaire ayant mis "en communication les
deux postes qui aboutissent à son -appareil puisse écouter
la conversation qu’ils échangent, en mettant ses récepteurs
en dérivation.
Tous les appareils d’un poste sont enfermés dans un coffre
transportable.
Dans certaines gares non pourvues de logement, il existe non seulement
un poste à la gare, mais aussi au domicile du chef de gare.
Enfin, outre les postes téléphoniques installés
à demeure dans les stations, tous les trains portent dans leur
fourgon un appareil téléphonique mobile permettant, en
cas de détresse, d’établir une communication entre
les deux postes voisins, en moins de trois minutes.
Le schéma de la figure 12,
Pl. 88 donne la vue de ce poste mobile composé des mêmes
appareils qu’un poste terminus. La boite qui contient ces appareils
mesure 0,22 x 0,17 X 0,19 et pèse 6,120 kg. Les deux récepteurs
sont montés sur une courroie agencée pour que l’application
puisse être faite aux oreilles sans qu’on ait besoin de se
servir de ses mains pour les maintenir. ( Voir fig. 43,
PL 88.)
Les dessins de la figure 13, PL 88 donnent
les vues en élévation, en plan et en coupe de ce poste
portatif qui est relié au fil de ligne au moyen d’un conducteur
fixé à une perche en bambou démontable, munie d’une
pince en cuivre. Cette pince, à laquelle est attaché le
fil, sert à le suspendre au conducteur aérien. La terre
est prise au rail par une pince en cuivré ou en enfonçant
dans le sol une lîche métallique.
Avec le poste de secours, on peut envoyer un courant d’induction
qui actionne la sonnerie magnétique des postes voisins. Ce poste
de secours ne peut lui-même recevoir que des appels phoniques.
Le téléphone est employé sur le réseau meusien
des chemins de fer à la transmission des dépêches
intéressant la circulation et la sécurité des trains.
Les dépêches de cette nature sont inscrites sur un carnet
et collationnées par répétition. Il n’est
pas tenu note des autres dépêches de service ou des avis
de départ des trains qui sont donnés de gare en gare.
L’appel phonique adopté pour certains postes de ces petites
lignes de la Meuse serait, croyons-nous, insuffisant dans la plupart
des applications du même système qui pourraient être
faites sur les lignes de chemins de fer, car il faut prêter une
oreille attentive pour percevoir le bruit produit par les vibrations
du téléphone récepteur, malgré le renforcement
dû au cornet placé sur le téléphone.
sommaire
ÉTUDE TECHNIQUE DES APPAREILS Par Edmond. BERNHEIM
Dans la première partie de cette communication, M. G. Dumontr
Ingénieur, chef des Services techniques de la Compagnie des chemins
de fer de l’Est, a parlé de l’emploi des téléphones
dans les chemins de fer ; nous allons maintenant donner quelques détails
sur les postes employés et sur les différents accessoires
destinés à les compléter.
Les appareils téléphoniques employés dans les Chemins
de fer sont de deux sortes : les appareils microphoniques et les appareils
magnétiques.
Les appareils magnétiques sont peu employés, étant
donné qu’ils ne peuvent pas être utilisés sur
les lignes d’une certaine-étendue ; nous n’en dirons
donc que quelques mots à la fin de cette communication.
Les appareils microphoniques, au contraire, sont très employés
et, parmi eux, celui dont l’usage est le plus courant, est le transmetteur
Ader. Nous donnerons donc une description très complète
du transmetteur Ader, et nous passerons rapidement en revue les autres
types de transmetteurs, car les principes sur lesquels repose leur construction
sont les mêmes et ils n’en diffèrent que par des détails.
En téléphonie comme en télégraphie on emploie,
pour relier deux postes, des lignes directes et des lignes omnibus.
Les premières ont pour but de relier deux postes, sans intermédiaire
entre eux; les autres de relier un certain nombre de postes par la même
ligne ou des lignes différentes de leur permettre de communiquer
à volonté l’un avec l’autre et, au besoin, de
mettre ces postes en communication directe l’un avec l’autre.
Ligne directe. — Lorsque deux postes sont reliés
par une ligne téléphonique directe, il faut à chaque
poste établir un poste simple. Comme nous l’avons dit plus
haut, nous prendrons comme type de poste simple, le transmetteur Ader.
Le Transmetteur Ader comprend trois circuits bien distincts :
1° Le circuit microphonique ou circuit inducteur;
2° Le circuit de transmission ou circuit induit ;
3° Le circuit d’appel.
Avant de parler de ces trois circuits, nous donnerons quelques explications
sur les organes principaux qui les constituent et qui sont :
Le microphone Ader proprement dit ;
La bobine d’induction ;
Le récepteur Ader ;
Et accessoirement, la sonnerie d’appel.
Microphone Ader (fig. 44). — Il se compose d’une planchette
en sapin fixée sur un pupitre en bois et inclinée d’environ
10° sur l’horizon; sur la face interne de cette planchette,
sont fixées dans un plan vertical trois réglettes de charbon
de cornue, B, G, D, comprenant entre elles dix crayons horizontaux également
en charbon de cornue A, et groupés en deux séries de cinq.
Les réglettes et les crayons ne sont pas assemblés d’une
manière rigide ; ils jouent les uns dans les autres et constituent
ainsi une série de contacts imparfaits. On conçoit que
si on ferme le circuit d^une pile à travers ce microphone et
si on vient à faire vibrer la planchette, on modifiera les contacts
et, par suite, la résistance électrique du microphone
; par conséquent, le circuit se trouvera traversé par
des courants d’intensité variable.
Bobine d'induction. - Elle se compose d’une bobine en buis
dont le noyau est formé par un faisceau de fils de fer doux,
et sur laquelle sont enroulés deux fils, l’un assez court
et peu résistant, qu’on désigne sous le nom de gros
fil ou fil inducteur, l’autre très long et très résistant
qu’on désigne sous le nom de fil fin ou fil induit.
Le gros fil est placé dans le circuit fermé par la pile
et le microphone Ader. Chaque fois que le courant traversant le circuit
dont nous avons parlé à propos du microphone change d’intensité,
le gros fil se trouve parcouru par des courants tantôt croissants
tantôt décroissants ; par suite des phénomènes
de l’induction, le fil fin sera parcouru par des courants beaucoup
plus courts, mais aussi beaucoup plus puissants que les premiers.
Récepteurs Ader. (Description du récepteur Ader
n° 3, le plus communément employé.) — Le récepteur
Ader n° 3 se compose d’un électro-aimant à deux
bobines, dont les noyaux sont fortement aimantés. L’armature
est formée d’une plaque de fer doux. Si le fil de l’électro
est parcouru par des courants variables, le champ magnétique
des noyaux va se trouver modifié et, par suite, le degré
d’attraction de l’armature, ce qui donnera lieu à des
attractions et des répulsions, c’est-à-dire à
des vibrations de cette armature. Si les courants variables correspondent
aux vibrations du son, l’armature reproduira les mêmes vibrations.
Sonneries d'appel. — Elle est, pareille aux sonneries d’appartement
que tout le monde connaît, avec cette différence que les
bobines ont une certaine résistance, variable selon la longueur
de la ligne et le groupement des appareils.
Disposition de l'appareil (fig. 45) — L’appareil comporte:
un microphone Ader, une bobine d’induction, deux récepteurs
Ader.
(A partir de la figure 45 consulter
le fichier à ce lien)
Ces organes sont montés dans une boîte qui est disposée
de manière à constituer lès trois circuits distincts
dont nous avons parlé plus haut. L’appareil porte en outre
huit bornes : les deux bornes L dites de ligne, que l’on vient
relier aux deux fils de ligne ; les deux bornes S, dites de Sonnerie,
que l’on relie aux fils allant à la sonnerie d’appel
; les deux bornes PT de pile mi-crohpone reliées à la
pile microphone ; enfin, les bornes PS reliées à la pile
d’appel. M'
Circuit microphonique. — Il comprend la pile microphone, le microphone
et le gros fil de la bobine d’induction. Au repos, ce circuit est
coupé, ce n’est qu’au moment de la transmission qu’il
se ferme ainsi que nous le verrons plus loin.
Circuit de transmission. -— De même que le précédent,
ce circuit n’est fermé que pendant la durée de la
transmission ; il part d’une des frornës dé ligne,
traverse le fil fin de la bobine d’induction,
On conçoit que si, par les bornes de ligne arrivent des courants
vibratoires, et si le circuit de transmission est fermé; ces
courants se trouveront reproduits par l’armature des récepteurs.
Si, au contraire, le fil fin. de la bobine d’induction se trouve
parcouru par des courants de cette nature (engendrés eux-mêmes
par le circuit microphonique), les fils de ligne seront également
parcourus par ces courants vibratoires.
Circuit d'appel. — Ce circuit n’est fermé qu’à
l’état de repos de l’appareil. Il part de l’une
des bornes de ligne et se rend de là à l’axe d’un
petit commutateur, appelé bouton d'appel, qui est analogue à
un bouton de sonnerie ; au repos, ce commutateur se trouve en communication
avec un contact qui ferme le circuit à travers la sonnerie d’appel
et la seconde borne de ligne. On voit que dans cette position, s’il
arrive un courant par la ligne, ce courant traversera la sonnerie et
la fera résonner, ce qui produira l’appel. Si, au contraire,
on vient à appuyer sur le bouton d’appel, le circuit se
ferme de la manière suivante : une borne de ligne, l’axe
du bouton d’appel, le contact inférieur du même bouton,
la pile d’appel et la seconde borne de ligne. Donc tout le temps
qu’on maintiendra le bouton d’appel abaissé, on fermera
la pile d’appel à travers la ligne.
Commutateur automatique. — Il faut maintenant montrer quel
a été le moyen employé pour fermer les circuits
microphonique et de transmission et couper le circuit d’appel au
moment où on passe de la position d’appel à la position
de transmission. On a, à cet effet, utilisé le commutateur
automatique. Il se compose d’un levier métallique divisé
en deux parties par une lame isolante I; il est terminé à
l’une de ses extrémités par un crochet sortant de
la boîte du téléphone et auquel on vient au repos
accrocher un des récepteurs, ce qui a pour effet de faire basculer
le levier ; si on décroche le récepteur, le levier est
déplacé en sens inverse par un ressort antagoniste.
L’axe du commutateur est relié en permanence à l’une
des bornes de ligne ; la partie antérieure du levier, qui est
en communication constante avec l’axe, vient dans sa position de
repos buter contre un contact qui vient compléter le circuit
d’appel ; au contraire, si on décroche le récepteur,
le commutateur se relève, vient buter contre un autre contact
et fermer ainsi le circuit de transmission. En même temps, la
partie du levier isolée par la lame isolante I vient buter contre
deux paillettes, dont l’une est reliée à l’une
des bornes de la pile microphone, l’autre à l’une des
extrémités du gros fll de la bobine d’induction.
Ces deux paillettes se trouvant en contact viennent ainsi, par l’intermédiaire
du commutateur automatique, fermer le circuit microphonique.
Lignes au simple fil. — On peut, au lieu de relier les deux
bornes de ligne chacune à un fil de ligne, n’employer qu’un
seul fil de ligne et rélier la seconde borne à la terre,
de manière à faire le retour commun par la terre comme
dans les lignes télégraphiques.
Pourtant, dans ce cas, on a à vaincre une difficulté qu’on
ne rencontre pas en télégraphie : ce sont les perturbations
apportées au courant de ligne par suite des effets d’induction
des fils voisins. En télégraphie, ces effets sont négligeables,
la durée des courants induits n’étant jamais assez
longue pour agir sur les appareils télégraphiques ; en
téléphonie, au contraire, où on ne transmet que
des courants induits, le passage dans le voisinage de la ligne du plus
petit courant, courant de lumière, courant télégraphique
ou simplement courant d’une autre ligne téléphonique,
est absolument nuisible à la bonne transmission.
On est donc conduit, dans la plupart des cas, à employer des
lignes au double fil, car alors les courants induits prenant
naissance dans chacun des fils sont égaux et de sens contraire,
et par conséquent se détruisent l’un l’autre.
Dans la première partie de cette communication, M. Dumont a montré
quelles étaient les dispositions adoptées pouf obtenir
l’égalité des deux courants de sens contraire.
D’ailleurs, même au cas où on n’aurait pas à
craindre le voisinage d’autres conducteurs électriques,
l’induction tellurique, pour des lignes d’une certaine étendue,
serait suffisante pour troubler la transmission.
Installation d’un transmetteur Ader (fig. 47).
Le poste s’installe de la façon suivante :
1° L’appareil est fixé au mur par trois vis passant
dans les champignons'en caoutchouc disposés sur l’appareil.
Si le local est humide, il faut interposer entre les murs et l’appareil
une planchette en bois ;
2° La pile est enfermée dans une boîte qui doit être
placée dans un endroit sec, à l’abri de la chaleur
et de l’humidité et à portée des appareils
;
3° La sonnerie est placée dans un endroit quelconque du local,
en tenant compte cependant de celui le plus commode pour en entendre
le son.
La ligne, la sonnerie et la pile sont reliées à l’appareil
par des fils de cuivre recouverts de gutta et coton communément
appelés fils de sonnerie.
Les deux bornes de la sonnerie sont reliées directement aux deux
bornes marquées S de l’appareil.
Ces deux bornes se trouvent à droite et en haut de l’appareil.
La pile est reliée à l’appareil de la façon
suivante : .
L’appareil possède quatre bornes à la partie inférieure
; la première à gauche se relie au premier zinc de la
pile ; la deuxième se relie au troisième charbon de la
pile de façon à ce que, entre ces deux bornes de l’appareil,
se trouve intercalée une pile de trois éléments.
On relie par un petit fil de cuivre sous gutta-eoton la première
borne à la troisième et on relie la quatrième au
dernier charbon de la pile. De cette façon, entre la première
et la quatrième borne se trouve toute la pile, de même
qu’entre la troisième et la quatrième.
Il faut toujours entre la première et la deuxième borne
mettre trois éléments, ni plus, ni moins. Ces deux bornes
correspondent en effet aux extrémités du circuit microphonique,
qui est un circuit local et qui, par suite, nécessite un nombre
d’éléments ne variant pas avec la résistance
de la ligne.
La pile totale comprend un nombre d’éléments variable
avec la résistance du circuit extérieur et avec la distance
; on compte en général trois éléments pour
50 ohms de résistance.
Les deux bornes supérieures de gauche sont destinées à
relier l’appareil avec le circuit extérieur.
Si on a une ligne au double fil, chacun de ces fils vient aboutir à
l’une de ces bornes indifféremment.
Si le circuit extérieur n’a qu’un fil, on relie ce
fil à la première borne de gauche, la deuxième
est reliée au fil de terre.
Prise de terre. — Lorsque les appareils sont mis en relation les
uns avec les autres, au moyen d’une ligne au simple fil, le circuit
se complète, en mettant chaque appareil en communication avec
la terre, qui fait alors office de fil de retour.
D’autre part, on préserve généralement
les appareils téléphoniques reliés entre eux par
des lignes aériennes, contre le danger d’un coup de foudre,
à l’aide de paratonnerre (voir plus loin la description
des paratonnerres les plus employés). Ges paratonnerres, lorsqu’ils
sont frappés par la foudre, sont disposés de telle sorte
qu’à ce moment la décharge, au lieu de traverser
les appareils, va directement à la terre. Les paratonnerres doivent
donc être tous reliés à la terre.
Dans un cas comme dans l’autre, la terre doit être prise
avec beaucoup de soin, car si elle ne l’était pas, avec
les lignes au simple fil, la communication serait mauvaise, et, dans
le cas d’emploi de paratonnerres, la protection serait inefficace
et même dangereuse. ,
Dans les endroits où se trouvent des conduites d’eau ou
de gaz en plomb, on se sert de ces conduites pour prendre terre (fig.
48); Dans ce cas, le fil conducteur venant, soit de l’appareil
(ligne au simple fil), soit du paratonnerre (lignes aériennes),
est généralement un petit câble composé de
trois fils de cuivre nu tressés ensemble.
On enroule plusieurs fois ce conducteur autour de la conduite d’eau
ou de gaz après avoir eu soin de décaper cette conduite
à l’endroit où vient s’enrouler le petit câble.
Lorsque le fil de terre est ainsi enroulé, on le fixe solidement
sur la conduite à l’aide de soudure d’étain..
Il faut avoir soin de bien serrer les spires d’enroulement sur
une longueur de conduite d’environ 10 cm. Si on veut souder sur
une conduite d’eau, il faut avoir soin de la vider, sans quoi la
soudure devient impossible. Si on. ne peut pas la vider, on remplace
la soudure par un fort serrage du fil autour de la conduite .
Si on a à sa disposition une conduite d’eau et une conduite
de gaz, il y a intérêt à prendre deux terres, l’une
sur l’eau, l’autre sur le gaz (fig. 49).
Si on n’a à sa disposition qu’une conduite d’eau
en fer, on desserre un boulon de la conduite, on la: nettoie sérieusement
et on vient y insérer l’extrémité du fil de
terre. On resserre ensuite fortement le boulon.
Si on se trouve dans un endroit où il n’y a ni conduite
d’eau, ni conduite de gaz, on opère ainsi :
1° Si on est à proximité d’un cours d’eau,
on vient y plonger l’extrémité, du fil de terre,
en laissant au fond de l’eau une longueur d’environ 2. ou
3 m de fil. Mais il est nécessaire que la partie immergée
se trouve toujours dans l’eau, quelle que soit la hauteur des eaux
du cours d’eau (fig. 20).
2° Si on n’a pas de cours d’eau, on creuse un puits, et
si on rencontre une couche de terre humide, on y place une plaque de
cuivre rouge d’environ 1 m de long sur 30 cm de large et 1 ou 2
mm d’épaisseur. On soude l’extrémité
du fil de terre après la plaque et on comble le puits autant
que possible avec de la terre humide (fig. 24).
3° Enfin si l’on n’a pas de terrain humide à sa
disposition, on enfonce en terre une barre de fer appointie d’environ
1,50 m de longueur sur 6 à 10 cm2 de section. Si la barre de
fer est ronde, un diamètre de 3 cm est suffisant. Si elle est
carrée, elle doit avoir 3 cm de côté. On enroule
le fil de terre autour de cette barre et on l’y soude après
avoir, au préalable, étamé la partie de la barre
qui doit recevoir la soudure. Il est bon de temps en temps d’arroser
l’endroit où cette barre est enfoncée (fig.- 22).
En résumé, on ne saurait prendre trop de précautions
pour assurer le contact intime du fil de terre avec le sol.
Il faut avoir soin également de bien fixer ce fil, de manière
à ne pas risquer sa rupture. Généralement, on le
fait descendre le long d’nn mur où il est fixé à
l’aide de crochets à gaz.
Paratonnerres.— Nous avons vu plus haut que, dans les lignes
aériennes, il était indispensable de protéger les
appareils contre les coups de foudre qui peuvent tomber en un point
quelconque de la ligne, la suivre et venir traverser, en y détruisant
les appareils, le poste téléphonique.
Il existe de nombreux modèles de paratonnerres qui peuvent d’ailleurs
tous se ramener à trois types principaux, savoir :
1° Les paratonnerres à pointes ;
2° Les paratonnerres a fil fin ;
3° Les paratonnerres à papier.
Paratonnerres à pointes. — Le principe de ces paratonnerres
est le pouvoir des pointes, phénomène bien connu en électricité
statique. La ligne, avant de se rendre dans l’appareil, traverse
une plaque dont Tune des faces est munie de pointes ; vis-à-vis
de ces pointes s’en trouvent d’autres, reliées à
une seconde plaque qui,, elle-même, est en communication avec
la terre.
En temps ordinaire, les courants traversant la ligne sont à un
potentiel trop faible pour être influencés par le voisiinage
des pointes en communication avec la terre; au contraire, au cas du
passage d’une décharge atmosphérique, le potentiel
croît subitement en passant dans la plaque munie de pointes, la
ligne se décharge par une série d’étincelles
sur les pointes placées en regard, en sorte que les appareils
se trouvent préservés.
Le paratonnerre de ce type le plus employé est le paratonnerre
Bertsch, dont on construit deux types, l’un renfermé dans
une boîte en bois, pour être placé à l’intérieur
des constructions ; l’autre, absolument étanche, destiné
à l’extérieur (fig. 23).
Paratonnerres à fil fin, — Le paratonnerre à fil
fin comprend un fil de cuivre couvert de soie que le courant de ligne
doit traverser avant de se rendre aux appareils. Si un courant trop
intense arrive par le fil fin de ligne, le fil fin fond et coupe toute
communication avec les appareils. Un commutateur à manette permet,
d’ailleurs, à l’approche d’un orage, de mettre
directement les fils de ligne à la terre, le fil fin ne servant
ainsi qu’en cas d’orage imprévu.
Nous représentons figure 24 un paratonnerre à fil fin
et commutateur de mise- à la terre. Nous citerons encore parmi
ces appareils les paratonnerres à lames et à fil fin préservateur,
qui se construisent pour un nombre de directions quelconque.
Paratonnerres à papier. — Le principe de ces paratonnerres
est le même que celui des condensateurs d’électricité.
Ils se composent d’une plaque métallique que le courant
de ligne traverse; cette plaque se trouve vis-à-vis d’une
seconde plaque reliée à la terre et n’en est séparée
que par une feuille de papier paraffiné.
En temps ordinaire, le courant passe normalement: dans les appareils
; mais si le courant est tel que le condensateur est chargé au
delà de ce que permet sa capacité, une décharge
se produit entre les deux plaques, brûle lé papier et établit
la communication de la ligne avec la terre (fig. 25).
On construit également des paratonnerres à lame d’air.
Ce sont des paratonnerres à papier dans lesquels on a perforé
la feuille de papier; ce qui en reste sert simplement à maintenir
l’écartement des deux plaques. On constitue ainsi un véritable
condensateur à lame d’air, qui se décharge brusquement
au passage d’un courant trop puissant.
Gomme nous l’avons dit, il existe de nombreux types de paratonnerres,
se rapprochant plus ou moins des types décrits, ou encore formés
du groupement de plusieurs de. ces types entre eux. Nous citerons notamment
le type de paratonnerre adopté par la Compagnie du Chemin de
fer de Paris à Orléans, et qui est à pointes, à
fil fin préservateur, à papier et à commutateur
de mise à la terre (fig. 26).
Transmetteurs autres que le transmetteur Ader.
Il existe un grand nombre de différents types de transmetteurs
; mais les seuls que l’on emploie un peu couramment dans les chemins
de fer sont les transmetteurs Ader, Breguet et Berthon.
Nous venons de parler du transmetteur Ader; nous dirons quelques mots
des deux autres. ^
Le montage des différents éléments entre eux est
le même que dans le transmetteur Ader, précédemment
décrit ; les seules modifications résident dans le microphone.
Le microphone du transmetteur Breguet se compose d’une planchette
en sapin, sous laquelle sont fixés des charbons cylindriques
montés entre trois Blocs de charbon, comme l’indique la
figure 27. Les communications sont les mêmes que dans le transmetteur
Ader.
Le microphone Berthon est basé sur un principe tout différent
: il se compose de deux plaques circulaires en charbon, entre lesquelles
se trouvent des petites billes de charbon ; lès bornes de la
pile microphone communiquent avec les plaques de charbon et le circuit
se ferme à travers les billes. On obtient ainsi une série
de contacts dont la perfection est variable et qui, par suite, laissent
passer le courant avec plus ou moins d’intensité (fig. 28).
Ce microphone est monté dans un boîtier en ébonite.
Un grand avantage de ce modèle est qu’il se monte très
facilement sur une poignée portant également un récepteur
Ader. Cette poignée se tient de la main gauche, et on peut, tout
en suivant la conversation, prendre des notes avec la main droite (fig.
29).
Outre le type de transmetteur Adér mural que nous avons décrit
plus haut, il existe un type pouvant se placer sur une .table et dont
les connexions se font au moyen d’un cordon souple à sept
conducteurs (fig. 30 et 31).
Il existe également de ce type des transmetteurs Breguet et Berthon
(7=fîg.32 et 33) .
sommaire
Lignes omnibus.
Il existe en téléphonie deux sortes de lignes omnibus
:
I — Les réseaux téléphoniques dont toutes
les lignes aboutissent à un même poste central :
a) Pouvant donner des communications directes entre les divers postes
reliés;
b) Ne pouvant pas donner de communications directes.
II— Les réseaux téléphoniques dont tous
les postes se trouvent situés le long d’une même ligne
et où :
a) Chaque poste peut communiquer seulement avec ses deux. voisins;
b) Chaque poste peut mettre en communication ses deux voisins, et, par
suite, en répétant cette manoeuvre de proche em proche,
deux postes quelconques peuvent communiquer entre eux..
c) Chaque poste peut appeler directement l’un quelconque-des autres
de la ligne.
II— Réseaux téléphoniques dont toutes les
lignes aboutissent à un même poste central.
a. — Le poste central peut donner des communications directes.
Il faut distinguer deux sortes de postes: les postes simples et. le
poste central.
Postes simples. — Ils sont en tout analogues à ceux
dont nous avons parlé plus haut et dont le type est le transmetteur
Ader. Ils peuvent, grâce au poste central, communiquer soit avec
ce poste, soit avec l’un des autres postes simples qui y sont reliés
; mais d’eux-mêmes, ils ne peuvent se mettre en communication
qu’avec le poste central.
Poste central. — Le poste central est relié à
un certain nombre de postes simples, avec lesquels il doit pouvoir se
mettre en communication.
Il doit de plus pouvoir mettre en communication entre eux deux des postes
simples auxquels il est relié.
En outre du transmetteur analogue à ceux décrits plus
haut, le poste central comprend :
1° Des indicateurs d’appel ;
2° Des commutateurs.
1° Indicateurs d’appel. — Ils ont pour but de faire
connaître au poste central quel est le poste simple désirant
lui parler ou demandant à être mis en communication avec
un autre poste simple.
Les principaux dispositifs, indicateurs d’appel, sont : la convention.
de sonnerie, les sonneries spéciales, les annonciateurs.
Convention de sonnerie. — Elle consiste en une sonnerie unique
placée au poste central ; chaque poste appelle d’une façon
particulière : par exemple, l’un par un appel bref, le second
par un appel prolongé, le troisième par deux appels brefs,
etc...
Sonneries spéciales. — Un autre procédé consiste
en une sonnerie spéciale affectée à chaque poste
simple.
Annonciateurs (fig. Si.) — C’est le plus employé de
tous les dispositifs indicateurs d’appel, car c’est celui
dont l’usage est le plus sûr et le plus commode. L’annonciateur
se compose d’un électro-aimant A, fixé à l’intérieur
d’une boîte. Sur la face antérieure de cette boîte,
se trouve placé un volet P, mobile autour d’une charnière
placée à sa base, et maintenu.appliqué contre la
boîte par un crochet terminant l’armature de l’électro.
Si on vient à faire passer un courant dans l’électro,
Farmature .se trouve attirée et le crochet abandonne le voleUqui
tombe, laissant à découvert un numéro (fig. 34).
En tombant l’annonciatéur peut faire résonner une
sonnerie qui, selon le cas, peut être intermittente ou continue.
La sonnerie est intermittente, lorsqu’elle ne résonne que
quand le poste simple appuie sur son bouton d’appel ; dans ce cas
c’est l’armature même de l’annonciateur qui vient
fermer un circuit local comprenant une sonnerie et une pile, en butant
contre un contact.
La sonnerie est continue, si elle résonne tout le temps que l’annonciateur
est tombé ; dans ce cas, qui est celui de la figure, c’est
le volet de l’annonciateur qui ferme le circuit local, en butant
contre un contact G fixé sur la boîte de l’annonciateur.
Enfin, on emploie fréquemment le commutateur I. O. G qui est
un petit commutateur à manette et à trois plots; si ce
commutateur se trouve sur le plot I, la sonnerie est intermittente ;
s’il est sur le plot O, la sonnerie ne résonne pas du tout
et l’attention de l’employé n’est attirée
que par la vue de l’annonciateur dont le volet est tombé
; enfin si le commutateur se trouve sur le plot G la sonnerie est continue.
Une vis de réglage replacée sur la boîte de l’annonciateur
permet de modifier la tension du ressort antagoniste de l’armature
de l’électro-aimant A et, par suite, de faire varier le
courant minimum nécessaire pour faire tomber le volet.
2° Commutateurs. — Les commutateurs ont pour but de
permettre au poste central de se mettre en communication avec un poste
simple quelconque, ou de mettre en communication entre eux deux postes
simples.
Ils doivent en outre être disposés en sorte que le poste
central puisse, à un moment quelconque, reconnaître si
les deux poster simples reliés peuvent avertir le poste central
de la fin de leur conversation.
En effet, dans les lignes télégraphiques où un
poste intermédiaire a à mettre en communication deux autres
postes, le galvanomètre du poste intermédiaire continue
â dévier tant que les postes simples communiquent, et le
poste intermédiaire se trouve ainsi averti qu’il ne doit
pas rompre la communication. Les courants téléphoniques,
au contraire, sont de beaucoup trop faible durée pour agir sur
un galvanomètre, et il faut un dispositif de fin de Conversation
spécial.
Les commutateurs employés en télégraphie sont :
Les commutateurs usités en télégraphie ;
Les commutateurs jack-lmives ;
Les commutateurs à leviers.
Commutateurs usités en télégraphie. — Ge sont
les commutateurs à mafiette et à plots, les commutateurs
suisses et les commuta-teursl(bavarois.
Tous ces commutateurs sont connus et ne demandent, pas de description
spéciale,
Les commutateurs à plots ne sont employés que dans quelques
cas particuliers, car ils ne permettent généralement pas
de monter facilement les indicateurs d’appel, ce qui permet bien
au poste central d’appeler les postes simples, mais empêche
les postes, simples d’appeler le poste central (fig. 35).
Les commutateurs suisse et bavarois, très employés au
début de la téléphonie, sont aujourd’hui complètement
abandonnés par suite de l’invention de commutateurs plus
parfaits, et en raison de la complication de leur manœuvre et de
leur prix de revient assez élevé.
Commutateurs jack-knives. — Nous décrirons d’abord
les commutateurs jack-knives employés dans les lignes au simple
fil, et nous dirons ensuite quelques mots de ceux employés dans
les lignes au double fil.
Le commutateur jack-knife simple fil se compose simplement d’une
plaque métallique P, percée de deux trous 1 et â
(fig. 36). Chacune des lignes L reliées au poste central communique
avec une telle plaque. Le commutateur est complété par
des cordons à un conducteur C, recouverts de soie tressée
et munis à chacune de leurs extrémités d’une
fiche métallique F (fig. 37).
En outre, la borne de ligne du transmetteur du poste central, qui, dans
le cas d’une installation de ligne directe, serait reliée
au fil de ligne, se trouve reliée à un cordon sous soie
muni d’une fiche Fl (fig. 38).
On comprend que, si on vient à enfoncer cette fiche dans l’un
des trous d’un jack-knife, on établit la communication entre
le poste central et le poste simple correspondant au jack-knife où
l’on a placé la fiche; si, au contraire, on vient à
enfoncer les deux fiches d’un cordon à deux fiches dans
deux jack-knives différents, on relie électriquement les
deux postes correspondants.
On voit que, quand on a ainsi mis deux postes en communication, il reste
à chaque jack-knife un trou disponible; le poste central peut,
en mettant sa fiche dans ce trou, se placer en dérivation sur
la ligne et écouter si les deyix postes parlent encore entre
eux. En outre, un dispositif spécial permet de laisser en permanence
un annonciateur en dérivation sur la ligne reliant les deux postes
simples, qui peuvent l’un ou l’autre faire tomber le volet
de cet annonciateur’, en envoyant dans la ligne le courant d’appel;
et, de cette manière, on sera, averti de la fin de la conversation..
A cet effet, au-dessus de ia plaque métallique P de chaque jack-knife,
se trouve un contact G, relié à l’annonciateur correspondant
A et isolé de la plaque P. Une lame de ressort R est én
communication avec la plaque P et le contact C, en sorte qu’elle
vient fermer le circuit de ligne à travers l’annonciateur.
Si on enfonce la fiche du cordon dans le trou de gauche 1 dujackdmife,
rien n’est changé aux connexions et l’annonciateur
reste en dérivation sur la ligne; si, au contraire, on vient
l’enfoncer dans le trou 2. une pièce isolante B repousse
la lame de ressort et rompt son contact avec l’annonciateur A.
L’annonciateur est donc ainsi mis hors circuit.
Donc, quand un poste, intermédiare met en communication deux
postes simples, il lui suffit d’enfoncer une des fiches dans le
trou de droite du premier jack-knife; l’autre, dans le trou de
gauche de l’autre; l’annonciateur correspondant au jack où
.le trou de gauche est occupé reste en déviation, et son
volet tombe si l’un des postes simples, appuyant sur le bouton
d’appel, envoie un courant assez énergique dans la ligne.
Le commutateur jack-knife double fil est absolument analogue à
celui au simple fil, avec cette différence qu’au lieu d’une
plaque percée de deux trous, il y en a deux, fixées i’une
sur l’autre et séparées par une matière isolante
; chaque plaque est reliée à l’un des fils de ligne
du poste correspondant; la fiche est elle-même formée de
deux parties concentriques, isolées entre elles, qui, quand on
vient enfoncer la fiche dans le jack, viennent chacune un contact avec
l’une des plaques, c’est-à-dire avec l’un des
fils de ligne (fig. 41 à 44).
Comme précédemment, l’une des plaques est munie d’une
lame de ressort, permettant de laisser un annonciateur en dérivation.
Le type de commutateur jack-knife que nous venons de décrire
est le plus communément employé ; il existe outre cela
d’autres types, tels que les commutateurs jack-lmives système
Bailleux : les commutateurs Sieur, les commutateurs de multiple, etc.,
que nous citons pour mémoire.
Ces commutateurs ne sont pas forcément à deux trous, mais
ils sont toujours disposés pour permettre d’intercaler un
annonciateur de fin de conversation.
Commutateurs à leviers (fig. 45). — Deux lames de ressort
RI, R2 sont reliées chacune à l’un' des fils de ligne
allant au poste simple ; au repos, chaque lame bute contre un contact
relié à l’annonciateur correspondant A, ce qui permet
au poste simple considéré d’appeler; si, au contraire,
on vient à abaisser un levier fixé sur la boîte
contenant les deux lames de ressort, ces dernières, solidaires
de son mouvement (grâce à des pièces isolantes interposées),
viennent buter contre deux contacts reliés aux bornes de ligne
de l’appareil du poste central, ce qui permet à ce poste
de communiquer avec le poste simple.
Pour mettre en communication deux postes simples, il suffit d’abaisser
les leviers correspondant à ces deux postes; le poste central
reste en dérivation. Pour que ce dernier soit averti de la fin
de la conversation, les deux bornes de sonnerie de ce poste sont reliées
à un annonciateur spécial F, qui tombera si l’un
des postes simples reliés vient à envoyer un courant assez
puissant dans la ligne.
Les commutateurs à leviers permettent de faire de nombreuses
combinaisons entre divers postes reliés, telles, par exemple,
avec un seul levier, de relier deux postes simples avec le poste central.
Pour ces combinaisons, on augmente naturellement le nombre de lames
ou de contacts des commutateurs. On se sert également des commutateurs
à leviers dans les commutateurs multiples, actuellement d’un
usage si répandu.
L’inconvénient des commutateurs à leviers est qu’on
ne peu généralement pas donner plus d’une communication
à la fois par un même tableau, car tous les contacts inférieurs
des lames de ressort sont en communication, en sorte que si on abaissait
plus de deux leviers, tous les postes correspondants seraient en communication.
Généralement, quand on veut pouvoir donner plusieurs communications,
on établit plusieurs séries de leviers correspondant chacune
à un circuit distinct.
M. Pinel, contrôleur du service télégraphique des
Chemins de fer de P.-L.-M., a inventé récemment un système
de tableaux à leviers à positions multiples, appelé
à rendre les plus grands services. Chaque levier peut prendre
un certain nombre de positions différentes.
Dans le type à quatre positions, si les leviers sont dans leur
première position, les annonciateurs se trouvent en communication
avec les lignes correspondantes, en sorte que, si un poste vient à
appeler, son annonciateur tombe ; la seconde position permet au central
de se mettre en communication avec l’un quelconque des postes simples
; si on place deux leviers dans la troisième position, on met
les deux postes correspondants en communication et on laisse un annonciateur
en dérivation; enfin, la quatrième position permet de
mettre en même temps deux autres postes en communication et de
laisser également un annonciateur en dérivation.
Réseaux téléphoniques comprenant plusieurs postes
centraux. — On peut, en groupant ensemble un certain nombre
de réseaux téléphoniques à poste central,
obtenir des combinaisons facilitant notablement la mise en communication.
Supposons, par exemple, qu’on ait à relier entre eux six
postes A, B, G, D, E, F (fig. 46).
On place à chaque poste un poste central à cinq directions
permettant à ce poste d’appeler chacun des cinq autres.
On peut ainsi, sans déranger personne,, se mettre soi-même
en communication avec le poste qu’on désire.
Il peut également arriver que chaque poste n’ait pas besoin
de communiquer avec chacun des autres. C’est le cas de l’installation
représentée figure Il y a sept postes à desservir,
A, B, C, D, E, F, G. Le poste A est à six directions et communique
avec chacun des autres postes.
Le poste B n’est qu’à cinq directions ; il ne peut
communiquer §,vec G que par l’intermédiaire de A.
E et G sont chacun à trois directions ; ils peuvent communiquer
entre eux et avec A et B.
D et F sont chacun à deux directions ; ils ne peuvent communiquer
qu’avec A ou B.
Enfin le poste G ne peut communiquer qu’avec A.
Ce système est fréquemment employé pour relier
entre eux les bureaux d’une même administration, car dans
ce cas les frais de construction des lignes ne sont pas très
importants à cause de leur faible étendue. Il serait tout
à fait impraticable si la longueur des lignes augmentait, car
les frais de premier établissement deviendraient immenses s’il
fallait relier tous les postes deux à deux.
— Le poste central ne peut pas donner de communications directes.
Il peut être très utile, particulièrement dans les
chemins de fer, d’empêcher un poste de donner des communications
directes. On évite ainsi qu’un agent, chargé de transmettre
un ordre, ne se décharge de sa responsabilité en permettant
aux deux postes entre lesquels il sert d’intermédiaire de
communiquer directement entre eux.
On emploie généralement les mêmes types d’appareils
que ceux décrits plus haut, aussi bien aux postes simples qu’au
poste central.
Commutateur jack-knife. — La seule modification qu’on ait
fait subir à ces appareils consiste dans la suppression des cordons
à deux fiches dont est muni le poste central. Ce dernier n’a
alors qu’un cordon à une fiche, lui permettant bien de se
mettre en communication avec Lun quelconque des postes simples reliés,
mais empêchant toute communication directe.
Commutateurs à leviers. — Les figures 48 et 49 montrent
différentes combinaisons de ces commutateurs.
La figure_48 montre la disposition d’un poste central à
trois directions, ne pouvant pas donner de communications directes.
Si un poste appelle, le courant passe par l’annonciateur, le fait
tomber et avertit le poste central. L’employé de ce dernier
poste •abaisse son levier et se met en communication avec le poste
appelant ; supposons que ce poste soit le poste 2. Le poste central
abaisse alors le levier et on peut voir, en suivant les communications,
que les bornes de ligne du poste central sont directement reliées
aux fils de ligne allant au poste 2. Si maintenant le poste central
vient à abaisser un autre levier, par exemple le levier 3, il
restera toujours en communication avec le poste 2 ; mais il ne reliera
pas 2 et 3.
La figure 49 montre la disposition d’un seul levier commandant
deux postes.
Le levier étant levé, le poste central se trouve en communication
avec le poste 2 ; le levier étant au contraire abaissé,
le poste central se trouve en communication avec le poste 1. De plus,
une sonnerie spéciale est affectée à chacun des
deux postes reliés, erj. sorte que le central peut reconnaître
quel est celui qui l’appelle ; on pourrait d’ailleurs remplacer
les deux sonneries par des annonciateurs et une seule sonnerie fonctionnant
en local.
sommaire
II. — Réseaux téléphoniques dont tous
les postes sont situés le long d’une même ligne.
a. — Chaque poste peut communiquer seulement avec ses voisins..
Ce cas revient à placer en chaque poste un poste central à
deux directions ne pouvant pas donner de communications directes. Les
ordres peuvent ainsi être transmis de proche en proche, 'd’un
bout à l’autre de la ligne.
Un dispositif qui est tout indiqué pour ce cas particulier est
celui d’un seul levier commandant deux postes.
b. — Chaque poste peut mettre en communication ses deux voisins.
La disposition est encore la même, avec cette différence
que le poste central peut en chaque point donner des communications
directes.
Le figure 50 représente la disposition d’un poste, constitué
de cette manière. C’est un poste central à deux directions
avec annonciateurs jack-knives et cordon à deux fiches.
c. — Chaque poste peut appeler directement l’un quelconque
des autres de la ligne.
Il existe un assez grand nombre de dispositifs permettant de réaliser
cette combinaison.
Nous en décrirons cinq pris parmi les plus employés.
Ce sont :
1° L’appel direct ;
2° Les annonciateurs polarisés ;
3° Le rappel par inversion ;
4° Les relais Ader ;
5° Le rappel omnibus Bréguet.
1° Appel direct.
Considérons trois postes A, B, C placés sur une même
ligne et reliés parles fils 1 et 2 (fig. 54).
Au poste B se trouve un relais composé d’un électro-aimant,
dont les deux extrémités de l’enroulement sont reliées,
l’une a, au fill ; l’autre b, au fil 2.
Au poste C se trouve également un relais formé d’un
électroaimant. Ce relais n’est pas monté de la même
façon que celui du poste B. La bobine porte deux enroulements,
cd et ef; cd est relié en c au fil 4, emd à la terre ;
efest relié, en e au fil 2, en fh la terre.
Supposons qu’en A se trouve une pile et que nous,reliions le pôle
positif de cette [pile au fil 3, son pôle négatif au fil
1. Le circuit se ferme d’une part par le relais de B, le courant
traversant l’enroulement ba ; ce courant aimante l’électro
et le relais fonctionne en faisant retentir une sonnerie locale. Au
poste G, le courant arrive «n e, parcourt cet enroulement suivant
ef, puis le second suivant de: donc le courant entoure deux fois la
bobine de Télectro-aimant du poste C, et les deux fois en sens
contraire ; il est donc sans action sur le noyau, car les deux effets
s’annulent.
Si donc on relie chacun des pôles de la pile À à
l’un des fils 1 ou 2, le relais de B fonctionnera seul et A pourra
de cette façon appeler B sans déranger C.
Si maintenant on relie chacun des fils 1 et 2 au pôle positif
de la pile en A et le pôle négatif de la même pile
à la terre, le courant parcourra chacun des fils 1 et 2 dans
le sens A, B, G. Aucun courant ne passera par ab, car, pour que le circuit
puisse se fermer, il faut y interposer une terre. Au contraire, au poste
C, le courant traversera -simultanément les deux enroulements
suivant cd et ef, c’est-à-dire dans le même sens,
et s’écoulera ensuite à la terre en d et /'.
Donc, de cette manière, A pourra appeler C sans déranger
B.
On construit donc une clef double d’appel pour le poste A; cette
clef permet, soit de relier le fil 1 au zinc et le fil 2 au cuivre et
d’émettre ainsi ce qu’on est convenu d’appeler
un courant d’appel métallique, parce que le circuit se ferme
entièrement par les fils sans traverser la terre, soit de relier
les fils 1 et 2 tous les deux au cuivre et le zinc à la terre
; on émet alors un courant dit d’appel direct.
Cette clef double est représentée figure 51.
2° Annonciateurs polarisés.
Ce dispositif est basé sur l’emploi des électro-aimants
à armature polarisée et actionnés, tantôt
par un courant positif, tantôt par un courant négatif.
Le principe de ces appareils est le suivant :
Si on considère un électro-aimant A (fig. 52) et si on
envoie un courant d’un certain sens dans les bobines de cet électro-aimant,
le passage du courant orientera les molécules magnétiques
du noyau et engendrera à l’extrémité des noyaux
deux pôles magnétiques de nom contraire. Soit 1 le pôle
austral engendré, 2 le pôle boréal. Si maintenant
on vient à faire passer dans les bobines un courant de sens contraire
au premier, le pôle 1 deviendra pôle boréal et le
pôle 2 pôle austral.
Si devant les pôles de l’électro se trouve une armature
de fer doux et si on fait passer un courant dans les bobines, l’armature
sera attirée, quel que soit le sens du courant, c’est-à-dire
quelle que soit la nature de l’aimantation de chacun des pôles.
Si, au contraire, l’armature est un barreau d’acier aimanté,
elle ne sera attirée que tant que ces pôles magnétiques
se trouveront en regard de pôles de nom contraire.
Si les pôles de l’armature se trouvent en regard de pôles
de meme nom de l’électro-aimant, il n’y aura aucune
attraction et tout se passera comme si l’on n’avait pas envoyé
de courant dans les bobines.
Les annonciateurs polarisés sont des annonciateurs ordinaires,
dont l’armature est constituée par un barreau aimanté,
au lieu d’une barre de fer doux.
Supposons un poste G (fig. 53) comportant un tableau et desservant deux
postes montés sur une même ligne A et B. La ligne arrive
au tableau du poste C par deux bornes, de là passe dans deux
jack-knives croisés, comme l’indique la figure, et enfin
se rend à deux annonciateurs polarisés a et b montés
en dérivation et disposés : a pour fonctionner par le
courant positif, b par le courant négatif.
Les sonneries des postes A et B ont leurs armatures également
polarisées et fonctionnent : celle de B par le courant positif,
celle de A par le courant négatif.
Enfin, les piles d’appel de A et B sont montées également
pour émettre, celle de A, un courant positif, celle de B, un
courant négatif. On voit donc que si A appelle, l’annonciateur
a fonctionnera seul; si c’est B qui appelle, l’annonciateur6
seul fonctionnera seul. Enfin, le poste G, en plaçant sa fiche
dans le jack-knives ja ou dans le jack-knives jb émettra dans
la direction des deux postes A et B des courants de sens contraire et,
par suite, seule la sonnerie correspondant au courant émis fonctionnera.
On aura ainsi très simplement résolu l’intercommunication
des trois postes.
Il existe bien d’autres façons d’utiliser les annonciateurs
polarisés ; ils permettent toujours de monter deux postes sur
une même ligne. On peut d’ailleurs éviter la disposition
des jack-knives croisés en munissant le poste G d’un inverseur
de courant.
Inverseur de courant. — C’est un commutateur disposé
de manière à permettre, rien que par la manœuvre
d’une manette, de changer le sens du courant d’une pile (fig.
54).
Il se compose de deux commutateurs manœuvrés par la même
manette. Les axes des deux commutateurs sont reliés respectivement
aux pôles cuivre et zinc de la pile, A la partie supérieure
sont deux bornes reliées aux fils de ligne 1 et 2.
Les commutateurs peuvent prendre deux positions différentes ;
lorsqu’ils se trouvent dans celle représentée en
traits pleins, on voit que le zinc de la pile est relié à
la borne 1 de la ligne et le cuivre à la borne 2. Si on tourne
les commutateurs dans la position pointillée, le zinc de la pile
est relié à la borne 2 et le cuivre à la borne
1 ; on a donc ainsi changé le sens du courant émis par
la pile.
En intercalant cet appareil entre la pile d’appel et ses bornes
au point G, on voit qu’on peut émettre vers A et B un courant,
soit positif, soit négatif.
Annonciateurs polarisés système Aulagne.
M. Aulagne, agent de la Société générale
des Téléphones, a combiné le système de
l’appel direct et celui des annonciateurs polarisés pour
grouper entre eux trois postes, leur permettre de s’appeler deux
à deux, sans déranger le troisième et faire connaître
en même temps au poste appelé quel est celui qui appelle
(fig. 55 et 56).
Les deux postes extrêmes comportent chacun une clef d’appel
direct, et deux annonciateurs polarisés disposés pour
fonctionner par l’appel direct, l’un par le courant positif,
l’autre par le courant négatif.
Le poste milieu comporte également deux annonciateurs mais montés
pour fonctionner par appel métallique, l’un positivement,
l’autre négativement. Enfin à ce poste se trouvent
deux jack-knives, permettant au poste de se mettre en communication
soit avec le poste de droite, soit avec celui de gauche.
Le poste de gauche appelle le poste milieu par un courant métallique
positif, et le poste de gauche par un courant d’appel direct positif.
Le poste milieu appelle chacun des postes extrêmes par un courant
d’appel direct négatif, mais il a soin auparavant de relier
son cordon à une fiche au jack-knife correspondant au poste,
qu’il veut appeler.
Enfin, le poste de droite appelle le poste milieu par un courant métallique
négatif et le poste de gauche par un courant d’appel direct
positif.
On obtient ainsi [cl’une manière très simple l’intercommunica-tion
des trois postes.
M. Anlagne a fait construire des types spéciaux d’annonciateurs
pour ces appareils. Nous en donnons ci-joint le croquis (fig. 56 j.
Les deux annonciateurs composant un même poste sont commandés
directement par un noyau commun à deux bobines se déplaçant
devant deux armatures fixes.
Ce noyau bascule à droite ou à gauche suivant le sens
du courant traversant les bobines, et déclenche ainsi le volet
de l’un ou l’autre des deux annonciateurs qu’il commande.
3° Rappel par inversion. — Le principe de ce dispositif est
le suivant :
Un électro-aimant polarisé enfer à cheval est relié
parles deux extrémités de son enroulement aux deux fils
de ligne (fig. 51 ).
Un barreau aimanté présente entre les deux pôles
de l’électro l’un de ses pôles, le pôle
austral a par exemple. Le barreau aimanté est mobile autour d’un
axe et peut se porter vers l’un ou l’autre des pôles
de l’électro-aimant. Si on envoie un courant dans les bobines
de l’électro, les noyaux s’aimanteront et le barreau
se portera vers le pôle boréal engendré, c’est-à-dire
vers la bobine B ou la bobine Bt selon le sens du courant.
Dans ce mouvement le barreau bute contre l’un des deux contacts
c ou cv En butant contre le contact ct rien n’est changé
aux conditions existantes ; au contraire en butant contre c, le barreau
vient fermer un circuit local de sonnerie, et produit ainsi l’appel.
Les postes à rappel par inversion ont pour but, étant
donnée une ligne au simple fil sur laquelle on a à placer
trois postes ABC, de permettre à chacun d’eux d’appeler
l’un des deux autres sans déranger le troisième (fig.
58 et 59).
Les postes A et G sont les postes terminus ; ils comprennent chacun:
un rappel par inversion, fonctionnant par le courant positif, un commutateur
inverseur, un appareil téléphonique.
Le poste B est le poste intermédiaire ; il comprend : un rappel
par inversion fonctionnant par le courant négatif, un appareil
téléphonique avec cordon à une fiche.
Les postes sont reliés au simple fil. Dans les deux postes terminus,
le rappel par inversion remplace la sonnerie dans le poste milieu ;
il est relié aux deux jack-knives comme le seraient des annonciateurs
dans un poste central ordinaire.
On conçoit que si le poste A par exemple émet un courant
d’appel positif, il fera agir le rappel par inversion de chacun
des postes B et G ; mais le rappel du poste G seul est disposé
pour fonctionner par le courant positif: donc, seule, la sonnerie de
ce poste retentira. Si, au contraire, il émet un courant négatif,
c’est la sonnerie du poste B qui retentira.
Pour changer le sens du courant d’appel les postes A et G n’cnt
qu’à agir sur leur inverseur de courant. Le poste B, au
contraire, appelé toujours positivement; il dirige son appel
vers A. ou vers G en plaçant la fiche de son cordon dans l’un
ou l’autre des deux jack-knives a ou c.
Enfin, si un poste est appelé, il lui suffit de décrocher
son récepteur pour se mettre en communication ; le poste B peut
en outre, en mettant sa fiche dans le jack a, couper toute communication
avec le poste G et en la mettant dans le jack c couper toute communication
avec le poste A. B pourrait d’ailleurs toujours parler avec l’un
ou l’autre des deux postes G ou A sans utiliser la fiche du cordon
; mais l’autre pourrait dans ce cas suivre la conversation.
4° Relais Ader. — Le principe du relais Ader est inverse de
celui des annonciateurs polarisés et du rappel par inversion.
Il se compose d’un circuit mobile entre les pôles d’un
aimant fixe (fig 60)
Le courant arrive dans le circuit mobile et, selon son sens, le fait
dévier vers le pôle austral ou le pôle boréal
de l’aimant.
Le circuit mobile G est porté par une tige métallique
T formant commutateur. L’une des extrémités d’un
circuit local de sonnerie est relié à l’axe de la
tige T ; cette dernière en déviant peut venir buter soit
contre le contact a, soit contre le contacté ; le contacta est
relié à la seconde extrémité du circuit
local de sonnerie. Il en résulte que si la tige T bute contre
le contact a, elle vient fermer le circuit local et la sonnerie retentit.
Si, au contraire, elle bute contre le contact b, le circuit reste ouvert
et la sonnerie ne retentit pas.
On voit donc que le relais Ader est susceptible de remplacer le rappel
par inversion car, comme lui, il permet de faire fonctionner une sonnerie
soit par un courant positif soit par un courant négatif.
En outre, la masse à déplacer dans le relais Ader est
très petite et, par suite, le relais Ader fonctionne sous l’action
de courants très faibles.
La figure 61 représente cette disposition pour une série
de quatre postes A B G D.
Les bornes de sonnerie de chaque appareil sont reliées à
un relais Ader actionnant en local une sonnerie d’appel. Si un
poste, le poste' B par exemple, appelle, tous les relais Ader vont fonctionner
et faire marcher les sonneries locales ; si, en outre, on a établi
une convention de sonnerie basée par exemple sur les signaux
de l’appareil Morse (coups brefs et coups prolongés), le
poste B indiquera quel est le poste auquel il désire parler.
Ce poste n’aura alors qu’à décrocher son récepteur
pour se trouver en ligne ; le poste B en fera autant et les deux postes
pourront communiquer ensemble.
On peut encore utiliser avantageusement ce dispositif dans les installations
où il faut pouvoir aviser en même temps toute une série
de postes. Il suffit alors d’avoir un signal d’appel général
; dès qu’ils entendent ce signal, les employés de
tous les postes se portent à leur appareil, décrochent
les récepteurs et se trouvent tous en ligne ; ils peuvent ainsi
avoir une conversation générale .
Le relais Ader peut, d’ailleurs, être construit de très
faible résistance, ce qui lui permet de remplacer avec avantage
même les relais ordinaires.
C’est ainsi qu’il est appliqué sur les lignes de Paris
à Marseille pour donner le signal de fin de conversation. De
même la Société générale des Téléphones
l’a installé sur le commutateur multiple pour 1 200 lignes
à circuit entièrement métallique qu’elle vient
de monter à Lille.
La Société générale
des Téléphones a en outre combiné un
système de postes basés sur le même principe que
les postes à rappel par inversion, mais permettant d’augmenter
notablement le nombre de postes reliés et s’appelant directement
entre eux.
A chaque poste se trouvent deux relais Ader au lieu d’un, et il
est nécessaire que chacun des deux relais composant un poste
vienne buter contre un contact pour que la sonnerie fonctionne. Les
relais sont disposés comme l’indique la figure 62.
L’installation comprend deux lignes complètement indépendantes
et comportant chacune un relais pour chaque poste.
Si dans le fil 1 on envoie un courant -|-, tous les relais s’inclineront
vers la gauche ; si c’est un courant négatif, ils s’inclineront
vers la droite. De même pour le fil 2.
Si maintenant on envoie dans chaque fil un courant -f-, les relais du
fil 1 des postes I, II, YII viendront buter contre leurs contacts ;
de même les relais du fil 2 aux postes I, III, V, YII. On voit
donc qu’il n’y a qu’aux postes I et YII que les deux
contacts ferment les circuits locaux et par suite que les sonneries
puissent retentir,
Mais on voit que si, par exemple, l’appel est émis par le
poste T, il suffira de disposer les communications à ce poste
pour que le courant qu’il émet ne passe pas par les relais
Ader qui s’y trouvent, et alors, en sonnant positivement dans chaque
fil, le poste I appellera simplement le poste YII ; si, au contraire,
c’est un poste intermédiaire qui appelle, pour éviter
qu’il n’appelle simultanément I et YII, il suffit de
disposer un commutateur permettant de, couper la ligne dans la direction
où on ne veut pas sonner.
On voit que certains postes ont un de leurs relais qui vient au repos
buter contre leurs contacts : donc leur sonnerie ne retentira qu’à
condition qu’il ne passe pas de courant dans le fil correspondant
à ce relais.
Dans ces conditions, l’appel se fera suivant le tableau ci-après
:
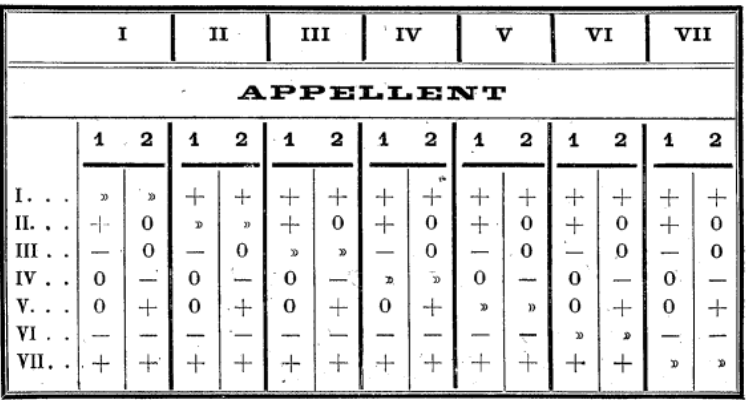
A chaque poste se trouvent six leviers chacun correspondant à
l’un des autres postes. En abaissant par exemple le levier 5, on
établit les communications entre la pile et la ligne par l’intermédiaire
de la clef d’appel, de telle façon qu’en appuyant sur
cette clef la ligne soit parcourue par le courant voulu pour actionner
le poste 5. (Voir le croquis du poste5, fig. 63.)
Outre ces applications des relais Ader pour remplacer les rappels par
inversion, on les a encore utilisés pour remplacer les relais
ordinaires, et cela en raison de leur faible résistance, ce qui
permet d’en monter une grande quantité en tension, sans
augmenter sensiblement le nombre d’éléments nécessaires.
6° Rappel omnibus Breguet. — Ce système a pour but de
permettre l’appel direct d’un poste quelconque à un
autre poste également quelconque, en n’exigeant qu’un
seul fil en tout, si la terre sert de retour, et deux fils si le retour
doit se faire par fil isolé ; ces résultats étant
obtenus quel que soit le nombre de postes à relier.
Le principe du système est celui du télégraphe
à cadran Breguet. Tous les postes sont semblables (fig. 64).
Chacun d’eux comprend un poste simple ordinaire et en outre :
1 indicateur à cadran ;
1 bouton d’appel spécial ;
1 tableau sur lequel sont montés les appareils.
Les postes sont successivement réunis l’un à la suite
de l’autre depuis le premier jusqu’au dernier par un seul
fil, comme l’indique le croquis donné plus haut pour la
disposition par relais Ader.
Si la terre sert de retour, le premier et le dernier postes sont reliés
à la terre. Si le retour doit avoir lieu par fil spécial,
le premier et le dernier postes sont reliés directement par un
second fil parallèle au premier.
Soient 13 postes 1, 2, 3, .... 13 à mettre en communication téléphonique.
Supposons un fil spécial de retour.
L’indicateur à cadran de chacun des postes comprend quinze
cases numérotées, les 13 premières de 1 à
13; la quatorzième est marquée « occupée
» et la quinzième est marquée « libre ».
Lorsque l’aiguille de l’indicateur du poste 1 est sur la case
1, elle ferme le circuit local de la sonnerie de ce poste. Lorsque l’aiguille
de l’indicateur du poste 2 est sur la case 2, elle ferme le circuit
de la sonnerie de ce poste sur la pile locale et ainsi de suite pour
tous les postes.
Cela posé, supposons que le poste 10 veuille appeler le poste
3.
L’opérateur du poste 10 pousse trois fois sur le bouton
d’appel de son appareil.
La première fois, les aiguilles de tous les postes du réseau
se portent sur la case 1, et au poste 1 seul la sonnerie tinte un coup.
La seconde fois, toutes les aiguilles se portent sur la case 2, et au
poste 2 seul la sonnerie tinte un coup.
La troisième fois, toutes les aiguilles se portent sur la case
3, et au poste 3 seul la sonnerie tinte aussi longtemps qu’aucune
modification ne sera apportée à l’ensemble, c’est-à-dire
jusqu’à ce que le poste 3 étant prévenu, la
personne appelée se porte à l’appareil et pousse
sur son bouton d’appel autant de fois qu’il faut pour amener
les aiguilles de tous les postes indicateurs sur la case « occupée
». Dans le cas présent, onze fois; puis la conversation
peut s’engager entre les postes 3 et 10.
Tous les postes sont ainsi avertis que deux postes sont en conversation
et qu’ils doivent attendre pour communiquer eux-mêmes.
Dès que la conversation est terminée, le poste qui a appelé
(ici le poste'10) pousse une fois sur son bouton d’appel et les
aiguilles de tous les indicateurs reviennent sur la case' « libre
» ; la ligne est ainsi rendue libre à tous les postes.
-Ce système de communications téléphoniques a déjà
été établi, notamment aux chemins de fer du Sud
de la France.
Outre les dispositifs décrits, il en existe un grand nombre d’autres
basés soit sur le principe du télégraphe à
cadran, soit sur l’emploi des courants électriques de différents
sens et des armatures polarisées ; nous citerons par exemple
le rappel Claude, la pendule américaine, etc., etc.
Enfin on emploie, quand on a une ligne directe téléphonique
ou télégraphique au simple fil qu’on désire
couper en un point intermédiaire pour la rendre omnibus, des
planchettes de coupure. Ces appareils laissent toujours la faculté,
à un moment donné, de rétablir la ligne directe
en supprimant le poste intermédiaire par une simple manœuvre
de commutateurs.
Appareils à sonnerie magnétique.
Lorsque les distances séparant deux postes sont assez grandes,
le nombre d’éléments à employer pour la pile
d’appel augmente très rapidement ; on se trouve donc en
présence d’une difficulté assez sérieuse.
On ne peut en effet songer à augmenter beaucoup le nombre des
éléments, en raison de la grande place qu’ils nécessitent
et, en outre, des frais d’installation et d’entretien assez
élevés qu’ils comportent. On a donc eu l’idée
d’utiliser les générateurs mécaniques d’électricité.
y.
On emploie à cet effet des petits magnétos, dits magnétos
d’appel. Ces magnétos fonctionnent au moyen d’une manivelle
et engendrent un courant alternatif de très haute tension (50
volts à la vitesse ordinaire de rotation).
On emploie alors des sonneries spéciales polarisées fonctionnant
par courant alternatif. Ce sont simplement des électroaimants
dont l’armature est polarisée et est mobile autour d’un
axe situé entre les deux bobines ; cette armature porte une tige
qui vient frapper alternativement sur les deux timbres. La figure 65
(1) montre la disposition d’un transmetteur Ader à sonnerie
magnétique; et la figure 66 (2) représente un magnéto
d’appel destiné à être relié à
un transmetteur Ader ordinaire.
Les magnétos d’appel font parfaitement tomber les annonciateurs
des postes centraux, et dans ce cas, pour obtenir un appel acoustique,
il suffit d’utiliser le dispositif de sonnerie continue dont nous
avons parlé plus haut.
Dans certains cas, les postes à sonnerie magnétique ont
à communiquer avec des postes centraux où 'l’appel
est fait par des piles ; on ne peut donc pas à ce poste central,
pour un seul poste à appel magnétique relié, établir
un magnéto d’appel; il existe donc des magnétos d’appel
spéciaux permettant au poste où ils sont montés
d’appeler par appél magnétique et d’être
appelés par piles (fig. 67) (3).
Les appareils à sonnerie magnétique ont reçu une
application très utile dans les chemins de fer: c’est le
téléphone portatif (fig. 68) (4).
(1) A sonnerie magnéto-électrique. — B bobine
d’induction. — C commutateur automatique. — D contact
s’interrompant quand on tourne la manivelle. — É pôle
relié à la masse du magnéto. — F second pôle
du magnéto.— M' microphone. — R récepteurs.
— T paratonnerre. — l bornes de ligne. — t borne de terre.
— P bornes de la pile microphone.
(2) A. magnéto. — B contact s’interrompant quand on
tourne la manivelle. — C pôle relié à la masse
du magnéto. — D second pôle du magnéto.
(3) A contact s’interrompant quand on tourne la manivelle. —
B contact se formant quand on tourne la manivelle. — C pôle
relié à la masse du magnéto. — D second pôle
du magnéto. — L fils de ligne.
(4) A sonnerie magnétique. — B bobine d’induction.
— C commutateur. — D contact s’interrompant quand on
tourne la manivelle. — E pôle relié à la masse
du magnéto. — F second pôle du magnéto. :—
M microphone. — R récepteur. —• P piles sèches.
— L bornes de ligne. — r bornes du récepteur. —
m bornes du microphone. — S plot de sonnerie. — N plot du
microphone.
Il se compose d’un transmetteur Berthon, d’un
récepteur Ader, d’une bobine d’induction, de trois
éléments secs à l’agar agar pour le circuit
microphonique, d’un magnéto d’appel avec commutateur
pour mettre l’appareil sur sonnerie ou transmission ; ce commutateur
peut, soit être complètement indépendant, soit être
porté par la poignée reliant le transmetteur Berthon et
le récep^ teur Ader. Le tout est renfermé dans une boîte
en chêne et prend place dans le fourgon du chef de train. Il est
complété par une longue canne en bambou, dite canne de
prise de ligne, portant une borne qu’on relie à l’une
des bornes de l’appareil et un crochet à la partie supérieure
communiquant avec cette borne ; l’autre borne est reliée
à la terre par l’intermédiaire d’un piquet métallique.
En cas d’accident, le chef de train descend du fourgon avec son
téléphone portatif, relie les bornes comme il vient d’être
dit et, avec sa canne de prise de ligne, vient saisir un des fils téléphoniques
courant le long de la voie; puis il appelle au moyen du magnéto
et parle en réclamant le secours nécessaire.
Cet appareil a encore été employé très fréquemment
pour la construction des lignes de chemins de fer, notamment dans le
cas du chemin de fer de Paris à Arpajon. Au fur et à mesure
que les travaux avançaient, on avançait également
l’appareil portatif et on restait en communication constante du
chantier de construction avec la direction des travaux.
Actuellement, la ligne est terminée et les ûls posés
servent à l’intercommunication des gares.
Dans certains chemins de fer où les gares sont reliées
téléphoniquement et où l’appel se fait par
piles, on a modifié l’appareil ci-dessus en remplaçant
le magnéto d’appel par une batterie de quatre éléménts
placée dans le fourgon.
sommaire
PILES. EMPLOYÉES EN TÉLÉPHONIE
Les piles employées en téléphonie sont les mêmes
que celles employées dans les installations intérieures
de sonneries domestiques. Pourtant on recherche plus de constance et
une meilleure construction.
Il était nécessaire d’avoir un élément
d’assez bonne qualité, de prix pas trop élevé
et ne contenant pas de liquide corrosif, les installations téléphoniques
se faisant généralement dans les intérieurs. La
pile Leclanché remplit ces différentes conditions. Sa
polarisation assez rapide n’est guère un inconvénient,
le circuit restant rarement fermé plus de quelques minutes.
Comme types d’éléments Leclanché, nous citerons
: .
Les éléments ordinaires à vase poreux et à
tête plomb (fig. 69);
Les éléments ordinaires à vases poreux et à
tête munie d’une pince cuivre ;
Les éléments Leclanché à plaques agglomérées,
où le mélange de manganèse et charbon, au lieu
d’être contenu dans un vase poreux, est comprimé sous
forme de plaques, qui se fixe sur une lame de charbon par un bracelet
en caoutchouc (fig. 70);
Les éléments Leclanché à agglomérés
cylindriques, où le mélange, au lieu d’être
comprimé sous forme de plaque, est en forme de vase (fig. 74);
Les éléments Goodwin à vase poreux charbon;
Les éléments secs à l’agar-agar, où
tout le liquide est absorbé par une sorte de pâte gélatineuse
obtenue par une herbe japonaise appelée agar-agar (fig. 72 et
73).
Les éléments secs, d’ailleurs peu employés
dans les débuts, à cause de leur mauvaise construction,
prennent de jour en jour une plus grande importance depuis qu’on
est arrivé à les rendre aussi sûrs que les éléments
à liquides. Leur maniement est, d’ailleurs, beaucoup plus
commode, et ils ont leur place tout indiquée dans tous les appareils
portatifs. Parmi les meilleurs, nous citerons encore, outre les éléments
à l’agar-agar dont nous avons parlé plus haut, la
pile Bloc (fig 74).
La pile Bloc est contenue entièrement dans uDe caisse en bois;
l’agglomérant est de la cellulose extraite de la noix de
coco. Cet élément, de forme commode, se prête admirablement
aux différents montages qui peuvent être nécessaires.
Sa force électromotrice moyenne est de 1 volt 50 et sa résistance
intérieure ne dépasse pas, dans certains types,
SONNERIES A RELAIS
Nous avons vu plus haut que, dans les tableaux de postes centraux, on
pouvait disposer la sonnerie de manière à la faire fonctionner
d’une manière soit intermittente, soit continue. Il peut
être utile, dans les endroits où se trouvent installées
des sonneries quelconques, d’avoir également une sonnerie
continue. C’est le but que remplissent les sonneries à relais.
Il existe deux types bien différents de sonneries à relais
: les sonneries à annonciateurs et les sonneries à lapins.
Sonneries à annonciateurs. — On en fait de différents
modèles les unes, montées comme des sonneries cubiques
ordinaires, portent sur une de leurs faces des annonciateurs en nombre
égal à celui des lignes aboutissant au poste (fig. 75).
L’annonciateur en tombant forme un circuit local qui vient faire
résonner la sonnerie.
Dans d’autres types tel que celui adopté par la Compagnie
des chemins de fer du Nord ; la sonnerie a la forme d’une sonnerie
ordinaire d’appartement ; un annonciateur placé sur la boîte
ferme le circuit local en tombant (fig. 76). ’
Sonneries à lapins. — Les lapins sont des sortes d’annonciateurs
actionnés de même que les précédents par
l’armature d’un électro-aimant. Le lapin est constitué
par une lame triangulaire, qui, au passage du courant, vient faire saillie
hors d’une ouverture longitudinale placée sur l’un
des côtés de la boîte de la sonnerie.
Les figures 77 et 78 en montrent différentes dispositions :
APPAREILS MAGNÉTIQUES
Si on considère deux récepteurs A et B reliés par
uu double fil de ligne, les vibrations de l’armature de A produites
par la voix, modifient le champ magnétique de l’électro-aimant
polarisé constituant le récepteur A (fig. 79).
Par suite des phénomènes de l’induction, la variation
de l’intensité d’aimantation détermine des courants
induits dans l’enroulement des bobines; ces courants se reproduisent
au poste B par l’intermédiaire des fils de ligne et agissent
sur l’armature de B. On obtient ainsi une transmission excellente,
et on a constitué aux postes A et B deux appareils magnétiques.
Malheureusement dès qu’on cherche à augmenter un
peu la longueur de la ligne, la transmission ne se fait plus ou se fait
mal. On a donc pu appliquer seulement ce procédé pour
des lignes très courtes.
La plupart du temps, au lieu de monter à chaque poste un seul
récepteur, on en monte deux ou trois accouplés en tension
; l’un d’eux sert alors pour la transmission et reçoit
le nom de transmetteur magnétique ; l’autre ou les autres
servent pour la réception.
Les appareils magnétiques les plus employés sont les appareils
Aubry. Il s’en construit plusieurs modèles, selon les usages
auxquels ils sont destinés.
L’appareil dit type des chemins de fer, employé sur la ligne
de Grande-Ceinture, se compose d’un transmetteur magnétique,
de deux récepteurs magnétiques, d’un magnéto
d’appel et d’une sonnerie fonctionnant par appel magnétique.
Dans la position d’appel, la sonnerie, le magnéto et les
lignes sont montés en série, en sorte que si on vient
à tourner la manivelle du magnéto, la sonnerie du poste
appelant et celle du poste appelé retentissent toutes deux. On
peut d’ailleurs, en appuyant sur un bouton à trois contacts,
mettre la sonnerie hors circuit et augmenter ainsi l’intensité
du courant traversant la ligne.
En décrochant les récepteurs, on actionne un commutateur
automatique, qui coupe la sonnerie et met le transmetteur et les récepteurs
en ligne.
D’autres types sont employés comme postes portatifs.
On se sert alors fréquemment du même appareil pour la transmission
et la réception. Il suffit donc d’un récepteur avec
deux bornes se reliant aux deux fils de ligne pour effectuer le service.
L’appel se fait au moyen d’une corne d’appel dans laquelle
on souffle en la plaçant devant l’appareil.
Ces appareils sont contenus soit dans des pochettes en cuir qu’on
fixe au ceinturon, soit dans des boites en bois qu’on porte en
bandoulière. Les pochettes contiennent un seul récepteur
Aubry, avec cordon à deux conducteurs et fiche à deux
bornes ; la boite en bois porte les deux bornes extérieurement;
deux récepteurs accouplés en tension y sont reliés
par des cordons à deux conducteurs.
1907 Aux Etats-Unis, le système de répartition
téléphonique diffère toutefois fondamentalement des
systèmes utilisés dans le domaine commercial et constitue
en fait un système de lignes partagées
hautement spécialisé, conçu pour la sonnerie sélective
et de nombreuses stations .
Le premier du type a été installé par le New York
Central and Hudson River Railroad en octobre 1907, entre Albany et Fonda,
New York, sur une distance de 40 miles. Cette section de la route se trouve
sur la ligne principale et comporte quatre voies contrôlées
par des signaux de cantonnement.
Le Chicago, Burlington and Quincy Railroad fut le deuxième à
installer des circuits de répartition des trains. En décembre
1907, une partie de la ligne principale d'Aurora à Mendota, dans
l'Illinois, sur une distance de 46 miles, fut équipée. Cette
opération fut suivie rapidement par divers autres projets d'autres
circuits dont la longueur dépasse en général 100
miles. À cette date, il existe plus de 20 circuits de répartition
des trains sur le Chicago, Burlington and Quincy Railroad, couvrant 125
miles de voie double, 28 miles de voies multiples et 1 381 miles de voie
unique, et reliant 286 gares.
D'autres chemins de fer sont entrés dans ce domaine rapidement après les installations initiales, et presque tous les grands réseaux ferroviaires des États-Unis sont équipés de plusieurs circuits de répartition des trains par téléphone et tous semblent étendre leurs systèmes.
En 1910, plusieurs chemins de fer, dont le Delaware,
le Lackawanna et le Western, ont équipé l'ensemble de leur
réseau de circuits de répartition téléphonique.
Le Atchison, Topeka and Santa Fe Railroad équipe l'ensemble de
son réseau aussi rapidement que possible et est déjà
le plus grand utilisateur de ce matériel dans ce pays. Alors plus
de 55 chemins de fer se sont lancés dans ce domaine, ce qui fait
que le téléphone est désormais utilisé dans
le service ferroviaire sur plus de 29 000 miles de lignes.
Causes de son introduction.
Les raisons qui ont conduit à l'introduction du téléphone
dans le domaine de la répartition étaient de la nature suivante
:
- Premièrement, et la plus importante, était la promulgation
de lois fédérales et d'État limitant à neuf
heures la journée de travail des employés des chemins de
fer transmettant ou recevant des ordres relatifs au mouvement des trains.
- La deuxième raison, qui dépend directement de la première,
était l'incapacité des chemins de fer à obtenir le
nombre supplémentaire d'opérateurs télégraphiques
requis par les dispositions des nouvelles lois.
On estimait que 15 000 opérateurs supplémentaires seraient
nécessaires pour maintenir le service de la même manière
après l'entrée en vigueur des nouvelles lois en 1907. L'augmentation
des dépenses annuelles occasionnée par l'emploi de ces opérateurs
supplémentaires était estimée à environ 10
000 000 $.
- Une troisième raison est trouvée dans la diminution de
l'efficacité de l'opérateur télégraphique
moyen des chemins de fer et des entreprises commerciales. Il y a aujourd'hui
une plainte très générale parmi les chemins de fer
à propos de ce point particulier, et beaucoup d'entre eux accueillent
favorablement le téléphone, ne serait-ce que parce qu'il
les rend indépendants du télégraphiste. Il n'est
pas facile de déterminer les causes de cette diminution de l'efficacité,
mais on a tendance à l'attribuer en partie à l'attitude
de l'organisation des télégraphistes à l'égard
de l'opératrice étudiante. Il est également vrai
que les limites imposées par ces organisations aux étudiants,
les opérateurs étaient directement responsables du manque
d’hommes disponibles lorsqu’ils étaient nécessaires.
Avantages.
En procédant à ce changement radical, les responsables des
chemins de fer ont fait preuve de la plus grande prudence, et pourtant
nous ne connaissons aucun cas où l'introduction du téléphone
ait été suivie de son abandon, la tendance ayant été
dans tous les cas à de nouvelles installations et à davantage
d'équipements de type moderne. Les raisons en sont claires : là
où le téléphone est utilisé, il n'exige pas
un homme hautement spécialisé comme opérateur de
gare et, par conséquent, les chemins de fer disposent d'un champ
beaucoup plus large pour recruter des opérateurs. C'est là,
à notre avis, l'avantage le plus important.
La méthode téléphonique est également
plus rapide.
Sur un circuit ordinaire de régulation des trains, il faut maintenant
entre 0,1 et 5 secondes pour appeler une station. Si plusieurs appels
sont nécessaires, le régulateur appelle une station après
l'autre, obtient la réponse de l'une d'elles pendant que la suivante
est appelée, et ainsi de suite. En parlant au téléphone,
on peut transmettre beaucoup plus de mots en un temps donné que
par télégraphie Morse. Il est possible d'envoyer cinquante
mots par minute en Morse, mais cette vitesse est exceptionnelle. Moins
de la moitié est la règle. Le gain de vitesse obtenu est
donc évident et il a été constaté que c'est
une caractéristique très importante dans les services à
forte activité. Il est vrai que pour donner des « ordres
», la vitesse, dans la régulation téléphonique
des trains, est limitée à celle nécessaire pour écrire
les mots à la main. Mais toutes les instructions de nature collatérale,
la réception d'informations importantes et les descriptions instantanées
de situations d'urgence peuvent être données et reçues
à une vitesse limitée seulement par celle de la parole humaine.
Le répartiteur est également amené à établir une relation personnelle plus étroite avec les agents de gare et les agents de train, et cette caractéristique de communication personnelle directe s'est avérée importante pour favoriser un degré plus élevé de coopération et une meilleure discipline dans le service.
Le système de répartition téléphonique
présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui
sont importantes pour améliorer la qualité du service. L'une
d'entre elles est la « réponse » donnée automatiquement
au répartiteur par la sonnerie de la station intermédiaire.
Cela informe le répartiteur si la sonnerie de la station a sonné
ou non, et les excuses des opérateurs pour ne pas avoir sonné
sont éliminées.
N'importe qui peut répondre à un appel téléphonique
en cas d'urgence. L'opérateur de la station est souvent aussi un
agent et ses fonctions l'éloignent souvent du signal du télégraphe.
La sonnerie du sélecteur utilisée avec le téléphone
peut être entendue à une distance de plusieurs centaines
de pieds. De plus, il est fort probable que n'importe qui dans le voisinage
reconnaîtrait que la station est recherchée et avertirait
l'opérateur ou répondrait à l'appel.
En cas d'urgence, les équipes de train peuvent communiquer directement
avec le répartiteur au moyen de téléphones portables
embarqués dans les trains. Il est bien connu que chaque minute
où une ligne principale est bloquée par un accident peut
être considérée comme une perte importante pour la
compagnie de chemin de fer.
Il est également possible d'installer des postes
téléphoniques de voie de garage situés soit dans
des cabines, soit sur des poteaux le long de l'emprise. Ces postes sont
aujourd'hui en service sur les voies de garage, les passages à
niveau, les ponts-levis, les réservoirs d'eau et autres endroits
où il peut être essentiel pour l'équipe d'un train
d'atteindre la station de chemin de fer la plus proche pour donner ou
recevoir des informations.
Les avantages de ces lignes de voie de garage sont de plus en plus évidents.
Avec la méthode de répartition par télégraphe,
un train reçoit l'ordre de dépasser un autre train sur une
voie de garage donnée, par exemple. Il atteint ce point et, pour
reprendre une expression ferroviaire, « se retrouve dans le trou
». Si un autre train subit un retard, le premier reste bloqué
sur cette voie de garage sans possibilité d'atteindre le répartiteur
ou d'être contacté par lui. Grâce au poste téléphonique
de la voie de garage, qui ne nécessite pas d'opérateur,
ce problème est évité. Si un train se retrouve en
attente trop longtemps, le conducteur se rend au téléphone
de la voie de garage et parle au répartiteur, ce qui lui permet
peut-être d'obtenir des ordres qui lui permettront de gagner plusieurs
kilomètres qui auraient été perdus autrement.
Il n'est plus nécessaire pour un opérateur
de station intermédiaire d'appeler le répartiteur. Lorsqu'un
de ces opérateurs souhaite parler au répartiteur, il lui
suffit de décrocher son combiné téléphonique,
d'appuyer sur un bouton et de parler au répartiteur.
Avec le téléphone, il est facile de prendre des dispositions
pour que le chef répartiteur, le surintendant ou tout autre fonctionnaire
puisse écouter à volonté un circuit de train pour
observer le caractère du service. Le fait que cela soit possible
et que les opérateurs le sachent contribue fortement à améliorer
la discipline.
Les répartiteurs sont tellement soulagés par l'élimination
de la tension liée à la télégraphie continue
et peuvent effectuer leur travail beaucoup plus rapidement grâce
au téléphone, que dans de nombreux cas, il a été
possible d'augmenter la longueur de leurs divisions de 30 à 50
pour cent.
Conditions des chemins de fer.
L'une des principales raisons qui a retardé pendant tant d'années
l'entrée du téléphone dans le domaine de la répartition
est que les conditions dans ce domaine ne ressemblent à rien de
ce qui a été rencontré jusqu'à présent
dans la téléphonie commerciale. Aucun système n'a
été développé pour y faire face, bien que
les éléments étaient à portée de main.
Un chemin de fer est divisé en un certain nombre de divisions ou
districts de répartiteurs de longueurs variables. Ces longueurs
dépendent de la densité du trafic sur la division. Dans
certains cas, un répartiteur ne gère pas plus de 25 miles
de ligne. Dans d'autres cas, ce district peut avoir 300 miles de longueur.
Sur la longueur d'une de ces divisions s'étend le circuit téléphonique,
et ce circuit peut comporter 5 ou 50 stations, qui peuvent toutes être
obligées d'écouter la ligne en même temps .
On voit que le circuit de répartition téléphonique ressemble quelque peu à un circuit commercial longue distance par sa longueur et qu'il ressemble aussi à une ligne rurale dans la mesure où il comporte un grand nombre de téléphones. En ce qui concerne trois autres caractéristiques, à savoir que plusieurs de ces stations doivent être connectées simultanément au circuit, qu'elles doivent toutes être signalées de manière sélective et qu'il doit également être possible de parler et de signaler simultanément sur le circuit, un circuit de répartition téléphonique ne ressemble à rien dans le domaine commercial. Ce sont ces exigences qui ont nécessité le développement d'équipements spéciaux.
Transmission des ordres.
La méthode de transmission des ordres est la même que celle
utilisée pour le télégraphe, à une exception
près. Lorsque le répartiteur transmet un ordre de train
par téléphone, il écrit l'ordre au fur et à
mesure qu'il le prononce dans son émetteur. De cette façon,
la vitesse à laquelle l'ordre est donné est réglée
de manière à ce que tous ceux qui le reçoivent puissent
facilement le noter, et le répartiteur conserve une copie de l'ordre
transmis. Tous les chiffres et les noms propres sont épelés.
Ensuite, après qu'un ordre a été donné, il
est répété au répartiteur par chaque personne
qui le reçoit, et il souligne chaque que le message est transmis
au fur et à mesure qu'il arrive. Cette procédure est maintenant
si rapide qu'un homme peut répéter une commande plus vite
que le répartiteur ne peut la souligner. Le doute quant à
la précision avec laquelle il est possible de transmettre des informations
par téléphone a été dissipé grâce
à cette méthode de procédure, et la sécurité
de la transmission par téléphone a été pleinement
établie.
Appareils.
Les appareils utilisés dans les stations peuvent être divisés
en deux groupes : les sélecteurs et les téléphones.
Le sélecteur est un dispositif électromécanique qui
permet de faire sonner une cloche dans une station lorsque le répartiteur
actionne une touche correspondant à cette station. Au début,
comme dans la télégraphie, les aimants du sélecteur
étaient connectés en série sur la ligne, mais aujourd'hui
tous les systèmes relient les sélecteurs au circuit téléphonique
de la même manière et pour les mêmes raisons que pour
les lignes partagées. Il existe actuellement trois types de sélecteurs
en usage général, et le kilométrage parcouru au moyen
de ceux-ci est probablement bien supérieur à 95 pour cent
du kilométrage total ainsi parcouru dans le pays.

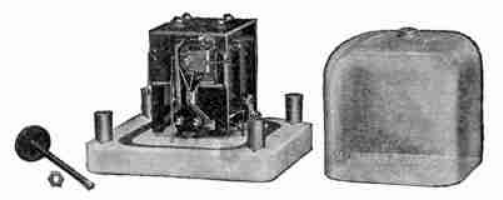 Sélecteur
Western Electric
Sélecteur
Western Electric
Le sélecteur Western Electric.
Ce sélecteur est le plus récent et peut-être le plus
simple. Les deux figures le montrent avec et sans son couvercle anti-poussière
en verre . Ce sélecteur est adapté pour fonctionner à
grande vitesse, les stations étant appelées à raison
de dix par seconde.
Le mécanisme de commande, qui est monté à l'avant
du sélecteur de manière à être facilement accessible,
fonctionne selon le principe de l'énergie centrale : la batterie
pour son fonctionnement, ainsi que pour le fonctionnement de la cloche
utilisée en relation avec celui-ci, sont toutes deux situées
au bureau du répartiteur. La batterie de la cloche peut cependant
être placée au poste de secours si cela est souhaité.
Le sélecteur est constitué de deux électroaimants
reliés en série au circuit téléphonique et
présentant une impédance très élevée.
Il est possible de placer autant de ces sélecteurs que l'on souhaite,
sur un circuit sans affecter sérieusement la transmission téléphonique.
Les impulsions de courant continu envoyées par le répartiteur
actionnent ces aimants, dont l'un est lent et l'autre rapide. La première
impulsion envoyée est une impulsion longue et tire vers le haut
les deux armatures, ce qui provoque l'engagement des cliquets situés
au-dessus et au-dessous de la petite roue à rochet, représentée
sur la figure, avec cette roue. Les impulsions restantes actionnent l'aimant
à action rapide et font avancer la roue autour du nombre approprié
de dents, mais n'affectent pas l'aimant à action lente qui reste
maintenu par eux. Le cliquet relié à l'aimant à action
lente sert simplement à empêcher la roue à rochet
de revenir en arrière. Fixé à la roue à rochet
est un contact dont la position du sélecteur peut être modifiée
par rapport au contact fixe situé à gauche du sélecteur
avec lequel il s'engage. Ce contact est réglé de telle sorte
que lorsque la roue a tourné du nombre de dents souhaité,
les deux contacts se ferment et la cloche sonne. N'importe quel sélecteur
peut ainsi être réglé pour n'importe quelle station,
et les sélecteurs sont donc interchangeables. Lorsque le courant
est coupé de la ligne au bureau du répartiteur, les armatures
retombent et tout est rétabli dans l'ordre normal. Un signal de
"réponse" est fourni avec ce sélecteur en fonction
du fonctionnement de la cloche. Lorsque le sélecteur d'une station
fonctionne, la cloche sonne normalement pendant quelques secondes. Le
répartiteur, cependant, peut maintenir cette sonnerie pendant la
durée souhaitée.
Les touches utilisées au bureau du répartiteur
pour actionner les sélecteurs sont représentées sur
cette figure gauche.

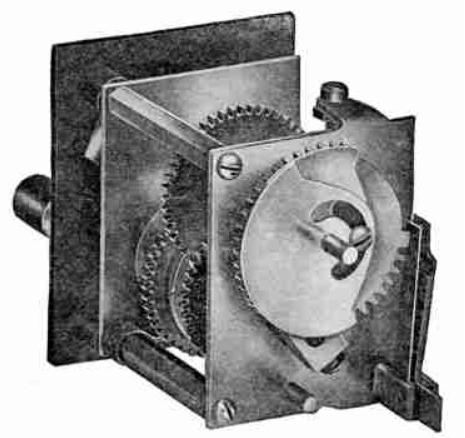
Clés du répartiteur et Mécanisme de clé du
répartiteur .
Il y a une touche pour chaque station intermédiaire de la ligne
et le répartiteur appelle n'importe quelle station en faisant simplement
tourner la touche correspondante d'un quart de tour vers la droite. La
figure droite montre le mécanisme de l'une de ces touches et les
moyens utilisés pour envoyer des impulsions de courant sur le circuit.
La touche est réglable et peut être disposée pour
n'importe quelle station souhaitée au moyen des cames mobiles représentées
à l'arrière de la figure, ces cames, lorsqu'elles occupent
différentes positions, servent à couvrir différents
nombres de dents de la roue d'impulsion qui actionnent les contacts d'impulsion.
Le sélecteur Gill.
Le deuxième type de sélecteur largement utilisé aujourd'hui
dans tout le pays est connu sous le nom de Gill, du nom de son inventeur.
Il est fabriqué pour les types à batterie locale et à
énergie centrale, ce dernier étant le dernier développement
de ce sélecteur. Avec le type à batterie locale, la cloche
de la station sonne jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée
par le répartiteur. Avec le type à énergie centrale,
elle sonne pendant une durée définie et peut être
maintenue plus longtemps comme c'est le cas avec le sélecteur Western
Electric.
Le sélecteur est actionné par des combinaisons d'impulsions
de courant continu qui sont envoyées sur la ligne par des touches
dans le bureau du répartiteur .
Le répartiteur dispose d'une armoire à clés et appelle
de la même manière que celle décrite précédemment,
mais ces clés, au lieu d'envoyer une série d'impulsions
rapides, envoient une succession d'impulsions dont les intervalles correspondent
à la disposition particulière des dents de la roue de sélection
de la station correspondante. Chaque clé appartient donc définitivement
à un certain sélecteur et ne peut être utilisée
en liaison avec aucun autre. Un exemple concret peut rendre cela plus
clair.
Le répartiteur peut actionner la touche n° 1421. Cette touche
met en marche un mécanisme d'horlogerie qui imprime à intervalles
réguliers, sur la ligne téléphonique, des impulsions
de courant continu, avec des intervalles comme suit : 1-4-2-1. Il y a
sur la ligne un sélecteur correspondant à cette combinaison
et seul, de tous les sélecteurs du circuit, fera tourner sa roue
de manière à établir le contact et à faire
sonner la sonnette. Dans tous les autres, les cliquets auront glissé
à un moment donné de la révolution et les roues seront
revenues à leur position normale.
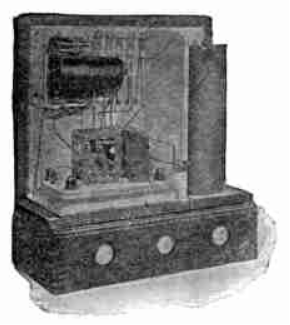 Sélecteur
de branchies
Sélecteur
de branchies
Le sélecteur Gill est représenté sur la figure ci dessus. Il contient un relais à double bobinage qui est ponté sur le circuit téléphonique et qui actionne le sélecteur. Ce relais a une résistance de 4 500 ohms et une impédance élevée, et actionne le mécanisme du sélecteur qui est une modification spéciale du principe du cliquet et du cliquet. Les caractéristiques essentielles de ce sélecteur se trouvent la roue de sélection « step-up » et une roue de temps, normalement maintenue au bas d'une piste inclinée.
L'aimant sélecteur actionne la roue du temps vers
le haut de la piste et lui permet de descendre. Si l'aimant est actionné
rapidement, la roue ne descend pas complètement avant d'être
repoussée. Une petite goupille sur le côté du cliquet,
qui engage normalement la roue du sélecteur, s'oppose aux dents
de la roue du sélecteur près de leurs points extérieurs.
Cependant, lorsque la roue du temps roule vers le bas de la piste, le
cliquet peut tomber au bas de la dent. Certaines dents de la roue du sélecteur
sont formées de manière à s'engager efficacement
avec le cliquet uniquement lorsque ce dernier est en position normale,
tandis que d'autres ne s'engageront que lorsque le cliquet est en position
basse ; ainsi, d'innombrables combinaisons peuvent être réalisées
qui répondront à certaines combinaisons d'impulsions rapides
avec des intervalles entre elles. La combinaison correcte d'impulsions
et d'intervalles fait avancer la roue du sélecteur de manière
à établir un contact. Les roues du sélecteur à
toutes les autres stations ne parviennent pas à atteindre leur
position de contact car à un ou plusieurs points de leur révolution,
les cliquets ont glissé, permettant aux roues du sélecteur
de revenir "à la maison".
La « réponse » est assurée dans ce sélecteur
au moyen de quelques spires inductives du circuit de sonnerie qui sont
enroulées sur le relais sélecteur. Le fonctionnement de
la sonnerie à travers ces spires induit un courant alternatif dans
l'enroulement du sélecteur qui circule sur la ligne et est entendu
comme un bruit de bourdonnement distinctif par le répartiteur.
Le sélecteur Cummings-Wray.
Les deux sélecteurs déjà décrits sont d'un
type connu sous le nom de sélecteurs d'appels individuels , ce
qui signifie qu'une seule station à la fois peut être appelée.
Si plusieurs appels sont souhaités, le répartiteur appelle
une station après l'autre. Le troisième type de sélecteur
utilisé aujourd'hui est celui connu sous le nom d' appel multiple
, dans lequel le répartiteur peut appeler simultanément
autant de stations qu'il le souhaite.
Le sélecteur Cummings-Wray et celui de la Kellogg Switchboard and
Supply Company sont de ce type et fonctionnent sur le principe des horloges
synchrones. Lorsque le répartiteur souhaite faire passer un appel,
il lance les touches de toutes les stations qu'il désire, puis
actionne une touche de démarrage. Les cloches de toutes ces stations
sont sonnées par une seule opération.
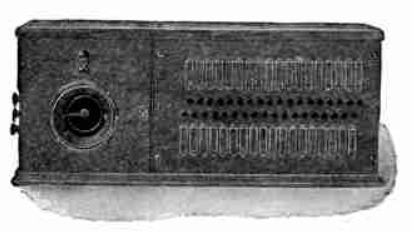 Cummings-Wray
Cummings-Wray 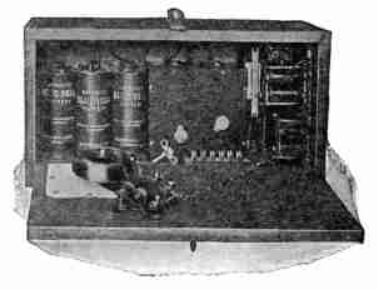
L'équipement d'envoi du répartiteur du système Cummings-Wray
est représenté sur la figure gauche ci dessus et le sélecteur
de station sur la figure droite . Avec ce système, il est nécessaire
que les horloges de toutes les stations soient remontées tous les
huit jours.
Dans le poste central du répartiteur, le mécanisme d'horlogerie
actionne un bras de contact qui apparaît sur la face du poste dans
la figure 480. Il y a un contact pour chaque station de la ligne. L'horloge
de ce bureau et les horloges de tous les bureaux de relais démarrent
en même temps, et c'est par ce moyen que les stations sont signalées,
comme nous le décrirons plus loin, lorsque nous aborderons le fonctionnement
détaillé des circuits.
Equipement téléphonique.
L'appareil téléphonique n'est pas moins important que les
dispositifs sélectifs. Celui qui est illustré ici est le
produit de la Western Electric Company, à qui nous sommes redevables
de toutes les illustrations de ce chapitre.
Transmetteur du répartiteur.
Le répartiteur utilise dans la plupart des cas un transmetteur
de poitrine semblable à celui utilisé par les opérateurs
de standard dans le service quotidien. Il est connecté en permanence
au circuit téléphonique, et pour cette raison, un équipement
facile à porter est essentiel pour lui. Dans les endroits très
bruyants, il est équipé d'un double transmetteur de poitrine.
Le répartiteur étant connecté en permanence à
la ligne et devant parler une grande partie du temps, la batterie de l'émetteur
est fortement sollicitée. C'est pour cette raison que l'on utilise
généralement des batteries de stockage.
 Téléphone
de bureau Waystation
Téléphone
de bureau Waystation
Téléphones de gare.
Dans les gares, on peut utiliser différents types d'équipements
téléphoniques. Le plus courant est peut-être le support
de bureau bien connu illustré à la figure ci dessus, qui,
pour le service ferroviaire, est équipé d'un levier de commutation
spécial à utiliser avec un récepteur principal.
Souvent, on utilise des supports téléphoniques à
bras pivotants bien connus, en liaison avec des récepteurs de tête,
mais certains types spéciaux développés spécialement
pour l'utilisation ferroviaire sont avantageux, car dans de nombreux cas,
l'opérateur qui traite les ordres de train se trouve dans une tour
où il doit également s'occuper des signaux d'enclenchement,
et pour ce service, il est nécessaire qu'il puisse s'éloigner
du téléphone et y revenir rapidement. Le bras téléphonique
Western Electric développé pour cet usage .
Dans ce cas, l'émetteur et le récepteur sont disposés
de manière à épouser approximativement la forme de
la tête de l'opérateur. Lorsque le bras est rejeté
en arrière, il ouvre le circuit de l'émetteur au moyen d'un
commutateur situé à sa base.
Téléphones de voie de garage.
Deux types d'appareils sont utilisés pour les voies de garage.
Le premier est un appareil mural magnéto ordinaire, qui comprend
les appareils et les circuits spéciaux utilisés dans les
appareils de voie de garage standard. Ces appareils ne sont utilisés
que lorsqu'il est possible de les placer à l'intérieur ou
dans des cabines le long de la ligne. Ces appareils sont connectés
en permanence au fil du train et, comme il y a peu de chances que plusieurs
d'entre eux soient utilisés à la fois, ils sont sonnés
par le répartiteur, au moyen d'un générateur manuel
ordinaire, lorsqu'il lui faut signaler une commutation.
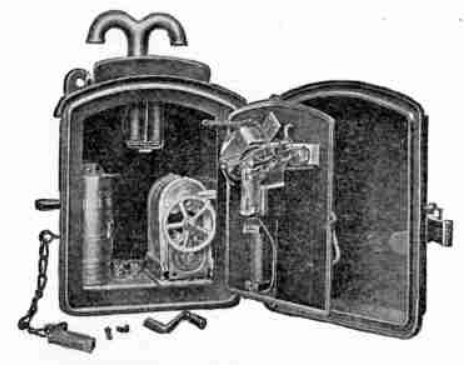

Téléphone résistant aux intempéries.
Dans certains cas, il n'est pas possible d'installer ces postes téléphoniques
de parement à l'intérieur, et pour répondre à
ces conditions, un poste en fer résistant aux intempéries
est utilisé. L'appareil de ce poste est traité avec un composé
anti-humidité, et le boîtier lui-même est imperméable
aux conditions météorologiques.
Coffrets de train portables. Des téléphones
portables sont régulièrement transportés dans les
trains de démolition et leur utilisation devient de plus en plus
courante. L'utilisation de ces appareils est plus générale
sur les trains de marchandises et de voyageurs.


La figure gauche montre un de ces appareils équipé d'un
générateur à cinq barres pour appeler le répartiteur.
L'autre figure montre un petit appareil sans générateur
destiné aux conducteurs et aux inspecteurs sur les lignes où
le répartiteur est en permanence connecté au circuit.
Ces ensembles sont connectés au circuit téléphonique
en tout point de la ligne au moyen d'un poteau portatif léger disposé
avec des bornes à son extrémité extérieure
pour le raccordement sur les fils de ligne, et avec des câbles flexibles.
aLes câbles conducteurs qui mènent au poste portatif. L'utilisation
de ces postes par les fonctionnaires dans leurs voitures particulières,
par les équipes de construction et de ponts travaillant sur la
ligne, et par les inspecteurs et les réparateurs de téléphone
pour signaler les problèmes, devient de plus en plus générale.
Circuits Western Electric.
Comme nous l'avons déjà dit, un circuit de répartition
de trains téléphoniques peut avoir une longueur de 25 à
300 miles, et il peut y avoir autant de stations que peut en gérer
un seul répartiteur. Le plus grand nombre connu de stations sur
un circuit existant de ce type est de 65.
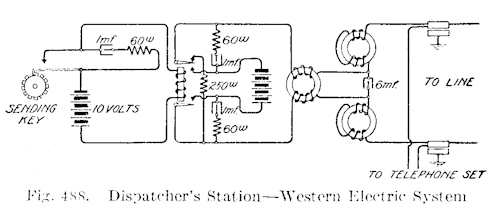
Circuit du répartiteur.
Les circuits du poste du répartiteur dans le système Western
Electric sont représentés sur la figure ci dessu, dont le
fonctionnement est brièvement le suivant : lorsque le répartiteur
souhaite appeler un poste particulier, il fait tourner la touche correspondant
à ce poste d'un quart de tour. Cela envoie une série d'impulsions
rapides de courant continu sur la ligne téléphonique à
travers le contact d'un relais télégraphique spécial
qui est actionné par la touche dans un circuit local. Le relais
télégraphique est équipé de condensateurs
anti-étincelles autour de ses contacts et est de construction robuste
dans son ensemble afin de transporter correctement le courant d'envoi.
La tension de la batterie émettrice dépend de la longueur
de la ligne et du nombre de stations qui la composent. Elle varie de 100
à 300 volts dans la plupart des cas. Lorsque des tensions plus
élevées sont nécessaires pour faire fonctionner le
circuit avec succès, il est généralement d'usage
d'installer un circuit répéteur télégraphique
au centre de la ligne, afin de maintenir la tension dans des limites sûres.
L'une des raisons pour lesquelles on limite la tension utilisée
est que les condensateurs utilisés dans le circuit ne supportent
pas des potentiels beaucoup plus élevés sans risquer de
griller. Il est également possible de réduire de moitié
la tension en plaçant le répartiteur au centre de la ligne,
d'où il peut envoyer des signaux dans deux directions au lieu d'une
seule extrémité.
Conversation et signalisation simultanées. Des bobines et condensateurs
de retardement seront visibles en série avec le circuit à
travers lequel le courant de signalisation doit passer avant de sortir
sur la ligne. Ils ont pour but d'absorber le bruit causé par la
batterie haute tension, permettant ainsi au répartiteur de parler
et de signaler simultanément. La résistance de 250 ohms
connectée au circuit par l'intermédiaire d'un contact arrière
du relais télégraphique absorbe la décharge du condensateur
de 6 microfarads.
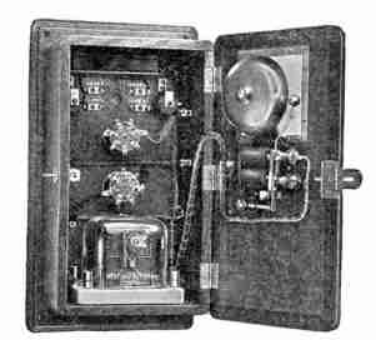 Sélecteurs
Western Electric
Sélecteurs
Western Electric 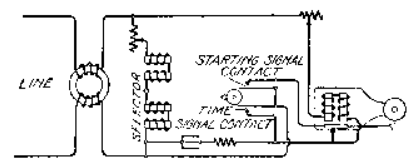
Circuit de relais.
L'ensemble complet de sélecteurs pour les relais est représenté
sur la figure ci dessus et le schéma de câblage de son appareil
sur la figure suivante.
La première impulsion envoyée par la clé dans le
bureau du répartiteur est une longue impulsion de courant continu,
la première dent étant trois ou quatre fois plus large que
les autres dents. Cette impulsion actionne les deux aimants du sélecteur
et attire leurs armatures, qui, à leur tour, font s'engager deux
cliquets dans la roue à rochet, tandis que les impulsions rapides
restantes actionnent le cliquet "d'augmentation" et font tourner
la roue du nombre de dents requis. Des bobines de retardement sont placées
en série avec le sélecteur afin d'étouffer les décharges
de foudre qui pourraient arriver sur la ligne. Le contact du sélecteur,
lorsqu'il est actionné, ferme un circuit de sonnerie, et on notera
que le sélecteur et la sonnerie sont actionnés par le courant
de batterie arrivant sur la ligne principale à travers des résistances
variables. Il existe bien sûr un certain nombre de sélecteurs
pontés sur le circuit, et la résistance variable à
chaque station est ajustée de manière à donner à
chaque station[Page 349]environ 10 milliampères, ce qui permet
un facteur de sécurité important pour les fuites de ligne
par temps humide. La chute de tension à travers les bobines à
10 milliampères est de 38 volts. Si ces bobines n'étaient
pas utilisées, il est clair que les sélecteurs les plus
proches du répartiteur recevraient la majeure partie du courant
et ceux les plus éloignés très peu.
Un contact de signal horaire est également indiqué sur le
schéma du circuit sélecteur de la figure droite. Il est
commun à tous les bureaux et peut être actionné par
une clé spéciale dans le bureau du répartiteur, lui
permettant ainsi d'envoyer des signaux horaires sur le circuit téléphonique.
Circuits Gill.
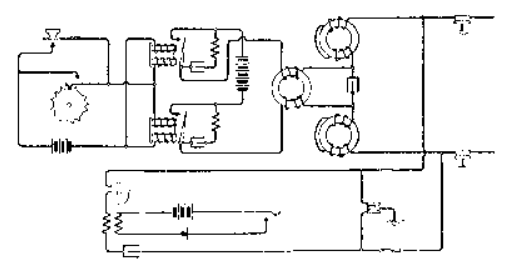
La figure montre le schéma de circuit du répartiteur du
système Gill. Il est semblable à celui du système
Western Electric qui vient d'être décrit. Le mode de fonctionnement
est également similaire, le principal point de différence
étant le moyen mécanique de sélection. La figure
492 montre le câblage du sélecteur Gill dans une station
intermédiaire pour le service de batterie locale. Le contact du
sélecteur ferme le circuit de sonnerie dans la station et quelques
enroulements de ce circuit sont situés sur les aimants du sélecteur,
comme indiqué. Ceux-ci fournissent la « réponse »
par des moyens inductifs.
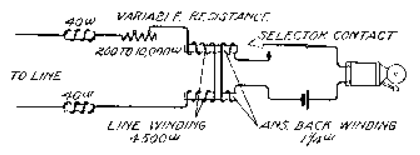
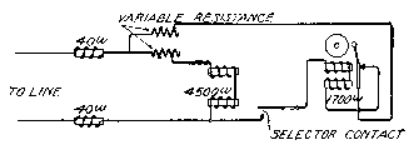
Câblage du sélecteur pour Batterie locale et pour Énergie
centrale.
Les touches d'envoi de ces deux types de circuits diffèrent en
ce que, dans le cas du sélecteur à batterie locale, le contact
de la touche est ouvert après l'actionnement du sélecteur
et la sonnerie doit être interrompue par le répartiteur en
appuyant sur un bouton ou en appelant une autre station. L'une ou l'autre
de ces opérations envoie une nouvelle impulsion de courant qui
libère le sélecteur et ouvre son circuit.
Avec le sélecteur d'énergie centrale, les contacts de la
touche d'envoi au bureau du répartiteur restent fermés après
l'opération pendant une durée définie. Cela est évidemment
nécessaire pour que la batterie puisse rester sur la ligne pour
le fonctionnement de la sonnerie. Dans ce cas, les contacts restent fermés
pendant une certaine partie du tour de la touche, et la sonnerie cesse
de sonner lorsque cette partie du tour est terminée. Si, cependant,
le répartiteur désire donner une sonnerie plus longue à
une station, il peut le faire en maintenant les contacts de la touche
fermés au moyen d'une touche auxiliaire dès qu'il entend
le signal de "réponse" de la station appelée.
Circuits Cummings-Wray.
Le système Cummings-Wray, comme indiqué précédemment,
est du type à appels multiples, fonctionnant avec des horloges
synchrones. Au lieu d'actionner une touche après l'autre dans l'ordre
pour appeler plusieurs stations, on actionne toutes les touches à
la fois et une touche de mise en marche met en marche le mécanisme
qui appelle toutes ces stations d'un seul coup.
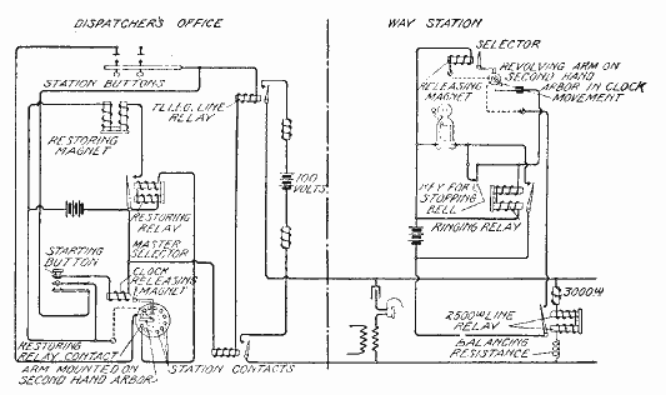 .
.
Pour faire sonner une ou plusieurs stations, le répartiteur appuie
sur la ou les touches correspondantes puis actionne la clé de démarrage.
Cette clé de démarrage maintient son contact pendant une
durée appréciable pour permettre au mécanisme de
l'horloge de se mettre en marche et de se libérer de l'embrayage
à aimant de déclenchement. La fermeture de la clé
de démarrage actionne l'aimant de déclenchement de l'horloge
et actionne également les deux relais de ligne télégraphique.
Ceux-ci envoient une impulsion de batterie sur la ligne actionnant les
relais de ligne pontés de 2 500 ohms et, à leur tour, les
aimants de déclenchement du sélecteur ; ainsi, toutes les
horloges de stations démarrent à l'unisson avec l'horloge
maîtresse. L'arbre de la seconde aiguille de chaque horloge porte
un bras qui, à chaque station, est réglé à
un angle différent par rapport à la position normale de
celui de toute autre station. Chacun de ces bras entre en contact précisément
au moment où le bras de l'horloge maîtresse passe sur le
contact correspondant à cette station.
Si l'on appuie sur une touche de station donnée dans l'émetteur
principal, les relais de la ligne télégraphique fonctionneront
à nouveau lorsque le bras de l'horloge principale atteindra ce
point, envoyant une autre impulsion de batterie sur la ligne. Le contact
sélecteur de la station intermédiaire est fermé à
ce moment-là. Ainsi, la fermeture du contact du relais actionne
le relais de sonnerie par l'intermédiaire d'un circuit local, comme
illustré. Le relais de sonnerie est immédiatement verrouillé
par son propre contact, ce qui maintient le circuit de sonnerie fermé
jusqu'à ce qu'il soit ouvert par la clé et que la sonnerie
soit arrêtée.
Lorsque le bras de l'horloge maîtresse passe le dernier point du
cadran de contact, le courant circule dans le relais de rappel qui actionne
l'aimant de rappel qui libère toutes les touches. Un bouton-poussoir
est prévu au moyen duquel les touches peuvent être libérées
manuellement, si on le souhaite. Il est utilisé au cas où
le répartiteur appuie sur une touche par erreur. Des bobines de
retardement et des résistances variables sont prévues au
poste de relais, tout comme dans les autres systèmes de sélection
qui ont été décrits et pour les mêmes raisons.
Les circuits de l'équipement téléphonique
de l'opérateur, représentés sur la figure 495, sont
également pontés sur la ligne.
Cet appareil est à haute impédance et d'une conception spéciale
adaptée au service ferroviaire. Il peut y avoir un nombre quelconque
de téléphones à l'écoute d'un train en même
temps, et souvent un répartiteur en appelle cinq ou six à
la fois pour donner des ordres.
Ces conditions ont nécessité l'agencement de circuit spécial
représenté sur cette figure :
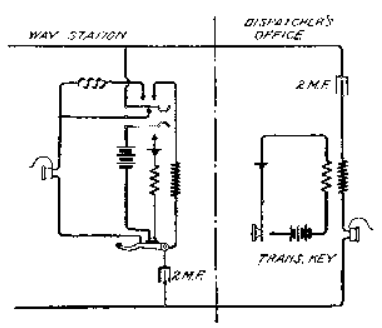 Circuits
téléphoniques
Circuits
téléphoniques
Les récepteurs utilisés dans les stations de cheminement
sont à haute impédance et sont normalement connectés,
par l'intermédiaire du commutateur à crochet, directement
sur la ligne en série avec un condensateur. Cependant, lorsque
l'opérateur, dans une station de cheminement, souhaite parler,
il appuie sur la touche indiquée. Cela met le récepteur
sur la ligne en série avec la bobine de retardement et en parallèle
avec le secondaire de la bobine d'induction. Cela ferme en même
temps le circuit de la batterie de l'émetteur par l'intermédiaire
du primaire de la bobine d'induction.
La bobine de retardement a pour but d'empêcher une tonalité
latérale excessive et augmente également l'impédance
du circuit récepteur, qui est un shunt sur la bobine d'induction.
Cette dernière bobine, cependant, est d'une conception spéciale
qui permet à juste assez de courant de circuler à travers
le récepteur pour permettre au répartiteur d'interrompre
un opérateur de station intermédiaire lorsqu'il parle.
La clé utilisée pour fermer la batterie de l'émetteur
est actionnée à la main et n'est pas verrouillable. Dans
certains cas, lorsque les opérateurs sont très occupés,
un interrupteur à pédale est utilisé à la
place de cette clé. L'utilisation d'une telle clé ou d'un
tel interrupteur dans la pratique s'est avérée parfaitement
satisfaisante et les opérateurs ne mettent que peu de temps à
s'y habituer.
Les circuits du bureau du répartiteur sont disposés de la même manière, et sont conçus spécialement pour faciliter leur fonctionnement. En d'autres termes, comme le répartiteur effectue la majeure partie du travail sur le circuit, son récepteur est de type à faible impédance, ce qui lui donne une transmission légèrement meilleure que celle des stations intermédiaires. La clé de son circuit émetteur est de type verrouillable, de sorte qu'il n'a pas besoin de la maintenir enfoncée pendant qu'il parle. C'est parce que le répartiteur fait la plupart des conversations sur ce circuit. Les répartiteurs utilisent également des interrupteurs à pédale dans certains cas.
Tableaux d'essai.
Il est devenu courant pour les chemins de fer d'installer plusieurs circuits
téléphoniques le long de leurs emprises. Dans de nombreux
cas, en plus du fil de train, un circuit de messages est également
installé et, assez fréquemment, un fil de bloc également
exploité par téléphone est installé en parallèle
des deux. Il est souhaitable que ces circuits puissent être utilisés
pour effectuer des essais simples et pour pouvoir également raccorder
un circuit à un autre en cas d'urgence.
 Carte d'essai
Carte d'essai
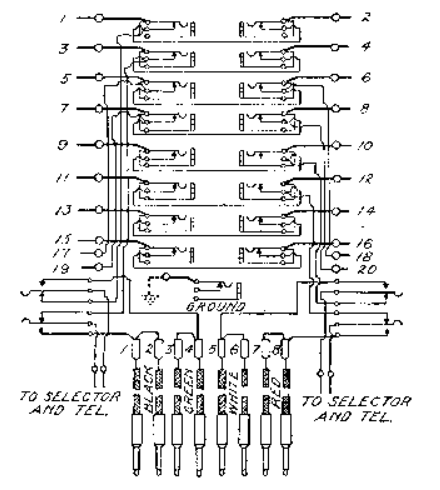 Circuits de
la carte de test
Circuits de
la carte de test
Des cartes de test ont été conçues pour faciliter
ce travail. Elles se composent de simples boîtiers à fiches
et à prises, dont l'aspect général est illustré
à la figure ci dessus. Le schéma de circuit de l'une d'entre
elles est illustré à la figure droite. Chaque fil entre
dans une prise individuelle, comme on le remarquera sur un côté
de la carte, et passe par le contact intérieur de cette prise,
pour ressortir par une prise similaire sur le côté opposé.
Le sélecteur et le téléphone d'un bureau sont retirés
de ces contacts intérieurs par l'intermédiaire d'une clé,
comme indiqué. Les contacts extérieurs de cette clé
sont câblés sur deux paires de cordons. Supposons maintenant
que le fil du train de communication arrive sur les prises 1 et 3 et le
fil de message sur les prises 9 et 11. En cas d'accident du fil de train
entre deux stations, il est souhaitable de raccorder cette connexion avec
un fil de message afin de maintenir en fonctionnement le fil de train
si important. Le répartiteur demande à l'opérateur
de la dernière station qu'il peut obtenir d'insérer les
fiches 1 et 2 dans les prises 1 et 10 et les fiches 3 et 4 dans les prises
3 et 12 , en même temps qu'il lance la clé de gauche. Puis,
obtenant un opérateur au-delà de la coupure par n'importe
quel moyen disponible, il lui demande également d'insérer
les fiches 1 et 2 dans les prises 9 et 2 et les fiches 3 et 4 dans les
prises 11 et 4 , en même temps qu'il lance la clé de gauche.
En suivant ce tracé, on observera que le fil du train est raccordé
sur la section désactivée au moyen du circuit de messages,
et que le sélecteur et l'équipement téléphonique
sont coupés sur les connexions raccordées ; en d'autres
termes, pontés sur les cordons de raccordement.
On verra également qu'avec cette carte, il est possible d'ouvrir
n'importe quel circuit simplement en le branchant sur une prise. Deux
fils peuvent être court-circuités ou une boucle peut être
réalisée en branchant deux cordons de même tension.Les
couleurs sont connectées aux deux prises. Une prise de terre est
prévue pour la mise à la terre de n'importe quel fil. De
cette façon, on obtient un agencement de circuits très flexible
et il est possible d'effectuer n'importe lequel des tests simples qui
sont les seuls qui sont habituellement nécessaires sur ce type
de circuit.
Blocage des lignes. Comme nous venons de
le mentionner, il arrive assez fréquemment qu'en plus des lignes
de train et des circuits de messages, les lignes de blocage soient également
exploitées par téléphone. Dans certains cas, des
appareils téléphoniques distincts sont utilisés pour
le service de blocage, mais dans d'autres cas, le même opérateur
gère les trois circuits via le même téléphone.
Le fil de blocage est généralement un fil télégraphique
transformé entre les stations, généralement en fer
et généralement relié à la terre. Sa longueur
dépasse rarement six milles.
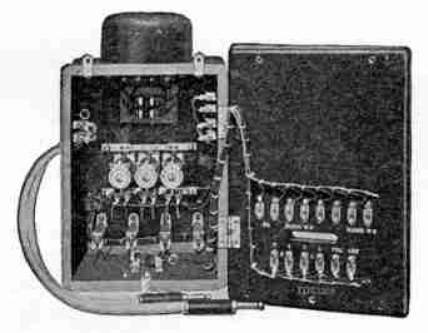 Ensemble
de blocage
Ensemble
de blocage 
Lorsque les fils de blocage sont utilisés comme des unités
individuelles avec leurs propres instruments, il n'est pas nécessaire
d'avoir un appareil auxiliaire à utiliser en relation avec eux.
Cependant, lorsqu'ils sont utilisés comme partie d'un système
et que le même téléphone est utilisé sur ceux-ci
que sur le fil de train et le fil de message, un appareil supplémentaire,
appelé ensemble de blocage, est nécessaire. Cet ensemble
de blocage, a été développé spécialement
pour ce service par la Western Electric Company. Comme on le remarquera,
une bobine répétitive au sommet et une touche à l'avant
de l'ensemble sont câblées en connexion avec une paire de
cordons de fil de train. Cette bobine répétitive est destinée
à être utilisée pour connecter un circuit mis à
la terre à un circuit métallique, comme par exemple pour
connecter un fil de blocage au fil de train, et est, bien entendu,[Page
356]Bien entendu, dans le but d'éliminer le bruit. Sous la touche
se trouvent trois prises combinées et des signaux. Un fil de bloc
arrive dans chacune d'elles et une ligne privée peut être
amenée dans celle du milieu. Lorsque le bloc suivant sonne, un
signal visuel s'affiche qui actionne une sonnerie dans le bureau au moyen
d'un circuit local. L'opératrice répond en branchant le
cordon téléphonique qui part du bas de l'appareil dans la
prise appropriée. Cela rétablit automatiquement le signal
et arrête la sonnerie.
Sous ces signaux apparaissent quatre prises. L'une est reliée au
fil du train, l'autre au fil des messages et les deux autres sont reliées
aux deux paires de cordons de raccordement de chaque côté
du poste. L'opérateur répond à un appel sur n'importe
quel circuit en branchant son cordon téléphonique dans la
prise appropriée.
Si une station de cheminement n'est pas ouverte le soir,
ou si l'opérateur la quitte pour une raison quelconque et la ferme
à clé, il peut relier deux blocs ensemble au moyen de câbles
de raccordement. Ceux-ci sont disposés simplement pour relier deux
circuits mis à la terre et servent à relier deux blocs adjacents,
éliminant ainsi une station. Une prise est câblée
sur ces câbles, de sorte que l'opérateur de la station de
cheminement peut écouter la connexion s'il le souhaite.
Dans certains cas, non seulement les circuits téléphoniques
sont amenés dans le tableau de test, mais deux fils télégraphiques
sont également bouclés à travers ce tableau avant
d'arriver au tableau de distribution. Cette pratique devient assez fréquente
et, en cas d'urgence, elle permet de réparer les fils télégraphiques
ainsi que les fils téléphoniques.
La répartition sur les chemins de fer électriques.
Les chemins de fer électriques interurbains s'étendant de
plus en plus et leur trafic devenant plus lourd, ils se rapprochent de
plus en plus des méthodes d'exploitation à vapeur. Il n'est
pas rare qu'un chemin de fer électrique répartisse ses wagons
exactement comme dans le cas d'une route à vapeur. Il existe cependant
une tendance de cette classe de travail, vers des méthodes légèrement
différentes, et celles-ci seront brièvement décrites.
Sur les lignes de chemin de fer électriques où le trafic n'est pas particulièrement intense, on utilise souvent une ligne téléphonique magnéto ordinaire avec des instruments magnéto standards. Dans certains cas, les postes téléphoniques sont placés dans des salles d'attente ou des cabines le long de la voie. Dans d'autres cas, il n'est pas possible d'installer le téléphone à l'intérieur et des postes en fer résistant aux intempéries, tels que ceux représentés sur les figures 484 et 485, sont alors montés directement sur les poteaux le long de la voie ferrée. Avec une ligne de ce type, il existe généralement un point central d'où les ordres sont donnés et les agents de train appellent ce numéro lorsqu'ils arrivent sur les voies de garage ou partout où ils peuvent avoir besoin de le faire.
Une autre méthode d'installation d'un système téléphonique sur les chemins de fer électriques est la suivante : au lieu d'installer des instruments dans des cabines ou sur des poteaux le long de la ligne, des postes téléphoniques portables sont transportés dans les wagons et des prises sont placées à intervalles réguliers le long de l'emprise sur les poteaux. L'équipage du wagon qui souhaite entrer en contact avec le bureau central ou le répartiteur se branche sur l'une de ces prises et utilise le poste téléphonique portable. Dans les gares intérieures, dans les bureaux ou les bâtiments appartenant au chemin de fer, les postes magnéto classiques peuvent être utilisés, comme dans le premier cas décrit.
Sur les réseaux ferroviaires électriques où le trafic est intense, les mouvements des trains ou des wagons peuvent être gérés par un répartiteur, tout comme sur le chemin de fer à vapeur. Il y a cependant généralement une différence. Sur une ligne à vapeur, les opérateurs qui donnent leurs ordres aux équipes de train et manipulent les signaux sémaphoriques sont situés à intervalles réguliers dans les différentes stations. On ne trouve généralement pas de tels opérateurs sur les chemins de fer électriques, sauf peut-être à des points très importants, et il est donc nécessaire que le répartiteur puisse signaler les wagons à n'importe quel point et entrer en communication avec les équipes de ces wagons. Il le fait au moyen de sémaphores actionnés par des sélecteurs téléphoniques sur la ligne téléphonique. Le circuit téléphonique peut être équipé de n'importe quel nombre de sélecteurs souhaités, et le répartiteur peut en actionner un en particulier sans en actionner aucun autre sur le circuit. Chaque sélecteur, lorsqu'il est actionné, ferme une paire de contacts. Cela complète un circuit local qui met le bras du sémaphore en position « danger », en même temps que le répartiteur émet un bourdonnement distinctif dans son oreille, l'informant que le bras a effectivement été actionné. il est déplacé vers cette position. Il ne peut obtenir ce signal que par l'actionnement du bras.
Chaque sémaphore est situé à côté d'une cabine téléphonique dans laquelle est également placé le levier de rétablissement, au moyen duquel le sémaphore est mis en position « libre » par l'équipage de la voiture qui a été signalée. Le poste téléphonique mural est généralement utilisé pour ce type de service, mais si on le souhaite, des supports de bureau ou l'un des différents bras émetteurs peuvent être utilisés.
Il est nécessaire que l'équipage du wagon
qui s'approche en premier d'un sémaphore réglé sur
« danger » sorte, communique avec le répartiteur et
rétablisse le signal en position « libre ». Le répartiteur
ne peut pas rétablir le signal. Le signal est réglé
uniquement pour que l'équipage du train puisse entrer en communication
téléphonique avec le répartiteur, et pour ce faire,
il est nécessaire qu'il entre dans la cabine dans tous les cas.
On retrouve plus en détails sur les document de la Western Electric
:
"Railway
Train Dispatching Telephone Systems".de 1924
"Railway
Train Dispatching Telephone Systems".de 1934