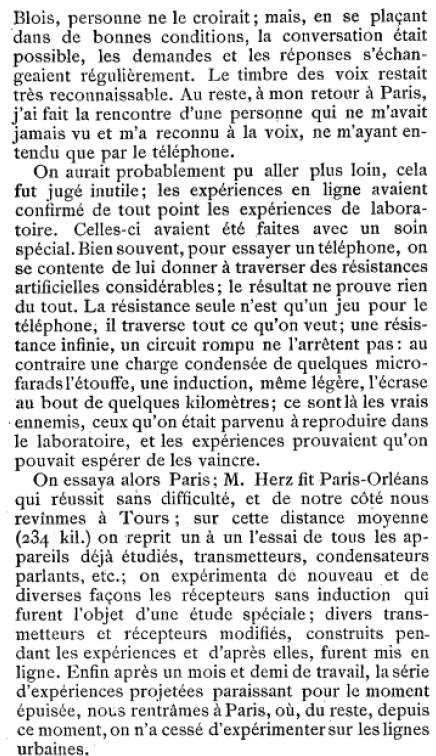|
Le cahier
chantant, le condensateur chantant
Nous ne pouvons pas parler que de téléphones
et microphones, sans mentionner le condensateur chantant, parce
que ce phénomène jette aussi un peu de lumière
sur les fonctions du téléphone.
M. Varley découvrit
en 1870 qu’un condensateur chargé et déchargé
rapidement émet un son. Ce fait provient de l’attraction
s’exerçant entre les armatures du condensateur chargé.
La hauteur du son obtenu est en rapport avec le nombre de charges
et de décharges par seconde.
L’appareil de Varley, était très encombrant, le
récepteur était un tambour d’un mètre de
diamètre.
En 1878 M. Warley imagina le condensateur chantant,
qui reçu une forme pratique par une combinaison très
simple que lui donnèrent MM. Pollard et Garnier.
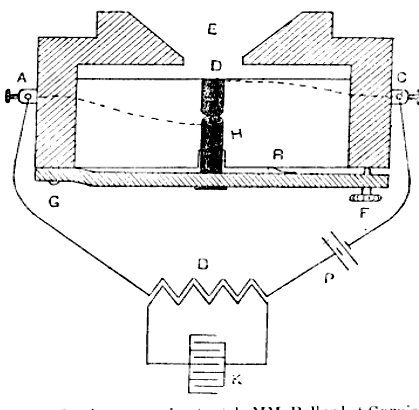
Le condensateur K est formé de 30 feuilles de papier superposées,
de 9 sur 13 centimètres , entre lesquelles sont interposées
28 feuilles d’étain de 6 sur 12 centimètres. Les
feuilles paires sont réunies ensemble à l’un des
bouts du cahier de papier et les feuilles impaires à l’autre
bout. Le tout
est relié avec une bande de papier et les feuilles d’étain
réunies aux deux garnitures de cuivre munies de bornes d’attache.
L’appareil transmetteur se compose d’une boîte cylindrique
portant une embouchure E. Sous rembouchure E se trouve une lame vibrante
en fer-blanc, au centre de laquelle est soudé un morceau cylindrique
de charbon D. Contre ce charbon appuie un autre cylindre de la même
matière, qui est porté par une traverse en bois GF articulée
en G et fixée de l’autre côté au moyen d’une
vis de réglage F. Un ressort arqué R, placé en
travers de cette pièce, lui donne une certaine élasticité.
La lame de fer est mise en rapport avec un des pôles d’une
pile P, de 6 éléments Leclanché, et le charbon
inférieur H correspond à l’hélice primaire
d’une bobine d’induction B reliée d’autre part
au second pôle de la pile.
Enfîn les deux bouts de l’hélice secondaire de la
bobine sont en relation avec les deux armatures du condensateur.
On règle les charbons de manière que les extrémités
en regard soient très près l’une de l’autre.
On arrive facilement à ce réglage par tâtonnement,
en émettant la même note dans l’embouchure, jusqu’à
ce que le condensateur résonne.
Si trois notes émises successivement sont bien reproduites,
l’appareil peut être considéré comme suffisamment
réglé. Pour le faire fonctionner, il suffit d’enfoncer
la bouche dans l’embouchure et de chanter. Il faut, pour obtenir
un bon résultat, que l’on entende la laine vibrer à
la manière des mirlitons. Au lieu de charbons, on peut employer
des contacts en platine.
Des perfectionnements nouveaux ont permis de transformer
le condensateur en un véritable téléphone , c'est
le condensateur parlant.
Différents observateurs, comme MM. Herz,
Dunant et Dolbear, ont constaté qu'un
condensateur d'une certaine construction spéciale, intercalé
à la place d'un téléphone récepteur dans
le circuit secondaire d'une bobine d'induction, pouvait reproduire
les sons musicaux chantés dans un téléphone ou
microphone intercalé dans le circuit primaire de la même
bobine.
M. Dolbear a même construit un téléphone
basé sur le principe de deux plaques juxtaposées dont
l'une, par les charges et décharges de l'autre, fait des mouvements
vibratoires.
C'est probablement M. W. Holtz qui le premier a observé
un phénomène qui est le précurseur du condensateur
chantant, et M. Giltay a étudié
les observations de ses prédécesseurs et les a complétées
par ses propres investigations.
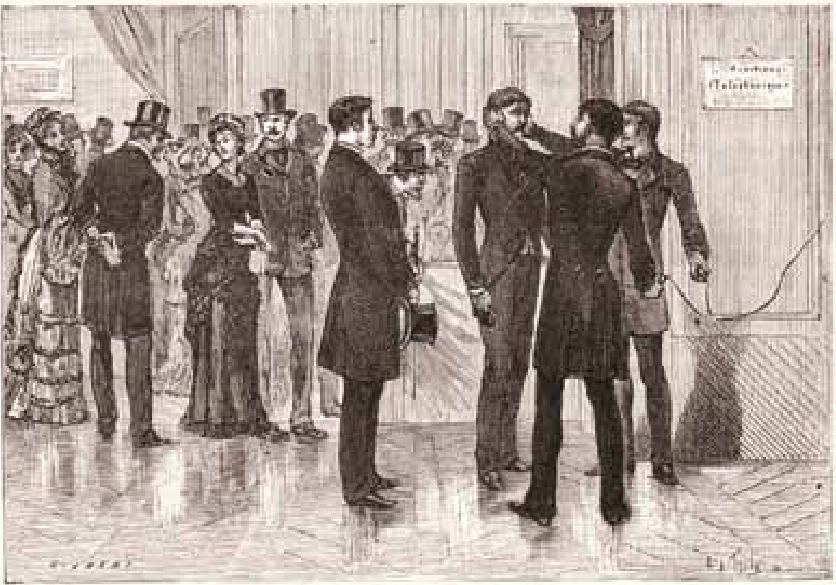 La
nature de 1884 La
nature de 1884
sommaire
Dans le livre de premier ouvrage Français traitant du Téléphone
en 1878, (sur cette page)  , ou à
feuilleter. on peut lire :
, ou à
feuilleter. on peut lire :
Téléphone de M. Varley.
— Ce téléphone n'est à proprement parler
qu'un téléphone musical dans le genre
de celui de M. Gray, mais dont le récepteur présente
une disposition originale vraiment intéressante.
Cette partie de l'appareil est essentiellement
constituée par un véritable tambour de grandes
dimensions (3 ou 4 pieds de diamètre), dans l'intérieur
duquel est placé un condensateur formé de quatre
feuilles de papier d'étain séparées par
des feuilles en matière parfaitement isolante, et dont
la surface représente à peu près la moitié
de celle du tambour. Les lames de ce condensateur sont disposées
parallèlement aux membranes du tambour et à une
très-petite distance de leur surface.
Si une charge électrique est communiquée
à l'une des séries de plaques conductrices de
ce condensateur, celles qui leur correspondront se trouveront
attirées, et si elles peuvent se mouvoir, elles pourront
communiquer aux couches d'air interposées un mouvement
qui, en se communiquant aux membranes du tambour, pourront,
pour une série de charges très-rapprochées
les unes des autres, faire vibrer ces membranes et engendrer
des sons; or ces sons seront en rapport avec le nombre des charges
et décharges qui seront produites. Comme ces charges
et décharges peuvent être déterminées
par la réunion des deux armatures du condensateur aux
extrémités du circuit secondaire d'une bobine
d'induction dont le circuit primaire sera interrompu convenablement,
on voit immédiatement que, pour faire émettre
par le tambour un son donné, il suffira de faire fonctionner
l'interrupteur de la bobine d'induction de manière à
produire le nombre de vibrations que comporte ce son.
Le moyen employé par M. Varley pour produire
ces interruptions est celui qui a été déjà
mis en usage dans plusieurs applications électriques
et notamment pour les chronographes; c'est un diapason électro-magnétique
réglé de manière à émettre
le son qu'il s'agit de transmettre. Ce diapason peut, en formant
lui-même interrupteur, réagir sur le courant primaire
de la bobine d'induction, et s'il y a autant de ces diapasons
que de notes musicales à transmettre, et que les électro-aimants
qui les animent soient reliés à un clavier de
piano, il sera possible de transmettre de cette manière
une mélodie à distance comme dans le système
de M. Elisha Gray.
La seule chose particulière dans ce système
est le fait de la reproduction des sons par l'action d'un
condensateur, et nous verrons plus loin que cette idée,
reprise par MM. Pollard et Garnier, a conduit
à des résultats vraiment intéressants.
...
Téléphones de MM. Pollard et
Garnier.
—Le téléphone à pile construit par
MM. Pollard et Garnier est différent de ceux qui précèdent,
en ce qu'il met simplement à contribution deux pointes
de mine de plomb portées par des porte-crayons métalliques,
et que ces pointes sont appliquées directement contre
la lame vibrante avec une pression qui doit être réglée.
La fig. 31 représente la disposition qu'ils ont adoptée,
et qui du reste peut être variée d'une infinité
de manières.
 Fig. 31.
Fig. 31.
LL est la lame vibrante en fer-blanc au-dessus de laquelle se
trouve l'embouchure E, et P, P' sont les deux pointes de graphite
munies de leur porte-crayons. Ces porte-crayons portent à
leur partie inférieure un pas de vis qui, étant
engagé dans un trou fileté pratiqué dans
une plaque métallique CC, permet de serrer plus ou moins
les crayons contre la lame LL. Cette plaque métallique
CC est composée de deux parties juxtaposées qui,
étant isolées l'une de l'autre, peuvent être
mises en rapport avec un commutateur cylindrique au moyen duquel
on peut disposer le circuit de diverses manières. Ce
commutateur étant pourvu de cinq lames, permet de passer
presque instantanément d'une combinaison à l'autre,
et ces combinaisons sont les suivantes:
1o Le courant entre par le crayon P, passe dans la plaque et
de là dans la ligne.
2o Le courant arrive par le crayon P', passe dans la plaque
et de là dans la ligne;
3o Le courant arrive à la fois par les crayons P et P',
se rend dans la plaque et de là à la ligne;
4o Le courant arrive par le crayon P, va de là à
la plaque, puis dans le crayon P', et de là à
la ligne.
On a donc de cette manière deux éléments
de combinaison que l'on peut utiliser séparément
ou en les associant en tension ou en quantité.
Lorsque les crayons sont bien réglés et donnent
une transmission bien régulière et de même
intensité, on peut étudier facilement les effets
produits quand on passe de l'une des combinaisons à l'autre,
et l'on constate:
1o que pour un circuit court, il n'y a pas de changement appréciable,
quelle que soit la combinaison employée;
2o que quand le circuit est long ou présente une grande
résistance, c'est la combinaison en tension qui a l'avantage,
et cela d'autant plus que la ligne est plus longue.
Ce système téléphonique, comme du reste
les deux précédents, met à contribution
une machine d'induction pour transformer les courants voltaïques
en courants induits; nous parlerons plus tard de cet accessoire
important de ces sortes d'appareils.
Quant au téléphone récepteur, la disposition
adoptée par MM. Pollard et Garnier est à peu près
celle de Bell.
Seulement ils emploient des lames de fer-blanc et des hélices
beaucoup plus résistantes. Cette résistance est,
en effet, de cent cinquante à deux cents kilomètres.
Nous avons toujours reconnu, disent ces messieurs, que quelle
que soit la résistance du circuit extérieur, on
a avantage à augmenter le nombre des tours de spires,
même en faisant usage du fil no 42, qui est celui que
nous avons employé de préférence.
...
|
sommaire
Début 1877, Edison expérimenta un émetteur
à condensateur, ou statique.
 Ce type
de dispositif repose sur le stockage d'une charge entre deux conducteurs,
en l'occurrence des plaques métalliques isolées. La
charge varie en fonction de la distance entre les deux plaques. La
première version était complexe et peu sensible, mais
en décembre 1877, il reprit l'idée. Il installa un empilement
de plaques métalliques, séparées par des disques
isolants, derrière un diaphragme. La pression de la voix sur
le diaphragme faisait varier la distance entre les plaques, donnant
ainsi une tension variable. Ce système aurait été
peu sensible, compte tenu du poids des plaques du condensateur. Cette
idée fut ensuite reprise par d'autres inventeurs, qui utilisèrent
une électrode arrière fixe et un ruban métallique
léger comme diaphragme, et produisirent un microphone à
condensateur utilisé en radiodiffusion et en enregistrement
sonore. Dans une variante, Edison remplaça
les plaques du condensateur par des plaques de cuivre et de platine.
Ces éléments constituaient une pile voltaïque (que
nous appellerions une batterie) et généraient leur propre
tension, qui variait selon la pression exercée sur les plaques
par le diaphragme. Ces idées furent finalement abandonnées. Ce type
de dispositif repose sur le stockage d'une charge entre deux conducteurs,
en l'occurrence des plaques métalliques isolées. La
charge varie en fonction de la distance entre les deux plaques. La
première version était complexe et peu sensible, mais
en décembre 1877, il reprit l'idée. Il installa un empilement
de plaques métalliques, séparées par des disques
isolants, derrière un diaphragme. La pression de la voix sur
le diaphragme faisait varier la distance entre les plaques, donnant
ainsi une tension variable. Ce système aurait été
peu sensible, compte tenu du poids des plaques du condensateur. Cette
idée fut ensuite reprise par d'autres inventeurs, qui utilisèrent
une électrode arrière fixe et un ruban métallique
léger comme diaphragme, et produisirent un microphone à
condensateur utilisé en radiodiffusion et en enregistrement
sonore. Dans une variante, Edison remplaça
les plaques du condensateur par des plaques de cuivre et de platine.
Ces éléments constituaient une pile voltaïque (que
nous appellerions une batterie) et généraient leur propre
tension, qui variait selon la pression exercée sur les plaques
par le diaphragme. Ces idées furent finalement abandonnées.
Vu dans la revue "La Nature 1878", l'Exposé
de M. Du Moncel :

sommaire
Partout en France, ces nouvelles faisaient l'objet
de conférences comme au Vésinet, on y retrouvait
la plupart du temps des élus , des avocats des ingénieurs
dont Messieurs Dumont et Napoli, ingénieurs et membres de l'association
Polytechnique, pour présenter “le phonographe, le cahier
chantant et les nouveaux téléphones”,
le samedi 21 février 1880,
Le 10 octobre 1878, le Courrier de Lyon rendait compte
d’une expérience, effectuée le 23 septembre précédent,
à l’Académie des Sciences, et du débat qu’elle
était censée clore. Cet article apporte un aperçu
intéressant sur la perception des techniques naissantes de
l’électricité par le monde savant. Il est reproduit
ci-après.
| Le Courrier de Lyon, 10 octobre
1878 «Le cahier parlant»
«L’Académie des Sciences a
offert, dans la séance de lundi, un spectacle tout à
fait inaccoutumé.
M. Bouillaud ayant attaqué les expériences
faites par M. du Moncel, ce dernier
avait demandé qu’une commission fut nommée
pour prouver qu’aucune supercherie n’était
pratiquée. Mais, les règlements de l’Académie
s’opposant à ce que l'assemblée se prononce
sur un travail régenté par un de ses membres,
le célèbre électricien a pris la résolution
d’exécuter en public la démonstration qui
avait poussé jusqu’au paroxysme l’incrédulité
de son savant confrère.
En conséquence, il a placé sur
une des tables de l’hémicycle un cahier de papier
à lettres dans l’intérieur duquel il avait
inséré quelques feuillets d’étain
rattachés aux deux pôles du circuit secondaire
d’un appareil d’induction. Le fil primaire de ce dernier
était rattaché à un transmetteur téléphonique
qui avait été installé dans le local voisin
où l’Académie Française tient ses
séances. Accompagné de M. Faye qui a bien voulu
servir de témoin, M. du Moncel est entré dans
cette salle dont il a fermé la porte, puis il s’est
mis à chanter. Aussitôt, ses confrères et
le public qui se pressait sur les banquettes ont entendu une
voix nasillarde sortir du cahier de papier. Le son de cette
voix était tellement fort qu’on l’entendait
aussi bien que si elle émanait du cornet d’un phonographe.
Il était cette fois impossible de prétendre qu’un
ventriloque se trouvait caché dans un objet qu’on
pouvait tenir dans la main.
M. Bouillaud a donné de très longues
explications tendant à prouver qu’il n’avait
pas entendu nier la possibilité physique de la reproduction
de la voix à l’aide du phonographe, mais il s’était
borné à avertir ses collègues qu’on
ne pouvait pas dire que le phonographe parlait. En effet, la
parole suppose une combinaison intellectuelle, et, en invoquant
l’exemple de Descartes, le savant docteur ne peut pas croire
que le phonographe soit doué de raison. Un immense éclat
de rire a accueilli cette explication peu digne d’un lieu
pareil. Mais M. Milnes Edwarts, qui avait pris part à
la discussion précédente, crut devoir protester.
En effet, ni lui, ni personne de l’Académie, n’avait
pu supposer qu’en invoquant la ventriloquie, M. Bouillaud
se bornait à refuser au phonographe et au condensateur
chantant le privilège de penser. L’honorable académicien
serait désolé que l’on put croire qu’il
avait assez peu de raison pour protester contre une semblable
assertion. Des expériences de phonographie, exécutées
devant les membres, ont eu lieu à l’issue de la
séance ».
Avant de reproduire les réflexions technico-philosophiques
de M. Bouillaud rapportées par le compte rendu de l’Académie
des Sciences, il n ’est pas inutile de donner quelques
éléments biographiques concernant les deux protagonistes
du débat. Jean-Baptiste Bouillaud (1796-1811), professeur
de médecine à la clinique de la Charité
pendant cinquante ans, a, en particulier, attaché son
nom à l’étude du rhumatisme articulaire aigu
et à son traitement par une méthode qu ’il
qualifie de «jugulante » bien qu ’encore molières
que : la saignée coup sur coup. Théodore du Moncel
(1821-1884), a été l’un des premiers physiciens
français à se spécialiser entièrement
en électricité, et s’est intéressé
à de nombreux domaines : thermostatique, mesures météo,
aide à la navigation, télégraphe, signalisation
dans les chemins defer... etc. Il a écrit plusieurs ouvrages,
dont Le téléphone,
le microphone et le phonographe en 1878.
Voici donc les réflexions qu’inspirent à
l’éminent médecin, les expériences
du pragmatique M. du Moncel.
Remarques sur le phonographe et le téléphone
; par M. Bouillaud.
I- Le Phonographe :
— L’expérience phonographique faite devant
l’Académie, il y a déjà quelques mois,
a été répétée, en ma présence,
dans le cabinet de mon savant confrère, M. du Moncel.
Quelques phrases prononcées dans l’ouverture du
phonographe, d’abord par un jeune homme qui faisait fonctionner
la machine, ensuite par M. du Moncel, et enfin par moi, furent
répétées et entendues de nous tous.
- 1° Etait-ce le phonographe qui les répétait,
après les avoir inscrites ? Etait-ce un autre moyen répétiteur
? Si c’était bien le phonographe, était-ce
par répétition des vibrations sonores qu’il
aurait enregistrées, et qu’il aurait reproduites
de lui-même, proprio motu, comme l’écho
reproduit les vibrations des ondes sonores qu’il a recueillies
?
Dans cette dernière hypothèse, cet appareil n’aurait
été qu’un écho sui generis,
et n’aurait pas, par conséquent, constitué
une véritable invention, puisque l’expérience
à laquelle il servait n’était qu’une
confirmation de celles déjà faites, en matière
de cette partie de l’acoustique qui concerne les divers
modes de transmission et de répercussion ou de réflexion
des sons. Ce rapprochement de la répétition des
paroles par la voix phonographique avec celle de leur répétition
par la voix de l’écho tel qu’on l’a connu
jusqu’ici, tourmentait en quelque sorte mon esprit.
Mais je ne pouvais me dissimuler que la répétition
dite phonographique n’avait pas lieu immédiatement
après la prononciation des paroles, comme il arrive dans
le cas de leur répétition par un écho très
voisin de l’oreille de la personne qui les a prononcées.
Je ne pouvais me dissimuler non plus que la répétition
d’origine phonographique pouvait se produire, selon les
phonographistes, un plus ou moins grand nombre de fois, à
des intervalles divers, sans avoir besoin d’une prononciation
nouvelle de la part de la personne qui les avait déjà
prononcées, tandis que la répétition des
paroles par le moyen de l’écho ne peut se reproduire
qu’à la condition, pour celles-ci, d’être
prononcées de nouveau.
De plus, il me fallait bien reconnaître que, sous le rapport
de la force, du ton, de la vitesse et du timbre, les paroles
d’origine dite phonographique différaient notablement
de celles qui avaient été prononcées, tandis
que c’est le contraire pour les paroles répétées
par l’écho.
-2° Etait-ce par une sorte d’imitation artistique
que les paroles attribuées au phonographe étaient
reproduites ?
Quelques-uns s’étonneront, sans doute, de cette
seconde hypothèse. Ce n’est pas, cependant, sans
aucune ombre de raison qu’il m’est arrivé de
la concevoir. Je ne prétends pas, toutefois, lui donner
plus d’importance qu’elle ne mérite, ni l’émettre
sans toutes les réserves requises.
«En attendant mieux, il ne m’est encore permis que
de m’en tenir au doute vraiment philosophique. Ce n’est
pas que, à l’exemple de Montaigne, je professe que
le doute est le plus doux oreiller sur lequel puisse reposer
une tête bien faite. Il me semble, au contraire, que la
certitude, quand rien ne lui manque, est un oreiller plus doux
encore. Mais, me demandera-t-on, quel est donc ce mieux que
j’attends ?
Je vais le dire. J’attends que M. du Moncel, opérant
lui-même, soit chez lui, soit ici, en présence
d’une Commission élue par l’Académie,
répète, un nombre suffisant de fois, et avec toutes
les précautions et conditions voulues par la saine méthode
scientifique, les expériences sur lesquelles s’appuie
la théorie qu’il enseigne relativement au mécanisme
du phonographe. Jusque-là, je ne saurais, malgré
toute la sympathie que j’éprouve pour sa personne
et l’intérêt que je prends à ses savantes
recherches, je ne saurais, dis-je, partager sa foi phonographique.
«Par une sorte d’argumentum ad hominem, M.
du Moncel dit que la phrase prononcée par moi est précisément
celle que le phonographe a répétée le mieux
; et, ce qui m’a beaucoup flatté, il a eu la politesse
de donner pour raison à cela que je l’avais fort
bien prononcée. Il faut, en vérité, que
mon caractère et mon esprit soient bien mal faits, pour
ne pas m’avouer converti par une logique aussi éloquente.
Que M. du Moncel veuille bien me pardonner une incrédulité
qui, pour être vaincue, attend uniquement, comme je viens
de le déclarer, l’heureux moment où, fonctionnant
sous sa direction personnelle, toutes les conditions requises
observées, en présence de la Commission demandée,
il fera répéter au phonographe la phrase enregistrée
par lui, telle que je l’ai prononcée, ce qu’il
a déjà fait plus d’une fois, dit-il, en présence
de certaines personnes. Alors, moi aussi, comme Thomas, ou comme
la femme de Polyeucte, voire même comme Orgon, je m’écrierai
: j’ai entendu, j’ai touché, j’ai vu,
vu dis-je ce qui s’appelle vu, et je rendrai hautement
des actions de grâce à mon victorieux confrère.
Je viendrai proclamer ma défaite, au sein de cette Académie,
et je n’en rougirai point ; car s’il y a quelque chose
de plus beau peut-être que de découvrir la vérité,
c’est de reconnaître son erreur. »
Passons maintenant au téléphone, ou, du moins,
à une certaine transmission électrique des sons,
objet de l’expérience en cause, et redonnons la
parole au sceptique et méfiant M. Bouillaud.
II. Téléphone :
— La condition nouvelle par laquelle cet instrument se
distingue de ceux déjà connus, au moyen desquels
les sons se propagent à des distances plus ou moins éloignées,
c’est qu’une machine électrique en fait partie
comme moyen de renforcement.
M. du Moncel assure avoir reconnu, par ses expériences
personnelles, l’influence de ce nouveau pouvoir électromagnétique,
comme moyen de propagation ou de transmission des sons. Il a
répété devant moi l’expérience
déjà pratiquée devant l’Académie,
pour prouver cette nouvelle propriété de l’électromagnétisme.
Il y a, pour moi, dans cette expérience, je ne sais quelle
illusion d’acoustique, dont un examen plus approfondi de
l’appareil au moyen duquel on l’exécute permettra,
je l’espère de se dégager.
Quant à l’expérience particulière,
au moyen de laquelle M. du Moncel m’a fait entendre le
bruit d’une montre placée dans une pièce
de son appartement, distante d’un certain nombre de mètres,
d’une autre pièce où nous étions,
je ne crois pas me tromper en disant que j’aurais également
entendu ce bruit, si le cornet dont je me servais pour l’écouter
eût communiqué avec la montre, au moyen d’un
appareil acoustique ordinaire, suffisamment multiplicateur du
son et convenablement disposé.
J’ai observé, en effet, un bon nombre de faits à
l’appui de cette assertion. Je n’ai pas eu le temps,
depuis que j’ai été témoin de l’expérience
de M. du Moncel, de faire construire un appareil spécial,
pour démontrer que le bruit d’une montre peut s’entendre
à plusieurs mètres de distance, quand il est transmis
par un moyen conducteur suffisamment puissant.
Une seconde expérience téléphonique, dont
M. du Moncel a bien voulu m’offrir le très amusant
et joli spectacle, c’est celle de l’instrument qu’il
appelle le condensateur chantant.
Elle consiste en ce que les chants d’une personne, recueillis
par le téléphone, sont transmis par un appareil
conducteur à ce condensateur, formé de feuilles
de papier et de lames métalliques. Celui-ci les propage
dans la salle où il est placé. Les chants ainsi
formés, transmis, condensés, propagés,
peuvent comme le tic tac de la montre, dont il a été
question plus haut, cesser de se faire entendre, si l’on
interrompt le circuit électrique, nécessaire,
selon M. du Moncel, au jeu du téléphone.
Les chants communiqués au condensateur sont purement
vocaux. Les paroles chantées, m’a-t-il été
dit, ce qui, je l’avoue m’a surpris un peu, ne seraient
pas transmises, condensées et propagées dans la
salle. Quant à ces chants vocaux, ils offrent un timbre
particulier qui ne peut guère se décrire, mais
mérite d’être signalé.
Ce que j’ai dit de l’influence de l’appareil
électrique du téléphone, à l’occasion
de l’expérience relative au tic tac d’une montre,
est applicable à celle dont il est actuellement question.
Il ne m’a pas été suffisamment démontré,
jusqu’ici, que cet appareil électrique jouât
un rôle aussi important que celui dont on le considère
essentiellement chargé.
L’argument que l’on fait valoir en sa faveur, c’est
que l’on peut à volonté supprimer le chant
en interrompant le circuit électrique et le reproduire
en rétablissant le circuit. Ce raisonnement serait sans
doute irréfutable, s’il était clairement
démontré que nulle autre condition n’est
intervenue pour déterminer le phénomène
; mais j’avoue franchement ne pas en avoir la certitude.
Jusqu’à plus ample informé, je me contenterai
donc de dire que par l’unique emploi d’un conducteur
acoustique ordinaire, suffisamment énergique, on produirait
les phénomènes, très curieux, je le répète,
de l’expérience dont je viens de rendre un compte
succint. »
M. Bouillaud semble ignorer que le téléphone de
Bell est apparu en 1876, et que M. du Moncel en fait état
dans son ouvrage de 1878, où il décrit les nombreux
appareils suscités par cette technique nouvelle à
d’imaginatifs inventeurs.
Venons en maintenant au «très amusant et
joli spectacle » offert par le condensateur chantant.
M. du Moncel, dans son ouvrage déjà cité,
le présente ainsi :
«Grâce à MM. Pollard et Garnier,
nous pouvons aujourd’hui voir sortir les chants d’une
espèce de cahier de papier, et cela avec une force telle
qu’on peut les entendre dans tout un appartement. Sans
doute, les chants ainsi produits ne sont pas toujours les plus
purs ; cependant, quand la personne qui chante dans le transmetteur
est un peu musicienne et a saisi la manière de s’en
servir, le condensateur en question peut émettre des
sons assez doux qui se rapprochent un peu de ceux du violoncelle
ou du haut-bois. »
Suit une description des éléments constitutifs
du système que nous résumons sous l ’illustration
jointe.
 — Schéma d’ensemble du dispositif dit du «cahier
chantant »
— Schéma d’ensemble du dispositif dit du «cahier
chantant »
K condensateur formé de 30 feuilles de papier
superposées, de 9 cm x 1 3 cm, entre lesquelles sont
intercalées 28 feuilles d’étain de 6 cm x
12 cm.
D borne de raccordement et de mise en parallèle
des feuilles d’étain paires.
D’ borne de raccordement et de mise en parallèle
des feuilles d’étain impaires.
E «transmetteur » : microphone à lames
de fer blanc LL et charbons C et H.
R ressort.
V vis de réglage de la distance C-H.
P pile.
M bobine d’induction.
Redonnons la parole à M. du Moncel pour
le mode d’emploi de l’appareil :
«Un poids assez lourd placé sur le condensateur
pour serrer les lames, n’arrête nullement son fonctionnement
; il en affaiblit seulement les sons qui deviennent alors plus
harmonieux, ce qui rend douteuse l’hypothèse des
mouvements attractifs des lames qu’on avait émise
à l’origine pour expliquer ces effets.
Pour obtenir le chant sur le condensateur, il faut
régler le transmetteur de manière que les charbons
C et H ne se touchent pas à l’état normal,
mais soient assez près l’un de l’autre pour que,
en chantant, les vibrations de la plaque LL puissent effectuer
des contacts suffisants. On arrive facilement à ce réglage
par le tâtonnement et en émettant une même
note jusqu’à ce que le condensateur résonne.
Si trois notes, faites successivement, sont bien reproduites,
l’appareil peut être considéré comme
suffisamment réglé, et pour le faire fonctionner,
il suffit d’enfoncer la bouche dans l’embouchure, comme
on le fait quand on chante dans un mirliton. »
Ce curieux appareillage a été
construit (et vendu ?) par MM. Chardin et Prager,
ce qui semble indiquer qu’il lui avait été
trouvé une utilisation. M. du Moncel n’en fait pas
mention.
Pour conclure cette petite incursion dans les
tout débuts de la reproduction et de la transmission
des sons, donnons la parole à Charles
Bourseul (1829-1912) qui avait proposé, à
sa hiérarchie de l’Administration des Postes, en
1853 — avant donc, Bell et Gray en 1876 — un projet
de téléphone qui n’avait suscité aucun
intérêt :
«Après les merveilleux télégraphes
qui peuvent reproduire à distance l’écriture
de tel ou tel individu et même des dessins plus ou moins
compliqués » — allusion, sans doute, au pantélégraphe
de Caselli, ancêtre du fax — «il semblerait
impossible d’aller plus loin dans les régions du
merveilleux. Essayons cependant de faire quelques pas de plus
encore. Je me suis demandé, par exemple, si la parole
ne pourrait pas être transmise par l’électricité,
en un mot, si l’on ne pourrait pas parler à Vienne
et se faire entendre à Paris. La chose est praticable
».
Ces propos sont rapportés, en 1878, par M. du Moncel,
qui nous apprend aussi que Bourseul, inventeur méconnu
mais sans rancune, se consacra au perfectionnement du téléphone
de Bell, ce qui ne l’empêcha pas de finir sa vie
ruiné.
Outre le compte rendu de l’Académie
des Sciences, les éléments de cette étude
sont tirés de l’ouvrage de M. du Moncel cité
dans le texte.
Cet ouvrage contient de nombreux renseignements sur les appareils
qui ont été imaginés pour réaliser
la transmission électrique des sons et rejetés
dans l’oubli par l’appareil d’Edison.
...
sommaire
La réponse de M. du Moncel ne tarda pas :

...
|
sommaire
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE NORMANDIE . SÉANCE DU 6 JANVIER 1879 .
M. Berjot met ses collègues à
même d'apprécier les effets du condensateur chantant
, L'appareil chantant consiste dans un condensateur formé
de 30 feuilles de papier superposées , de 9 centimètres
sur 13 , entre lesquelles sont intercalées 28 feuilles
d'étain de 6 centimètres sur 12 , réunies
de manière à constituer les deux armures du condensateur
.
A cet effet les feuilles paires sont réunies ensemble à
l'un des bouts du cahier de papier , et les feuilles impaires
à l'autre bout . En appliquant ce sys tème sur un
carton rigide , après avoir eu soin de le ligaturer avec
une bande de papier , et en serrant les feuilles d'étain
réunies aux deux bouts du condensateur avec deux garnitures
de cuivre , munies de boutons d'attache pour les fils du circuit
, on obtient ainsi un appareil qui joue le rôle d'un véritable
chanteur .
L'appareil transmetteur se compose d'une sorte de téléphone
, dont la lame vibrante est constituée par une lame de
fer- blanc très - mince , au centre de laquelle est soudé
un morceau cylindrique de charbon , et contre ce charbon appuie
un autre cylindre de la même matière , qui est porté
par une traverse de bois , articulée d'un côté
sur le bord inférieur de la boîte du téléphone
et fixée de l'autre côté sur le bord opposé
de la boîte , au moyen d'une vis de réglage .
Un ressort arqué placé en travers de cette pièce
lui donne une certaine élasticité sous son serrage
, et cette élasticité est nécessaire pour
le bon fonctionnement de l'appareil qui constitue une sorte de
microphone à diaphragme . La lame de fer est mise en rapport
avec l'un des pôles d'une pile de 6 éléments
Léclanché , et le charbon inférieur correspond
à l'hélice primaire d'une bobine d'induction , déjà
reliée au second pôle de la pile . Enfin les deux
bouts de l'hélice secondaire de la bobine sont reliés
directement aux deux armures du condensateur ,
Pour obtenir le chant sur le condensateur , il faut régler
le transmetteur de manière que les deux charbons ne se
touchent pas à l'état normal , mais soient assez
près l'un de l'autre pour que , en chantant , les vibrations
de la plaque puissent effectuer des contacts suffisants .
M. Berjot , qui se trouvait avec le téléphone dans
une pièce différente de celle où étaient
placés ses collègues , a chanté dans ce téléphone
, et les membres de la Société ont entendu le cahier
de papier , et cela à diverses reprises , reproduire l'air
qui avait été chanté dans le téléphone
.
Des bravos répétés ont prouvé à
M. Berjot toute la sur prise et tout le plaisir qu'il avait produits
. M. Berjot promet à ses collègues de les entretenir
dans la prochaine séance d'une application médicale
du téléphone . |
sommaire
Bulletin de la Société des sciences de Nancy , séance
de 2 décembre 1878
— M. BICHAT fait sur
le cahier chantant une communication expérimentale à
la suite de laquelle il présente, sur la cause du son dans
le condensateur chantant, les considérations suivantes
:
Il est intéressant, dit M. Bichat, de rechercher l'origine
du son que l'on obtient au moyen du cahier chantant. Indépendamment
des changements de volume signalés par M. Govi et
qui doivent avoir certainement de l'influence, je crois que l'on
doit surtout attribuer la cause du son obtenu au bruit qui accompagne
les décharges électriques produites dans des conditions
particulières. Tout le monde connaît la vieille expérience
dite de la pluie de feu signalée, je crois, pour la première
fois par M. du Moncel. En même temps que l'on voit cette
pluie de feu, on entend un certain son dont la hauteur et l'intensité
varient avec la distance des lames de verre et la grandeur de
la bobine que l'on emploie. Si, entre les lames, on met une poudre
métallique, on voit cette poudre exécuter une série
de mouvements de va-et-vient et le son change surtout de timbre.
Lorsqu'il n'y a que de l'air, on
peut admettre par analogie que les molécules d'air exécutent
le même mouvement de va-et-vient qui concorde avec l'émission
du son. Une remarque importante pour le but que je me propose
est la suivante : Si l'on emploie une bobine dans laquelle les
interruptions du courant inducteur sont produites par une lame
vibrante, on remarque que le son qui accompagne la pluie de feu
varie de hauteur en même temps que le son de la lame vibrante.
Si, au lieu de prendre seulement deux lames de verre, on en prend
un grand nombre, l'épaisseur de ces lames de verre étant
très faible, on peut, en empilant ces lames les unes sur
les autres et y interposant entre elles de petits morceaux de
carton, obtenir une pluie de feu dans tous les intervalles successifs,
cette pluie de feu étant toujours accompagnée d'un
son dont la hauteur varie avec h hauteur du son de l'interrupteur.
En résumé, on peut faire un condensateur chantant
à lames de verre disposé de la même façon
que le condensateur à feuilles de papier et fonctionnant
de la même façon, mais plus difficilement. Il faut
en effet que les étincelles qui doivent charger le condensateur
à lame isolante en verre, aient une plus grande longueur
que dans le cas où la lame de verre est remplacée
par une simple feuille de papier.
Avec le cahier chantant, on ne peut employer que de petites
bobines.
Si la bobine donnait de fortes étincelles, ces étincelles
perceraient les feuilles de papier, et l'instrument ne fonctionnerait
plus. Cela montre bien qu'il faut que l'étincelle présente
la forme d'effluve et se produise de la même manière
que dans la pluie de feu. Le condensateur à lames de verre
marche au contraire de mieux en mieux à mesure que les
dimensions de la bobine augmentent, et alors on voit trèsnettement
avec une grande bobine la pluie de feu qui accompagne le chant
et qui, d'après moi, en est la cause principale.
Ce qui me fait penser que l'intervalle d'air nécessaire
à la pluie de feu est indispensable, c'est que, si l'on
vient à presser fortement sur le cahier chantant, il ne
fonctionne plus; on a beau charger les lames de verre séparées
par les morceaux de carton, le condensateur à lames
de verre ne cesse pas de fonctionner. |
sommaire
1879 Compte rendu des travaux de la Société des ingénieurs
civils
On a construit depuis M. Hughes
un grand nombre de microphones, et quelques-uns présentent
des dispositions particulières qui permettent de
les employer comme parleurs , ce qui dispense de l'emploi des
téléphones.
M. FICHET présente à la Société plusieurs
microphones entre autres ceux de M. Trouvé, de M, Ader
et un microphone à charbon oscillant de M. de Combettes.
Il présente également un autre
appareil de M. Ader, appelé l'EIectrophone et
dans lequel la plaque vibrante se trouve remplacée par
une
membrane en papier-parchemin, sur laquelle est fixée
une petite armature en fer placée en regard des pôles
d'un électro-aimant, dont les bobines sont dans le circuit
d'un microphone. Avec une membrane de 20 centimètres
de diamètre on reproduit facilement le chant et la parole
avec assez d'intensite de son pour être entendu de toute
une salle.
M. de Combettes» constructeur de
cet instrument, présente aussi un spécimen du
cahier chantant de M. Nouette.
Cet appareil est un condensateur formé d'une série
alternée de feuilles de papier isolant et de feuilles
d'étain communiquant deux par deux avec les fils positif
et négatif du courant.
En chantant à une certaine distance devant un trembleur,
cet appareil reproduit le son sans articuler la parole et avec
un accent naûUard qui rappelle le son d'un mirliton.
Jusqu'ici, dans tous les appareils passés
en revue, nous trouvons toujours, à un bout de la ligne,
un transmetteur actionné par les vibrations de l'air
engendrées par la parole, et transformant ces vibrations
en une série de courants d'induction se succédant
d'une façon synchronique et correspondant aux vibrations
de l'air produites par la parole, et à l'autre bout de
la ligne, un récepteur dans lequel une plaque vibrante
est mise en mouvement par les courants d'induction, et communiquant
à son tour son mouvement vibratoire à l'air ambiant.
Il n'y a, sauf l'intensité, aucune différence
entre ce qui se passe aux deux bouts de la ligne, et la théorie
du téléphone reproduite au commencement de la
séance semble bien donner l'explication des faits.
Il y eut cependant dès l'origine, des
incrédules, et plusieurs savants, H.
du Montcel en tète, se sont demandé s'il
était rationnel d'admettre que des
courants, assez faibles pour ne produire aucune action sur le
galvanomètre, pussent cependant accomplir un travail
mécanique comme celui de la mise en mouvement d'une membrane
tendue. N'ayant aucune autre explication à donner en
échange de la théorie de leurs adversaires, ils
se sont contentés de formuler un doute et ont entrepris
des expériences très délicates pour rechercher
la vérité. Il serait trop long de les passer en
revue, et il suffira, pour montrer combien ils avaient raison
de se méfier de la théorie nouvelle, de dire qu'il
existe des instruments qui reproduisent la parole et qui ne
comportent ni membrane vibrante ni aucune pièce mobile.
H. FICHET présente à la Société
un de ces instruments, le téléphone de M. Âder,
qui se compose simplement d'un fil de fer doux planté
dans une
planchette de sapin et entouré de quelques spires de
fil de cuivre fin recouvert de soie. En mettant la planchette
contre l'oreille, on entend parfaitement la parole d'un interlocuteur
qui, placé à l'autre bout de la ligne, parle devant
un microphone. Si l'on applique un poids contre l'extrémité
libre du fil de fer, le son se trouve considérablement
renforcé.
En pratique, M. Ader construit son appareil
en soudant aux extrémités d'an fil de fer de 1millimètre
de diamètre et de 5 centimètres de longueur, deux
masses pesantes, et en disposant autour du fil de fer une petite
bobine de fil de cuivre entourée de soie. On tient l'instrument
à la main et, en
l'approchant de l'oreille, on entend le son avec une netteté
satisfaisante. Le timbre de la voix est absolument conservé.
Avec cet instrument l'ancienne théorie n'est plus admissible,
et il ne reste plus qu'à admettre avec M. de La Rive
que raiiuaulalion du fer produite par les courants d'induction
produit un état vibratoire des molécules de fer,
qui s'entrechoquent en produisant un son. Comme aucun mouvement
n'est précipité à l'extérieur, on
en est réduit à se demander comment ces chocs
de molécule à molécule peuvent délenniner
dans l'air ambiant les vibrations nécessaires pour impressionner
la membrane du tympan. La réponse, à cette demande
est, il faut bien le dire, encore à trouver.
Après avoir produit l'aimantation du
fer au moyen de courants induits passant dans la bobine, M.
Ader a supprimé la bobine et a fait passer les
courants induits dans le fil de fer lui-même.
M. FICHET présente à la Société
l'appareil ainsi construit, qui transmet là parole comme
le précédent.
En substituant au fil de fer un fil d'un métal
non magnétique, on n'a obtenu aucun résultat;
il semble donc que jusqu'à un certain point l'opinion
de M. de La Rive se trouve confirmée et que ce sont bien
des phénomènes magnétiques qui déterminent
ces chocs intérieurs d'où résulte le son.
Pour en avoir la preuve, H. Ader a placé
sur une planchette semblable aux précédentes une
bobine de fil de cuivre isolé en tout pareil à
celui em-
ployé, mais sur laquelle le fil est enroulé très
peu serré. Il n'y a plus là aucun métal
magnétique, mais seulement du bois, du cuivre et de la
soie,
et cependant l'appareil parle encore.
Quelle explication plausible en donner?
Si , au lieu d'enrouler le fil très peu
serré, on fixe les spires d*une façon invariable
au moyen de gomme laque, l'appareil devient muet. La gomme
laque est un isolant par excellence, les phénomènes
électriques n'ont pas de prise sur elle, elle n'a pas
produit d'autre effet que d'immobiliser les
spires, pourquoi le son cesse-t-il de se produire dans ce cas.
Il est impossible dans l'état actuel de la science de
fournir aucune explication satis-
faisante.
M. FICHET regrette que l'heure avancée
ne lui permette pas de faire fonctionner tous ces appareils
de M. Ader, qui lui ont été obligeamment confiés
par M. Du Moncel pour la séance de ce jour, et pour le
service desquels M. de Combettes avait eu la complaisance d'installer
aux divers. étages de l'hôtel, des postes reliés
par des fils isolés. Ces appareils du reste, tout en
présentant un intérêt scientifique considérable,
sont encore trop récents pour que l'inventeur ait eu
le temps de les rendre susceptibles d'une application pratique.
Ceux qui ont été présentés
tout d'abord, à savoir le téléphone de
M. Gower et le téléphone avertisseur de M. Trouvé,
sont au contraire des instruments tout à fait pratiques.
Leur installation pour de courtes distances coûte déjà
moins que celle des tuyaux acoustiques; et, pour des ateliers
et des usines, ils sont dès maintenant en mesure de rendre
les plus grands services.
M. LE PRESIDENT remercie Mr Fichet de son intéressante
communication,
...
|
sommaire
L’appareil téléphonique de Varley a été
simplifié et rendu maniable par Janssens, qui lui a
donné la forme que représente la figure suivante .
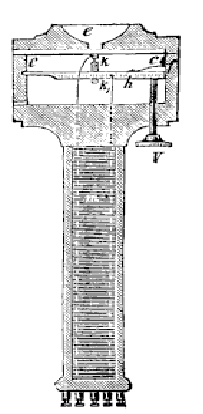
La bobine d’induction m est ici réunie avec le transmetteur,
et en outre toute l’organisation a été faite de
façon à ce que l’appareil s’emploie à
la façon d’un téléphone parleur ordinaire.
Deux de ces téléphones, avec le condensateur décrit
plus haut et deux ou trois éléments Leclanché,
suffisent pour établir une communication téléphonique
complète entre deux stations.
Pour donner à la plaque vibrante c, c une mobilité aussi
libre que possible, et ne pas gêner ses mouvements dessus et
dessous par la pression de l’air, on a ménagé des
ouvertures sur les côtés de la boîte du transmetteur.
Par la vis v et la traverse h mobile, qui est maintenue par le ressort
f,. on règle la pression de contact des crayons de charbon
kkl. Au moyen des cinq bornes représentées au bas de
la figure 18, l’appareil peut être employé de différentes
manières.
sommaire
 Modèle vendu par Radiguet
Massiot
Modèle vendu par Radiguet
Massiot 
Les Travaux du docteur Cornélius
Herz :
1880 1881
Invention d'un Système téléphonique à
condensateur .
Les travaux de Herz sont commentés pour la première
fois dans la revue qu'il a créée en 1879,
"La Lumière électrique".
Extrait de la revue "la lumière électrique"
de 1881 , par Th Du Moncel (pages 97 ... )
En 1882 le
Scientific American du 22 Juillet 1882 lui conssacre 3 pages
avec les très belles illustrations
 
sommaire
1881 Dolbear est un scientifique, qui à
travailé sur "la transmission du son"
Basé sur le principe et théorie présentée
par M. Du Moncel, il met au point un Téléphone électrostatique
à condensateur,
brevet US 239 742
A, 5 avril 1881

et un autre Brevet "Mode of Transmitting Sound by Electricity".
US 240 578 26 Avr 1881

 
Article paru dans la revue SCIENCE pages 310 -12 et 13
sommaire
|
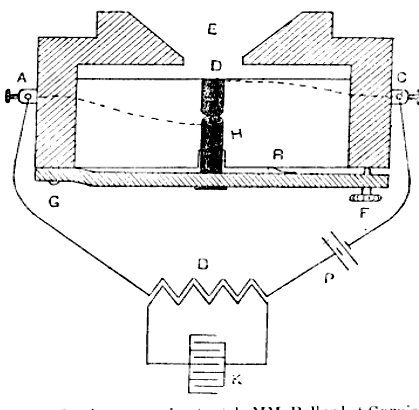
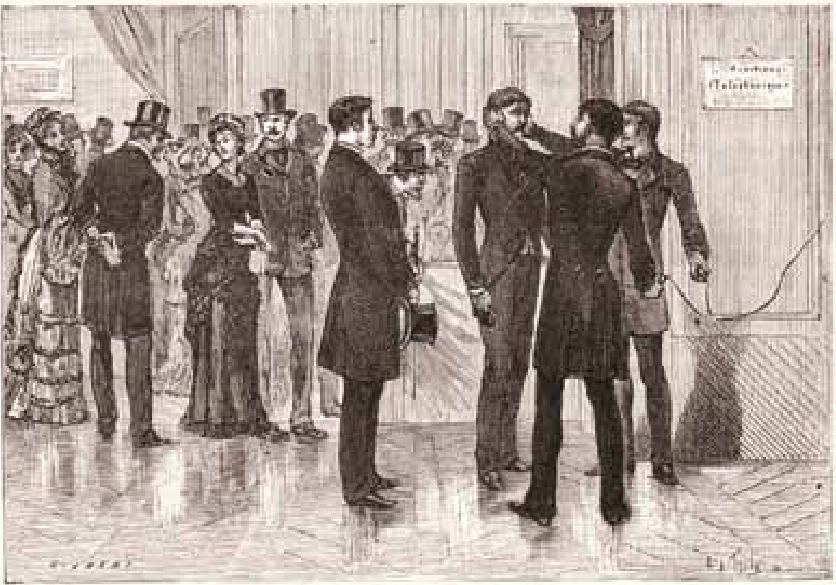

 Fig. 31.
Fig. 31.  Ce type
de dispositif repose sur le stockage d'une charge entre deux conducteurs,
en l'occurrence des plaques métalliques isolées. La
charge varie en fonction de la distance entre les deux plaques. La
première version était complexe et peu sensible, mais
en décembre 1877, il reprit l'idée. Il installa un empilement
de plaques métalliques, séparées par des disques
isolants, derrière un diaphragme. La pression de la voix sur
le diaphragme faisait varier la distance entre les plaques, donnant
ainsi une tension variable. Ce système aurait été
peu sensible, compte tenu du poids des plaques du condensateur. Cette
idée fut ensuite reprise par d'autres inventeurs, qui utilisèrent
une électrode arrière fixe et un ruban métallique
léger comme diaphragme, et produisirent un microphone à
condensateur utilisé en radiodiffusion et en enregistrement
sonore. Dans une variante, Edison remplaça
les plaques du condensateur par des plaques de cuivre et de platine.
Ces éléments constituaient une pile voltaïque (que
nous appellerions une batterie) et généraient leur propre
tension, qui variait selon la pression exercée sur les plaques
par le diaphragme. Ces idées furent finalement abandonnées.
Ce type
de dispositif repose sur le stockage d'une charge entre deux conducteurs,
en l'occurrence des plaques métalliques isolées. La
charge varie en fonction de la distance entre les deux plaques. La
première version était complexe et peu sensible, mais
en décembre 1877, il reprit l'idée. Il installa un empilement
de plaques métalliques, séparées par des disques
isolants, derrière un diaphragme. La pression de la voix sur
le diaphragme faisait varier la distance entre les plaques, donnant
ainsi une tension variable. Ce système aurait été
peu sensible, compte tenu du poids des plaques du condensateur. Cette
idée fut ensuite reprise par d'autres inventeurs, qui utilisèrent
une électrode arrière fixe et un ruban métallique
léger comme diaphragme, et produisirent un microphone à
condensateur utilisé en radiodiffusion et en enregistrement
sonore. Dans une variante, Edison remplaça
les plaques du condensateur par des plaques de cuivre et de platine.
Ces éléments constituaient une pile voltaïque (que
nous appellerions une batterie) et généraient leur propre
tension, qui variait selon la pression exercée sur les plaques
par le diaphragme. Ces idées furent finalement abandonnées.


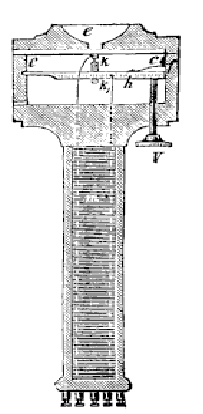
 Modèle vendu par Radiguet
Massiot
Modèle vendu par Radiguet
Massiot