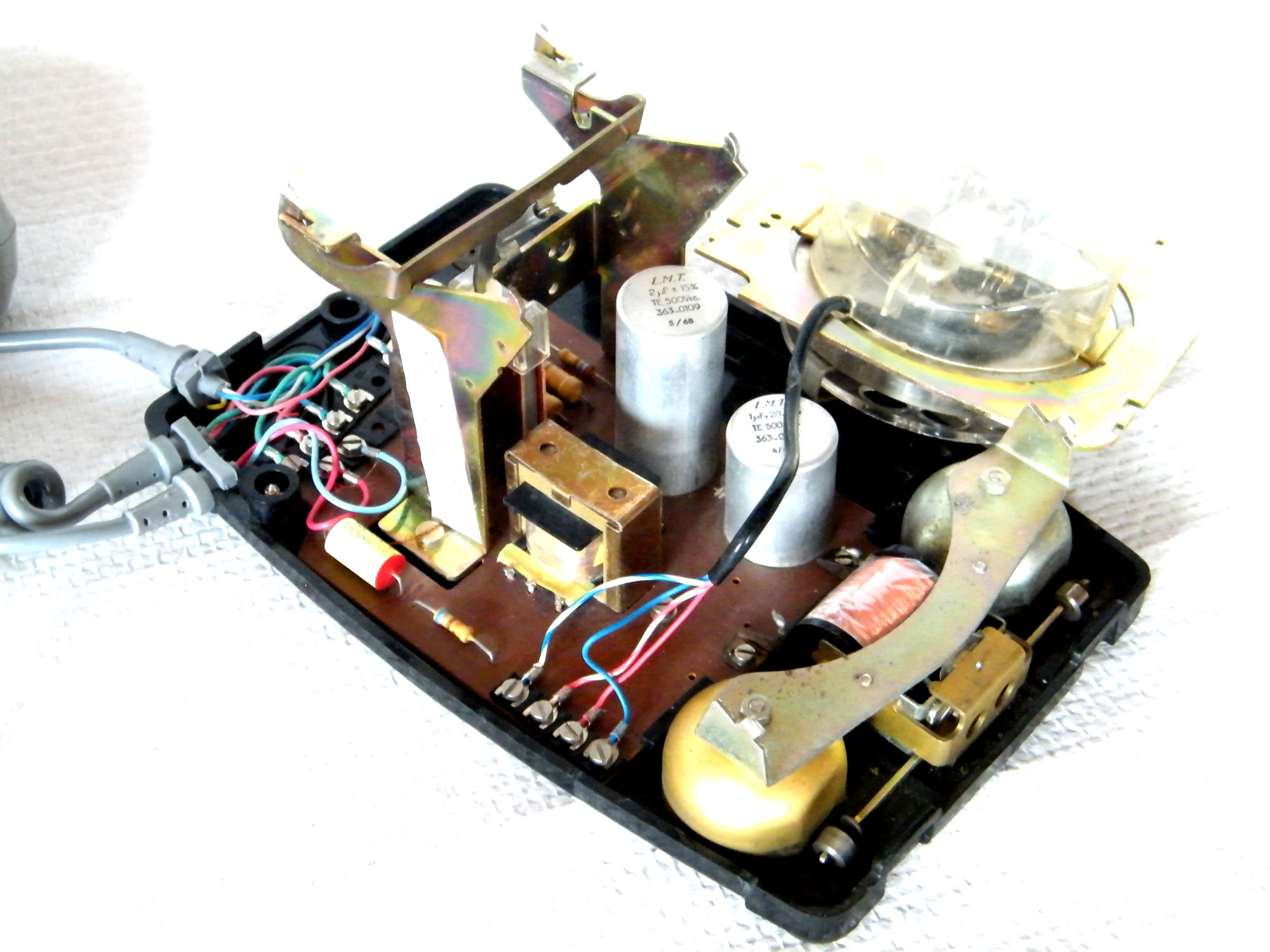Les Installations de postes téléphoniques.
Rappel sur les lignes et réseaux téléphoniques
:
En 1884, le réseau français de la Société
Générale des Téléphones avait déjà
pris une grande extension. A l’occasion de rétablissement
d’un nouveau cahier des charges, diverses améliorations furent
apportées dans le service; c’est ainsi que les abonnés
eurent la faculté de transmettre et de recevoir leurs télégrammes,
entre le bureau central et leur domicile; des cabines téléphoniques
publiques furent installées; enfin, des réseaux suburbains
étaient créés.
Entre lemps, l'Administration des Postes et Télégraphes
avait entrepris la construction de réseaux téléphpniques
dans des villes qui, pour des raisons diverses, n’en avaient pas
été pourvues par la Société Générale
desTéléphones ; en 1884, certaines de ces villes étaient
reliées entre elles, dans les limites de distance permise par le
fonctionnement des systèmes alors en usage; l’exploitation
était assurée par lés bureaux télégraphiques;
en 1887, les abonnés de tous les réseaux eurent la faculté
de correspondre d’une ville à l’autre, à partir
de leur domicile.
C'est vers 1888 que l’on renonça, de façon à
peu près définitive,à l’emploi de la terre pour
fermer le circuit téléphonique; les constructions se firent
à l'aide de deux fils, c'est-à-dire, en circuit complètement
métallique; on peut ainsi, par une construction appropriée
et un équilibrage convenable des deux conducteurs, diminuer sensiblement
les troubles résultant de l’induction ; mais le nombre des
circuits téléphoniques allant toujours en augmentant, ceux-ci
réagirent les uns sur les autres.
On y remédia en « croisant » périodiquement
les deux composants de chaque circuit, suivant le dispositif indiqué
par Hughes; le système de rotations est universellement employé
maintenant, et les différents circuits forment, sur les lignes,
de véritables hélices, dont le pas diffère pour chacun
d'eux, suivant leur position.
Jusu'à cette date, les téléphones avaient une borne
T pour raccorder le retour à la terre, la borne L
servait à raccorder la ligne du téléphone. Par la
suite les téltéphones comprtaient deux indications L1
et L2 qui resta jusqu'à la fin du téléphone
filaire (ce qui permet pour les collectionneurs et historiens de dater
l'époque d'un vieux téléphone).
Enfin en 1889, à l’expiration de la concession de la
Société Générale des Téléphones,
l’Etat racheta en entier le réseau de cette Société
et, à partir de cette époque, assura seul l’exploitation
des téléphones en France.
sommaire
Les installations privées.
— Les lignes pour installations privées peuvent être
établies d’une manière beaucoup plus simple qu’un
réseau de distribution multiple comportant un nombre considérable
d’abonnés avec le bureau central. Quand il n’existe que
deux postes correspondant ensemble, on relie simplement les bornes de
départ des appareils par deux fils, à moins que l'on utilise
la terre comme fil de retour, cas dans lequel il suffit
d’un unique fil de ligne, comme dans les télégraphes.
Quand le nombre des postes à desservir dépasse
une dizaine, on emploie d’autres méthodes ; les plus usitées
sont celles-ci :
1° Installation avec poste central, exigeant
la présence permanente d’un employé, et desservant
les postes secondaires, lesquels ne peuvent communiquer l’un avec
l’autre que par son intermédiaire.
2° Installation avec postes embrochés,
reliés ensemble par un seul fil et pouvant communiquer à
volonté et directement entre eux.
Dans les installations avec poste central, des postes
en nombre quelconque sont réunis téléphoniquement,
l’un d’eux est poste central, les autres sont postes simples
ou secondaires, et forcés, dans ce cas, de s’adresser au poste
central pour obtenir la communication désirée.
Tous les postes sont donc reliés à celui-ci, d’où
rayonnent toutes les lignes desservies, et où s’effectuent
les connexions de fils.
Un poste simple comporte les organes suivants :
1 transmetteur microphonique ; 1 à 2 récepteurs téléphoniques
; 1 sonnerie d’appel ; 1 commutateur .
1 batterie de piles au sel ammoniac composée du nombre d’éléments
voulu.
Le poste central comporte, en sus de ces mêmes
organes, un tableau annonciateur avec les jacks correspondants pour établir
les jonctions.
Les fonctions de ce tableau consistent à attirer l’attention
de l’employé du central qui répond à l’appel
et demande au correspondant qui l’a sonné ce qu’il désire.
Celui-ci indique le numéro de l’abonné avec lequel
il désire être mis en rapport. Armé de son cordon
à double fiche, l’employé réunit la ligne du
demandeur à celle du correspondant demandé, et la conversation
peut commencer directement entre les deux abonnés, l’attention
de celui que l’on appelle ayant été attirée
par le bruit de sa sonnerie.
Dans les installations avec postes embrochés,
l’employé doit se tenir en permanence auprès du tableau
annonciateur, et c’est pourquoi on n’emploie ce dispositif que
lorsque le nombre des postes desservis est considérable. Ce système
a surtout pour but de permettre l’appel direct d’un poste quelconque
en exigeant seulement deux fils, ou même un fil unique quand la
terre est prise comme conducteur de retour. Il permet donc de réaliser
une certaine économie.
La forme la plus simple installée chez les particuliers
était le bouton-téléphone .
Le « bouton-téléphone » n’a pas de grandes
prétentions. Cette combinaison heureuse d’un bouton d’appel
et d’un téléphone avec un commutateur automatique permet
de remplacer, dans une installation ordinaire de sonneries électriques,
les boutons d’appel par un système qui donne le moyen, en
même temps que l’on sonne une personne, d’entrer en conversation
avec elle.



En un mot, c’est la transformation, à très peu
de frais, d’un réseau de sonnerie existant en réseau
téléphonique.
Si nous examinons les figures nous voyons que les deux boutons d’appel
bb ont été remplacés, purement et simplement, par
les boutons-téléphones Bi,B2. En plus, à proximité
de la sonnerie, on a placé un bouton téléphonique
spécial (sans bouton d’appel). Et c’est tout.

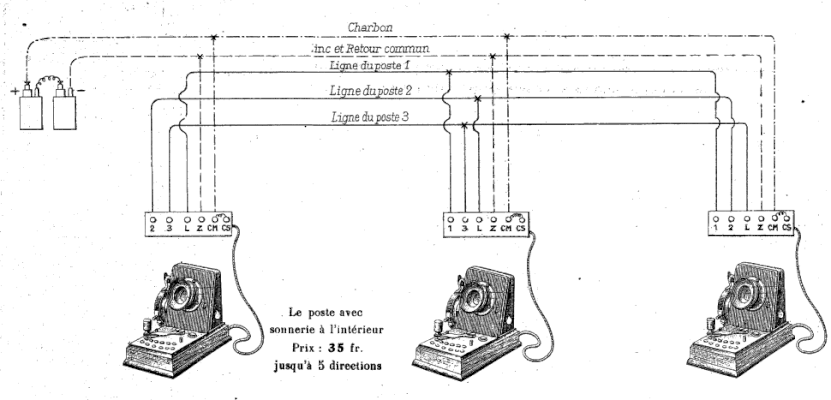 Trois
exemples de montage : un avec un tableau indicateur existant, un motage
de 3 petits postes privés et trois postes à courant primaire
dont un sert de central..
Trois
exemples de montage : un avec un tableau indicateur existant, un motage
de 3 petits postes privés et trois postes à courant primaire
dont un sert de central..

Nous classons les appareils micro-téléphoniques
en deux catégories :
1° Poste micro-téléphonique à courant primaire,
à petite distance. (exemple ci desssus)
2° Poste micro-téléphonique à courant secondaire,
c’est-à-dire à bobine d’induction ou à
grande distance.
Les appareils simples du début n'avait pas de repère pour
connecter les fils, deux fils de ligne suffisait, puis avec des montages
plus sophistiqués il a fallu indiquer les repères suivant
: C. Cuivre Z. Zinc. L. Ligne. S.
Sonnerie, C S. Cuivre sonnerie. PM. Pile microphone, et
T Terre pour les retours de ligne par la terre des postes à
bobine d'induction.

Au début, voici comment est décrit le poste micro-téléphonique
à courant primaire, quel qu’en soit le système connu,
se compose de :
1° D’une planchette en sapin portant les charbons, et dont la
disposition est aussi variable que preque tous les systèmes, mais
l’avantage revient sûrement à la disposition adoptée
par M. Ader, sauf, cependant, le microphone à granules de charbon,
que l’on commence depuis quelques temps à employer, et dont
on obtient également de très bons résultats ;
2° D’une clef d’appel, dite clef Mors ou un bouton d'appel;
3° D’un pont équerre mis à cheval sur la clef d’appel;
4° D’un crochet mobile
jouant le rôle d’interrupteur automatique puisqu’il se
trouve, soit sur la ligne de la sonnerie, soit sur celle du microphone
;
5° De deux paillettes disposées
de manière que l’une se trouve en permanence avec la sonnerie,
et l’autre avec le microphone ;
6° D’un ou deux récepteurs
avec aimants et bobines.
Le poste micro-téléphonique à courant secondaire,
à bobines d’induction, se compose des mêmes pièces
que le premier, plus la bobine d’induction qui est indispensable
pour les grandes distances, et un montage intérieur spécial.
Il est absolument impossible de suivre une méthode dans les installations
téléphoniques, puisque chacun fait établir le service
selon ses besoins.
Mais le principe d’installation des postes,
avec ou sans bobines, quelle qu’en soit la combinaison, est fait
par des lignes et la terre.
C’est dans la pose du téléphone
que la terre est employée le plus fréquemment; surtout pour
les postes à grandes distances;
Nous allons maintenant expliquer les effets qui peuvent, en cas de mauvais
fonctionnement être attribués aux appareils.
A. — En pressant sur le bouton d’appel, on se sonne soi-même.
Cela provient de ce que le ressort porte-bouton ne quitte pas complètement
le pont équerre, lequel se trouve relié au crochet et ce
dernier à la sonnerie. En donnant un peu de rigidité au
ressort, près du bouton, on supprime cet inconvénient.
B. — Les sonneries sonnent continuellement.
Cela peut s’expliquer de deux manières différentes.
1° Un fil de bobines du téléphone ou du cordon se trouve
en contact avec la masse métallique du récepteur.
2° Le crochet tient les deux paillettes, sonnerie et microphone à
la fois, tandis que le récepteur accroché ne doit être
en contact qu’avec la paillette de la sonnerie.
C. — En décrochant le récepteur d’un poste la
sonnerie du deuxième poste se met en mouvement. Le fait est dû
à l'insuffisance de résistance, sur les bobines des récepteurs
(cela ne se produit généralement qu’à l’un
des postes, dont le pôle du microphone est le même qu’à
la sonnerie).
D. — La parole passe très difficilement. On peut admettre
deux causes :
1° Les charbons du microphone ne sont pas bien nettoyés de
la couche brillante qui les recouvre.
2° Les récepteurs se trouvent déréglés.
Dans le premier cas la rectification doit être faite par le constructeur.
Dans le second cas, il est facile d’y remédier soi-même,
puisque dans presque tous les récepteurs il y a des rondelles très
minces, permettant de maintenir la distance nécessaire entre les
barreaux des bobines et le diagramme, distance qui est de 2/10 de m/m
environ. Pour s’assurer si cette distance estobservée, il
suffit de faire une légère pression avec les doigts sur
le diagramme (ou plaque vibrante) la flexibilité l’indique
très nettement.
Nous avons indiqué quelques cas pouvant être
attribués aux appareils, cas qui se présentent très
rarement, car nous présumons qu’une surveillance très
étroite est exercée par tous les constructeurs dans la fabrication
de leurs appareils.
Enfin pour éviter des recherches quelquefois
difficiles et embrouillées, il serait nécessaire d’essayer
chaque appareil avant de l’employer.
L’essai pour les postes à courant primaire
seuls, se fait de la manière suivante :
Une batterie de deux ou trois éléments
et deux bouts de fils, que l’on conduit aux bornes marquées
L. — ligne, et P M = pile microphone, puis en plaçant une
montre sur la planchette microphonique, et en portant le récepteur
à l’oreille, on doit percevoir distinctement le tic-tac de
la montre, ce qui indique le réglage maxima de l’appareil.

Si, il peut se glisser quelques défauts de
construction dans un appareil, du reste faciles à réparer,
et ne mettant qu’une partie d’installation hors service, il
y a des défauts résultant de la pose même, qui par
fois arrêtent le service tout entier. Or il ne faut pas s’imaginer
que chaque fait soit dû à une cause particulière ...
Pour la pose de deux postes, puis trois, des postes avev bobne ... avec
inverseur de courant ... la notice décrivant les problèmes
rencontrés et des réparations à faire s'allonge,
alors nous en resterons là pour les installations privées.
Les installations sur le réseau de l'Etat.
Depuis 1889 L’installation des postes, chez les abonnés, est réglementée par un carnet de montage publié par l’Administration. Ce carnet contient les divers types d’installations qui répondent à tous les besoins de la pratique. Les mécaniciens et les monteurs sont tenus de s’y conformer ; toutefois, nous verrons que certaines substitutions peuvent être effectuées.
Ce que le carnet ne décrit pas, ce qu’on ne
peut davantage décrire ici, c’est le détail des procédés
mis en œuvre pour monter les installations chez les abonnés
et dans les bureaux; percement et tamponnage des murs, ligatures et disposition
des fils, changement de couleur de ces fils lorsqu’on traverse un
appartement luxueux présentant des tentures de différentes
nuances, emplacement des appareils, etc. C’est surtout en pratiquant
le montage que les agents chargés de ce service apprennent à
se servir de l’outillage qui est mis à leur disposition. Il
faut également tenir compte, dans la mesure du possible, des désirs
de l’abonné en ce qui concerne certaines parties du travail,
entre autres l’emplacement des appareils et des piles, et le passage
des fils. Les fils sont posés de plusieurs manières, suivant
les différentes parties de leur parcours. On verra, d’après
les installations représentées plus loin, que les conducteurs
qui réunissent des appareils situés à proximité
les uns des autres passent dans des isolants en bois fixés au mur
par des vis sont de petites règles percées de deux à
dix trous. Les fils sont tendus soigneusement entre les isolants et arrêtés
en contournant pour les faire passer une deuxième fois par le même
trou. Quand un fil ou deux font un certain parcours seuls, ils sont tendus
sur des isolants en os enfilés sur des clous. Enfin, quand plusieurs
fils franchissent une certaine distance, ou traversent un mur, on peut
les grouper ensemble sous forme de câble; toutefois, si cette disposition
rend les fils moins apparents, elle rend aussi leur vérification
et la recherche es dérangements moins aisées. Dans ce cas,
es fils sont tendus sur des crochets en fer émaillé
...
sommaire
LES INSTALLATIONS NORMALISEES DES POSTES
A partir de 1893
Les Postes simples d’abonnés.
1 — Entrées de postes : lignes aériennes, lignes souterraines.
2 — Installation des communications intérieures.
3 — Postes simples.
4 — Installation des paratonnerres.
5 — Prises de terre.
6 — Appareils muraux.
7 — Appareils portatifs.
8 — Installation d’un poste combiné Berthon-Ader avec
applique murale, type 8.
9 — Installation d’un poste portatif Paul Bert-d’Arsonval.
10 — Installation d’un poste Crossley.
11 — Installation d’un appareil Deckert (modèle réduit).—
Installation de l’appareil Deckert à appel magnétique.
12 — Installation de l’appareil Degryse-Werbrouck (ancien modèle).
13 — Installation de l’appareil Dejongh portatif.
14— Installation d’un appareil Journaux pour lignes souterraines.
— Installation d’un appareil Journaux pour lignes aériennes
seulement.
15— Installation d’un appareil portatif Mildé.
16 — Installation d’un poste portatif Mors-Abdank.
17 — Installation d'un poste mural Ochorowicz. — Installation
d’un poste portatif Ochorowicz.
18 — Installation d’un appareil portatif Pasquet.
19 — Installation des appels électro-magnétiques.
Les Postes centraux d'abonnés.
20 — Installation d’un tableau annonciateur à disque,
grand modèle, avec place pour appareil.
21 — Installation d’un tableau annonciateur à disque,
grand modèle, sans place pour appareil
22 — Installation d’un tableau annonciateur à disque,
petit modèle (système Bailleux).
23 — Installation d’un poste pour l’appel direct.
24 — Installation d’un poste avec sonnerie à double enroulement.
25 — Installation des postes avec le rappel par inversion de courant.
26 — Installation d’un poste central d’abonné avec
un appareil Paul Bert-d’Arsonval ou tout autre appareil ayant les
bornes semblablement placées et un tableau Sieur (ligne à
simple fil).
27 — Installation d’une ligne bifurquée avec des postes
Ducousso.
28 — Installation d’une station automatique Sieur.
A partir de 1905
29 — Les postes mureaux avec appel magnétique.
30 — Les Postes mobiles avaec applique magnétique.
31 — Installation de deux postes en dérivation sur un commutateur
à deux directions.
32 — Installation des postes dans les cabines publiques.
Les postes d'abonnés rekiés aux bureaux à batterie
centrale ou automatique
33 — Principe de la batterie centrale.
34 — Montage des postes simples.
35 — Postes à B. C. I.
36 — Poste mural à B. C. I. modèle 1918.
37 — Applique murale à B. G. I., modèle 1918.
38 — Appareil mobile à B. G. I., modèle 1918.
A partir de 1924
39 — Disque d’appel administratif modèle 1927 pour réseaux
automatiques.
40 — Appareils modèle 1924.
41 — Appareil mural, modèle 1924, à combiné.
42 — Appareil mobile, modèle 1924, à combiné.
43 — Appareils, modèle 1924, à microphone Solid-Back
et récepteur Bell.
44 — Installations diverses réalisées avec les postes,
modèle 1924.
45 — Conjoncteurs, type 1924, pour appareils à batterie centrale.
46 — Installation de postes mobiles, modèle 1918, avec conjoncteurs,
modèle 1924.
47 — Installation de postes mobiles, modèle 1924, avec conjoncteurs,
modèle 1924.
48 — Installation de postes à B. C. avec conjoncteurs à
dix bornes.
49 — Appareil à prépaiement pour
réseau B. C. (le taxiphone).
50 — Appareil à
prépaiement et encaissement automatique pour réseau B. G.
ou automatique (le taxiphone).
51 - Le téléphone Universel U43
52 - Le téléphone Socotel S63
sommaire
1 - Entrées de postes : lignes aériennes, lignes souterraines.
— Les lignes desservant les postes d’abonnés sont aériennes
ou souterraines, c’est-à-dire en fil nu ou en câble;
elles peuvent être aussi à simple ou à double fil.
Dans l’un comme dans l’autre cas, il faut assurer, dans les
meilleures conditions, leur jonction avec les conducteurs qui doivent,
à l’intérieur de l’immeuble, les rattacher aux
appareils téléphoniques. (voir la page
lignes)
Lorsqu’il s’agit de lignes aériennes, chaque conducteur
est solidement arrêté sur un isolateur au dernier appui de
la ligne, consolidé en conséquence, pour faire équilibre
à la traction que les fils exercent d’un seul côté.
De chacun des isolateurs du dernier appui part un fil de cuivre, soudé
au conducteur, et aboutissant à un petit isolateur, scellé
dans la muraille de l’immeuble destiné à recevoir les
appareils. Cet isolateur se nomme isolateur d’entrée de poste.
Au-dessous de tous ces isolateurs d’entrée de poste recevant
les fils qui viennent de l’extérieur, un trou est percé
à travers le mur; un câble recouvert de plomb, contenant
un nombre de conducteurs égal ou supérieur à celui
des fils de ligne, est engagé dans ce trou et déborde de
part et d’autre. Les fils qui composent ces sortes de câbles
sont recouverts de gutta-percha et d’un revêtement de coton.
La coloration du coton varie avec chaque conducteur ou chaque paire de
conducteurs, de sorte qu’il est aisé de les reconnaître,
quelle que soit l’extrémité du câble à
laquelle on ait affaire.
Du côté de l’extérieur, le revêtement de
plomb est enlevé, les fils sont séparés, puis dénudés.
Chacun d’eux est relié par une ligature et par un grain de
soudure à un des conducteurs de la ligne. Cette opération
terminée, l’ouverture pratiquée dans le mur est hermétiquement
close autour du câble avec du plâtre.


Chez l'abonné — Planchette de raccordement à 14 bornes.
A l’intérieur les conducteurs, préalablement dénudés,
sont amenés à des planchettes de raccordement.
Ces planchettes de raccordement sont des plaques d’ébonite
ou de bois dans lesquelles sont incrustées ou, plus simplement,
sur lesquelles sont fixées des traverses en cuivre, disposées
parallèlement et portant une vis de serrage à chaque bout
(photo ci dessus).
On les construit évidemment de la dimension que l’on veut;
les modèles courants portent de 1 à 10 traverses. Ces planchettes
employées depuis longtemps par la Société générale
des Téléphones, sont désignées comme
suit :
Planchette à une traverse : contact simple fil.
— deux traverses : contact double fil.
— trois traverses : planchette à six bornes.
— dix traverses : planchette à vingt bornes.
La planchette de raccordement est fixée sur le mur, près
de l’entrée du câble sous plomb. Les conducteurs de
celui-ci, préalablement séparés et dénudés
à leur extrémité, sont respectivement arrêtés
sous les bornes supérieures de la planchette; les bornes inférieures
reçoivent les conducteurs de l’intérieur du poste.
Ceux-ci sont des fils recouverts de gutta-perclia et de coton.
Souvent, lorsque les fils de ligne sont nombreux, on amène le câble
sous-plomb jusqu’à la planchette de raccordement; on évite
ainsi de développer les conducteurs en une nappe qui occuperait
sur la, muraille un espace relativement considérable. Les fds sont
simplement dénudés dans le voisinage des bornes supérieures
de la planchette.
sommaire
2 - Installation des communications intérieures.
— A l’intérieur des appartements, pour diriger les
fils le long des murs, les séparer et les tendre, on fait usage
d’isolateurs en bois.
Ce sont de petits blocs de bois durs, tels qùe le hêtre,
le chêne, le noyer, percés, dans un sens, de trous dont le
nombre varie suivant la longueur de l’isolateur; ces trous reçoivent
les vis ou les clous servant à le fixer. Dans une direction perpendiculaire,
les trous destinés au passage des fils sont aussi en nombre variable,
suivant la quantité de fils que doit supporter l’isolateur
.
 Isolateur en bois
Isolateur en bois
 Passage du til dans
les isolateurs
Passage du til dans
les isolateurs
On en fabrique depuis un trou jusqu’à cinquante et même
plus. Le diamètre des trous destinés au passage des fds
est suffisant pour laisser pénétrer deux fois le même
fil ; c’est sur ce dispositif qu’est basé le système
d’arrêt.
En effet, tout fil conducteur traversant un isolateur du genre de ceux
que nous venons de décrire, fait un tour complet sur cet isolateur.
Que le fil vienne d’en haut, comme, ou bien d’en bas, il passe
dans le trou de l’isolateur, est tendu, recourbé, engagé
de nouveau dans le même trou, et, finalement, continue son trajet
après avoir fait une boucle autour de la partie antérieure
de l’isolateur. Les fils dénudés sont pincés
sous les boutons des bornes, mais comme la manœuvre de. ces boutons
peut amener une rupture du fil conducteur, il est utile de se ménager
une réserve permettant, sans faire de raccord, d’engager sous
la borne un nouveau morceau de fil. Au lieu d’amener le fil tendu
directement sous la borne, on en forme une spirale, dont les spires peu
serrées forment en quelque sorte une réserve toujours prête
à parer à une éventualité. Ces spirales sont
connues sous le nom de boudins; on les fabrique avec un outil très
simple.

C’est un gros fil de fer ou d’acier dont le diamètre
est approprié à celui du boudin que l’on veut faire.
Il est enfoncé dans un manche en bois, et son extrémité
libre est fendue. Le fil à boudiner est engagé dans la fente,
et, tandis que de la main droite on fait tourner l’outil, de la gauche
on guide les spires qui viennent se juxtaposer le long de la tige. Lorsque
la quantité de fil voulue a été enroulée de
la sorte, il suffît de dégager l’extrémité
placée dans la fente et de retirer l’outil pour obtenir un
boudin absolument souple.
sommaire
3 - Postes simples. (consulter la
page regroupant les différents téléphones
)
Rappel : en 1893 Pour les téléphones
connectés sur le réseau, l'état ordonne une normalisation
de la fabrication des appareils :
L'abaissement des taxes après la nationalisation de 1889, eut pour
conséquence une augmentation considérable dans le nombre
des abonnements.
Chaque constructeur d'appareils électriques voulut avoir son modèle
de téléphone. Beaucoup cherchèrent à produire
à bon marché. Il en résulta que, si les appareils
avaient bel aspect, si les parties visibles étaient soignées,
les organes cachés n'étaient pas toujours d'un fini irréprochable.
« Du moment que l'appareil fonctionne bien, disait-on dans les milieux
intéressés, cela suffit. » Non, cela ne suffit pas,
et l'Administration chargée des réparations, tant pour son
compte que pour celui des abonnés, ne pouvait se désintéresser
de la question.
Aussi, le 10 juin 1892, adressait-elle aux constructeurs un programme
auquel ils devaient se conformer, à dater du 1er
janvier 1893, sous peine de voir prononcer l'interdiction de
l'emploi de leurs appareils sur le réseau.
| « 1° Toutes les vis entrant
dans la construction des appareils téléphoniques devront
être faites avec des tarauds fabriqués avec un jeu qui
sera établi par les soins du Dépôt central des
Télégraphes et dont un exemplaire sera remis aux constructeurs
qui en feront la demande. « 2° Les contacts à butée seront absolument proscrits et remplacés par des contacts à frottement. « 3° Il y aura lieu de supprimer les boudins qui sortent des joues des bobines d'induction. Noyer dans ces joues des plots métalliques sur lesquels on prendra les communications avec les circuits de la bobine. « 4° Ne faire usage que de paillettes d'acier, avec contacts platinés, pour les ressorts de communication. « 5° Le ressort antagoniste du crochet mobile devra fonctionner, d'une façon normale, sous des poids de 200 à 600 grammes attachés au crochet. « 6° Les vis à bois seront remplacées par des vis à métaux ou par des boulons. Les têtes des boulons seront munies d'un pied et les écrous refendus, pour permettre le serrage au tournevis. « 7° Toutes les communications seront établies en fil de cuivre, recouvert d'un isolant avec tresse de coton ou de soie et terminé par des poulies en laiton. La tresse sera rouge pour le circuit primaire, bleue pour le circuit secondaire, jaune pour le circuit d'appel et des trois couleurs pour les fils communs à plusieurs circuits. « 8° Les bornes auront la disposition et porteront les indications : L1+L2 pour les fils de lignes, S1+S2 pour la sonnerie d'appel, ZS+CS aux pôles - et + de la pile d'appel, ZM+CM aux pôles - et + de la pile du microphone.  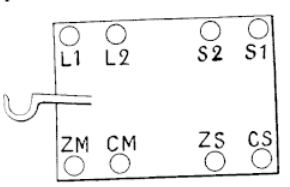 On comprend de suite l’importance de cette obligation qui permet d’uniformiser le montage des connexions extérieures, et surtout, de remplacer rapidement un appareil quand une réparation ne peut être effectuée sur place. « 9° On n'emploiera, pour les joues des bobines d'induction, que du bois de buis, bien sec et bien sain. (Depuis, l'emploi de l'ébonite a été autorisé.) « 10 ° Les cordons souples seront attachés sur les récepteurs à des bornes extérieures. « 11° Les membranes des récepteurs seront vernies. » Enfin, l'Administration, sans en faire une obligation, conseille l'adoption des dispositions suivantes : - 1° Fendre les têtes des boutons pour permettre le serrage au tournevis. - 2° Placer le crochet commutateur à gauche, ce qui permet à la personne qui se sert du téléphone d'avoir la main droite libre.. - 3° Ne plus faire usage, pour les bobines des récepteurs, de bobines en bois qui se fendent, et employer, au contraire, des joues métalliques soudées sur le noyau, en veillant à ce que cette carcasse métallique soit bien isolée du fil qu'elle supporte. - 4° La couleur des fils des différents circuits : circuit d’appel (transmission et réception), jaune; circuit de conversation, bleu; fil commun à ces deux circuits, tricolore; circuit microphonique, rouge. Cette disposition permet évidemment de suivre plus facilement les différents fils en cas de dérangement.A titre d'exemple, nous examinerons un peu en détail un poste mural et un poste mobile de 1893.
Nous nous plaisons à reconnaître que le programme de l'Administration a provoqué une sorte d'émulation entre les constructeurs, et que les nouveaux types de récepteurs et de transmetteurs sont beaucoup plus soignés que les anciens. Il faudra attendre 1902, pour que l'administration normalise les appareils (comme le poste Pasquet), puis 1910 ... |
— Connaissant les procédés élémentaires,
examinons l’installation dans un poste simple d’abonné,
d’un poste Ader, avec pile et sonnerie.
 Poste Ader SGT
Poste Ader SGT
Tout dépend un peu de la forme du local, mais il est presque toujours
possible de réaliser le montage que nous choisissons comme type,
et que la figure ci dessous représente dans son ensemble. (Instruction
pour la pose des appareils et accessoires. Société générale
des Téléphones.)
 vue extérieure
vue extérieure  vue
intérieure Ader
vue
intérieure Ader
Les piles sont en boîtes de trois éléments; celle
de gauche est affectée au microphone; les deux autres, réunies
en tension avec la première, constituent la pile d’appel.
Deux isolateurs à trois trous, plus s’il est nécessaire,
sont interposés entre l’appareil et la pile : l’un à
quelques centimètres au-dessous du transmetteur, simple (Ader à
pupitre). l’autre à quelques centimètres au-dessus
des boites à pile. Ces isolateurs sont évidemment placés
dans l’axe des appareils.
On prépare un boudin de 10 à 15 centimètres, dont
on assujettit l’extrémité dénudée sous
la borne de gauche, en bas, du transmetteur. Le conducteur est ensuite
engagé dans le premier trou de l’isolateur supérieur,
recourbé, passé de nouveau dans le même trou, tendu
et introduit dans le trou correspondant de l’isolateur inférieur.
Là, il est arrêté de la même manière,
puis contourné en boudin sur une longueur de 20 à 30 centimètres
et fixé sous la borne Z de la pile de gauche.
Le second fil, posé par les mêmes procédés,
part de la seconde borne du transmetteur pour aboutir à la borne
C de la pile de gauche; quant au troisième, placé toujours
dans des conditions identiques, il part de la quatrième borne du
transmetteur, pour arriver, à travers les deux isolateurs, à
la borne C de la pile de droite.
Sur le transmetteur, un boudin réunit la première borne
de gauche à la troisième; de même, la borne C de la
pile de gauche est reliée à la borne Z de la pile du milieu,
et la borne C de cette dernière à la borne Z de la pile
de droite.
Il est aisé de voir que les trois éléments de la
pile de gauche correspondent aux bornes 1 et 2 de gauche, tandis que la
pile entière de neuf éléments, ou plutôt l’ensemble
des trois piles, est installé sur les bornes 3 et 4 de droite.
Au-dessus de l’appareil, un isolateur à quatre trous livre
passage aux fils venant des bornes L et S. Un second isolateur à
quatre trous est placé à quelques centimètres au-dessus
de la sonnerie. La figure nous montre que les fils de ligne sont placés
à l’extérieur, les fils de sonnerie à l’intérieur.
Ceux-ci, après avoir franchi le dernier isolateur, redescendent
en boudins pour rejoindre les bornes de la sonnerie; les fils de ligne
continuent leur trajet à travers des isolateurs à deux trous
jusqu’à la planchette de raccordement.
sommaire
4 - Installation des paratonnerres.
— En se reportant au sujet des appareils de préservation,
et en le complétant par ce qui va suivre, au sujet des prises de
terre, on aura une idée très suffisante de l’installation
des paratonnerres à l’entrée des postes téléphoniques
ou bien à leur intérieur.
sommaire
5 - Prises de terre.
— Dans les postes installés au double fil, il n’est question
de prises de terre que pour l’installation des paratonnerres. Pour
les lignes à simple fil, il faut un fil de terre dans chaque poste.
Que le fil de terre soit d’ailleurs affecté à un appareil
préservateur ou bien qu’il devienne le complément indispensable
du circuit principal, il n’en doit pas moins être établi
dans des conditions de conductibilité exceptionnellement favorables.
Dans l’installation des fils de terre des postes d’abonnés,
on s’est longtemps inspiré des questions d’économie,
et on est allé, pour ainsi dire, au plus près, tout en faisant
consciencieusement les choses. On s’est raccordé aux conduites
de gaz et aux conduites d’eau, et nous trouvons, dans les instructions
de la Société générale des Téléphones,
les indications suivantes :
« Dans les endroits où se trouvent les conduites d’eau
ou de gaz en plomb, on se sert de ces conduites pour prendre la terre.
Dans ce cas, le.fil conducteur venant, soit de l’appareil (ligne
au simple fil), soit du paratonnerre, est généralement un
petit câble composé de trois fils de cuivre nu, tressés
ensemble.
« On enroule plusieurs fois ce conducteur autour de la conduite
d’eau ou de la conduite de gaz, après avoir eu soin de décaper
la conduite à l’endroit où vient s’enrouler le
petit câble. Lorsque le fil de terre est ainsi enroulé, on
le fixe solidement sur la conduite à l’aide d’une soudure
à l’étain. Il faut avoir soin de bien serrer les spires
d’enroulement, ce qui se fait d’ailleurs sur une longueur de
conduite d’environ 10 centimètres. Si on veut souder sur une
conduite d’eau, il faut avoir soin de la vider, sans quoi la soudure
devient impossible. Si on ne peut la vider, on remplace la soudure par
un fort serrage du fil autour de la conduite.
« Si on a à sa disposition une conduite d’eau et une
conduite de gaz, il y a intérêt à prendre deux terres,
une sur l’eau et une sur le gaz.
« Si on n’a à sa disposition qu’une conduite d’eau,
en fer on desserre un boulon de la conduite, on le nettoie sérieusement
et on vient y insérer l’extrémité du fil de
terre. On resserre fortement le boulon.
« Si on est dans un endroit où il n’y a ni conduite
d’eau ni conduite de gaz, on opère ainsi :
1° Si on est à proximité d’un cours d’eau,
on vient y plonger l’extrémité du fil de terre, en
laissant au fond de l’eau une longueur d’environ 2 ou 3 mètres
de ce fil. Mais il est nécessaire que la partie immergée
soit toujours dans l’eau.
2° Si on n'a pas de cours d’eau, on creuse un puits et, si on
rencontre une couche de terre humide, on y place une plaque de cuivre
rouge, d’environ 1 mètre de long sur 50 centimètres
de large, sur 1 ou 2 m/m d’épaisseur. On soude l’extrémité
du fil de terre après la plaque et on comble le puits, autant que
possible avec de la terre humide.
3° Si on n’a pas de terrain humide à sa disposition, on
enfonce en terre une barre de fer appointée d’environ lm.50
de longueur sur 6 à 10 centimètres carrés de section.
Si la section est ronde, un diamètre de 3 centimètres est
suffisant; si elle est carrée, chaque côté doit avoir
environ 3 centimètres. On enroule le fil autour de cette barre
et on'l’y soude, après avoir préalablement étamé
la partie de la barre de fer devant recevoir la soudure. Il est bon d’arroser,
de temps à autre, l’endroit où cette barre est enfoncée.
« En résumé, on no saurait prendre trop de précautions
pour assurer le contact intime du fil de terre avec le sol.
« Il faut également bien faire attention de fixer le fil
de cuivre servant à prendre la terre, de façon à
ne pas risquer de rupture de ce fil. Généralement on le
fait descendre le long d’un mur où il est fixé à
l’aide de crochets à gaz. »
Aujourd’hui que l’État a pris possession de tous les
réseaux français, nous pensons qu’il convient d’appliquer,
tant aux postes d’abonnés qu’aux bureaux centraux, les
dispositions admises en matière de constructions télégraphiques.
Ces dispositions ont été réglées par une circulaire
administrative dont voici les prescriptions les plus importantes :
« Employer un toron de fils dont la conductibilité soit au
moins égale à celle de l’ensemble de tous les fils
de ligne qui aboutissent à la station.
« Veiller à ce qu’il soit bien soudé en tous
ses raccords et qu’il communique avec le sol au moyen d’une
plaque de fer galvanisé, à large surface, variable suivant
l’importance du bureau et plongeant dans un puits, une nappe d’eau
ou un cours d’eau intarissable.
« Utiliser, le cas échéant, les conduites d’eau
dont les tuyaux sont en fer ou fonte avec joints métalliques.
« A défaut de ces prises de terre, creuser dans le sol un
trou d’une profondeur suffisante pour atteindre, sinon une nappe
d’eau, du moins un terrain qui conserve l’humidité.
« Établir le fil de terre, et même les fils de ligne,
aussi loin que possible de toute conduite de gaz en plomb.
« Restreindre autant que possible l’emploi des tuyaux de gaz
comme point d’attache du fil de terre, et, en cas d’absolue
nécessité, aller chercher pour s’y raccorder la conduite
mai-tresse en fonte. »
sommaire
6 - Appareils muraux. (consulter
la page regroupant les différents téléphones
)
— L’installation des appareils dont les noms suivent se
rapporte à un type unique :
 Ader N°3
Ader N°3
Poste Ader
— — n° 1
— — n° 2.
— — n° 3.
— — n° 7.
— Berthon n° 2.
— — n° 3 (à coulisse).
— — n° 9.
— Paul Bert — d’Arsonval (mural).
— Bourdin (mural et pupitre).
— Bourseul.
— Bréguet (mural).
— Degryse (type à 4 bornes).
— Dejongh (mural).
— Gallais (mural).
— Maiche (mural).
— Mildé (mural).
— Sieur.
Les dispositions de détail varient évidemment suivant les
locaux, mais il est presque toujours possible de ramener l’installation
au type précité.
Trois ou quatre vis, traversant des champignons en caoutchouc, servent
à fixer l’appareil à la muraille et, si l’appartement
est humide, il est bon, au point de vue de la conservation et d’un
fonctionnement régulier, d’interposer entre le mur et l’appareil
une planche de bois.
Les piles sont livrées en boites par l’administration.
La liaison des divers organes a lieu par l’intermédiaire de
fils de cuivre recouverts de gutta-percha et de coton.
Les deux fils de ligne, ou bien le fil de ligne et le fil de terre, sont
amenés aux bornes L placées en haut et à gauche du
transmetteur. Si la ligne est à double fil, les lignes sont placées
indifféremment sous les deux bornes; pour les lignes à simple
fil, on réserve la première borne de gauche à la
ligne, la seconde à la terre.
Les deux bornes de la sonnerie sont réunies de
la même manière aux bornes S, en haut et à droite
de l’appareil.
La pile se subdivise en pile de microphone et pile d'appel. La pile de
microphone contient toujours trois éléments, ni plus ni
moins ; c’est une pile locale ; elle est renfermée dans la
boîte de gauche. La puissance de la pile d’appel doit varier
suivant la distance à franchir; elle se compose d’un certain
nombre de boîtes, associées en tension, et comprenant la
boîte de pile du microphone. Sur les réseaux urbains, six
ou neuf éléments suffisent généralement pour
la pile d’appel; on ne fait donc usage que de deux ou de trois boîtes
en tout.
Le premier zinc de la pile est mis en relation avec la première
borne de gauche, en bas du transmetteur, le troisième charbon avec
la seconde borne; les trois premiers éléments de pile sont,
de la sorte, insérés entré les deux bornes de gauche;
c’est la pile du microphone.
Par un boudin, la première borne de gauche du transmetteur est
unie à la première borne de droite; disons plutôt,
pour éviter toute erreur, que la première borne, en allant
de gauche à droite, est unie à la troisième. Enfin,
la dernière borne, en allant vers la droite, reçoit le dernier
charbon de la pile, quel que soit le nombre des boîtes associées
en tension.
Il en résulte que la pile microphonique est localisée entre
les deux bornes de gauche, tandis que la pile totale correspond aux deux
bornes de droite et aussi aux bornes extrêmes, la première
à gauche, la dernière à droite.
sommaire
7 - Appareils portatifs. (consulter
la page regroupant les différents téléphones
)
— Un second type d’installation se rapporte aux appareils portatifs
à pied. Les postes suivants rentrent dans cette catégorie
:

 Ader N°4
Ader N°4  Cartel
Cartel
Ader n° 4.
Berthon-Ader n° 10 et forme cartel.
Bréguet portatif.
Gallais
Maiche
L’installation de ces appareils, montés sur une colonne ou
sur un piédestal, a lieu au moyen d’une planchette de raccordement
à 14 bornes et d’un cordon souple à 7 conducteurs diversement
colorés.
 Installation d’un
appareil portatif (Ader n° 4).
Installation d’un
appareil portatif (Ader n° 4).
Les cordons de la Société des Téléphones contiennent
un fil bleu, un fil rouge, un fil marron, un fil jaune, un fil noir, un
fil blanc, un fil vert.
Le fil de ligne arrive à la traverse n° 1 de la planchette
à 14 bornes, le fil de retour ou le fil de terre à la traverse
n° 2; les fils de sonnerie aboutissent aux traverses nos 3 et 4. Le
premier zinc de la pile est attaché à la traverse n°
5, le troisième charbon à la traverse n° 6, le dernier
charbon à la traverse n° 7.
Tous ces conducteurs sont pincés sous les bornes supérieures.
Des bornes inférieures partent les conducteurs du cordon souple,
savoir :
Traverse n° 1 fil bleu.
— n° 2 — rouge.
— n° 3 — marron.
— n° 4—jaune.
— n° 5 — noir.
— n° 6 — blanc.
— n° 7 — vert.
On voit sur la la figure les connexions de ces fils avec les bornes réparties
par paires sur le pourtour du socle du transmetteur. Le bouton d’appel
étant placé au bas de la figure, les bornes L reçoivent
le fil bleu et le fil rouge, les bornes P T, le fil marron et le fil jaune;
la première borne du groupe P S ne reçoit aucun fil, mais
est reliée métalliquement à la première borne
du groupe P T ; à la seconde borne du groupe P S aboutit le fil
noir, enfin le blanc et le vert sont attachés aux bornes S.
Il nous reste maintenant à examiner quelques cas particuliers .
sommaire
8 - Installation d’un poste combiné Berthon-Ader avec applique
murale, type 8.
N°8  N°8 bis
N°8 bis

— Deux vis passées dans les oreilles que l’on aperçoit
sur les côtés de l’applique fixent l’instrument
au mur. Les bornes sont divisées en deux groupes ; nous les supposerons
numérotées de gauche à droite.
On fait usage, comme dans les installations précédentes^
d’isolateurs en bois et de boudins.
Les bornes 1 et 2 sont réunies à la sonnerie, les bornes
3 et 4 au fil de ligne, au fil de retour ou à la terre. La borne
5 reçoit le premier zinc de la pile du microphone et est reliée
à la borne 7. La borne 6 reçoit le dernier charbon de la
pile du microphone, la borne 8 le dernier charbon de la pile totale. On
voit que, comme précédemment, trois éléments
sont intercalés entre les bornes o et 6, tandis que la pile totale
correspond aux bornes 5 et 8 et aussi aux bornes 7 et 8, le nombre des
éléments variant d’ailleurs avec la longueur de la
ligne.
sommaire
9 - Installation d’un poste portatif Paul Bert-d’Arsonval.


— Un cordon à six conducteurs s’attache aux six bornes
du transmetteur, savoir : le fil jaune à la borne L, le fil blanc
à la borne T, le fil marron à la borne Retour ou, Terre.
le fil rouge à la borne P, le fil vert à la borne M, le
fil bleu à la borne S.
La planchette de raccordement est à six lames, dont l’une,
située vers le milieu, est plus large que les autres. La première
lame reçoit le fil bleu et est réunie à une des bornes
de la sonnerie, la seconde borne de celle-ci communiquant avec la troisième
lame. La seconde lame reçoit le fil jaune et le fil de ligne; la
troisième lame reçoit le fil blanc, le fil de retour ou
la terre, le pôle négatif de la pile d’appel et, ainsi
que nous venons de le dire, le second fil de sonnerie. La quatrième
borne reçoit le fil marron et le pôle positif de la pile
de sonnerie, la cinquième lame reçoit le fil rouge et le
pôle négatif de la pile du microphone, la sixième
lame reçoit le fil vert et le pôle positif de la pile du
microphone.
sommaire
10 - Installation d’un poste Crossley.


— Dans le poste Crossley, dont l’usage d’ailleurs est à
peu près abandonné en France. L’instrument porte quatre
bornes L, G, Z T, C M. A la borne L, on attache le fil de ligne, à
la borne T le fil de retour ou le fil de terre et le pôle négatif
de la pile totale servant aux appels. Le pôle positif de cette pile
est relié à la borne C. Pour le service du microphone, on
prélève trois éléments qu’on réunit
à la borne CM; en d’autres termes, la pile microphonique comprend
trois éléments localisés entre le premier zinc réuni
à la borne Z T et le troisième charbon réuni à
la borne C M.
sommaire
11 - Installation d’un appareil Deckert (modèle réduit).
— On se rappelle que l’appareil Deckert, modèle réduit,
ne porte que quatre bornes et que le bouton d’appel est indépendant;
en résumé, l’applique murale ne contient que le crochet
commutateur et la bobine d’induction; le récepteur et le microphone
composent un appareil double réuni à l’applique par
un cordon souple. Ce dispositif nécessite une installation particulière
représentée par la figure 288.



Installation de l’appareil Deckert à appel magnétique.
— L’appel magnétique et la sonnerie font corps avec le
transmetteur dont les bornes se trouvent réduites à quatre
: Z, Iv, L, E, c’est-à-dire : zinc, cuivre, ligne, terre.
Dans ces conditions, l’installation devient des plus simples. Il
suffit d’attacher le pôle négatif de la pile du microphone
à la borne Z, le pôle positif à la borne K, le fil
de ligne à la borne L, le fil de terre ou le fil de retour à
la borne E.
sommaire
12 - Installation de l’appareil Degryse-Werbrouck, ancien modèle.
— Le transmetteur Degryse modifié se monte comme l’appareil
Ader n° 1 (type d'installation de la figure 284), mais dans l’ancien
modèle il existe cinq bornes placées en haut du socle et
marquées : L, 8, Z T, G S, C M.


Le fil de ligne s’attache à la borne L, le fil allant à
la sonnerie à la borne S. Le fil revenant de la sonnerie, le fil
de terre ou le fil de retour et le pôle négatif de la pile
sont pincés sous la borne Z T. Pour le service du microphone, on
prélève trois éléments sur la pile totale
; à cet effet, le troisième charbon est attaché à
la borne C M, tandis que le dernier aboutit à la borne C S.
sommaire
13 - Installation de l’appareil portatif Dejongh.
— Ce transmetteur est garni de cinq bornes L, T, S, P M, P S auxquelles
aboutit un cordon souple dont les cinq conducteurs ont une coloration
uniforme (marron).



Ces conducteurs aboutissent à une planchette de raccordement à
cinq lames, dont l’une est plus large que les autres.
Le fil de ligne est attaché à la première lame de
gauche ; la seconde reçoit le fil de retour ou le fil de terre,
le fil de retour de la sonnerie et le pôle négatif de la
pile. Le fil de sonnerie est relié à la troisième
lame ; le charbon du troisième élément de la pile
à la quatrième lame, et le dernier charbon à la cinquième
lame.
sommaire
14 - Installation d’un appareil Journaux pour lignes aériennes
et souterraines.
— Dans ce transmetteur on trouve huit bornes : quatre en haut, quatre
en bas. Les bornes du haut, disposées par paires, sont marquées
« ligne, retour » pour la première paire, « sonnerie
» pour la seconde. De ce chef, le montage est tout indiqué.
En bas, les bornes correspondent à deux piles distinctes pour le
microphone et pour les appels; les deux groupes de bornes sont marqués
: « CHARBON ZINC PILE D’APPEL » « CHARBON ZINC
PILE MICROPHONE» il n’y a donc pas d’hésitation
à avoir .
Installation d’un appareil Journaux pour réseaux aériens
seulement.

— Les bornes T Z, L, CM, C, en allant de droite à gauche,
reçoivent respectivement : la première, le pôle négatif
de la pile et le fil de retour ou le lîl de terre; la seconde, le
fil de ligne; la troisième, un conducteur venant du troisième
charbon de la pile; la quatrième, le dernier charbon; la pile du
microphone (3 éléments) se trouve ainsi comprise entre les
bornes T Z, C M, et la pile totale servant aux appels entre les bornes
T Z et C. Les deux fils de sonnerie sont attachés aux bornes marquées
« sonnerie », et situées au bas de l’applique
murale.
sommaire
15 - Installation d’un appareil portatif Mildé.
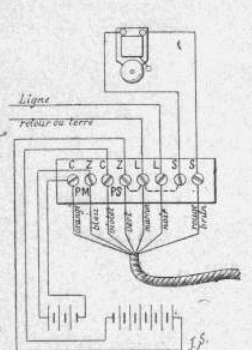


— Le socle de l’appareil ne porte pas de bornes. Le cordon souple
à sept conducteurs est attaché à l’intérieur
du piédestal; il comprend :
1 brin orangé;
1 brin bleu;
1 brin violet;
1 brin vert;
1 brin marron;
1 brin rouge brun ;
1 brin noir.
La planchette de raccordement est à huit bornes. Les 2e, 4e et
5e, en partant de la droite, sont réunies ensemble.
La figure indique suffisamment les dispositions à adopter pour
le montage.


sommaire
16 - Installation d’un poste mural Mors-Abdank.



— L’applique porte quatre paires de bornes : en haut, L,
S ; en bas, PM, PS. On peut adopter la disposition de la figure 291, ou
bien réaliser une installation analogue à celle du poste
Berthon-Ader avec applique murale, type n° 8.
Installation d’un poste portatif Mors-Abdank.
— Le socle de ce transmetteur ne porte pas de bornes ; le cordon
souple est directement attaché aux communications intérieures.
Ce cordon souple est bleu, violet, blanc, marron foncé, marron
clair, vert olive, vert émeraude, orangé; en tout, huit
conducteurs.
La planchette de raccordement est garnie de neuf bornes; au milieu du
rectangle se trouve un paratonnerre à peignes. Trois trous, a,
b, c, permettent, par l’interposition d'une cheville métallique,
de mettre la ligne à la terre en laissant le retour poste hors
circuit, ou bien de réunir directement la ligne à la sonnerie.
sommaire
17 - Installation d’un poste mural Ochorowicz.
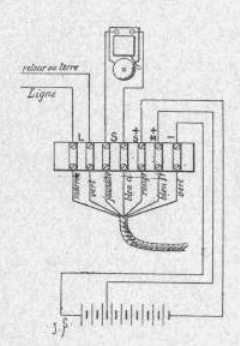



— Le transmetteur mural Ochorowicz, admis sur les réseaux
aériens seulement, est garni de six bornes réparties par
groupes de trois le long des pans coupés de l’applique murale;
à gauche, L, L T, T Z ; à droite, S, C M, C A.
On attache la ligne à la borne L, le fil de retour ou la terre
à la borne L T, le fil de terre de la sonnerie et le pôle
négatif de la pile à la borne T Z, le fil de sonnerie à
la borne S, le troisième charbon de la pile à la borne C
M, et le dernier charbon à la borne CA.
sommaire
18 - Installation d’un poste portatif Ochorowicz.

— Comme dans plusieurs des appareils dont nous avons précédemment
examiné le montage, le cordon souple à sept conducteurs
est relié à l’intérieur du transmetteur Ochorowicz,
sans qu’aucune borne apparaisse à l’extérieur.
Les fils de ce cordon sont : jaunâtre, marron, rouge brun, bleu
clair, bleu foncé; les deux derniers sont d’un vert de nuance
uniforme. A l’intérieur de l’appareil, ces fils ont les
connexions suivantes : le fil marron correspond au massif du levier-commutateur;
le fil bleu foncé au circuit primaire de la bobine d’induction;
le fil bleu clair au plot de repos du bouton d’appel; le fil rouge
brun au plot de travail de la clé d’appel; le fil jaunâtre
et les deux fils verts à une même vis en relation avec le
récepteur (du côté du crochet fixe) et avec le microphone.
MM. Chateau père et fils, constructeurs de ces appareils, n’ont
pas fait adopter par l’Administration des Postes et des Télégraphes
un modèle spécial de planchette de raccordement, il est
donc permis d’admettre qu’en utilisant une planchette à
quatorze bornes, du type de la Société des Téléphones,
l’installation aura lieu de la façon suivante.
A la première lame, on attachera le fil marron et la ligne, à
la seconde un des fds verts et le fil de retour ou la terre, à
la troisième le fil jaunâtre et le fil de retour de la sonnerie,
à la quatrième le fil bleu clair et le fil de sonneriè,
à la cinquième le fil rouge et le dernier charbon de la
pile (pile d’appel), à la sixième le fil bleu foncé
et le troisième charbon de la pile (pile de microphone), à
la septième, le second fil vert et le zinc commun aux deux piles.
Installation d’un appareil portatif Pasquet. — Cette installation
se fait à l’aide d’un cordon souple et d’une planchette
de raccordement. Le cordon souple est à 5 conducteurs et les 5
brins sont de couleurs différentes (rouge, blanc, vert, bleu, jaune).
La planchette de raccordement porte dix bornes communiquant deux à
deux. Les bornes de l’une des rangées sont marquées
CM, TZ, L, ZS, CS; elles reçoivent les fils venant de la pile,
de la ligne et de la sonnerie. Les bornes de l’autre rangée
sont marquées R, B, V, B, J, lettres qui indiquent la coloration
des fils à y adapter, et qui, d’ailleurs, sont peintes de
la même couleur que le fil :
R (rouge) communique avec C M.
B (blanc) » avec T Z.
V (vert) » avec L.
B (bleu) » avec Z S.
J (jaune) » âvec C S.
A l’intérieur de l’appareil, les fils sont reliés
de la manière suivante :
Le fil rouge avec le contact de fermeture du circuit primaire..
Le fd blanc avec la sortie des circuits primaire et secondaire.
Le fil vert avec l’axe du levier-commutateur.
Le fil bleu avec le plot de repos de la clé d’appel.
Le iil jaune avec le plot de travail de la clé d’appel.
sommaire
| 19 - Installation des appels électro-magnétiques. — Qu’il s’agisse du modèle de la Société de matériel téléphonique (plus tard LMT) ou de celui de la Société générale des Téléphones (SGT), l’installation est identiquement la même. Les figures 295, 296, 297 et 298 montrent cette installation appliquée à un poste Ader, Pour ne pas compliquer les dessins, nous avons éliminé les communications sans utilité pour le cas qui nous occupe. Dans les figures 295 et 297, on voit l’appel électro-magnétique au repos; dans les figures 296 et 298, il est supposé en marche. La borne 1 de l’appel magnétique est reliée à la borne de gauche du groupe P S du transmetteur, la borne de droite restant libre. La borne 2 est en relation avec la sonnerie communiquant d’autre part avec la borne S., du transmetteur; la borne 3 est réunie à la borne S2. Ce qui précède s’applique au modèle d’appel de la Société de matériel téléphonique. Dans les figures 297 et 298, nous reproduisons des croquis se rapportant au modèle de la Société générale des Téléphones. On voit que les connexions entre les appareils magnétiques et les transmetteurs sont absolument les mêmes ; il est d ailleurs facile de suivre la marche des courants à travers les circuits, le but à atteindre restant constant, savoir : 1° soustraire la sonnerie du poste de départ à l’action des courants distribués sur la ligne par ce poste; 2° offrir au courant venant de la ligne un parcours sans résistance, permettant d’éviter l’affaiblissement qui résulterait d’un passage dans la bobine de l’induit. Ce double but est atteint par le dispositif de l’appareil. , |
 |

sommaire
Postes centraux d'abonnés.
20 - Installation d’un tableau annonciateur à disque, grand
modèle, avec place pour appareil.
— Soit un tableau à trois directions pour lignes simples :
Ce tableau permet :
1° de communiquer avec tous les postes qui lui sont'reliés;
2° de faire communiquer entre eux ces différents postes.
Il comprend :
1° Autant d’annonciateurs qu’il y a de lignes.
2° Autant de conjoncteurs à simple fil qu’il y a de lignes;
3° Deux conjoncteurs repos de fiche et un cordon souple à deux
fiches ou bien un seul repos de fiche et un cordon souple à une
fiche (fig. 299) ;
4° Un nombre suffisant de cordons souples à deux fiches pour
établir la liaison entre les lignes (ce nombre dépend du
nombre des lignes à relier et, par conséquent, du nombre
des. conjoncteurs du tableau);
5° Un crochet de suspension pour ces cordons;
6° Un transmetteur Ader avec ses récepteurs.
L’installation du poste est complétée par une sonnerie
et un nombre de boîtes à piles qui dépend de la longueur
des lignes.
Communications d’un tableau annonciateur à disque, grand
modèle, avec place pour appareil
| La figure ci dessous montre
dans quel ordre les différents conducteurs sont rattachés
au tableau. La pile de microphone est intercalée entre les bornes Z et C M, la pile locale du tableau entre les bornes Z et CS, et enfin la pile totale destinée aux appels de bureaux entre les bornes Z et C. 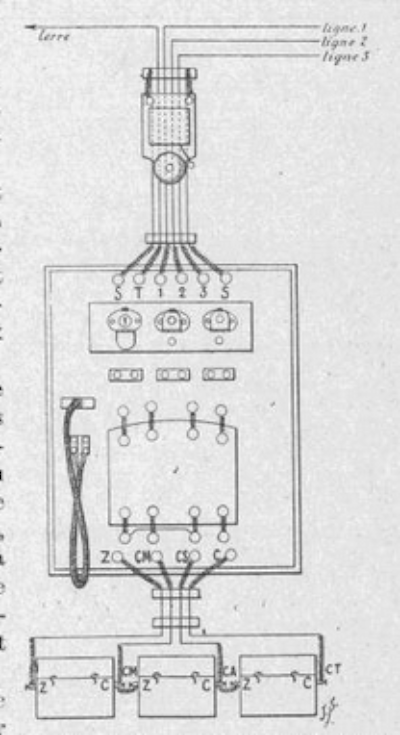 |
Au repos, les fiches de l’un des
cordons à deux fiches sont engagées dans les cononcteurs
repos de fiche, ou bien, si le tableau comporte un cordon rouge à
une fiche, comme dans la figure , la fiche de ce cordon est placée
dans le repos de fiche unique. Les autres cordons sont suspendus au
crochet. Un poste appelle le poste central, le poste n° 1 par exemple : le volet de l’annonciateur n° 1 tombe. L’opérateur du poste central relève le volet, retire une des fiches du repos de fiche (ou bien la fiche unique du cordon rouge) et l’introduit dans le conjoncteur n° 1 ; cette fiche est placée dans le trou de droite si le conjoncteur est horizontal, dans le trou inférieur si le con-joncteur est vertical. L’opérateur appuie ensuite sur la clé d’appel du transmetteur, décroche les récepteurs et peut entamer la conversation avec le poste n° 1. La conversation terminée, il raccroche les téléphones, retire la fiche du conjoncteur n° 1 et la replace dans le repos de fiche. Réciproquement, si le poste central veut appeler un des postes auxquels il est relié, il retire une üche du repos de fiche, la place dans le trou de droite ou dans le trou inférieur du conjoncteur correspondant à la ligne qui dessert le poste à appeler et presse sur la clé d’appel. Dès que le bruit de la sonnerie a annoncé la réponse du correspondant, il décroche les récepteurs et parle. A la fin de la conversation, les choses sont remises en l’état comme précédemment. La mise en communication de deux postes est provoquée par l’appel de l’un d’eux, la première partie de l’opération rentre donc dans le cas que nous avons examiné lorsqu’un poste appelle le poste central, soit le poste n° 2. Le poste central ayant répondu à l’appel du poste n° 2, et s’étant mis en relation avec lui, reçoit sa demande de communication, avec le poste n° 3 par exemple. Le poste central retire la fiche qu’il a engagée dans le conjoncteur n° 2 pour parler à l’abonné n° 2, et la place dans le conjoncteur n° 3; il appelle ce dernier poste et lui dit : communiquez avec n° 2. L’opération de liaison entre les deux postes dépend de la forme du tableau. 1° Le tableau a deux repos de fiche. L’une des fiches est déjà engagée dans le trou de droite ou dans le trou inférieur du conjoncteur n° 3; on retire du repos de fiche la fiche restée libre et on la place dans le trou de gauche ou dans le trou supérieur du conjoncteur n° 2. 2° Le tableau n’a qu’un seul repos de fiche et un cordon rouge à une fiche qui se trouve engagée dans le conjoncteur n° 3. L’opérateur retire cette fiche, prend au crochet un cordon vert à deux fiches, introduit l’une dans le trou de droite ou inférieur du conjoncteur n° 3, et l’autre dans le trou de gauche ou supérieur du conjoncteur n° 2. La communication est établie de la sorte, et l’annonciateur n° 2 reste en dérivation dans le circuit. La conversation terminée, les récepteurs sont remis aux crochets dans les deux postes, et le poste qui a demandé la communication presse sur la clé d’appel de son appareils Cette manœuvre a pour effet de faire tomber le volet de l’annonciateur correspondant du poste central. L’opérateur de ce poste relève l’annonciateur, retire les fiches des conjoncteurs et rétablit les choses dans leur état primitif. |
L’installation d’un tableau pour ligne double
a lieu de la même manière, seulement, au lieu d’une
seule borne pour chaque ligne, le tableau en comporte deux, auxquelles
on attache les deux conducteurs. Ces bornes sont numérotées
par paire, 1, 2, 3... en allant de gauche à droite.
L’installation des tableaux pourvus de commutateurs IOC n’est
pas différente, seulement, ici, la manœuvre du commutateur
permet au poste central de placer la sonnerie hors circuit, de la rendre
intermittente, c’est-à-dire de ne la mettre en marche que
lorsque l’armature de l’annonciateur est attirée, ou
bien d’obtenir un tintement continu tant que le volet de l’annonciateur
n’est pas relevé.
Dans le premier cas, la manette du commutateur est placée sur le
plot O, dans le second sur le plot I, dans le troisième sur le
plot C.
sommaire
21 Installation d’un tableau â annonciateurs à, disque,
grand modèle sans place pour appareil.
— Ces appareils destinés à être reliés
à un transmetteur Ader n° 4 ou à un Berthom-Ader n°
10.
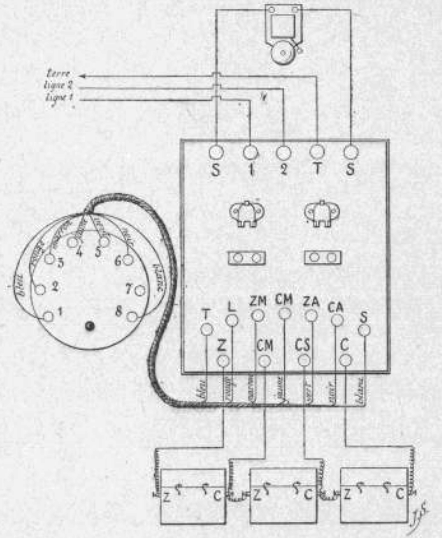 |
Ils comprennent : |
sommaire
22 - Installation d’un tableau à annonciateurs à disque,
petit modèle (système Bailleux).
 |
— Ces tableaux, qu’ils aient
une place pour l’appareil ou qu’ils n’en aient pas,
ne diffèrent pas sensiblement dans leur installation des tableaux
que nous connaissons déjà. Ils sont généralement destinés, lorsque la place est réservée pour l’appareil, à recevoir un Ader n° 3 ou bien un Berthon-Ader n° 8; lorsqu’il n’existe pas de place pour l’appareil, on peut les rattacher à un appareil portatif. Le nombre des annonciateurs et celui de conjoncteurs est égal à celui des lignes, mais ces conjoncteurs sont à un seul trou. Un cordon rouge à une üche, un repos de fiche, un crochet de suspension et des cordons à 2 fiches indépendants complètent le tableau. Ces cordons sont garnis d’une fiche longue et d’une fiche courte. Les appels et les réponses de poste à poste ont lieu comme nous l’avons indiqué pour les tableaux précédents; quant aux intercommunications, elles ont lieu par les fiches longues et courtes. La fiche longue met hors circuit l’annonciateur du conjoncteur dans lequel elle est engagée; la fiche courte laisse dans le circuit l’annonciateur; c’est donc celui-ci qui fait l’office d’annonciateur de fin de conversation. |
23 - Installation des postes pour l’appel direct.
— Ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire en décrivant
les appareils d’appel (système Bailleux), et de liaison, certains
abonnés
possèdent deux établissements entre lesquels s’échange
la plus grande partie de leur correspondance.
Il y a intérêt à ce que les postes installés
dans ces établissements restent normalement en communication, mais
il faut aussi que chacun d’eux puisse correspondre avec les abonnés
du réseau.
Les postes ainsi organisés sont réunis au bureau central
et pourvus d’appareils d’appel direct. Ils peuvent, de la sorte,
communiquer entre eux sans déranger le bureau central, mais aussi
appeler celui-ci lorsqu’ils désirent être reliés
à un abonné du réseau.
Les deux postes sont purement et simplement reliés au bureau central
dans les conditions ordinaires mais, à ce bureau, un cordon à
deux fiches réunit les deux conjoncteurs de ligne tout en laissant
un des annonciateurs en dérivation dans le circuit; dans chacun
des postes extrêmes, on place deux clés d’appel (l’une
pour l’appel du bureau central, l’autre pour l’appel direct
du poste extrême opposé), un relais à double enroulement
et une sonnerie actionnée par celui-ci.
Il est à remarquer, en effet, que, dans le cas de l’appel
direct, la distance est souvent presque doublée.
Les appareils dont nous venons de parler sont, généralement,
réunis sur une même planchette (sauf la sonnerie) qui porte
aussi le transmetteur et les récepteurs ; il existe cependant un
modèle dans lequel le transmetteur est indépendant.
Nous avons déjà figuré et décrit ce dernier
appareil et, pour ne pas compliquer, nous ne représenterons ici
que ses organes essentiels : les clés d’appel et les relais
.

Au poste central, les lignes 1 et 2 aboutissent respectivement aux conjoncteurs
J,,, J2; elles sont reliées entre elles par un cordon souple à
deux fiches engagées dans les deux conjoncteurs, de telle sorte
que l’un des annonciateurs, A2, par exemple, reste en dérivation
dans le circuit. Normalement, les postes 1 et 2 sont en communication
directe, au poste central, par l’intermédiaire de ce cordon
souple.
Les clés d’appel direct, placées au-dessous des conjoncteurs
J, et J2, servent à appeler les postes 4 ou 2 lorsqu’un autre
poste, desservi par le bureau central, désire communiquer avec
l’un d’eux. L’emploi de ces clés est nécessité
par la présence du relais à double enroulement dans les
postes 1 et 2.
Dans chacun de ces postes, l’installation du transmetteur et du,
récepteur ne présente rien de particulier. Les fils partant
des bornes S du transmetteur aboutissent aux circuits du relais à
double enroulement (R,, ou R2) en relation avec la terre d’autre
part. On voit aisément sur la figure comment ce relais ferme le
circuit de la sonnerie lorsque son armature est attirée. Les bornes
L du transmetteur sont reliées aux plots de repos de la clé
d’appel de bureau ; les massifs de cette clé communiquent
avec les plots de repos de la clé d’appel direct. Celle-ci
est montée à trois ressorts : les deux supérieurs
sont en relation avec la ligne, et, par là, avec leurs homologues
du bureau central; le ressort inférieur est à la terre.
Les plots de travail sont réunis aux pôles de la pile.
On se rappelle que, dans la clé d’appel direct, les trois
leviers, simultanément abaissés, établissent les
communications suivantes : le levier supérieur communique électriquement
avec le levier du milieu et avec un des pôles de la pile mis ainsi
en relation avec les deux fils de ligne ; le ressort inférieur
prend contact avec le second pôle de la pile et le met à
la terre, mais ce ressort est isolé des deux autres.
Dans la clé d’appel de bureau, les deux ressorts sont isolés
Fun de l’autre, et chacun d’eux puise à l’un des
pôles de la pile. Il est facile maintenant de voir ce qui se passera
dans les différents cas qui peuvent se présenter.
A. — Le poste 1 appelle le poste 2 ou réciproquement.
— Le poste 1 appuie sur la clé d’appel direct : le pôle
négatif de la pile est mis à la terre ; le flux d’électricité
provenant du pôle positif forme, en quelque sorte, deux courants
égaux et de même sens qui traversent la clé d’appel
direct du bureau central, le conjoncteur J,, le cordon souple, le conjoncteur
J2, la ligne 2, la seconde clé d’appel direct du bureau central,
les deux clés et le transmetteur du poste 2, le relais R2. Là,
ces deux courants parcourent les deux circuits du relais dans le même
sens; l’armature est attirée, la sonnerie fonctionne. En traversant
le conjoncteur J2, les deux courants dont nous suivons la marche ont rencontré
la dérivation formée par l'annonciateur A2 ; en traversant
cette dérivation, ils ont parcouru les bobines de l’annonciateur
en sens contraire et sont restés sans action sur lui.
Le poste 1 a donc appelé le poste 2 sans déranger le bureau
central; il en aurait été de même si le poste 2 eût
appelé le poste I.
B. — Le poste 1 (ou le poste 2) appelle le bureau central.
— Le poste 1 appuie sur la clé d’appel de bureau : les
deux pôles de la pile spnt mis en relation avec les deux fils de
ligne. Le circuit est le même que précédemment, à
cette différence près que le courant traverse la clé
d’appel direct du bureau d’appel; mais l’annonciateur A2,
dont les bobines sont parcourues par un courant unique, est actionné,
tandis que le relais R2 du poste 2, dont les deux circuits sont traversés
en sens inverse par le même courant, reste inerte.
Donc, le poste central est appelé sans que le poste n° 2 soit
dérangé.
C. — Le poste central appelle les postes 1 ou 2. — La
communication étant rompue entre les conjoncteurs J, et J2, l’appel
se fait dans les conditions ordinaires, seulement il est nécessaire
de faire usage d’une clé d’appel direct pour actionner
le relais à double enroulement du poste appelé.
La figure ci dessous montre une combinaison plus complète d’un
poste à appel direct; c’est un tableau à deux directions,
dont une des lignes est montée pour l’appel direct, l’autre
pour l’appel ordinaire.
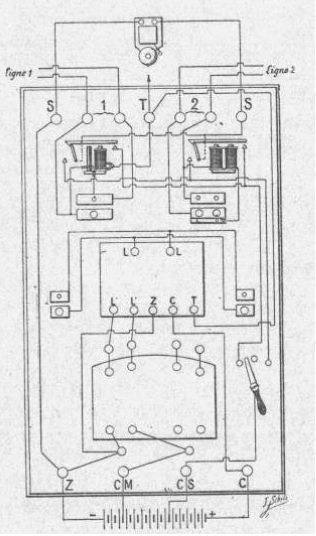 Installation d’un poste à deux directions, avec appel direct et appel ordinaire. |
Le commutateur I O C permet en outre
de recevoir les appels, soit dans une sonnerie ne fonctionnant que
lorsque l’armature de l’annonciateur est attirée,
ne fonctionnant en aucun cas, ou bien marchant d’une façon
continue tant que le volet de l’annonciateur n’est pas relevé. L’annonciateur de gauche est constitué par un électro-aimant boiteux, à double enroulement, dont chacun des circuits a une résistance de 200 ohms. L’annonciateur de droite a deux bobines de 100 ohms chacune; c’est l’annonciateur ordinaire. Le conjoncteur de gauche est à un seul trou; il sert à relier la ligne 1 avec le poste; cette jonction se fait à l’aide d’un cordon souple à deux fiches, l’une est introduite dans ce eonjoncteur, l’autre dans le conjoncteur carré, également situé à gauche et à un seul trou. Le conjoncteur long de droite est à deux trous et permet, par conséquent, de laisser l’annonciateur correspondant en dérivation dans le circuit. Ce conjoncteur sert avec le conjoncteur carré placé au-dessous à relier au poste la ligne 2. Les deux conjoncteurs carrés sont réunis ensemble et aussi aux bornes L de la boîte rectangulaire qui contient une clé d’appel direct et une clé d’appel de bureau. Le commutateur IO C donne l’appel intermittent de sonnerie, pas d’appel de sonnerie ou l’appel continu suivant que la manette est placée sur l’un ou l’autre des trois plots. Les bornes ligne du transmetteur sont réunies aux bornes L’ L' de la boite à clés; les bornes sonnerie restent libres ainsi que les bornes de la pile d’appel, tandis que les bornes de la pile microphonique sont réunies, comme à l’ordinaire, aux trois éléments de cette pile. Si nous considérons maintenant les bornes du tableau, nous voyons que les connexions de ces bornes sont les suivantes : S de gauche avec Z du tableau et avec Z de la boîte à clés ; 1 avec le eonjoncteur long de gauche ; T avec le double circuit de l’annonciateur de gauche, et avec T de la boîte à clés ; 2 avec le eonjoncteur long de droite; S de droite avec les masses des deux annonciateurs ; C M avec C M du transmetteur; C S avec l’axe de la manette du commutateur IO C. C avec C de la boîte à clés. |
A l’extérieur, les bornes S S sont reliées à la sonnerie ; les bornes 4, 2 au double fil des deux lignes, la borne T à la terre. La pile est montée comme dans les installations ordinaires, seulement le nombre des éléments est gradué suivant les distances à franchir, c’est-à-dire que le 1er zinc est réuni à la borne Z, le 3e charbon à la borne C M, le 6e ou le 9e charbon à la borne C S, le dernier charbon à la borne C. Il en résulte que trois éléments sont compris entre les bornes Z et C M, six ou neuf entre les bornes Z et C S, la pile totale entre les bornes Z et C.
sommaire
24 - Installation d’un poste avec sonnerie à, double enroulement.
— L’emploi des sonneries à double enroulement n’est
plus admis pour les nouveaux abonnés, mais comme il en existe encore
un certain nombre sur les anciens réseaux à double fil,
et notamment sur le réseau de Paris, nous ne pouvons nous dispenser
de dire quelques mots sur ce mode d’installation.
La manœuvre de la clé d’appel ordinaire a pour effet
de mettre chacun des fils de la ligne en relation avec un des pôles
de la pile, le circuit de celle-ci étant fermé par les bobines
de la sonnerie du poste appelé. Il en résulte que le circuit
total comprend la résistance de la pile d’appel, celle de
la sonnerie mise en marche et celle des deux fils de ligne qui s’ajoutent.
Ce mode d’appel n’a pas d’inconvénient lorsque la
ligne est courte, mais lorsque la distance à franchir est considérable,
la résistance additionnée des deux fils de ligne devient
très importante. On a songé à la réduire au
moyen d’un artifice : En faisant usage de la clé d'appel direct,
on réunit en quelque sorte les deux fils de ligne et on les met
en rapport avec l’un des pôles d’une pile dont l’autre
est à la terre; la résistance totale de la double ligne
se trouve de la sorte réduite au quart de ce qu’elle était
lorsque les fils se trouvaient, pour ainsi dire, bout à bout dans
le circuit.
A la station d’arrivée, les bobines de la sonnerie sont composées
de deux conducteurs enroulés côte à côte et
dont chacun a une résistance de 200 ohms. Ces deux conducteurs,
à l’entrée des bobines, correspondent chacun à
un des fils de ligne; à la sortie, ils sont réunis sur un
fil de terre commun.
Cette disposition permet de ne pas augmenter le nombre des éléments
de la pile d’appel en proportion de la distance à parcourir.
Si nous nous reportons à la figure 78 du circuit de sonnerie du
transmetteur Ader n° 1, nous voyons que l’emploi des paillettes
f, f est justifié par l’usage de la sonnerie à double
enroulement. Le levier-commutateur, abaissé par le poids du transmetteur
suspendu au crochet, réunit les ressorts f, f et par conséquent
la borne L2 à la borne S2. Il eût été plus
simple de relier ces deux bornes directement, et c’est ce qui existait
dans les anciens appareils, mais alors, même lorsque le circuit
de conversation était fermé, la ligne L2 se trouvait à
la terre par les bobines de la sonnerie à double enroulement, et
cet inconvénient prenait un caractère exceptionnel de gravité
s’il existait une autre perte sur la ligne qui devenait alors comparable
à une ligne à simple fil et sujette aux mêmes causes
de perturbation provenant de l’induction des fils voisins.
25 - Installation des postes avec le rappel par inversion
de courant.
— Ce dispositif est employé pour éviter des demandes
de communication, lorsque trois postes, deux extrêmes, un intermédiaire,
sont installés sur une même ligne.
Le problème consiste en ceci : l’un des postes doit pouvoir
appeler chacun des deux autres sans déranger celui auquel il n’a
pas affaire; le poste appelé doit pouvoir répondre dans
les mêmes conditions.
Dans chaque poste extrême, on pose un rappel par inversion de courant,
un commutateur inverseur et l’appareil téléphonique
ordinaire.
Au poste intermédiaire, on place un rappel par inversion de courant,
deux conjoncteurs jack-knives et deux conjoncteurs repos de fiche, ou
bien un cordon à une fiche fixée à demeure d’un
côté.
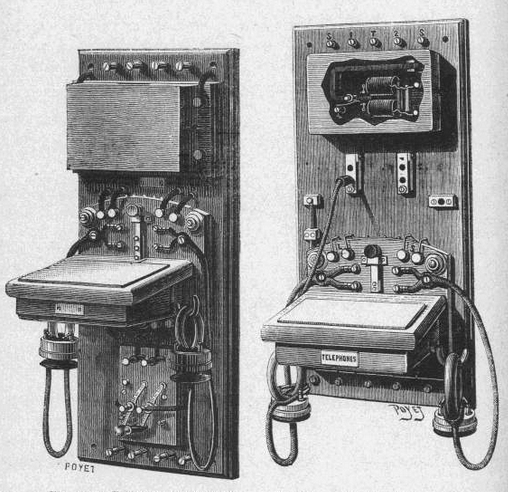
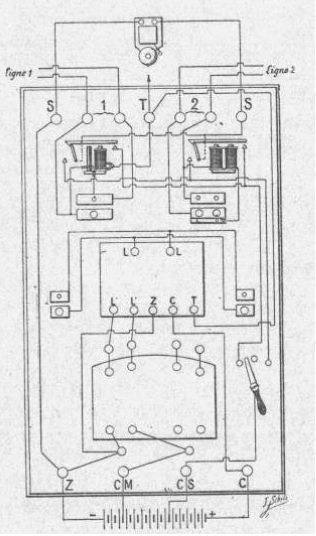
— 1 Tableau Ader N°1 ou 2 avec rappel — 2 Tableau avec
rappel par inversion de courant et commutateur inversion de courant (poste
intermédiaire), inverseur (poste extrême).
On montre ci dessus le modèle de tableau construit par la Société
générale des téléphones pour les postes extrêmes
; on voit, sur le schéma, le type destiné aux postes intermédiaires.

Supposons, pour simplifier, qu’il s’agisse d’une ligne
à simple fil : soient A, B, C, les trois postes installés
sur la ligne unique (figure ci dessus).
Dans les postes extrêmes A, C, le tableau porte quatre bornes en
haut et quatre en bas. Les bornes de sonnerie qui sont les bornes extrêmes
du haut sont reliées aux deux bornes de la sonnerie, en faisant
usage d’un ou de plusieurs isolateurs en bois, s’il y a lieu.
Les bornes intermédiaires sont affectées : celle de gauche
à la ligne, celle de droite à la terre. En bas, la première
borne de gauche reçoit le premier zinc de la pile, la deuxième
borne reçoit le troisième charbon; c’est la pile microphonique;
la troisième borne est reliée au sixième charbon;
c’est cette pile de 6 éléments, comprise entre la première
et la troisième borne, qui forme la pile locale agissant sur le
rappel par inversion de courant et sur la sonnerie. La quatrième
borne reçoit le dernier charbon. La pile totale, dont le nombre
d’éléments est proportionné à la longueur
et à la résistance de la ligne, est affectée à
l’appel des postes voisins.
L’installation du poste intermédiaire B ne diffère
de celle des postes extrêmes que par la présence de cinq
bornes à la partie supérieure du tableau. Les bornes extérieures
reçoivent les fils de sonnerie; la borne du milieu, le fil de terre
et les bornes intermédiaires, les conducteurs se dirigeant vers
A et vers C.
Les postes montés de la sorte sont habituellement pourvus de paratonnerres
installés dans les conditions ordinaires.
Les postes extrêmes A, C sont appelés avec un courant positif,
le poste intermédiaire B avec un courant négatif.
Lorsque A veut appeler B, il place son commutateur inverseur dans la position
indiquée par la figure ci dessus, c’est-à-dire le bouton
de la manette dirigé vers la gauche, c’est d’ailleurs
la position de repos du commutateur; il presse sur le bouton d’appel,
et un courant négatif est envoyé sur la ligne; ce courant
actionne le rappel de B et reste sans effet sur celui de C. Dès
que la réponse est parvenue, A décroche ses récepteurs
et parle comme dans un poste ordinaire.
Lorsque A veut appeler C, il tourne le bouton de la manette 4e son commutateur
vers la droite et opère comme précédentment. Le courant
positif envoyé sur la ligne reste sans action sur le rappel de
B, mais fait fonctionner celui de C.
Reste à examiner comment B appelle A et C ou leur répond
en temps normal, les fiches du cordon souple de B sont engagées
dans les repos de fiche. Pour appeler A, B dégage la fiche de droite
et la place dansale conjoncteur de gauche, tout en laissant en place la
fiche det'gauche; il presse alors sur le bouton d’appel.
Pour appeler C, B dégage la fiche de gauche et la place dans le
conjoncteur de droite, tout en laissant en place la fiche de droite; il
presse alors sur le bouton d’appel.
Il est à remarquer que chacun des postes reçoit indistinctement
les appels des deux autres, sans savoir d’où ils lui viennent;
pour éviter toute confusion, il a fallu établir une convention
de sonnerie qui est la suivante :
A appelle B par un contact prolongé; B répond de même.
A appelle C par un contact prolongé suivi d’un contact bref;
C répond de même.
C appelle B par un contact bref suivi d’un contact prolongé;
B répond de même.
On peut cependant éviter la convention de sonnerie, mais pour retomber
dans un autre inconvénient. Si en effet, le poste intermédiaire
est pourvu de conjoncteurs à deux trous, il lui suffit de placer
sa fiche dans le trou supérieur, mais tout en s’entretenant
avec le poste qui a appelé, il laisse en dérivation le troisième
poste qui peut surprendre la conversation.
Dans certains tableaux, il n’existe qu’un seul repos de fiche
au poste intermédiaire B; le cordon souple est alors à une
seule fiche et son extrémité libre est fixée à
un plot en communication avec la borne ligne du transmetteur.
Pour répondre aux appels de A ou de C, B place alors sa fiche unique
dans le conjoncteur de gauche ou dans celui de droite.
Tableau téléphonique DE
LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES TÉLÉPHONES
La multiplicité des tableaux construits par la Société
industrielle des Téléphones ne nous permet pas de les décrire
tous en détail ; nous en ferons connaître les organes en
insistant sur les types les plus répandus.

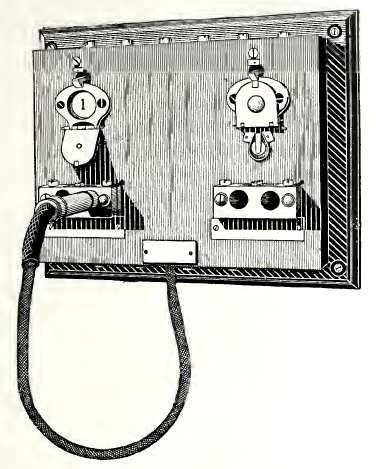
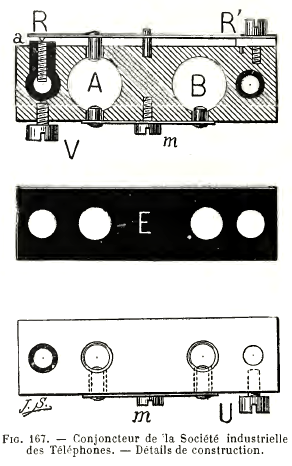
Fig. 169. — Tableau à cinq directions
de la Société industrielle des Téléphones.
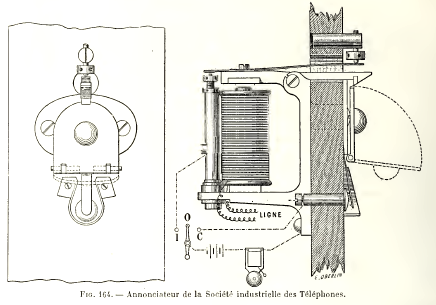
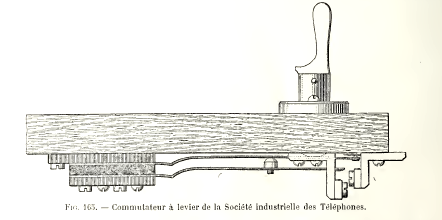


Fiche. — La fiche, représentée par la figure
168, comporte une pointe et un corps isolés l’un de l’autre.
Le cordon souple à deux conducteurs, recouvert d’une tresse
de soie,
Annonciateurs. — La Société utilise dans le
montage de ses tableaux trois types d’annon¬ ciateurs. Dans le
premier (type A, fig. 164), l’électro-aimant est à
deux bobines verticales dont la résistance totale est de 200 ohms.
Dans le second (type B), il n’existe qu’une seule bobine horizontale
de 100 ohms; le levier qui porte l’armature est coudé et ramené
au repos par son propre poids. Dans le type C, la bobine unique est horizontale
et de 200 ohms.
Commutateurs a leviers. — Ce sont deux ressorts, isolés
l’un de l’autre, se déplaçant simultanément
sous l’action d’un levier qui, lorsqu'on l’abaisse, chasse
un piston qui commande les ressorts. Seul, le ressort le plus long s’appuie
sur un contact de repos; les contacts de travail sont représentés
par deux barrettes qui courent le long du tableau, en regard des extrémités
libres des deux ressorts, et qui communiquent avec le transmetteur. Il
existe autant de leviers que d’annonciateurs. On peut exceptionnellement
mettre deux lignes en communication en abaissant les deux leviers correspondants;
mais le poste qui donne la communication reste en dérivation.
Certains tableaux sont montés avec des annonciateurs polarisés
; il en existe quatre types.
Type A : C’est un aimant en fer à cheval, entre les
pôles duquel oscille une pièce de fer doux fixée à
l’extrémité du noyau d’une bobine d’électro-aimant.
Cette bobine est montée sur un des bras d'un levier coudé
pouvant pivoter autour d’un axe fixe et dont l’autre bras, terminé
en crochet, retient le volet. Suivant le sens du courant qui traverse
la bobine, l’adhérence entre le crochet et le volet est augmentée,
ou bien le volet est déclenché.
Type B : Il comprend deux bobines montées sur l’un
des pôles d’un aimant recourbé à angle droit.
Le second pôle supporte une armature maintenue à égale
distance de deux pièces polaires placées sur les noyaux
des bobines. Le crochet qui termine l’armature soutient un volet.
Lorsque l’équilibre est rompu par le passage du courant, l’armature
est sollicitée vers le haut ou vers le bas, suivant le sens de
ce courant: c’est dans le second cas que le volet tombe.
Type D : L’aimant est recourbé deux fois à angle
droit; c’est une variante du type B.
Type L : Dans ce modèle, le noyau de la bobine constitue
l’un des pôles d’un aimant recourbé à angle
droit. Le volet est fixé à une pièce de fer doux
articulée sur l’autre pôle ; il n’est retenu que
par le noyau de la bobine aimanté par contact; le sens du courant,
traversant la bobine, peut donc ou bien augmenter l’adhérence
ou bien la diminuer et alors le volet tombe.
Revenons à l’annonciateur ordinaire du type A (fig. 164);
avec ce modèle, on fait généralement usage d’un
commutateur que l'on désigne par le nom de I O C, et qui permet
de mettre une sonnerie en circuit par intermittence, de la supprimer ou
de là rendre con tinue.
Chaque suppor d’annonciateur est relié au support voisin par
un fil isolé.
Les bornes I sont montées sur le support, mais isolées de
lui par un manchon d’ivoire ; on les relie ensemble par un fil de
cuivre nu pincé sous une vis que porte chaque colonne.
Les bornes C sont montées dans l’ébénisterie
et réunies entre elles par un fil isole. des Téléphones.
— Détails de construction.
Le volet, en tombant, s’appuie sur la borne C.
La course et la sensibilité de l’armature sont réglées
par des vis, dont l’une surmonte la colonne à laquelle est
relié le plot I, et dont l'autre est fixée à l’ébénisterie,
au-dessus du crochet.
Avec les différents annonciateurs dont nous venons de parler, on
emploie des commutateurs à levier ou des jacks-knives.
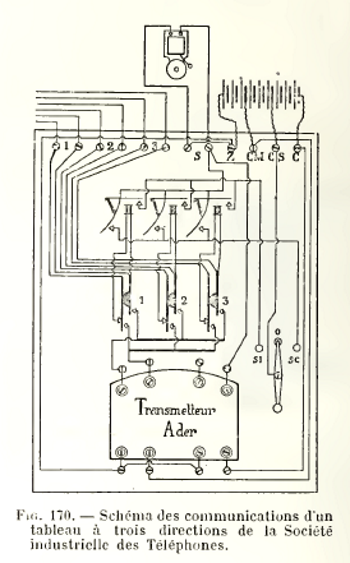

Fig. 170. — Schéma des communications d'un tableau à
trois directions de la Société industrielle des Téléphones.
Conjoncteur jack-knive. — On les établit pour lignes
simples et pour lignes doubles. Les conjoncteurs pour lignes doubles se
composent de deux plaques de laiton superposées et séparées
par une lame d'ébonite, le tout percé de deux trous, les
trous de la plaque inférieure étant plus petits que ceux
de la plaque supérieure. Les figures 166 et 167 représentent
cette disposition.
Dans la figure 167, m est un ressort de sûreté qui assure
un bon contact avec une fiche que l’on introduit dans le jack. RR'
est un ressort de coupure qui s’appuie sur une goupille a, en relation
avec l’annonciateur. Au repos, le ressort RR réunit donc l’annonciateur
au conjoncteur. Ce ressort RR' porte un goujon qui pénètre
dans le trou A. Les deux fils de ligne sont attachés, l’un
en V, l'autre en U.
Lorsqu’une fiche est introduite dans le trou B, l’annonciateur
resle en dérivation. Si, au contraire, on la place dans le trou
A, elle chasse le goujon, soulève le ressort RR' qui abandonne
la goupille a et l’annonciateur est coupé.
traverse le lube qui forme le corps de la fiche ; les conducteurs sont
divisés à l’intérieur; l’un est fixé
au lube, l’autre à la douille qui forme la pointe.
Communications intérieures. —La figure 169 montre un
tableau à leviers à cinq directions
avec place pour le transmetteur; la figure 170 représente les communications
du même tableau, mais pour trois directions seulement.
La figure 171 est la vue d’un tableau jack-knive à deux directions
pour ligne simple; la figure 172 montre les communications d’un tableau
analogue à trois directions pour lignes doubles.
sommaire
26 - Installation d’un poste central d’abonné avec un
appareil Paul Bert-d’Arsonval ou tout autre appareil ayant les bornes
semblablement placées et un tableau Sieur (ligne à simple
fil).


Installation d’un poste central d’abonné avec un appareil
Paul Bert-d’Arsonval et un tableau Sieur.
— La figure représente l’installation d’un poste
central correspondant avec cinq lignes à simple fil.
En haut, on voit la sonnerie, puis le tableau annonciateur avec ses cordons
et ses clés de jonction; plus bas se trouve le transmetteur garni
de deux récepteurs qui n’ont pas été figurés;
enfin on aperçoit en dessous la pile divisée en deux groupes
et formée d’éléments de Lalande et Chaperon
à fermeture hermétique. Notre dessin montre, sans qu’il
soit besoin d’insister davantage, comment les communications sont
établies; ce qu’il importe de connaître, ce sont les
manœuvres à exécuter :
1° Pour qu’une conversation puisse s’échanger entre
le bureau central et un quelconque de ses cinq correspondants et réciproquement;
2° Pour que deux quelconques des postes reliés au bureau central
puissent correspondre directement entre eux, le bureau central étant
avisé du moment où la conversation est terminée et,
par conséquent, du moment où il peut couper la communication.
Ces manoeuvres sont très simples :
Le poste n° 2, par exemple, appelle ; le volet de l’annonciateur
n° 2 du poste central tombe et, en même temps, la sonnerie se
fait entendre.
La personne chargée de desservir le poste central introduit la
clé, reliée à ce tableau et placée au crochet
de repos, sous le crochet de gauche du conjoncteur n° 2; elle relève
le volet de l’annonciateur pour faire cesser le tintement de la sonnerie,
presse sur le bouton d’appel du transmetteur, décroche les
téléphones et les porte aux oreilles en maintenant la bouche
à proximité de la planchette du microphone; la conversation
peut alors commencer. Dès quelle est terminée, les téléphones
sont accrochés et la clé, retirée du conjoncteur
n° 2, est replacée à son cran de repos.
Si le poste central désire communiquer avec un des postes du réseau,
le n° 1 par exemple, il place la clé du tableau sous le crochet
de gauche du conjoncteur n° 1, presse sur le bouton d’appel du
transmetteur et attend que sa sonnerie indique la réponse du correspondant;
il ne s’agit plus alors pour entrer en relation que de décrocher
les récepteurs, de les porter aux oreilles et de parler devant
le microphone.
S’agit-il de mettre en relation deux quelconques des postes du réseau
?
Le poste n° 2 appelle, le volet de l’annonciateur n° 2 tombe;
le poste central répond comme nous l’avons vu précédemment
et se met en relation avec le poste n® 2 ; celui-ci demande la communication
directe avec le poste n° 4.
Le poste central aura à appeler le poste n° 4 et à établir
la liaison. Des cordons souples portant une clé à chaque
extrémité servent à cet usage; on en voit un suspendu
au crochet de repos sur la gauche de la figure.
Dès que le poste central a reçu l’appel du poste n°
2, il retire sa clé du crochet, suspend ses téléphones,
et engage sous le crochet de droite du conjoncteur n° 2 une des clés
du cordon souple à deux clés; reprenant ensuite le cordon
souple du tableau, il en introduit la clé sous le crochet de gauche
du conjoncteur n8 4, presse sur le bouton d’appel et invite le n°
4 à répondre au poste n° 2. Ceci fait, il retire la
clé du tableau et lui substitue la clé restée libre
du cordon à double clé; la communication directe est établie
entre les postes2 et 4.
Pour que le poste central soit averti que la conversation est terminée
et qu’il doit couper la communication, il faut qu’il puisse
recevoir un signal d’appel de l’un des deux postes reliés
directement. C’est généralement au poste appelant qu’incombe
cette mission; c’est lui qui a provoqué la communication,
c’est lui qui doit la faire rompre. En plaçant la première
clé du cordon souple à double clé sous le crochet
de droite du con-joncteur n° 2, on a laissé l’annonciateur
n° 2 en dérivation dans le circuit; le volet de cet annonciateur
en tombant annonce que la communication peut être coupée.
Si les deux clés du cordon avaient été placées
sous les crochets de gauche des annonciateurs 2 et 4, le poste central
n’aurait pu être prévenu, les deux annonciateurs se
trouvant hors circuit.
Si les deux clés avaient été placées sous
les crochets de droite, les deux annonciateurs se seraient trouvés
dans le circuit, précaution inutile et nuisible, puisque la résistance
de l’un d’eux aurait été introduite en pure perte
et au détriment de la netteté de la parole.
Un seul annonciateur suffit, et c’est pour cela qu’on place
une des clés sous le crochet de droite, l’autre sous le crochet
de gauche. On peut d’ailleurs, sans inconvénient, inverser
la disposition que nous avons admise et engager les clés sous le
crochet de gauche de l’annonciatenr n° 2 et sous le crochet de
droite de l’annonciateur n° 4.
Nous avons choisi pour exemple un poste à simple fil; c’est
le cas le plus général des réseaux de province.
Le montage des tableaux à double fil se déduit aisément
de celui des tableaux à simple fil. Chaque ligne aboutit à
deux bornes, l’une pour le fil d’aller, l’autre pour le
fil de retour. En outre, les conjoncteurs sont à trois crochets,
comme celui que nous avbns représenté . Les cordons souples
sont à double conducteur et, par suite, les clés sont à
deux contacts.
Les manœuvres sont, d’ailleurs, absolument les mêmes que
s’il s’agissait d’un tableau à simple fil.
sommaire
Tableau commutateur, de Sieur (1882).
— Chacune des lignes aboutit à un conjoncteur, constitué
par trois crochets, C, C' et G" montés sur une planchette,
P, à l’aide d’un ressort, B, fixé par une vis,
V. Les crochets peuvent ainsi être écartés du bloc
métallique qui les supporte, jusqu’à une limite assignée
par la vis, A. A l’état de repos, le crochet de gauche, C,
s’appuie, par sa vis, A, sur une butée, B, reliée à
l’annonciateur; il est en relation avec le fil de ligne n° 1,
de meme que le troisième; la ligne n° 2 est amenée au
crochet du milieu.


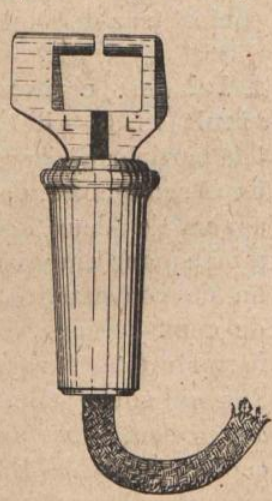
Les annonciateurs se composent chacun d’une bobine d’électro-aimant,
E, dont le noyau est prolongé, de part et d’autre, par des
pièces polaires, P; au-dessus de ces plaques se trouve l’armature,
A, taillée^en fourche; elle porte, du côté de l’avant,
un appendice, C, terminé en bec, et qui soutient le volet, D. Lorsqu’un
courant parcourt la bobine, le bec se dérobe et Je volet, relié
à la terre, tombe sur une vis, S, rattachée au circuit d’une
sonnerie. La fiche est constituée par deux pitons, L et L', isolés
l’un de l’autre et vissés dans un manche creux, en corne
; deux conducteurs, réunis en un cordon souple, sont reliés,
d’une part aux pitons, et, d’autre part, aux bornes de ligne
de l’installation téléphonique: quand on place la fiche
sur les crochets, l'annonciateur se trouve isolé, par suite de
la rupture de contact qui se produit au crochet n° 1 : si la fiche
est mise sur les crochets C' et C", l’annonciateur reste en
dérivation. Afin que les pitons, L et L', se trouvent toujours
respectivement reliés aux lignes 1 et 2, la joue du premier, L,
est plus large que celle de L', et ne peut s’engager dans l’intervalle
entre deux crochets, de sorte qu’on doit retourner la liche, suivant
qu’on veut la placer sur les crochets C et C', ou sur C et G".
Lorsqu’on ne communique avec aucune ligne, la fiche est suspendue
à un crochet de repos, placé sur le côté droit
du tableau. Pour relier deux lignes, on fait usage de deux fiches, réunies
par un cordon souple: on les place dans les conjoncteurs des lignes à
relier, l’une sur les crochets G et G, l’autre sur G' et C"
: l’un des annonciateurs est mis hors circuit, tandis que l’autre
reste en dérivation sur la liaison et enregistre le « signal
de fin de conversation ».
27 - Installation d’une ligne bifurquée
avec des postes Ducousso.
— Trois postes sont installés sur la
même ligne : l’un intermédiaire, dit poste central,
les deux autres extrêmes.
A chacun des postes extrêmes se trouve un tableau du système
imaginé par M. Ducousso. Sur ce tableau, outre les relais qui en
constituent la partie principale, est également installé
le transmetteur; d’autres tableaux ne comportent pas de place pour
l’appareil et sont destinés à être reliés
à des appareils portatifs.
Au bureau central, on trouve un annonciateur à voyant blanc et
rouge, et deux clés, l’une à bouton noir, l’autre
à bouton rouge; ces deux clés font l’office de commutateur
inverseur, l’une envoie le courant positif, l’autre le courant
négatif.
Que l’on fasse usage, dans les postes extrêmes, de l’un
ou de l’autre des tableaux dont nous venons de parler, les conditions
du problème restent les mêmes et sont résolues de
la même façon :
1° A la suite de l’appel du poste central ou des postes extrêmes,
la sonnerie du poste appelé fonctionne seule; dans l’autre
poste, le voyant indique que la ligne est occupée;
2° La conversation entre deux postes ne peut être surprise par
le troisième; en décrochant ses récepteurs, il coupe
la communication ;
3° Les deux postes extrêmes peuvent cependant communiquer entre
eux par l’intermédiaire du poste central et en manœuvrant
convenablement les chevilles de leurs conjonc-teurs. Au poste A, la ligne
est reliée à la borne L du tableau et la terre ou le fil
de retour à la borne L1 ; au poste C, c’est le contraire qui
a lieu.
Habituellement, une pile de 9 éléments suffit aux besoins
des trois postes groupés sur la ligne. Le zinc commun est réuni
à la borne Z, le 3e charbon à la borne CM, le dernier charbon
aux bornes CV, CS, C réunies ensemble. Il peut arriver cependant
que les deux postes A, C, quoique rapprochés l’un de l’autre,
soient fort éloignés du poste central B, qu’en un mot,
ils soient placés à l’extrémité d’une
longue ligne; le nombre des éléments de la pile d’appel
est, dans ce cas, supérieur à 9; alors, on attache le zinc
commun à la borne Z, le 3e charbon à la borne CM, le 9e
aux bornes CV, CS réunies, le dernier à la borne C. Si les
trois postes sont très éloignés l’un de l’autre,
on relie le zinc commun à la borne Z, le 3e charbon à la
borne CM, le 93 à la borne CS et le dernier aux bornes CV, C réunies.
La vis de réglage a du relais doit être à 1 millimètre
environ du contact de la bobine librement suspendue ; la vis b en reste
éloignée de 4 à 3 millimètres.
La fiche du commutateur est normalement placée en f, c’est-à-dire
dans le trou de droite, le trou de gauche g restant ouvert; alors, quand,
dans un des deux postes pourvus de tableaux, on décroche le téléphone,
le voyant portant la mention occupée doit apparaître dans
l’autre poste.
Pour qu’il puisse y avoir conversation entre les postes A et C, il
faut qu’il y ait au préalable appel au poste central; ce dernier
ayant donné la communication, le poste appelant et le poste appelé
doivent placer la cheville de leur commutateur dans le trou g. La conversation
terminée la cheville est replacée en f.
L’installation du poste central comporte un annonciateur rouge et
blanc, dont le voyant se déplace suivant le sens du courant qui
traverse les bobines. On se rappelle que l’une des bobines porte
une armature spéciale formée par un aimant en fer à
cheval; suivant le sens du courant, l’un ou l’autre des pôles
est attiré, ce qui détermine, au moment ou le volet tombe,
l’apparition du voyant blanc ou du voyant rouge.
Le conjoncteur, suivant la position d’une fiche dans le trou de gauche
ou dans celui de droite, permet de laisser l’annonciateur dans le
circuit ou de l’en retirer.
Une double clé portant sur un de ses ressorts un bouton rouge,
sur l’autre un bouton noir ou blanc, correspond aux deux couleurs
de l’annonciateur. La clé rouge est en relation avec une pile
émettant un courant négatif ; elle sert à répondre
au poste dont l’appel se fait par le voyant rouge ; la clé
blanche répond au voyant blanc. Pour plus de précaution,
on peut disposer au-dessus du conjoncteur une étiquette mi-partie
rouge, mi-partie blanche; sur la partie rouge, on inscrit le nom du poste
dont l’appel fait apparaître cette couleur, il en est de même
pour la partie blanche.
L’installation à simple fil se fait de la même manière,
à cette différence près que toutes les communications
avec le fil de retour sont remplacées par des communications avec
la terre.
Examinons ce qui se passe lorsque l’un ou l’autre des trois
postes appelle : soit le poste central B appelant A. La fiche de B étant
placée dans le conjoncteur m (c’est sa position normale) le
téléphoniste appuie sur la clé à bouton rouge
M. Le courant passe par la fiche, le conjoncteur, et arrive sur la ligne
aux points de bifurcation x y ; là il se divise en deux parties
et se rend simultanément aux deux postes A, C. Suivons-le d’abord
dans la direction A : dans ce poste, il arrive aux bornes L, L,. De L
il passe par le ressort r et sa vis de contact, arrive à la borne
l du transmetteur, en ressort par la borne s, parcourt la bobine du relais
polarisé de c en d et revient à la borne L.
Dans le poste C les choses se passent de la même manière,
seulement le courant y circule en sens inverse, puisque la ligne y attachée
à L dans le poste A est reliée à Li dans le poste
C; il en résulte que les relais polarisés c d de ces deux
postes sont parcourus par des courants de sens contraires qui ont pour
effet de les orienter différemment.
La conséquence de cette orientation est, dans chaque poste, la
fermeture d’un circuit différent :
Dans le poste A, la bobine mobile du relais polarisé est attirée
vers la gauche et vient buter contre la vis b : le circuit de la sonnerie
se trouve fermé par borne Z,e, d, b, S, son-7ierie, S, h, borne
C, pile d'appel; le poste A est appelé.
Dans le poste C, la bobine du relais polarisé est attirée
vers la droite et vient buter contre la vis a : le circuit du relais qui
porte le voyant se trouve fermé par borne Z, e, d, a, bobine de
droite du relais, i, h-, borne C, pile d'appel. L’armature du relais
est attirée et entraîne le voyant qui laisse voir la partie
rouge et la mention : occupée.
Si nous suivons à partir de y le courant venant de la ligne, nous
voyons qu’il a pénétré dans le poste C par la
borne L, a suivi le trajet L.,, d, c, bornes s et i du transmetteur, v,
r, borne L. Au moment où l’armature est attirée, le
ressort r est abaissé et séparé de sa vis de contact
v; le circuit est rompu en ce point et le relais polarisé reprend
sa position de repos; mais alors le courant de ligne prend une autre route.
De L4 il passe en k, traverse la bobine de gauche du relais inférieur,
arrive à la vis de réglage, à l’armature en
conta'ct avec le ressort r et gagne par là la borne L. L’armature
reste donc attirée par la bobine de gauche, et, par conséquent,
le voyant montre toujours la mention occupée.
Voilà ce qui se passe au moment de l’appel.
Dès que le poste appelé a répondu (le poste A dans
notre hypothèse) les récepteurs sont décrochés
dans ce poste, ainsi qu’au bureau central, et la conversation commence.
Par le fait du décrochage des récepteurs et du relèvement
des leviers-commutateurs, un courant permanent est envoyé sur la
ligne, courant qui, en traversant le relais du poste C, maintient l’armature
abaissée et le voyant dans la position de ligne occupée.
Ce courant persiste tant que dure la conversation entre le poste A et
le poste central, en d’autres termes, tant que les récepteurs
ne sont pas remis aux crochets.
En suivant ce courant à partir du pôle C de la pile du poste
A, nous le voyons prendre la direction C dans le transmetteur du poste
A, il passe à travers les récepteurs, le circuit secondaire
de la bobine d’induction, le levier-commutateur, puis, sortant par
la borne l, il va sur la ligne par le chemin v r L. De L il arrive par
y en L^ du poste C, parcourt le fil de la bobine de gauche du relais,
entrant par k sortant par r L et revenant au poste A à travers
la ligne x pour aboutir par la borne L, et le point e à la borne
Z.
La remise des téléphones au crochet supprimant ce courant,
l’armature du relais de C n’est plus attirée et le voyant
reprend sa position initiale, laissant apparaître la mention libre.
Il est facile de voir que, lorsque le voyant du poste C indique que la
ligne est occupée, c’est-à-dire lorsque l’armature
du relais est attirée, la communication entre la ligne et les récepteurs
de ce poste est coupée. En effet, les ressorts r, r' ont abandonné
les contacts v, v'. Il n’est donc pas possible au poste immobilisé
de surprendre la correspondance, puisque son appareil est hors circuit.
Ce que nous venons de dire au sujet des communications entre A et B s’applique
aux communications entre B et C.
Les réponses ou les appels de A ou de C s’adressant à
B se traduisent dans ce poste par le déplacement du voyant rouge
et blanc; la couleur qui apparaît au moment de la chute du volet
de l’annonciateur fait connaître le poste qui a appelé.
Les noms des postes qui font apparaître le rouge ou le blanc sont
inscrits au poste central.
Reste à examiner le cas où A et C veulent communiquer entre
eux.
Les deux postes extrêmes ne peuvent communiquer entre eux que par
l’intermédiaire du poste central. A, par exemple, appelle
B qui sonne C. En même temps le poste central B invite les postes
A et C à placer les fiches de leur commutateur dans le trou de
gauche g. La communication est dès lors établie .Les deux
circuits microphoniques sont fermés dans les transmetteurs, comme
d’habitude, par la position du levier commutateur.


En disposant convenablement, comme le montre la dernière figure,
un jack-knive pour chaque ligne, on peut supprimer la clé spéciale
au bureau central. Les jack-knives sont alors croisés, la portion
inférieure de l’un étant réunie à la
portion supérieure de l’autre.
L’installation pour ligne simple ne présente pas de difficulté
; le fil de retour est remplacé par la terre. Au poste central
on fait usage de deux clés simples, dont l’une correspond
au pôle positif d’une pile, l’autre au pôle négatif
d’une seconde pile, le pôle resté libre dans chacune
de ces piles étant à la terre.
Les tableaux Ducousso sans place pour appareil fonctionnent comme les
précédents; ils sont reliés au transmetteur par un
cordon souple dont la figure ci dessous montre les connexions.
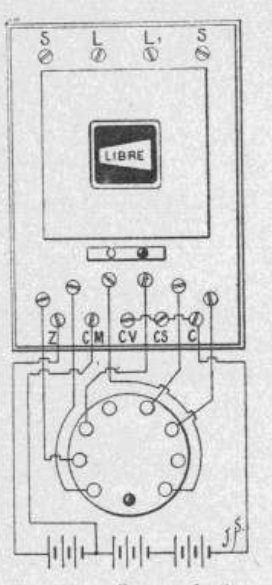


Tableau téléphonique DUCOUSSO monocordes.

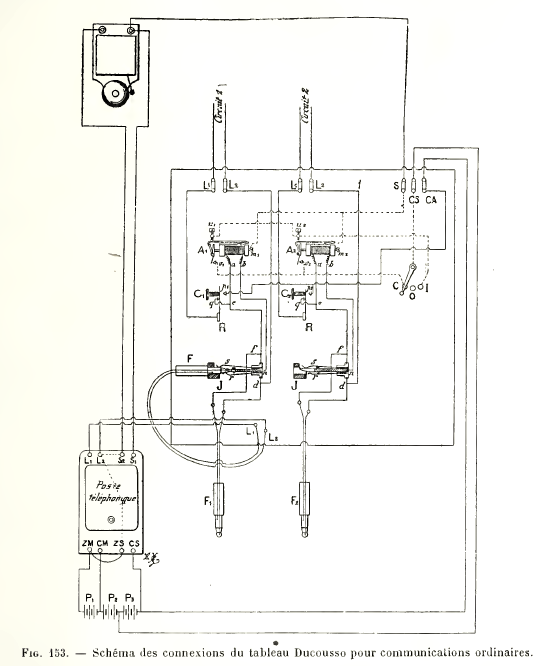
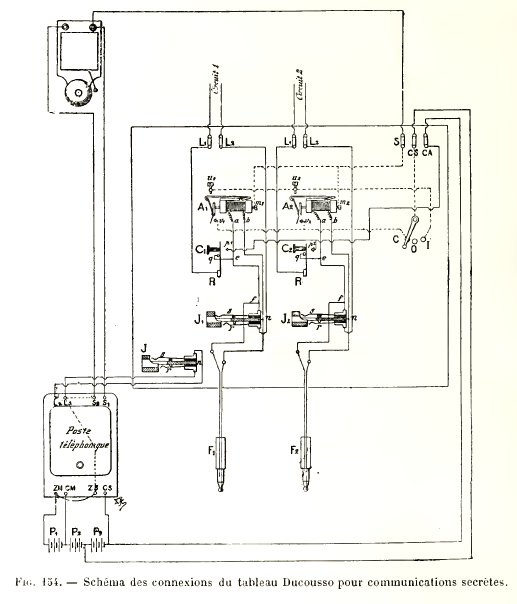
Il en existe deux modèles: l’un, permettant
d’établir la communication entre deux quelconques des lignes
aboutissant au tableau, mais laissant la faculté au poste central
de se placer en dérivation sur la communication établie
et, par conséquent, d’écouter les conversations; l’autre,
dit à communications secrètes, permettant également
de mettre en relation deux quelconques des lignes reliées au tableau,
mais ne permettant plus au poste central de surprendre les conversations.
Le tableau pour les communications ordinaires comprend autant d’annonciateurs,
de clés d’appel et de jacks qu’il dessert de lignes.
Le nombre des fiches est égal au nombre des lignes desservies plus
une.
Le tableau pour les communications secrètes comprend autant d’annonciateurs,
de clés d'appel et défichés qu’il dessert de
lignes. Le nombre des jacks est égal au nombre des lignes desservies
plus une.
Chacun des tableaux est pourvu d’un commutateur IOC, c’est-à-dire
d’un commutateur permettant d’utiliser une sonnerie intermittente
(position I), de ne pas employer la sonnerie (position O), ou bien d’obtenir
un tintement continu, tant que le volet de l’annonciateur n’est
pas relevé (position C).
En principe, les montages des deux genres d’installation (fig. 153
et 154) diffèrent par les points suivants :
Dans le tableau pour communications ordinaires, les deux fils de chaque
ligne reliée au tableau aboutissent à la pointe et au corps
de la fiche, quelle que soit la position du jack ; les bornes L1,L2 du
poste central sont reliées à une fiche placée sur
le tableau.
Dans le tableau à communications secrètes, la fiche ne représente
l'extrémité de la ligne qu’autant que le jack de cette
fiche est au repos; si une fiche est introduite dans ledit jack, la ligne
est coupée en ce point et ne correspond plus avec sa fiche; les
bornes L,L2 du poste central sont reliées à un jack placé
sur le tableau.
Annonciateur.
— L’annonciateur est d’un modèle analogue à
celui qu’emploie la maison Postel-Vinay dans la construction de ses
multiples du système d’Àdhémar.
Le noyau et les joues de la bobine forment une seule masse de fer doux
sur laquelle est vissée une plaque, également en fer doux,
qui supporte l’armature. Cette armature est réunie à
la plaque par un ressort-lame en acier, fixé de part et d’autre
par deux vis.
L’armature supporte une tige à crochet en laiton qui soutient
le volet ou bien l’abandonne, suivant que l'armature est au repos
ou attirée.
Lorsque l’armature est attirée, la tige de laiton rencontre
une vis qui, tout en limitant la course de cette tige, joue un rôle
électrique; en effet, le contact de ces deux pièces ferme
le circuit qui assure le fonctionnement intermittent de la sonnerie.
D'autre part, le volet, en tombant, met en relation un mince ressort d'acier
à contact platiné avec une autre vis et ferme ainsi le circuit
qui assure le fonctionnement continu de la sonnerie.
L’une ou l’autre des deux vis est dans le circuit de sonnerie
ou bien elles n’y sont ni l'une ni l’autre; cela dépend
de la position delà manette du commutateur IOC.
L’enroulement de la bobine de l’annonciateur a une résistance
de 200 ohms.
Par-dessus cet enroulement, dont les extrémités se terminent
par des boudins, se trouve un autre enroulement en fil de cuivre nu de
0,40 mm de diamètre, enroulement fermé sur lui-même
et constituant autour de la bobine proprement dite une gaine de cuivre
qui a pour objet d’éviter l’induction mutuelle entre
les annonciateurs voisins.
Jack.
— Le jack est simple et robuste. 11 se compose d'un massif en laiton
dont la partie antérieure, évidée, forme la douille
dans laquelle s’engage la fiche ; cette partie est fixée par
deux vis à l’ébénisterie du tableau.
Sur la partie postérieure du massif sont boulonnés deux
ressorts d’inégale longueur. Le boulon est complètement
isolé ; les ressorts sont isolés l’un de l’autre
et du massif.
Des équerres en laiton, garnies de vis, servent à assujettir
les fils de communication abou¬ tissant aux ressorts. Au repos, le
ressort long, celui qui doit prendre communication avec le corps de la
fiche, repose sur une goupille isolante enfoncée dans le massif
du jack ; le ressort court, celui qui doit être en relation avec
la pointe de la fiche, s’appuie directement sur la masse métallique
du jack ; cette liaison cesse d’exisler lorsque la fiche est enfoncée
dans le jack.
Fiche.
— La fiche, à deux conducteurs, ne présente aucune
disposition particulière; elle comprend un corps et une pointe
isolés l’un de l’autre.
Commutateur. — Le commutateur IOC est bien connu : c’est une
manette centrale à laquelle aboutit le conducteur à permuter
et qui peut, à volonté, être posée sur les
plots I, O ou C.
Clé d'appel.
— C’est un bouton-poussoir actionnant un ressort qui, au repos,
reste appliqué sur un contact en relation avec l’annonciateur
et qui, lorsqu’on appuie sur le bouton, prend contact avec le plot
de pile, représenté par une barrette en laiton commune à
toutes les clés.
A l’intérieur du tableau, la borne CA correspond aux plots
de travail , p2 de chacune des clés d’appel, la borne CS à
l’axe de la manette du commutateur IOC, la borne S à la masse
m1 m2, ..., de chacun des annonciateurs. Le plot 1 du commutateur est
relié aux vis supérieures ur w2, ..., des annonciateurs,
le plot C aux vis inférieures v1, v.2 ; le plot O est isolé
et dépourvu de toute communication.
Dans chaque circuit de ligne, la borne L, est reliée au ressort
R de la clé d'appel, la borne L2 à la pointe de la fiche
(F,, F2, ...), avec une dérivation en d sur le ressort court r
du jack. Le plot de repos q de la clé d’appel est réuni
d’une part, en rt, à l’entrée de la bobine de
l’annonciateur, de l’autre au ressort long s du jack avec, en
/*, une dérivation sur le corps de la fiche ; enfin la sortie b
de la bobine de l'annonciateur est en relation avec la masse n du jack.
Fonctionnement du tableau ordinaire.
— Au moment de l’appel, provenant d’une des lignes qui
aboutissent au tableau, le volet de l’annonciateur correspondant
tombe ; la sonnerie ne fonctionne pas si la manette du commutateur est
sur le plot 0; elle fait entendre un tintement continu si la manette est
sur le plot C ; elle n’est actionnée qu’à chaque
attraction de l’armature de l’annonciateur si la manette repose
sur le plot I.
Pour répondre, la personne préposée au service du
tableau enfonce la fiche F dans le jack de la ligne qui a appelé
et presse sur la clé d’appel de la même ligne; elle
peut également faire usage du bouton d’appel de son propre
transmetteur. Le circuit 1 demande la communication avec le circuit 2
; la fiche F, est aussitôt introduite dans le jack J de droite.
Le poste central peut alors laisser la fiche F dans le jack J de gauche
ou la retirer. S’il la laisse, il se trouve en dérivation
sur les deux circuits reliés ensemble et peut saisir les conversations;
il est à remarquer que si, dans cette position, il presse sur son
bouton d’appel, il appellera le poste terminus de chacun des deux
circuits 1 et 2.
Pour éviter les indiscrétions pouvant provenir de la dérivation
que le poste central a la faculté d’établir, M. Ducousso
a construit son tableau à communications secrètes.
Fonctionnement du tableau a communications secrètes.
— L’appel au poste central a lieu comme d’ordinaire ; il
est signalé par la chute du volet et, s’il y a lieu, par le
tintement de la sonnerie. Pour répondre, il suffit au poste central
d’appuyer sur la clé située au-dessous du volet tombé;
mais, pour se mettre en relation avec le circuit d’où provient
l’appel, il faut introduire la fiche de ce circuit dans le jack J.
Soit le circuit 1 appelant: la fiche F, est introduite dans le jack J
; le circuit 1 demande la communication avec le circuit 2 ; la fiche F,
est retirée du jack J et introduite dans le jack J2. La communication
entre 1 et 2 est alors absolument secrète; c’est en vain que,
pour prendre une dérivation sur les circuits 1 et 2 associés,
le poste central intro¬ duirait la fiche F2, restée libre,
dans le jack J. En effet, la fiche F,, placée dans le jack J2,
a soulevé les ressorts s, r; le ressort r n’a plus de communication
avec la masse n du jack et, par consé¬ quent, la borne L2 ne
communique plus avec la fiche F2 ; la pointe de la fiche du circuit appelé
est donc isolée, tant que la fiche du circuit appelant reste dans
le jack du circuit appelé. Le rappel de l’un ou l’autre
circuit peut toujours avoir lieu par la clé d’appel qui lui
est propre.
Tableaux sans clés d’appel.
— Tels que nous les avons décrits, les tableaux Ducousso ne
fonctionnent pas avec la nouvelle installation des postas d’abonnés,
seuls admis sur les réseaux français depuis le 1er janvier
1900 ; il a donc fallu modifier leur construction pour les adapter tant
aux anciens qu’aux nouveaux aménagements. La transformation
est d’autant plus heureuse qu’elle simplifie le tableau.
Dans le poste d’abonné, pour assurer l’indépendance
des circuits, la pile de microphone a été séparée
delà pile d'appel. Les pôles de la première sont reliés
aux bornes ZM, CM, les pôles de la seconde aux bornes ZS, CS. La
liaison ZM, ZS, L2, S2, a été supprimée. La clé
d’appel est double. Pour approprier ses tableaux à ce nouveau
montage, M. Ducousso supprime ses clés d'appel ; il enlève
le fil de liaison pf, p2, CA et réunit le point R au point e.
Avec cetle nouvelle disposition, l’appel des abonnés reliés
au tableau se fait toujours par la clé d'appel du poste téléphonique
amené audit tableau.
Ces tableaux sont construits par la Société des établissements
Postel-Vinay.
sommaire
28 - Installation d’une station automatique Sieur.
— L’installation d’une station automatique du système
Sieur pour ligne double ne présente aucune difficulté. La
planchette sur laquelle sont rangés les différents organes
porte, en haut, autant de paires de bornes qu’il y a d’abonnés
à desservir plus une paire pour la ligne principale,- en bas, trois
bornes sont affectées à la pile et à la terre.



Communications du tableau Ducousso sans place pour appareil.
Les deux conducteurs de la ligne principale sont attachés aux deux
bornes de gauche, les lignes d’abonnés sont successivement
amenées aux paires de bornes suivantes, la ligne n° 1 aux bornes
1, la ligne nu 2 aux bornes 2, et ainsi de suite.
Le pôle négatif de la pile est réuni à la borne
inférieure de gauche, le pôle positif à la borne du
milieu; la borne de droite communique avec la terre.
Dans chaque poste d’abonné le commutateur spécial à
deux manettes, muni du vibrateur, est intercalé entre la ligne
et le transmetteur. Les deux fils de ligne sont attachés aux bornes
LL'; les bornes AL, AL' sont reliées aux bornes ligne du transmetteur,
la borne -f- au pôle positif de la pile d’appel, la borne +A
à la borne inférieure de droite du transmetteur.
Quant au poste central , une clé à quatre contacts distribue
sur chacune des deux lignes le courant positif ou le courant négatif
d’une pile, suivant la touche que l’on abaisse.
Tableau commutateur, de Ducousso 1897.
— A la partie supérieure sont les trois annonciateurs; au-dessous,
trois boutons-poussoirs pour les appels: plus bas, trois jacks à
simple rupture, et enfin trois fiches. Dans chacun de ces groupes vertieaux,
le fil n° 1 de la ligne arrive au ressort du bouton d’appel puis,
par la butée de repos de celui-ci, va se rattacher, d'une
part au grand ressort du jack et, d’autre part, à l’entrée
de l’annonciateur: le fil n° 2 va au petit ressort dil jack et,
par le contact à rupture, à la sortie de l'annonciateur;
en outre, les deux parties de la fiche, F, sont en dérivation sur
les deux fils de ligne.

Le tableau est complété par un poste
téléphonique, dont les bornes de lignes communiquent avec
une fiche, F', qu’on enfonce dans un jack de ligne lorsqu'on veut
entrer en communication avec le correspondant. Pour relier deux lignes,
on place, la fiche, F, de l'une dans le conjoncteur de l’autre.
sommaire
29 - Les postes muraux avec appel magnétique
L’Administration française a prescrit de généraliser
l’emploi des magnétos, en vue de diminuer l'entretien
onéreux des piles d'appel chez l’abonné dans les réseaux
à batterie locale. Tous les postes nouveaux doivent être
montés avec appel magnétique, et l’on doit profiter
de toute occasion pour transformer les postes existants.
 Poste mural avec appel 1901.
Poste mural avec appel 1901.
L’installation comporte : un poste mural, une sonnerie, un appel
magnétique une pile microphonique. Celle-ci est constituée
par Un élément à liquide immobilisé. Le montage
de l’appel a été indiqué ; il n’y a à
tenir compte Pour l’installation pratique, que de la disposition
des isolants et des trous à utiliser pour le passage des fîls.
On remarque que les fils de la pile de microphone contournent l'appel
; on tolère cependant le passage de ces fils sous cet appareil.
L’emploi d’un appel magnétique est toujours préférable
avec un poste mural; le montage est en effet plus simple et Plus élégant,
car les boîtes de piles constituent un matériel encombrant
et assez laid dans un local luxueux; il faut alors recheroher un endroit
convenable pour dissimuler les piles et allonger souvent sensiblement
les conducteurs qui les relient au poste.
L’entretien des piles exige, de plus, de fréquents déplacements
du personnel; il est, par suite, assez onéreux.
Tous ces inconvénients ne sont pas occasionnés par les éléments
microphoniques, qui sont à liquide immobilisé, Car leur
étanchéité permet de les loger dans un endroit quel-conque.
Cependant, si l’installation est faite avec une pile d’appel,
celle-ci est formée de six éléments groupés
en tension, c’est-a~dire de deux boîtes. On peut alors, mais
seulement en cas nécessité absolue, prendre, sur cette pile,
trois éléments Pour former la pile du microphone. L’installation
prend alors a disposition représentée par la figure suivante
:
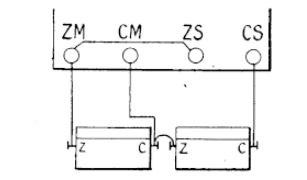
En 1905
apparait le modèle normalisé mural à micro fixe et
toujours à magnéto (appel magnétique)
Poste mural administratif.
— C’est une installation analogue à la précédente
; mais la suppression des bornes de pile d’appel permet un montage
plus symétrique.


Poste mural avec appareil 1902 et appel 1901.
Poste téléphonique complet, modèle
1905.

 Poste mural complet, modèle 1905.
Poste mural complet, modèle 1905.
Un même ensemble comprend : un appareil mural, un appel magnétique
une pile de microphone. L’installation consiste simplement a attacher
les fils de ligne aux bornes L et à monter la sonnerie sur les
bornes S.
1905 1910 Evolutions, Normalisation
1907,
les constructeurs d'appareils téléphoniques on l'obligation
de monter les récepteurs (écouteurs) en dérivation
au lieu d'être en série.
Jusqu'en 1907, sur Paris les installations sont réalisées
dans Paris en batterie locale, les postes étant munis
d'une magnéto que l'abonné doit actionner
au début et à la fin des communications. Une première
transformation du réseau de Paris consiste à mettre en oeuvre
la batterie centrale pour l'appel, ce qui supprime les magnétos.
Jusqu'alors pour appeler l'opératrice afin d'obtenir la communication
demandée, les abonnés envoyaient un courant sur la ligne,
soit en tournant une magnéto, soit en actionnant un bouton d'appel
relié à une batterie de piles qui se trouvait chez eux.
L'innovation qui vient des Etats-Unis consiste à
remplacer ces sources particulières de courant par une batterie
centrale c'est-à-dire un puissant groupe de piles dans chaque central.
Il suffit donc aux utilisateurs de décrocher leur combiné
pour établir le contact.
Les travaux de transformation commencés en 1907 se terminent en
1909. Les piles pour l'alimentation des microphones subsistent encore
chez les abonnés après la suppression des magnétos,
mais à partir de 1920 tous les postes du réseau de
Paris sont à "batterie centrale intégrale".
Ces modifications techniques facilitent la vie des abonnés en rendant
le geste technique plus simple. On constate pendant cette période
un réel accroissement du nombre d'abonnés à Paris.
De 45 000 au 1er janvier 1910, le nombre d'abonnés passe à
65 000 en juillet 1914. Cette progression se ralentit pendant le premier
conflit mondial à la fin duquel on dénombre (31 décembre
1918) 76 000 abonnés répartis en 16 circonscriptions au
centre de chacune desquelles est implanté un central manuel. La
vétusté du réseau est alors patente, alors que l'incendie
du central Gutenberg (18 000 abonnés) en septembre 1908 et les
énormes dégâts provoqués par les inondations
de 1910 avaient déjà souligné et aggravé sont
état défectueux.
1910 les téléphones sur le réseau
de l'Etat appelés modèle de téléphone 1910
(Appélé aussi PTT 1910 ou Marty) à magnéto
sont installés sur tous les centraux encore manuels. Il n'y a plus
de bouton + pile pour faire l'appel, la magnéto sert d'avertisseur
pour l'opératrice ou un volet magnétique indique la position
de l'abonné.
 PTT 1910 BL avec batterie Locale
,
PTT 1910 BL avec batterie Locale
,  pour
alimenter le microphone sur la plupart des anciens centres manuels.
pour
alimenter le microphone sur la plupart des anciens centres manuels.
sommaire
Poste mural complet, modèle 1910 à magnéto
(ou applique magnétique)
— Ce modèle est destiné à remplacer le précédent.
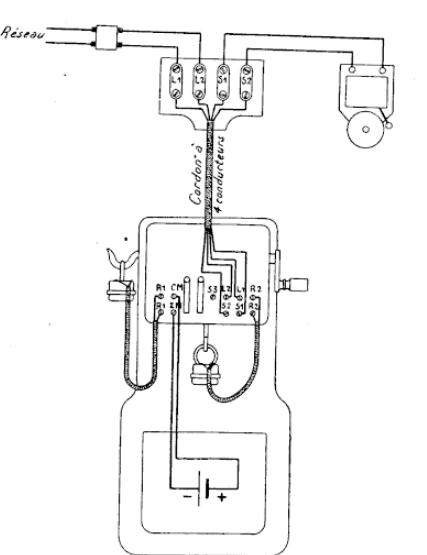


Poste mural complet, modèle 1910 à micro fixe ou avec combiné..
L’appareil est le type mural 1910 ; il
est muni d’un câble à 4 conducteurs relié à
une planchette de raccordement sur laquelle on amène les fils de
ligne et de sonnerie.
Poste avec applique murale, modèle 1910 et applique
magnétique.
— L’applique est reliée par un câble à 10
conducteurs à une planchette de raccordement à 6 plots.
 Poste avec applique
murale, modèle 1910, Corcdon à 6 conducteurs
Poste avec applique
murale, modèle 1910, Corcdon à 6 conducteurs
Les fils (de ligne et de pile microphonique aboutissent directement à
la planchette : la sonnerie y est reliée par l’intermédiaire
de l’appel magnétique.
30- Les Postes mobiles avec applique magnétique..
Les fils de ligne, de sonnerie et de Piles sont amenés près
d’une planchette portant huit plots Alunis chacun de deux bornes.
La planchette est fixée horizontalement au mur, puis les boudins
qui terminent les conducteurs sont fixés sous les vis supérieures.
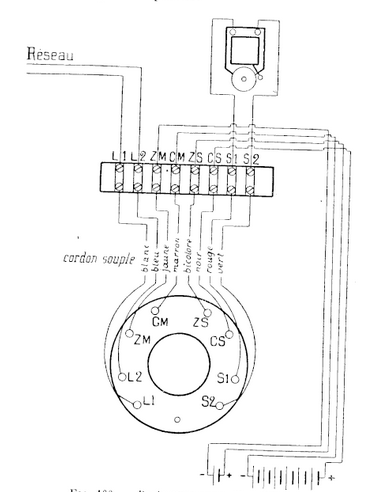 Poste avec appareil
mobile.
Poste avec appareil
mobile.
L’appareil est relié à la planchette par un câble
souple, d’une longueur de 5 mètres, dont les huit fils de
couleur sont utilisés dans l’ordre indiqué par la figure.
Le câble est serré sous un ponl fixé sur la planchette,
et les fils suivent l’axe de celle-ci pour s’attacher successivement
sous les bornes inferieures de leurs plots respectifs.
En 1930 on trouve encore en service certains postes mobiles montés
avec des planchettes à 14 bornes seulement. L’Administration
admettait en effet, il y a quelques années, l’installation
d’une pile unique pour l’appel et le microphone. Dans Ces conditions,
un plot Z était commun aux deux fils venant des bornes ZM et ZS
de l’appareil.
Poste avec appareil mobile, modèle 1910.
L’appareil Mobile contenant un appel magnétique, le câble
de jonction avec la planchette de raccordement contient
seulement 6 conducteurs destinés à la ligne, la sonnerie
et la pile microphonique.
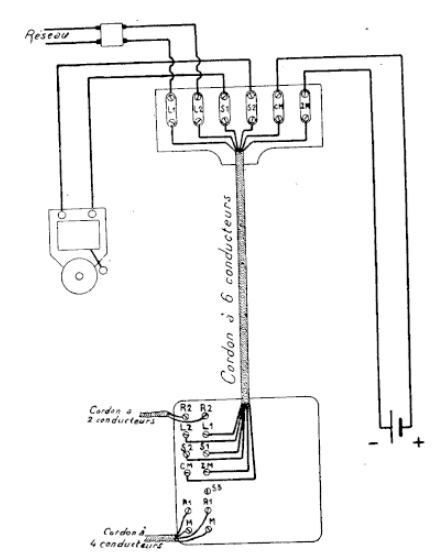 Poste mural avec sonnerie supplémentaire commandée
Poste mural avec sonnerie supplémentaire commandée
Poste mural avec sonnerie supplémentaire commandée par un
commutateur
— Le poste, muni de l'une des sonneries, est installé, par
exemple, dans le bureau ou magasin de l’abonné, et la sonnerie
supplémentaire dans son appartement. Le commutateur permet à
l’abonné de recevoir l’appel dans un endroit ou dans
l’autre, à condition toutefois qu’il n’oublie pas
de le manœuvrer quand il change de local.
 Poste
mural avec sonnerie supplémentaire.
Poste
mural avec sonnerie supplémentaire.
Le commutateur prend la place de la sonnerie sur l’un des fils partant des bornes S de l’appel magnétique, ou de la borne SI, si l’appareil est muni d’une pile d’appel. Le poste mural peut être évidemment remplacé par un appareil mobile. Dans ce cas, le commutateur est placé sur le fil partant de la borne SI de la planchette de raccordement.
Montage de sonneries en série et en dérivation.

L’installation suivante comportant deux sonneries à actionner
en même temps, ou même davantage si l’abonné le
désire, il est nécessaire d’examiner d’abord les
conditions dans lesquelles pourront fonctionner ces sonneries.
Quand on installe différents appareils dans un même circuit,
on peut placer les appareils les uns à la suite des autres, c’est-à-dire
en série.
On peut aussi faire entrer le courant dans tous les appareils à
la fois et l’en faire sortir, par un fil commun, pour revenir au
pôle négatif : les appareils sont en dérivation sur
le clrcuit. Nous avons déjà vu l’application de ces
deux systèmes ans le montage des deux téléphones
d’un poste.
1- 2-
2-
Dans le premier cas, les résistances des appareils s’ajoutent
; on a donc, comme résistance du circuit la résistance du
conducteur, plus la résistance totale des appareils. Dans le deuxième
cas,nous avons l’application des courants dérivés,
c’est-à-dire que le courant, rencontrant plusieurs chemins,
trouve un écoulement plus facile ; il rencontre évidemment
moins de résistance que dans le premier cas; il en rencontre même
moins que s’il n’avait qu’un appareil à traverser,
puisque, par le fait, nous augmentons la section du conducteur, l'intensité
du courant est donc plus grande, mais il faut oserver que ce courant se
divise et qu’il n’en passe qu’une partie dans chaque appareil.
Il résulte de ceci qu’il faut éviter de mettre en dérivation
des appareils de résistances très différentes, car
la majeure partie du courant s’écoulerait par celui qui est
ie moins résistant, et l’intensité pourrait ne pas
être suffisante pour faire fonctionner les autres.
C'est d’ailleurs l’expérience, à défaut
du calcul, qui doit aider l’agent chargé d’une installation,
si aucune indication pécise ne lui a été donnée.
Il y a en effet, dans le cas d’appareils en dérivation, à
tenir compte non seulement de l’intensité du courant qui passe
dans chacune des dérivations, aussi du nombre de tours de fil des
électro-aimants et, dans certaines conditions dont l’étude
nous entraînerait trop loin, ce serait précisément
l’appareil le plus résistant qui fonctionnerait le mieux.
Quand on place plusieurs sonneries snr un circuit, on
les monte suivant les prescriptions de l’Administration, c'est' à-dire
en dérivation. Cependant, si les sonneries sont de résistances
très différentes, on comprend, d’après ce que
nous venons de voir, qu’il peut être plus avantageux de les
monter en série.
Il se présente alors, un inconvénient
: c’est qu’il est rare de disposer de deux sonneries donnant
exactement le même nombre d’interruptions dans le même
temps ; autrement dit, il n’y a pas synchronisme entre les marteaux.
En effet, l’ensemble des pièces de l’armature constitue
une sorte de tige vibrante dont le nombre de vibrations dépend
: de la longueur et de la rigidité du ressort antagoniste, du poids
de la palette, de la longueur et du poids du marteau. Si l’on considère
deux sonneries, même d’une fabrication identique, la moindre
différence dans le montage des pièces peut faire varier
le nombre des vibrations.

Il en résulte que, si les deux armatures partent ensemble au moment
de l’émission du courant, elles ne reviennent pas au repos
au même instant : le circuit est alors refermé par l’une
et encore ouvert dans l’autre ; le courant ne peut donc passer. La
deuxième revient presque aussitôt au repos ; mais, en vertu
de l’élasticité du ressort antagoniste, la première
tend à quitter de nouveau la vis de réglage, ét son
contact est Mauvais : le courant éprouve donc une certaine résistance,
le même effet se reproduit jusqu’au moment
où les deux armatures reviennent franchement ensemble an repos.
En somme, les deux sonneries fonctionnent irrégulièrement,
et le marteau de l’une d’elles peut même ne jamais toucher
le timbre.
On évite cet inconvénient en laissant
une des sonneries montée normalement et en supprimant, dans l’autre,
ou les autres, l’interruption automatique du circuit : il suffit
d'établir une dérivation entre le massif et la borne de
droite. De cette façon la première sonnerie ouvre seule
le Clrcuit et commande le mouvement des autres.
Poste mobile avec relais et deux sonneries.
— Cette installation est établie quand l’abonné
désire recevoir l’appel dans deux endroits, ou même
plus, à la fois. Dans ce cas, si la ligne est un peu longue et
surtout si les sonneries sont nombreuses, un relais est presque toujours
nécessaire.
 Poste mobile
avec relais et deux sonneries.
Poste mobile
avec relais et deux sonneries.
Le relais est installé à la place
de la sonnerie, c’est-à-dire ses bornes LT reliées
aux bornes S de la planchette. La pile d’appel servant de pile locale,
des dérivations prises sur la Planchette relient le plot CS à
la borne P, et le plot ZS à l’une des bornes de la première
sonnerie, dont l’autre borne est reliée à la borne
S du relais. Enfin, la ou les sonneries supplémentaires sont mises
en dérivation sur la première.
Une installation neuve est toujours montée avec
des songeries du type administratif de 200 ohms ; toutefois, quand un
abonné fait modifier une installation déjà ancienne
et fournit, à l'agent chargé du travail, des appareils admis
antérieurement, celui-ci peut se trouver en présence de
sonneries de modèles différents : d’anciennes sonneries
n’ont, par exemple, que 50 ohms. Il peut alors y avoir intérêt
à adopter le montage en série et à prendre les dispositions
que nous venons d’indiquer.
L’appareil mobile peut être remplacé par un poste mural.
Dans ce cas, si le poste est muni d'un appel magnétique, une pile
locale est affectée spécialement au relais.
Si l’abonné veut avoir la possibilité d’empêcher
l’une des sonneries de fonctionner, un commutateur est placé
sur l’un des fils de cette sonnerie à l’endroit désigné
au monteur par l’intéressé.
sommaire
Installations comportant des conjoncteurs.
— Ces installations permettent de communiquer avec le réseau
de deux ou trois endroits différents et de n’utiliser qu’un
seul appareil mobile. Dans ces conditions, le cordon souple à huit
conducteurs de l’apparoil se termine par une fiche à huit
ressorts. En chacun des points où peut être branché
l’appareil se trouve un conjoncteur, sorte de jack à multiples
ressorts, dans lequel on peut enfoncer la fiche de l’appareil ; ces
conjoncteurs se présentent sous la forme de planchettes rondes
ou ovales au centre desquelles se trouve une sorte de mâchoire constituée
par les ressorts de contact et qui porte à sa périphérie
les bornes de raccordement.
 Conjoncteur à 10 bornes.
Conjoncteur à 10 bornes.
Les anciens conjoncteurs ne comportaient que huit ressorts
comme les fiches, mais dans ces conditions lorsqu'aucune fiche n’est
en prise la sonnerie (ou les sonneries) se trouve isolée. On n’utilisera
plus que les conjoncteurs à dix bornes permettant l’embrochage
des divers conjoncteurs grâce à des ressorts supplémentaires,
ce qui évite l’inconvénient que nous venons de signaler.
Quand la fiche n’est pas dans la mâchoire, les deux fils de
ligne sont en communication avec les bornes RI R2 par l’intermédiaire
de deux ressorts. De ces bornes, on passe aux bornes similaires de la
planchette, puis aux bornes L1 et L2 du deuxième poste, sur lequel
on retrouve le même dispositif de renvoi vers le troisième
poste.
En mettant la fiche dans la mâchoire, on écarte les ressorts
qui coupent la communication de la ligne avec les conjoncteurs suivants.
Installation de conjoncteurs à 10 bornes.
Si, comme le dessin l'indique, il n’y a qu’une sonnerie, elle
est placée en dérivation sur tous les postes ; puis, pour
éviter lue le poste central soupçonne une rupture de la
ligne si la fiche n est pas en prise avec l’une des mâchoires,
on établit la boucle A. entre les deux bornes de renvoi du dernier
conjoncteur.
Cependant, si la fiche n’est pas en prise,
l’abonné ne peut encore recevoir d’appel : il suffit
alors, ou de mettre une sonnerie supplémentaire dans l'endroit
désigné par l’intéressé et de la relier
aux bornes à la place de la boucle ; ou bien de relier ces bornes
à la première, ou plutôt à l’unique sonnerie,
si l’abonné ne veut pas faire d’autre dépense.
— L’emploi des conjoncteurs, dont le nombre est limité
à trois pour éviter la présence de plus de quatre
contacts à rupture supplémentaires, permet un grand nombre
d’autres combinaisons parmi lesquelles nous indiquerons seulement
les suivantes.
L’abonné peut demander, comme l’une
des planches du carnet de montage l'indique, une sonnerie dans deux des
postes. ou même dans tous les postes ; il peut alors choisir entre
deux systèmes d’appel : ou bien les sonneries doivent fonctionner
toutes à la fois, quand, bien entendu, la fiche de l’appareil
est dans l’une des mâchoires ; ou bien la sonnerie située
près du conjoncteur occupé doit seule fonctionner.
Lans le premier cas, un relais est nécessaire
: ses bornes de ligne sont en dérivation sur toutes les planchettes
comme la s°nnerie de l’installation précédente.
Toutes les sonneries sont aWs placées en dérivation sur
le circuit local du relais.
Dans le second cas, les bornes SI et S2 de toutes
les plan-dettes ne sont pas conjuguées : chaque sonnerie est indépendante
et reliée, sur chaque planchette, à ces deux bornes.
Si, enfin, l’un des postes peut se passer de
sonnerie, les bornes SI et S2 de sa planchette sont reliées à
celles du poste plus rapproché.
Mâchoire à sept contacts.
— On fabrique des mâchoires à sept contacts pour relier
les appareils portatifs, tels que les appareils Ader n° 4, aux communications
extérieures. Ces mâchoires, construites comme les précédentes,
sont habituellement encastrées dans des macarons en bois. Deux
lames correspondent à la ligne, deux autres à la sonnerie
et les trois dernières aux piles d’appel et de microphone
montées, comme hous l’avons déjà indiqué,
avec un pôle négatif unique.
Fiche â sept lames.
— Cette fiche est analogue à la fiche a quatre lames; elle
porte cinq ressorts sur sa face supérieure et
deux sur scs faces latérales; les sept ressorts communiquent avec
les sept brins du cordon souple, rattachés d’autre part aux
bornes de l’appareil portatif. Avec un certain nombre de mâchoires,
disposées dans différentes pièces et unies sur un
circuit commun, on peut transporter avec soi le transmetteur et les récepteurs,
et les installer instantanément dans un cabinet de travail, au
salon, partout enfin où l’on se tient momentanément.

sommaire
31 - Installation de deux postes en dérivation sur un commutateur
à deux directions.
— Les deux postes, mobiles ou muraux, sont indépendants; le
commutateur permet de relier le réseau à l’un ou à
l’autre.
L’abonné peut ainsi quitter le premier poste, après
avoir tourné le commutateur, et se rendre dans le local où
est situé le second. Pour parer à l’oubli de la manœuvre
du commutateur, le poste principal, ou même les deux postes, peuvent
être munis d’une sonnerie supplémentaire mise en dérivation
sur celle de l’autre.

Quand une même ligne dessert plusieurs postes
complets, le poste placé près de L'entrée de la ligne,
et susceptible de commander les autres, est le poste principal ; les autres
sont des postes supplémentaires ou postes accessoires.
Installation d’un poste principal embroché
sur un poste accessoire — Les appareils sont muraux ou mobiles.
Dans le premier poste, deux fils partent des bornes SI et S2 et, au lieu
de se rendre à la sonnerie, se dirigent sur les bornes L1 et L2
du second poste; celui-ci est monté normalement. Le premier poste
est donc embroché par la ligne qui dessert le second, et sa sonnerie
est mise en dérivation sur celle de ce dernier.

Quand on décroche les téléphones
du poste principal, celui-ci n’a plus aucun rapport avec le second,
puisque le circuit de réception d’appel est coupé par
le crochet-commutateur.
En plaçant un interrupteur sur l’un
des fils de la sonnerie du premier poste, on donne à l’abonné
la faculté de couper le circuit de cette sonnerie quand il quitte
le local où se trouve ce poste. Ce système
de montage évite l’emploi du commutateur double de l’installation
précédente et supprime du même coup l'inconvénient
d’oublier de manœuvrer cet organe.

32 - Installation des postes dans les cabines publiques.
—- Indépendamment des postes particuliers installés
chez les abonnés, des cabines pourvues d’un poste téléphonique
sont mises à la disposition du public. Ces cabines peuvent se trouver
:
1° Dans la salle d’attente des différents
établissements des Postes et des Télégraphes d’une
même ville. Dans ce cas, les cabines sont reliées, comme
des postes d’abonnés, au bureau Central téléphonique
delà ville ;
2° Dans la salle d’attente de l’unique
bureau d’une ville possédant un réseau urbain. La cabine
est reliée au poste central bureau même ;
3° Dans une localité ne possédant
pas de réseau urbain. La cabine est reliée à un bureau
par un circuit interurbain. L’installation comportant alors des dispositifs
spéciaux, nous l’étudierons plus loin.
Installation d’une cabine dans un établissement
relié à bureau central téléphonique.
— Dans les établissements trés peu importants, comme
les bureaux de poste auxiliaires, par exemple, l'installation se réduit
à un poste simple, cest-à-dire à un appareil avec
appel magnétique, monté dans ta cabine, et à une
sonnerie placée dans la salle, Mais, quand ta service est plus
important, l'installation est complétée par un poste de
guichet.
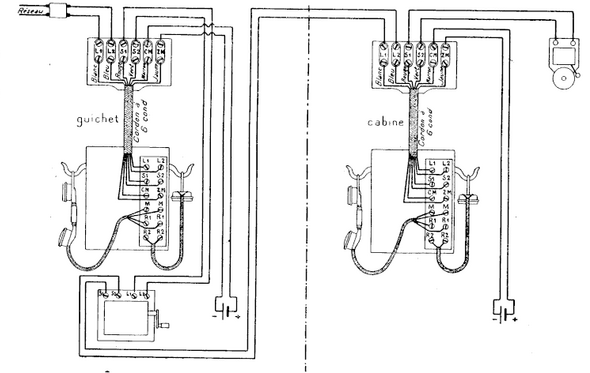
Installation d'un poste de cabine et d'un poste de guichet.
L’appareil de ce poste est placé, soit sur la tablette d’un guichet, soit sur une table près de laquelle se tient la péroné chargée du service téléphonique. Embroché sur la ligne qui aboutit à la cabine, le poste de guichet est pourvu d’un appel magnétique. Le préposé attaque le bureau central et transmet la demande du client ; dès que la communication est donnée, il raccroche son récepteur pour rendre la ligne à la cabine ; enfin, quand la conversation est terminée, il donne le signal de fin.
Dans les installations établies antérieurement à 1911, le poste de la cabine était pourvu d’un moyen d’appel (pile ou appel magnétique) qui n’existe plus dans le montage indiqué ici.
Installation d’une cabine dans un bureau de poste
central.
Si la salle d’attente n’est séparée du local où
se trouve le poste central que par les guichets, la cabine est munie simplement
d’un appareil avec sa pile microphonique. Il n’y a en effet,
nul besoin d’organes de transmission ou de réception d’appel,
puisque la communication entre la cabine et une ligne quelconque est établie
sur le tableau-commutateur au moment voulu.
Si le poste central est installé dans une salle
complètement séparée des guichets, une ligne locale,
sur laquelle est embroché un poste de guichet, est établie
entre le poste central et la cabine.

Pour constituer la pile d’appel du poste de
guichet, on prend le nombre nécessaires d’éléments
sur la pile d’appel du poste central.
sommaire
POSTES D’ABONNÉS RELIÉS AUX BUREAUX A BATTERIE CENTRALE OU AUTOMATIQUES
33 - Principe de la batterie centrale.
— Les appareils d’abon-nes que nous avons étudiés
jusqu’alors comportent une source de courant d’appel et une
source de courant microphonique. dans les premiers appareils construits,
la source de courant d’appel était constituée par une
batterie de piles à liquide et nous avons vu que par son humidité
et, par suite, sou mauvais isolement, elle pouvait amener des perturbations
dans les communications telles que friture et affaiblissement. Dans les
appareils plus récents, en vue de s’affranchir de ces incontinents,
la source de courant d’appel a été constituée
par une magnéto et a permis de recourir à des schémas
plus simples, commutation par court-circuit au lieu de commutation par
double rupture ; mais bien que la magnéto constitue un procès
considérable, elle coûte relativement cher.
La source de courant microphonique est, dans tous ces appareils, constituée par une pile à liquide immobilisé qui est d’un prix élevé, surtout si on le rapporte à la capacité en ampère-heure de la pile, c’est-à-dire, plus simplement, au nombre d'heures de service qu’elle est capable de fournir avant mise au rebut. De plus, dès que la pile commence à s user, sa résistance intérieure croît lentement et, par suite, le courant d’alimentation du microphone diminue et il en résulte une baisse progressive de l’efficacité a la transmission du poste de l’abonné, donc de la qualité des communications; Pour éviter cet inconvénient, les piles exigent des vérifications fréquentes, donc des déplacements de monteurs et on conçoit que, dans les réseaux importants, par suite du grand nombre de piles en service chez les abonnés, l’entretién en soit très onéreux.
Enfin, les postes à batterie locale obligent l'abonné à faire une manœuvre spéciale pour appeler le bureau et pour le prévenir de la fin d’une communication. Il est fréquent que l’abonné oublie cette seconde manœuvre, d’où nécessité pour l’opératrice du bureau de se porter en écoute, ce qui lui fait perdre du temps et diminue son rendement.
On a donc recherché pour les réseaux importants un système qui permette de s'afïranchir de ces multiples inconvénients.
Si, en particulier, au lieu de disposer comme sources de courant microphonique des piles placées chez les abonnés, nous utilisons une source unique placée au bureau central, une batterie centrale, la surveillance de cette batterie unique sera facile. De plus, puisqu’elle doitservirpour tous les abonnés, elle devra avoir un grand débit et son importance permettra de la constituer avec des accumulateurs dont les frais d’entretien sont considérablement plus faibles que pour des piles puisqu’ils sont régénérables, c’est-à-dire peuvent être rechargés. On aura une alimentation constante des microphones. Par contre, il y a lieu de remarquer que, pour que l’alimentation du microphone soit suffisante malgré la résistance de la ligne, il y a lieu d’utiliser des tensions assez élevées, 24 ou 48 volts.
Si la tension de la batterie est appliquée en permanence
sur la ligne de l’abonné, le courant ne devra néanmoins
passer que lorsque l’abonné est à l’appareil et
nous obtiendrons ce résultat en fermant la ligne par l’intermédiaire
du crochet commutateur; si nous intercalons au bureau central un relais
entre la batterie et la ligne, ce relais ne sera parcouru par du courant
et, par suite, n’attirera son armature que quand l’appareil
sera décroché ; nous pouvons utiliser l’attraction
de l’armature pour fermer le circuit d’une lampe qui s’allumera
par suite au moment du décrochage, signalant ainsi l’appel
de Abonné, sans imposer à, ce dernier une manœuvre
spécilale.
Central 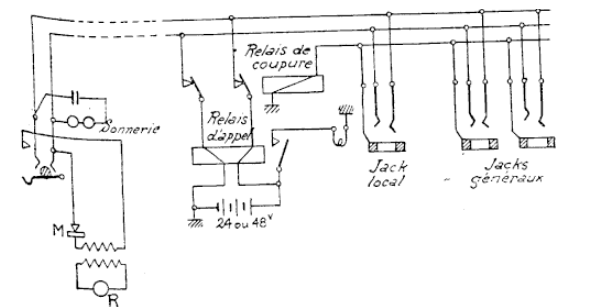 Poste
Poste
Principe d'une ligne d'abonné à B. C.
De meme, pendant la durée de la communication, des relais convenablement placés au bureau sur les lignes des deux correspondants ou sur le dicorde et commandant des lampes, permettront de se rendre compte de la position des récepteurs, donc de la marche de la communication sans que l’opératrice ù se porter en écoute. Lorsque, la communication termiée les deux abonnés raccrochent, les relais de surveillance encore relais de supervision) reviennent au repos et donnent le signal de fin, sans manœuvre spéciale des abonnés et par suite sans oubli possible. La ligne de l’abonné doit être ouverte tant que le récepteur est accroché, c’est-à-dire que le courant continu de la batterie ne peut pas passer, mais il faut cependant que l’abonné puisse être appelé et à on se servira à cet effet de courant alternatif. On placera en dérivation sur la ligne de l’abonné une sonnerie magnétique en série avec un condensateur, ce dernier organe possédant la propriété de laisser passer le courant alternatif et non le courant continu. Si la sonnerie utilisée a une grande distance, on n’aura d’ailleurs pas besoin de supprimer la dérivation ainsi mise sur le poste pendant la conversation, car pour les fréquences téléphoniques, la forte self-induction de la sonnerie s’opposera à ce que le courant dérivé par ce chemin soit appréciable et on n’atfaiblira pas de façon notable la communication. Cette considération explique pourquoi le» sonneries magnétiques ont une résistance de 1.000 ohms. Pour la même raison, lorsque plusieurs sonneries seront utilisées simultanément, elles seront montées en série.
On voit que la batterie centrale présente des avantages
con' sidérables qui peuvent se résumer comme suit :
1° Simplification des postes d’abonnés en ce qui concerne
la commutation et les organes d’appel, donc prix moins élevé,
une grande robustesse et par suite frais d’entretien beaucoup plus
faibles;
2° Simplification des manœuvres à faire par l'abonné-donc
moins grandes chances d’erreur ou d’oubli ;
3° Possibilité de donner aux opératrices du bureau la
signalisalion des manœuvres faites par les abonnés, facilitant
par suite la surveillance des communications et
la libération des lignes en fin be conversation.
Poste simple, avec appa reil mural, relié
à un bureau à batterie central.
34 - Montage des postes simples.
— Pour adapter la batterie centrale aux anciens appareils, on plaça
la sonnerie magnétique et son condensateur, comme la sonnerie ordinaire,
entre les bornes SI et S2 des appareils; mais, pour permettre au bureau
de rappeler un abonné qui oublie de raccrocher son récepteur,
ces organes ont ensuite été montés en dérivation
sur les bornes de ligne.
. 
SCHÉMA DE MONTAGE D'UN ANCIEN
POSTE D'ABONNÉ. TRANSFORME POUR LA BATTERIE CENTRALE.
— L, ligne. — L1, L2,. bornes de ligne. — S1,
S2, bornes de sonnerie. — C, condensateur. —- S, sonnerie
magnétique.
— Cr. crochet-commutateur fermant le circuit de ligne par le contact
c et le circuit primaire par les contacts a et b. — R, récepteurs.
— I, bobine d'induction. — T, transmetteur. — ZM, CM.
bornes de la pile microphonique PM.

La règle actuelle, quand l’appareil
est mural, est de mettre la sonnerie et son condensateur en dérivation
sur le coupe-circuit-Puratonnerre.
Toutefois, si celui-ci est trop éloigné du poste, la dérivation
est encore prise sur les bornes de ligne; Quelquefois même, si la
distance est trop grande et si la sonuerie se trouve sur le parcours,
on peut, exceptionnellement, prendre la dérivation sur les fils
au moyen de ligatures faites avec soin. Si le poste
est pourvu d’un appareil mobile, la sonnerie condensée est
mise eu dérivation sur les plots de ligne de planchette de raccordement.
Quand plusieurs sonneries doivent fonctionner séparément,
deux par exemple, un condensateur seulement est placé en avant
du commutateur qui commande ces sonneries.
Enfin, qu'il n’y en ait qu’une, ou plusieurs
montées en série, toutes les fois que
l’abonné veut empêcher une sonnerie
de fonctionner, cet organe doit être, non coupé, mais coürt-circuité
(nous enverrons plus loin la raison). A cet effet, uu commutateur permet
de réunir métalliquement, au moment voulu, les deux bornes
de la sonnerie intéressée (fig ci dessus).
35 - Postes à B. C. I.
— Toutefois, l’utilisation d’appareils a batterie locale
ne permet pas la suppression de la pile microphonique, suppression qui
est cependant d’un gros intérêt comme nous l’avons
vu et, de plus, le courant de la batterie centrale passe en permanence
dans les récepteurs de l’abonné durant les conversations.
Ce courant continu tend à désaimanter ou à suraimanter
l’aimant permanent, c’est-à-dire à désensibiliser
ou à faire « coller » les membranes.
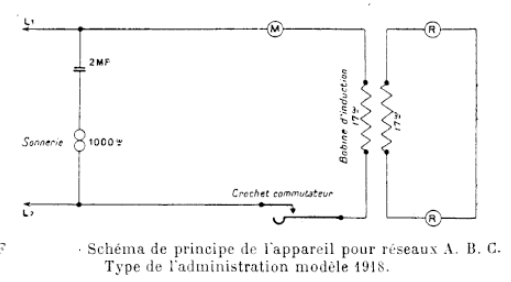
Divers montages ont été proposés pour oublier à
cet inconvénient, mais ils ne sont pas très efficaces, ou
bien ils compliquent l'installation du poste.
C’est pourquoi tous les appareils nouvellement installés sont
Montés en batterie centrale intégrale (B. C. I.)
Les postes d’abonnés sont simplifiés
au maximum ; il n’y a plus qu’un ou deux contacts mobiles. Les
dérangements et l'entretien s’en trouvent extrêmement
réduits.
 PTT 1910 pour
batterie centrale ,
PTT 1910 pour
batterie centrale ,  Jacqueson.
Jacqueson. Thomson,
sur certains centres manuels. Cependant il subsistait encore chez le client
une batterie nécessaire pour alimenter le microphone dans le cas
ou le centre manuel ne pouvait fournir l'alimentation du courant microphonique
des téléphones BL à batterie locale
(bornes Zm et Cm sur le schéma).
Thomson,
sur certains centres manuels. Cependant il subsistait encore chez le client
une batterie nécessaire pour alimenter le microphone dans le cas
ou le centre manuel ne pouvait fournir l'alimentation du courant microphonique
des téléphones BL à batterie locale
(bornes Zm et Cm sur le schéma).
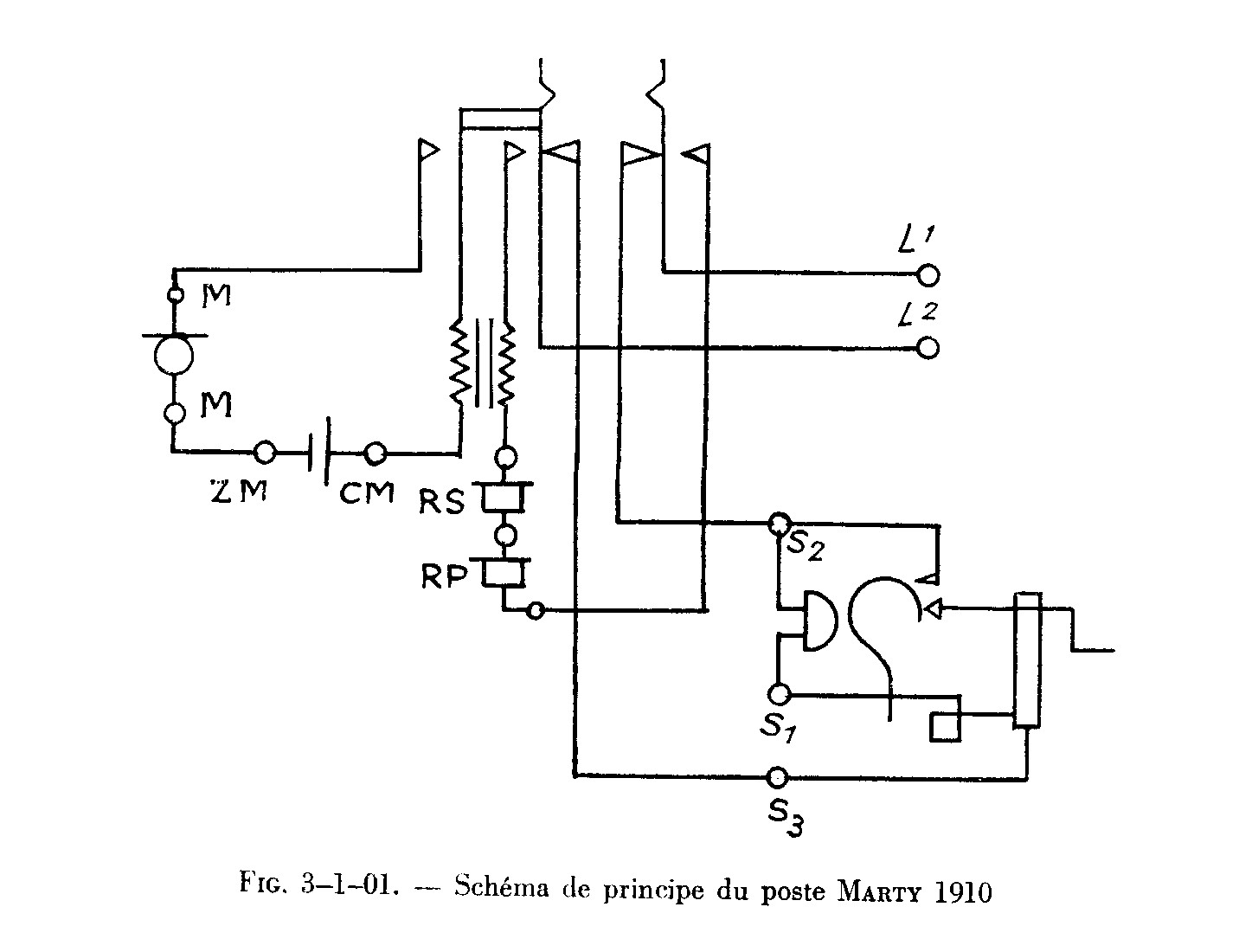 Schéma
du 1910
Schéma
du 1910  Grammont
Grammont Sit
Sit
Plus tard en 1912 l'administration prescrit la modification
des appareils Pasquet en court-circuitant le circuit secondaire à
double rupture
Obligation pour les constructeurs de relier les fils de liaisons à
l'intérieur de l'appareil et suppression des bornes extérieures.
sommaire
36 - Poste mural à B. C. I. modèle 1918.
— Le boîtier contient le microphone, le crochet commutateur,
la sonnerie magnétique et son condensateur.
Les récepteurs sont raccordés aux bornes R1R1 et R2R2, la
ligne aux ligrnes L1 L2.

Transmetteur mural à batterie centrale
intégrale, modèle 1918
 Schéma
des connexions
Schéma
des connexions
On voit que la sonnerie condensée est coustamment
en dérivation sur la ligne, et que le microphone série sur
le primaire de la bobine d’induction boucle la ligne lorsque le crochet
commutateur, libéré du poids du récépeur,
ferme le contact de droite. Quant aux récepteurs, ils sont sur
le circuit local du secondaire de la bobine d’induction à
l’abri du courant continu de la batterie centrale.
La bobine d’induction possède, comme nous l’avons vu,
deux enroulements identiques de 17 ohms de résistance et la capsule
microphonique présente une résistance d’environ 50
ohms.
37 - Applique murale à B. G. I., modèle
1918.
— La construction est tout à fait la même que pour le
précédent appareil ; mais le microphone est combiné
avec un récepteur et est suspendu au crochet-commutateur. Le principe
du montage, identique au précédent, résulte immédiatement
de la figure suivante :

Applique murale à batterie centrale intégrale, modèle
1918, pour combiné.
38 - Appareil mobile à B. G. I., modèle
1918
— Cet appareil comporte un combiné, et son montage est identique
à celui du précédent .




Après 1918 Pour les anciens systèmes
encore en batterie locale, avec l'arrivée des centraux automatiques,
le poste de l'abonné n'aura plus besoin de magnéto et de
pile, c'est simplement en décrochant le combiné du poste
que le central entrera en action pour lui passer une opératrice
dans le cas du semi automatique (cas du Rotary)
ou il numérotera lui même avec un cadran rotatif sur
le poste, composer le numéro de son choix.
En France le mot cadran n’est apparu qu’après 1925. Auparavant,
on utilise les locutions disque transmetteur ou disque automatique ou
encore, combinateur.
sommaire
39 - Disque d’appel administratif modèle 1927 pour réseaux
automatiques.
Pour les numéros parisiens notamment,
on prévoit de doter les appareils d’un nouveau
cadran associant des lettres aux chiffres permettant de composer
les numéros alphanumériques.
 (la notice) Ce modèle
de cadran équipera tous les nouveaux téléphones à
cadran à partir de cette date.
(la notice) Ce modèle
de cadran équipera tous les nouveaux téléphones à
cadran à partir de cette date.
— Un disque ou cadran d’appel pour réseaux automatiques
est un appareil qui sert à provoquer sur la un nombre d’interruptions
(impulsions) égal au chiffre evoyé, c’est-à-dire
dépendant de l’angle dont a tourné le disque. Ces interruptions
doivent être franches et se faire Sur des circuits sans self et,
d’autre part, ne doivent provoquer aucun toc désagréable
dans le récepteur. Nous trouvérons donc, en principe, deux
contacts d’impulsion (interruption) et deux contacts auxiliaires
qui court-circuitent les récepteurs, ou la bobine d’induction,
pendant tout le temps que dure l’envoi des impulsions, c’est-à-dire
tant que le disque a quitté sa position de repos. La durée
des impulsions devant être constante, 0,66 seconde d’interruption
pour 0,33 de passage du courant, il est indispensable que l’envoi
soit indépendant de la rapidité apportée par l’abonné
dans la manœuvre du disque ; il se fera donc pendant le retour au
repos de ce dernier et la vitesse de ce retour sera maintenue constante
par un régulateur.


Sur l’axe principal sont fixés, d’avant en arrière
:
1° Un disque mobile M percé de dix trous qui, au repos, découvrent
les chiffres numérotés de 1 à 9 et 0 et des lettres.
En engageant le doigt dans l’un de ces trous, on peut faire tourner
ce disque jusqu’à ce qu’une butée fixe I arrête
le doigt et limite ainsi l’angle de rotation à une valeur
correspondant à chaque chiffre ;
2° Une sorte d’étoile à quatre branches qui porte
un cliquet CI armé par un ressort à boudin dont nous verrons
le rôle plus loin ;
3° Un ressort à boudin Ré fixé d’une part
sur l’extrémité de l’axe et d’autre part
sur le boîtier fixe. Ce ressort armé par la rotation du disque
tend à le ramener au repos;
4° Un système comportant deux butées B et b. La butée
b s’appuie au repos sur un poussoir isolant et maintient séparés
les trois contacts de droite, mais tant que le disque n’est pas au
repos, les trois ressorts sont en contact : ce seront donc les ressorts
de court-circuit. Nous verrons plus loin le rôle de B.
5° Une roue à rochet Ro et une grande roue dentée sont
montées'sur le même axe, mais à frottement doux, et
peuvent par suite tourner librement. Lorsqu’on arme le disque, le
cliquet Cl glisse sur les dents de la roue à rochet sans l'entraîner
et, au contraire, pendant le retour au repos, il entraîne les roues
Ro et R cl dans son mouvement.
Un axe secondaire porte d’avant en arrière :
l° Un pignon denté Piqui engrène avec la roue Rd précédente
;
2° Un engrenage hélicoïdal qui engrène avec une
vis sans fin Rg portée par le régulateur de vitesse :
3° Une came en matière isolante C qui, dans sa rotation, viendra
rompre le contact des deux ressorts de gauche.
Le régulateur est constitué par deux masselottes fixées à s ressorts portés par l’arbre de la vis sans fin. Sous l’action e la force centrifuge pendant la rotation, ces masselottes ‘partent et viennent frotter sur la paroi intérieur d’un tamour cylindrique. Le frottement limite la vitesse de rotation.
Il y a lieu de noter que l’utilisation d’une
vis sans fin présente deux avantages:
1° on obtient ainsi une grande multiplication de vitesse, puisque
à un déplacement d’une dent de Pr et Rd correspond
à un tour entier de la vis sans fin et, grâce à cette
vitesse, on a ainsi une régularité plus grande de la rotation
;
2° la vis sans fin est irréversible, c’est-à-dire
qu’elle ne peut tourner que dans un seul sens; par suite, pendant
qu’on arme le disque, on ne risque pas que le cliquet Gl par frottement
entraîne la roue à rochet R0 et par suite la came C. La came
Cne peut donc tourner que pendant le retour au repos disque. La came C
effectue un demi-tour chaque fois que le disque tourne d’un angle
tel qu’un trou se substitue au précédent et cecésultat
est obtenu par le rapport du nombre de dents de et Pr et Rd qui est de
1 à 7.
Or l’angle entre le trou
1 et la butée fixe D étant égal à celui qui
sépare quatre trous, on voit que le retour au repos, lorsqu’on
a fait le chiffre 1, se traduiraitpar l’envoi de quatre impulsions
; de môme l'envoi d’un autre chiffre se traduirait par l’envoi
de trois impulsions supplémentaires. Mais ces rois interruptions
ne se produisent pas, car la butée B dans retour au repos vient
écarter les ressorts d’impulsion et ermpêche par suite
la came C, qui continue à tourner, de séparrer les ressorts.
On a ainsi nécessairement un temps mort de
trois impultions qui sépare l'envoi d’un chiffre de l’envoi
du chiffre suivant et ceci pour créer un intervalle indispensable
entre l'envoi des différents chiffres.
Pratiquement, quatre fils sont nécessaires
pour connecter le cadran sur un poste et l’un des ressorts d’impulsion
est raccordé directement au premier ressort de court-circuit.
(voir d'autres informations à la page cadran)
sommaire
40 - Appareils modèle 1924.
— Les progrès de la technique téléphonique ont
conduit l’Administration des P. T. T. a adopter un nouveau type d’appareils
destinés à remplacer les appareils modèle 1918 dans
tous les réseaux à batterie centraie ou réseaux automatiques.
L
es directives qui ont guide le choix de cet appareil sont les suivantes
:
1° Avec la généralisation des
communications à grande distance, il est indispensable que les
appareils aient une éfficacité à la transmission
et à la réception aussi grande que possible ;
2° Ces appareils doivent être préparés
pour recevoir un disque d’appel qui est, comme nous venons de le
voir, l'organe qui, dans les réseaux automatiques, permet aux abonnés
de composer eux-mêmes le numéro demandé ;
3° Dans les réseaux automatiques, l’envoi
du numéro se traduisant par des interruptions de courant sur la
ligne, aucune interruption du circuit ne doit être possible en dehors
de la manœuvre du disque ou du raccrochage du récepteur sous
peine de fausser le numérotage. Il convient en particulier que
le microphone n’introduise pas de telles ruptures du circuit de ligne,
quelle que soit sa position pendant la conversation. On peut d’ailleurs
noter que si l’interruption se produit après l’envoi
complet du numéro demandé, elle a pour résultat de
déconnecter l’abonné demandeur, c’est-à-dire
de couper la communication.
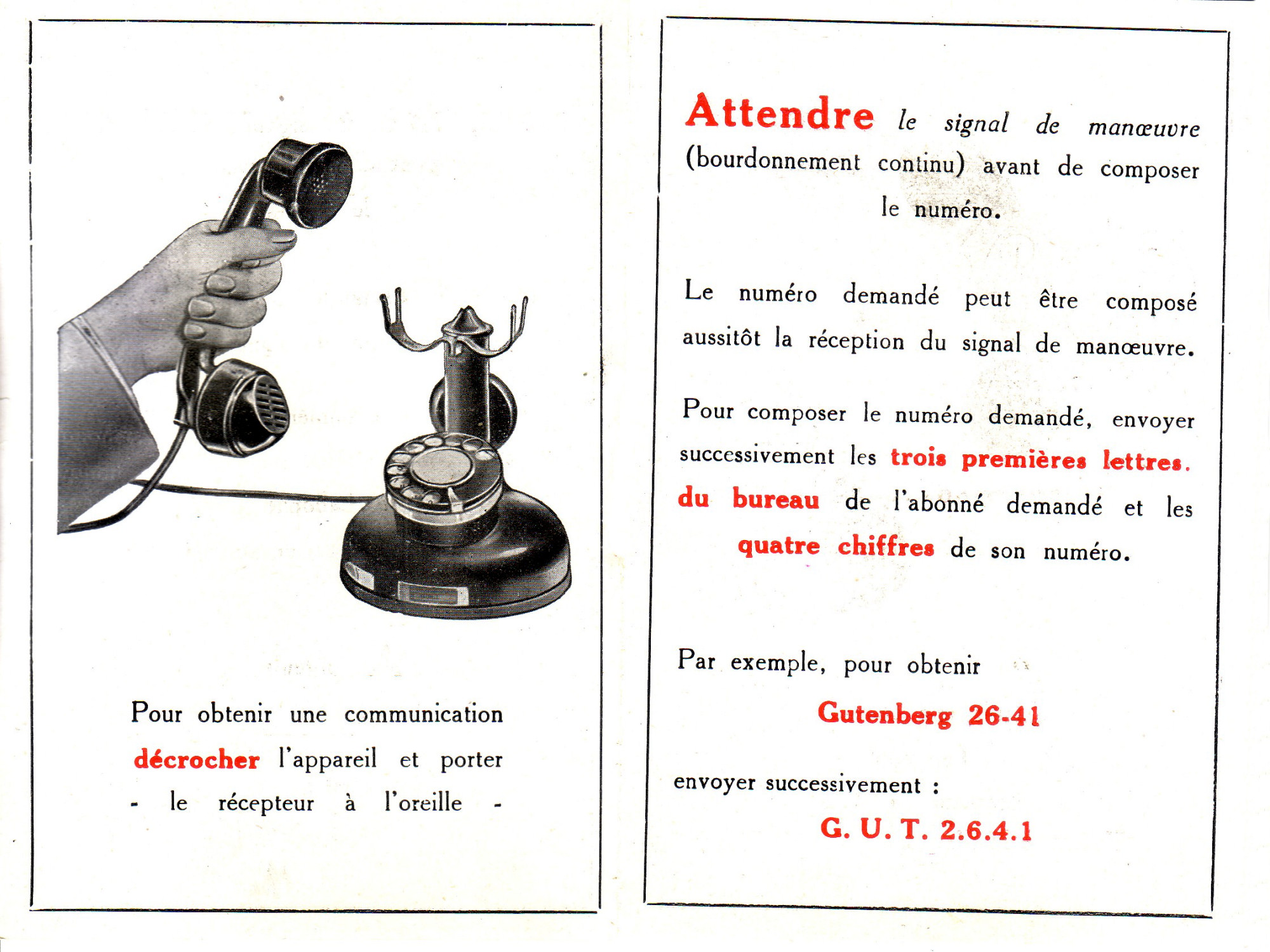

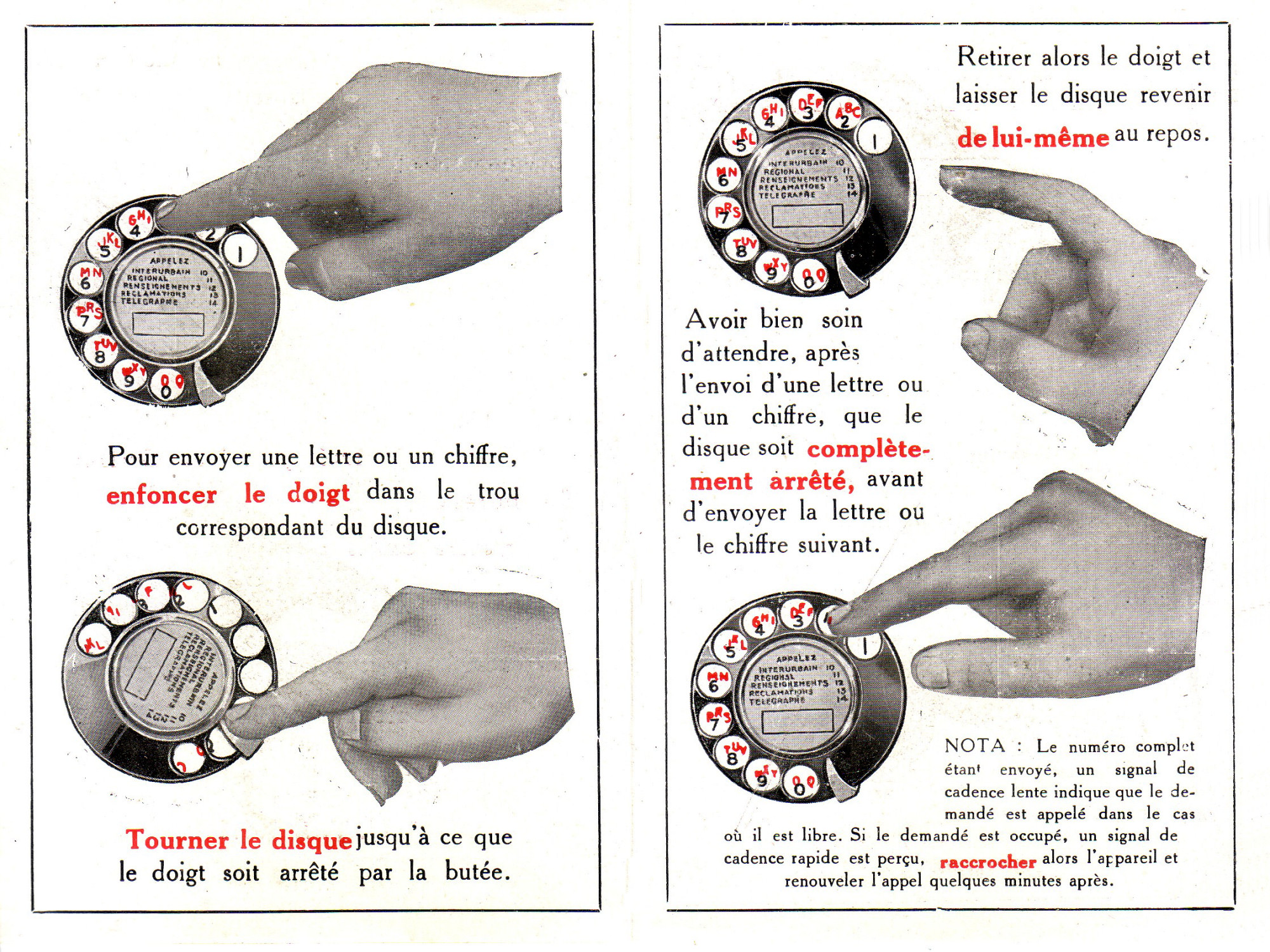
Les impulsions du numérotage ne doivent pas
faire tinter la sonnerie, ce qui se produirait à coup sur si celle-ci
était montée simplement en dérivation sur les deux
fils ; ces impulsions ne doivent pas davantage provoquer des tocs désagréables
dans les récepteurs qui, à cet effet., seront court-circuités
pendant l’envoi des impulsions.
On voit que ces diverses considérations imposent
un mode de construction ou de montage qui n’était pas prévu
pour les appareils, modèle 1918, et que, malgré les qualités
de ce type, il était nécessaire d’en créer un
nouveau.
Le schéma de principe de l’appareil, modèle
1924, est conforme à la figure suivante :


Schéma de principe de l’appareil avec combiné pour
réseaux à B. G. type de l’Administration, modèle
1924.
Au moment du décrochage, le crochet-commutateur ferme les contacts
; ces contacts sont échelonnés de façon à
éviter la production de tocs dans le récepteur. Le contact
supérieur boucle la ligne sur le microphone M, le récepteur
R, l'enroulement de 13w,5 de la bobine d’induction et suivant la
position d’une connexion mobile à travers une résistance
de 300, 200, 100 ohms ou nulle, ce qui permet de régler l’intensité
dans le microphone et surtout dans le récepteur électromagnétique
qui, comme nous l’avons vu, se trouve dans les meilleures conditions
lorsqu’il est traversé par un courant de 50 à 60 milliampères.
En dérivation sur le récepteur électromagnétique
de 23 ohms sont montés un récepteur supplémentaire
magnétique dont la résistance varie entre 400 - 500 ohms
et le secondaire de la bobine d’induction de 625 ohms de résistance.
Dans ces conditions, la presque totale du courant continu traverse le
récepteur électromagnétique.
Le deuxième contact du crochet-commutateur
met en dérision sur le microphone le troisième enroulement
de 7w,4 de bobine d’induction en série avec le condensateur
de 2 microfarads .
Lorsque le crochet-commutateur est abaissé, ce même condensateur
se trouve en série avec la sonnerie magnétique de 1000 ohms.
On peut noter d’ailleurs que, si le deuxième contact du crochet
n’est pas rompu au raccrochage, la sonnerie se trouve shuntée
par 7W,I, récepteur de 23 ohms — 13w,5 et résistance
additionnelle si le poste en comporte une intercalée. Par suite,
la sonnerie pourra ne pas fonctionner.
La présence d’un troisième enroulement
sur la bobine permet d’obtenir un effet antilocal à la transmission
en même temps qu’un effet de renforcement à la réception
(Voir 32» bobine d’induction).
Le micro est cette capsule interchangeable perfectionnée
par M.Marzin, Ingénieur des PTT.
 Capsule
micro
Capsule
micro  Prise
3 broches
Prise
3 broches
Examinons maintenant le cas où l’appareil sera
pourvu d’un disque d’appel.
Cet organe comporte quatre ressorts dont deux établissant un contact
de repos sont intercalés entre le microphone et le crochet-commutateur
et les deux autres par un contact de travail court-circuitent les récepteurs
pendant l’envoi d’un train d’impulsions correspondant à
un chiffre. On peut donc représenter schématiquement le
circuit d’impulsions.

On voit que la sonnerie est shuntée par 13w,5 +
7w,4 et la résistance additionnelle mise en circuit (s’il
y a lieu) ; par conséquent, quand le contact d’impulsions
s’ouvre, l’énergie magnétique emmagasinée
dans la sonnerie de 1000 ohms (qui a une forte impédance, donc
emmagasine une forte énergie) tendra à se dépenser
dans le circuit local ainsi constitué sous forme d’un courant
dans le même sens que celui qui parcourait la sonnerie avant la
rupture et, par suite, la polarité des noyaux n’étant
pas changée, l’armature ne vibrera pas.
Le condensateur et l’enroulement de 7w,4 constituent
le circuit de choc (ou pare-étincelle).
41 - Appareil mural, modèle 1924, à combiné.
— Cet appareil est constitué par un coffret en tôle
émaillée noire dont le le fond peut être fixé
au mur et supporte une réglette de con-nexion à quatre bornes
L et S, le condensateur et la bobine fi induction.
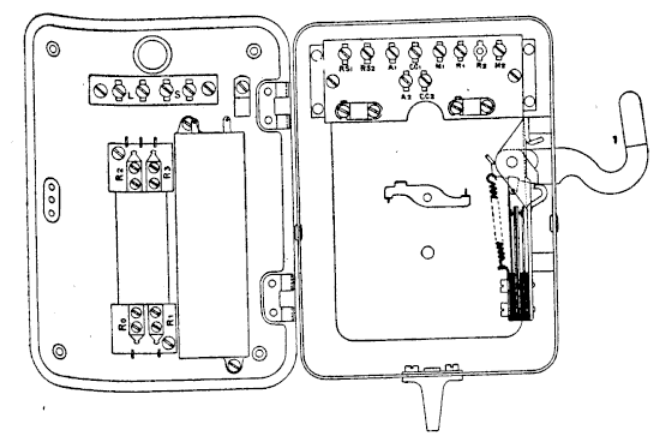
Les trois résistances de 100 ohms seront pour le réglage
de l’intensité sont fixées sur cette même bobine
et quatre bornes R0, R1, R2 et R3 permettent de fixer le bd de connexion
mobile terminé par une cosse.
La partie avant mobile sur charnière comprend
le crochet comutateur, un crochet pour le deuxième récepteur
et une réglette de connexion sur laquelle se raccordent les trois
conducteurs du cordon du combiné, les deux conducteurs du cordon
du deuxième récepteur et éventuellement les quatre
conducteurs aboutissant aux ressorts du disque d’appel fixé
sur la face avant du boîtier. Lorsque l’appareil est utilise
dans un réseau non pourvu d’un commutateur automatique! le
Irou permettant la fixation du cadran est obturé.
 Câblage
de poste murale avec combiné, type 1924.
Câblage
de poste murale avec combiné, type 1924.
Toutes les connexions du poste autres que celles
mentionnées ci-dessus sont soudées (figure ci dessus), ce
qui diminue les risques de mauvais contacts ; somme toute, les seules
connexions établies par cosses et vis correspondent aux organes
dont le remplacement peut être nécessité par détérioration
: combiné, deuxième récepteur et disque ainsi que
les fils de ligne et de sonnerie pour permettre le montage sans utiliser
de fer à souder. Lorsque le coffret est ouvert,
tous les organes sont facilement accessibles.
sommaire
42 - Appareil mobile, modèle 1924, à combiné.
— La bobine d’induction, le condensateur et les réglettes
de raccordement sont fixés à l’intérieur du
socle en tôle émaillée..


A la partie supérieure d’une colonne également en tôle
émaillée qui surmonte le socle se trouve fixé le
crochet-commutateur dont les ressorts sont logés dans la colonne.
Le crochet-commutateur a la forme d’un T dont chacune des branches
est terminée par une fourche. Le combiné se pose à
plat dans les deux fourches. Le disque d’appel peut se fixer sur
le smtele dans un trou ménagé à cet effet et qui
est obturé dans le cas où le disque n’est pas utilisé.
La base est fixée au socle par trois vis qu’il suffit de dévisser
pour pouvoir vérifier tous les organes du poste.

En dehors de ces dispositions matérielles, les remarques faites
sur l’appareil mural s’appliquent également à
l’appareit mobile.
Un cordon souple à trois conducteurs permet de relier l'apareil mobile à une rosace de raccordement sur laquelle arrivent d’autre part les fils de ligne et de sonnerie.
Le micro Solid-Back
| L’adhérence
entre la plaque vibrante F et le microphone est assurée par
une tige filetée appartenant à ce dernier; cette tige
traverse un trou percé au centre de la plaque, et un double
écrou se visse, par dessus. Le microphone est une petite boîte en laiton dont le fond et le couvercle sont garnis de disques de charbon polis avec le plus grand soin ; une bande de papier est collée sur le pourtour. Entre les deux disques de charbon, la grenaille de graphite est emprisonnée dans la boîte. Voici comment : Le fond de la boîte est figuré en i il est traversé par un téton sur lequel le disque de charbon a été soudé après avoir été préalablement cuivré par l’électrolyse sur la face qui n’est pas polie. Le couvercle est formé par le second charbon, soudé de la même manière sur la pièce de laiton k. Sur celte pièce, qui se termine par la tige filetée J, est vissé l’écrou e; mais entre les deux est intercalée une rondelle de mica qui repose sur la boite i; une bague est vissée par dessus et assure la fixité du système, tout en lui laissant une grande élasticité. Ainsi que nous l’avons dit, la tige filetée J traverse la plaque vibrante, qui est serrée sur la pièce k par les deux écrous. Le téton j est enfoncé dans le pont H et immobilisé par la vis K; le pont H lui-même est fixé par quatre vis sur le boîtier B. Sur le pont H se trouve un bloc en ébonite L, dans lequel un téton M est maintenu par la vis N. Un fil souple est soudé à l’écrou e et au téton M. De ce dernier part un autre fil conducteur souple serré sous la vis N. Ce conducteur, recouvert de soie, se termine par un œillet serré sous la tête du boulon E. Le couvercle du microphone communique donc avec le boulon E, tandis que le fond de sa boîte est en relation par le pont H avec le boîtier AB. De la sorte les prises de communication peuvent être obtenues par un crochet engagé dans la gorge d, et par un res sort appuyé sur la pointe du boulon E. C’est ainsi qu’est faite l’installation. Ces transmetteurs sont présentés par la maison Aboilard (France) et par la Western Electric C° de Chicago. |
43 - Appareils, modèle 1924, à microphone
Solid-Back et récepteur Bell.
— Il existe un appareil mural et un apport mobile de ce type.
Le schéma de principe est représenté ci dessous :


Ils conprennent un microphone Solid-Back fixé sur le boîtier
dansIe modèle rural et sur une genouillère placée
en haut de la colonne dans le modèle mobile. La bobine d’induction
ne comporte que deux enroulements de 14 ohms et de 9 ohms. Les deux récepteurs
sont du type magnétique, l’un d’enx est constitué
par un récepteur Bell, l’autre est le récepteur montre
qui existe également dans les types précédemment
étudiés.
On voit qu’une partie négligeable du
courant continu traverse les récepteurs puisque la sonnerie de
1000 ohms est montée en série avec eux et que l’ensemble
est shunté par 14 ohms. Les courants émis par le microphone
trouvent deux chemins: l’un par l’enroulement de 14 ohms et
la ligne, l'autrc traverse les récepteurs, l’enroulement de
9 ohms et le condensateur; en outre, par l’action du courant qui
traverse le premier enroulement, les courants induits dans le deuxième
circuit considéré peuvent, si le sens des enroulements est
convenable, réaliser un effet antilocal comme dans le type 1924
combiné.
Les appareils de ce type sont excellents au point
de vue de la qualité des communications qu’ils permettent,
la fixité du microphone assurant sa constance et le récepteur
Bell possédant un aimant puissant et très stable. Par contre,
ils sont d’un enaploi beaucoup moins pratique que les appareils à
combiné.
Les dispositions des organes : condensateur, bobine
d’inaction et réglettes de raccordement à l’intérieur
du boîtier de ces appareils sont les mêmes que pour les appareils
à c°ntbiné.
44 - Installations diverses réalisées
avec les postes, modèle 1924.
1° Un seul appareil avec deux sonneries fonctionnant simultanément,
les deux sonneries sont montées en série. Si l’on désire
mettre en service l’une ou l’autre des deux sonneries seulement
par un commutateur, il suffit de monter ce commutateur pour court-eircuiter
l’une ou l’autre des sonneries.
 Fig A
Fig A
Installation d'un poste mural, type 1924, avec sonnerie supplémentaire
commandée par un commutateur.
 Fig B
Fig B
Même disposition du commutateur et des sonneries quand l'installation
comporte deux postes mobiles.

Installation de deux postes muraux, type 1924 montés sur commutateur
avec une seule sonnerie.
2° Deux appareils en dérivation permanente avec une seule
sonnerie; les bornes L des deux appareils sont montées en dérivation
sur la ligne et la sonnerie reliée aux bornes S de l’un d’eux
(Fig A); on relie en outre les bornes S2 des deux appareils .
3° Deux appareils en dérivation permanente avec deux sonneries
: l’installation est analogue à la précédente,
mais les deux sonneries sont montées en série (Fig B);
sommaire
45 - Conjoncteurs, type 1924, pour appareils à batterie centrale.
— Nous avons étudié précédemment les
conjoncteurs a dix bornes utilisés avec les appareils à
batterie locale; les appareils à batterie centrale étant
beaucoup plus simples que les précédents, les conjoncteurs
utilisés ne comporteront que cinq bornes.
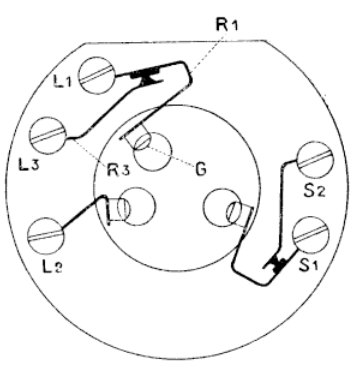

Schéma des connexions d’une mâchoire, 1 type
1924, pour appareil A. B. C. 1.
La mâchoire, type 1924, est constituée
par un bloc de bakélite moulée, percé de trois trous
dans lesquels peut s’engager une fiche triple ; ces trois trous sont
disposés aux sommets d'un triangle isocèle ne permettant
ainsi qu’une seule positon pour la fiche.
Un ressort en maiîlechort Rx muni d'un goujon
rivé G en maillechort est fixé par son extrémité
recourbée sous mi écrou et le goujon déborde à
l’intérieur du trou de façon à être écarté
lors de l’enfoncement de la fiche. Un second ressort en maille-chort
R3 muni d’une goutte d’alliage or-ar-gent est fixé sur
le socle comme Rx par un écrou vient au repos
s’appuyer sur R1; ce contact sera rompu lors de l’enfoncement
d’une fiche; deux écrous marqués L1 et L2, permettent
de connecter les fils à ces deux ressorts.
La borne L2 est reliée à un ressort analogue au précédent
R1, mais ne comporte pas de contact à rupture. Le support est enfermé
dans un boîtier muni d’un couvercle dont le centre est évidé
pour laisser passer les fiches; ces deux pièces sont en laiton
émaillé noir.
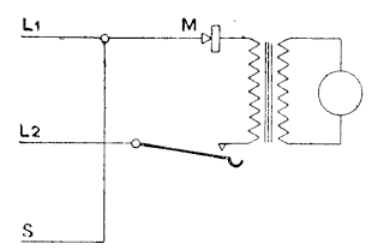
Schéma de raccordement d’un poste mobile à B. C. 1.,
type 1924, et d’une fiche pour mâchoire, type 1924.
La fiche triple comporte trois broches en laiton fixées sur une pièce en bakélite; des vis permettent de serrer sur les broches les brins d’un cordon souple à trois conducteurs. Un couvercle émaillé protège les connexions et à l’intérieur se trouve une barrette qui bloque l’extrémité du cordon de façon à ce que les efforts de traction soient supportés par la tresse et non par les brins conducteurs.
sommaire
46 - Installation de postes mobiles, modèle 1918, avec conjoncteurs,
modèle 1924.
— Les deux bornes L de l’appareil sont reliées aux deux
bornes L de la fiche, la borne S de la fiche étant reliée
dans l’intérieur de celle-ci à la borne L1.


1° Cas d’une seule sonnerie (Voir fig. 138) ;
2° Cas de trois sonneries : la sonnerie principale
est tou-jours en circuit et éventuellement celle correspondant
aujack dans laquelle la fiche est en prise (fig. 139);
3° Cas de deux sonneries : la sonnerie principale
est toujours èn circuit et la sonnerie supplémentaire quand
une fiche est enfoncée dans un des jacks 2 ou 3 (fig. 140);
4° Cas de trois sonneries : la sonnerie correspondant
au jack utilisé est seule en circuit. Quand aucune fiche n’est
en prise, la première sonnerie est utilisée (fig. 141);
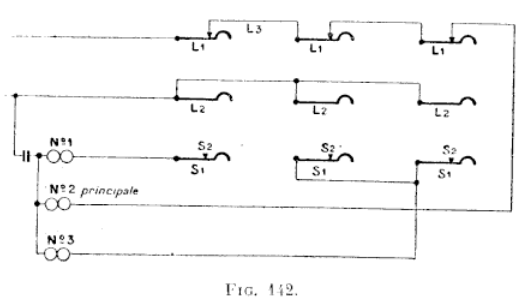
5° Cas de trois sonneries : la sonnerie principale est en service quand aucune fiche n*est en prise. La sonnerie n° 1 est utilisée quand la fiche est enfoncée dans le jack n° 1, la sonnerie n° 3 quand la fiche est enfoncée dans les jacks nos 2 ou 3 (fig. 142).
47 - Installation de postes mobiles, modèle
1924, avec conjoncteurs, modèle 1924.
— Les trois bornes L1L2 et S de l’appareil mobile sont réunies
aux trois bornes correspondantes de la fiche (fig. 143).

Le condensateur étant à l’intérieur des postes,
on est conduit, dans ces installations, à mettre un condensateur
supplémentaire sur les jacks pour éviter que le ligne soit
ouverte lorsque la fiche n’est pas en prise.


Les figures 144 à 1-48 donnent les schémas
de principe des installations à réaliser dans les cinq cas
déjà étudiés avec l’appareil 1918.
48 - Installation de postes à B. C. avec conjoncteurs
à dix bornes.
— Avant la création des conjoncteurs, modèle 1924,
on utilisait pour le montage des postes, modèle 1918, à
B. G., des conjoncteurs à dix bornes dont seules les bornes L,
R et S étaient utilisées.
On peut citer, à titre d’exemple, deux
types d’installations réalisées avec ces conjoncteurs
en admettant que chaque con-joncteur est pourvu d une sonnerie condensée.
1° L'abonné veut recevoir l'appel, même
si la fiche de son appareil n'est pas engagée dans la mâchoire.
Les bornes de renvoi du dernier conjoncteur sont reliées à
une sonnerie c°udensée qui peut être celle de ce conjoncteur,
ou une autre s°nnerie indiquée par l’abonné;
2° L'abonné ne veut pas recevoir l'appel
quand la fiche n'est pas en prise. On a vu précédemment
que, pour éviter de hisser une ligne ouverte, on boucle les bornes
de renvoi du dernier conjoncteur dans le cas où l’abonné
ne veut pas de sonnerie d’oubli. Or, en batterie
centrale, la ligne etant normalement ouverte, il paraît
ne pas y avoir d’inconvénient à laisser ces deux borues
sans emploi ; toutefois la capacité de 2 micro-farads d’un
condensateur pouvant être constatée par les appareils de
mesure du burean central, et indiquer ainsi la non-réponse
d’un abonné n’est pas due à une interrupytion
de là ligne, on a jugé préférable, quand l’abonné
ne veut pas recevoir l’appel, de mettre un condensateur entre ces
bornes.
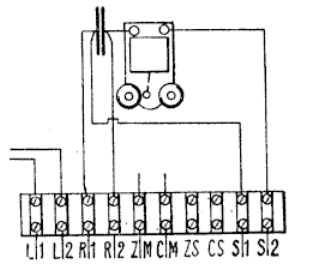
Ce condensateur peut être celui de la sonneirie la plus rapprochée;
mais si l'utilisation de celui-ci uécessite une trop grande longueur
de fil, on pose un condensateur supplémentaire près de la
planchette de raccordement.
49 - Appareil à
prépaiement pour réseau B. C. (le taxiphone).
Au repos, la ligne est bouclée sur un
condensateur; si 1 on doit pouvoir appeler la cabine, une sonnerie magnétique
se trouve intercalée en série avec le condensateur.

Au décrochage, la ligne se trouve bouclée sur une self à
^ux enroulements (500-500 ohms), mais la terre du relais d'appel au bureau
central ayant été supprimée, ce dernier n'ctionne
pas. Si le demandeur introduit une pièce de valeur Co,,respondant
à la taxe urbaine, cette pièce, si son poids est suffisant,
tombe et ferme les contacts 1-2 et 3-4; le contai 1-2 met une terre sur
les deux fils de ligne en parallèle et provoque l’allumage
de la lampe au central. L’opératrice répond en enfonçant
la fiche d’un dicorde modifié pour inverser le courant à
la réponse du demandé. L’abonné peut formuler
sa demande dans le microphone M, le sens du courant dans le relais polarisé
R ne le faisant pas fonctionner. Le relais R, dont l’impédance
est élevée, est shunté par le condensateur C. Dès
que l’abonné demandé répond, le courant étant
inversé sur la ligne du demandeur par le fonctionnement du relais
de supervision de la fiche d’appél, le relais h fonctionne
et le microphone M est court-circuité par 3-4 l’armature du
relais R. En pressant sur un bouton A (non représenté),
la pièce P tombe dans la caisse, le microphone auxiliaire M a est
impressionné par le bruit de la chute qui peut alors être
perçu par l’opératrice ; le court-circuit de est ouvert
en 3-4 et, par contre, le contact 4-5 établi courcircuite le microphone
auxiliaire Ma et le relais R devenu inutiles et qui pourraient affaiblir
la communication; en même temps, le contact 1-2 s’ouvre et
supprime la terre mise au milieu de la self S. L’encaissement de
la pièce provoque le fredonnement d’un compteur dans l’appareil
même.
Eu cas de non-réponse ou d’occupation, si l’abonné
appuie sur le boulon B, il provoque le remboursement de la pièce
(elle tombe dans une sébille extérieure ; le contact 1-2
est overt et supprime la terre comme ci-dessus, mais les contacts 3-4
restent établis, empêchant l’usage du poste si le remboursement
a été provoqué en entendant le correspondant répondre.
50 - Appareil à prépaiement et encaissement
automatique pour réseau B. G. ou automatique (le taxiphone).
— Cet appareil a 1 avantage de ne nécessiter aucune modification
du relais d'appel ni orientation de la ligne et
fonctionne dans tout réseau à inversion de courant à
la réponse du demandé. Il ne aecessite aucune manœuvre
spéciale autre que le décrochage du combiné et l’introduction
de la pièce de monnaie convenable (ou des pièces).

Nous examinerons son fonctionnement dans le cas d’un réseau
automatique .
Le décrochage du combiné libère le crocliet-commulateur
G et ouvre le contact 1; l’introduc-tion d’une pièce
de monnaie et la chute de cette pièce dans R balance ouvrent le
contact 2 et libèrent le cliquet Clqui permet aux contacts 3 et
4 déjà libérés par le crochet-commutaleur
de s’établir. Dans ces conditions, la ligne est bouclée
sur Ie poste, qui est du modèle 1924, à la manière
habituelle (sauf l’introduction en série du relais polarisé
R et du microphone auxiliaire Ma). Le passage du courant d’alimentation
dans K fait basculer l’armature dans un sens et libère un
cliquet de garde qui fait passer la glissière de la balance en
position d’attente. L’usager reçoit le signal de numérotage
et compose sur son disque le numéro de son correspondant.
A la réponse du demandé, l’inversion
de courant fait basculer le relais polarisé R en sens inverse,
ce qui libère un deuxième cliquet de garde de la glissière
qui passe en position d’encaissement; la pièce tombe dans
la caisse, le compteur de l’appareil fonctionne et le contact 2 rétabli
courtcircuite le disque d’appel, le relais R et le microphone auxiliaire
Ma. La conversation a lieu comme avec un poste modèle 1924 ordinaire.
Au raccrochage du combiné, la glissière de la balance revient
en position de repos et le crochet-commutateur réenclenche les
contacts 3 et 4 qui ouvrent la ligne.
Si le demandé n’a pas répondu
ou n’est pas libre, la glissière est restée en position
d’attente et le raccrochage la fait passer en position de remboursement
(qui est la position normale de repos) et réenclenche les contacts
3 et 4 comme ci dessus.
Si la cabine est demandée, la sonnerie S
fonctionne, le relais A parcouru par te courant d’appel libère
Cl et au décrochage du combiné, les contacts 3 et 4 se ferment;
la communication s’établit donc sans introduction de pièce
de monnaie.
Le microphone auxiliaire Ma permet de contrôler
l’introduction d’une deuxième pièce dans le cas
d’une communication suburbaine à taxe double ; le relais polarisé
R est un relais lent.
sommaire
.
1927 Modèle de Tableaux d'abonnés
pour réseaux à Batterie Centrale ou automatique, à
une ligne réseau et 2 postes supplémentaires.
Ce tableau est du type à leviers et à secret.

 Modèle deTableau e 1927.
Modèle deTableau e 1927.


1938 Modèles deTableaux administratifs : 1+2 , 1+4 et 2+6 à
clés, puis les 1+4, 2+6, 3+10 et 4+12 à jacks.
51 - Le téléphone Universel U43
En 1941, La direction des Télécommunications développe
un laboratoire de recherche auquel on confie la tache d’étudier
un nouveau modèle d’appareil téléphonique
capable de s’adapter facilement aux nouveaux réseaux téléphoniques
qui se sont développés quelques années au paravant.
C’est ainsi qu’apparaît fin 1941
un nouvel appareil, le type DRCT également appelé
LAURENT du nom de son concepteur alors ingénieur au SRCT
(service de recherche et de contrôle technique), appareil,
référencè sous le N° 326 par l'administration
des PTT,

 Schema du 326
Schema du 326
Il se veut universel, c'est-à-dire qu’il s’adapter non
seulement au nouveaux systèmes automatique rural mais également
à tous les systèmes existants, par une astucieuse combinaison
de branchements et pontages réalisés sur le bornier interne
au poste , Malheureuseusemnt il ne fonctionnera bien que sur les réseaux
à batterie locale alors que l'automatique avec batterie centrale
est déjà bien avancé.
En France, après l’armistice intervenu le 22 juin 1940, des
ingénieurs des PTT des services techniques sont alertés
discrètement par des officiers militaires de l’existence d’un
stock de 50.000 à 60.000 bobines d’induction téléphoniques
destinées initialement à la téléphonie militaire.
Ces précieuses bobines d’inductions constituées évidemment
d’une majeure partie de cuivre, métal très précieux
en temps de guerre, sont menacées d’être saisies, détruites
et leur cuivre refondu pour le compte de l’occupant allemand dès
que le stock aura tôt fait d’être découvert par
leurs zélateurs. Ainsi, en catastrophe, le Service des Recherches
et du Contrôle Techniques des PTT va-t-il étudier dès
l’été 1940 la faisabilité d’un modèle
de téléphone entièrement basé sur ce modèle
militaire de bobine d’induction, afin de concevoir un poste téléphonique
qui sera agréé dans la foulée, pour pouvoir écouler
rapidement le stock de bobines militaires, et éviter ainsi leur
saisie et leur destruction par l’occupant, rappelons-le, adepte du
pillage de tout ce que pouvait fournir la terre de France ...
Il est finalement retenu que le modèle mobile PTT 1940 ainsi
créé sera directement dérivé du Modèle
mobile agréé de 1924 (Numéro de nomenclature PTT
: 321-1) afin de réutiliser un maximum d’éléments
mécaniques et de carrosserie disponibles en stock La commande
est passée à la société Le Matériel
Téléphonique s'est étalée d'Octbe 1940 à
Janvier 1941, fabriqué qu’en nombre réduit d’exemplaires
(60.000 au maximum), c'est un poste devenu rare. Le combiné à
Batterie Centrale Intégrale est le modèle 1924 n°320-2,
qui est pourvu d’un écouteur à excitation, c'est-à-dire
dépourvu d’aimant permanent mais seulement d’un noyau
de fer doux, la bobine militaire utilisée comporte 6 plots, mais
elle est beaucoup plus petite comparée à la bobine du poste
PTT 1924, la coque est identique au PTT24.
 Intérieur du PTT 1940
Intérieur du PTT 1940
Le nouveau modèle, le modèle mobile PTT 1941 n°323-1
qui, lui, a été produit jusqu’en 1947 au minimum.
(avec une bobine nouvelle de taille réduite, mais à 8 plots).
1943 suivra l'appareil U43 (Universel 1943)
Il est Universel dans le sens qu'il est conçu pour être branché
sur tous les types de réseaux en exploitation à cette date
: automatique, rural, batterie locale, centrale avec ou sans magnéto
à pouce ...
Sur le plan électrique, le problème de l’anti-local
n’étant pas résolu, ce sont en fait 2 versions qui
apparaissent sur le marché fin 1943.
La première dite « universelle » et portant la référence
331 s’inspire très fortement du type Laurent et est
essentiellement destinée à équiper les réseaux
en automatique rural.
La seconde version dite « BCI » ou batterie centrale
intégrale, de référence 330 est destinée
à remplacer le modèle 1910 dans les zones urbaine de moindre
importance ou la batterie centrale toujours avec opératrice fait
lentement son apparition.

 Capsule micro
Capsule micro 
L'intérêt pour un modèle unique, capable de fonctionner
aussi bien en batterie locale qu'en batterie centrale, était devenu
plus pressant pour deux raisons : tout d'abord une standardisation permettant
par l'emploi de pièces communes une fabrication en plus grand nombre
et ainsi moins chère, ensuite la conception d'un modèle
dit universel permettait une adaptation facile et à moindre coût
à l'évolution technique des réseaux (passage BL à
BC).
Sur ces modèles, on trouve toujours le schéma de câblage
sous le téléphone après avoir ouvert le bloc de raccordement.

| La magnéto poussoir
parfois appelée magnéto Ducruet, a été
fabriquée pendant 30 ans. Son succès jusqu’à
l’arrivée de l’automatique intégral, repose
sur 3 points : son encombrement, celui d’un cadran (D=80mm),
sa simplicité d’emploi grâce au poussoir et, sa
technologie innovante de 1943. Elle est constituée d’un induit bobiné sur un tore de tôle au centre duquel tourne un aimant cylindrique couplé à une petite roue libre entraînée par un secteur denté solidaire du poussoir. Si l’on ajoute à ça un boîtier en aluminium et le traditionnel groupe de contact, on ne pouvait faire plus simple. Seuls points faibles, la roue libre qui s’encrasse au fil du temps et les petites vis de fixation du poussoir qui cassent comme par hasard quand l’opératrice met un temps fou à répondre… |
 |
La première dite « universelle » et portant la référence 331 s’inspire très fortement du type Laurent et est essentiellement destinée à équiper les réseaux en automatique rural. La seconde dite « BCI » de référence 330 est destinée à remplacer le modèle 1910 dans les zones urbaine de moindre importance ou la batterie centrale toujours avec opératrice fait lentement son apparition .
Pour les appareils, mis à part l’apparition pour le cadran d’un disque perforé en plexiglas au environ des année 1950, il faut attendre 1954 pour voir quelques innovations.
Tout d’abord, la mise sur le marché d’un modèle luxe. Electriquement en tous points identique au modèle BCI il est réalisé en mélanine blanche ou ivoire (la bakélite ne pouvant prendre des teintes claires) et porte le référence 339.
A noter que au environ des années 60, certaines séries seront réalisées en kralalite, matière qui vieillit très mal et prend un aspect jaunâtre.



A cette même époque apparaît également une version murale. Il faut dire que pour les demandeurs de ce type d’appareil on en était resté au 1924 boîtier tôle format « kilo de sucre » . Sur le plan électrique, une nouvelle bobine d’induction est mise au point, nettement plus performante sur le plan de l’anti-local, elle équipera dorénavant le modèle universel qui de ce fait prend la référence 328.
sommaire
52 - Le téléphone Socotel S63
Après 1980 le câblage
s’est harmonisé à huit fils c’est-à-dire
le même câblage sur toutes les prises de l’installation
sans astuces avec possibilité de distribuer deux lignes indépendantes.
La prise T



On retrouve les bornes L1 et L2 sur les fils Gris et Blanc.








 S=Socotel
S=Socotel