Le téléphone et la littérature
Bien embêté pour nommer ces objets en évolution
rapide. Le nommer par le nom de leur marque est habituel, mais gênant
: on est assez soumis à leur racket permanent (mais on l’accepte
: révolution en temps réel, comment ne pas suivre ?).
Et puis d’ailleurs, toutes les marques se ressemblent. Donc, appeler
ça téléphone ? Mais je déteste le téléphone,
j’en dissémine le moins possible le numéro : pire,
en ce moment, j’ai régulièrement des appels concernant
le précédent propriétaire de mon nouveau numéro,
et je plains la personne qui éventuellement a hérité
de celui que j’ai utilisé dix ans, avant ce changement.
Pourtant, le téléphone et la littérature ont une
histoire commune : extraordinaire passage de Proust dans
La Prisonnière – où placer l’appareil
pour que l’usage domestique (la commande à la poissonnerie)
et l’usage collectif (il doit aussi servir aux parents) ne soit
pas incompatible avec l’appel éventuel d’Albertine
en milieu de nuit, même si l’appel ne viendra pas ? C’est
que le téléphone n’est pas transportable, belle lettre
de Proust aussi, qui s’est abonné dans les tout premiers
aux retransmissions en direct de l’opéra de Paris, après
une longue soirée Debussy ou Wagner debout dans son vestibule,
le cornet tenu à la main face à l’oreille droite,
sur les contradictions du progrès.
Mais Cocteau, dans La voix humaine, en fait le
vecteur même de sa forme artistique : le théâtre
représente sur scène les locuteurs de la parole exacerbée,
disséquée, séparée du monde pour mieux le
subvertir. Avec l’arrivée du téléphone, un
interlocuteur disparaît : il s’en induit quoi, pour l’exercice
de la parole, et pour cet acteur seul sur la scène avec son téléphone
sur une table, créant la totalité de l’espace parlé,
y compris le silence des réponses ? On est en 1935.
Il s’agit donc pour moi, trois quarts de siècle plus loin,
d’un ordinateur de poche. Par ordre de fréquence, j’y
convoque mes outils réseaux, mon compte e-mail, l’appareil-photo,
l’enregistreur vocal. J’y dispose aussi d’un plan avec
fonction d’itinéraire en direct par repérage satellitaire,
du moins sur le territoire français (sinon, il faut payer en
sus), de la navigation web, de plusieurs lecteurs de livres numériques
ou de textes personnels selon leurs formats, et d’une vaste quantité
de musique, dans des conditions d’écoute confortables. J’y
dispose aussi des « applications » dédiées
d’organes de presse, d’un traducteur, de dictionnaires, d’un
mini scanner qui convertit en texte une page de document via l’appareil
photo, sans oublier le réveil-matin, le chronomètre et
l’altimètre. Il n’y a donc aucune raison objective
d’appeler téléphone cet appareil qui m’accompagne
dans la quasi-totalité de mes déplacements, et le changement
radical est là : où nous revenions consulter le web après
une absence dans la ville, il nous est accessible en permanence, qu’on
garde le choix du rythme des consultations, ou qu’on laisse l’appareil
vous les notifier. Il déplace en retour notre capacité
à documenter le réel : photographie, enregistrements sonores
ou filmiques, je disposais auparavant d’outils dédiés
pour chacune de ces fonctions, aux capacités nettement supérieures
à celles de mon non-téléphone. Il m’est même
arrivé de penser que la résistance au web des professions
culturelles, amis libraires ou théâtreux, venait de la
façon dont le téléphone s’était imposé
comme outil principal, et de leur difficulté à en restreindre
l’usage. Mon ordinateur de poche me permet d’écrire
et rapatrier sur mon ordinateur des notations brèves, d’intervenir
sur mon site pour corriger ou compléter, ou commenter sur les
sites des autres : mais je n’y ai pas l’environnement global
que me procure mon ordinateur (qui inclut aussi une fonction de téléphonie
importante, via Skype). Que voilà bien du temps et des mots gâchés
à un asservissement de privilégié, et la puissance
économique – avec ses enjeux de prescription culturelle
– transférée aux tout-puissants fournisseurs d’accès,
via notre forfait. Et côté comique, dans le métro
ou les lieux d’attente, à voir si fréquemment l’appareil
tenu à la main, les deux fils qui les relient aux oreilles des
gens dans leur bulle, ou les pouces crispés sur les messages-texte.
Où que je sois encore, l’accès à des ressources
denses aussi bien que des sources d’information pointue, et la
capacité à glisser d’une ressource lente (livre)
à un fil d’actualité, ou prolonger ma communication
écrite privée ou professionnelle. Qu’est-ce que cela
change en retour à mon rapport à l’ordinateur, que
je laisse plus facilement s’ancrer sur mes pratiques d’écriture,
hors réseau ? Comment je peux aussi solliciter l’ordinateur
de poche pour une intervention textuelle directement propagée
par les réseaux, et qu’est-ce que cela déporte du
rapport de la littérature au monde, si on multiplie ce geste
minuscule à échelle de tous ceux qui le pratiquent ? Et
puis soubassement immédiat : l’ordinateur de poche, avec
fonction téléphone, est un outil non seulement immensément
populaire, mais qui est la vraie nappe de diffusion numérique
à échelle du monde. L’intégration de la fonction
photographie sur les téléphones portables remonte à
quelques années, mais n’était pas requise d’office
sur les précédents appareils. La fonction d’accès
aux sites Internet était encore l’apanage des appareils
les plus sophistiqués depuis, elle ne l’est plus. La question
de la propulsion et de la recommandation se pose autrement : pour moi-même,
sur mon ordinateur de poche qui n’est pas un téléphone,
je peux ouvrir le navigateur web et aller surveiller si pas trop d’irruption
de messages inamicaux ou polluants sur mon site, et bien sûr j’ai
accès à ma page liens qui me permettra d’aller visiter
les sites amis. Mais j’utilise plutôt les outils réseaux
et les recommandations d’articles ou de liens de mes propres abonnements
: l’outil donc qui peut permettre l’appel à mes propres
articles (posant cette question si décisive de l’association
de ressources qui nous appartiennent en propre, et de leur propulsion),place
dans la même poche l’écran de même taille tout
autour du monde, pour tant de ceux qui n’auront pas, cependant,
ni la même langue ni les mêmes intérêts que
ceux qui me font recourir à cet outil. L’enjeu politique
devient énorme, si le partage peut se faire de si loin, simplement
ouvert : le téléphone-ordinateur m’importe, parce
que ceux qui l’utilisent m’importe, et ce qu’on a à
bousculer pour devenir citoyens du monde.
Comment l’appeler, alors, cet appareil ? C’était bien
plus facile avec le couteau suisse.
Alain Freudiger en 2023 auteur de "Au
téléphone" publié récemment
chez Héros-Limite, explore la constellation de souvenirs et de
pensées incidentes que lui inspire l’évocation de
cet appareil.
Entre les années 1980 et les années 2020, le téléphone
a connu de nombreuses évolutions et révolutions techniques.
Passant de l’analogique à l’électronique, du
téléphone à cadran au sans fil, puis du téléphone
portable au smartphone. Vivant cette période en témoin
et en usager, Alain Freudiger a voulu évoquer ces changements
– si rapides qu’ils laissent peu de traces et peu de mots,
même s’ils sont perceptibles pour chaque personne qui les
éprouve – et s’en occuper de manière littéraire.
Ce recueil de textes rend au plus près l’« expérience
du téléphone ». Et cela de multiples manières
et par toutes sortes d’approches : souvenirs, réflexions,
épiphanies, micro-récits, transcriptions, évocations…
L’écriture s’attache à des petits gestes rarement
aperçus, peu documentés, encore plus rarement mis en mots,
mais qui en disent long sur nous, à travers les formes littéraires
de la légèreté, de l’évanescence, du
« sur le vif ». Des miniatures et des poèmes qui
sont autant de facettes ou d’instantanés de notre «
condition téléphonique » et de ses rapides mutations.
Nous le savons tous, la révolution numérique
a bouleversé en profondeur nos conditions de vie. Désormais
les objets communicants sont au cœur de la compréhension
des mutations sociales actuelles et au cœur de nos pratiques les
plus ordinaires.
Il est de fait normal que le téléphone portable se soit
inséré dans le roman comme objet courant. Il met le plus
souvent en scène des conduites conversationnelles entre les personnages.
Il est tout simplement représentatif du réel et de nos
comportements actuels.
Mais si le portable a profondément modifié les interactions
entre les individus et leurs pratiques de communication dans la vie
courante, comme dans le roman, il a également stimulé
l’imaginaire de certains écrivains. Ainsi quelques romanciers
n’hésitent plus à construire leur intrigue autour
de cet objet ordinaire qu’est devenu le téléphone
cellulaire.
Bien avant le portable, dans les premières années ou le
téléphone fut commercialisé, les écrivains
exploitent abondamment les métaphores techniques dans leur travail
littéraire.
1883 "Le Vingtième Siècle"
est un roman d'anticipation écrit et illustré par Albert
Robida. Publié aux éditions Georges Decaux en 1883,
le roman aborde le genre du merveilleux scientifique en traitant avec
humour les progrès scientifiques et technologiques.
Éditions Georges Decaux, 1883.
Éditions Édouard Dentu, 1883, sous le titre Le Vingtième
Siècle, roman d'une Parisienne d'après-demain.
Éditions Édouard Dentu, 1884, sous le titre Le Vingtième
Siècle, roman d'une Parisienne d'après-demain avec des
illustrations inédites d'Albert Robida.
Librairie illustrée Montgrédien, 1893, dans le recueil
Le Vingtième Siècle suivi de La vie électrique.
Éditions Édouard Dentu, 1895, sous le titre Le Vingtième
Siècle, roman d'une Parisienne d'après-demain.
La Science Illustrée no 471 au no 522, du 5 décembre 1896
au 27 novembre 1897.
Le Populaire no 5903 au no 5963, du 16 avril au 15 juin 1939, sous le
titre Le XXe siècle vu par Albert Robida.
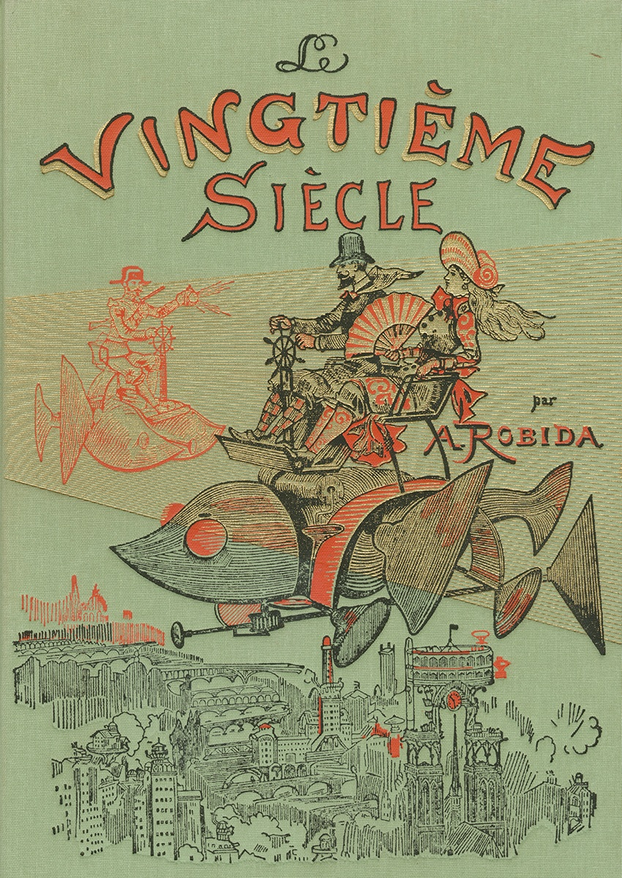 Albert Robida décrit la vie quotidienne des Parisiens des
années 1952 à 1959 et expose les nombreuses inventions
qui ont révolutionné les moyens de communication et les
transports.
Albert Robida décrit la vie quotidienne des Parisiens des
années 1952 à 1959 et expose les nombreuses inventions
qui ont révolutionné les moyens de communication et les
transports.
L'auteur parsème le récit de nombreuses inventions, à
l'instar du téléphonoscope, véritable emblème
de la société future, ou encore du tube, système
de transports qui a rendu obsolète la locomotive. Outre l'omniprésence
de ces nouvelles technologies, Albert Robida décrit une société
dont les femmes sont complètement émancipées et
occupent à présent tous les postes à responsabilité,
y compris dans l'armée. Par ailleurs, la société
est si bien parvenue à encadrer toutes les activités,
qu'elle a naturellement aboli bagne, peine de mort et même prison.
Dans les numéro de La Science Illustrée du 28 novembre
1891 au 30 juillet 1892, il publie l'ouvrage La vie électrique
qui fait figure de complément de l'ouvrage Le Vingtième
Siècle puisqu'il précise les événements
de l'année 1955 en approfondissant l'emploi générique
et polyvalent de l'électricité.
Robida profite de l'intrigue, assez simple, pour présenter un
monde du futur très différent de celui des lecteurs de
1883 : parmi les inventions qu'il décrit, le téléphonoscope
préfigure à la fois la télévision, l'Internet
et les appareils nomades. Il permet la visiophonie, mais il offre aussi
des distractions (spectacles, feuilletons, dont l'un intitulé
Purée de poubelles, informations). Les programmes sont entrecoupés
de publicités obsédantes. L'appareil est constitué
d'un mince écran de verre accroché comme un tableau au
mur du salon, mais il existe aussi une version de poche qui permet à
chacun de suivre les programmes à tout moment.
Robida écrit ainsi : « Excellent
pour les voyageurs, le téléphonoscope !... on ne craint
plus de s’expatrier, puisque tous les soirs on retrouve sa famille
au bureau du téléphonoscope ! ». Comme pour la télévision
moderne, le dispositif est couramment désigné par l'abréviation
« télé ».
1884 August Strindberg (1849-1912), écrivain suédois
montre très jeune un grand intérêt pour les sciences
et les techniques, il comprend par ailleurs très vite les possibilités
stylistiques des innovations techniques. Il a su transformer ses compétences
techniques et scientifiques en nouvelles métaphores et renouveler
non seulement la langue suédoise mais aussi et surtout la langue
littéraire.
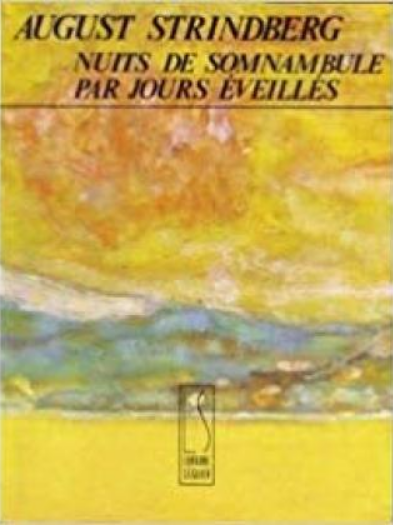

Dans la troisième nuit du long poème "Nuits
de somnambule par jours éveillés" (1884),
c’est probablement la première apparition du téléphone
dans la poésie suédoise.
Photo de Strindberg en nihiliste russe, autoportrait, Gersau (Suisse),
1886.
Après des études scientifiques avortées à
l’université, Strindberg s’inscrit au cours de la Compagnie
nationale du télégraphe puis se tourne vers la littérature.
Il déclare à maintes reprises son désir d’être
reconnu comme homme de sciences et publie de nombreux articles scientifiques,
dans des domaines variés : chimie, médecine, mathématiques,
astronomie, optique, zoologie, météorologie ou encore
botanique. Quel est le bilan de ses activités techniques et scientifiques
? Malgré ses expérimentations, il n’a inventé
aucun objet technique et il n’a fait comme scientifique aucune
découverte remarquable. Mais ses compétences scientifiques
dans des domaines très larges et parfaitement en phase avec les
dernières avancées du savoir montrent l’exceptionnelle
faculté de Strindberg à sentir les prémices de
mouvements de pensée, à capter les évolutions de
la société de son époque. C’est en 1884 que
Strindberg donne un premier témoignage du téléphone.
Dans la troisième nuit du long poème Nuits de somnambule
par jours éveillés (1884), quatre ans seulement après
l’ouverture de la première ligne téléphonique
en Suède, et moins de dix ans après l’invention du
téléphone électrique par Alexander Graham Bell,
il intègre le téléphone à sa production
poétique et s’exalte du « chant nouveau, hymne aux
électro-aimants que propage le téléphone »
(p. 65). C’est probablement la première apparition du téléphone
dans la poésie suédoise. Lors d’une visite au musée
des techniques à Paris, Strindberg prend conscience que les machines
sont la marque du xixe siècle et de la modernité. Le téléphone
trouve sa place dans la description du nouveau culte aux objets techniques.
A son retour de voyage en 1889, il redécouvre Stockholm, ville
métamorphosée par le développement technique et
industriel et complète le poème Nuits de somnambule par
jours éveillés par une cinquième nuit appelée
« le réveil ». Il y décrit ce nouveau paysage
urbain décoré de lignes téléphoniques et
conclut : « le conte est devenu vérité » (p.
131). Strindberg joue sur la dimension onirique et fantasmagorique de
l’innovation technique. Le somnambule se réveille ici de
son rêve parisien et découvre une ville transfigurée
par la révolution industrielle.
Strindberg s’abonne au téléphone au tournant du siècle.
Conscient des dangers possibles de cette invention, Strindberg demande
à ne pas figurer dans l’annuaire téléphonique.
Il est ainsi en quelque sorte en Suède l’inventeur de la
liste rouge. Comme il l’exprime dans la pièce de théâtre
Pâques (Påsk, 1901), il craint la violence
des mots échangés au téléphone et ressent
la nécessité de se protéger des intrusions non
désirées dans sa vie privée. La nouvelle «
Une demi-feuille de papier » (« Ett halvt ark papper »,
1903) témoigne de cette réalité. Un homme est sur
le point de quitter l’appartement où il a vécu avec
sa femme récemment décédée. Son regard croise
alors une feuille de papier posée près du téléphone.
Une liste de numéros y figure et rend compte des événements
passés. Elle est pour lui l’occasion de parcourir en deux
minutes les deux années qu’il vient de vivre. L’écrivain
précise : « Une tranche de vie sur une demi-feuille de
papier ». Les notes gribouillées sur un bout de papier
deviennent des points de repère dans la description d’une
réalité quotidienne ordinaire et permettent à l’écrivain
de susciter l’imagination du lecteur à partir des indications
apparemment triviales que sont quelques numéros de téléphone
sur une feuille de papier. Par cette construction dramatique, il confère
au téléphone une puissance symbolique sans précédent
: le téléphone peut témoigner des événements
décisifs de la vie d’un homme. Œuvre courte mais efficace,
elle dévoile sa volonté d’adapter l’esthétique
littéraire aux comportements créés par le téléphone.
Le téléphone, en tant qu’innovation technique, est
associé à une écriture littéraire tournée
vers la modernité et lui donne une signification esthétique.
Strindberg exploite les possibilités dramatiques des télécommunications en plaçant la pièce de théâtre La Danse de mort (1900) sur une île reliée au continent par le téléphone et le télégraphe. La femme du capitaine apprend en cachette à télégraphier afin d’éviter les écoutes téléphoniques des standardistes. Le télégraphe nourrit toutes les tensions du huis-clos insulaire et finit par provoquer la mort du capitaine. Il décède d’une crise cardiaque lorsqu’il reçoit le télégramme du colonel lui annonçant la rupture de leur relation : « Le télégraphe fait entendre un signal, une seule fois puis c’est le silence. Le capitaine, saisi d’une angoisse mortelle, tressaille ; il reste debout, immobile, la main sur le cœur, l’oreille tendue » (p. 56). Le télégraphe rythme implacablement la danse de mort.
Dans le drame onirique Le Songe (1902), les dieux écoutent la plainte des hommes. A la fin de l’échange entre le poète et Agnès une bouée apparaît. Il s’agit de la gardienne de la mer qui chante lorsqu’un danger se profile. Le poète conclut que c’est « un pylône de téléphone… un pylône qui monte jusqu’au ciel… C’est la tour de Babel moderne, avec ses câbles qui montent et permettent à ceux de là-haut de se tenir au courant… » (p.82). Il y a chez Strindberg cette idée récurrente d’une communication avec une réalité non visible. Les innovations techniques telles que le téléphone ou l’appareil photographique sont selon lui des artefacts qui peuvent permettre de rendre visible l’invisible.
Strindberg comprend par ailleurs très vite les
possibilités stylistiques des innovations techniques et exploite
abondamment les métaphores techniques dans son travail littéraire.
Pour lui, écrire à l’ère industrielle c’est
inventer une nouvelle langue. Il n’hésite pas à affirmer
dans un article intitulé « Qu’est-ce que le
moderne ? » publié en français en 1894 :
« A` nous, hommes de vapeur, d’électricité´,
de poste par poste, de téléphone, un volume
à trois francs cinquante, qui se lise entre Paris et Versailles.
A nous le langage de téléphone : bref, net, correct !
»
Il annonce ainsi de façon visionnaire le travail linguistique
que les poètes des avant-gardes allaient développer en
lien avec les objets techniques.
Strindberg a ainsi su transformer ses compétences techniques
et scientifiques en nouvelles métaphores et renouveler non seulement
la langue suédoise mais aussi et surtout la langue littéraire.
Cela a conféré à son œuvre une force créatrice
dynamique exceptionnelle. Il s’est efforcé d’effacer
les frontières disciplinaires entre science, technique et littérature
et de montrer que ce qu’on a appelé « les deux cultures
» ne forment en fait qu’une seule culture.
Plus connu et réferencé sur ce site, Marcel
Proust « A la recherche du
temps perdu » est passée dans le domaine public.
A cette occasion nous avons cherché à savoir comment Proust,
mort en 1922, témoin d'un monde en mutation, avait fait place
dans son oeuvre à une technique nouvelle : le téléphone.
A la fin du dix-neuvième siècle, l'artiste -peintre ou
écrivain - croise la technique. Fasciné et inquiet, Proust
rencontre la machine. L'objet technique pénètre son univers.
« l’appel téléphonique est délibérément
associé au féminin » , elle s’arrête
en particulier sur l’épisode du Côté de Guermantes
(1920-1921) où le narrateur, croyant parler à sa grand-mère,
a en réalité, à la suite d’un quiproquo, été
mis en relation avec celle d’un voisin d’hôtel. Toute
l’angoisse téléphonique est résumée
dans ces quelques lignes : la grand-mère est un substitut maternel
(angoisse du Fort-Da) dont on craint d’autant plus la disparition
que, par la force des choses, elle n’est plus jeune (angoisse de
la mort – d’ailleurs, la mort de la grand-mère est
l’un des événements traumatiques de la Recherche)
; à quoi il faut ajouter le trouble qui s’ensuit du remplacement
d’une grand-mère par une autre (angoisse de découvrir
l’Autre là on l’on attendait le Même, le différent
à la place du semblable, l’étranger au lieu du familier).
« Qui est à l’appareil ? » demande le titre
du deuxième chapitre (pp. 67-97) de Téléphonez-moi.
C’est là, d’une certaine façon, la question
centrale de l’essai. Téléphoner, d’un point
de vue communicationnel, c’est parler sans savoir précisément
à qui l’on parle, c’est prêcher, non dans le
désert, mais pour l’inconnu.
"La
voix humaine"
(consultez le texte en pdf) est une pièce de théâtre
en un acte de Jean Cocteau écrite en 1927.
La Voix Humaine est l’une des œuvres majeures du théâtre
de Cocteau. Depuis qu'il a été écrit, ce monologue
n'a jamais cessé d'être joué dans le monde entier.
Il met en scène une femme quittée, parlant au téléphone
pour la dernière fois à l’homme qui l’a trahie.
« Ce qui surtout est émouvant ici, c’est la situation
elle-même, ce drame de la présence-absence, ce dialogue-monologue
; et ce qui fait de cette scène rapide une vraie tragédie,
c’est cet appareil insensible, image de la fatalité, plutôt
que les paroles qu’il apporte et emporte. » (Pierre Bost,
Revue hebdomadaire, mars 1930.)
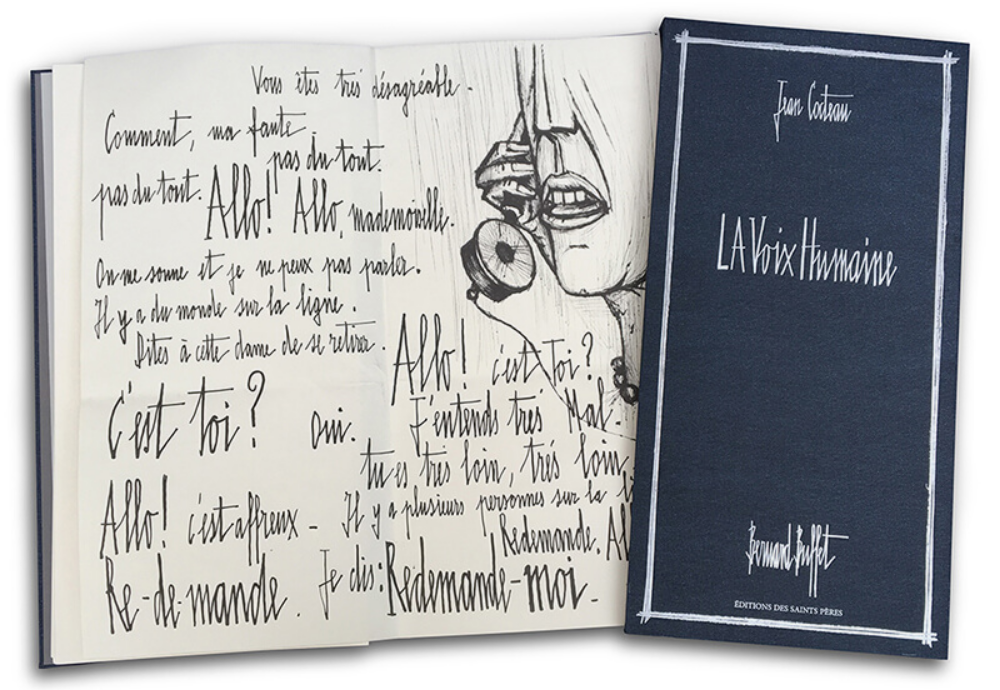
Étonnante de modernité, universelle, La Voix Humaine continue
d’inspirer. En 1958, Francis Poulenc, qui est un proche de Jean
Cocteau de longue date, en tire une tragédie lyrique en un acte,
créée et jouée le 6 février 1959, salle
Favart à Paris, avec la soprano Denise Duval.
"Par un curieux mystère ce n'est qu'au bout de quarante
ans d'amitié que j'ai collaboré avec Cocteau. Je pense
qu'il me fallait beaucoup expérience pour respecter la parfaite
construction de La Voix Humaine qui doit être, musicalement, le
contraire d'une improvisation", écrivit Francis Poulenc.
Ce à quoi Cocteau répondit : "Mon cher Francis, tu
as fixé une fois pour toutes, la façon de dire mon texte."
En 1964, le texte de La Voix Humaine est enregistré en une seule
prise chez Simone Signoret, dans son appartement, place Dauphine à
Paris. Selon le producteur Jacques Canetti, cet enregistrement est l’un
des plus beaux qu’il ait vécu et réalisé.
Il obtient la même année le Grand Prix du Disque.
En 2021, Pedro Almodóvar devrait faire son retour au cinéma
avec un court-métrage expérimental de 29 minutes librement
adapté de La Voix Humaine, filmé à Madrid, où
Tilda Swinton tient le rôle principal. En 1987, l'extrait final
de la pièce fut déjà joué dans le film de
Pedro Almodóvar La Loi du désir.
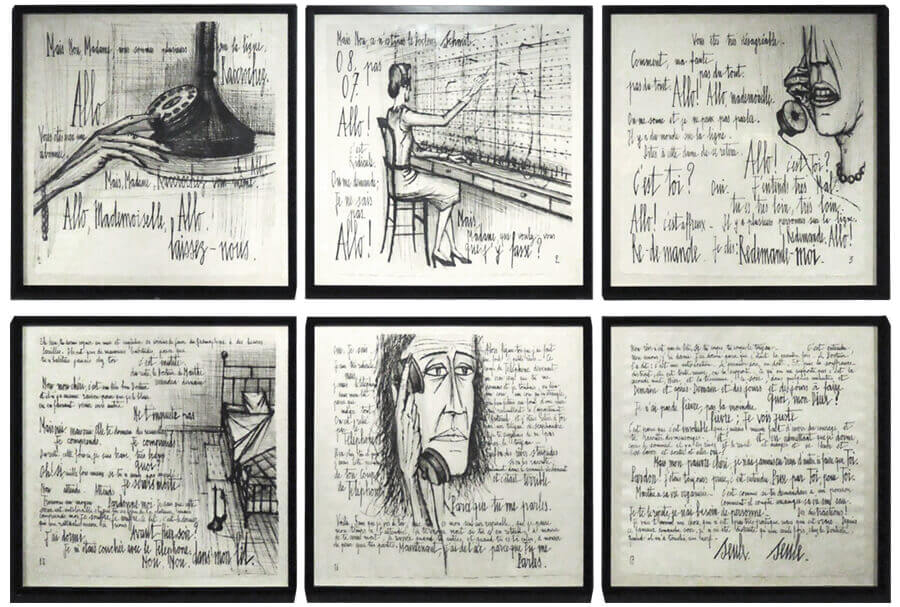
Présentation de La Voix Humaine, dans une version encadrée,
lors de son exposition au Musée d'Art Moderne de Paris.
sommaire
Le téléphone portable et l'écriture la littéraire
« Tout relève de l’imagination et
de l’imagination tout révèle. Il paraît que
le téléphone est utile : n’en croyez rien, voyez
plutôt l’homme à ses écouteurs se convulsant,
qui crie Allô ! Qu’est-il qu’un toxicomane du son, ivre
mort de l’espace vaincu et de la voix transmise ? » Louis
Aragon
« Il y a eu la lessive, le linge qui sèche, le repassage.
Le gaz, l’électricité. Les enfants. » Les choses,
Georges Perec
Et j’ajouterai : le téléphone portable, c’est
là notre sujet. Un sujet littéraire ?
Le progrès technique est une donnée incontournable de
l’époque contemporaine. Les objets connectés sont
des éléments centraux de notre mode de vie et de nos modes
culturels. La littérature peut intégrer cette présence
de la technique comme une donnée naturelle à l’existence
de ses personnages, elle peut en dénoncer les excès, être
fascinée ou hostile, mais ne peut pas rester hors de ce phénomène.
On parle même de mutation humaine en décrivant l’homme
contemporain accroché à ses écrans, l’homme
connecté qui zappe et… lit moins ou ne lit plus du tout.
Ainsi, les objets techniques, éléments de la vie, sont
de plein droit des thèmes de la littérature, même
si, d’une certaine façon, ils prennent sa place.
Pour Frédérique Toudoire-Surlapierre,
le portable « impose à la littérature d’être
aussi efficace qu’un coup de téléphone ! »,
Michel Serres était en extase devant sa manipulation
par des poucettes agiles.
Nous ne sommes pas obligés de partager ces enthousiasmes, mais
il faut l’accepter, bien rares sont ceux qui résistent aux
sirènes du téléphone portable. L’écriture,
si elle reste proche de la vie, si elle veut restituer la vibration
particulière de son époque, peut-elle totalement s’extraire
de ce type de sujets ? Mais comment l'écrire ?
Le piège de ce type de sujet très contemporain,
c’est de rester prisonnier de leur aspect habituel et concret,
les scènes de pertes ou d'addiction dans la stricte restitution
de l'oralité et des formules convenues et répétée,
pour le dire simplement, le risque, c'est la banalité.
On peut y échapper par l'utilisation d'un ton original : humour,
ironie... aller jusqu'à l'absurde.
Au niveau du style, le propre de la technologie étant de limiter
l’accès à notre vie intérieure, est-il légitime
d'employer un langage littéraire ?
Si l'on ne raconte pas d'une façon extérieure, s'il s'agit
d'exprimer l'addiction, le vide, la perte, et même si cela peut
sembler paradoxal, les outils littéraires peuvent permettre l'expression
des sensations, du trouble du désir, du manque...
La perte du téléphone peut être l’occasion
de pendre conscience d’une intériorité masquée
sous les appels, les messages , les jeux.
Le transfert sur l’objet technologique neutralise les émotions
et les angoisses, mais ne les supprime pas, sa perte les fait surgir
comme autant de spectres, mais cela peut aussi être une possibilité
de se retrouver : se perdre, pour se retrouver autrement.
Quelque chose s’ouvre ? Cela peut être un moment d’épiphanie,
un autre thème littéraire passionnant.
Le téléphone mobile devient maintenant
un outil multifonction. Au Japon, où le temps passé dans
les transports en commun est très important pour chaque habitant,
se développent de nouvelles utilisations du combiné téléphonique.
En 2007, trois romans écrits pour être lu sur un téléphone
s’inscrivaient en tête des meilleures ventes.
Sur les 10 titres les plus populaires en 2007, la moitié étaient
des keitai shosetsu (romans mobiles), des romans d'abord «diffusés»
sur téléphone cellulaire, avant d'être vendus sous
forme imprimée. Depuis 2000, plus d'une soixantaine de keitai
shosetsu ont été publiés sous forme de livre, d'autres
ont été adaptés en manga.
Comme les jeux disponibles sur les mobiles, on télécharge
ces romans d’un nouveau genre sur le portable, puis on les lit
le temps de se rendre au travail. Il existe même la possibilité
d’envoyer un mail à l’auteur afin de lui suggérer
quelques corrections ou pistes pour la suite.
On est en plein dans le roman interactif. Le téléphone
va-t-il maintenant révolutionner aussi la littérature
?
L'Italien Robert Bernocco a innové en mettant en ligne, sur Lulu.com, le premier roman écrit en SMS.
2007 Sans plume ni papier ni machine à écrire ni ordinateur, l'Italien Robert Bernocco, vient de publier son premier roman, Compagni di Viaggio (Compagnon de voyage). Un ouvrage de science-fiction qui n'a pas encore rencontré, comme on dit, son public : treize exemplaires seulement de ce titre, disponible en italien, espagnol et anglais, ont été vendus depuis la mi-mai.Le livre n'en est pas moins l'objet d'une grande curiosité sur le Net. Car la particularité de Compagni di Viaggio est d'avoir été intégralement rédigé sur téléphone portable. Une première ! Informaticien de profession, l'auteur a écrit son texto de 384 pages par bribes de 160 caractères, lors du trajet quotidien entre son domicile et son lieu de travail.
"Dans les transports en commun, j'ai réalisé que mon imagination était productive et que les idées foisonnaient. Je me suis mis peu à peu à écrire sur mon téléphone pendant mon temps libre", explique-t-il, en prenant soin d'ajouter que "cette oeuvre est structurée comme un livre."
Grâce à l'outil de frappe prédictive
intégré à son téléphone, qui facilite
l'écriture des SMS, cet écrivain ingénieux a échelonné
son projet sur dix-sept semaines. Le temps de rédiger son livre,
de transférer au fur et à mesure les paragraphes sur son
ordinateur, puis de retraiter le texte.
"La relecture et la mise en page ont été fastidieuses",
se remémore M. Bernocco, insistant sur le fait que "ce livre
n'est non pas rédigé en langage SMS, mais bel et bien
en style littéraire classique".
"Nous sommes dans une ère de l'innovation,
et les gens n'ont plus le temps de se consacrer aux arts et encore moins,
pour les écrivains, de trouver un éditeur, voire d'écrire.
Roberto Bernocco en est le parfait exemple. C'est un créateur
qui n'hésite pas à tirer parti des outils qui nous entourent".
Après les pocket films (films de poche tournés et montés
sur mobile), Robert Bernocco inaugure la "littérature
cellulaire" et entend bien bouleverser le milieu du livre avec
cette production atypique. L'outil de communication le plus répandu
de la planète inspire ses utilisateurs et s'immisce, de manière
expérimentale, dans le monde des arts.
Les portables nippons sont bien plus performants que
les nôtres et jouent à plein leur rôle de lecteur
de contenus lors des heures de transports. Cela donne lieu à
un véritable marché. Le téléchargement de
ce type de romans représentait au Japon un chiffre d'affaires
de près de 100 millions de dollars pour les maisons d'édition
et sites spécialisés en la matière. Un des principaux
éditeurs virtuels, Papyless, propose un catalogue de plus de
80 000 titres.
Ce qui est encore plus frappant, c’est que certains de ces nouveaux
romans sont eux-mêmes écrits sur téléphone
portable… Ainsi Rin, une jeune étudiante de 21 ans a écrit
If You sur le clavier de son cellulaire, sur une période
de six mois, dans le train qui la menait de la maison à son travail
à temps partiel. Le texte s’est vendu à 400 000 exemplaires.
«Ce qui fait le succès des keitai shosetsu, c'est leur
absence de décalage avec la réalité telle que la
vivent leurs lecteurs», explique Shintaro Nakanashi, professeur
et sociologue à l'Université de Yokohama. Il n'y a plus
de fossé entre l'auteur et le lecteur, dont les réalités
se fondent au fil des pages.
Qu’en est-il de l’avenir du livre papier
?
L’Europe a encore un train de retard dans ce domaine. Déjà
en mai 2007, Robert Bernocco, informaticien de formation, a terminé
la rédaction d'un roman de 384 pages, écrit en 17 semaines
sur le clavier de son Nokia. L'ouvre de science-fiction, Compagni di
viaggio (Compagnons de voyage) est écrite de façon traditionnelle,
sans recours au langage abrégé des SMS. Le livre a été
publié sur Lulu.com, un site créé en 2002 qui permet
aux auteurs de diffuser et de vendre leurs romans sur le Web tout en
en gardant le contrôle éditorial et légal.
La question est désormais posée de la prééminence
de l’ère numérique sur l’ère du papier…
Va-t-on bientôt amener avec soi sa bibliothèque, comme
c’est maintenant le cas pour la musique sous format MP3 ?
«Nous allons avoir l'équivalent d'une armoire de livres
dans notre veste. Nos enfants n'auront plus mal au dos en se rendant
à l'école et [...] on ne trimballera plus des valises
de deux tonnes au moment des départs en vacances», soulignait
récemment l'auteur Frédéric Beigbeder. «Le
progrès va peut-être détruire le livre, mais le
progrès ne détruira pas la lecture, ni l'écriture,
ni la littérature !», conclut-il.
Reste à espérer que ces romans d’un nouveau genre
sauront aussi dépasser les romans de gare…