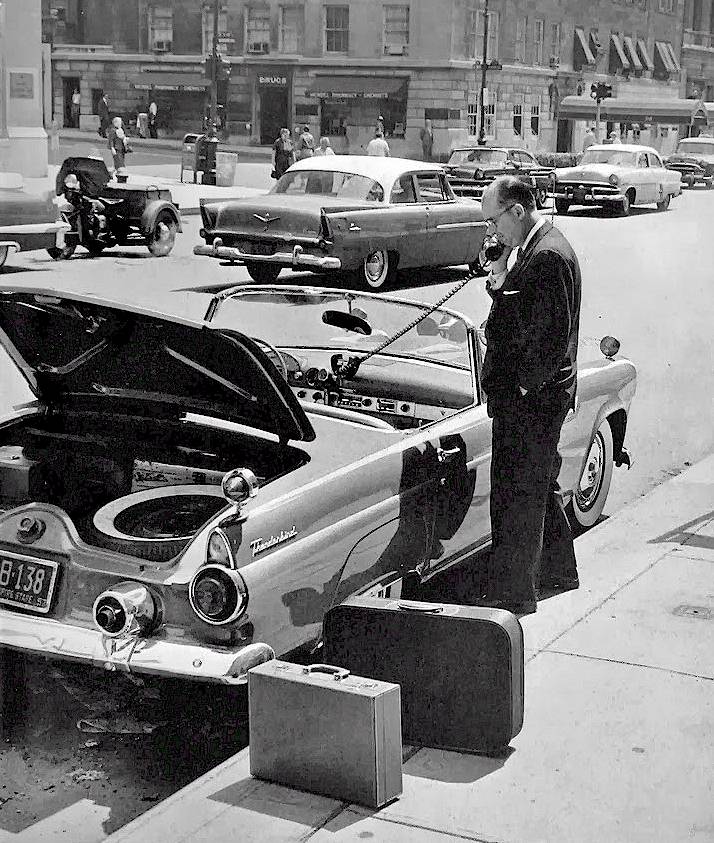Le téléphone de voiture
LES PREMIERS TÉLÉPHONES DE VOITURE,
1946-53
Lars Magnus Ericsson le fondateur de la société
suédoise de téléphone/radio du même nom a
créé la première version rudimentaire du téléphone
de voiture en 1910. C’était le résultat d’un
« projet de retraite amusant ! ». Quand lui et sa femme
Hilda veulent passer un appel, il se garent près d'une ligne
téléphonique au bord de la route et Hilda connecte deux
tiges à la ligne. Intéressant ?
Seulement si c'était vrai – les rapports indiquent qu'Ericsson
ne possédait ni voiture ni permis de conduire.
Aux États-Unis, l’histoire des téléphones
de voiture commence en 1920 avec WW Macfarlane – un passionné
de radio de Philadelphie.
Le magazine Electrical Experimenter l'a présenté ainsi
que son invention dans un article intitulé « Comment les
conversations téléphoniques peuvent avoir lieu lors d'un
voyage en automobile. » Mais la version de Macfarlane était
plus proche d'une radio bidirectionnelle. Cependant, l’appareil
permettant de parler/écouter (combiné) était un
téléphone. Mais la manière dont le signal fonctionnait
reste un mystère.
Le premier vrai téléphone de voiture développé
par Bell System dans les années 1940. C'est un radiotéléphone
mobile spécialement conçu pour être installé
dans une automobile. La technologie nécessite un combiné,
un émetteur et parfois une antenne externe pour fonctionner.
Dès 1939, Motorola proposait des autoradios bidirectionnelles, principalement destinées à la sécurité publique. Fonctionnant sur la bande AM, ces appareils étaient un peu comme des talkies-walkies améliorés, car ils fonctionnaient entièrement sur des fréquences radio. Les radiotéléphones embarqués fonctionnaient un peu différemment .(c’est expliqué dans la vidéo ci-dessous).
Les premiers téléphones de voiture connectés
au réseau téléphonique public commuté aux
États-Unis ont été mis en service en 1946,
en réponse à la mobilité croissante de la population
américaine dans les années d'après-guerre.
L'équipement d'origine pesait 80 livres (36 kg), et il n'y avait
initialement que 3 canaux pour tous les utilisateurs de la zone métropolitaine.
Le système de Bell MTS présenté est en fait deux
systèmes distincts, mais liés, destinés à
deux cas d’utilisation différents. Le premier est fait pour
permettre aux gens de téléphoner aux autres voitures roulant
sur le réseau routier. Dans la vidéo, un répartiteur
d’une entreprise de camionnage appelle deux chauffeurs de son entreprise
sur le terrain, leur demandant de faire un arrêt supplémentaire
pour remplir un espace vide dans leur semi-remorque. Le second permet
à quiconque se trouve dans une zone urbaine d’utiliser le
téléphone de sa voiture pour appeler un numéro
de téléphone fixe ; la vidéo nous montre par exemple
comment une personne peut appeler depuis la banlieue pour obtenir des
pièces pour un engin de terrassement en panne.

Contrairement aux téléphones mobiles apparus dans les
années 1980, qu’ils soient basés sur des voitures
ou véritablement portables, ces premiers exemples de «
téléphones MTS » étaient super exclusifs,
non seulement parce qu’ils étaient super chers, mais aussi
parce qu’ils présentaient un défaut majeur qui empêchait
leur adoption généralisée. À savoir, il
y avait vraiment très peu de canaux disponibles pour le service
– au départ, seulement trois. Ainsi, seules trois personnes
dans une zone donnée pouvaient utiliser l’installation à
un moment donné en raison du nombre limité de fréquences
sur lesquelles elles fonctionnaient.
sommaire
La conception initiale du téléphone mobile lui-même
a été entreprise par la Western
Electric Corporation, le principal fournisseur de
postes téléphoniques des sociétés d'exploitation
du système Bell du pays, tandis que les Laboratoires
Bell ont eux-mêmes conçu le système
global et défini les spécifications de l'équipement.
Parallèlement, les compagnies de téléphone indépendantes
développaient leurs propres équipements, qui seraient
fournis par Automatic Electric.
L'équipement du système Bell s'appuie sur un poste de
radio mobile déjà existant, l'équipement radio
de police VHF FM de type 38 ou 39 de Western Electric datant de 1945,
ajoutant un combiné de style téléphonique et un
décodeur d'appel sélectif, qui sonnait une cloche dans
l'automobile lorsque le numéro unique de ce téléphone
ce qui a signalé. Le décodeur d'appel sélectif
consistait en une petite roue dans une enceinte en verre, avec des broches
situées à certains points autour de sa circonférence.
Le décodeur a été développé au XIXe
siècle pour la signalisation d'emprise ferroviaire, puis a été
utilisé dans les installations radiotéléphoniques
navire-terre dans les années 1930 et constitue un concept éprouvé.
Ce décodeur était étiqueté « 102 ».
Western Electric et les sociétés Bell n'ont donc pas élaboré
un concept entièrement nouveau de téléphone de
voiture en 1946 ; ils ont utilisé des composants éprouvés
d'autres systèmes pour créer le nouveau service téléphonique
public de voiture.
L'équipement de téléphonie mobile était déjà utilisé en interne au sein du système Bell à titre expérimental, dès avant la Seconde Guerre mondiale, en utilisant des radios mobiles telles que l'équipement VHF Western Electric Type 28. Un exemple était le service radiotéléphonique d'urgence créé par le New York Telephone en décembre 1940, qui utilisait la AM sur la bande 30-40 mégacycles. Sur la base des tests réussis de cet équipement, AT&T a annoncé la création du service radiotéléphonique mobile général le 29 juin 1945 et a demandé à la FCC l'autorisation d'établir des stations de base à Baltimore, Chicago, Cincinnati, Milwaukee, Philadelphie, Pittsburgh, St. .Louis, Washington DC, Columbus Ohio, Denver, Houston, New York et Salt Lake City. Il faut se demander pourquoi rien n’a été initialement envisagé pour la Californie.
La FCC et les sociétés Bell envisageaient
deux formes de service de téléphonie mobile, « HIGHWAY
» et « URBAN ».
Les deux seraient VHF et tous deux utiliseraient la FM. Le service «
Highway », comme son nom l'indique, était destiné
principalement à desservir les principales routes terrestres
et fluviales qui existaient à travers les États-Unis dans
les années 1940, qui ne seraient pas desservies par les systèmes
« Urban ». Le service routier était destiné
aux camions et aux barges circulant sur les voies navigables intérieures
plutôt qu'aux véhicules privés. Le service routier
s'est vu attribuer 12 canaux dans la « bande basse » VHF,
l'équipement mobile recevant sur 35 mégacycles et transmettant
sur des fréquences de 43 mégacycles, bien que les 12 canaux
n'aient pas été initialement utilisés. L'équipement
Urban, comme son nom l'indique, était destiné à
desservir les abonnés mobiles dont les déplacements les
amenaient principalement dans le rayon immédiat d'un grand centre
urbain, comme les médecins, les camions de livraison, les ambulances,
les journalistes, etc. L'équipement urbain fonctionnait sur VHF
152 mégacycles (réception) et 158 ??mégacycles
(émission) et l'allocation initiale de la FCC en 1946 était
de 6 canaux. La séparation des canaux de transmission et de réception
était nécessaire pour fournir un circuit de communication
« semi-duplex » et permettait à la station de base
de la compagnie de téléphone de rester en ondes en continu
pendant toute la durée de l'appel. Le premier système
routier a été diffusé le 28 août 1946 à
Green Bay, Wisconsin, et le premier système urbain a été
diffusé à Saint Louis le 17 juin 1946.
En 1948, le service Urban était disponible dans 60 villes des États-Unis et du Canada, avec 4 000 abonnés mobiles, traitant 117 000 appels par mois. Le service routier était en place dans 85 villes avec 1 900 abonnés mobiles, traitant environ 36 000 appels par mois, la plupart des principales autoroutes de l'est et du Midwest étant couvertes.
Le système Bell est également entré
sur le marché des radios bidirectionnelles d'affaires et de police
après la guerre en proposant la location de systèmes radio
complets, y compris leur maintenance et leur mise à jour. Cet
équipement était marqué « Bell System »
soit en lettres peintes en blanc, soit avec des décalcomanies
à eau. Les petits services de police ont été encouragés
à utiliser le système de téléphonie mobile
« urbain » par opposition à un système de
répartition traditionnel, dont le fonctionnement devait être
quelque peu étrange. La plupart des équipements loués
par les filiales de Bell System étaient des équipements
Motorola « Deluxe » en deux parties, des radios FMTRU-5V
« Dispatcher » et des radios GE monobloc pré-Progress
Line. On pense que le système Bell a abandonné cette pratique
entre le début et le milieu des années 1950.

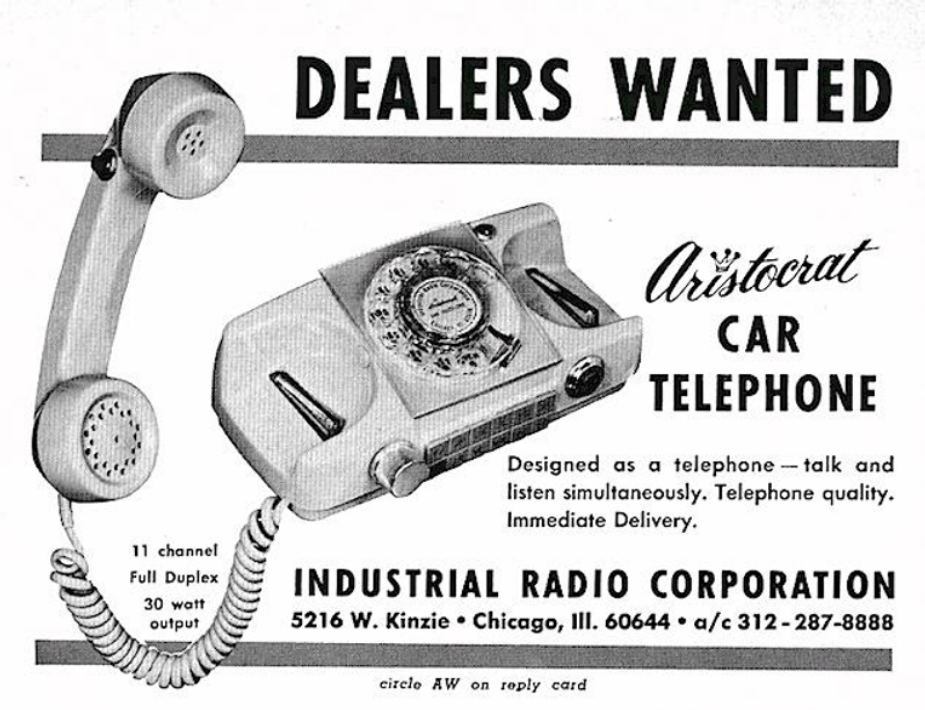
Motorola 342
Carte des stations terrestres de téléphonie
mobile en service ou prévues début 1947 :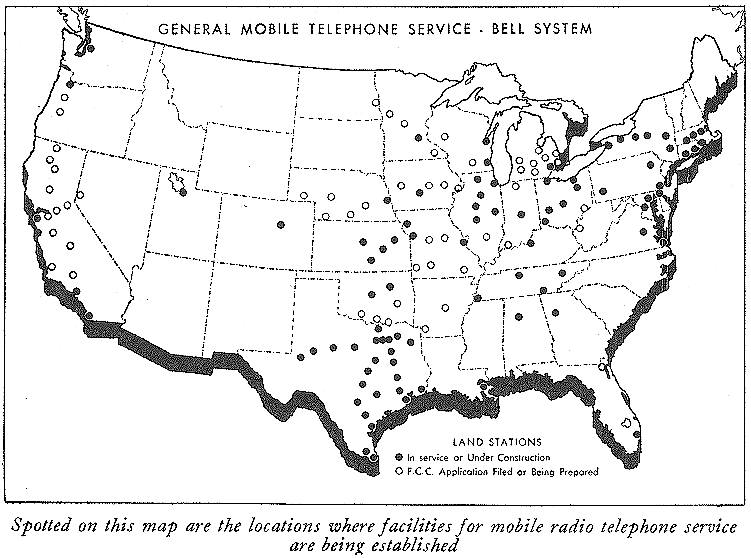
Carte des premières attributions de canaux de stations terrestres
de téléphonie mobile « autoroute », début
1947 :
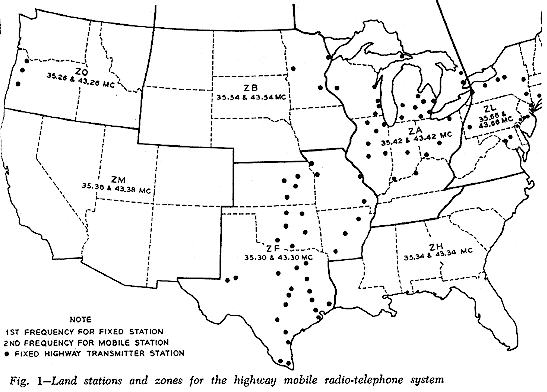 |
DÉSIGNATEURS ALPHA ORIGINALS À SIX
CANAUX URBAIN : WJ WR JL JP JR JS DÉSIGNATEURS ORIGINALS DES CANAUX AUTOROUTES ALPHA : ZF ZH ZM ZO ZB ZA ZL DÉSIGNATEURS DE CANAL ALPHA POST-BANDE ÉTROITE : (Après 1964) Autoroute : ZO ZF ZH ZM ZA ZY ZR ZB ZW ZL Urbain : JL YL JP YP YJ YK JS YS YR JK JR UHF : QJ QA QP QB QR QF QS QH QW QL QX QM |
sommaire
Installation typique du premier téléphone de voiture
:
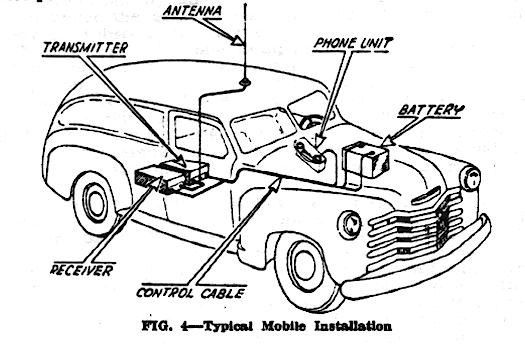
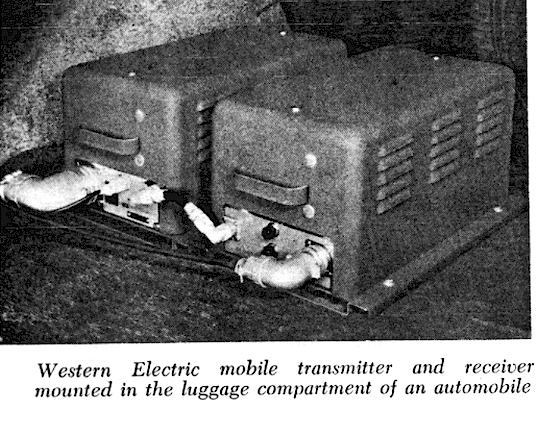
ÉQUIPEMENT WESTERN ELECTRIC 238 et 239 ET TÊTE DE COMMANDE
41A
L'équipement fabriqué par Western Electric se composait
de deux pièces ; l'armoire émettrice et l'armoire réceptrice.
Ceux-ci étaient montés dans le coffre de l'automobile,
et un gros câble avancé sous le tapis relié à
une « tête de commande » sous le tableau de bord qui
contenait un combiné téléphonique. La tête
de commande comportait deux lentilles lumineuses : l'une indiquait que
l'équipement était allumé et l'autre s'allumerait
lorsque le téléphone portable était appelé.
Le Western Electric Type 38 était un équipement à
bande routière, c'est-à-dire une bande basse VHF, et l'équipement
de type 39 était un équipement urbain ou à bande
haute VHF. Une installation complète porterait le préfixe
« 2 » ; en d'autres termes, le type 238 serait un téléphone
mobile routier complet, et le type 239 un téléphone mobile
urbain complet. Tel qu'il était initialement fourni, tous les
équipements fonctionnaient sur un seul canal, bien qu'une extension
à deux canaux soit possible.


La première tête de commande de téléphone
mobile du système Bell était la Western Electric Type
41A, vue ci-dessous.
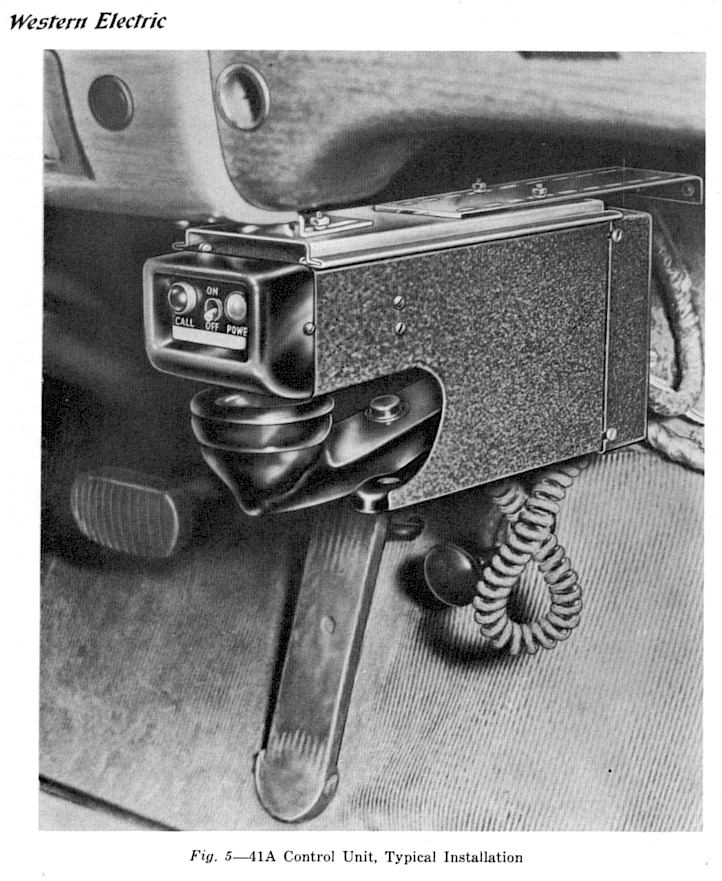 |
Le combiné, avec un cordon
en tissu tressé, se range dans une curieuse poche à
ressort au bas de la tête de commande. La cloche et les borniers
pour le câblage sont autonomes dans le 41A. Il y avait deux
styles de tête de commande 41A ; la différence résidait
uniquement dans la façade autour des lampes témoins
et de l'interrupteur à bascule. Le 41A original avait deux
lentilles de lampe exposées, comme indiqué. Le dernier
modèle avait une feuille de plastique lisse avec des morceaux
de lentilles colorées placés derrière. L'ensemble
41A était techniquement une installation monocanal, bien
qu'un interrupteur multicanal ait été développé
et monté à côté dans un boîtier
séparé. L'équipement permettant de décoder un signal de sonnerie destiné à une voiture particulière était une roue pas à pas rotative avec un verrou, conçue pour compter les impulsions entrantes au fur et à mesure qu'elles étaient composées depuis la station côté terre, située sur un châssis appelé "Sélecteur". Le signal de la station terrestre consistait en impulsions alternées de tonalités de 600 et 1 500 Hz représentant les différents nombres. La description de la façon dont cela a fonctionné est ci-dessous. Si tous les bons chiffres étaient reçus, la roue atteindrait la fin de sa course et une cloche serait activée soit à l'intérieur de la tête de commande (série 41), soit (plus tard) dans une boîte à cloche sous le tableau de bord de la voiture (série 47). |



En 1949, un schéma de numérotation typique pour l'équipement
était le suivant :
- Émetteurs
Type 38B Urbain 6 volts
Type 38C Urbain 12 volts
Type 39A Autoroute 6 volts
Type 39B Autoroute 12 volts
WETU-30-D Motorola urbain Deluxe 6 volts
WETU-30-12D Motorola urbain Deluxe 12 volts
- Dans les récepteurs de types 38 et 39, les circuits du décodeur
étaient montés à l'intérieur du châssis
du récepteur. Western Electric a également fabriqué
un boîtier séparé pour ce décodeur, de sorte
qu'il puisse être utilisé avec d'autres marques d'équipements
de radio mobile, tels que les radios FM bidirectionnelles de la ligne
Motorola "Deluxe" et les ensembles de deux pièces GE
1949 "Pre Progress Line". Le jeu de sélecteurs séparé
s'appelait 106A. Voir ci-dessous.
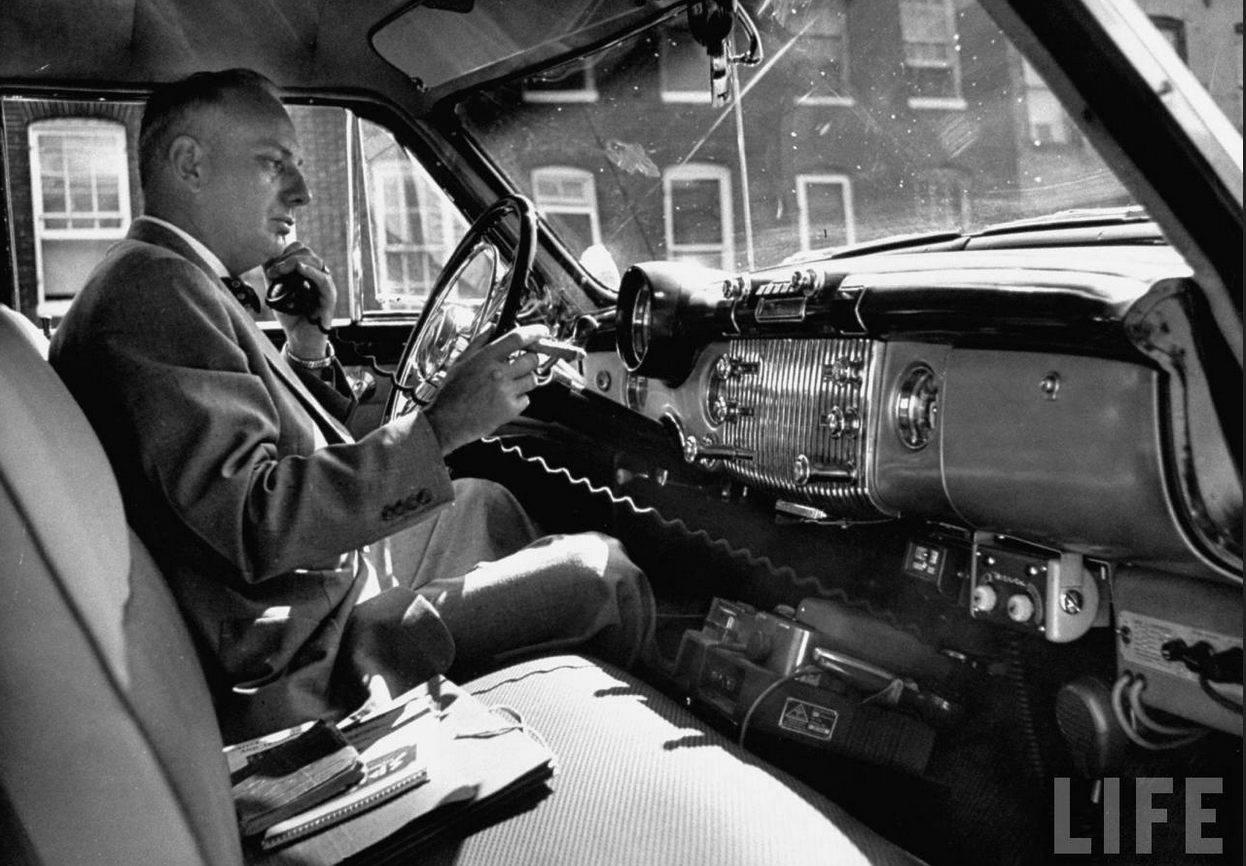
ENSEMBLE DE SÉLECTEURS WESTERN ELECTRIC SÉRIE 106A :

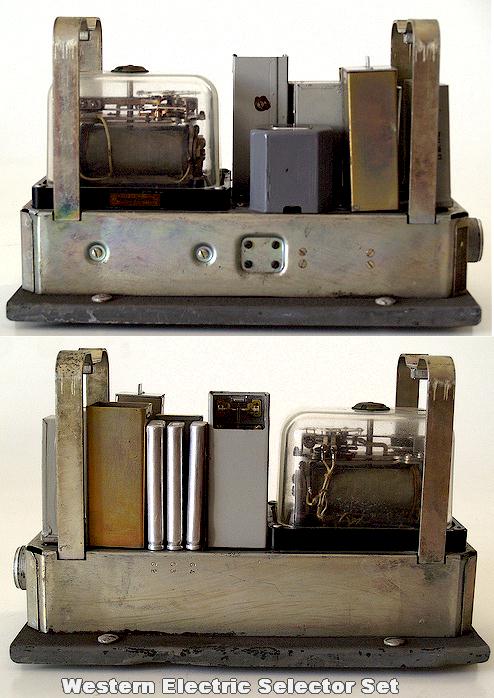
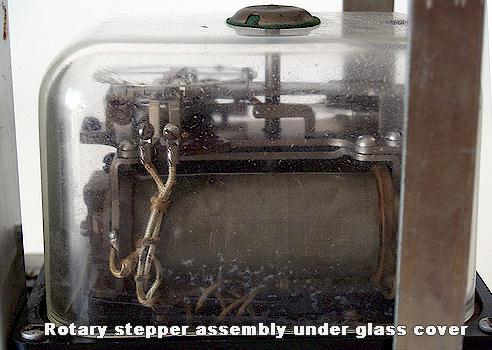
Les décodeurs de ces ensembles étaient capables de répondre
à un maximum de cinq chiffres et étaient actionnés
par une série de petites broches placées dans des trous
autour de la circonférence d'une roue à rochet dentée.
Lorsque l'opérateur composait un numéro d'unité
mobile spécifique, toutes les roues de tous les téléphones
mobiles à portée commençaient à bouger au
rythme des impulsions composées depuis la station de base de
la compagnie de téléphone. À la fin du premier
chiffre, seuls les mobiles dont les roues sont fixées à
ce numéro maintiendraient les roues à cet endroit. Les
autres se remettraient en position de repos. Ce processus se poursuivrait
jusqu'au cinquième chiffre, auquel cas (idéalement) toutes
les roues du décodeur des autres téléphones portables
seraient revenues en position de repos, sauf celle dont les cinq broches
correspondaient au numéro composé par l'opérateur,
auquel cas la roue fermerait un interrupteur et la cloche du mobile
sonnerait. Les signaux de la compagnie de téléphone étaient
des tonalités audio, alternant entre 600 et 1 500 cycles lorsqu'un
chiffre était composé. Il était possible d'entendre
la roue pas à pas fonctionner dans votre coffre avec des appels
destinés à d'autres personnes, et même d'anticiper
le moment où votre téléphone sonnerait en écoutant
le cliquetis du moteur pas à pas.
Ce premier système de téléphonie
mobile serait appelé « MTS ». Il n'y avait
pas de fonction de numérotation dans les voitures - - pour lancer
un appel, il suffisait d'appuyer brièvement sur le bouton Push-to-Talk,
ce qui allumait une lampe au niveau du standard de l'opérateur
mobile et mettait la station de base de la compagnie de téléphone
en veille. air. L'unité mobile donnerait à l'opérateur
son numéro de téléphone et sa ville d'immatriculation,
ainsi que le numéro à composer. Les mobiles n'étaient
pas "duplex", le fonctionnement du bouton-poussoir du combiné
était "appuyer pour parler" et "relâcher
pour écouter". La majorité des téléphones
mobiles n'avaient pas de circuit silencieux, de sorte que le bruit caractéristique
de « précipitation » FM émanait du combiné
chaque fois que la station de base cessait d'émettre. Ce n'était
pas un problème puisque le son du combiné était
coupé chaque fois qu'il était raccroché sur son
support.
Des équipements fabriqués par Motorola (la "Deluxe
Line") ont également été mis en service avec
Western Electric, principalement sur les chaînes "Highway",
ainsi qu'un petit nombre d'émetteurs-récepteurs FM en
deux parties GE (également pour "Highway" service.)
Les compagnies de téléphone indépendantes utilisaient
un équipement presque identique à celui des premiers téléphones
de voiture Western Electric, fabriqués par Automatic Electric
Co. comme indiqué ci-dessous, et qui auraient été
utilisés avec les radios Motorola et GE :
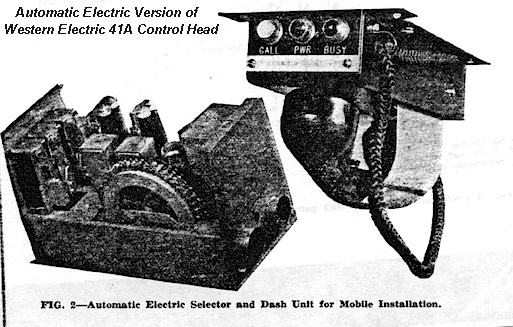
sommaire
LIGNE MOTOROLA « DE LUXE » ADAPTÉ À L'UTILISATION DE MTS :
La photo ci-dessous montre un radiotéléphone
"Urban" de la ligne "Deluxe" de Bell
System Motorola à bande haute (150 MHz) installé dans
un taxi du Delaware en 1948, occupant pratiquement tout le coffre. Beaucoup
de ces unités avaient une plaque de tôle soudée
au couvercle supérieur de l'armoire couvrant la zone des connecteurs.
Cela visait à empêcher les connecteurs et les câbles
d'être brisés par des objets jetés dans le coffre
et étaient généralement vus dans les taxis.

l'extrême gauche est le récepteur, le centre l'émetteur
et l'extrême droite le jeu de sélecteurs 106A. Notez que
ce type devrait acheter une nouvelle roue de secours !
L'unité de sélection rotative de signalisation type 106A
est représentée à l'extrême droite. Le récepteur
aurait été un modèle FMRU-16V modifié pour
une utilisation par Western Electric et (apparemment) renuméroté
WERU-16-V (pour un récepteur de 6 volts.) L'émetteur aurait
été le WETU-30-D (alimenté par un dynamoteur urbain
de 6 volts). émetteur) qui dans la numérotation Motorola
était le FMTU-30D.
Les armoires de ces unités montrent qu'elles ont déjà
été « recyclées » par le système
Bell : l'une est légèrement plus ancienne que l'autre
et elles ne correspondent pas strictement. Il s'agissait de radios bidirectionnelles
régulières modifiées pour une utilisation du système
Bell en incorporant l'unité de sélection externe et une
tête de commande de type téléphone.
Côté station terrestre
Vous trouverez ci-dessous une photo du récepteur à
distance typique utilisé pour transmettre le signal des téléphones
mobiles à la carte opérateur du central, dans ce cas appelée
console G2. Ils étaient montés dans une armoire résistante
aux intempéries au bas d'un poteau téléphonique,
l'antenne située au sommet du poteau étant alimentée
par un câble concentrique rempli de gaz. Il y avait généralement
plusieurs de ces récepteurs situés à des points
stratégiques, mais un seul émetteur. Celui-ci se trouvait
à l'extérieur de Philadelphie et utilise un récepteur
Motorola FSRU-16B sur 157 MHz.
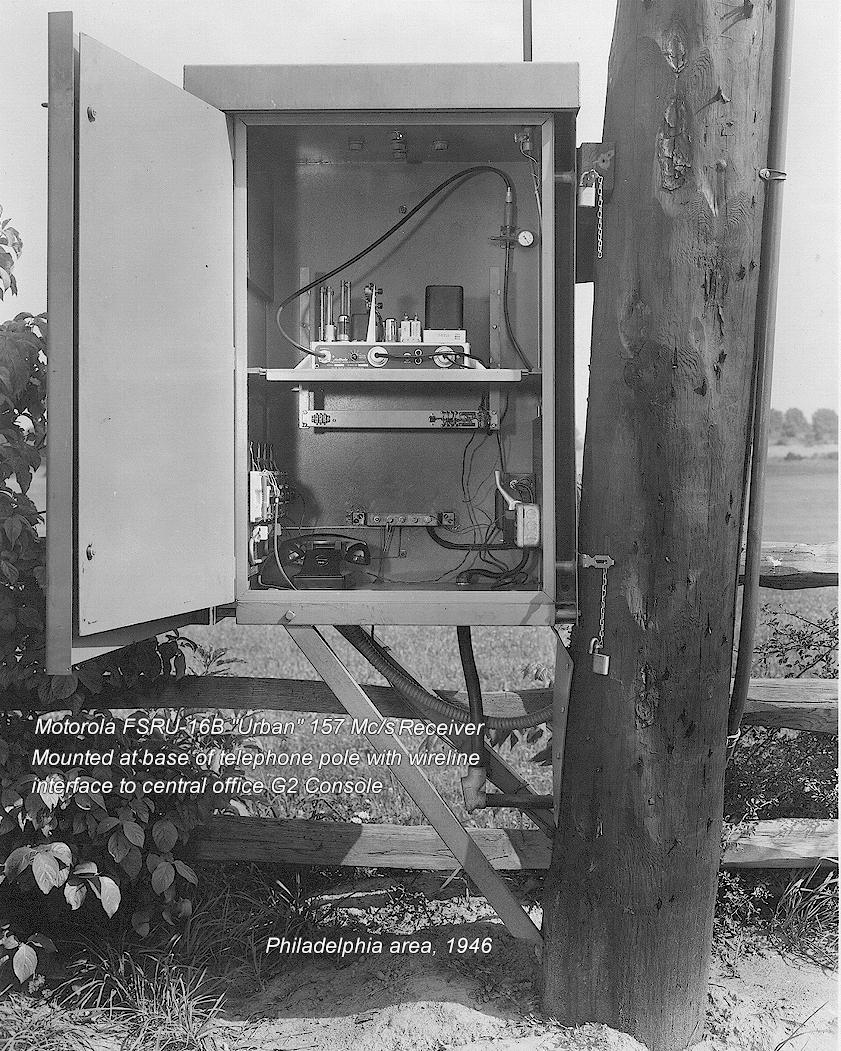
RÉCEPTEUR À DISTANCE UTILISANT UN ÉQUIPEMENT WESTERN
ELECTRIC TYPE 38 :


La vue de droite montre un site de réception distant où
le récepteur lui-même se trouvait à l'intérieur
d'un bâtiment d'emprise ferroviaire qui semble avoir été
autrefois une petite gare, déjà fermée en 1947,
quelque part près de Philadelphie.
Vous trouverez ci-dessous des vues typiques d’un standard et d’un
équipement de bureau central. Dans ce cas, Philadelphie, 1946,
la console de commande Western Electric G2. Les supports représentent
la console dans la zone de commutation de l'usine téléphonique
et le standard en bois et l'imprimante de tickets de péage se
trouvent à l'intérieur de la zone principale de l'opérateur.
Notez les récepteurs VHF Western Electric « Urban »
et « Highway » montés sur le dessus des cadres du
rack. L'émetteur était situé ailleurs.
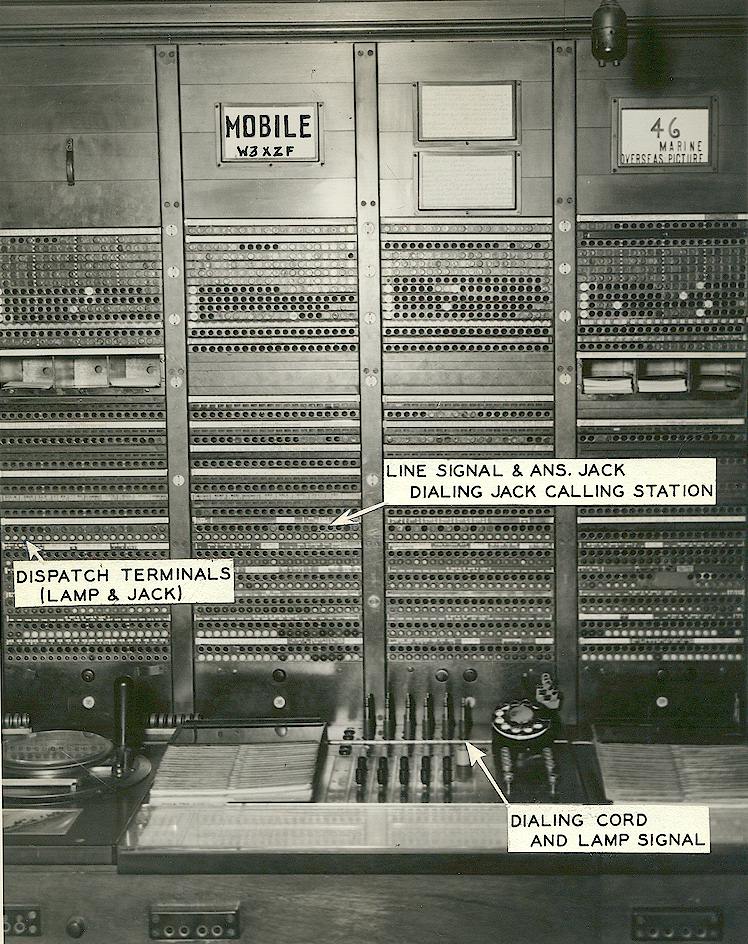
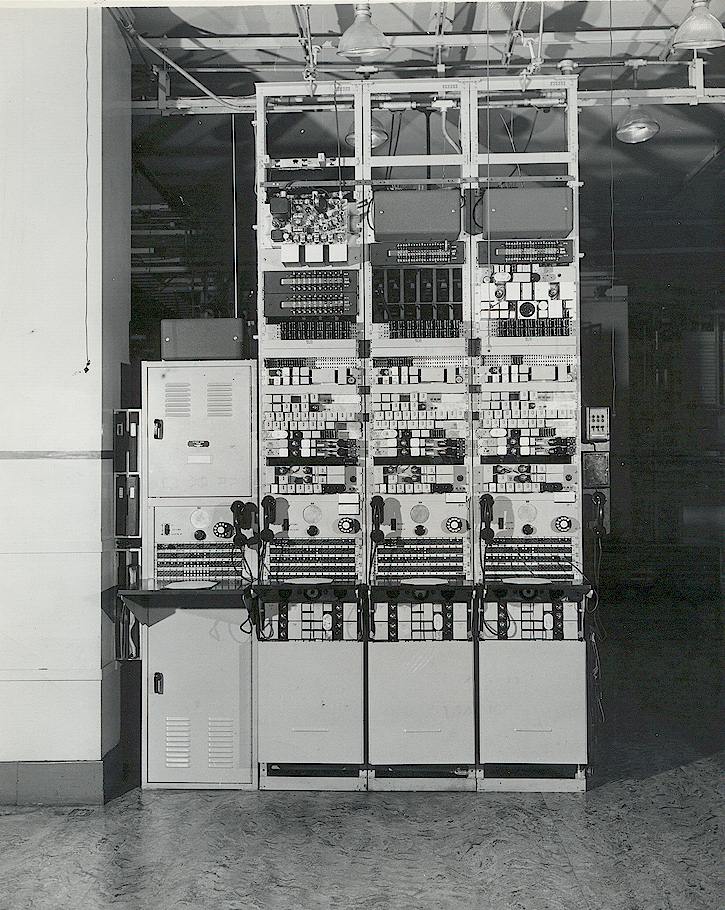

La légende de la photo ci-dessus se lit comme suit :
" Terminal de contrôle Western Electric G2 . Les installations
de terminaux pour le service de téléphonie mobile dans
la région de Philadelphie comprennent quatre terminaux de contrôle
Western Electric G2. Le type d'armoire à gauche est destiné
à la liaison Philadelphie dans le réseau routier New York
- Washington. Le premier monté en rack le type à gauche
est pour le canal Philadelphia Urban # 1 (FCC # 11.) Les trois boîtes
carrées au-dessus des panneaux de fusibles sont des filtres dans
les lignes électriques CA entrantes pour réduire le bruit.
Le récepteur en haut est destiné à surveiller les
récepteurs en haut. de la Les racks sont destinés à
surveiller leurs canaux respectifs. Le rack du milieu de type G2 est
destiné au canal urbain de Philadelphie n° 2 (FCC n°
9.) Le rack de droite de type G2 est destiné au canal urbain
n° 3 (FCC n° 7.) Service ferroviaire pour le Le trajet de New
York à Washington est également géré sur
ce canal. L'appareil situé juste au-dessus de l'équipement
G2 sur le support de droite est un réducteur de bruit A1 J6806L1
et une unité appliquée utilisée en relation avec
le service ferroviaire.
Photo ci-dessous de l'opérateur mobile du bureau
central de Michigan Bell. Au verso de la photo, on peut lire : "COMMANDE
MOBILE - - Les appels vers et depuis les unités mobiles sont
traités par un 'opérateur de service mobile' spécial
dans le bureau principal de la Michigan Bell Telephone Company. Mlle
Pat A. Voige est montrée alors qu'elle termine les premiers appels
sur le nouveau système ici" (1948)
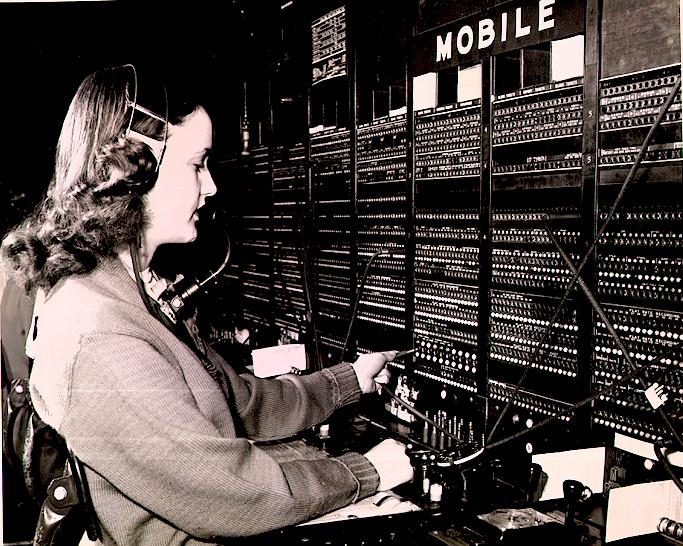
Au début des années 1950, Western Electric
avait abandonné le secteur de la fabrication de téléphones
mobiles et de radios bidirectionnelles, mais l'écart a été
rapidement comblé par un certain nombre de fabricants, dont Motorola
et General Electric.
Le service de téléphonie mobile dans le système
« manuel » d'origine composé par l'opérateur
sera plus tard appelé simplement « MTS ».
À cette époque, les canaux restaient dans les attributions
de bandes basses et hautes VHF. Il n'y avait pas de téléphones
mobiles UHF Bell autres que certaines unités GE Progress Line
sur commande spéciale à la fin des années 1950
pour une utilisation dans les bureaux urbains « abonnés
».
Les canaux de téléphonie mobile, du moins
dans les zones urbaines, étaient déjà saturés
à la fin des années 1950.
Les listes d'attente pour un numéro de mobile se sont allongées
et les abonnés ont souvent eu recours à l'enregistrement
d'un mobile dans un autre État juste pour obtenir un numéro,
utilisant ce numéro pour passer des appels en tant que «
itinérant » dans une zone qui n'avait pas de nouveaux numéros
disponibles. Les statistiques montrent que les sociétés
Bell System avaient littéralement des milliers de personnes sur
des listes d'attente pour devenir clients et avaient eu recours à
un système quelque peu « élitiste » d'attribution
de nouveaux numéros, donnant la priorité aux médecins,
aux hôpitaux, aux équipes d'urgence, etc. Néanmoins,
je dois dire que « des milliers » de clients potentiels
ne signifie pas que la population américaine dans son ensemble
avait désespérément besoin d'un téléphone
mobile ou qu'elle en voyait même le besoin.
Employé d'une compagnie de téléphone dans le Wisconsin
vers 1956, le véhicule est équipé à la fois
d'un canal "Z" à bande basse et de téléphones
"Urban" à bande haute :


Le boîtier de jonction VJB-1 (borne et cloche). Il y a une petite
cloche à l'intérieur, et cette boîte était
généralement montée dans la zone du panneau de
protection avant ou sous le tableau de bord, là où la
cloche pouvait être entendue.
Au début des années 1950, une installation MTS typique
consistait en une radio bidirectionnelle presque générique
Motorola Deluxe, Research Line (plus tard « Twin-V ») ou
GE « Progress Line » avec une tête de commande Western
Electric série 41A ou 47A. L'équipement Motorola utilisait
toujours le sélecteur externe Western Electric 102A, tandis que
l'équipement GE Progress Line utilisait son propre sélecteur
interne, appelé VS-1. Les équipements GE plus anciens
antérieurs à la « Progress Line » utilisaient
également le sélecteur externe Western Electric. Les numéros
de radio typiques de Motorola étaient W43-1 et W41-1, le «
W » signifiant contrat Western Electric et le 43 faisant référence
à « Urban » tandis que le « 41 » représentait
« Highway ». Les numéros Motorola ultérieurs
étaient généralement W43GGV-1 et W41GGV-1. L'équipement
GE « Progress Line » post-1954 était numéroté
WA/E-33 ou WA/E-13. L'équipement GE Progress était initialement
livré dans des boîtiers de 17" pour accueillir le
jeu de sélecteurs interne et un pont à canaux multiples.
Les mobiles GE "Progress Line" à alimentation transistorisée
de 12 volts de la fin des années 1950 avaient suffisamment d'espace
à l'intérieur pour permettre l'utilisation d'un boîtier
plus étroit, et sinon boîtier standard de 13 pouces.
Le premier système automatique a été
l'IMTS du Bell System, qui est devenu disponible en 1964, offrant une
numérotation automatique vers et depuis le mobile.
 Motorola Carphone Model TLD-1100, 1964
Motorola Carphone Model TLD-1100, 1964
Parallèlement au service téléphonique mobile amélioré
(IMTS) aux États-Unis jusqu'au déploiement des systèmes
cellulaires AMPS, une technologie de téléphonie mobile
concurrente était appelée Radio Common Carrier ou RCC.
Ce service a été fourni des années 1960 aux années
1980, lorsque les systèmes AMPS cellulaires ont rendu l'équipement
RCC obsolète. Ces systèmes fonctionnaient dans un environnement
réglementé en concurrence avec les systèmes MTS
et IMTS du Bell System. Les RCC traitaient les appels téléphoniques
et étaient exploités par des entreprises privées
et des particuliers. Certains systèmes étaient conçus
pour permettre aux clients de RCC adjacents d'utiliser leurs installations,
mais l'univers des RCC n'était pas conforme à une norme
technique interopérable unique (une capacité appelée
itinérance dans les systèmes modernes). Par exemple, le
téléphone d'un service RCC basé à Omaha,
au Nebraska, ne fonctionnerait probablement pas à Phoenix, en
Arizona. À la fin de l'existence de RCC, les associations industrielles
travaillaient sur une norme technique qui aurait potentiellement permis
l'itinérance, et certains utilisateurs mobiles possédaient
plusieurs décodeurs pour permettre le fonctionnement avec plus
d'un des formats de signalisation courants (600/1500, 2805 et Reach).
Le fonctionnement manuel était souvent une solution de repli
pour les itinérants du RCC.
Lorsqu'un relais est utilisé, il est possible d'interconnecter
le réseau de radiotéléphonie avec le réseau
de téléphonie fixe (et donc le réseau de téléphonie
mobile) via le relais. Ce système est beaucoup utilisé
par les compagnies de taxi. Lorsqu'une personne appelle le numéro
de téléphone depuis son téléphone fixe,
cela déclenche le relais et tout ce que dit la personne est émis
sur les ondes ; les communications radio sont également basculées
sur le réseau de téléphone fixe. Pour la personne
au téléphone, la communication se fait de manière
habituelle, n'étant en général pas au fait des
conventions de radiotéléphonie, la station radio s'attache
donc à parler normalement et uniquement lorsqu'elle sent que
la personne au téléphone a fini de parler.
...
sommaire
En 1954, le téléphone en voiture fait fantasmer sur un
avenir moderne et palpitant, avec au passage un chouïa de rêve
américain. "Le téléphone va-t-il étendre
son réseau aux voitures qui circulent dans Paris ? Une automobile,
munie d'un poste radio téléphonique expérimental,
a été mise en circulation", affirme un journaliste
dans un reportage de l'époque. Aucune évocation d’un
quelconque risque, même si on pianote pas soi-même le numéro
mais on le donne à une standardiste.
En France 1950, le Téléphone Mobile de Voiture
150 Mc/s est mis en étude par le Service des Recherches et du
Contrôle Technique, sur décision de l'Administration des
PTT. Les études sont avancées avant Janvier 1952 et la
première expérimentation débute le 1er décembre
1954 avec un véhicule SIMCA Arond.
1955 en Octobre, le premier réseau téléphonique
mobile R150 est ouvert commercialement en France, uniquement à
Paris et Région Parisienne, avec 10 premiers abonnés.
Ce réseau utilise des fréquences autour de 150 MHz, il
est conçu par la société Thomson-CSF
en coopération avec le SRCT.
Le système est entièrement manuel : tout se passe par
opératrice, via le Central Téléphonique Radio de
Paris situé dans le Centre Téléphonique Émetteur
Ménilmontant, sur un point haut de Paris.


Centre Radiotéléphonique de Paris-Ménilmontant
en 1955 puis en 1986.
Un abonné au radiotéléphone R150 désirant
joindre un autre abonné (fixe) appuie sur un bouton : il est
alors mis en relation avec une opératrice du Central Téléphonique
Radio de Paris.
Un abonné du réseau téléphonique fixe voulant
joindre un abonné au radiotéléphone R150 compose
le numéro d'appel dédié : OBErkampf 88.00, porté
par un Commutateur téléphonique automatique ROTARY
7A1.
Une opératrice traite dès que possible sa demande de mise
en relation.

Poste avec combiné d'appel est du type PTT 1924 dans une Citroën
DS19 - modèle 1956 équipés du Radiotéléphone
Thomson-CSF R150 entièrement Manuel, d'une puissance d'émission
de 10 watts.

1963, le numéro devient le 023.88.00, puis le 27 octobre
1970, le numéro devient le 366.88.00 porté par un Commutateur
PENTACONTA - en prévision de l'arrêt
prochain du Commutateur ROTARY 7A1 Oberkampf qui intervient le 3 février
1971.
Le réseau parisien est complété par 4 stations
de réception situées sur des points hauts de la capitale
: le Mont-Valérien, Montmartre, Belleville et Villejuif, afin
que l'administration puisse capter de la meilleure manière possible
les appels émis par les véhicules (dont la faible puissance
d'émission engendrait des problèmes de portée...)
Aussi, la multiplication des stations de réception permettait-il
d'accomplir le meilleur choix qualitatif de la liaison.
Le système est entièrement analogique.
Dans les années 1960, l'on signalera qu'un des plus anciens
abonnés célèbres au Radiotéléphone
manuel R150 à Paris est Philippe Bouvard, qui, en tant que journaliste,
avait installé son bureau dans son automobile Rolls-Royce pour
pouvoir joindre et être joint rapidement.
Le Radiotéléphone compte 449 abonnés en Octobre
1971.
1973, à la veille de son automatisation,
le Téléphone de Voiture R150 culmine avec 500 abonnés.
Chaque abonné au radiotéléphone manuel est à
cette époque pourvu d'un Indicatif à une lettre suivi
d'un numéro à 4 chiffres.
1973 : le Réseau Téléphonique Mobile PTT
R450 ouvre officiellement en France le 1er juin 1973.
Une expérimentation sur abonnés-test étant déjà
mise en œuvre au mois de Janvier 1972.
Sa dénomination initiale est : Service de la Correspondance Publique
Automatique avec des Installations Mobiles Terrestres.
Le réseau R450 vient compléter le réseau R150.
Ces deux réseaux fonctionnent de manière combinée
et complémentaire. (ceci était transparent pour l'usager)
Ce réseau utilise des fréquences autour de 450 MHz. Le
rayon d'action de chaque station émettrice est d'environ 30 km.
(Diamètre de 60km). Le système est entièrement
analogique.
Le nouveau réseau téléphonique R450 est à
commutation entièrement automatique. Il permet d'appeler et d'être
appelé selon les mêmes procédures que le réseau
téléphonique filaire ordinaire. Seule la zone locale de
Paris est ouverte à l'exploitation au 1er juin 1973 (avec le
préfixe réservé BPQ=399)...
Techniquement, en Île-de-France, nous savons qu'au 1er juin 1973,
un préfixe BPQ=399 est attribué aux abonnés du
radiotéléphone R450 ; cette situation perdure jusqu'en
Juillet 1979 au minimum et change avant Juin 1982.
Le préfixe est alors initialement porté par un Commutateur
de type électromécanique PENTACONTA
.
Quelques années plus tard nous savons que le préfixe BPQ
392 existe déjà le 26 janvier 1983 (T250 : VRD3) et qu'il
est porté par un commutateur téléphonique du réseau
public de type MÉTACONTA 11F : (à Paris ).
Le préfixe BPQ=392 aurait remplacé le 399 en 1980-81.
Les abonnés au Radiotéléphone automatique de province
se voient attribuer un numéro de téléphone commençant
par l'indicatif interurbain de leur zone, dans le plan de numérotage
du réseau téléphonique filaire.
Qu'il s'agisse d'un abonné d'Île-de-France ou de Province,
chaque abonné au radiotéléphone doit être
appelé au format de la numérotation nationale à
8 chiffres, via l'indicatif 16 (ou 15), même si l'abonné
au radiotéléphone circule dans sa circonscription.
La zone locale de Lille ouvre le R450 à l'exploitation le 17
juin 1974 ((AB).PQ=(20).21...)
La zone locale de Lyon ouvre le R450 à l'exploitation le 6 janvier
1975 ((AB).PQ=(74).44...)
La zone locale de Marseille (Marseille 1) ouvre le R450 à l'exploitation
le 24 février 1975 ((AB).PQ=(91).32...). Marseille 2 sera mis
en service le 24 mi 1976. La zone sera par la suite étendue le
19 août 1986 ((AB.PQ=(91).19...)
La zone locale de Strasbourg ouvre le R450 à l'exploitation le
15 novembre 1976 ((AB).PQ=(88).21...)
La zone locale de Bordeaux ouvre le R450 à l'exploitation le
18 juillet 1977 ((AB).PQ=(56).53...)
La zone locale de Toulouse ouvre le R450 à l'exploitation le
1er septembre 1979 ((AB).PQ=(61).45...)
Les zones locales de Rouen et Caen ouvrent le R450 à l'exploitation
le 1er juillet 1980 ((AB).PQ=(35).01...)
Les zones locales de Nice et Cannes (+ Monaco) ouvrent le R450 à
l'exploitation le 1er juillet 1980 ((AB).PQ=(93).06...)
Les AB.PQ de province indiqués sont les premiers mis en service
à l'ouverture du R450 dans chaque zone. Quelques autres ont été
ajoutés ultérieurement suivant les zones. (voir le Dépliant
du RadioTéléphone de Voiture en 1988.)
Le parc d'abonnés au R150 et R450 confondus atteint 8.600 abonnements
au 31 décembre 1983, puis 10.000 abonnés le 26 juin 1984,
et 10.500 abonnés au 31 décembre 1984.
Ce réseau est définitivement fermé le 1er janvier
1989 aux nouveaux abonnés et au 31 décembre 1989 pour
les anciens abonnés. (Décret n°88-461 du 28 avril
1988).
Dans les faits, en Île-de-France, le réseau R450 ferme
le 4 décembre 1989, date à laquelle l'AB.PQ=43.92 qui
portait les derniers abonnés de ce réseau est fermé.
(Ordre Télex du 4 décembre 1989 faisant foi).
La gamme de fréquences des 450 MHz est alors réutilisée
pour la SFR dès le 30 mars 1989.
Les abonnés désirant conserver leur abonnement au Radiotéléphone
de Voiture demeurent acheminés via le réseau R150 MHz
jusqu'à la fin 1991.
Les derniers abonnés à ce système se voient proposer
un basculement dans la nouvelle norme Radiocom 2000 de France-Télécom
avant le 2 janvier 1992.
La capacité maximale du réseau R450 est de 3.500 abonnés.
Il vient en "complément" du réseau R150.
En 1975, les derniers abonnés au Radiotéléphone
manuel sont basculés en automatique.
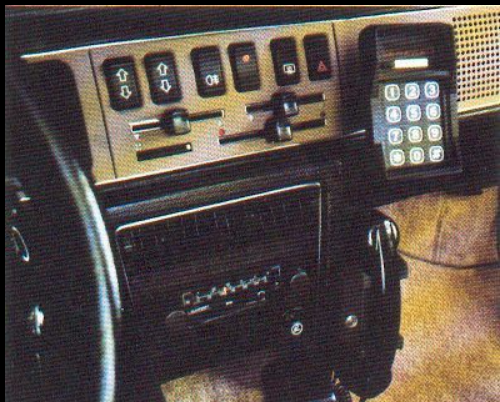 Thomson
CSF de 1973.
Thomson
CSF de 1973.
Que ce soit en technologies R150 ou R450, ce qu'il est
convenu d'appeler le "Téléphone de Voiture"
atteint le 10.000ème abonné le 26 juin 1984 pour culminer
en fin 1985 à un total de 12.000 abonnés. Autant dire
que le Téléphone de Voiture n'était réservé
qu'à une élite privilégiée.
Le prix, la complexité, la limite de portée réservent
ce service à un très petit nombre : lorsque le service
manuel est arrêté en 1973, il compte 500 abonnés...
1979 Renault 18.
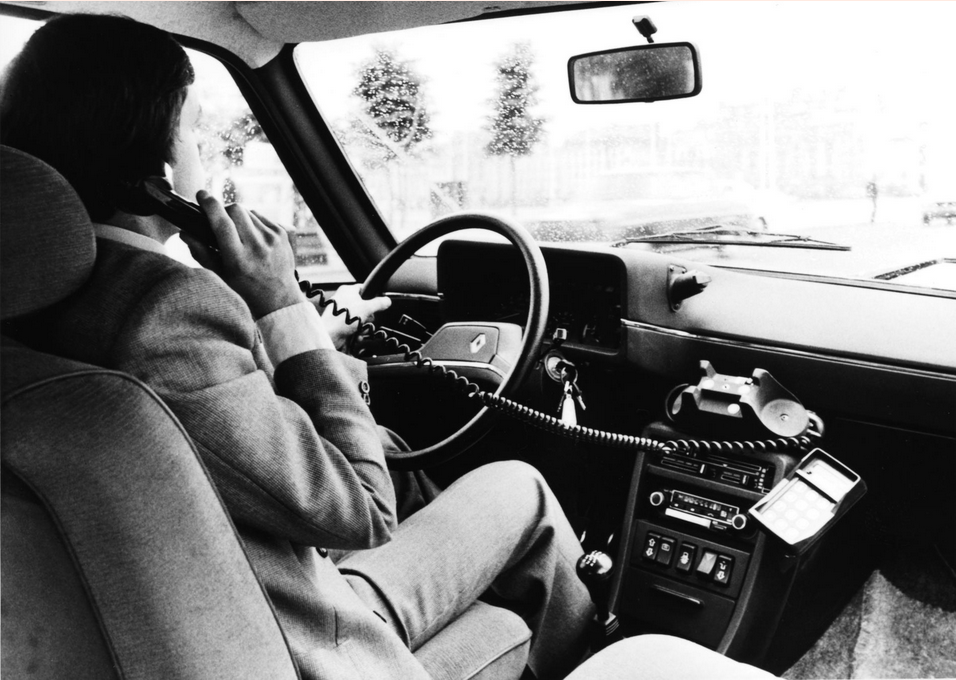

Dans le monde du sans fil, les années 70 ont été
l'heure du service 0G.
Les systèmes téléphoniques de voiture utilisent
les batteries du véhicule pour recevoir un signal. Mais leur
popularité s'améliorait et, dans les années 80,
lorsque Ameritech a lancé
un service cellulaire commercial, les téléphones
de voiture étaient encore plus populaires que les téléphones
portables.
1982 - 1996 : repères réglementaires.
Le 3 mai 1982, il est créé la Délégation
aux Télécommunications avec les Mobiles à la Direction
Générale des Télécommunications par l'arrêté
n° 1187. Son premier responsable est M. l'Ingénieur Général
- Philippe Dupuis. La DTM est basée au Centre Téléphonique
de Paris - Voltaire.
Le 25 février 1983, il est créé la Sous-Direction
des Radiocommunications au sein de la Direction des Affaires Industrielles
et Internationales par la décision n° 259. Cette nouvelle
organisation anticipe l'accroissement à venir du parc d'usagers
en définissant les conditions d'utilisation des fréquences
radio-électriques et l'élaboration de la réglementation.
Le 28 janvier 1986, il est créé une Délégation
Générale à la Stratégie.
Le 7 octobre 1986, il est créé, en remplacement à
la Direction Générale à la Stratégie, une
Mission à la Réglementation Générale. Son
responsable est M. Jean-Pierre Chamoux, centralien. Son adjoint est
M. l'Ingénieur en Chef des Télécommunications -
Laurent Virol.
La Mission à la Réglementation Générale
est présentée "pour rajeunir le droit des P et T".
Dans les faits, elle prépare la dérèglementation
du secteur des télécommunications et sa privatisation...
Le 24 avril 1987, il est créé un Département des
Radiocommunications à la Mission à la Réglementation
Générale qui sera chargé d'établir les contrôles
des futurs opérateurs de services de radiocommunications à
venir, par l'arrêté n°1731 signé de M. le Ministre-délégué
chargé des P et T - Gérard Longuet.
Le 22 avril 1988, il est créé le Service des Télécommunications
avec les Mobiles à la Direction Générale des Télécommunications
par l'arrêté n° 2003 signé par M. le Ministre
délégué auprès du ministre de l'industrie,
des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T - Gérard
Longuet. L'arrêté n°1187 du 3 mai 1982 est abrogé.
Le 19 janvier 1989, il est créé la Direction des Radiocommunications
avec les Mobiles (DRM) par le décret n°89-12 signé
par M. le Premier Ministre - Michel Rocard. Cette Direction dépend
de la Direction Générale des Télécommunications.
Cette étape marque l'accroissement de l'importance de la téléphonie
mobile en France.
Le 19 mai 1989, il est créé, en remplacement de la Mission
à la Réglementation Générale, une Direction
de la Réglementation Générale, par le décret
n°89-327 signé par M. le Premier Ministre - Michel Rocard.
Son Directeur, nommé le 12 juin 1989 est M. Bruno Lasserre.
Le 1er décembre 1993, il est créé en remplacement
de la Direction de la Réglementation Générale,
la Direction Générale des Postes et Télécommunications
(DGPT), par le décret n°93-1272 signé par M. le Premier
Ministre - Édouard Balladur. Son Directeur, nommé au 13
décembre 1993, est M. Bruno Lasserre.
Le 23 décembre 1996, il est créé, en remplacement
de la Direction Générale des Postes et Télécommunications,
une Autorité de Régulation des Télécommunications
(ART) par le décret n° 96-1138 signé par M. le Premier
Ministre - Alain Juppé
1982 : le Radiocom 200 expérimental, par l'administration
des PTT.
Le Radiocom 200 est un réseau téléphonique
mobile semi-analogique et semi-numérique expérimental
de 1ère génération (1G) ouvert en premier
lieu en Région Parisienne. Il permet à des flottes de
véhicules d'une même entreprise de se téléphoner
entre eux ainsi qu'avec le siège de leur société,
sous la forme d'un réseau privatif.
En 1979, l'Administration des Télécommunications
décide de lancer l'étude d'un nouveau système de
télécommunications basé sur le principe américain
"Trunked Radio System". Ce système doit
permettre une meilleure utilisation du spectre de radiofréquences,
une meilleure concentration.
En 1980, une consultation est ouverte par l'Administration et des discussions
s'engagent avec Thomson et Matra Télécommunications. Thomson
se retire n'étant pas prêt technologiquement.
En 1981, un marché d'étude est signé entre l'Administration
et la société Matra Télécommunications.
Ce système repose sur une nouvelle technologie expérimentale
créée par Motorola.
En Décembre 1982, commence par Paris la commercialisation du
système R200, pour une durée initiale de 2 années,
par un arrêté ministériel en date du 1er décembre
1982 (J.O.R.F du 16 décembre 1982).
En 1984, le Radiocom 200 est ouvert en zone Marseille.
En 1985, le Radiocom 200 est ouvert en zone Lyon.
Ce réseau utilise des fréquences autour de 200 MHz.
Le parc d'abonnés au réseau R200 culmine à 3.900
abonnés en Région Parisienne.
Le 1er janvier 1990, le service Radiocom 200 cesse d'être commercialisé
aux nouveaux abonnés à cette date, conformément
au décret n°89-793 du 27 octobre 1989.
Les derniers abonnés Radiocom 200 sont basculés en Radiocom
2000, s'ils le désirent, via une offre commerciale de France
Télécom, avant le 1er septembre 1990, date butoir de fermeture
définitive du système Radiocom 200.
Le 1er septembre 1990, le système R200 est définitivement
arrêté. Les fréquences de la bande des 200MHz sont
réattribuées au réseau R2000.
sommaire
1985 : le Radiocom 2000, par France Télécom.
Radiocom 2000 est la norme 1G ou première génération.

Le 15 décembre 1983 sont lancées simultanément
en France et en RFA des consultations en direction des industriels.
Le 26 mars 1984, cinq réponses sont reçues et soumises
aux deux administrations provenant des consortiums suivants :
CIT Alcatel, Thomson-CSF, Philips Kommunication Industrie et Siemens,
Matra, Ant Nachrichtentechnik et Robert Bosch, Motorola, SAT, AEG-Telefunken
et S.E. Lorenz, SECRE et Ericsson Radio System AB.
La solution présentée par Matra est retenue par l'Administration.
Le 30 octobre 1984, lors du 11ème sommet Franco-Allemand qui
s'est tenu en RFA, les deux pays décident d'une coopération
poussée pour se lancer concrètement dans l'aventure. Constatant
la nécessité de plus de temps pour développer le
système numérique il est décidé de procéder
:
À titre transitoire, à l'ouverture rapide en France et
en RFA de systèmes de radiotéléphone analogique
1G, ce qui donnera le Radiocom 2000.
À titre pérenne, à l'ouverture du système
numérique GSM900 à l'horizon 1988-1989, période
envisagée.
En Novembre 1984, une première maquette fonctionnelle du système
Radiocom 2000 est mise en service à Bois d'Arcy (78) dans les
ateliers de la société Matra.
Du 19 au 22 septembre 1985, le Radiocom 2000 est présenté
en démonstration au SICOB sous forme de maquette, que les visiteurs
du Salon des Industries et du Commerce de Bureau peuvent essayer à
loisir.
Le 18 novembre 1985, l'ouverture du Radiocom 2000 au grand
public est effective . Il est l'héritier direct du Radiocom 200
expérimental ouvert en 1982. L'installation, la mise en service
et l'exploitation est organisée par la Direction des Télécommunications
des Réseaux Extérieurs (DTRE) de l'Administration.
Zone Paris : 18 novembre 1985, via les 5 premiers sites émetteurs
mis en service : Mont Valérien, Clichy-sous-Bois, Ménilmontant
(Paris), Lisses et Meudon.
Zone Nantes : 21 janvier 1986.
Zone Blois, Orléans, Tours : 15 octobre 1986.
Zone Metz : 19 décembre 1986.
Le lien avec le Réseau Téléphonique Commuté
est assuré par des Commutateurs téléphoniques d'abonnés
en système MT25, dont les plus importants, en Île-de-France
sont, au début du déploiement : Boissy-Saint-Léger
B2, Eaubonne B2, Le Raincy A3, Massy A5 et Philippe Auguste 2 ET1 à
Paris. (Des Commutateurs E10N1 seront aussi utilisés ultérieurement.)
Nous n'avons pas retrouvé la liste des tous premiers indicatifs,
ou des portions d'indicatifs utilisés au tout début du
réseau Radiocom 2000 entre la fin 1985 et la mi-1987.
À sa création il est essentiellement utilisé en
téléphone de voiture raccordé au Réseau
Téléphonique Public.
De plus, il est aussi utilisé en mode "réseau d'entreprise"
(groupe fermé d'usagers).
Les téléphones sont lourds, pèsent plusieurs kilogrammes
(au moins 5 Kg) et sont voraces en énergie.
Le 21 janvier 1986, le Radiocom 2000
est officiellement inauguré en France. En cette occasion, une
videotransmission bilatérale (dans les deux sens) a été
établie entre le Ministère des PTT (Salle des Congrès
- 20 avenue de Ségur) et Nantes (Grande salle du Centre de Communication
de l'Ouest - Tour Bretagne). Préside la cérémonie
officielle qui se tient de 17H00 à 18H30, M. le Ministre des
PTT - Louis Mexandeau qui y prononce de Paris le discours d'inauguration
du Réseau Radiocom 2000.
 1986 Radiocom 2000
1986 Radiocom 2000
Radiocom 2000 en 1986, a vraiment révolutionné la téléphonie
en France, avec les premiers "téléphones portables",
proposés dans une sorte de valisette de 3 à 5 kg la notion
de mobilité venait de naitre ... Il fallait compter 950 Frs/mois
(144 €) pour un abonnement multi zones et les communications étaient
taxées, fonction de la distance, sur la base d’une unité
PTT de 0.75 Frs/24 secondes. Petit détail, lorsque vous étiez
appelé, votre correspondant payait lui aussi une communication
surtaxée sur la base d’une unité PTT toute les 48
secondes
Le Radiocom 2000 est un réseau téléphonique mobile
semi-analogique et semi-numérique à structure cellulaire.
Il est aussi connu à ses débuts sous la dénomination
RARC, pour Radiotéléphone Automatique à Relais
Communs.
La taille des cellules, à l'ouverture de cette technologie, est
de l'ordre de 30 km de diamètre.
Ce réseau utilise des fréquences autour de 400 MHz pour
la couverture nationale (cas des abonnements nationaux), ainsi que la
bande des 200 MHz pour la couverture régionale (cas des abonnements
régionaux, c'est à dire confinés à une seule
région)
Le Radiocom 2000 est classé dans les systèmes de téléphonie
mobile de 1ère génération (1G).
Les signaux de contrôle et de localisation sont numériques,
ce qui représente un énorme progrès par rapport
aux anciens réseau de téléphones mobiles précédents
entièrement analogiques.
Tandis que les signaux des conversations téléphoniques
transitent directement en modulations analogiques et sans cryptage par
la voie aérienne. (De ce fait, les conversations étaient
très facilement écoutables : les journalistes parisiens
étaient couramment équipés de scanners pour "chopper"
des scoops en écoutant par exemple des personnalités importantes
équipées de cette technologie.)
En revanche, le système de géolocalisation (suivi de cellules)
n'existe pas encore en 1985 : ainsi, lorsque l'on quitte une cellule,
en voiture, la communication téléphonique mobile est alors
systématiquement coupée. Il est nécessaire de rappeler
le correspondant une fois couvert par une nouvelle cellule. Statistiquement
parlant, avec des cellules de 30km de diamètre, seules 5% des
communications se retrouvent interrompues, ce qui est alors considéré
comme tout à fait acceptable en 1985.
Chaque Radiotéléphone R2000 est rattaché à
son propre Relais Nominal. C'est de ce Relais Nominal que les Numéros
de Radio-Téléphone sont attribués aux usagers ayant
domiciliation officielle dans ce secteur.
Chaque Numéro de Radiotéléphone est rattaché
à un indicatif AB.PQ du Réseau Téléphonique
Commuté (tout ce qu'il y a de plus habituel), sachant qu'il n'est
pas obligatoire "d'immobiliser" la totalité d'un indicatif
AB.PQ, soit 10.000 numéros, pour une seule Station Relais. En
pratique, chaque Station Relais ne nécessite en général
que le segment de base d'un seul Millier ; soit 10% d'un indicatif d'AB.PQ,
soit seulement 1.000 numéros.
Chaque Radiotéléphone R2000 établit les communications
directement avec la Station Relais qui le couvre lors du début
de la conversation. Dans la Station Relais, les conversations hertziennes
analogiques sont numérisées avant d'intégrer le
Réseau Téléphonique Commuté.
Chaque Station Relais est raccordée par 2 ou 3 liaisons numériques
MIC (chaque liaison ayant 30 voies) à un Commutateur Téléphonique
Urbain (CAA) de type Électronique
Temporel de 2ème Génération (MT25 ou E10N1),
puis de 3ème Génération (AXE10 sûr). Chaque
Commutateur Téléphonique voit les liaisons MIC provenant
des Stations Relais R2000 comme une simple Unité de Raccordement
d'Abonnés Distante (URAD).
En 1987 et 1988, huit Commutateurs Temporels de 2ème génération
E10-5 sont mis en service en France pour assurer le raccordement de
certaines stations Radiocom 2000 isolées, en zones montagneuses.
Lorsque le Radiotéléphone est en déplacement et
qu'il se retrouve en dehors de sa zone de couverture habituelle, il
est alors pris en charge par la Station Relais où il se trouve.
On appelle ceci un Relais de Passage. Ceci permet à l'usager
de pouvoir téléphoner de n'importe où dans la zone
de couverture, quelle que soit sa position, mais ceci permet aussi de
recevoir les appels téléphoniques de tout correspondant
(fixe ou mobile) qui essaye de le joindre. En effet, les Relais de Passage
informent en temps réel l'ensemble du Réseau Téléphonique
Commuté, ce qui permet d'assurer la continuité du service
sur toute l'étendue de la couverture du Réseau Radiocom
2000 (décrochage, numérotation, acheminement, conversation,
taxation, raccrochage).
L’ajout de la fonction de « handover » permet
de continuer la communication en changeant de zone de couverture.
Cette dernière évolution technique a coûté
le rapatriement de tous les mobiles pour mettre à jour le logiciel
de gestion du mobile !
Mai 1986, le Radiocom 2000 compte 1.800 abonnés en France.
Ce n'est pas vraiement un téléphone
mobile indépendant du réseau commuté, il faudra
attendre un peu.
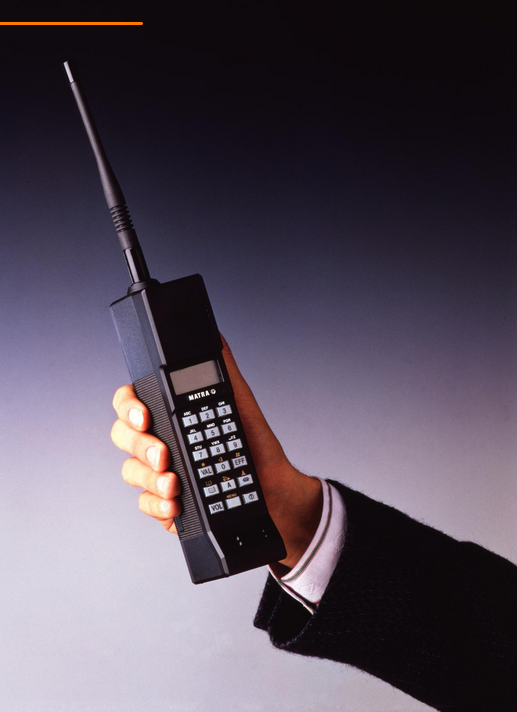 Un des
premiers radiotéléphones analogiques commercialisé
en France vraiment portatif, capable de fonctionner en dehors d'une
voiture, produit par Matra Communication à partir de 1989.
Un des
premiers radiotéléphones analogiques commercialisé
en France vraiment portatif, capable de fonctionner en dehors d'une
voiture, produit par Matra Communication à partir de 1989.
Modèle Matra ER2405 - version française du modèle
Cityman, fabriquée sous licence Nokia.
Ce modèle est disponible pour le Radiocom 2000 de France Télécom
et pour La Ligne SFR. Poids : 750 grammes.
Développement :
Début Mai 1986, le Radiocom 2000 compte 1.800 abonnés
en France.
Au 31 décembre 1986, le Radiocom 2000 compte 10.000 abonnés
en France.
Le 17 février 1987, le Radiocom 2000 est ouvert dans la Zone
de Nice, avec la mise en service du relais du Mont Agel.
Article de Février 1987 présentant le Radiocom 2000.
Au 30 juin 1987, le Radiocom 2000 compte 25.000 abonnés en France.
Entre Août 1987 et Mars 1989 sont créés techniquement
à Paris et dans les Hauts-de-Seine quatre indicatifs AB.PQ entièrement
réservés au Radiocom 2000 d'Île-de-France :
49.66 créé le 4 août 1987 sur Commutateur MT25 Observatoire
2 ET1 (CC62) (Ordre Télex du 8 juillet 1987).
40.57 créé le 10 septembre 1987 sur Commutateur MT25 Robert
Keller 2 ET1 (AD82) (Ordre Télex du 28 août 1987).
49.67 créé le 23 septembre 1987 sur Commutateur E10N1
Puteaux 4 ET2 (CC84) (Ordre Télex du 3 septembre 1987).
44.60 créé le 8 mars 1989 sur Commutateur MT25 Turbigo
4 ET1 (AE34) (Ordre Télex du 3 mars 1989).
Entre le 30 septembre 1987 et le 27 septembre 1988, un total de 8 Commutateurs
Temporels de 2ème génération E10-5 sont mis en
service en France pour assurer le raccordement de certaines stations
Radiocom 2000 isolées, en zones montagneuses.
Le premier Commutateur E10-5 mis en service pour le Radiocom 2000 est
Pech-Redon (AO93) le 30 septembre 1987.
Le Commutateur E10-5 le plus récent de France mis en service
pour le Radiocom 2000 est Força-Real (PR84) le 27 septembre 1988.
Le 28 décembre 1987, le Radiocom 2000 est ouvert dans toutes
les Régions administratives de France. En effet, la Corse voit
à cette date la mise en service de son relais Ajaccio-La Punta.
Au 31 décembre 1987, le Radiocom 2000 compte 40.000 abonnés
en France et couvre 44 % du territoire.
Le 8 janvier 1988, le premier radiotéléphone portatif
Radiocom 2000 est homologué. Il s'agit du modèle ATR 2000
P, d'un poids de 600 grammes, commercialisé par Alcatel.
En Avril 1988, le Radiocom 2000 est expérimenté pour la
première fois sur le réseau des Trains à Grande
Vitesse de la SNCF couplé avec un Publiphone spécifique
R2000TGV. Première ligne équipée : Paris-Montpellier.
Au 31 mai 1988, le Radiocom 2000 compte 62.200 abonnés en France
et couvre 60 % du territoire.
Le 1er Juillet 1988, toute souscription à l'Abonnement National
à 400MHz est suspendue en France. Le R2000 est victime de son
succès. Les canaux et les fréquences manquent. Le Réseau
400 MHz sature alors à un maximum de 100.000 abonnés.
Au 31 décembre 1988, le Radiocom 2000 compte 98.000 abonnés
en France et couvre 56 % du territoire.
Documentation Grand Public Radiocom 2000 de Janvier 1989.
Les Outils de Communication Radiocom 2000 - 1989.
Descriptif Technique succinct du système et de l'architecture
Radiocom 2000 (1993).
Au 14 février 1989, le Radiocom 2000 fête son 100.000ème
abonné. Désormais, dans certaines régions, il devient
de plus en plus difficile d'accepter de nouvelles souscriptions d'Abonnements
Régionaux, notamment à Paris. La saturation gagne même
les bandes additionnelles régionales des 200 MHz. Mais à
cette date et il est alors impossible d'étendre le spectre de
fréquences.
Le 21 mars 1989, les abonnements régionaux dans la bande des
200 MHz d'Île de France sont rouverts à la commercialisation,
après augmentation de la capacité technique du réseau,
pour 6.000 abonnements régionaux supplémentaires.
Le 31 mars 1989, le Radiocom 2000 atteint 115.000 abonnés.
Le 17 mai 1989, le Radiocom 2000 est expérimenté avec
succès pour la seconde fois sur le réseau des Trains à
Grande Vitesse de la SNCF couplé avec un Publiphone spécifique
R2000TGV. L'expérimentation se déroule sur la ligne Paris-Le
Mans, en présence de M. le Président de la République
- François Mitterrand, de M. le Ministre des PTE - Paul Quilès
et de M. le Directeur Général des Télécommunications
- Marcel Roulet.
Le 31 mai 1989, le Radiocom 2000 atteint 128.000 abonnés.
Le 30 juin 1989, le Radiocom 2000 atteint 135.800 abonnés.
Le 31 juillet 1989, le Radiocom 2000 atteint 141.000 abonnés.
Le 3 août 1989, en urgence, une bande de 4MHz est débloquée
par l'État pour créer en Île-de-France 40.000 abonnés
supplémentaires.
En Août 1989, la technologie du Hand-Over (Suivi automatique de
cellule en déplacement) est expérimentée à
Rouen. Le Hand-Over permet le transfert des conversations téléphoniques
en cours, d'un relais Radiocom 2000 à son relais voisin en cas
de déplacement de l'usager. Le Hand-Over est un préalable
au déploiement à venir du Réseau Haute Densité
devenu nécessaire.
Le 24 septembre 1989, ouverture commerciale du Radiocom 2000 TGV, sur
les lignes de TGV Paris-Nantes, Paris-Rennes et Paris-Lyon-Marseille,
par le biais de Publiphones à télécartes spécifiques.
Le 15 octobre 1989, le Radiocom 2000 atteint 153.600 abonnés.
En Octobre et Novembre 1989, sont techniquement créés
trois indicatifs supplémentaires ABPQ en Île-de-France.
Ce sont des indicatifs entièrement réservés au
R2000 dans cette région qui coïncident avec la mise en service
prochaine du Réseau Haute Densité :
44.03 créé le 23 octobre 1989 sur Commutateur MT25 Palais-Rose
2 ET1 (AD42) (Ordre Télex du 16 octobre 1989).
44.02 et 44.04 créés le 17 novembre 1989 sur Commutateur
MT25 Brune 2 ET1 (AB43) (Ordre Télex du 16 octobre 1989), puis
transférés sur Commutateur MT25 Murat 2 ET1 (AD02) le
15 février 1990 (Ordre Télex du 7 février 1990).
Au 31 décembre 1989, le Radiocom 2000 atteint alors 170.000 abonnés
et couvre 83 % du territoire.
Au 28 juin 1990, la barre des 200.000 abonnés au Radiocom 2000
est atteinte.
Le 3 juillet 1990, une extension du réseau en technologie améliorée
RHD (Réseau Haute Densité) est mise progressivement en
service.
Au 31 Décembre 1990, avec 230.000 abonnés atteints en
France, le R2000 peut enfin respirer : le RHD technologie permet de
récupérer des fréquences utilisables en multipliant
par 5 le nombre de cellules en service, ce qui entraîne un effet
pervers majeur : la taille moyenne des cellules est en conséquence
divisée par 5. Chaque cellule se retrouve à la dimension
moyenne de 6 km de diamètre seulement. Problème majeur,
avec des cellules de dimensions si réduites, les automobilistes
seraient sans cesse interrompus dans leurs conversations à chaque
changement de cellule ; changements devenus trop fréquents.
La solution très novatrice et très complexe a consisté
à concevoir et à mettre en service réel le suivi
dynamique numérique de communications, par changement de cellule
à chaud, durant les communications engagées. Ceci permet
le Transfert Automatique Intercellulaires. La prouesse technologique
ayant pu être accomplie, le réseau R2000 se retrouve désaturé
et peut permettre de patienter jusqu'au lancement prochain du téléphone
GSM France-Télécom en cours d'élaboration à
cette même époque.
À la fin de l'été 1991, le nouveau Réseau
Haute Densité R2000 sur la bande des 400 MHz est entièrement
déployé en lieu et place du réseau R2000 initial.
À partir de 1992, à titre transitoire, le Radiocom 2000
va aussi utiliser des fréquences dans la bande des 900 MHz (entre
929 et 935 MHz), pour étendre la capacité du réseau
sur Paris, Lyon, Lille et Strasbourg. En effet, cette gamme de fréquences
est d'ores et déjà réservée pour le futur
téléphone numérique GSM, mais en attendant son
plein déploiement, une dérogation transitoire est acceptée
pour "employer" temporairement ces fréquences alors
inutilisées. Cette seconde solution permettra aussi de faire
patienter dans les zones à forte densité de population.
Au 31 décembre 1991, le Radiocom 2000 compte 290.000 abonnés
en France. (97% de la population couverte)
En fin Février 1992, le Radiocom 2000 compte 300.000 abonnés
en France.
Au 31 décembre 1992, le Radiocom 2000 compte 330.000 abonnés
en France, qui constituera le maximum sur ce réseau.
Au 1er janvier 1993, les investissements sur le Radiocom 2000 cessent
et sont réorientés massivement vers le GSM Itinéris
de France Télécom.
En Mai 1994, le service Radiocom 2000 compte 325.000 abonnés
en France ; une prouesse technique en semi-analogique, mais signale
le début du déclin de ce système.
Au 31 décembre 1994, le Radiocom 2000 compte 201.000 abonnés
en France, confirmant une décrue importante du parc d'abonnés.
À partir de l'année 1995, le Radiocom 2000 est progressivement
délaissé par la clientèle au profit de la nouvelle
norme numérique GSM.
Dès le début de l'année 1997, Radiocom 2000 subit
une importante baisse de trafic.
Le 7 juillet 1997, commence le démantèlement progressif
du Radiocom 2000 : les premières bandes de fréquences
additionnelles n°8, 9, 11 et 12 sont fermées.
Le 4 août 1997, suit la fermeture des bandes de fréquences
additionnelles n° 7, 10 et VHF A/B. Ce qui signifie l'arrêt
du système Radiocom 2000 dans la bande des 200 MHz, avec l'arrêt
total des Abonnements Régionaux.
Le 1er Octobre 1998, il est confirmé une date d'arrêt du
réseau Radiocom 2000 fixée au 31 décembre 1998.
Mais au final, le réseau 1G bénéficiera d'un répit
d'un an et demi.
Le 28 juillet 2000, la fermeture technique définitive du Réseau
Radiocom 2000 et des Abonnements Nationaux (400 MHz + 900 MHz additionnels)
est effective à cette date.
le 8 septembre 2000, le Radiocom 2000 voit son existence légale
cesser par la publication au Journal Officiel d'un arrêté
du 31 août 2000 du Ministre de l'Industrie.
Les derniers abonnés au système Radiocom 2000 se voient
alors proposer un basculement dans la nouvelle norme GSM, sur le réseau
Itinéris de France-Télécom.
Avec le recul, le nom commercial du réseau 1G de France
Télécom apparaît prémonitoire... En effet,
le Radiocom 2000 disparaît en... 2000.
sommaire
- L'A-Netz, lancé en 1952 en Allemagne de l'Ouest, est le premier
réseau public commercial de téléphonie mobile du
pays.
- Le système 1 lancé en 1959 au Royaume-Uni, le «
Post Office South Lancashire Radiophone Service », qui couvrait
le sud du Lancashire et fonctionnait à partir d'un central téléphonique
à Manchester, est cité comme le premier réseau
de téléphonie mobile du pays, mais il était manuel
(il fallait être connecté par l'intermédiaire d'un
opérateur) et sa couverture a été très limitée
pendant plusieurs décennies.
- Le premier système automatique a été l'IMTS du
Bell System, qui est devenu disponible en 1964, offrant une numérotation
automatique vers et depuis le mobile.
- Le système de téléphonie mobile « Altai
(en) » a été lancé dans le service expérimental
en 1963 en Union soviétique, devenant pleinement opérationnel
en 1965, un premier système automatique de téléphonie
mobile en Europe.
- Televerket a ouvert son premier système manuel de téléphonie
mobile en Norvège en 1966. La Norvège a ensuite été
le premier pays d'Europe à se doter d'un système automatique
de téléphonie mobile.
L'Autoradiopuhelin (en) (ARP), lancé en 1971 en Finlande, est
le premier réseau public commercial de téléphonie
mobile du pays.
- L'Automatizovaný mestský radiotelefon (en) (AMR), lancé
en 1978, pleinement opérationnel en 1983, en Tchécoslovaquie,
comme le premier radiotéléphone mobile analogique de tout
le bloc de l'Est.
- Le B-Netz (en), lancé en 1972 en Allemagne de l'Ouest, est
le deuxième réseau public commercial de téléphonie
mobile du pays (bien que le premier qui ne nécessite pas d'opérateurs
humains pour connecter les appels).
...
1989 : le Nordic Mobile Telephone - France (par la Société
Française du Radiotéléphone).
Le NMT-F est un réseau téléphonique
mobile semi-analogique et semi-numérique développée
à l'origine en Suède par la société L.M.
Ericsson, d'une technologie très voisine de la norme Radiocom
2000 lancée par France-Télécom en 1985.
SFR est la première société à concurrencer
France-Télécom sur le territoire national avec son service
mobile semi-analogique : "Ligne SFR".
Ce réseau utilise des fréquences autour de 450 MHz.
Le NMT-F est classé dans les systèmes de téléphonie
mobile de 1ère génération (1G).
Mis en service après le Radiocom 2000 de France Télécom,
le réseau SFR est pourvu dès l'origine de la technologie
de Transfert Automatique Intercellulaires des appels téléphoniques
des conversations en cours, ce qui représente alors une avance
technologique certaine (que France Télécom s’efforcera
de compenser peu après en 1990).
Le 28 janvier 1987, dans le journal Le Figaro, M. le Ministre des P
et T - Gérard Longuet annonce vouloir rompre au plus vite le
monopole sur le Radiotéléphone et précise qu'un
appel d'offre sera lancé dès le printemps 1987, avec obligation
de couvrir l'ensemble du territoire national. la Compagnie Générale
d’Électricité ( CGE - future Alcatel) est déjà
sur les rangs.
Le 26 avril 1987, la Société Française du Radiotéléphone
est créée par la Compagnie Générale des
Eaux. Ses premiers dirigeants sont M. le Président - Alain Bravo
et M. le Directeur Général - Richard Lalande, ces deux
personnes ayant initialement commencé leur carrière en
tant que haut fonctionnaire à la Direction Générale
des Télécommunications (l’Administration des P et
T). La SFR constituera historiquement la première société
privée à concurrencer l'Administration des Télécommunications
en France.
Le 17 juillet 1987, un appel à candidature en vue d'ouvrir un
deuxième réseau de téléphonie mobile analogique
est publié au Journal Officiel de la République Française.
Il est décidé par avance qu'aucun exploitant relevant
de l’État ne pourra se porter candidat. Les candidats ont
jusqu'au 14 septembre 1987 pour déposer un dossier. 5 groupes
se manifestent : Bouygues, Lyonnaise des Eaux, Compagnie Générale
des Eaux, US West et Bell South.
SFR (Générale des Eaux) remporte l'appel et obtient une
licence d'exploitation pour ce réseau téléphonique
semi-analogique par un arrêté du 16 décembre 1987.
Courant Mars 1988, est approuvée par M. le Ministre des P et
T - Gérard Longuet, une convention liant France-Télécom
et la Société Française du Radiotéléphone
concernant le fonctionnement du futur réseau de radiotéléphone
à naître prochainement. Cette convention fixe les conditions
techniques et les compensations financières concernant le raccordement
entre le réseau téléphonique fixe et ce futur réseau
de radiotéléphonie mobile 1G. Naturellement, le Radiotéléphone
concurrent de la SFR étant techniquement intégralement
acheminé par France Télécom via les autocommutateurs
téléphoniques de l'État...
À sa création, il est essentiellement utilisé en
téléphone de voiture.
Les signaux de contrôle et de suivi de localisation sont numériques,
ce qui représente un énorme progrès par rapport
aux anciens réseau de téléphones mobiles précédents
entièrement analogiques.
Tandis que les signaux des conversations téléphoniques
transitent directement en modulations analogiques et de surcroît
sans cryptage. (De ce fait, les conversations étaient très
facilement écoutables : les journalistes parisiens étaient
couramment équipés de scanners pour "chopper"
des scoops en écoutant par exemple des personnalités importantes
équipées de cette technologie.)
Le 30 mars 1989, l'ouverture du NMT-F "Ligne SFR" au public
est effective à Paris. Cette mise en service est inaugurée
ce jour par M. le Ministre des Postes, Télécommunications,
Espace - Paul Quilès.
_____
Les abonnés "Ligne SFR" sont portés
à Paris et Île-de-France par les deux premiers indicatifs
suivants, suivis de deux autres :
l'ABPQ 44.00 créé le 8 novembre 1988 sur le Commutateur
MT25 Brune 2 ET1 de France Télécom ,
l'ABPQ 44.22 créé le 3 janvier 1989 sur le Commutateur
MT25 Bobillot 3 ET1 de France Télécom .
l'ABPQ 44.66 créé le 20 juin 1990 sur le Commutateur MT25
Bobillot 3 ET1 de France Télécom.
l'ABPQ 44.33 créé le 22 juin 1990 sur le Commutateur MT25
Brune 2 ET1 de France Télécom .
Le réseau semi-analogique 1G "Ligne SFR" permet à
son ouverture de fournir un nombre maximal de 100.000 clients radiotéléphoniques
répartis sur le territoire métropolitain, le tout acheminé
à travers la France et le monde par les Commutateurs téléphoniques
de France Télécom.
À la Mi-Mai 1989, l'ouverture du NMT-F "Ligne SFR"
au public est effective à Lyon (et Saint-Étienne). Cette
mise en service est inaugurée par M. le Maire de Lyon - Michel
Noir et M. le Président cofondateur de la SFR - Alain Bravo.
Le 26 juin 1989, M. Pierre Mauroy, Maire de Lille et ancien Premier
Ministre, inaugure la mise en service de la "Ligne SFR" en
région Nord - Pas-de-Calais.
Le 18 septembre 1989, M. Dominique Baudis, Député-Maire
de Toulouse, inaugure la mise en service de la "Ligne SFR"
en région Midi-Pyrénées.
Au 31 décembre 1989, le Radiotéléphone SFR compte
10.000 abonnés en France.
Au 31 décembre 1990, le Radiotéléphone SFR compte
45.000 abonnés en France.
Au 31 décembre 1991, le Radiotéléphone SFR compte
95.000 abonnés en France.
Au 31 décembre 1993, le Radiotéléphone SFR compte
130.000 abonnés en France.
Au 31 décembre 1994, le Radiotéléphone SFR compte
144.000 abonnés en France, mais amorcera peu après sa
décrue.
Le 28 juillet 2000, la fermeture définitive du NMT-F est effective
à cette date, le même jour que le Radiocom 2000 de France-Télécom.
Les derniers abonnés à ce système se voient proposer
un basculement dans la nouvelle norme GSM, sur le réseau SFR.