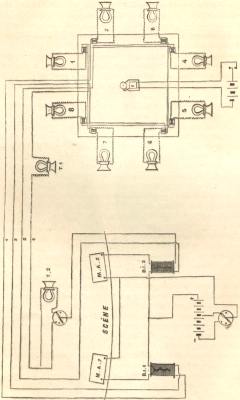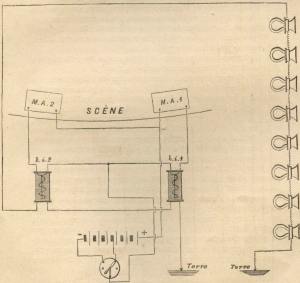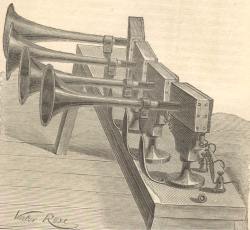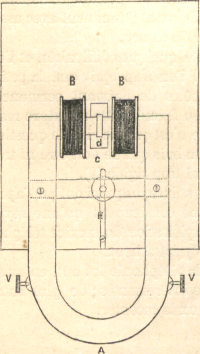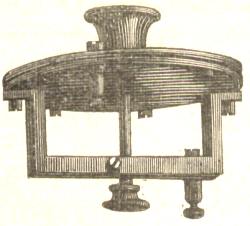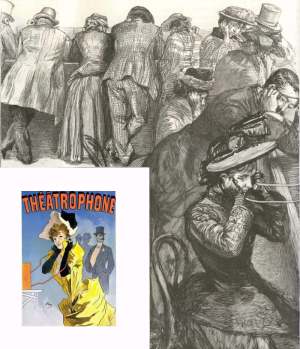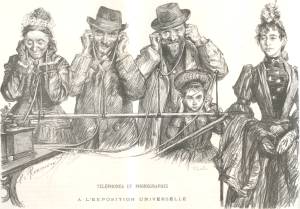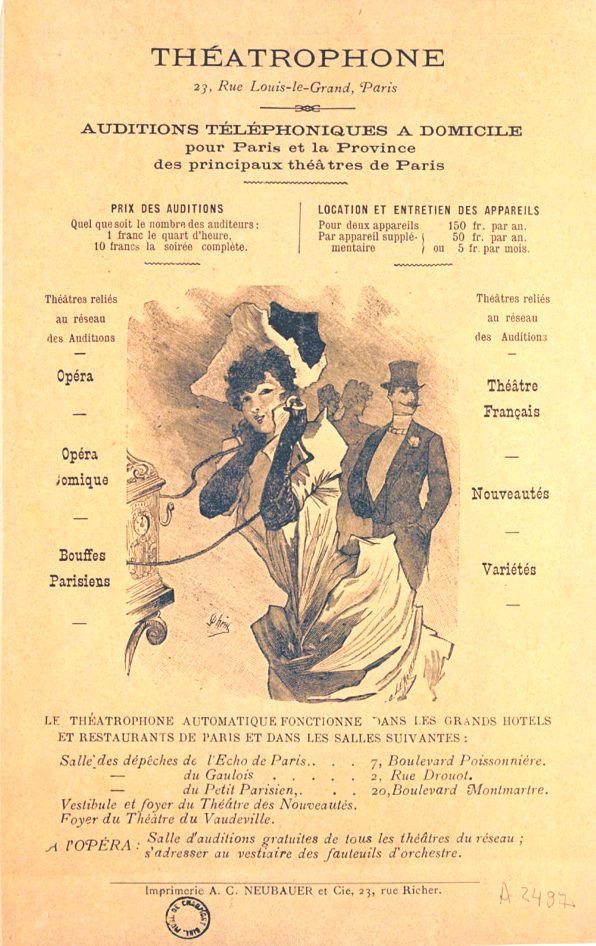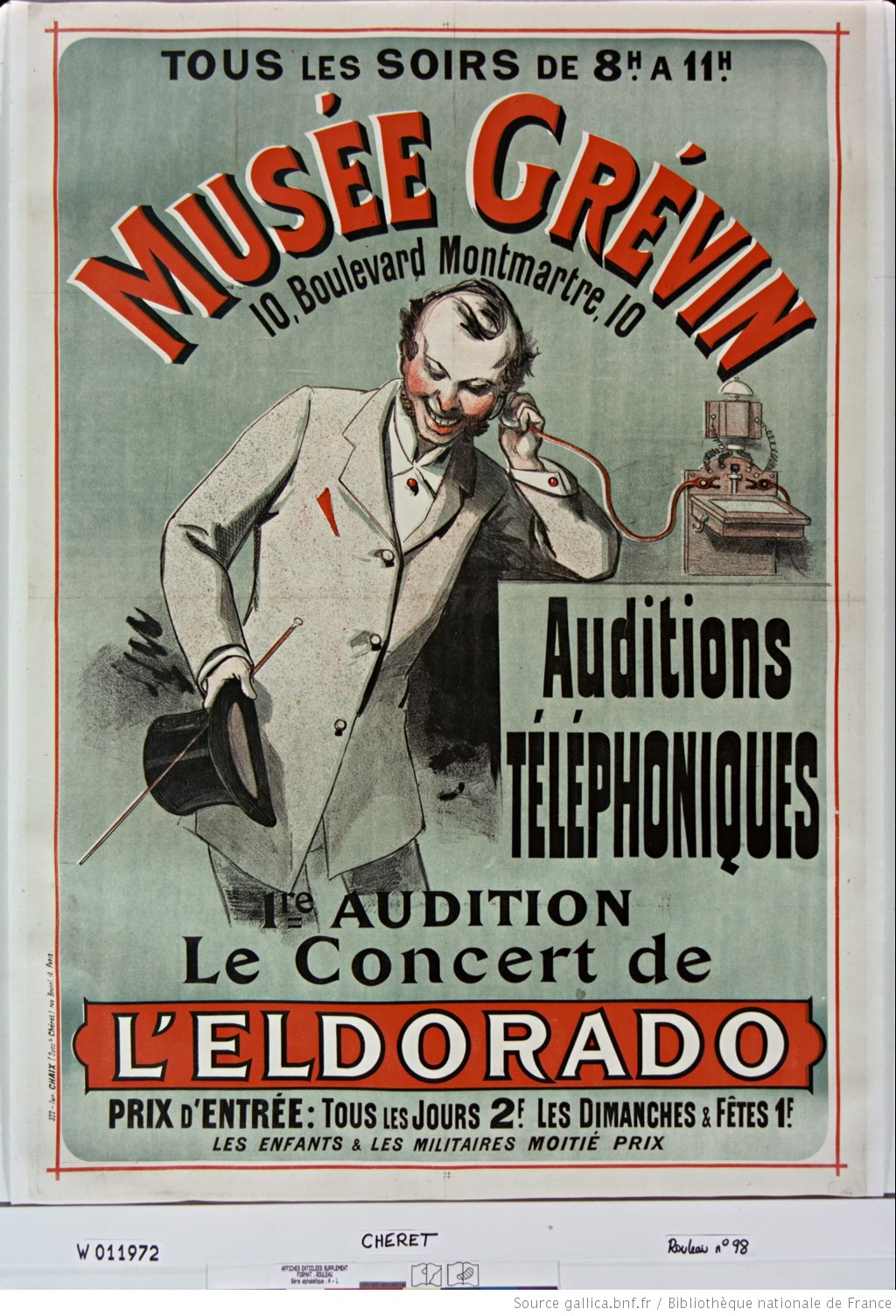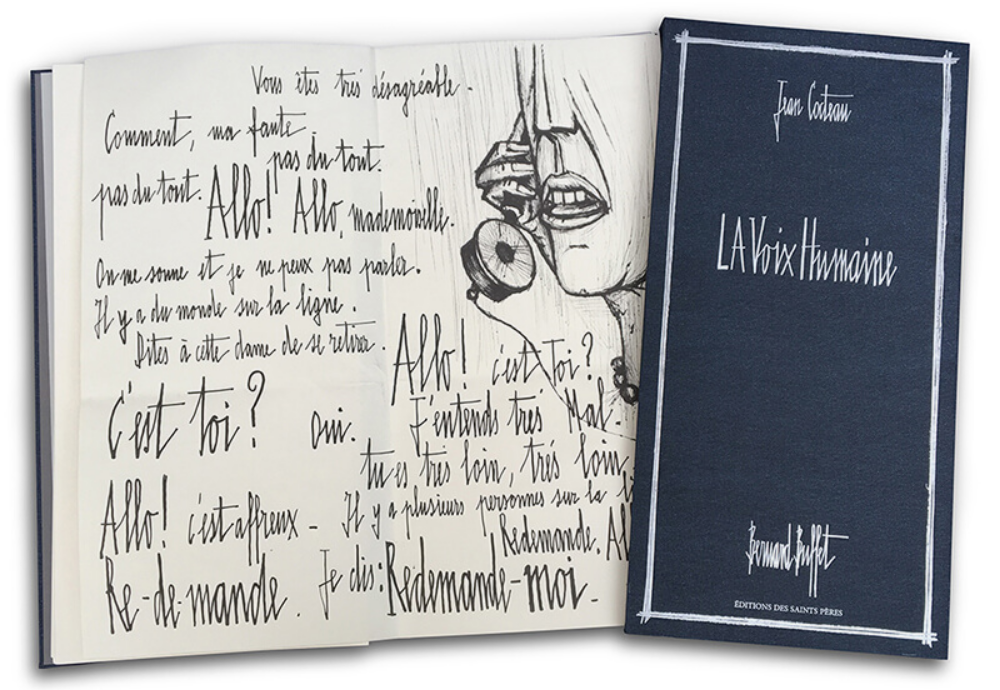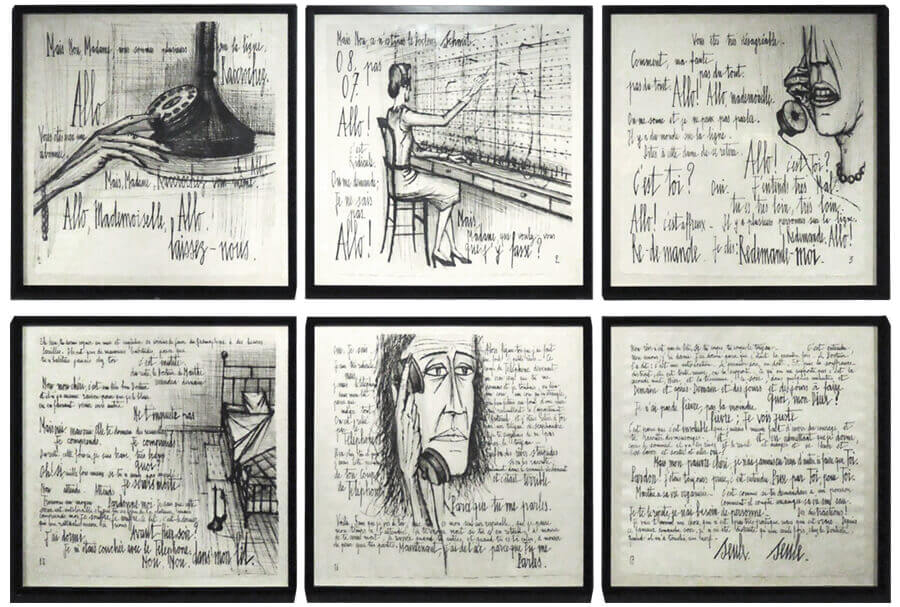Le
THEATROPHONE de
Ader
LE PREMIER MEDIUM ELECTRIQUE
DE DIFFUSION CULTURELLE
C'est ici le lieu de décrire avec plus de détails
cette opération extraordinaire, qui a passé
longtemps pour un rêve, et qui n'était qu'une
merveilleuse réalité
Les conceptions précoces des usages multi-points du
téléphone
Le téléphone électrique de Graham Bell
est, par excellence, une forme de communication "point
à point", permettant à émetteur
et à un récepteur de communiquer.
Cependant, dès sa mise au point, on a imaginé
des formes d'usage plus collectif.
En témoigne le dessin "Terrors of the Téléphone"
paru dans le magazine new-yorkais Daily Graphic du 15 mars
1877 : on y voit un orateur - ou est-ce un chanteur ? - en
nage, gueule ouverte, s'adressant, via une émetteur
que prolongent un réseau mondial de fils, à
des publics installés à Pékin, San Francisco,
Saint-Petersbourg, Dublin et Londres, et réunis autour
de récepteurs dont la forme ressemble curieusement
à celle de l'appareil émetteur.
D'autres destinations, notamment vers des peuplades insulaires
et une sorte de sauvage solitaire, sont également suggérées.
L'historien américain de la radiodiffusion, qui reproduit
ce dessin en ouverture de sa monumentale History of Broadcasting
in the United States, cite également une chanson populaire,
publiée à St-Louis la même année,
|
|
|
|
The Wondrous Telephone, qui témoigne de ce que, immédiatement,
on a imaginé que le téléphone permettrait
d'amener les loisirs à domicile :
You stay at home and listen
To the lecture in the hall
Or hear the strains of music
From a fashionable ball !
Graham Bell lui-même aimait, lors des démonstrations
du téléphone, faire entendre des orchestres,
afin de démontrer les capacités de son invention.
Mais ce sont surtout les perfectionnements apportés
au téléphone par le français Clément
Ader qui vont permettre, à partir de 1881, la propagation
du théâtrophone, première forme de diffusion
culturelle recourant à une technologie de communication
électrique, et dont l'exploitation commerciale perdurera
jusqu'à l'arrivée de la radio.
Sommaire
|
Le théâtrophone
de Clément Ader (1881)
L'inventeur français Clément Ader (1845-1921)
est principalement connu pour sa contribution au développement
de l'aéronautique.
Il fut cependant également un des pionniers du téléphone
en France.
Il propose diverses améliorations techniques au téléphone
électrique : le "téléphone d'Ader"
présente certaines spécificités techniques
(système dit "à contact unique", téléphone
dit "à surexcitation") qui sont décrites
dans la cinquième édition (1887) de l'ouvrage
Le téléphone du Comte Th. du Moncel.
En 1880, Ader crée la Compagnie générale
des téléphones de Paris, déploie le premier
réseau téléphonique de la capitale.
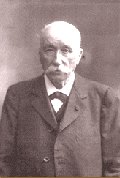 Clément Ader
Clément Ader
|
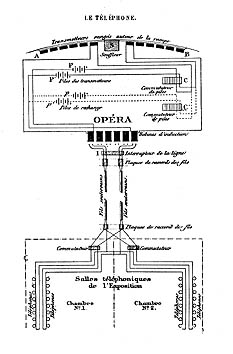
Plan du dispositif de théâtrophone à
l'Opéra durant l'Exposition universelle de Paris (1881).
|
En 1881, dans le cadre de
l'Exposition universelle, Clement Ader conçoit le système
du théâtrophone, notons que le terme ne sera
utilisé qu'à partir de 1889.
Le théâtrophone tel qu'il a été
présenté en 1881 était un système
qui permettait de diffuser des concerts ou des pièces
de théâtre, captés à l'Opéra,
à l'Opéra-Comique ou au Théâtre-Français.
L'inauguration eût lieu en novembre 1881 par le président
de la République, Jules Grévy, qui, le premier,
eût la possibilité d'offrir à ses invités
une audition à domicile.
Le public de l'Exposition universelle pouvait entendre, en
recourant à deux écouteurs, les spectacles diffusés
à l'Opéra qui se situait à plus de deux
kilomètres.
Cette expérience fût l'occasion de découvrir
(et d'élaborer des solutions) les problèmes
de la captation en direct.
Ader met au point un système de captation qui préfigure
la stéréophonie (l'oreillette de droite permet
d'entendre les sons captés à la droite de la
scène et l'oreillette de gauche ceux capter sur la
partie gauche).
Les auditions des représentations de l'Opéra
eurent lieu pendant l'automne de 1881, dans quatre salles
de l'Exposition d'électricité.
Les transmetteurs employés étaient ceux du téléphone
Ader, les mêmes qui fonctionnent aujourd'hui pour la
correspondance entre particuliers. Ils étaient placés,
au nombre de dix, de chaque côté de la boîte
du souffleur.
|
|
Dans Le Ménestrel : journal de musique
du 2 octobre 1881 on lisait ;
LA MUSIQUE ET LE THEATRE A L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ.
.
Les applications de l'électricité aux
divers services des théâtres sont nombreuses et .l'Exposition
du Palais de l'Industrie nous en montre des spécimens variés.
Comme d'ordinaire, ce ne sont pas les découvertes les plus
utiles qui. frappent, le plus vivement les curieux. L'immense succès
des auditions téléphoniques, fort, intéressantes
à coup sûr, mais d'ordre encore fantaisiste, en est la
meilleure preuve. Chaque soir le public se presse dans les salles
d'audition : il ne serait même pas impossible que la fortune,
un peu douteuse au début de l'Exposition d'électricité
fût fixée, par cette récréation quotidienne.
Suivons donc la foule et commençons par l'étude des
téléphones, cette courte revue des applications électriques.
Rien de plus simple que les chambrés d'audition placées
au'premier étage du Palais de l'Industrie.Quatre cloisons,
capitonnées et matelassées; des tapis épais;
des lampes à incandescence dont la lueur aveuglante et cependant
mystérieuse étend sur toute la salle Un reflet opalisé.
Vous entrez, vous prenez deux forts anneaux, deux grosses bagues à
chaton suspendues devant vous, et vous appliquez ce double chaton
sur vos oreilles.dès qu'une petite sonnerie vous avertit que
l'audition téléphonique va commencer. Aussitôt
vous entendez avec une extrême netteté soit les chanteurs
de l'Opéra et de I'Opéra-Comique, soit les choeurs,
soit l'orchestre, soit enfin le rythme de la danse.
Ces appareils, au nombre de quarante pour deux salles ne suffisent
pas à la curiosité du public. Il faut limiter à
deux minutes le temps de chaque audition; encore beaucoup d'amateurs
s'en retournent-ils désappointés; quant à ceux
qui parviennent jusqu'aux appareils, il est curieux d'observer leur
surprise. Ils arrivent toujours avec un sourire aux lèvres
et un vague scepticisme; mais la netteté des perceptions, l'effet
de « relief » que donnent les vibrations téléphoniques
semblant avancer et reculer comme recule et avance le chanteur en
scène, ne tardent pas à les convaincre. Ils s'arrachent
à regret et partent enthousiasmés, bien prêts
à crier au miracle.
Il n'y a cependant ni féerie, ni tour de force dans les auditions
téléphoniques. Jamais résultat plus curieux n'a
été atteint par des procédés plus élémentaires.
Entre les deux bagues brillantes dont les visiteurs du Palais de l'Industrie
s'appliquent le chaton sur les oreilles et le mur des salles d'audition
se trouvent des cordons de soie contenant des fils métalliques.
Ces fils parcourent le Palais de l'Industrie, descendent dans l'égout,
arrivent dans les dessous de l'Opéra, et rassortent à
droite et à gauche du trou du souffleur, de chaque côté
duquel sont placés les transmetteurs.
Les transmetteurs sont fondés sur le principe du microphone
Hughes, instrument délicat destiné à saisir les
moindres nuances de la voix, à en être pour ainsi dire
le microscope. Une planchette en sapin, des traverses de charbon et
dix crayons de charbon, disposés en deux séries de cinq
charbons chacune, s'appuyant sur ces traverses, voilà les éléments
constitutifs; le bruit des voix, les sons de l'orchestre font vibrer
la plaque; les vibrations sont transmises aux crayons. Cette sensibilité
est extrême: de plus elle est limitée à la seule
action des ondulations atmosphériques, grâce à
quelques précautions accessoires. Ainsi pour éviter
les trépidations, on a installé les transmetteurs de
l'Opéra sur des socles de plomb soutenus par quatre pieds en
caoutchouc. Le plomb fait masse ; les supports isolent l'appareil
du plancher.
Les acteurs et les chanteurs n'ont pas à se préoccuper
du transmetteur. A quelque distance qu'ils se fassent entendre, le
son est saisi et emmagasiné par l'appareil. Il en résulte
même cet effet de relief dont je parlais tout à l'heure
et qui cause tant de surprise aux auditeurs du palais de l'Industrie.
Quand on regarde une vue de paysage dans un stéréoscope,
les détails de la photographie s'accusant ; la perspective
s'établit. L'impression est toute semblable dans les auditions
téléphoniques. On peut se rendre un compte exact de
la distance des chanteurs en scène; on perçoit leurs
allées et venues. Il'y a là une sorte d'illusion produiteljpar
les deux transmetteurs, qui, placés, .l'un à droite,
l'autre à gauche de la scène, . impressionnent variablement
les organes auditifs ; il y a aussi le résultat des différences
d'intensité des vibrations transmises.
Les sons emmagasinés par le transmetteur sont immédiatement
saisis par les fils et: arrivent jusqu'aux récepteurs.
Ces récepteurs sont les deux bagues à chaton que tient
en mains le Visiteur de l'Exposition d'électricité,
deux téléphones Bell. Les anses des bagues sont deux
aimants, dont les bouts pénètrent dans le chaton. Au
fond de ce chaton se trouve une petite plaque en fer-blanc. Cette
plaque reçoit les vibrations envoyées par le transmetteur
et les reproduit dans leurs nuances les plus délicates.
Quant au rôle de l'électricité,
il est tenu par une batterie de piles Léclanché. Ainsi
se trouvent accrus lés effets magnétiques, condition
essentielle quand il s'agit de transmettre les.bruits téléphoniques
à grande distance. Les courants induits «actionnent»,
l'appareil-et on peut les renforcer à volonté.
¦Le téléphone Bell, et
le microphone Hughes sont les éléments de cette remarquable
découverte ; mais ou doit les perfectionnements et la combinaison
totale à M. Clément Ader, dont l'appareil porte le nom.
Cet appareil sera sans doute perfectionné lui-même ;
il a encore ce qu'on pourrait appeler les défauts de. ses qualités
: il.demande de grandes précautions, son extrême sensibilité
le rend, fragile., Il perçoit .mieux la voix des chanteurs
que celle des acteurs; il se laisse impressionner très vivement,
mais parfois confusément, par l'orchestre. Autant de détails
qui seront bientôt corrigés. L'enthousiasme du public
reste donc très légitime, les auditions téléphoniques
sont une brillante promesse. Quand on voit le chemin parcouru en cent
ans par la science des phénomènes électriques,
on a la certitude que ceite promesse sera tenue. Quelques années
encore et le proscenium de tous nos théâtres sera tapissé
de transmetteurs; le réseau déjà si important
du Paris souterrain se compliquera d'éléments nouveaux;
des milliers de fils parcourront les rues, monteront dans les maisons,
transmettant la musique d'Ambroise Thomas et de Charles Gounod, là
prose d'Emile Augier et de Victorien Sardou, faisant monter le grand
art à tous les étages comme montent déjà
le gaz et l'eau. Les amateurs, désireux de ne pas quiter le
coin du feu, n'auront qu'à prendre un téléphone
Ader pour s'offrir le spectacle dans leur fauteuil. On aura l'opéra
et la comédie chez soi, comme on a Enghien ou Vichy à
domicile. Et si loin qu'aillent nos grandes cantatrices, qu'elles
émigrent à Saint-Pétersbourg ou même à
New-York, on pourra encore les entendre. Il suffira d'augmenter le
nombre des batteries et de renforcer les courants magnétiques.
(A suivre.) CAMILLE LE SENNE.

Chacun de ces 20 récepteurs était
en rapport avec une pile Leclanché et une bobine d'induction
correspondait à cette pile. Le fil conducteur double (pour
l'aller et le retour) s'étendait sur une longueur de 2
kilomètres environ qui sépare l'Opéra du
Palais de l'Industrie. Ces conducteurs étaient placés
à la voûte des égouts. Comme les piles se
polarisent rapidement, et perdent ainsi de leur puissance, on
les changeait de quart d'heure en quart d'heure.
Pour cela, chaque pile avait son commutateur, au moyen duquel,
chaque quart d'heure, on mettait le transmetteur en rapport avec
une pile nouvelle : pendant ce même temps on rechargeait
la pile usée |
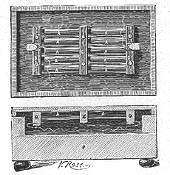 |
Pour mieux assurer le bon fonctionnement
des appareils, et pour se mettre en garde contre toute
cause de dérangement, Mr Ader avait pris certaines
précautions, qu'il n'est pas hors de propos de
mentionner.
Les transmetteurs microphoniques disposés sur
la scène étaient fixés, chacun,
sur un socle en plomb, reposant sur des pieds en caoutchouc.
|
On évitait ainsi les bruits qui, sans
cette précaution, auraient été transmis
en même temps que les sons, et qui provenaient des pas
et des mouvements des acteurs et des danseuses.
L'inertie des masses de plomb servant de supports aux transmetteurs,
éteignait ces trépidations, et les empêchait
d'arriver à la planchette microphonique du transmetteur.
M. Ader encore une fois précurseur dans son domaine
avait jugé indispensable de munir chaque auditeur d'un
récepteur double : un pour chaque oreille. Il venait
d'inventer la stéréophonie
Et voici la raison de cette particularité.
Sommaire
|
Le chanteur n'est pas immobile
sur la scène, il passe fréquemment de l'un à
l'autre côté de la rampe.
C'est même là une des règles de l'art.
Supposons que le chanteur se trouve à droite du souffleur;
la voix actionnera le microphone transmetteur de droite plus
énergiquement que celui de gauche, et l'oreille droite
de l'auditeur sera plus vivement impressionnée que l'oreille
gauche.
Si le chanteur passe à gauche du souffleur, c'est le
contraire qui se produira.
Ainsi, quand l'acteur, marche sur la scène, son déplacement
se traduit, pour celui qui écoute, par un affaiblissement
du son dans un des cornets récepteurs et par un renforcement
dans l'autre cornet récepteur.
De là des inégalités d'intensité,
qui nuisent à la pureté de la transmission. M.
Ader eut l'idée, très ingénieuse, de croiser
les impressions arrivant à chaque oreille de l'auditeur,
c'est-à-dire, de faire aboutir à l'oreille droite
les sons d'un transmetteur et à l'oreille gauche le son
d'un second transmetteur, placé à une distance
de quelques mètres du premier.
Les transmetteurs sont donc groupés par paires, l'un
étant sensiblement éloigné de l'autre.
|
 |
Chaque personne reçoit l'impression
des deux transmetteurs distincts, par l'une et l'autre
oreille, ainsi que le montre le diagramme de la figure
ci contre, dans laquelle on voit que le chanteur étant
placé en A, par exemple, la voix traversant le
microphone M, est recueillie par le récepteur
B, correspondant à l'oreille droite du spectateur,
et à travers le microphone M', par le récepteur
B', correspondant à son oreille gauche, et que,
lorsque le chanteur se trouve au point A', sa voix est
recueillie à travers le microphone M', par le
récepteur B', correspondant à son oreille
gauche et à travers le microphone M, par le récepteur
B, correspondant à l'oreille droite.
|
Dès lors, le chanteur peut se mouvoir
: l'une des deux oreilles de l'auditeur percevra toujours le
son à peu près avec la même intensité
que l'autre.
|
Les deux transmetteurs disposés
le long de la scène de l'Opéra répondaient
à 80 récepteurs Ader pour desservir quarante auditeurs
placés dans deux salles du Palais de l'Industrie.
Ces salles étaient disposées de manière
à éteindre tout bruit extérieur, qui aurait
nui à l'effet sonore que l'on voulait recueillir.
Pour cela, un épais tapis couvrait le parquet; des rideaux
et des tentures composaient l'enceinte.
Des portes doubles et faites d'épaisses étoffes
en défendaient l'entrée. L'éclairage était
faible et triste, pour ne point distraire l'attention des oreilles
par l'impression des yeux. Au milieu se tenait, devant une table,
un employé, chargé de la surveillance générale.
Le public entrait par fournée de 20 personnes dans chaque
salle, et n'y séjournait que à 4 à 5 minutes.
Cet intervalle de temps écoulé, les assistants
sortaient par une porte, tandis que la seconde fournée
entrait, silencieusement, par la porte opposée.
Grace à ces ingénieuses dispositions, on assistait
littéralement à une représentation de l'Opéra.
Sommaire
|
|
On reconnaissait la voix des
chanteurs.
Ce n'était pas l'effet d'un rêve lointain, mais
celui d'une réalité auditive. Sellier, Boudouresque
et Mlle Kraus vous chantaient dans l'oreille. Les choeurs arrivaient
pleins et harmonieux, et on ne perdait pas un accord de l'orchestre.
Pendant les entractes, on entendait les bruits de la salle,
et même la voix des crieurs de journaux et des marchands
de programmes. Et comme, malgré la fidélité
de la transmission des sons, on était privé du
spectacle de la scène, ces auditions aveugles avaient
quelque chose d'étrange, de fantastique, que n'oublieront
jamais ceux qui ont pu en jouir.
Rien ne pouvait mieux populariser dans le public les nouveaux
progrès de l'électricité.
Comme l'indique du Moncel, "le succès de ces auditions
théâtrales a été très grand.
Tous les soirs d'Opéra on faisait queue pour y assister,
et cette vogue a continué jusqu'à la fin de l'Exposition.
Bien que des esprits chagrins aient voulu jeter de l'eau sur
ce succès au nom de l'art contre ces reproductions musicales,
presque toutes les personnes de bonne foi ont été
ravies et ont prétendu avoir mieux entendu qu'à
l'Opéra, ce qui se conçoit facilement, si l'on
réfléchit que les transmetteurs étant interposés
entre les acteurs et l'orchestre, celui-ci se trouvait un peu
sacrifié au profit des acteurs, dont les paroles pouvaient
alors être admirablement entendues".
|
|
|
Le souvenir de ces belles soirées
inspira l'idée de multiplier les auditions téléphoniques
théâtrales.
Mais une telle installation est compliquée et coûteuse.
Les frais faits en 1881, par la Société des téléphones,
à l'Opéra et au Palais de l'Industrie, atteignirent,
dit-on, la somme de 160 000 fr.
Aussi jusqu'à ce jour les reproductions de ce genre ont-elles
été rares.
On ne peut citer à Paris que le musée Grévin
qui. pendant l'été de 1883, ait imaginé
de donner des auditions téléphoniques.
A la fin de l'exposition, le dispositif des microphones de l'Opéra
fut démonté. Des auditions théâtrophoniques
furent organisées par le Musée Grévin.
Les microphones étaient placés sur la scène
de l'Eldorado, un café-concert en vogue.
Seulement, au lieu des chants superbes de l'Opéra, on
entendait, au Musée Grévin, le répertoire
grossier d'un vulgaire café-concert, l'Eldorado, du boulevard
de Strasbourg.
On recevait, par l'oreille droite ce refrain, légué
par Thérésa :
« C'est dans l'nez que ça me chatouille ! »
tandis que l'oreille gauche vous faisait entendre cet autre,
popularisé par Judic :
« Ah ! si ma mère le savait ! »
Et lorsque, suffoqué par ces chansons idiotes, à
demi asphyxié par l'atmosphère irrespirable de
la cave
|
où se faisaient ces auditions,
on s'empressait de regagner l'escalier étroit et tournant
qui vous ramenait à l'air, relativement pur, du boulevard
Montmartre, on était poursuivi par les regards d'une
foule de personnages en cire, portant de vieux habits, qui vous
fascinaient avec leurs yeux en boule de loto, immobiles et morts.
C'est que tout soleil a son ombre, toute médaille a son
revers, toute belle chose a sa caricature.
Les auditions du musée Grévin étaient la
caricature des auditions téléphoniques de l'Opéra.
En 1883 voila ce que l'on pouvait penser :
En raison de l'intérêt qui s'attache au phénomène
scientifique de ces auditions théâtrales, il n'est
pas douteux que la transmission de la musique par la voie du
téléphone ne soit appelée à prendre
un jour une grande extension.
Ce n'est qu'une question de temps. On arrivera à réaliser
ce système de reproduction musicale d'une manière
économique, et on pourra alors en généraliser
l'usage. L'Opéra, l'Opéra-Comique, le Théâtre
Français, pourraient être reliés par des
conducteurs téléphoniques à des salles
disposées dans ce but particulier, et un jour des spéculateurs
trouveront leur bénéfice à créer
des établissements consacrés aux répétitions
téléphoniques de la musique de ces théâtres.Bien
plus, il ne sera pas impossible à un particulier de se
procurer le luxe d'une représentation théâtrale
à domicile, et d'entendre, sans quitter son salon, les
accents du Trouvère, de Faust ou de la Favorite.
Sommaire
|
|
C'est ce qu'expose fort bien
le savant rédacteur scientifique du Journal dès
Débats, M. H. de Parville, dans l'ouvrage qu'il a publié
sur l'Exposilion d'électricité en 1881.
Nous souhaitons, dit M. de Parville, que le public soit bientôt
mis à même d'assister, au bout d'un fil télégraphique,
aux représentations de l'Opéra, de l'Opéra-Comique
et de la Comédie-Française. Il est de règle
en ce monde que toute chose nouvelle doit passer par une période
d'évolution. On commencera par aller entendre l'Opéra
dans un local approprié, qui remplacera les salons de
l'Exposition; puis, peu à peu, on tiendra à rester
chez soi, et à entendre ce qui se passe à la Comédie-Française,
puis à la place Favart, et l'on réclamera un réseau
théâtral. On s'abonnera aux téléphones
de l'Opéra, de l'Opéra-Comique, etc., comme on
s'abonne aujourd'hui aux téléphones de la Société
générale. Et dans dix ans on vous invitera à
prendre le thé et à assister à une première.
Au lieu de la mention, devenue vulgaire : « on dansera,
on fera de la musique », les cartes d'invitation porteront
: « Audition théâtrale. » Et ailleurs
: « à dix heures, Robert-le-Diable, à onze
heures, Monologue par Coquelin cadet, etc. »L'inauguration
de ce genre de distraction artistique et scientifique fut offerte,
comme un hommage à sa haute dignité, au Président
de la République française, au mois de novembre
1881.
Le palais de l'Elysée avait été relié,
par les moyens ci-dessus décrits, avec la scène
de l'Opéra; de sorte que M. Jules Grévy put donner
à ses invités la curieuse distraction de l'Opéra
à domicile.
|
Il est évident que ce
qui a été réalisé sous des lambris"
aristocratiques et officiels, peut, grâce à la
science et à l'industrie de notre temps, se produire
sous les toits les plus modestes, et que l'Opéra à
domicile pourra un un jour être un genre de distraction
à la portée de tous.
Autrefois, on louait les appartements avec « le gaz à
tous les étages ».
Quand le nouveau service des eaux a permis de distribuer l'eau
potable dans les appartements, au moyen d'une colonne montante,
les propriétaires parisiens ont mis sur leurs écriteaux
: « Eau et gaz à tous les étages ».
Plus tard, quand la construction des ascenseurs s'est simplifiée,
et que leur usage est passé des gares de chemin de fer
dans les grands hôtels meublés, et de là
enfin dans les maisons particulières, les propriétaires
des immeubles de Paris ont inscrit sur leurs écriteaux
: « Eau, gaz et ascenseur à tous les étages
».
Quand les architectes auront réussi à distribuer,
par un calorifère de cave, la chaleur dans toute une
maison, et que, d'autre part, la Compagnie des horloges pneumatiques
sera parvenue, comme elle l'annonce, à donner à
chaque locataire la facilité de se procurer une pendule
pour un sou par jour, les propriétaires inscriront avec
fierté : « Eau, gaz, ascenseur, heure et chaleur
à tous les étages. »
Enfin, un jour viendra, il n'en faut pas douter, où on
lira sur l'annonce des appartements à louer : «
l'Opéra à tous les étages !»
Sommaire
|
Nous représentons dans
la figure ci dessous les douceurs de l'Opéra à
domicile.
Une belle mondaine, en son élégant salon, se donne
le plaisir, sans sortir de chez elle d'entendre, son opéra
favori.

Cliquez
sur la vue pour l'agrandir
Sommaire
|
Avec un abonnement au téléphone
théâtral, on pourrait se coucher tranquillement,
et au lieu de prendre le volume dont la lecture doit forcément
amener le sommeil, comme un roman de M. X. ., on décrocherait
le téléphone, qui vous ferait entendre le Trouvère
ou la Favorite et l'on s'endormirait, en vrai Sybarite, aux
sons harmonieux d'une musique aimée.
On pourrait même créer une feuille d'abonnement
électrique pour les trois jours d'opéra : lundi,
mercredi, vendredi.
On ne tarda pas à reproduire, en province et à
l'étranger, une expérience qui avait eu à
Paris le plus vif succès.
A Bordeaux, par exemple, plusieurs personnes réunies
au bureau central de la Société des téléphones
écoutèrent un violoniste de talent qui jouait
dans une maison des allées de Tourny; elles saisirent
les sons les plus faibles de l'instrument. A Berlin, on installa
une liaison téléphonique entre l'Opéra
et une salle située dans la Leipziger Strasse, et les
auditeurs reconnurent parfaitement la voix de chacun des artistes
en scène.
A Charleroi, la compagnie des téléphones
Bell fit à ses abonnés, le 14 août 1884,
la surprise d'un concert à domicile. Chaque abonné
avait reçu, le matin, l'avis suivant : — ConcertTéléphone.
— Dimanche, 14 août, concert au bureau central du
téléphone Bell. Toutes les communications seront
établies à onze heures précises du matin.
Mettre le cornet à l'oreille à l'heure juste,
sans avertir le bureau central.
Le concert eut lieu à l'heure dite, à la grande
satisfaction des nombreux auditeurs.
En septembre 1884, on mit en communication le chalet que la
reine des Belges habitait à Ostende avec le théâtre
de la Monnaie de Bruxelles. La reine put ainsi entendre, à
une distance de plus de deux cent cinquante kilomètres,
Guillaume Tell, et, le lendemain, la répétition
du Barbier de Séville.
|
|
Un peu plus tard, on établit
une ligne téléphonique entre le théâtre
de la Monnaie et le château de Laeken, où résidait
la reine. « Un jour, raconte un journal de Bruxelles,
Sa Majesté suivait, par l'appareil téléphonique,
la répétition de l'opéra les Templiers,
du maestro Litolf. Tout à coup elle eut un tel mouvement
de brusque surprise, que le téléphone, lui tomba
des mains. C'est qu'elle venait d'entendre le chef d'orchestre,
dans un moment d'impatience contre les choeurs, tenir un langage
qui n'avait absolument rien d'édifiant. Depuis lors,
les répétitions du théâtre de la
Monnaie sont conduites de la façon la plus correcte.
»
En 1889 on trouve dans les grands hôtels, les cafés
et restaurants, ailleurs encore, des théâtrophones,
— sortes d'appareils qui tiennent à la fois du téléphone
et du distributeur automatique, et qui permettent, moyennant
l'introduction d'une pièce de 50 centimes dans une fente
ad hoc, d'entendre pendant cinq minutes les artistes qui jouent
sur la scène d'un théâtre dont un avertisseur
présente le nom dans un guichet pratiqué sur le
devant de la boîte.
Vient-il à se produire un entracte pendant la durée
de l'audition, aussitôt le nom du premier théâtre
est remplacé par un autre, et l'on entend une nouvelle
pièce. S'il arrivait qu'à un moment tous les théâtres
fussent à l'entracte, l'appareil transmettrait un morceau
de piano ou de chant, en sorte que l'auditeur ne risque pas
de payer pour ne rien entendre.
Comment ce résultat est-il obtenu ? Le voici.
Le poste central de la compagnie du théâtrophone
est relié à des postes secondaires placés
dans les théâtres.
|
|
|
Chacun de ces postes secondaires
est muni de piles, bobines, appareils d'appel, commutateurs,
etc., et communique avec une série de microphones disposés
comme il a été dit.
Les câbles qui relient ces postes secondaires au poste
central aboutissent à une rosace sur laquelle viennent
également se fixer les câbles desservant les théàtrophones
et un certain nombre de câbles allant au bureau central
téléphonique de l'avenue de l'Opéra.
Les câbles de théâtrophone sont formés
de trois conducteurs; deux, toronnés ensemble, servent
à la transmission de la musique; le troisième
fait marcher l'avertisseur. Le même câble dessert
plusieurs appareils; ainsi, pour ne citer qu'un exemple, la
ligne de l'hôtel Continental dessert un nombre total de
douze appareils répartis entre les hôtels du Rhin,
Dominici, de Londres, Continental, Saint-James, Albion, Windsor,
Wagram et Brighton. D'ailleurs, les appareils ne sont pas nécessairement
fixes; il suffit de ménager, sur le parcours du câble,
des prises de courant sur lesquelles on peut greffer un appareil
que l'on veut faire fonctionner; c'est le cas du café
de la Paix, qui possède quatre appareils mobiles et soixante
prises de courant.
Lorsque l'appareil est fixé, l'avertissement se fait
aisément au moyen du troisième conducteur.
Dans le cas d'appareils mobiles, on ne peut plus opérer
de la même manière; on dispose alors, en des points
déterminés et bien en vue, des avertisseurs fixes,
indépendants par conséquent de l'appareil. Celui-ci
est muni d'un bouton qui permet de rétablir le synchronisme
entre ses indications et celles de l'avertisseur fixe commandé
par le poste central.
.
|
La compagnie a installé
dans Paris un grand nombre d'appareils; mais, en dehors du service
des théâtrophones, elle a des abonnés,
c'est-à-dire des particuliers qui, moyennant payement
d'une redevance fixe, ont droit à des auditions à
domicile.
A ce service est affecté le groupe de câbles allant
au bureau central téléphonique de l'avenue de
l'Opéra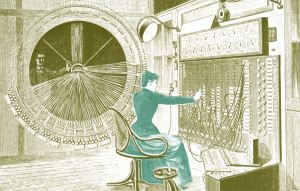
Cliquez
sur la vue pour l'agrandir
Les abonnés du théâtrophone sont nécessairement
des abonnés du téléphone ; pour leur donner
une audition, l'employée du bureau de l'Opéra
relie la ligne qui les dessert avec la ligne venant du poste
central du théâtrophone dont le numéro lui
est indiqué par la préposée à ce
dernier poste.
Sommaire
|
|
Grâce au téléphone
et au théâtrophone, le lord maire de Londres
a pu, en 1892, offrir à ses invités, au cours
d'une réception, le luxe d'une audition de l'Opéra
de Paris.
Il n'y a plus qu'une chose à souhaiter : c'est que la
science, poursuivant ses conquêtes, double le théâtrophone
du théâtrophote, c'est-à-dire d'un
appareil qui permette de suivre des yeux les acteurs tandis
que l'oreille perçoit leurs paroles ou leurs chants.
Le jour où sera réalisé ce desideratum,
il sera possible à tout Parisien d'offrir chez lui à
autant d'invités qu'il voudra la représentation
complète de la pièce en vogue, ou, s'il le préfère,
de faire défiler successivement devant eux les troupes
des principaux théâtres.
Cela viendra, n'en doutons point; il y a longtemps qu'on l'a
dit : le xx° siècle sera encore dans l'enfance qu'on
lira sur toutes les maisons nouvelles, au-dessus de la porte
d'entrée, cette inscription : Eau, ascenseur, lumière
électrique, téléphone et théâtrophone
à tous les étages.
Passons, comme le veulent les principes de la bonne littérature,
du plaisant au sévère. — S'il sert à
transmettre des représentations théâtrales,
le téléphone sert aussi à transmettre à
distance des sermons et des exercices de piété.
Dans plusieurs villes des Etats-Unis, — à Mansfield,
à Brooklyn et à Hartford, par exemple, —
les personnes que leur grand âge ou des infirmités
empêchent de se rendre à l'église peuvent
entendre les offices de chez elles. Il en est de même
dans certaines localités anglaises, — à Bradford,
à Birmingham, à Greenock, etc. A Birmingham, les
parents et les amis des malades soignés dans les hôpitaux
peuvent correspondre avec eux par le téléphone,
prendre de leurs nouvelles sans courir aucun risque d'infection.
|
La compagnie du théâtrophone
: 1890-1932
Les expériences qui avaient eu lieu à Paris en
1881, à l'occasion de l'exposition d'électricité,
furent reprises en grand en 1889, lors de l'Exposition universelle.
Concurremment avec le phonographe d'Edison alors dans toute
sa nouveauté, les candidats « auditeurs »
purent éprouver la sensation rare d'entendre à
distance ce qui se jouait sur les grandes scènes parisiennes.
Les recettes furent, paraît-il, aussi bonnes qu'en 1881.
De plus, les organisateurs n'avaient pas hésité
à faire écouter pendant la journée, c'est-à-dire
à la période creuse pendant laquelle les théâtres
étaient fermés, des transmissions d'un piano mécanique
qui débitait docilement ses bandes perforées et
enchantait les oreilles peu exigeantes des badauds de passage.
Pour l'occasion, Ader avait remis à jour ses brevets
de 1881 par une série d'additifs. Il avait amélioré
l'installation de ses microphones, le long des rampes devenues
électriques (elles étaient équipées
au gaz quelque dix ans auparavant). Il avait mis au point des
casques à deux écouteurs, pour rendre l'audition
plus commode. Enfin, il avait prévu un système
de commutation polarisé permettant d'envoyer un courant
d'appel chez les abonnés au début du spectacle
et à la fin des entractes : car, en plus des visiteurs
de l'Exposition qui goûtaient en passant aux joies du
théâtre téléphoné dans un
lieu public, un petit nombre d'usagers du téléphone
en étaient bénéficiaires à domicile.
Sommaire
|
|
L'Exposition de 1889 terminée,
il fallut trouver une nouvelle utilisation du matériel
et, le 26 mai 1890, des batteries d'appareils récepteurs
furent placées au foyer du théâtre des Nouveautés.
Une société se constitua, qui prit le nom de Compagnie
du théâtrophone et qui entreprit d'étendre
les activités de cette attraction.
Un grand coup fut tenté avec un matériel nouveau
et des méthodes d'exploitation inédites.
Des récepteurs à encaissement automatique furent
placés dans différents lieux publics : cafés,
hôtels, cercles, tandis que les microphones étaient
installés dans plusieurs théâtres parisiens
après de laborieuses négociations avec leurs directeurs
; ceux-ci, à l'instar de nos actuels organisateurs de
matchs de football, craignaient sans doute que les retransmissions
leur fassent perdre des entrées.
Les nouveaux entrepreneurs, nommés Marinovitch et Szarvady,
commandèrent une belle affiche au célèbre
dessinateur Jules Chéret, qui faisait d'ailleurs partie
du conseil d'administration du Musée Grévin.
De son crayon léger, il croqua une élégante
à multiples frisettes, tenant devant ses jolies oreilles
les écouteurs Ader du théâtrophone ; étincelante
dans sa robe jaune citron, elle apparaissait devant un fond
bleu-de-nuit sur lequel se découpait la silhouette d'un
"copurchic" à moustaches effilées.
|

La Parisienne de Chéret prit place non seulement sur
les affiches murales, mais aussi, en vignette, sur les appareils
récepteurs et constitua la « marque » du
nouveau théâtrophone.
Sommaire
|
Des boîtes à
sous et à sons.
Les appareils publics comportaient à leur partie supérieure
deux fentes, une pour les pièces de cinquante centimes
qui permettaient une audition de cinq minutes, et une pour les
pièces d'un franc grâce auxquelles on prolongeait
l'écoute jusqu'à dix minutes.
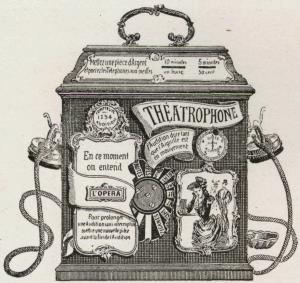
Cliquez sur la vue pour
l'agrandir
|
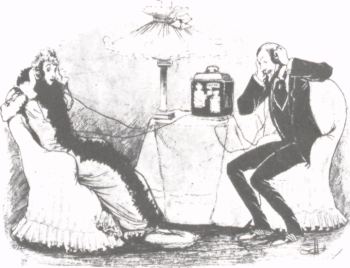
Un système indicateur intégré faisait savoir
aux clients avec quel théâtre un poste donné
pouvait les mettre en relation : cet « affichage »
était obtenu à partir de plaquettes montées
en éventail sur un axe central mû par un électro-aimant,
auquel les impulsion nécessaires étaient envoyées
au moyen d'un fil spécial par le central du théâtrophone.
Sommaire
|
|
Le central en question était
installé près des grands boulevards, au 23 de
la rue Louis-le-Grand, dans un sous-sol où l'on remarquait
d'abord le « répartiteur ». Celui-ci, comme
tous ceux de l'époque, affectait la forme d'une rosace
; il constituait le point d'aboutissement de tous les circuits
d'arrivée provenant des microphones dans les théâtres,
et de départ vers les postes publics.
Le central du théâtrophone, à ses débuts.
Au fond, la rosace regroupant les circuits d'arrivée
et de départ. Au premier plan et au centre, l'émetteur
d'impulsions pour la mise à jour, à distance,
de l'affichage des postes publics. En haut du meuble-tableau,
indicateurs synchronisés avec l'affichage des postes
: l'opératrice pouvait ainsi vérifier à
quel théâtre chaque appareil était relié
Plus tard, la multiplication du nombre des postes publics
et des abonnés rendra nécessaire plusieurs opératrices
et des «"tableaux» beaucoup plus complexes.
Le répartiteur était relié, circuit par
circuit, à un tableau desservi alors par une seule opératrice.
Son travail consistait à établir les liaisons
entre les différents théâtres et les appareils
à sous, et à mettre à jour les voyants
indicateurs de ces derniers par télécommande.
|
|
En 1893 en Hongrie, Le Telefon
Hírmondó est un système similaire, ouvert
en 1893.
En Angleterre,l'Electrophone
un système similaire, aussi inspiré par le Théatrophone
a ouvert en 1894.
Comme le soulignait un chroniqueur
de l'époque : « C'est un exemple peu commun d'une
personne entendant toutes les pièces du répertoire
moderne sans pouvoir mettre jamais les pieds dans une salle
de spectacles. »
De ce même tableau de commutation partaient également
des lignes vers le central téléphonique «
Opéra », d'où l'on pouvait joindre ceux
des abonnés au réseau du téléphone
qui étaient clients du théâtrophone : les
transmissions se faisaient alors par l'intermédiaire
de leur central d'attache et par le moyen de leur ligne téléphonique
normale. Toujours d'après notre chroniqueur, ils «
étaient les mieux partagés puisque, chez eux-mêmes,
sans sortir de leur appartement et même de leur lit, ils
pouvaient se croire transportés dans leur théâtre
préféré ». Heureusement, les centraux
n'étaient pas encore automatiques et la « demoiselle
du téléphone » était en mesure d'interrompre
l'audition pour prévenir d'une communication urgente
: grave responsabilité, qui pouvait lui valoir d'amères
récriminations. Inconvénient de la ligne particulière
: plus de stéréophonie.
 Sommaire Sommaire
|
MARCEL PROUST, AMATEUR DE THEATROPHONE
 Marcel
Proust, dont on sait que les problèmes de santé
l'incitait à éviter les sorties, fut, comme
le révèle sa correspondance, un adepte du théâtrophone. Marcel
Proust, dont on sait que les problèmes de santé
l'incitait à éviter les sorties, fut, comme
le révèle sa correspondance, un adepte du théâtrophone.
Le 21 février 1911, il écrit à son ami
Reynaldo Hahn : "J'ai entendu hier au théâtrophone
un acte des Maîtres Chanteurs [...] et ce soir... tout
Pelleas" .
Comme le note Philippe Kolb, éditeur de la Correspondance,
cet abonnement de Proust paraît lié à
une nouvelle campagne promotionnelle du théâtrophone.
Il cite une annonce parue dans le Tout Paris de 1911 :
"Le Théâtre chez soi. Pour avoir à
domicile les auditions de : Opéra - Opéra Comique
- Variétés - Nouveautés - Comédie
française - Concerts Colonne - Châtelet - Scala,
s'adresser au Théâtrophone 23, rue louis-le-Grand,
tél. 101-03. Prix de l'abonnement permettant à
trois personnes d'avoir quotidiennement les auditions : 60
F par mois. Audition d'essai sur demande."
Quelques jours après son abonnement, Proust témoigne
une certaine déception, dans une lettre à Georges
de Lauris : "Je me suis abonné au théâtrophone
dont j'use rarement, où on entend très mal.
Mais enfin pour les opéras de Wagner que je connais
presque par coeur, je supplée aux insuffisances de
l'acoustique. Et l'autre jour, une charmante révélation,
qui me tyrannise même un peu : Pelléas. Je ne
m'en doutais pas !".
|
|
La mauvaise qualité de
la transmission n'empêche pas Proust de se faire le propagandiste
du système.
En 1912, il recommande à une de ses correspondantes,
Mme Strauss, de souscrire au service : "Si vous êtes
demain soir chez vous, vous devriez demander le théâtrophone.
On donne à l'Opéra la charmante Gwendoline".
En 1913, il revient à la charge auprès de la même
Mme Strauss :
"Vous êtes-vous abonnée au théâtrophone
? Ils ont maintenant les concerts Touche et je peux dans mon
lit être visité par le ruisseau et les oiseaux
de la Symphonie pastorale dont le pauvre Beethoven ne jouissait
pas plus directement que moi puisqu'il était complètement
sourd. Il se consolait en tâchant de reproduire le chant
des oiseaux qu'il n'entendait plus. A la distance du génie
à l'absence de talent, ce sont aussi des symphonies pastorales
que je fais à ma manière en peignant ce que je
ne peux plus voir !".
Commentant cette lettre dans son ouvrage Proust au miroir de
sa correspondance, Luc Fraisse remarque que "le théâtrophone
n'est pas seulement un épisode anecdotique dans sa vie.
[...]. L'abonné mélomane aperçoit dans
ce procédé moderne un symbole de sa condition
d'écrivain. [...] Abolissant la distance de l'absence,
le théâtrophone ressemble à l'écriture
selon Proust, en ce qu'il restitue à sa manière
une musique retrouvée, un temps retrouvé. Il recrée
en outre un chant intérieur, cette mélodie intime
dont, à l'image de Vinteuil, tout artiste est habité.
Ainsi, le véritable théâtrophone de Proust,
c'est son imagination."
Il n'était pas étonnant que, quelques années
plus tard, Proust s'intéresse également aux perspectives
ouvertes par les travaux sur la vision à distance. Nous
y reviendrons.
|
1930 : trois cents abonnés
Et le théâtrophone connut des jours heureux...,
même au domicile de Clément Ader, qui possédait
chez lui un énorme champignon permettant à huit
auditeurs d'écouter, en monophonie toutefois, la transmission
des dernières nouveautés de l'Opéra ou
de l'Opéra-Comique.

Sommaire
|
Avec les années, les auditeurs,
qui étaient le plus souvent des mélomanes devinrent
plus exigeants et il fallut améliorer la qualité
du service.
Vers les années 1910,— l'électronique n'ayant
pas encore fait son apparition—, on recourut au relais
Brown pour obtenir une certaine amplification du courant parcourant
les lignes et remédier ainsi à l'affaiblissement
de l'audition on obtint des résultats intéressants.
Le 24 mai 1913, ce type d'installation permit une transmission
audible à Londres, de « Tristan et Isolde »
donné à l'Opéra de Paris ; dans l'autre
sens, une représentation de l'Alhambra dei Londres était
offerte aux auditeurs parisiens.
Les microphones aussi furent améliorés.
Au lendemain de la guerre 1914-1918, chaque abonné au
théâtrophone pouvait disposer l'espace d'une soirée
et dans le théâtre de son choix, d'un microphone
de type « Paris-Rome », c'est-à-dire du même
type que les microphones très sensibles dont étaient
dotées les opératrices assurant les communications
téléphoniques à longue distance.
Mais le système, en lui-même, limitait nombre des
bénéficiaires : sans quoi, la rampe du théâtre
se serait écroulée sous le poids des appareils,
et le nombre des circuits les reliant un à un central
serait devenu prohibitif.
En outre, de vieux abonnés compliquaient le travail du
personnel en demandant qu'on les place bien entendu «
côté violons ».
En 1923, tout se simplifia : on put, à partir d'un microphone
rattaché à un amplificateur à lampes, atteindre
de multiples usagers.
Sommaire
|
En 1930, le théâtrophone
était toujours installé rue Louis-Lé-Grand
desservait environ trois cents abonnés, dont les demandes
d'audition étaient reçues de dix à dix-neuf
heures par plusieurs « théâtrophonistes
».
Une grande amélioration était intervenue au
domicile des abonnés, ils écoutaient désormais
confortablement grâce à un haut-parleur Après
des essais avec des appareils à pavillon, la Compagnie
avait retenu des diffuseurs Lumière ou SFR, assez semblables
à nos haut-parleurs modernes.
Nous terminerons cette étude par l'examen des moyens
employés par la Société scientifique
industrielle de Marseille pour les auditions téléphoniques
du Grand Opéra qui ont eu lieu, aidée du concours
actif de M. B. Dupuy, directeur de l'agence de la société
générale des Téléphones, dans
la Bibliothèque de la Société et à
quatre reprises différentes en mars 1882.
Les dispositions adoptées à Marseille étaient
les mêmes que celles qui avaient été prises
à Paris lors de l'Exposition d'Electricité en
1881.
Bien entendu le nombre des microphones était moindre,
de même que les appareils d'audition, mais le système
était absolument le même et avait été
installé obligeamment entre l'Opéra et le siège
de la Société par M. R. G. Brown, Ingénieur
Electricien de la Société générale
des Téléphones
— Les dispositions prises au grand opéra de Paris
sont représentées dans les figures suivantes,
qui donnent un dessin de la rampe à gaz montrant de
chaque côté de cette rampe une série de
microphones.
|
|
|
A Marseille on s'était
contenté des deux appareils placés de chaque
côté du trou du souffleur et l'effet n'en a pas
été moins bon.
La figure ci contre représente les communications telles
qu'elles avaient été établies, afin d'éviter
l'induction, les circuits étaient entièrement
métalliques, et l'on avait établi quatre fils
entre l'Opéra et la salle de la Bibliothèque
de la Société, Ces fils étaient reliés
à quatre paires de téléphones Ader installés
sur une table entourée de sièges et au centre
de laquelle ou avait mis une sonnerie devant limiter le temps
d'audition accordé aux invités.
On peut voir par notre diagramme que les courants engendrés
dans le circuit local des microphones et des bobines primaires
placées au théâtre lançaient sur
la ligue des courants qui, en la traversant, influençaient
les téléphones placés à la Société
scientifique industrielle.
Le microphone de droite au théâtre influençait
le circuit des fils n°1 et 2 de la ligne dans lequel étaient
placés les téléphones 1, 3, 5 et 7 placés
à la droite des auditeurs.
Le microphone de gauche faisait passer les courants par les
fils 3 et 4 et les téléphones 2, 4, 6 et 8 placés
à gauche des auditeurs qui pouvaient ainsi entendre
également bien les chants et la musique exécutés
des deux côtés de la scène.
La pile, divisée en deux parties, pouvait d'ailleurs,
être utilisée par moitié et être
renouvelée chaque quart d'heure au moyen d'un commutateur
manoeuvrépar l'employé placé au théâtre.
On évitait ainsi l'affaiblissement des sons provenant
de l'épuisement de la pile. Un téléphone
était mis dans le circuit des fils 1 et 2 pour la personne
qui dirigeait les opérations et donnait toutes les
cinq minutes le coup de sonnette qui devait renouveler la
série d'auditeurs admis par quatre à la fois
dans la salle d'audition.
|
Un autre téléphone placé
au théâtre dans le même circuit permettait
les communications orales avec ce lieu, pendant les entre
actes, quand le commutateur l'introduisait dans le circuit
des lignes.
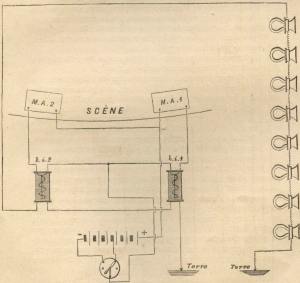
Cliquez
sur la vue pour l'agrandir
On se rappellera sans doute avec plaisir l'effet à
la fois grandiose et saisissant produit par l'audition téléphonique
du Barbier de Séville et de l'Africaine. Les dispositions
prises avaient répondu à l'attente de tous .
Sommaire
|
Évidemment deux microphones étaient insuffisants
et les conditions adoptées à Paris étaient
beaucoup plus favorables.
La haute société de Marseille n'en a pas moins
pu assister à des séances très-intéressantes
au point de vue de l'art et de la science.
Désireuse de pouvoir renouveler quelquefois ces auditions,
la Société Scientifique Industrielle de Marseille,
d'accord avec le Cercle Artistique, a établi une ligne
permanente à deux fils qui lui permet de maintenir
des communications téléphoniques constantes
entre les deux établissements, aussi bien pour l'audition
musicale que pour les échanges verbaux.
Cette ligne peu d'ailleurs être utilisée pour
d'autres expériences relatives à la lumière
électrique et au transport de la force à distance.
La Société Scientifique est aussi reliée,
au moyen des appareils d'Ader, au réseau téléphonique
de Marseille.
L'un de ces deux fils est installé comme une communication
téléphonique ordinaire. Le second, spécialement
réservé aux auditions musicales, aboutit, d'un
côté, à la salle de musique du Cercle
Artistique où sont placés les microphones, les
piles et les bobines d'inductions.
Une série de douze téléphones aboutit
à la salle des Commissions de la Société
Scientifique Industrielle de la manière indiquée
par la figure 37. On voit que, dans ce cas, il a suffi d'un
circuit ordinaire avec un seul fil et la terre pour retour.
Cette disposition suffisait en effet en cette circonstance
dans laquelle l'induction n'était pas à redouter,
elle est d'ailleurs très-effective par suite d'un groupement
particulier des appareils.
|
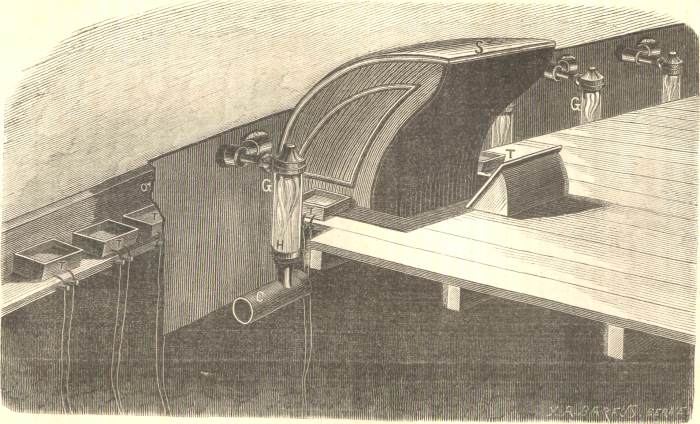
|
On a fait récemment, entre
l'Hippodrome et les bureaux de la Compagnie Internationale des
Téléphones, 15, place Vendôme, une expérience
intéressante.
L'orchestre de l'Hippodrome, qui joue dans la journée
et le soir pour les deux représentations quotidiennes,
a été entendu par de nombreux invités réunis
place Vendôme. Il y avait là 90 récepteurs
téléphoniques ; chaque personne en ayant deux,
48 personnes pouvaient entendre à la fois.
Nous allons entrer dans quelques détails sur les dispositions
prises par le docteur J. Moser pour obtenir ce résultat
.
Grâce à la complaisance de l'Administration de
l'Hippodrome et à celle de la Société Générale
des Téléphones, on a pu faire usage des deux fils
qui servent habituellement à la Direction de l'Hippodrome
qui compte parmi les abonnés du réseau de Paris.
Mais de ces deux fils, il en fallait un pour l'échange
des conversations, ordres donnés, avis transmis, etc.,
etc., tout à fait indispensables pour mener à
bien une opération exécutée, comme celle-ci,
entre deux points éloignés.
Il ne restait donc plus qu'un seul fil pour l'audition musicale.
Voici comment les appareils étaient disposés à
l'Hippodrome :
II y avait 25 transmetteurs microphoniques montés sur
une planche unique, placée elle-même un peu inclinée
sur l'horizontale et au-dessus du chef d'orchestre. Les microphones
étaient, bien entendu, au-dessus de la planche, protégés
de la poussière par une boîte légère.La
planche elle-même était suspendue par quatre cordes.
|
La pile agissant sur ces microphones
était composée de 3 accumulateurs Ueynier-Faure
au début ; l'intensité du courant était
indiquée par un galvanomètre Deprez placé
dans le circuit ; on la maintenait sensiblement constante
en ajoutant à ces 3 accumulateurs un autre, puis un
autre, jusqu'au nombre total de 9. Le résultat aurait
pu être obtenu également avec 5 éléments
Daniell modèle Reynier, qui ont une très-faible
résistance et une constance absolue. Le courant de
la pile est dérivé entre les 25 microphones,
puis dans les 24 fils primaires de
24 bobines d'inductions, montés par 2 en série
et 12 en dérivation. L'intensité du courant
est de 12 ampères environ.
Les 24 circuits secondaires des 24 bobines d'induction sont
groupés par 4 en série et 6 en dérivation.
La résistance de chacune est de 300 ohms, soit pour
l'ensemble 1200 ohms.
La ligne de l'Hippodrome, de 3512 mètres de longueur,
aboutit 96, rue des Petits-Champs, à l'un des bureaux
de la Société Générale des Téléphones
auquel arrive également la ligne de la place Vendôme
qui est très-courte. Avec le raccordement à
la rue des Petits-Champs, la communication était établie.
Les récepteurs du type Ader étaient groupés
par 16 en série et 6 en dérivation.
La netteté de l'audition a été parfaite
et il a paru que tous les auditeurs, ceux de l'après-midi
et ceux du soir, partaient satisfaits.
Nous ne croyons pas qu'on puisse contester qu'il y ait là
un progrès sensible sur le mode d'installation mis
en oeuvre entre l'Opéra et le Palais de l'Industrie,
lors de l'Exposition d'électricité de 1881.
Sommaire
|
|
Il y avait d'un côté
10 microphones et de l'autre 80 récepteurs ; mais la
moitié seulement des récepteurs était en
service à la fois ; il y avait donc en fait 4 récepteurs
par microphone avec deux fils, soit en tout 20 fils. La réduction
du nombre des fils facilitera la pose ; elle diminuera le coût
de l'installation, et par suite permettra un plus grand nombre
d'applications.
L'expérience de M. Moser a été faite avec
un seul fil, parce que le second avait un autre usage ; mais
nous ne prétendons pas que, dans d'autres cas, il faille
n'employer qu'un fil; tout au contraire, nous pensons qu'il
conviendra généralement d'unir ainsi deux fils
pour éviter les bruits d'induction.
Nous dirons en terminant que dans les dispositions de M. Moser
la principale nouveauté consiste dans l'association en
dérivation des
25 microphones, dans l'association des 24 fils secondaires des
bobines d'induction en tension et en quantité comme on
fait avec des éléments de pile.
Avant de terminer cette étude, nous dirons quelques mots
de la fanfare Ader qu'on voyait à l'Exposition Universelle
d'électricité de 1881 et qui a été
également présentée à la Société
Scientifique Industrielle de Marseille.
Cette fanfare, telle qu'on l'avait installée au Palais
de l'Industrie, consistait en quatre cors de chasse ou récepteurs
semblables. Chaque récepteur avait sa ligne et sa pile
(figure ci contre). Pour une salle de dimensions ordinaires,
comme l'est celle des conférences de la Société
Scientifique Industrielle, un seul cor suffisait et donnait
une sonorité assez grande.
|
|

Cliquez sur la
vue pour l'agrandir
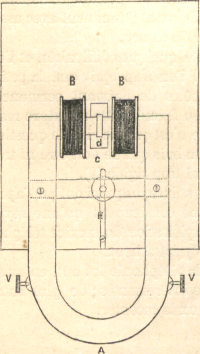
Sommaire
|
Le récepteur consiste
en un grand et fort aimant permanent en fer à cheval,
dont les pôles sont très-rapprochés l'un
de l'autre. Une feuille en laiton remplit l'espace compris entre
ces pôles. Un fil de cuivre recouvert de soie floche est
enroulé autour de chaque pôle en forme de bobine;
ces bobines arrivent jusqu'à 5 m/m des bords des pôles
de l'aimant et forment un circuit dont les extrémités
se rattachent à des bornes placées sur le socle
de l'appareil.
L'aimant est fixé à l'intérieur de façon
à pouvoir pivoter sur l'axe W et on le renferme dans
une boîte en bois munie d'une ouverture latérale.
Cette ouverture est close par un diaphragme en bois de 10 cm
de long sur 08 de large et n'a qu'un demi millimètre
d'épaisseur. Collé au centre de ce diaphragme
se trouve un petit bloc de bois C sur la face intérieure
duquel est fixée une petite armature en fer doux d de
9 m/m de long, 4 m/m de large et un 1/2 m/m d'épaisseur.
Le fer à cheval est alors ajusté au moyen de la
vis E de manière à placer cette petite armature
juste en face et presque à toucher ses pôles. Une
boîte en bois dans le centre de laquelle on perce un orifice
de 25 m/m de diamètre est alors fixée au-devant
du diaphragme. Cette boîte a pour effet de protéger
le diaphragme et de former autour de lui une chambre résonnante
qui augmente l'intensité du son. Celui-ci peut d'ailleurs
être considérablement amplifié lorsqu'on
fixe à la boîte sonore un pavillon de trompette
dont les vibrations métalliques ajoutent à l'effet
obtenu.
Le transmetteur ressemble à celui du condensateur chantant
; il consiste en un diaphragme de 1/2 m/m d'épaisseur
ayant un morceau de platine soudé à son centre.
Le diaphragme est fixé dans un anneau métallique
sous lequel est placée, dans un cadre, une vis isolée
à pointe de platine qui permet le réglage.
Pour l'obtenir, il suffit de tourner la vis du transmetteur
jusqu'à ce qu'elle vienne affleurer le diaphragme métallique.
|
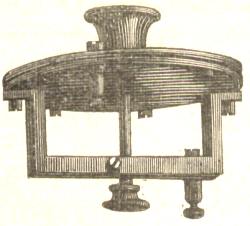
Quand la ligne est longue, il y a avantage à se servir
d'une bobine d'induction en mettant le transmetteur et la
pile sur la primaire et le récepteur et la ligne sur
la secondaire. La résistance des bobines du récepteur
doit, dans ce cas, être de 100 ohms.
Quand la ligne est courte, il est préférable
de se dispenser de la bobine d'induction et de mettre le récepteur,
le transmetteur et sa pile dans le circuit direct de la ligne.
Dans ce cas, la résistance des bobines du récepteur
ne devrait pas dépasser 3 ohms.
Six à huit éléments de pile sont suffisants
dans les deux cas.
Sommaire
|
Pour faire fonctionner l'appareil
il suffit de chanter dans l'embouchure du transmetteur à
la façon du mirliton et non pas comme si l'on soufflait
dans l'embouchure d'une trompette.
Les vibrations produites ainsi ouvrent et ferment alternativement
le circuit de la pile dont le courant attire et repousse de
même l'armature en fer doux fixée au diaphragme
du récepteur.
En effectuant ces différents mouvements, l'armature frappe
les pôles de l'aimant permanent avec assez de force pour
produire les sons d'un cor de chasse.
La construction du récepteur présente quelques
difficultés, et l'on ne devra pas se laisser décourager
si l'on s'aperçoit que la petite armature refuse de venir
frapper les pôles de l'aimant permanent chaque fois que
le circuit est ouvert ou fermé. Cette armature reste
parfois même collée à l'aimant, mais ce
n'est qu'une simple question de dimensions exactes du diaphragme
en bois qui ne doit être ni trop grand, ni trop petit,
ni trop flexible, ni trop rigide.
Le brevet ADER fut vendu partout dans le monde et le
théâtrophone fut utilisée jusqu'en 1926,
à Moscou et 1937 à Paris. Bien sûr, son
succès déclina beaucoup après la découverte
des ondes hertziennes.
Ader fut surpris de cet engouement, autant qu'il fut surpris
de l'échec commercial de certaines de ses inventions.
Mais grâce au théâtrophone et au téléphone,
Ader devint multimillionnaire
|
|
TÉLÉPHONES
ET PHONOGRAPHES
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE de 1889
|
L'illustration du samedi 19 Octobre 1889.
La science moderne a parfois le mot pour rire.
Si tous les ans elle dote l'humanité de canons, explosifs,
ou projectiles de plus en plus meurtriers, étrennes utiles
mais peu agréables, elle daigne parfois nous offrir en
compensation quelque invention ayant, outre son côté
pratique, le caractère et le charme de jouets merveilleux,
tels le phonographe et le téléphone.
Aussi ces instruments constituent-ils une véritable attraction
pour les nombreux visiteurs de l'Exposition, habitants des pays
ou des localités où l'art de causer ainsi avec
un interlocuteur invisible et placé à grande distance
est encore inconnu.
Les curieux se pressent chaque jour, faisant queue le long des
câbles de velours rouge qui protègent les appareils
mystérieux contre la poussée de leurs admirateurs,
dans l'exposition Edison ou au pavillon des téléphones,
près la tour Eiffel.
C'est la physionomie de ce coin de l'Exposition que notre dessinateur
a croquée sur le vif pour le plus grand plaisir de nos
lecteurs.
|
|
Voici, d'abord, les amateurs
du phonographe alignés devant la boîte carrée
d'où partent les fils conducteurs comme les tentacules
d'une pieuvre ; ils ont appliqué à leurs oreilles
les récepteurs et sont sous le charme : l'instrument
répète, en scandant lentement chaque mot, la phrase
gravée sur son rouleau ; une vieille toute attentive
sourit avec satisfaction : « C'est qu'on entend comme
si quelqu'un vous parlait tout de même, on n'a pas idée
de ça à Carpentras ! » Un enfant à
grand chapeau marin rejeté en arrière regarde
la boîte avec de grands yeux, il espère surprendre
le truc; puis deux bons provinciaux, un vieux et un jeune, assez
absorbés, les malheureux! pour ne pas voir à deux
pas le chef-d'oeuvre d'un inventeur qui en vaut bien d'autres,
une toute charmante Parisienne, en toilette exquise. Elle passe,
toisant dédaigneusement du coin de oeil les chapeaux
mous déformés, et le bibi invraisemblable de la
bonne vieille ! 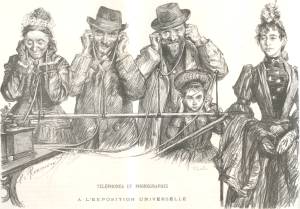
Cliquez sur la vue pour
l'agrandir
|
|
|
Tout le monde ne partage pas,
Dieu merci ! l'indifférence de ces quidams pour le sexe
charmant.
Si la galanterie était chassée du reste de la
terre, elle se retrouverait certes chez le gros monsieur de
notre second dessin (où va-t-elle se nicher ?).
Malgré son épaisse carrure, les rides qui étoilent
le coin de sa paupière, sa grosse moustache et ses cheveux
mal peignés, il a gardé les saines traditions
de galanterie et, qui sait ? quelque prétention à
être encore aimable, sinon aimé.
Aussi c'est avec un geste gracieux (ou du moins il l'espère)
qu'il passe à sa voisine les récepteurs sortis
tout chauds de ses oreilles.
II sourit et esquisse un malin clignement d'œil : dame!
c'est le répertoire d'un calé-concert un peu risqué
que répète en ce moment l'inconscient instrument.
« A vous, belle dame ! » dit-il tout haut,
et in petto: « Vous allez en entendre de drôles
! »
La jolie femme reçoit en baissant les yeux le compliment
de son adorateur suranné, et risque ses deux mignonnes
oreilles ; si le refrain est un peu trop leste, tant pis !
|
|
|
Voici venir l'abbé Bontemps
: le député de sa circonscription a organisé
un train à prix réduits pour ses électeurs,
et l'abbé ne l'a pas manqué, soyez-en sûrs.
Quelle occasion de voir toutes les merveilles dont l'entretient
chaque matin l'Univers ! et surtout le téléphone,
cette merveilleuse découverte de la science.
Car l'abbé Bontemps n'est pas un de ces esprits arriérés
qui enverraient encore au bûcher, s'il leur était
loisible, les successeurs de Galilée.
Non, il sais faire la part du progrès. Son moral, pas
plus que son physique de bon vivant, gras et réjoui,
n'offre de ressemblance avec la Torquemada à l'esprit
atrabilaire, déplorable conséquence d'un estomac
délabré.
Après une longue attente, il est arrivé jusqu'à
l'instrument : son devancier lui tend les récepteurs
: la face hilare, l'abbé les porte à ses oreilles,
avec une certaine émotion.
Il va être initié aux mystères de la science
moderne !
il écoute ! sa physionomie passe par toutes les expressions
de l'attention , de l'intérêt, de la surprise,
pour tomber de l'indignation
et dans la consternation. Il est trop initié.
Qu'a-t-il donc entendu ? Ah! voilà : c'est que le téléphone
est relié un café-concert et au moment ou le brave
abbé entrait en communication, une étoile quelconque
attaquait à plein gosier le refrain d'une chanson dont
voici le premier vers :
Mon pantalon est décousu (bis), etc.
|
|
|
L'abbé n'en a pas voulu
savoir davantage sur les désordres de la toilette intime
de cette jeune personne, nous aimons à le croire ; il
a précipitamment raccroché les récepteurs,
et reste pensif, les pouces passés mélancoliquement
dans la ceinture qui sangle son robuste abdomen.
« Encore un instrument de perdition ! ô mes illusions
! »
Et voilà un ennemi de plus pour Edison !
Puis c'est une longue file d'auditeurs le long des murailles
du pavillon téléphonique ; les uns nous montrent
la face, les autres le contraire.
Au premier plan, une bien jolie femme assise, enchantée
d'une joie enfantine.
Son voisin a de terribles distractions, et, entre nous, il regarde,
je crois, plus qu'il n'écoute.
Quant à la jolie voisine, gageons qu'à son tour
elle écoute moins qu'elle ne regarde. Comment cela finira-t-il
? Par un mariage peut-être, le mariage au téléphone.
Que de petits romans dont le dénouement aura lieu devant
M. le maire auront commencé ainsi dans la galerie des
machines, sans que leurs acteurs aient aperçu l'observateur,
dessinateur ou romancier, qui les guettait le crayon à
la main, faisant de leur naissante idylle un document !
Le spectacle, enfin, est vraiment curieux.
|
|

Cliquez
sur la vue pour l'agrandir
Louis D'HURCOURT.
L'illustration du samedi 19 Octobre 1889.
Sommaire
|
Voyez-vous un de nos grands-pères
subitement ressuscité au milieu de la pièce,
et voyant cette file de gens silencieux, collés au
mur, écoutant avec attention, l'oreille appliquée
à des tampons qui ne rendent aucun son? Il se croirait
dans une maison de fous, évidemment.
Pour finir, encore deux petites femmes : l'une absorbée
par le phonographe, l'autre par le téléphone.
La première, une brave nourrice que la Bourgogne regrette,
écoute de ses deux oreilles, ahurie et charmée
tout à la fois, pendant qu'assis gravement à
ses pieds, Bébé se creuse peut-être sa
petite cervelle pour deviner ce que Nounou peut bien faire
là. Quand Bébé aura vingt ans, qui sait
si téléphone et phonographe ne seront pas démodés
et remplacés par d'autres inventions, plus abracadabrantes
encore ?
La dernière, dilettante sans doute, a choisi l'appareil
en communication avec . l'Opéra-Comique ; le hasard
l'a servie, on achève un duo d'amour.
Bercée par la voix chaude du baryton, elle a fermé
les yeux, et l'illusion a été si forte que,
le morceau terminé, elle pose les récepteurs
et applaudit bruyamment, oubliant que le bruit de ses petites
mains entrechoquées ne saurait arriver jusqu'à
l'objet de son enthousiasme.
Encore un artiste qui ne connaîtra pas son bonheur!
Et voilà quelques bons moments de passés aussi
bien pour ceux qui écoutent que pour ceux qui vont
regarder écouter.
Les premiers s'en reviennent du Champ-de-Mars enthousiasmés
pour les inventions nouvelles ; les seconds publient des croquis
et des articles qui feront peut-être se liâtei
vers cette partie de l'Exposition les indifférents
et les retardataires.
|
Proust, s’est
abonné dans les tout premiers aux retransmissions en direct
de l’opéra de Paris.
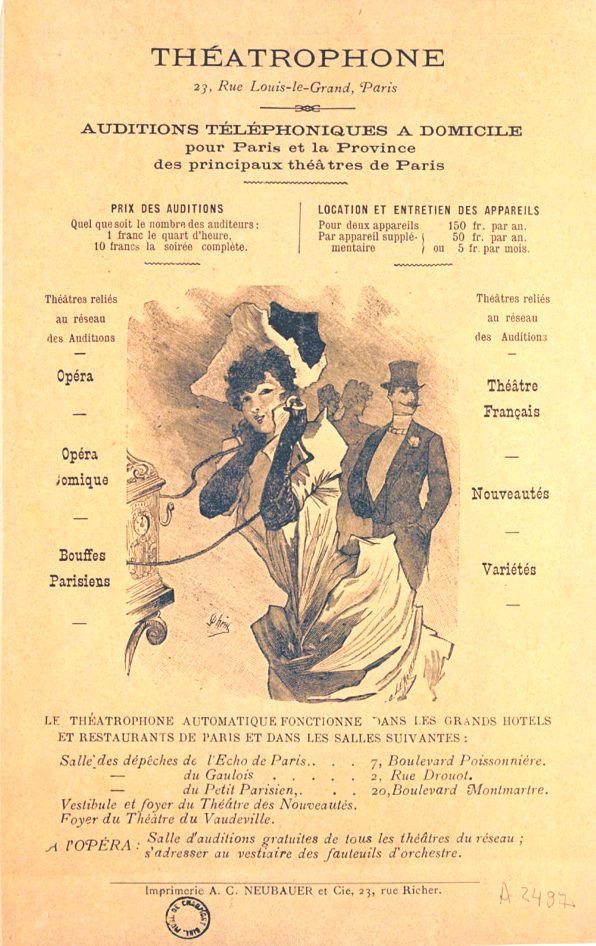 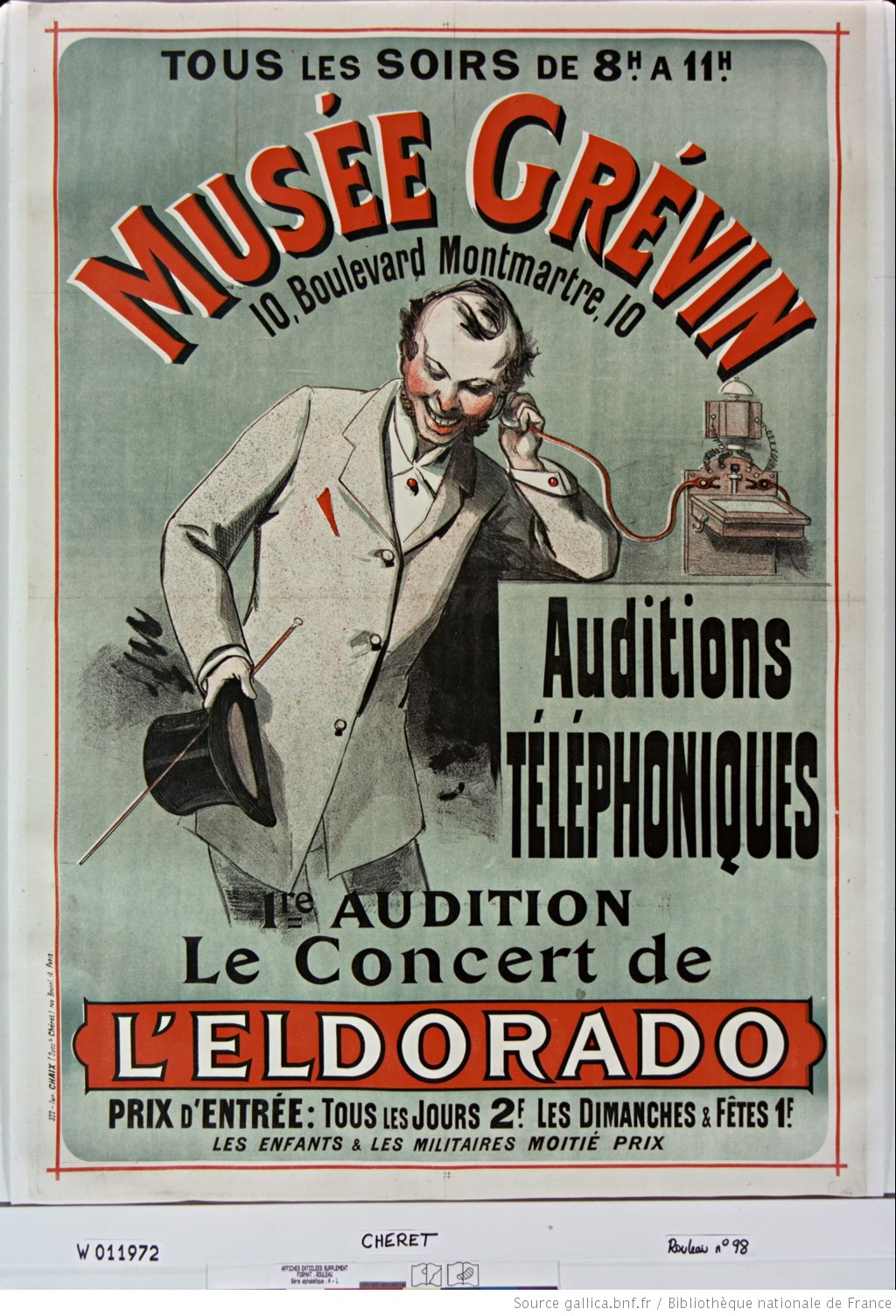
Sommaire
Revenons sur "La Voix humaine"
Une femme, après quelques tentatives infructueuses, finit par
joindre son amant au téléphone. Elle l'appelle «
chéri », mais doit lui rendre leurs lettres et se montrer
courageuse. À travers les non-dits et
un moyen de communication défaillant (la communication s'interrompt
sans cesse), la pièce présente une rupture amoureuse
difficile. La femme aime toujours l'homme à qui elle parle
et a tenté de se suicider.
La
voix humaine"
(consultez le texte en pdf) est une pièce de théâtre
en un acte de Jean Cocteau écrite en 1927.
La Voix Humaine est l’une des œuvres majeures du théâtre
de Cocteau. Depuis qu'il a été écrit, ce monologue
n'a jamais cessé d'être joué dans le monde entier.
« Ce qui surtout est émouvant ici, c’est la situation
elle-même, ce drame de la présence-absence, ce dialogue-monologue
; et ce qui fait de cette scène rapide une vraie tragédie,
c’est cet appareil insensible, image de la fatalité, plutôt
que les paroles qu’il apporte et emporte. » (Pierre Bost,
Revue hebdomadaire, mars 1930.)
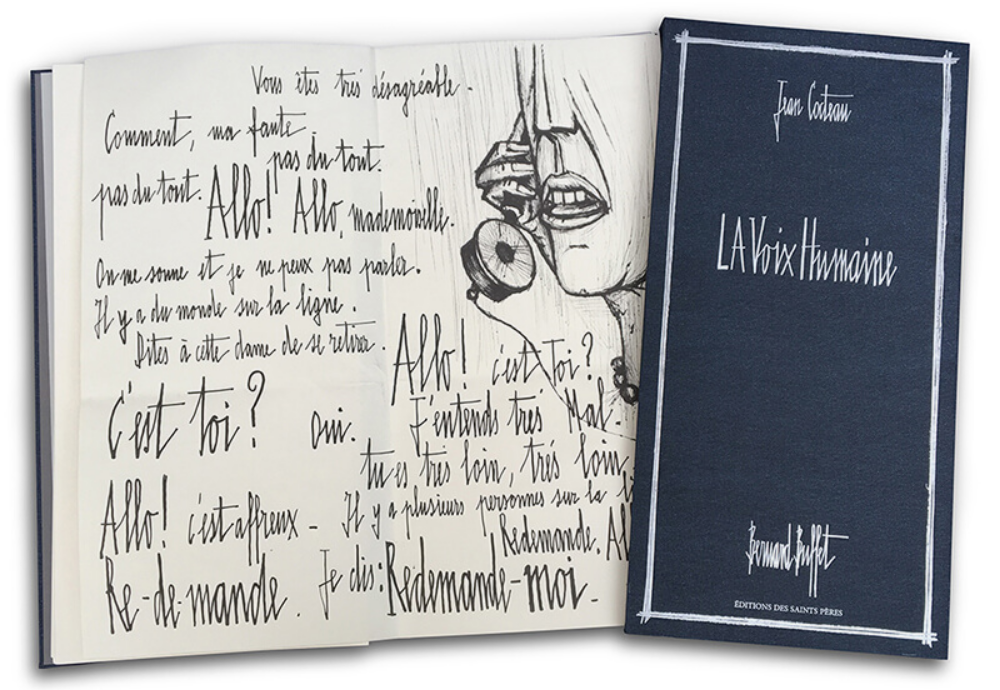
Étonnante de modernité, universelle, La Voix Humaine
continue d’inspirer. En 1958, Francis Poulenc, qui est un proche
de Jean Cocteau de longue date, en tire une tragédie lyrique
en un acte, créée et jouée le 6 février
1959, salle Favart à Paris, avec la soprano Denise Duval.
"Par un curieux mystère ce n'est qu'au bout de quarante
ans d'amitié que j'ai collaboré avec Cocteau. Je pense
qu'il me fallait beaucoup expérience pour respecter la parfaite
construction de La Voix Humaine qui doit être, musicalement,
le contraire d'une improvisation", écrivit Francis Poulenc.
Ce à quoi Cocteau répondit : "Mon cher Francis,
tu as fixé une fois pour toutes, la façon de dire mon
texte."
En 1964, le texte de La Voix Humaine est enregistré en une
seule prise chez Simone Signoret, dans son appartement, place Dauphine
à Paris. Selon le producteur Jacques Canetti, cet enregistrement
est l’un des plus beaux qu’il ait vécu et réalisé.
Il obtient la même année le Grand Prix du Disque.
En 2021, Pedro Almodóvar devrait faire son retour au cinéma
avec un court-métrage expérimental de 29 minutes librement
adapté de La Voix Humaine, filmé à Madrid, où
Tilda Swinton tient le rôle principal. En 1987, l'extrait final
de la pièce fut déjà joué dans le film
de Pedro Almodóvar La Loi du désir.
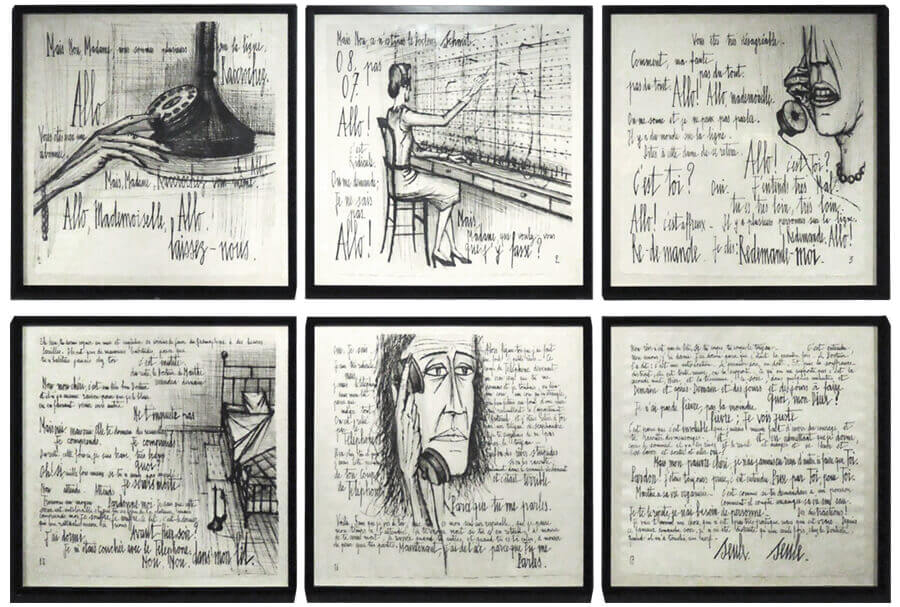
Présentation de La Voix Humaine, dans une version encadrée,
lors de son exposition au Musée d'Art Moderne de Paris
Sommaire
Le Téléphone au théâtre
(France, 1880-1930) par Isabelle Krzywkowski.

Les indications bibliographiques complètes des pièces
étudiées sont fournies dans la titrologie en annexe.
"La lettre est sortie de la littérature le jour où
le Narrateur de La Recherche a téléphoné à
sa mère. (E. Fantou)"
On sait que l’objet technique est un motif littéraire
et artistique fréquent depuis la fin du XVIIIe siècle.
On se rend souvent moins clairement compte que, si sa présence
peut être motivée par une volonté de réalisme
ou de modernité, elle entraîne aussi la question de son
« traitement » littéraire, pictural, musical, etc.
Souvent, donc, le recours à la technique suppose une double
préoccupation : son intérêt thématique
d’une part, d’autre part le travail sur les modalités
de son utilisation, qui peut conduire à trouver en lui un nouveau
mode de
création.
La variété même des interventions proposées
pendant ces journées atteste que le téléphone
a fait l’objet de nombreuses utilisations en art. L’axe
par lequel nous allons l’aborder permettra de donner un aperçu
de l’usage que le théâtre en a fait. C’est
un peu le hasard qui en a déterminé le corpus : la recherche
dans le fichier « Titres » de la Bibliothèque nationale
de France et dans les revues spécialisées de l’époque
a fait apparaître un nombre
significatif d’auteurs, de la fin du XIXe siècle à
l’entre-deux-guerres, qui non seulement recourt à cet
objet, mais le juge suffisamment expressif pour en faire le titre
d’une œuvre. Nul doute qu’on trouverait les mêmes
traces d’intérêt dans les autres genres à
la même époque, mais les contraintes du genre théâtral
semblent si peu adaptées à l’usage du téléphone
que cette étude devenait une occasion de mettre en évidence
la manière dont la littérature se saisit, thématiquement,
mais aussi formellement, d’un nouvel objet.
Ainsi, au théâtre aussi, le téléphone peut
remplacer la lettre, et d’autres choses encore, comme l’explique
un des personnages de Le Téléphone en amour :
Que le téléphone rend donc de services !… Au lieu
de mettre les domestiques dans la confidence, ou bien d’être
obligé d’aller porter soi-même des cartes-télégrammes
à la poste pour se fixer rendez-vous, aussitôt que le
mari s’absente, vite, un coup de téléphone, et
on a en deux minutes la demande et la réponse.(1).
1 A. Damocède, Le Téléphone en amour, 1898,
sc. 4.
Gageons que le téléphone ne se borne pas à faire
évoluer les mœurs amoureuses et que l’absence des
domestiques ou les réponses à distance pourraient bien
contribuer à faire évoluer les mœurs théâtrales…
S’il est toujours intéressant de constater qu’un
objet peut faire l’objet d’un titre, les éléments
fournis par cette titrologie ne manquent pas d’intérêt.
Peu de situations précises sont évoquées (trois
mariages, une histoire d’amour, une demande de décoration)
et deux seulement font directement référence à
un fait d’époque : l’existence de « centraux
téléphoniques » tenus par les « demoiselles
du téléphone ». Pour le reste, les « surprises
» et les « farces » fonctionnent comme des références
internes au théâtre, particulièrement au genre
comique (voir les « Gaietés » ou les « Joies
», qui constituent d’ailleurs des antiphrases : on s’énerve
beaucoup au téléphone à l’époque
!).
Mais la plupart des titres renvoient à la simple « situation
» (2 )
« Au téléphone
» retranscrit sur ce site, qui semble pour l’essentiel
exploitée par le vaudeville

(on ne trouve, outre La Voix humaine de Cocteau, qu’un
seul mélodrame).
Il y a cependant lieu de s’étonner de la récurrence
de ce sujet et de la volonté d’exploiter théâtralement
une situation (pour nous du moins) très quotidienne, apparemment
si pauvre en intrigue et surtout qui suppose un personnage… absent
– paradoxe dont l’auteur dramatique ne semble pouvoir se
sortir qu’avec beaucoup d’habileté…
Pourtant, si l’on en croit Cocteau, le téléphone
est devenu, en 1930 (en 1927 pour la rédaction de La Voix humaine),
« l’accessoire banal des pièces modernes »
(3).
C’est bien ce que cette titrologie semble confirmer, avec un
rapport de dates intéressant : le sujet apparaît très
tôt (1882 au moins), puis l’on constate un vide dans les
années 1910 / 1920 et une reprise dans les années 1920
/ 1930, avant de voir le sujet pratiquement disparaître, dans
les titres du moins, jusqu’aux années 1980 (4), ce qui
correspond historiquement aux différentes améliorations
techniques (passage de la batterie locale à la batterie centrale
vers 1920), jusqu’à l’installation de « l’automatique
» (5), à la suite de laquelle son usage s’est banalisé
(6).
La remarque de Cocteau fait apparaître un autre
élément important : le téléphone est un
objet « moderne », sans doute même est-il chargé,
comme la plupart des machines, d’incarner la « modernité
». Dans les pièces qui vont nous occuper, qui sont rien
moins qu’un théâtre d’avant-garde, il suffit
même le plus souvent à la signifier : être abonné,
c’est être un « homme de progrès » (7),
et il n’est guère besoin de recourir à d’autres
machines. En revanche, ce théâtre se préoccupera
de mettre en scène les habitudes particulières qui découlent
de l’usage, que ce soit la manière dont on utilise l’objet
ou les situations de parole provoquées par l’intermédiaire
d’un central non automatique.
À l’évidence, donc, le téléphone
permet de conjoindre la touche de modernité, la quotidienneté
et la théâtralité nécessaires au «
théâtre de boulevard ». Mais si son usage est,
de fait, immédiatement récupéré par les
situations archétypales du vaudeville, nous verrons que sa
présence entraîne une véritable réflexion
sur le genre et la pratique du théâtre : le téléphone
contient un potentiel dramaturgique et dramatique certain, car il
pose des problèmes de jeu, de mise en scène, de théâtralité,
voire d’écriture. Dans la mesure, en effet, où
il est lié à la voix (8), il se devait d’intéresser
le théâtre ; mais dans la mesure où il suppose
une voix absente, il ouvre sur une situation théâtrale
paradoxale qui obligera les auteurs à trouver des
mises en forme (en scène ou en écriture) originales.
2 Le terme renvoie bien sûr à l’ouvrage contemporain
de Georges Polti, Les Trente-six Situations dramatiques, Paris, Mercure
de France, 1895, qui répertorie et classe des structures récurrentes
au théâtre.
3 Jean Cocteau, préface à La Voix humaine [1927], Paris,
Stock, 1930, cité dans Paris, Gallimard, « La Pochothèque
», 1995, p. 1093.
4 On notera que cette bibliographie étant titrologique, elle
ne permet évidemment pas de rendre compte de l’utilisation
du téléphone au théâtre en général
; elle peut cependant être considérée comme un
« symptôme » pertinent.
5 Le premier central automatique en France est celui de Nice, installé
en octobre 1913, mais la mise systématique en automatique n’est
entreprise que vers 1925. La France du tournant du siècle est
en retard sur les U.S.A. et plusieurs autres pays européens
: on compte en 1900 un téléphone pour 60 habitants aux
U.S.A., pour 115 en Suède, 129 en Suisse et 397 en Allemagne,
alors qu’il n’y en a encore qu’un pour 1216 habitants
en France. Sur l’histoire des réseaux téléphoniques,
on pourra entre autres se reporter, en français, à Clairette
Hajdu, Au Cœur du téléphone : histoire des instal’,
[Pantin], Le Temps des cerises, 1995 ; Le Téléphone
à la Belle Époque, Paul Charbon (éd.), Bruxelles,
éditions Libro-sciences, 1976 ; « Le Téléphone
de 1850 à 1914 », Histoire de la Poste et des télécommunications,
actes du 7e colloque de la F.N.A.R.H., t. 2, 1992.
6 L’objet, bien sûr, n’a pas disparu du champ artistique,
mais il n’y entre plus, bien souvent, que comme un élément
du décor quotidien. Régulièrement cependant sortent
des œuvres qui tentent d’en proposer une utilisation originale.
7 Maurice Hennequin, Un mariage au téléphone, 1888,
p. 12.
8 Notons d’ailleurs qu’à la même époque,
le « théâtrophone » de Clément Ader
permettait d’écouter chez soi une pièce ou
un concert
Thèmes et situations
L’inventaire des situations et des thèmes dans lesquels
le téléphone apparaît est, du moins pour le corpus
qui nous intéresse, assez rapide à établir.
On y retrouve, bien sûr, les thèmes majeurs du vaudeville.
L’adultère, d’abord, comme chez Damocède,
Marsan, Suzanne Chebroux, ou Zamacoïs, y trouve de nouvelles
ressources : un mari entend sa femme le tromper grâce au téléphone,
une femme ne cesse de s’assurer que son mari est au travail pendant
qu’elle se fait courtiser par son amant, ce qui, bien entendu,
nuit quelque peu aux épanchements (9). D’une manière
générale, le téléphone est un outil de
tromperie, qui permet en particulier de mentir sur le lieu ou l’état
dans lequel on se trouve (10).
Il sert, par ailleurs, à se mettre d’accord sur toutes
sortes de choses, depuis les demandes en mariage (11), jusqu’aux
demandes de décoration (12), situations dont le comique tient
bien sûr à la brièveté de la manœuvre,
eu égard à l’importance de l’engagement. Il
va de soi que, dans le même ordre d’idée, il est
d’un grand secours aux amants qui, non contents de pouvoir prendre
rendez-vous en toute facilité, profitent souvent de cette conversation
différée pour goûter un premier aperçu
des plaisirs qui les attendent (13) ; je ne résiste pas au
plaisir de faire revivre ce succulent « dialogue » d’André
Pascal :
Au revoir ma chérie. (Elle lui embrasse la main tout en écoutant
à l’appareil. Madeleine sort. À l’appareil)
.À présent je suis seule… oui, elle est partie…
– Ouf ! (Éclats de rire) Oui, mon chéri, je vais
m’installer à mon aise… (Prenant l’appareil
et se dirigeant vers le divan) Toi, viens avec moi. (S’installant
sur le divan) Ça y est, je suis étendue sur le divan…
avec toi naturellement… très confortablement. Nous allons
pouvoir bavarder un bon moment. Oui, je lui ai dit que j’étais
en communication avec ma sœur… Tu ne comprenais pas, mon
pauvre chéri […] Si je t’aime ? Quelle question !
Ça te fait plaisir quand je te le dis ?… Même par
téléphone ? Je n’ai pas pu m’endormir…
J’ai pensé à toi toute la journée […]
Le téléphone a du bon… Il me semble que tu es là
près de moi… Veux-tu être convenable… Comment
? Si j’ai compris ?… Bien sûr, j’ai compris…
mais oui… Non, tais-toi… tais-toi… Assez… Assez…
moi aussi… […] Attends… j’éteins…
l’électricité… Pourquoi ? par habitude…
Non !… tais-toi… tais-toi donc… je suis bête
!… Je t’adore quand tu me dis cela…
Rideau (14)
9 A. Damocède, op. cit. (le mari et l’épouse
utilisent chacun le téléphone pour arranger leurs rendez-vous
galants) ; Maurice de Marsan, Par téléphone, 1902 (un
mari apprend grâce au téléphone que sa femme le
trompe avec leur voisin) ; Suzanne Chebroux, Allô, c’est
moi, Edgar !, 1904 (un homme parle au mari en croyant parler à
la femme) ; Miguel Zamacoïs, Au bout du fil, 1903 (un homme reçoit
une femme qui n’accepte de devenir sa maîtresse que s’il
installe un téléphone pour qu’elle puisse rassurer
son mari).
10 Hippolyte Raimond et Paul Burani, Le Téléphone, 1882
(une femme utilise le téléphone pour éviter la
rencontre de ses deux amants) ; Miguel Zamacoïs, Deux femmes
et un téléphone, 1920 (deux amants font un poisson d’avril
à leur maîtresse en leur annonçant leur rupture
par téléphone) ; Jean Cocteau, op. cit. ; Pierre Valdagne,
Allô ! Allô !, 1886 (un mari se réconcilie avec
sa femme en croyant parler à une autre au téléphone,
alors que celle-ci est chez son amant – bien entendu le meilleur
ami du mari).
11 Maurice Hennequin, op. cit., 1888 (un exilé qui croit que
sa fiancée l’a trahi oblige un notaire à lui arranger
un autre mariage par téléphone) ; Louis de La Garde,
Un mariage par téléphone, 1893 (arrestation erronée
d’un père et de son fils suite à un quiproquo téléphonique)
; E. du Tesch, Par téléphone, 1909 (des fiancés
se téléphonent journellement à l’insu de
leurs parents) ; André Mouëzy-Éon, « Les
Joies du téléphone » [1942?]
(suite de disputes et de quiproquos téléphoniques).
12 Paul Deroyre, Décoré par téléphone
[1908?] (un homme appelle un ministre pour obtenir une décoration).
13 Friedrich Kittler montre du reste que le motif du téléphone
repose souvent en littérature sur des connotations érotiques
(Voir Grammophon Film Typewriter, Berlin, Brinkmann et Bose, 1986,
p. 87-93).
14 André Pascal, Tout s’arrange, s.l., s.é., s.d.
[1925?], p. 121-122 (la présidente d’une association de
bienfaisance arrange tout, y compris ses rendez-vous amoureux, par
téléphone). Voir aussi Octave Pradels, « Les Gaietés
du téléphone », 1905 (une femme tente de joindre
son couturier et tombe sur un inconnu qui lui fait la cour par téléphone)
; Jules Legoux, Par téléphone, 1883 (une femme appelle
sa couturière et croit comprendre
que son fiancé la trompe), ainsi que Damocède et Du
Tesch.
Bien qu’apparemment moins souvent, le mélodrame y trouve
aussi la possibilité de renouveler ses thèmes par le
biais de cet outil « mystérieux, surnaturel » (15)
; le seul exemple rencontré ne manque pas d’intérêt,
puisqu’il s’agit d’une pièce écrite pour
le Grand Guignol où, contrairement aux habitudes qui rendirent
ce théâtre célèbre, l’assassinat n’est
justement pas réalisé sur scène, mais perçu…
par téléphone : « on les tue ! on les égorge…
» – le rideau tombe sur ces cris du mari qui tient le téléphone
en main (16).
Mais on trouve également des scènes, voire des intrigues
spécifiquement liées à la pratique du téléphone.
Dans les premières années surtout, plusieurs pièces
prennent pour sujet l’apprentissage du téléphone
(17), ce qui donne lieu à toutes sortes d’effets comiques
: confusion entre la sonnette de la porte d’entrée et
la sonnerie du téléphone (18), incompréhension
de l’onomatopée « allo », représentation
de l’incapacité de certains à comprendre le fonctionnement
de l’objet (19). Très tôt l’on voit également
apparaître des situations où le téléphone
est utilisé de manière quotidienne, pour les affaires
(20), les courses (21), les rendez-vous (22), l’amusement (23)
aussi. Sa présence donne alors lieu à des considérations
sur le progrès (24), la rapidité nouvelle des communications
et les problèmes que cela pose ; il est cependant relativement
rare que les commentaires ou les critiques soient explicites : la
pièce de Roche dénonce par exemple les travers d’une
communication qui sépare les gens (25), mais seule la pièce
de Louis de La Garde se construit sur l’opposition de deux opinions
(le père contre le fils). Certaines pièces, en revanche,
ont pour unique sujet la pratique du téléphone, c’est-à-dire
la représentation d’une conversation dont le seul intérêt
est d’être passée par téléphone (26).
15 André de Lorde et Charles Foley, Au Téléphone…,
Paris, Librairie Molière, s.d. [1901?], p. 28 (un homme entend
l’assassinat de sa famille par téléphone). Cette
pièce connaît un parcours intéressant : créée
le 28 novembre 1901 au théâtre Antoine, avec André
Antoine et Jean Kemm, reprise par Firmin Gémier, reçue
en 1913 à la Comédie française, mais retirée
en octobre 1921 par les auteurs, qui estimaient qu’ils avaient
attendu assez longtemps de la voir monter et la donnent alors au théâtre
du Grand Guignol.
16 Ibid., p. 30.
17 Par exemple M. Tournebroche, Le Téléphone, 1897 (description
des procédures d’un coup de téléphone pour
inviter quelqu’un à dîner) ou Jehan d’Agno,
Le Gendarme par téléphone, 1902 (un gendarme tente de
faire venir du renfort mais ignore comment se servir du téléphone
: il écrit, il s’adresse à lui, etc.) ; voir aussi
le personnage de la bonne chez Raymond et Burani ou de Lorde et Foley,
ou l’héroïne de Pradels.
18 Zamacoïs, Au Bout du fil, 1903 (l’amant qui équipe
sa maison pour obéir aux desiderata de sa maîtresse fait
des essais sur sa nouvelle installation).
19 À noter qu’on trouve chez une héroïne de
Zamacoïs l’idée que l’énervement peut
nuire au bon passage du courant (Zamacoïs, Deux femmes et un
téléphone, 1920, p. 11), preuve que le fonctionnement
du téléphone reste incompréhensible à
beaucoup.
20 Par exemple La Garde, op. cit., p. 7, 30, etc. ; de Lorde et Foley
(le téléphone est « indispensable en affaire »)
; Pascal, op. cit., acte I. Seule la pièce de Jacques Cossin,
Allo Blima… ici 283 (1936) présente une situation plus
exceptionnelle (une station météorologique en plein
Sahara, où le téléphone, unique point de contact
avec la civilisation, sert à transmettre quotidiennement des
informations chiffrées sur le temps et, finalement, l’annonce
du décès du dernier arrivé).
21 C’est le prétexte des pièces de Legoux, Pradels,
Mouëzy-Éon, A. Ducasse-Harispe (« Le Téléphone
! mon cauchemar… » [1928?], où l’on assiste
à la dispute d’un abonné avec une téléphoniste).
22 Guy Dorrez, Les Surprises du téléphone, 1931 (un
homme tente vainement de joindre un ami pour l’inviter à
une promenade) ; Paul Croiset, Arthur au téléphone,
1930 (un garçon fait peur à son frère grâce
au téléphone).
23 Chez de Lorde et Foley, un des personnages féminins explique
qu’elle adore téléphoner à des amis, à
des célébrités (Edmond Rostand, la Belle Otero),
ou même composer un numéro au hasard. Voir aussi La Farce
du téléphone, d’Henri Farémont (1935) où
des enfants recourent au téléphone pour obtenir les
réponses de leurs exercices scolaires.
24 La Garde, op. cit., sc. 1 et 10 ; de Lorde et Foley, op. cit.,
p. 25, 27, 28, etc. ; Marsan parle de « merveilleuse invention
» (op. cit., p. 9).
25 Voir aussi les plaintes des personnages de M. de Savoie, Le
Téléphone, 1888 (un mari reçoit la déclaration
que son propriétaire, qui vient de leur offrir le téléphone,
croit faire à sa femme), Pradels, Dorrez, Mouëzy-Éon
ou Ducasse-Harispe, mais il s’agit le plus souvent de déboires
liés aux difficultés de la communication, comme l’illustre
également le « Duo téléphonique »
de Mac Nab, fondé sur une série d’incompréhensions.
26 Par exemple Ducasse-Harispe, Pradels, Dorrez, ou Mouëzy-Éon.
Il faut alors accorder une place particulière à ce qui
s’avère le principal lieu commun de l’époque
en ce qui concerne le téléphone : les « demoiselles
» qui font naître tant d’énervement et de
fantasmes qu’on leur consacre même des chansons (27). De
très nombreux textes mentionnent le processus à suivre
et la difficulté que connaît l’usager d’alors
: brouillage des voix, interruptions constantes, interventions de
tiers, retards font souvent naître des colères dont les
employées font régulièrement les frais, et transforment
bien souvent l’expérience, comme le dit Ducasse-Harispe,
en un « cauchemar » (28). Antony Mars et Maurice Desvallières
y puisent les péripéties d’un premier acte qui
se passe au « Bureau central des
Téléphones » : le spectateur voit défiler
les « demoiselles », leur surveillante et un inspecteur,
reçoit le compte rendu des insultes ou des tentatives de séduction
par téléphone, assiste à des écoutes clandestines
et aux commentaires que tout cela fait naître, l’ensemble
dans un rapport assez lâche avec les deux actes qui vont suivre
(29).
Roche consacre un monologue à cette « demoiselle »
qui devient un parangon de morale hypocrite :
"Dring ! Dring ! Qu’est-ce qu’il y a encore ? Un abonné
qui demande la communication. Vous pouvez attendre, Monsieur. Vous
croyez que je me vais me tuer pour mettre en communication des bavards,
des amoureux. Je me repose. Je suis fatiguée. […] Je suis
une philosophe. […] Ah ! si l’on ne parlait jamais, que
de malheurs on éviterait".
Mais le mal est plus grand aujourd’hui qu’il y a ces fameux
téléphones, grâce auxquels on n’a même
plus la peine de se déranger pour converser avec les gens.
Un monsieur, bien tranquille dans son bureau, s’évite
cent visites. Il lui faudrait un grand mois pour aller chez Pierre
et Paul, dire du mal de son prochain, combiner des affaires louches,
préparer de mauvais coups. En une heure, il fait tout cela
; heureusement que nous sommes là, pour mettre bon ordre à
un tas d’abus.
"Dring ! Dring ! Vous êtes bien pressé, Monsieur.
Les gens honnêtes ne sont jamais si hâtés. Je ne
parle pas en étourdie, qui ne sait pas ce qu’elle dit.
J’écoute, allez, toutes les conversations et j’en
apprends de belles (30).
27 Par exemple « La Demoiselle du téléphone
» de Dominus, repris dans Les Refrains de la Butte, Paris, Plessis,
1904.
28 Voir Pradels, La Garde, Ducasse-Harispe, Deroyre, Mouëzy-Éon,
Dorrez.
29 Antony Mars et Maurice Desvallières, La Demoiselle du téléphone,
1891
30 E. Roche, La Demoiselle du téléphone, s.d. [v.
1930]
Le téléphone peut donc être « récupéré
» pour rajeunir des situations stéréotypées
; mais il peut aussi – comme certains titres invitent à
le penser offrir des situations inusitées dont la mise en scène
devient la finalité même de la pièce.
Dramaturgie téléphonique
On comprend que l’intérêt premier du téléphone
est de permettre le renouvellement d’un certain nombre de procédés
comiques traditionnels, en particulier les scènes de quiproquo
qui trouvent ainsi des justifications inédites : la mauvaise
qualité de la conversation dégénère parfois
en un dialogue… de sourds (Mac Nab) ; les erreurs de numérotation
peuvent provoquer des arrestations injustes (chez l’Abbé
Bernard ou La Garde),
ou encore des « rencontres » imprévues (comme cette
jeune femme qu’un inconnu tente de séduire par téléphone
chez Pradels) ; le « défaut d’identité »,
dû au fait qu’on oublie parfois de demander le nom de l’interlocuteur
invisible, conduit à des arrivées inattendues (les deux
amants qui se retrouvent chez Raymond et Burani, ou l’amant qui
téléphone au mari chez Damocède) ou à
des interprétations erronées (chez Legoux, une dame
se croit trompée par son futur époux) ; enfin, l’écoute
à distance permet d’entendre ce que l’on aurait dû
ignorer (Marsan), ou fait dire ce que l’on aurait dû taire
(le héros de Mouëzy-Éon insulte sa future belle-mère,
la femme du personnage de Tournebroche traite son ami de « vieux
pot », Edgar parle au mari en croyant parler à sa maîtresse
chez S. Chebroux, tandis que le mari reçoit les invitations
d’un soupirant chez Maurice de Savoie).
Les insuffisances de la conversation téléphonique donnent
également lieu à d’assez nombreux jeux de mots,
en particulier ceux qui ont trait à l’onomatopée
« allo », déclinée en « à l’eau
» (« c’est un porteur d’eau ? – Non, c’est
l’appel pour voir si ça fonctionne bien »), «
à lot » (« Allo ? — oui, à lot —
Allo ? — Non je ne les ai pas jeté à l’eau.
— Allo ? — oui, à lot, à loterie »),
etc. (31).
Les mécompréhensions sont la source d’un assez
grand nombre de situations comiques, qui restent cependant pour la
plupart, il faut le reconnaître, assez attendues et répétitives.
Il est donc plus intéressant de voir les conséquences
que la présence du téléphone a sur la mise en
scène. Notons d’abord que l’objet lui-même
est souvent le seul élément de décor mentionné
; Damocède précise même que « le reste est
facultatif » et certains auteurs vont jusqu’à envisager
des aménagements spéciaux : Louis de La Garde, par exemple,
propose un trucage recourant à une voix extérieure,
Jules Legoux explique comment construire un faux téléphone.
Surtout, la présence de l’objet commande certains gestes
et attitudes que les auteurs le plus souvent précisent en didascalies
: tourner la manivelle, appuyer sur un bouton, se saisir de l’appareil
qui symbolise le lien avec l’interlocuteur (on a vu que, chez
André Pascal, il devient le substitut du corps de l’amant,
idée que Cocteau utilisera également dans La Voix humaine
(32) ou au contraire le rejeter (comme chez Pradels ou Ducasse-Harispe).
De fait, l’intérêt majeur de l’objet est sans
doute le jeu qu’il permet dans le rapport du présent (sur
scène) à l’absent (hors scène – donc
a priori hors pièce…). Certains auteurs recourent aux
changements de lieux : chez de Lorde et Foley ou chez Marsan, le personnage
masculin quitte sa famille au premier acte, et le second le montre
téléphonant chez lui depuis une autre demeure ; ce déplacement,
en impliquant un changement d’acte qui permet le changement de
décor, crée un effet de suspens ; mais il utilise aussi
une qualité particulière du téléphone,
celle de « présentifier » l’absent, pour rassurer
:
Téléphonez, ça nous fera de la distraction […]
D’entendre sa voix au bout du fil là… ça sera
un peu… comme s’il était au milieu de nous ! […]
Ah ! cet instrument, c’est une belle invention tout de même…
V’là Monsieur à plusieurs lieues… et il va
nous causer comme s’il était près de nous, dans
cette chambre ! […] Bien sûr quand j’entendrai sa
voix, ça me calmera… je n’aurai plus peur… c’est
déjà comme si Monsieur était là. (33)
Cette situation paradoxale au théâtre, où rien
n’existe en dehors de la scène, est particulièrement
efficace lorsqu’il s’agit, comme dans les deux pièces
que nous venons de citer, de faire entendre sans les voir un assassinat
ou un adultère : le caractère dramatique (même
dans une situation a priori comique, comme chez Marsan) est bien sûr
augmenté de ce que le spectateur, relayé par celui qui
téléphone, se voit obligé d’imaginer la
situation.
31 Raymond et Burani, op. cit., p. 6-7 ; Deroyre, op. cit., 1910,
p. 7. Voir aussi Legoux, op. cit., p. 9 [« Allons, allons (Prononcer
alô, alô.) Drôle d’entrée en conversation
! »] ; Zamacoïs, op. cit., 1903, sc. 1 ; ou encore Deroyre
ou Dorrez, chez qui les dialogues sont parsemés de jeux de
mots dus à la mauvaise qualité de la communication.
À noter qu’« Allo » est assez fréquemment
utilisé comme titre, même lorsqu’il n’est pas
question de téléphone, comme dans la « revue féerique
» de Gorsse et Nanteuil, Allo !… de Vichy !… (1906).
32 Cocteau énumère les différentes attitudes
du personnage dans la note liminaire intitulée « Décor
» et les utilise pour ponctuer les différentes phases
de la pièce (op. cit., p. 1095-1096).
33 André de Lorde et Charles Foley, op. cit., p. 25.
Le téléphone autorise donc un dédoublement tout
à fait intéressant au théâtre entre le
fait et le dit. Certains personnages, qui ne prennent pas conscience
de la distance (puisque, jusqu’alors, la voix impliquait la présence
(34), se conduisent comme si leur interlocuteur leur faisait face.
Ceci donne bien sûr lieu à de nouveaux effets comiques
: une jeune femme qui s’agenouille pour implorer la téléphoniste
de lui passer le numéro qu’elle demande chez Pradels,
un rond-de-cuir ridicule qui se met au garde-à-vous lorsqu’il
croit parler au ministre chez Deroyre, un mari en colère qui
frappe l’appareil à défaut de l’amant, chez
Savoie, ou encore, chez Marsan, un mari qui s’énerve contre
sa femme qu’il entend le tromper parce que
le téléphone a été mal raccroché
:
Ah ! c’est comme ça ! (Il crie sur la plaque) Eh bien
je vais vous faire voir si je suis parti !… Adèle ! je
te défends… tu entends… Je suis là… je
suis là… Et vous… sortez… si vous ne voulez
pas que je vous flanque par la fenêtre… sortez… Monsieur,
je vous chasse !… […] Ah ! les canailles ! les canailles
!… Il l’embrasse et elle rit… Oh !… (Hurlant)
Nous nous retrouverons Monsieur !… (Atterré) Mais c’est
qu’ils ne m’entendent pas !… Ah ! Ah ! Ah ! Non ! par
exemple je ne veux pas voir ça ! (Il repousse l’appareil
avec dégoût) […] ils sont en train de me faire
cocu…! (35)
On voit que l’usage du téléphone dispose d’une
gestuelle pour exprimer qu’on ne parvient pas à prendre
en compte l’absence (36).
La conversation téléphonique permet ainsi de créer
un lien de complicité avec le spectateur, seul susceptible
d’identifier le décalage entre les paroles et les actes
ou les pensées. Parfois, la présence d’un tiers
sur scène justifie des explications, des commentaires sur la
conversation ; Pascal joue de ce procédé pour créer
des effets de double sens. D’autres, comme Raymond et Burani
ou Zamacoïs, y trouvent un élément de dynamique
pour
l’intrigue : chez ce dernier, le spectateur assiste au parcours
purement verbal d’une femme qui s’invente des occupations
pour cacher à son mari qu’elle lui téléphone
depuis l’appartement de son amant ; là encore, l’extérieur
est convoqué par l’intermédiaire du téléphone,
mais sur un mode comique. La pièce de Cocteau repose en grande
partie sur cette technique, mais dans une visée pathétique
qu’il est un des rares à avoir aperçue et dont
la mise en scène peut jouer de manière assez saisissante
: l’héroïne vue par le spectateur diffère
totalement de l’héroïne telle qu’elle se décrit
à son interlocuteur invisible. Le mensonge que permet la distance
– variante intéressante d’une situation de «
théâtre dans le théâtre » – prend
un caractère dramatique, et Cocteau parvient à des effets
de tension efficaces : jusqu’à quel point sa voix ne la
trahira-t-elle pas ? Jusqu’à quel point parviendra-t-elle
à tenir son mensonge ?
Le téléphone intervient donc différemment de
la plupart des accessoires de théâtre (37) : alors que
l’objet, au théâtre, a souvent pour fonction de
montrer ce que les mots ne peuvent que suggérer (un état
d’esprit, un trait de caractère), le téléphone
au contraire sépare la parole de l’action : c’est
le lieu d’une parole sans corps, tout à fait paradoxale
sur scène. Or le théâtre se saisit de cette fragmentation
: le téléphone, plus que tout autre objet, fait apparaître
le hors-scène et donne au spectateur, en créant un effet
de contraste, le plaisir d’un savoir partagé avec le personnage
: voilà bien un fonctionnement intéressant de l’énonciation
théâtrale.
34 L’une des critiques principales que recevra le téléphone
tient à ce pouvoir de désincarnation de la voix. Voir
à ce sujet les commentaires de Laurence Dahan-Gaida sur une
lettre de Kafka à Milena en mars 1922, où celui-ci considère
le téléphone comme ce qui contribue à éliminer
« le fantomatique entre les hommes » (cité dans
Laurence Dahan-Gaida, « La Science et ses œuvres : de la
créature artificielle à la création littéraire
», L’Homme artificiel, Paris, Ellipses, 1999, p. 128-129).
35 Marsan, op. cit., p. 10.
36 On sait d’ailleurs que la contemplation d’une personne
enfermée à parler dans une cabine téléphonique
sera pour Camus l’un des exemples de l’absurde (Le Mythe
de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942, cité dans Paris, Gallimard,
coll. « Idées », 1979, p. 29).
37 Voir par exemple le « classement textuel de l’objet
» (utilitaire / référentiel / symbolique) que
propose Anne Ubersfeld dans Lire le théâtre, Paris, Éditions
sociales, 1977, rééd. 1982, p. 180.
Écriture dramatique
Si le recours au téléphone s’avère un support
très riche de la mise en scène, il impose également,
du fait même de ces conditions d’énonciation particulières,
des contraintes à l’écriture dramatique (38). Celles-ci
sont, pour la plupart, liées à ce paradoxe de la «
figure absente ».
Cocteau explique, dans sa préface à La Voix humaine,
que la pièce est née de sa fascination pour «
la singularité grave des timbres, l’éternité
des silences » et le « désaccord de rythme »
entre les personnes (39). Il l’entendait, il est vrai, d’un
point de vue psychologique ; mais de fait, la conversation téléphonique
répond à un rythme propre – une fois encore paradoxal
au théâtre, puisqu’il est constitué de blancs.
Le rythme, pour un abonné du début du siècle,
est d’abord fait d’interruptions : brouillages, parasites,
tierce personne, conversations parallèles, déconnexion
impromptue, intervention soudaine des standardistes viennent en permanence
gêner le flux de parole, la continuité du dialogue ;
il y a, pour ainsi dire, deux paroles qui alternent, avec leur sujet,
leur ton, leur rythme même, propres. Les auteurs de ce corpus
ont presque tous été sensibles à cette situation
dont l’intérêt est multiple : outre les scènes
qu’elle permet (quiproquos, colères), elle peut créer
des effets de retardement comiques, voire de suspens dramatiques ou
pathétiques ; Cocteau fait ainsi de ces pauses nécessaires
le marqueur des différentes phases
du dialogue.
Plusieurs auteurs tentent même d’intégrer ces silences
à la dramaturgie, utilisant le téléphone comme
une variante intéressante du monologue (40). Certains signalent
le problème :
« Pendant le dialogue au téléphone, les artistes
devront faire attention de laisser entre chaque phrase le temps matériel
de la réponse », « le trait indique l’intervalle
pendant lequel est censée se faire la réponse »
(41). Apparaît alors un discours troué, haché,
peu conforme au langage dramatique, même s’il ne s’écarte
pas d’un des plus vieux ressorts du comique (le principe de la
communication perturbée) et proche du monologue, bien que ce
soit un dialogue (de ce fait d’ailleurs plus « vraisemblable
»),. Cocteau, dont la pièce se construit sur le renversement
du mensonge à l’aveu, a cependant fait de cette qualité
particulière de la conversation téléphonique
la dynamique dramatique de son texte : parce qu’elle efface le
corps, la conversation téléphonique permet aussi de
libérer une parole intime (42).
Se pose alors le problème de faire entendre la voix de l’autre,
de l’absent. Les solutions les plus diverses ont été
adoptées, qui jouent à la fois de l’effet rythmique
et de la mise en scène. De Lorde et Foley se bornent à
l’évoquer :
Crois-tu que ce soit admirable : tu es près de moi… je
sens les moindres inflexions de ta voix… de tes gestes…
je te vois presque… oui je te vois…(43)
38 Pierre Larthomas suggère dans son étude sur Le
Langage dramatique qu’il pourrait être intéressant
d’analyser la nature des rapports entre les accessoires et les
éléments verbaux (II, 3, « Le Décor »,
Paris, Colin, 1972). Il me semble qu’on a ici un assez bon exemple
de cette influence de l’objet sur l’écriture.
39 Jean Cocteau, op. cit., p. 1093 et 1090.
40 Plus d’un tiers des textes proposés sont d’ailleurs
des monologues (comme il était de mode à l’époque,
où pullulent les recueils de « monologues » ou
de « scènes » pour jeunes filles, pour hommes,
pour enfants, etc.).
41 Marsan, op. cit., deuxième tableau ; Deroyre, op. cit.,
p. 5 ; voir aussi Ducasse-Harispe ou Raymond et Burani.
42 Nul doute que la communication par écran imprimé,
en supprimant la voix, ne l’ait encore un peu plus libérée.
Mais la possibilité de disposer d’écrans qui permettent
de visualiser l’interlocuteur (web-cam ou autres), en faisant
disparaître l’ambiguïté, risque fort de faire
perdre également cette dimension du secret, que le téléphone
partage avec la lettre, mais à laquelle il ajoute l’immédiateté
d’une parole non contrôlée.
43 De Lorde et Foley, op. cit., p. 30.
Plusieurs auteurs en revanche jouent sur une alternance, le discours
du personnage en scène s’interrompant pour répéter
(Raymond et Burani, Hennequin) ou commenter (Damocède, Marsan),
assurant parfois les questions et les réponses (Pascal). Ces
lignes de Jules Legoux jouent de tous les cas de figure avec originalité
:
Mademoiselle Andrée, la première de Mademoiselle Clémence…
C’est bien vous, mademoiselle ?
Oui, sans doute
Je vous ai attendue, comme c’était convenu, à sept
heures
Elle a été très occupée d’une capeline
pour Madame de Hautefeuille [c’est elle-même]. Impossible
d’aller dîner chez Ledoyen comme elle l’avait promis…
mon chéri !
Son chéri ?…
Comment ! Que je ne prenne pas une petite voix de femme pour causer
? Il n’y a personne auprès d’elle : elle est seule…
Qu’est-ce que cela me fait à moi qu’elle soit seule
?
Je ne contrefais pas ma voix, mademoiselle. Je suis Madame de Hautefeuille,
et j’attends mon chapeau.
Tous ses regrets ; elle ne savait pas… Je l’aurai ici dans
un quart d’heure (44).
Si le caractère oral du passage est artificiel, la tentative
d’une transcription alternée, tant visuellement (gras
pour l’interlocution, italiques pour les propos rapportés),
que grammaticalement (le recours au discours indirect libre, l’alternance
des pronoms) atteste la réflexion sur les modalités
d’une transcription de ce nouveau type de « monologue-dialogue
» (45).
Une autre solution consiste à suspendre le dialogue, en fournissant
dans les seules paroles du personnage en scène des éléments
permettant de comprendre le déroulement de la conversation.
C’est ce que feront, par exemple, Hennequin ou Pradels. Sur scène,
cette condition de communication présente en outre l’avantage
d’entraîner le spectateur, en l’obligeant à
faire un effort de reconstitution. Ceci explique sans doute que la
plupart de ces pièces soient très courtes : combien
de temps peut-on tenir l’attention d’un spectateur qui n’assiste
qu’à la moitié d’une conversation ? Mais Cocteau
a poussé le procédé jusqu’à son extrême
: le nombre de réponses en « oui / non » est tel
que le spectateur n’est souvent pas en état de reconstruire
le dialogue ; la parole a alors essentiellement pour fonction de faire
sentir l’état de l’héroïne.
Ce travail est parfois redoublé par l’établissement
d’un code graphique : le recours à une composition sur
deux colonnes chez Mac Nab, l’usage très étendu
des points de suspension qui criblent le dialogue et parasitent, par
exemple, le texte de Cocteau, voire le recours à des traits
de différentes longueurs pour indiquer « l’intervalle
pendant lequel est censée se faire la réponse »
(46), ou même le jeu d’une alternance graphique, comme
nous venons de le voir chez Legoux, donnent à lire un texte
démembré qui, à sa manière, n’est
pas loin des recherches que mène l’époque sur les
jeux de langage et la mise en page. De fait, ce dernier aspect n’est
pas sans intérêt, car il manifeste la volonté
de donner à « voir » la voix – ce qui rejoint,
par des chemins certes détournés, une préoccupation
essentielle de la poésie et
du théâtre expérimentaux de l’époque.
Même dans un genre aussi codé que le vaudeville ou le
mélodrame, la présence du téléphone permet,
ou peut-être plutôt impose des recherches formelles et
un renouvellement :
Ce serait une faute de croire, explique Cocteau à propos de
La Voix humaine, que l’auteur cherche la solution de quelque
problème psychologique. Il ne s’agit que de résoudre
des problèmes d’ordre théâtral. (47)
44 Legoux, op. cit., p. 9.
45 Cocteau, op. cit., p. 1096.
46 Deroyre, op. cit., p. 5.
47 Cocteau, op. cit., p. 1094.
En attestent, en quelque sorte, les « sous-genres » que
proposent certains auteurs : « comédie-opérette
», « fantaisie parodique », « bouffonnerie
», « saynète », ou encore « Conversation
téléphono-comique, sans fil, à un seul personnage
», « Comédie en trois actes et quatre coups de
téléphone » : il y a bien là une veine
qui cherche à se distinguer de la comédie de boulevard
traditionnelle. Ceci illustre bien, je crois, l’idée que
l’objet technique introduit en littérature (en art), a
des conséquences d’ordre esthétique : il conditionne
aussi des formes d’écriture, même si parfois, comme
ici, il en fait disparaître d’autres. Ainsi, le téléphone
a peut-être tué la lettre, mais il a amené le
théâtre à réfléchir sur lui-même.
Une question reste cependant ouverte dans l’état actuel
de mes lectures. Il me semble que le théâtre d’avant-garde
a peu utilisé le téléphone qui semblait pourtant
lui offrir tant de pistes proches de ses propres préoccupations
(désincarner la voix et les espaces sont des tentatives récurrentes
du théâtre expérimental des années 1910
/ 1920, sous l’influence, entre autres, de Jarry) ; peut-être
est-ce, justement, parce que ces mêmes expérimentations
l’avaient conduit à élaborer d’autres procédés,
qui pouvaient se passer d’un objet aussi pesamment « réaliste
» que le téléphone ? Mais ce dernier paragraphe
ne vaut que jusqu’à preuve du contraire.
Cette communication a été présentée lors
du festival La Voix au téléphone organisé
par l’I.N.S.A.-Lyon les 22-26 mai 2000.
Annexe : Titrologie
Lorsque la date est différente de celle de la première
édition, elle correspond à la date de la première
représentation ; la date entre crochets est celle du dépôt
légal. Quand le lieu d’édition n’est pas mentionné,
il s’agit de Paris.
1882 Hippolyte Raymond et Paul Burani [Paul Roucoux, dit],
Le Téléphone, vaudeville en un acte (Tresse, 1883)
1883 Jules Legoux, Par téléphone, saynète
(Ollendorff, 1883)
1886 • Pierre Valdagne, Allô ! Allô !, comédie
en un acte (Ollendorff, 1886) • Mac Nab, « Duo téléphonique
», Poèmes mobiles (Léon Vanier, 1886, repris
dans Le Cri Cri, n° 72, 1890 : numéro spécial pour
le décès de Mac Nab)
1888 • Maurice Hennequin, Un mariage au téléphone,
comédie en un acte (Libraire théâtrale, 1888)
• Maurice de Savoie, Le Téléphone [monologue] (in
Le Cri Cri, n° 14, 1888)
1891 Antony Mars et Maurice Desvallières, La Demoiselle
du téléphone, comédie-opérette en 3 actes,
musique de G. Serpette (Librairie théâtrale,1891)
1893 Louis de la Garde, Un mariage par téléphone, comédie
(Delhomme et Briguet, 1895)
1897 • M. Tournebroche, Le Téléphone, monologue
(F. Laclau aîné, 1897) • Abbé E. Bernard,
« Le Coup de téléphone », Scènes
comiques pour jeunes gens et pour enfants (Au petit séminaire
de Notre Dame de Sainte Garde à Saint Didier (Vaucluse), 1897)
1898 A. Damocède, Le Téléphone en amour,
vaudeville en un acte (Albert Clément, s.d. [1898])
1901 André de Lorde et Charles Foley, Au téléphone…,
pièce en deux actes (Librairie Molière, s.d. [1902])
1902 • Maurice de Marsan, Par téléphone,
fantaisie parodique en un acte et 2 tableaux (Joubert, s.d. [1902])
• Jehan d’Agno, Le Gendarme par téléphone,
bouffonnerie en un acte (J. Bricon et A. Lesot,1902), d’après
Charles Normand, « Un Gendarme au téléphone, Six
nouvelles (A. Colin, 1891)
1903 Miguel Zamacoïs, Au Bout du fil, comédie en
un acte (Librairie théâtrale, Éd. Billaudot, s.d.
[1904], 6e rééd. 1954,
1904 • Bertol-Graivil et Marc Sonal [Georges Lanos, dit],
Le Coup de téléphone, pièce en un acte et deux
tableaux (P. –V. Stock, 1904) • Suzanne Chebroux, Allo,
c’est moi, Edgar !…, monologue pour homme (Stock, 1904)
1905 Octaves Pradels, « Les Gaietés du téléphone
», Monologues pour jeunes femmes et jeunes filles (M. Labbé,
s.d. [1908])
1906 H. de Gorsse et G. Nanteuil, Allo !… de Vichy !…,
revue féérique en deux actes et dix tableaux (Vichy,
imp. C. Bougarel, 1906)
1908 Paul Deroyre, Décoré par téléphone,
conversation téléphono-comique, sans fil, à un
seul personnage (Bricon et Lesot, 1908, rééd. 1910
1909 E. du Tesch, Par téléphone, monologue en
vers (Schaub-Barbré, 1909)
1920 Miguel Zamacoïs, Deux femmes et un téléphone,
comédie en un acte (Librairie théâtrale, artistique
et littéraire, 1920)
1925 André Pascal [Henri de Rotschild, dit], Tout s’arrange,
comédie en 3 actes et 4 coups de téléphone (s.l.,
s.é., s.d. [Paris, Daunou, 1925])
1928 A. Ducasse-Harispe, « Le Téléphone
! mon cauchemar… », Les Petits Défauts… des
autres, six monologues, IV (Niort, H. Boulord, s.d. [1928]
1930? Paul Croiset, Arthur au téléphone, saynète
(Lesot, 1931, 6e éd.)
1931 Guy Dorrez, Les Surprises du téléphone,
monologue pour homme (Niort, Boulord, s.d. [1931]
1933 J. O. Mercier, « Allô ! Allô ! père
Noël », comédie en un acte, Saynètes et scènes
comiques à l’usage des écoles et pensionnats, n°
6, (Paris, imp.-libr. Larousse,1933)
1935 Henri Farémont, La Farce du téléphone,
comédie en un acte pour enfant [pour quatre garçons
ou quatre filles] (Paris, C. Vaubaillon, 1935, rééd.
1948)
1936 Jacques Cossin, Allo Blima… ici 283 [pièce
radiophonique ?] (Librairie de théâtre J. L. Lejeune,
1937)
1942 André Mouëzy-Éon, « Les Joies
du téléphone », Cinq pièces gaies en un
acte et un monologue (Éd. Musicales, s.d. [1942])
v1930 E. Roche, La Demoiselle du téléphone, monologue
pour demoiselle (G. Rigolet, s.d.)

Sommaire
La Voix au téléphone organisé
par l’I.N.S.A.
Drames téléphoniques, corps fantasmés
(Ariane Martinez)
La dissociation de la voix et du corps est l’un
des traits marquants de la crise du drame, et de l’avènement
de la mise en scène à la fin du XIXe siècle (1).
Cette non-convergence de l’action et du discours peut, bien entendu,
renvoyer à des causes extra-théâtrales diverses.
Causes sociales, notamment : le théâtre du XXe siècle
est truffé de personnages muets, ou quasi-muets, qui par leur
présence scénique dénoncent le statut d’infériorité
qui leur est fait. Causes psychanalytiques, bien entendu : les textes
dramatiques témoignent aussi du fait que notre langage peut
échapper à notre maîtrise physique (lapsus, contradictions,
dénégations), mais aussi que notre corps trahit parfois
la parole donnée (actes manqués). Causes technologiques,
enfin, puisqu’avec l’invention du cinématographe,
du phonographe, du téléphone (2), corps et voix apparaissent
comme des éléments potentiellement séparables
l’un de l’autre.
Machine au départ conçue comme
extraordinaire, avant de faire partie de nos vies ordinaires, le téléphone
s’avère être l’un des objets récurrents
des écritures théâtrales de 1900 à 2000.
Or, ce phénomène ne se contente pas, me semble-t-il,
de refléter les usages sociaux qu’on peut faire des appareils
modernes. Si les auteurs dramatiques s’emparent du téléphone,
c’est parce que ce moyen très simple leur permet, non
seulement de dissocier la voix du corps, mais aussi de séparer
le locuteur et l’interlocuteur, et de court-circuiter, en quelque
sorte, la double énonciation théâtrale, en faisant
du spectateur le premier destinataire de la parole prononcée
en scène.
Comme l’indique la bibliographie insérée
à la fin de cet article, le corpus choisi couvre tout le spectre
de la période, allant de 1901 à 2000. Il traverse en
outre des genres et des courants variés, des prémisses
du Grand-Guignol (Foley et Lorde) au vaudeville (Bertol-Graivil et
Sonal), du boulevard (Guitry) au drame psychologique (Cocteau), du
théâtre de l’absurde (Ionesco) au théâtre
du quotidien (Vinaver). Parfois, le téléphone s’affiche
comme medium unique des répliques : c’est le cas dans
La Voix humaine de Cocteau, dans Le Téléphone de Worms
ou dans Roaming monde de Danan. Mais le plus souvent, il apparaît
de manière ponctuelle, dans une scène de la pièce.
Si j’ai sélectionné ces textes, et pas d’autres,
car il y en de nombreux autres (3), c’est parce que le téléphone
joue ici le rôle de révélateur de certaines mutations
dramatiques qui s’affirment tout le long du siècle : la
perte des repères spatiaux, le brouillage énonciatif
croissant, et le développement d’un théâtre
mental où les actes se fantasment, plus qu’ils ne s’accomplissent
sur scène.
Corps délocalisés – « Tu sais d’où
j’appelle ? » (Danan, p. 32) (4)
L’une des spécificités du
médium téléphonique, largement exploitée
dans nos pièces, repose sur le fait que les protagonistes partagent
le même temps, mais pas le même espace. Diverses configurations
mettent ainsi en jeu la question de l’absence-présence
: les situations dramatiques et les dialogues varient selon les textes.
Dans sept pièces sur les dix étudiées,
le locuteur parle à un interlocuteur situé hors-scène,
dont le public n’entend jamais les réponses. Aussi le
téléphone induit-il un « pseudo-dialogue »
( )5 avec l’absent, un « quasi-monologue », selon
l’expression d’Anne Ubersfeld (6). Le discours du protagoniste
marque des poses, laisse entendre des temps d’écoute,
puis reprend son cours. Souvent, le spectateur comprend ce qui se
dit au bout du fil grâce au phénomène de l’écholalie
: le personnage reprend telles quelles les paroles de son interlocuteur.
Ce système d’échos a plusieurs fonctions. D’abord,
il donne une tournure orale et réaliste à l’échange
téléphonique. Ensuite, il permet au spectateur de suivre
le déroulement de la conversation, tout en en devinant certains
éléments. Enfin, il souligne que le théâtre
est écoute, autant que prise de parole. Et c’est dans
cette écoute du locuteur, seul en scène, que se mesure
l’écart qui s’est creusé entre les êtres.
Dans L’Homme aux valises, une femme téléphone à
sa fille et s’étonne que cette dernière ait changé
de mari durant son hospitalisation : « Ce n’est pas possible,
quand je suis entrée en clinique, c’était le même
[le même mari]. Il y a six mois, tu dis ? [écholalie]
Mon Dieu, comme le temps est relatif ! » (Ionesco, p. 1244).
Le vrai-faux monologue domine donc dans nos pièces. Il n’est
cependant pas le seul cas de figure possible.
Plus rarement, le dialogue apparaît. Chez
Danan, par exemple, on entend la « voix » de l’interlocuteur,
malgré son absence physique de la scène. Il arrive aussi
que les deux personnages soient présents sur le plateau. C’est
le cas dans la pièce de Worms, où le quatrième
mur avec le spectateur se double d’un autre mur immatériel,
mur fictionnel, représenté par l’ombre qui sépare
l’homme et la femme, chacun placé sous un faisceau de
lumière, à « un bout de la scène »
(Worms, p. 7).
Enfin, cas particulier lié à l’usage
du répondeur, chez Crimp, et parfois chez Danan, on entend
seulement des voix. Rien ne nous est précisé sur la
présence, ou non, d’un corps (auditeur ou locuteur) sur
la scène durant l’écoute, par le public, de ces
messages laissés sur un répondeur.
Dans ces décalages entre corps et voix, ce
qui ressort, c’est l’intimité paradoxale que génère
le téléphone, « ce plaisir spécial et cruel,
cette impression étrange d’être loin de toi et de
pouvoir pourtant te parler à l’oreille » (Guitry,
p. 37). Les femmes des Travaux et les jours, employées dans
un service après-vente par téléphone, confirment
cette idée : si les clientes les appellent, « ce n’est
pas tellement pour la réclamation », mais pour «
un sourire au bout du fil un petit coin chaud quelqu’un qui les
écoute qui les comprend » (Vinaver, p. 80-81). Cette
proximité vocale dans la distance physique, ce partage du temps
en dépit d’une séparation spatiale, reflètent
bien entendu le dispositif théâtral, tout en le déplaçant
légèrement. On n’est plus dans « l’ici
et maintenant », mais bien dans un « là-bas et
maintenant », là-bas sur le plateau, là-bas dans
la fiction, mais aussi là-bas, hors-scène, où
l’interlocuteur se parle plus qu’il ne se représente.
Ce « là-bas » devient d’ailleurs
de plus en plus morcelé et indéfini, à mesure
que le siècle avance. En effet, si on lit les pièces
dans l’ordre chronologique, on notera que les repères
spatiaux, clairement posés dans les années 1900, tendent
à se multiplier de nos jours, accompagnant en cela le mouvement
de globalisation des échanges. Les personnages de Roaming monde
parcourent la planète. Leurs messages de voyages d’affaires
et de visites touristiques, témoignent d’une humanité
conquérante et insatiable, aux points de chute divers : San
Francisco, Angkor, Londres, Rome (Danan, p. 24-25). Chez Crimp, la
mondialisation s’avère moins heureuse, et le déplacement
se teinte d’une inquiétude et d’une perte des repères.
L’un des personnages qui appelle Anne, ne sait même plus
où il se trouve, perdu qu’il est dans un aéroport,
« non-lieu » de la surmodernité (7) : « Anne
(pause) C’est moi. (pause) J’appelle de Vienne. (pause).
Non, pardon, j’appelle de… Prague. (pause) C’est ça,
Prague. (pause) Je suis à peu près sûr que c’est
Prague » (Crimp, p. 125).
Aux multiples espaces convoqués par la parole
s’adjoint, dans plusieurs textes, une tricherie sur le lieu.
Le personnage n’est pas où il prétend être.
Déjà, dans La Voix humaine, la femme s’aperçoit,
en rappelant son interlocuteur, que son ancien amant ne l’a pas
appelée de chez lui, comme il le prétendait, mais probablement
de chez sa maîtresse (Cocteau, p. 458). À l’ère
du téléphone portable, on assiste à une situation
similaire, mais inversée, dans Roaming monde : « Lui
» appelle « Elle », qui prétend être
dans un magasin de chaussures, déclaration démentie
par la didascalie initiale de la scène :
Elle est avec un amant.
ELLE : Ah, c’est toi.
VOIX DE LUI : Je te dérange ?
ELLE : Non, mais je ne pourrai pas te parler longtemps. Je suis dans
un magasin. De chaussures. Tu entends ?
VOIX DE LUI : Qu’est-ce qu’il y a à entendre ?
ELLE : Les chaussures. Tu es où ?
VOIX DE LUI : Chez moi.
ELLE : Toujours sédentaire. (Danan, p. 19)
Au-delà même de la question du lieu,
une distance s’impose entre les corps des personnages et les
discours qu’ils tiennent sur eux-mêmes. On constate un
écart fréquent entre réplique et didascalie :
la femme de La Voix humaine prétend n’avoir pas retrouvé
les gants de son ancien amant, alors qu’elle les « embrasse
passionnément » et les tient collés contre sa
joue (Cocteau, p. 455). On pourrait multiplier les exemples à
l’envi :
LA FEMME : Je suis sûre que vous êtes
à votre table, un verre à la main, fumant votre pipe
!
L’HOMME : (retirant brusquement sa pipe de sa bouche. Légère
hésitation) Je ne fume pas.
LA FEMME : Puritain, par surcroît ! J’aurais dû m’en
douter. (Worms, p. 12)
Ce démenti de la parole par le geste, fait
que, à la différence de la pièce radiophonique,
le drame téléphonique réclame souvent une scène
physique, où le spectateur puisse voir la contradiction entre
ce qui se dit et ce qui se fait. Ceci n’empêche pas que
certaines de ces pièces, et notamment La Voix humaine, aient
donné lieu à des enregistrements sonores célèbres
(8). Pourtant, ils ne pouvaient restituer cette dimension essentielle
des textes : la mise en doute des discours par le jeu des corps. Cocteau
affirmait d’ailleurs, au sujet de La Voix humaine, qu’il
avait écrit cette pièce, non dans « la langue
» (en auteur), mais bien « dans la voix », c’est-à-dire
en acteur. Et de préciser : « Elle ne pouvait être
écrite que par un acteur, par un homme rompu au métier
des planches. […] J’ai fait la pièce en la jouant
et lorsque je la lis, je la monte, j’en indique la mise en scène
méticuleuse » (9).
Identités indécises – « C’est toi
? »« C’est moi »
La présence d’un corps en scène
n’empêche pourtant pas un certain trouble quant à
l’identification des protagonistes. À cet égard,
la récurrence de la question « C’est toi ? »,
ou de l’affirmation « c’est moi » dans les pièces
étudiées, est trompeuse. En effet, elle laisse supposer
que l’identité du personnage est toute entière
contenue dans sa voix, si bien qu’il n’a pas besoin de la
décliner. Le code phatique du « allô » est
« collectif et pourtant il particularise chaque voix »
(10), indique justement Olivier Leplâtre. C’est le cas,
notamment, dans les échanges amoureux de nos pièces.
Chez Guitry, « Lui » entame son appel par un « Allô,
c’est vous, chérie ? – Oui, c’est moi »
(Guitry, p. 35). Chez Cocteau, la femme s’inquiète de
l’identité de son interlocuteur, en répétant
de manière compulsive la question « Allô ! C’est
toi ?.............................. c’est toi ? » sans
jamais prononcer le prénom de l’homme en question (Cocteau,
p. 452). Cet emprunt à nos usages sociaux quotidiens –
il nous arrive à tous de dire « c’est moi »
au téléphone sans décliner notre identité
– a aussi un effet dramaturgique : elle vient souligner l’anonymat
du personnage, et le fait tendre vers la figure (11).
En effet, dans de nombreuses pièces,
les protagonistes n’ont pas de nom : ils s’appellent «
Elle » et « Lui », comme chez Danan ou Guitry ;
ou bien « La femme » et/ou « L’homme »,
chez Cocteau, Worms, ou Ionesco. Par ce procédé, la
voix prend une portée universelle, ce que confirme Cocteau
dans sa préface : « Il fallait peindre une femme assise,
pas une certaine femme, une femme intelligente ou bête, mais
une femme anonyme » (Cocteau, p. 447). Danan trouve dans ce
flottement identitaire matière à plaisanterie : «
VOIX D’ELLE : C’est toi ? / LUI : On dirait, oui »
(Danan, p. 13-14). Cette réponse teintée de doute renvoie
bien entendu à la situation de « Lui », réveillé
au milieu de la nuit, et qui peine à retrouver ses esprits,
mais elle est aussi une allusion à la convention fictionnelle
: « on dirait » que l’acteur est ce personnage-là.
Chez Worms, l’identité se masque volontairement. L’homme
refuse de se présenter, et préfère répondre
à une question par une insinuation :
Elle se jette sur l’annuaire […] et
cherche un numéro, qu’elle forme. […]
LA FEMME : (angoissée) Allô…
L’HOMME : (décroche, très calme, lénifiant
même) Oui
LA FEMME : Allô…
L’HOMME : Je suis là.
LA FEMME : Qui êtes-vous ?
L’HOMME : Vous le savez, puisque vous m’avez appelé.
LA FEMME : C’est vous qui m’avez appelée…
L’HOMME : Si vous voulez. (Worms, p. 8)
Même quand les protagonistes ont un nom attribué,
le fait qu’ils passent par le medium du téléphone
tend à donner un caractère impersonnel à leurs
voix. Lors d’une grève de la société Cosson,
Yvette et Nicole répètent ce que « la direction
», instance d’autorité sans représentant
nommé, leur a dicté : « NICOLE : Cosson Après-Vente
à votre service quelque retard c’était inévitable
mais la direction soucieuse du désagrément souffert
par la clientèle a pris les mesures nécessaires ».
Ici, l’impersonnel dit la contrainte sociale. Il reflète
« ce qu’on nous fait dire », comme le formule justement
Yvette (Vinaver, p. 64-67).
Si les personnages en scène affichent un déficit
d’identité, on notera que leurs interlocuteurs hors-scène
ne se contentent pas d’être anonymes. Ils sont incertains.
En effet, lorsque le spectateur assiste à un monologue adressé,
il ne sait jamais bien s’il y a, effectivement, dans la fiction,
une autre personne au bout du fil. Certaines situations dramatiques
le révèlent. Dans L’Homme aux valises, de Ionesco,
plusieurs personnages composent tour à tour le même numéro,
facile à repérer pour le spectateur, puisqu’il
s’agit de la suite : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Or, à
chaque nouvel appel, le destinataire du coup de fil change d’identité
: la femme tombe sur sa fille, l’homme aux valises qui refait
ce numéro entend une voix qui lui déclare « Le
numéro que vous avez composé n’est pas attribué
», puis il renouvelle son appel et parle, enfin, au consul qu’il
espérait joindre (Ionesco, p. 1243-1248). Chez Koltès,
Zucco entre dans une cabine téléphonique « décroche,
fait un numéro, attend », puis il adresse son monologue
au téléphone, et ce n’est qu’au moment où
il a raccroché que la pute commente « Je vous l’avais
dit que c’était un fou. Il parle à un téléphone
qui ne marche pas » (Koltès, p. 49). Ces deux exemples
mettent l’accent sur la dimension factice de la double énonciation,
dénoncée comme un leurre. La variété des
interlocuteurs chez Ionesco, ou l’absence d’interlocuteur
chez Koltès, tend à faire comprendre au spectateur que
c’est à lui que ces discours s’adressent, en premier
lieu. Ces situations reposent sur ce que Franc Schuerwegen nomme «
la logique de la destinerrance » (12). En appelant, «
je ne sais jamais très bien qui j’appelle », et
cette ouverture à des interlocuteurs potentiels est aussi une
interpellation des spectateurs.
Le fait que la conversation téléphonique,
censée être privée, se fasse devant témoin,
est d’ailleurs souligné dans de nombreuses pièces,
par la récurrence du brouillage énonciatif. «
Mais non, madame, raccrochez, nous sommes plusieurs sur la ligne »
s’exclame la femme de La Voix humaine, clin d’œil pathétique
à sa situation de femme trompée, mais aussi à
la présence du public. Et d’ajouter, une fois son amant
retrouvé : « C’était un supplice de t’entendre
à travers tout ce monde » (Cocteau, p. 452). La dernière
séquence de Roaming monde consiste en une conversation entre
« Elle » et « Lui », constamment interrompue
par l’immixion de voix étrangères – qui parlent
en russe, en chinois, en italien, de la quête de l’autre
(Danan, p. 31-35). Le dialogue privé apparaît soudain
comme public.
Corps invoqués – « Je te vois,
tu sais » (Cocteau, p. 456)
Parler à l’autre, au téléphone,
c’est aussi parler de l’autre, l’invoquer, le dessiner,
et de ce fait, susciter l’imagination du spectateur. «
Je te vois, tu sais […] J’ai des yeux à la place
des oreilles » affirme la femme de La Voix humaine (Cocteau,
p. 456-457), avant de décrire, très précisément,
l’attitude supposée de son ancien amant, dont elle prétend
connaître tous les gestes. Le public ne saura jamais si elle
a vu juste. L’homme de la pièce de Worms se fait plus
inquisiteur encore : « Ne mentez pas. Je vous vois » déclare-t-il
à la femme, qui lui a reproché, un peu plus tôt,
d’être « un voyeur par l’oreille » (Worms,
p. 32 et p. 11).
Le drame téléphonique, qui invoque des
corps hors-scène, joue fréquemment sur deux situations
qui ont à voir avec le fantasme : d’une part la séduction,
de l’autre la séparation. Ces deux situations sont d’ailleurs
souvent liées dans nos pièces : on appelle l’autre,
on le rapproche de soi par la voix, on le convoque ou l’invente
dans le langage, puis on raccroche, on le perd. Le téléphone
est un médium orphique, un instrument du deuil. Il a beaucoup
à voir avec le fort und da freudien, ce jeu compulsif de proximité
et d’éloignement qui permet de supporter la séparation.
Cette caractéristique du téléphone, de nombreux
artistes l’ont pointée, en-dehors même de la sphère
théâtrale. Dans Du Côté de Guermantes, le
narrateur commente en ces termes la conversation téléphonique
qu’il a eue avec sa grand-mère : « Présence
réelle que cette voix si proche – dans la séparation
effective ! Mais anticipation aussi d’une séparation éternelle
! » (13). Plus récemment, dans son film No sex last night,
Sophie Calle compose le numéro de son ami, Hervé Guibert,
mort depuis peu, pour faire entendre son annonce de répondeur
au spectateur. La voix enregistrée résiste à
la disparition du corps, tout en mettant en évidence cette
disparition. Les pièces de notre corpus témoignent,
elles aussi, de ce deuil permanent qu’est la relation téléphonique.
Raccrocher, c’est tantôt mourir (Ionesco, p. 1245 ; Cocteau,
p. 452), tantôt tuer l’autre. La femme de Worms le signale
plaisamment à son correspondant : « Ce qu’il y a
de commode avec vous, c’est que vous, pas même besoin de
vous tuer. Je coupe, et pfut ! vous n’existez plus ! Vous n’avez
jamais existé ! » avant de préciser, quelques
pages plus loin : « Si vous croyez que c’est drôle
de parler avec un fantôme » (Worms, p. 23 et 28). Le statut
spectral d’autrui ouvre la voie au fantasme de sa présence.
Il arrive ainsi que le drame téléphonique
conduise au théâtre mental. Dans ces cas précis,
la voix invente des situations ou des corps fictifs, qui n’existent
que par et dans le langage. Le spectateur ne saura jamais si ces situations
sont effectives, et c’est précisément le doute
entre réalité et fantasme qui leur donne leur puissance
dramatique. Je citerai trois exemples de ce phénomène
récurrent dans les textes.
Le premier est tiré du vaudeville de Bertold-Graivil
et Sonal, Le Coup de téléphone. Deux personnages se
trouvent sur scène : Amélie Paimbelle et Dumouron. Dumouron
est alité suite à une mauvaise chute, et Amélie,
pour le distraire, lui lit un roman d’Alphonse Karr, dans lequel
un certain Stéphane, en voyeur, assiste aux ébats de
deux amants. À cette situation représentée sur
scène, s’ajoute un évènement hors-scène
: les époux respectifs d’Amélie et Dumouron, Paimbelle
et Marthe, ont dû partir pour une affaire et sont retenus loin.
Ils viennent de téléphoner à leurs conjoints
pour leur annoncer qu’ils passeront la nuit à l’extérieur.
Or, suite à ce coup de fil, Dumouron n’a pas raccroché
le téléphone. Ce dernier devient outil d’espionnage
ou machine à fantasmes jaloux.
AMÉLIE, lisant : Stéphane parle : «
O mon Dieu, mon Dieu ! Ils sont au lit ; j’entends des baisers,
de longs baisers. Ah ! Elle les rend ; les baisers sont plus fréquents,
plus pressés ; elle les rend ; elle lui rend ses baisers !
»
DUMOURON : Taisez-vous ! Non ? je deviens fou ! Ce n’est pas
possible !... On entend tout ce qui se passe dans la chambre de Marthe…
[…] Écoutez ! Écoutez !
Ils tiennent chacun un récepteur et écoutent.
AMÉLIE : Ah !... Ah… Oui… la gredine ! Elle abuse
de mon mari… Mais criez donc, vous, criez donc… Allô
! allô ! allô ! allô !
DUMOURON : Gueux ! allô ! allô ! gueux ! allô !
gueux ! allô ! allô !
AMÉLIE : Criez plus fort ! Allô ! allô…
DUMOURON : Je ne peux plus… Je suis enroué ! Allô…
AMÉLIE : Les misérables… (Bertol-Graivil et Sonal,
p. 37)
Il est intéressant de noter que les auteurs
du vaudeville proposent à ce dénouement une variante
« moins brutal[e] », affirment-ils, où Marthe et
Paimbelle, censés être fautifs, rentrent à la
maison durant le coup de fil, entendent les ébats téléphoniques,
et constatent, en souriant, qu’il s’agit en fait de ceux
« du jardinier et de la cuisinière » (Bertol-Graivil
et Sonal, p. 39-40). Si elle sauve les conventions matrimoniales et
bourgeoises, cette fin a aussi l’intérêt de souligner
que les sons entendus par Amélie et Dumouron sont potentiellement
trompeurs, et qu’en l’absence de la vue, l’adultère
ne saurait être certain. On notera d’ailleurs que c’est
précisément durant la lecture du roman, par Marthe,
que la situation d’adultère surgit, comme si elle était
une extrapolation de la fiction littéraire, une hallucination.
Le deuxième exemple, tiré de Au téléphone,
de Charles Foleÿ et André Lorde renvoie à un tout
autre registre. Ici, la scène décrite est une scène
de crime, et non une scène érotique. Marex, parti en
voyage d’affaires, assiste, ou croit assister, par téléphone,
à l’assassinat de sa femme Marthe, de son fils Pierre,
et de sa servante Nanette :
MAREX : […] la porte craque… pour la forcer…
c’est impossible : les volets sont solides !… Ah ! Je t’entends
trembler… bébé pleure... – Ne faites plus
de bruit… fais-le taire… Fais-le donc taire… –
mon chéri, tais-toi, je t’en prie, mon cher petit Pierre…
Oui, éteignez la lampe… dis à Nanette… Tout
de suite… ça les éloignera peut-être !…
Je ne sais plus, moi !… ah ! mon Dieu… maintenant…
sous les volets des fenêtres ?... Tu crois ?… Ils sont
plusieurs… Et aussi derrière la porte ? […] Marthe
! Marthe ! C’est toi qui as crié ?... Réponds…
mais réponds…
MADAME RIVOIRE, affolée, à son mari : Il faut prévenir
la police.
RIVOIRE, désespéré : Prévenir ? ça
se passe à soixante-dix kilomètres d’ici !
MAREX, au téléphone : Ah… encore des cris…
Qu’est-ce qu’on leur fait… mais qu’est-ce qu’on
leur fait ?… On les tue… On les égorge… Ah !
Au secours ! À l’assassin ! ah ! ah !... ah ! au secours…
(Foleÿ et Lorde, p. 34)
Le discours de Marex, témoin auditif direct
et commentateur sportif du crime, donne à la scène tout
son suspens et son épouvante. La situation est censée
être d’autant plus horrible qu’elle n’est pas
représentée, mais décrite, et que le spectateur
se voit contraint de l’imaginer. Mais on ne m’ôtera
pas de l’idée que le recours au téléphone
laisse planer un doute sur la réalité des évènements
narrés : « mais qu’est-ce qu’on leur fait ?…
On les tue… On les égorge… » Les questions
de Marex, aussitôt suivies de réponses affirmatives extrêmement
précises, pourraient aussi bien signaler qu’il invente
la scène, en la racontant aux spectateurs internes que sont
Rivoire et sa femme. La pièce s’interrompt d’ailleurs,
sans qu’on sache ce qui s’est réellement passé
à l’autre bout du fil.
Dans Atteintes à sa vie, de Crimp, dernier
exemple plus proche de nous, le locuteur pose clairement son discours
comme fictionnel, en convoquant l’idée d’un scénario
de thriller à la David Lynch, ou de film catastrophe :
Et si tu étais allongée là,
Anne, déjà morte ? Hein ? C’est cela le scénario
que je suis censé imaginer ? Un cadavre en train de pourrir
près du répondeur ? (léger rire. Pause)
Quoi, les larves de mouches qui écoutent tes messages ?
Ou bien ton immeuble détruit.
Ou bien ta ville détruite. […]
Je deviens morbide, Anne.
Je pense que tu devrais décrocher et me faire sourire, me faire
sourire comme autrefois, Anne.
Je sais que tu es là. (Crimp, p. 128)
Bien qu’elle soit retirée aussitôt
après avoir été formulée, cette hypotypose
toute en suppositions, avec ses questions et ses alternatives, résonne
comme une menace ou une prophétie. Elle fait surgir des possibles
de l’action, sans les réaliser sur scène, et les
pose comme des points de départ pour les scénarios suivants
d’Atteintes à sa vie.
Le téléphone fonctionne, dans nos drames,
comme une machine à fictionner. En irréalisant le cadre
spatial de l’action (énoncé plus que montré),
en autorisant les décalages entre le dire et le faire, en impersonnalisant
les propos, il fait émerger des situations et des corps, construits
et fantasmés par et dans la voix. Ce faisant, il invite le
spectateur à mettre en doute la parole des personnages, à
multiplier les hypothèses, et enfin, à s’inventer
des mondes.
Bibliographie
Le corpus est présenté dans l’ordre
chronologique : la date indiquée en début de ligne est
celle de l’écriture de la pièce, ou de la création
du spectacle. Vient ensuite l’édition du texte, pour le
repérage des passages cités dans l’article.
1901 : Foleÿ, Charles et Lorde, André,
Au téléphone, pièce en deux actes, Paris, LibrairieMolière,
1905, troisième édition.
1904 : Bertol-Graivil et Sonal, Marc [Georges Lanos, dit], Le Coup
de téléphone, pièce en un acte et deux tableaux,
Paris, Stock, 1904.
1916 : Guitry, Sacha, Acte II de Faisons un
rêve : une pièce, un dossier, une actualité (1916),
Paris, L’Avant-scène théâtre, 1er septembre
2008, n° 1247.
1930 : Cocteau, Jean, La Voix humaine, dans
Théâtre complet, Paris, Gallimard, 2003, « La Pléiade
».
1975 : Ionesco, Eugène, Scène
XII de L’Homme aux valises, dans Théâtre complet,
édition présentée, établie et annotée
par Emmanuel Jacquart, Paris, Gallimard, 1991.
1979 : Vinaver, Michel, Les Travaux et les jours,
dans Théâtre complet 4, Paris, L’Arche 2002.
1979 : Worms, Jeannine, Le Téléphone,
dans Pièces pendulaires, Paris, L’Avant-Scène théâtre,
Collection des Quatre vents, 2002.
1997 : Crimp, Martin, scénario 1 : «
tous vos messages sont effacés » de Atteintes à
sa vie, traduit de l’anglais par Christophe Pellet avec la collaboration
de Michelle Pellet, dans Le Traitement, Atteintes à sa vie,
Paris, L’Arche, 2002.
2000 : Danan, Joseph, Roaming monde, Vitry-sur-scène,
les éditions de la gare, 2005.
Notes de bas de page
1 On pourrait multiplier les exemples de cette situation
de dissociation. Du côté du texte, je me contenterai
de faire référence au dernier acte de La Mort de Tintagiles,
de Maeterlinck (1894), où l’enfant disparaît derrière
une porte de fer, et où ses appels à l’aide répétés
témoignent de la vie qui est en train de le quitter. Dans ce
cas-ci, la voix subsiste, alors que le corps demeure caché
aux yeux des spectateurs. Du côté de la mise en scène,
on rappellera la découverte de Stanislavski face aux rôles
tchékhoviens, rôles si peu loquaces qu’ils réclament
de l’acteur une existence physique détachée de
la réplique, une vie silencieuse indépendante du rythme
de la parole. Dans ce cas-là, à l’inverse, le corps
maintient sa présence scénique et son activité,
même quand la voix se retire.
2 Lire à ce sujet : Sylvain Briens, Technique
et Littérature : train, téléphone et génie
littéraire suédois ; suivi d’une anthologie de
la poésie suédoise du train et de téléphone,
Paris, L’Harmattan, 2003.
3 Ne serait-ce que dans la période allant de
1880 à 1930 (en léger décalage avec la nôtre),
Isabelle Krzywkowski a répertorié trente-et-une pièces,
dont le titre comprend le terme de « téléphone
», dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de
France, et dans les revues spécialisées. Elle en a proposé
une analyse, dans une communication présentée lors du
festival La Voix au téléphone organisé par l’I.N.S.A.-Lyon
les 22-26 mai 2000.
4 Les références aux pièces du
corpus seront abrégées de la sorte dans tout l’article
: elles comprendront seulement le nom de l’auteur et le numéro
de page de la citation. Pour identifier la référence
complète de l’ouvrage, il suffit de se reporter à
la bibliographie en fin d’article.
5 Expression empruntée à Jean-Pierre
Beaumarchais, « Seuls en scène ou l’art du monologue
», in Sacha Guitry, Faisons un rêve, une pièce,
un dossier, une actualité, L’Avant-scène théâtre,
1er septembre 2008, p. 84.
6 « Nous appellerons quasi-monologue une forme
particulière de soliloque, celle qui contient une demande,
explicite ou non, adressée à un interlocuteur muet.
» Anne Ubserfeld, « Le quasi-monologue dans le théâtre
contemporain, Yasmina Réza et Bernard-Marie Koltès »,
Études théâtrales n° 19, 2000, p. 88.
7 Marc Augé, Non-lieux, introduction à
une anthropologie de la surmodernité, Paris, La Librairie du
XXIe siècle, Seuil, 1992.
8 Lire à ce sujet Melissa Van Drie, «
Que se passe-t-il quand le visage écoute ? Le visage téléphonique
de La Voix humaine (1930) », in Ligéia, Dossier «
Art et frontalité », n° 81-82-83-84, janvier-juin
2008, p. 43.
9 Jean Cocteau, « dactylogrammes non numérotés
retrouvés à Milly-la-Forêt (date probable : 1930)
», cité par Francis Ramirez et Christian Rolot, Notice
de La Voix humaine, dans Théâtre complet, Paris, Gallimard,
2003, La Pléiade, p. 1675.
10 Olivier Leplâtre, Appel à communications,
écritures du téléphone, Paris, L’Harmattan,
2005, p. 205.
11 Les figures « ne sont que des apparitions,
dont le sens se négocie par et dans la parole, et qui, au nom
du jeu de la représentation, refusent souvent toute idée
de permanence, de profondeur, et de densité ontologique »
(Jean-Pierre Ryngaert et Julie Sermon, Le Personnage théâtral
contemporain : décomposition, recomposition, Montreuil-sous-bois,
Théâtrales, 2006, p. 118).
12 Franc Schuerwegen, À distance de voix, essai
sur les « machines à parler », Lille, Presses universitaires
de Lille, 1994, p. 113.
13 Marcel Proust, Le Côté de Guermantes
(Livre I), Paris, Gallimard, 1988, Collection « Folio Classiques
», p. 126.
Sommaire
|

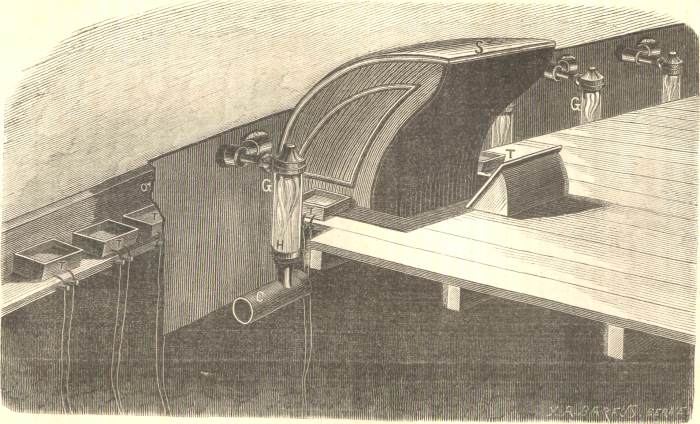

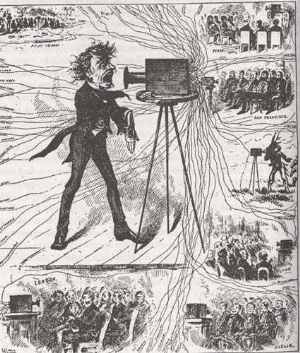
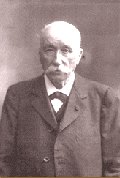 Clément Ader
Clément Ader 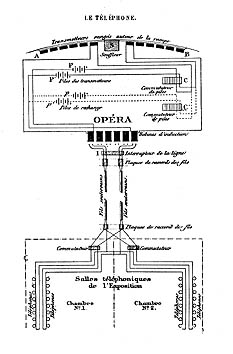

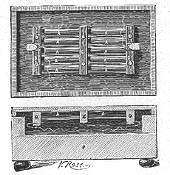



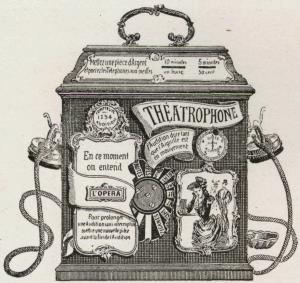
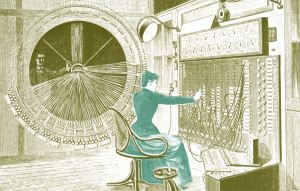
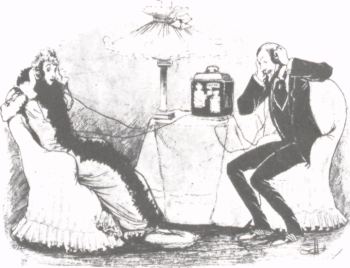
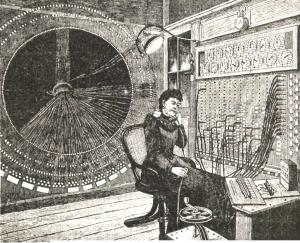

 Marcel
Proust, dont on sait que les problèmes de santé
l'incitait à éviter les sorties, fut, comme
le révèle sa correspondance, un adepte du théâtrophone.
Marcel
Proust, dont on sait que les problèmes de santé
l'incitait à éviter les sorties, fut, comme
le révèle sa correspondance, un adepte du théâtrophone.