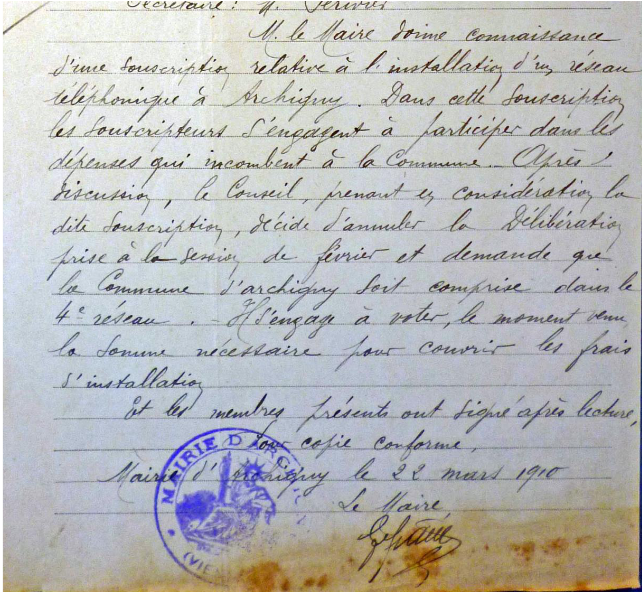Petites histoires de téléphone dans
nos régions de France
On ne trouve pas beaucoup de traces d'histoire du téléphone
de nos régions et localités dans les documents, archives
et sites disponibles, mais quelques particuliers ou anciens des télécom
racontent une petite tranche d'histoire du téléphone dans
leur région que j'ai inclus dans cette page.
Merci de me communiquer vos petites histoire de téléphone
dans votre entourrage pour alimenter cette page : jean.godi@free.fr
1877 Le premier téléphone Bell arrive
à Paris.
A la réunion annuelle de l'association Britannique (BAAS) à
Plymouth Septembre 1877 Alfred Niaudet,
neveu de Mr
Louis Bréguet (père) et
célébre constructeur de matériel électrique
Bréguet, membre de la "Society of telegraph
Engineers", assistent à une présentation du téléphone
par G. BELL. Le
lendemain Niaudet reçoit des mains même de Bell une
paire de téléphones pour les amener en France.
Puis Breguet sans tarder fit une présentation
devant un petit comité appartenant à l'institut et Collège
de France.
« C’est Monsieur Breguet qui a joui du précieux
avantage de tenir entre ses mains et d’essayer, à son aise,
le téléphone. Pareil à saint Thomas, il a pu croire
parce qu’il a vu et touché. Aussi s’est-il empressé
de faire part à l’Académie des Sciences de l’étonnement
que lui a inspiré le merveilleux appareil américain, non
seulement par les résultats incroyables obtenus, mais aussi par
la simplicité des organes qui le composent. La pureté
de la voix humaine et ses nuances sont si bien conservées que
l’on peut reconnaître la voix de la personne qui parle
»
Puis nous eûmes le plaisir de voir l’atelier de M. Breguet
et le cabinet de travail où se trouvait alors le seul téléphone
double qu’on connût en France. M. Breguet nous fit voir l’appareil
et nous pûmes assister à une expérience concluante.
Les premières démonstrations en France se font au Congrès
Scientifique du Havre en septembre 1877
Plusieurs savants venant de Plymouth (Angleterre) sont présents
au Congrès Scientifique du Havre qui se tient peu après
les séances de l'Association Britannique en aout 1877 comme raconté
ci dessus. .
"Ils ont assistés aux expériences de M. Bell, ils
ont fait fonctionner eux-mêmes le téléphone. Ils
ont pu converser avec des amis, à une distance de plusieurs centaines
de mètres, et ce n'est pas sans une légitime émotion
qu'ils reconnaissaient la voix de ceux qui parlaient au loin, en approchant
l'oreille de l'ouverture du Téléphone à la station
d'arrivée" (La Nature, 1877).
En septembre 1877, les frères Alexandre et Louis Poussin, deux
industriels Elbeuviens (de la ville d'Elbeuf, Seine-Maritime, France),
lisent dans le journal scientifique "la Nature" un article
donnant la description d'un "admirable instrument appelé
le Téléphone inventé par le professeur américain
Monsieur Graham Bell" Les frères Poussin, très intéressés
par les nouvelles applications de la science, se rendent à Paris
pour rencontrer Antoine Bréguet. Emporté par l'enthousiasme
de celui-ci qui vient de déclarer à l'Institut : "depuis
que j'ai ce magique petit instrument, je ne dors plus", ils demandent
à A.Breguet de construire sur ses indications (sous licence C.Roosvelt)
une paire de téléphones.
Après l'avoir expérimenté, ils décident
d'en faire profiter les membres de la Société Industrielle
d'Elbeuf. Cette société, créée par leur
père en 1857, réunit tout ce que la ville compte de notables,
industriels et commerçants.
En décembre 1877 l'Industriel Elbeuvien écrit :"aujourd'hui,
un téléphone est à la disposition des membres de
la Société Industrielle qui pourront ainsi confirmer tout
ce que nous avons déjà dit de cet appareil extraordinaire".
Le président de la société, Monsieur Pelletier,
s'empresse de nommer une commission chargée d'étudier
l'appareil. Cette commission organise le 11 décembre 1877 une
expérience décisive : un téléphone Bell
est installé dans le local de la société, un fil
d'une longueur d'environ six cent mètres va sur la tour Saint-Jean
et revient vers un deuxième Téléphone situé
dans une autre pièce de la société.
Les expériences faites hier ont parfaitement réussi. A
une très grande distance et dans deux pièces fermées,
la commission, divisée en deux groupes, a pu correspondre. La
parole, un peu affaiblie à la vérité, est parfaitement
claire et permet même de distinguer la personne qui parle. Tous
les sons, toutes les syllabes s'entendent parfaitement bien. Une boîte
à musique dont les sons sont assurément peu intenses,
placée à l'une des stations, a fait entendre à
l'autre extrémité les mêmes sons, avec la plus grande
pureté, et l'on distinguait même très bien le timbre
de l'instrument. L'audition était la même que si la boîte
à musique avait été placée à quelque
distance de l'oreille" (l'Industriel Elbeuvien, décembre
1877).
Début novembre 1877 à Paris Breguet fabrique et
installe un téléphone dans ses ateliers du 39 quai de
l’Horloge pour que tout le monde puisse l’essayer La Maison
Breguet du quai de l’Horloge à Paris ne désemplit
pas pendant qu’Antoine expérimente le téléphone
devant ses amis académiciens, et des représentants de
diverses sociétés savantes. Les commentaires sur les résultats
sont unanimes : « c’est merveilleux »...
Décembre 1877
A.Niaudet et C. Roosevelt créent la première
société de téléphonie en France la"Société
Anonymes des Téléphones Bell"
Son siège social est situé au 1, rue de la Bourse, à
Paris.
Fin décembre 1877,
A.G.Bell de passage en France, réalise une communication gare
Saint Lazare entre Paris et Saint Germain...
Dans les archives, on retiendra aussi que le 8 janvier
1878, une expérimentation Téléphonique avait été
tentée avec succès à Marseille.
Juin 1879 La première société
à demander une concession est la Compagnie
du Téléphone Gower Roosvelt la CdTG
à Paris. Gower installa un atelier
et des bureaux près de la place Vendôme, 66 rue des petits
champs. en décembre
1879 est insallé le premier central téléphonique
français, on y raccorda les 42 premiers abonnés au réseau
Parisien fin 1879 et 60 personnes ont signé une promesse d’abonnement.
Paris offrait un espace excellent car il n’y
avait pas besoin de creuser des tranchées ou de créer
une canalisation spéciale : on utilisa le réseau d’égouts
dont la Ville de Paris a été dotée par Belgrand
pour la construction des lignes téléphoniques souterraines.
De plus, l’une des spécificités de la ville (et de
la préfecture) de Paris est d’avoir imposé à
la compagnie de renoncer aux fils aériens et d’emprunter
le réseau des égouts. Ceci se révéla fort
utile au niveau de la connectivité, étant donné
qu’il fallait relier plusieurs points diversement espacés
par des lignes disposées de manière à permettre
le plus grand nombre de liaisons directes, avec une longueur la plus
petite possible. Le réseau d’égout s’y prêtait
justement.
Puis le 30 septembre 1879, le central téléphonique
manuel est ouvert à Paris. Il s'agit du Bureau A, sis 27,
avenue de l'Opéra qui compte 454 abonnés au téléphone
à sa création....
Le 2 février 1880, est fondée officiellement
la Compagnie des Téléphones.
ex Compagnie
du Téléphone Gower Roosvelt , chargé
d'exploiter les réseaux de Marseille Lyon Nantes Bordeaux Lille
et Le Havre et Paris ...
Le 16 et 17 août 1880, est fondée officiellement
la Société Générale
des Téléphones. Cette société,
présidée par Amédée Jametel, est créée
dans le but prévisionnel de fusionner la Compagnie des Téléphones
(Gower) et la Société Française des Téléphones
.
Le 10 décembre 1880, l'État transfère
enfin à M. Amédée Jametel, Président de
la Société Générale
des Téléphones, la concession d'exploitation
accordée le 8 septembre 1879 ...
Fin 1880 La
France compte 3039 abonnés au téléphone sur le
réseau public de Paris plus 1812 abonnés hors de Paris.

A Paris, à l'Institut, quai Conti, les salles des diverses
académies sont, depuis le mois de décembre 1881, reliées
entre elles par des appareils téléphoniques, et les bureaux
des diverses sections en séance sont en relation directe avec
le personnel des secrétariats perpétuels pour demander
les renseignements ou les manuscrits dont ils peuvent avoir besoin.
1881 Le prix de l'abonnement avait été fixé par
un arrêté ministériel à 600 francs par an
pour le réseau de Paris et à 400 francs pour les réseaux
de province.
En 1884 11 villes desservie par la S.G.T
sont : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille, le Havre, Rouen,
Saint-Pierre-lès-Galais, Alger et Oran. En 1884 furent mis en
service les réseaux de Halluin, Troyes, Nancy, Dunkerque et Elbeuf.
En région Parisienne
Dans le département de Seine-et-Oise,
12 postes téléphoniques reliaient entre eux les établissements
des grandes fabriques Decauville.
Les fils aboutissent à Petit-Bourg, Évry et Corbeil; de
sorte que les chefs de gare de ces trois localités peuvent prévenir,
par le téléphone, M. Decauville de l'arrivée en
gare de ses marchandises.
J'ai retracé dans les archives locales de ma région de
Fontainebleau et raconté cela
dans cette autre page : Fontainebleau.
En Normandie,
Rappelons que des premières expériences
eurent lieu au Havre dès 1877, la ville jouait alors un
rôle de centre d'échanges (en raison du port et de son
important trafic). On y était très sensible à tout
ce qui venait des Etats-Unis. Le Havre était alors en pleine
croissance économique. Le 3 février 1878, fut présenté
"Le téléphone et ses applications" devant plus
de 2 000 personnes.
La Ville de Rouen découvre le Téléphone
le 12 décembre 1877
( vous pouvez lire le compte rendu dans le
Bulletin 1877 de la Société industrielle de Rouen
de cette présentation)
| Messieurs Gouault et Dutertre,
membres de la Société Industrielle de Rouen, présentent
le Téléphone Bell lors d'une conférence publique
organisée dans la grande salle de l'Hôtel de ville
de Rouen (Seine-Maritime, France). La Société Industrielle de Rouen se définit à l'époque comme "une association ouverte à toutes les bonnes volontés, étudiant les applications des découvertes de la science, cherchant à propager l'instruction technique, s'efforçant de vulgariser les procédés industriels, en un mot, travaillant à faire la lumière ". Elle regroupe près de 700 membres de toutes origines, chaque département français est représenté ainsi que la plupart des pays étrangers (Etats-Unis, Russie, Allemagne, Angleterre, Suisse, Espagne, Belgique, Hollande,...). Monsieur Gouault présente l'appareil : "le Téléphone que je vais décrire et expérimenter est le cornet acoustique portatif. Il remplit les fonctions alternatives de transmetteur lorsqu'il reçoit la voix, et de récepteur lorsqu'il l'apporte à l'oreille. Cet appareil se compose d'un pavillon, destiné à recevoir la bouche ou l'oreille. Derrière ce pavillon, une membrane métallique en fer doux, de un à deux dixième de millimètres d'épaisseur, est tendue entre deux pinces annulaires en bois réunies par des vis en cuive. Cette membrane est l'appareil vibrant destiné à recevoir l'impulsion de la parole ou à la reproduire. Derrière cette plaque, et à une distance mesurée par une fraction de millimètre, se trouve un système composé d'une bobine entourée d'un fil de cuivre isolé et d'un aimant central. Les deux fils de la bobine ressortent de la gaine en bois de l'appareil par deux bornes ; l'un est mis en communication avec un fil télégraphique aboutissant au récepteur ; l'autre est conduit à la terre, comme dans les appareils télégraphiques ordinaires" (Bulletin de la Société Industrielle de Rouen, 1878). Cette description très scientifique cède parfois la place à une description plus terre à terre : "l'appareil de Monsieur Graham Bell se compose essentiellement de deux parties ayant assez l'aspect des patères en bois qui servent à retenir les draperies" (le Journal de Rouen, 1877). Monsieur Gouault donne ensuite le principe du Téléphone : "le premier principe, d'ordre philosophico-physiologique, est antérieur à Bell ; le second principe, d'ordre purement physique, était connu de la science et était implicitement renfermé dans la loi de Lentz. Bell a eu le bonheur d'en trouver le premier, je crois, une application pratique". Enfin Messieurs Gouault et Dutertre réalisent une série d'expériences qui réussissent parfaitement. Ils montrent qu'il est possible d'entretenir une conversation à distance, un deuxième poste étant installé dans l'hôtel de la gendarmerie, à plus de 300 mètres de la salle de conférence. Ils présentent également leurs essais sur de longues distances : le petit appareil que vous avez sous les yeux a été expérimenté par Monsieur Dutertre et moi-même jusqu'à 300 kilomètres de résistance locale. Monsieur Bréguet affirme avoir perçu les sons que transmet le téléphone avec des résistances de 1000 kilomètres ! Les expériences faites sur des fils de lignes ont été moins concluantes, en raison même de la grande sensibilité de l'appareil. C'est qu'en effet les fils voisins des lignes télégraphiques, soumis à des courants électriques intenses, agissent par induction sur le fil télégraphique. Ces courants induits se superposent à l'action principale du Téléphone et la troublent d'une manière sérieuse. C'est ainsi que lors d'une expérience opérée sur un fil de ligne de l'Etat, j'ai entendu très distinctement, superposés à la voix transmise, les bruits donnés par trois télégraphes ordinaires du service. On reconnaissait très nettement le fonctionnement d'un Morse, d'un Bréguet et d'un Hughes. En dehors de ces actions et de ces inconvénients extérieurs qu'un service général téléphonique ne comporterait pas, la transmission par l'appareil de Bell se fait, sur les fils de ligne, à des distances importantes. On peut citer les expériences faites il y a quelques semaines, entre Paris et Mantes, à une distance de 58 kilomètres, lesquelles ont parfaitement réussies". Monsieur Gouault termine sa conférence en présentant ce que pourrait être les premières applications du téléphone : "il remplacera, dans un avenir rapproché, les tuyaux accoustiques des habitations privées et des manufactures. Il rendra de grands secours, en campagne, pour les services des avant-postes, des reconnaissances des aérostats militaires. On peut espérer même l'utiliser pendant les batailles, lorsqu'il sera devenu plus puissant. Il aura d'ailleurs toujours cet immense avantage de n'exiger la présence d'aucun télégraphiste, et de permettre, dans des cas graves, la relation directe du général en chef avec les commandants des camps engagés. Son emploi est dès à présent indiqué pour les expériences de tir au polygone, dans le but de remplacer l'espèce de langage télégraphique constitué par les sonneries au clairon. Enfin Monsieur Bell fait des recherches pour en réaliser l'application à la télégraphie transatlantique et il a la conviction d'y réussir dans un avenir très rapproché". Le lendemain, Monsieur Gouault organise une deuxième conférence pour le public. Dans son rapport annuel de janvier 1878, le président de la société s'en félicite : "la présence de la foule qui est venue entendre la conférence publique et gratuite a affirmé le succès que notre collègue avait eu la veille". Voici comment le Journal de Rouen relate la conférence : "l'orateur, après avoir rappelé qu'un simple jouet avait été le précurseur du téléphone, a présenté l'instrument et minutieusement décrit les pièces dont il se compose, puis il a cherché à exposer la manière dont se fait la perception des sons. Toutes les fois, a-t-il dit, que nos sens se trouvent placés dans des circonstances différentes, mais semblables par leur résultante matérielle, ils transmettent au cerveau les mêmes impressions, et notre individu se croit absolument dans des conditions identiques ; c'est ce qui fait que les amputés croient percevoir une sensation dans le membre qu'ils n'ont plus ; qu'avec le stéréoscope, nos yeux croient voir des objets en relief, en examinant une image plate. |
| La première liaison téléphonique,
le Premier Communiqué de Presse Le 18 décembre 1877, Monsieur Gouault, invité par la Société Industrielle d'Elbeuf, donne, "devant un auditoire d'élite, une conférence sur le Téléphone". Après avoir présenté l'appareil, il passe aux expériences. Voici comment le Bulletin de la Société Industrielle d'Elbeuf relate les faits : "au moyen des appareils de Messieurs Poussin, une communication a été établie entre le local de la Société Industrielle et l'Hôtel de Ville. Le conférencier et d'autres personnes ont pu converser avec les personnes placées dans ce dernier local. Des phrases ont été échangées ; la sonnerie d'une montre, produite à l'Hôtel de Ville, s'est faite entendre très distinctement dans la salle où avait lieu la conférence ; on a pu, de la même manière, entendre l'air et les paroles d'un couplet de chanson". Enfin, grâce à la complicité de l'Inspecteur des lignes télégraphiques de Rouen, Monsieur Gouault va soulever l'enthousiasme de son auditoire. Réalise-t-il alors qu'il va effectuer la première liaison téléphonique "commerciale" en Normandie et probablement le premier communiqué de presse français ? Le Téléphone Bell est alors relié par un fil qui, tiré du local de la Société Industrielle, rejoint le bureau télégraphique puis emprunte la ligne télégraphique Elbeuf - Rouen. Voici le commentaire du bulletin de la Société Industrielle : "une communication a pu être établie entre le local de la conférence et la guérite télégraphique de la gare Saint-Sever à Rouen, et vers 10 heures et demie du soir, Monsieur Gouault transmettait la dépêche téléphonique suivante : "Président Société Industrielle d'Elbeuf à Président Société Industrielle de Rouen. Une conférence très intéressante sur le téléphone a été faite ce soir à la Société Industrielle d'Elbeuf, par Monsieur Gouault, ingénieur. Mis en communication avec Rouen grâce à l'obligeance de Monsieur le Directeur des Télégraphes, le conférencier transmet cette dépêche oralement pour être communiquée aux journaux : un incendie qui menaçait de prendre de graves proportions s'est déclaré ce soir rue de l'Hospice. Un ouvrier a été sérieusement brulé au bras et à la poitrine. On est actuellement maître du feu". "Les termes de cette dépêche ont été répétés mot par mot, par la personne qui la recevait à Rouen : la transmission avait donc parfaitement réussie". A cette date on pouvait acheter une paire de téléphones pour la somme de 15 francs ce qui équivalait 2 jours de travail pour un ouvrier qualifié. |
En Normandie, la ou la première liaison avait été établie en décembre 1877, en juillet 1878, M. Dutertre installe un fil téléphonique entre sa demeure particulière et la mairie de la petite commune de La Vaupalière dont il est le maire.
| Puis peu à peu, il
ajoute de nouveaux fils: il relie le garde champêtre distant
de 1600 mètres, le receveur des contributions, distant de
2000 mètres. Et en mai 1879, il fait la demande officielle pour un réseau avec 6 stations : j'ai l'intention de faire construire un réseau complet de lignes aériennes qui relieraient à la Mairie la recette des contributions indirectes, dont le receveur est un conseiller municipal et le domicile du garde-champêtre. Les mêmes poteaux serviraient à supporter des fils spéciaux mettant en communication la Mairie avec le presbytère et la maison de l'adjoint au maire plus le prolongement de la ligne vers ma demeure particulière. Les avantages généraux de cette installation seraient de relier les extrémités de la commune avec la Mairie d'où seraient expédiés des ordres, il serait facile d'obtenir promptement les secours des sapeurs pompiers ou de la gendarmerie. En mai 1880 M. Dutertre obtient du Ministre, avec avis favorable du préfet, l'autorisation de relier son réseau à Maromme, le chef lieu de canton situé à 4 km de La Vaupalière. Voici la description du réseau : "l'appareil choisi est celui de Gower (système de Bell perfectionné). Des études comparatives ont fait reconnaître que le système Bell est encore celui qui a la supériorité pour transmettre les caractères distinctifs de la voix M. Dutertre a ajouté un ingénieux petit système avertisseur, pour qu'il fût possible de savoir sans retard si quelqu'un se trouvait à l'appareil sollicité pour répondre immédiatement. Le fil est supporté à l'aide d'isolateurs mobiles dits à queue. La portion du fil susceptible d'être en contact avec le support est entourée d'un morceau de caoutchouc vulcanisé. Dans une grande étendue du parcours, les supports-isolateurs sont piqués aux arbres de la forêt le long de la route qui conduit à La Vaupalière. Une fois en haut de la côte, les isolateurs sont apposés contre les maisons; puis, sur un espace d'environ deux kilomètres, ils sont attachés à des poteaux placés de 90 mètres en 90 mètres. En face de la mairie, un certain nombre de fils devant provenir de différentes directions et attendant une destination sont réunis dans un tuyau, traversent le chemin sous terre et arrivent au système receveur. Pendant ce cours trajet les fils sont chacun revêtus d'une couche de gutta-percha ; cet enduit a pour but d'isoler les courants. Là, chaque fil est mis en rapport avec un commutateur suisse. Par le moyen de cet appareil, on établit la communication avec le point téléphonique avec lequel on doit correspondre. Les essais sont tout à fait concluants et certifiés par le docteur Laurent, membre de la Société Industrielle de Rouen, qui rapporte: j'ai entendu distinctement les paroles et les phrases émises par les personnes qui ont communiqué avec moi par le téléphone administratif de M. Dutertre. Le son de la voix arrive à l'oreille, de manière à comprendre très clairement. Le timbre présente même des différences caractéristiques qui permettent de reconnaître la voix des personnes qui parlent ". De son côté, M. Dutertre écrit au Directeur ingénieur des télégraphes de Rouen : "ce fil a fait ses preuves; gendarmes, contrôleur des contributions directes et indirectes, percepteur, agent-voyer, l'ont tous employé pour avoir des renseignements plus prompts; des malfaiteurs, des conducteurs de voiture ivres ou sans lanterne, ont pu être arrêtés, signalés au passage par le secrétaire de la mairie' (juin 1881). En novembre 1880, M. Dutertre présente à ses collègues de la Société Industrielle, un projet de "téléphonie administrative dans les communes rurales et de son application au service public". II montre tout d'abord la supériorité du téléphone sur le télégraphe : "pour un service télégraphique il faut un employé spécial, un employé initié aux difficultés de la marche de l'appareil télégraphique. Avec l'appareil téléphonique, point de complications semblables. Tout le monde est apte à parler dans un cornet téléphonique, à mettre le cornet à l'oreille, à écouter. Il suffit d'une explication fort simple, d'une démonstration élémentaire pour permettre à même une personne dont l'instruction est très restreinte, pour ne pas dire nulle, de correspondre par le téléphone. ". M. Dutertre insiste ensuite sur les profits que chaque commune rurale doit retirer du téléphone : "je mentionnerai tout d'abord les communications qui doivent avoir lieu dans la commune. Quand il est nécessaire de recourir au garde champêtre, il faut avoir sous la main quelqu'un à envoyer chez ce fonctionnaire, il faut écrire l'ordre à transmettre, remarquez la vitesse d'exécution avec l'emploi du téléphone. Une communication verbale est rapidement faite et allège le fardeau bureaucratique. Actuellement, il faut de trois à cinq jours pour les communications de commune à commune. Les intérêts agricoles eux mêmes ont une part considérable à attendre du téléphone administratif. Les dépêches astronomiques, le cours des denrées, certains conseils urgents, etc... pourront être propagés dans un bref délai parmi les habitants. Il n'est pas jusqu'à l'administration militaire pour le recrutement; lors d'une levée d'hommes, en cas de guerre, et même la stratégie qui n'aient à profiler largement de l’installation en question. En cas d'incendie, on ne saurait encore contester qu'il soit du devoir de l'autorité municipale de recourir le plus promptement possible, à tous les moyens, pour faire appel aux personnes capables de porter secours. II en sera de même s'il arrive un accident. Un autre point essentiel que je ne puis passer sous silence, c'est l'assistance médicale dans les campagnes. Vous remarquerez que notre petite commune, comme bien d'autres, est trop petite pour posséder un médecin et un pharmacien. Les habitants sont obligés, pour se faire soigner, de s’adresser à un praticien domicilié à une distance plus ou moins gronde ; le médecin n'est pas chez lui, est en tournée, quelquefois dans une commune avoisinant La Vaupalière ; il retourne fort tard à son domicile où il trouve l'adresse du malade de La Vaupalière. Le médecin, harassé de fatigue renverra au lendemain matin la visite à faire. Avec l'installation d'un appareil téléphonique quelle différence ! Un appareil serait placé chez le médecin cantonal chargé de la médecine chez les indigents et le médecin le plus voisin de la commune. Le médecin pourrait être prévenu par le téléphone, chez lui et dans les communes où il est en tournée, Il pourrait en passant à chaque station téléphonique, s'informer s'il est demandé. On peut dire de même pour ce qui concerne le pharmacien et l'obtention de médicaments urgents. Ainsi encore, au moment des élections, pour les renseignements nombreux que les autorités réclament ,cette installation sera on ne peut plus utile.
M. Dutertre propose ensuite la formation d’un
réseau plus complet qui relierait 13 communes du canton
de Maromme. |
| De la Téléphonie administrative
dans les communes rurales et de son application au service public.
septembre 1881 RAPPORT sur l'installation faite par M. Dutertre, maire de La Vaupalière, membre de la Société industrielle, etc PAR M. le D'' LAURENT. SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 1881. ( que vous trouverez à cette adresse https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1225841/) MESSIEURS, Dès le mois de février qui suivit
la conférence (février 1878), M. Dutertre a installé
un fil entre sa demeure particulière, à La Vaupalière,
et la mairie. Puis, peu à peu, il a ajouté de nouveaux
fils à La Vaupalière même plus tard, en avril
1880, il a relié cette commune avec le chef-lieu du canton. Mes essais ont donc été aussi variés
que possible pour m'éclairer sur les avantages de cette
installation. La téléphonie administrative dans
les communes rurales est une innovation. Malheureusement, dans
notre beau pays, tout ce qui est innovation rencontre le plus
souvent des entraves diverses et puissantes. On a à compter
avec la routine, l'ignorance, les préventions, les superstitions,
etc. Aussi, dois-je dire qu'il a fallu la force de conviction
et la méritante persévérance de notre collègue
pour ne pas être rebuté et ne pas renoncer entièrement
à cette entreprise d'utilité publique. Car, il ne
s'agit pas d'une exploitation privée, mais bien d'un réseau
qui a pour but les intérêts de la commune, les intérêts
du canton et les intérêts départementaux.
Je dois ajouter que c'est à ses frais, avec ses propres
deniers, que M. Dutertre a installé et entretient ce service
administratif. Ne sachant pas si la ligne téléphonique
serait autorisée à fonctionner, et si, par conséquent,
elle avait l'espoir d'une existence plus ou moins durable, notre
collègue a cru devoir s'arrêter dans la voie des
améliorations. Cette ligne marche aujourd'hui telle qu'elle
a été disposée tout d'abord. A La Vaupalière,
sous la main du secrétaire de la mairie, dans la maison
commune, est placé un appareil téléphonique.
A chaque point avec lequel a lieu la communication existe un autre
appareil téléphonique. Messieurs, notre collègue, M. Dutertre,
en établissant le téléphone administratif
de La Vaupalière à Maromme, s'est surtout préoccupé
de servir les intérêts de sa commune et de la région
qu'il habite. Il a étudié la formation d'un réseau
qui comprendrait tout le canton de Maromme. Avant de clore ce rapport, permettez-moi de vous
lire un passage emprunté à un livre paru récemment
(1881) sur les télégraphes, par Ternant (Bibliothèque
des Merveilles), page 54. « Alors qu'en France, le service
des communications téléphoniques se limite à
Paris, en ce moment on compte actuellement dans le nouveau monde
quatre-vingt-cinq villes qui se servent de ces installations.
A Chicago, il y a 3,000 abonnés, 600 à Philadelphie,
autant à Cincinnati, un nombre sans cesse croissant à
New-York, et le chiffre des personnes abonnées aux compagnies
téléphoniques en Amérique dépasse
70,000. » |
1878 En Basse Normandie, c'est un inspecteur
des télégraphes de l'Orne, G. Triger qui, de retour de
l'Exposition de 1878 utilisa un téléphone sur le fil du
télégraphe Alençon-Argentan en branchant un écouteur
à chaque extrémité... Mais, plus souvent les pionniers
furent ceux qui les premiers demandèrent des lignes d'intérêt
privé afin de relier en circuit fermé le domicile à
la fabrique ou à la boutique. Ces demandes émanaient d'industriels
et de représentants des milieux d'affaires.
1881 au Havre, le réseau téléphonique
établi atteignit rapidement 100 abonnés; la Société
des Téléphones inaugura au mois d'août 1881, un
service de petits facteurs ou commissionnaires pour courses, ou port
de petits paquets, dépêches télégraphiques,
échantillons, etc. Mais ce service ne dura que quelques jours
; il fut supprimé sur l'injonction du ministre des postes et
des télégraphes.
1884 le réseau d'Elbeuf est mis en service le 25 novembre avec 46 abonnés.
Le téléphone dans le CALVADOS
Le réseau d'État est arrivé le 16 novembre 1886,
mais il ne fonctionnait qu'en interne. C'était le bazar jusqu'à
la nationalisation en 1889, l'État et le privé étaient
en concurrence. A Caen au départ, on comptait 22 abonnés.
Des notables, comme le pâtissier Stiffler, le grand charbonnier
Alain Guillaume, des banquiers, le palais de justice... La police et
les pompiers n'avaient pas de ligne, car il fallait payer.
Il a fallu attendre le 1er mai 1898 pour que soit établie la
ligne Caen - Paris. On recensait alors cinquante abonnés. Pour
être précis, une ligne privée avait été
installée en 1885 entre Caen et Ouistreham pour réguler
les entrées et sorties des bateaux sur le canal.
Le système est resté manuel jusqu'au milieu des années
70. On appelait le central téléphonique et on tombait
sur une opératrice. On en comptait près de 300 à
Caen dans les années 60, vingt-quatre heures sur vingt-quatre
et sept jours sur sept. On les appelait les « demoiselles du téléphone
». Chaque opératrice écoulait soixante appels à
l'heure. Y régnait une discipline de fer.
Quant aux lignes, elles ont longtemps été installées
ainsi : on les tirait manuellement, on posait les poteaux avec une charrette.
11 février 1924 : Caen s'est doté d'un nouveau central téléphonique pour augmenter son nombre d'abonnés. Toutes les lignes ont été centralisées à 21 h. Le bureau des postes était situé dans l'aile droite de l'hôtel de ville, place de la République. La Poste y avait un bail de cinquante ans, de 1882 à 1932. Tout y était concentré : la direction, les services postaux, le centre de tri, le central... Puis, en 1932, le central a déménagé rue Auber, dans l'immeuble Gambetta. Si on appelait à Caen, l'appel pouvait être immédiat. Mais pour Paris, notamment l'été, on pouvait s'entendre répondre : « Rappelez demain. » Il y avait si peu de circuits à l'époque qu'ils étaient vite encombrés. C'était encore vrai dans les années 30, sans parler des années 40 où le téléphone était sous la houlette des Allemands. Et après la Guerre, il a fallu reconstruire les lignes...
La majorité des gens correspondait donc par lettres
?
Oui, c'est longtemps resté le vecteur préférentiel
de communication. Les Télécoms ont longtemps été
un service résiduel. D'autant que le télégraphe
avait un avantage sur le téléphone : il avait valeur de
preuve sur le plan juridique. La France était très en
retard. Ce fut un mal pour un bien, car lorsque fut lancé le
célèbre plan téléphonique des années
70, on est passé directement à l'électronique.
LES PREMIERS DÉVELOPPEMENTS DU TÉLÉPHONE EN LORRAINE 1885-1914 (Jean-Paul Martin)
| Comme dans la plupart des régions, l'Alsace
suit les évolutions des télécommunications. Évolution de la commutation en Alsace. En 2000 l’Alsace comptait onze commutateurs E10N1 qui ne permettaient plus de faire face à l’émergence de tous les nouveaux services. Un plan national, en 1999, de renouvellement de ces cœurs de chaînes, dont les premiers avaient 20 ans d’existence, aboutit à leur démontage en moins de trois ans en Alsace. La fin des années 1990 avait effectivement vu apparaître la troisième génération de commutateurs électroniques (3G) de type E10B3 (Alcatel Lucent) et AXE10 (Ericsson) dont la capacité allait jusqu'à 120.000 abonnés. Quatre E10B3 seront implantés en Alsace : Mulhouse Arc, Colmar Preiss, Molsheim et Strasbourg Wodli et deux AXE10 à Mulhouse Europe et Strasbourg Broglie, ainsi qu'un E10B3 de transit à Strasbourg Wodli. Ces commutateurs 3G permirent le renouvellement de tous les commutateurs 2G E10N1 et MT25, qui s’est terminé en Alsace au début des années 2010. Il a été facilité par la baisse du nombre des abonnés commutés après l’introduction du tout IP en ADSL. Mais on ne parlera que bien plus tard, vers 2014, de la fin de la commutation avec une première échéance pour 2022. Les choix techniques pour traiter les derniers abonnés résiduels sur RTC restèrent aussi à confirmer. Une solution sur ADSL ne sera retenue qu’en 2018. Pendant cette période, un grand projet mobilisateur pour les équipes de commutants des CPE, fraîchement devenu UER, fut le deuxième plan de changement de numérotage, celui du passage à 10 chiffres, qui a eu lieu en fin 1996. Évolution des techniques lignes La DG donna beaucoup d'importance à la qualité du réseau de lignes au début des années 90, mais après EO2, changement de cap, tant pour les investissements qui firent l'objet de choix drastiques projet par projet, pour ne pas dire au niveau des «POI» (petites opérations d'infrastructure), que la maintenance préventive... En même temps, on passait au tout optique pour les clients d'affaire. La DR Alsace, déjà précurseur avec les ROF (réseau optique flexible), continua le développement des ROCA (réseau optique clients d’affaires). En 1999 on pouvait compter plus de 80 sites équipés pour une soixantaine de clients, principalement les banques (BFCM,…), les institutions européennes (IPE4,…), les sociétés informatiques ou audiovisuelles et autres entreprises multi-sites. Évolution des transmissions Dans ce domaine, la région a continué à déployer l’infrastructure optique à un rythme soutenu, ainsi la quasi-totalité des classes 4 commutation d’Alsace a été desservie. Parallèlement, à partir de 1996, le déploiement des équipements terminaux SDH (Hiérarchie Digitale Synchrone) s’est poursuivi au même rythme. Les équipements STM1 ont rendu possible l’acheminement du trafic de la totalité des classes 4 et de les sécuriser. L'apparition du STM16 (débit de 16x63 Mbits) a permis très vite de sécuriser les grandes artères du réseau alsacien, Strasbourg-Mulhouse avec un axe via Molsheim-Sélestat-Colmar et un autre via Marckolsheim-Neuf-Brisach. Ce qui entraîna la disparition des câbles cuivre nationaux, ainsi que de la plupart des faisceaux hertziens. Avec l’arrivée d’Internet et de l’ADSL en début des années 2000, le réseau de transmission mis en place a très vite été insuffisant, les débits nécessaires saturant le réseau SDH. L’évolution continue des équipements ADSL (Dslam), nécessitée par la montée en débit des applications Internet, et donc la multiplication des liens Dslam-BAS (concentrateurs de trafic), permettant l’accès au réseau des FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) qui ont très vite saturé les câbles optiques en place. Ce problème trouva sa solution par le déploiement très rapide d’équipements permettant le multiplexage en longueurs d’onde des fibres optiques permettant de multiplier par 4, 8, 16 la capacité de ces fibres optiques selon leur qualité (les fibres déployées avant 2000 ne permirent pas toujours cette évolution). A partir de 2010, commença le désinvestissement des premiers équipements SDH Il était lié à la baisse du trafic provenant de la commutation et à l’évolution du trafic mobile (passage en 3G puis en 4G qui nécessitait également des débits saturant très vite les équipements SDH). Cette montée en débit incessante nécessaire à Internet et aux réseaux mobile obligea constamment à revoir les équipements transmission. Ce qui a entraîné l’entrée de nouveaux fournisseurs de matériel. Aux historiques Alcatel, puis Alcatel-Lucent s’est ajouté ECI (Israël) et surtout Huawei qui fournit maintenant la moitié des équipements de base du réseau. Cela a impliqué également la multiplicité d’équipements dans nos salles de transmission. En matière de protocole, le bas du réseau Orange reste essentiellement en ATM, (Asynchronous Transfer Mode) protocole gourmand en ressources. (ATM emploie une technique de commutation à mi-chemin entre la commutation de circuit (téléphonie) et la commutation de paquets (X25). Par contre le haut du réseau (au-delà du BAS) utilise de plus en plus le réseau IP/Ethernet, qui permet une augmentation plus rapide en débits tout en étant, surtout, moins couteux. Lancement de la téléphonie mobile Le 1er octobre 1991, France Telecom commence à Strasbourg une expérience-pilote de téléphonie sans fil grand public, en ville. Le Bi-Bop est commercialisé « en grand » à partir d’avril 1993 à Paris, Lille et dans quelques lieux de villégiature. Suivi par Itinéris en 1992 avec la norme GSM La « préhistoire » des Mobiles 1G et 2G (Radiocom 2000 en 1986) a été abordée dans la première partie. L’arrivée de la norme GSM révolutionne ce domaine . Itinéris est inauguré en Alsace le 19 mai 1993 avec une couverture réseau à 80% de la région. Fin 1993, Dès 1982, la Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications (CEPT) crée le Groupe spécial pour système public de radiocommunications avec les mobiles à 900 MHz, soit en abrégé le Groupe spécial mobiles (GSM). En 1990, la structure cible du système cellulaire GSM est déjà choisie : les Stations de Base Radio (BTS), les Contrôleurs de Stations de Base (BSC), les Commutateurs de Services Mobiles (MSC). En juillet 1992, les premiers modèles de Radiotéléphones de 2ème génération GSM portatifs sont commercialisés par France Télécom lors de l'ouverture grand public. Ces premiers modèles ne sont pas encore badgés France Télécom vue leur récence. Prix de vente de ces radiotéléphones: 15.000 francs ! Puis se suivent les évolutions technologiques : 2001 le GPRS (56kbit/s), 2005 EDGE (200kbit/s), les premiers réseaux 3G dès 2004 (600Kbit/s) et enfin la 4G qui ne démarra qu'en 2012 (avec un débit de données maximum de 150 Mbit/s) la France ne compte encore que 50.000 abonnés, mais la concurrence du deuxième opérateur français SFR est déjà une réalité. En 1995, l’accélération de la demande avec plus de 50 nouveaux clients par semaine en Alsace témoigne de l’engouement du public mais entraîne déjà la saturation du réseau et nécessite la multiplication des émetteurs. La recherche de nouveaux sites est très difficile et on parle déjà de zones d’ombre dans le sud de la région. Fin 1995, avec une vingtaine d’émetteurs supplémentaires, la région possède une cinquantaine de sites. Cette multiplication du nombre d’antennes est imposée par passage de la puissance de 8 watt de téléphone de voiture (2G) à celle de 2 watt du terminal GSM. Cela entraîna aussi une insuffisance des fréquences disponibles et leur réutilisation entre différents sites devient problématique en particulier dans les zones denses. Nos voisins allemands avaient les mêmes difficultés et très vite il a fallu harmoniser les fréquences avec Deutsche Telekom. Fin 1996 l’Alsace compte 44.000 abonnés, en 1997 on assiste à l’explosion de la demande, l’objectif de vente de 5.800 pour le premier quadrimestre passe à 13.650 pour le troisième. En fin d’année on fit appel à l’ensemble du personnel pour renforcer les équipes de vente, plus de 70 agents répondirent. C’était aussi l’année du lancement de la marque OLA dont une des répercussions fut la création de la plateforme Ola à Colmar en 1999, qui a été rattachée à l'Agence Haut Rhin. Sa mission est d’apporter aux clients OLA une assistance sur les aspects techniques et commerciaux. Pour la promotion de cette marque, FT Mobiles créa place Kleber,en octobre 1999, un univers magique et féerique « Olaween » à l'occasion d'Halloween (voir photo, FA45 1/99) L’ouverture de la 3G avait fait l’objet d’un pré-lancement à Strasbourg en septembre 2004 et a permis l’ouverture de l’UMTS dans 14 villes de France en décembre de la même année. A l’ouverture, en Alsace, 54% de la population est couverte mais se concentre sur les principales villes de la région, soit au total que 290 communes. Évolution du réseau internet L'ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) a été introduit en France en 1999. Ce produit déjà utilisé aux USA et dans certains pays Asiatiques, devait développer l'internet en faisant passer les débits à 512/128 KB. L'Alsace a été choisie dès début 1999, comme première et seule région pilote de province, avec Paris intra-muros. Ce choix devait rester confidentiel jusqu'à l'ouverture du service pour ne pas attiser la concurrence. L'ampleur de la demande de raccordements dès l'ouverture des premiers centraux dans la ville de Strasbourg en décembre 1999 a été une grande surprise pour tous les responsables de FT. Très vite toutes les communes voulaient leur ADSL. Malheureusement les budgets et les capacités de production des matériels spécifiques (DSLAM-Cartes) ne suivaient pas. Nous étions amenés à gérer la pénurie et à faire face à beaucoup de mécontentement. La situation s'est normalisée avec l'industrialisation et l'évolution des produits : capacité des DSLAM, amélioration des débits, augmentation des distances de couverture, introduction de la télé par ADSL, ouverture du dégroupage,... A Mulhouse, l’ADSL a été inauguré en octobre 2000, puis à Colmar et Saint Louis en décembre. Les offres Netissimo étaient alors vendues à 265F/mois. C’était aussi l’époque où Roxana Maracineanu, championne de natation et médaillée d’argent au Jo de 2000, faisait partie des équipes d’action commerciale de l'AG Mulhouse. Elle est devenue ministre des sports en 2018. André Bourrel l’avait récompensée lors de cette inauguration. La contrepartie de cette évolution a certainement été le développement de la concurrence et l'accélération de la fin du monopole de FT . Suite au développement technique de l’ADSL, Wanadoo est lancé en 1996 et comptait 26.000 abonnés début 1997, dont 350 en Alsace. La concurrence est très vive sur ce marché et France Télécom veut rester leader en affichant sa volonté de devenir la « Net Compagnie » française. Avec l'explosion de l'internet, apparaissent des offres et des opérateurs concurrents. France-Télécom, avec Wanadoo, rachète plus d'une centaine de sociétés technologiques. Fin 1998, l’Alsace ne comptait que 10.000 abonnés Wanadoo. Les agences furent totalement mobilisées pour la vente et la promotion de ces nouveaux services sur les foires, en boutiques, sur les Campus, les Collectivités Locales, les écoles…. On imagina même les fêtes de l’internet dans toutes la France pour s’affirmer comme la Net Compagnie. L’Alsace s’est mobilisée pour la deuxième édition en 1999, qui a vu des « Villages Internet » sur de nombreuses places à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Pour la troisième édition en 2000, l’Alsace se distingua tant à Strasbourg, Colmar qu’à Mulhouse où les animations furent nombreuses, les « Net d’Or » venant récompenser les meilleures pages perso Internet. Côté Entreprises, il fallut aussi faire connaître ces nouveaux services. En juin 1999 plus de 150 entreprises ont répondu à l’invitation d’AE au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Avec l’aide de la filiale interne « Oléane/Transpac » l’objectif était de créer une marque forte dans le monde de l’entreprise comme elle avait été faite avec Wanadoo pour le grand public. Faire connaître ces outils et les promouvoir devint une priorité. Les actions étaient multiples. Les ambassadeurs firent partie de cette force de frappe. Lancée dès 1998, les ambassadeurs alsaciens, plus de 50 en 2000, se firent connaître à tous les niveaux, bien sûr essentiellement en Alsace (dans les écoles,…), à Paris au Parlement en 2001 pour familiariser nos députés, auprès des ministres européens en 2000… Par la suite, l’évolution de tous les produits fut incessante tant sur le fixe que mobile (haut débit, HD mobile, MaLigne TV…) Leur promotion devait s’accélérer. Le lancement de « Ma ligne TV » s’est déroulé en septembre 2004 et ne concernait à l’ouverture en Alsace que 138 000 foyers, exclusivement sur la ville de Strasbourg. Pour faire découvrir ce nouveau service un stand fut mis en place devant l’Agence Arcade lors du marché de Noël. |
En Meurthe-et-Moselle
A Fréménil c'est le 29 Juin 1911 que le chemin de
fer de LUNEVILLE à BLAMONT et à BADONVILLER est ouvert
au public. Les travaux de pose de la voie ferrée s'accompagnent
d'une plantation latérale destinée à supporter
les lignes aériennes du téléphone de la Compagnie.
Car la régulation des trains et la sécurité de
circulation sont assurées par le cantonnement téléphonique.
Chaque gare demande l'autorisation de circuler à la gare suivante
en s'assurant que la voie est libre. Le téléphone de l'LBB
installé pour son propre usage, suscite immédiatement
un besoin d'utilisation des supports, les poteaux téléphoniques,
pour implanter un service similaire, mais pour la desserte des communes,
à savoir les PTT (service des Postes, Télégraphes
et Téléphones).
La desserte terminale est "la cabine téléphonique".
En l'occurrence, pour notre commune, la cabine fait l'objet d'une plaque
émaillée portant la-dite mention et le poste mural est
installé chez Monsieur Christian ADAM, Maire de Fréménil
et par ailleurs Entrepreneur de broderie perlée (à l'époque
1 Rue de la Prairie) .
En ce temps-là, lorsqu'on voulait joindre un correspondant ,
il était nécessaire de passer par un central téléphonique
où opérait "la dame du téléphone"
qui, à l'aide de ses fiches (les jacks de communication), permettait
d'obtenir l'intéressé s'il était équipé
d'un poste de réception. Si ce n'était pas le cas, le
poste recevant l'appel pouvait prendre le message par écrit et
le remettre à domicile à l'intéressé.
Cela s'appelait un "message téléphonique". Ou
alors, le destinataire de l'appel téléphonique se déplaçait
au poste pour joindre l'appelant. Peu à peu le nombre de postes
privés est allé en s'augmentant permettant une relative
souplesse des communications.
La cabine téléphonique chez le gérant des PTT a
marqué un progrès dans le domaine de la communication
du territoire. Les postes à coffrets en bois et leurs sonneries
bruyantes caractéristiques ont maintenant disparu ou plutôt
font l'objet de collection pour les amateurs ou pour les musées.
Les habitants de nos villages ont compris bien vite tout l'intérêt
de l'équipement téléphonique. Mais, il faut en
convenir, ce ne fut pas une généralité, même
si l'on pouvait constater au fil des ans un accroissement des habitations
"branchées sur le téléphone".
Le service de "la cabine" tel qu'il était pratiqué
par la famille ADAM se termine dans les années 1970, mais le
relais est ensuite assuré par Mme et Mr Paul HENRY, 38 Grande
Rue, et ce jusqu'au 1er Avril 1988; ce qui permettait aux personnes
non équipées en téléphone personnel de contacter
malgré tout leurs interlocuteurs et surtout les urgences (médecins,
secours). Après la cessation de service de "la cabine"
de Mr Paul HENRY on aurait pu espérer l'installation d'une "vraie
cabine publique" telle que l'on pouvait trouver en ville avec utilisation
de monnaie, de jetons ou de cartes. Cette cabine publique devait même
s'implanter près du local communal (la salle des pompes). Cette
installation n'a pas eu lieu. Un essai timide et d'une efficacité
très limitée a été l'équipement de
l'abri-bus situé près de l'église avec un appareil
permettant d'appeler les secours (pompiers, gendarmes). Inconnu des
habitants, cet appareil l'était beaucoup plus des casseurs et
faisait régulièrement l'objet de dérangement.
Il faut constater que "le monde du téléphone"
a connu une évolution rapide et qui n'est pas terminée
avec "l'époque du portable". Aujourd’hui le portable
a lui-même évolué. Il permet toujours de téléphoner
à ses parents, à ses amis, à tous les services
mais il peut également recevoir la radio, prendre des photos
et envoyer à profusion des messages abréviés "les
SMS" très appréciés par la jeunesse!!
Le téléphone d'aujourd'hui connaît une véritable
révolution qui ne semble pas prête d'être terminée.
Dans l'AUBE le 13 février 1878 , une expérience
est réalisée à Troyes, entre le Moulin Notre-Dame
et le domicile de l’inspecteur du télégraphe.
La ville de Troyes est désignée pour être en 1883,
le siège du concours agricole de toute la région Nord-Est
de la France, la manifestation devant se tenir place Saint-Nicolas.
Un groupe d’industriels et de commerçants décident
d’organiser une exposition des Beaux-Arts place du Lycée
et une industrielle place de la Préfecture et à la Halle
aux blés. Le Conseil Municipal en profite pour demander au Ministre
des Postes et Télégraphes, la concession, pendant la durée
de l’exposition régionale, d’une liaison téléphonique
destinée à des auditions publiques. Troyes été
la première ville à faire cette expérience.
Le 7 août 1883 se tient au tribunal de Commerce, une première
réunion regroupant 40 des futurs abonnés (sur 62) qui
ont signé un engagement.
Le 1er avril 1884, la Ville de Troyes est l’une des 1ères
villes de France à être dotée du téléphone,
grâce à l’action conjointe de la Municipalité
et de la Chambre de Commerce qui avancent, chacune la moitié
des fonds nécessaires (25.500 francs) à la pose de la
1ère liaison Troyes-Paris le 22 mars 1891.
En 1900, c’est la même chose pour la ligne Dijon-Troyes-Reims,
en 1903, pour la pose du 2ème fil entre Troyes et Paris, et en
1908 pour la construction de 2 nouveaux circuits entre Troyes et Paris.
En 1903, il y a eu 43.682 communications entre Paris et Troyes, en 1906,
il y en a eu 59.208.
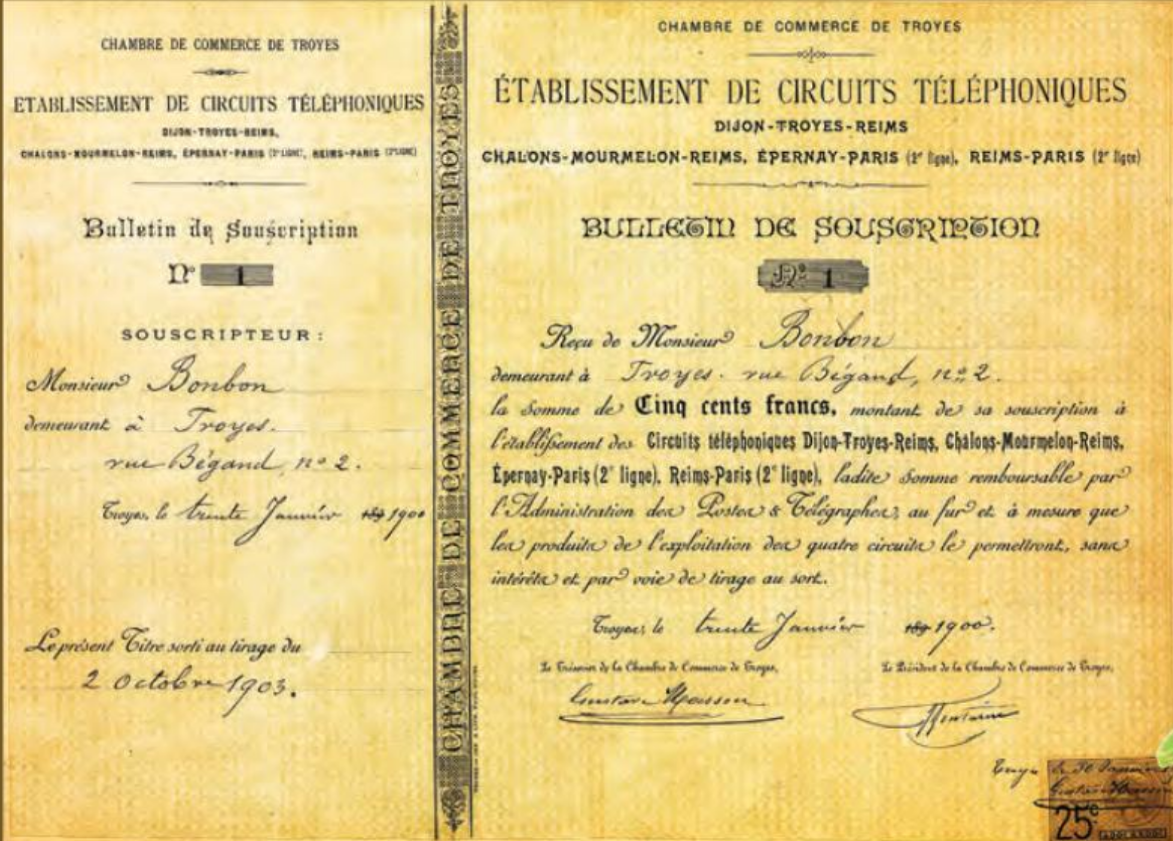
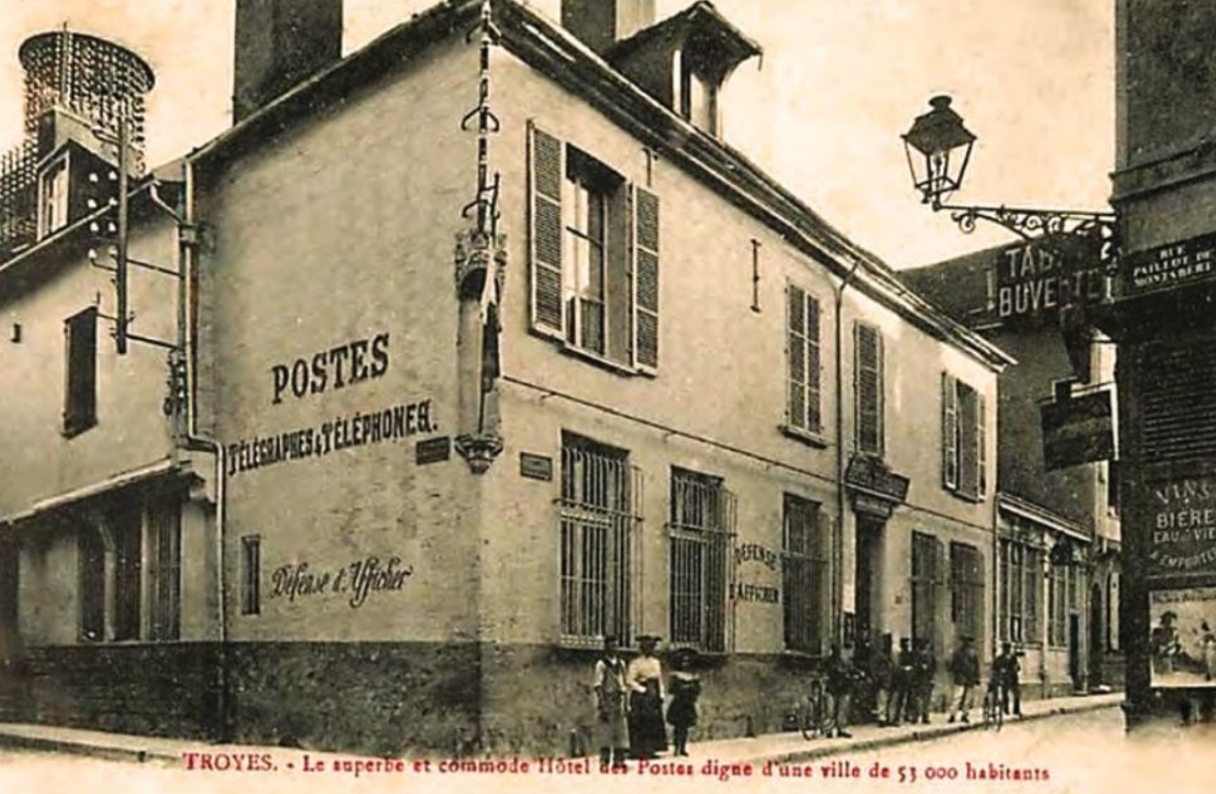

Le central est situé au bureau de poste de la rue Charbonnet
(la maison de Moïse), qui, dès 1909, devient vite exigu.
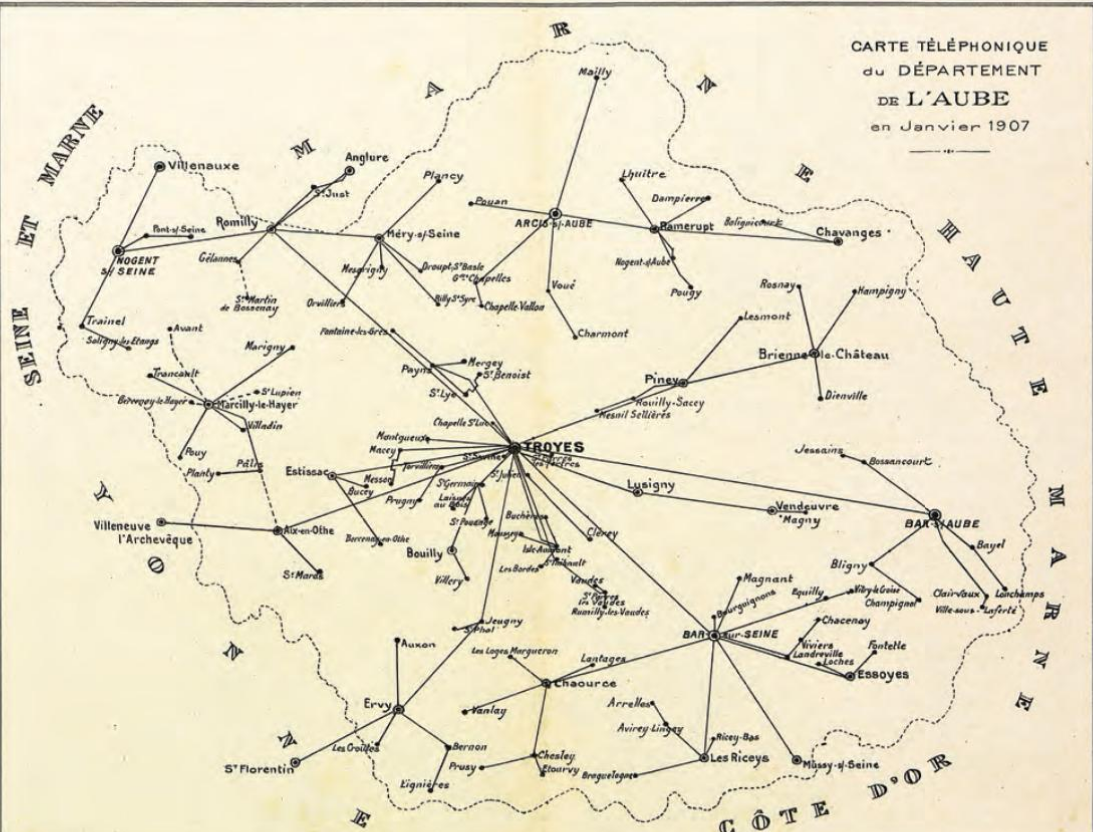
Au cours des premières années, les abonnés sont
appelés d’après leur nom ou la dénomination
de leur firme.
Au fur et à mesure de l’extension du service, cette pratique
s’avère source de difficultés et de lenteur. Afin
d’y remédier, l’Administration attribue à chaque
abonné un numéro.
Dès 1903, les annuaires indiquent ce numéro, en regard
du nom et de l’adresse de l’abonné.
Le nombre d’abonnés est au départ de 104, de 125
en 1884, de 149 en 1889, 177 en 1896, de 364 en 1903, de 678 en 1910
et de 1.527 en 1913. Dès 1901, pour permettre au public de communiquer
avec les abonnés, il y a une cabine publique à la poste
centrale. Il en coûte 25 centimes pour une communication maximale
de 5 minutes. Une deuxième cabine est installée au bureau
du Quartier-Bas fin 1902.
En 1910, le service de nuit est possible, grâce à la Chambre
de Commerce.
A la veille de la Première Guerre mondiale, le département
de l’Aube est le mieux équipé de France.
Lors du Conseil municipal du 9 juillet 1937, le rapport ci-dessous est
adopté :
« Par lettre du 14 mai dernier, M. le Directeur des Postes,
Télégraphes et Téléphones de l’Aube
fait connaître que son Administration envisageait la pose d’un
appareil téléphonique à prépaiement sur
la façade de l’Hôtel des Postes de Troyes. L’installation
de cet appareil permettrait d’obtenir, après la fermeture
du guichet du télégraphe, soit après 23 heures
les jours ouvrables et 19 heures, le dimanche et les jours fériés,
des communications urbaines et interurbaines pendant toute la nuit.
La seule réserve émise par l’Administration des Postes,
Télégraphes et Téléphones à cette
installation consiste dans la prise en charge par la Ville de Troyes
des dépenses d’éclairage du poste et de sa lanterne
de signalisation. L’éclairage de l’appareil ne fonctionnerait
d’ailleurs que pendant les périodes d’utilisation.
Seule la lanterne de signalisation serait d’ailleurs allumée
en permanence après 23 heures. Etant donné l’intérêt
incontestable que présenterait pour la population troyenne l’amélioration
envisagée par l’Administration des P.T.T., nous vous proposons
d’accepter la condition mise par cette Administration à
sa réalisation, c’est-à-dire de décider que
les dépenses d’éclairage qui en résulteront
seront à la charge de la ville »
Ce n’est qu’en 1927 qu’il s’installe
dans le bel immeuble " Jargondis " rue Raymond Poincaré.

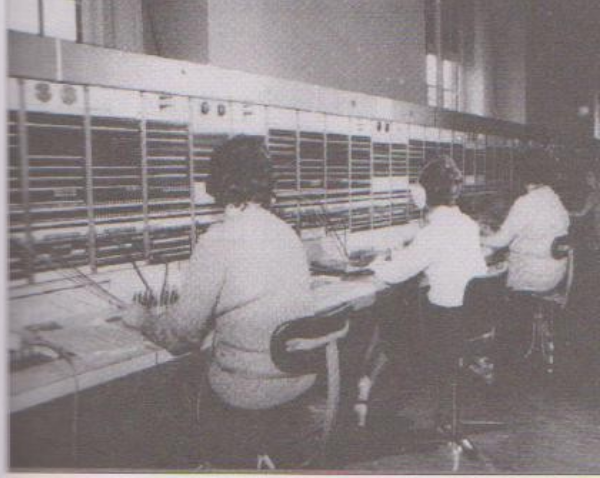
L’avantage qu’a pris la ville de Troyes en étant parmi
les premières villes à vouloir être dotées
du téléphone, lui a toujours été bénéfique.
C’est ainsi qu’en 1928, Troyes est la première ville
de France à être dotée d’un central automatique
urbain, et qu’en 1964, elle est une des premières villes
à recevoir un central automatique de 9.600 lignes. Le département
est entièrement automatisé, 2 années avant l’ensemble
du territoire français. Les cabines téléphoniques
fleurissent partout.
En 1975, sous l’impulsion du maire Robert Galley, ministre des
PTT, c’est l’établissement de communications interurbaines
de manière automatique, qui annonce la disparition des "
demoiselles du téléphone " !
Dans les Ardennes
Au village de La Romagne, le Préfet des Ardennes propose
en 1899 un projet d’organisation de réseau départemental.
Ceci nécessite la mise en place d’un très important
emprunt de 600 000 francs remboursable sur 30 ans. La Romagne pourrait
se rattacher à ce projet. Mais elle attendra 1906 pour que cela
soit effectif et que ce service assure aussi l’échange des
télégrammes.
Rares sont les particuliers qui possèdent personnellement une
ligne téléphonique jusqu’à l’après-guerre,
en dehors des Etablissements Malherbe qui ont été les
premiers. En 1954, le téléphone rural automatique est
installé à La Romagne. Le développement du fixe
et du portable fera disparaître définitivement ces cabines
du village.
L’ARRIVÉE DU TÉLÉPHONE
À CHARLEVILLE ET À MÉZIÈRES (Jean-François
Saint-Bastien)
Le samedi 22 février 1890, Édouard Joye, maire
de Charleville, tenait une réunion d’information avec la
commission chargée d’étudier l’établissement
d’un réseau téléphonique urbain à Charleville
et à Mézières. Le point central de ce réseau
était fixé au bureau de poste de Charleville,
place des Capucins (actuelle place Winston-Churchill), à partir
duquel un câble était déployé jusqu’à
l’installation de l’abonné.
Le coût de l’installation était aux frais du demandeur,
en fonction de la distance à parcourir entre le poste téléphonique
et le bureau central. Mais il ne s’agissait pas de la seule dépense
à prévoir pour se moderniser et se faire installer le
téléphone.
Un coût significatif pour tous. Un abonnement de trois ans devait
être contracté pour la somme de 200 francs par an et pour
se procurer, comme l’écrit Le Petit Ardennais,
« les appareils récepteurs et transmetteurs, sonnerie ou
appareils d’appel » qui devaient être reliés
au fameux câble. Il en coûtait encore entre 150 et 200 francs
en fonction du modèle de téléphone choisi. L’administration
se chargeait de l’installation et de la mise en route du téléphone.
Pour les établissements publics comme les restaurants, cafés
et hôtels, le coût de l’abonnement était doublé
!
Du superbe projet à la désillusion
Financièrement, la démarche n’était pas neutre
pour la municipalité qui avait la charge d’avancer le montant
des dépenses d’installation pour le compte de l’administration,
propriétaire du réseau. Les abonnements devaient permettre
à la ville de recouvrer cette dépense à concurrence
de la somme engagée. Le 5 mars 1890, Edmond Bouchez-Leheutre,
maire adjoint et rapporteur de la commission des finances compétente,
s’exprime devant le conseil municipal pour donner l’avis de
la commission sur l’établissement de ce réseau téléphonique.
« Elle ne pouvait évidemment que se montrer favorable à
la réalisation d’un si utile progrès », arguant
entre autres de la simplification des démarches commerciales
pour les industriels et les commerçants. Le rapporteur estimait,
en fonction du nombre escompté d’abonnés, que le
remboursement de la somme avancée pourrait être effectué
entre deux et quatre ans. Prudent, il préconisait néanmoins
que la ville s’assure a priori d’un nombre suffisant de promesses
d’abonnements avant de se lancer « dans cette entreprise
aussi tentante qu’elle soit ».
Alors, à l’issue de la réunion d’information,
un formulaire était mis à disposition des industriels,
commerçants et particuliers qui voudraient utiliser le téléphone,
et les réponses centralisées à la mairie. Le 15
avril 1890, certains Carolopolitains et Macériens reçurent
un nouveau courrier du maire rappelant les avantages du téléphone,
soulignant que la commission ad hoc « a la conviction que nos
deux villes et les environs renferment les éléments suffisants
pour mener le projet à bonne fin » et incitant les intéressés
à se faire connaître, « si vous étiez, comme
le pense la commission, disposé à contracter un abonnement
».
Tout était mis en œuvre pour faire aboutir ce projet. La
direction départementale de l’administration des Postes
et des Télégraphes à qui la circulaire avait aussi
été adressée pour information, écrivait
au maire pour souligner « l’intérêt que notre
administration attache à la création de ce réseau
» et demandant « votre avis particulier sur les chances
de réussite du projet ». Mais cette lettre arrivait à
la mairie quelques jours après la décision prise par les
édiles.
Le 31 mai 1890, le conseil municipal « après un sérieux
examen de la situation financière, constate avec regret l’impossibilité
où se trouve la Ville de faire l’avance des fonds relativement
importants que nécessiterait l’établissement d’un
réseau téléphonique à Charleville, surtout
en présence du nombre trop restreint de promesses d’abonnements
qui se sont produites à ce jour ».
L’enjeu tant local que national voire international était
tel qu’il n’était pas possible de renoncer au projet.
Des dispositions furent trouvées et permirent d’installer
le téléphone à Charleville et à Mézières.
Dès le mois d’août 1890, l’administration des
Postes et Télégraphes transmettait à la mairie
le tracé des premières lignes qui nécessitaient
d’engager
des travaux sur la voie publique, mais aussi sur le terrain de certains
particuliers, pour la pose des poteaux.
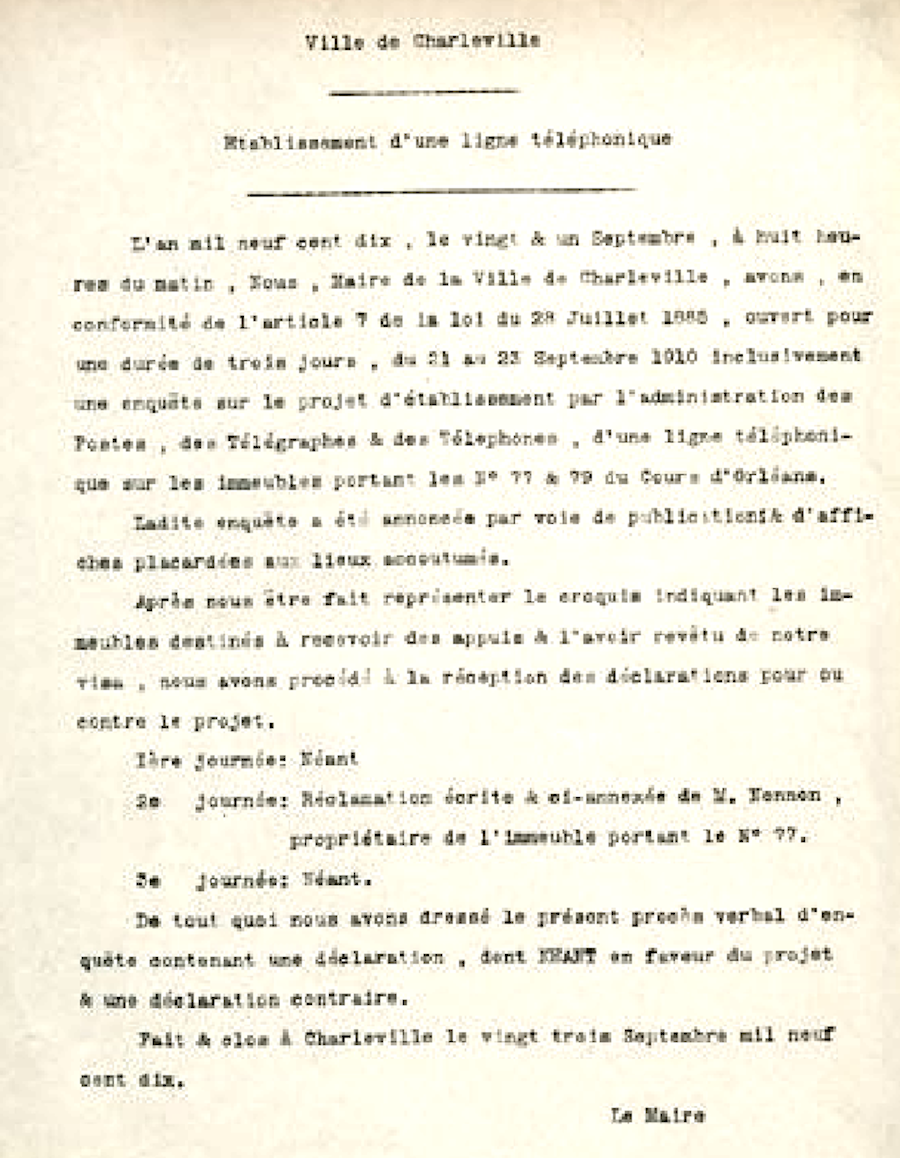
La municipalité était réglementairement tenue de
procéder à une enquête commodo incommodo pour prendre
en considération les observations ou réclamations que
la population était
susceptible d’émettre sur le projet. Pendant trois jours,
l’information était apposée sur la porte de la mairie
et faisait l’objet d’un procès-verbal transmis à
l’administration et au préfet. Il y eut autant d’enquêtes
que de lignes à établir !
Finalement, les industriels perçurent rapidement les avantages
du téléphone et s’abonnèrent comme ce fut
le cas, par exemple, de Faure qui fit établir une ligne entre
son usine de Laifour et son domicile carolopolitain. Pour son usage
propre, la mairie demanda l’installation de deux lignes téléphoniques.
Petit à petit, l’engouement pour cette technologie récente
se renforça et le téléphone devint un outil de
communication courant, jusqu’à devenir une extension de
soi-même avec nos téléphones actuels. Antan, l’on
se rappellera des dames téléphonistes qui assuraient avec
leurs fiches la liaison entre deux postes et le fameux « ne coupez
pas mademoiselle », ou encore le sketch de Fernand Reynaud, Le
22 à Asnières (1966) : « Allô ? New-York ?
Passez-moi le 22 à Asnières ! » Aurait-il eu plus
de chance s’il avait appelé le 22 à Charleville.
En Bretagne
A Saint-Brieuc, après une première expérience le 21 février 1878, entre l'Hôtel de Ville et la Chambre de Commerce, plusieurs commerçants demandèrent l'installation de lignes téléphoniques. En 1883, un entrepreneur relia son domicile à ses ateliers.
Dans le Morbihan en 1883, la Direction des Postes
et Télégraphes sollicite la mairie de Plœmeur pour
l’installation d’un bureau télégraphique dans
le bourg, Le conseil municipal refusera à plusieurs reprises.
Il faudra attendre 1895 pour que soit inauguré le premier bureau
télégraphique de Plœmeur »
En 1899, le projet de créer un réseau téléphonique
sur le Morbihan est à l’étude. Mais la ville refuse
de s’associer financièrement à cette création.
Elle n’est pas la seule. Les communes sont plutôt frileuses
face à l’arrivée de cette nouvelle technologie. En
1900, 16 communes sur les 45 ont adhéré au projet.
En 1904, la municipalité donne son accord pour établir
une ligne téléphonique reliant Lorient à Plœmeur.
En 1920, un poste téléphonique est installé à
la mairie alors que quelques particuliers « fortunés »
en sont déjà dotés. Durant quelques années,
le télégraphe et le téléphone cohabitent.
En 1927, la ligne téléphonique Lorient-Plœmeur est
doublée, mais à l’été 1930, seul le
bourg est équipé. Il faudra attendre encore quelques années
pour que le téléphone arrive sur la côte.
Au début des années 1970, le réseau téléphonique
s’étend et en 1974, la commune compte 4 cabines publiques
dans le bourg, à Fort-Bloqué, à Lomener et au Perello.
À Quimper, avant l’avènement des téléphones
fixes, les échanges transitaient par le télégraphe.
En 1853, le télégraphe électrique en système
morse arrive à Quimper, via la ligne Nantes — Vannes —
Lorient — Brest grâce à des lignes électriques
aériennes, qui suivaient le trajet des lignes de chemin de fer
et quelques années plus tard, la station télégraphique
de Quimper employait sept personnes. La poste était alors installée
dans la maison Rossi, à l’angle de la rue du Parc et du
quai du Steir. Pour plus de commodités, les deux services furent
regroupés, après des travaux d’agrandissement.
En 1889, treize ans après l’invention du téléphone
par Alexander Graham Bell, parvint à Quimper la première
demande d’installation téléphonique. Quelques années
après, les centraux téléphoniques intégrant
les services télégraphiques furent créés.
Les locaux Rossi étaient « inconfortables, misérables,
sombres et étouffants, froids l’hiver et chaud l’été,
et les demoiselles se plaignaient notamment du nombre insuffisant de
toilettes… Plusieurs rapports avaient signalé l’insalubrité
du bâtiment. Dans ce climat vindicatif, les mouvements de grève
nationaux furent vigoureusement suivis à Quimper, menés
par la hiérarchie et notamment Madame Jehanno, surveillante,
instigatrice de la grève, qui fait mettre en quarantaine les
employées qui ont continué leur service ! » lit-on
dans le journal du Finistère, en novembre 1880.
En 1908, les « demoiselles » assuraient le service télégraphique
et desservaient une cinquantaine d’abonnés au téléphone.
L’administration tenta d’améliorer en vain le confort
des locaux. En 1921, les postes furent mis en demeure de quitter les
lieux. Depuis des années, vu le développement des services
postaux et télégraphiques, l’État et la Ville
de Quimper ambitionnaient la construction d’un hôtel des
postes digne de ce nom. Un emplacement idéal fut trouvé,
situé boulevard de Kerguelen, dans un local appartenant au couvent
des sœurs de la Retraite, passage obligé entre le centre-ville
et le quartier de la gare, alors en pleine expansion. Mais les lenteurs
administratives et le manque de crédits contraignirent l’administration
à installer les opératrices et postiers « provisoirement
» dans les locaux de l’ancienne prison. Huit ans plus tard,
les postiers emménagèrent dans un superbe bâtiment
neuf, en juin 1929.
Landerneau voit l’arrivée du téléphone en 1895. À cette date, la mise en contact de deux abonnés est réalisée par une opératrice. Au XXème siècle, le téléphone se développe dans la ville. Le 13 novembre 1908, une cabine téléphonique est installée au bureau de poste de Landerneau. En 1935, des cabines à prépaiement sont implantées dans les quartiers de Kerloret, Bel Air et Traon Elorn.
A Pénestin Novembre 1899
A Brest, en 1885, c'est un commerçant qui demanda à installer une ligne entre son magasin et son entrepôt sur le port de commerce.
A Nantes, le téléphone fut reçu avec faveur. Dès le mois de mai 1881, c'est-à-dire quelques mois à peine après son ouverture, le réseau de la Société générale avait atteint un développement de 20 kilomètres et desservait plus de 40 abonnés dans cette ville .
Partant des apparences selon lesquelles le vivier des
consommateurs potentiels de nouveaux objets comme l’automobile
ou le téléphone est très étroit au début
du siècle, on serait tenté de concentrer l’attention
sur les seules élites oisives. Dans les Côtes-du-Nord,
par exemple, aux 45 premiers propriétaires de lignes téléphoniques
privées, ne s’adjoignirent que de maigres effectifs du réseau
général : 14 à Saint-Brieuc en 1899, 9 à
Dinan ; à côté de cela, 41 dans le Finistère
et, de manière inattendue, seulement 121 en Ille-et-Vilaine,
alors même que la ligne Paris/Rennes fut la première liaison
directe installée entre capitale et province en 1885.
Dans le Morbihan, 24 lignes privées sont accordées de
1888 à 1897 (15 à Lorient, 8 dans les différentes
îles, 1 à Vannes). Pour cet ensemble, guère plus
d’une conversation par jour et par abonné en moyenne. Et
il faut attendre 1922 pour atteindre le nombre significatif de 1658
abonnés.
Le“suréquipement des communes (...) se traduisit par un sous-équipement de la population”. De fait, et une fois financé le segment Rennes/Brest traversant le département (à hauteur de 475 000 francs, dont les 178 000 francs versés par le Conseil général), chaque commune pouvait se raccorder pour 600 francs, sans concert avec ses voisines, conduisant ainsi à la multiplication de réseaux locaux. Le réseau breton est organisé selon un décret du 21 mars 1900. En 1914, sur les 391 communes du département, 90 sont ainsi raccordées, mais 58 ont moins de 5 abonnés. Dans le Morbihan, l’arrivée du téléphone à Belle-Ile, Groix, l’Ile-aux-Moines (1908), Arz (1910), Hoëdic (1912), Houat (1914) fut aussi furieusement disputée, mais bien peu s’abonnèrent.
En 1914 dans les Côtes-du-Nord , 81 % des abonnés
proviennent du commerce ou des professions libérales, mais les
nobles ne comptent que pour 3 %
Connaissez vous la loi de Chaplin ?
Joyce Chaplin, est professeur d'histoire à Harvard. Et, dans
un article très intéressant récemment publié
par le site en ligne Aeon, elle résume ainsi sa « loi »
« tout appareil portable est l'aboutissement d'un équipement
plus ancien qui, autrefois, devait être porté à
deux mains et aujourd'hui se doit de tenir dans la paume d'une seule
».
Si un téléphone à fil nous paraît être
aujourd’hui un ustensile parfaitement désuet, cet objet
n’en demeure pas moins le fruit d’une patiente évolution
technique. Pour s’en convaincre, il suffit de se replonger dans
l’Echo de Lannion n°947, qui, dans son édition
du 11 septembre 1965, affirme triomphalement que « 80 pour cent
des abonnés au téléphone posséderont l’automatique
en 1970 »
La publication de cet article ne doit pas surprendre.
Depuis le milieu des années 1950, la cité costarmoricaine
marque un intérêt prononcé pour le développement
technologique et accueille même, à partir de 1963, un important
laboratoire du Centre national d’études
des télécommunications. On comprend donc que la presse
locale s’intéresse à un secteur qui pèse dans
l’emploi local même si, au final, le produit dont il est
question ici ne concerne que peu de monde. En effet, les chiffres évoqués
dans l’article donnent aujourd’hui le vertige.
On y apprend ainsi qu’en 1964, le nombre de téléphones
pour 100 habitants est de 11,85 alors qu’en 2008 on compte 68 millions
de téléphones portables en France ! Si les régions
parisienne, lyonnaise et marseillaise sont de ce point de vue les plus
développées, les Côtes-du-Nord et le Morbihan comptent
parmi les départements où l’on recense le moins de
terminaux. Et encore faut-il préciser que ceux-ci sont reliés
à des centraux manuels, où une opératrice vous
connecte à la ligne du correspondant que vous souhaitez joindre.
On comprend dès lors mieux en quoi consiste le fameux téléphone
automatique que 80% des abonnés devraient posséder en
1970 à en croire l’Echo de Lannion…
En définitive, le principal défaut de la « loi de Chaplin » est de masquer le rythme du progrès. Loin d’être constant, celui-ci s’effectue parfois au gré de surprenantes accélérations du temps, dont rend parfaitement compte l’article de cet hebdomadaire breton. Car si l’on ne compte que six millions d’abonnés au téléphone en 1964, on n’en recense que deux dix ans plus tôt ! Plus intéressant encore, les équipes du CNET de Lannion commencent dix ans plus tard, avec leurs collègues rennais, à développer les premières technologies télématiques, ancêtre de l’internet qui nous est aujourd’hui si indispensable et qui vous permet de lire cet article.
1923 L’arrivée tardive du téléphone
à Saint-Urbain
Les extraits issus des registres des conseils municipaux de Saint-Urbain
sont reproduits en « italique » avec leurs éventuelles
fautes d’orthographe.
1911 : un net refus La première évocation
de la mise en service du téléphone date du conseil municipal
du 18 juin 1911, dans lequel le conseil décline la proposition
d’installation du téléphone par le Préfet...
« à cause des nombreux emprunts qu’il a déjà
faits, de ne pouvoir accepter la dite proposition, malgré l’insistance
de Mr Le Gall et le don généreux de 25 francs offert par
Mr De Boisanger ». Aujourd’hui ce refus à posteriori
nous paraît totalement incompréhensible.
1913 : des réticences. Le 30 mai 1913, le sujet
est de nouveau d’actualité. Mais le conseil « est
d’avis qu’il soit d’abord procédé à
une enquête pour connaître les engagements financiers incombant
de ce fait à la commune, tant pour l’installation elle-même,
que pour la continuation du service et désigne comme devant faire
partie de la commission d’enquête messieurs De Parcevaux,
adjoint, Toulec, conseiller et Cloarec, menuisier. »
La séance du 8 juin 1913, à huit heures du matin nous
évoque « le rapport présenté par la commission
d’enquête » Le détail est ainsi exposé
:
- remboursement annuel pour emprunt 50 F
- traitement annuel du gérant 100 F
- location annuelle d’une cabine téléphonique 25
F
plus les frais d’installation d’une cabine 50 F. Le total
général est donc de 225 F. »
Cette année 1913 ne verra pas l’arrivée du téléphone
car « le conseil après avoir délibéré,
vu les dépenses qu’il faut engager [...] vu l’état
peu propice des finances de la commune qui est obligée d’avoir
recours annuellement à un vote de 14 à 15 centimes pour
insuffisance de revenus décide qu’il y a lieu de surseoir
à l’installation du téléphone jusqu’à
création dans la commune d’une taxe d’octroi sur l’alcool.
» Demande de création qu’elle fait ce jour-même
à l’administration.
La séance du 28 novembre 1913 présente les modalités
du futur octroi. Ils veulent un octroi sur une « période
maxima » , « sur toute l’étendue de la commune
», « que les produits taxés soient l’alcool
pur contenu dans les eaux de vie, esprits, liqueurs absinthes »,
« que la taxe soit élevée à quinze francs
par hectolitre. »
1914 - 1919 : d'autres priorités puis une avancée
La guerre mondiale de 1914-1918 va freiner l’arrivée
du téléphone. Les priorités se trouvent ailleurs,
et le projet ne ressurgit que lors de la séance du 27 février
1918, quand la commune décide de prolonger l’octroi sur
les alcools, justifiant sa décision par les dépenses futures,
« vu que le téléphone sera un jour venant très
probablement installé dans la commune. » La taxe est prolongée
jusqu’au 31 décembre 1924.
Lors de la session du 19 mai 1919, le conseil réagit comme en
1913, et s’il « est d’avis, en principe, qu’il
y a lieu d’installer un téléphone dans la commune.
mais désire d’abord connaître les engagements financiers
incombant à la commune tant pour l’installation elle-même
que pour la continuation du service ». et décide de «
faire une enquête pour connaître le prix du local téléphonique
et le traitement demandé par la personne chargée de recevoir
et de distribuer les messages. »
1920 : enfin une demande favorable
Le 26 décembre 1920, « Monsieur le Maire donne
lecture de la lettre de M Le Directeur des Postes et Télégraphes
du Finistère » qui « donne des renseignements des
plus précis. » et le conseil municipal, « comme il
en a déjà exprimé le désir demande à
l’unanimité que la commune soit doté du service téléphonique.
» L’arrivée du téléphone semble imminente.
Le 27 février 1921, le conseil « renouvelle
sa demande d’incorporation au réseau téléphonique
départementale et prend l’engagement
- de mettre gratuitement à la disposition de l’Administration
des Postes un local pour l’installation du téléphone
- d’assurer les frais d’aménagement sous la direction
de l’administration des Postes de la cabine téléphonique
- de supporter les frais de gérance du téléphone,
ainsi que ceux de la distribution des télégrammes et des
avis d’appels téléphoniques »
La demande est renouvelée en novembre 1921 à l’Administration
faute de réponse de sa part.
1923 : l'aboutissement
Le 15 février 1923, les douze membres du conseil prennent
« connaissance des instructions générales données
par M le Directeur départemental des Postes et Télégraphes.
» Histoire téléphone et « décide»
- Mlle Pédel Marie Joséphine, débitante de tabacs,
maîtresse couturière habitant la maison proposée
pour l’installation de la cabine téléphonique serait
la gérante du téléphone et sa sœur Mademoiselle
Pédel Marie-Yvonne cohabitant avec elle et de même profession,
la gérante-suppléante.
- Mlle Le Roux Marie, la distributeuse et Madame Callec Guillaume, la
distributeuse-suppléante, toutes deux de bonne conduite et journalières
au Bourg.
La distribution ne serait gratuite que pour le bourg seulement : les
habitants hors l’agglomération paieraient à raison
des kilomètres parcourus
L’indemnité à payer à la gérante est
fixée à titre d’essai pour la première année
à 250 francs... »
1933 Arrivée du téléphone à
Cesson-Sévigné
L'annuaire téléphonique de 1933 comptait 10 abonnés.
Celui de 1935, pour 1902 habitants, en liste 14, dont 5 restaurants
cafés ainsi présentés :
4 Clause, restaurateur, pont de Cesson-Sévigné
13 Café-restaur. du Pont de Cesson, Chantrel (A.)
6 Marre (E) restaur., mécan., La Friture
15 Mouton (J.), taxis, locat., Café, Croix-Noblet
10 Pitort, pâtisserie, restaurant
Les autres abonnés sont: un négociant, deux bouchers et
un courtier en bestiaux, un minotier, un expert, trois particuliers,
aucun médecin.
Au début des années 1950 il y a moins de 40 abonnés
au téléphone à Cesson-Sévigné. Ils
accèdent alors au service universel. C'est à dire qu'ils
ont la possibilité d'obtenir des communications jours et nuits
par l'intermédiaire d'une opératrice.
Auparavant le service était assumé de 8h à 12h
et de 14h à 19h en semaine, de 8h à 11h les dimanches
et jours fériés. Au début des années 1960
les abonnés sont raccordés à l'automatique. Ils
composent le numéro de leur correspondant au cadran.
1923 LES RELATIONS TELEPHONIQUES à CALLAC
1902 : Un bateau scandinave, en route pour les États-Unis
d'Amérique, est pris dans une très forte tempête
dans la Manche. Les très graves avaries subies contraignent le
capitaine à faire escale à Brest. Le bateau mis en cale
sèche, et il nécessite entre quatre et six mois de réparations.
Un ingénieur présent à bord prend alors une décision
qui sera lourde de conséquences : il décide de décharger
la cargaison et de tenter de la vendre sur place. C’est de cette
manière que les quatre premiers autocommutateurs
manuels (Ericsson) entrent sur le sol français.
Ayant vendu ces « centraux téléphoniques »
en un temps record, l’ingénieur en question commande alors
d’autres exemplaires à sa maison-mère et crée
une structure locale pour leur commercialisation et leur entretien.
La société Ericsson-France est devenue par la suite Société-Française-des-Téléphones-Ericsson,
puis Société-Française-des-Téléphones,
puis Thomson-CSF-Téléphone, puis Alcatel.
Et c'est aussi pour cette raison que les principaux centres de recherche,
tant d’Alcatel que de France Télécom, se trouvent
dans la région de Brest.
1913 : Le téléphone automatique fait ses débuts
en France.
Le téléphone à Callac arrive en 1923.
M. Yves Le Trocquer, ministre des Travaux Publics, avait appelé
l'attention du directeur des Postes des Côtes-du-Nord sur la nécessité
urgente d'améliorer les relations téléphoniques
de Callac et sa région. En réponse, le directeur des Postes,
lui à fait connaître qu'un nouveau circuit était
à la veille d'être établi et mis en service, au
plus tard le 1er mai 1923.
Grace à cette liaison, le canton de Callac disposera désormais
de deux circuits ; un circuit direct Guingamp-Callac et le circuit commun
Guingamp-Bourbriac-Callac, en outre, la liaison commune Callac-Plougonver-Belle-Isle-en-Terre
sera réalisé avant la fin de l'année.
Enfin, la liaison directe Callac-Locarn-Maël-Carhaix, est prévue
pour le début de 1924. Ainsi cette région, jusqu'ici déshérité
quant au relations téléphoniques sera desservie désormais
dans des conditions tout à fait satisfaisantes.
M. Yves Le Trocquer n'oublie pas que le berceau de sa brillante vie
politique fut en quelque sorte cette bonne ville de Callac. Fouéré,
Yann- écrivain autonomiste , fut Directeur du secrétariat
du ministre guingampais, Yves Le Trocquer et conseiller municipal de
Callac.
A Mordelles, en 1900, la Poste de Mordelles
est située place de l’église.
Sur la photo ci-dessous, l’appellation « Postes et Télégraphes
» provient de la fusion de l’administration des services
postaux et télégraphiques.
Les Mordelais peuvent alors communiquer par télégrammes.
C'est un service extrêmement rapide et fiable pour l’époque.
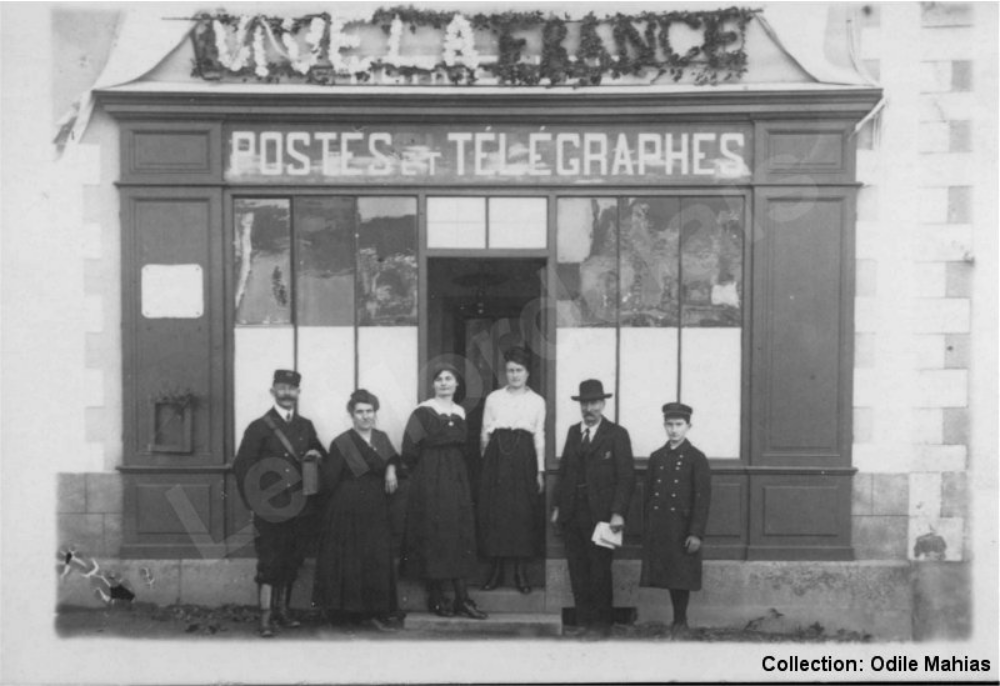 Tout à fait en haut de la façade, la déclaration
sous forme de décoration florale, « vive la France »,
indique que cette photo a été prise pendant la première
guerre mondiale. En tenue de facteur avec sa sacoche en bandoulière,
Louis Holland se tient à gauche. C’est un personnage important
dans le village et connu de tous. Ex-soldat au 18e escadron du train
des équipages, il est nommé facteur à Mordelles
en juin 1907. Mademoiselle Lejeune, receveuse des postes et télégraphes
à cette époque, doit probablement figurer sur cette photo.
Louis Holland, M. Fouville et Placide Robin sont les tout premiers facteurs
à avoir exercé dans la commune de Mordelles au début
du XXe siècle.
Tout à fait en haut de la façade, la déclaration
sous forme de décoration florale, « vive la France »,
indique que cette photo a été prise pendant la première
guerre mondiale. En tenue de facteur avec sa sacoche en bandoulière,
Louis Holland se tient à gauche. C’est un personnage important
dans le village et connu de tous. Ex-soldat au 18e escadron du train
des équipages, il est nommé facteur à Mordelles
en juin 1907. Mademoiselle Lejeune, receveuse des postes et télégraphes
à cette époque, doit probablement figurer sur cette photo.
Louis Holland, M. Fouville et Placide Robin sont les tout premiers facteurs
à avoir exercé dans la commune de Mordelles au début
du XXe siècle.
Si depuis plusieurs années, il existe à Mordelles un réseau
télégraphique et postal, il faut attendre 1912
pour que les habitants puissent bénéficier du téléphone.
En 1914, seuls quelques privilégiés se voient attribuer
le téléphone, la majorité des habitants devant
se rendre au bureau téléphonique probablement situé
place de l’église dans les locaux de la poste et des télégraphes.
Ainsi, en 1914 on ne recense que 12 abonnés.
Les numéros sont attribués de la manière suivante
:
le numéro 1 au docteur Georges Gateau
le numéro 2 au notaire Eugène Angot qui réside
au domaine de la Perruche.
le numéro 3 à Hubert - Baudais, commerçant de grains,
pommes et cidre en gros
le numéro 4 à Joseph Hubert, marchand de grains
le numéro 5 au comte Odon de Toulouse Lautrec du château
de la Haichois
le numéro 6 au vicomte Henri de Farcy du Château de la
Villedubois
le numéro 7 au maire Paul de Farcy du château de la Chesnaye
le numéro 8 au vicomte du Boberil du château du Molant
(Bréal-sous-Montfort)
et le numéro 12 à la caserne de gendarmerie du domaine
de l’Ecu.
A Vannes Le central téléphonique
dans l'avenue de la Marne fut construit en « 1938 par l’entrepreneur
vannetais Groleau sur les plans de l’architecte en chef des PTT
(Postes, Télégraphes et Téléphones) Fernand
Moineau et selon un modèle standardisé », dévoile
François Ars.
Construit en retrait de la route et complètement isolé
au moment de sa construction, le bâtiment en béton armé
possède une cage d'escalier semi-circulaire à l'angle
et les lettres PTT sont fixées sur le mur de façade rappelant
ainsi le nom du propriétaire. Les décorations de la façade
ainsi que l'utilisation de granit montre une volonté d'intégration
dans le style de la région. La construction terminée fait
l'objet d'un procès en raison de l'apparition de fissures dans
les planchers due aux batteries en plomb très lourdes qu'ils
supportaient. Le procès est gagné par l'entreprise Groleau.
En 1941 les Allemands le transforment en central téléphonique
militaire. Épargné par la guerre, il poursuivit sa mission...
...
1964 La Bretagne, du point de vue téléphonique
comme de beaucoup d'autres, est sous-équipée (3,7 à
5,5 postes par 1.000 habitants contre 9,4 pour la moyenne française)
progresse moins que le reste du pays, use donc moins du téléphone.
Les communications y sont surtout d'intérêt régional.
Rennes effectue 54 % de ses communications avec la Bretagne, Brest 76
%, Lorient 73 %, St-Brieuç 79 %. L'étude des flux intrabretons
(au sens de la région de programme aux quatre .départements,
sans la Loire-Atlantique) révèle la nette- prédominance
de Rennes comme métropole régionale. Non seulement elle
lance à elle seule 2 fois plus d'appels interurbains que Brest,
4 fois plus que Lorient, Quimper ou Saint-Brieuc, mais encore elle est
seule à communiquer couramment avec toute la Bretagne ; à
ce titre Nantes ne peut absolument pas lui être comparée.
Cependant le trafic intense n'intéresse guère que le département
même, auquel il faut ajouter en première ligne les circonscriptions,
Ploërmel, Dinan, Saint-Brieuc et Loudéac, plus modestement
celles de Vannes, Lorient, Carhaix, Brest, Lamballe et Guin- gamp. Le
rôle de métropole n'efface donc pas le rôle attractif
d'un certain nombre d'autres villes. On peut les classer en deux groupes
: six centres principaux (Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Lorient, Vannes,
Saint-Malo), 10 centres secondaires (Fougères, Vitré,
Redon, Dinan, Lannion, Pontivy, Morlaix, Concarneau, Douarnenez, Quimperlé).
On remarque non sans étonnement que Vannes, encore peu industrialisée
effectue un trafic téléphonique analogue en importance
à celui de Lorient deux fois plus peuplée et que la Bretagne
centrale apparaît assez démunie de villes-centres.
1973 en Bretagne, trois semaines en moyenne suffisent pour obtenir
le téléphone.
Du moins dans les grandes villes, telles Brest, Lorient, Rennes... Ainsi,
sur cinq demandes " bretonnes ", trois sont satisfaites très
rapidement. Une plus longue patience, en revanche, est toujours exigée
des futurs abonnés résidant dans des agglomérations
rurales : pour eux, toutefois, grâce à une " astuce
", l'obstacle du coût de l'installation est en grande partie
levé. L'idée est venue de la direction régionale
des télécommunications de Rennes. Grâce à
un prêt-relais accordé par le Crédit mutuel agricole,
les futurs abonnés ruraux des quatre départements de l'extrême
Ouest n'ont plus à verser ni " part contributive "
ni " avance remboursable ". Celle-ci, jusqu'à présent,
leur était remboursée par l'Etat, au fil des années,
sur leurs dépenses de téléphone. Il fallait en
moyenne dix ans pour que l'administration parvienne à effacer
sa dette, le coût annuel moyen des factures téléphoniques
étant de l'ordre de 500 F et la " participation " (part
contributive et avance remboursable) des abonnés au téléphone
des villages s'élevant en moyenne à 5 000 F.
Car, bien que les P.T.T. soient devenus, en trois ans, le plus important
investisseur du pays (80 milliards de francs), ravissant ce titre à
l'E.D.F., elles ne disposent toujours pas de suffisamment d'argent pour
regagner une partie du temps perdu dans l'équipement téléphonique
du pays. Si dans les villes et aussi dans certains bourgs ruraux, là
où le réseau est dense, le rattachement d'un futur abonné
n'est pas trop coûteux pour l'administration (il n'est pas nécessairement
rapide, si les lignes manquent), les frais sont de dix à douze
fois supérieurs lorsqu'il faut lancer une ligne pour relier au
réseau un habitant vivant dans un hameau trop éloigné...
Lancé au début des années soixante-dix sous l'impulsion
d'un breton, Pierre Marzin, le plan français
"de rattrapage du téléphone" a été
mis en oeuvre avec succès par la Direction générale
des télécommunications, devenue depuis France Télécom.
 Pierre Marzin.
Pierre Marzin.
Après des décennies de passivité, ce plan a nécessité
une véritable mobilisation des personnels de l'exploitant public
et un important effort d'investissement chez les industriels français
du secteur : les télécommunications françaises
sont ainsi entrées dans leur maturité ; elles ont même
acquis une renommée mon diale. Durant les trente dernières
années, l'histoire des télécommunications françaises
et le développement économique de la Bretagne sont restés
étroitement associés, avec leurs heures de gloire, leurs
prouesses techniques, mais aussi leurs aléas notamment en matière
d'emploi industriel.
La recherche, c'est par elle dit-on que tout commence, c'est bien avec
elle qu'a commencé l'aventure commune, dès 1960, avec
la décentralisation (on ne disait pas encore "délocalisation")
des laboratoires du CNETP" à Lannion, une des rares décentralisations
réussies selon la presse de l'époque, symbolisée
dès 1962 par l'établissement de la première liaison
télévisuelle transatlantique par satellite, entre
Andover et Pleumeur-Bodou.
Par la suite, progressivement, la Bretagne est devenue un pôle
d'excellence pour la recherche en télécommunications,
le premier en France devant Grenoble, Sophia Antipolis et sans doute
même devant Paris.
Le CNET Lannion réunissait 1500 personnes,
dont 500 chercheurs. C'est le berceau de la commutation électronique
française puis du réseau numérique à intégration
de service (numéris), le premier centre
de développement français pour la fibre
optique, etc. Créé dix ans plus tard à Rennes,
en 1972, le Centre commun d'études de télédiffusion
et télécommunications (CCETT) mobilise environ 300 chercheurs
de haut niveau avec des études portant sur Télétel,
la Télévision haute définition, les terminaux multimédias,
le traitement des images et du son, les réseaux de vidéo
communications, etc. Dans l'orbite du CCETT, Transpac,
société filiale de France Télécom, a installé
à RENNES sa direction technique (250 personnes). Le réseau
public français de transmissions de données que Transpac
exploite, le plus grand réseau commuté de données
au monde, est en effet sorti des laboratoires du centre.
En 1977, l'Ecole nationale supérieure des télécommunications
de Bretagne, dite "SupTélécom Bretagne", a été
implantée pour les trois quarts sur la rade de Brest, pour un
quart sur le site de Rennes-Atalante. Cette école, dont la réputation
dépasse largement les limites de l'hexagone, forme des ingénieurs
destinés à des carrières internationales au sein
des entreprises françaises, comme France Télécom.
En aval de ces activités de recherche, et en plus des services
territoriaux relevant de la Direction régionale de France Télécom
à Rennes (chiffre d'affaires 4 milliards de francs, 3 600 salariés
dont 600 cadres, investissements proches de 1 milliard de francs en
1991), la Direction générale de France Télécom
a choisi l'agglomération rennaise pour implanter son centre de
Maintenance, d'exploitation, de gestion et d'assistance à la
télématique (le MEGAT) et celle de Lorient pour implanter
son unique centre de fabrication de matériels, les Ateliers de
Lanester, qui emploient 700 personnes Au total, 1'"impulsion"
ainsi donnée par France Télécom emploie par elle-même
une dizaine de milliers de travailleurs de tous niveaux. Mais bien entendu
l'objectif n'était pas de créer quelques îlots technologiques
perdus dans un environnement décalé. Il était bien
de provoquer un effet d'entraînement s'appuyant sur l'esprit d'entreprise
de la région, à l'image de la Société lannionaise
d'électronique (SLE), filiale d'Alcatel créée
dans la ligne des recherches sur les transmissions numériques
effectuées dès les années soixante à Lannion,
ou de l'entreprise rennaise de 300 personnes OST créée
par un ancien ingénieur de TRANSPAC.
L'effet "boule de neige" espéré a souvent été
réel. C'est ainsi que les initiatives de Pierre Marzin et de
France Télécom ont entraîné la présence
de tous les grands noms de l'industrie française des télécommunications
en Bretagne : Alcatel à Lannion, Tréguier et Brest, Thomson
à Brest et Cesson-Sévigné, Matra à Quimper,
Douarnenez et Rennes, SAGEM-SAT à Lannion, Fougères et
Dinan, etc. Et cette présence des "grands" a été
complétée par la création de nombreuses PMI du
secteur électronique. Un symbole de cette symbiose réussie
entre recherche, formation et industrie est donné par la "technopole"
de Rennes-Atalante, nouveau fleuron de l'agglomération rennaise.
Il faut toutefois rappeler que le développement des industries
électroniques bretonnes, dont les télécommunications
constituent un des principaux débouchés, ne s'est pas
toujours fait sans à-coups : les variations de la croissance
en consommation de services provoquent des fluctuations croissance-décroissance
dans les programmes d'équipements des prestataires. Cela a été
notamment le cas pour l'opérateur public après la mise
en
œuvre de son "plan de rattrapage du téléphone",
malgré ses efforts pour lisser les commandes. A ce phénomène
qui n'est propre ni à la Bretagne, ni au secteur des télécommunications
(cf le secteur informatique), se sont ajoutées les fortes variations
de productivité liées au passage des technologies électromécaniques,
qui nécessitaient une main d'oeuvre nombreuse et particulièrement
qualifiée, aux technologies électroniques qui n'ont pas
les mêmes besoins. Les conséquences de cette situation
dans le Trégor et le Haut Léon n'ont sans doute pas été
tout à fait oubliées...
Au printemps 1963, le projet PLATON
est lancé, l'aventure du central téléphone numérique
temporel commence , lire les pages Pierre
Marzin et Alcatel. Les premiers commutateurs
élecroniques de Perros-Guirec et de Lannion ont
montré des performances assez encourageantes pour faire prendre
la décision de lancer la fabrication d’une présérie
de commutateurs que l’on va désormais appeler E10.
Cette décision a sans doute été facilitée
par le fait que Pierre Marzin était depuis 1968 directeur de
la DGT (Direction Générale des Télécommunications),
responsable de l’équipement et de l’exploitation du
réseau français.
Les deux premiers sites retenus sont Guingamp et Paimpol, dépendant
de la Direction Régionale de Rennes.
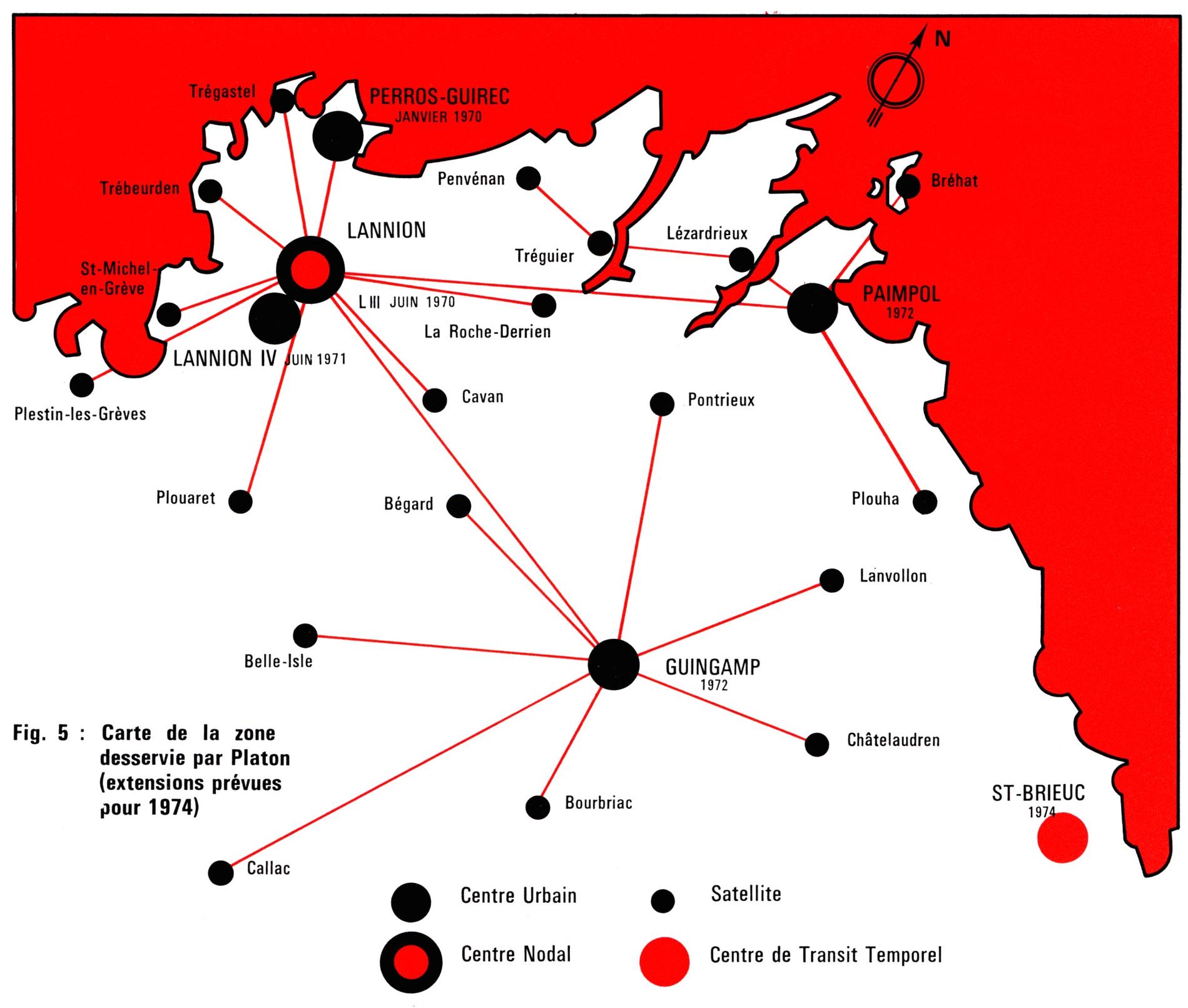
Le système E10 et ses évolutons sera généralisé
en France et installés dans de nombreux pays du monde.
sommaire
Dans la région Nord Pas de Calais
C'est en mai 1880 que la première demande de réseau a
été déposée à la Compagnie des Téléphones
de PARIS avant la création de la SGT.
LILLE, renouvelle sa demande à la SGT, débattue
par le Conseil Municipal à la Séance du Mardi 7 Juin
1881
|
M. Rochart présente le rapport suivant
au nom de la Commission des travaux : Enquête ouverte par l’administration
Tarif d’abonnement |
Pour Lille, l'aventure commence, le bureau est
installé au 3 de la place de la gare, les lignes sont construites
sur le toit des immeubles, le réseau est inauguré le 1er
mai 1882 avec 26 lignes et 94 demande sont en attente.
Le 1er avril 1883 se sera le tour de Roubaix-Tourcoing qui ouvrira son
réseau.
Le téléphone à Tourcoing
Voici un extrait des souvenirs retrouvés dans « Tourcoing
Mon pays » de Jean Christophe.
Un jour, il demande à sa mère, 90 ans en 1977, de retrouver
son plus grand souvenir. Après réflexion, elle se met
à dire : Ce qui m’a le plus frappée, c’est le
téléphone. J’ai cru que c’était un miracle.
On venait d’installer les appareils à Tourcoing. Mon mari
était à Paris. Quand j’ai reconnu sa voix dans cette
sorte de boite à malice, j’en étais éberlué.
Une voix qui venait de si loin … »
Sa mère et les tourquennois de son temps auraient pu parler de
la même manière dix ans plus tôt.
Une raison toute bête empêcha le ministre de doter notre
ville d’un des tout premiers réseaux téléphoniques
du pays. Celui de Paris fonctionnait depuis 1879.
Le nombre d’abonnés dépassait 3000 en 3 ans. Le ministre
se pris d’enthousiasme pour ce moyen de communiquer et de traiter
les affaires. Il rêvait d’établir un réseau
à titre d’expérience, entre de 2 villes industrielles
de son choix.
Dans une lettre datée du 18 mai 1883, M. Devau écrit à
la mairie de Tourcoing : « Monsieur le Ministre, voulant voir
s’il était possible pour l‘Etat d’installer le
téléphone dans de grandes villes sans risquer de mécomptes,
a songé à faire un essai à Tourcoing et à
Reims où la multiplicité des affaires devrait rendre la
tentative concluante … »
Le maire, M. Victor Hassebroucq, adressa une lettre à «
MM. les Industriels, Commerçants et autres intéressés
de la ville ». Il les prévenait du projet du ministre et
leur demandait de s’abonner sans tarder : « il est indispensable
qu’on se presse, disait la lettre, mais, l’engagement deviendrait
nul et non avenu si, pour une raison ou une autre, l’Etat ne se
trouvait pas en mesure de tenter l’essai dont il s’agit, …
».
C’est ce qui arriva. La ville de Tourcoing, offrit au ministre
des bureaux sous les arcades de la vielle mairie Grand-Place. Le ministre
n’en voulu pas. « Il entendait n’avoir d’autre
partie contractante que le maire », or les bureaux appartenaient
à la commission syndicale de la Bourse du commerce. Pour ce motif,
les pourparlers traînèrent en longueur. Les roubaisiens
mirent à profit notre retard. Le téléphone fonctionnait
très bien chez eux alors que les Tourquennois cherchaient encore
un lieu pour y installer le poste central.
Bientôt, le ministre se montra plus arrangeant. On rattrapa le
temps perdu. Une des plus anciennes photographies de la Grand-Place
montre, sur le toit de St Christophe et sur le toit de la vielle mairie
des herses qui soutienne les fils de téléphone (une soixantaine
de ligne), elles se multiplieront à vue d’œil.
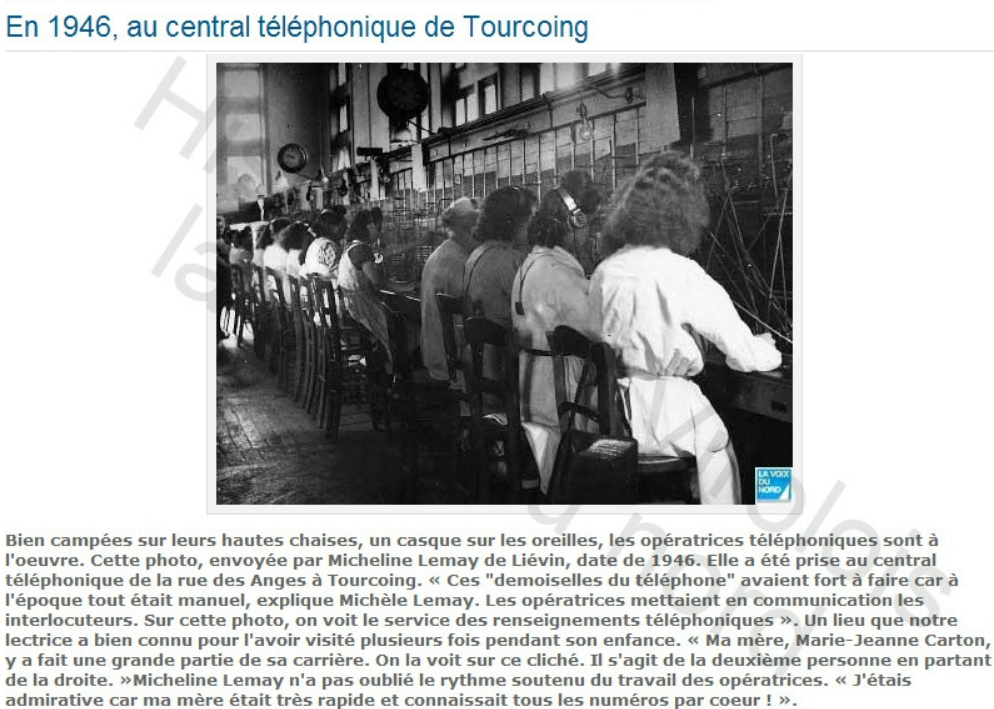
Au fil des évolutions, le poste central changera de place : la
vielle maire, rue de l’Hôtel de Ville, place Charles et Albert
Roussel et enfin son lieu actuel.
En Auvergne-Rhône-Alpe
A Bourg-en-Bresse l’un hôtel des postes et du télégraphe,
est ouvert le 21 juin 1895, lorsque le Conseil municipal décide,
le 9 juillet 1896, pour y installer le téléphone. Il répond
ainsi à un « mouvement de l’opinion en faveur de l’installation
à Bourg du service téléphonique. » Se pouvant
être rattaché au circuit de Paris, Lyon, Marseille, la
liaison se fera à Lyon qui « présente cet avantage
que, pour les communications avec Paris, Bourg n’aurait ainsi qu’un
intermédiaire. La dépense de construction (…) ne
sera qu’une avance faite à l’État. »
L’étude est lancée pour une ligne qui suit la voie
de chemin de fer jusqu’à la gare de Bourg et, de là,
elle sera souterraine jusqu’à l’hôtel des postes.
Impatients, réunis au tribunal de commerce, « 47 négociants
et industriels demandent, à Bourg, la création d’un
réseau téléphonique et le rattachement de ce réseau
au réseau national ». Ils souhaitent surtout que la ville
se décide à financer le projet. Elle accepte et une convention
est ensuite signée avec le ministère.
Il faut donc créer le départ du réseau aérien
urbain. La ville sollicite l’architecte Tony Ferret pour «
dresser un plan, avec devis, de la tourelle destinée à
la concentration des fils du réseau téléphonique
projeté à Bourg » et lui demande que « son
aspect décoratif soit conservé dans la plus large mesure
[car] la Ville de Bourg ne craint pas d’engager des dépenses
sensiblement supérieures au chiffre du devis prévu ».
Les travaux se terminent et un communiqué de presse annonce que,
« à partir du 20 mars 1900, le circuit téléphonique
Bourg-Lyon sera ouvert au public au moyen de la cabine téléphonique
installée dans la salle d’attente de la recette principale
des postes et des télégrammes à Bourg. (…)
La liste complète des villes avec lesquelles la recette principale
de Bourg pourra établir des communications téléphoniques
est déposée au bureau des postes . ». La ville de
Bourg est désormais reliée au circuit national. Il reste
à aménager, en fils aériens, le réseau urbain,
autorisé depuis le 3 mars par le ministère. Quelques habitants
protestent car le plan n’est pas strictement respecté et
des isolateurs sont fixés sur leurs murs. Le circuit est complété
au printemps 1901 et une cabine téléphonique est installée
en gare, en août 1901.
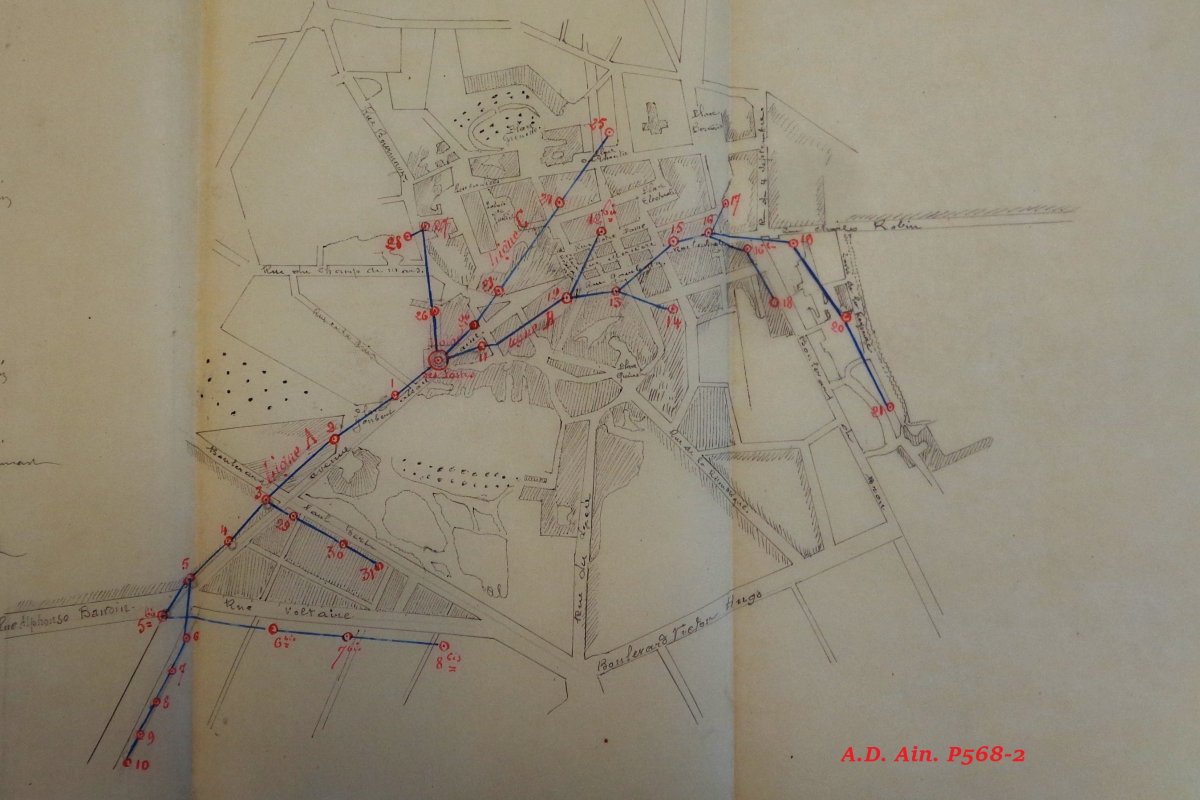 Plan du réseau téléphonique urbain de Bourg en
1900.
Plan du réseau téléphonique urbain de Bourg en
1900.
Le Conseil général de l’Ain s’est décidé,
au printemps 1898, pour l’étude d’un réseau
départemental. La décision est prise le 25 avril 1900
et le Conseil général a déjà demandé
à la ville de Bourg si elle accepterait de s’y intégrer.
La Ville accepte et ses charges seront transférées au
Département. Les communes ont été interrogées
et 61 ont demandé leur rattachement en prenant l’engagement
d’un financement annuel. Une convention est signée le 9
mars 1901 entre le Département et l’administration des postes.
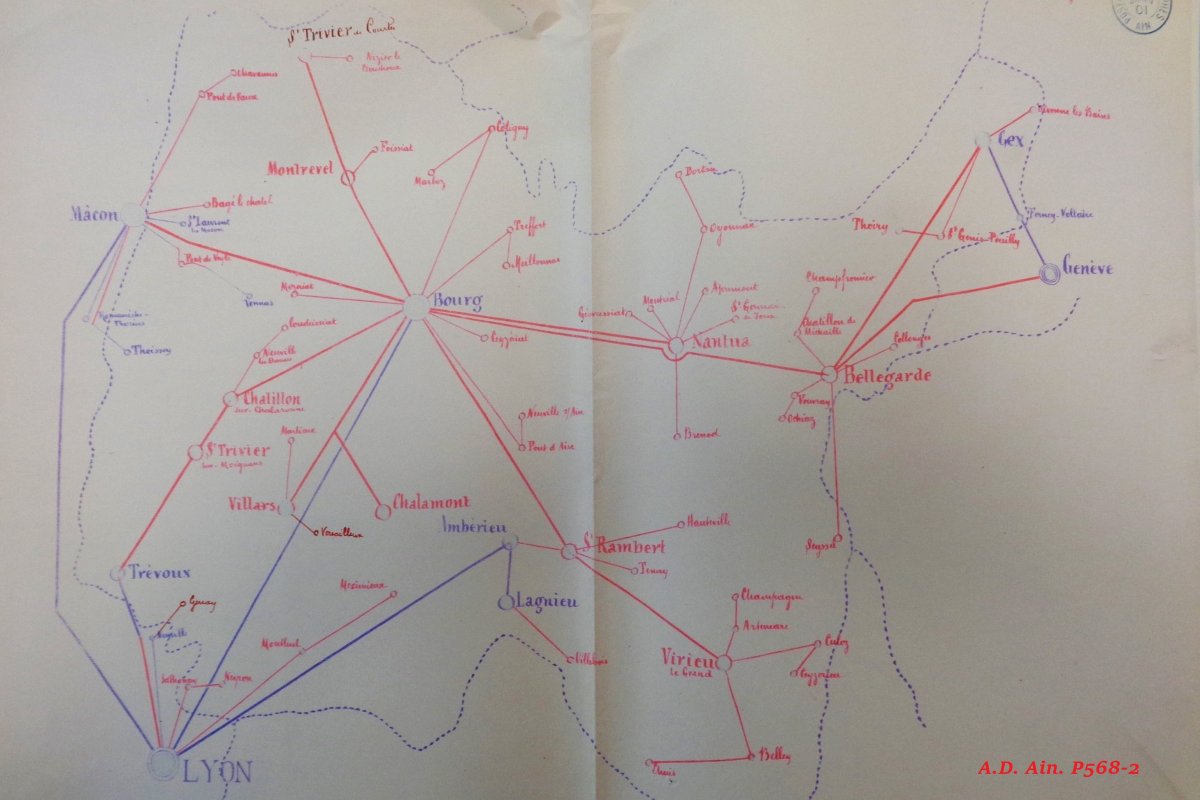
Carte du réseau départemental annexé à la
convention du 9 mars 1901 .
Liste des 61 communes : Atemare, Apremont, Bâgé-le-Châtel,
Bellegarde, Belley, Bourg, Brénod, Ceyzériat, Ceyzérieu,
Chalamont, Champagne, Champfromier, Châtillon-de-Michaille, Châtillon-sur-Chalaronne,
Chavannes-sur-Reyssouze, Coligny, Collonges, Condeissiat, Culoz, Divonne-les-Bains,
Dortan, Foissiat, Géovreissiat, Hauteville, Lhuis, Marboz, Gex,
Marlieux, Meillonnas, Meximieux, Mézériat, Montluel, Montréal,
Montrevel, Nantua, Neuville-les-Dames, Neuville-sur-Ain, Neyron, Ochiaz,
Oyonnax, Pont-d’Ain, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Saint-Genis-Pouilly,
Saint-Germain-de-Joux, Saint-Nizier-le-Désert, Saint-Rambert,
Saint-Trivier-de-Moignans, Saint-Trivier-de-Courtes, Trévoux,
Sathonay, Seyssel, Tenay, Thoiry, Treffort, Villars, Villebois, Vouvray,
Virieu-le-Grand, Genay, Versailleux.
Les travaux sont entrepris et le réseau évolue en fonction
des circonstances locales et des opportunités. Un rapport du
31 décembre 1904 indique que « les travaux, commencés
en 1901, ont été terminés en 1903, à une
exception, Chavannes-sur-Reyssouze. (…) À titre d’indication,
66 communes avaient [finalement] adhéré à ce premier
réseau.
Les études du deuxième réseau ont été
entreprises en octobre 1902 [avec] les adhésions définitives
de 145 communes. La convention avec l’État a été
signée le 29 août 1903. Les travaux ont été
commencés au printemps 1904. (…) Ils ont été
menés avec célérité. (…) Nous avons
organisé un groupement de cinq équipes avec un nombreux
personnel ouvrier qui, bien entraîné aux travaux de cette
nature, a fourni un rendement maximum. La persistance du beau temps
a été un auxiliaire précieux. (…)
Ce deuxième réseau, commencé en 1904, comporte
la construction de 495 kilomètres de ligne neuve et la pose de
2 050 kilomètres de lignes. Les travaux actuellement terminés
comprennent 470 kilomètres de ligne neuve et 1 950 kilomètres
de fil. (…)
Le nombre de bureaux ouverts au 31 décembre 1903 était
de 73. (…) Les recettes suivent une progression constante qui permet
d’envisager le remboursement intégral en quelques années
seulement. En 1904, il a été ouvert 132 nouveaux bureaux
téléphoniques. (…) Il reste 252 communes qui n’ont
pas consenti à se faire incorporer dans les réseaux .
»
Le troisième réseau est étudié en avril
1905 et le quatrième, en 1910. Au 23 octobre 1911, 50 des 76
communes, non raccordées, souhaiteraient l’être. Cela
ne sera possible que pour 26 d’entre elles, dans un premier temps,
dont Granges où un syndicat s’est constitué pour
suppléer la commune . C’est la situation à la veille
de la Grande Guerre.
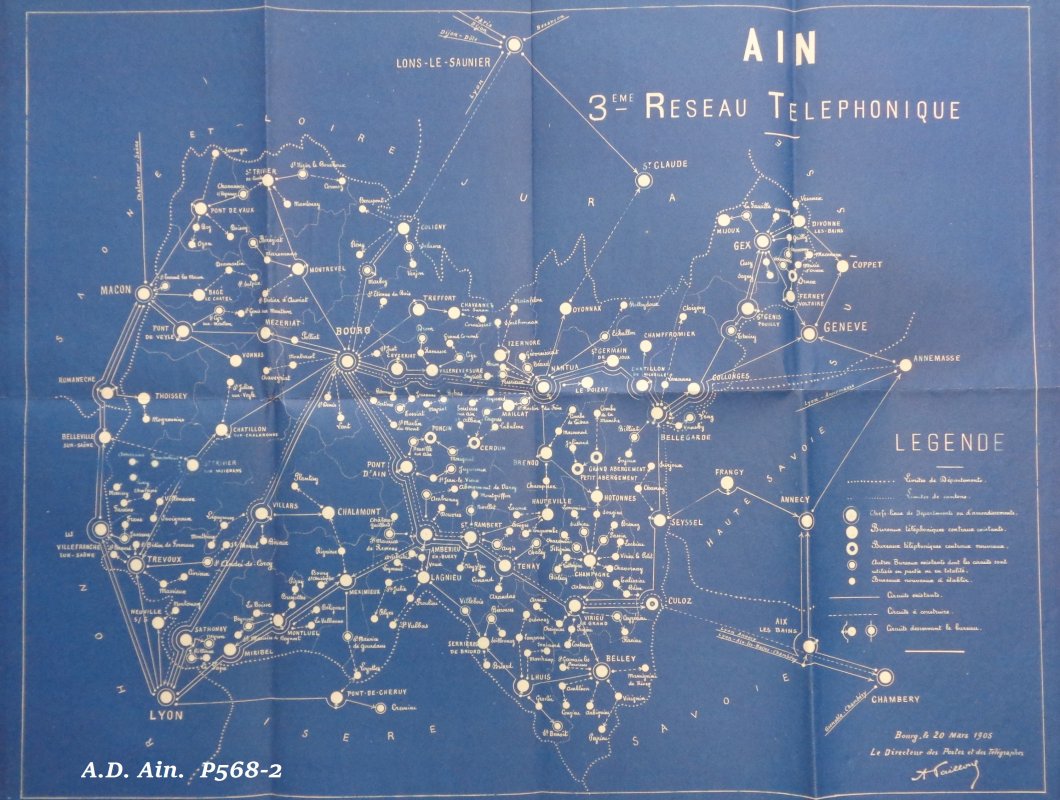
Le réseau téléphonique dans l’Ain lorsque
le 3e réseau sera établi. Carte du 20 mars 1905 .
Documents à télécharger :
- Les débuts du téléphone dans l’Ain (pdf
- 890.8 kio)
- De l’Hôtel
des Postes au Centre Camus (pdf - 1.5 Mio)
Le téléphone dans le Cantal :
Des débuts difficiles (1899)
Nous sommes en 1899, Léon Mougeot, sous-secrétaire d’Etat
des Postes et des Télégraphes (et pas encore du téléphone…),
propose de « doter le Cantal d’une organisation téléphonique
». Il rappelle « l’importance très grande qu’a
prise la téléphonie dans divers pays, notamment en Allemagne,
en Belgique et en Suisse » tandis que « la France n’a
pas jusqu’ici profité, aussi largement que ses voisins,
des facilités nouvelles qu’offre ce merveilleux moyen de
communication pour les relations d’affaire et de famille ».
Considérant que « notre pays se doit à lui-même
de ne pas rester plus longtemps en arrière », il demande
le soutien du préfet et en appelle à son influence «
pour faire aboutir l’œuvre nationale que j’ai entreprise
».
Un premier projet de réseau est donc proposé
par le sous-secrétaire d’Etat en 1899, il prévoit
de relier ensemble les quatre chefs-lieux d’arrondissement Aurillac,
Mauriac, Murat et Saint-Flour, puis de relier ces derniers à
leurs chefs-lieux de canton ainsi qu’à quatre autres communes
: Le Vaulmier, Ussel, Valuéjols et Junhac. Soit un total de 25
communes pour un coût global de 289 500 francs.
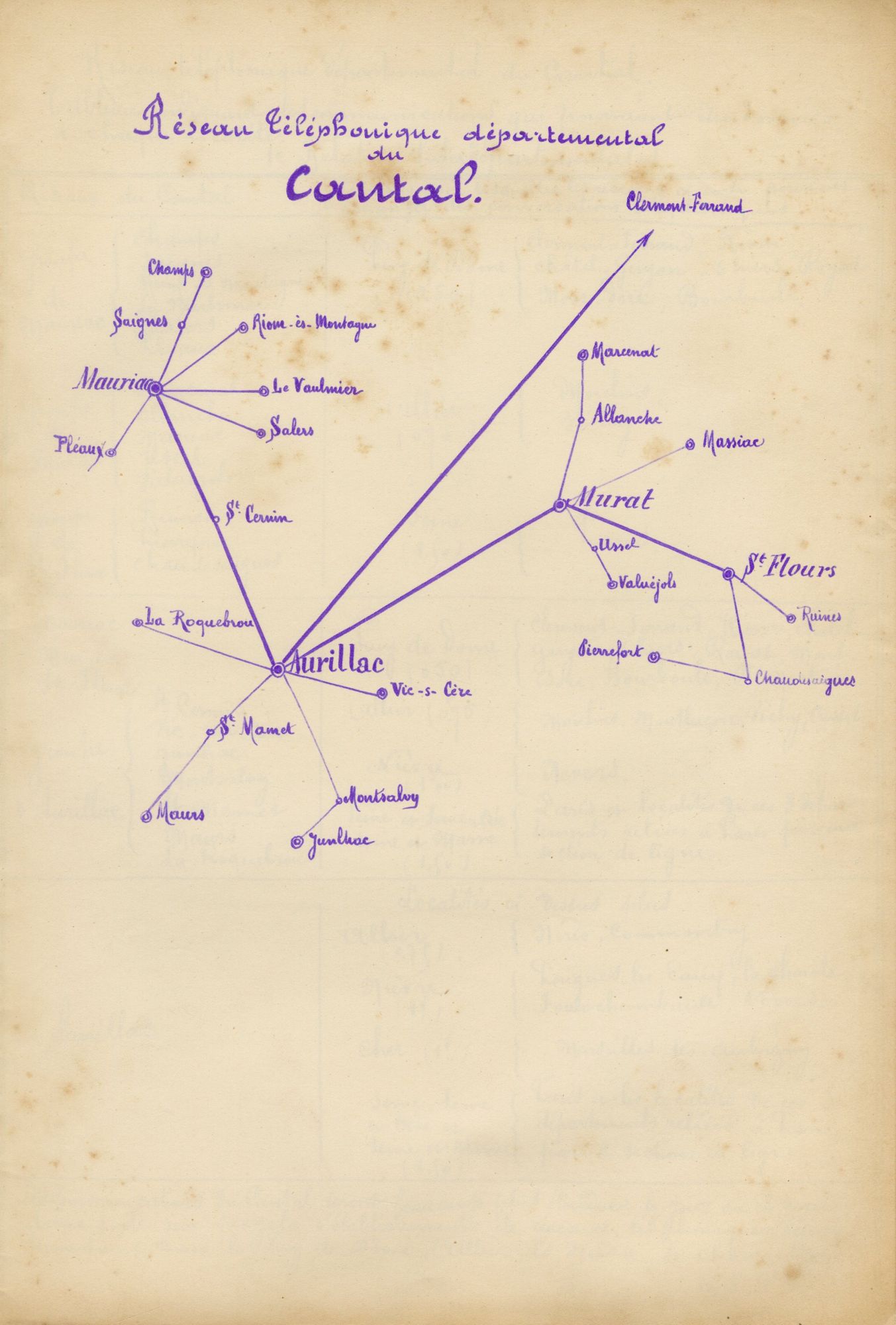
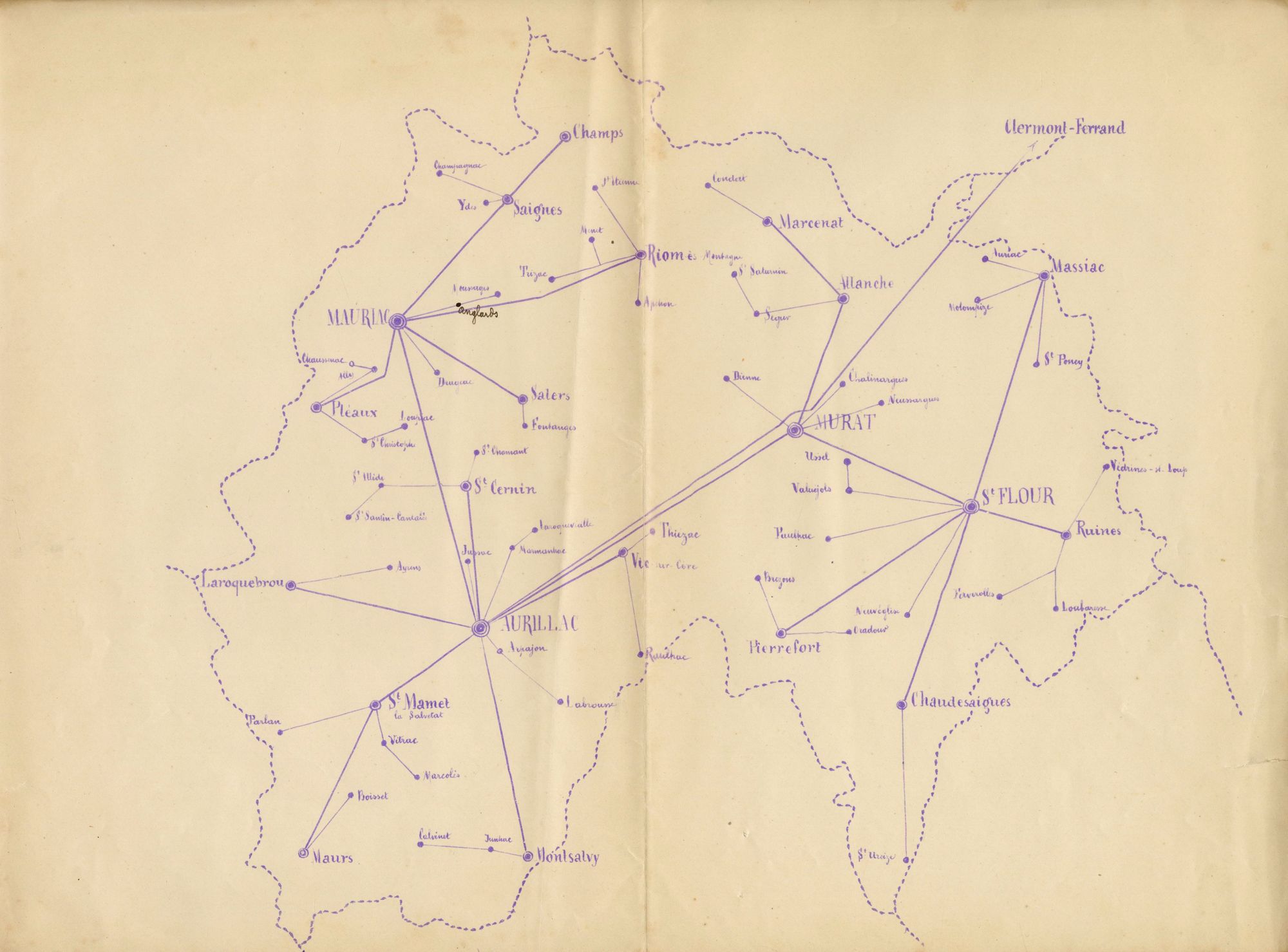
Plan du premier projet de 1899 et plan du deuxième projet de
réseau en 1900.
Après une première consultation auprès des communes
susceptibles d’être intéressées, le projet
devient bien plus ambitieux et une nouvelle carte est établie.
Si la base du réseau reste la même, il s’agit désormais
de relier entre elles plus de soixante-dix communes. Mais comme souvent,
l’Etat n’a pas les moyens de ses ambitions. La carte est accompagnée
d’un devis qui fait état d’une dépense totale
de 541 375 francs, soit près de 2 500 000 euros actuels. La dépense
initiale a presque doublé. Pourtant dès le premier projet,
Léon Mougeot prend bien soin de rappeler au préfet que
son « administration ne disposant […] d’aucun crédit
budgétaire pour la construction des lignes téléphoniques,
le montant des dépenses devrait être fourni à l’Etat,
à titre d’avance remboursable, sans intérêts
». C’est aux administrations locales, conseil général
et communes, d’avancer l’intégralité des sommes
nécessaires à l’Etat avec l’espoir d’en
être ensuite remboursé par les éventuelles recettes
du réseau ainsi créé. De plus, l’Etat ne consent
à rembourser que le capital des sommes empruntées pour
le financement des travaux à l’exclusion des intérêts
de la dette, qui eux restent à la charge des administrations
locales. Le conseil général du Cantal décide alors
d’avancer l’intégralité du capital à
emprunter mais pas les intérêts qui seront à financer
par les communes. Aussi, sur 71 communes intéressées dans
un premier temps, il n’y en a plus que 12 qui ont voté les
ressources demandées, 23 ont ajourné leur décision,
29 ont préféré renoncer et 7 n’ont pas répondu.
Début 1902, le projet n’est toujours pas adopté et
« le Cantal est un des rares départements qui n’ont
pas donné suite, au moins partiellement, aux propositions de
l’administration et qui n’ont aucune relation avec le réseau
général ». Il faut attendre le 22 avril 1903 pour
que le projet soit définitivement adopté par une délibération
du conseil général, ce dernier emprunte et avance la somme
totale de 584 990 francs nécessaire à l’établissement
du réseau. Il prend aussi à sa charge la moitié
des intérêts annuels, l’autre moitié étant
à supporter par les communes. Sur les 267 communes du département,
66 acceptent d’être reliées au réseau et s’engagent
à verser les sommes demandées pour une durée de
trente ans.
Les débuts du téléphone dans le Cantal sont donc
assez laborieux. Cependant, après la mise en place de la distribution
postale à domicile et le développement du réseau
télégraphique au cours du XIXe siècle, c’est
un nouveau moyen de communication qui s’offre aux Cantaliens. S’il
existe bien une volonté politique – ici initiée par
l’Etat – de favoriser le progrès de ces moyens de communication,
comme pour la poste et le télégraphe avant lui, le développement
du réseau téléphonique ne peut se faire sans l’aide
des pouvoirs locaux et leurs apports financiers parfois conséquents.
Les attentes sont pourtant nombreuses et ces moyens de communications
sont de véritables enjeux en milieu rural. Ils sont considérés,
à juste titre, comme des outils du désenclavement. A cet
égard, comme la route ou le rail, ils ont contribué à
la modernisation de la France en tant que moteur de civilisation et
d’unité nationale.
En Haute-Loire
Le premier appel passé du Puy-en-Velay vers un autre département
date de 1902. L’année d’après le déploiement
dans la Haute-Loire commence.
La zone autour de Chomelix d’abord puis le Langeadois et l’Est.
Aurec-sur-Loire est la première commune à bénéficier
d’une cabine téléphonique en 1903. En 1912, le département
compte 250 abonnés dont près de la moitié au Puy-en-Velay.
Neuf ans plus tard, il y en 771 dont 285 dans la ville préfecture.
Les centraux téléphoniques essaiment sur le territoire
au Puy-en-Velay, à Saint-Didier-en-Velay, Langeac, Brioude et
Yssingeaux. Des femmes s’y activeront pour transmettre les communications.
Elles poseront définitivement leurs casques au début des
années 1970 avec l’automatisation du téléphone.
Les premières communes à bénéficier du téléphone
automatique (sans passer par une opératrice) sont Saint-Romain-Lachalm
et Allègre. Le déploiement dans l’ensemble du territoire
durera une vingtaine d’années.
Il faudra attendre 1998 pour que la Haute-Loire fête ses 100 000
e abonnés
Dans l'Hérault
L’arrivée du téléphone à Montpellier
Juin 1892, le réseau téléphonique urbain
de Montpellier est mis en service : 28 opératrices sont
recrutées pour mettre en relation les abonnés de Montpellier
avec ceux de Nîmes, Sète, Béziers et Narbonne.
En 1953, pour appeler la province depuis Paris, il fallait patienter
3 minutes pour obtenir son correspondant. En 1970, seul un Français
sur sept disposait du téléphone chez lui.
A NICE
jeudi 14 juin 1883 Le Petit Niçois nous apprend
qu’une entreprise de la ville vient d'installer un téléphone,
qui serait le troisième à Nice.
À noter qu’il s’agit encore de liaisons point à
point et que, d’un poste d’appel, on ne peut joindre que le
seul correspondant auquel le câble vous relie.
« Téléphones. – Un troisième téléphone
a été établi hier à. Nice.
C’est la Société générale de transports
qui l’a fait établir pour mettre en communication ses bureaux
de la rue Gubernatis avec ses remises situées au quartier Riquier.
On sait qu’il existait déjà deux téléphones
dans notre ville : l’un entre la Caisse de Crédit et la
Villa de M. Sicard à Saint-Jean ; l’autre entre le Théâtre
Français et le café de la Maison Dorée. »
Un autre article du Petit Niçois paru le 6 mars 1885 écrit
« Téléphone. – À la suite d’une
démarche auprès de M. le ministre des postes et télégraphes,
des avantages plus sérieux viennent d’être accordés
à notre ville pour l’établissement d’un réseau
téléphonique. M. Cochery persiste toujours – il est
vrai – à refuser une exploitation quelconque des téléphones,
exploitation qu’il ne saurait concéder à une cité
sans être immédiatement assiégé de demandes
analogues, mais il consent, en faveur de Nice, à une nouvelle
réduction dans le chiffre des abonnements pour commencer les
travaux.
Ce chiffre, qui avait déjà été réduit
à 80 au lieu de 200, se trouve maintenant fixé à
50. Dans ces conditions excellentes nous espérons que nos concitoyens
s’empresseront de profiter des faveurs accordées par le
gouvernement à la ville de Nice et que prochainement fonctionnera
parmi nous cet utile et rapide moyen de communication. »
1913 Le tout premier centre automatique de France est mis en
service à NICE.
(Centre Téléphonique
de Nice-Biscarra)
En Ardèche
L'arrivée du téléphone à Saint Martial
(Yvon Guibal, Nicole Clément)
La première cabine téléphonique installée
à Saint Martial l'a été au Rulladou dans la maison
de Monsieur Henri Salançon (actuelle maison de M et Mme Bray).
Henri Salançon en était le gérant et elle aurait
servi la première fois à accueillir l'annonce de la guerre
de 1914 ! Lorsqu'en 1927 M. Salançon décide de partir
à Nîmes avec quelques unes de ses ouvrières, pourdévelopper
dans cette ville sa petite manufacture de bonneterie (bas et chaussettes),
se pose le problème de son remplacement. Les délibérations
du conseil municipal font état des difficultés rencontrées
:
Session extraordinaire du 13 mars1927{ma ire Jean Prosper Viala):
Désignation d'un gérantde la cabine téléphonique
en remplacement de M. Salançon Henri.
Monsieur le maire fait connaÎtre au conseilque M. Salançon
ne pouvant plus gérer la cabine téléphonique, à
partir du 20 mars courant, il y a lieu de désigner d'urgence
son remplaçant, or aucun candidat ne s'est présenté
après les publications qui ont été faites dans
la commune.
Plusieurs membres du Conseil municipal désignent Mlle Julie Ducros
comme titulaire et Mlle Marcelle Ducros sa sœur comme suppléante.
A l'unanimité, le conseil accepte ce choix.
Mais le 14 Août1927 M. le maire communique au Conseil une lettre
en date du 27 jul1/et 1927 par laquelle M. le Directeur régional
des postes l'informe que la candidature proposée par le conseil
municipal ne peut être agréée le conseil devant
choisir entre les candidatures de MM Bosc Jean
et Matai Urbain. le conseil soucieux de hâter la réponse
du service de la cabine téléphonique après une
fermeture de plus de trois mois, que la population de la commune considère
comme un scandale..... .. à l'unanimité....... rejette
absolument comme inacceptables les candidatures
de MM Bosc Jean et Matai Urbain pour les motifs suivants :
Bosc Jean, facteur auxiliaire, ne peut, vivant seul, assurer le service
du téléphone de plus, le sus nommé, ne jouit pas
de la plénitude de ses facultés mentales, M. Matai Urbain
ne présente pas les conditions suffisantes de moralité,
le conseil se voit dans /'impossibilité de trouver un autre candidat
que Mlle Julia Ducros proposée par la délibération
du13 Mars, aucune autre personne ne présentant sa candidature
ou ne voulant accepter ces fonctions. De ce fait, le conseil municipal
se verrait obligé de démissionner, ne voulant pas prendre
lui même, la responsabilité de la continuation de l'état
de choses actuel.
27 octobre1931 : Internement de Jean Bosc à l'asile de Monteverques
le maire communique que à la suite de plusieurs actes de démence,
du sieur Bosc Jean Félix, le maire a été obligé
de constituer un dossier concernant le sus nommé. A la suite
d'une plainte adressée à la direction des PTT (Postes,
Télégraphe, Téléphone), la gendarmerie se
rendit à Saint Martial aux fins d'enquête et M. le préfet
prit un arrêté d'internement à Montevergues et le
21 du mois de décembre, les agents de l'asile sus désignés
vinrent le chercher.
De fait la cabine sera cette année là, installée
dans l'épicerie de Marcelle, Place de l'Eglise.
Une cabine ? c'est beaucoup dire, le téléphone était
dans l'épicerie, caché par un paravent, on y accédait
après que l'opératrice ait obtenu la communication et
lon commentait ensuite ensemble et avec les éventuels clients
présents dans la boutique, la réception : la confidentialité
était donc limitée !!
En avril 1936: (maire Georges Viala) le service postal est transformé
en Aqence postale « les mandats, plis recommandés et autres
opérations postales qui ne peuvent se faire qu'à Sumène,
se feront au bureau de Saint Martial chose très avantageuse pour
le public. la dépense (pour cette transformation) sera minime
(711 frs 75) somme fixée par le service des postes pour le transport
du courrier de Sumène à Saint Martial, part de la commune».
En 1955 la cabine téléphonique et l'agence postale sont
transférées au Trive, Yolande Guibal en assurant dorénavant
la gérance, ceci jusqu'en 1981. Et les anciens se souviennent
du courrier récupéré à bicyclette, par n'importe
quel temps, au bureau de poste de Sumène, par les facteurs: Fabian
Bousquet et Noémie Delon d'abord, puis Joseph Salendres et Francis
Guibal ensuite, Jean Paul Salendres a également effectué
ce travail. Le dit courrier arrivait de Nîmes par fourgon et continuait
ensuite sa route vers le Vigan et Alzon. Après qu'il ait été
départagé entre Sumène et Saint Martial, notre
facteur remontait avec un sac bien rempli à Saint Martial où
il arrivait autour de 8 h30. Francis Guibal fut le premier à
assurer ce service en utilisant sa moto alors qu'il aurait du le faire
à vélo!! Ce n'est qu'en 1970 que Sumène prit le
relais du transport du courrier par des facteurs motorisés.
Le courrier était trié à l'agence postale en deux
tournées, pour les deux facteurs, celui qui distribuait les campagnes
du haut, celui qui distribuait celles du bas. Les tournées se
faisaient à pied et à l'exception de quelques mas très
isolés, toute la population avait son courrier avant midi. Nombreux
étaient ceux qui s'abonnaient au «Midi libre» ou
au« Provençal» qu'ils recevaient ainsi journellement.
Les télégrammes, indispensables à cause de l'absence
de téléphones, étaient souvent malheureusement
porteurs de mauvaises nouvelles. Ils étaient transmis à
pied dans le village et les hameaux par des porteurs ou porteuses de
télégrammes payées à la course. Marie Durand
(la maman d'Emilienne et de Francine) fût la première,
puis Paulette Mourgues la suivit en suite. Le Trive et le Galinier,
où Paulette habitait, étant très proches à
vol d'oiseau, le texte en était souvent hélé de
vive voix depuis le parapet !!
Les progrès modernes ont certes apporté certaines améliorations
à ce service, mais la fiabilité de même que la qualité
humaine de l'ancienne façon de faire peuvent rendre certainsnostalgiques
!
A Saint Apollinaire de Rias
Les travaux se précisent le 14 mars 1934 avec l’autorisation
officielle d’établissement de la ligne de Vernoux à
St-Apollinaire de Rias.
On note principalement les articles 3: les propriétaires riverains
sont mis en demeure de couper et d’élaguer à la limite
de la route les plantations qui présenteraient des branches en
saillie dur l’arête extérieure des fossés et
talus et pourraient trancher les fils et l’article 7 qui précise
que «la hauteur minimum des fils dans les villes et villages est
de 6 m50 au-dessus de la chaussée».
Evidemment nous assistons avec l’arrivée du téléphone
à une forme de modernité qui n’a pas cessé
de nous entourer et de modifier nos modes de relations aux autres. Même
si ce poste téléphonique est collectif, un seul pour la
commune, St–Apollinaire de Rias est relié au reste du monde!
A Cros-de-Géorand
Lors de sa séance du 22 mars 1908, le Conseil Municipal
de notre commune souligne « l’isolement et l’extrême
détresse au point de vue du service des Postes et Télégraphes
» et considère « qu’il importe de rendre plus
aisé les relations des habitants et de favoriser le développement
du commerce local ». Il demande « l’établissement
d’une ligne télégraphique entre St Cirgues en Montagne
et le Cros de Géorand et vote sa part contributive à la
dépense ». Cette requête est toujours d’actualité
lors de la séance du 1er mars 1909 qui demande que le projet
« d’un bureau de facteur receveur avec un poste télégraphique
» soit mis à l’étude par l’administration.
Mais, dès 1910 les élus voient plus loin ...
Le 19 septembre 1909, « le Maire expose que le chef-lieu de la
commune de Ste Eulalie est pourvu du téléphone et qu’il
est d’intérêt général de l’obtenir
également au chef lieu du Cros. Afin d’atténuer la
dépense occasionnée par cette installation, le Maire a
accepté la combinaison qui lui était proposée par
le Maire d’Usclades et l’entente suivante est intervenue entre
eux : Il serait créé en même temps un courant téléphonique
Ste Eulalie, Usclades, le Cros-de-Géorand avec poste et combiné
dans chacun des chef-lieu du Cros-de-Géorand et d’Usclades.
» Et le conseil approuve aussi « le projet d’entente
dans le but de partager les frais qu’occasionnerait le circuit
téléphonique Montpezat-Usclades-Cros-de-Géorand,
après l’établissement téléphonique
qui doit avoir lieu à Montpezat ».
Le 2 janvier 1910, à Cros de Géorand, on vote «
les fonds d’avance à l’Etat pour l’installation
du circuit téléphonique et télégraphique
Montpezat, Usclades, le Cros de Géorand avec poste et cabine
publique dans chacun des chef-lieu ».
Le 14 août 1910 Le Conseil municipal est d’avi « d’installer
la cabine téléphonique dans le local communal attenant
au groupe scolaire existant actuellement au chef-lieu du Cros où
sera logé le gérant et distributeur des télégrammes
et des communications téléphoniques qui se feront gratuitement
pour toute la commune. Il sera également chargé, outre
la distribution des télégrammes, dans toute la commune
des appels au téléphone.
La fonction de gérant et distributeur de toute communication
téléphonique pour toute la commune sera remplie par M.
PLANTIN Baptiste secrétaire de la Mairie, auquel il sera alloué
par la commune une somme annuelle de 150 francs, outre son logement
dans le local où sera installée la cabine téléphonique.
Il aura droit de percevoir également les remises qui lui seront
allouées d’après le règlement en vigueur par
la Direction des Postes et Télégraphes et Télphone.
» . Le 6 novembre 1910, le Conseil nomme Mme PLANTIN Pélagie
pour gérer le bureau téléphonique et M. PLANTIN
Baptiste distributeur de messages et des appels au téléphone.
Puis en 1926 ces fonctions reviennent à M. SOLEILHAC Prosper,
gérant du téléphone et Mme SOLEILHAC née
TEYSSIER comme suppléante. Au Chef-lieu du Cros, l’emploi
de « gérant du téléphone » est supprimé
le 22 septembre 1956. Cette fonction étant désormais assurée
par la receveuse de l’Agence Postale, Mme POMMIER.
La délibération du 6 mars 1958 précise les horaires
de 8h à 12h et de 14h à 18h pour l’ouverture de la
cabine téléphonique avec un budget pour
cette mission 55 000 frs/an.
Le 16 décembre 1989, la Mairie se raccorde au réseau téléphonique
en prenant un abonnement. (jusqu’à cette date, la secrétaire
de Mairie utilisait la cabine téléphonique !)
Le 2 avril 1933, « le hameau de La Palisse étant
à une distance de deux kilomètres à vol d’oiseau
du chef-lieu et regroupant une population de 86 habitants parmi laquelle
un certain nombre de commerçants », le Conseil délibère
sur l’utilité d’y installer une cabine téléphonique
publique. Le Conseil note que « cette installation supprimerait
un grand nombre de télégrammes au distributeur de dépêches
et que M. VOLLE, facteur audit quartier, s’engagerait à
autoriser cette installation chez lui et qu’il en assurerait le
fonctionnement par lui-même ou avec le concours de son épouse
pendant les heures d’ouverture ».
Le 28/12/1941, Le Conseil décide de transférer le poste
d’abonnement municipal de La Palisse chez TEYSSIER, Hôtel
du Pont.
Le 11/04/1954, le Maire expose que « la maison où est installé
le Poste d’abonnement Public de La Palisse n°8 a été
acquise par EDF et va être incessamment démolie, les barrages
devant être mis en eau, aussitôt les derniers travaux achevés
». Le Conseil demande à l’administration des P.T.T.
le transfert de cette installation dans la nouvelle maison de Melle
TEYSSIER Victorine qui accepte.
Le 13/11/1966, le Conseil donne un avis favorable au transfert de l’installation
téléphonique du poste d’Abonnement Public de La Palisse
au domicile de M. VOLLE Auguste. Celui-ci continue d’être
le gérant de la cabine de téléphone publique dans
sa nouvelle résidence en 1973. Puis, en 1975, le Conseil confie
la gérance à Mme VOLLE Germaine, veuve. Ce poste ne sera
supprimé qu’en 1985.
A partir de 1954, plusieurs téléphones sur la commune
de Cros-de-Géorand.
Les premiers abonnés au téléphone sont des hommes
d’affaires, des entrepreneurs, des négociants, des commis
de bourse, des banques, des journaux, mais aussi des sociétés
de service s’adressant à une clientèle de luxe .
On compte en 1954, une dizaine d’abonnements sur la commune. Jusque
dans les années 70, seuls la Mairie et les commerçants/artisans
sont équipés d’un téléphone.
De fait ces quelques postes sont utilisés par l’ensemble
de la population. L’emploi de ce moyen de communication est alors
réservé à des situations d’urgence. Pour appeler
les postes situés au Cros, il fallait demander à la téléphoniste
:
le 0 à Cros de Géorand (l’agence postale)
le 1 à Cros de Géorand (l’hôtel GIRAUD)
le 2 à Cros de Géorand (la boucherie MOULIN)
….
Le 31 mars 1979, le Conseil Municipal, « sur la proposition de
la Direction Opérationnelle des Télécommunications
de Grenoble, décide l’installation d’une cabine téléphonique
sur la voie publique ». L’installation se fera à l’extrémité
de la place à proximité du monument aux
morts. Cette cabine ne sera démontée qu’en 2015.
Une autre cabine sera mise à la disposition du public au carrefour
du Pont de La Palisse .
Les témoignages varient, ce qui permet de penser que le téléphone
entre petit à petit dans les maisons, plutôt vers la fin
des années soixante-dix.
Les prix des communications sont basés sur la durée et
sur la distance. Chaque intervalle est facturé au prix fixe d'une
Taxe de Base ; les intervalles de temps exprimés en secondes
entre deux taxes de base sont d'autant plus courts que la distance entre
les deux abonnés est grande. Du coup, les habitants réfléchissent
à deux fois avant de passer un appel. Et pour les longues distances,
ils s’organisent pour appeler sur les tarifs de nuit à prix
réduit.
Les années 70, le téléphone à domicile.
Dans son article du 24 décembre 2020 paru dans l’Hebdo de
l’Ardèche, Flora CHADUC cite les communes du plateau ardéchois
où le téléphone fixe a été coupé
jusqu’à des mois.
Les élus interpellent « Des particuliers aussi me saisissent
» remarque Fabrice BRUN, député de la 3ème
circonscription de l’Ardèche. « Mais nous, députés,
ne sommes pas le service après-vente des opérateurs !
».
« C’est le sujet qui revient le plus, avec la santé,
dans les échanges avec les habitants » confirme Hervé
SAULIGNAC, député de la 1ère circonscription ardéchoise.
Il estime que 80 % du territoire ardéchois est concerné
par des dysfonctionnements ou menacé d’avoir un réseau
de téléphonie fixe coupé.
Cros de Géorand sur l’annuaire des Pages Blanche 2017.
Sur l’annuaire des Pages Blanches édité en 2007,
on compte 124 abonnements à Cros de Géorand.
Les tout derniers exemplaires de l'annuaire papier des Pages Blanches,
qui contient les numéros de téléphone des particuliers,
seront livrés en décembre 2019 .
Dans son article du 24 décembre 2020 paru dans
l’Hebdo de l’Ardèche, Flora CHADUC cite les communes
du plateau ardéchois où le téléphone fixe
a été coupé jusqu’à des mois. Les élus
interpellent « Des particuliers aussi me saisissent » remarque
Fabrice BRUN, député de la 3ème circonscription
de l’Ardèche. « Mais nous, députés,
ne sommes pas le service après-vente des opérateurs !
»
Le 15 septembre 1989, l’association des Maires de l’Ardèche
encourage les communes à s’informatiser. La Mairie de Cros
de Géorand adhère à ce nouveau service MAIRIETEL
07/63.
En 2009, quelques habitants de Cros de Géorand réussiront
à se connecter grâce à Numéo. « Je
me souviens, aux Rancs nous avions conduit un câble Ethernet sur
le haut des rochers surplombant la maison pour avoir une connexion.
Si la neige pesait trop lourd, le câble sortait du boîtier
situé au sommet, plus de connexion. Si nos chèvres trop
curieuses croquaient le câble, plus de connexion !!! ».
Le 9 novembre 2007, le Maire informe le Conseil Municipal du plan de
résorption des zones blanches ADSL qui devrait permettre à
de nombreuses communes ardéchoises de pouvoir bénéficier
d’une couverture ADSL par des opérateurs locaux. Notre commune,
étant en zone blanche, sollicite l’aide du Conseil Général
de l’Ardèche, de la Région et de l’Europe pour
le financement des travaux nécessaires à la couverture
de la commune
pour l’accès à Internet Haut Débit...
A Saint Sylvestre
Le 30 juin 1901, Monsieur le Maire donne lecture de la lettre préfectorale
concernant la dépense qu’occasionnerait l’établissement
d’un circuit téléphonique reliant la commune au bureau
le plus central. Le conseil considérant que la commune est déjà
très obérée(= très endettée !) ne
prend pas l’engagement d’assurer le service des intérêts
de l’emprunt que nécessiterait l’établissement
d’un circuit téléphonique.
Il en sera de même en 1903, en 1905 et en 1907. La commune n’est
pas assez riche pour supporter les frais d’installation !
Enfin, le 4 novembre 1909, Monsieur donne lecture de la lettre préfectorale
concernant un cinquième projet d’extension du réseau
téléphonique départemental. Le Conseil demande
que la commune soit rattachée au réseau et s’engage
à créer les ressources nécessaires au paiement
de sa quote-part des dépenses occasionnées.
Le 1er septembre 1912, Monsieur le Maire informe le conseil municipal
qu’il est appelé à délibérer sur l’emplacement
de la cabine téléphonique. Le Conseil municipal décide
de placer la cabine téléphonique dans le village de Marcelette,
maison Roupioz Claude.
Le 29 décembre 1912, le conseil municipal s’engage à
voter à partir de 1914 une imposition extraordinaire de 124,86
F pour le paiement de la contribution de la commune au service des intérêts
de l’emprunt du Département de 56 601 F.
Dans le Doubs
28 novembre 1909, le service téléphonique
fonctionnera à partir du 1er décembre prochain dans les
communes ci-après :
Aubonne, Bians-les-Usiers, Bouverans, Bulle, Chapelle-des-Bois,
Chatelblanc, Dompierre, Les Hôpitaux-Vieux, Vaux-et-Chantegrue
et Villedieu-les-Mouthe.
A Villedieu-les-MoutheCamille Maire en 1924 a décidé
de tenir la "cabine" téléphonique.
Par la suite, sa femme Louise prit le relais jusqu'en 1963. Camille
Maire fabriquait des manches d'outils. Les courroies de ses machines
était disposées partout dans la pièce, même
au plafond. Le téléphone était dans un recoin de
son atelier. Il était payé pour recevoir les messages
et aller les porter aux destinataires. Ils emmenaient parfois des télégrammes
urgents.
Une vraie cabine téléphonique fut installée vers
la cure à Villedieu-les-Mouthe. Elle existe toujours, mais elle
n'a pas d'autre fonction que de s'y abriter.
A Villedieu-les-Rochejean, la cabine était tenue par Jules
Saillard, il habitait à la sortie du village, côté
Rochejean. Les gens du haut du village devait le traverser entièrement
pour aller téléphoner, comme Jules Saillard le faisait,
pour porter les messages. Les habitants qui ont eu par la suite un téléphone,
dépannaient ceux qui n'en avaient pas. Une cabine fut installée
à coté de l'ancienne fromagerie, dans un virage, en bas
du village.
En hiver, comme elle était en bas d'une côte, certains
automobiliste l'ont "emportée" plusieurs fois : les
conducteurs partaient en la laissant en l'état, sauf un, qui
doit encore s'en souvenir et regretté d'avoir été
honnête.
Cette cabine était très rentable, car l'ancienne fromagerie
avait été louée au 7 ème R.C.S., unité
militaire basée à Besançon. Cent soldats y logeaient.
Ils avaient aménagé le grenier.
Les militaires n’avaient pas de problèmes
de téléphonie, ni de salle de bains. Ils
se lavaient dans le bac intérieur, de la fontaine "Maltrou",
juste en face. Ils ont été vu nus
à intérieur, en hiver, alors que ce jour-là on
acceptait volontier des petites laines.
Depuis le 29 mars 1973, le téléphone automatique intégral
est mis en service dans les communes de Boujeons (les), Brey-et-Maison-du-Bois,
Chaux-Neuve, Châtelblanc, Crouzet (le), Gellin, Mouthe, Petite-Chaux,
Pontets (les), Reculfoz, Rondefontaine, Sarrageois et Villedieu (les).
Les abonnés devront être appelés à l'aide
de leur nouveau numéro d'appel à six chiffres figurant
à l'annuaire du Doubs (édition 72, couverture orange).
Dans les Landes
A Pontenx-les-forges Faute de moyen,
il faut aussi refuser l’arrivée du téléphone
en 1914,d’autant qu’on installe le bureau de poste.
La paix revenue, en1921, le conseil se réjouit : « Tous
les bâtiments de la commune ont été réparés
et munis d’un porte-drapeau». À partir de là,
on avance vers le progrès à pas de géant : construction
d’un abattoir, premier revêtement routier en bitume et agrandissement
de la gare en1925, la place publique est pavée, achat d’une
pompe à incendie, installation du téléphone à
la mairie ... 1934 On installe deux cabines téléphoniques.
Les débuts du téléphone dans l'Aude par Georges Galfano.
En Ariège
En octobre 1896, le Conseil avait souhaité demander
à l’administration des Postes et Télégraphe
l’établissement d’un téléphone reliant
Pamiers à Toulouse. Ce fut chose faite en 1900.
Installation du téléphone à Pamiers en janvier
1900
Le conseil municipal de Foix pouvait se joindre au conseil municipal
de Pamiers pour faire cette demande et participer ainsi à la
dépense d’installation dans des proportions à déterminer.
La dépense de Toulouse à Foix était de 18000 francs.
Celle-ci n’était qu’une simple avance qu’auraient
eu à faire ces deux villes, l’État s’engageant
à payer l’annuité et l’amortissement de l’emprunt.
Le rattachement de la commune au réseau téléphonique
ne fut décidé qu’en janvier 1900. Lors de la séance
du 6 juin de la même année, le conseil approuva la répartition
faite par la commission départementale entre les communes adhérentes
à l’emprunt de 202 800 francs nécessaire à
la construction du réseau téléphonique et dans
laquelle la ville de Pamiers fut comprise pour une somme de 27 313,91
francs, en capital, et celle de 983,30 francs d’intérêt
pour la première annuité. Un crédit de 983 francs
fut voté sur les fonds disponibles de l’exercice 1900 pour
le paiement de la première annuité.
Quelques années après, l’installation à l’Hôtel
de ville de sonnerie électrique et téléphones reliant
les divers bureaux de la mairie fut envisagée. Le devis de l’électricien
qui en était chargé s’élevait à la
somme de 497 francs, toutes fournitures d’appareils et pose comprise.
L’installation fut réalisée en mars 1912..
Pour les Appaméens, le nouveau central téléphonique,
situé rue des Carmes, qui avait une capacité de 4900 lignes,
a été inauguré en septembre 1975. Les nouveaux
abonnés, 1200 au total, étaient dotés de "l’automatique".
Pour la petite histoire, la première communication téléphonique
officielle sur l’automatique de Pamiers fut celle qui mit en relation
le préfet de l’Ariège et le docteur Bareilles, maire
de Pamiers. Avec la mise en place de l’automatique, les Appaméens
allaient enfin voir l’installation de cabines téléphoniques
sur la voie publique. Il n’en existait qu’une située
aux HLM du Foulon. Ce fut chose décidée et faite en 1975
: "Seront installées courant deuxième semestre 1975,
les cabines téléphoniques situées aux emplacements
suivants : rue des Carmes face au centre téléphonique
automatique, cour de la gare SNCF, angle Boulevard, Pierre Sémard,
quartier des Canonges, angle avenue Capitaine Tournissa et rue des Cendresses,
quartier Marassé-Randille devant le collège Jean XXIII,
angle Avenue de la Paix, carrefour de Lestang, place Sainte Hélène,
celles du quartier de Loumet, place Marché-au-Bois, place de
la République seront installées dans le premier semestre
1976.
Dans le Cher
A Bourges dès 1895, le maire, Henri Mirpied,
qui réfléchit à l’installation d’un réseau
téléphonique municipal : un devis estimatif est dressé
le 21 février pour une somme de 5700 francs de l’époque.
Il faut cependant attendre quelques années avant que les choses
se mettent en place : une délibération du Conseil municipal
du 25 mars 1905 décide de "L’établissement
d’un réseau téléphonique destiné à
relier à un point central, l’Hôtel de ville, les bureaux
d’octroi, les postes de police, l’hôtel-Dieu et le bourg
d’Asnières".
L’année suivante, le maire, Henri Ducrot, demande au Conseil
municipal de contracter un emprunt pour couvrir l’établissement
de ce réseau téléphonique dont les frais de première
installation se chiffrent à 9111 francs et soixante centimes.
Le matériel choisi provient de l’entreprise Alfred Burgunder,
constructeur-électricien qui propose une grande variété
de postes muraux et mobiles, poinçonnés par l’Etat
et réalisés en acajou verni. L’horloger électricien
Julien Elis, domicilié 2, Place de la Gare à Bourges,
sert d’intermédiaire entre l’entreprise parisienne
et la municipalité.
L’installation du réseau téléphonique se poursuit
dans les années suivantes.
A cette époque, la mairie qui vient de s’installer dans
l’ancien palais archiépiscopal se dote d’un équipement
ultra moderne. Il s’agit de trois appareils portatifs (bureaux
du Maire, des adjoints et du secrétaire général),
un appareil mural (local du garçon de bureau) et treize appareils
muraux destinés uniquement à la communication interne.
Le marché destiné à cette nouvelle installation
et passé avec Julien Elis est approuvé par le Conseil
municipal dans sa séance du 18 mars 1910.
Le téléphone restera pendant des décennies
l'apannage des personnes fortunées ou celles qui avaient un vrai
besoin professionnel comme les médecins. Il faudra attendre les
années 1970 et un grand plan du gouvernement sous l'autorité
de Giscard d'Estaing, pour que le téléphone se développe
en France et à Bourges.
Il faut savoir qu'un couple habitant Bourges en 1975, demandait une
ligne téléphonique, et qu'entre sa demande faite très
officiellement aux PTT (Postes, Téléphone et Télégraphes)
et l'arrivée de la ligne et du numéro à 6 chiffres,
il fallait entre 1 et 2 ans d'attente.
Il y avait peu de téléphone à Bourges et beaucoup
n'en éprouvaient pas le besoin, puisque leurs relations et leurs
amis n'en disposaient pas.
"A qui voulait-vous que l'on téléphone ?" tel
était la remarque sensée de beaucoup, car hormis le médecin,
les pompiers et l'hôpital, nul besoin de téléphoner.
Et en quelques années, par une vraie volonté politique,
le téléphonne entrera dans les foyers des Berruyers.
Aussi, la révolution de la fin du XXième siècle
avec le développement de la téléphonie mobile va
constituer un phénomène de société.
Dans la Creuse
En 1904, il ne comptait qu'une trentaine d'utilisateurs.
On en comptait 10 à Guéret : Auclair, agent d'assurances
; Bennejean, journal La Dépêche ; Bourzat, syndicat agricole
; la Chambre de commerce ; Coulon, compagnie l'Union ; Gauvin-Planchat,
représentant ; Gomot, docteur en médecine ; Lavenat, marchand
de bois ; Marquet, café Continental et la préfecture.
Quant à la mairie, elle était aux abonnés absents.
Aubusson devançait le chef-lieu avec onze abonnés
: Braquenié, Croc et Jorrand, Fougerol, Hamot, Sallandrouze frères,
Tabard, tous fabricants de tapisseries ; Dubreuil, hôtel et café
de France ; Merlat, avoué ; Moluçon, journal le Mémorial
de la Creuse ; la Société Générale, banque
et la sous-préfecture.
On notait deux abonnés à Bourganeuf, la sous-préfecture,
et Danthon, fabricant de papier de paille ; quatre à Boussac,
la sous-préfecture, Janot et Janot, minotiers, Sambon, minotier
; un à Lavaveix, les Houillères d'Ahun ; deux à
La Souterraine, Loubry, hôtel du Lion d'Or et Rousseau,
marchand de chevaux.
La taxe locale était de 10 centimes pour trois minutes de conversation
; de 40 centimes pour téléphoner dans la Haute-Vienne
; de 50 pour l'Allier, la Corrèze, la Charente, la Dordogne ;
de 1 franc pour la Seine, la Seine-et-Oise, la Seine-et-Marne et la
Haute-Garonne. L'abonnement coûtait 100 F la première année,
80 F la deuxième, 60 F la troisième, 40 F les suivantes.
Les PTT fournissaient aux abonnés la ligne intérieure
de raccordement, les générateurs nécessaires au
fonctionnement du poste téléphonique de type mural. Pour
un poste mobile, il fallait payer 10 F de redevance annuelle.
L'abonnement forfaitaire annuel donnait la possibilité de téléphoner gratuitement depuis l'un des 16 postes publics du département (Guéret, Aubusson, Bénévent-l'Abbaye, Bourganeuf, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Chénérailles, Évaux-les-Bains, Felletin, Genouillac, Gouzon, Le Grand-Bourg, Jarnages, Lavaveix, La Souterraine, Vallières.
En Haute-Savoie
17 Janvier 1878 : première liaison Thonon-Évian
.
A Lyon, le réseau a progressé
assez rapidement.
1881 : Lyon compte initialement 23 abonnés, et depuis
1881, les habitants de cette ville peuvent en cas d'accident grave ou
d'incendie, prévenir instantanément le bureau central
de police. Cinq bureaux de police étaient reliés à
cette époque avec le bureau central : le bureau du 2° arrondissement,
rue Sorbier; du 3° arrondissement, rue Annonay ; du 4e arrondissement,
rue Soleysel ; du 5e arrondissement, rue Bourgneux, et à l'abattoir
de Mattetières.
En 1908, le lundi 28 décembre, est mis en service à
Lyon à titre d'essai, et provisoirement, un Centre Téléphonique
Automatique raccordé à 200 abonnés qui peuvent
alors s'appeler directement entre eux, sans passer par une seule opératrice.
Le système alors expérimenté est du type LORIMER,
c'est un autocommutateur de type rotatif à impulsions, conçu
en 1903 aux U.S.A par les trois frères Lorimer d'origine canadienne.(l'histoire
est intéresante)
1928 L'automatique arrive enfin à Lyon :
Une lettre du 16 septembre 1924 du directeur général des
Postes et Télégraphes ( 33 bis rue Vaubecour) demande
autorisation de construire au dessus de la gare du funiculaire de Lyon
à la Croix-Rousse (rue Terme) un bâtiment de 2 étages,
rue du jardin des plantes et rue Burdeau.
Le Central Téléphonique Lalande (1, boulevard Jules-Favre
; rue Fournet ; rue Lalande dans le 6e arrondissement de Lyon) a aussi
été construit dans ces années (permis de construire
datant de 1927).
Deux Commutateurs Strowger
sont installés à Lyon-Franklin (6.000 Lignes) et
à Lyon-Burdeau (7.000 lignes) puis mis en service le 11
mai 1928. (Ils seront remplacés respectivement le 26 janvier
1952 et le 13 septembre 1969) .le Central Burdeau, est aujourd’hui
désaffecté .
Au début du 20 ème sièclel plusieurs 'Centraux
Téléphonique' ont été construit : LALANDE,
PARMENTIER, VAUDREY-MONCEY 1919-1927, FRANKLIN, LACASSAGNE 1972 .
Dans la Vienne
1899 c'est l ’arrivée du téléphone à
Montamisé.
| Le 29 août 1899, le Conseil général
de la Vienne va décider de créer un réseau
téléphonique départemental, ainsi toutes les
communes pourront y avoir accès. Dans la réalité ce projet va être plus difficile à élaborer, notamment sur l’aspect financier pour les communes. Le 12 janvier 1902, le maire de Montamisé Jacques Adrien Taveau de Morthemer, répond au préfet, au nom du conseil municipal «le Conseil considérant que la commune a fait cette année beaucoup de dépenses et qu’elle n’a pas de ressources, refuse cette demande». Seulement 58 communes répondront favorablementà la création du premier réseau téléphonique. Le 13 novembre 1904, le maire de Montamisé, Jacques Adrien Taveau de Morthemer répond à la demande du préfet «Le Conseil... refuse de faire partie du second réseau téléphonique, n’ayant pas de fonds disponibles». Vingt-sept communes répondront favorablement. Le 25 janvier 1908, le maire de Montamisé, Jacques Adrien Taveau de Morthemer adresse une lettre au préfet «avant de proposer au conseil municipal l’installation du téléphone à Montamisé, je viens vous prier de m’envoyer les instructions nécessaires afin que nous puissions délibérer en connaissance de cause, car nous voudrions avant de rien entreprendre, savoir ce que cela coûterait». Dans une délibération du 9 février 1908, le maire donne lecture d’une circulaire du préfet relative à l’organisation du troisième réseau téléphonique «le Conseil...accepte les conditions énoncées dans la dite circulaire et s’engage à payer les frais nécessités pour l’installation». Le 10 janvier 1909, le conseil décide de donner à l’adjudication la gérance, le local et le port des dépêches, deux soumissionnaires sont candidats, Auguste Clément Maillet est déclaré adjudicataire au prix de 80 F. Puis le 14 février 1909, le préfet demande de procéder à une nouvelle adjudication pour le service téléphonique, gérance et port des dépêches, celle-ci aura lieu le 21 février 1909. Il y a quatre soumissionnaires, Adrien Gentis ayant demandé le prix le moins élevé (48 F) a été déclaré adjudicataire. Le 10 octobre 1909 il est désigné par le directeur des postes pour la gérance du bureau téléphonique (30 F) et port des dépêches (18 F). La mise en service de la cabine téléphonique se fera le 1 janvier 1910, son lieu d’implantation est dans l’immeuble Delavault. Adrien Gentis est maréchal-ferrant au bourg, marié à Anna Ribreau, il est aidé dans sa gérance par sa fille Adrienne. L’annuaire de la Vienne de 1922-1923 nous apprend que le facteur-receveur est M Blanchard, il y a un abonné au téléphone: le comte Louis de Murard au château de la Roche de Bran. Le tarif pour les conversations locales est de 25 centimes, pour les conversations interurbaines vers le canton de 50 cts et 1F pour les autres réseaux. L’abonnement au téléphone pour la première année est de 300 F, deuxième année 200 F et 125 F pour la troisième année. En 1926-1927, le facteur-receveur est M Martin, il y a deux abonnés: le comte Louis de Murard et le brigadier des eaux et forêts à Moussel, forêt de Moulière. En 1948, pour 779 habitants, l’annuaire téléphonique de Montamisé «s’étoffe» : -N°1 le comte Hugues de Murard, exploitant agricole et forestier à la Roche de Bran -N°2 le brigadier des eaux et forêts, à Moussel, forêt de Moulière -N°3 Martin René, garagiste à Charassé -N°4 Veuve Rat (née Joyeux Marie Eugénie), auberge àCharassé -N°5 Getten Pierre, château de Sarzec -N°6 Prévost Léon, aubergiste au bourg -N°7 Neveu Joseph, bois et charbon à Tron -N°8 Mairie de Montamisé. En En 1948, Montamisé ne dispose que de 8 abonnés au téléphone. |
Toujours dans la Vienne à Achnigny, la première cabine publique tarde à arriver.
Etant natif des Deux Sèvres, j'aime l'histoire lue sur le site de Pioussay
|
Téléphone
en Deux-Sèvres au travers des sessions du Conseil général Les élus Deux-Sèvriens ont dû partir à la pêche à la ligne… et aux subventions pour que la ville puisse enfin bénéficier du téléphone. Si l'Américain Graham Bell effectue ses premiers tests dès 1876, il faut encore attendre un quart de siècle avant que le téléphone ne fasse son apparition en Deux-Sèvres. Et plutôt timidement… Le 30 septembre 1899, le préfet adresse en effet un courrier à l'ensemble des communes, leur indiquant que l'État projette de mettre en place un réseau dans le département. Dans un premier temps, seuls les chefs-lieux de canton seraient reliés entre eux. Le préfet précise pourtant d'emblée… que l'État ne dispose d'aucun budget pour implanter le réseau en Deux-Sèvres ?! Alors même qu'il note « l'importance que prend chaque jour la téléphonie et les facilités qu'offre ce nouveau moyen de communication ». il lance un appel… aux communes et au conseil général pour financer l'opération, laissant entendre qu'ils se rembourseraient grâce à l'exploitation des lignes?! Le téléphone c'est bien sans doute Le 25 octobre 1899, le conseil municipal de Pioussay admettait le principe de la création d'un réseau téléphonique départemental des Deux-Sèvres, mais qu'il ne voulait prendre aucun engagement à ce sujet.Plutôt dubitatifs, les maires répondent finalement à l'appel… et décrochent différentes aides. La construction du réseau deux-sévrien doit revenir à environ 16.500 F de l'époque, pris en charge pour les 2/3 par le conseil général. Le 6 novembre 1900, les élus parthenaisiens, sous la houlette du maire Louis Aguillon, votent une participation de 835 F. Le réseau se met progressivement en place dans les mois qui suivent. Pourtant, dès 1903, certaines lignes jugées peu rentables sont déjà supprimées… Aucune utilité pour Pioussay Le 25 novembre 1900, le conseil municipal indique qu'il pense que la commune de Pioussay n'a aucune utilité d'avoir le téléphone et juge qu'elle n'en a pas les moyens.Maintien de la décision Le 21 décembre 1906, Jean Queron, maire de Pioussay, soumet au conseil municipal une circulaire du préfet qui demande si la commune a l'intension ferme d'adhérer à l'extension du réseau téléphonique départemental des Deux-Sèvres. Le conseil municipal refuse d'adhérer. Les élus Deux-Sèvriens ont dû partir à la pêche à la ligne… et aux subventions pour que la ville puisse enfin bénéficier du téléphone. Maintenant on le veut ce téléphone Le 15 juillet 1922, M. Fillon, le maire de Pioussay, soumet au conseil municipal une lettre qui sera adressée au directeur du service postal des Deux-Sèvres. Le conseil municipal décide à l'unanimité que la commune de Pioussay doit être dotée d'un service téléphonique. Confirmation Le 8 octobre 1922, suite à la réponse du préfet, le conseil municipal décide de se rattacher au réseau et d'en assurer le fonctionnement selon les conditions édictées. En 1956  En 1970
En 1970  |
En Vendée
A Bournezeau Le télégraphe et le téléphone
à la gare de Bournezeau fut longtemps un handicap pour le voir
apparaître en centre ville, car la gare n'était qu'à
2 km du bourg, à 5 mn pour un cavalier et 20 mn pour un piéton.
Nous avons peu de renseignements concernant le service téléphonique,
à part les quatre délibérations du conseil municipal
ci-dessous :
- 6 août 1905 - lettre du préfet au maire demandant à
la commune de voter des ressources pour l'établissement d'un
réseau téléphonique cantonal en Vendée.
Le conseil donne un avis favorable et réserve ses faibles ressources
au cas o๠le conseil général présenterait
un projet pour relier Bournezeau à la ligne téléphonique
cantonale.
- 17 septembre 1905 - lettre du préfet au maire, concernant le
rattachement de Bournezeau au réseau téléphonique
départemental. Le conseil donne un avis favorable à l'unanimité,
et prie le préfet de bien vouloir faire procéder à
des études en vue de déterminer le montant de la dépense
de la commune de Bournezeau.
- 12 novembre 1905 - Lettre du Préfet au maire. Il demande au
conseil municipal de voter la somme de 5 810 francs pour l'établissement
du circuit téléphonique de Bournezeau à la Chaize
et de s'engager à payer les frais d'installation d'une cabine
téléphonique. Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal unanime s'engage à payer les frais d'installation
d'une cabine téléphonique de 1,20m de côté.
Il s'engage également à payer l'intérêt de
4 % de la somme, soit 232,40 francs, ce montant sera porté au
budget additionnel de 1906.
On peut en conclure que le téléphone est probablement
arrivé à Bournezeau, l'année suivante, en 1906.
- 17 mai 1914, le conseil municipal sollicite le directeur des P.T.T
de la Vendée, pour l'ouverture entre midi et deux heures de l'après-midi,
du bureau de poste de Bournezeau les jours de foire, des services téléphoniques
et télégraphiques.
Le téléphone est arrivé à la laiterie de
l'Oiselière vers 1930. « Les fils venaient de Bournezeau.
»
Dans les années 1950, le téléphone arrivait de
la gare vers Bournezeau. Les fils longeaient la voie ferrée et
la départementale n°7, jusqu'à l'arrivée du
téléphone automatique vers 1960. Avant, on rentrait en
contact avec une opératrice qui vous demandait votre numéro
et le numéro de votre correspondant pour vous mettre en ligne
avec lui.
On ne sait pas quand le premier annuaire téléphonique
est sorti, mais sur celui de 1933, il y avait 22 abonnés à
Bournezeau. Sur celui de 1962, il y en avait 78 et 1210 sur celui de
2012. (Sans Saint-Vincent-Puymaufrais).
Des jours différents s’annoncent pour nos campagnes avec
la privatisation de la Poste : fermeture des bureaux ruraux, ouverture
à temps partiel, création d’agence postale (communale
? communautaire ?) ou de relais postal commercial. Le facteur fera t-il
encore un passage quotidien ou tous les deux jours comme avant 1832
? Internet est-il entrain de tuer le service postal du courrier ?
Les facteurs s’en sont allés avec beaucoup de peine, ce
lundi 14 février 2005, en quittant le bureau de la poste de Bournezeau,
laissant seul un collègue qui les a rejoints le 17 avril 2007,
fermant ainsi la longue marche de l’histoire du centre de tri de
Bournezeau. Les derniers facteurs de Bournezeau gardent un souvenir
amer de leur départ.
En même temps que la fermeture du bureau de poste, un relais postal
sera créé dans un commerce de Bournezeau le 31 mai 2013.
Dans le Puy-de-Dôme
Source : Claude Lambert : Parmi les quelques rares informations que
j’ai pu trouver, notons qu’à Rawdon l’arrivée
du téléphone remonte à 1904 et à Sainte-Julienne
vers 1910.
À Chertsey, le premier téléphone "central"
est installé chez Théophile Poudrier vers 1902.
A Saint-Donat Pour le moment je possède très peu
d’informations sur ce qui existait à Saint-Donat avant la
création de la Compagnie de Téléphone St-Donat
Ltée, en 1926. Aux dires des anciens, le village était
relié par une ligne téléphonique à la Compagnie
de Téléphone de Joliette, (fondée au début
de 1900 par un groupe de citoyens de Joliette et du comté de
Montcalm). Le téléphone "central" aurait été
chez Théodore Riopel au moment où il demeurait sur la
rue principale aujourd’hui l’emplacement de la Caisse Populaire.
Ce serait avant 1920. Mais qu’est-ce qu’un téléphone
central ? Cela veut dire que les gens doivent se déplacer à
un même endroit pour faire leurs appels. Mais attention ! Chacun
doit attendre patiemment son tour, en espérant que la ligne ne
sera pas occupée ! Était-ce une ligne téléphonique
installée par les compagnies de bois pour leurs affaires et dont
pouvaient bénéficier les villageois ? Pour le moment je
ne pourrais le dire.
Fondation de la Compagnie de Téléphone
St-Donat Limitée 1926-1960.
Quelques versions m’ont été racontées quant
à l’origine de la fondation de cette compagnie dont voici
la plus probable. Hector Bilodeau alors garde forestier à Saint-Donat,
était un homme avant-gardiste et à cette époque
il cherchait à intéresser son beau-père Joseph
Thibault à la mise sur pied d’un système de téléphone
qui conviendrait mieux au progrès croissant du village. Un incident
dans la famille Thibault fera cependant que précipiter les choses.
Vers 1925 une des filles de Joseph, Lucienne tombe gravement malade.
Puisque la municipalité n’a pas encore de médecin
résident (Altitude 1350, juin 1995), Joseph se rend chez Théodore
Riopel pour téléphoner, mais ne parvient pas à
obtenir la communication. Heureusement, l’incident ne sera pas
fatal pour Lucienne, mais contribuera grandement à décider
Joseph de fonder avec son gendre sa propre compagnie de téléphone.
Lorsque Joseph Thibault crée la " Compagnie de Téléphone
St-Donat Limitée " en juin 1926, il est alors propriétaire
de la Pension Thibault qui deviendra avec les années l’Hôtel
Le Château du Lac. Cette compagnie est une corporation dont les
actionnaires à ses débuts outre Joseph Thibault président
et Hector Bilodeau secrétaire, sont : " Ovila Villeneuve,
mesureur de bois, Eva Thibault, cuisinière, et Marie-Anne Thibault,
gérante de Banque " (une succursale de la Banque Provinciale).
La Compagnie ne cessera de prendre de l’ampleur au fil des années,
comme nous le verrons dans le prochain article. Je vous invite à
conserver celui-ci pour mieux comprendre la suite de l’histoire...
Le central téléphonique était installé dans
une annexe de la maison de Joseph Thibault, sur la rue Principale. Mais
avant la construction de cette annexe, le central fut d’abord installé
dans la maison même de Joseph Thibault. La première année,
l’entreprise dessert 15 abonnées et progressivement le service
s’étend à Notre-Dame-de-la-Merci et à Lantier.
Les premières téléphonistes sont Ange-Emma Godon
épouse de Joseph et leur fille Eva. Plus tard, les autres filles
du couple, Lucienne, Blandine et Cécile prendront la relève.
En 1928, on retrouve dans le bottin téléphonique 57 abonnés
dont 4 à Notre-Dame-de-la-Merci, soit : la Maison de Pension
de Théodore Crépeault, le curé Eugène Mondor,
Adélard Prud’homme et la Maison de Pension de Maxime Rivest.
En tout on compte 5 lignes privées et 11 lignes de groupe.
Dring ! Dring ! En résumé voici comment
on acheminait un appel. On ne signalait pas le 424-3720 pour obtenir
directement une communication. Deux choix s’offraient, soit que
l’on rejoigne une personne par une ligne privée ou par une
ligne de groupe. Pour les lignes de groupe, on retrouvait dans le bottin
un numéro comme le 7-r-13 qui signifiait à l’opératrice
de brancher au central la ligne 7 et de faire sonner (r= ring ou s=
sonnez) 1 grand coup et 3 petits coups. Tous les abonnés dont
le numéro commençait par 7 entendaient la sonnerie, mais
le nombre et la longueur des coups leur disait si l’appel leur
était destiné ou non. En faisant le 7-r-13 on rejoignait
le Constable Emile Desrochers. Pour les lignes privées, plus
dispendieuses, on n’avait qu’à demander un chiffre,
par exemple le 16 et on obtenait la communication directement avec l’abonné.
À cette époque le réseau téléphonique
comptait une ligne pour Montréal et une pour Sainte-Agathe-des-Monts.
Les appels devaient passer par Sainte-Agathe-des-Monts avant d’être
acheminés vers d’autres villes.
Voici une description de l’intérieur du central téléphonique
à l’époque où il est aménagé
dans l’annexe de la maison de Jos Thibault. Dans la pièce
avant, on retrouve un espace aménagé pour recevoir les
clients ainsi qu’une cabine téléphonique publique
branchée au central et servant surtout pour les "longues
distances". À l’arrière, il y a le central proprement
dit, un poêle à bois, une petite cuisine et un lit. Deux
opératrices se relaient pour offrir le service 24h sur 24h et
dorment sur place. Avant de se coucher, l’opératrice prend
bien soin de fixer à son lit une corde reliée à
une clé du central afin de pouvoir répondre promptement
si le téléphone sonnait durant la nuit. Mme Madeleine
Forget-Regimbald se souvient d’un été, vers 1944,
où durant cette grosse saison les gens devaient attendre de 3
à 4 heures pour appeler à Montréal. Elle devait
limiter les conversations à 5 minutes et souvent elle devait
rappeler les gens à la maison, de 10 à 15 minutes avant,
pour savoir s’ils désiraient toujours effectuer leur appel.
Une facture de téléphone s’élevait approximativement
à 2.10$ par mois excluant les "longues distances".
Une téléphoniste gagnait 50$ par mois.
Succession à la présidence. Après le décès de Joseph Thibault en 1947, son gendre Ovila Villeneuve devient le second président de la Compagnie. En 1952, la fille de Joseph, Lucienne succède à Ovila et devient l’une des premières femmes d’affaires à diriger une entreprise d’envergure à Saint-Donat. Elle demeure à son poste jusqu’à la vente de la Compagnie. La fin d’une époque. À la fin des années 1950, presque toutes les familles donatiennes profitent du service téléphonique. On compte également de plus en plus de villégiateurs désirant un appareil à leur chalet. La compagnie ne pourra bientôt plus servir correctement ses quelque 500 abonnés à moins d’investir des sommes considérables dans de nouveaux équipements. Une grave décision s’impose et elle sera prise officiellement le 20 août 1960 : on vend l’entreprise à Bell Canada après 34 années de loyaux services à la communauté. Le central restera en opération durant trois ans encore, jusqu’à l’automatisation de l’équipement. Aussi verra-t-on disparaître progressivement des maisons le téléphone mural à magnéto avec sa manivelle. Le métier de téléphoniste cessera d’être exercé à Saint-Donat en 1963.
A Saint-Laure
Les deux frères Pierre et Marcel Robillon, se rappellent que
leur famille a été l'une des premières de la commune
à avoir fait installer le téléphone en 1955.
- A Bordeaux, le réseau téléphonique,
installé en 1880, se développait rapidement. En juillet
1881, la Société générale des Téléphones
desservait déjà dans cette ville plus de 50 abonnés.
La Chambre de commerce de Bordeaux fit relier plusieurs locaux, dépendant
de son administration, au bureau central. Elle permit aussi l'organisation
à la Bourse, d'un bureau spécial d'où chaque abonné
du réseau, sur la présentation de sa carte d'abonnement,
pouvait être mis en communication avec les autres abonnés.
Plusieurs industriels sont, depuis 1881. reliés directement avec
leurs succursales situées dans un autre quartier de la ville
que la maison-mère.
En raison du développement rapide de son réseau téléphonique,
la Société générale des Téléphones
décida qu'à partir du 15 novembre 1881, le service aurait
lieu à Bordeaux, sans interruption, nuit et jour.
sommaire
- A Saint-Etienne (Loire), des postes téléphoniques
furent établis en 1881, reliant entre eux les bureaux de police.
Le téléphone fut également installé dans
d'importantes maisons de cette localité, des fabriques de rubans,
d'armes à feu, de quincaillerie, de verrerie, de coutellerie,
et surtout dans toutes les grandes exploitations houillères de
la ville et des environs.
sommaire
- A Angoulême, un service téléphonique entre
l'École d'artillerie, l'arsenal de la Madeleine et les autres
établissements militaires fut établi au commencement de
1881. Soit par suite de l'indifférence du public, qui regardait
le téléphone comme un simple jouet sans utilité
pratique, soit surtout par suite des nombreuses difficultés élevées
par l'administration, qui craignait l'absorption du télégraphe
par le téléphone, jusqu'en 1882, ce nouveau mode de transmission
avait, en somme, fait peu de progrès en France.
En Sologne
C'est en 1900 que la Romorantin a été raccordée
au réseau téléphonique. Au début, les abonnés
sont au nombre de dix. Le bureau de poste est alors installé
rue de la Tour. Dans son bulletin n° 168 la Société
d'art, d'histoire et d'archéologie de la Sologne (Sahas) décrit
:« Sur le toit de la poste se dresse une herse d'où partent
les fils raccordant les abonnés au téléphone, visible
sur les cartes postales ».
Le nombre d'abonnés au téléphone s'accroît
rapidement. En 1914, ils sont 63 ; 124 en 1928.
Parallèlement le nombre d'employés au central téléphonique
augmente aussi et les locaux deviennent trop exigus.
1936 Un nouveau bâtiment est construit quai Jacquemart,
il sera livré en septembre . Dans le bulletin de la Sahas précité
Hélène Leclert écrit : « Les Romorantinais
découvrent un bureau de poste vaste, bien éclairé
avec son long comptoir de granit noir […] L'architecture du bâtiment
est critiquée par de nombreux habitants.»
Il faudra attendre 1980 pour que le central téléphonique
soit complètement automatisé.
1893 LE TÉLÉPHONE AU PAYS BASQUE.
Voici ce que rapporta à ce sujet la presse locale, dans diverses
éditions :
1893 La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz,
le 17 décembre :
"Question urgente. Il y a quelque trois ans, la Chambre de Commerce
de Bayonne a délibéré sur l'opportunité
de la création d'un réseau télégraphique
ou téléphonique, entre Hendaye, le Socoa, la Barre et
Bayonne ; il nous souvient que des résolutions favorables à
cette création ont été prises, et qu’un arrêté
ministériel en date du 15 Août 1891 donnait les autorisations
nécessaires.
Tout récemment encore, dans de douloureuses circonstances, la
nécessité de ce réseau s'est manifestée
cruellement.
Il permettrait de se renseigner en temps utile sur le sort des embarcations,
de rassurer ou prévenir familles ou amis des marins, de secourir
les bateaux en danger sur un point quelconque de la côte.
Au surplus nous plaidons une cause gagnée ; mais c’est l’exécution,
l'exécution rapide que nous demandons.
Le 28 Novembre le Conseil Municipal de Biarritz, sur l’initiative
de M. Garay, a émis un vœu en ce sens ; ce vœu comporte
un amendement bien logique : participation de tous les points importants
de la côte au bénéfice de cette organisation, et
aussi participation, s'il en est besoin, des communes desservies aux
frais d'établissement.
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce de Bayonne est
donc prié de vouloir bien donner la raison des atermoiements
inexpliqués et dire si, oui, ou non, la Chambre de Commerce veut
donner suite aux projets en question.
Si c’est l’argent qui manque, il faudrait nous dire au moins
dans quelles proportions, afin que les communes, consultant les ressources
de leur budget, puissent aider à l'accomplissement d’une
amélioration si ardemment souhaitée, si impatiemment attendue."
1894 La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz,
le 27 mai :
"Séance du 19 mai Sont présents : MM. Augey, maire
; Moureu, adjoint ; Garay, secrétaire ; Peyta, Rongau, Lacour,
Cassiau, Crouxet, Legrand, Dalbarade, Pierson, Baylion.
...Des réponses reçues du Ministère des Postes
et du Ministère des Travaux publies, il ressort que l’on
n’obtiendra pas la ligne téléphonique reliant les
divers points de la côte d’Hendaye à la Barre.
Cependant, une nouvelle démarche sera tentée sur la demande
du conseil, auprès du ministre de la marine et auprès
de la Chambre de commerce de Bayonne. La dépense est évaluée
à 15 000 fr., mais l’utilité de cette création
est considérée comme nulle par les ministères."
1896 La Gazette de Biarritz-Bayonne et
Saint-Jean-de-Luz, le 31 janvier :
"Ligne téléphonique.
A la réunion de la Chambre de Commerce de Bayonne, le 8 Janvier
dernier, il a été donné lecture des propositions
de M. le Directeur des postes et des télégraphes des Basses-Pyrénées
pour un établissement d’un réseau téléphonique
comprenant Biarritz-bureau, Biarritz-sémaphore, Bidart, Guéthary,
St-Jean-de-Luz, Socoa et Hendaye ; ce réseau se trouverait naturellement
relié à celui de Bayonne, et, par l’intermédiaire
de ce dernier, au Boucau, par les communications déjà
existantes.
Par une délibération motivée et sous réserve
de l’autorisation ministérielle, la Chambre a décidé
l’établissement de ce réseau."
1897 La Gazette de Biarritz-Bayonne et
Saint-Jean-de-Luz, le 1 avril :
"Téléphone".
Dans un mois, le 1er mai prochain, la ligne téléphonique
côtière reliant Biarritz à Bidart, Guéthary,
St-Jean-de-Luz, Hendaye, Bayonne, le Boucau, sera enfin ouverte au public
; il n’y a plus qu’à effectuer la pose du fil de St-Jean-de-Luz
à Hendaye.
Cette indispensable création sera bien accueillie, surtout de
la population de Biarritz. La facilité des relations téléphoniques
avec les localités voisines, sera un premier palliatif à
l’incommodité des communications en chemins de fer, incommodité
causée par l’éloignement ridicule de la gare de la
Négresse et par les retards indéfinis subis par la question
du raccordement.
D’un autre côté, les villes de Dax, Pau, Bayonne et
Bordeaux ont toutes accordé des avances, variant de 10 000 à
40 000 francs, en faveur de la création du réseau téléphonique
direct, reliant ces localités à Paris. Il n’y a donc
plus aucun obstacle à ce que l’établissement de ce
réseau soit fait dans le plus court délai. On peut espérer
qu’il fonctionnera dans les premiers mois de l’année
1898.
Le prix des communications sera fixé, de Biarritz à Bordeaux,
à 1 fr. 50 les 3 minutes de conversation et de Biarritz à
Paris, à 4 fr. 50 pour la même durée. De Biarritz
ou de Bayonne à Pau, le prix sera de 1 franc."
1898 La Gazette de Biarritz-Bayonne et
Saint-Jean-de-Luz, le 24 février :
"Nouveau Réseau Téléphonique.
A partir de samedi prochain, 20 février, Biarritz pourra correspondre
directement, par le téléphone, avec Pau, Dax, Bordeaux,
Paris, etc.
Nous n’avons pas à revenir sur l’utilité incontestable
de cette amélioration, pour laquelle d’ailleurs la ville
de Biarritz a consacré une avance de 10 000 fr.
Voici le prix des conversations par 5 minutes avec les principales villes
desservies :
De Biarritz à Pau : 1 fr.
De Biarritz à Dax : 0 fr. 50
De Biarritz à Bordeaux : l fr. 50
De Biarritz à Angoulême : 2 fr. 50
De Biarritz à Royan : 2 fr. 50
De Biarritz à Saintes : 2 fr. 50
De Biarritz à Niort : 2 fr. 50
De Biarritz à Fontenav-le-Comte : 2 fr. 50
De Biarritz à Montauban : 2 fr. 50
De Biarritz à Agen : 2 fr. 50
De Biarritz à Limoges : 3 fr. 50
De Biarritz à Toulouse : 3 fr. 50
De Biarritz à Carcassonne : 3 fr. 50
De Biarritz à Paris : 4 fr. 50
De Biarritz à Versailles : 4 fr. 50
De Biarritz à Melun : 4 fr. 50
De Biarritz à Fontainebleau : 4 fr. 5
I l sera également permis à Bidart, au Boucau, à
Guéthary, à St-Jean-de-Luz, à Hendaye, de téléphoner
indirectement, et avec le même barème de prix, avec les
villes indiquées ci-dessus."






 Fig 2
Fig 2 Fig 3
Fig 3






 Equipe des lignes
de Carcassonne 1937
Equipe des lignes
de Carcassonne 1937