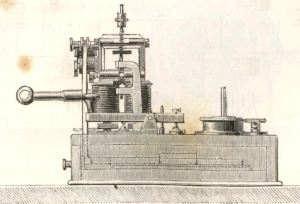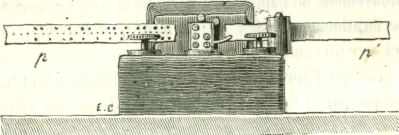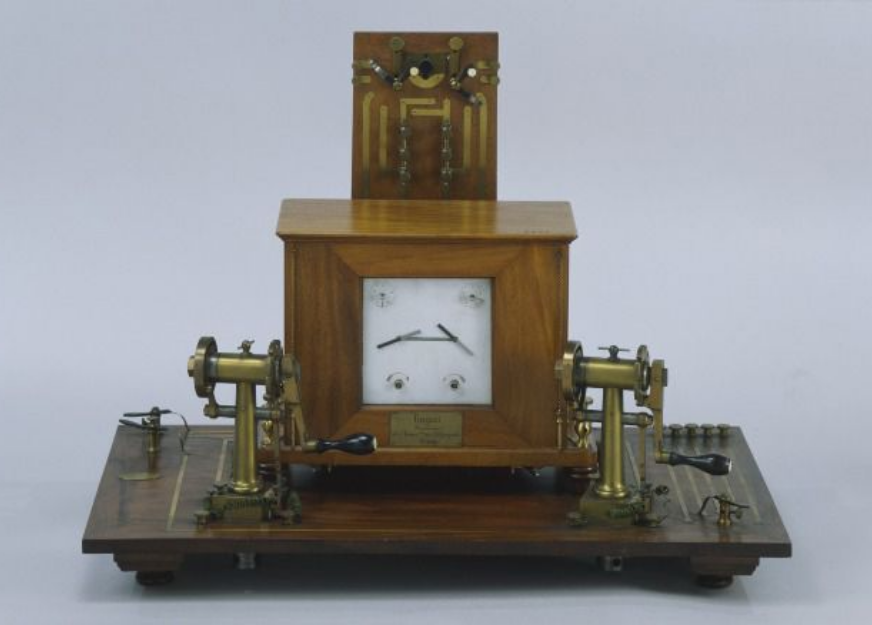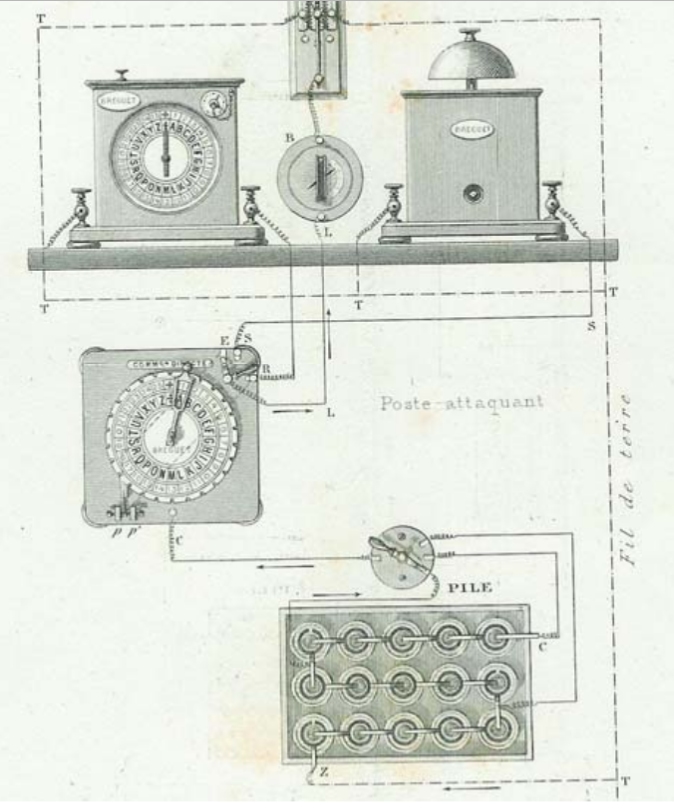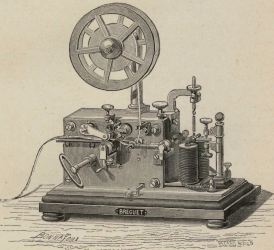|
ORGANISATION
DES ADMINISTRAIONS DES POSTES ET DES TELEGRAPHES
Comment expliquer que l'on soit passé d'un réseau
télégraphique français considéré
comme le meilleur au monde en 1864 (1), d'un domaine où les
innovations françaises obtiennent des succès sur la
scène internationale dans les années 1870, à
un état désastreux du réseau téléphonique
en 1900 ?
L'étude de l'attitude d'un groupe spécifique parmi
les ingénieurs du télégraphe que nous baptiserons
« groupe des Annales », et de sa volonté
de favoriser la recherche et la culture technique des télégraphistes
va nous permettre d'apporter à cette question des éléments
de réponse tranchés par rapport aux explications traditionnelles.
L'invention des premiers instruments électriques
permettant l'échange d'informations écrites à
distance (télégraphe) est réalisée simultanément,
en 1836-1837, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne (2).
L'installation des premières lignes, puis des premiers réseaux,
dès le début des années 1840, sont effectives
dans les principaux pays développés (Grande-Bretagne,
Etats- Unis, France, Etats allemands...) quelles que soient les
formes empruntées (réseaux d'Etat
en Europe, privés aux Etats-Unis).
Partie avec un temps de retard, la France va connaître un
développement spectaculaire dans les années 1850-70
grâce à la conjonction de plusieurs facteurs :
— l'octroi de crédits importants
autorise l'installation du réseau dès la fin des années
1840. Rompant avec les tergiversations et les résistances
de la Monarchie de Juillet, la politique d'équipement votée
par l'éphémère Seconde République sera
amplifiée sous Napoléon III,
— l'ouverture du télégraphe
aux échanges commerciaux, opérée dans les premières
années du Second Empire, va permettre une croissance soutenue
du trafic et des recettes,
— la mutation de l'Administration traditionnelle
(la « maison Chappe ») sera entreprise très tôt
sous le règne du directeur général de Vougy,
la mesure la plus spectaculaire étant la promotion des inspecteurs
techniques au détriment des anciens chefs de station, dont
le rôle était essentiellement administratif et politique
(les garants du secret des dépêches) (3),
— la création par A. Foy, dès
le début des années 1840, d'une politique de recrutement
de personnel technique de haut niveau, ingénieurs issus de
l'Ecole polytechnique et même, en 1860, d'un ingénieur
conseil féru d'électricité (Théodose
du Moncel (4),
— l'existence, au sein du tissu social
français, d'une tradition de petits ateliers de mécanique
performants appuyés sur les compétences des anciens
élèves des Arts et Métiers. L'exemple de la
collaboration d'Emile Baudot, célèbre employé
de l'Administration, inventeur de la lignée des télégraphes
multiple-imprimeurs portant son nom et de Victor Cartier, ancien
de l'Ecole des Arts et Métiers de Châlons- sur-Marne,
chef du bureau des études aux ateliers Carpentier (5,) est
tout à fait significatif (6).
Ce qui caractérise cette période de la télégraphie
française tient dans la capacité d'un groupe d'ingénieurs,
qui se constitue au sein de l'Administration des télégraphes
dès la fin des années 1840, à poser les bonnes
questions techniques, à mettre en place une politique de
veille technique et technologique, à favoriser l'innovation,
à lutter inlassablement pour la mise sur pied d'une école
d'ingénieurs électriciens, bref à « inventer
» l'embryon de ce que l'on baptisera plus tard « politique
de recherche ».
1. C'est l'affirmation de H. de Vougy, directeur
général de l'Administration des télégraphes,
qui donne les principaux chiffres des divers réseaux européens.
C'est convaincant sauf pour la Grande-Bretagne.
2. Cette simultanéité des "découvertes"
ou "inventions", qu'elles soient d'ordre conceptuelles,
figure classique du développement des sciences et des techniques.
3. BERTHO, 1981, p. 104.
4. Théodose du Moncel et non pas Théodore comme on
le rencontre souvent dans la littérature secondaire.
5. Jules Carpentier (1851-1912), polytechnicien passé très
rapidement dans l'industrie privé (Compagnie des Chemins
de fer PLM) rachète, à la mort de Rhumkorff, ses ateliers
de constructions d'instruments de mesure électriques.
6. Pour le rôle des Écoles des Arts et Métiers
au XIX' siècle, voir T. Shinn, A. Grêlon.
La constitution du groupe des Annales
Saisissant très tôt l'importance
que va prendre la technique, Foy recrute des polytechniciens (7
) et émet le vœu de créer une école d'application
analogue aux écoles des Mines ou des Ponts et Chaussées.
Eugène Gounelle (1821-1864) en 1844, puis Edouard Blavier
(1826-1887) en 1846, dirigent le chantier de la première
ligne électrique installée entre Paris et Rouen. Bien
d'autres suivront dont nous ne citerons que les plus connus. Jules
Ray- naud (1842-1888), docteur es physique en 1870, popularise,
à l'occasion des essais et mesures qu'il effectue sur les
câbles fabriqués à Toulon, les équations
de Kirchhoff tombées dans l'oubli en France (8). Ernest Mercadier
(1836-1911), entré aux télégraphes à
sa sortie de polytechnique en 1859, est un grand spécialiste
de l'histoire de la science musicale et de la physique appliquée
à la musique.
Républicain convaincu, il est mis à l'index par de
Vougy en 1866 et se met en disponibilité en 1868. Il sera
rappelé en 1870 par Stee- nackers et sera nommé chef
du laboratoire de l'Ecole supérieure de télégraphie
en 1878 ; il est nommé en 1882 directeur des études
à l'Ecole polytechnique, école dans laquelle il enseignait
depuis 1875. Vaschy (1857-1899), brillant théoricien, enseignera
à l'Ecole supérieure des télégraphes
et à l'Ecole polytechnique. Charles Bon- temps (1839-1884)
sera chargé des cours pratiques de télégraphie
à l'Ecole supérieure de télégraphie
(9).
Tous collaboreront activement aux Annales
Télégraphiques, (consultables en
ligne) tant sous la forme d'articles de recherche originaux
que par des notes d'analyses des travaux et inventions réalisés
en France et à l'étranger. Ils vont jouer durant quarante
ans un rôle technique, scientifique et politique original
au sein de l'Administration (10).
Le premier souci de ces ingénieurs et particulièrement
du plus illustre d'entre eux, Blavier, est celui de la formation,
de l'éducation technique des télégraphistes,
quelle que soit la place qu'ils occupent dans la hiérarchie.
Blavier publie un traité de télégraphie en
1857 (seconde édition très enrichie en 1867) qui sera
le traité de référence de l'Administration
pendant plusieurs décennies. On retrouve Blavier et Gounelle,
dès 1860, dans la commission d examination des chefs de station
(grade issu de l'ancienne administration) aspirant à devenir
inspecteur à l'issue d'un recyclage. Responsable des cours
supérieurs internes à l'administration organisés
à partir des années 1870, Blavier sera logiquement
nommé directeur de l'Ecole supérieure de télégraphie
à sa création en 1878.
7. On ne voit pas où l'administration des télégraphes
aurait pu puiser ailleurs les ingénieurs dont elle avait
besoin. Mis à part l'École polytechnique et ses écoles
d'application, civiles ou militaires, il n'existait dans les années
1840 que l'école Centrale des arts et manufactures, résolument
hostile à envoyer ses élèves dans les administrations
d'État voir Grêlon (1984), Shinn (1980).
8. BUTRICA, 1988.
9. Nous ne citons que les plus connus. Il faudrait y ajouter les
noms des élèves de l'École, après 1878,
comme Thévenin, Guillebot de Nerville qui sera directeur
du Laboratoire central d'électricité (LCE) dès
sa création, Cailho, Barbara...
10. Pour plus de détails sur ce groupe d'ingénieurs,
voir M. Atten, A. Butrica.
Cette entreprise pédagogique se prolonge
par la part active qu'il prend, avec Gounelle jusqu'en 1864, puis
avec Raynaud, Vaschy... à partir de 1874, à la publication
des Annales Télégraphiques. Cette revue organise,
dès 1858, une véritable politique de veille technique
et technologique pour utiliser un vocabulaire d'aujourd'hui. Suivi
et popularisation des théories de l'électricité
les plus modernes (avec traduction d'articles scientifiques de W.
Thomson, Faraday, Kirchhoff, Maxwell...), reproduction systématique
de notes (des Comptes rendus de l'Académie) ou articles traitant
de questions concernant l'électricité (des dynamos
aux courants forts...), suivi des revues étrangères
de télégraphie et d'électricité (britanniques
et américaines avant tout) (11), analyse du développement
de la télégraphie dans le monde, description des appareils
du monde entier, qu'ils soient issus des administrations ou de fabricants
privés... Cet organe est d'autant plus précieux qu'il
est le seul journal d'électricité en France, entre
1858 et 1876 (12). Revue de veille technique mais également
de recherche : les travaux des ingénieurs français
portent sur la théorie des transmissions, sur les unités
électriques, sur les diverses techniques de transmission
(duplex, multiplex), sur les technologies des fils (matériaux),
des parafoudres, des relais, des électroaimants, des piles,
des systèmes d'impression...
La participation de ces ingénieurs
à la commission chargée d'étudier les perfectionnements
ou inventions proposés par les membres de l'Administration,
par des électriciens ou par des ateliers de construction
d'appareils électriques, leur permet
de favoriser l'innovation.
Les décennies 1860-1880 de la télégraphie française
font apparaître un remarquable dynamisme avec la mise au point
des appareils de Meyer, de Hughes, de Baudot, de Lenoir... dont
certains, tels les Baudot connaîtront un succès international
indéniable.
Cette réussite tient aux liens privilégiés
que ces ingénieurs, qui sont des savants, des scientifiques,
entretiennent avec l'exploitation technique. L'expression de Gounelle
résume leur position : « On ne peut séparer
la théorie de la pratique ; sans la première, on marche
en aveugle, sans la seconde, on ne marche pas » (13). C'est
là que leur exigence pédagogique trouve sa raison
d'être : « développer l'instruction technique
au-delà du strict nécessaire, s'efforcer de former
des agents qui soient non seulement à hauteur de leur tâche
journalière, mais encore capables de contribuer au progrès
» (14). En prise directe avec la réalité quotidienne
de la pratique télégraphique, ils ont une claire conscience
des contraintes et contradictions propres à l'innovation.
« L'innovation, pour être vraiment utile, ne doit pas
être perpétuelle : en effet, elle ne se présente
pas, comme certains se l'imaginent, complète et parfaite
du premier jour ; elle a besoin d'essais, de tâtonnements,
d'améliorations graduelles, elle n'atteint que peu à
peu sa forme définitive, et c'est seulement alors qu'elle
devient profitable » (15). Evidemment, une telle conception
ne rencontre pas que des assentiments, y compris au sein même
de l'Administration des télégraphes comme le montre
l'éviction de Blavier par de Vougy, en 1865, peu après
la mort de Gounelle. « Dans la crainte sans doute que l'attrait
des questions théoriques ne détournât ses fonctionnaires
de leurs occupations administratives, M. de Vougy crut devoir prendre
en dehors du corps les conseillers scientifiques de son administration
» (16).
11. Cette attitude, évidente de nos jours,
ne sera pratiquée systématiquement par les physiciens
français qu'à partir de la création du Journal
de physique en 1872.
12. Excepté pour la période 1866-1873. L'Électricité,
premier journal spécifique à cette branche n'apparaît
qu'en 1876 et la Lumière Électrique en 1879.
13. Cité dans "notice de Blavier", p. 1
14. 14. idem, p. 106.
15. idem, p. 112.
16. BLAVIER, "Notice..." par Raynaud, p. 38.
Afin de montrer l'interaction entre formation professionnelle
de niveau élevé, action du groupe des Annales et innovation,
nous nous appuierons sur l'exemple de Baudot. Après une instruction
primaire et une adolescence consacrée aux travaux des champs,
Emile Baudot (1845-1903) entre comme surnuméraire de l'Administration
des télégraphes en 1870. Il mène dès
lors de pair ses travaux inventifs et son éducation technique.
Promu contrôleur en 1880, il est reçu, grâce
à la formation interne à l'Administration, à
l'examen d'inspecteur-ingénieur en 1882. Son brevet (juin
1874) repose sur le choix de l'alphabet de Gauss et Weber (1834)
permettant de transmettre sur un seul fil 31 signes distincts par
la combinaison de cinq éléments (17). La commission
chargée d'examiner le projet (composée de Blavier,
Raynaud, et des chefs de la Station centrale de Paris, du service
du contrôle et des ateliers) propose l'ouverture d'un crédit
de 2 000 francs pour la construction d'un prototype (18). Rappelons
que ce système va connaître un succès international
important : il est introduit en Italie (1887), en Hollande (1895),
en Suisse (1896), en Autriche et au Brésil (1897), en Angleterre
(1898), en Allemagne (1900)... Nous avons bien d'après cet
exemple le mélange d'ingrédients supposés ci-dessus
: les cours internes qui permettent la formation d'employés
brillants mais sans instruction supérieure de par leur origine
modeste, les contacts noués dans ce cadre entre Baudot et
ses professeurs, le soutien reçu de la commission des perfectionnements
au sein de laquelle ces mêmes ingénieurs jouent un
rôle décisif, les conseils amicaux et les encouragements
techniques qu'ils prodiguent au jeune inventeur,
tout cela favorise l'innovation.
Enfin, il est un aspect de l'activité
de ce groupe d'ingénieurs qu'il convient de souligner parce
qu'il jouera un rôle par la suite : les liens noués
avec les mondes industriel et universitaire. De part leur activité,
ces ingénieurs nouent de nombreux contacts avec les fabricants
de matériels télégraphiques et, d'une façon
plus générale, avec l'industrie électrique
naissante. Ces liens seront particulièrement visibles lors
de l'exposition internationale d'électricité de 1881,
ou avec l'élection de Blavier comme vice-président
de la Société internationale des électriciens.
Les liens avec la communauté scientifique
et, plus particulièrement, avec les physiciens sont tout
aussi ténus. Partie prenante de la création de la
Société française de physique en 1872, Blavier
en sera élu président en 1878. On voit ces ingénieurs
prêter leurs instruments aux laboratoires de la Sorbonne.
Blavier réalise, au début des années 1880,
un important travail sur les courants telluriques qui l'amène
à collaborer avec Mascart, professeur au Collège de
France. Enfin, les liens sont très étroits avec l'Ecole
polytechnique où Raynaud, Mercadier, Vaschy seront répétiteurs,
et plus particulièrement avec les professeurs de physique,
Potier et Cornu (ce dernier présente leurs notes à
l'Académie des sciences...).
En résumé, par leurs exigences théoriques,
l'accent mis sur la recherche et l'innovation, par la parfaite connaissance
de l'exploitation, leur insistance à développer la
culture technique du personnel, par leur action constante de veille
technique, c'est, en utilisant une expression anachronique, une
pratique de recherche et développement que porte ce groupe
d'ingénieurs. Il convient toutefois de préciser cette
appréciation : nous parlons de pratique parce qu'il ne s'agit
pas d'une « politique » identifiée comme telle,
construite sur l'appréciation consciente, raisonnée
du poids à attribuer aux divers paramètres.
Dans un tel contexte, la création de l'Ecole supérieure
de télégraphie en 1878 peut apparaître comme
un aboutissement logique. Nous allons voir qu'il n'en est rien.
L'existence et la logique de ce groupe vont se heurter à
d'autres déterminations, à commencer par les rapports
entre les administrations des postes et des télégraphes.
17. Mimault, employé des télégraphes
à Poitiers et concurrent malheureux de Baudot dans le long
conflit qui opposera ces deux hommes, avait proposé dans
son brevet déposé en janvier 1834 un système
utilisant le même code à 31 signes mais sur cinq fils.
Voir, entre autres articles, "Baudot et son œuvre"
(biblio).
18. C'est la même commission qui rejettera la proposition
de Mimault, ce qui conduira cet employé, se considérant
comme floué au terme d'une longue bataille juridique (12
ans), à assassiner, dans un moment de folie, J. Raynaud en
1888.
Le débat sur la fusion dans les années
1860
Une grande question agite ces deux administrations
tout au long du XIXe siècle : leur fusion.
La solution adoptée va sceller le sort des télécommunications
françaises pour un bon siècle. C'est dans les années
1820 que naît cette idée, mais elle ne prend corps
et ne devient un problème concret, débattu, qu'à
partir des années 1860.
En 1864, les Annales Télégraphiques
publient les rapports des deux directeurs généraux,
E. Vandal pour les postes et H. de Vougy pour les télégraphes.
Les grandes lignes de l'affrontement y sont tracées, les
principaux arguments avancés ; ils ne varieront guère
jusqu'à l'absorption finale des télégraphes
par les postes dans les années 1880.
Ces rapports, destinés aux ministres de tutelle (Finances
et Intérieur), sont provoqués par la demande de crédits
des télégraphes (quelque 12 millions de francs) en
vue d'étendre le réseau télégraphique
jusqu'au cœur de chaque canton, soit la création d'environ
4 000 petits bureaux télégraphiques
qui viendront s'ajouter aux 1 147 bureaux existants.
Les arguments de Vandal sont assez simples
:
— la séparation de ces deux administrations
à vocation similaire (transporter des messages) est contre-nature
(19),
— le réseau des bureaux de poste,
beaucoup plus étendu (4 558 bureaux fin 1864), laisse entrevoir
des économies qui paraissent évidentes, particulièrement
dans les cantons,
— la fusion est inscrite dans la marche
de l'histoire ; cela est confirmé par une évolution
analogue dans la plupart des pays européens, affirme Vandal,
— les postes et télégraphes
sont complémentaires : les postes ont les bras et les locaux
dont les télégraphes ont besoin ; ces derniers ont
un encadrement supérieur pléthorique dont les postes
feraient le meilleur usage (20).
Avant d'examiner les réponses du directeur
des télégraphes, nous ferons deux remarques.
Il y a un long développement du rapport de Vandal consacré
à l'opposition entre « les postes, instrument démocratique
et populaire » face « au télégraphe, instrument
des riches » qui nous paraît digne de la Troisième
République.
Voilà qui pourrait soutenir une des raisons avancées
pour expliquer le démantèlement de l'administration
des télégraphes (bonapartiste) si l'on pouvait croire
un seul instant à une administration des postes républicaine
en plein Second Empire (21). La seconde remarque a trait à
l'absence totale de préoccupation technique dans le texte
de Vandal. La seule allusion tient en trois lignes : « On
sait combien l'appareil télégraphique est facile à
manier et combien il se prête aux aptitudes des femmes »
(22) . L'accent mis sur les terminaux et leur maniement semble occulter
totalement le réseau qui les relie. Ce qui n'est pas étonnant
en regard de la logique purement administrative de Vandal.
19. Cet argument, qui va peser lourd, reste sans
réponse de la part de Vougy, ce qui est un peu surprenant.
Pourquoi, avec le même type de raisonnement, ne pas confier
les chemins de fer aux Ponts et Chaussées ? Ce qui, au XIXe
siècle, aurait provoqué un beau tollé.
20. "Au point de vue budgétaire, la fusion réaliserait
l'économie suivante : le personnel télégraphique
est monté avec un luxe réel, luxe qui a été
remarqué par le corps législatif. Vandal, op. cité
p. 615.
21. Cf. Bertho. Cet argument qui traduit probablement une certaine
réalité nous paraît un peu court ; surtout parce
qu'il présuppose l'homogénéité des administrations,
peu crédible pour les postes et fausse pour les télégraphes.
Le groupe des Annales, par exemple, inclut au moins un républicain
notoire et engagé, Mercadier.
22. VANDAL, 1864, p. 613.
La caractéristique la plus surprenante de
ce débat tient au fait que la réponse du directeur
des télégraphes, de Vougy, se situe dans la même
logique. Il justifie son opposition à la fusion par cinq
arguments essentiels :
— le réseau cantonal sera construit
par étapes, en collaboration financière avec les communes
intéressées (sur les 4 000 stations cantonales potentielles,
seules 344 sont légitimes à court terme, ce qui réduit
considérablement les investissements nécessaires immédiatement).
— l'affirmation de Vandal d'une fusion
réalisée dans les autres pays d'Europe est fausse,
assure de Vougy. Il fournit, en annexe à son rapport, une
analyse de la situation des administrations, pays par pays (Prusse,
Russie, Angleterre, Autriche, Italie, Belgique, Espagne, Suisse...).
Le seul exemple de fusion, celui de la Prusse, ne concerne précisément
que le réseau cantonal, affïrme-t-il.
— il se propose de conclure un accord
avec son homologue pour unifier les petits bureaux secondaires (confiés
pour certains, à titre d'expérience, au secrétaire
de mairie ou à l'instituteur).
— argument ultime : le télégraphe
est un outil d'ordre public qui ne saurait être confié
qu'au ministère de l'Intérieur (les postes sont rattachées
à cette époque aux Finances).
Le seul argument d'ordre technique évoqué
par de Vougy est symétrique à celui de Vandal : le
maniement des appareils télégraphiques est délicat
et demande une sérieuse instruction (par exemple, il faut
un an pour former un opérateur sur le Hughes (23).
Sur recommandation du rapporteur, «
une commission est instituée par les ministères des
Finances et de l'Intérieur en vue d'étudier les moyens
pratiques de la réforme ». Quelques bureaux municipaux
sont organisés en commun à titre d'expérimentation.
Le débat est donc gelé jusqu'à 1870.
23. Le télégraphe de Hughes, amélioré
par les français en accord avec l'inventeur, est complexe.
Il est évidemment exclu de l'installer dans les bureaux cantonaux
!
La fusion dans les années 1870-1880 : un changement
de tactique
La question va évidemment ressurgir (nous
avons comptabilise huit rebondissements en dix-huit ans), le plus
souvent à l'initiative de la direction de la Poste avec quelques
contre-offensives des ingénieurs. Il semble que la direction
du télégraphe, confiée entre 1871 et 1878 à
Pierret (24), un polytechnicien issu du sérail, soit particulièrement
effacée. Après la période des grands débats
des années 1860, la tactique des postiers change, conduisant
à une prise du pouvoir par petits pas. (25)
C'est la guerre franco-prussienne qui relance
les hostilités. Le télégraphe apparaît,
en ces temps troublés, comme un instrument décisif,
stratégique du point de vue militaire. De plus, les ingénieurs,
sous la direction de Blavier, font un travail remarquable permettant
d'établir des liaisons avec le front, rétablissant
dans des délais record le réseau français amputé
de l'Alsace et de la Lorraine. Il n'est pas très étonnant,
dans ces conditions, que les deux administrations soient regroupées
sous la direction des télégraphistes (unité
au seul niveau de la direction supérieure, les deux administrations
restant par ailleurs autonomes). Thiers rétablit la situation
antérieure dès 1871. La même année, une
des cinq commissions de l'Assemblée nationale « émet
l'avis, longuement motivé, que le maniement des appareils
télégraphiques pouvait être confié aux
agents des postes dans les petits bureaux, mais que les deux personnels
devaient rester entièrement distincts pour tous les postes
de quelque importance ».
Les deux administrations pourraient être placées sous
une autorité unique, le ministère des Travaux publics.
Fort du prestige acquis sur le front, les ingénieurs,
par la voix de leur plus illustre représentant, osent (26)
faire entendre leur conception.
En 1872, Blavier publie un opuscule de 120 pages sur cette question
dans lequel il propose une véritable « politique »
de rapprochement qui tienne compte de la dimension technique d'un
domaine fortement structuré par l'innovation (27).
Reprenant les arguments un à un en les triant, il présente
le contexte de fonctionnement d'un réseau, précise
les divers postes en service, en déduit les aptitudes à
demander au personnel pour arriver à la conclusion que seule
la fusion de petits bureaux communaux présente un intérêt.
Il combat l'idée émise de confier la construction
des lignes aux Ponts et Chaussées au nom de l'indispensable
unité entre utilisation et entretien des fils. Mais ses critiques
sont essentiellement concentrées sur le rôle de l'Administration
centrale que l'on veut « cantonner dans des travaux purement
administratifs ; il réclame un bureau de statistiques, un
bureau scientifique chargé de la direction des recherches
techniques et théoriques, un laboratoire, une bibliothèque,
des crédits pour encourager les travaux, un journal pour
les faire connaître » (28).
Il conclut en proposant comme solution institutionnelle
« la création d'un ministère spécial
des postes et des télégraphes dans lequel
les deux services conserveraient leur autonomie, sans être
subordonnés l'un à l'autre ». Et de repousser
radicalement le rattachement aux Finances pour sa propension à
la fiscalisation : « cette tendance, si naturelle, si justifiée
dans une administration financière, à s'attacher surtout
à ce qui rapporte et à redouter ce qui peut devenir
une occasion de dépenses, on pourrait craindre un peu de
parcimonie à l'égard des recherches, des essais et
des innovations ».
Malgré l'avis de la commission parlementaire
de 1871, l'intervention de Blavier, l'idée de la fusion fait
son chemin, notamment dans plusieurs pays européens. Une
loi est votée en 1873 qui confie la gestion des bureaux municipaux
aux postes. La crise économique de 1873, faisant suite à
celle de 1867, pèse lourd dans la décision de l'Assemblée
nationale de faire des économies (29).
Toutefois, les choses traînent en cette période incertaine
de la Troisième République. Les règlements
d'application sont promulgués en 1876 et les décrets
d'application en octobre 1877 et en février 1878. A la clé,
la création de l'Ecole supérieure de télégraphie.
Cochery, artisan de cette politique, obtient « son »
ministère en 1879.
Ce n'est pas le moindre paradoxe (30) de cette
histoire que de voir Cochery s'appuyer sur les ingénieurs
du télégraphe pour asseoir son ministère alors
même que la direction des postes, sous sa tutelle, continue
son grignotage. En effet, l'entente entre les ingénieurs
et Cochery semble bonne.
24. Jugé très timide par le Journal
télégraphique de Berne, cité dans "Blavier
: Notice..." et dans la nécrologie que les Annales lui
consacrent.
25. Peut-être le mot tactique est-il un peu fort ? Déterminer
dans quelle mesure la démarche de la direction des postes
est consciente reste à étudier.
26. Les relations entre le groupe des Annales et la direction de
l'Administration des télégraphes restent à
étudier ; mais, en aucune façon, les ingénieurs
ne sont habilités à parler au nom de l'Administration.
27. E. Blavier, Considérations sur le service télégraphique
et sur la fusion des Postes et des Télégraphes. Nancy
(1872). La forme employée par Blvier, un opuscule et non
pas un article dans les Annales, nous paraît un indice de
la position inconfortable des ingénieurs.
28. Cité dans Notice sur la carrière... Annales télégraphiques
(1888), p. 103. Rappelons qu'à cette époque les Annales
avaient été arrêtées à la suite
de l'hostilité affichée par de Vougy.
29. La commission parlementaire chargée d'évaluer
les économies supputées (par réduction du personnel
entre autre) en profite pour stigmatiser l'emploi de deux ingénieurs
électriciens qui "n'ont d'autre fonction que de réaliser
des expériences pour hâter le développement
de l'art télégraphique" (cité dans A.
Butrica). La nécessité d'une politique de recherche
de la part d'une Administration d'État semble loin.
30. Ce paradoxe tient peut-être au manque d'études
plus précises sur cette question.
La création de l'Ecole supérieure
de télégraphie et de son
laboratoire associé, avec des moyens adéquats, ravit
les ingénieurs et constitue un indéniable succès
pour l'obstiné Blavier. Cochery « avait entendu témoigner,
par le choix du chef, du prix qu'il attachait à l'institution
» assure le biographe de Blavier. Nous pourrions ajouter que
Cochery se fait ainsi des alliés décisifs qui vont
l'aider sérieusement à prendre la direction du grand
projet d'exposition universelle d'électricité de 1881
et du congrès scientifique qui l'accompagne, alors même
que l'initiative de l'exposition appartenait aux industriels (31)
. Une proposition pour organiser une telle exposition avait été
avancée dès 1879 par le comte d'Arroz (32). On retrouve
le soutien direct de Cochery à Blavier, en 1882, lors des
essais utilisant des fils souterrains du réseau qui conduisent
ce dernier à son importante et remarquée étude
des courants telluriques (33). L'état de nos recherches ne
nous permet pas de nous prononcer sur la cohérence de Cochery.
Mais il semble clair que son initiative de décharger les
ingénieurs de leurs tâches administratives se soit
transformée en instrument de pouvoir contre les ingénieurs.
Dans le même temps, le grignotage, l'absorption
des télégraphes par la direction des postes continue.
Le décret de 1883 est à cet égard décisif
; il établit la coupure entre services techniques et services
d'exploitation, décision qui, au delà des conséquences
évidentes et immédiates sur le rapport de force entre
ingénieurs et administrateurs, aura des effets à long
terme sur la recherche.
Les ingénieurs, dès lors cantonnés
dans les services centraux ou les services techniques des régions
(au nombre de seize), perdent, trois ans plus tard, ce qu'il leur
restait de pouvoir. En effet, la nouvelle réforme de 1886
leur retire la direction des services techniques des régions
qui est confiée aux directeurs départementaux des
postes (34). Ne restent aux mains des ingénieurs que l'Ecole
supérieure de télégraphie et la recherche,
qu'ils vont perdre deux ans plus tard (35). Afin de tenter d'avancer
des éléments d'explication à cette évolution,
il convient de revenir à l'Ecole supérieure de télégraphie.
31. On peut parler de "coup" politique
parfaitement réussi : en plus du succès de masse de
l'exposition tout à fait conséquent dont Cochery tire
une bonne part du bénéfice, ce dernier réussit
à se faire nommer président du congrès scientifique
!
32. F. Caron voit dans cette manifestation le point de départ
d'une concurrence accrue entre industriels de l'électricité.
Cela souligne qu'en aucune façon, l'organisation par l'État
de cette manifestation ne peut être comprise comme l'amorce
d'une politique technique de l'État.
33. "La contribution la plus importante depuis Gauss à
l'étude du magnétisme terrestre..." commente
W. Thomson.
34. On est loin désormais des arguments avancés par
Vandal pour justifier la fusion, notamment celui qui consistait
à souligner la complémentarité des des administrations,
la Poste fournissant les bras et le Télégraphe l'encadrement
supérieur dont il était pourvu avec luxe.
35. GUILLET, 1989. 36. VEDEL, 1984.
Les dix ans de l'Ecole supérieure de télégraphie
II semble que la création de cette
Ecole soit la contrepartie offerte aux ingénieurs à
la mainmise des cadres administratifs de la Poste sur l'ensemble
des P. et T (36). Mais c'est aussi le résultat d'années
d'efforts des ingénieurs. Rappelons qu'à la mort de
Gounelle en 1864, de Vougy supprime l'embryon de formation supérieure
mise sur pied par Gounelle et Blavier et confie la formation élémentaire
des surnuméraires (stagiaires) à Guillemin, professeur
de physique à l'école Saint-Cyr. Ce n'est qu'après
la chute du Second Empire et la guerre qu'une politique sérieuse
de formation du personnel est rétablie avec des cours pratiques
dispensés dans tous les grands centres et « un cours
supérieur destiné à former des électriciens
» (Raynaud, Mercadier... y enseignent). Ce cours supérieur,
de dimension modeste au départ (une douzaine d'agents pendant
trois mois chaque année), s'étoffe en 1877 (25 agents).
Mais les contraintes de service, une durée trop courte (3
mois) en limitent l'efficacité.
La création de l'Ecole supérieure de télégraphie
transforme cette situation. Outre la formation permanente du personnel
qu'elle continue à assurer, sa mission essentielle est la
mise sur pied d'une véritable formation d'ingénieurs
électriciens : un programme beaucoup plus vaste, incluant
des matières scientifiques (mathématique, physique,
chimie...) de haut niveau, une scolarité de deux ans, des
épreuves d'admission exigeantes... (37) Pratique nouvelle
pour ce secteur, le travail en laboratoire, particulièrement
pour les mesures électriques, est favorisé comme le
montre le cours autographié de Vaschy (1886) divisé
en deux parties : la première consacrée aux théories
de l'électromagnétisme, la seconde aux appareils et
dispositifs de mesures de grande précision (38). Afin de
ne pas exclure le personnel des télégraphes, des facilités
et des cours préparatoires sont institués.
Si cette création est un incontestable succès des
ingénieurs, elle reste ambiguë. C'est une école
d'ingénieurs qui très rapidement ne recrutera plus
que quelques candidats français tous les deux ans et des
élèves envoyés par des administrations étrangères.
La vision de Blavier : en faire une école d'ingénieurs
électriciens, va se heurter à la logique de la direction
de l'administration des P. et T. qui cantonne son école au
recrutement des ingénieurs dont elle a besoin, et à
l'hostilité des électriciens qui ne veulent pas d'une
école d'Etat. En l'absence d'école d'ingénieurs
dans ce domaine (39), dans le contexte d'une demande forte de ce
type de spécialiste de la part d'une industrie électrique
en plein décollage dans les années 1880, c'est probablement
une occasion manquée pour l'enseignement technique supérieur
français.
37. Le recrutement visé concerne les polytechniciens,
bien sûr, mais également les normaliens, les centraliens
et les licenciés de l'université.
38. L'inventaire de ce laboratoire reste à faire. Une chose
est certaine : dans un état des lieux établi en 1910
(Notices descriptives sur quelques installations récentes
du service des postes, télégraphes et téléphones,
Paris, Imprimerie nationale, 1910), les instruments de mesure du
laboratoire de l'École supérieure des FIT décrits
semblent, pour une bonne part, appartenir à l'héritage
des dernières décennies du XIXe siècle. Notons
également que le laboratoire de l'École supérieure
de télégraphie possédait un stand propre lors
de l'Exposition d'électricité de 1881. Voir, entre
autres, Guillet, 1988, p. 24.
39. GRELON, 1986. 40. ATTEN, 1988. 41. Les fameuses "bobines
de pupin" permettant de réduire l'affaiblissement et
la distorsion.
Malgré sa courte existence, l'action de l'Ecole
est loin d'être négligeable.
L'enseignement dispensé est parmi les plus avancés,
notamment pour les théories de l'électricité
(introduction de Maxwell en France. Elle favorise la recherche tant
théorique que pratique. Liée aux nécessités
de l'enseignement, une politique de traduction d'ouvrages britanniques
est entreprise par le groupe des annales. Vaschy, qui supplée
à Raynaud dans les années 1880, y développe
ses remarquables travaux sur la théorie des transmissions
débouchant sur une solution originale de résolution
de l'équation des télégraphistes, travaux que
Pupin revendiquera comme source première de ses innovations.
La prise en compte de l'irruption du téléphone, peu
avant la création de l'école, y est nette. De nombreux
essais de lignes, de matériaux (fils en cuivre, en bronze,
étude d'isolant : gutta- percha...), de liaisons associant
fils aériens, souterrains et sous-marins, entre la France
et la Grande-bretagne..., des parafoudres, l'étude des courants
de terre, etc, sont menés dans le laboratoire par les professeurs
et les élèves, les résultats publiés
par les Annales. Des voyages d'études aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne sont organisés. Bref, malgré des moyens
de plus en plus restreints, les dix années de l'Ecole se
soldent par une moisson de travaux dont les Annales témoignent.
Ce dernier bastion des ingénieurs finit par
tomber en 1888 avec la transformation de l'Ecole supérieure
de télégraphie en Ecole professionnelle des P. et
T. qui ne laissera qu'une place réduite aux ingénieurs.
La création de l'Ecole supérieure
de télégraphie et la part prise dans le succès
de l'exposition de 1881 marquent incontestablement l'apogée
du groupe des Annales ; elles en traduisent aussi les limites. Loin
d'être le point d'appui d'une politique de recherche plus
ambitieuse, l'Ecole supérieure de télégraphie
va devenir un point de focalisation des critiques, une position
de plus en plus circonscrite, coupée de la réalité
technique quotidienne et des lieux de décision. Le groupe
des Annales va consacrer ses forces à faire vivre l'Ecole,
à la défendre contre les attaques de plus en plus
virulentes, à faire face au défi technique et technologique
que représente l'irruption du téléphone...
Du rêve de Blavier, créer une école supérieure
d'ingénieurs électriciens, il ne reste bientôt
plus rien. La transformation de l'Ecole supérieure de télégraphie
en Ecole professionnelle consacre le retour à la situation
antérieure : une structure de formation interne à
l'administration.
Cochery, dont on a vu que la politique s'est
retournée contre le groupe, n'en était pas le moindre
supporter. Mais il meurt en 1885 et son ministère disparaît
peu après. Les P. et T. se retrouvent sous la tutelle des
Finances, solution que les ingénieurs ne semblent pas considérer
comme la plus favorable à leurs intérêts. Du
côté des physiciens et de l'enseignement supérieur,
des changements importants interviennent également entre
la fin des années 1870 et les années 1880. Renforcement
conséquent des universités (au détriment du
système des écoles d'ingénieurs ?) et surtout
fort développement d'une critique de l'Ecole polytechnique
et de son système élitiste. D'où l'affaiblissement
du plus solide allié du groupe des Annales. Enfin, la mort
de Blavier en décembre 1887 suivie de l'assassinat de Raynaud,
son successeur, quelques mois plus tard semblent être des
éléments contingents qui accentuent l'affaiblissement
de la résistance des ingénieurs.
La logique première de la fusion, forte de
certains arguments non dénués de fondements pour les
bureaux cantonaux, va se muer en technique d'absorption au profit
d'une vision très anti-technique. La logique de fusion des
deux administrations à tous les niveaux s'est donc réalisée
de façon administrative. En plus de cette logique qui occulte
la dimension technique des réseaux, d'autres éléments
sont à prendre en compte.
Le téléphone arrive en France au moment
même où la nouvelle direction des P. et T. est confrontée
à des problèmes d'envergure telles la création
de la Caisse nationale d'épargne et la mise sur pied du service
des colis postaux.
L'absence de politique de recherche, l'incompréhension
de la spécificité technique des services du télégraphe
et du téléphone, patentes dès le début
des années 1870, sont encore plus visibles au niveau des
choix opérés pour le développement du téléphone.
La politique des concessions à très court terme (5
ans) va se révéler catastrophique. Les recherches
historiques doivent être poursuivies sur cette question car
l'hostilité des ingénieurs à ce choix ne semble
pas faire de doute comme en témoigne
la courte nécrologie de Lartigue, président de la
Société générale
des téléphones, publiée par
les Annales en 1885 : « C'est lui qui a donné à
cette puissante et courageuse Compagnie les moyens pratiques de
vaincre toutes les difficultés inhérentes à
l'établissement d'un service public dont les habitants de
nos grandes villes n'ont pas apprécié immédiatement
tous les bienfaits et la commodité ; auquel les administrations
de l'Etat, dominées par les exigences fiscales de la loi
et des règlements, n'ont jamais pu prêter qu'un concours
d'apparence intéressée. » Mis à part
le thème classique utilisé par les techniciens pour
expliquer leurs déconvenues (« c'est la faute aux clients
qui ne comprennent pas l'intérêt de notre magnifique
invention »), nous y lisons le constat (fait par les ingénieurs)
du désintérêt de l'Administration pour le développement
du téléphone.
Il convient d'introduire une nuance. Si les travaux
sur le téléphone menés par les ingénieurs
français dès le début des années 1880
sont remarquables, il traduisent une approche du téléphone
analogue à celle du télégraphe : l'accent est
mis sur les questions théoriques des transmissions. En un
certain sens, on peut dire que ce sont des hommes du câble.
Or, le téléphone est bien différent du télégraphe
: par son terminal, d'abord, qui doit être installé
chez les abonnés, ce qui multiplie les contraintes, par son
réseau ensuite, qui posera très rapidement la question
de la commutation. Deux terrains sur lesquels les ingénieurs
français vont être absents. Le terrain sur lequel ils
sont présents et même à la pointe de la recherche,
l'amplification, ne débouchera sur des solutions concrètes
que dans les premières décennies du XXe siècle.
Absence également des ingénieurs de l'Administration
du domaine de la télégraphie sans fil dans les années
1890.
sommaire
Le télégraphe pneumatique
Entre 1851 et 1867, le nombre de stations
télégraphiques passe de 17 à 2 200 et entraine
une saturation des lignes de la capitale.
Les services télégraphiques doivent alors utiliser
des navettes à cheval partant toutes les 15 minutes entre
deux points névralgiques du système parisien. Les
résultats étant peu satisfaisants en raison de l’intense
circulation routière, il est décidé d’utiliser
le tube pneumatique pour relier les stations du télégraphe
à Paris.
En 1852, Ambroise Ador, l’un des inventeurs
du tube pneumatique procède à des essais au Parc Monceau
en transportant de petits colis par air comprimé.
En 1854, Antoine Galy-Cazalat reproduit l’expérience
et dépose un brevet pour le transport des dépêches
par pression de l’air. La première ligne, longue de
1 050 mètres est ouverte en décembre 1866, reliant
le Grand-Hôtel (12 boulevard des Capucines) au central télégraphique
de Paris-Bourse (rue Feydeau). Le tube d’acier de 65 mm de
diamètre permet de faciliter les communications de la riche
clientèle. Le message est rédigé sur un formulaire
et remis à un tubiste qui l’expédie par le tube
au central télégraphique. Là, un télégraphiste
le transmet en code vers n’importe quelle ville de France ou
vers une capitale étrangère. La réponse suit
le même chemin.
En 1867, un circuit unidirectionnel –
en forme d’hexagone - est constitué entre les centres
télégraphiques de la place de la Bourse et le 103
rue de Grenelle. (rue de Grenelle > rue Boissy d’Anglas
> Grand Hôtel > place de la Bourse > place du Théâtre-Français
> rue des Saints-Pères).
Toutes les 15 minutes un « train omnibus » effectue
le circuit complet en 12 minutes. C’est à partir de
ce circuit que se développe la poste pneumatique.
Dès 1872, la circulation devient bidirectionnelle.
Lors de la fusion des postes et des télégraphes en
1879, le service se développe et s’ouvre aux particuliers.
La poste pneumatique n’est plus, désormais, un vecteur
auxiliaire de la télégraphie.
sommaire
Autre inovation Le pantélégraphe
Le pantélégraphe est un télégraphe
autographique, l'ancêtre du fax.
Le pantélégraphe de Caselli permet
la transmission d'une reproduction fidèle d'un manuscrit,
d'un dessin, d'un plan ou d'un portrait. C'est le fruit des recherches
de Caselli sur la transmission télégraphique
des images.
1856 : premier prototype concluant
1857 : début de la collaboration entre Caselli et
Paul Gustave Froment, Création de la Société
du Pantélégraphe
1860, 10 mai : démonstration de l'appareil face à
Napoléon III dans les ateliers de Froment
1860, novembre : tests réussis sur la ligne télégraphique
Paris-Amiens
1861, septembre : démonstrations à l'occasion de l'exposition
de Florence, sur la demande du roi Victor-Emmanuel II
1863 : Autorisation accordée pour l'exploitation officielle
d'une première ligne entre Paris et Marseille
Autorisation d'une exploitation expérimentale de quatre mois
entre Londres et Liverpool
Démonstration face à deux hauts fonctionnaires de
l'Empire chinois, l'intérêt pour la transmission des
idéogrammes est élevé
1884 : Tractations entre la Chine et l'Italie dans le but de réaliser
une expérimentation du pantélégraphe à
Pékin. Elles restent sans suite.
Le pantélégraphe reçut un accueil
particulièrement euphorique. Toutefois, cette invention n'a
pas eu de résultat économique à la hauteur
de cet accueil. Ceci pour plusieurs raisons :
La Société du Pantélégraphe
n'entreprend pas de promotion énergique du produit
L'exploitation en Italie est abandonnée
L'administration des Télégraphes en France maintient
un tarif prohibitif sur les télégrammes autographes
Le pantélégraphe apparaît au moment de la mutation
du réseau télégraphique optique Chappe vers
un réseau télégraphique banalisé (Hugues,
Morse, Baudot). "On" cantonne le pantélégraphe
aux transmissions des signatures autographes, même s'il pouvait
transmettre n'importe quel texte.
sommaire
Les câbles télégraphiques
sous-marins avant le début du téléphone
1838 : premier essai de câbles sous-marins
isolés au caoutchouc.
1843 : découverte de la gutta18, isolant
naturel, à Singapour.
1845 : Werner von Siemens invente l’extrusion
et le collage de la gutta percha sur un fil de cuivre.
28 août 1850 : John Watkins Brett pose
le premier câble sous-marin entre les caps Gris-Nez (France)
et Southerland (Angleterre) qui ne fonctionne que 11 minutes ; il
s’agit plus d’un fil conducteur entouré de gutta
percha que d’un câble.
1851 : le premier câble sous-marin à
4 conducteurs renforcé à 8 tonnes est posé
entre les caps Gris-Nez (France) et Southerland (Angleterre) et
fonctionnera plus de 40 ans. Il est considéré comme
le premier câble commercial sous-marin télégraphique.
1er décembre 1852 : une liaison télégraphique
directe est établie entre Paris et Londres ; les messages
sont transis en moins d’une heure entre les bourses de Paris
et de Londres, au lieu de 3 jours auparavant.
10 juin 1853 : Napoléon III accorde
une concession aux frères Brett pour relier la Corse et l’Algérie
à la France
L’histoire des câbles télégraphiques
en Méditerranée est intimement liée aux projets
impériaux, ce moyen de communication servant les fins coloniales
en Méditerranée et permettant d’affirmer la toute
récente présence française en Algérie.
Alors que la diffusion de l’information s’accélère
sur terre, les espaces marins continuent de poser de sérieux
problèmes techniques. Suite au succès du câble
traversant la Manche, John Watkins Brett développe le projet
d’un câble Méditerranéen reliant La Spezia
(près de Gênes) à la Corse, puis à la
Sardaigne et enfin l’Afrique du Nord jusqu’à Bône
(Algérie française). Ce projet est à la croisée
de plusieurs volontés géopolitiques : le royaume de
Sardaigne afin d’unifier le territoire royal, la France pour
rattacher la Corse et l’Algérie au territoire métropolitain
et le Royaume-Uni où ce câble sera la première
étape d’une connexion télégraphique avec
l’Inde. C’est un échec, les eaux profondes de la
Méditerranée se révélant complexes pour
les poseurs tandis que le câble construit pour la portion
Sardaigne-Algérie est trop court. Ce problème est
récurrent pour la pose du câble Crète-Alexandrie.
Le projet de câble entre Toulon et Alger en 1860 doit être
modifié et devient un câble Alger-Minorque, se raccordant
ensuite au câble espagnol reliant les Baléares à
Barcelone, le but étant de réduire les portions submergées
des câbles en priorisant les îles.
Si la pose des câbles est perçue à
l’époque comme une grande réussite (surtout le
câble Atlantique de 1866) les câbles n’ont rien
de définitif et ne remplacent pas la circulation des nouvelles
par voie maritime.
Entre 1850 et 1860, la longueur totale des
câbles sous-marins s’élève à 20 826
km dont 5 173 km en Méditerranée et en Mer noire.
En 1860, il est décidé d’abandonner les câbles
posés par plus de 300 m de profondeur après leur
premier dérangement.
5 août 1858 : le premier câble
transatlantique est posé entre l’Irlande et Terre-Neuve,
prolongeant ceux existants entre le Canada et les Etats-Unis d’une
part et entre l’Irlande et la Grande-Bretagne d’autre
part. Dès 1840, Samuel Morse déclarait sa conviction
de la faisabilité d’une ligne télégraphique
sous-marine à travers l’Atlantique. Cyrus West Field
est à l’origine de la construction de ce câble
dont les études préalables débutent en 1854.
Il est composé de 7 fils de cuivre recouverts de 3 couches
de gutta percha et enroulé dans du chanvre goudronné
autour duquel une gaine de 18 brins composés chacun
de 7 fils métalliques est posée en spirale. Il ne
fonctionne que 3 semaines ; le premier télégramme
officiel transmis entre les deux continents émane de la reine
Victoria :« L’Europe et l’Amérique sont
unis par la télégraphie, Gloire à Dieu au plus
haut des cieux, paix et bonne volonté aux hommes sur Terre ».
Il est suivi d’un message de félicitation au président
des Etats-Unis James Buchanan, le 16 août 1858 qui répond
: « C’est un triomphe plus glorieux, parce que beaucoup
plus utile à l’humanité, que ceux gagnés
par des combattants sur le champ de bataille. Que le télégraphe
transatlantique, avec la bénédiction du ciel, se révèle
être un lien perpétuel de paix et d’amitié
entre les nations apparentées, et un instrument destiné
par la Divine Providence à répandre la religion, la
civilisation, la liberté et la loi dans le Monde ».
En septembre 1858, suite à la détérioration
progressive de l’isolant et à la corrosion du câble,
celui-ci tombe en panne. La tentative suivante n’est entreprise
qu’en 1865 avec d’autres matériaux.
31 juillet 1865 : le « SS Great
Eastern20 » après avoir posé près de
2 000 km de câbles rentre en Angleterre suite à
la rupture du câble.
13 juillet 1866 : la pose d’un nouveau
câble permet de retrouver le 9 août 1866 celui perdu
en 1865 et de le connecter au câble présent dans la
cale du navire ; les deux câbles télégraphiques
transatlantiques sont opérationnels.
En 1863, le « Dix-Décembre »
devient le premier navire câblier français ; il est
rebaptisé “Ampère” le 29 octobre 1870. Un
atelier de maintenance est créé à Toulon.
1864 : la pose d’un câble entre
Oran et Carthagène par le « Dix-Décembre »
échoue.
1866 : Le « Dix-Décembre »
installe un réseau de 194 km entre la Corse et l’Italie.
1869 : le premier câble sous-marin reliant
la France aux Etats-Unis entre Brest et Cape Cod près de
Boston (Etats-Unis) via Saint-Pierre-et-Miquelon, est commandé
par la Société du câble Transatlantique français
et posé par le « SS Great Eastern ».
5 février 1870 : la liaison Marseille-Bône-Malte
(828 km) est posée avec la technologie britannique. Les câbles
sont désormais sous monopole britannique.
Pour encore plus de détails, consultez la page des câbles
sous-marins de ce site.
DATES
CLES avant le téléphone
14 mars 1837 - Wheatstone & Cooke envoie
le premier message télégraphique britannique.
10 juin 1837 - Charles Wheatstone, de Hanover
Square, Middlesex, et William Fothergill Cooke, de Breeds Place,
Hastings, reçoivent un brevet anglais pour le « télégraphe
à cinq aiguilles » électrique ; nécessitait
six fils entre chacune de ses stations;
6 janvier 1838 - Samuel Morse et son associé,
Alfred Vail, ont fait la première démonstration publique
d'un système télégraphique électrique
à Vail's Speedwell Iron Works à Morristown, NJ (a
transmis une phrase de 2 miles) ; 24 janvier 1838 - deuxième
manifestation à l'Université de New York ;
21 février 1838 - Morse fait une démonstration
du télégraphe au président Van Buren, cabinet
à Washington ;
21 janvier 1840 - Charles Wheatstone et WF
Cooke reçoivent le premier brevet télégraphique
alphabétique anglais ; Le télégraphe ABC était
populaire en Angleterre et en Europe et ne nécessitait pas
de télégraphiste qualifié pour lire et envoyer
les messages ; première application pratique de la communication
numérique codée en série.
10 juin 1840 - Wheatstone a reçu un brevet américain
pour une "amélioration du télégraphe électromagnétique"
("améliorations nouvelles et utiles pour donner des
signaux et déclencher des alarmes dans des endroits éloignés
au moyen de courants électriques transmis à travers
des circuits métalliques"); 10 jours avant Morse a reçu
le brevet, mais Morse a eu la priorité en tant que premier
inventeur ; le brevet Morse décrivait le prototype du célèbre
code point-dash ; au Royaume-Uni, leur télégraphe
n'avait aucun moyen d'enregistrer des messages (Morse le considérait
comme un grand inconvénient).
20 juin 1840 - Samuel FB Morse, de New York,
NY, reçoit un brevet pour les « signes télégraphiques
» (« Amélioration du mode de communication d'informations
par signaux par application de l'électromagnétisme
») ; "Télégraphe électromagnétique
américain".
3 mars 1843 – Le Congrès adopte
un projet de loi prévoyant une dépense de 30 000 $
pour une ligne télégraphique entre Washington, DC
et Baltimore ; - Première ligne télégraphique
publique, de Paddington à Slough.
24 mai 1844 - La première ligne téléphonique
américaine est terminée,
L'inventeur américain Samuel FB Morse
inaugure la première ligne télégraphique commerciale
au monde lors d'une démonstration en présence de membres
du Congrès ; message télégraphique envoyé
(« Qu'est-ce que Dieu a fait ? » tiré de la Bible,
- suggéré à Morse par Annie Ellworth, fille
du commissaire aux brevets) du Capitole des États-Unis à
Alfred Vail à la gare de Baltimore, MD ; message télégraphié
au Capitole un instant plus tard par Vail.
6 novembre 1845 - Première ligne télégraphique
(commerciale) payante (deuxième ligne aux États-Unis)
ouverte le long de l'emprise ferroviaire entre Lancaster, Pennsylvanie
et Harrisburg, Pennsylvanie ; 8 janvier 1946 - premier message
reçu.
18 avril 1846 - Royal E. House, de New York,
reçoit un brevet pour un « télégraphe
à impression » ; un téléscripteur qui
imprimerait les lettres de l'alphabet ; capable d'imprimer à
une cadence de 50 mots par minute en lettres romaines.
5 juin 1846 - Ouverture d'une ligne télégraphique
entre Philadelphie et Baltimore.
27 juin 1847 – New York et Boston reliées
par des fils télégraphiques.
10 juin 1848 – Première liaison
télégraphique établie entre New York et Chicago.
13 juin 1848 - réédition du brevet pour «
Amélioration des télégraphes électromagnétiques
» ; Morse.
1849 - Antonio Meucci découvre le
principe du téléphone (découvre la transmission
de la voix humaine par électricité en appliquant l'électrothérapie
à un patient souffrant de rhumatismes à la tête)
;
1859 - Meucci dépose un cavea de modèle de
téléphone fonctionnel (de nombreuses années
avant le brevet d'Alexander Graham Bell en 1876). Cependant, les
aléas de l'histoire et du bureau des brevets ont déterminé
qu'Antonio Meucci ne sera reconnu qu'en Italie comme le véritable
inventeur du téléphone ;
1er mai 1849 - Samuel FB Morse reçoit
un brevet pour un « télégraphe » («
amélioration des télégraphes électriques
») ; registre télégraphique; incorporé
les fonctionnalités de base du récepteur 1844 et la
méthode de marquage de points et de tirets sur papier.
Avril 1851 - Un groupe d'hommes d'affaires
de Rochester, dans l'État de New York, forme la New York
and Mississippi Valley Printing Telegraph Company ;
13 novembre 1851 – Début du service
télégraphique entre Londres et Paris.
1856 - Hiram Sibley et Don Alonzo Watson acquièrent
une série de systèmes télégraphiques
concurrents (le plus grand actionnaire d'Ezra Cornell) ; a changé
son nom pour The Western Union Telegraph Company (signifie l'union
des lignes télégraphiques « occidentales »
avec les lignes orientales ») ;
20 mai 1856 – David Edward Hughes. de
Louisville, KY, a reçu un brevet pour un « télégraphe
» ; premier téléscripteur qui a imprimé
avec succès des caractères ; 1857 - vend les droits
pour 100 000 $ à la Commercial Co.
19 mai 1857 - William F. Channing, de Boston,
MA, Moses G. Farmer, de Salem, , ont reçu un brevet pour
un « télégraphe d'alarme incendie électromagnétique
pour les villes » (« pour donner une alarme instantanée
et définitive, soit générale ou local, dans
une ville ou un village, en cas d'incendie");
4 août 1858 - Cyrus W. Field a achevé
le câble de l'Atlantique, établi la communication télégraphique
entre les États-Unis et l'Angleterre (avait conçu
l'idée du câble télégraphique en 1854,
obtenu une charte pour poser une ligne bien isolée à
travers le fond de l'océan Atlantique ; obtenu l'aide des
Britanniques et des Américains. des navires de guerre ; firent
quatre tentatives infructueuses en 1857 ; quatre navires britanniques
et américains [Agamemnon, Valorous, Niagara, Gorgon] se rencontrèrent
au milieu de l'océan pour une cinquième tentative
en juillet 1858, avec leur chargement de câbles, partis pour
la baie de la Trinité ; , Terre-Neuve, Agamemnon et Valorous
s'embarquèrent pour Valentia, Irlande le 29 juillet 1858);
5 août 1858 - le navire Niagara, ancré sur
la côte de Terre-Neuve, pose 1 016 milles de câble ;
quelques jours plus tard, l'autre extrémité du câble
a atterri avec succès en Irlande ; s'étendait sur
près de 2 000 milles à travers l'Atlantique à
une profondeur souvent supérieure à deux milles ;
16 août 1858 - Le président James Buchanan
a échangé des messages d'introduction et de compliments
officiels avec la reine Victoria ; Il a fallu près de 18
heures pour atteindre Terre-Neuve (99 mots, 509 lettres, en moyenne
environ 2 minutes par lettre ; message transmis à travers
Terre-Neuve par fil aérien soutenu par des poteaux ; à
travers le détroit de Cabot par câble sous-marin jusqu'à
Aspy Bay, Cap-Breton ; par fil aérien à travers l'est
Canada et Maine, via Boston jusqu'à New York) ;
Septembre 1858 - le câble s'est avéré
faible, le courant insuffisant et a cessé de fonctionner
;
1866 - Câble amélioré posé avec
succès.
8 octobre 1860 – Ouverture de la ligne
télégraphique entre Los Angeles et San Francisco.
1861 – achèvement de la première
ligne télégraphique transcontinentale, assurant des
communications rapides d'un océan à l'autre pendant
la guerre civile américaine ;
24 octobre 1861 - La Western Union
Telegraph Company reliait les réseaux télégraphiques
de l'est et de l'ouest du pays à Salt Lake City, UT ; la
ligne transcontinentale achevée, a permis une communication
instantanée entre Washington, DC et San Francisco (huit ans
avant que le chemin de fer transcontinental ne soit achevé)
; Stephen J. Field, juge en chef de Californie, a envoyé
le premier télégramme transcontinental au président
Abraham Lincoln, prédisant que la nouvelle liaison de communication
contribuerait à garantir la loyauté des États
occidentaux envers l'Union pendant la guerre civile.
24 mai 1862 - Télégraphe de campagne utilisé
pour la première fois dans la guerre américaine ;
quartier général du général de l'armée
près de Williamsport, en Virginie. connecté par fil
à l'avant-garde à plusieurs kilomètres de là
à Mechanicsville, en Virginie.
1866 – introduction du premier stock ticker, a fourni
aux sociétés de courtage les cotations de la Bourse
de New York ;
27 juillet 1866 - Après
deux échecs, Cyrus W. Field réussit à poser
le premier câble télégraphique sous-marin entre
l'Amérique du Nord et l'Europe.
1869 - Elisha Gray, client, rachète la participation
de George Shawk, copropriétaire de l'atelier de fabrication
de Cleveland associé aux sociétés télégraphiques
Western Union ; formé Gray and Barton, en partenariat avec
Enos N. Barton, ancien opérateur télégraphique
en chef pour Western Union à Rochester, New York ; Anson
Stager, surintendant général de Western Union, a rejoint
le partenariat ;
1870 - lancement du service de gestion du temps, a contribué
à standardiser l'heure à l'échelle nationale
(a été distingué en tant que « le gardien
du temps de la nation » pendant près d'un siècle
);
7 juin 1870 - Frank L. Pope, d'Elizabeth, NJ, et Thomas A.
Edison reçoivent un brevet pour une "amélioration
des instruments d'imprimerie et de télégraphie"
("les communications peuvent non seulement être enregistrées
automatiquement en caractères imprimés, à un
ou plusieurs points éloignés, au gré de l'opérateur
émetteur, mais grâce auxquels ce résultat peut
être obtenu avec une plus grande certitude et d'une manière
beaucoup plus simple").
28 décembre 1871 - Meucci dépose
sa première opposition au brevet (avis d'intention de déposer
un brevet), sur le "Talking Telegraph", renouvelé
en 1872 et 1873 mais, malheureusement, pas par la suite ; déclenchant
une série d’événements mystérieux
et d’injustices qui seraient incroyables s’ils n’étaient
pas aussi bien documentés.
1871 - Introduction du service de transfert d'argent de Western
Union, qui est devenu le principal service de l'entreprise ; entreprise
;
1872 - Réorganisée sous le
nom de Western Electric Manufacturing Company après que Stager
ait convaincu le président de Western Union, William Orton,
d'investir dans une entreprise manufacturière ; est devenu
le principal fournisseur de Western Union ;
30 juillet 1872 - Mahlon Loomis reçoit un brevet pour
une « amélioration du télégraphe »
(« mode nouveau et amélioré de télégraphie
et de génération de lumière, de chaleur et
de force motrice ») ; radio sans-fil.
22 octobre 1872 - Thomas
A. Edison a reçu des brevets pour une amélioration
du "Papier pour télégraphes chimiques" (utilisant
une pâte très fine de farine et d'eau qui, avec une
solution d'iodure de potassium, pénétrerait dans le
tissu en papier) et pour un "Appareil" amélioré.
for Perforating Paper for Telegraph Use" (une machine compacte
pour perforer du ruban perforé utilisé pour transmettre
des messages télégraphiques - un seul trou pour un
point ou trois trous pour un tiret).
1er juillet 1873 - Thomas Edison reçoit un brevet
pour une « amélioration des circuits pour télégraphes
chimiques » ; concernait une méthode pour réduire
le problème des marques qui se rejoignent sur du papier chimique
dues à l'action électrique d'une pulsation d'un fil
télégraphique qui ne s'efface pas avant la suivante
; 3 mai 1892 – Thomas Edison reçoit un brevet pour un
télégraphe parlant.
4 février 1873 - Thomas A. Edison obtient son brevet
pour une « amélioration des circuits pour télégraphes
chimiques » ; méthode pour aiguiser les impulsions,
réduire le problème des marques qui se rejoignent
sur le papier chimique dues à l'action électrique
d'une pulsation d'un fil télégraphique qui ne s'efface
pas avant la suivante.
26 mai 1874 - Thomas A. Edison reçoit
un brevet pour la « télégraphie automatique
et ses perforateurs » ; produit le message directement sur
une bande de papier de telle sorte qu'il soit prêt à
être plié, envoyé immédiatement à
sa destination ; lettres formées par un carré de 5x5
de 25 fils perforés.
1875 - Gardiner G. Hubbard, de Cambridge, MA, et Thomas Sanders,
de Haverhill, MA, acceptent de financer les travaux d'Alexander
Graham Bell qui essayait d'inventer un télégraphe
parlant - un téléphone ;
6 avril 1875 - Alexander Graham Bell, de Salem, a reçu
un brevet pour une « amélioration des émetteurs
et récepteurs pour télégraphes électriques
» ; attribué à Hubbard et Sanders;
1875 - Gray vend sa participation et prend sa retraite ;
7 mars 1876 - Bell a reçu un brevet pour «
l'amélioration de la télégraphie » ;
9 juillet 1877 - Bell, Greene, Hubbard et Thomas Watson
fondent Bell Telephone Company pour exploiter l'invention ;
18 février 1876 – Liaison télégraphique
directe établie entre la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande.
14 février 1876 – Bell et son inventeur rival
Elisha Gray déposent une demande de brevet pour le téléphone
à quelques heures d'intervalle ;
3 mars 1976, Alexander Graham Bell, de Salem,
reçoit le brevet n° 174 465 pour le téléphone.
Avril 1876 - Lars Magnus Ericsson ouvre un
atelier électromécanique dans une cuisine louée
à Stockholm pour réparer les instruments télégraphiques
et autres appareils électriques ; le fonds de roulement était
de 1 000 couronnes, empruntées à Mme Maria Stromberg
de Nygard ; société nommée LM Ericsson &
Co. ; Novembre 1878 - livraison des premiers téléphones
de la fabrication Ericsson.
30 mai 1876 - Thomas a. Edison a reçu
trois brevets pour une « amélioration des télégraphes
duplex » ; le signal transmis activé soit envoyé
sur le même fil que le signal reçu.
27 juillet 1876 - Après deux échecs,
Cyrus W. Field réussit à poser le premier câble
télégraphique sous-marin entre l'Amérique du
Nord et l'Europe.
9 octobre 1876 - La première conversation
téléphonique bidirectionnelle a eu lieu sur des fils
extérieurs entre Alexander Graham Bell et Watson sur une
ligne télégraphique reliant Boston et East Cambridge.
sommaire
|

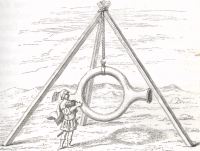
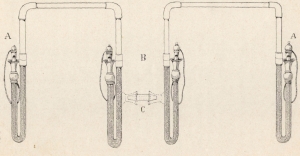


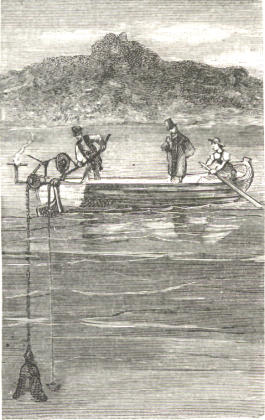
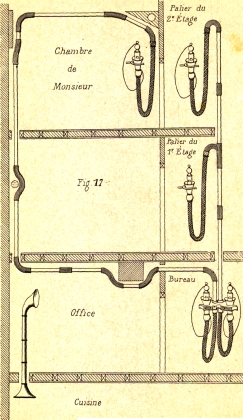


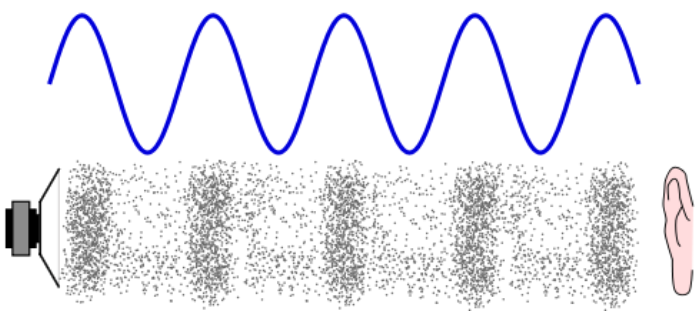
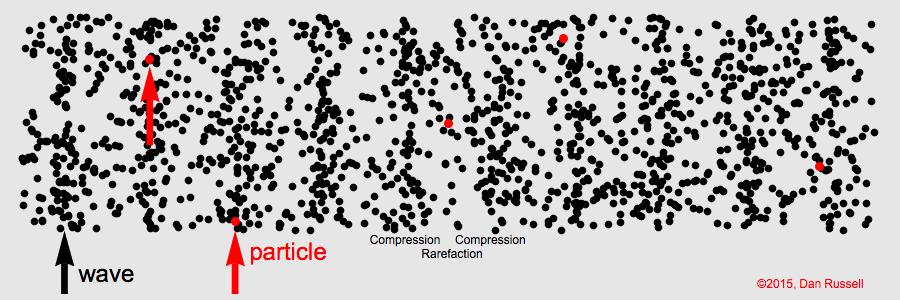
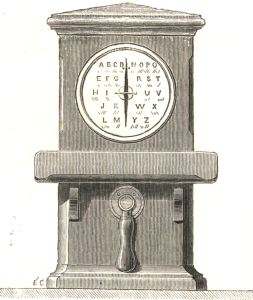
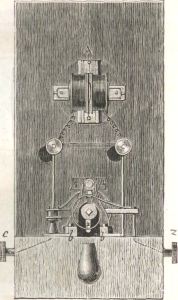
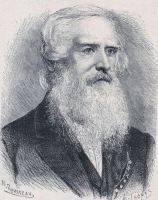 Morse
Morse