LA DISTRIBUTION DE L'HEURE
La notion de l’heure, c’est-à-dire
de la subdivision du temps, est aussi ancienne que l’homme : elle
a dû s’imposer à son esprit dès qu’il s’est
aperçu que les choses ont une « durée » et que
la nuit succède au jour. Aussi, est-ce aux astres, régulateurs
de la succession des jours, desmois et des années, c’est-à-dire
au soleil et à la lune tout d’abord, qu'il s’est adressé
pour mesurer le temps. Les cadrans solaires, les clepsydres ou «
horloges d’eau » furent ses premiers chronomètres.
Le problème de l’heure est capital pour les conditions mêmes
de la vie courante : il est essentiel de savoir subdiviser le temps que
l’on doit consacrer à son travail, à ses plaisirs,
à son sommeil. Aussi le problème, dès que la construction
mécanique se fut perfectionnée suffisamment, se posa-t-il
sous ses deux faces bien distinctes : la détermination de l’heure
et la conservation de l’heure.
En Angleterre, en 1833, c’est une time-ball ou boule de grand diamètre qui, en tombant à midi d’un point très haut, signale l’heure dans les environs de l’Observatoire de Greenwich. Des systèmes similaires sont installés dans de nombreuses villes.
Déjà en 1840, en Angleterre,
on expérimente déjà le premier réseau de distribution
de l’heure par télégraphe.
Dès 1852, Bruxelles, comme le rappelle Le Génie
civil, s’est dotée d’un réseau électrique
de 220 horloges, dont 170 sur la voie publique, réglées
et mises à l’heure simultanément.
Une des missions de l’Observatoire de Paris, fondé en 1666,
est de donner l’heure exacte.
Dès 1867 à Paris, le directeur de l’Observatoire,
Urbain Le Verrier propose la synchronisation de différentes horloges
parisiennes, plan qui se concrétise finalement en 1880 ... Dès
1877, une horloge est visible à la porte de l’établissement.
A New York, dans les années 1870 une boule chute de 8 mètres
tous les matins à 9h depuis la tour de l’Hôtel des télégraphes.
L’indication de l’heure exacte est fournie par liaison télégraphique
avec l’Observatoire de Washington. Un mouchoir agité permet
d'attirer l'attention sur la chute imminente afin que tous soient prêts
à régler leur montre. La classe est même interrompue
dans les écoles de New-York et aux alentours pour que les élèves
puissent assister à la chute de la time ball.
Déjà en 1876, l’horloger Lesieur s’occupe
déjà de synchroniser des horloges de la Bourse et du ministère
de l’Intérieur avec le poste central des lignes télégraphiques.
Depuis 1879, existe pour Paris et dans les plus grandes villes
d’Europe munies d’un observatoire un service de distribution
de l’heure par transmission électrique . Les principales horloges
sont reliées électriquement au régulateur des observatoires.
De nombreux brevets sur la synchronisation
sont déposés à cette époque. La paternité
du procédé de synchronisation électrique finalement
mobilisé pour le service horaire de Paris est revendiquée
par l’horloger Vérité, alors qu’elle est attribuée
à MM. Foucault et Froment par un numéro de la Revue chronométrique.
La question ne relève pas simplement d’enjeux de réputation,
elle soulève des problèmes juridiques et économiques.
Un autre horloger, Armand-François Collin, menace ainsi d’entamer
des poursuites judiciaires à l’encontre de tout confrère
qui appliquerait un procédé de son invention dans le service
de la ville. La Direction des travaux et le Conseil municipal choisissent
d’empêcher ces prétentions monopolistiques en favorisant
les expériences d’autres horlogers, comme Henry Lepaute. La
concurrence ainsi favorisée empêche une dépendance
manifeste à l’égard d’un seul horloger.
La question des brevets se trouve également au centre de la constitution
de la Compagnie générale des horloges pneumatiques. Le procédé
pneumatique qu’elle mobilise fonctionne à grande échelle
à Vienne depuis 1877. Dès l’année suivante,
la société propriétaire de la concession d’exploitation
du brevet en France engage les procédures pour appliquer le même
procédé à Paris. Elle entame alors une importante
campagne de publicité. Selon elle, le système « résout
le problème de l’heure unitaire, vainement demandé
à d’autres moyens ; il a la faculté de donner la même
heure, à la minute, sur tous les points de la ville, gare, usine,
administration, école, appartement, etc.. Elle affirme donner l’«
heure exacte de l’Observatoire et vante les mérites de son
système pneumatique, notamment dans un livret richement illustré
qui met en scène ses installations et explique leur fonctionnement.
La commercialisation de la synchronisation pneumatique s’appuie sur
une stratégie éditoriale visant le grand public, mais aussi
la Direction des travaux. La Compagnie publie ainsi une liste de ses abonnées
de manière à démontrer le succès de son système
pneumatique et, par là, le sérieux et la solidité
de l’entreprise.
LA NOTION DE L’HEURE.
La notion de l’heure, c’est-à-dire de la subdivision
du temps, est aussi ancienne que l’homme : elle a dû s’imposer
à son esprit dès qu’il s’est aperçu que
les choses ont une « durée » et que la nuit succède
au jour. Aussi, est-ce aux astres, régulateurs de la succession
des jours, desmois et des années, c’est-à-dire au soleil
et à la lune tout d’abord, qu'il s’est adressé
pour mesurer le temps. Les cadrans solaires, les clepsydres ou «
horloges d’eau » furent ses premiers chronomètres.
Le problème de l’heure est capital pour les conditions mêmes
de la vie courante : il est essentiel de savoir subdiviser le temps que
l’on doit consacrer à son travail, à ses plaisirs,
à son sommeil. Aussi le problème, dès que la construction
mécanique se fut perfectionnée suffisamment, se posa-t-il
sous ses deux faces bien distinctes : la détermination de l’heure
et la conservation de l’heure.
La détermination de l’heure se fait dans les observatoires
astronomiques. Grâce à la précision toujours croissante
avec laquelle sont construits les instruments, on peut garantir l’heure
exacte à un dixième de seconde près, et l’on
peut espérer l’obtenir avec la précision d’un
centième de seconde.
Quant à la conservation de l’heure, c’est un problème
tout à fait différent de celui de sa détermination
: il se résout par les horloges.
Toutefois, ces horloges en réception ont un inconvénient,
elles sont essentiellement fixes et ne sont pas portatives. Aussi leur
emploi était-il impossible a bord d’un navire, et les horlogers
cherchèrent-ils de tous côtés à réaliser
des « horloges portatives » dans lesquelles le Poids moteur
se trouvait remplacé par un ressort. Ce n’est qu’au commencement
du XVIIe siècle que la construction de ces « montres »
devint assez précise pour qu’on pût les employer à
des usages astronomiques. A partir du XVIIIe siècle, grâce
à l'émulation suscitée entre les horlogers par le
concours qu’avait institué l’Académie des sciences
de Paris, on voit apparaître de véritables «chronomètres»,
qui illustrèrent les noms de leurs constructeurs, Leroy et Berthoud
; au XIXe, auXX6 siècle, ces chronomètres, jusque-là
très coûteux, devinrent d’un prix plus abordable, et
l’on Peut avoir aujourd’hui, pour 300 francs, une « montre
de torpilleur » assez portative pour être mise dans le gousset,
et assez précise pour être un excellent « garde-temps
».
C’est en « transportant l’heure » par des chronomètres
que les marins, jusqu’à ces derniers temps, pouvaient déterminer
la longitude en mer, que les compagnies de chemins de fer réglaient,
au début de leurs exploitations, les horloges de leurs gares, qui
doivent toutes indiquer la même heure et la même minute pour
assurer la précision du service des trains.
L’HEURE UNIVERSELLE.
La forme même de la terre, qui est, à très peu
de chose près, une sphère, le mouvement de rotation dont
elle est animée autour de son axe, font que chaque point de la
terre défile à son tour devant le soleil. Au moment où
il passe devant l’astre, il est midi vrai, et il en résulte
forcément qu’il ne peut être midi que pour un seul point
de la terre à la fois. Chaque point du globe a donc son heure locale
; quoi que l’on puisse faire ou penser, quand il est midi à
Paris, il y a cinquante-cinq minutes que la ville de Vienne, en Autriche,
a passé devant le soleil au cours du mouvement diurne de la terre,
et il ne peut être à la fois midi dans ces deux stations.
Tant que les communications entre les peuples furent peu rapides, tant
que les voyages sur terre se faisaient par des véhicules marchant
lentement, ayant leurs itinéraires indépendants les uns
des autres et assez clairsemés sur les routes, on se contenta de
l’heure locale de chaque endroit. Mais, quand l’invention et
la généralisation des chemins de fer vinrent poser le problème
de la circulation rapide des trains sur une voie unique, il fallut songer
à unifier l’heure des diverses stations. Ce fut l’époque
où l’on avait, dans chaque ville de France, deux « heures
» différentes : 1’ « heure de la ville »
et 1’ « heure de la gare », qui était celle de
Paris, transmise télégraphiquement. L’heure de la ville
avançait sur l’heure de la gare pour les stations situées
à l’Est de Paris; elle retardait, en sens contraire, pour
les stations situées à l’Ouest. La différence
des heures n’était pas d’ailleurs sans atteindre une
valeur relativement importante pour les points extrêmes du territoire
: elle atteignait vingt-sept minutes à Brest et vingt minutes,
en sens contraire, à Nice.
Les inconvénients de cette double numération furent si manifestes
que, dès 1891, une loi rendit réglementaire pour toute la
France l’heure de Paris. Les divers États du monde avaient
d’ailleurs pris des mesures analogues, chacun pour l’étendue
de son territoire. Cela allait très bien tant qu’on ne sortait
pas d’un État déterminé, mais l’inconvénient
devenait grave quand il fallait passer d’un État dans un autre,
et, pour en citer un cas typique et demeuré classique, sur le bord
du lac de Constance, dont les rives baignent cinq États différents
: la Suisse, le Duché de Bade, la Bavière, la Wurtemberg
et l’Autriche, on ne comptait pas moins de cinq heures différentes
! De là une confusion, tout au moins une complication extrême
dans les horaires des bateaux et des chemins de fer.
Ainsi l’heure nationale, suffisante pour un même pays de peu
d’étendue, devient insuffisante quand il s’agit de plusieur
États ; elle le devient même pour un seul pays, si l’étendue
de celui-ci de l’Est à l’Ouest est considérable....
Voila posé tous les problèmes
à résoudre avant de distribuer l'heure dans le monde entier.
Après le réseau de distribution électrique de
l'heure, d'autres moyens ont été utilisés :
I - Distribution de l'heure par air comprimé
II - Distribution de l'heure par télégraphe
III - Distribution
de l'heure par téléphone
IV - Distribution de l'heure par Télégraphie
sans fil
I - Distribution
de l'heure par l'air comprimé
- Dans l'ouvrage "L'unification de l'heure à Paris et
dans toute la France" Collin, s'exprimait ainsi :
L’unification de l’heure est à l’ordre du jour !
C’est une grande question qui m’est devenue familière,
grâce à des recherches que je poursuis sans relâche
depuis plus de quinze ans.
En 1865 Collin dépose un brevet de système pneumatique.
Victor Popp est à l’origine du réseau pneumatique
fournissant une énergie régulière pour les horloges.
La Compagnie générale des horloges pneumatiques, originaire
de Vienne, s’implante à Paris à la fin des années
1870. Cette compagnie avait déjà mis en place 4500 mètres
de canalisations à Vienne. Elle fonda en 1879 la Société
des horloges pneumatiques, renommée Compagnie parisienne de l'air
comprimé en 1927 puis Société urbaine de distribution
d’air comprimé (SUDAC).
(Un magnifique document de la Sudac
est disponible ici en pdf) 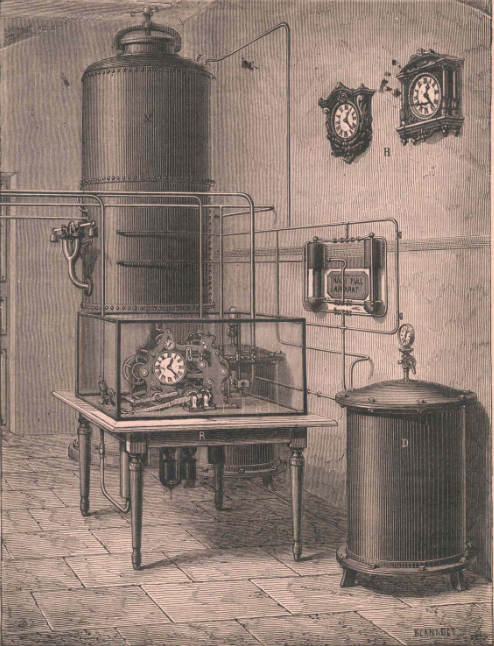
Elle obtient en 1881 une concession de 50 ans avec la ville de Paris pour
"établir ou conserver sous la voies publiques des tuyaux pour
la conduite d’air comprimé". L’usine de l'entreprise,
située Saint Fargeau à Paris, dispose d’une horloge
mécanique sur laquelle sont effectués les réglages,
comme l’explique Henri de Graffigny dans le Manuel de l'horloger
et du mécanicien amateur.
Le cadran de cette horloge actionne une tige qui conduit à l’envoi
d’air comprimé par pulsations dans les conduites.
Le réseau pneumatique se développe en empruntant les conduites
des égouts.
La société indique en 1888 qu'elle dispose, pour les horloges
pneumatiques, de 65 kilomètres de canalisations et fournit de l'air
comprimé pour 7800 pendules et 95 cadrans de la ville.
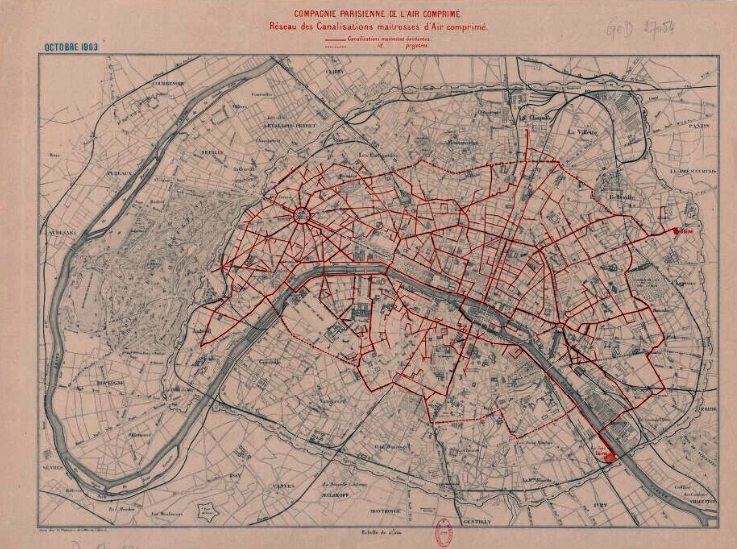
Cependant, l’utilisation du réseau décline progressivement
au début du XXe siècle.
La Centrale de l’heure pneumatique fut
installée vers 1880, dans un immeuble de la rue Sainte-Anne, et
les passants peuvent voir au rez de chaussée de cet immeuble, les
deux horloges distributrices du temps, qui fonctionnent à tour
de rôle. Au sous-sol, de gros réservoirs reçoivent
l’air comprimé à cinq kilogrammes, de l’usine
de Bercy ; cet air est détendu dans d’autres réservoirs
pour ramener la pression de travail à 750 grammes, pression largement
suf(îsante au fonctionnement des appareils. Deux détendeurs
interviennent : l’un, branché sur la canalisation à
cinq kilogrammes, ne laisse pénétrrt dans le réservoir
d’arrivée que de l’air à la pression de deux kilogrammes.
De ce réservoir, une canalisation conduit l’air à un
robinet automatique à mercure dont l’échappement est
relié à deux autres réservoirs où la pression
est maintenue normalement à sept cent cinquante grammes.
C’est cette pression que le système de transmission automatique,
commandé par l’horloge-mère, envoie dans tou t le vaste
réseau de canalisations commandant les horloges.
Dès l’année 1866, comprenant que le système pneumatique, que Collin a breveté en 1865, était insuffisant , il prenais un brevet qui m’assurait la propriété d’un système de remise à l’heure par l’électricité, que M. Th. du Moncel, membre de l’Institut, a jugé digne d’être décrit dans son Traité des applications de l'électricité. Il est cependant bon, dans certaines conditions. C’est ainsi que le grand cadran de l’orgue de Notre-Dame de Paris, et les cadrans intérieurs et extérieurs du casino de l’établissement thermal de Vicliy fonctionnent très régulièrement, depuis 1865, par ce système pneumatique.
Si l’accès à l’heure est relativement facile à Paris dans la première moitié du XIXe siècle, les horloges publiques sont inégalement précises et appartiennent à des propriétaires variés. Cette diversité pose et complexifie la question de la synchronisation des horloges, d’autant plus que l’exigence du public atteint un seuil inédit à partir de la seconde moitié du siècle. L’accélération des réseaux postaux et l’introduction des chemins de fer expliquent en partie cette nouvelle exigence, de même que l’intensification du « quadrillage du temps individuel qui l’accompagne, à des degrés divers, dans tous les domaines de la vie quotidienne.
La Compagnie estime que les horloges, «
au lieu de marquer l’heure exacte, avancent ou retardent, ce qui
créé des incertitudes très-désagréables
au moment des départs, des repas, des rendez-vous, etc. Le
succès de l’entreprise parisienne est, dans un premier temps,
au rendez-vous. En 1880, cent vingt personnes travaillent pour la compagnie.
Elle règle deux mille cent pendules dans six cents maisons en juin
1881. La valorisation de la discipline horaire touche des milieux variés,
de la fonction publique au commerce en passant par la restauration, où
la compagnie souhaite qu’il n’y ait plus une seule pièce
où des employés et clients n’aient constamment l’heure
exacte sous les yeux », mais aussi au foyer, « où la
connaissance constante de l’heure exacte aurait une sérieuse
influence sur la régularité du service, si précieuse
aux yeux des maîtresses de maison. Discipline des employés,
des clients, des maîtresses de maison qui repose sur des dispositifs
techniques parfois très spécifiques, comme ce procédé
inventé par l’horloger Collin pour s’assurer des heures
de passage des veilleurs de nuit sur les différents points qu’ils
doivent traverser.
La liste des abonnés de la compagnie permet d’ailleurs de
situer socialement les premiers clients de la compagnie dans les arrondissements
centraux de Paris. Près de la moitié sont des artisans et
commerçants. S’il est difficile de restituer l’utilisation
effective de ces horloges, on peut supposer qu’elles étaient
d’abord un moyen d’organiser et de surveiller leur propre activité,
révélateur d’une certaine éthique du travail
passant par la discipline horaire, avant d’être un objet pratique
et de prestige à destination des clients. Le service public de
synchronisation de l’heure qui prend forme au début des années
1880 à Paris répond donc à des besoins en précision,
synchronisation et discipline horaires. Mais le projet débute grâce
à l’action énergique des astronomes de l’Observatoire
de Paris.
sommaire
II - LA TRANSMISSION DE L’HEURE
PAR LA TELEGRAPHIE
Ce n’est qu’à partir du
milieu du XIXe siècle que l’accès à l’heure
de Paris, calculée par les astronomes et jusque-là réservée
aux ports et observatoires, subit un mouvement inédit de démocratisation
grâce au développement de la télégraphie électrique.
La première idée qu’on avait eue était d’unifier
l’heure par le télégraphe électrique. A Paris,
le directeur de l’Observatoire, Urbain Le Verrier propose dès
1867 la synchronisation de différentes horloges parisiennes, plan
qui se concrétise finalement en 1880 .
L'horloge de référence est celle de l'Observatoire dont
les battements sont synchronisés avec des centres secondaires grâce
à l'électricité. Les horloges de plusieurs mairies,
de la Sorbonne ou du Conservatoire des arts et métiers sont ainsi
synchronisées avec celle de l’Observatoire.
L’Observatoire
propose alors la constitution d’un service public de distribution
de l’heure à la minute pour les horloges publiques, en province
et dans la capitale, dont il serait le centre névralgique. Ce sont
toutefois la Direction des travaux de Paris et ses ingénieurs qui
gèrent au quotidien le réseau et ses dysfonctionnements.
Ces derniers, issus de l’École des ponts et chaussées
créée en 1747, participent activement à la formation
des services publics, et notamment des réseaux routiers, depuis
le XVIIIe siècle . Leur corps est organisé au niveau
départemental, sous l’autorité des préfets,
à partir de 1804.
Revenons à l'ouvrage de Collin
: L’unification de l’heure
C.’est une grande question qui m’est devenue familière,
grâce à des recherches que je poursuis sans relâche
depuis plus de quinze ans.
Dès l’année 1866, comprenant que le système
pneumatique, breveté par moi en 1865, était insuffisant,
je prenais un brevet qui m’assurait la propriété d’un
système de remise à l’heure par l’électricité,
que M. Th. du Moncel, membre de l’Institut, a jugé digne d’être
décrit dans son Traité des applications de Vélectricité
. Il est cependant bon, dans certaines conditions. C’est ainsi que
le grand cadran de l’orgue de Notre-Dame de Paris, et les cadrans
intérieurs et extérieurs du casino de l’établissement
thermal de Vicliy fonctionnent très régulièrement,
depuis 1865, par mon système pneumatique.
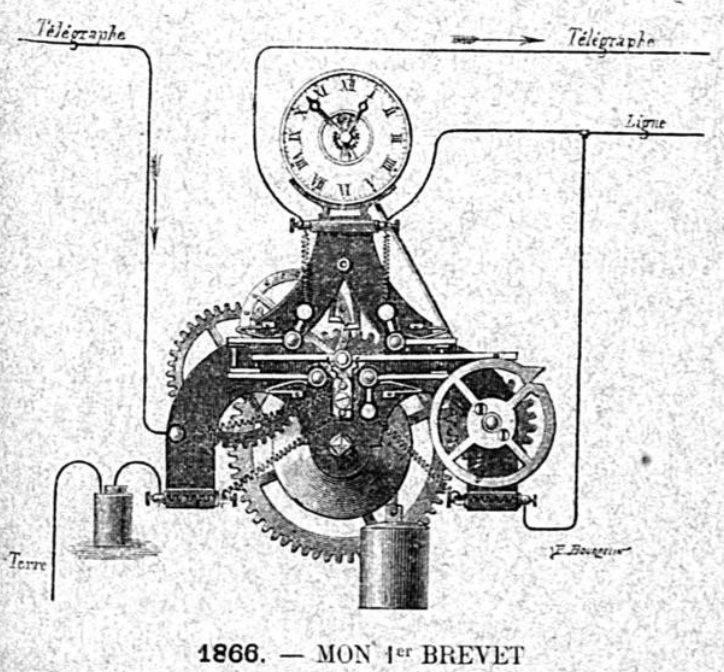
Mes travaux incessants sur l’unification de l’heure m’ont
amené à créer un grand nombre d’appareils qui,
tous, ont satisfait, non seulement à des expériences diverses
et longtemps continuées, mais encore à des applications
en grand, dont certaines datent de plusieurs années. Je crois remplir
un devoir en faisant connaître au public ce qu’une longue pratique
m’a appris, et en exposant, aussi nettement et aussi méthodiquement
que je le pourrai faire, les moyens les meilleurs d’unifier l’heure
à Paris et dans toute la France.
L’expérience a démontré que l’électricité
est un agent trop peu puissant, trop capricieux et trop infidèle
pour qu’on- puisse en user comme moteur d’horloges ou de compteurs.
Il faut donc, pour arriver à l’unification de l’heure,
renoncer à l’emploi de l’électricité en
tant que force motrice. Il faut conserver les horloges anciennes avec
leurs moteurs mécaniques, poids ou ressorts, et ne se servir de
l’électricité que pour les régler, automatiquement
et périodiquement, de façon à les contraindre à
donner l’heure exacte. Le réglage électrique, qui est
le seul moyen d’arriver, économiquement et sûrement,
à l’unification de l’heure, est, depuis de longues années,
l’objet de mes ëtüdes, ainsi que le constatent les divers
brevets que j’ai pris de 1866 à 1880. Dans une brochure, publiée
au commencement de 1877, j ’ai dit qu’il était inutile,
pour les besoins de la vie ordinaire, que l’unification de l’heure
se fit à chaque seconde, parce que, d’une part, le public
n’a guère besoin d’avoir l’heure à la seconde
et que, d’autre part, les horloges ne donnent pas la seconde et ont,
d’ailleurs, dans leurs aiguilles, des jeux qui rendent impossible
la constatation d’une différence d’une ou de quelques
secondes.
Cela est vrai et doit être maintenu
pour les horloge publiques ou particulières, qui n’ont à
satisfaire qu’aux besoins de la vie civile, mais il est bien entendu
que les pièces de quelque précision doivent donner la seconde
et qu’il est extrêmement désirable que le public puisse
se procurer, au besoin, l’heure exacte à la seconde. Or, il
est facile d’arriver à ce résultat. Voici comment :
A l’Observatoire, on obtient astronomiquement, chaque jour ou, du
moins, à des intervalles de temps très rapprochés,
la détermination exacte de l’heure pour le méridien
de Paris. Cette heure obtenue sera conservée à l’aide
de pièces de très-haute précision placées
sous les yeux des astronomes dans les conditions les plus favorables.
Ce seront les Garde-Temps. L’heure des Garde-Temps sera confiée
à des Régulateurs-types de précision, qui, par l’emploi
des courants électriques, régleront et maintiendront réglées
d’autres horloges qui, elles-mêmes, seront construites avec
soin et qui deviendront, sous le nom de Centres-horaifes, des types chargés
de régler les diverses horloges qui leur seront reliées
électriquement. Les Centres-horaires donneront la seconde, et les
horloges réglées par les Centres-horaires donneront l’heure
avec toute la précision que comporteront la disposition et le jeu
de leurs aiguilles; en tous cas, avec beaucoup plus d’exactitude
qu'il n’en faut pour la vie civile. Comme mon système de remise
à l’heure ne demande l’emploi de l’électricité
que pendant un petit nombre de secondes, soit toutes les heures, soit
toutes les six heures, toutes les douze heures ou toutes les vingt- quatre
heures, on conçoit qu’il sera facile d’emprunter pour
le service de l’unification de l’heure les lignes télégraphiques
existantes, sans nuire en rien au service des dépêches. On
arrivera donc à l’unification de l’heure, non seulement
à Paris, mais encore, si on le veut, dans toute la France, par
des moyens sûrs et peu coûteux. Les bases principales de l’organisation
que je propose sont, en effet, les suivantes :
1° L’emploi des lignes télégraphiques existantes
ou même des Lignes téléphoniques ;
2° L’emploi des horloges existantes qui, qu’elles soient
bien ou mal construites, régulières ou non, seront toujours
contraintes, par ma remise à l’heure électrique, à
donner l’heure exacte. Ceci indiqué, je vais entrer dans quelques
détails qui permettront de bien comprendre mes idées.
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SYSTÈME
Des Garde-Temps.
— A l’Observatoire de Paris on installera deux régulateurs
de très haute précision, que j’appelle les Garde-Temps.
Ces deux Garde-Temps seront remis à l’heure d’après
les observations exécutées par les astronomes en vue de
la détermination de l'heure exacte. Ils seront placés à
l’abri des trépidations du sol, à l’abri de l’humidité,
dans un local spécial dont la température sera aussi constante
que possible. En un mot, on réalisera pour eux toutes les conditions
qui leur permettront de conserver l’heure exacte. On ne s’en
servira que pour garder le temps. Des Régulateurs-types.
— A côté de ces deux Garde-Temps, dépositaires
de l’heure, on placera ce qu’on pourra appeler les têtes
de ligne de transmission de l’heure. Ces têtes de ligne seront
constituées par six bons régulateurs de précision
que j’appellerai Régulateurs-types. Ces six Régulateurs-types
devront avoir une très bonne marche se rapprochant le plus possible
de celle des deux Garde-Temps sur lesquels ils seront réglés.
Ces Régulateurs-types seront munis de divers contacts électriques
nécessaires pour donner la seconde, la minute ou les autres intervalles
de temps qu’on voudra. Le contact donnant la seconde sera employé,
si on adopte le système de réglage des Centres-horaires
à la seconde par le pendule. Le contact à minute sera plus
spécialement employé si l’on s’en tient complètement
à mon système. En tous cas, les Régulateurs-types
auront un contact spécial se faisant cinq secondes avant l’heure
et cessant à l’heure juste. On verra plus loin dans quel but
éminemment utile ce contact spécial est institué.
Sur les six Régulateurs - types, quatre seulement seront en usage
effectif; les deux autres, constituant un corps de réserve, ne
seront mis en service qu’en cas d’accident nécessitant
la réparation d’un ou de deux des quatre premiers. Voyons
ce qu’on fera de ces tètes de lignes constituées par
les Régulateurs-types.
Usage des Régulateurs-types.
— Les quatre Régulateurs-types en service distribueront
ou rompront, soit par eux-mêmes soit au moyen de relais, des courants
électriques rayonnant dans un certain nombre de directions de façon
à régler les Centres-horaires dont il va être parlé.
A cet effet, si les transmissions s’opèrent à chaque
seconde, c’est-à-dire d’une façon presque continue,
on devra employer nécessairement des fds spéciaux ou lignes
spèciales. Si, au contraire, on adopte complètement mon
système, si on se contente de régler les Cent res-horaires
d’une façon intermittente, c’est-à-dire à
des intervalles de temps d’une heure ou plus, on pourra user des
lignes télégraphiques existantes.
Des Centres-horaires.
— Les Centres-horaires seront les intermédiaires entre les
Régulateurs-types de l’Observatoire, faisant tète de
ligne, dont, il vient d’ètre parlé, et les horloges
ou pendules à régler. Ces Centres-horaires seront des régulateurs
ou, pour mieux dire, de très petites horloges, bien et fidèlement
construites, établies de façon à pouvoir donner une
bonne marche dans tous les endroits où il sera nécessaire
de les placer. Ils donneront au public, à l’extérieur,
l’heure, la minute et la seconde.
Emplacements des Centres-horaires
— On les placera à la façade des bureaux télégraphiques
et de poste. Cette place est nécessairement indiquée :
1° Parce que c’est aux bureaux télégraphiques qu
e se trouvent les fils avec lesquels les Centres-horaires devront être
mis en rapport pour remettre à l’heure les horloges.
2° Parce que les employés des postes et télégraphes
constitueront un personnel tout formé, pouvant surveiller et entretenir
les piles et, au besoin, le mécanisme de remise à l’heure.
3° Parce que c’est à ces bureaux que le public aura le
plus besoin de trouver l’heure exacte.
Réglage ou mise à l’heure des Centres-horaires.
J’ai indiqué déjà que l’on pouvait envoyer
un courant, à chaque seconde, des têtes de ligne de l’Observatoire
à chaque Centre-horaire, pour régler, à chaque seconde,
chacun des Centres-horaires par le pendule. Mon opinion n’est pas
favorable à ce système de réglage presque continu,
et, pour ma part, je préférerais qu’on se contentât
de remettre les Centres-horaires à l’heure à des intervalles
rapprochés, par exemple, toutes les heures ou même toutes
les six heures. Je vais exposer ici les inconvénients du réglage
des Centres-horaires à toutes les secondes et, ensuite, je reviendrai
à mon système.
Des inconvénients du réglage des Centres- horaires à
chaque seconde.
— Si, contre mon espoir, on réglait les Centres-horaires à
chaque seconde il faudrait établir de l’Observatoire à
chacun des Centres horaires des lignes spéciales, ce qui occasionnerait
de grandes dépenses d’établissement et d’entretien.
Les piles travailleraient constamment, elles s’épuiseraient
et s’useraient vite.
— De là des dépenses pour le renouvellement et l’entretien
continuel de ces piles. La nécessité où l’on
serait d’avoir des lignes spéciales restreindrait l’unification
de l’heure à la Ville de Paris et rendrait impossible la réalisation
de l'idée, très pratique et éminemment utile, de
l'unification de l’heure dans toute la France.
Ajoutons que, dans le réglage à chaque seconde, faut compter
avec une difficulté pratique, celle des contacts. Pour obtenir,
à chaque seconde, le passage d’un courant électrique,
on adapte sur les Régulateurs- types deux séries de trois
contacts qui doivent être soulevés par le pendule à
la fin de chacune de ses oscillations. Or, quelques soins minutieux qu’on
apporte à l’exécution de ces séries de contacts,
il est certain que le travail qu’on impose au pendule peut altérer
la marche du Régulateur-tgpe. On est, d’ailleurs, si peu sûr
des contacts qu’on les multiplie pour pouvoir, pendant la marche,
les soulever et les nettoyer souvent. Ainsi, en vue de rechercher une
exactitude absolue, on complique le Régulateur-type et on le charge,
au risque de le rendre infidèle et de perdre, par les irrégularités
de marche qui peuvent se présenter, ce qu’on espère
obtenir par la transmission à chaque seconde. Il vaut mieux, selon
moi, ne pas faire de contact toutes les secondes et n’avoir qu’un
contact, soit toutes les heures, soit moins souvent encore. Sans doute,
il peut, à la rigueur, se faire qu’en agissant ainsi on n’ait
l’heure qu’à une fraction de seconde près ; mais
cette fraction de seconde, qui représenterait la variation de marche
du Centre-horaire en une heure, restera toujours inaperçue et on
réalisera une économie énorme tout en gagnant en
sûreté. On peut m’objecter qu’avec la transmission
de l’Observatoire à chaque Centre-horaire à chaque
seconde, 011 pourrait, puisqu’on aurait des lignes spéciales,
user de ces lignes pour recevoir à l’Observatoire des signaux
des Centres-horaires;... que, même, on pourrait disposer les choses
de telle sorte que les pendules des Centres horaires fissent agir des
galvanomètres ou des compteurs indiquant à l’Observatoire
leur marche et le 013 arrêts... Certes, ce serait faisable ! Mais
ce serait très cher, très compliqué et médiocrement
utile. Il est clair que les Centres-horaires étant aux bureaux
télégraphiques, l’employé surveillant enverra
de suite, en cas d’accident, une dépêche à l’horloge
chargé de l’entretien qui viendra, aussitôt, réparer
le désordre.
En résumé, les inconvénients principaux du système
de réglage presque continu ou de transmission à chaque seconde
sont les suivants :
1° Obligation d’avoir des lignes spéciales, très
coûteuses d’établissement et d’entretien.
2° Dépense pour le remplacement des piles qui, travaillant
sans cesse, s’useront vite.
3° Obligation de restreindre, de peur de trop dépenser, le
nombre des Centres-horaires.
4° Impossibilité d’unifier l'heure dans toute la France.
5° Obligation de surveiller et d’entretenir, sans cesse, a 1'Observatoire,
les contacts des Régulateurs-types.
Je dois faire ici une observation qui a son utilité. J’ai,
pendant des années, mis en expérience des contacts de tous
genres, en vue de faire la transmission a chaque seconde. J’ai obtenu
des résultats excellents en procédant, à chaque seconde,
non pas par émission du courant comme on le fait dans le système
que je viens de discuter, mais, au contraire, par rupture du courant.
Il faut rompre le courant au moment même où le pendule du
type passe dans la verticale. Cela affecte bien moins la marche que quand
on agit à la fin de l’oscillalion.
Des Centres-horaires remis à l’heure par mon système.
— Je crois que mon système qui, je le répète,
consiste à remettre les Centres-horaires à 1 heure, toutes
les heures, devrait être adopté de préférence
à celui dont il vient d’être parlé. On aurait
l’heure à une fraction de seconde près, et on réaliserait
les avantages suivants :
1° On se servirait des lignes télégraphiques existants.
On ferait, de ce chef, une énorme économie.
2° On pourrait, à raison de l’économie indiquée
ci- dessus, multiplier les centres-horaires et régler automatiquement,
non seulement toutes les horloges de Paris, mais bien toutes les horloges
de France.
3° On conserverait longtemps les piles, puisqu elles n’agiraient
que toutes les heures ou même, si on voulait et ce qui vaudrait
mieux selon moi, à des intervalles plus éloignés.
Ce serait encore une très notable économie.
4° On n’aurait que peu de chose à faire pour l'entretien
des contacts. En effet, en réglant toutes les heures, on aurait
un contact par heure, au lieu des 3,600 contacts par heure que nécessiterait
le région 6 à chaque seconde. Et si on ne réglait
que toutes les six heures, on aurait un contact en six heures au lieu
des 1,600 contacts que nécessiterait le réglage à
chaque seconde.
Tous ces avantages sont certains. Le principal est la possibilité
d’arriver aisément à l'unification de l h heure dans
toute la France. J’y attache une extrême importance, et je
veux montrer comment on atteindra ce but
Unification de l’heure dans toute la Franc par mon système.
— Nous savons déjà que les Régulateurs-types
de l’Observatoire régleront les divers Centres-horaires, placés
aux bureaux télégraphiques, ou ils donneront l’heure
au public. Les Centres-horaires régleront eux-mêmes, autourd’eux,
les horloges diverses qui leur seront reliées. C’est ainsi
que l’unification de l’heure se féra a Paris.
* A Paris, l’Observatoire pourrait envoyer
l’heure exacte de ses régulateurs-tvpes à un centre-horaire
principal placéà l’Hôtel de Ville, qui enverrait
l’heure aux bureaux télégraphiques des vingt mairies,
par les lignes déjà existantes.
Voici maintenant comment on agira pour l’unification de l’heure
dans toute la France.
A l’administration centrale des télégraphes, rue de
Grenelle, endroit où aboutissent toutes les lignes télégraphiques,
on établira un Centre-horaire réglé par l'un ries
Ilégulateurs-types de l’Observatoire. De ce Centre-horaire
partiront des courants qui suivront les voies ferrées par les fils
dits omnibus, qui desservent télégraphiquement toutes les
stations. On remettra ainsi à l’heure, au grand avantage des
compagnies, toutes les horloges des stations de chemin de fer. On unifiera
donc l’heure sur tous les chemins de fer. L’horloge de chaque
station enverra elle-même, par les fils télégraphiques
existants, l’heure au bureau télégraphique de la ville
voisine. Là, un Centre-horaire remettra à l’heure toutes
les horloges de la ville. On voit que l'unification de l’heure en
France est bien loin d’être une utopie!... C’est, au contraire,
une œuvre très réalisable et très pratique,
et nous pouvons affirmer qu’un jour on unifiera l'heure dans toute
la France. c’est certain !
* Il est bien entendu que, pour les horloges autres que celles des chemins de fer, on pourrait tenir compte, par les aiguilles, des différences d’heures résultant de la situation géographique.
Après deux ans d’essai qui garantissent «
toute la sécurité nécessaire à un service
public, le Conseil municipal vote en 1880 le projet définitif de
douze centres horaires reliés par télégraphie à
quarante horloges du réseau secondaire, pour une dépense
totale de quatre-vingt mille francs.
Les principes d’accessibilité et de visibilité guident
la disposition des centres. Dès janvier 1880, sept d’entre
eux, construits par Bréguet, fonctionnent à la porte extérieure
de l’Observatoire, aux mairies des IIe et VIe arrondissements, au
presbytère rue de la Trinité, aux écoles près
de Saint-Philippe du Roule et de Saint-François-Xavier, et au pavillon
du Bureau des Ponts et Chaussées. Le réseau secondaire comprend
vingt horloges de mairies et vingt horloges d’établissements
publics et semi-publics, principalement des églises, mais aussi
la Bourse, le Palais de justice, l’hôpital Beaujon, le marché
aux chevaux et la prison Mazas. Bien que les centres horaires se situent
dans les arrondissements centraux, Wolf et Tresca, rapporteurs de la commission,
insistent sur l’extension du réseau secondaire qui amènera
« l’heure exacte à la minute en tout temps » à
« tous les quartiers de la Ville, même les plus excentriques .
La synchronisation s’insère dans un projet d’intégration
des arrondissements périphériques depuis leur annexion en
1860 : dès 1882, les horloges des vingt mairies d’arrondissement
sont reliées entre elles.
L’unification de l’heure en France
sera terminée en 1891. Jusqu’à cette date, en France,
chaque ville avait sa propre heure. Il était midi quand le Soleil
atteignait son point le plus haut...
En 1891, l’heure de Paris, calculée par l’Observatoire,
devient l’heure légale et est diffusée grâce
au télégraphe.
La pendule de l’Observatoire est munie d’un
dispositif qui envoie dans des lignes télégraphiques des
signaux très courts, à des heures convenues. Ces signaux
sont reçus dans les stations intéressées ; suivant
les cas, ils sont enregistrés graphiquement ou simplement perçus
à l’oreille, et permettent aux observateurs de ces stations
de connaître exactement la « marche» de leur pendule
ou de leur chronomètre, c’est-à-dire l’écart
qu’ils présentent avec la pendule type du premier méridien.
Ce procédé permet la précision du dixième
de seconde, ce qui est déjà bien ; mais il a l’inconvénient
d’exiger un « fil », et, par conséquent, de ne
pouvoir s’appliquer ni à l’envoi de l’heure aux
navires en mer, ni à cet envoi aux explorateurs qui parcourent
des contrées inconnues. De plus, en ce qui concerne la distribution
de l’heure, celle-ci ne pouvait être faite qu’à
quelques centres importants, qui devaient, à leur tour, la transmettre
à des stations secondaires. De là des complications et des
introductions de cause d’erreurs inévitables.
Mais les nombreux dysfonctionnements, notamment dans les années 1886-1891, posent rapidement la question de la responsabilité du réseau et mettent au jour la complexité de sa cogestion. Si l’Observatoire de Paris est bien à l’initiative du projet, c’est la Direction des travaux qui se charge de sa mise en place, de son entretien et de sa surveillance pour le compte de la ville. La Direction devient l’interlocuteur privilégié de tous les participants au service. Mais elle n’intervient pas directement sur les douze centres horaires, sous la responsabilité de la maison Bréguet. Différents horlogers s’occupent ensuite des horloges du réseau secondaire . L’Observatoire, quant à lui, veille au bon fonctionnement de l’horloge régulatrice entreposée dans ses murs. Il est également en capacité de surveiller la marche de certains centres, puis de leur totalité à partir du milieu des années 1880. Cet investissement croissant de l’Observatoire dans la supervision technique fait suite à des plaintes du public. Une enquête interne diligentée en 1887 rejette la faute sur la maison Bréguet et propose une révision complète des horloges. La collaboration entre les horlogers, les ingénieurs de la Direction des travaux, et l’Observatoire de Paris se révèle problématique quand il s’agit d’identifier l’origine des accidents et de désigner des responsables. Les modalités de fonctionnement du service ne sont pas toujours clairement établies. De plus, le service horaire de la ville ne couvre qu’une petite partie des horloges publiques et ne résout donc pas la question de leur synchronisation à grande échelle. Le Conseil municipal s’appuie alors sur des initiatives privées pour reprendre l’initiative et compléter le réseau public.
1894 Les horloges strictement municipales, c’est-à-dire
destinées à l’usage du public et à la charge
du service d’architecture de Paris, peuplent les églises,
les établissements scolaires et universitaires, les mairies, halles
et marchés. On en dénombre cent trente-trois en 1894 :
Les horloges des bureaux des surveillants de voiture de place, au nombre
de cent soixante en 1888, et celles des différents services techniques
municipaux, au nombre de quatre-vingts, sont également à
la charge de la ville Ces petites horloges sans sonnerie représentent
« les indicateurs du temps les plus fréquemment consultés .
Elles font partie d’une catégorie plus vaste, les horloges
publiques, qui recouvrent tous les instruments de mesure du temps, de
propriété privée ou publique, dont les indications,
visuelles ou auditives, sont accessibles aux citadins.
Un inventaire partiel à l’initiative de la Direction des travaux
en 1882 permet d’apprécier la diversité des propriétaires
de ces horloges. Les cinq horlogers ayant répondu à l’invitation
(Garnier, Lepaute, Borrel, Verdavainne, Detouche) comptabilisent deux
cent quatre-vingt-onze grosses horloges à sonnerie dont ils ont
la charge de l’entretien . On y retrouve des horloges municipales,
mais aussi des horloges étatiques situées dans les différents
ministères, dans des casernes, prisons, asiles, etc. Dans une moindre
mesure, ces horloges appartiennent à des individus ou des sociétés
privées, comme des sociétés bancaires et financières,
des journaux, des ateliers ou des raffineries.
III
- DISTRIBUTION DE L'HEURE PAR LE TELEPHONE
Déjà en 1884 aux Etats-Unis, lors de l’exposition
internationale d'électricité ou la Téléphoné
Bell C° se trouve réunie à celle de la Société
de construction la Western Electric C°, l’on remarque dans cet
espace un système fort ingénieux pour la distribution de
l’heure par le téléphone, un appareil pour l’allumage
électrique des becs de gaz, des appareils avertisseurs d’incendie,
... et différents types de sonneries, de tableaux indicateurs,
etc.
Etant donné un réseau téléphonique,
une idée qui se présente naturellement à l’esprit
est de l’utiliser à transmettre l’heure au lieu de recourir
à un réseau spécial. On peut transmettre l’heure
aux abonnés par deux procédés différents,
les signaux optiques et les signaux acoustiques. Dans le premier cas il
faudrait que chaque abonné reçût une horloge sympathique
mue par l’électricité dont la marche serait réglée
par des émissions de courant venant du bureau central. On pourrait
dans ce cas graduer les impulsions de courant par la méthode de
van Rÿsselberghe, en sorte qu’elles n’affecteraient pas
les téléphones. Ce mode de transmission de l'heure ne présenterait
aucune difficulté sérieuse. Si cette idée n’a
pas encore reçu d’application pratique cela tient sans doute
uniquement à ce que les frais de première installation seraient
considérables ; le service serait également assez onéreux
car il faudrait, par suite de la grande résistance des lignes,
de fortes batteries de piles.
Ces inconvénients disparaissent quand on a recours aux signaux
acoustiques.
Au Etats-Unis en 1888 La méthode des signaux acoustiques
est employée par la National Time Reglating C° de Boston et
la New England Téléphoné C° de Lowell (Massachussetts).
L’appareil qui donne l’heure est un cylindre muni de dents,
comme les cylindres des boîtes à musiques. Contre ce cylindre
vient frotter un levier de contact qui s’élève ou s’abaisse
suivant qu’il appuie sur une dent ou sur la surface même du
cylindre ; le mouvement de ce levier est utilisé pour fermer ou
ouvrir le circuit d’une pile. Les dents du cylindre, qui sont placées
dans un même plan normal à l’axe et qui par conséquent,
pour un tour complet, viennent toutes se mettre en contact avec le frotteur
forment trois groupes. Les dents du premier groupe donnent les heures,
celles du second groupe les dizaines de minutes et enfin celles du troisième
groupe les minutes. Le levier de contact se déplace le long du
cylindre par le jeu d’un électro-aimant. Toutes les minutes,
une horloge électrique envoie un courant dans cet électro-aimant
et au moyen d’une crémaillière, déplace parallèlement
à l’axe du cylindre le frotteur d’une quantité
égale à l’intervalle qui sépare deux cercles
dentés consécutifs. La même impulsion de courant déclanche
un moteur électrique mis en mouvement par une batterie de piles;
ce moteur fait faire un tour au cylindre et le frotteur passe successivement
sur toutes les dents du cercle devant lequel il se trouve placé
à ce moment Le frotteur est relié à la ligne de terre
de tous les abonnés au téléphone, qui sont en même
temps abonnés à la distribution de l’heure. Si donc
un de ses abonnés porte à l’oreille son téléphone,
au moment où le cylindre tourne, il entend trois groupes de signaux
brefs, mais faciles à distinguer et séparés par des
temps de pose, relativement longs. Supposons par exemple qu’il compte
deux, puis trois, puis neuf : il sait que cela veut dire 2 heures 39 minutes.
Cette opération a lieu une fois par minute.
Schéma du système. 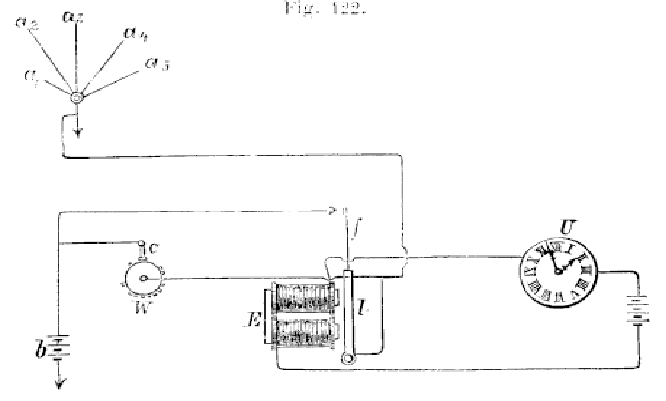
Dans cette figure, U représente l’horloge qui toutes les minutes
envoie un courant dans l’électro-aimant E. L’électro-aimant
attire son armature l et celle-ci en se déplaçant fait avancer,
par l’intermédiaire d’une transmission très simple
(cette transmission n’est pas représentée sur la figure),
le frotteur C d’une dent le long du cylindre W. En même temps,
une lame élastique f fixée à l’armature l, met
à la ligne la pile b. Comme cette lame est élastique et
que l’attraction de l’arma ture se fait brusquement, elle vibre
pendant un laps de temps très court, ce qui produit une succession
rapide d’ouvertures et de fermetures du circuit; l’abonné
qui a le téléphone à l’oreille, entend un bruit
sourd, indiquant que l’heure va être immédiatement transmise.
L’armature l a encore une troisième fonction ; elle déclanche
le moteur qui fait faire un tour complet au cylindre ; toutes les dents
viennent successivement frotter contre le levier de contact et envoient
dans la ligne le nombre voulu d’émissions de courant.
Les coups que l'on entend dans le téléphoné doivent
naturellement être assez faibles pour ne pas nuire à la transmission
de la parole.
Les Compagnies font payer un dollar par an pour l’abonnement à
l’heure.
En France, Guyou entreprend en 1903 des démarches auprès de la chambre syndicale de l’horlogerie de Paris, afin d’établir un « service de l’heure donnant l’heure temps moyen de Paris, par le téléphone », soit au domicile des horlogers, soit auprès d’un bureau voisin.
Transmettre les longitudes au téléphone
Quand l’invention et la généralisation des chemins
de fer vinrent poser le problème de la circulation rapide des trains
sur une voie unique, il fallut songer à unifier l’heure des
diverses stations. Ce fut l’époque où l’on avait,
dans chaque ville de France, deux « heures » différentes
: 1’« heure de la ville » et 1’« heure de
la gare », qui était celle de Paris, transmise télégraphiquement.
L’heure de la ville avançait sur l’heure de la gare pour
les stations situées à l’Est de Paris; elle retardait,
en sens contraire, pour les stations situées à l’Ouest.
La différence des heures n’était pas d’ailleurs
sans atteindre une valeur relativement importante pour les points extrêmes
du territoire : elle atteignait vingt-sept minutes à Brest et vingt
minutes, en sens contraire, à Nice.
Les inconvénients de cette double numération furent si manifestes
que, dès 1891, une loi rendit réglementaire pour toute la
France l’heure de Paris. Les divers États du monde avaient
d’ailleurs pris des mesures analogues, chacun pour l’étendue
de son territoire. Cela allait très bien tant qu’on ne sortait
pas d’un État déterminé, mais l’inconvénient
devenait grave quand il fallait passer d’un État dans un autre,
et, pour en citer un cas typique et demeuré classique, sur le bord
du lac de Constance, dont les rives baignent cinq États différents
: la Suisse, le Duché de Bade, la Bavière, la Wurtemberg
et l’Autriche, on ne comptait pas moins de cinq heures différentes
! De là une confusion, tout au moins une complication extrême
dans les horaires des bateaux et des chemins de fer.
Ainsi l’heure nationale, suffisante pour un même pays de peu
d’étendue, devient insuffisante quand il s’agit de plusieur
États ; elle le devient même pour un seul pays, si l’étendue
de celui-ci de l’Est à l’Ouest est considérable.
Puisque le téléphone est installé au centre de Montsouris,
Auguste Claude et Émile Guyou peuvent se lancer dans des expériences
scientifiques, notamment sur la suppression du chronographe et son remplacement
par le téléphone dans les déterminations des différences
de longitudes entre deux stations.
L’observatoire de Montsouris entreprend, au printemps de 1903, la
détermination de la différence de longitude entre Paris
et Brest, en utilisant l’astrolabe à prisme pour les observations
d’heure en chaque station, le téléphone et une méthode
de coïncidences sonores très ingénieuse pour l’échange
des signaux.
Ces expériences sont décrites en 1907 avec grand enthousiasme
par le commandant R. Bourgeois, successeur des géodésiens
de l’armée Perrier et Bassot, à la direction de la
section de géodésie au service géographie de l’armée.
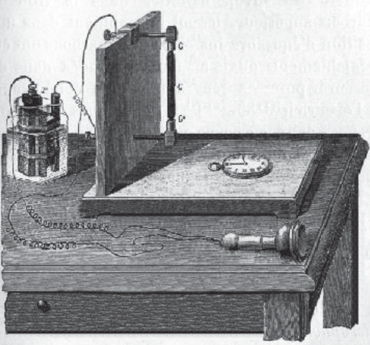

A droite : Microphone de type Hughes, vers 1900, construit par Pericaud
ou Radiguet.
Les vibrations de la montre font vibrer le barreau de charbon très
sensible CC’C’’. Dispositif inventé par D.E. Hughes
en 1878.
Dans la méthode ordinaire, explique Bourgeois, les secondes de
l’horloge locale s’enregistrent sur une bande de papier sur
laquelle s’enregistrent aussi simultanément les signaux reçus
par chaque station d’échanges. La différence de longitude
s’obtient par différence de ce signal d’échange
avec la seconde la plus proche (sous réserve de vérifier
l’instantanéité ou non de la transmission). Dans la
méthode employée par Guyou et Claude dans leur détermination
de la longitude Paris-Brest, deux chronomètres sont employés,
l’un de temps sidéral, l’autre de temps moyen, battant
la demi-seconde et donc en coïncidence toutes les trois minutes.
Sur la vitre de chaque montre est placé un microphone sensible
(de type Hughes) relié à la ligne téléphonique.
Les observateurs perçoivent alors simultanément les deux
signaux ; un système potentiométrique permet d’égaliser
l’intensité des battements reçus. Les observateurs
notent les coïncidences entre les battements. L’heure locale
est obtenue à l’aide de l’astrolabe à prisme,
en observant les hauteurs égales de quelques étoiles brillantes.
Moyennant des corrections et de petits calculs, les différences
de longitude entre les stations sont ainsi obtenues.
En 1906, le projet de service de l’heure
par téléphone basé à l’Observatoire de
Paris (Montsouris) est abandonné car un projet de radiodiffusion
de l’heure à partir de la tour Eiffel voit peu à peu
le jour.
Le 5 mars 1907 parait le décret qui classe les stations radiotélégraphiques
en catégories et qui prévoit des autorisations accordées
par l'administration des PTT pour l'installation des stations privées
et d'installations des stations temporaires.
On commence les échanges de données météorologiques
avec les États-Unis, la Russie et l'Asie de l'est, permettant d'avoir
une meilleure analyse des systèmes en amont.
Le projet de Guyou resurgira en 1910, en vain, sous la houlette du nouveau
directeur de l’observatoire, l’amiral Ernest Fournier (1842-1934),
alors que la France est en pleine discussion pour l’adoption d’une
heure légale . La loi du 9 mars 1911 fixera l’heure légale
comme « l’heure du temps moyen de Paris retardée de
9 minutes 21 secondes », c’est-à-dire le temps universel.
En 1933, c’est un nouveau service,
téléphonique, que met en place Ernest Esclangon (1876-1954),
le directeur de l’Observatoire : l’horloge parlante. Le principe
en est détaillé par le Bulletin d'informations du Ministère
des Postes, télégraphes et téléphones. Un
enregistrement, réalisé sur le modèle des films parlants,
annonce toutes les dix secondes l’heure à venir sous la forme
heure /minutes/secondes suivie d’un top musical qui correspond à
l’heure exacte. Trente abonnés peuvent alors etre simulténément
raccordés à l'horloge parlante
Il faudra attendre le 14 février 1933 pour qu’une horloge
parlante soit mise en service à l’Observatoire
de Paris par son directeur Ernest Esclangon (1876-1954) et que
selon ce dernier, « se développe dans le public, une sorte
d’habitude de l’heure exacte, […] le besoin de l’heure
précise » .
LA TSF
De même que pour le téléphone, l’invention de
la Télégraphie Sans Fil, ne peut revenir à un seul
chercheur.
Il est apparu très vite que les moyens de transmission par fil
étaient un handicap de taille au développement universel
de la communication, en particulier avec les navires ainsi que dans tous
les endroits géographiquement difficiles d’accès.
Heureusement, la réunion des techniques de télégraphie,
puis plus tard de téléphonie, avec la découverte
des ondes radio fit sauter les dernières barrières ouvrant
la voie aux communications modernes.
C’est ce que nous allons étudier maintenant.
Le
Radiophone. (par le comte Th. Du Moncel.)
La première expérience de transmission de la parole sans
l’utilisation d’un fil fut conduite par Graham
Bell en 1880. Il avait étudié les propriétés
du sélénium dont il disait ceci : « Quand il
est à l’état vitreux, il est de couleur brun foncé,
presque noir à la lumière diffuse, et a une surfae extrêmement
brillante. Réduit à l’état de pellicule fine,
il est transparent, et paraît d’un beau rouge quand il est
frappé par la lumière. Quand, après avoir été
fondu, il est refroidi très lentement, il présente un aspect
tout différent ; il devient d’un rouge pâle, avec aspect
granuleux et cristallin, ayant l’apparence métallique. Il
est alors parfaitement opaque, même en pellicules minces. Cette
variété de sélénium a été longtemps
connue sous le nom de granulaire ou cristalline ou métallique,
ainsi que l’a appelée M. Regnault. C’est cette variété
de sélénium qu’Hittorf trouva être conductrice
de l’électricité à la température ordinaire,
et il trouva également que sa résistance diminuait constamment
en la chauffant jusqu’au point de fusion, mais qu’elle augmentait
ensuite subitement en passant de l’état solide à l’état
liquide. On a vu d’ailleurs que la lumière agissait d’une
manière considérable sur cette substance. »
Dans le numéro du 1er octobre 1880, du journal « La Lumière
électrique », il disait : « Il est aisé de comprendre
que si le photophone pouvait être mis
en action à une distance un peu grande, ce qui n’est pas facile
à admettre en raison de l’affaiblissement rapide de l’intensité
lumineuse avec la distance, il pourrait rendre quelques services pour
la défense des places assiégées, dans certains travaux
de géodésie, et peut-être même à la
guerre, comme complément de la télégraphie optique…
»
Dans son premier mémoire sur le « Radiophone », Graham
Bell détaillait ses expériences avec des figures que nous
reproduisons ci-dessous, accompagnées du commentaire suivant :
« Je fus alors frappé de l’idée de produire des
sons sous l’influence de la lumière, et, en étudiant
plus à fond la question, je pensai que tous les eff ets d’audition
produits sous l’influence électrique pouvaient être
obtenus par des changements d’intensité d’un rayon lumineux
projeté sur le sélénium, et qu’ils ne pouvaient
avoir pour limite que celle à laquelle s’arrête l’action
de la lumière sur cette substance ; or, comme cette limite peut
être assez reculée par la projection de rayons parallèles
concentrés sur la plaque sensible par un réfl ecteur parabolique,
je pensai qu’il serait possible d’établir, par ce moyen,
des communications téléphoniques d’un point à
un autre sans le secours
d’aucun fil conducteur, entre le transmetteur et le récepteur.
Il était évidemment nécessaire, pour rendre cette
idée pratique, de construire un appareil susceptible d’actionner
la lumière sous l’infl uence de la parole, et c’est ainsi
que je fus conduit au système dont je parle aujourd’hui. »

La figure ci-dessus montre la manière de reproduire des sons par
la rotation d’un disque muni de trous et interceptant le faisceau
lumineux agissant sur le disque de sélénium. L’auditeur
est en A, ayant un téléphone à chaque oreille ; le
disque de sélénium est en S, la pile en P, et le disque
tournant en DD, au point de croisement des rayons réfléchis.
Ces rayons tombent sur un miroir M, qui les réfléchit à
travers une première lentille L’’, d’où ils
sortent pour se projeter, après s’être croisés,
sur une seconde lentille L’ qui les rend parallèles pour atteindre
une troisième lentille L ; celle-ci les concentre sur le disque
de sélénium, et c’est au point de croisement D des
rayons qu’est placé le disque percé de trous DD que
l’on aperçoit vu de face au bas de la figure.
 fig. 36
fig. 36
La figure 36 représente le miroir téléphonique derrière
lequel on parle pour transmettre la parole par l’action des rayons
lumineux ; la lame de mica argenté ll forme, comme on le voit,
la lame vibrante d’un téléphone TT, ayant, une longue
embouchure E, et les rayons lumineux projetés angulairement sur
cette lame se trouvent déviés de leur direction normale
de réflexion par les vibrations de la lame, ce qui équivaut
à des extinctions proportionnelles à ces vibrations.
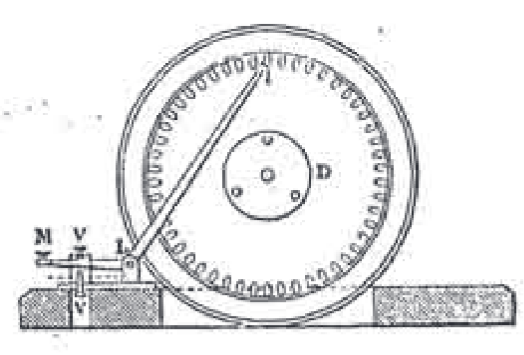 fig. 37
fig. 37
La figure 37 montre le disque tournant D sur une plus grande échelle
que dans la figure 35. Devant les trous de ce disque se trouve un levier
obturateur articulé Ll dont la branche la plus courte, LM, constitue
une clef Morse, mobile entre deux butoirs V. En effectuant avec la poignée
la manœuvre du Morse, on obtient une obturation saccadée et
plus ou moins longue des rayons lumineux, et par suite les sons longs
et courts des parleurs télégraphiques dans le système
Morse.
 fig. 38 et 39
fig. 38 et 39
Les figures 38 et 39 représentent la disposition de la première
expérience sans l’intervention du circuit téléphonique,
et par conséquent les sons produits dans ces conditions résultent
de l’action directe de la lumière sur les plaques où
elle se trouve projetée ; l’auditeur a alors, comme on le
voit, la plaque appliquée à l’oreille.
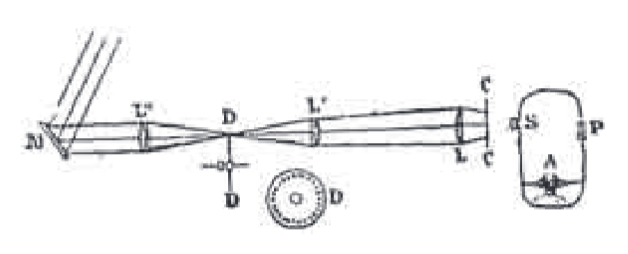 fig. 40
fig. 40
La figure 40 représente la première expérience avec
l’interposition du disque mince de caoutchouc durci CC sur le trajet
des rayons lumineux avant leur concentration sur le sélénium
S.
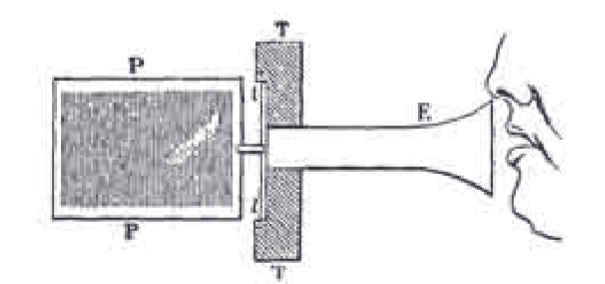 fig. 41
fig. 41
La figure 41 représente le premier dispositif au moyen duquel le
rayon lumineux se trouvait actionné par la voix pour reproduire
la parole ; la plaque percée de fentes longitudinales se voit en
PP, et elle est, comme on le remarque, fixée à la membrane
vibrante ll d’un téléphone T. C’est derrière
cette plaque PP que se trouve la seconde plaque percée qui doit
être fixe. D’après cette disposition, on comprend facilement
que si deux plaques sont disposées de manière que les fentes
se correspondent à l’état normal, les vibrations de
la voix agissant sur le diaphragme, et par suite sur la plaque mobile,
devront provoquer des extinctions plus ou moins grandes de la lumière,
en rapport avec l’amplitude des ondes sonores.
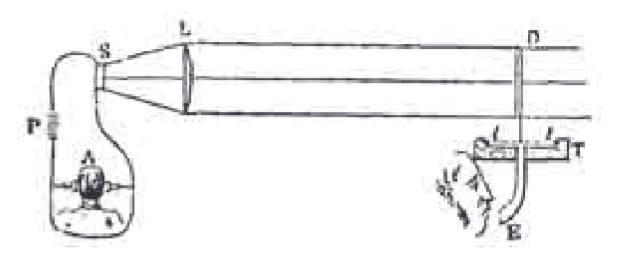 fig. 42
fig. 42
La figure 42 indique comment ce système est disposé pour
actionner la plaque de sélénium S en rapport avec le circuit
des téléphones. Les deux plaques sont représentées
en D vues sur la tranche.
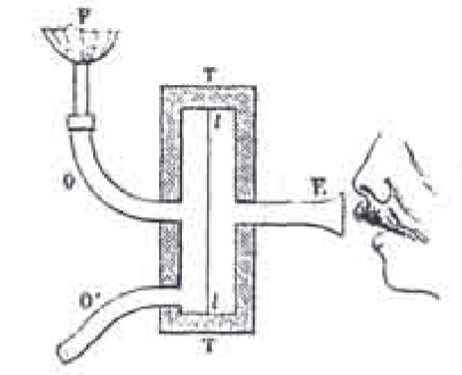 fig. 43
fig. 43
La figure 43 représente le moyen employé par M. Bell pour
impressionner par la voix la flamme d’un bec de gaz. Le jeu du système
est facile à comprendre par l’inspection de la seule figure.
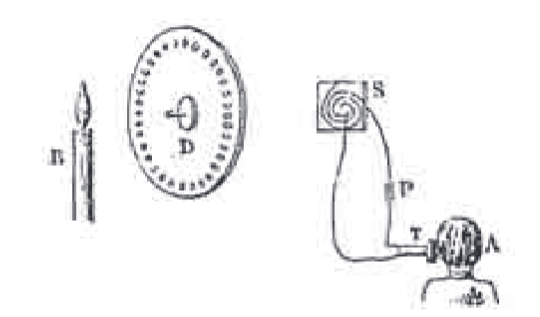 fig. 44
fig. 44
La figure 44 montre la disposition de l’expérience au moyen
de laquelle on prouve que la lumière d’une bougie peut produire
des sons en agissant sur un système à sélénium.
Il suffit, comme on le voit, de placer, entre ce système et la
bougie, le disque percé de trous dont nous avons parlé.
Tel est le résumé du premier travail de M. Bell sur la radiophonie,
travail déjà bien riche, comme on le voit, en observations
curieuses et nouvelles, et qui a provoqué immédiatement
l’étude des savants des différents pays sur cette nouvelle
branche ouverte à la science.
Ce système avait peu d’avenir en l’état des connaissances
de l’époque. Sa portée était limitée,
mais l’idée était là : transporter les sons
à distance sans fil !
Bien que de nombreuses découvertes dans le domaine de l’électricité
aient été nécessaires au développement de
la radio, celui-ci commença réellement en 1873, avec
la publication, par le physicien britannique James Clerk Maxwell (1831-1879)
de son « Traité d’électricité et de magnétisme
». Par raisonnement mathématique, il établit que toute
perturbation électrique donne naissance à des oscillations
électromagnétiques de fréquences diverses, non perceptibles
par nos sens, qui rayonnent dans l’espace, comme le son, la lumière
et la chaleur.
Quelque quinze ans plus tard, le physicien
allemand Heinrich Hertz générait, pour la première
fois, de telles ondes avec une source électrique.
Il chargea électriquement un condensateur, puis le court-circuita
à l’aide d’un éclateur. Dans la décharge
électrique qui s’ensuivit, la quantité de charges électriques
déplacées dépassa le point neutre, développant
une charge de même valeur et de signe opposé sur les armatures
du condensateur, puis ces charges électriques continuèrent
de passer par va-et-vient d’une armature à l’autre du
condensateur, créant ainsi une décharge électrique
oscillatoire apparaissant sous la forme d’une étincelle. Une
partie de l’énergie de cette oscillation fut rayonnée
par l’éclateur sous forme d’ondes électromagnétiques,
que l’on nomma ondes hertziennes.
Les travaux de Hertz comprenaient plusieurs montages qui allaient constituer
pour longtemps la base technologique du développement de la radio.
Son expérience, réalisée en 1887, s’organisait
autour des deux éléments fondamentaux d’un système
radioélectrique, l’émetteur et le récepteur.
Le premier était constitué d’un générateur
d’oscillations de haute fréquence, ou « excitateur »,
dans lequel des étincelles étaient produites par
un éclateur à boules. Le second, dénommé alors
« résonateur », éloigné de plusieurs
mètres, permit à Hertz d’observer une étincelle
témoignant de
l’existence d’oscillations de haute fréquence induites
à distance. Il en mesura diverses grandeurs, dont la longueur d’onde
et la vitesse de propagation.
Ce fut sur cette base que de multiples éléments vinrent
progressivement se greffer pour déboucher sur une utilisation pratique
des ondes hertziennes. L’apport du physicien Édouard Branly
fut fondamental en ce domaine.
En 1890, il réalisa un tube radioconducteur à limaille
métallique qu’il impressionna jusqu’à 30m avec
les ondes produites par un appareillage de Hertz. Ainsi fut réalisé
le premier détecteur d’ondes électromagnétiques.
Le « radioconducteur » de Branly est constitué
d’un tube de verre d’environ 3 mm de diamètre dans lequel
sont introduits deux pistons métalliques distants d’environ
1 mm. L’espace disponible est rempli partiellement d’une limaille
métallique (fer ou métal inoxydable).
Le dispositif est monté dans un circuit électrique alimenté
par une pile de faible voltage. Sous l’effet d’un rayonnement
électromagnétique le tube devient conducteur et laisse passer
le courant dans le circuit.
Sir Oliver Lodge eut aussi l’idée d’utiliser ce
dispositif à l’étude des ondes hertziennes. Les Anglo-saxons
disent que la limaille a été « cohérée
». Il faut pour la « décohérer » donner
un petit choc sur le tube. De ce fait le tube portera le nom de «
coherer » qui sera francisé en « cohéreur
» malgré les protestations de Branly qui tenait au terme
de radioconducteur.
La grande contribution de Sir Oliver Lodge au développement de
la TSF est souvent largement passée sous silence. Bien qu’il
fut très apprécié de ses pairs, à l’inverse
d’un Marconi, il est resté, en pur scientifique qu’il
était, éloigné des turbulences médiatiques
et son absence de la grande presse fait qu’il est aujourd’hui
quasi inconnu du grand public.
Ce fut l’élément central de tout appareil récepteur
de télégraphie sans fil pendant plusieurs années.
Aux travaux de Hertz et de Branly, il conviendrait d’ajouter ceux
de Nicolas Tesla et d’Alexandre Popov.
"Parmi les nombreuses inventions de Tesla, on peut citer les générateurs
à haute fréquence (1890) et la bobine qui porte son nom
(1891) et qui a eu des applications importantes dans le domaine des communications
radio. Il est considéré comme l’un des princi paux
pionniers dans le domaine de l’énergie électrique.
L’unité appelée Tesla est l’unité (Système
international, symbole T). de l’intensité d’un champ
magnétique.
Popov réalisa la première expérience attestée
de « télégraphie sans fil », à Saint-Pétersbourg,
le 7 mai 1895.
Apport fondamental
à cette histoire du télégraphe fut l’ajout d’une
antenne aux systèmes de réception et d’émission,
ce qui lui permit des résultats extrêmement encourageants.
Il transmit des messages en code Morse et démontra ainsi la portée
pratique de l’utilisation des ondes hertziennes. On lui doit également
la « prise de terre »
Guglielmo Marconi, physicien et inventeur italien né à
Mazabotta près de Bologne le 24 avril 1874 et mort à Rome
le 20 juillet 1937. À l’été 1894, il apprend
la mort de Hertz et imagine d’utiliser ses travaux comme moyen de
communication sans l’aide de fils. Guglielmo MARCONI a juste 20 ans.
Avec son frère Alphondo, il s’installe dans le grenier de
la maison familiale et construit un appareillage qui permet de faire tinter
une sonnette deux étages plus bas. Il associe bobine de Ruhmkorff,
éclateurs, manipulateur télégraphique de Morse, cohéreur
de Branly, antennes verticales de Popov pour concevoir un ensemble émetteur/récepteur
complet.
Il avait organisé de manière plus rationnelle ces différents
éléments, constatant alors le rôle essentiel joué
par la prise de terre et révélant l’influence de la
hauteur de l’antenne. À quelques mois d’écart,
il obtint des résultats très sensiblement supérieurs
à ceux de Popov, transmettant ainsi, à la fin de l’année
1895, un message en morse à une distance de 2 400m. L’année
suivante, à 22 ans, il propose son invention au Ministère
des Postes
italien qui ne le prend pas au sérieux. Il faut dire qu’à
cette époque, la télégraphie conventionnelle à
fils est parfaitement au point en Europe et que des câbles sous-marins
relient l’Europe aux États-Unis.
En 1897, il transmit des signaux de la côte jusqu’à
un navire situé en mer, à 29 km de là. Le 16 juin
1897, suite à ses premiers succès, il est convié
à faire une présentation devant la Royal Society sous couvert
de son protecteur Sir William Preece. Sir Oliver Lodge assiste à
cette présentation. Cette même année, le gouvernement
italien informé des succès de Marconi revoit son attitude
et l’invite, en juillet, à une démonstration à
bord d’un navire militaire le San Martino. On peut dire que ce navire
sera le premier bateau équipé d’une station de TSF.
Au mois de novembre, Marconi construit sa première station fixe
de TSF à Needless sur l’île de Wight. Le 3 juin 1898,
il transmet le premier message radio payant entre l’île de
Wight et Bornmouth. Son premier client n’est autre que Lord Kelvin
qui débourse un penny pour le service !
Il établit entre l’Angleterre et la France une communication
commerciale, fonctionnant quel que soit le temps. Le 28 mars 1899, la
première liaison télégraphique entre Douvres et Wimereux
(50 km) franchissait la Manche avec ce texte : « MR MARCONI ENVOIE
A MR BRANLY SES RESPECTUEUX COMPLIMENTS PAR LE TELEGRAPHE SANS FIL A TRAVERS
LA MANCHE ? CE BEAU RESULTAT ETANT DU EN PARTIE AUX REMARQUABLES TRAVAUX
DE MR BRANLY » * (le E n’était pas inscrit sur le
message d’origine…)
Mais Marconi, homme de recherches ne s’en tint pas là. Le
12 décembre 1901, avec la collaboration de l’anglais J.A.
Fleming , il réussit à envoyer un message d’une seule
lettre à travers l’océan Atlantique, entre les Cornouailles
(émetteur de 10 kW à Poldhu) et Terre-Neuve (Signal Hill)
soit 3 400 km.
En France, Eugène Ducretet réalisa avec ses appareils la
première émission télégraphique au dessus
de la capitale. Le 5 novembre 1898, après quelques mois d’essais,
ce fut, entre la tour Eiffel où l’assistait Ernest Roger,
et le Panthéon, la première liaison. Ce fut le départ
de la télégraphie sans fil en France. Des 4 km entre la
tour Eiffel et le Panthéon, on passa vite à 7 km entre le
Sacré Cœur et l’église sainte Anne (toujours en
novembre 1898). Enfin, en septembre 1899, une liaison maritime de 42 km
avait lieu en Bretagne, à cette occasion, Ducretet télégraphia
à Tissot : « RETOUR VOYAGE – DITES A MINISRE QUE
NOUS FERONS AUSSI BIEN QUE LES ANGLAIS – AVEC CREDITS… AMITIES
– DUCRETET », car déjà, il y avait des problèmes
de crédits…
À partir de 1902, des messages furent régulièrement
envoyés à travers l’Atlantique et, dès 1905,
de nombreux bateaux utilisaient la radio pour communiquer avec les stations
côtières. Pour son travail de pionnier dans le domaine de
la télégraphie sans fil, Marconi partagea, en 1909, le prix
Nobel de physique avec le physicien allemand Karl Ferdinand Braun.
Pendant cette période, différentes améliorations
techniques furent réalisées. Les circuits résonants,
constitués d’une impédance et d’un condensateur,
furent utilisés pour accorder les appareils.
Les antennes furent améliorées, et leurs propriétés
directionnelles furent découvertes et utilisées. On employa
des transformateurs pour augmenter la tension transmise à l’antenne.
D’autres détecteurs furent développés pour remplacer
le cohéreur, peu pratique en raison de la nécessité
de lui imposer une secousse pour libérer la limaille. On citera
le détecteur magnétique, qui utilisait la capacité
des ondes radio de démagnétiser les fils d’acier ;
un bolomètre, mesurant l’augmentation de température
d’un fil fi n lorsqu’il est traversé par des ondes radio
; la valve de Fleming, le précurseur du tube thermoélectronique
ou tube à vide.
Le développement du tube à vide remonte à la découverte
par l’inventeur américain Thomas Edison qu’un courant
passe entre le filament chaud d’une lampe à incandescence
et une autre électrode de cette même lampe, et que ce courant
passe dans une seule direction. La valve de Fleming n’était
pas foncièrement différente du tube d’Edison. Développée
par le physicien britannique John Ambrose Fleming en 1904, ce fut la première
des diodes, ou tubes à deux électrodes, à être
utilisée dans les matériels radio. Ce tube servit alors
de détecteur, de redresseur et de limiteur.
Un progrès révolutionnaire, rendant possible l’avènement
de l’électronique, fut réalisé en 1906, lorsque
l’inventeur américain Lee De Forest monta un troisième
élément, la grille, entre le filament et la cathode d’un
tube à vide. Le tube de De Forest, qu’il nomma « audion
» mais que l’on désigne de nos jours sous l’appellation
de triode (tube à trois électrodes), ne fut d’abord
utilisé que comme détecteur, mais ses possibilités
comme amplificateur et comme oscillateur furent rapidement découvertes,
et lui donnèrent un rôle décisif. Historiquement,
les développements de la radio et de l’électronique
furent toujours liés.
...
IV
- DISTRIBUTION DE L'HEURE PAR LA TSF
Un service de l’heure pour les horlogers parisiens.
L’unification de l’heure en France ne
date que de 1891. Jusqu’à cette date, en France, chaque ville
avait sa propre heure. Il était midi quand le Soleil atteignait
son point le plus haut.
Pourquoi vouloir transmettre l'heure dans
le monde entier ?
En présence de l’impossibilité de trouver une heure
vraiment « universelle », on pensa alors à se plier
aux exigences solaires : puisque les points de la terre défilent
en vingt-quatre heures devant le soleil, divisons le globe, comme un énorme
melon, en vingt-quatre tranches égales ; décidons que, dans
chacune de ces tranches, on emploiera une seule heure, celle de son méridien
central. Dans ces conditions, quand on passera d’un fuseau dans un
autre, la différence sera exactement d’une heure « ronde
». Il suffira d’avancer ou de reculer d’une heure exactement
la petite aiguille de sa montre : la grande aiguille restera en place,
et les minutes seront les mêmes sur toute l’étendue
de la terre.
Le problème depuis que l'homme naviguait sur les mers était
"Comment déterminer la longitude d’un bateau" ?
La latitude peut être déterminée à partir de
la hauteur du Soleil dans le ciel lorsqu’il culmine, c’est-à-dire
lorsqu’il est midi au Soleil; ceci est connu depuis très longtemps.
En ce qui concerne la longitude, c’est plus complexe. Il faut
utiliser la différence entre l’heure locale et l’heure
de référence.
On se base sur la rotation moyenne de la Terre. Celle-ci tourne, d’ouest
en est, en moyenne de 360° en 24 h, soit 15° par heure ou 1°
tous les 4 minutes. Le proplème en embarquant des pendules mécaniques
à bord des bateaux, on était pas vraiement certain du bon
fonctionnement de la pendule, des pannes mécaniques ...
Alors en 1875, La création de l'observatoire
de la marine au parc montsouris s’inscrit dans un contexte très
particulier pour le Bureau des longitudes. Le Bureau des longitudes
a été institué par la loi du 7 messidor an III (25
juin 1795) afin de résoudre les problèmes astronomiques
que posait, à l’époque, la détermination de
la longitude à la mer.
Chargé dès sa création de la rédaction de
la Connaissance des temps et du perfectionnement des tables astronomiques,
ses missions ont évolué au gré de l’histoire,
par des décrets successifs, mais elles ont toujours comporté
des fins de connaissance scientifique et d’utilisation opérationnelle.
Le Bureau des longitudes a ainsi tenu un rôle de premier plan dans
l’organisation et le développement de l’astronomie en
France, l’adoption du système métrique, la réalisation
d’éphémérides planétaires et lunaires,
l’organisation de grandes expéditions scientifiques de mesures
géodésiques et d’observations astronomiques, ainsi
que la fondation de plusieurs organismes scientifiques, tels que le Bureau
international de l’heure (1919), le Groupe de recherche de géodésie
spatiale (1971) et le Service international de la rotation de la terre
et des systèmes de référence (1988). Le Bureau des
longitudes s’est adapté en permanence aux évolutions
dans les domaines scientifiques qui sont issus de son histoire. Tout en
assumant toujours la responsabilité scientifique des éphémérides
astronomiques de caractère national ayant l’appellation d’«
éphémérides du Bureau des longitudes », le
Bureau fonctionne actuellement comme une académie scientifique
dans le domaine des sciences de l’univers.
À sa création, le Bureau des
longitudes a eu sous sa responsabilité l’Observatoire de Paris,
ainsi que tous les instruments d’astronomie de la nation. À
la suite du décret du 30 janvier 1854, qui a redonné son
indépendance à l’Observatoire de Paris, la composition,
les responsabilités et le fonctionnement de ces deux institutions
scientifiques ont été reprécisées. Puis, le
décret de réorganisation du Bureau des longitudes du 15
mars 1874 a introduit une nouvelle clause concernant la formation des
géographes voyageurs, marins et explorateurs, à qui le Bureau
a été chargé d’assurer, sur demande, une préparation
scientifique nécessaire à l’accomplissement de leur
mission, ainsi que l’étude et la vérification de leurs
instruments. L'observatoire destiné à améliorer et
répandre les techniques de l’astronomie d’observation
dans la marine et développer le goût de l’astronomie
nautique chez les marins est lancée par l’amiral Mouchez.
L’installation d’un observatoire de la marine à Montsouris
marque une étape importante dans les relations entre astronomie
et marine, dans un contexte plus général de diffusion des
connaissances, des méthodes et des pratiques des techniques de
l’observatoire au plus grand nombre des navigateurs. En effet, à
l’époque où cet observatoire est créé,
la navigation astronomique est en pleine mutation méthodologique.
La complexe et fastidieuse méthode des distances lunaires est progressivement
remplacée par la méthode dite de la « droite de hauteur
» qui exige moins d’observations astronomiques délicates
et moins de calculs. De nouvelles tables de navigation voient le jour,
simplifiant ainsi les longs calculs de trigonométrie sphérique.
Les techniques de navigation astronomique développées depuis
la moitié du xviiie siècle vont être bouleversées
par l’apparition de la télégraphie sans fil (TSF)
au début du xxe siècle puis de la radiodiffusion
réduisant ainsi la nécessité d’une astronomie
de pointe.
Enfin, les marins ont aussi à apprendre de nouvelles disciplines
pour conduire leur navire, l’électricité et la science
des machines notamment, ce qui rend plus lourde leur instruction scientifique
et demande de nouveaux aménagements des programmes des écoles
d’hydrographie et des écoles navales. Mais les marins ne seront
pas les seuls concernés par la formation qui sera mise en place
à l’observatoire de Montsouris : les officiers et géographes
de l’armée de terre ainsi que les explorateurs coloniaux compteront
parmi ses visiteurs.
En 1884, la Conférence de Washington avait décidé
de diviser la Terre en 24 fuseaux horaire de 15° chacun, fuseaux
horaires avec le méridien de l’Observatoire de Greenwich comme
origine.
C’est ce système, appelé
système des fuseaux horaires, qui a prévalu pour l’heure
universelle : la France l’a adopté officiellement depuis 1911.
La carte de la planche hors texte en montre la réalisation sur
la surface de la terre entière. Chaque fuseau occupe 15° de
longitude et prend l’heure du méridien qui est à son
centre, le méridien originaire étant celui de Greenwich.
Les pays de petite ou de moyenne étendue adoptent, pour tous les
territoires, l’heure du fuseau correspondant ; ceux qui sont coupés
par plusieurs fuseaux répartissent leurs provinces suivant les
diverses heures des fuseaux qui en coupent la surface la plus grande.
...
Le désengagement de la marine de Montsouris
Dans les années 1890, pour des raisons à la fois politiques
et budgétaires, l’État réorganise progressivement
le ministère de la Marine et des Colonies. La pensée navale
française évolue. La marine semble moins prioritaire sur
une armée de terre qu’il faut entièrement reconstruire
après les désastres de la guerre 1870-1871 et le tribut
qu’il faut encore payer à la Prusse. La politique navale est
en pleine redéfinition, stratégique et politique ; différents
ministères de sensibilités distinctes se succèdent
et entreprennent des actions contradictoires .
L’une des principales conséquences de cette réorganisation
du département de la marine et des colonies est, paradoxalement,
son désengagement de la formation scientifique, technique et professionnelle
des marins, excepté celle dispensée à l’École
navale de Brest et dans les écoles de guerre. Depuis 1886, pour
des raisons principalement budgétaires, l’État s’était
déjà lancé dans une réduction du nombre des
écoles d’hydrographie placées, depuis le xviii e siècle,
sous la responsabilité du ministère de la Marine. Entre
1905 et 1912, ces écoles vont passer sous la tutelle du ministère
de l’Industrie et du Commerce et changer de nom : d’écoles
d’hydrographie, elles deviendront en 1920 les écoles nationales
de navigation maritime. Les professeurs d’hydrographie changent de
statut : d’officiers, ils deviennent fonctionnaires civils.
Par ailleurs, en raison de la mutation technique de la navigation,
l’émergence des techniques de télégraphie
avec et sans fil, et de la radionavigation naissante, l’exigence
d’une formation de pointe en astronomie pour les marins semble moins
se justifier.
C’est ce système, appelé système des fuseaux horaires, qui a prévalu pour l’heure universelle : la France l’a adopté officiellement depuis 1911. . Chaque fuseau occupe 15° de longitude et prend l’heure du méridien qui est à son centre, le méridien originaire étant celui de Greenwich. Les pays de petite ou de moyenne étendue adoptent, pour tous les territoires, l’heure du fuseau correspondant ; ceux qui sont coupés par plusieurs fuseaux répartissent leurs provinces suivant les diverses heures des fuseaux qui en coupent la surface la plus grande.
Mais il restait à « réaliser » cette conception de l’heure universelle, à assurer qu’effectivement, sur toutes les horloges précises de la Terre, l’aiguille des minutes et celle des secondes indiqueraient, au même instant, le même chiffre.
Montsouris vieillit : En quelques
années, la marine se désengage de l’observatoire de
Montsouris.
Devant le recul du principal ministère de tutelle de Montsouris,
la Ville de Paris réduit aussi sa subvention de 3 000 à
2 500 francs en 1901.
C’est à Émile Guyou qu’échoit la redoutable
tâche de devoir gérer les conséquences dramatiques
de ce désengagement de la marine de Montsouris : comment justifier
alors l’existence d’un tel établissement dont l’objectif
initial était la formation des officiers de marine ? Certes un
très grand nombre d’explorateurs et d’ingénieurs
sont déjà venus se former mais il faut trouver d’autres
ressources et d’autres activités. Émile Guyou va donc
tenter de développer et diversifier les activités de l’observatoire
de Montsouris .
Entre formation et science : la nouvelle « école pratique
d’astronomie » du commandant Émile Guyou.
Depuis le vote du parlement en mars 1902 qui supprimait les subventions
de la marine à Montsouris, le fonctionnement de l’observatoire
devient très délicat. Après l’échec de
l’école d’astronomie de l’Observatoire de Paris
que Mouchez avait mise en place en 1879, Guyou rappelle au Bureau en 1902
que Montsouris demeure la seule école pratique d’astronomie
existante. Si l’on envisage le problème de la surveillance
et de la garde des instruments, qui étaient auparavant assurée
par un retraité de la marine, de la réaffectation et du
réaménagement des locaux, les besoins s’élèvent
à un budget annuel de 6 500 francs. L’aide de la Ville de
Paris ayant été réduite à 2 500 francs, l’apport
du Bureau s’élevant à 3 000 francs, le budget actuel
de 5 500 francs s’avère insuffisant au fonctionnement de l’observatoire.
Le personnel d’encadrement est ainsi brutalement réduit :
ne restent qu’un astronome chargé du service scientifique
et administratif et un employé unique pour le service d’entretien
et d’assistance aux observateurs. À l’aide d’allocations
secondaires, la marine payait les dépenses de chauffage, d’éclairage
des bureaux de leur équipement, pour une somme d’environ 900
francs. Le Bureau des longitudes, disposant lui-même de ressources
limitées et devant assurer prioritairement la parution de la Connaissance
des temps et de son Extrait, ne peut pas prendre en charge le surcoût
occasionné par le départ de la marine de Montsouris.
Émile Guyou doit donc gérer la pénurie de moyens
et assurer une certaine reconversion de l’observatoire : «
Il faut donc, ou organiser l’établissement sur de nouvelles
bases ou se résigner à sa suppression » . Sous la
direction de Guyou, Montsouris reprend son intitulé non officiel
et sa vocation d’« École d’astronomie pratique
de l’observatoire de Montsouris » . Son rôle sera désormais
clairement de développer les applications de l’astronomie
à la géographie, d’assister les géographes et
les explorateurs pour le maniement des instruments portatifs et d’accueillir
les étudiants en astronomie de la Sorbonne.
En 1903, le Bureau des longitudes détache Auguste Claude
(1858-1938), employé au service des calculs, comme conservateur
des instruments et instructeur pour les observations et les calculs faits
à Montsouris. Il recevra de temps en temps l’aide de l’astronome
de l’Observatoire de Paris Guillaume Bigourdan. Guyou décide
aussi de rédiger un rapport annuel sur la situation de l’observatoire
au 1er novembre de chaque année.
Montsouris est encore, temporairement, un lieu de science.
Les distances lunaires pour la détermination des longitudes sont
depuis longtemps tombées en désuétude et Guyou lui-même
est l’un des artisans de la suppression de ces tables dans la Connaissance
des temps et de son Extrait, qu’il dirige au sein du Bureau des longitudes.
Il en va de même avec les méthodes qui ont, dès les
années 1870, remplacé les distances lunaires. Le «
point Marcq Saint-Hilaire » et la « droite de hauteur »
sont aussi en passe d’être mis au panthéon des méthodes
oubliées ou obsolètes, devant l’arrivée des
nouveaux moyens technologiques que sont la télégraphie sans
fil et le téléphone : les premières stations de radionavigation
maritimes sont opérationnelles dès 1904 sur la côte
atlantique française.
(Le premier essai de communication sans fil a lieu en 1898 dans la rade
de Brest et est l’œuvre d’un professeur à l’École
navale, le lieutenant de vaisseau C. Tissot. Marconi réalise plusieurs
essais en mer entre 1897 et 1899 à bords de navires de guerre britanniques.)
Guyou et Claude s’attachent à mettre à jour leurs pratiques
et leur enseignement ; ils sont aussi inventeurs et promoteurs de nouvelles
méthodes de navigation. Mais il leur faut trouver de nouvelles
sources de financement extérieures au Bureau des longitudes.
sommaire
C'est d'abord Guillaume Bigourdan qui a eu, au début du
siècle, l’idée de relier les horloges par la
télégraphie sans fil, à l’aide d’un
éclateur connecté à une grande antenne et rayonnant
une onde électromagnétique.
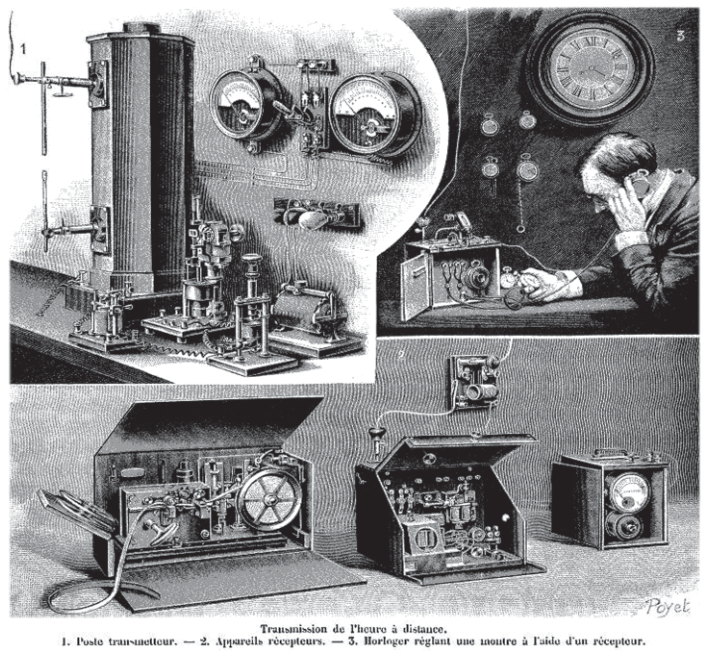
Après des essais fructueux réalisés par Bigourdan
à Montsouris, les applications de ce système se tournent,
dès 1904, vers la mise à l’heure des chronomètres
de marine .
En 1903, le général Gustave Ferrié perfectionne
la télégraphie sans fil (TSF) en inventant un nouveau récepteur
électrolytique associé à sa proposition d'installation
d'une antenne au sommet de la tour Eiffel, donnant ainsi avec cette utilisation
une raison supplémentaire pour le non-démantèlement
de la tour, qui était prévu à la fin de l'Exposition
universelle de Paris de 1889.
La Chronologie en 1904
| Sur la distribution de l'heure à distance
ait moyen de la télégraphie électrique sans
fil. — Un grand nombre de villes ont fait installer des appareils
qui distribuent la même heure dans tous les quartiers. A
Paris, par exemple, quinze horloges, reliées à l'Observatoire
par des fils électriques, sont disséminées
dans les divers arrondissements et donnent partout l'heure du premier
méridien français. En raison même des circuits qu'il a été nécessaire d'établir, ce système est coûteux et d'un usage limité. Ces inconvénients peuvent être beaucoup atténués aujourd'hui par la télégraphie électrique sans fil, dont l'emploi permet de simplifier considérablement l'envoi de l'heure à distance. M. Bigourdan a fait dans cette voie quelques essais qu'il a fait connaître par la note ci-après qu'il a adressée à l'Académie des Sciences. Une horloge directrice, ouvrant un contact électrique à chaque seconde, commande un relais qui, à son tour, lance un courant dans le circuit primaire d'une bobine d'induction munie d'un oscillateur; le circuit induit de cette bobine fournit ainsi une décharge oscillante de durée très courte qui éclate régulièrement à chaque seconde. Les deux pôles du fil fin de la bobine sont reliés, l'un à la terre, l'autre à une antenne de quelques mètres. Par le moyen de cette antenne, les étincelles commandent à distance des récepteurs d'ondes électriques, et ainsi tous ces récepteurs battent, à un intervalle constant près, chaque seconde de la pendule directrice. J'ai essayé deux récepteurs différents ; le plus simple est un radiotéléphone du système Popoff-Ducretet. On y entend très nettement chaque seconde battue par la pendule directrice. Le second, qui est inscripteur, se compose d'un poste récepteur ordinaire de télégraphie sans fil ; pour avoir des signaux plus nets, j'y ai parfois remplacé le récepteur Morse par un chronographe à bande et à plume. Avec ce chronographe, qui débite environ 1 cm. de bande par seconde, les signaux obtenus sont bien nets, et l'heure de chacun d'eux peut être relevée à 2/100 ou 37/100 ièùe de seconde près. Quoique les moyens employés dans ces essais fussent bien modestes, on obtenait une très bonne transmission dans une station éloignée de 2 km., et certainement on aurait pu aller à une distance notablement plus grande s'il avait été facile d'y installer des appareils de réception. Aussi nous paraît-il hors de doute qu'avec des moyens peu coûteux on pourrait distribuer ainsi l'heure dans tous les points de Paris et même de la banlieue. Pour numéroter les . minutes et secondes, on conviendrait de commencer les émissions à la seconde zéro de telle minute et de faire des interruptions, par exemple, de 10 en 10 secondes. D'ailleurs, pour la minute, il ne saurait y avoir d'erreur, car lorsqu'on a besoin de l'heure exacte, on dispose généralement de garde-temps qui ne laissent aucune incertitude de plus de quelques secondes. Il est inutile d'insister sur les avantages que présenterait cette distribution de l'heure, non seulement pour les usages de la vie courante, mais surtout au point de vue scientifique et industriel ; par ce moyen, les laboratoires, les établissements scientifiques en général, les horlogers, les constructeurs d'instruments de précision, etc., pourraient, sans déplacement, avoir l'heure avec la plus grande exactitude. Parmi les opérations scientifiques appelées à bénéficier immédiatement de ce mode de transmission de l'heure, on peut citer les déterminations de l'intensité de la pesanteur avec le pendule et même les déterminations de longitudes, surtout quand la portée de la télégraphie sans fil aura été augmentée. Pour les usages courants, la précision demandée ne dépasse pas 0,3 à 0,4 seconde, et, comme il est relativement facile de maintenir au-dessous de cette quantité la correction d'une pendule, celle-ci servirait à distribuer l'heure qui serait dite sans correction. Mais quand on voudrait la plus haute précision, on ferait distribuer l'heure par l'horloge même sur laquelle on observe les passages des étoiles ; alors on pourrait donner immédiatement la correction approchée de cette horloge, et l'on ferait connaître plus tard sa correction exacte, quand on aurait réduit les observations astronomiques destinées à donner cette correction avec précision. |

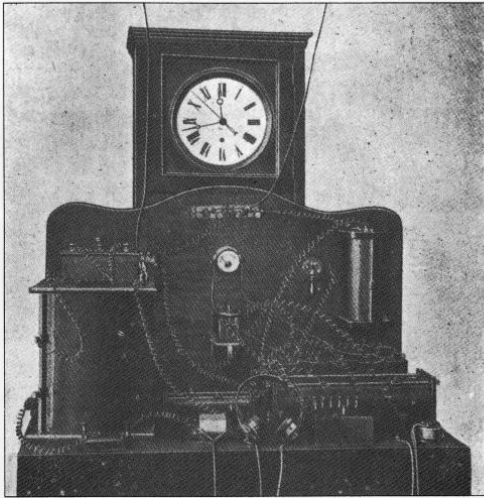 Modèle 1910 du livret "TSF Traité pratique ..."
Modèle 1910 du livret "TSF Traité pratique ..."
 |
Les premiers utilisateurs de cette
"nouvelle technologie" sont les horlogers, qui s'enorgueillissent
de pouvoir régler les montres et horloges de leurs clients
sur l'heure exacte de l'observatoire de PARIS. Ainsi un célèbre horloger d'AMBOISE (Indre et Loire), Abel GODY, construit pour lui-même et quelques confrères des récepteurs horaires. Ayant acquis une certaine notoriété dans le domaine, il fondera en 1912 sa propre entreprise et fabriquera des récepteurs réputés jusqu'en 1955. |
Guyou fait valoir l’équipement de l’observatoire de Montsouris,
tout désigné pour assurer ce service.
Pour un abonnement de 1 200 francs, Guyou propose que l’heure serait
donnée « par l’adaptation d’un microphone faisant
entendre les battements du régulateur ; la voix donnerait la minute
et le numérotage des premières secondes ». Une personne
serait de permanence pour répondre aux abonnés. Les démarches
sont entreprises entre la chambre syndicale et le ministère de
l’Instruction publique pour que Montsouris soit équipé
du téléphone en plus de la télégraphie avec
et sans fil.
Courant 1905, tout se met en place
malgré des travaux toujours plus nombreux à réaliser
dans l’observatoire ; les quatre pendules en service sont conservées
dans une pièce insalubre qui nuit à leur fonctionnement.
Plusieurs essais ont lieu sur le réseau parisien puis sur le réseau
général français. L’heure est transmise au service
des chronomètres de la marine et à plusieurs horlogers de
précision. La marine profite pleinement de ce service : le 25 mai
1905, un contre-torpilleur basé à Brest peut régler
ses chronomètres sur le pendule de l’observatoire de Montsouris.
Le lendemain, le lieutenant E. Perret, directeur de l’observatoire
de la marine à Lorient, effectue une comparaison de son heure à
celle de Montsouris : la différence de longitude adoptée,
les pendules des observatoires de Lorient et de Montsouris sont d’accord
à 0,15 seconde près.
sommaire
Mais toutes ces idées ne connaîtront pas le succès
escompté. Les systèmes de diffusion de l’heure ne seront
pas installés à Montsouris ; c’est l’Observatoire
de Paris qui héritera dès 1908 de tous les systèmes
d’essais de diffusion de l’heure et de détermination
des longitudes par TSF.
La première activité de la TSF a été la radiotélégraphie.
La transmission était faite en morse.
La première contribution de la TSF à la sécurisation
de la navigation remonte sans doute à 1899. Le East Goodwin lightship,
un bateau-feu équipé d'une installation de télégraphie
sans fil Marconi lança un message de secours après sa collision
avec le R.F. Matthews qui permis l'assistance d'un bateau qui croisait
dans les environs et sauva des vies humaines.
La réception d'une heure de référence à bord
des navires va permettre un recalage des chronographe et une amélioration
considérable de la précision de la navigation.
Les signaux horaires automatiques sont envoyés
par un dispositif spécial installé dans la salle des pendules
de l'Observatoire de Paris.
Des signaux analogues sont envoyés par divers postes étrangers
par le Bureau international de l'heure. Les émissions sont exécutées
par ondes amorties musicales. Les signaux horaires scientifiques ou rythmés
sont effectués à l'aide de battements, chacun de une seconde
sidérale, moins 1/50 de seconde sidérale. Ces battements
sont écoutés à l'Observatoire de Paris et sont radiotélégraphies
par le poste lui-même. On peut à l'aide de ces indications
déterminer à 1/100 de seconde de temps près la longitude
d'un lieu où l'on détermine directement l'heure sidérale
locale.
L’action de Mouchez est relayée
par le commandant Émile Guyou qui a tenté de sauver l’activité
de l’observatoire malgré des contraintes administratives fortes
pendant les années 1896-1910.
L’observatoire a continué de remplir sa mission originelle
: former plusieurs générations d’officiers de marine
et de l’armée de terre, d’explorateurs coloniaux et d’ingénieurs
divers. Sous la direction de Guyou, l’observatoire de Montsouris
et le Bureau des longitudes ont été impliqués dans
des développements scientifiques importants : la diffusion de l’heure
par télégraphie sans fil, les longitudes par le téléphone,
les essais sur l’emploi de l’Invar pour la conception de nouvelles
horloges astronomiques toujours plus fiables, le développement
de l’astrolabe à prisme, instrument de campagne destiné
aux voyageurs géographes et aux officiers de la marine et de terre.
De nouveaux choix scientifiques, de nouvelles contraintes administratives
et matérielles ont conduit à l’abandon rapide de cet
observatoire en tant que lieu de science à partir des années
1920.
sommaire
DEBUT DE LA TRANSMISSION DE L’HEURE PAR
T.S.F.
Le 30 novembre 1908, le ministre de la marine, convaincu des premiers
essais et conscient des avantages que la marine pourrait tirer de ce nouveau
service, avisait l'Académie des Sciences que la station radio télégraphique
du Champ de Mars était autorisée à recevoir les appareils
de transmission de signaux horaires.
Le lieutenant de vaisseau Camille TISSOT est chargé de la création
d'un service de transmission de l'heure par TSF.
La diffusion de signaux horaires bénéficie de ces progrès
pour s’effectuer sur des distances de plus en plus grandes.
En liaison avec le Bureau des longitudes, Ferrié met ses
connaissances de la TSF au service de la standardisation de l'heure sur
tout le territoire français : à partir de 1910, l'émetteur
de la tour Eiffel émet à intervalles réguliers des
signaux qui permettent de rectifier l'« indication des horloges
dans les différentes provinces »
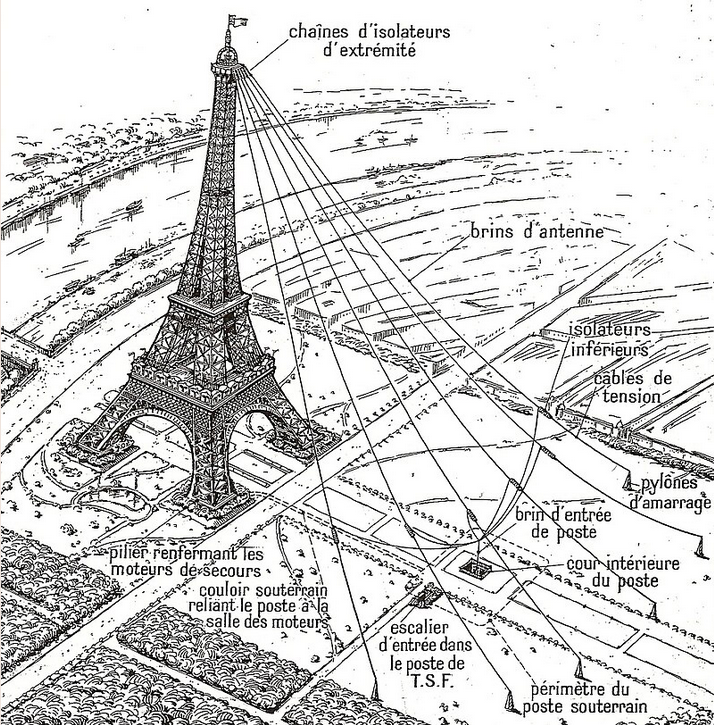
Le 23 Mai 1910, la station radiotélégraphique du
Champ-de-Mars transmet l’heure du méridien de Paris à
la moitié du monde. C'est le début du service régulier
de transmission de signaux horaires depuis la Tour Eiffel. Elle émet
avec une puissance de 20 à 60 kW, les signaux horaires sur 2600
m. (soit 115 kHz). Ce système permet aux navires de recaler leur
chronomètre et ainsi de déterminer avec précision
leur position en longitude.
La Conférence Internationale de l’Heure qui s’est tenue
à l’Observatoire de Paris du 15 au 23 Octobre 1912 (6 mois
après le drame du TITANIC) va normaliser le découpage de
l'heure suivant les fuseaux horaires et fixer définitivement le
méridien de Greenwich comme référence universelle.
La station radiotélégraphique reliée à l'horloge
de référence de l'Observatoire de Paris va transmettre l'heure
exacte deux fois par jour : à midi et minuit. On voit immédiatement
les avantages de cette méthode. La portée actuelle des ondes
longues émises par la Tour Eiffel est de 6 500 kilomètres
environ. Les signaux envoyés par la Tour pourront donc rayonner,
non dans une direction unique, mais dans toutes les directions dans la
limite de cette portée considérable.
La France abandonne le méridien de Paris et s’aligne sur celui
de Greenwich (temps universel). Les pendules de tout le territoire français
sont retardées de 9 minutes et 21 secondes.
Plusieurs pays vont reprendre les propositions de la France de transmission
de l'heure par radiotélégraphie.
Dès 1908, le poste Marconi de Camperdown près de Halifax
transmet des signaux horaires qui permettent aux bateaux de régler
leur chronomètre à plus de 250 miles au large du Canada.
En 1912, la station radiotélégraphique navale d'Arlington,
transmet des signaux horaires sur l'Atlantique Nord et le continent américain,
en provenance de l'observatoire de Washington.
1912, le Bureau International de l’Heure (BIH) installé
à l'Observatoire de Paris a pour mission de déterminer les
paramètres qui définissent l'orientation de la Terre pour
les analyses de stations d'observation.
La volonté politique d'imposer une heure légale est atteinte,
il reste à l'harmoniser sur tout le territoire.
Cela commence dans les grandes villes françaises, qui pour la plupart,
ont encore deux heures, celle de Paris et la leur, avec parfois, des différences
de quelques minutes entre deux villes françaises situées
à quelques kilomètres l'une de l'autre.
Dès lors, il ne restait plus qu’à réglementer
l’envoi de l’heure par T. S. F. C’est ce que fit la Conférence
de 1912 et celle qui vient de se réunir à nouveau en octobre
1913. Il a été décidé, d’abord, de créer
à Paris un Bureau international de l'heure, qui devra centraliser
les observations laites par tous les observatoires correspondants.
1913 L'astronome français Guillaume, est nommé premier
Directeur du BIH. Il réalise quelques expériences préliminaires
à l'aide d'appareils construits par MM. DUCRETET et ROGER à
partir de la station du Parc MONSOURIS à PARIS.
La généralisation du service de l’heure, de cette façon,
ne comporte plus de limite, les signaux étant reçus par
les observatoires, par les stations de T.S.F., par les navires et même
par les simples particuliers. Les résultats en furent confirmés
par la détermination précise des différences de longitude
entre Paris et Bizerte et entre paris et Washington.
Dès lors, il ne restait plus qu’à réglementer
l’envoi de l’heure par T.S.F. C’est ce que fit la Conférence
de l’année 1912 et celle qui vient de se réunir à
nouveau en octobre de l’année 1913. Il a été
décidé, d’abord, de créer à Paris un
Bureau international de l’heure, qui devra centraliser les observations
faites par tous les observatoires correspondants.
Ce n’est pas trop, en effet, de plusieurs observatoires pour avoir,
à chaque instant, l’heure la plus exacte. Si l’observatoire
de Paris pouvait, chaque jour, observer les astres, il connaîtrait
rigoureusement la marche de sa pendule. Mais les jours nombreux où
le ciel est nuageux, les observations astronomiques sont impossibles.
Heureusement, le ciel n’est pas couvert à la fois sur toute
la terre, et les observatoires plus favorisés peuvent envoyer par
télégramme, à Paris, le résultat de leur observation
de l’heure : le Bureau central en déduit, alors, l’heure
la plus probable, et, à son tour, par l’intermédiaire
de la Tour Eiffel, il la fera connaître aux stations correspondantes.
A cet effet, on a désigné un certain nombre de postes radio-télégraphiques
puissants pour émettre, deux fois par jour, à des heures
« rondes » déterminées, des signaux horaires
analogues à ceux de la Tour, dont ils auront, eux-mêmes,
reçu l’heure exacte :
Voici ces stations, avec l’indication des heures où elles
émettent leurs signaux :
Paris (Tour Eiffel), minuit ou 00
San-Fernando (Brésil) 02
Arlington (Etats-Unis) 03
Mogadiscis (Somalie italienne) 04
Manille (Phillipines) 05
Tombouctou (Soudan) 06
Paris (Tour Eiffel) 10
Norddeich (Allemagne), midi ou 12
San-Fernando (Brésil) 16
Arlington (Etats-Unis) 17
Massouah (Erythrée) 18
San-Fransisco (Etats-Unis) 20
Norddeich (Allemagne) 22
Quant aux modes d’émission des
signaux, ceux-ci sont faits dans les trois dernières minutes de
l’heure qui précède l’heure indiquée par
le fuseau, Voici les raisons qui ont milité en faveur de cette
combinaison.
Évidemment, un point bref et sec est un signal facile à
percevoir et à noter exactement, surtout quand on est prévenu
de son arrivée prochaine par une série de signaux dits «
d’avertissement ».
Mais nous avons vu qu’il existe en permanence, dans l’atmosphère,
des signaux parasites dus aux orages, aux manifestations électriques,
aux courants telluriques et à d’autres causes sans doute inconnues
ou même insoupçonnées. Le résultat pratique
de ces causes dépendantes d’ondes diverses se traduit, dans
le téléphone, par des crachements, des bruits rauques, analogues
au bruit de « friture » des téléphones. Ces
crachements, secs et brefs eux-mêmes, peuvent parfaitement masquer
les signaux formés eux-mêmes d’un point sec et bref,
tandis qu’ils ne masqueront pas un trait, d'une durée d’une
seconde, qui continuera d’être perçu nettement, surtout
s’il provient d’un poste à émission musicale,
c’est-à-dire donnant une note de hauteur donnée. L’opérateur
apprécie alors soit le commencement, soit la fin du trait, et si
celui-ci dure exactement une seconde, l’appréciation du signal
horaire se fait avec toute la précision désirable.
ENVOI AUTOMATIQUE DES SIGNAUX HORAIRES.
Quand la Conférence de l’heure décida d’émettre
des signaux horaires, il devint évident qu’il était
difficile de charger un observateur unique d’émettre, à
la main, cette longue série de signaux : cela eût exigé
de lui qu’il observât, d’une part, la pendule et que,
d’autre part, il actionnât un manipulateur. Il fut donc décidé
que des appareils spéciaux seraient mis à l’étude,
pour permettre à la pendule directrice de l'Observatoire d’envoyer
elle-même, automatiquement, les signaux radiotélégraphiques
suivant la règle adoptée pour le service international de
l’heure.
C’est l’ingénieur français Édouard
Belin qui a résolu le problème de la façon la plus
élégante et la plus précise, par son appareil émetteur
de signaux horaires, qui fonctionne à l’Observatoire de Paris
depuis le 31 juillet 1913.
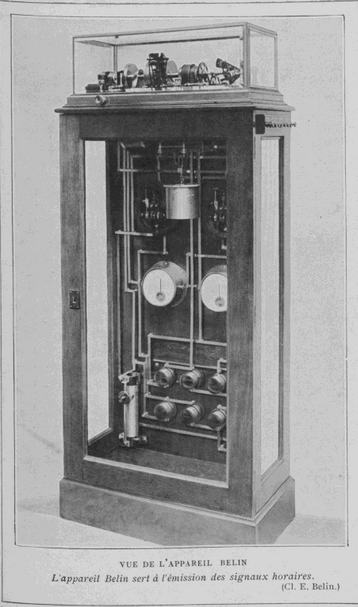
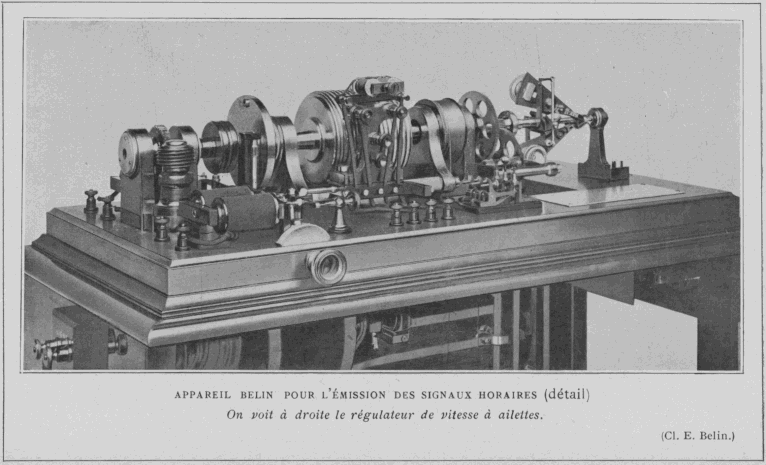
L'appareil Belin sert à l’émission des signaux horaires.
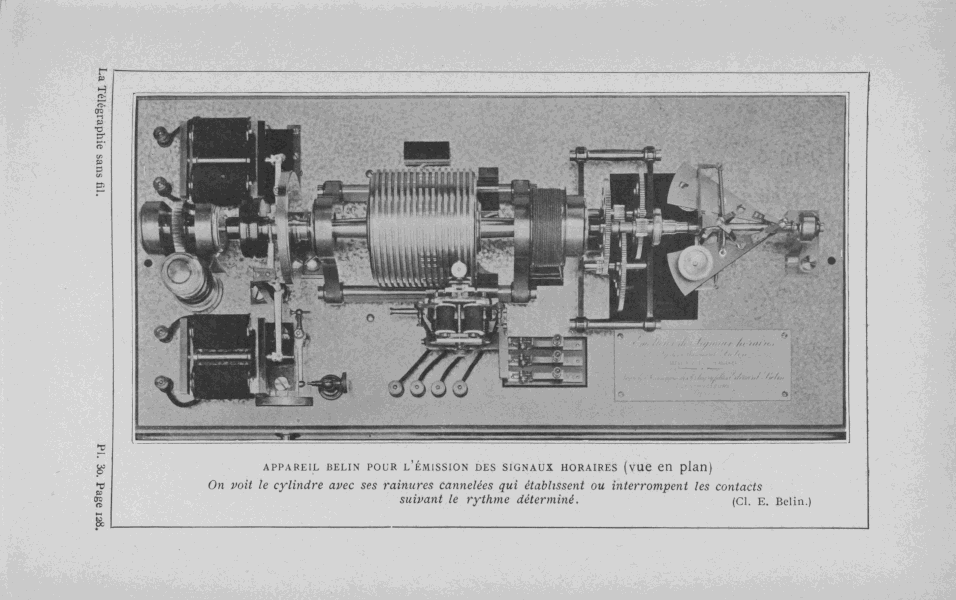 ...
...
On voit le cylindre avec ses rainures cannelées qui établissent
ou interrompent les contacts suivant le rythme déterminé.
Cet appareil met en jeu une énergie locale : celle
d’un Poids moteur, qui est simplement déclenché par
la pendule, à l’aide d’un contact électrique,
au moment voulu. La chute de ce poids met en marche, avec une vitesse
rigoureusement uniforme, maintenue constante par un régulateur
centrifuge de haute précision, un cylindre sur lequel sont des
disques « distributeurs de signaux ». Ces disques Portent,
sur leur circonférence, des dents espacées suivant les Intervalles
qui séparent les points et les traits des signaux horaires, et
un contact, au moment où ces dents passent devant lui, actionne
un relais et émet directement les signaux horaires par l’intermédiaire
des ondes électriques de la Tour Eiffel avec laquelle l’appareil
est relié par une hgne télégraphique directe.
Ce qu’il y a de remarquable dans cet appareil, c’est qu’il
n’est ni une pendule, ni un garde-temps. C’estun engin automatique
qui se met en mouvement par la commande précise d’une pendule
directrice ou intermédiaire synchronisée, munie de dispositifs
convenables de déclenchement. Il ne nécessite normalement
aucune mise à l’heure spéciale, et son fonctionnement
est exact si la pendule directrice est, elle-méme, rigoureusement
mise à l’heure.
Le système, purement mécanique, est synchronisé toutes
les dix secondes par une pendule produisant une rupture de circuit toutes
les deux secondes : le moment de la fonction de synchronisme a été
choisi entre les signaux, et 1'arrêt qui se produit à cet
instant n’est perceptible que pendant les appels. On peut ainsi s’assurer
de la régularité de marche de l’appareil avant l’émission
des signaux horaires proprement dits. Du reste, bien que le régime
de marche des cylindres distributeurs de signaux ne soit pas modifié,
il a cependant été tenu compte du temps d’arrêt
de synchronisme lors de la construction, et la précision exacte
est rigoureusement entretenue.
L’émission est produite par l’ouverture brusque d’un
interrupteur de haute précision, dont le fonctionnement ne nécessite
qu’un effort négligeable, incapable d’apporter à
la marche de l’appareil la plus petite perturbation. Quand cette
émission est terminée, le poids moteur est automatiquement
remonté par un moteur électrique dont la mise en route est
réglée par un contact de « fin de course »,
et l’appareil revient de lui-même à sa position d’origine.
A ce moment, tous les circuits sont automatiquement coupés, et
l’appareil, remis à l’heure pour l’envoi suivant,
ne consomme, entre temps, absolument rien. Ramené à l’insensibilité
complète, il ne risque, entre deux séries d’émission,
ni dérangement ni déréglage.
La mise à l’heure peut être assurée avec une
précision toute particulière de l’ordre du millième
de seconde. Elle peut être effectuée soit à l’arrêt,
soit pendant la marche, par la manœuvre d’un bouton extérieur,
et la lecture se fait sur un tambour micrométrique. La durée
absolue des signaux peut, s’il est nécessaire, être
modifiéepar un bouton à division micrométrique.
Le fonctionnement de l’appareil est assuré par deux petites
batteries d’accumulateurs, qui, pour une capacité de 20 ampères-heure,
doivent être chargées seulement deux ou trois fois par mois.
La première, de 8 volts, est destinée aux relais ; la seconde,
de 12 volts, est destinée à l’électro-aimant
de synchronisme ainsi qu’au moteur qui sert à remonter le
poids.
Enfin, ajoutons que, indépendamment des signaux d’appel et des signaux horaires prévus par la Conférence, l’appareil peut envoyer, pendant la minute précédente, des signaux préalables facultatifs ayant chacun la durée d’une seconde ronde. Ces signaux, destinés au contrôle des relais et aux réglages qui pourraient sembler nécessaires, ne sont émis que si l’on presse sur un bouton extérieur à l’appareil, et tant que l’on presse sur ce bouton : il est ainsi impossible de commettre le moindre oubli, et ces signaux spéciaux ne risquent, en aucun cas, d’être émis involontairement.
Tel est, dans ses grandes lignes, l’appareil émetteur
de signaux de l’ingénieur Édouard Belin. Il a été
placé à l’Observatoire de Paris, le 28 juillet 1913
; une vérification de son fonctionnement fut faite le lendemain,
29 juillet, et, en raison de la précision du résultat, l’appareil
fut mis en service effectif le 31 juillet. Depuis ce jour, l’appareil
a assuré le service de l’heure sans nécessiter la moindre
retouche technique de la transmission des signaux Horaires,
Enfin, disons un mot des conditions techniques dans lesquelles ces signaux
sont envoyés : car il ue suffisait pas d’unifier le mode de
leur envoi, mais il fallait réglementer du même coup les
caractéristiques de leur émission au point de vue radiotélégraphique.
Il fallait, d'une part, faciliter à tous la réception de
l’heure en permettant l’installation de récepteurs aussi
simples que possible et d’un prix de revient aussi réduit
que possible. Il était nécessaire, d’autre part, afin
d’éviter la perturbation provenant d’ondes similaires,
de décider l’adoption d’une ou de plusieurs longueurs
d’onde déterminées pour trans-niettre les signaux horaires.
La Conférence de l’heure s’est rangée à
l’avis le plus simple : celui de l’adoption d’une longueur
d’onde unique de 2500 mètres.
Certes il eût pu paraître désirable d’employer,
pour les signaux horaires, une longueur d’onde plus courte, dans
le but de faciliter leur réception par les navires qui fonctionnent
habituellement avec la longueur d’onde de 600 mètres; niais
il faut bien remarquer que le matériel radiotélégraphique
s’est grandement perfectionné pendant les dernières
années : on ne peut plus considérer l’emploi d’ondes
de grande longueur comme une complication, et l’on peut toujours
organiser à bord les dispositifs nécessaires à leur
réception. D’autre part, ces ondes de grande longueur ont
bien des avantages : elles se propagent plus loin et mieux, surtout dans
les pays tropicaux, où, au cours de la journée, les ondes
courtes sont vite atténuées.
Enfin, grâce à l’étude que nécessite la
transmission précise des signaux horaires à grande distance,
des expériences décisives vont être instituées
pour élucider diverses parties encore obscures en matière
de T. S. F., en particulier sur le rôle, encore bien mal connu,
de l’antenne : les expériences faites en Allemagne, où
l’on a pu recevoir les ondes de Glace-Bay, au Canada, simplement
avec des fils nus couchés par terre, montrent qu’il y a encore
beaucoup à apprendre dans cette voie.
Ce sera la Conférence de l’heure qui aura eu le mérite
de tracer la route à suivre.
Quoi qu’il en soit, les avantages de la transmission radio-télégraphique
de l’heure commencent à éclater à tous les yeux;
on commence à s’en préoccuper dans divers pays, et
notamment chez nos voisins les Belges : à la date du 21 février
dernier, le ministre des postes et télégraphes vient de
décider l’organisation régulière de la transmission
de l’heure effective deux fois par jour par la station de la Tour
Eiffel. A cet effet, trente-quatre bureaux de télégraphe
vont être munis d’antennes et de postes de réception
des signaux. Ces bureaux pourront ainsi recevoir les signaux horaires
leur fournissant l’heure exacte et transmettre cette heure, télégraphiquement
cette fois, aux bureaux secondaires
Pendant la Première Guerre mondiale,
Ferrié développe la radiotélégraphie
pour les unités d'infanterie et d'artilleurs et devient ainsi l'un
des artisans de la victoire de 1918. Cette démarche est concrétisée
en mars 1918 par sa nomination, par l'intermédiaire du général
Henri Mordacq, à la tête de l'Inspection des télégraphies
militaires. Concrètement, dès 1914, il propose des modifications
techniques permettant un meilleur échange entre l'émetteur
et le récepteur, doté d'une triode. Durant la guerre, ses
postes de radio sont construits à plus de 10 000 exemplaires.
Lorsque les États-Unis entrent en guerre en 1917, le plan des installations
de l'émetteur de Lafayette est confié au colonel Ferrié,
dans le cadre de la Radiotélégraphie militaire française.
Le Bureau International de l'Heure (BIH) crée en 1919 à
la suite de la première assemblée générale
du Conseil International des Recherches, fonctionne depuis cette date
à l'Observatoire de PARIS.


Poste opérateur de la tour Eiffel.
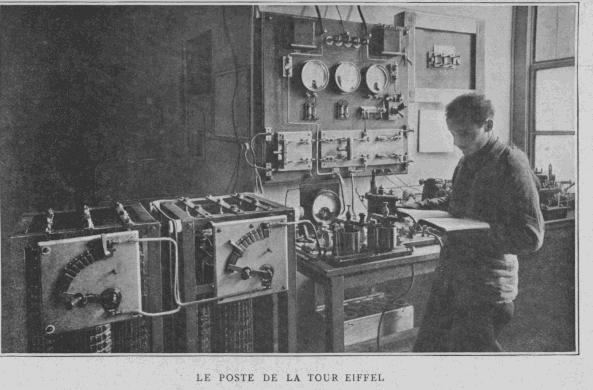
1924 L'horloge de la remise à l’heure automatique
par les signaux horaires, construite par M. Lipmann.
Disons d’abord que les horloges électriques Lip sont à
remontage automatique simple par le courant de lumière. L’horloge
comprend deux parties distinctes : le rouage et le mécanisme électrique
de remontage. Le premier est constitué comme un rouage ordinaire
; il porte en plus, sur le barillet, un dispositif spécial qui
commande un contact chargé de fermer le circuit électrique
toutes les quatre heures, six heures ou vingt-quatre heures, à
volonté. L’échappement à ancre, adopté
pour ces horloges, a l’avantage de pouvoir fonctionner dans toutes
les positions.
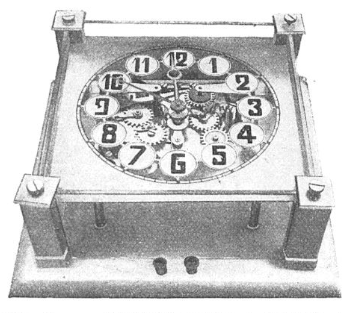
HORLOGE LIP DE REMISE A L’HEURE AUTOMATIQUE PAR LES SIGNAUX HORAIRES
DE LA TOUR EIFFEL.
Le mécanisme électrique de remontage comprend un moteur
universel pouvant marcher sur courant continu ou sur courant alternatif
à tous voltages au-dessus de 90 volts. Le moteur entraîne
le barillet lorsque celui-ci l’a mis en circuit. Une horloge ainsi
construite peut marcher soixante-douze heures consécutives sans
remontage. Si le remontage s'effectue automatiquement, toutes les vingt-quatre
heures, par exemple, il reste constamment une réserve de marche
de quarante-huit heures, qui permet, si, pour une cause quelconque, le
courant vient à manquer au moment du remontage, d’assurer
la marche normale jusqu’au prochain remontage Pour remettre à
l’heure ces horloges par les signaux horaires de la tour Eiffel,
à 9 h. 26’ 30”, un relais retardé spécial
suffit. Afin de les soustraire à toutes les autres émissions
d’une durée égale à 5 secondes, le mécanisme
ferme lui-même le circuit des lampes amplificatrices quelques minutes
avant l’heure officielle, puis le coupe immédiatement après
la remise à l’heure en remettant l’antenne à la
terre. Dans le cas où, pour une raison quelconque, la remise à
l’heure par T. S .F. n’aurait pu s’effectuer, la pendule
coupe elle-même le circuit et remet l’antenne à la terre.
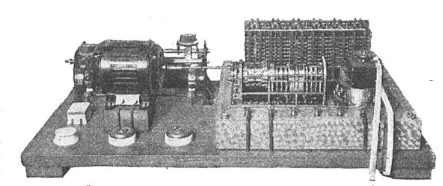
Le morse imprimeur de M. R. Pénot est une vraie petite merveille,
qui fera, plus tard, l’objet d’une étude approfondie.
En voici le principe :
Rappelons d’abord qu’en télégraphie sans fil,
on utilise, à la réception, divers appareils enregistrant
les signaux Morse soit sur des cylindres de phonographe, soit sur des
bandes de papier, soit sur des films photographiques. Ces signaux, reçus
à une très grande vitesse, sont ensuite traduits par les
opérateurs à des vitesses réduites. Un autre appareil,
le Çreed, que nous avons décrit ici même, traduit
les signaux en une bande perforée, laquelle les transforme ensuite
en caractères typographiques.
L’appareil Pénot se distingue de ce dernier en ce sens que
la traduction en caractères d’imprimerie s’effectue directement
à la réception. Dès qu’un signal, qui peut comporter
jusqu’à cinq points ou traits, est terminé, le «traducteur
» l’imprime aussitôt sur la bande, et cela quelle que
soit la vitesse d’émission. Toute perte de temps entre la
réception et la traduction est donc supprimée, avantage
énorme qui permet de rectifier, pour ainsi dire instantanément,
toutes les erreurs.
Trois organes interviennent : un régulateur qui prend la vitesse
de l’appareil d’émission et qui reçoit les signaux
par l’intermédiaire de l’antenne, des amplificateurs
et de relais ; un sélecteur-distributeur dans lequel s’effectue
la classification des points et des traits constituant chaque signal Morse
; enfin, un «traducteur » com mandé électri
quement par le distributeur et transforma nt les signaux Morse en lettres
ou chiffres imprimés sur une petite bande de papier.
1929, une horloge à pression
constante.
Cette horloge de haute precision développée par le fabricant
français Leroy est installée dans une salle souterraine
creusée à 5 mètres sous la bibliothèque de
l’Observatoire de Besançon afin de garantir une température
stable. Elle participe avec d’autres Observatoires à la constitution
d’un réseau du temps.
1956, le Temps Universel (TU).
Le Comité International des Poids et Mesures (CIPM) propose la
nouvelle définition de la seconde dite "secondes éphémérides".
On définit ainsi le Temps Universel (TU) comme le temps solaire
moyen de Greenwich augmenté de 12 heures : lorsqu’il est midi
TU, il est 0 heure GMT. Basée sur
la rotation de la Terre, sa mesure est effectuée en observant chaque
jour le passage d’étoiles hors du système solaire.
Ceci apporte une précision de l’ordre de la microseconde.
La durée d’une seconde est la fraction d’1/86400 du jour
solaire terrestre moyen. Cette durée est proche de la période
moyenne du battement normal du cœur humain au repos. En France, l’heure
légale est obtenue en rajoutant 2 heures en été et
1 en hiver à l’heure TU. Mais rapidement les astronomes remarquent
que le TU n’est pas assez précis.
La rotation de la Terre est assujettie à de trop nombreux phénomènes
imprévisibles : marées, ouragans, éloignement de
la lune, etc. Les astronomes retiennent le mouvement orbital de la Terre
autour du Soleil comme nouvelle échelle de temps. La notion de
Temps Éphémérides (TE) est mise en
place afin de tenir compte des imperfections de la rotation de la Terre.
L’observation de la longitude du Soleil dans le ciel au cours de
l’année telle qu’elle a été adoptée
en 1952 par l’Union astronomique internationale est proposée.
1967, la définition de la seconde.
Lors de la treizième Conférence Générale des
Poids et Mesures, la seconde est définie comme "la durée
de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à
la transition entre les niveaux hyperfins F=3 et F=4 de l’état
fondamental 6S1/2 de l’atome de césium 133". Cet atome
possède un isotope extrêmement stable permettant de définir
une oscillation parfaite.
Ceci signifie que la division d’une seconde grâce à
la stabilité du césium 133 permet une exactitude jamais
atteinte avec le temps défini par l’astronomie. Lorsqu’un
des électrons change de niveau d’énergie, il produit
des oscillations d’une stabilité remarquable, absolument identiques
partout dans le monde et totalement indéfectibles .
2013 En France, le SYRTE a mis au point deux horloges optiques à
atomes neutres (limite ultime 10-18).
Celles-ci surpassent en précision et stabilité les fontaines
atomiques Césium. Une radiation du domaine optique a une fréquence
100 000 fois plus élevée que celle du Césium 133.
Cette première mondiale est une étape importante et devrait
permettre à l'horizon 2026 une redéfinition de la
seconde au niveau international ...

l’heure
légale est fabriquée et diffusée par le laboratoire
SYRTE de l’Observatoire de Paris -
LA SECURISATION DES ROUTES MARITIMES
Le premier navire marchand à être
équipé de T.S.F. est vraisemblablement le transatlantique
Kaiser Wilhelm der Grosse (Empereur Guillaume Le Grand), en 1900. En 1903,
moins de 50 navires sont équipés de la radio et en 1907
le nombre n'atteint pas 150. 5 ans plus tard, la TSF à bord des
navires reste encore un investissement jugé non indispensable.
Parmi les 23 217 navires enregistrés et en service en 1912, seulement
1000 (dont 400 britanniques) sont équipés de radio et naviguent
sur les lignes de l'Atlantique Nord.
Jusqu'au naufrage du Titanic, peu de compagnies maritimes avaient donc
pris conscience de l'importance de la radio pour la sécurité
en mer.
Pourtant, la T.S.F. a déjà, à cette époque,
sauvé de nombreuses vies humaines : Le premier sauvetage maritime
de grande ampleur assisté par la TSF restera sans doute, dans l'histoire,
celui du SS REPUBLIC qui, le 23 janvier 1909, était entré
en collision avec le vapeur italien FLORIDA au large de la côte
Est des Etats-Unis. Pendant 2 jours, l'opérateur radio Jack Binns,
dans des conditions très difficiles de froid et de brouillard avait
aidé les secouristes de LA LORRAINE et du BALTIC. La T.S.F. avait
contribué à sauver 760 personnes parmi les 1700 passagers
à bord.
Ce bâtiment était équipé d'une installation
Marconi. Mais le système de Marconi n'est pas à cette époque
le seul à être utilisé sur les mers. Il existe d'autres
procédés brevetés et rivaux tels ceux commercialisés
par Telefunken, la Western Electric ou la United Wireless par exemple.
La concurrence entre les procédés et les compagnies exploitantes
est telle à cette époque que les opérateurs radio
ont pour instruction de ne pas traiter ou relayer les messages concernant
les compagnies rivales !
A bord des navires, l'utilisation de la télégraphie manque
encore de règles de déontologie : les opérateurs
radio ont pour mission essentielle d'envoyer les messages personnels des
passagers (messages payants), ce qu'ils ne peuvent faire qu'à courte
distance des côtes et le reste du temps, ils s'amusent parfois à
perturber les transmissions des radios rivales. Ils ne sont pas tenus,
en tout cas, à une veille permanente qui pourrait contribuer à
sécuriser le trafic maritime.
L'aventure malheureuse du TITANIC sera un argument de poids pour obliger
les compagnies maritimes récalcitrantes à s'équiper
en matériel de T.S.F. et les pays à mettre en place une
règlementation maritime cohérente.
On se souvient que le naufrage survenu dans la nuit du 14 au 15 avril
1912 fit plus de 1500 morts malgré un signal de détresse
lancé vers 0h30 et capté par le Carpathia qui fonça
vers les lieux du drame. On n'oubliera pas non plus les autres évènements
dramatiques survenus en mer au début du 20ième siècle
et le grand nombre de victimes évitées lors de naufrages,
grâce à l'utilisation de la T.S.F. pour alerter les secours.
Beaucoup de radiotélégraphistes laisseront leur vie en mer
pour sauver des naufragés.
Pratiquement tous les pays industrialisés vont à cette époque
renforcer leur législation dans ces domaines.
En France, par exemple, le décret du 24 février 1917 publié
au J.O. du 6 mars, autorise les Directeurs départementaux des postes
à délivrer aux particuliers des licence d'installation d'appareils
récepteurs de signaux horaires et de télégrammes
météorologiques
|
Les mairies, les écoles, les industries
horlogères, les compagnies de chemin de fer, la marine
marchande vont profiter des renseignements horaires et météorologiques
transmis par les stations radiotélégraphiques. L'image ci-contre montre un exemple de récepteur
horaire à détecteur électrolytique utilisé
à cette époque. L'appareil était monté
sur une planchette de bois fixée au mur. L'écoute
des signaux morse se faisait à l'aide d'un écouteur
téléphonique. |
 |
Des essais, calculs et mesures furent réalisés tout au long de l'année 1906 et aboutirent à la mise au point d'un premier dispositif capable d'identifier la position azimutale d'un navire en mer.
Bellini qui cherchait un nom pour son invention proposa d'abord le terme de Radio-Clinomètre puis choisit en définitive celui de Radio-Goniomètre (du grec gonia : angle). A l'époque, dans les milieux scientifiques comme dans l'industrie de la T.S.F. l'invention fut plutôt connue sous le nom de Compas Azimutal Hertzien Bellini-Tossi ou encore de boussole Hertzienne.
Toutes les expériences avaint été si probantes que le Gouvernement Français adopta cette invention pour les navires militaires et certains sémaphores. Le poste de Boulogne sur Mer en fut équipé à partir du 15 mai 1910.
La marine marchande suivit par la Cie Générale Transatlantique fit installer la Boussole Herzienne sur ses bâtiments dès 1910...
sommaire
Revenons sur la détermination
de Ia différence de longitude par transport de chronométre.
La détermination de Ia différence de longitude entre deux
lieux, Neuchâtel et Greenwich par exemple, comporte trois opérations
distinctes:
1. On détermine l'heure à Neuchâtel;
2. On détermine l'heure à Greenwich;
3. On compare les heures obtenues aux deux stations et leur différence
est égale à la différence de longitude.
Nous ne voulons pas traiter ici le problème de la détermination
de l'heure que nous avons exposé dans de nombreux articles.
Nous nous arrêterons seulement au problème de la comparaison
des heures obtenues aux deux stations.
A l'heure actuelle, il existe un moyen moderne très rapide : la
T . S. F. Une station d'émission diffuse le battement d'une pendule.
Pratiquement, ce battement est enregistré en même temps par
les deux stations qui ont ainsi un moyen très simple de comparer
leurs heures. Mais la T . S. F. est d'invention très récente
et un grand nombre de déterminations de différences de longitudes
ont été faites par d'autres méthodes dont il est
intéressant de connaître la précision.
On compare souvent des observations modernes de différences de
longitudes à d'autres plus anciennes qui n'ont pas la même
exactitude. Avant de tirer des conclusions des résultats de ces
comparaisons, il importe de fixer l'erreur des anciennes observations.
Il existe une méthode de comparaison des heures des deux stations
qui intéresse spécialement les chronométriers : c'est
la méthode par transport de l'heure au moyen de chronomètres.
Pour obtenir la différence de longitude Neuchâtel-Greenwich
par exemple, on compare un certain nombre de chronomètres à
la pendule de Neuchâtel, on les transporte à Greenwich en
tenant compte autant que possible de leurs variations de marche pendant
le transport et on les compare à Ia pendule de Greenwich dont la
différence avec la pendule de Neuchâtel donnera le résultat
recherché. Pendant le transport, les chronomètres sont soumis
à de nombreuses causes perturbatrices dont il n'est pas toujours
facile d'évaluer l'effet; c'est l'inconvénient de la méthode.
Mais les résultats des recherches de certains savants comme M.
Paul Ditisheim ont prouvé que la précision de cette méthode
dépasse largement celle à laquelle on pourrait s'attendre.
Dans les « Annales Françaises de Chronométrie »,
deuxième trimestre 1942, on trouve quatre articles consacrés
à cette intéressante question:
« Méthodes de détermination de différences
de longitudes radiotélégraphiques, par transport de temps
et par signaux », par M. René Baillaud.
« Fssai d'une détermination de la différence de longitude
Paris-Neuchâtel (1902-1903), avec transport de l'heure par rail
», par M. Paul Dirisheim.
« Détermination de la différence de longitude Greenwich-Paris
par transport du temps par avion », par M. Dirisheim.
«Comparaison des résultats obtenus en 1907 et 1908 dans Ia
détermination des longitudes par transport de l'heure et par l'observation
d'occultation d'étoiles par la Lune, au cours d'un voyage en Afrique
(Centrale», par le général J. Tilho.
De ces quatre articles nous tirons une partie des renseignements qui suivent
en espérant intéresser les lecteurs de la « Fédération
Horlogère » à cette belle application de la chronométrie
à la science géodésique.
Avant l'invention des chronomètres, on ne connaissait pas de garde-temps
susceptibles de conserver l'heure sur les routes maritimes et terrestres.
Dans Ie but de remédier à cette carence, des concours dotés
de prix importants furent créés en Espagne, en Hollande
et en France. En Angleterre, un prix de 20,000 livres sterling fut offert
en 1714 par le parlement à celui qui découvrit le garde-temps
capable de fonctionner sur mer. Il fut versé à John Harrison
en 1773 seulement. En France, Pierre Le Roy reçut à la même
époque le prix de l'Académie des Sciences pour ses montres
marines qui avaient fait leurs preuves sur la frégate « La
Flore » en 1771.
Pendant longtemps, seuls les chronomètres de marine volumineux
à échappement à ressort furent utilisés sur
mer. Ils permirent de déterminer avec exactitude les longitudes
des ports importants et de réviser les cartes qui contenaient de
nombreuses erreurs.
Au début du vingtième siècle, les observatoires chronométriques
créent les épreuves pour chronomètres de bord avec
échappement à ancre.
Ces nouveaux garde-temps font bientôt leurs preuves et ne tardent
pas à être utilisés dans les déterminations
des différences de longitudes par transport de l'heure sur terre
puis plus tard par avion.
Le premier essai est tenté par M. Paul Ditisheim en 1902.
Il dépose cinq chronomètres de bord à l'Observatoire
de Neuchâtel où on étudie leur marche très
sérieusement jusqu'au 15 décembre 1902. On vérifie
le réglage aux températures. Le 15 décembre, les
chronomètres sont transportés par chemin de fer à
l'Observatoire de Paris où on les observe jusqu'au 24 décembre
1902, date à laquelle ils sont ramenés à Neuchâtel.
Lors du deuxième voyage, les cinq pièces sont de nouveau
transportées à Paris le 13 février 1903. Trois d'entre
elles reviennent à Neuchâtel le 19 février, les deux
autres le 28 juin 1903. Tous calculs faits, il résulte de ces deux
voyages pour la différence de longitude Neuchâtel-Paris le
chiffre de 18m28s ,80. Or, les déterminations les plus modernes
de différences de longitudes Neuchâtel-Paris sont celles
faites par T . S. F. en 1926 (18m28s ,852) et en 1933 (18 m 28s,855) qui
donnent en moyenne 18 m 28s,858.
(Lire Essai
d'une détermination de la différence de longitude Paris-Neuchâtel
(1902-1903), avec transport de l'heure par le rail )
Le résultat de 1902-1903 par transport
de chronomètres ne diffère donc des résultats modernes
que de 0S,058.
Du 18 au 27 mai 1920, 12 chronomètres de bord de M. Paul Ditisheim
furent transportés cinq fois de Greenwich à Paris ou de
Paris à Greenwich par avion. Toutes les précautions avaient
été prises pour caler les chronomètres et tenir compte
des variations de température et de pression atmosphérique
au cours du voyage. Le premier voyage fut d'une durée anormale
par suite du manque d'essence. Pour les quatre autres le trajet s'accomplit
en 2 h 45 m en moyenne. La différence de longitude trouvée
fut de 9 m 20s,947. Les opérations par T . S. F. de 1926 et de
1933 ont donné respectivement comme résultats 9 m 10s ,
9 1 3 et 9 m 10 s , 9 4 6 dont la moyenne vaut 9 m 20s,929. La moyenne
obtenue par M. Ditisheim grâce au transport par avion n'en diffère
que de 0S,018.
Au cours d'un voyage en Afrique Centrale, le général Tilho
a utilisé des chronomètres pour contrôler les différences
de longitude. Nous tirons de son article cité plus haut les renseignements
suivants qui intéresseront certainement les horlogers:
« Dans les pages qui précèdent, nous nous sommes borné
à donner les renseignements généraux et les principaux
résultats d'ensemble qui montrent le degré de perfectionnement
qu'ont pu atteindre les constructeurs de ces admirables chronomètres
de petit format que les marins appellent «montres de torpilleur».
Puis plus loin: « De ces écarts remarquablement faibles,
on peut conclure que l'on doit avoir plus de confiance, au cours de longs
voyages à terre, dans les déterminations de longitude par
les transports du temps convenablement exécutés, que dans
les longitudes provisoires calculées sur place par la méthode
des occultations. Mais il est bien évident que cette conclusion
ne présente plus maintenant le moindre intérêt (sinon
peut-être d'ordre historique) au point de vue de la solution du
problème des longitudes en exploration: depuis 1916, en effet,
la télégraphie sans fil a réalisé de tels
progrès qu'en tous les points de la terre on peut maintenant recevoir
les signaux horaires que les grands postes radiotélégraphi-ques
du monde entier transmettent chaque jour à heures fixes, avec une
précision de l'ordre de deux à trois dixièmes de
seconde de temps, poulies signaux usuels et de deux à trois centièmes,
pour les signaux scientifiques. De. telle sorte que tout explorateur un
peu entraîné, muni d'une petite antenne et d'un appareil
récepteur de T . S. F. simple et peu encombrant, peut régler
facilement ses garde-temps sur l'heure du premier méridien avec
toute l'exactitude désirable.
La pensée ne me serait donc pas venue de rédiger, en 1942,
une notice sur les déterminations de longitudes effectuées
entre le Niger et le lac Tchad au cours de nos deux missions de 1903 et
1907, si je n'en avais été prié de Ia façon
la plus flatteuse et la plus pressante par M. Paul Ditisheim, le savant
chronométrier qui compte parmi les plus érudits de nos contemporains
en matière de science et d'histoire chronométriques: le
degré d'exactitude des différences de longitudes que les
« montres de torpilleur » permettent de calculer au cours
d'une exploration étant le plus sûr critérium de leur
précision, je ne pouvais guère hésiter à faire
enregistrer par les « Annales de Chronométrie » les
témoignages que je viens de présenter ci-dessus. C'est en
même temps pour moi une heureuse occasion d'apporter mon modeste
hommage de gratitude et d'admiration aux grands horlogers dont les persévérantes
recherches ont abouti à la création de ces véritables
chefs-d'œuvre de conservation de l'heure que sont les
actuels chronomètres de petit format, du volume et de la forme,
des montres ordinaires avec échappement à ancre, au lieu
de la forme classique des gros chronomètres de marine à
échappement libre, lesquels n'en restent pas moins (il est à
peine besoin de le dire) les instruments par excellence de réception
des signaux rythmés internationaux de T . S. F., quand il s'agit
de mesures très précises de longitude. » il n'y a
rien à ajouter de plus à ce grand hommage rendu par un militaire
à Ia science chronométrique.
E. GUYOT
Mais en 1906, ce projet de service de l’heure par téléphone
à Montsouris est abandonné car un projet de radiodiffusion
de l’heure à partir de la tour Eiffel voit peu à
peu le jour. *
Le projet de Guyou resurgira en 1910, en vain, sous la houlette du nouveau
directeur de l’observatoire, l’amiral Ernest Fournier (1842-1934),
alors que la France est en pleine discussion pour l’adoption d’une
heure légale . La loi du 9 mars 1911 fixera l’heure légale
comme « l’heure du temps moyen de Paris retardée de
9 minutes 21 secondes », c’est-à-dire le temps universel.
Il faudra attendre le 14 février 1933 pour qu’une horloge
parlante soit mise en service à l’Observatoire de
Paris par son directeur Ernest Esclangon (1876-1954) et que selon ce dernier,
« se développe dans le public, une sorte d’habitude
de l’heure exacte, […] le besoin de l’heure précise
» .
* Pour sauver la Tour Eiffel de la destruction,
le capitaine Ferrié proposa en 1903 à Gustave Eiffel d’installer
un réseau militaire de TSF (Télécommunication Sans
Fil). La Tour Eiffel était à l’époque la plus
haute construction au monde. Elle permettait d’installer de grandes
antennes du sommet jusqu’au sol, en plein Paris, pour envoyer ou
recevoir des ondes électromagnétiques.
Gustave Eiffel accepta le 15 décembre 1903 de financer le projet
à hauteur de 40 000 francs. Dès 1908, on découvrait
que la portée des ondes pouvait atteindre des distances considérables,
de l’ ordre de 6 000 km. Henri Poincaré demanda alors à
la Chambre des députés de créer un service commercial
radiophonique au sommet de la Tour Eiffel. Le projet fut voté le
17 juillet 1909.
Les premiers signaux horaires officiels par TSF datent du 23 mai 1910.
En 1911, 6 câbles de 425 m de long partent du sommet de la Tour
Eiffel pour atteindre la station souterraine située sous le Champs
de Mars à environ 150 m du pilier est. La Tour Eiffel émettait,
à 12 h et à 24 h, des signaux horaires donnant exactement
l’heure de Paris. Ces signaux étaient extrêmement utiles
pour les bateaux en haute mer pour déterminer avec précision
leur longitude.
...
sommaire
1938 Horloge orthochrone de «mise
à l'heure» automatique par radio 1er Prix le la Société
Suisse de ChronométrieSociété Suisse de Chronométrie.
Brevet Suisse Ch. Piton No. 223349. 24 décembre 1938, 20 h. —
Dispositif pour la mise à l'heure automatique d'une horloge au
moyen de signaux électriques horaires.
L'horloge orthochrone se compose en principe de 4 parties principales:
1) Un récepteur radiotélégraphique,
2) Un sélecteur de signaux,
3) Un correcteur,
4) Le mouvement d'horlogerie.
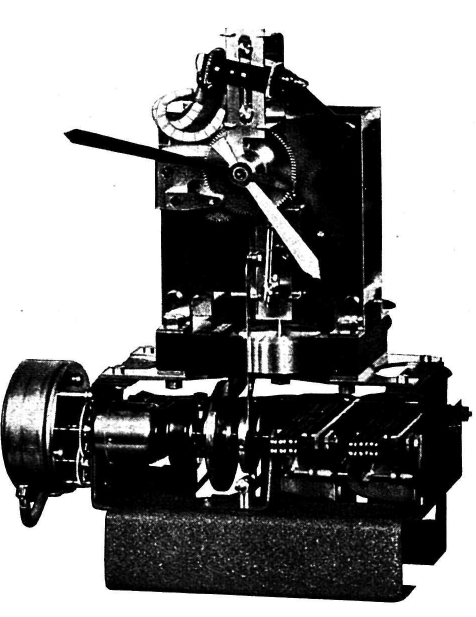
Récepteur radiotélégraphique
Puisque l'horloge orthochrone est une "horloge qui se « met
à l'heure » par les signaux horaires transmis par radio,
il s'agit de recevoir ces signaux et de leur faire subir certaines transformations
pour les rendre propres à agir sur les organes de l'horloge chargés
de faire la correction ou Ia « mise à l'heure ».
C'est au récepteur radiotélégraphique qu'est réservé
ce rôle. Dans ce but il est basé sur le principe du superhétérodyne
ou changement de fréquence avec l'utilisation d'une moyenne fréquence
spéciale permettant de recevoir simultanément les émissions
de Sottens et celles de Beromunster.
Ceci est la condition nécessaire si l'on veut pouvoir mettre en
service le même type d'horloge orthochrone à n'importe quel
endroit du territoire Suisse, c'est-à-dire indifféremment
à portée de l'un ou de l'autre des deux émetteurs
nationaux sans être obligé de construire le récepteur
avec des étages d'amplification particulièrement puissants
ni de réglage spécial pour Sottens ou pour Beromunster.
Cette propriété du superhétérodyne, de pouvoir
recevoir ensemble deux émissions distinctes, qui est gênante
dans le cas de Ia radiophonie, est au contraire très utile pour
le récepteur radiotélégraphique pour l'horloge orthochrone
qui doit pouvoir être commandé indifféremment par
l'un ou l'autre des émetteurs transmettant le signal horaire.
Le récepteur ne possède ni haut-parleur ni cadran, son accord
est fixe sur Ia fréquence de 556 kc/sec. (fréquence de Beromunster)
avec une fréquence image de 677 kc/sec. (fréquence d eSottens).
Le récepteur comporte en plus d'un étage changeur de fréquence
un étage d'amplification moyenne fréquence, un étage
détecteur et un ou deux étages d'amplification basse fréquence
avec des circuits accordés sur la fréquence de 1000 p .p.
sec. environ (fréquence musicale du signal horaire).
L'étage de puissance attaque un transformateur de sortie suivi
lui-même d'un redresseur oxymétal pour fournir une tension
puisée à l'un des deux relais du sélecteur et provoquer
ainsi l'attraction de ce relais à chaque son transmis par l'émetteur,
son qui d'ailleurs reste sous forme de variation électrique.
Le récepteur radiotélégraphique se branche sur le
réseau de courant de lumière avec une prise de terre et
éventuellement une petite antenne intérieure. Il est, par
décision de l'administration des P . T . T., exonéré
de la taxe annuelle sur les récepteurs de radio.
Sélecteur de signaux
Le sélecteur de signaux remplace le haut-parleur nabituel d'un
récepteur radiophonique et a comme fonction principale de faire
un tri de ce que lui fournit le récepteur. Ce tri a pour effet
de séparer le signal horaire des autres émissions, de l'enregistrer
et d e déclencher au moyen de cet enregistrement le correcteur
pour faire la « mise à l'heure ».
Le sélecteur de signaux agit donc à la façon d'un
cerveau qui, par l'entremise de l'oreille perçoit les émissions
et qui, à la fin du signal horaire transmet à la main l'impulsion
nerveuse qui lui fera corriger la position de l'aiguille de la pendulette
pour ce cas habituel où la «mise à l'heure »
se fait à la main d'après le signal horraire transmis par
radio.
Le sélecteur de signaux est construit de façon à
restreindre l'effet perturbateur des parasites radioélectriques
qui peuvent atteindre le récepteur, il est placé dans la
cage même de l'horloge; Horloge orthochrone de démonstration
(mouvement d'horlogerie et sélecteur] de l'Exposition Nationale
de Zurich il est de dimensions réduites et son fonctionnement est
sûr et éprouvé. Il se compose en principe d'un relais
téléphonique double, d'un embrayage magnétique entraînant
un groupe de contacteurs rotatifs et un ressort spiral dont la tension
s'opère pendant la réception du signal horaire et qui fournit
par sa détente l'énergie mécanique nécessaire
pour la correction de l'horloge.
Correcteur
L'énergie mécanique emmaganisée dans le ressort spiral
du sélecteur est transmise à l'aiguille de l'horloge pour
la « mettre à l'heure » par l'intermédiaire
du correcteur placé devant la platine d'avant, sous la cadrature.
Il agit sur un « V » fixé à la roue de chaussée
et a pour effet d'avancer l'aiguille des minutes quand l'horloge retarde
et la reculer quan d l'horloge avance.
La correction peut se faire pour une avance ou un retard allant jusqu'à
5 minutes; toutefois le cas d'une correction de 5 minutes ne se présentera
pas car l'échappement de l'horloge étant réglé
le plus exactement possible la variation de l'horloge entre deux émissions
du signal horaire ne dépassera probablement jamais une minute.
Si, pour une cause étrangère à l'horloge la correction
n'a pas pu se faire un jour donné , soit qu'il y ait eu une panne
de courant au moment précis de l'émission du signal, soit
qu'il y ait eu un orage et que des parasites trop intenses aient empêché
la correction, celle-ci s'effectuera le jour suivant pour le double de
l'erreur quotidienne de l'horloge.
Quelles que soient les causes qui pourraient exceptionnellement gêner
la «mise à l'heure», le sélecteur ne risquera
jamais de faire faire une fausse correction à l'horloge, c'est-à-dire
la «mettre à l'heure » à un moment autre que
celui qui est choisi à l'avance et d'après lequel est établi
le schéma du sélecteur. En général, la correction
se fera au premier des six tops qui terminent le signal horaire à
midi 29 minutes 55 secondes ou à 16 heures 59 minutes 55 secondes.
Une seule « mise à l'heure » par jour suffit. En conséquence,
on pourra régler l'horloge pour qu'elle fonctionne soit au signal
de 12 heures 30 soit à celui de 17 heures.
Mouvement d'horlogerie
L'horloge est du type à réserve de marche pour le cas de
pannes éventuelles du courant électrique et à remontage
automatique par le moyen d'un petit moteur synchrone qui fournit d'ailleurs
également l'énergie mécanique pour la tension du
ressort spiral du sélecteur dont la détente provoque la
correction.
Lorsque Ie ressort du barillet est tendu, un frein vient automatiquement
arrêter le moteur et l'effet de ce frein est supprimé pendant
l'émission du signal horaire, Ia rotation du moteur étant
nécessaire pour tendre le ressort spiral du sélecteur.
Une came faisant 1 tour e n 24 heures et en liaison avec le rouage de
l'horloge par l'intermédiaire de l'axe de Ia roue de minuterie
provoque 5 minutes avant et 5 minutes après l'émission du
signal le basculement brusque d'un interrupteur à mercure. Cet
interrupteur enclenche pendant 10 minutes le courant d'alimentation du
récepteur d e radio qui se trouve ainsi e n état
de recevoir le signal horaire et les émissions le précédant
et lui succédant.
C'est au sélecteur qu'incombe le soin de faire le tri parmi les
émissions et d'en extraire le signal horaire.
L'horloge peut posséder également une aiguille des secondes
et dans ce cas la correction affectera à la fois la position de
l'aiguille des minutes et celle de l'aiguille des secondes.
Pour un e horloge de précision dont on désire connaître
la variation diurne, le correcteur au lieu de déplacer les aiguilles
mettra en marche une aiguille trotteuse qui permettra de mesurer aisément
l'écart de marche diurne.
Le cabinet de l'horloge a approximativement le même encombrement
que celui d'une horloge courante et il renferme tout l'ensemble de l'horloge
orthochrone, récepteur radiotélégraphique compris.
Les aiguilles de l'horloge ne sont pas accessibles, le cabinet est plombé
et le fonctionnement de même que la marche sans variation (l'erreur
diurne exceptée) est garanti par le constructeur pour un certain
nombre d'années.
C O N C L U S I O N
Les épreuves subies par le prototype d'horloge orthochrone amènent
à la conclusion que cette horloge sera dans un avenir prochain
indispensable à quiconque voudra l'heure exacte, son prix de revient
et ses caractéristiques en font une horloge courante de grande
précision.
L'horloge orthochrone marque du reste une étape dans le développement
de la radio et démontre les possibilités d'applications
des derniers perfectionnements techniques dans le développement
conjuré de l'horlogerie et de la radioélectricité.
Charles P I T O N .
Charles Piton (1907-1997), est un technicien-électricien. En
1940 il met à point la première horloge radio contrôlée.
Documents techniques produits par Charles Piton, portant surtout sur son
appareil pour la correction automatique de l'heure et sur les signaux
horaires en général. Correspondances (avec la SSR, l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel, Adolf Ogi, etc.), des coupures de presse
relatives à Charles Piton et au système CORIC.
Sa pendulette électrique qui est une
preuve nouvelle que l’industrie suisse est toujours à l’avant
garde dans le domaine de l’horlogerie. Cette pendulette a la propriété
d’être pilotée par l’observatoire chronométrique
de Neuchâtel, lequel la remet à l’heure journellement
de façon absolument automatique et cela sans fil. Elle est dotée
d’un cerveau électronico-mécanique qui réagit
au signal horaire et qui déclenche le mécanisme de correction
des aiguilles. Au 10ème de seconde, s’il vous plaît.
Note. — La majorité des pièces
détachées du prototype d'horloge orthochrone ont été
exécutées par l'Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
de St-Imier qui avait, d'autre part, exposé une horloge à
«mise à l'heure» automatique de démonstration
à l'Exposition Nationale de Zurich dans le stand des Ecoles Techniques.