Joseph Henry
Joseph Henry (1797-1878), physicien et premier secrétaire
du Smithsonian, fut un pionnier dans les domaines de l'électricité
et de l'électromagnétisme, et stimula les travaux en anthropologie,
aéronautique, météorologie, télégraphe
et téléphone.
Il exerça ses fonctions de 1846 à 1878. Professeur au
College of New Jersey, ce physicien mena des recherches pionnières
en électromagnétisme et contribua à l'orientation
du Smithsonian.
Henry naquit en 1797 à Albany, dans l'État de New York,
de William et Ann Henry. Trop pauvre pour payer ses frais de scolarité,
Henry n'entra à l'Albany Academy qu'à l'âge de 21
ans, malgré son admission antérieure. À l'Académie,
Henry travailla comme assistant chimiste et préparateur de cours.
Lorsqu'un poste se libéra en 1826, Henry accepta un poste
de professeur de mathématiques et de philosophie naturelle.
C'est là qu'il commença ses recherches scientifiques
sur l'électromagnétisme et travailla au développement
du télégraphe .
En 1832, Henry fut nommé professeur de philosophie naturelle
au College of New Jersey (aujourd'hui l'université de Princeton),
et sa tournée des centres scientifiques européens en 1837
assura sa réputation scientifique internationale. Les réalisations
d'Henry en tant qu'éducateur et scientifique ont fait de lui
un candidat de choix pour le poste de secrétaire du Smithsonian
le 3 décembre 1846.

Henry enseigna pendant une vingtaine d'années,
d'abord dans une école préparatoire à l'université
de New York, puis à Princeton.
Durant ces années, il se fit connaître auprès des
scientifiques des États-Unis et d'Europe pour ses recherches
révolutionnaires en électromagnétisme.
Sa réputation de scientifique américain
de premier plan aida le Conseil à prendre sa décision,
et son expérience reflète la voie qu'il traça pour
l'institution dont il prit la direction. Henry exposa son plan pour
la nouvelle institution dans son Programme d'organisation . Ce programme
contenait quatorze principes directeurs, notamment la suggestion que
le Smithsonian n'entreprenne que des programmes ne pouvant être
menés de manière adéquate par les institutions
américaines existantes, et que l'institution produise une publication,
Smithsonian Contributions to Knowledge, ainsi que des rapports périodiques
sur les progrès scientifiques. Réticent à assumer
la responsabilité de la gestion d'un musée abritant les
collections nationales, Henry retira les dispositions relatives à
la bibliothèque nationale de la loi d'habilitation du Smithsonian.
Il établit également le principe du maintien du don de
James Smithson en tant que dotation et commença à solliciter
des dons supplémentaires. Le bâtiment de la Smithsonian
Institution, ou « Château », fut construit sous son
administration, malgré son opposition, craignant un gaspillage
d'argent pour un bâtiment monumental. Achevé en 1855, il
offrait des espaces pour des expositions et des conférences,
des laboratoires de recherche et des logements pour Henry et sa famille.
Henry a axé le Smithsonian sur la recherche, les publications
et les échanges internationaux. Le système d'échanges
internationaux a débuté en 1849, le Smithsonian jouant
un rôle de centre d'échange d'œuvres littéraires
et scientifiques entre les sociétés et les individus aux
États-Unis et à l'étranger. Dès 1849, il
a créé un programme d'étude des conditions météorologiques
en Amérique du Nord, projet qui a finalement conduit à
la création du Service météorologique national.
Le Projet météorologique du Smithsonian disposait d'un
réseau de plus de 600 observateurs bénévoles, notamment
au Canada, au Mexique, en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le Smithsonian fournissait aux bénévoles des instructions,
des formulaires standardisés et, dans certains cas, des instruments.
Les bénévoles fournissaient au Smithsonian des rapports
mensuels d'observations météorologiques, indiquant les
températures quotidiennes, la pression barométrique, l'humidité,
la nébulosité et les précipitations.
Henry travailla sans relâche pour soutenir la science américaine.
Il encouragea les jeunes scientifiques et leur offrit un logement au
château. Il participa, et souvent dirigea, des sociétés
scientifiques américaines, dont l'Académie nationale des
sciences et le US Lighthouse Board. De plus, il se rendit en Europe
pour participer à des discussions scientifiques et promouvoir
la science américaine à l'étranger. Il maintint
le Smithsonian pendant les années difficiles de la guerre de
Sécession et fut l'un des conseillers scientifiques du président
Abraham Lincoln. Henry s'occupa des problèmes budgétaires
causés par la guerre et envoya même une note demandant
à la population d'économiser du papier afin de pouvoir
le revendre. L'institution apporta également son aide pendant
la guerre en coopérant avec la Commission sanitaire et le chirurgien
général de l'armée américaine pour améliorer
la santé et le confort des soldats, tout en collectant des données
intéressantes pour les ethnologues et autres chercheurs.
Malheureusement, les exigences de son poste de professeur à Princeton limitaient le temps qu'Henry pouvait consacrer à ses activités scientifiques en dehors des cours. « Mes obligations universitaires sont telles que je ne peux rien faire en matière de recherche pendant le trimestre et, à la fin des vacances, je me retrouve souvent au milieu d'une série d'expériences intéressantes que je suis obligé d'abandonner et, avant de pouvoir y revenir, mon esprit est occupé par d'autres sujets », écrivait Henry en janvier 1846. Il ajoutait que certaines de ses découvertes ne lui avaient pas été reconnues, faute de les avoir publiées rapidement.
Le cours de philosophie naturelle d'Henry comprenait
des cours magistraux au moins trois fois par semaine le matin, des récitations
l'après-midi et des séances supplémentaires de
démonstrations expérimentales.
Un ensemble de notes de cours rédigées par Henry à
Albany illustre son utilisation des expériences comme outil pédagogique
et son assiduité en tant qu'enseignant. Les expériences
en classe sur l'électricité et le magnétisme ont
contribué à certaines des principales réalisations
scientifiques d'Henry pendant ses années à Albany, notamment
sa découverte indépendante de l'induction électromagnétique
. Il les a décrites dans des lettres à ses collègues
Benjamin Silliman , à Yale, et au scientifique britannique et
co-découvreur de l'induction électromagnétique
Michael Faraday .
Il s'est intéressé aux méthodes d'éclairage
et à l'acoustique des signaux de brouillard. Henry a également
été consulté pour des conseils scientifiques lors
de la construction du Capitole des États-Unis et a mené
des expériences sur le marbre, le chauffage, la ventilation et
l'acoustique du bâtiment. Attentif aux applications pratiques
de la recherche fondamentale, Henry a conçu des méthodes
pour tester la force de cohésion des particules du marbre envisagé
pour l'extension du Capitole. Il a ensuite conseillé sur la protection
du Capitole contre la foudre , un sujet sur lequel il avait mené
des recherches pendant ses années à Princeton ...
Henry était un professeur novateur. Son intérêt
pour le domaine relativement nouveau de l'électromagnétisme,
combiné à sa conviction de l'importance de démontrer
les phénomènes scientifiques à ses étudiants,
le conduisit à développer des électroaimants bien
plus puissants que tous ceux fabriqués auparavant. Utilisant
ces électroaimants pour démontrer des effets à
la fois spectaculaires et subtils à ses étudiants et pour
explorer l'électromagnétisme en laboratoire, il développa
le premier moteur basé sur l'attraction et la répulsion
magnétiques (ancêtre du moteur à courant continu
moderne) et une forme primitive du télégraphe électromagnétique.
Bien qu'il n'ait pas perfectionné ces dispositifs, ses travaux
ouvrirent la voie au développement de moteurs par d'autres et
au télégraphe de Samuel F.B. Morse. Il découvrit
également d'importants principes de l'induction électromagnétique,
pour lesquels il fut honoré en 1893, lorsque le Congrès
international des électriciens baptisa l'unité d'induction
« henry ».
Après une rapide détérioration de son état suite à sa paralysie de décembre 1877, Henry mourut dans ses appartements du Smithsonian Castle le 13 mai 1878. Henry fut un pionnier de l'étude de l'électromagnétisme et de son application à diverses technologies, et un défenseur infatigable de la science américaine, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Pendant 32 ans, Henry consacra toute son énergie à faire du Smithsonian un centre de recherche de premier plan, malgré les difficultés de la guerre de Sécession. Aujourd'hui, une statue commémore ses efforts à l'extérieur du Smithsonian Castle, premier bâtiment de l'institution qu'il a contribué à créer.
Les travaux d'Henry en électromagnétisme apportèrent non seulement d'importantes contributions à la science, mais contribuèrent également à jeter les bases de l'industrie et des télécommunications modernes.
L'ÉLECTROMAGNÉTISME
Le domaine de l'électromagnétisme n'avait que six ans
lorsqu'Henry commença à enseigner à l'Albany Academy
de New York.
Le scientifique danois Hans Christian Oersted avait découvert
en 1820 qu'un courant électrique dans un fil provenant d'une
pile faisait dévier l'aiguille d'une boussole située à
proximité. Soucieux de démontrer les phénomènes
électromagnétiques à ses étudiants, Henry
s'appuya sur les travaux du scientifique anglais William Sturgeon
, qui découvrit en 1825 qu'enrouler un fil autour d'un noyau
de fer renforçait l'effet magnétique. Henry expérimenta
divers paramètres : isoler le fil afin de pouvoir enrouler plusieurs
couches sur le noyau (Sturgeon avait utilisé du fil nu avec une
couche de gomme-laque isolante sur le fer) ; enrouler plusieurs bobines
sur le même noyau ; connecter des piles bout à bout (en
série) pour augmenter l'intensité (tension) et côte
à côte (en parallèle – une autre solution consistait
à avoir des plaques plus grandes dans une seule pile) pour augmenter
la quantité (courant). Il a constaté qu'une source de
haute intensité fonctionnait mieux avec les bobines connectées
bout à bout (en série, formant une seule bobine), tandis
qu'une source de grande quantité était meilleure avec
les extrémités des bobines connectées ensemble
(en parallèle). Il s'agissait, sans le savoir, d'une démonstration
de la loi d'Ohm, publiée en 1826, mais encore peu connue et comprise.
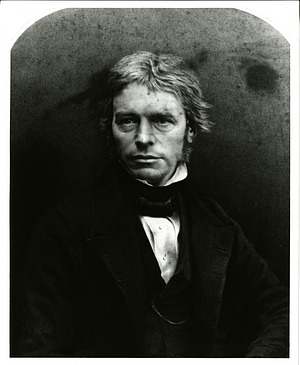 Michael Faraday
(1791-1867), chimiste et physicien à la Royal Institution of
Great Britain, a découvert l'induction électromagnétique
en même temps, mais indépendamment, de Joseph Henry, vers
les années 1830,
Michael Faraday
(1791-1867), chimiste et physicien à la Royal Institution of
Great Britain, a découvert l'induction électromagnétique
en même temps, mais indépendamment, de Joseph Henry, vers
les années 1830,
Michael Faraday, considéré comme l'homologue britannique
d'Henry, fut crédité de la découverte de l'induction
mutuelle en 1832, peu après avoir pris connaissance des récentes
expériences d'Henry avec des électroaimants , mais avant
qu'Henry n'ait eu le temps de terminer ses propres expériences.
 L'aimant
de Joseph Henry
L'aimant
de Joseph Henry  vers
les années 1820.
vers
les années 1820.
Electroaimant formé en enroulant étroitement plusieurs
bobines d'un fil conducteur isolé autour d'une barre de fer,
en illustration l'aimant avec sa batterie et son appareil pour mesurer
sa force,
 Peu après
avoir publié un article sur son électro-aimant pour l'American
Journal of Science de Benjamin Silliman, Joseph Henry, entreprit la
fabrication d'un grand électro-aimant pour que Silliman le présente
à ses étudiants de Yale vers les années 1830. L'aimant
de 38 kg s'avéra capable de supporter plus de 900 kg.
Peu après
avoir publié un article sur son électro-aimant pour l'American
Journal of Science de Benjamin Silliman, Joseph Henry, entreprit la
fabrication d'un grand électro-aimant pour que Silliman le présente
à ses étudiants de Yale vers les années 1830. L'aimant
de 38 kg s'avéra capable de supporter plus de 900 kg.
En 1831, il rapporta avoir fabriqué un électro-aimant
capable de soulever 750 livres, soit plus de trente-cinq fois son propre
poids (avec des bobines en parallèle, en utilisant une batterie
de quantité). Henry remarqua plus tard que ces premiers électro-aimants
« possédaient une puissance magnétique supérieure
à celle de tous ceux connus auparavant ». En 1833, il en
avait construit un qui pouvait soulever plus de 3 300 livres . Henry
a détaillé ses recherches et ses découvertes dans
des lettres à ses collègues, notamment Benjamin Silliman,
Sr. ( 1830 ), ( 1831 ), John Henry ( 1831 ), Edward Hitchcock ( 1832
) et Parker Cleaveland ( 1831 ), ( 1832 ).
Bien qu'Henry ait commencé ses travaux dans ce domaine en août
1831, c'est à peu près à la même époque
que Faraday rencontra des obstacles et des retards tout au long de l'année
universitaire et ne commença véritablement ses travaux
qu'en juin 1832. Faraday est ainsi considéré comme le
premier à avoir obtenu cet effet, plus tard appelé induction
mutuelle. Le biographe d'Henry, Albert Moyer, démontre de manière
convaincante que Faraday fut inspiré à entreprendre ses
recherches par la lecture des implications possibles des travaux d'Henry
sur ses électro-aimants et fut considérablement aidé
par la découverte de ses puissants électro-aimants et
de son utilisation de bobines multiples .
Bien que le rapport d'Henry sur l'induction d'électricité par le magnétisme soit conforme à celui de Faraday, ses recherches sur les étincelles observées lors des coupures et des étincelles répétées de son moteur alternatif, ainsi que sur celles observées lors de ses expériences avec les longs fils utilisés dans ses expériences télégraphiques, ont conduit à sa découverte , annoncée en juillet 1832, de ce que l'on appelle l'auto-induction . L'auto-induction se produit lorsqu'une coupure dans un circuit provoque un champ magnétique décroissant, ce qui induit un courant momentané dans le circuit d'origine, dans le sens inverse du courant initial. Pour sa découverte indépendante de l'induction mutuelle, et pour avoir été le premier à découvrir l'auto-induction, Moyer attribue à Henry « non seulement un concept fondamental de la physique de l'électricité et du magnétisme, mais aussi le principe très reconnu qui sous-tend la technologie des transformateurs et des générateurs électriques, deux piliers de l'industrialisation moderne ».
En cherchant à optimiser l'utilisation de ses
batteries et à maximiser la puissance de ses électroaimants,
Henry fit des découvertes fondamentales en électromagnétisme,
notamment sur les types d'entrées électriques à
adapter aux types de circuits en fonction des effets recherchés.
Ces découvertes fondamentales le conduisirent à développer
un moteur et un dispositif de sonnerie, précurseur du télégraphe
électromagnétique de Morse. Le défi du développement
d'un moteur résidait dans l'utilisation du courant d'une batterie
pour produire non seulement un effet mécanique, mais aussi un
mouvement mécanique continu .
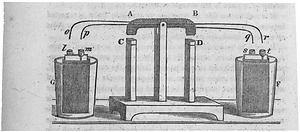
 Reconstruction vers1830
Reconstruction vers1830
Moteur électromagnétique oscillant de Joseph Henry, vers
1830
 Réplique
Smithsonian du moteur électromagnétique oscillant de Joseph
Henry, construit par lui vers les années 1830. Le moteur alternatif
de Henry était constitué d'un électroaimant droit
équilibré sur un axe, ses extrémités se
trouvant au-dessus des pôles nord de deux aimants permanents verticaux.
Des paires de fils, fixées à chaque extrémité
de l'électroaimant, étaient alternativement plongées
dans des coupelles de mercure, servant de bornes à une cellule
électrochimique. Lorsque les fils entraient et sortaient alternativement
des coupelles, créant et coupant ainsi un circuit, la polarité
de l'électroaimant s'inversait à plusieurs reprises ,
ce qui produisait un mouvement de bascule continu. Henry parvint à
obtenir un « mouvement uniforme, à raison de soixante-quinze
vibrations par minute… pendant plus d'une heure » . Bien
que son dispositif contienne les éléments d'un moteur
à courant continu moderne, il le considérait avant tout
comme un « jouet philosophique » pour les démonstrations
en classe et ne chercha pas à le breveter. En référence
au mouvement de va-et-vient de l'aimant, Henry qualifiait cet appareil
de « queue de mouton ».
Réplique
Smithsonian du moteur électromagnétique oscillant de Joseph
Henry, construit par lui vers les années 1830. Le moteur alternatif
de Henry était constitué d'un électroaimant droit
équilibré sur un axe, ses extrémités se
trouvant au-dessus des pôles nord de deux aimants permanents verticaux.
Des paires de fils, fixées à chaque extrémité
de l'électroaimant, étaient alternativement plongées
dans des coupelles de mercure, servant de bornes à une cellule
électrochimique. Lorsque les fils entraient et sortaient alternativement
des coupelles, créant et coupant ainsi un circuit, la polarité
de l'électroaimant s'inversait à plusieurs reprises ,
ce qui produisait un mouvement de bascule continu. Henry parvint à
obtenir un « mouvement uniforme, à raison de soixante-quinze
vibrations par minute… pendant plus d'une heure » . Bien
que son dispositif contienne les éléments d'un moteur
à courant continu moderne, il le considérait avant tout
comme un « jouet philosophique » pour les démonstrations
en classe et ne chercha pas à le breveter. En référence
au mouvement de va-et-vient de l'aimant, Henry qualifiait cet appareil
de « queue de mouton ».
LE TÉLÉGRAPHE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Le défi de la conception d'un télégraphe
électromagnétique n'était pas de produire un mouvement
continu, mais plutôt une action mécanique à grande
distance d'une batterie. Avant les recherches d'Henry, les signaux électriques
ne pouvaient pas être transmis par de longs fils. Le scientifique
anglais Peter Barlow avait d'ailleurs émis l'hypothèse
que l'impossibilité de transmettre un signal sur plus de soixante
mètres rendait impossible la mise au point d'un télégraphe
électromagnétique. En faisant varier les paramètres
lors du développement de ses puissants électroaimants,
Henry avait découvert que si une seule paire de plaques était
idéale pour transmettre un courant à travers plusieurs
fils plus courts, une batterie à auges composée de plusieurs
plaques (haute intensité) pouvait transmettre un courant à
travers un fil très long. L'utilisation d'une batterie à
haute intensité avec une bobine à enroulements multiples
était essentielle au développement du télégraphe
électromagnétique, car les pertes sur une longue ligne
étaient relativement faibles.
Morse apprit cela (indirectement d'Henry) en 1837, avec des conséquences
dramatiques. Les recherches fondamentales d'Henry sur le télégraphe
électromagnétique remontent à 1830, lorsqu'il commença
à démontrer à ses étudiants d'Albany qu'un
courant de batterie pouvait être transmis par un fil de mille
pieds . À l'extrémité du fil, un électroaimant
sous tension attirait l'extrémité d'un aimant en barreau
suspendu à un pivot, ce qui faisait que l'autre extrémité
heurtait une cloche. L'un des étudiants de l'Académie
d'Albany où Henry était né rapporta avoir vu Henry
réussir un circuit de deux kilomètres et demi de long.
Henry continua de développer des électroaimants plus puissants et démontra à ses étudiants un moyen de produire des effets mécaniques à une portée bien plus grande qu'on ne le pensait auparavant. Il utilisa un petit aimant « d'intensité » dans un circuit local pour contrôler un grand aimant « de quantité » supportant des poids de plusieurs centaines de kilos. Lorsqu'il alimenta le petit aimant par un long circuit, il attira vers le haut un fil métallique, ce qui rompit le circuit local et provoqua la chute brutale des poids. Il ne publia pas de description de ce relais primitif, dont Morse eut connaissance par un intermédiaire et qui joua un rôle crucial dans le développement du télégraphe. Il en parla cependant à Charles Wheatstone en Angleterre en 1837 et affirma en avoir fait la démonstration à ses étudiants de Princeton plusieurs années auparavant. Bien qu'il ne fût pas intéressé par des applications commerciales, Henry considéra plus tard ces démonstrations comme les premières à démontrer la faisabilité d'un télégraphe électromagnétique .
Le télégraphe expérimental de
Samuel Morse
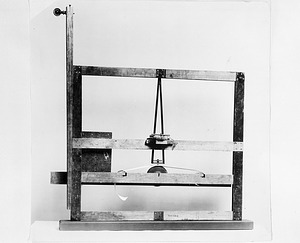
Alors que Samuel Morse développait son télégraphe,
il sollicita les conseils et le soutien du public auprès de Joseph
Henry.
Dans une lettre qui serait plus tard citée pour établir
l'origine du télégraphe, Henry écrivit à
Morse en 1842 que, bien qu'une telle invention ait été
suggérée « par diverses personnes depuis l'époque
de Franklin jusqu'à nos jours », ce n'est que « ces
dernières années ou depuis les découvertes de l'électromagnétisme
» qu'elle fut réalisable. Henry poursuivit en affirmant
que « peu de crédit pouvait être accordé »
à l'invention du télégraphe « car elle surgirait
naturellement dans l'esprit de presque toute personne familière
avec les phénomènes électriques », mais il
soutenait le projet de Morse plutôt que les télégraphes
à aiguilles proposés par les scientifiques européens.
Trois ans plus tard, la publication d'un livre sur le télégraphe
par l'un des principaux assistants de Morse, Alfred
Vail, ne mentionna pas les contributions d'Henry et marqua le
début d'un conflit entre Henry et Morse qui dura de nombreuses
années.
LE TÉLÉPHONE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Dès 1837, le physicien américain Page
avait reconnu que si un électroaimant est soumis à des
aimantations et désaimantations très rapides, les vibrations
transmises à l’atmosphère par le barreau aimanté
émettent des sons. C’est ce que ce savant appelait la musique
galvanique.
De 1847 à 1852, Mac Gauley, Wagner, Heef, Froment et Pétrina,
combinèrent des vibrateurs électriques qui transportaient
fort nettement les sons musicaux à distance.
Les contributions de Joseph Henry au développement
du téléphone sont mineures comparées à son
rôle dans le développement du télégraphe
et du moteur électrique. Cependant, l'histoire d'Henry et du
téléphone offre un exemple intéressant de son interaction
avec les inventeurs, qui sollicitaient souvent ses conseils et ses orientations.
L'histoire commence avec un inventeur méconnu, Joseph Faber
(lire la page sur "la voix"), et
se termine avec le père du téléphone, Alexander
Graham Bell.
Une ancienne gravure, dont on ignore l’auteur et la date de création
(éventuellement 1835), montre une jeune dame (probablement l’épouse
de Joseph Faber) qui manipule le clavier à 16 touches de la machine
parlante. La face de la tête est posée sur la table et
on peut voir la bouche de la machine avec des lèvres et une langue.
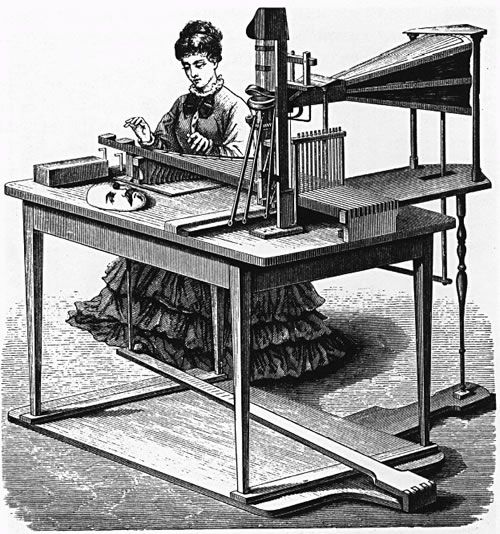 Gravure ancienne de la
machine parlante Euphonia.
Gravure ancienne de la
machine parlante Euphonia.
En 1840, il a présenté son invention, qu’il appelait
Euphonia, au public à Vienne et au Roi de Bavière en 1841.
En décembre 1845, Joseph Faber expose sa «
Merveilleuse Machine Parlante » au Musical Fund Hall de Philadelphie.
Cette machine, comme l'a récemment décrite l'écrivain
David Lindsay, se composait d'une tête parlante à l'aspect
étrange, qui parlait d'une voix monocorde, étrange et
fantomatique, tandis que Faber la manipulait à l'aide de pédales
et d'un clavier.
Juste avant cette exposition publique, Joseph Henry visita l'atelier
de Faber pour assister à une démonstration privée.
Son ami et collègue scientifique, Robert M. Patterson, avait
tenté de mobiliser des fonds pour Faber, un immigrant allemand
aux abois qui peinait à gagner sa vie et à apprendre l'anglais.
Henry, à qui l'on demandait souvent de distinguer les inventions
frauduleuses des inventions authentiques, accepta d'accompagner Patterson
pour examiner la machine. Si un acte de ventriloquie était à
l'œuvre, il était certain de le détecter.
Au lieu d'un canular, comme il le soupçonnait, Henry découvrit
une « invention merveilleuse » aux applications
potentielles variées.
« J'ai vu la figure parlante de M. Wheatstone de Londres »,
écrivit Henry dans une lettre à un ancien élève,
« mais elle ne peut être comparée à celle-ci
qui, au lieu de prononcer quelques mots, est capable de prononcer des
phrases entières composées de n'importe quel mot.»
Henry observa que seize leviers ou touches, « comme ceux
d'un piano », projetaient seize sons élémentaires
grâce auxquels « chaque mot de toutes les langues européennes
peut être distinctement reproduit ». Une dix-septième
touche ouvrait et fermait l'équivalent de la glotte, une ouverture
entre les cordes vocales. « Le plan de la machine est le même
que celui des organes humains de la parole, ses différentes parties
étant actionnées par des cordes et des leviers plutôt
que par des tendons et des muscles. »
Henry, qui avait inventé un télégraphe de démonstration
en 1831 tout en poursuivant ses recherches sur l'électromagnétisme,
pensait que de nombreuses applications de la machine de Faber étaient
envisageables en lien avec le télégraphe. « Les
touches pouvaient être actionnées au moyen d'aimants électromagnétiques
et, avec un petit dispositif simple à mettre en œuvre, des
mots pouvaient être prononcés à une extrémité
de la ligne télégraphique, leur origine se trouvant à
l'autre. » Presbytérien fervent, Henry saisit immédiatement
l'opportunité de faire prononcer un sermon simultanément
par fil à plusieurs églises.
Alors qu’il avait les compétences requises, Joseph Henry
n’avait jamais mis en pratique cette idée.
Étonnamment proche dans une lettre de l'idée
du téléphone, Henry orienta ensuite sa discussion vers
un sujet sans doute plus important à ses yeux : la découverte
de l'effet Faraday, comme on l'appelait alors. Henry informa son correspondant
qu'au cours de la semaine précédente, il avait réussi
à reproduire les récentes expériences du scientifique
britannique Michael Faraday démontrant l'effet du magnétisme
sur la lumière.
Henry qualifia astucieusement les phénomènes observés
par Faraday de « plus grande découverte du siècle »,
après les démonstrations de Hans Christian Oersted sur
le lien entre électricité et magnétisme.
Le résultat de Barlow semblait constituer un obstacle insurmontable
à l'utilisation de cette force physique nouvellement découverte
pour les communications longue distance.
Peut-être Henry ne parvenait-il tout simplement pas à imaginer
le téléphone. La possibilité d'un simple appareil
– aussi révolutionnaire soit-il pour la société
– ne pouvait rivaliser avec une découverte éclairant
le fonctionnement de phénomènes physiques fondamentaux.
Quoi qu'il en soit, il faudra attendre trente ans avant qu'Henry ne
s'intéresse sérieusement au téléphone.
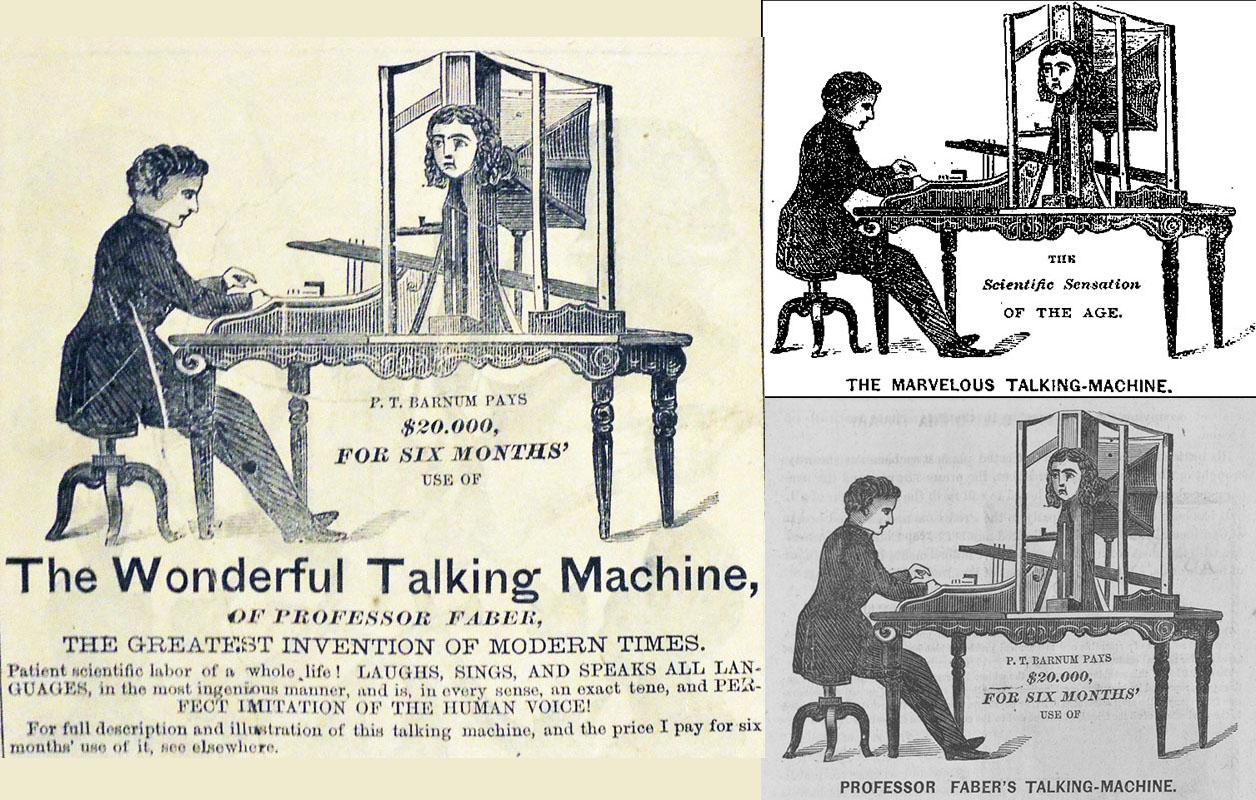
Entre-temps, Faber, qui avait détruit une version antérieure
de sa machine parlante par frustration face à un public peu enthousiaste,
se sentit apparemment encouragé par l'accueil réservé
à sa nouvelle machine par Henry et Patterson. En 1846, il accompagna
P. T. Barnum à Londres, où l'« Euphonia »,
comme on l'appelait désormais, fut exposée à l'Egyptian
Hall. L'exposition reçut le soutien du duc de Wellington et resta
au répertoire de Barnum pendant plusieurs décennies. Les
retombées financières pour Faber furent cependant maigres.
Il mourut dans les années 1860 sans avoir atteint la gloire ni
la fortune qu'il espérait.
Faber ne vécut donc pas assez longtemps pour assister à
l'aboutissement le plus important de son invention. Par un curieux hasard
du destin, Melville Bell, le père d'Alexander Graham Bell, aperçut
l'Euphonia à Londres en 1846 et en ressortit profondément
impressionné.
Bell père était un étudiant en acoustique, particulièrement
intéressé par la production de la parole. Toujours intrigué
par le souvenir de l'appareil de Faber, il emmena son fils Alexander
Bell, alors âgé d'environ seize ans, en 1863, voir
la « machine à parler » du scientifique
britannique Charles Wheatstone, celle qu'Henry avait jugée inférieure
à celle de Faber.
Après la visite, Melville mit Alexander et son frère au
défi de construire eux-mêmes une telle machine.
Cette année-là, ils commencèrent à travailler
sur le projet et réussirent rapidement à faire crier « Maman »
leur machine parlante.
Toutefois, jusqu’en 1854, personne n’avait
encore entrevu la possibilité de transmettre la parole, lorsqu’un
simple employé du télégraphe, Charles
Bourseul, publia une Note dans laquelle il imaginait un téléphone
primitif. Malgré tous ses efforts, il se heurta au scepticisme
général. Son appareil ne fut jamais réalisé,
car l’Administration française y opposa une fin de non-recevoir,
l’exploitation du télégraphe n’en étant
qu’à ses balbutiements.
En 1860, le physicien allemand Philippe Reis
construit un premier appareil basé sur la reproduction des sons
entrevue par Page en 1837 et pour la transmission électrique,
sur le système des membranes vibrantes qui avait été
utilisé dès 1855 par Léon Scott, dans son phonautographe.
L’appareil de Reis, perfectionné par MM. Yeates et Vander
était composé d’un transmetteur qui se composait
principalement d’un diaphragme fait d’une fine membrane à
laquelle est fixé un fil de platine reposant sur une tête
de platine réglable, et d’un récepteur. Le récepteur
était une simple aiguille à tricoter en acier enroulée
d’un fil de cuivre recouvert de soie, pour former un électroaimant,
et posé dans une caisse de résonance.
L’idée du téléphone était clairement
exposée, mais les savants de l’époque n’apportèrent
pas leur soutien à ce génial inventeur, bien qu’un
des plus célèbres vulgarisateurs de l’époque,
Victor de Parville prophétisât : « Bientôt
on parlera à distance avec la même facilité. La
parole se transmettra comme l’écriture »
Mais revenons à la décennie suivante, Alexander Bell poursuivit
plusieurs recherches qui aboutirent au téléphone. Aidant
son père dans ses travaux sur la production vocale, il apprit
à analyser la hauteur des voyelles en corrélant leurs
sons à l'aide d'un diapason.
Bell continua d'expérimenter la production mécanique du
son tout en se lançant dans une carrière d'enseignant
à la parole auprès d'élèves malentendants.
L'une de ses idées était de fabriquer un instrument transmettant
des vibrations permettant aux lecteurs labiaux de distinguer le « P »
du « B ».
Ce dernier instrument, selon le biographe de Bell, témoignait
de son intérêt pour le développement d'un télégraphe
multiple, c'est-à-dire capable de transmettre plusieurs messages
simultanément sur le même fil. Thomas Edison,
de seulement trois semaines son aîné, tentait également
d'en développer un. Mais l'approche harmonique de Bell était
différente : elle impliquait la transmission de différentes
hauteurs sur un fil et l'utilisation de récepteurs accordés
pour les réassembler.
Début 1874, après de nombreuses expérimentations,
Bell avait construit un télégraphe multiple harmonique
qu'il estimait prêt à être breveté. Il retarda
la demande après avoir reçu une lettre hautaine et décourageante
du surintendant en chef des télégraphes de la Poste britannique
à Londres. (Bell était originaire du Canada et donc sujet
britannique.) Mais breveter l'invention demeurait son objectif principal.
À l'été 1874, Bell commença à
explorer une autre idée : la « parole électrique »,
comme son père l'appelait dans un journal.
Il esquissa un appareil de harpe basé sur l'idée, selon
une lettre qu'il écrivit à ses parents, que « les
vibrations d'un aimant permanent induisent un courant électrique
vibrant dans les bobines d'un électroaimant ». Bell
émit l'hypothèse que si l'on parlait dans une harpe émettrice,
une série d'anches en acier vibreraient sur un aimant pour induire
un courant ondulatoire et reproduire le son à l'autre extrémité.
De cette manière, les fréquences complexes de la voix
humaine pourraient être transmises. Bell qualifia l'appareil nommée
harpe de « ma première forme de téléphone
articulé ».
Alors qu'il poursuivait ses recherches pour améliorer le télégraphe,
il apprit qu'Henry avait déjà découvert certains
des phénomènes acoustiques qu'il observait. Bell décida
donc de se présenter à Henry en mars 1875, lors d'un voyage
à Washington. Comme il l'écrivit dans une lettre à
ses parents, Bell souhaitait « expliquer toutes les expériences
et distinguer les nouveautés des anciens ».
La lettre de Bell à ses parents, écrite quelques semaines
après avoir rencontré Henry au Smithsonian, témoigne
de l'importance que le jeune scientifique attachait à cette visite.
À l'époque, Henry avait cinquante ans de plus que Bell,
alors âgé de vingt-sept ans. Bell décrit comment
Henry « écoutait d'un air impassible, mais avec un intérêt
évident pour tous, mais lorsque je lui racontai une expérience
qui, à première vue, semblait sans importance, je fus
surpris par l'intérêt soudain manifesté ».
Ce qui intrigua Henry, ce fut le son que Bell entendit provenant d'une
bobine de fil de cuivre vide lorsqu'un courant électrique la
traversa. Henry demanda à Bell de répéter l'expérience
pour lui, ce qu'il fit le lendemain.
« Son intérêt m'encouragea tellement », écrivit
Bell, « que je décidai de lui demander conseil sur l'appareil
que j'ai conçu pour la transmission de la voix humaine par télégraphe.
»
Bell souhaitait savoir s'il devait publier ses recherches immédiatement
ou continuer à travailler sur le problème lui-même.
Henry lui conseilla de le résoudre lui-même, le qualifiant
de « germe d'une grande invention ». Lorsque Bell a déclaré
qu'il estimait qu'il manquait des connaissances électriques nécessaires
pour surmonter certaines des difficultés mécaniques de
son appareil de harpe, Henry a simplement répondu : "GET
IT" « Acquérez-les». « Je ne peux vous
dire à quel point ces deux mots m'ont encouragé »,
dit-il à ses parents. « Je vis trop souvent dans une atmosphère
de découragement pour les recherches scientifiques…»
Une idée aussi chimérique que la télégraphie
vocale semblerait à la plupart des esprits difficilement réalisable
pour qu'on y consacre du temps. Je crois cependant qu'elle est réalisable
et que j'ai trouvé la solution. »
L'année suivante, avec l'aide de Thomas
Watson, Bell parvint à résoudre le problème.
Il déposa un brevet pour son téléphone le 14 février
1876, et le brevet fut officiellement délivré le mois
suivant. Le 10 mars, un an après sa rencontre avec Henry, Bell
réussit à transmettre la première parole humaine
intelligible par téléphone : les mots désormais
célèbres : « M. Watson, venez ici, je
veux vous voir.»
Henry continua de soutenir Bell dans ses efforts pour développer
le téléphone.
En tant que juge à l'Exposition du centenaire de 1876 à
Philadelphie, Henry soumit un rapport expliquant le fonctionnement et
l'importance de l'invention de Bell. Lui et les autres juges considéraient
le téléphone de Bell comme « la plus grande
merveille jamais réalisée par le télégraphe ».
En janvier 1877, alors que Bell était à Washington pour
déposer son deuxième brevet de téléphone,
il fit une démonstration du téléphone au Smithsonian
pour Henry et ses filles.
Il réitéra la démonstration le soir même,
à l'invitation de Henry, devant la Société philosophique
de Washington, dont Henry était le président. À
cette occasion, Henry parla de « la valeur et du caractère
étonnant de la découverte et de l'invention de M. Bell ».
Les témoignages de Henry et d'autres scientifiques éminents
contribuèrent à asseoir la crédibilité de
Bell à une époque où sa situation financière
était précaire. Dans un état d'instabilité,
il avait été contraint de reporter ses projets de mariage.
Les honoraires de ses conférences constituèrent sa principale
source de revenus en juillet 1877, lorsqu'il créa la Bell Telephone
Company avec Watson et deux autres associés.
Bell n'oublia jamais la contribution d'Henry. Peu après la mort
d'Henry en 1878, il organisa un service téléphonique gratuit
pour sa veuve, Harriet, et ses filles. Plusieurs années plus
tard, il intervint lorsque le téléphone fut mis hors service.
Dans une lettre adressée au président de l'American Bell
Telephone Company, son nom actuel, Bell expliqua pourquoi il insistait
fortement pour le rétablissement du service : « Ce
téléphone a été installé là
et aucun frais n'a été facturé en reconnaissance
des efforts et des services du professeur Henry, qui a contribué
aux débuts de l'invention de l'instrument et qui a grandement
contribué à encourager l'invention.»
La sollicitude de Bell envers la famille Henry se manifesta également
peu après la mort d'Harriet en 1882. Lorsque sa fille Mary eut
besoin de financement en 1883 pour un investissement immobilier et un
voyage d'affaires à New York, Bell accepta de lui acheter la
bibliothèque d'Henry pour 5 000 dollars. Bien des années
après la mort de Bell, ses descendants ont fait don de la bibliothèque
Henry au Smithsonian, ainsi que de quelque 2 000 livres et brochures
ayant appartenu à Bell. La bibliothèque Bell-Henry, comme
on l'appelle, unit à juste titre deux grands scientifiques...
Alexander Graham Bell fut nommé au conseil d'administration
de la Smithsonian Institution en tant que citoyen du district de Columbia.
Bell avait été influencé dans ses recherches par
le premier secrétaire de la Smithsonian Institution, Joseph Henry,
notamment par ses travaux sur l'induction électromagnétique.
Bell en a exercé quatre mandats jusqu'à sa mort en 1922.
Voila une belle histoire.