Les Antilles
françaises
Les Antilles françaises sont les îles
françaises de l'archipel des Antilles dans la mer des Caraïbes.
Ancienne partie intégrante des Îles et Terre Ferme de l'Amérique
et de l'Empire colonial français jusqu'en 1946, ces territoires
deviennent à cette date des départements d'outre-mer (collectivité
territoriale).
Répartie sur 2 835 km2, la population totale
des Antilles françaises est de 844 811 habitants en 2008.
L'archipel de la GUADELOUPE
qui forme administrativement avec ses dépendances à la fois
un département et une région d'outre-mer (DOM et ROM, ou
DROM) ainsi qu'une région ultrapériphérique de l'Union
européenne, son code officiel géographique départemental
(COG) est le 971. L'archipel se compose de deux îles principales
: Basse-Terre et Grande-Terre.
La Désirade : un haut plateau
calcaire de 21 km, située en plein océan Atlantique, elle
est l'île la plus orientale des Antilles françaises. L'île
dépend administrativement de la Guadeloupe.
Marie-Galante : la troisième
île la plus étendue des Antilles françaises. Elle
est également rattachée au département de la Guadeloupe
sur le plan administratif et jouit donc des prérogatives relatives
au statut européen de ce dernier.
L'archipel des Saintes : composé
de deux terres habitées (Terre-de-Haut et Terre-de-Bas) et de quelques
ilots déserts. Il est également une dépendance administrative
du département de la Guadeloupe et inclut donc les régions
ultrapériphériques de l'union européenne par l'intermédiaire
de celui-ci.
Saint-Barthélemy :
cette île du nord des Antilles, ancienne dépendance
de la Guadeloupe, est devenue sur le plan administratif, une collectivité
d'outre-mer (COM). Même si le code postal 97133 relatif à
la Guadeloupe demeure, son code est le 977 depuis les changements intervenus
à la suite de la loi organique no 2007-223 du 21 février
2007 publiée au Journal Officiel no 45 du 22 février 2007
portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l'outre-mer. Elle est incluse parmi les régions ultrapériphériques
de l'Europe jusqu'au 1er janvier 2012, date officielle où l'île
est devenue le premier pays et territoire d'outre-mer français
de la Caraïbe.
La MARTINIQUE : l'île de la Martinique forme administrativement une Collectivité territoriale unique d'outre-mer sous le code officiel géographique 972. Elle compte aussi parmi les régions ultrapériphériques de l'Europe.
Saint-Martin : la partie nord de l'île est française. Le sud est, quant à lui, le territoire du pays autonome Sint-Maarten du royaume des Pays-Bas. Depuis la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007 publiée au Journal Officiel no 45 du 22 février 20072, dans les mêmes conditions que Saint-Barthélemy, la partie française, ancienne dépendance de la Guadeloupe, est passée du statut de commune à celui de collectivité d'outre-mer (COM). Son C.O.G est 978, même si le code postal 97150 relatif à la Guadeloupe reste d'actualité3. Elle est incluse dans les régions ultrapériphériques de l'Europe.
Haïti est un État des Gandres Antilles, occupant le tiers occidental de l'île d'Hispaniola (soit 27 750 km2 environ), les deux tiers orientaux étant occupés par la République dominicaine. Sa capitale est Port-au-Prince.
sommaire
Connaître les colonies Françaises
Comment communiquer avec ses lointaines colonies ?
A - Les câbles de télécommunications sous-marins
installés entre 1850 et 1956 ont servi au réseau mondial
de télégraphie par câblogrammes, ils utilisaient d'abord
une technologie de câbles binaires en cuivre pur isolés à
la gutta-percha, puis coaxiale à partir de 1933 grâce à
la découverte du polyéthylène.
La France s'est toujours intéressée aux câbles sous-marins.
Et pour cause, elle fut l'une des deux grandes puissances coloniales,
et les câbles télégraphiques apportaient la solution
pour diriger les colonies à partir de la métropole.
Le développement du réseau fut modeste au tout début,
mais à compter de 1893 et jusqu'en 1914 l'effort fut considérable,
et permit de s'affranchir des Anglais pour relier métropole et
colonies.
1886 : « A la Chambre des Députés est adobté
le Projet de Loi portant approbation d’une convention relative
à l’établissement de câbles télégraphiques
sous-marins destinés à desservir les colonies françaises
des Antilles et de la Guyane française, présenté
par Jules GRÉVY Président, Sadi CARNOT Ministre des finances,
Le Vice-Amiral AUBE, Ministre et par M. GRANET Ministre des Postes et
des Télégraphes. ».
La Société française des télégraphes
sous-marins est une société française créée
en 1888 pour assurer une liaison par câble entre les Antilles et
le Venezuela puis entre la Nouvelle-Calédonie et l’Australie.
Elle a fusionné en 1895 avec la Compagnie française du télégraphe
de Paris à New-York.
En 1896 l’Etat impose notamment la création de la Compagnie
française des câbles télégraphiques (CFCT)
à partir des biens de l’entreprise en faillite Pouyer Quertier
et de la Compagnie des Antilles (SFTSM).
En 1899 une note sur l’opportunité d’une liaison
entre Marseille et le Sénégal et les possessions occidentales
françaises est écrite en mars et une étude sur l’établissement
d’un réseau télégraphique sous-marin est réalisée
au mois d’août la même année ...
Ainsi se construit année par année un réseau par
câbles sous-marins (voir la page
sur ce site).
A ces raisons domestiques, qui modèrent les résolutions
prises, s’ajoutent la catastrophe naturelle qui éclate à
St Pierre et Miquelon en 1902 (éruption volcanique de la Montagne
Pélée) et qui refroidit les ardeurs en provoquant de multiples
ruptures de câbles sous-marins dans les Antilles, qui sont tous
portés par une entreprise française, la CFCT.
Cette « crise des câbles » du début du XXe siècle
reflète ainsi la posture plus générale de la France
dans le domaine : alors qu’un intérêt continu de l’Etat
français pour ce réseau se constate depuis les origines
télégraphiques du réseau, dans la pratique les actions
de l’Etat à l’égard du réseau sont, elles,
en demi-teinte.
En 1939, le réseau français comptait environ 60 000
km et était essentiellement orienté vers la Méditerranée
et vers l'Afrique occidentale, avec deux traversées Atlantique
Nord et Atlantique Sud. Le réseau mondial, quant à lui,
cerclait le globe d'environ un demi-million de kilomètres de câbles
télégraphiques.
B - Arrive la T.S.F qui signifie Télégraphie
Sans Fil, c'est ce concept que la France va adapter pour communiquer
avec le monde entier.
En 1896 c'est le début de la télégraphie sans
fil (Marconi) puis dès 1899, le général Gustave
Ferrié chargé d’organiser les transmissions militaires.
chercheur et ingénieur, applique la T.S.F à l'armée.
Il crée la radiotélégraphie militaire .
Puis la radiodiffusion viendra par la suite se greffer à
ces réseaux, Gustave Ferrié installe en 1904 des antennes
à la tour Eiffel ...
En 1911, un plan global de construction d'un réseau mondial
de stations de Radiotélégraphie pour nos besoins propres,
mais aussi extérieurs est élaborés par une équipe
de spécialistes animée par Ferrié.
Il est décidé que la liaison entre la France et nos possessions
d'outre-mer se ferait rapidement par voie hertzienne de façon à
s'affranchir du câble.
Ainsi vont naitre des stations à Bamako, Tananarive,
Tombouctou, mais aussi à Saïgon,
Papeete, Cayenne, Fort de France
pour n'en citer que quelques unes.
Dès 1910, un réseau de communication se met en place en
Afrique du Nord. Il s'appuit sur les stations télégraphiques
de Bizerte en Tunisie, Fort de l'eau et Oran en Algérie et Casablanca
au Maroc. Sous l'impultion du commandant Ferrié, du capitaine Brenot
et de bien d'autres pionniers, ce réseau sera par la suite étendu
à d'autres stations puis relié vers le sud à Tombouctou
puis aux stations d'Afrique centrale Dakar, Konakry, Monrovia, Tabou,
Grand-Bassam, Cotonou, Brazaville et Léopoldville.
1917 La France, après l'Angleterre, travaille
à la construction d'un réseau mondial de télégraphie
sans fil qui lui appartienne et fasse le tour de l'univers en n'empruntant
que des points d'appui sur sol français.
Les principaux points de départ indiqués sont : Paris (Tour
Eiffel), Brest, Lyon et Marseille. La route suivie autour du globe passe
par les points suivants: Paris (ou Brest), Saint-Pierre (Nouvelle-Écosse),
Martinique, Iles Marquises, Tahiti, Nouméa, Saïgon, Pondichéry,
Djibouti, Dahomey, Tombouctou, Tunis, Marseille-Paris.
Les autres grandes possessions françaises (Cayenne, Madagascar,
Sénégambie) se relient à la ligne principale par
des lignes secondaires.
Déjà en 1918 est produit une ESQUISSE
DU RÉSEAU TRANSOCÉANIQUE FRANÇAIS
— ORGANISATION D'ENSEMBLE DU RÉSEAU TELEGRAPHIQUE.
Le réseau transocéanique français, de vue de ses
relations télégraphiques avec l'étranger, permettant
d'atteindre n'importe quel pays du monde à partir d'une station
établie en territoire français et d'établir des communications
entre la France et les différentes parties de son empire colonial,
devra consister en un ensemble de stations de 7.000 kilomètres
de portée environ, doublées par d'autres, moins importantes,
de 3 à 4.000 kilomètres de portée.
La base de tout le système serait constituée par une ligne
continue de radiocommunications, formée d'une série de postes
de 7.000 kilomètres de portée environ, établis tous
en territoires français, et enserrant toute la terre. Cette ligne
suivie en allant ¦de l'Est à l'Ouest, passerait par: Tahiti,
Nouvelle-Calédonie, Indochine, Djibouti, Paris; puis se bifurquerait
en deux branches aboutissant au Sénégal et à la Martinique
.
Les diverses stations de cette ligne principale pourraient atteindre :
- D'une part, des correspondants établis aux Indes françaises,
Madagascar, l'Afrique Équatoriale française, le Maroc, l'Algérie,
la Tunisie, et assurer ainsi les communications des différents
points de l'empire colonial français entre eux et avec la métropole
;
- D'autre part, les États-Unis (côtes de l'Océan Atlantique
et de l'Océan Pacifique), le Japon, la Chine, l'Australie, l'Amérique
-centrale, le Brésil, la République Argentine, et assurer
ainsi les communications de la France avec l'étranger.
Le centre de radiocommunications françaises pourrait
être constitué par une station quadruple, comprenant quatre
postes: trois à grande puissance affectés :
- Le premier aux relations avec les États-Unis ;
- Le deuxième aux lignes de la Martinique et du Brésil ;
- Le troisième aux lignes de l'Afrique occidentale et de Djiboutiet
un poste à puissance restreinte affecté aux lignes de l'Afriquedu
Nord (Algérie, Tunisie, Maroc).
- Les stations de l'Afrique Occidentale française, de Djibouti
et d'Indochine devraient être prévues doubles, comprenant
chacune deux postes, l'un de grande puissance pour le trafic à
grande distance, l'autre de puissance réduite pour le trafic plus,rapproché.
De sorte qu'en résumé, le réseau serait constitué
par l'ensemble de stations suivantes :
STATION QUADRUPLE.
1 Emplacement : France (3 postes de grande puissance). (1 poste de moyenne
puissance).
STATIONS DOUBLES.
3 Emplacements : Djibouti. Afrique occidental (1 poste de grande pUIssance):
Indochine (1 poste de moyenne puissance).
STATIONS SIMPLES
3 Emplacements Martinique : Nouvelle-Calédonie. (de grande puissance)
Tahiti.
STATIONS SIMPLES
9 Emplacements Congo.Maroc. Algérie. Tunisie. Madagascar, Indes
françaises, (de moyenne puissance).
Chaque station devra remplir les conditions suivantes :
1° Rayonner une quantité d'énergie suffisante
pour pouvoir réaliser, de jour et de nuit, dans toutes les circonstances,
la portée pour laquelle elle est établie.
2° Posséder des rechanges assez largement prévues
pour permettre un service absolument continu.
3° Assurer l'exploitation en duplex et à grande vitesse.
4° Mesures à prendre pour assurer les radiocommunications
en toutes circonstances. — L'énergie rayonnée par les
postes d'émission doit être suffisante pour permettre un
service continu de jour et de nuit.
Actuellement aucune des stations en service n'est assez puissante pour
réaliser cette condition à la distance de 7.000 kilomètres;
mais que l'emploi de moyens techniques suffisants, moyens existants d'ailleurs
à l'heure actuelle, donnera très probablement la solution
du problème.
J'estime que, pour réaliser la portée de 7.000 kilomètres
dans de bonnes conditions, il y a lieu de prendre les mesures suivantes
:
- 1° Au point de vue antenne, accroître autant que possible
le rendement :
Soit en augmentant la hauteur des antennes jusqu'aux limites qu'il est
actuellement possible d'atteindre, et qui pourraient être cinq à
six cents mètres ;
Soit en faisant des antennes de hauteur modérée, mais de
très grande étendue, de telle sorte qu'on puisse diminuer
la résistance de la prise de terre par des dispositifs appropriés.
Il est d'ailleurs probable que la première solution, réalisée
sous la forme d une antenne supportée par un pylône central
unique de grande hauteur, donnera, à résultat égal,
la solution la plus économique.
- 2° La puissance fournie à l'antenne ne sera pas inférieure
à 500 kilowatts. Cela signifie que, si l'on admet pour le rendement
d'ensemble, ou rapport de l'énergie fournie à l'antenne
à l'énergie empruntée au réseau de distribution
ou à l'usine génératrice, une valeur égale
à 33 % ce qui paraît être l'ordre de grandeur obtenue
en moyenne dans les installations existantes, que la puissance totale
absorbée sera de l'ordre de 1 500 kilo-watts.
Pour les stations de 4.000 kilomètres de portée, le problème
sera plus facile à résoudre, en prenant modèle sur
des radiocommunications actuellement en service.
- 3° De grandes antennes permettant de rayonner de grandes quantités
d'énergie avec un bon rendement sur de grandes longueurs d'ondes,
il y aura lieu, pour faciliter la production de grandes puissances et
la propagation, de prévoir des longueurs d'ondes notablement plus
grandes que celles qui sont couramment employées aujourd'hui. On
sera conduit probablement à adopter 15 à 25.000 mètres.
- 4° Toutes ces stations devront être équipées
de façon à pouvoir travailler à puissance réduite,
la puissance totale installée ne devant être utilisée
que quand des difficultés de propagation le rendent nécessaire.
5° Les emplacements des postes d'émission devront réaliser
l'ensemble des conditions suivantes :
- 1° Permettre l'établissement d'une bonne prise de terre;
- 2° Être autant que possible à proximité d'un
important réseau de distribution électrique, ce qui permettrait
d'éviter les frais de construction d'une usine génératrice
;
- 3° Correspondre aux plus courtes distances possibles par rapport
aux stations correspondantes.
Le choix des emplacements des postes de réception et de manipulation
devra également être le résultat d'une étude
approfondie. La principale condition à réaliser sera que
les parasites soient réduits au minimum. Par exemple, dans le cas
des stations françaises, les régions du Nord seront à
ce point de vue beaucoup plus avantageuses que les rivages de la Méditerranée.
Il y aura d'ailleurs intérêt à rapprocher autant que
possible les postes de réception du siège du Gouvernement
ou de la ville principale.
- 4° Mesures à prendre pour permettre l'exploitation en duplex.
— L'obligation de prévoir un service duplex entraînera
celle de séparer, dans chaque station, les postes de transmission
d'une part, de réception et de manipulation d'autre part, en les
éloignant suffisamment pour que la syntonie et au besoin les propriétés
des antennes dirigées permettent de faire en sorte que le poste
de réception n'entende pas les signaux du poste d'émission
voisin.
— ORGANISATION DES STATIONS.
Il s'agit, en fait, de prévoir l'organisation générale
des stations, simples ou multiples, de façon à pouvoir leur
faire rendre le maximum d'efficacité.
Celle-ci peut être conçue de plusieurs façons. Pour
discuter les mérites et les inconvénients de chacune des
solutions, nous raisonnerons sur l'exemple le plus complexe et le plus
intéressant : celui du système français.
Nous avons vu plus haut qu'il y a lieu de le constituer de quatre stations
simples.
Trois stations simples de très grande puissance destinées
respectivement au trafic avec :
Les États-Unis; La Martinique et le Brésil; le Sénégal
et Djibouti.
Une station simple de grande puissance destinée à
communiquer avec l'Afrique du Nord.
En ce qui concerne les postes de transmission, les emplacements suivants
paraissent réaliser les conditions que nous avons indiquées.
Région de la Basse-Loire, pour les communications avec les États-Unis
;
Région de Bordeaux, pour les communications avec la Martinique
et le Brésil ;
Région de Nîmes pour les communications avec le Sénégal
et Djibouti ;
Région d'Arles pour la ligne de l'Afrique du Nord.
Au point de vue des postes de réception et de manipulation, deux
solutions peuvent être envisagées ;
- Ou bien faire correspondre à chaque poste de transmission un
poste de réception voisin ; constituer en somme quatre stations
complètement indépendantes l'une de l'autre comme sur la
figure 1 :
fig 1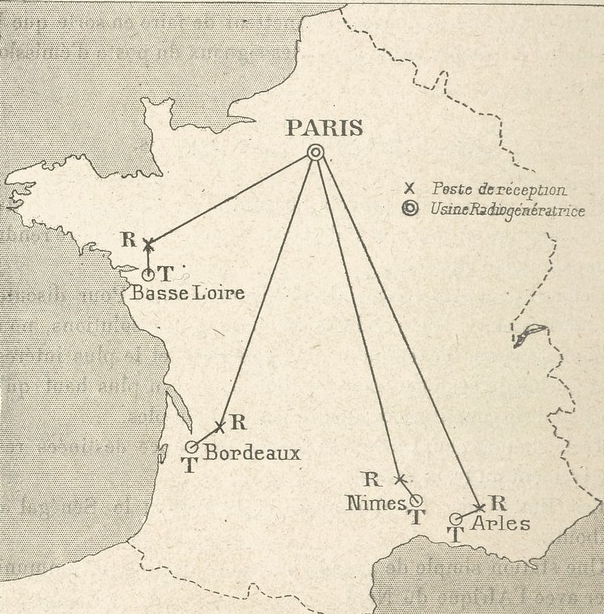 fig 2
fig 2 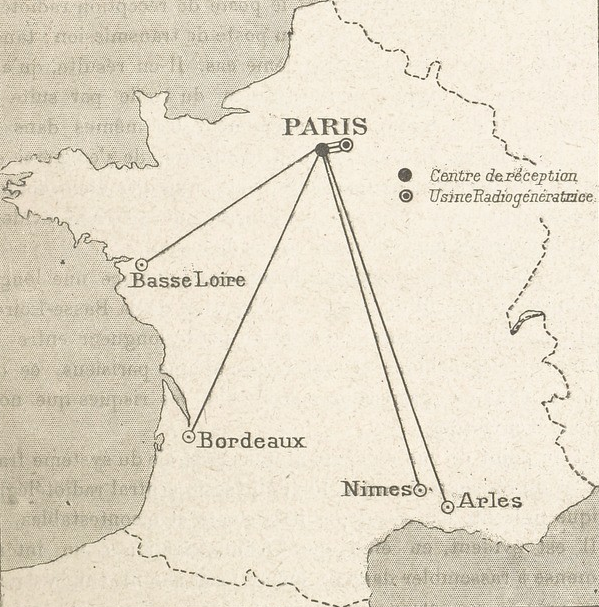
- Ou bien rassembler tous les postes de réception et de manipulation
dans un même local, sur un emplacement situé dans Paris ou
à proximité de Paris ; constituer, en somme, un grand central
radiotélégraphique parisien (fig.2).
Dans les deux hypothèses, d'ailleurs, des fils
spéciaux devront réunir les postes de transmission aux postes
de réception et ceux-ci à Paris
La première remarque à faire est que, dans le cas de la
transmission, les parcours télégraphiques par fils sont
exactement les 'mêmes dans les deux cas et que par suite les causes
de dérangement du fait du mauvais fonctionnement des fils sont
également les mêmes.
Dans le premier cas, en effet, un radiotélégramme partant
transmis par fil du central télégraphique au poste de réception
de la station radiotélégraphique de la Basse-Loire ; puis,
de là, de nouveau par fil, au poste de transmission de cette même
station, puis enfin, émis radiotélégraphiquement
par l'usine radiogénératrice. Dans l'hypothèse d'un
central radiotélégraphique parisien, le même télégramme
sera transmis par fil du central télégraphique au central
radiotélégraphique, puis de là de nouveau par fil,
à l'usine radiogénératrice de la Basse-Loire, puis.
enfin émis radio télégraphiquement par cette station.
Les parcours par fils sont équivalents dans les deux cas ; la seule
différence est que, dans le premier cas, le trajet le plus long
est entre le central télégraphique et le poste de réception
radio télégraphique et le plus court de là au poste
de transmission ; tandis que c'est l'inverse dans le deuxième cas.
Il en résulte, qu'à la. transmission, les risques d'interruption
du trafic par suite de. dérangement des lignes sont exactement
les mêmes dans les deux hypothèses. Il n'y a pas lieu, d'ailleurs,
de s'exagérer ces. risques, les fils spéciaux que nous avons
envisagés étant doublés par ceux du réseau
télégraphique général, qui peuvent évidemment
leur prêter leur concours en cas de besoin.
A la réception, la deuxième hypothèse remplace une
longue transmission par fil du poste de réception de la Basse-Loire
it Paris, par une transmission par fil de petite longueur entre les centraux
télégraphique et radiotélégraphique parisiens,
ce qui diminue dans une proportion considérable les risques que
nous venons d'envisager.
Et au point de vue de l'exploitation générale
.du système français et du réseau tout entier, l'hypothèse
du central radiotélégraphique présente des avantages
importants et incontestables.
Il est évident, en effet, que l'Administration a un intérêt
immense à rassembler dans un même local sur un emplacement
situé près de ses services centraux et près du Gouvernement
les organes d'impulsion commandant l'important réseau prévu,
qui assurant les relations de la France avec le monde entier, aura dans
l'organisation mondiale de la puissance française, le rôle
que joue le système nerveux dans le corps humain.
A un point de vue moins étendu, il est nécessaire,
pour une bonne exploitation, que les diverses stations transocéaniques
françaises, parties juxtaposées d'un même organisme
travaillent sous une même impulsion. C'est d'autant plus nécessaire
pour une exploitation aussi délicate qu'une exploitation arrêtée,
de sorte qu'on pourra supprimer Les quatre stations génératrices
d'électricité qui devaiemt être prévues dans
le premier
cas et réaliser une économie, de plusieurs millons.
Pour toutes, ces raisons : commodité d'exploitation
; exploitation plus intensive du réseau, économies importantes
que cette solution permettra de réaliser, j'estime que la station
quadruple française centre de tout le réseau transocéanique
doit être constituée par :
1° un central radio télégraphique de réception
et de manipulation établi à Paris ou à proximité
et comportant quatre ensembles (appareils et antennes) pour les radiocommunications
envisagées ou seront centralisées la réception et
la manipulation, et d'où sera. réglé à chaque.
instant l'exploitation ;
2° Quatre usines radiogénératrices produisant
l'énergie à haute fréquence et transformant automatiquement
en signaux radiotélégraphiques les signaux qui lui sont
transmis par fil du central radiotélégraphique.
Organisation des stations doubles.
Les stations doubles prévues au Sénégal, en
Indo-Chine et à Djibouti devront être prévues
suivant les mêmes principes que la station quadruple
française; : elles comprendront alors chacune :
Un central radio télégraphique de réception et die
manipulation établi dans la capitale de la colonie, comportant
deux ensembles (appareils et antennes) pourries radiocommunications envisagées,
où seront centralisées la réception et la manipulation,
et d'où sera réglé à chaque instant l'exploitation
de l'ensemble.
Deux usines radiogénératrices d'émission : L'une
d'une portée de 7.000 kilomètres ; L'autre d'une portée
de 4000. kilomètres, produisant et rayonnant l'énergie sous
forme de haute fréquence et transformant automatiquement en signaux
radiotélégraphiques les signaux qui lui seront transmis
par fil du central radiotélégraphique. Ces usines génératrices
seraient placées aux points les plus favorables au point de vue
technique.
Dans le cas de la station de Dakar l'usine génératrice d'émission
à longue portée. serait réservée eh prmeipe
aux eommunications à grande distance (France, République
Argentine) ; l'usine radiogénératrice à moyenne puissance,
aux communications à moyenne distance (Maroc, Brésil, Afrique
équatoriale).
Le poste à grande puissance du Sénégal serait affecté
normalement aux relations avec Djibouti, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie.
Le poste à moyenne puissance, aux communications avec le Japon,
les Indes, les Philippines.
Le poste de grande puissance de Djibouti serait normalement réservé
aux relations avec la France et l'Indochine ; celui de moyenne
puissance aurait pour correspondants Madagascar et Pondichéry.
— LE ROLE DE LA FRANCE DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
Quel que soit le système qui sera choisi pour le réseau
transocéanique français, il est certain que la France trouvera
chez elle des ingénieurs et des techniciens capables d'assurer
dans de bonnes conditions l'exécution de cette œuvre considérable.
Si, en effet, l'état de guerre actuelle oblige à laisser
dans l'ombre la plupart des progrès réalisés dans
notre pays, il n'en est pas moins vrai que ceux-ci sont très intéressants.
- Au point de vue pylônes, c'est une œuvre française,
la Tour Eiffel, qui tient toujours le record de la hauteur et c'est en
France que se préparent les projets où les hauteurs peuvent
atteindre 500 mètres et plus.
- Au point de vue systèmes, nous trouvons également d'importantes
réalisations et des perspectives d'avenir intéressantes.
- La méthode à arc, dont nous avons vu l'essai en Amérique
a sous l'impulsion du Colonel Ferrié et de ses éminents
collaborateurs, suivi en France, depuis 1915, un développement
parallèle ; de très puissantes installations fonctionnent
actuellement en France, et la puissance s'accroît de jour en jour.
- Les brevets de l'alternateur Goldschmidt sont, ainsi que nous l'avons
vu en ce qui concerne tous les pays excepté l'Allemagne la propriété
de la Compagnie Universelle de Télégraphie et de Téléphonie
sans Fil.
- La méthode de la multiplication de fréquence par transformateurs
statiques est d'origine française.
- Les procédés employés en, Allemagne ont été
inventés par un éminent savant français, M. Maurice
Joly, mort à la peine, peu après sa découverte. -
Les brevets de M. Joly sont un modèle d'exposé clair et
approfondi. La compagnie générale de radiotélégraphie
a, sous l'impulsion de son Directeur technique, M. G.-E Petit, constamment
développé la méthode et construit actuellement des
postes de grande puissance avec multiplicateurs de fréquence.
- D'autre part, la Société française radioélectrique
a, depuis longtemps, mis au premier rang de ses préoccupations
le problème de l'alternateur à haute fréquence. M.
J. Bethenod a étudié,dans une série d'intéressants
mémoires, les questions de l'emploi des ondes entretenues en télégraphie
sans fil. M. Marius Latour a récemment construit un alternateur
de haute fréquence de petite puissance et le résultat de
l'essai fait prévoir que la puissance
peut être augmentée suffisamment pour qu'on puisse envisager
l'application de la méthode aux grandes puissances.
- Enfin le procédé des étincelles commandées
était étudié par le Service de la télégraphie
sans fil des Postes et Télégraphes en même temps que
Marconi, d'une façon indépendante, d'ailleurs, poursuivait
les expériences dont nous avons parlé et que je ne connaissais
pas alors.
Dès mai 1917, à un moment où le problème de
la construction dans un court délai, d'une station transatlantique
avait été posé, j'avais envisagé la création
d'une station dans laquelle l'énergie fournie aux condensateurs
aurait été 800 kilowatts, l'énergie étant
d'ailleurs répartie entre quatre circuits suivant le schéma
suivant, équivalent à celui de Marconi.
Lès lignes suivantes, empruntées à un rapport fait
à cette occasion, précisent le principe de la méthode
:
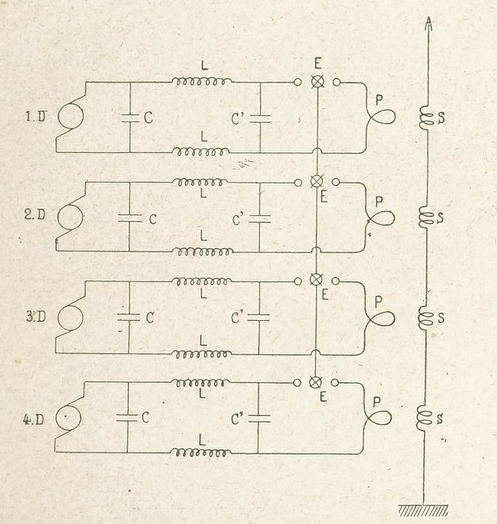 |
« Considérons par exemple le schéma
d'installation ci-joint : « Le circuit d'antenne comprend les 4 secondaires S des 4 radiotransformateurs.. « Les 4 éclateurs E sont montés sur le même arbre, mais les pôles fixes (ou les pointes) sont décalés de telle sorte que les éclatements aient lieu à intervalles réguliers dans l'ordre suivant pour les différents ensembles. « Les quatre ensembles fonctionnent indépendamment les uns des autres et l'antenne se trouve ainsi excitée, comme elle le serait par un seul circuit de décharge identique aux quatre précédents, mais dont l'éclateur supporterait une puissance quatre fois plus grande » |
Toutes les solutions qui peuvent être envisagées pour la production de courants de haute fréquence entretenus, et de grandes puissances sont donc actuellement en France l'objet d'études approfondies. Il n'est pas douteux que notre pays puise réaliser à son honneur la grande œuvre que sera le réseau transocéanique français, œuvre qui lui donnera le premier rang dans le monde au point de vue des radiocommunications, et qui contribuera à la grandeur de la France en facilitant le rayonnement de sa pensée à travers le monde.
sommaire
Au lendemain de la guerre 14-18, le réseau à grande distance télégraphique
va se fondre avec le réseau téléphonique qui, peu à peu, a réussi à vaincre
les problèmes de l’affaiblissement avec lesquels il était confronté. Les
communications télégraphiques à courte distance encore équipées en Morse
sont remplacées par des liaisons téléphoniques spécialisées. 60 millions
de télégrammes sont transmis en 1920, le nombre tombe à 30 millions en
1939.
La radiotélégraphie apparut comme un remède permettant à la France
de s’affranchir de la tutelle étrangère.
En 1922, la France disposera à Sainte-Assise près de
Melun, de l'émetteur de radiotélégraphie le plus
puissant du monde avec une puissance antenne de 1 000 KW. Des tests avaient
montré que les ondes émises étaient détectables
depuis les antipodes et pouvaient même faire le tour de la terre.
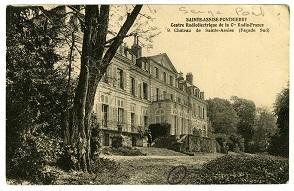 Sainte-Assise
Un
peu d'histoire sur le site de Radio France .
Sainte-Assise
Un
peu d'histoire sur le site de Radio France .
Notre pays, avec ses six grands postes (ceux de la Tour Eiffel et de Saint-Pierre-des-Corps
(près de Tours), appartenant au ministère de la Guerre,
celui de Basse-Lande (près de Nantes) appartenant au ministère
de la Marine, ceux de la Doua à LYON et de La Croix d'Hins à
Bordeaux, construits par la Guerre et administrés par les Postes
Télégraphes et Téléphones et enfin celui de
Sainte-Assise) n'a plus aucun problème pour communiquer avec nos
territoires éloignés de la métropole et avec bien
d'autres pays du monde.
La station Lafayette/Croix d'Hins qui permettait déjà, depuis
1920, des liaisons militaire avec les Etats-Unis, assure en 1924, un tiers
des liaisons civiles entre la France et le Continent Nord-américain
relayée par 3 stations de radio aux USA et 3 autres en Europe et
ceci malgré la concurrence que les dix-sept câbles sous-marins,
en service entre l'Amérique du Nord et l’Europe faisaient
à la Radiotélégraphie.
A l'inverse de la télégraphie terrestre, le "sans fil"
ne demande, en implantation, que quelques mètres carrés
de terre et respecte les croyances les plus superstitieuses des autoctones.L'information
peut-être transmise sur de longues distances sans relais intermédiaire,
ce qui n'est pas le cas pour la télégraphie terrestre.Le
fil ne peut pas être coupé en dehors de quelques effacement
de signaux par temps d'orage.
Entre 1922 et 1969 – Radio et câbles. Concurrence
ou complémentarité ?
À partir de 1922, le câble n’est
plus le seul support des télécommunications à grande
distance, car la radio permet d’établir des liaisons télégraphiques
sans fil de qualité commerciale. En France, la CSF est en mesure
de construire le réseau colonial qui fonctionne entre Paris, Saigon,
Hanoi, Brazzaville, Tananarive, La Réunion, Bamako et Dakar. L’Indochine
sert de relais au trafic à destination de la Nouvelle-Calédonie
et de la Polynésie. Ce grand programme est réalisé
au cours de la décennie 1920 – 1930 et il permet à
la France et à l’Allemagne de construire des réseaux
nationaux indépendants. Cela n’empêche pas le réseau
de l’Eastern Telegraph de s’étoffer et de se moderniser
pour régner sans partage entre Londres et l’Extrême-Orient
et l’Australie. Après 1918, la compagnie Radio Marconi and
Wireless devient un sérieux concurrent pour l’Eastern. Les
deux intervenants connaissent des difficultés financières
avec la crise mondiale à partir de 1929 lorsque le trafic international
s’effondre. Le gouvernement britannique intervient et sous sa pression,
toutes les compagnies câblières britanniques et Radio-Marconi
se regroupent. La fusion de Radio-Marconi et l’Eastern Telegraph
se fait au bénéfice du câble (56% -44%) et évite
une concurrence dangereuse entre les deux techniques. Après 1930,
l’exploitation de la télégraphie est automatisée
et devient moins coûteuse en personnel. La radio utilise les ondes
courtes dont les équipements terminaux sont moins volumineux. À
partir de 1935, elle offre un service téléphonique à
grande distance entre Londres ou Paris vers New York, Buenos-Aires, Saigon,
Le Cap et Sydney. Cependant, la radio ne remplace pas le câble,
même après la Deuxième Guerre mondiale lorsque les
réseaux de câbles sous-marins sont endommagés. Dans
tous les pays, les câbles sousmarins sont réparés
et remis en service après la guerre. Dans l’océan Indien,
ils continuent d’assurer le service télégraphique jusqu’en
1978, année de fermeture du centre d’Aden.
Algérie 1922,
Alger est équipé d'un poste en Ondes Entretenues
(300 et 600 m) exploité par les PTT (Alger TSF - indicatif FFA).
La station radiotélégraphique du FORT-de-L'EAU (actuellement
BORDJ el KIFFAN) était installée sur un terrain militaire,
dans la baie d'Alger, non loin du village de Fort-de-l'Eau, station balnéaire
très fréquentée dans les années 60 par les
Algérois.
Il existait aussi une station installée à Aïn-el-Turck
(indicatif FUK) dans la région d'Oran, qui transmettait plus particulièrement
des informations météorologiques et une autre à Oran
même (indicatif FUO).
La Tunisie sous protectorat français
dans les années 1920. en 1920 un émetteur était en
exploitation à Cap Bon (indicatif FFT) et un autre à Bizerte
(FUA).
Le Maroc sous protectorat
français dans les années 1920 possède, à cette
époque, une station de télégraphie sans fil dans
les principales villes : à Rabat (CNF), à Casablanca (CNP),
à Mogador (CNY), à Tanger (CNW) et à Fez (indicatif
non retrouvé).
Des stations de T.S.F. sont installées aussi dans les villes de
garnison comme par exemple Taourirt au Maroc oriental ou Tadla, plus au
centre du pays, au sud du Moyen Atlas.
Le Cameroun Passé
sous mandat français en 1919 suite au traité de Versailles,
le Cameroun dispose à Douala au bord du golfe de Guinée
d'une station de télégraphie de puissance.
Madagascar et l'Archipel des Comores Il
existe vers 1920 au moins 4 stations dans cette région :
Diego Suarez (FDG) au nord de Madagascar (actuellement Antsiranana),
Majunga (FJA) sur la côte ouest de Madagascar,
Dzaoudzi (FDO) à Mayotte,
Mutsamudu (FLU) sur l'île de Ndzuani-Anjouan aux Comores
Mauritius (BZG) à l'Ile Maurice - Emetteur anglais
La Radio Diffusion Nationale - Radio Tananarive - émet à
partir d'avril 1931
L'Indochine Avant la mise en place de liaisons
hertziennes, il n'y avait pas d'autres moyens pour notre pays de communiquer
rapidement avec nos colonies d'Indochine que de louer des câbles
sous-marins appartenant à des Compagnies étrangères.
Pour remédier à cette insuffisance, dès 1911, M.
Serraut, alors gouverneur général de l'Indochine française,
faisait décider la construction à Saïgon (actuellement
Ho Chi Minh-Ville - Vietnam) d'un grand poste de T. S. F. en communication
directe avec la métropole. Le matériel est immédiatement
commandé. Sur le port de Marseille, dans des caisses, un émetteur
"à étincelles" de 50 kW construit par la S.F.R.
est en instance de départ pour Saïgon.
Nous sommes à la veille de la Grande Guerre. Requisitionné
par l'autorite militaire, ce matériel sera installé à
Lyon-la-Doua.
Après la guerre, les travaux sont repris à Saïgon.
Le premier boulon des pylônes du nouvel émetteur sera posé
par le maréchal JOFFRE à la fin de l92l, lors de son voyage
en Extrême-Orient. Le ler janvier 1924, M. Albert SARRAUT, ministre
des Colonies, inaugure par un échange de messages, la première
station de T.S.F. construite en lndochine à Phu-Tho à 4,5
km à l'Ouest de Saïgon pour le poste émetteur et à
Thang-Phu, à 20 km au N-E pour le poste récepteur.
Fourni par la Compagnie Générale de T. S. F., l'émetteur
sera identique à celui installé à Bordeaux-Croix
d'Hins à la même époque. Sa puissance sera aussi la
même : 500 kilowatts-antenne. Il sera en liaison avec le poste français.
La distance qui sépare les deux installations est de plus de 10
000 km. Malgré des conditions climatiques qui pouvaient être
difficiles, la communication pourra être assurée dans de
bonnes conditions.
Il existait aussi un émetteur à Tourane ( Da Nang) - indicatif
FLT et à Cap-Saint-Jacques (Vung Tau) - indicatif FCA et à
Poulo-Condor.
Une station de grande puissance était en service à Hanoï
dès 1910. Hai Phong avait aussi un émetteur (Kien-An - indicatif
FKA).
En Inde Dans les colonies françaises d'Océanie ,la France possède au début du siècle dernier plus de 120 îles en l'Océanie dont les plus grandes sont Taïti en Polynésie et la Nouvelle Calédonie aux antipodes de notre pays. La mise en place de liaisons télégraphiques "sans fil" représente un enjeu stratégique important pour s'affranchir du cable sous-marin exploité le plus souvent par des sociétés anglaises.
En Polynésie Française Une station de télégraphie sera installée à Papeete à Taïti et fonctionnera dès fin 1915 (indicatif FOP)
En 1949, L'Administration des PTT fait installer par la SFR, un émetteur Thénieux Graphie-Phonie.
La liaison était difficile à certaines heures, car l'arc de grand cercle passant par Papeete et Paris (chemin le plus court - 18 000 Km) passe près du Pôle Nord et la liaison subissait de ce fait à certaines heures des perturbations magnétiques importantes.
En Nouvelle Calédonie Un émetteur est en service en 1920 à Nouméa. (Nouméa-Sémaphore - indicatif FQN).
En 1922, l'Afrique Française comptait les stations suivantes :
Conakry en Guinée, Dakar au Sénégal, Port-Etienne en Mauritanie, Rufisque au Sénégal, Tabou en Côte d'ivoire
Station Indicatif Type d'ondes Longueur d'ondes Territoire.
Une station de TSF est opérationnelle à COLOMB-BECHAR dès les années 1925.
En 1939, la Marine Nationale équipe l'Arsenal de Dakar d'un émetteur de télégraphie SFR de 600 m de longueur d'onde.
On retrouve aussi dans la littérature trace d'un émetteur à Loango (FGO) au Gabon.
Une station de grande puissance permettant des liaisons directes avec la métropole (Paris et Croix d'Hins) est construite à Bamako (Mali ex Soudan français) en 1924. Une station de puissance est déjà en exploitation à Tombouctou à cette époque.
Vers 1932, on compte aussi des stations de radiotélégrapie (souvent à ondes courtes) en Mauritanie (St-Louis, Atar, Chinguetti), en Haute Volta (Ouagadougou), au Niger (Niamey, Tahoua, Agades, Bilma) et au Dahomey (Cotonou).
Si ces stations ont pour fonction d'assurer des liaisons
pour les services de l'Administration française, elles ont aussi
pour mission de transmettre des messages télégraphiques
à usage commercial et privé (télégramme).
Les liaisons téléphoniques traditionnelles avaient certes
déjà permis des progrès énormes, mais les
liaisons sur de très longues distances ne présentaient pas
le même niveau de fiabilité et de qualité que la T.S.F...
A cette époque il n'y a pas encore de communications téléphoniques
passant par les ondes, c'est suite aux travaux de Louis
Maiche que le téléphone sans fil
va se développer et prendre le dessus sur la télégraphie.
 Maiche crée la Société
Générale de Téléphonie sans fil le 17
avril 1907,
Maiche crée la Société
Générale de Téléphonie sans fil le 17
avril 1907,
sommaire
Revenons aux Antilles Françaises.
« Le 1er septembre 1635, Pierre BELAIN D’ESNANBUC
s’établit à la Martinique, avec une centaine de compagnons,
au nom de la Compagnie des Isles d’Amérique, créée
la même année par le Cardinal de RICHELIEU… »
« En 1685, à l’instigation de COLBERT, est promulgué
le « Code noir », code de lois, destiné à réglementer
l’esclavage dans la Colonie…
De 1794 à 1802, la Martinique est occupée par l’Angleterre.
Il faudra attendre le traité d’Amiens, et l’arrêté
du Consulat du 6 Prairial an X (26 mai
1802), pour que la Martinique soit rétablie comme terre française…
»
Le 19 mars 1946, la Martinique devient « Département d’Outre-mer
–D.O.M. »
A la fin du XIXe siècle, « … les télégrammes
pour l’Amérique centrale et les Antilles sont généralement
acheminés par les câbles sous-marin de la voie Galveston,
de la voie Key-West, de la voie de Haïti ou de celle des Bermudes
…Par exemple un dépêche pour la Martinique pourrait
être acheminée sur Brest, puis la voie Anglo, puis les lignes
américaines, puis la voie Key-West… »
Dans la nuit du 8 au 9 mai 1902, la terrible éruption volcanique
de la Montagne Pelée détruit la ville de Saint-Pierre, capitale
administrative de la Martinique. « Le câble sous-marin reliant
la Martinique à la Guadeloupe (et au reste du Monde) est coupé,
l’île est isolée au moment où elle à le
plus besoin de secours. La réparation du câble demandant
de longs mois, le Ministère des Colonies fait appel à la
télégraphie militaire.
En 1902 Le mardi 22 avril : rupture du câble
télégraphique vers la Guadeloupe.
L'éruption de la montagne Pelée est une éruption
volcanique majeure, qui a débuté le 23 avril 1902 :
Le lendemain, treize heures après cette proclamation, à
7 heures 50 du matin, la ville était broyée, pulvérisée,
brûlée, anéantie et plus de trente mille humains étaient
instantanément rayés du nombre des vivants ! Et pas un réchappé
de la fournaise, pas un seul pour dire l'horreur suprême et la modalité
vraie de l'holocauste terrifiant !,..
| A Fort-de-France, c'est trois heures
après le désastre — ô suprême ironie
des terribles contradictions supra-humaines ! — que l'on afficha
cette Consultation solennelle. Mais déjà une nouvelle étrange, extraordinaire, rapidement propagée dans la ville entière y avait fait courir un mystérieux frisson. A l'heure fatale précisera 7 heures 50— midi 5 minutes, heure de Paris — le receveur du Téléphone, M. Lodéon, était depuis quelques instants en conversation avec son collègue de Saint-Pierre, lorsque celui-ci se tut brusquement, au milieu d'un mot inachevé. Et, tandis que toutes les sonneries du bureau se mettaient en branle et jetaient des étincelles, M. Lodéon ressentait soudain une violente secousse électrique et percevait un râle d'agonie et comme le bruit d'un vaste effondrement. La communication était rompue ... Un négociant de Fort-de-France était en communication téléphonique avec un de ses amis de Saint-Pierre. Celui-ci décrivait les phénomènes volcaniques qui les inquiétaient et ajoutait : « Si ces manifestations extraordinaires continuent, je me déciderai à gagner Fort-de-France avec toute ma famille. » Tout d'un coup, un cri épouvantable suit cette phrase, puis un second moins fort, comme un râle étouffé, puis le silence. C'était de nouveau. Allô ! Allô ! Comme réponse, un cri rauque, le fracas d'un édifice qui s'effondre et toutes les sonneries du bureau de Fort-de-France vibrant et jetant des étincelles. La communication avec Saint-Pierre a cessé |
Le 3 mai : le vent renvoie le nuage de cendres vers le nord, dégageant provisoirement Saint-Pierre ; séismes ; rupture du câble télégraphique vers la Dominique. Le lundi 5 mai un tsunami inonde les bas-quartiers de Saint-Pierre, coulant un navire au mouillage et coupant toutes les liaisons télégraphiques avec les îles voisines.
 1910 Fort-de-France Hôtel des Postes Téléphones
et Télégraphes
1910 Fort-de-France Hôtel des Postes Téléphones
et Télégraphes
La Radio
Le capitaine FERRIE rassemble à Bordeaux, en moins de deux semaines,
le matériel nécessaire : c’est de ce port qu’il
embarque pour les Antilles,
accompagné de l’Inspecteur MAGNE des Postes et Télégraphes
et du lieutenant MOUNIER…
Sur place, la liaison Martinique-Guadeloupe est établie par deux
stations d’une puissance de 120 watts, installées à
Beauséjour, près de La Trinité (en Martinique), par
le capitaine FERRIE et à la Verdure, près de Pointe-à-Pitre
(en Guadeloupe) par Monsieur MAGNE…Les antennes sont montées
sur des mâts de 55 mètres de hauteur ; la distance entre
les stations est de 180 Kilomètres…Après avoir transmis
les premiers radiotélégrammes, le capitaine FERRIE rejoint
son poste à Paris. Le service sera assuré par le lieutenant
MOUNIER jusqu’à la fin de n’année 1903…Au
début d’août 1902, un cyclone brise le mât de
la Martinique, mais la liaison est maintenue avec un mât de 30 mètres
seulement…
Ce service, utilisé pendant plus d’une année, attire
l’attention du Ministère de la Guerre sur les possibilités
offertes par la T.S.F… »
Après l’éruption de la montagne Pelée,
le gouvernement français décide de créer «
l’observatoire de la Martinique », par décret du 18
août 1911. Puis en 1915, installation de la première
station de T.S.F. à Fort-de-France – « HYV » et
« HZH ». En 1920, une station télégraphique
militaire de forte puissance –indicatif « FKQ » - est
en place à la Pointe des Carrières.
« Un décret du 29 avril 1929 crée le « service
météo colonial »…Le 21 juillet 1932, ce service
devient le « service météorologique et de physique
du globe. Jean ROMET, nouveau directeur, installe à Fort-de-France
la première station météorologique des Antilles,
et l’équipe d’une station de T.S.F. »
En décembre 1937, début de Radio Martinique. Le poste diffuse
des échos et nouvelles sur 9700 Kcs, avec une puissance de 200
watts.
Puis en 1945 R.F.O. Martinique .
26 août 1964, date du raccordement de l'île de la Martinique au téléphone automatique. "Au quotidien, ça nous change la vie", écrivait alors en titre le journal martiniquais.
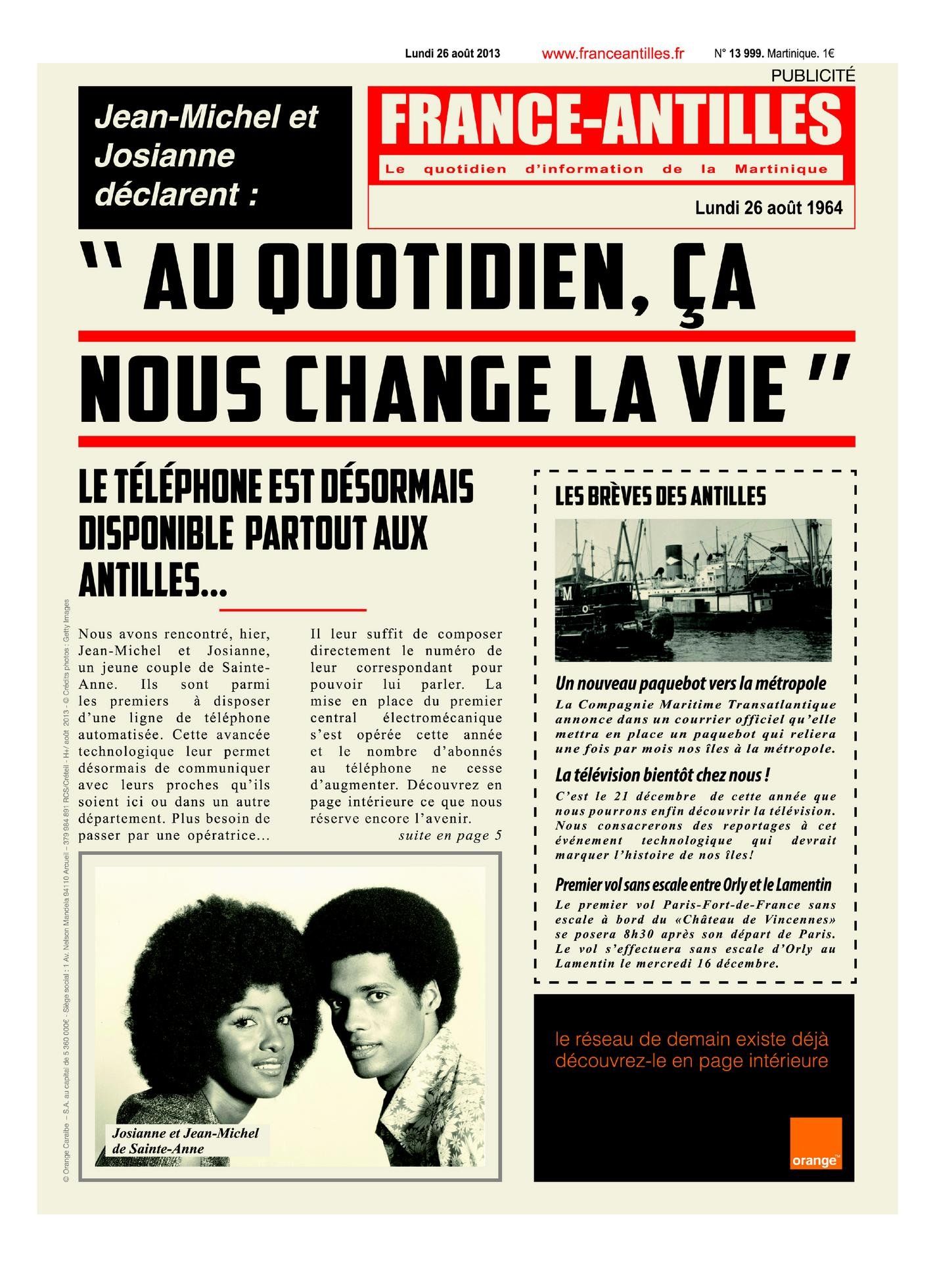
Il y a peu de traces sur l'histoire du télégraphe et du
téléphone sur la Martinique, Merci de m'informer si vous
en avez.
« …Christophe COLOMB découvre l’archipel
le 4 novembre 1493, et lui donne le nom de Guadeloupe...
Au nom de la Compagnie des Iles d’Amérique, créée
par RICHELIEU, Charles LIENARD DE L’OLIVE et Jean DUPLESSIS D’OSSONVILLE
débarquent à la Pointe Allègre et prennent possession
de l’archipel… »
L’archipel regroupe les îles de : la Grande-Terre, la Basse-Terre,
la Désirade, Marie-Galante et les Saintes. Ensuite, Saint-Barthélemy
et une partie de Saint-Martin seront rattachés à la Guadeloupe.
Le 19 mars 1946, la Guadeloupe et dépendances deviennent «
Département d’Outre-mer – D.O.M. »
Nous avons vu au chapitre « La Martinique », que FERRIE avait
installé la première station télégraphique
sur l’ile, pour liaison avec Paris, suite à l’éruption
de la Montagne Pelée : station « La Verdure », en 1902.
Nous savons par ailleurs, qu’une station de T.S.F., pour diffusion
de nouvelles locales et de la presse mondiale, avait été
installée au Gosier, à l’entrée de la propriété
« Montauban » vers 1900 . Une autre station de T.S.F. est
installée à « Baie-Mahault » en 1919 et une
à Destrellan – « HYU » en 1925.
Faustin BOURGUIGNON est –REF 573 – en avril 1934, et en 1937,
André HANN (futur « FG8AH » en 1938, « FG7XH
» dans les années 60), aidé par Roger BABIN, monte
la première station de radio privée :
« Radio – Guadeloupe » à Pointe à Pitre
», ancêtre de R.F.O. Guadeloupe, émettant sur 40,29
mètres (bande 7 Mcs !), avec 150 watts…
En 1868 on compte 66 Km de lignes télégraphiques
par la Compaenic West-Indiâ and PanamaTetegraph,
En 1884 Un service de téléphones fait communiquer la ville de Basse-Terre avec le Morne-à-l'Eau, le Moule, Port-Louis et Petit-Canal; enfin, toutes les usines de la Grande-Terre sont reliées à la Pointe par des fils spéciaux.
On compte : 54 Km : Ligne téléphonique subventionnée par la colonie et 60 km. Lignes téléphoniques privées.
En 1900 Deux câbles sous-marins
mettent la colonie en communication avec le monde entier. Le câble
français donne chaque jour, matin et soir, les nouvelles générales
du monde.
La Guadeloupe et la Grande-Terre proprement dite sont couvertes d’un
réseau téléphonique qui met en relation tous les
bourgs de la colonie,
toutes les usines, toutes les maisons de commerce importantes.
Un câble relie les dépendances de Marie-Galante et des Saintes.
| La station radio de « La Verdure
» installée en 1902, en Guadeloupe. « …Voici les détails d’une station du système FERRIE… Le montage de transmission est celui dit à étincelle directe. La bobine employée est une bobine de Rochefort du type 25 centimètres d’étincelle avec interrupteur à mercure, qui exige 6 à 8 ampères sous 32 volts. L’emploi de cette bobine permet de diminuer la hauteur de l’antenne… L’oscillateur est monté sur la bobine même, les sphères ont 2 centimètres de diamètre : l’un des pôles, le positif est mis en permanence à la terre, tandis que le négatif est relié à l’antenne quand on veut transmettre. Dans le primaire de la bobine sont intercalés, un commutateur destiné à couper le circuit, les accumulateurs, un manipulateur et un ampèremètre. Le manipulateur est à contact cuivre sur cuivre dans le pétrole. Un voltmètre peut être mis en dérivation pour s’assurer de l’état des accumulateurs… » |
 |
1893 le 9 septembre, les trois communes de Marie-Galante
étaient désormais reliées par un réseau téléphonique.
Le Cyclone à Marie-Galante : « On croit que Marie-Galante
a été fortement éprouvée. La communication
téléphonique avec cette dépendance ne sera rétablie,
nous dit-on au télégraphe français, que dimanche
après-midi »
1920 le décret du 29 mars 1920, portant relèvement des taxes postales, télégraphiques et téléphoniques, ainsi que celui de la taxe des lettres dans les relations avec les bureaux français et indochinois en Chine. Cayenne,
1903 L'Administration a l'honneur d'informer le public que, dans le but d'établir la coïncidence avec les heures d'ouverture et de fermeture dés bureaux.de là télégraphie sans.fill pour la réception ou la transmission des dépêches de ou pour-la Martinique, les bureaux des réseaux téléphoniques de la colonie sont ouverts au public, les dimanches et jours fériés de sept heures à dix heures du matin, et de une heure à quatre heures du soir.
1923 Le Service des postes et télégraphes
continue à se développer cl à accroître son
trafic.
Ses recettes péscntenl un accroissement sensible. Au 3o septembre
dernier, l'excédent, par rapport aux pressions budgétaires,
dépassait 5o.ooo francs et atteignait près de 26.000 francs
par rapporta la période correspondante de l'année dernière.
Cet heureux résultat est dû, d'une part au dernier relèvement
des taxes postales, télégraphiques et téléphoniques
qui produit maintenant son plein effet, d'autre part, au développement
de la T. S. F., et aussi aux nouvelles attributions du Service se rapportant
aux envois contre remboursement et aux recouvrements.
Les travaux d'aménagement du nouvel hôtel
des postes de Pointe-à-Pitre sont en cours ; il y a lieu d'espérer
qu'il seront achevés à la fin de l'année.
Parallèlement, la réfection entière du réseau
téléphonique de cette ville a été entreprise.
Des appareils téléphoniques nouveaux, pouvant desservir
deux cents abonnés, seront installés au nouveau central
téléphonique.
Pointe-à-Pitre sera donc dotée non seulement d'un hôtel
des postes, mais également d'un réseau téléphonique
entièrement neuf.
Aussitôt installée dans son nouveau local, la poste sera en mesure d'assurer le service des colis postaux contre remboursement,
La T. S. F. se développe dans des conditions
satisfaisantes.
La liaison unilatérale France-Guadeloupe a été réalisée
depuis le 4 juin dernier et donne de très bons résultats.
Dans lo nouvel hôtel des postes, un local sera affecté à la réception des grands postes et un autre à un cours de T. S. F. destiné à former les radiotélégraphistes dont lo Service aura besoin.
Dès que seront parvenus les renseignements demandés au Département pour l'organisation d'un roseau optique destiné à relier les Dépendances avec la Guadeloupe proprement dite, cette question sera étudiée et soumise à l'Assemblée locale.
1926 Les communes de la Guadeloupe proprement dite et de la Grande-Terre, ainsi que les trois communes de Marie-Galante, sont reliées entre elles par un réseau téléphonique.
1929
Vu dans "Les Annales Coloniales"
T. S. F. Coloniale et Agriculture M. I-H. Ricard, ingénieur
agronome, ancien ministre de V Agriculittre, président d'honneur
de la C. N. A. A. (Confédération Nationale des Associations
Agricoles), connaît à fond les gens et les choses de la terre.
Vers celle-ci l'ont porté à la fois, sans doute, un instinct
impérieux et une ferme et claire raison. Anglais, il eût
étudié avec une passion jamais lassée les problèmes
de la mer. Français, il s'est longuement penché sur le sol
de France et sur le paysan, bien certain que l'un était la plus
sûre richesse du Pays, et l'autre sa force profonde. Puis, c' est
l'agriculture aux colonies qui a sollicité son appétit de
servir.
L'une de ses dernières initiatives a été la création
d'un vaste organisme d.e propagande et d'actionf la Radio-Agricole Française,
ou Fédération nationale de Radiophonie dans les campagnes,
qui a pour but de propager l'usage de la téléphonie sans
fil parmi les populations rurales.
Cette fédération, qu'il préside, comprend UJZ Comité
colonial où figurent notamment MM. Franç ois-Mars al, le
général Ferrié, V amiral Lacaze, Albert Lebrun"
Martial Merlin, le général Messimy...
Nous avons donc jugé d'un haut intérêt, au moment
où nous préparions une étude sur la T.S. F. coloniale,
de demander à M. Ricard quels mobiles guidaient son action actuelle.
Dans son calme logis familial de Neuilly, le Président de la Radio-Agricole
a bien voulu satisfaire au vœu des Annales Coloniales.
— Monsieur le Ministre, demandai je, qu'est-ce que la « Radio
Agricole », que veut-elle, qu'espère-t-elle réaliser
aux Colonies ?
Mon hôte eut un bref sourire.
— Vous devez, fit-il, connaître d'avance ma réponse,
si vous vous rappelez mon effort d'autrefois en faveur du cinéma
à la campagne. Ma conviction est toujours la même : il faut
apporter au village des éléments, de distraction et de progrès,
si l'on ne veut pas que le village meure tout à fait par l'exode
de ses habitants.
— Je n'ignore pas, en effet, votre lutte persévérante
pour la plus utile des professions...
— Eh ! bien, qu'il s'agisse de cinéma ou de radiophonie, de
la Métropole ou des Colonies, j'essaie de favoriser l'application
des découvertes de la Science, dans la plus large mesure possible,
au progrès social et, notamment, au progrès des populations
agricoles.
« Puisque c'est la T. S. F. qui vous occupe actuellement, je saisis
avec plaisir cette occasion de dire — de redire plutôt —
mon admiration pour cette invention d'immense portée. Elle est,
à mon avis, capable de transformer radicalement les conditions
d'existence des campagnes. Des notions instructives, de saines disfractions
qui, jusqu'à présent, étaient pratiquement réservées
aux villes, peuvent maintenant pénétrer à tout instant
dans les lieux les plus reculés. Si on le veut — et je songe
aux Colonies autant qu'à la métropole — il peut, d'ici
quelques années, n'y avoir plus, sur toute l'étendue des
terres françaises, un seul village condamné à l'isolement.
A un point de vue immédiatement pratique, nos paysans, comme les
colons de nos possessions lointaines, pourront chaque jour recevoir, à
l'heure du repos, les conseils techniques d'agronomes réputés,
des prévisions météorologiques, des aperçus
de méthodes nouvelles expérimentées en France ou
à l'Etranger, des informations sur l'état général
des cultures, sur les cours des divers produits, sur les grandes questions
discutées dans les associations, les Congrès et le Parlement...
A un point de vue plus général et fort élevé,
la radiophonie peut doter la vie de famille d'un élément
très précieux d'union et de santé morale, sans
parler de la santé physique pour laquelle les conseils d'hygiène
« parlés » sont évidemment plus persuasifs que
les conseils écrits... qu'on ne lit pas toujours. En effet, lorsque
les ondes invisibles apportent dans un foyer, comme cela se fait couramment,
des leçons souvent fort bien conçues pour les enfants, et,
pour les femmes, des causeries propres à développer leur
goût et leur activité intellectuelle, ce foyer devient plus
vivant, plus gai, plus heureux.
« Notez, d'ailleurs, que le Radio Agricole française ne fait
pas seulement appel aux agriculteurs. Elle s'adresse à tous ceux
qui vivent à la campagne ; médecins, pharmaciens, vétérinaires,
notaires, instituteurs, aubergistes, petits commerçants, artisans
ruraux, etc... car tout le village doit trouver plaisir et profit dans
la T.S. F.
« Tout cela, voyez vous, n'est nullement du domaine du rêve.
Tout cela existe et il ne reste qu'à le généraliser.
-— Question d'organisation.
— Justement, et c'est bien pourquoi la Radio-Agricole a été
fondée. Vous me demandiez quel était le but de cette association
? C'est, d'une part, de rechercher les moyens d'améliorer les émissions
et les appareils récepteurs destinés aux habitants de nos
campagnes et de nos colonies, et, d'autre part, de vulgariser parmi eux
l'emploi de la T. S. F. Quant au programme d'action de la Radio-Agricole,
il consiste à organiser des expositions, des concours, des démonstrations
radiophoniques, à établir des relations entre les sociétés
et les postes d'émission de France et de
l'Etranger, à étudier tous les problèmes concernant
la radiophonie, à intervenir en faveur de celle-ci auprès
des Pouvoirs publics.
« Et nous avons déjà agi. La Fédération,
par exemple, a pris l'initiative d'un communiqué agricole quotidien,
émis par Radio-Paris; elle a diffusé (dans un rayon limité,
pour commencer, aux cinq ou six départements voisins de Paris)
un commentaire du Bulletin météorologique officiel, qui
a suscité un vif intérêt chez les agriculteurs; elle
a présenté au grand public une série d'expériences
inédites touchant à la plus haute technique... C'est ainsi
que le général Messimy, à l'issue d'une conférence
que nous avions organisée à Paris, dans la salle des Ingénieurs
Civils, a parlé, de sa place, par le moyen des ondes courtes, à
nos colonies africaines. Son allocution, transmise à la station
de Sainte-Assise, était, de là, dirigée sur l'Afrique
par l'appareil de l'ingénieur Chireix.
Elle fut entendue en Algérie, au Maroc, en A.E.F.,au grand enthousiasme
de nos compatriotes d'outre-mer. Jusqu'alors, ils n'avaient pu recevoir
que des postes étrangers. Il apparaît bien que l'on
s'achemine désormais rapidement vers un système de communications
où tous les fils télégraphiques et téléphoniques
seront supprimés. Quand on sait ce qu'ils coûtent
aux budgets coloniaux, et les difficultés de leur établissement,
et les hasards contraires auxquels ils sont soumis : tornades, destruction
des lignes, comme cela s'est vu, par les animaux sauvages, etc., on imagine
facilement le bénéfice promis par la T. S. F.
En somme, il s'agit avant tout de créer en faveur de la radiophonie
agricole un vaste courant d'opinion, semblable à celui qui a soutenu
le sport et
le tourisme.
— Oui, là où fait défaut la force de l'opinion,
la marche du progrès peut bien s'accomplir, mais avec bien plus
de lenteur. Il en existe précisément un exemple que les
lecteurs des Annales Coloniales doivent connaître, mais qu'il n'est
pas mutile de rappeler.
« En 1902, après la trop fameuse éruption de la montagne
Pelée, le capitaine Ferrié fit communiquer par T. S. F.
la Guadeloupe et la Martinique. Puis, des postes furent établis
çà et là, dans nos diverses colonies. Ils étaient
de faible portée : quelques centaines de kilomètres.
C'est entre le Tchad et le Moyen Congo, en 1910, que fut tentée
la première grande liaison. Au lieu de tendre des fils télégraphiques
à travers 2.000 kilomètres de brousse, M. Paul Brenot, alors
conseiller technique du ministère des Colonies, eut l'idée
d'employer de petits postes de T. S. F. transportables à dos de
chameau. Ce fut là, semble-t-il, l'origine du premier projet, dû
à M. Messimy, de réseau de T. S. F., destiné à
faire communiquer la France (en la délivrant de sa sujétion
aux câbles étrangers) avec ses colonies et celles-ci entre
elles. Mais ce projet, pour devenir projet de loi, devait préalablement
réaliser l'accord de cinq ministères. Ce ne fut qu'en juillet
1912 qu'il put être déposé, par M. Albert Lebrun,
sur le bureau de la Chambre. Les Commissions, d'ailleurs, cette année-là
et en 1913, lui furént hostiles et se refusèrent à
l'adopter.
« C'est qu'à cette époque, une infime minorité,
seulement, croyait à l'avenir de la T. S. F., c'est que l'opinion,
à cet égard, était indifférente parce qu'elle
n'était pas avertie. Cependant, deux initiatives des plus heureuses
avaient été prises sans vaines formalités dès
1911 : M. Albert Sarraut, gouverneur général de l'Indo-Chine
et M. Merleau-Ponty, gouverneur général de l'Afrique Occidentale
française, avaient commandé à l'industrie privée
deux grands postes, l'un pour Saigon, l'autre pour Tombouctou... Mais
vous connaissez l'histoire...
— Oui, la guerre survint...
— Et les postes furent montés à Lyon et à Nantes,
où, concurremment avec la Tour Eiffel, ils rendirent d'immenses
services. En 1917, on se rendit
à l'évidence : le réseau intercolonial parut indispensable
et l'on commença la construction des grandes stations coloniales.
« Bref, la cause est gagnée, surtout depuis que l'emploi
des ondes courtes permet des installations relativement peu coûteuses.
Mais, j'y insiste, si la T. S. F. est déjà d'un très
grand secours pour les communications officielles, elle est très
loin d'avoir, sous la forme radiophonique, pénétré
dans la pratique courante. Il n'existe pas, en vérité, de
radiophonie coloniale française. Ce qu'on entend à Hanoï,
si je suis bien informé, c'est la propagande et les concerts d'un
poste de Vladivostock. A Alger, à Dakar, un peu partout se dessine
un mouvement radiophile, mais il a besoin d'être organisé,
coordonné, encouragé. L'initiative privée n'a pas
assez conscience du rôle qu'elle pourrait et devrait jouer. Notre
association veut l'aider à prendre conscience de ce rôle.
Comment diffuser la radiophonie aux colonies ? Par des postes-relais transmettant
les émissions métropolitaines ? Par des émissions
locales ? Où placer les relais ou les stations émettrices
? Et sur quelles ressources compter ?
Il y avait un questionnaire général à établir
et à adresser aux coloniaux eux-mêmes. Ce qui fut fait.
— Et quelles questions, M. le Ministre, furent posées ?
— Vous les trouverez dans cette revue, répondit M. Ricard
en me tendant un numéro de La Radio-Agricole, organe de l'Association
qu'il préside.
— Prenez votre temps, lisez.
Et je lus les onze questions suivantes :
1° Quels sont les postes, français ou étrangers, que
vous entendez régulièrement ou par intermittence ;
2° Si aucun poste n'est entendu dans votre région, verriez-vous
l'utilité d'une nouvelle station ou d'un poste-relais ? En quel
endroit ?
3° Dans le cas précédent, y aurait-il des particuliers
ou des groupements susceptibles de coopérer à l'établissement
et au fonctionnement de ces nouvelles stations de postes-relais.?
4° Quels sont vos desiderata concernant l'installation des appareils
récepteurs (antennes, cadres, manœuvre, etc. ?) et sur ces
appareils eux-mêmes
(piles, accumulateurs, alimentation par un secteur électrique,
prix, etc.) ?
5° Parmi les questions et les conférences des programmes émis
actuellement, quelles sont celles qui vous paraissent :
a) les plus utiles ; b) les plus agréables?
6° Plus spécialement, les renseignements commerciaux, financiers,
agricoles, maritimes, etc., donnés maintenant, correspondent-ils
à vos besoins?
7° Y a-t-il d'autres sujets ou d'autres informations à recommander?
8° Quels sont les heures et jours les meilleurs pour les émissions
d'ordre économique, notamment agricole ?
9° Le nombre des amateurs sans-filistes dans votre région est-il
appréciable ? Combien, approximativement ? Est-il susceptible d'accroissement
? Dans quelle proportion ?
10° Quelles initiatives vous paraîtraient les plus urgentes,
pour aider aux progrès de la T. S. F. française dans votre
région ?
11° Quelles autres observations sont à faire en ce qui concerne
la colonie et le lieu que vous habitez ?
« Et nous avons reçu un grand nombre de réponses,
pour la plupart très précises et riches de renseignements
pratiques, fit mon éminent interlocuteur, dès qu'il eut
vu que j'avais terminé ma lecture.
— C'est que, Mr le Ministre, les questions, d'où dépendait
toute l'organisation future, avaient été elles-mêmes
posées d'une façon pratique. Mais... si je ne me trompe,
vous avez, par un voyage en Algérie, payé de votre personne.
— Dites que j'ai eu la double joie de visiter l'admirable Algérie,
après un long voyage d'études au Maroc, et de trouver dans
le grand amphithéâtre de Maison-Carrée, à mon
retour des territoires du Sud, l'auditoire le plus accueillant et le plus
compréhensif, pour la conférence que nos adhérents
d'Alger m'avaient demandé de faire, sous les auspices de la Société
des Agriculteurs d'Algérie.
— Vos adhérents ?
— Oui, nous avons eu la vive satisfaction de pouvoir créer
une section Algéroise de la Radio-Agricole. La manifestation de
propagande, à l'occasion de laquelle j'ai été invité
à prendre la parole, a marqué la constitution définitive
de cette section. Devant ses membres et ceux de la Société
des Agriculteurs, j'ai dit combien j'avais été frappé
de l'isolement extrême de nombreux colons.
« Je venais de parcourir en automobile un circuit de plus de 3.000
kilomètres. J'avais traversé Oudjda, les Hauts-Plateaux
du Maroc Oriental jusqu'à Figuig, la vallée de la Saoura
par Taghit et Beni-Abbès, Timimoun, la dernière ville saharienne
avant le Niger, Fort Mac-Mahon, l'oasis merveilleuse d'El Golea, Ghardaïa,
Laghouat, Bou-Sââda...
J'étais encore, tandis que je parlais, sous l'impression de ce
voyage trop rapide où, tant de fois, par la pensée, je m'étais
incliné devant l'énergie des
Français du Maroc et de l'Algérie, qui, chaque jour, au
prix d'un dur labeur, transforment un peu plus d'espace inculte en terrain
utile. Fallait-il les plaindre ? Non, certes, leur existence libre, digne,
active susciterait plutôt l'envie.
Mais je réalisais la sécurité, le profit, la joie
que pouvaient apporter à telle ferme éloignée de
tout centre civilisé, les « trains d'ondes » tour à
tour chargés, demain, de conseils médicaux, d'informations
techniques ou économiques, de poésie, d'harmonie, et, après-demain,
des prodiges de la télévision.
« Aussi bien n'ai-je eu aucune peine, croyez-le, à faire
admettre à mes auditeurs l'immense bienfait futur de la Radiodiffusion.
Certes, je me suis gardé d'oublier la part si grande d'agrément
qu'elle contient, lorsqu'elle transmet quelque beau morceau de littérature,
ou quelque chef-d'œuvre musical. Mais je me suis attaché aussi
à faire ressortir le côté utilitaire de la radiophonie.
Vous avez fait partie de la commission du cinéma agricole que j'avais:
instituée autrefois au Ministère de l'Agriculture. et vous
n'ignorez donc pas qu'à mon avis, il faut se préoccuper
de donner des distractions au grand peuple des campagnes. Mais je considère,
et ceci résume toute ma foi, que les postes émetteurs et
récepteurs doivent figurer, dans notre outillage économique,
comme des instruments absolument indispensables.
Qu'ajouterions-nous à ce vibrant plaidoyer et à l'enthousiaste
article de M. Taittinger ?
Il ne nous reste qu'à nous féliciter de pouvoir donner à
l'effort de propagande que nous tentons à notre tour l'appui de
si hautes autorités.
Nous avons, cependant, un désir à exprinier : c'est que
nos lecteurs dans leur propre intérêt, veuillent bien arrêter
un moment leur attention sur le questionnaire que nous nous sommes fait
un devoir de reproduire. Soit qu'ils nous adressent des réponses,
soit qu'ils nous posent eux-mêmes des questions, nous serons heureux
d'étudier les unes et les autres (ce qui ne nous empêchera
pas de les transmettre à la Radio-Agricole dont l'initiative nous
parait excellente) et de publier les résultats de cette étude
dans les Annales Coloniales quotidiennes. Nous espérons aider ainsi
au progrès si désirable de la Radiophonie coloniale.
René DE LAROMIGVIÈRE
1931 SERVICE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES,
TÉLÉPHONES & DE LA T. S. F.
Organisation.
— Le service des P. T. T. et de la T. S. F. comprend :
1° Des bureaux de direction;
2° Des bureaux d’exploitation.
Les bureaux de la direction des P. T. T. et de la T. S. F. sont situés
à Basse-Terre, et se répartissent en tris sections :
1° Affaires générales; 2° Personnel, ordonnancement,
matériel; 3° Comptabilité, contrôle.
Les bureaux d’exploitation des P. T. T. et de la T. S. F. se répartissent
comme suit :
1° Des bureaux de plein exercice ou recettes dont deux : Basse-Terre
et Pointe-à-Pitre sont érigés en bureaux d’échange
et s’appellent recettes d’arrondissement ;
2° Des recettes ordinaires, composées ou simples, au nombre
de 18;
3° Des bureaux secondaires, appelés recettes auxiliaires, au
nombre de 31 ;
4° Une station principale de T. S. F. située à Destrellan
;
5° Des postes secondaires de T. S. F. situés dans les dépendances,
au nombre de 6.
Service télégraphique.
— Le service télégraphique proprement dit ne fonctionne
actuellement qu’entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre.
Mais, au point de vue radiotélégraphique, toutes les dépendances
sont reliées à la Guadeloupe par la station centrale de
Destrellan, située à 6 kilomètres de Pointe-à-Pitre.
Dans ses relations extérieures, la Guadeloupe communique avec le
réseau mondial par la station émettrice et réceptrice
de Destrellan.
Les câbles sous-marins appartenant à la Compagnie française
télégraphique ainsi qu’à la compagnie anglaise
West India ont été récemment supprimés.
— Le service téléphonique.
— Le réseau téléphonique de la Guadeloupe comprend
plusieurs lignes interurbaines s’étendant sur une longueur
d’au moins 600 kilomètres, et deux centraux téléphoniques
particulièrement importants (Basse-Terre et Pointe-à-Pitre).
— Taxes téléphoniques.
Conversations urbaines : 25 centimes. Conversations interurbaines : Avis
d’appel : 50 centimes.
Abonnements forfaitaires : 1200, 480, et 120 francs suivant la nature
de l’abonnement.
Rapport de l'ASSEMBLÉE NATIONALE — SEANCE DU 30 JUIN
1960
...
Autre question : il me parait indispensable d ' entreprendre en Guadeloupe
des travaux de modernisation du téléphone, notamment par
l'installation à Pointe-à-Pitre du téléphone
automatique . J'ai la bonne fortune, comme maire de Basse-Terre, de pouvoir
dire que l'installation du téléphone automatique est en
cours dans ma ville. Mais il faut également penser à la
ville de Pointe-à-Pitre qui mérite aussi de connaître
ce progrès.
... Nous nous réjouissons également
du programme du ministère des postes et télécommunications
pour lequel 12 .500 .000 nouveaux francs sont inscrits . Nous serions
particulièrement heureux si, même à la fin de ce plan
triennal, l'installation du télex à la Guadeloupe,
celle du téléphone automatique actuellement commencée
à Basse-Terre étaient achevées et complétées
par l'installation de l'automatique à Pointe-à-Pitre,
qui coûtera trois cents millions d'anciens francs, la liaison Basse-Terre-Pointe-à-itre,
qui coûtera environ 280 millions d'anciens francs et le branchement
au moins sur les communes les plus importantes et sur les dépendances.
Puisque l'on parle de favoriser le tourisme, peut-on concevoir son plein
développement sans liaison téléphonique moderne alors
que, à l'heure actuelle, on doit, entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre,
attendre souvent plus d'une heure une communication urgente ?
Je voudrais maintenant — je crois que c'est utile — souligner
brièvement l'apport de l 'économie guadeloupéenne
à la métropole ....
1965 Dans le département de la Guadeloupe, les promesses
du IV' Plan n'ont pas été tenues....
Un exemple : en 1962, le ministre des postes et télécommunications
de l'époque avait mis en train dans notre département un
planning de travaux de l'équipement en téléphone
automatique de Pointe-à-Pitre, ville principale et centre commercial
le plus important de la Guadeloupe, en partie du reste avec une avance
du budget départemental. En exécution de ce planning, le
bâtiment prévu pour ce central téléphonique
sera achevé dès la fin de 1966, et l'on aurait pu penser
qu'il serait équipé pour fonctionner en 1967, comme il était
initialement prévu. Hélas ! il a fallu utiliser les crédits
de 1966, première année d'exécution du V' Plan, pour
un autre département et, de ce fait, un bâtiment terminé
devra rester inutilisé jusqu'en 1969, avant-dernière année
du V' Plan .
1965 Débats de l'Assemlée Nationale :
M.Albrand attire l 'attention de M. le ministre des postes et télécommunications
sur la profonde émotion qu'ont suscitée dans la population
de la Guadeloupe les bruits qui courent depuis quelques jours, et selon
lesquels le Gouvernement envisagerait de retarder d'une assez longue durée
l'installation de l'automatique de Pointe-à-Pitre . Cette décision
résulterait du fait que les crédits inscrits au budget de
1955 pour l'automatique de Pointe-à-Pitre devraient être
maintenant amputés de plus de la moitié de leur montant
au profit d'une opératioin similaire, non prévue initialement
. Il lui rappelle que l'installatiou de l'automatique de Pointe-à-Pitre
fut solennellement promise depuis 1961, au nom du Gouvernement, par le
ministre des postes et télécommunications d'alors, au cours
d'un voyage officiel aux Antilles . Un tel retard serait d'autant plus
surprenant qu'une avance remboursable prévue pour financer l'installation
du comrmutateur automatique a été votée par le département
de la Guadeloupe, et versée à l'administration des postes
et télécommunications, afin d 'arrêter de façon
définitive la priorité à donner à Pointe-à-Pitre
sur d'autres projets éventuels. Il lui demande si ce projet, qui
remonte à cinq années, conserve bien sa priorité
par rapport à tout projet neuf, et si les travaux actuellement
en cours seront menés, sans solution de continuité, jusqu'àleur
terme . (Question du 28 août 1965.)
Réponse. — Il est exact que le département de la Guadeloupe
a versé en deux fois (14 mars 1964 et 10 mai 1965) une avance remboursable
de 1.800.000 francs . Cette avance est une participation aux frais de
modernisation des installations téléphoniques de Pointe-à-Pitre
nécessitant la construction d 'un bâtiment pour le central
téléphonique et la commande d'un autocommutateur. Cette
avance ne couvre qu'une partie estimée à 24,3 % du coût
de l 'ensemble de l'opération . Elle a permis de lancer la construction,
actuellement en cours, du bâtiment, opération d'un montant
de l'ordre de 3 millions qui doit être achevée au cours du
1" semestre 1967 . Le marché de commande de l'autocommutateur
sera préparé dans le courant du 2' semestre 1966, la commande
passée soit au cours du dernier trimestre 1966, soit au cours du
1" trimestre 1967 . La mise en service interviendra vers la fin de
1968 . Les promesses faites sont donc bien en cours de réalisation
. Le ministre des postes et télécommunications en profite
pour déplorer l'agitation inconvenante du représentant local
d'une entreprise privée qui espérait obtenir un marché
de l'administration des P . T . T., et qu'il n'a pas hésité
à agiter l'opinion, en particulier la chambre de commerce, alors
que les décisions définitives, quant à la date de
passation de la commande, fin 66 ou début 67, n'étaient,
et ne sont pas encore prises, et que de toute manière, elles ne
sauraient retarder sensiblement l'achèvement de l'opération
. L'émotion proforde constatée par l'honorable parlementaire
est très artificielle, et a été en fait, délibérément
suscitée par un agent commercial soucieux d'enregistrer, au plus
vite, une commande à son profit.
1969 Enfin le central téléphonique
Automatique Pentaconta 31F (Matériel Téléphonique)
de Pointe-à-Pitre est mis en service.
Suivra aussi Basse Terre aussi en Pentaconta.
Le 5 avril 1979 à Pointe à Pitre, reçoit une
extension du central automatique Pentaconta.
Le 15 juin à Basse Terre, reçoit une extension dn central
téléphonique automatique Pentaconta 44F.
1988
La Poste et France Télécom sont deux gros employeurs du
département avec plus de 2 000 salariés.
Au cours de ces cinq dernières années, France Télécom
a équipé les ménages guadeloupéens de plus
de 10 000 lignes principales par an pour atteindre un parc de lignes de
170 745 et 5 854 minitels installés au 31/12/1996. Bien que l'équipement
des ménages de l'archipel, en minitel, ait été multiplié
par cinq entre 1987 et 1994, la diffusion de la télématique
reste pour autant limitée. On compte près de 14 terminaux
pour 1000 ménages guadeloupéens contre 112 pour 1000 dans
l'Hexagone.
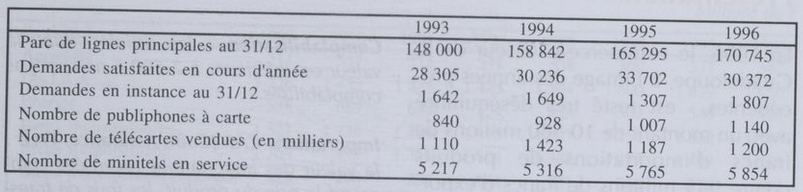
Quant à La Poste qui a distribué 819 525 paquets et près
de 62 millions de lettres en 1996, elle connaît un développement
constant de ses services financiers. Les avoirs des différents
comptes ouverts dans ses établissements ont été en
1996, de l'ordre de 210 millions de francs pour les 34 018 Comptes Chèques
Postaux (C.C.P.) et de 986 millions de francs pour les 180 442 CNE.
3 122 clients de La Poste en Guadeloupe, étaient détenteurs
de la carte bleue en 1996.
L’opérateur historique France Télécom
est propriétaire du réseau téléphonique lui
permettant de proposer des services de type ADSL aux 180 000 foyers guadeloupéens.
La technologie xDSL repose sur l’utilisation de la paire de cuivre
téléphonique. En pratique, la technologie DSL nécessite
la mise en place de fibre optique, au niveau du Nœud de Raccordement
d'Abonnés (NRA) où convergent les lignes téléphoniques.
En amont, le NRA est relié à Internet par le réseau
de collecte de l'opérateur. En aval, il est relié aux abonnés
par les lignes téléphoniques.
Le réseau de France Télécom est structuré
autour de 52 centraux téléphoniques dont 44 sont opticalisés.
Le nombre de NRA dégroupés est de 37 sur les 52 NRA présents
en Guadeloupe.
En aval, de l’ordre de 480 sous-répartiteurs rattachés
aux centraux téléphoniques desservent les quelques 180 000
foyers guadeloupéens.
Zones d’emprise câblées
Le réseau câblé de WSG couvre 17 des 32 communes de
la Guadeloupe. L’emprise du réseau câblé s’étend
à environ 83 000 prises, soit près de 50% des foyers de
Guadeloupe. Ce réseau, déployé à 60% en aérien,
offre le nuancier de situations suivant :
- Certaines plaques câblées sont uniquement analogiques et
ne permettent pas le transport de signaux Haut Débit. Ce cas de
figure concerne de l’ordre d’un quart des foyers de Guadeloupe
(~60 000 prises).
- D’autres plaques câblées sont modernisées en
HFC19 et permettent des connexions haut débit sensiblement supérieures
l’ADSL (de l’ordre de 30 Mbits/s descendant et 1Mbits/s en remontant).
Ceci concerne de l’ordre de 12% des foyers de Guadeloupe (~20 000
prises HFC).
La technologie employée pour la gestion du réseau est DOCSIS
2.020, spécifiquement développée pour assurer la
fourniture d’un service Internet sur une infrastructure HFC. Cette
spécification ne permet toutefois pas d’assurer une gestion
efficace de la bande passante, la dernière version de cette spécification
étant DOCSIS 3.0 qui sera compatible avec les prochains modems
délivrés par le câblo-opérateur.
- Quelques prises câblées ont été équipées
de Fibre « en Pied d’Immeuble » pour être compatibles
en Très Haut Débit, avec des performances pour l’usager
de 100 Mbits/s descendants et 5 Mbits/s remontants. Ceci concernerait
sur le court terme (en cours de modernisation) de l’ordre de 2% des
foyers de la Région (~3 000 prises). WSG précise qu’il
observe une forte appétence THD des administrés sur ces
zones.
ILE SAINT MARTIN
« L’île de Saint-Martin fut découverte, en 1493,
par Christophe COLOMB qui la revendique pour le Roi d’Espagne. En
1647, l’Espagne abandonne l’île, laissant comme occupants
quatre français et cinq hollandais…En 1648, ces derniers se
partagent l’île selon le traité du mont des
accords : organisation d’une course à pied à travers
l’île…le point de rencontre des deux coureurs délimitera
la frontière !
En 1763, Saint-Martin est rattaché à la Guadeloupe sur les
plans administratifs et militaires .
En 2003, par référendum, Saint-Martin devient une collectivité
territoriale d’outre-mer, détachée de la Guadeloupe…
»
La première activité amateur, sur cette île, avec
un nouveau préfixe « FS », eut lieu en mars 1956, organisée
par L. EVANS - « W2BBK ». Ce dernier avait été
autorisé à trafiquer à Saint-Pierre et Miquelon,
en octobre 1952, sous l’indicatif de « FP8AK ». Il connaissait
les « méandres » de l’administration française,
et à la surprise générale (surtout en France métropolitaine),
il obtient l’indicatif « FS7AA »…
Il y a peu de traces sur l'histoire du télégraphe et du téléphone sur cette île, Merci de m'informer si vous en avez.
ILE SAINT-BARTHELEMY
“…L’île est découverte en 1493 par Christophe
COLOMB, et revendiquée pour la couronne d’Espagne.
La première colonisation française a lieu en 1648, où
des colons bretons et normands s’insallent.
Le 16 mars 1878, l’île est rattachée à la Guadeloupe,
puis en décembre 2003, par référendum devient «
collectivité d’outre-mer »…(cf. : site web outre-mer)
Les premiers radioamateurs sur « St. Barth. » seront, à
priori, la Dxpédition organisée par le « club DX 24
», et des membres qui deviendront ensuite l’ossature du «
Bordeaux DX Groupe » (F6BKI, F6EXV, F1TE, F6BLK, F6CUK), en octobre/novembre
1978. Les indicatifs, donnés par l’administration française,
et employés étaient : « FG0DWT/FS, FG0DXS/FS, FG0EUU/FS
».
Mais en février 2007, Saint-Barthélemy est devenu collectivité
territoriale, séparée de Saint-Martin, pour l’administration
française.
Il y a peu de traces sur l'histoire du télégraphe et du téléphone sur cette île, Merci de m'informer si vous en avez.
Haïti est un État des Gandres Antilles, occupant le tiers occidental de l'île d'Hispaniola (soit 27 750 km2 environ), les deux tiers orientaux étant occupés par la République dominicaine. Sa capitale est Port-au-Prince et son point culminant est le pic la Selle (2 680 m d'altitude).
La défaite de l'armée française au
cours de l'expédition de Saint-Domingue, au terme de la révolution
haïtienne, est à l'origine de la création de la république
d'Haïti, qui devient en 1804 la première république
noire, le premier État noir des Temps modernes et le deuxième
État indépendant d'Amérique (après les États-Unis).
Haïti est aussi le seul territoire francophone
indépendant des Caraïbes, dont il est également le
pays le plus peuplé.
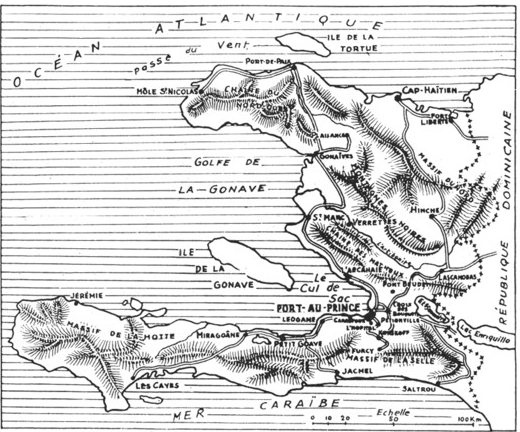

Après avoir été une des premières
destinations des Caraïbes dans les années 1950 à 1970
et avoir manqué la transition démocratique après
la chute des Duvalier (François Duvalier, dit « Papa Doc
», et son fils Jean-Claude Duvalier, dit « Baby Doc »),
Haïti, surnommée « la Perle des Antilles » depuis
l'époque coloniale, fait l'expérience d'une démocratie
renaissante et tente de s'organiser et de se reconstruire après
le violent séisme du 12 janvier 2010.
Guerre financière
et révolution de 1915
Depuis 1906, le pays est dans le champ
d'application de la « diplomatie du dollar » et le département
d'État fait pression en 1910-1911 sur Port-au-Prince. En décembre
1914, des troupes américaines s'emparent de fonds publics contenus
dans la banque et les transfèrent aux États-Unis. Le pays
est en état d'insurrection quasi permanente.
Occupation américaine
(1915-1934)
Décidant d'intervenir par la force,
les États-Unis, dont des soldats étaient présents
sur l'île depuis 1914, envahissent le pays et établissent
par un traité leur domination militaire, commerciale et financière.
Une nouvelle Constitution est écrite par les États-Unis
et instaurée en 1918. L'anglais devient de 1918 à 1934 la
seconde langue officielle du pays, après le français. L'instauration
du travail forcé et le racisme des Marines favorisent les recrutements
par la résistance nationaliste, dirigée par Charlemagne
Péralte, qui comprend 5 000 combattants permanents et 15 000 irréguliers.
La zone de la guérilla concerne essentiellement le Nord et le Nord-Est
du pays. En France, des élus politiques pensaient que Haïti
allait devenir une colonie Américaine, comme le furent les territoires
Espagnols de Porto Rico et des Philippines, qui furent occupés
par les Américains en 1898, lors de la guerre des États-Unis
contre l'Espagne.
La dynastie Duvalier (1957-1986)
Après la fin de l'occupation américaine, l'instabilité
politique (entre militaires mulâtres et populistes noirs) reprend,
et ne s'achève qu'à partir de 1957 avec l'élection
de Duvalier, dont le régime, basé sur le principe du pouvoir
au plus grand nombre, durera jusqu'en 1986...
Pendant toutes ces périodes troubles, les télécommunications
sont peu déveoppées. Il y a très peu de traces sur
ce sujet.
Le télégraphe
1880 L’ancien Ministre des Finances de l’Empereur Faustin
Soulouque a essayé sérieusement d’améliorer
la situation économique d’Haïti une fois devenu président.
Il a appelé les investisseurs français à fournir
le capital nécessaire pour créer une banque nationale, qui
ouvrit ses portes en 1880. La même année, il reprit les paiements
de l’indemnité française, sachant que cette pincée
sur l’économie haïtienne aurait des dividendes dans le
futur. Pendant ce temps, Salomon avait amélioré la situation
de la nation en de multiples façons. Il prévoyait la création
d’un système postal et il invita une compagnie britannique
à installer un câble de télégraphe qui
relia Port-au-Prince et Kingston, Jamaïque. Un second
câble fut installé en 1887, reliant le Môle St. Nicolas
à Santiago de Cuba.
Sous la 3e république, l’état se réserve le
réseau colonial et encadre très étroitement un secteur
privé réservé à l’atlantique Nord et
un peu Sud. Il n’y a pas de stratégie globale et stable des
réseaux nationaux et internationaux et des industries sous-jacentes.
Les changements politiques font et défont les projets, que ce soit
pour les liaisons coloniales ou pour les projets privés: un cas
d’école est ici le projet de câble Brest / Haïti
via Lisbonne et les Açores favorisé par le gouvernement
jusqu’en 1892 puis coulé par le nouveau ministre en 1893,
causant la perte de la SFTSM ( Sté Fse des Télégraphes
Sous-Marins ) à laquelle participe la Société Générale
des Téléphones (réseau nationalisé en France).
Le téléphone
1888 sous la présidence d’Hyppolite
: Jamais les finances de l’État n’auront été
plus prospères. Fort de ses ressources, le pays verra un développement
inégalé des travaux publics ponts, éclairage public,
arrivée du câble transatlantique à Port-au-Prince,
téléphone dans les grandes villes, marchés.
Le département des Travaux Publics, prévu par la Constitution
de 1889, fut organisé. Haïti participa à l'exposition
de Chicago. On acheva le Palais des cinq ministères. Aucun gouvernement
n'a signé plus de contrats; on peut en relever plus de cinquante,
relatifs, les uns au service hydraulique, au télégraphe
terrestre, au téléphone, au câble
sous-marin à prolonger le long d'Haïti, — les
autres à des wharfs, abattoirs, marchés publics (Port-au-Prince,
Cap), à des ponts (Momance), etc
Un réseau télégraphique terrestre corollaire de l'établissement
du câble dont il doit alimenter les recettes est voté, et,
si l'exécution a dû en être retardée, il ne
faut s'en prendre qu'à certaines divergences de vue, faciles à
accorder d'ailleurs, qui se sont produites entre le Gouvernement et la
Société qui a proposé de créer ce réseau
terrestre. Il est à prévoir qu'une base d'entente sera trouvée
par les deux parties contractantes, de sorte que les intérêts
de l'Etat et ceux de la Compagnie puissent être en même temps
sauvegardés. Le désir de doter le
Pays d'innovations réclamées par le
commerce national, et parmi lesquelles il ne faut point oublier l'établissement
prochain d'un réseau téléphonique à Port-au-Prince,
n'a pu tellement absorber le Ministère dzs Travaux publics qu'il
n'ait trouvé l'occasion et le loisir de donner aux différentes
communes de la République toute
la satisfaction qu'elles étaient en droit d'attendre de lui...
1890 Dans son message en date dn 9 jnin 1890,
le Président d'Haïti, s'adressant aux Membres du Corps législatif
réunis en Assemblée nationale, soumettait aux députés
du Peuple et aux sénateurs un Exposé général
de la situation de la République, depuis son arrivée ...
Traçant à grandes lignes l'œuvre
réalisée par le nouveau département ministériel,
le Pouvoir exécutif signalait alors au Pays les travaux exécutés
tant à la Capitale que dans les
autres localités de la République, en môme temps qu'il
attirait l'attention sur les contrats proposés pour l'établissement
de lignes télégraphiques, de lignes de chemins de fer dans
le Pays et pour la création d'un réseau téléphonique
à la Capitale...
Puis en 1891 La Capitale est reliée au monde entier par
le câble sous-marin ; une ligne téléphonique vient
d'être établie ;
Début 1896, c’est au tour d’un réseau téléphonique
d’être installé pour 300 abonnés à Jacmel.
Le 19 septembre 1896, un terrible incendie éclate au Bel-Air, qui
se répand dans toute la ville .. Au milieu des années 1970,
aucune ligne téléphonique ne relie Jacmel aux autres villes
du pays.
En 1922, Louis Borno fut élu prochain président
d'Haïti et le général John Russell, Jr. fut nommé
haut-commissaire. Le gouvernement de Borno-Russell a construit 1 600 milles
de route, établi un central téléphonique,
modernisé les installations portuaires et amélioré
les installations de santé publique. Mais c’est également
sous le mandat du commissaire Russell que de nombreux abus contre le peuple
haïtien ont eu lieu.
L’administration et l’armée sont professionnalisées,
et la corruption combattue. Les infrastructures connaissent un essor sans
précédent : Ainsi, le téléphone automatique
Strowger
est installé à Port-au-Prince ;
Port-au-Prince est devenu la première ville d'Amérique latine
à avoir un service de téléphone disponible avec la
numérotation automatique.

1929 Centrale du téléphone automatique à PauP;
Bâtiment de préselecteurs et sélecteurs et table d’essai.
Conseil d'Etat : Séance du 28 mai 1926
Extension dn système de téléphone automatique de
Port-au-Prince. . . . .. . . . . . . . . . . . 258. 000
Ligne télépbonique-télégraphique permanente
de Petit-Goâve anx Cayes. . . . . . . . . . . . . 204.000
Ligne téléphonique-télégraphique Las-Cahobas-Hinche........
. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.500
Ligne téléphonique-télégraphique permanente
Pont-Sondé-Petite-Rivière de l 'Artibonite. . .. 2.500
Téléphone automatique, Cap-Hllïtien ....
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 48.000
Téléphone automatique, Cayes. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 49.500
Connection du réseau téléphonique de Pétion-ville
avec celui de Port-an--l'rinca.. . . . . . . . 50. 500
16 Mai 1927 «La Teleco a été inaugurée
sous la dénomination de Telegraphe Terrestre sous la présidence
de Louis BORNO avec comme Président Directeur Général
Monsieur A. HARTUNG. Elle conserva cette dénomination jusqu’au
2 Juin 1969 où elle passera à celle de Telecommunications
d’Haiti , date marquant le début de la periode d’administration
canadienne qui durera 3 années avant que les autorités haitiennes
n’en prennent charge. Le 4 Mai 1976, elle fut investie de son appellation
les Telecommunications d’ Haiti .
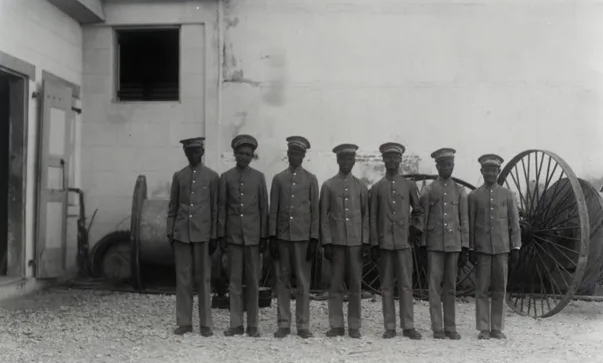 Facteurs 1929.
Facteurs 1929.
Il faut bien se rappeler, que pendant pratiquement plus de 70 ans (1927–1997), le téléphone est une affaire de grands, dans l’Haiti de toujours…
La Radio
Le général américain John W. Russell et d'autres
ont pris la décision d'acheter une station de radio pour 40 000
$ pour l'enseignement agricole en milieu rural, apparemment sans grande
dissidence de la part des dirigeants politiques ou de la presse.
L'émetteur construit par Western Electric a été installé
et testé à Port-au-Prince en juillet 1926. Sa puissance
était de 1 000 watts et sa fréquence était d'abord
de 830 Kc/s, puis changée à 920 Kc/s. Il utilisait une antenne
filaire de type « T », suspendue entre deux tours de 170 pieds
de haut situées au Palais des Ministres, où il resta jusqu'en
1942.
D. H. Newman, un spécialiste des Bell Laboratories de New York,
est venu tester l'installation. Il a parlé d'un excellent accueil
dans les villes haïtiennes et même dans certaines villes lointaines
des Caraïbes. La station fut en tests réguliers jusqu'au 25
août 1926, en attendant une ouverture officielle en octobre.
1934 - Fin de l’occupation américaine
dont l’autorité souvent « musclée » aura
permis au pays de se relever et de progresser.
Aménagement des ports, instruction publique encouragée,
service de santé développé, avec la construction
d’hôpitaux ou de dispensaires, relance de l’agriculture,
création de 1 700 kilomètres de routes, développement
de l’électricité et du téléphone
mais dans les années qui suivent le départ des Américains,
Haïti retombe dans l’instabilité politique.
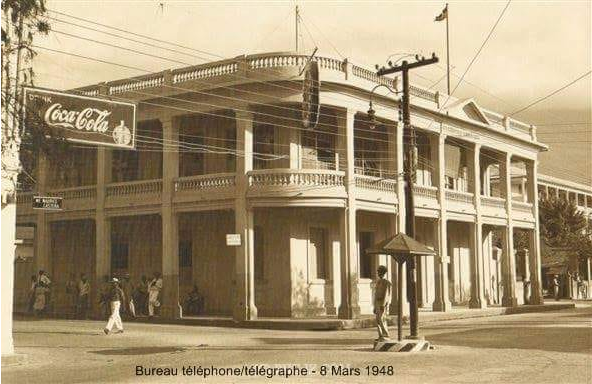
Toutefois, malgré les progrès considérables
réalisés dans les technologies de l’information et
de la télécommunication, le taux de pénétration
de ce service en 1998 était seulement de 0,72%, soit un
total de 55,000 lignes installées pour une population de
près de 7.650 millions d’habitants, et ce service
était concentré dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince
à hauteur de 85% ».
En 2003, on dénombrait plus de 140 000 lignes
sur le territoire pour une population de 9 millions d'habitants;
en 2008, ce nombre avait fondu à 108 000, chute importante
qui s'explique par l'arrivée du cellulaire et, surtout, l'arrivée
de nouveaux joueurs dans un univers de télécommunication
jusque-là réservé et exploité uniquement par
le gouvernement,
seulement 428 personnes sur 1 000 disposent d'un téléphone
mobile, tandis que 300 personnes ont accès à internet.
Néanmoins, grâce à l'arrivée de nouveaux opérateurs
téléphoniques et fournisseurs d'accès à internet
à l'instar de la Natcom, entreprise haitiano-vietnamienne, en 2011
et l'extension du réseau de la Digicel, beaucoup de progrès
sont réalisés dans ce secteur. Par ailleurs, la jeunesse
haïtienne est très connectée.
Le CONATEL (Conseil National des
Télécommunications, qui relève du ministère
des travaux publics, transports et communications) veille au développement
de ces secteurs. Les opérateurs commerciaux pour la téléphonie
mobile et Internet sont Digicel (qui a racheté Comcel en 2012)
et Natcom. En 2013 le secteur des télécommunications apporte
près d'un quart des recettes fiscales (la taxation des appels entrants
a apporté 50 millions de dollars américains).
De 2011 à 2013 l'État a repris en
main la lutte contre la fraude téléphonique et a procédé
au blocage de 38 155 numéros. Un contrôle des ventes des
cartes SIM permettant l'identification des utilisateurs est mis en place
En 2015 on dénombre 41 000 postes téléphoniques
fixes et plus de 7,4 millions de téléphones
portables.
Ce sont le réseau et les équipements de la téléphonie
fixe comme les moins développés des Caraïbes et de
l'Amérique latine mais l'introduction de téléphones
portables bon marché a contribué à un taux d'équipement
de près de 73 % de la population4.
2020 : Les territoires d’Outre-mer sont particulièrement attentifs
à la connectivité fixe et mobile, qui contribue à
leur cohésion économique et sociale.
Le 15 novembre, Orange a annoncé cesser la commercialisation
de nouvelles lignes analogiques (RTC réseau téléphonique
commuté) sur l’ensemble des départements d’outremer,
ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Il ne sera plus possible d’ouvrir de nouvelles lignes RTC mais les
lignes existantes continueront à fonctionner.
La fermeture technique effective se fera ensuite progressivement, à
partir de fin 2023, par plaques géographiques.
Pour permettre aux consommateurs de se préparer
à cette transition technologique, l’Arcep a imposé
à Orange d’annoncer au moins 5 ans à l’avance
le périmètre géographique des plaques devant être
fermées.
En matière de déploiement des
réseaux, les territoires ultramarins connaissent des problématiques
similaires à celles de la Métropole. Mais elles présentent
aussi leurs spécificités : des tailles de marché
très inférieures ne bénéficiant pas nécessairement
de la dynamique concurrentielle métropolitaine, la question de
la continuité numérique avec la Métropole, l’entretien
des réseaux dans des conditions géographiques et météorologiques
plus difficiles. Bien consciente de ces problématiques particulières,
l’Arcep les prend en compte afin d’assurer une meilleure connectivité
aux citoyens ultramarins :
- dans sa réglementation, à l’image des modalités
d’attribution spécifiques qu’elle a mises en place pour
les fréquences 4G;
- dans ses travaux, avec un accompagnement spécifique à
la reconstruction des réseaux après le passage de l’ouragan
Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy;
- au travers de ses outils cartographiques « Carte fibre »
et « Mon réseau mobile » qui rendent compte de l’état
des déploiements des réseaux fixes et mobiles dans les territoires
ultramarins.


14 août 2021 Samedi à 8h29 du matin, la terre tremble en
Haïti. Déjà durement frappé il y a 11 ans par
un séisme qui a ébranlé la capitale Port-au-Prince
et fait entre 100 000 et 250 000 victimes.