Connaitre les Colonies Françaises
Pourquoi évoquer ce sujet dans
un site de télécommunications ?
Tout simplement parce que l'histoire du télégraphe, du
téléphone puis de la radio commence dans la période
des colonies ou les télécommunications étaient
le lien essentiel à l'essor de chaque colonie.
L'Empire colonial français est l'ensemble
des colonies, protectorats, territoires sous mandat et territoires ayant
été sous tutelle, gouvernés ou administrés
par la France. Inauguré au XVIe siècle, il a connu une
évolution très contrastée selon les époques,
aussi bien par son étendue que par sa population ou sa richesse.
Les possessions coloniales ont connu différents statuts et modes
d'exploitation ; des colonies antillaises esclavagistes du XVIIe et
du XVIIIe siècle à l'Algérie française,
partie intégrante de la France à certaines périodes,
en passant par les protectorats de Tunisie et du Maroc et les territoires
sous mandat de Syrie et du Liban.
On distingue généralement deux grandes périodes,
le pivot étant la guerre de Sept Ans, puis la Révolution
et l'époque napoléonienne, épisodes au cours desquels
la France perdit pratiquement l'ensemble de sa première entreprise
coloniale.
- Le premier
empire colonial, constitué à
partir du XVIe siècle, comprend des territoires nord-américains,
quelques îles des Antilles, les Mascareignes et des établissements
en Inde et en Afrique. La guerre de Sept Ans se solde par la perte d'une
grande partie des territoires coloniaux de la France au profit de la
Grande-Bretagne (Nouvelle-France et en Inde). L'empire colonial survit
malgré tout et connaît une certaine prospérité
grâce aux exportations antillaises (Saint-Domingue, Martinique,
Guadeloupe) de café et surtout de sucre entre 1763 et la fin
des années 1780. Il s'effondre toutefois brutalement au point
de disparaître presque entièrement à la suite de
l'époque napoléonienne (ex : vente de la Louisiane).
La Nouvelle-France :
« La Nouvelle-France » désignait l’ensemble
des territoires de l’Amérique du Nord sous administration
française, avant 1773. Dans sa plus grande dimension, avant le
Traité d’Utrech de 1713, la Nouvelle-France comprenait cinq
colonies : le Canada, l’Acadie, la Baie d’Hudson, Terre-Neuve,
la Louisiane... Le premier explorateur Giovanni VERRAZZANO, mandaté
par le roi de France François Ier, décrivit la côte
allant de la Floride jusqu’à Terre-Neuve et donna le nom
« Nova Franca » en 1524…
Dix ans plus tard, le malouin Jacques CARTIER découvrit le golfe
du Saint-Laurent, et remonta le cours du fleuve.
Le Canada, à son tour, était ainsi nommé et
Jacques CARTIER en prend possession au nom du roi François Ier…
»
“…L’exploration est reprise sous les règnes d’Henri
IV et de Louis XIII par un hardi aventurier, Samuel de CHAMPLAIN, qui
fonde la ville de Québec… » À partir
de 1534, les Français explorent le canal du Saint-Laurent. La
Nouvelle-France est fondée.
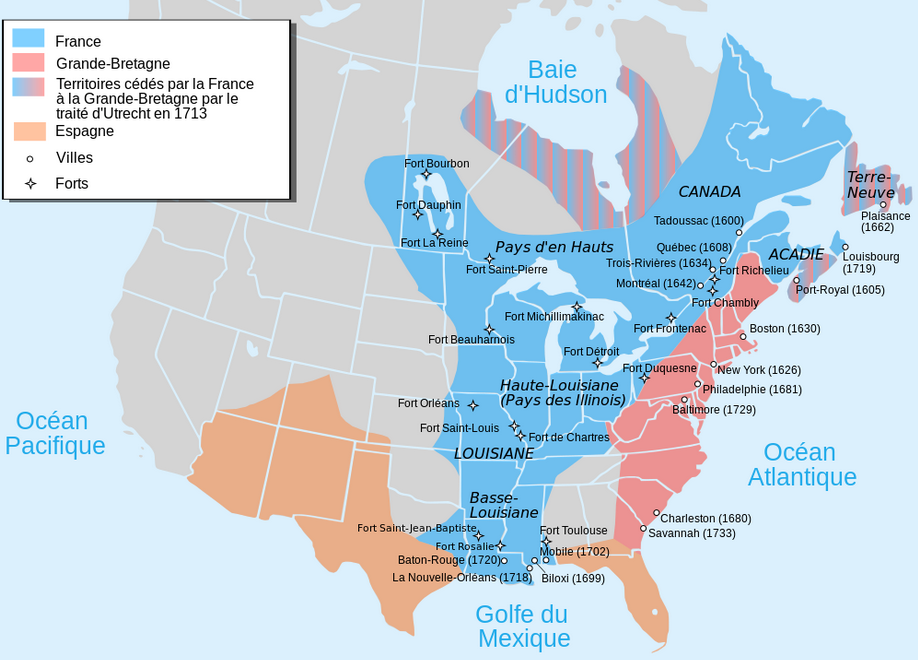
En Amérique, la Nouvelle-France s'accroît de façon
spectaculaire et comprend presque la moitié de l'Amérique
du Nord. Elle forme quatre colonies dont l'Acadie, le Canada, Terre-Neuve
et la Louisiane.
En 1627, la Nouvelle-France est concédée par RICHELIEU
à la Compagnie des Cents-Associés, mais en 1663 Louis
XIV dissout la compagnie et réorganise la colonie sur le modèle
d’une province… Au cours du XVIIIe siècle la rivalité
franco-anglaise débouche sur la guerre des Sept Ans (1756-1763)…
Le marquis de MONTCALM prend le commandement des troupes françaises…Le
13 septembre 1759, MONTCALM est mortellement blessé dans la défense
de la ville de Québec… Cédée à
l’Angleterre par le traité de Paris, la Nouvelle-France
est rebaptisée « Province of Quebec » …
L’Acadie :
« Dans les colonies nouvelles, les Espagnols commencent par bâtir
une église, les Anglais une taverne et les Français un
fort » (Chateaubriand : Itinéraire de Paris à Jérusalem).
Le 24 juin 1497, Jean CABOT découvre Terre-Neuve.
Le tout premier établissement français en Acadie fut installé
en 1604, sur l’île Sainte Croix, par Pierre Du GUA. Ensuite
il fonde la ville de Port-Royal.
Après le traité d'Utrecht en 1713,
la colonie perd l'Acadie (partie sud), la Baie-d'Hudson et Terre-Neuve
(Plaisance). Cependant, elle forme deux nouvelles colonies : l'isle
Royale et isle Saint-Jean.
Après la chute de Québec, et la main mise des Anglais
sur ces territoires, en 1755, une politique de déportation des
acadiens français est instauré :
Le Grand Dérangement. Sur une population acadienne d’origine
française de 13000 âmes, 7000 sont déportées,
renvoyées en France, puis ensuite vers la Louisiane, où
en 1773 est fondé Saint Martin Ville…
Tout s'écroule avec le traité de Paris
en 1763, après la guerre de Sept Ans, où elle perd le
Canada, l'Acadie, isle Royale, isle Saint-Jean, et la partie est du
Mississippi, qui faisait partie de la Louisiane, et la partie ouest
qui revient à l'Espagne, pour sa perte de la Floride aux dépens
des Anglais.
La France reprit la Louisiane occidentale à condition de ne pas
la vendre ni à l'Angleterre ni aux Américains, ce que
Napoléon fit trente ans plus tard, sans l'appui ou l'approbation
de l'Assemblée Nationale en 1803. L'Amérique du Nord devient
alors en majorité anglophone.
- Le
second empire colonial, constitué à
partir des années 1830, se compose principalement de régions
d'Afrique acquises à partir des anciens comptoirs, mais aussi
d'Asie (Indochine et Levant) et d'Océanie (Polynésie française,
Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides).
Ce second empire colonial fut au cours de la seconde moitié du
XIXe et au XXe siècle le deuxième plus vaste du monde,
derrière l'empire colonial britannique en superficie. Présent
sur tous les continents, il s'étendait à son apogée,
de 1919 à 1939, sur 12 347 000 km2, où vivaient 68 690
000 habitants en 1939, loin derrière l'Empire britannique où
l'Inde à elle seule comptait 330 000 000 habitants à la
même date en incluant la France métropolitaine, les terres
sous souveraineté française atteignaient ainsi la superficie
de 12 898 000 km2.
L'empire colonial français fut, tout particulièrement
sous le régime républicain, appuyé sur l'idée
d'une mission civilisatrice. Sous l'ancien régime, la conversion
au catholicisme était déjà un motif important dans
la justification du colonialisme.
Aujourd'hui, l'héritage territorial de ce vaste empire
colonial constitue la « France d'outre-mer » (départements
et régions d'outre-mer, collectivités d'outre-mer soit
« DROM-COM », anciens « DOM-TOM ») : une douzaine
de territoires insulaires dans l'Atlantique, les Antilles, l'océan
Indien, le Pacifique sud, au large de l'Antarctique, ainsi que la Guyane
sur la côte nord de l'Amérique du Sud, pour une superficie
émergée totale de 119 394 km2, soit à peine 1 %
de la superficie de l'empire colonial à son apogée entre
les deux guerres mondiales. D'une faible superficie émergée,
ces territoires d'outre-mer permettent toutefois à la France
de revendiquer la seconde plus grande zone économique exclusive
(ZEE) au monde, couvrant 10 186 526 km2 d'océans, derrière
celle des États-Unis.
1928 Ce que sont les Colonies Françaises
GEORGES-ALEXANDRE publie un récit des colonies (vision de l'époque).
| Les colonies françaises constituent
le second empire colonial du monde comme étendue. Au point
de vue économique, elles viennent après les Britanniques
et les Néerlandaises. On peut les diviser en deux séries : 1° Les colonies autonomes, avec la plupart de nos anciennes possessions : colonies d'Amérique, Réunion, Etablissements français dans l'Inde, Côte française des Somalis et colonies du Pacifique. Ces pays comprennent des îles qui ne méritent plus guère le nom de colonies, étant à peu près complètement mises en valeur et jouissant d'une assimilation presque identique à celle de la Métropole. Ce sont la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, le groupe du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et les Etablissements français de l'Océanie, pays de quasi peuplement, en ce sens que la race blanche peut y vivre, même y prospérer (Nouvelle-Calédonie), sans cependant pouvoir se livrer à tous travaux comme en France. 2° Les Gouvernements Généraux et les Territoires Africains sous mandat sont des pays essentiellement tropicaux, où l'homme de race blanche ne peut pas espérer se fixer définitivement et faire souche, à l'exception de quelques rares points qui imposent cependant des restrictions d'activité et des précautions sans nombre.Ces colonies, à part quelques petits établissements côtiers, ont été conquis à la France grâce aux efforts conjugués des coloniaux de la génération qui s'en va. Sous le second empire, Faidherbe, au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, a préparé les travaux de Binger, Monteil, Gallieni, et de tous les autres pionniers de la conquête de l'A. O. F. par la République. En même temps, en Cochinchine, les Amiraux commençaient la prospection de l'Indochine actuelle, avec la mission Doudart de Lagrée, qui devait entraîner, par la suite, celle de Francis Garnier, et les reconnaissances de la Côte d'Annam au Mékong par les Médecins de marine Vergniaud et Neïs et la mission Pavie. Les territoires immenses que forment ces colonies, dont la conquête commencée il y a quarante-cinq ans est à peine terminée, et dont l'occupation n'est pas encore effective partout, nous donnent déjà des résultats considérables, tant au point de vue production économique qu'au point de vue de l'expansion des idées françaises. Les indigènes qui, il y a quelque vingt ans, vivaient uniquement du produit de leur chasse, et, hier encore, étaient cannibales, sont maintenant à nos côtés de parfaits collaborateurs. Le lettré d'Asie évolue chaque jour vers une civilisation meilleure. A quinze ans à peine de la grande tourmente passée, nous avons la fierté d'écrire que pendant toute la durée de la guerre nous avons pu retirer du territoire de nos possessions lointaines la plus grande partie de nos troupes régulières, recruter sur place 150.000 combattants et 300.000 travailleurs, et les envoyer en France, sans avoir aucun ennui, aucune révolte sérieuse. La coopération et l'association de pareils éléments ne peuvent qu'être fructueuses dans tous les domaines et pour tous les participants. Pour réussir, elles exigent l'emploi d'un cadre français formé d'hommes parfaitement sélectionnés, physiquement et moralement. Il ne faut envoyer, ou laisser partir, aux colonies, que des sujets répondant à ces conditions primordiales. Les incapables et les tarés ne pourront que nuire à l'oeuvre commune. Dans le passé, la vie dure et pénible de l'expansion opérait elle-même une double sélection naturelle. Les faibles et les malingres ne résistaient pas, mouraient ou rentraient en France, fortement handicapés. Ceux dont les ressorts moraux fléchissaient fuyaient la colonie dès qu'ils le pouvaient. Ceux qui restaient — à part quelques déséquilibrés qui nous ont causé les incidents que l'on sait — présentaient d'incontestables garanties et d'indiscutables qualités. Les colonies françaises diffèrent des pays de l'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc), en ce sens que si, dans ces régions, le Blanc vit, procrée et travaille comme dans la métropole, cela lui est totalement impossible dans la zone tropicale. C'est pour avoir utilisé nos troupes blanches à des travaux de construction, de fortification ou de premier établissement indispensables, que nous avons eu les hécatombes qui marquent le début de nos campagnes coloniales du siècle dernier, et cela malgré les soins éclairés et le dévouement d'un corps médical auquel on doit une grande partie des découvertes les plus récentes. Certes, il existe quelques régions de bien faibles étendues (Réunion, Antilles et Océanie), où la race blanche vit et peut se perpétuer, à condition d'éviter les travaux pénibles, — celui de la terre, en particulier — et les intempéries. L'avenir nous dira s'il peut en être de même dans certaines contrées du Haut Tonkin et du Haut Laos, des plateaux du Tran-Ninh, des Bolovens et du Lang-Bian, pour l'Indochine. De même pour le centre et le sud de Madagascar, particulièrement le Betsiléo. L'Afrique pourra, de son côté, tenter de coloniser le Fouta-Djallon en Guinée, et l'Adamoua, au Cameroun. Encore ce peuplement gagnera-t-il à être tenté par le procédé appliqué par les Espagnols dans l'Amérique du Sud, pays cependant plus favorable à la race blanche. Or, les Espagnols se sont surtout alliés aux femmes du pays, puis aux métisses provenant des premières unions. Aux Philippines, ils ont opéré de même et les résultats sont probants. Nous mêmes, nous avons pu constater, dans nos anciennes colonies des Antilles et de la Réunion, que le métissage a amélioré sensiblement la race et nous a fourni quelques sujets remarquables. D'autant qu'il faut bien convenir que la femme blanche résiste très mal au climat tropical, s'ennuie, est prise par la nostalgie, s'anémie considérablement, plus rapidement que l'homme, et voit souvent son système nerveux détraqué. Sauf de très rares cas, il ne faut pas essayer de faire vivre une femme blanche en dehors des villes importantes, où elle peut recevoir les soins médicaux utiles et échapper dans la mesure du possible à l'isolement. Il est certain que, parmi les très rares françaises ayant résisté à ces épreuves de sélection, certaines, d'une trempe supérieure, ont pu rendre de grands services aux leurs et, par suite, au pays, comme la femme de cet administrateur qui était devenue l'infirmière des noirs terminant le Thiés Kayes. De ce qui précède, nous constatons donc qu'il faut, en région tropicale, ne créer que des colonies d'exploitation, où le travail manuel est fait par des indigènes, conduits et dirigés par le plus petit nombre possible d'Européens, pourvus, autant qu'il est possible de le faire, du maximum de confort et de moyens d'action. Cela suffit à démontrer que la colonisation de ces régions ne peut se faire qu'avec de puissants moyens financiers, après une étude très complète de chaque question. La colonisation devient en quelque sorte un problème scientifique demandant une solution pour chaque produit. Par exemple, la culture du coton en A. O. F. entraîne des travaux considérables pour aménager le Niger en vue des irrigations nécessaires, il faut choisir et adapter des variétés de coton convenant au but proposé. Pour cela, des spécialistes des cotons d'Egypte et d'Amérique sont engagés pour renforcer les services locaux d'études et le personnel de l'Association cotonnière coloniale (groupement réunissant les industriels français du coton) qui, depuis plus de vingt ans, fait des études et des essais sur place. Ce n'est que par des moyens semblables que l'on est maintenant certain de pouvoir créer avec succès des champs de coton au Soudan, en y mettant les capitaux indispensables. De même pour l'élevage du mouton et pour la solution de tous les grands problèmes économiques; il faut toujours du temps, de l'argent et surtout des compétences. |
Les Colonies Africaines
Jamais, dans l’histoire de l’Afrique, des
changements ne se sont succédé avec une aussi grande rapidité
que pendant la période qui va de 1880 à 1935. À
vrai dire, les changements les plus importants, les plus spectaculaires,
les plus tragiques aussi, ont eu lieu dans un laps de temps beaucoup
plus court qui va de 1890 à 1910, période marquée
par la conquête et l’occupation de la quasi-totalité
du continent africain par les puissances impérialistes, puis
par l’instauration du système colonial.
La période qui suivit 1910 fut caractérisée essentiellement
par la consolidation et l’exploitation du système.
Le développement rapide de ce drame a de quoi surprendre, car,
en 1880 encore, seules quelques régions nettement circonscrites
de l’Afrique
étaient sous la domination directe des Européens.
Pour l’Afrique occidentale, l’ensemble se limitait aux zones
côtières et insulaires du Sénégal, à
la ville de Freetown et à ses environs (qui font aujourd’hui
partie de la Sierra Leone), aux régions méridionales de
la Gold Coast (actuel Ghana), au littoral d’Abidjan en Côte-d’Ivoire
et de Porto Novo au Dahomey (actuel Bénin), à l’île
de Lagos (dans ce qui forme aujourd’hui le Nigéria).
En Afrique du Nord, les Français n’avaient colonisé,
en 1880, que l’Algérie.
Dans toute l’Afrique orientale, pas un seul pouce de terrain n’était
tombé aux mains d’une puissance européenne, tandis
que dans toute l’Afrique centrale les Portugais n’exerçaient
leur pouvoir que sur quelques bandes côtières du Mozambique
et de l’Angola.
Ce n’est qu’en Afrique méridionale que la domination
étrangère était, non seulement fermement implantée,
mais s’était même considérablement étendue
à l’intérieur des terres (voir fig. ci dessous).
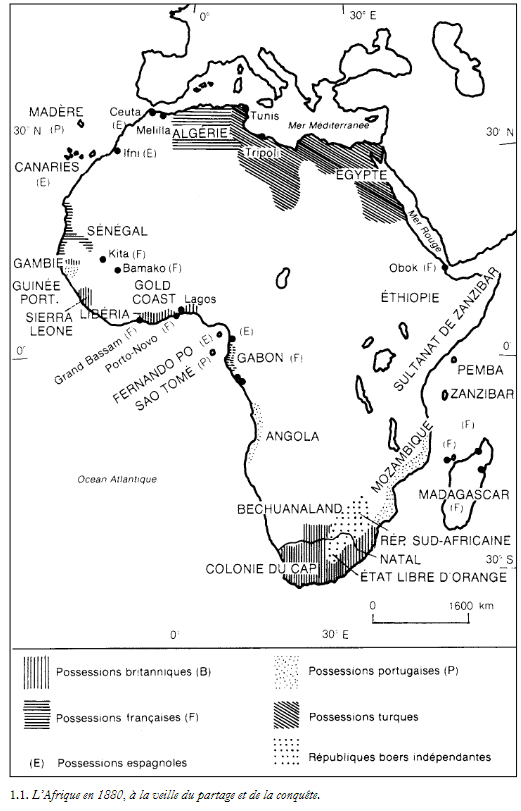 L'afrique en
1880
L'afrique en
1880
En 1880, sur une superficie atteignant environ 80 % de son territoire,
l’Afrique est gouvernée par ses propres rois, reines, chefs
de clan et de lignage, dans des empires, des royaumes, des communautés
et des unités d’importance et de nature variées.
Or, dans les trente années qui suivent, on assiste à un
bouleversement extraordinaire, pour ne pas dire radical, de cette situation.
En 1914, à la seule exception de l’Éthiopie et du
Libéria, l’Afrique tout entière est soumise à
la domination des puissances européennes et divisée en
colonies de dimensions variables, mais généralement beaucoup
plus étendues que les entités préexistantes et
ayant souvent peu ou aucun rapport avec elles. Par ailleurs, à
cette époque, l’Afrique n’est pas seulement assaillie
dans sa souveraineté et son indépendance, mais également
dans ses valeurs culturelles. Comme Ferhat Abbas le fait remarquer en
1930, à propos de la colonisation en Algérie, pour les
Français, « la colonisation ne constitue qu’une entreprise
militaire et économique défendue ensuite par un régime
administratif approprié ; pour les Algériens, au contraire,
c’est une véritable révolution venant bouleverser
tout un vieux monde d’idées et de croyances, un mode d’existence
séculaire. Elle place un peuple devant un changement soudain.
Et voilà toute une population, sans préparation aucune,
obligée de s’adapter ou de périr. Cette situation
conduit nécessairement à un déséquilibre
moral et matériel dont la stérilité n’est
pas loin de la déchéance totale ».
Ces observations sur la nature du colonialisme valent non seulement
pour la colonisation française en Algérie, mais pour toute
colonisation européenne en Afrique, les différences étant
dans le degré, non dans la nature, dans la forme, non dans le
fond.
Autrement dit, au cours de la période 1880-1935, l’Afrique
doit faire face à un défi particulièrement menaçant
: celui que lui lance le colonialisme.
La génération de 1880 -1914 a été
le témoin d’une des mutations historiques les plus importantes,
peut-être, des temps modernes. C’est en effet au cours de
cette période que l’Afrique, continent de vingt-huit millions
de kilomètres carrés, fut partagée, conquise et
effectivement occupée par les nations industrialisées
d’Europe.
L’importance de cette phase historique dépasse cependant
de beaucoup la guerre et les changements qui la caractérisent.
L’histoire a vu des empires se constituer puis s’écrouler
; conquêtes et usurpations sont aussi anciennes que l’histoire
elle-même, et, depuis bien longtemps, divers modèles d’administration
et d’intégration coloniales avaient été expérimentés.
L’Afrique a été le dernier continent à être
conquis par l’Europe. Ce qu’il y a de remarquable dans cette
période, c’est, du point de vue européen, la rapidité
et la facilité relative avec lesquelles, par un effort coordonné,
les nations occidentales occupèrent et subjugèrent un
aussi vaste continent. Le fait est sans précédent dans
l’histoire.
Malgré l’influence considérable qu’exerçaient,
à la fin du troisième quart du XiXe siècle, les
puissances européennes française, anglaise, portugaise
et
allemande et les intérêts commerciaux qu’elles y détenaient
dans différentes régions de l’Afrique, leur mainmise
politique y demeurait extrêmement
limitée. L’Allemagne et, surtout, l’Angleterre exerçaient
à leur gré leur influence et aucun homme d’État
avisé n’aurait spontanément choisi d’engager
des dépenses et de s’exposer aux risques imprévus
d’une annexion dans les règles alors qu’ils retiraient
des avantages identiques d’un contrôle
occulte. « Refuser d’annexer ne prouve aucunement que l’on
répugne à exercer sa domination », a-t-on fait remarquer
fort justement . Cela explique à la fois les comportements de
Salisbury, de Bismarck ainsi que celui de la plupart des protagonistes
du partage.
Mais ce comportement commença à évoluer à
la suite de trois événements importants qui se produisirent
entre 1876 et 1880. Le premier fut le nouvel intérêt que
le duc de Brabant, sacré roi des Belges en 1865 (sous le nom
de Léopold I er ), porta à l’Afrique. La chose apparut
lors de ce qui fut appelé la Conférence de géographie
de Bruxelles, qu’il convoqua en 1876 et qui déboucha sur
la création de l’Association internationale africaine et
le recrutement de H. M. Stanley en 1879 pour explorer les Congos sous
le couvert de l’association. Ces mesures amenèrent la création
de l’État libre
du Congo, dont la reconnaissance par toutes les nations européennes
fut obtenue par Léopold avant même la fin des délibérations
de la Conférence
de Berlin sur l’Afrique occidentale».
Les activités du Portugal à partir de 1876 constituèrent
la deuxième série d’événements importants.
Vexé de n’avoir été invité à
la Conférence de Bruxelles qu’à la dernière
minute, ce pays lança une série d’expéditions
qui conduisirent, en 1880, à l’annexion par la couronne
portugaise des domaines des planteurs afro-portugais du Mozambique,
jusque-là quasi indépendants. Ainsi, pour les Portugais
et pour le roi Léopold, la lutte commença en 1876. Le
troisième et dernier événement qui paracheva le
partage fut sans aucun doute l’esprit expansionniste qui caractérisa
la politique française entre 1879 et 1880 et qui se manifesta
par sa participation au condominium franco-anglais d’Égypte
(1879), par l’envoi de Savorgnan de Brazza au Congo, par la ratification
de traités avec le chef des Bateke, Makoko, et par le renouveau
de l’initiative coloniale française à la fois en
Tunisie et à Madagascar .
L’action de ces grandes puissances entre 1876 et 1880 montra clairement
qu’elles étaient dorénavant toutes impliquées
dans l’expansion coloniale et l’instauration d’un contrôle
formel en Afrique, ce qui obligea finalement l’Angleterre et l’Allemagne
à abandonner leur théorie favorite d’une influence
occulte pour un contrôle affirmé qui les conduisit à
annexer des territoires de l’Est, de l’Ouest et du Sud africain
à partir de 1883.
Ainsi, la seconde annexa le sud-ouest de l’Afrique, le Togo, le
Cameroun et l’Afrique-Orientale allemande, contribuant par là
à accélérer le processus
du partage.
Au début des années 1880, le partage battait son plein
et le Portugal, craignant d’être évincé d’Afrique,
proposa de convoquer une conférence internationale afin de débrouiller
l’écheveau des litiges territoriaux dans la zone du centre
de l’Afrique. Il semble évident, d’après ce
que nous venons
de dire, que ce n’est pas l’occupation anglaise de l’Égypte
en 1882 qui déclencha le partage, comme l’ont affirmé
Robinson et Gallagher
, mais bien plutôt les événements qui se déroulèrent
en différentes parties de l’Afrique entre 1876 et 1880..
sommaire
La Conférence de Berlin sur l’Afrique Occidentale (1884-1885)
L’idée d’une conférence internationale qui permettrait
de résoudre les conflits territoriaux engendrés par les
activités des pays européens dans la région du
Congo fut lancée à l’initiative du Portugal et reprise
plus tard par Bismarck, qui, après avoir consulté les
autres puissances, fut encouragé à lui donner corps. La
conférence se déroula à Berlin, du 15 novembre
1884 au 26 novembre 1885 . À l’annonce de cette conférence,
la ruée s’intensifia. La conférence ne discuta sérieusement
ni de la traite des esclaves ni des grands idéaux humanitaires
qui étaient censés l’avoir inspirée. On adopta
néanmoins des résolutions vides de sens concernant l’abolition
de la traite des esclaves et le bien-être des Africains.
Initialement, le partage de l’Afrique ne faisait pas partie des
objectifs de cette conférence. Elle aboutit pourtant à
répartir des territoires et à dicter des résolutions
concernant la libre navigation sur le Niger, la Bénoué
et leurs affluents. Elle établit aussi les « règles
à observer dorénavant en matière d’occupation
des territoires sur les côtes africaines». En vertu de l’article
34 de l’Acte de Berlin, document signé par les participants
à la Conférence, toute nation européenne qui, dorénavant,
prendrait possession d’un territoire sur les côtes africaines
ou y assumerait un « protectorat » devrait en informer les
membres signataires de l’Acte de Berlin pour que ses prétentions
fussent ratifiées. C’est ce qu’on a appelé la
doctrine des «sphères d’influence», à
laquelle est liée l’absurde concept d’hinterland. Cette
dernière fut interprétée de la façon suivante
: la possession d’une partie du littoral entraînait celle
de l’hinterland, sans limite territoriale vers l’intérieur.
L’article 35 stipulait que l’occupant de tout territoire côtier
devait aussi être en mesure de prouver qu’il exerçait
une « autorité » suffisante « pour faire respecter
les droits acquis et, le cas échéant, la liberté
du commerce et du transit dans les conditions où elle serait
stipulée ». C’était là la doctrine dite
« de l’occupation effective », qui allait faire de
la conquête de l’Afrique l’aventure meurtrière
que l’on verra.
De fait, en reconnaissant l’État libre du Congo, en permettant
à des négociations territoriales de se dérouler,
en posant les règles et les modalités de l’appropriation
« légale » du territoire africain, les puissances
européennes s’arrogeaient le droit d’entériner
le principe du partage et de la conquête d’un continent.
Pareille situation est sans précédent dans l’histoire
: jamais un groupe d’États d’un seul continent n’avait
proclamé avec une telle outrecuidance son droit à négocier
le partage et l’occupation d’un autre continent.
Pour l’histoire de l’Afrique, c’était là
le résultat essentiel de la conférence. Dire que, contrairement
à ce que l’on croit en général, celle-ci n’a
pas dépecé l’Afrique n’est vrai que si l’on
se place sur le plan purement technique.
Les appropriations de territoires eurent virtuellement lieu dans le
cadre de la conférence, et la question des acquisitions à
venir fut clairement évoquée
dans sa résolution finale. En fait, c’est dès 1885
que fut esquissé le partage définitif de l’Afrique
.
sommaire
Les traités de 1885 à 1902
Avant l’Acte de Berlin, les puissances européennes avaient
déjà acquis en Afrique, et de diverses façons,
des sphères d’influence : par l’installation
d’une colonie, l’exploration, la création de comptoirs,
l’occupation de zonesstratégiques et par des traités
passés avec des chefs africains. Après la
conférence, les traités devinrent les instruments essentiels
du partage de l’Afrique sur le papier. Ces traités étaient
de deux types : les traités conclus
entre Africains et Européens ; les traités bilatéraux
conclus entre Européens. Les traités afro-européens
se répartissaient en deux catégories. Il y
avait d’abord les traités sur la traite des esclaves et
le commerce, qui furent source de conflit et provoquèrent l’intervention
politique européenne dans les affaires africaines. Puis venaient
les traités politiques, par lesquels les chefs africains, soit
étaient amenés à renoncer à leur souveraineté
en
échange d’une protection, soit s’engageaient à
ne signer aucun traité avec d’autres nations européennes.
Ces traités politiques furent très en vogue durant la
période considérée.
Ils étaient passés par des représentants de gouvernements
européens ou par certaines organisations privées qui,
plus tard, les cédaient à leurs gouvernements respectifs.
Lorsqu’un gouvernement métropolitain les acceptait, les
territoires concernés étaient en général
annexés ou déclarés protectorats ; d’un autre
côté, si un gouvernement doutait de l’authenticité
des traités ou s’il se sentait contraint à la prudence
par les vicissitudes de la Weltpolitik, il utilisait alors ces traités
pour obtenir des avantages dans le cadre de négociations bilatérales
européennes. Par ailleurs, les Africains convenaient de ces traités
pour diverses raisons mais surtout dans l’intérêt
de leur peuple.
Dans certains cas, ils souhaitaient nouer des relations avec les Européens
dans l’espoir d’en tirer des avantages politiques par rapport
à leurs voisins.
Parfois, un État africain en position de faiblesse signait un
traité avec une puissance européenne en espérant
pouvoir ainsi se libérer de son allégeance
à l’égard d’un autre État africain qui
faisait valoir des droits sur lui. Ce dernier pouvait aussi souhaiter
un traité en comptant l’utiliser pour maintenir dans l’obéissance
des sujets récalcitrants. Enfin, certains États africains
estimaient qu’en passant un traité avec un pays européen,
ils pourraient sauvegarder leur indépendance menacée par
d’autres nations européennes . Quel qu’en fût
le cas de figure, les traités afro-européens jouèrent
un rôle important dans la phase finale du partage de l’Afrique.
Les traités signés entre l’Impérial British
East Africa Company (iBeac) et le Buganda nous montrent un souverain
africain sollicitant l’aide d’un représentant d’une
compagnie européenne en raison des conflits qui l’opposent
à ses sujets. Le kabaka Mwanga II avait écrit à
la compagnie d’être
« assez bonne pour venir et me rétablir sur mon trône
» ; il avait promis en retour de payer la compagnie avec «
beaucoup d’ivoire et vous pourrez faire tout commerce en Ouganda
et tout ce que vous désirez dans le pays placé sous mon
autorité 43 ». Comme il ne recevait pas de réponse
à sa demande, il envoya à Zanzibar deux ambassadeurs,
Samuel Mwemba et Victor Senkezi, pour requérir l’aide des
consuls anglais, français et allemand. Il recommanda à
ses ambassadeurs de demander la chose suivante : « S’ils
veulent nous aider, quelle récompense devrons-nous leur accorder
en échange ? En effet, je ne veux pas leur [ou vous] donner mon
pays. Je désire que les Européens de toutes les nations
viennent en Ouganda construire et commercer à leur guise. »
Il est évident que, par ce traité, Mwanga II n’entendait
pas renoncer à sa souveraineté. Il allait découvrir
plus tard, à ses dépens, que les Européens
pensaient le contraire. Les traités du capitaine Lugard de décembre
1890 et mars 1892 avec Mwanga, qui offraient à ce dernier une
« protection », lui
furent imposés plus qu’ils ne furent négociés
avec lui. Il est vrai que l’iBeac l’aida à reprendre
son trône, mais la victoire des protestants bougandais (grâce
à la mitrailleuse Maxim de Lugard) sur les catholiques bougandais
lors de la bataille de Mengo (24 janvier 1892) avait laissé le
kabaka affaibli. Lorsque la compagnie cessa ses activités au
Buganda (31 mars 1893), elle céda ces traités au gouvernement
britannique. Le dernier traité du colonnel H. E. Colvile avec
Mwanga (27 août 1894) confirmait tous les traités précédents
; mais il allait plus loin : Colvile exigea et obtint pour son pays
le « contrôle des affaires étrangères, du
trésor public et des impôts » qui, des mains de Mwanga,
passaient à celles du « gouvernement de Sa Majesté,
dont le représentant faisait fonction de cour suprême d’appel
pour toutes les affaires civiles». La même année,
l’Angleterre déclarait le Buganda protectorat. Il est révélateur
que Lugard ait écrit quelques années plus tard dans son
journal à propos des traités offrant la protection de
la compagnie : « Aucune personne avisée ne l’aurait
signé, et prétendre que l’on ait convaincu un chef
sauvage de céder tous ses droits en échange d’aucune
contrepartie est d’une évidente malhonnêteté.
Si on lui a dit que la compagnie le protégerait contre ses ennemis
et s’allierait avec lui lors des guerres, on lui a raconté
un mensonge. La compagnie n’a jamais eu de telles intentions et,
de toute façon, elle ne disposait d’aucun moyen pour les
réaliser . »
Lugard disait, en fait, que ses propres traités avaient été
obtenus frauduleusement ! Nous n’avons pas la place de débattre
des nombreux autres traités afro-européens, mais nous
pouvons mentionner, au passage, les demandes présentées
par l’émir de Nupe (dans l’actuel Nigéria) L.
A. A. Mizon pour s’allier avec lui contre la « Royal Niger
Company », avec laquelle il s’était brouillé,
comme exemple du désir d’un souverain africain de solliciter
l’aide d’une puissance européenne contre une autre
puissance européenne menaçant son indépendance.
Les traités européens Bilatéraux de Partage
Définir une sphère d’influence par un traité
était en général l’étape préalable
à l’occupation d’un État africain par une puissance
européenne. Si ce traité n’était contesté
par aucune puissance, la nation européenne bénéficiaire
transformait peu à peu les droits qu’il lui reconnaissait
en droits souverains.
Une zone d’influence naissait donc d’une déclaration
unilatérale, mais elle devenait réalité seulement
une fois acceptée, ou tout au moins lorsqu’elle n’était
pas contestée par d’autres puissances européennes.
Les sphères d’influence étaient souvent contestées,
mais les problèmes d’ordre territorial et les querelles
de frontières finissaient par se résoudre par le biais
d’accords entre deux ou plusieurs puissances impérialistes
déployant leurs activités dans la même région.
Les limites de ces règlements territoriaux étaient déterminées,
avec autant de précision que possible, par une frontière
naturelle ou, en son absence, par des références aux longitudes
et aux latitudes. Au besoin, on prenait en considération les
frontières politiques du pays.
On considère que le traité anglo-allemand du 29 avril
(et du 7 mai) 1885, qui définit les « zones d’intervention
» de l’Angleterre et de l’Allemagne dans certaines régions
d’Afrique, est peut-être la première application sérieuse
de la théorie des sphères d’influence des temps modernes.
Par une série de traités, d’accords et de conventions
analogues, le partage de l’Afrique sur la carte est pratiquement
achevé à la fin du XiXe siècle. Nous ne pouvons
examiner ici brièvement que les plus importants.
Le traité de délimitation anglo-allemand du 1er novembre
1886, par exemple, est particulièrement important. En vertu de
ce traité, Zanzibar et la plupart de ses dépendances tombent
dans la sphère d’influence britannique, mais il reconnaît
à l’Allemagne une influence politique en Afrique orientale,
ce qui met fin officiellement au monopole de l’Angleterre dans
cette région.
L’empire omani se trouve ainsi divisé. Aux termes de l’accord
ultérieur de 1887, destiné à préciser ce
premier traité, l’Angleterre s’engage à «
décourager les annexions britanniques en arrière de la
zone d’influence de l’Allemagne, étant bien entendu
que le gouvernement allemand découragera de même les annexions
allemandes dans l’hinterland de la zone britannique ». L’accord
prévoyait également que, si l’un des deux pays occupait
le littoral, « l’autre ne pourrait pas, sans le consentement
de son partenaire, occuper les régions non revendiquées
à l’intérieur. » Ces accords sur l’occupation
de l’hinterland dans la partie ouest des « sphères
d’influence » des deux pays étaient trop vagues et
finirent par rendre nécessaire la conclusion du célèbre
traité d’Heligoland, en 1880, qui parachève le découpage
de l’Afrique orientale. Il est très important d’observer
que ce traité réservait l’Ouganda à l’Angleterre,
mais réduisait à néant le grand espoir britannique
d’un axe Le Cap-Le Caire. Il restituait l’Heligoland à
l’Allemagne et mettait fin à l’indépendance
de Zanzibar.
Les deux traités anglo-allemands de 1890 et 1893 et le traité
anglo-italien de 1891 aboutirent à placer officiellement le Haut-Nil
dans la sphère d’influence britannique. Au sud, le traité
franco-portugais de 1886, le traité germano-portugais de 1886
et le traité anglo-portugais de 1891 reconnaissaient l’influence
portugaise en Angola et au Mozambique tout en délimitant la zone
d’influence britannique en Afrique centrale. Le traité de
1894 entre l’Angleterre et l’État libre du Congo est
également très important : il fixait les limites de l’État
libre du Congo de telle façon que celui-ci servît de tampon
entre les territoires français et la vallée du Nil, tout
en laissant aux Britanniques un corridor sur l’axe Le Cap-Le Caire,
reliant l’Ouganda au lac Tanganyika (clause qui fut supprimée
en juin à cause des protestations de l’Allemagne). En Afrique
occidentale, les accords les plus importants furent l’acceptation
de la ligne Say-Barroua (1890) et la Convention du Niger (1898), par
lesquelles l’Angleterre et la France achevèrent le partage
de cette région. Enfin, la Convention franco-anglaise du 21 mars
1899 réglait la question égyptienne, tandis que la paix
de Vereiniging (1902) — qui mit fin à la guerre des Boers
— confirmait, pour un temps au moins, la suprématie britannique
en Afrique du Sud.
sommaire
La conquête militaire (1885 -1902)
Pour diverses raisons, ce furent les Français qui menèrent
le plus activement cette politique d’occupation militaire. S’avançant
du Haut-Niger vers le Bas-Niger, ils ne tardèrent pas à
vaincre le damel du Kajoor, Latjor, qui lutta jusqu’à sa
mort en 1886. Ils l’emportèrent sur Mamadou Lamine à
la bataille de Touba-Kouta, en 1887, mettant ainsi fin à l’empire
soninke qu’il avait fondé en Sénégambie. Ils
réussirent également à briser la résistance
obstinée et célèbre du grand Samori Touré,
capturé (1898) et exilé au Gabon (1900). Une série
de victoires — Koudian (1889), Ségou (1890) et Youri (1891)
— du commandant Louis Archinard fit disparaître l’empire
tukuloor de Ségou, bien que son chef, Ahmadu, ait poursuivi une
résistance
acharnée jusqu’à sa mort, à Sokoto, en 1898.
Ailleurs en Afrique occidentale, les Français conquirent la Côte-d’Ivoire
et la future Guinée française, où ils installèrent
des colonies en 1893. Commencées en 1890, la conquête et
l’occupation du royaume du Dahomey s’achevèrent en
1894. Á la fin des années 1890, les Français avaient
conquis tout le Gabon, consolidé leurs positions en Afrique du
Nord, mené à bien la conquête de Madagascar (ils
exilèrent la reine Ranavalona III en 1897 à Alger) et
, à la frontière orientale entre le Sahara et le Sahel,
mis un terme à la résistance obstinée de Rabah
au Sennar, tué au combat en 1900.
La conquête britannique fut, elle aussi, spectaculaire et sanglante
et elle rencontra, de la part des Africains, une résistance décidée
et souvent lente à réduire. Utilisant ses possessions
côtières de la Gold Coast (actuel Ghana) et du Nigéria
comme bases d’opérations, l’Angleterre bloqua l’expansion
française en direction du Bas-Niger et dans l’arrière-pays
ashanti. La dernière expédition de Kumasi (en 1900) fut
suivie par l’annexion de l’Ashanti en 1901 et par l’exil
aux Seychelles de Nana Prempeh. Les territoires au nord de l’Ashanti
furent officiellement annexés en 1901, après leur occupation
de 1896 à 1898. À partir de Lagos, leur colonie, les Britanniques
se lancèrent à la conquête du Nigéria. En
1893, la plus grande partie du pays yoruba était placée
sous protectorat. En 1894, Itsekiri était conquis, et l’habile
Nana Olomu, son prince marchand, exilé à Accra. Apparemment
incapable d’affronter le roi Jaja d’Opobo sur le champ de
bataille, Harry Johnston, le consul britannique, préféra
lui tendre un piège.
Invité à le rencontrer à bord d’un navire
de guerre britannique, le roi fut fait prisonnier et expédié
aux Antilles en 1887. Brass et Benin furent conquis à la fin
du siècle. En 1900, la domination britannique au Nigéria
méridional était pratiquement assurée. L’occupation
du pays igbo et de certaines régions de l’hinterland oriental
ne fut cependant effective que dans les deux premières décennies
du XXe siècle. Au nord, la conquête britannique partit
du Nupe, où, en 1895, la Royal Niger Company de George Goldie
exerçait son influence, de Lokoja à la côte. Ilorin
fut occupé en 1897 et, après la création de la
West African Frontier Force en 1898, le sultanat de Sokoto fut conquis
par Frederick Lugard en 1902.
Au nord de l’Afrique, l’Angleterre, déjà en
position de force en Égypte, attendit jusqu’en 1896 pour
autoriser la reconquête du Soudan. Celle-ci
(en 1898) donna lieu à un véritable bain de sang, inutile
et cruel. Plus de 20 000 Soudanais, dont leur chef, Khalifa ?Abdallah,
moururent au combat.
L’occupation de Fachoda par la France — dans le sud du Soudan
— en 1898 ne pouvait, bien entendu, être tolérée
par lord Salisbury, et la France futforcée de se replier.
Le Zanzibar fut officiellement placé sous protectorat britannique
en novembre 1890. Cette mesure et les tentatives d’abolition de
l’esclavage qui en découlèrent provoquèrent
des rébellions vite écrasées. Zanzibar servit de
base à la conquête du reste de l’Afrique-Orientale
britannique. Le pays le
plus convoité par l’Angleterre dans cette région
était l’Ouganda ; la bataille de Mengo (1892) — au
Buganda, centre des opérations — aboutit à la proclamation
du protectorat sur l’Ouganda (1894). La voie était donc
libre pour la conquête du reste de l’Ouganda. Celle-ci fut
réalisée quand les rois Kabarega et Mwanga furent capturés
et exilés aux Seychelles en 1899. Toutefois, au Kenya, il fallut
près de dix ans aux Britanniques pour imposer leur domination
effective sur les Nandi.
En Afrique centrale et australe, la British South Africa Company (BSac)
de Cecil Rhodes entreprit d’occuper le Mashonaland sans l’accord
de Lobengula. En 1893, le roi fut contraint de fuir sa capitale et il
mourut l’année suivante. Son royaume ne fut cependant pas
totalement soumis avant la
répression sanglante de la révolte des Ndebele et des
Mashona en 1896-1897. La conquête de l’actuelle Zambie, moins
mouvementée, fut achevée
en 1901. La dernière des guerres britanniques dans le cadre du
partage de l’Afrique fut celle qu’elle mena contre les Boers
en Afrique du Sud. Elle présente l’intéressante particularité
d’avoir mis aux prises des Blancs entre eux. Commencée en
1899, elle s’achève en 1902.
Pour les autres puissances européennes, l’occupation effective
se révéla difficile. Les Allemands, par exemple, parvinrent
à établir leur domination effective au Sud-Ouest africain,
à la fin du XIXe siècle, en raison essentiellement de
l’hostilité plus que séculaire qui empêchait
les Nama et les Maherero de s’unir. Au Togo, les Allemands s’allièrent
aux petits royaumes des Kotokoli et des Chakosi pour mieux écraser
la résistance des Konkomba — dispersés — (1897
-1898) et des Kabre (1890). Aux Camerouns, ce fut au nord que le commandement
allemand Hans Dominik, qui dirigeait les opérations, rencontra
le plus de difficultés ; mais, en 1902, il avait réussi
à soumettre les principautés peul. En revanche, la conquête
de l’Afrique-Orientale allemande fut la plus féroce et la
plus prolongée de toutes ces guerres d’occupation effective.
Elle se prolongea de 1888 à 1907. Les expéditions les
plus importantes furent celles envoyées contre le célèbre
Abushiri l’indomptable (1888 -1889), les Wahehe (1889 -1898) et
les chefs de la révolte maji maji (1905 -1907).
L’occupation militaire portugaise, commencée dans les années
1880, ne s’acheva que dans le courant du XXe siècle. Pour
les Portugais, cette entreprise fut particulièrement laborieuse.
Ils parvinrent néanmoins à consolider définitivement
leur domination au Mozambique, en Angola et en Guinée (actuelle
Guinée-Bissau). L’État libre du Congo fut confronté,
lui aussi, à de graves problèmes avant de pouvoir mener
à bien l’occupation
militaire de sa zone d’influence. Il commença par s’allier
avec les Arabes du Congo qui lui étaient, en fait, particulièrement
hostiles. Quand l’inanité de la collaboration apparut clairement,
Léopold lança une expédition contre eux. Il fallut
près de trois ans (1892 -1895) pour les soumettre. Mais la conquête
du Katanga, entamée en 1891, ne fut achevée qu’au
début duXXe siècle.
C’est l’Italie qui rencontra les plus grandes difficultés
dans ses guerres pour l’occupation effective. En 1883, elle avait
réussi à occuper une partie de l’Érythrée.
Elle avait également obtenu la côte orientale de la Somalie
lors du premier partage du l’empire Omani en 1886. Plus tard, le
traité de Wuchale (ou Uccialli) (1889), conclu avec l’empereur
Menelik II, définit la frontière entre l’Éthiopie
et l’Érythrée. À la suite d’un étrange
quiproquo sur l’interprétation des clauses du traité,
l’Italie informa les autres puissances européennes que l’Éthiopie
était un protectorat italien.
Mais, quand elle tenta d’occuper ce protectorat fictif, elle subit
la défaite ignominieuse d’Adowa en 1896. Toutefois, elle
parvint à garder ses territoires en Somalie et en Érythrée.
En Afrique du Nord, c’est seulement en 1911 que l’Italie parvint
à occuper les zones côtières de la Cyrénaïque
et de la Tripolitaine (actuelle Jamahiriya arabe libyenne populaire
et socialiste).
Le Maroc réussit à sauvegarder son indépendance
jusqu’en 1912, date à laquelle il la perdit au profit de
la France et de l’Espagne. Ainsi, en 1914,
seuls le Libéria et l’Éthiopie étaient encore
— tout au moins nominalement — indépendants.
En 1902, la conquête de l’Afrique était presque achevée.
L’histoire en avait été très sanglante.
sommaire
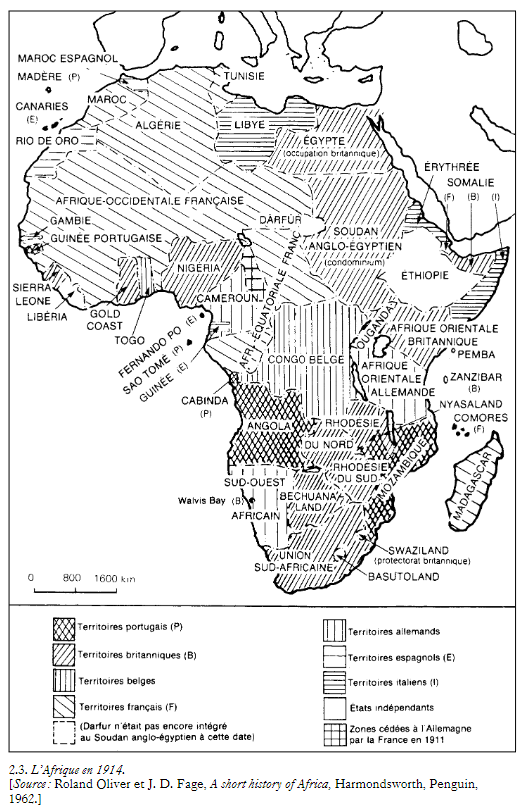 L'Afrique
en 1914.
L'Afrique
en 1914.
1914-1918 La guerre sur le sol africain
La première guerre mondiale fut avant tout un conflit entre puissances
européennes auquel l’Afrique se trouva mêlée,
directement et indirectement, du fait qu’à l’ouverture
des hostilités elle était dans sa majeure partie placée
sous la domination des belligérants.
Pour l’Afrique, la conséquence immédiate de la déclaration
de guerre en Europe fut l’invasion des colonies allemandes par
les Alliés. Aucun des deux
belligérants ne s’était préparé au
conflit au sud du Sahara. En fait, on espéra même un court
instant que la région pourrait être épargnée.
Le gouverneur du Togo, Doering, proposa à ses voisins de la Gold
Coast (actuel Ghana) britannique et du Dahomey (actuel Bénin)
français de neutraliser le Togo pour ne pas donner aux Africains
le spectacle de Blancs se disputant entre eux . En Afrique-Orientale
allemande (actuelle Tanzanie), le gouverneur, le D r Schnee, était
résolu à éviter les hostilités de façon
à pouvoir poursuivre son énergique programme de développement
; quand les Britanniques bombardèrent Dar es-Salaam peu après
la déclaration de guerre, il souscrivit à l’idée
d’une trêve de courte durée, destinée à
neutraliser l’Afrique-Orientale allemande. Certains milieux espéraient
même que les dispositions du traité de Berlin (1885) relatives
à la neutralité du bassin conventionnel duCongo permettraient
d’éviter la guerre à l’Afrique de l’Est
et du Centre .
Cependant, le courant en faveur d’une extension du conflit africain
aux possessions allemandes devait l’emporter. Pour l’Angleterre,
qui possédait la
maîtrise des mers, la stratégie définie en 1919
par le Committee for Imperial Defence (Comité pour la défense
de l’Empire) prévoyait de porter la guerre dans les colonies
de l’ennemi. Pour conserver cette suprématie navale, elle
devait mettre hors d’usage le système de communication et
les principaux ports de l’Allemagne en Afrique. Quant aux Alliés,
une victoire pouvait leur permettre de se partager les possessions allemandes
à titre de butin de guerre. Cette considération joua certainement
un grand rôle dans la décision du commandant général
des Forces d’Afrique du Sud, le général Louis Botha
et du ministre de la Défense, J. C. Smuts, face à l’opposition
ouverte des Afrikaners intransigeants, d’engager les forces sud
africaines aux côtés des Alliés et d’envahir
le Sud-Ouest africain allemand (actuelle Namibie), puis de participer
plus tard à la campagne d’Afrique orientale . Non seulement
Botha et Smutz voyaient dans le Sud-Ouest africain une cinquième
province possible, mais ils espéraient qu’en contribuant
à une victoire des Britanniques dans l’Est africain une
partie du territoire allemand conquis pourrait être offerte aux
Portugais en échange de la baie de Delagoa, port naturel du Transvaal
vers l’Afrique du Sud 8. En Grande-Bretagne, on pensait que la
perspective pour l’Afrique du Sud d’entrer en possession du
Sud-Ouest africain serait le gage de son intervention et de son loyalisme9.
Pour les Français, l’invasion du Cameroun devait leur permettre
de récupérer le territoire cédéà
contrecœur à l’Allemagne en 1911 au lendemain de l’incident
d’Agadir. Même la Belgique, qui avait immédiatement
invoqué la neutralité perpétuelle du Congo (actuel
Zaïre) garantie par l’article X du traité de Berlin,
s’empressa, sitôt sa propre neutralité violée
par les Allemands, d’envahir elle aussi des territoires allemands
en Afrique, dans l’espoir qu’un succès lui conférerait
un atout dans le règlement de paix final.
Les colonies allemandes n’étaient pas faciles à défendre
du fait de la suprématie navale des Alliés et de la très
grande infériorité numérique des troupes coloniales
qui y étaient stationnées. Les Allemands avaient espéré,
au début, que la victoire rapide qu’ils escomptaient en
Europe éviterait la
participation directe des colonies tout en leur permettant de réaliser
leur ambition d’une Mittelafrika reliant le Cameroun et l’Afrique
orientale, et ruinant une fois pour toutes le vieux dessein britannique
d’un axe Le Cap-Le Caire; mais dès qu’il apparut nettement
qu’une victoire rapide était impossible, les Allemands comprirent
que des campagnes prolongées en Afrique immobiliseraient des
troupes coloniales alliées qui auraient pu être envoyées
sur le front européen. Cette situation fut brillamment exploitée
par von Lettow-Vorbeck, qui, à la tête des troupes allemandes
d’Afrique orientale, combattit des Alliés — un moment
dix fois supérieurs en nombre — pendant la durée
de la guerre ...
Les campagnes d’Afrique peuvent se diviser en deux phases distinctes.
Au cours de la première — qui ne dura que quelques semaines
—, les Alliés cherchèrent à détruire
la capacité offensive de l’Allemagne et à neutraliser
ses ports africains. Ainsi, Lomé au Togo, Douala au Cameroun,
Swakopmund et Lüderitz Bay dans le Sud-Ouest africain furent occupés
peu après l’ouverture des hostilités. En Afrique-Orientale
allemande, les croiseurs britanniques bombardèrent Dar es-Salaam
et Tanga en août, et, bien que ces deux ports n’aient été
pris que plus tard, ils ne purent désormais être utilisés
par les navires de guerre allemands. En égypte, lors de l’entrée
en guerre de la Turquie aux côtés de l’Allemagne,
les Britanniques renforcèrent les défenses du canal de
Suez et repoussèrent une expédition turque en février
1915. Par la suite, l’Égypte fut la principale base anglaise
pour les opérations contre la Turquie et ses provinces moyen-orientales,
et devint le pivot de la puissance britannique en Afrique et au Moyen-Orient
pour les trois décennies à venir.
Cette première phase de la guerre en Afrique revêtit une
importance capitale du point de vue de la stratégie globale.
La deuxième phase, à l’exception des opérations
contre l’Empire turc lancées à partir de l’égypte,
n’eut qu’un effet marginal sur l’issue du conflit mondial.
Néanmoins, les Alliés étaient résolus à
conquérir les colonies allemandes, tant pour éviter qu’elles
ne servent de bases à la subversion de leurs propres colonies
(où leur autorité était souvent mal assise) que
pour les partager entre eux dans l’éventualité d’une
victoire totale. C’est pourquoi, dès qu’il eut réprimé
la révolte des Afrikaners — qui avait bénéficié
de l’appui des Allemands du Sud-Ouest africain —, le gouvernement
sud-africain entreprit une conquête
du territoire qu’il mit six mois à mener à son terme.
Cette campagne fut la seule à laquelle des troupes africaines
ne participèrent pas ; en effet, les généraux de
l’Union hésitaient à armer les populations africaines.
Les Allemands, qui avaient réprimé avec brutalité
les soulèvements des Herero et des Nama, n’y étaient
guère enclins non plus.
La longue campagne du Cameroun fut menée en grande partie par
des troupes africaines. En dépit de leur supériorité
numérique, les Alliés — Français, Britanniques
et Belges — mirent plus de quinze mois à conquérir
le territoire. Conscient qu’il ne pouvait espérer l’emporter
en Afrique orientale sur des forces numériquement dix fois supérieures
aux siennes, von Lettow-Vorbeck décida d’immobiliser l’ennemi
le plus longtemps possible en ayant recours à la guérilla.
Il resta invaincu jusqu’à la fin des hostilités,conduisant
sa colonne de soldats en haillons à travers l’Afrique-Orientale
portugaise (actuel Mozambique) pour parvenir enfin en Rhodésie
du Nord (actuelle Zambie), où l’atteignit l’annonce
de l’armistice en Europe . Quelque 160 000 soldats alliés
— et c’est là une estimation prudente — auraient
été opposés à von Lettow-Vorbeck, dont les
effectifs ne dépassèrent à aucun moment 15 000
hommes. Comme au Cameroun, les troupes africaines jouèrent un
rôle décisif des deux côtés, faisant souvent
preuve d’une grande bravoure et se révélant bien
meilleurs combattants que les soldats sud-africains blancs, qui furent
décimés par la maladie. Certains jours, la ration du fantassin
nigérian se composait, en tout et pour tout, d’une demi-livre
de riz. Les porteurs payèrent un tribut particulièrement
lourd : au moins 45 000 d’entre eux auraient succombé à
la maladie au cours de la campagne.
La guerre vit un important exode d’Européens, exerçant
des fonctions administratives et commerciales dans les colonies africaines
des pays alliés,
qui durent partir sur le front occidental ou s’engagèrent
dans des unités stationnées en Afrique pour mener des
campagnes hors d’Afrique. À l’exception de la campagne
du Sud-Ouest africain, les troupes africaines jouèrent un rôle
déterminant dans les succès militaires des Alliés
en Afrique. Non seulement les troupes indigènes ont combattu
sur le sol africain, mais elles ont renforcé les armées
européennes sur les fronts occidental et
moyen-oriental. près l’ouverture des hostilités,
alors que l’Afrique occidentale comptait à elle seule 14
785 soldats africains, il fut décidé d’en recruter
50 000 autres au cours de la période 1915 -1916. C’est alors
que commença en Afrique française ce que le gouverneur
Angoulvant a appelé une « véritable chasse à
l’homme» et que Jide Osuntokun a récemment qualifié
de nouvelle traite des Noirs . Ayant à fournir un certain contingent
de recrues, les chefs s’emparaient d’étrangers et d’anciens
esclaves pour éviter d’enrôler leurs enfants ou leurs
parents. Les naissances n’étant pas enregistrées,
nombreuses furent les recrues qui avaient dépassé ou n’avaient
pas encore atteint l’âge de porter les armes. Mais, la campagne
de recrutement provoqua d’importantes révoltes, et il fut
impossible de lever des troupes dans les régions en rébellion.
Ayant besoin d’hommes et espérant qu’un Africain haut
placé pourrait réussir là où les Français
avaient échoué, le gouvernement se résolut en 1918
à nommer Blaise Diagne au poste de commissaire général
du recrutement des troupes noires. Chargées de recruter 40 000
tirailleurs, ses équipes en enrôlèrent en fait 63
378, dont un faible pourcentage, cependant, devait aller au front puisque
la guerre prit fin en novembre 1918.
Le service obligatoire fut également institué en Afrique-Orientale
britannique, pour le recrutement de soldats et de porteurs, par un décret
de 1915, au titre duquel tous les hommes âgés de dix-huit
à quarante-cinq ans étaient assujettis au service militaire.
Cette disposition fut étendue au protectorat de
l’Ouganda en avril 1917. En Rhodésie du Nord, du fait du
recrutement forcé en vigueur dans tous les districts, plus du
tiers de la population de sexe masculin fut mobilisée pendant
une grande partie de la guerre dans les services de portage. Après
1917, les besoins pressants du front syrien contraignirent le gouvernement
du protectorat britannique en Égypte à introduire la conscription
et la réquisition des animaux, malgré sa promesse antérieure
de supporter tout le poids de la guerre. Les oumda de villages «
réglèrent de vieux comptes en remettant leurs ennemis
entre les mains des agents recruteurs ou en fournissant des animaux
à l’insatiable caravane syrienne». En Algérie,
en Tunisie et même au Maroc, dont la conquête n’était
pas achevée, les indigènes furent précipités
dans la guerre. On estime à plus de 483 000 le nombre total de
soldats coloniaux, pour la plupart enrôlés d’office,
qui ont servi dans l’armée française pendant la guerre.
Au Congo, les Belges recrutèrent jusqu’à 260 000
porteurs durant la campagne d’Afrique orientale. Ces chiffres,
à eux seuls, défient l’imagination, notamment si
l’on songe que la conquête était toute récente.
Dans sa période la plus dramatique, le commerce des esclaves
n’en avait jamais atteint le dixième en une seule année.
Si elle fit directement un très grand nombre de morts et de blessés
en Afrique, la guerre fut aussi indirectement responsable des innombrables
décès dus à l’épidémie de grippe
de 1918-1919, qui toucha tout le continent et dont la propagation se
trouva facilitée par le rapatriement des soldats et des porteurs...
sommaire
L'afrique après la guerre 1914-18
La grande guerre marqua donc dans l’histoire de l’Afrique
un tournant qui, pour n’être pas aussi spectaculaire que
le deuxième conflit mondial, n’en
était pas moins important à maints égards. Elle
a notamment redessiné la carte de l’Afrique telle qu’elle
se présente à peu près aujourd’hui .
L’Allemagne quitta le rang des puissances coloniales pour être
remplacée par la France et la Grande-Bretagne au Cameroun et
au Togo, par l’Union
sud-africaine dans le Sud-Ouest africain et, dans l’ex-Afrique-Orientale
allemande, par la Grande-Bretagne et la Belgique, ce dernier pays obtenant
les
provinces, petites, mais très peuplées, du Rwanda et de
l’Urundi (actuelsRwanda et Burundi) .
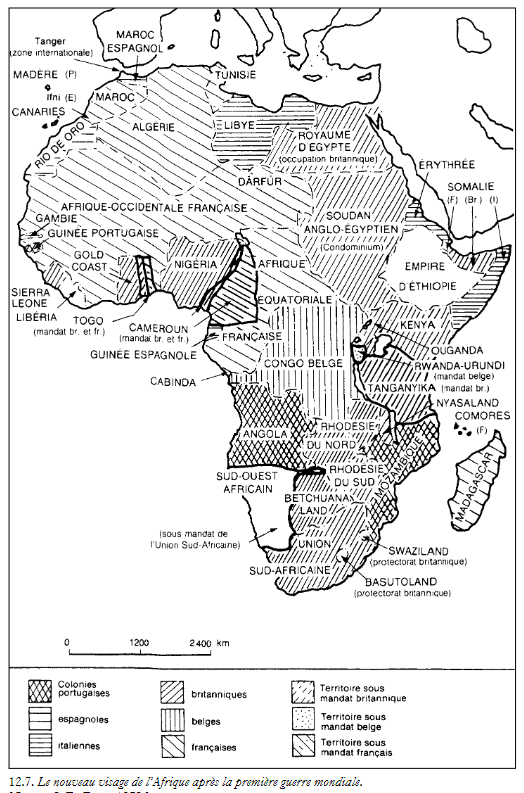
Les délicates négociations auxquelles donna lieu à
Versailles la redistribution de ces territoires entre les Alliés
victorieux appartiennent, à proprement parler, à l’histoire
de l’Europe, bien que la façon dont le Cameroun et le Togo
furent divisés, sans guère d’égards pour les
considérations historiques
et ethniques, ait créé une très vive amertume dans
certaines fractions de la population de ces territoires, en particulier
chez les Ewe du Togo. Pour ce
qui est des habitants des anciennes colonies allemandes, leur sort ne
fut pas sensiblement amélioré par le changement de maîtres.
Aux yeux de certains Africains, la balance penchait même plutôt
pour les premiers ; au Cameroun et au Togo, la population conçut
une certaine nostalgie pour l’ancien régime, les Français
ayant introduit leur système de travail obligatoire et les Britanniques
ayant fait preuve de moins d’ardeur que leurs cousins germaniques
pour développer leurs territoires .
Étant donné que la France et la Grande-Bretagne considéraient
que leur rôle de mandataire était purement transitoire,
les deux Togo furent moins
développés que la Côte-d’Ivoire et la Gold
Coast (Ghana), et le Tanganyika Tanzanie) moins que le Kenya ou l’Ouganda.
Et, si le Sud-Ouest africain
se développa de façon spectaculaire sous l’«
administration » sud-africaine, ce fut au bénéfice
d’une population de colons en accroissement rapide ; en ce qui
concerne les autochtones, la brutalité de la domination allemande
fit place à un régime ouvertement raciste, pratiquant
une politique de peuplement et d’exploitation du pays par et pour
les Blancs.
Bien qu’européenne en premier chef, la première guerre
mondiale eut de profondes répercussions sur l’Afrique. Elle
marqua à la fois la fin du partage
du continent et celle des tentatives faites par les Africains pour reconquérir
une indépendance fondée sur la situation politique antérieure
à ce partage.
Elle fut une cause de profonds bouleversements économiques et
sociaux pour de nombreux pays africains, mais inaugura une période
de vingt années de calme pour les administrations européennes,
à l’exception des zones comme le Rif français et
espagnol, la Mauritanie française et la Libye italienne.
Toutefois, semée pendant la guerre, l’idée de l’autodétermination
des peuples et de la responsabilité des puissances coloniales
devait, au cours de la
période de paix ultérieure, influencer profondément
l’essor des mouvements nationalistes naissants. Mais il a fallu
le cataclysme d’une deuxième guerre mondiale pour que ces
mouvements, qui réclamaient auparavant un plus grand rôle
dans l’administration, en viennent à exiger les rênes
du pouvoir.
Histoire extraite du livre " L’Afrique sous domination coloniale, 1880-1935"
L'Afrique Occidentale Française : voir
la page l'AOF
Sénégal - Mauritanie
Soudan Français - Haute
Volta Guinée Française
- Côte d'Ivoire - Dahomey
- Territoire du Niger
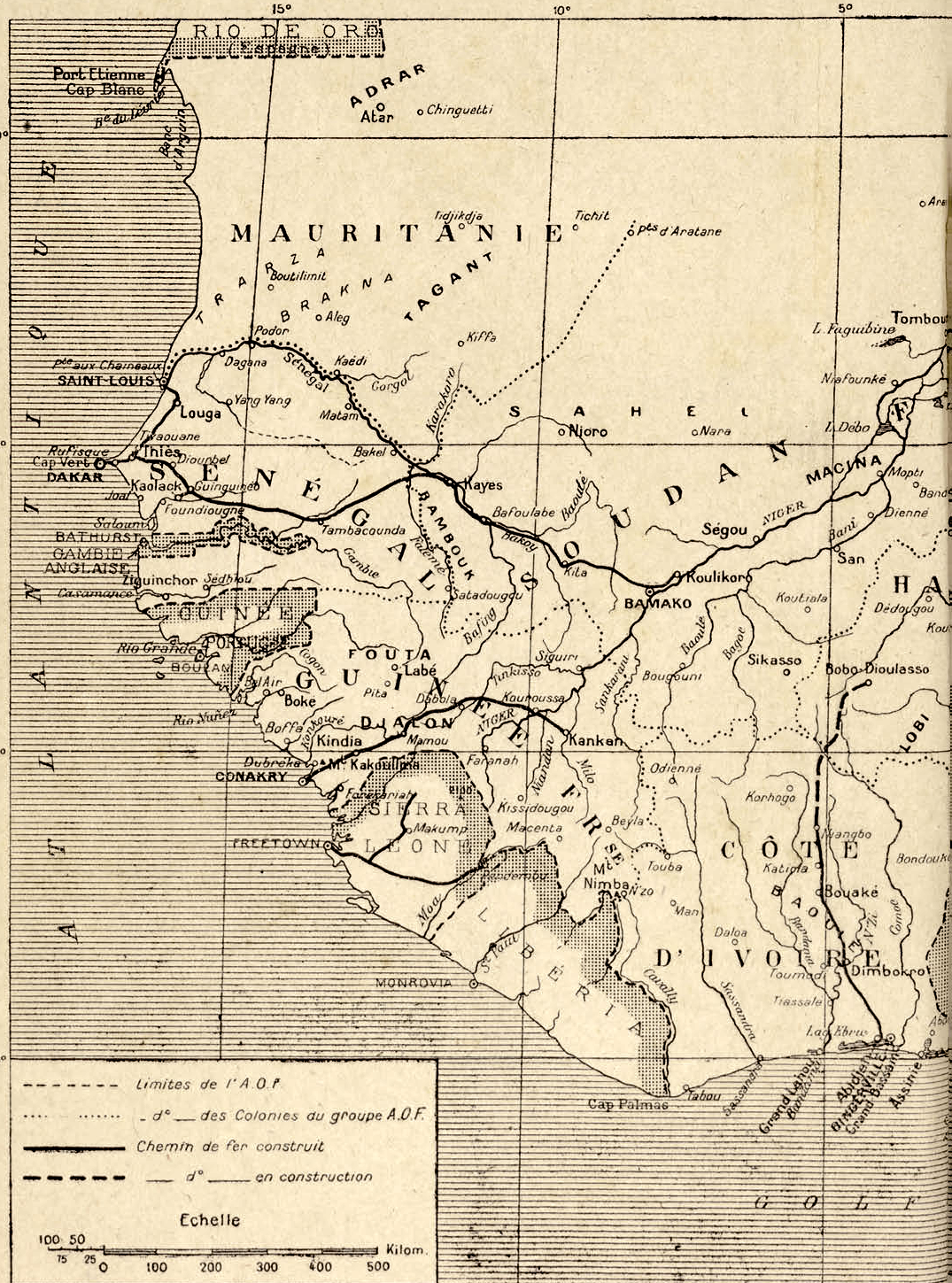
sommaire
Les Territoires Africains sous mandat :
Les Territoires Africains sous mandat se composent des parties des anciennes
colonies allemandes du Togo et du
Cameroun qui ont
été, au lendemain du Traité de Versailles, placées
sous l'autorité de la France.
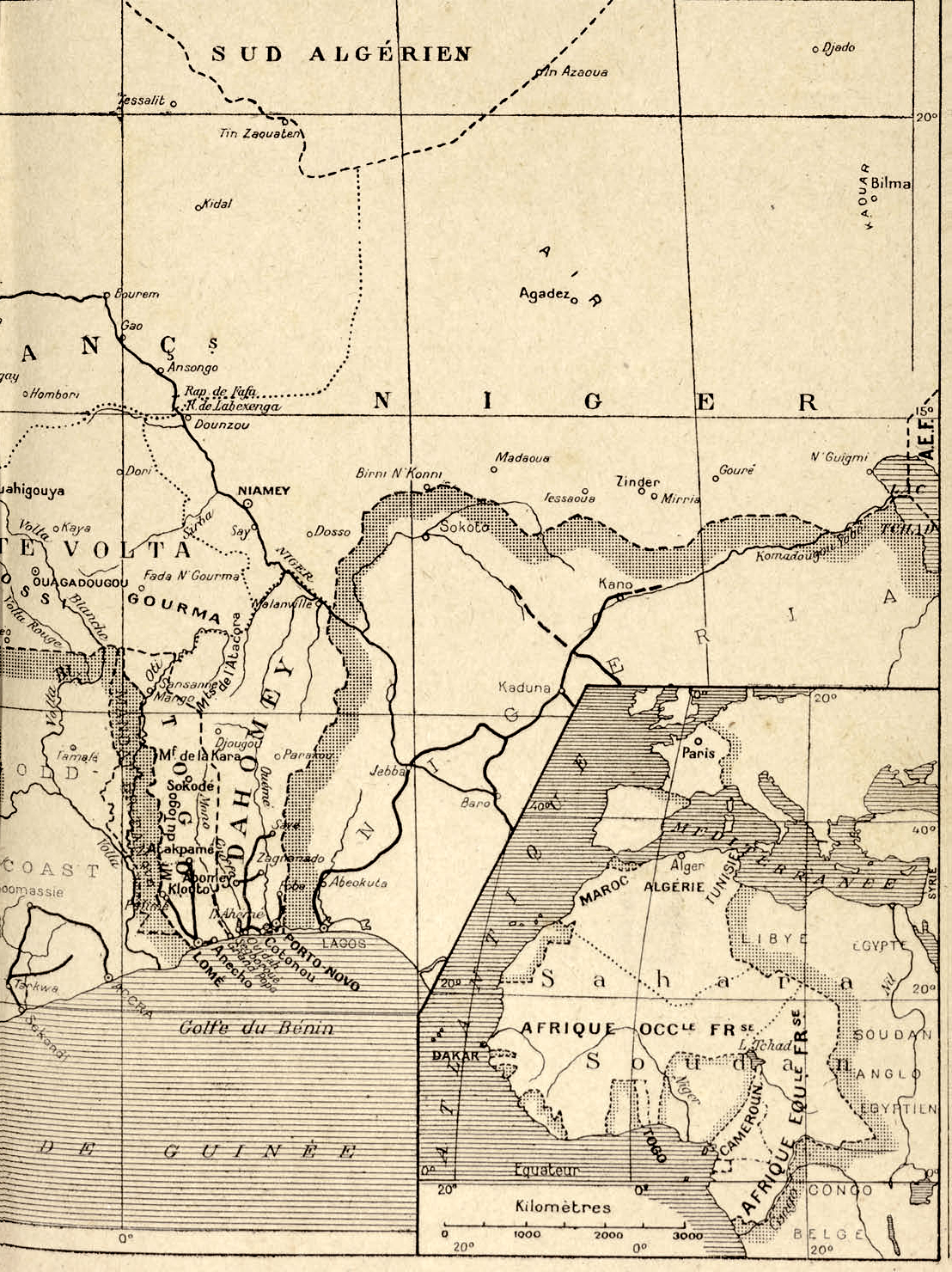
sommaire
L'Afrique Equatoriale Française : voir la page l'AEF
Gabon - Moyen-Congo
Oubangui-Chari - Tchad
- Cameroun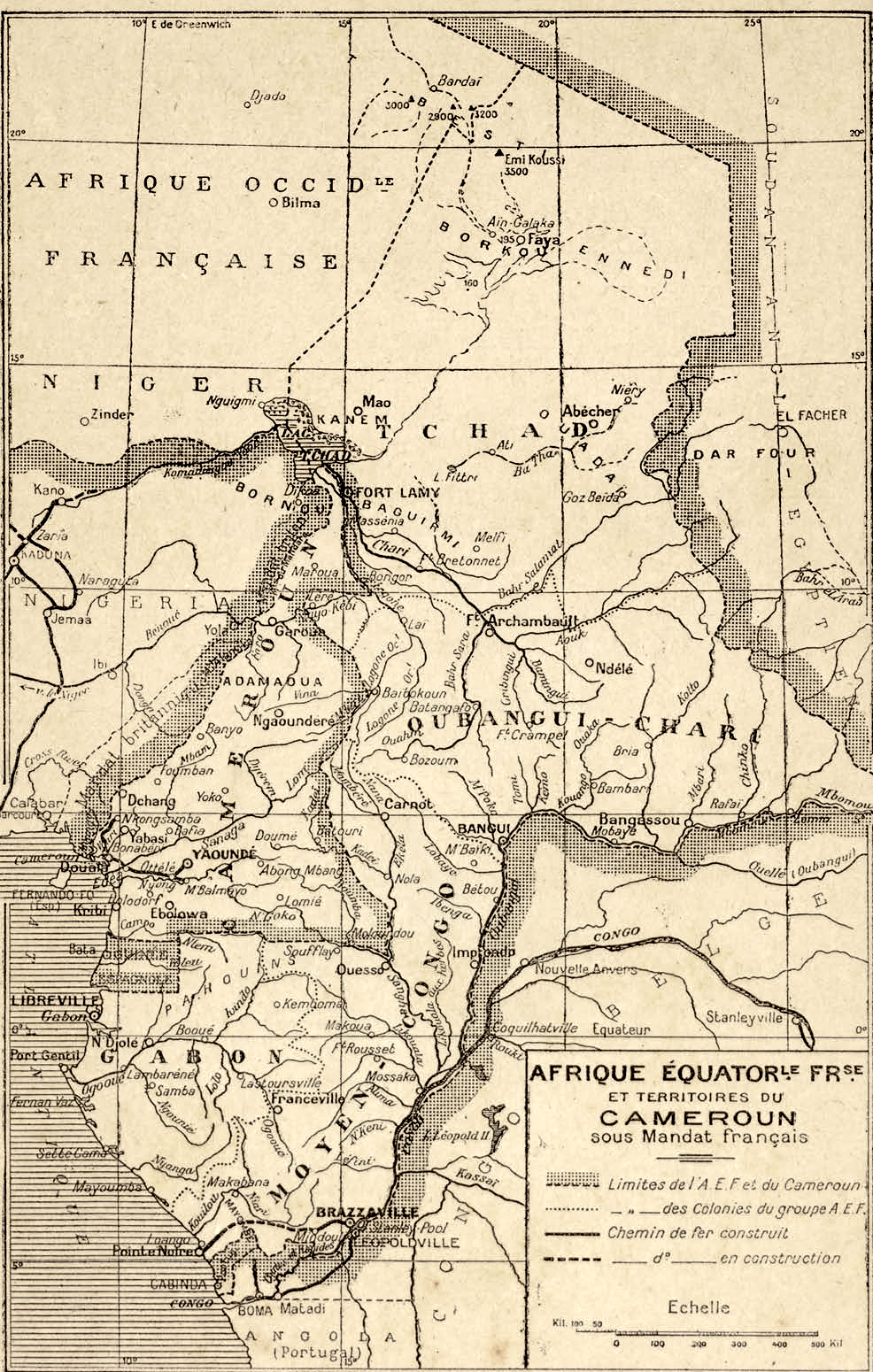
Madagascar et
Dépendances :

sommaire
L'Indochine : voir la page l'Indochine
Avec : la Cochinchine - Cambodge - Ânnam - Tonkin - Laos Territoire
de Kouang-Tchéou-Wan
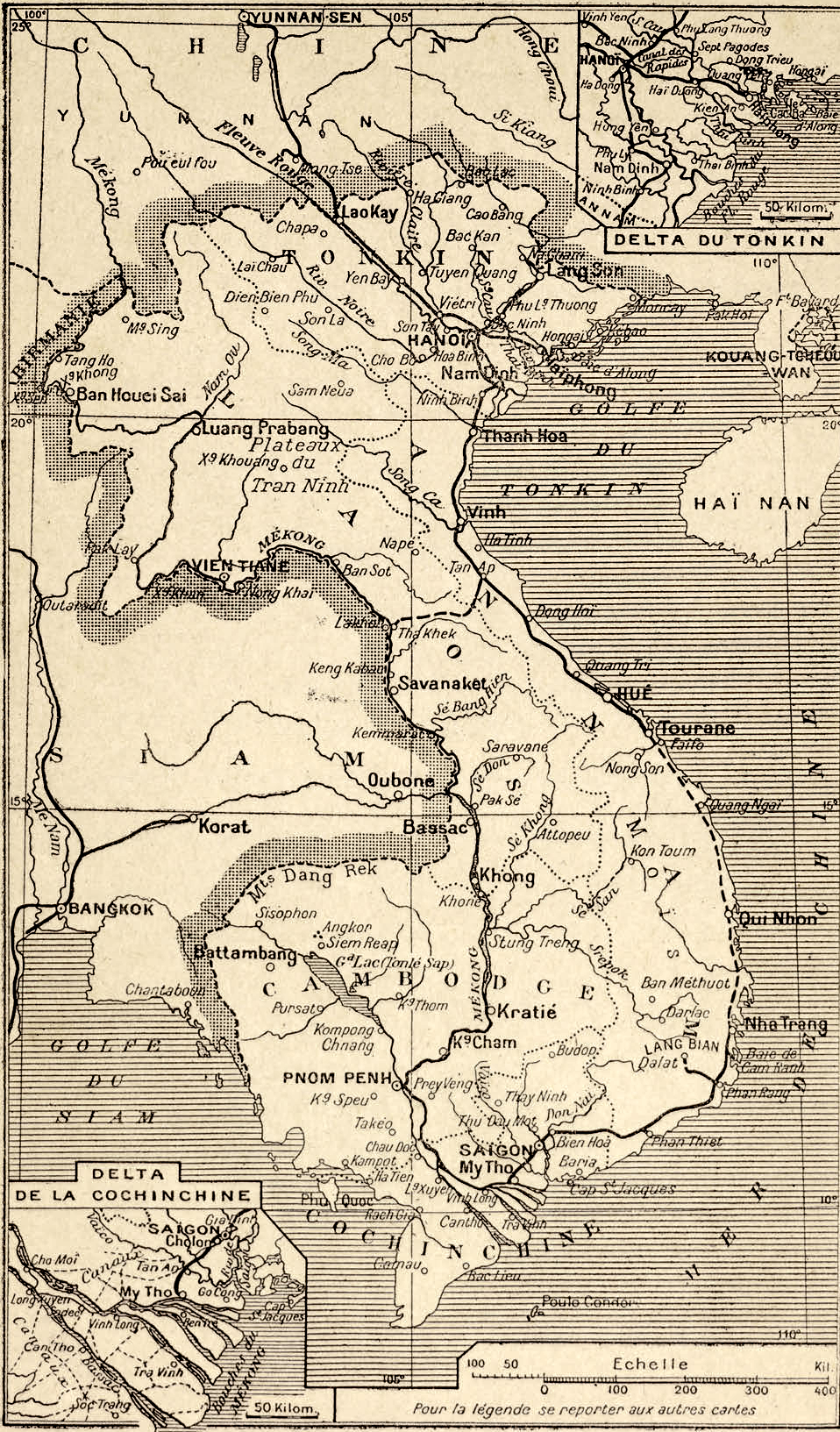
sommaire
Colonies de l'Océan Indien :
Côte Française des Somalis - Ethiopie - Ile de la Réunion-
Établissements dans l'Inde Française
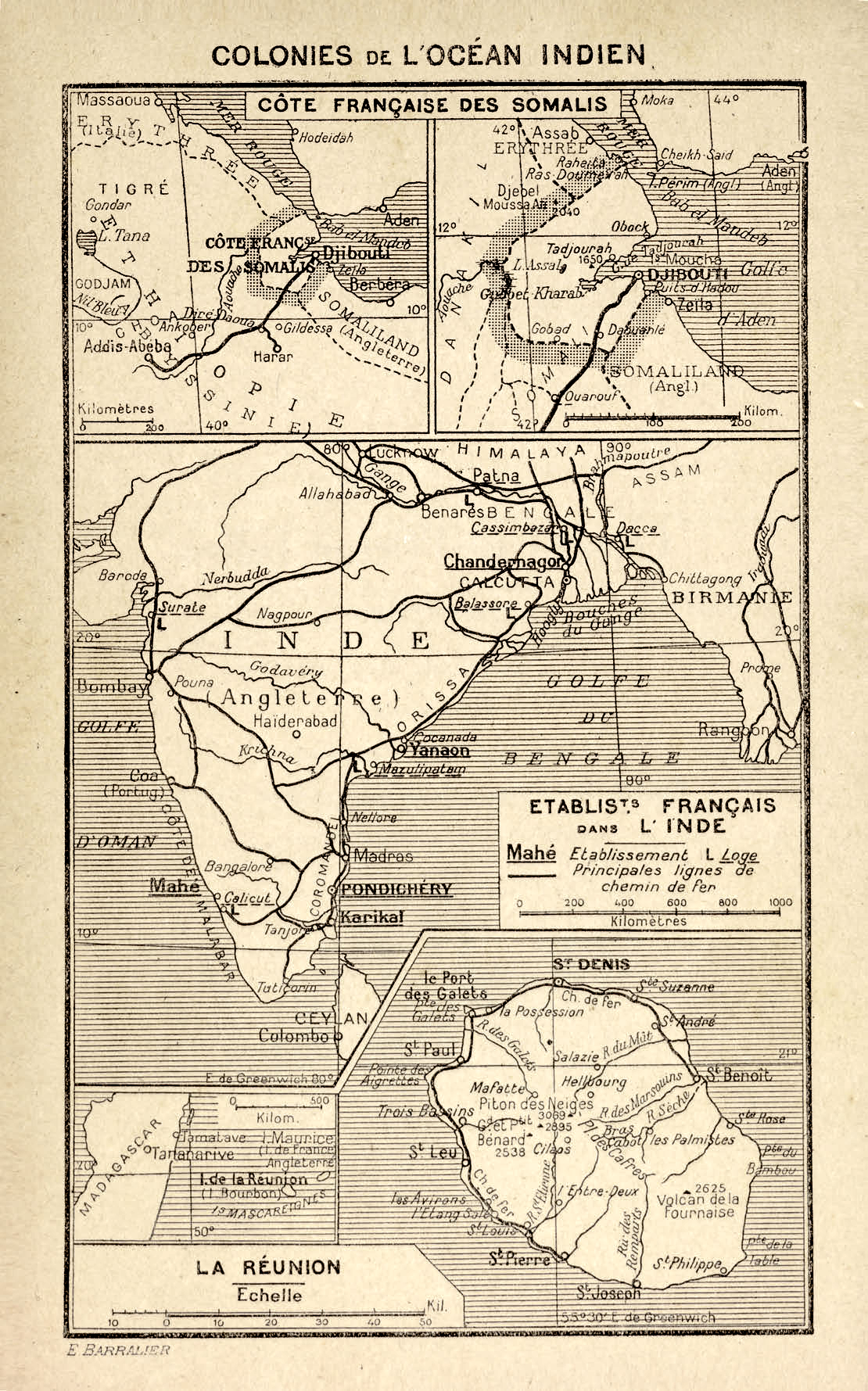

Colonies du Pacifique :
Nouvelle-Calédonie - Nouvelles-Hébrides
- Tahiti et Dépendances
Le condominium des Nouvelles-Hébrides
La création du Condominium résulte de tout un contexte
de géopolitique spécifique au début du XXe siècle
: après l'incident diplomatique de Fachoda, au Soudan, entre
la France et le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne effectue un revirement
très sensible de politique étrangère à
partir de 1901, et avec l'accession au trône du très
francophile Édouard VII.
Le Royaume-Uni lança donc une politique surprenante de rapprochement
avec la France, pour répondre à la montée en
puissance de l'empire allemand, et trouver un allié solide
lors de la conclusion de l'Entente cordiale en 1904.
Pour concrétiser cette entente, régler les problèmes
coloniaux entre les deux puissances constituait l'une des priorités
pour les nouveaux alliés.
- La France proposait d'échanger les établissements
français dans l'Inde contre la Gambie, enclavée dans
la colonie du Sénégal. Mais la Gambie était devenue
protectorat britannique en 1894.
- Le deuxième choix, définitif, se porta alors sur les
îles des Nouvelles-Hébrides, au Nord de la Nouvelle-Calédonie.
Pour symboliser et concrétiser l'entente entre les deux états,
les Britanniques proposèrent à la France de faire de
la colonie un condominium entre les deux États, et les Britanniques
demandèrent à la France de conserver les 5 comptoirs
de l'Inde. La proposition fut saluée avec enthousiasme par
la majorité des parlementaires des deux pays.

Colonies d'Amérique :
Martinique Guadeloupe
et ses Dépendances Guyane - Iles de
Saint-Pierre et Miquelon
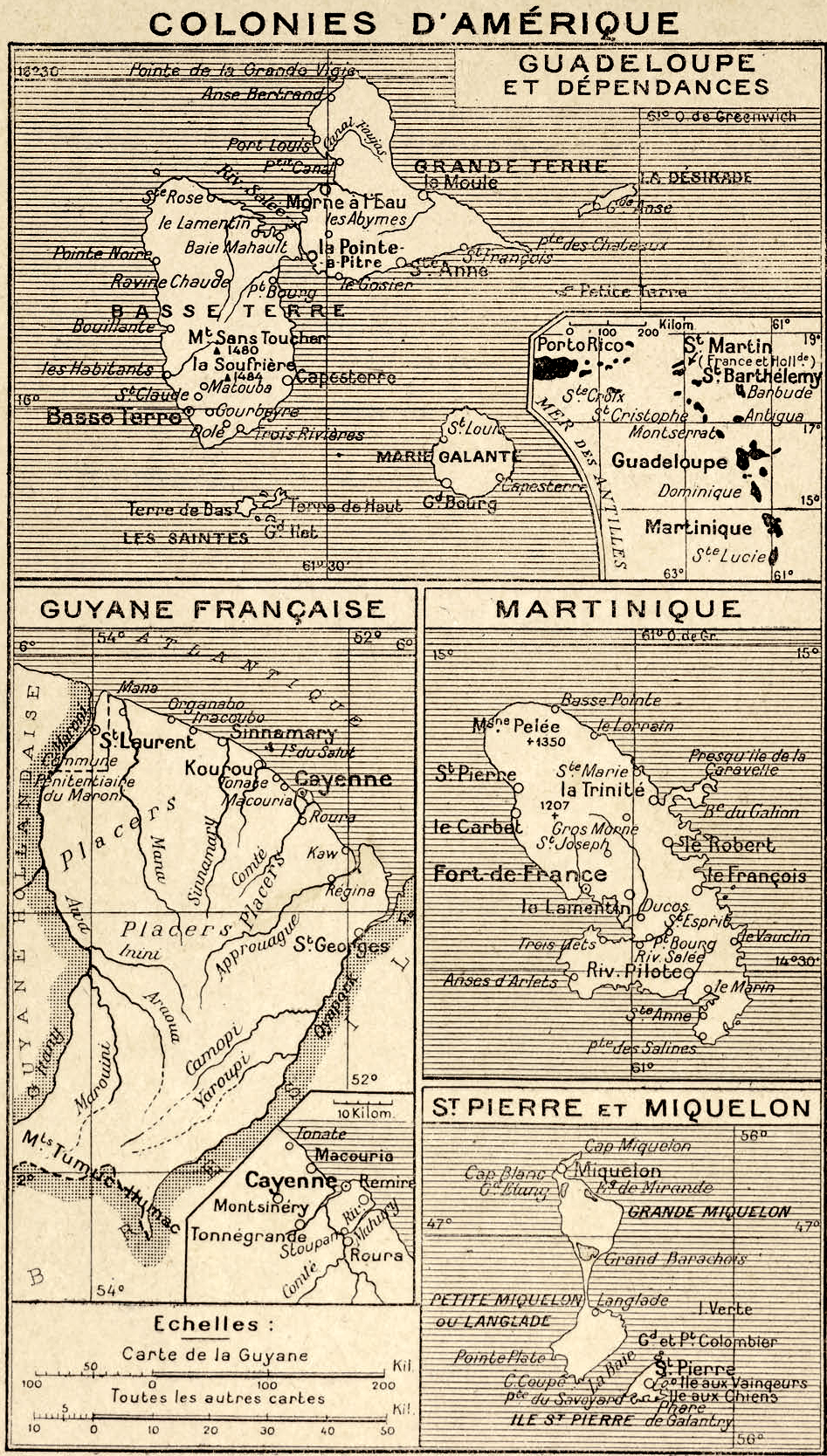
sommaire
1928 Suite du récit Ce que sont
les Colonies Françaises
Ce que l'on va faire aux Colonies :
LES EMPLOIS DANS LE COMMERCE
Le commerce colonial s'exerce dans nos vieilles possessions, Antilles,
Réunion, etc., dans les mêmes conditions qu'en France.
Les habitants du pays vendent au détail, en se servant à
des grossistes locaux qui ont leurs bureaux de vente et d'achat en France.
Dans les autres colonies, et particulièrement dans les Gouvernements
généraux, nous trouvons de très grosses entreprises
pratiquant en même temps l'importation et l'exportation. Elles possèdent
d'importants capitaux leur permettant d'acheter des stocks considérables
et d'ouvrir de nombreux comptoirs pour la vente et l'achat. Il existe
en Afrique Occidentale Française des sociétés créées
au capital de 100 millions, disposant de cent à cent cinquante
comptoirs répartis dans les colonies françaises et anglaises
voisines.
Ces sociétés sont les fournisseurs habituels de l'Administration,
par adjudication ou appel d'offres.
On constate, dans certaines colonies, au Sénégal, par exemple,
que le commerce des arachides qui représente les quinze seizièmes
du commerce local à l'exportation est, en fait, monopolisé
par une quinzaine d'entreprises de ce genre qui ont su se réserver,
la conquête et la pacification terminées, tous les emplacements
favorables, autour des marchés du pays.
A l'importation, ces bazars prennent toutes les marchandises utilisées
dans le pays; c'est assez pratique pour le consommateur.
En dehors de leurs comptoirs particuliers, ils ont également la
clientèle du petit commerce local, généralement indigène,
qui leur achète les marchandises dont il a besoin, obtient du crédit,
et vend, au comptant, les produits qu'il a drainés.
Ces conditions rendent fort difficile la création de nouvelles
entreprises et ne permettent pas aux commerçants métropolitains
de fournir directement les petits détaillants locaux.
Les maisons de commerce coloniales entretiennent un nombreux personnel
indigène, Tenforcé encore à la période active
du commerce (la traite, au Sénégal) par des auxiliaires
de tous genres, rabatteurs, indicateurs, manœuvres, etc. Parmi le
personnel permanent, on trouve des éléments qui commencent
à tenir des fonctions autrefois assurées par des Européens,
petits comptables, agents de dédouanement, etc.
Certains indigènes d'A. O. F. sont même arrivés à
des situations importantes, chefs comptables et inspecteurs de comptoirs.
Le rôle du « blanc », dès qu'il est au courant
du pays, c'est-à-dire au second séjour, devient, dans ces
conditions, un rôle de surveillance, d'instruction et de direction
de l'indigène. En général, aussi, les caissiers sont
toujours choisis parmi les Européens. On devine aisément
pourquoi.
En Indochine, où la civilisation très avancée permet
rapidement l'adaptation de l'Annamite à nos méthodes, on
réduit le personnel blanc au minimum indispensable : la direction,
et quelques services permettant, par la suite, de recruter les éléments
constituant cette direction.
Dans toutes les colonies, les entreprises commerciales ne recrutent que
par la base, mais il peut arriver qu'un agent ayant déjà
un certain rang dans une maison, passe dans une autre, avec avancement.
Pour créer une affaire nouvelle, il faut connaître à
fond le pays, y avoir longtemps séjourné, y posséder
de nombreuses relations indigènes. Généralement,
les créations nouvelles sont l'œuvre d'employés supérieurs,
ou même de directeurs d'entreprises existantes, qui, sachant bien
ce que l'on peut tenter, exploitent une branche nouvelle et réunissent
facilement les capitaux qui leur sont nécessaires.
Le personnel européen débutant est généralement
pris parmi les jeunes gens célibataires, sortant du régiment,
et ne dépassant pas 28 à 30 ans. Certaines maisons ne recrutent
pas d'employés de plus de 25 ans. Les candidats doivent déjà
exercer une profession commerciale, de préférence dans les
tissus de coton ou la quincaillerie, avoir une forte instruction primaire
supérieure, ou mieux secondaire, connaître la comptabilité
commerciale, et enfin, souvent, la langue anglaise.
Les anciens élèves d'écoles supérieures de
commerce ont, dans certains comptoirs, la priorité.
Sur la côte d'Afrique, chaque maison loge, nourrit, blanchit, et,
en cas de besoin, hospitalise son personnel. Les appointements de début
varient ordinairement entre 500 et 800 francs par mois. En fin d'année,
une gratification, en rapport avec les affaires traitées et la
manière de servir de l'employé, est très souvent
accordée.
Il faut ajouter que plusieurs sociétés, et non des moindres,
se montrent depuis quelque temps, beaucoup moins exigeantes pour le recrutement
de leur personnel. Quelques-unes, même, préfèrent
les anciens commis de grandes épiceries et engagent ces débutants
au salaire de deux mille francs par an.
Les contrats imposés au personnel sont généralement
très durs. On peut même considérer que plus ils sont
draconiens, plus ils avantagent les employés, car, les clauses
deviennent telles qu'un tribunal ne peut les... reconnaître, en
cas de contestation...
Pour arriver à obtenir une situation intéressante, il faut
compter au moins six ans de présence dans la maison. L'étude
et la pratique des langues et usages locaux contribuent pour beaucoup
au succès.
En Indochine, le personnel est quelquefois logé, mais assez rarement.
Le coût de l'existence pour un célibataire est de 200 à
250 piastres par mois, à Saïgon. Il est un peu moins élevé
au Tonkin et dans tout l'intérieur du pays. Les employés
débutants doivent exiger des contrats normaux, augmentant la somme
indiquée plus haut.
A Madagascar, l'organisation du personnel n'est plus africaine; elle n'est
pas devenue indochinoise. Généralement, les employés
sont logés, ils touchent un salaire et une indemnité de
cherté de vie, calculée selon les postes et variables par
suite des grandes différences qui existent d'une région
à l'autre.
L'Ecole pratique coloniale du Havre, dont les cours durent dix mois, et
se font souvent dans les magasins du port, forme d'excellents débutants.
Elle reçoit des élèves de tous âges; un certain
nombre la fréquentent à leur sortie du régiment.
Le maire de la ville du Havre répond gratuitement aux demandes
concernant cette école, dont l'enseignement se perfectionne et
se développe chaque jour.
LES EMPLOIS DANS L'INDUSTRIE
L'industrie coloniale se réduit au strict nécessaire, indispensable
à la vie du pays.
La plus considérable est celle des transports par voies ferrées.
Sauf quatre lignes concédées à des compagnies privées,
l'exploitation des chemins de fer coloniaux est rattachée au service
des Travaux publics. Sur toutes les lignes, le personnel européen
est peu nombreux. Chauffeurs, mécaniciens, chefs de petites stations,
contrôleurs, etc., sont indigènes.
Les transports automobiles qui fonctionnent maintenant un peu partout
utilisent quelques rares mécaniciens et chefs de garage métropolitains.
En Indochine, plusieurs importantes sociétés annamites,
à personnel et capitaux indigènes, existent.
L'éclairage électrique et la fourniture de la glace représentent,
dans la plupart des centres, une usine comparable à celle d'un
de nos chefs-lieux de cantons ruraux. Un bon contremaître, aidé
de quelques indigènes, assure le fonctionnement du service.
L'industrie coloniale ne se développe réellement que dans
les pays à cannes à sucre, pouT ce qui concerne la sucrerie,
la distillation du rhum et des alcools de mélasse.
L'Indochine compte, néanmoins, de grosses usines exploitées
par les procédés les plus modernes répondant aux
besoins locaux et se préparant à exporter dans les pays
limitrophes.
A Madagascar, l'industrie locale commence à naître. Depuis
quelques années on a traité, dans cette colonie, le manioc
pour l'exploitation en cossettes bouchons, briquettes ou tapioca, et fécules.
L'industrie de la viande frigorifiée, conservée en boîtes,
existe également.
L'agent européen, dans l'industrie, joue le même rôle
que dans le commerce. Il encadre, dresse et forme des ouvriers indigènes.
Nous avons des ouvriers de couleur qui valent souvent les ouvriers européens,
dans l'entreprise et le bâtiment, notamment.
En Indochine, nous trouvons des annamites passés dans nos écoles
d'ingénieurs, aussi capables que leurs camarades de promotion de
conduire un atelier ou un chantier.
En général, les ouvriers indigènes travaillent beaucoup
plus lentement que les Européens, et obligent à une surveillance
de tous les instants.
* *
Pour le confort chez tous, les ETABLISSEMENTS WALLACH FRÈRES, 103
et 105, rue de Tocqueville, à Paris, fournissent tout l'outillage
à main, les appareils électriques, de ventilation, d'aspiration,
de levage, etc.. Réclamez le gros catalogue.
LES EMPLOIS DANS L'AGRICULTURE ET LES FORÊTS
L'agriculture, dans la zone tropicale, exige de grands moyens d'action
et des capitaux dont l'importance varie suivant la colonie où l'on
s'installe et les cultures envisagées. C'est la partie de l'exploitation
coloniale qui demande le plus de technique et aussi de pratique. C'est
dans ce domaine de 1'activité et de l'initiative individuelle qu'il
faut éviter à tout prix « le maître Jacques
», bon à tout... et propre à rien. Au point de vue
cultures, en général, l'Indochine vient en tête de
toutes nos colonies, avec le café du Tonkin et de l'Annam, les
hévéas des Terres Rouges, et quantité de produits
de moindre importance, mais très rénumérateurs.
Cette colonie, dont les habitants sont de remarquables cultivateurs, possède
cinq écoles agricoles ou forestières.
Madagascar, qui produit la moitié de la vanille du monde et qui
a créé l'industrie du manioc séché, se place
après.
Enfin, l'A. O. F., malgré que certains proclament l'inaptitude
du noir à la culture, fait en ce moment un effort remarquable pour
la culture industrielle du coton au Soudan, où déjà
elle a obtenu de très encourageants résultats en culture
indigène sèche.
Les plantations d'agavé sisalana, de la région de Kayes
— au Soudan également — entrent actuellement dans la
période de pleine production.
En Guinée française, la question des bananes et des ananas
sera réglée définitivement dès que le petit
frigorifique « Figafrika » fonctionnera et permettra des envois
réguliers sur la métropole. La construction d'un immense
frigorifique colonial est actuellement à l'étude.
En Côte d'Ivoire et au Dahomey, de sérieuses études
se poursuivent en vue de l'utilisation sur place des produits du palmier
à huile.
L'industrie forestière, possible dans toutes nos grandes colonies,
est en excellente voie. En Indochine, où un service forestier,
conservateur et protecteur, permet une bonne utilisation des coupes, les
scieries sont nombreuses et bien outillées.
Au Tonkin et dans le Nord-Annam, des fabriques d'allumettes privées
utilisent le bodé ou arbre à benjoin. Le bambou sert à
la fabrication de la pâte à papier.
En Cochinchine, on procède même à la distillation
des bois. Les bois durs et d'ébénisterie sont très
recherchés et vendus à bon prix.
A Madagascar, malgré les obstacles que présente la configuration
du sol, une industrie forestière assez importante vit.
En A. O. F., au Cameroun, en A. E. F., l'exploitation forestière
devient importante. Des scieries modernes font d'excellente besogne et
l'exploitation des bois d'œuvre est commencée. Néanmoins
des progrès sont encore à réaliser, particulièrement
en ce qui concerne le débardage et le traînage des grumes
jusqu'au chemin forestier de chaque exploitation.
Au Cameroun, une société créée pendant la
guerre emploie avec succès le palétuvier pour la douve de
tonnellerie et les traverses de chemin de fer.
Les sociétés forestières emploient un certain nombre
d'Européens, coupeurs de bois faisant fonctions de contremaîtres
bûcherons; ils vivent en forêts, au campement de leurs travailleurs.
Actuellement ils sont payés par un salaire de 800 à 1.000
francs et une indemnité de nourriture d'environ 600 francs, qui
représente approximativement le montant de la dépense mensuelle.
Il existe à peu près dans toutes les sociétés
des gratifications ou primes au rendement.
Enfin, la Guyane expédie aussi un peu de bois. Sa production pourrait
augmenter considérablement si des entreprises à gros capitaux,
outillées convenablement, possédant la main-d'œuvre
tropicale nécessaire, allaient s'installer sur place.
L'Institut National d'Agronomie Coloniale, avenue de la Belle-Gabrielle,
à Nogent-sur-Marne (Seine), fournit un personnel d'ingénieurs
agronomes spécialisés, très apprécié
des sociétés de plantations.
L'Ecole Pratique Coloniale de la Ville du Havre, indiquée au paragraphe
« Commerce », fournit aussi un personnel très utilisable.
Enfin, certains vieux praticiens des plantations de ces vingt dernières
années forment aussi un très bon élément de
recrutement.
Il existe également à Paris, au Conservatoire des Arts et
Métiers, des cours du soir concernant l'agriculture et les produits
coloniaux.
Ces cours, comme tous ceux du même établissement, sont confiés
à des professeurs qualifiés et augmentent sérieusement
le bagage de ceux qui peuvent les suivre.
Le Muséum d'Histoire Naturelle (Jardin des Plantes), à Paris,
possède, de son côté, un certain nombre d'excellents
cours, professés gratuitement.
En province, il existe dans les grandes villes, en particulier à
Lyon, Marseille et Bordeaux, des cours coloniaux.
A Paris, quelques écoles privées se lancent, depuis peu,
dans l'enseignement colonial.
Toutes ces écoles ou cours permettent d'augmenter l'instruction
générale de l'élève. S'il ne peut, par la
suite, aller aux colonies, il a toujours le bénéfice de
connaissances supplémentaires acquises et toujours utiles dans
la vie.
* *
N'achetez plus vos machines-outils, vos machines à bois, votre
matériel de transports, de manutention, votre outillage, sans consulter
la grande firme
: ETABLISSEMENTS WALLACH FRÈRES, 103 et 105, rue de Tocqueville,
à Paris. Livraison très rapide, conditions les plus avantageuses.
sommaire
LES EMPLOIS ADMINISTRATIFS
Le personnel administratif colonial se divise en trois grandes classes
:
1° Personnel des cadres généraux. Il est alimenté
par les cadres particuliers aux colonies (Administrateurs des colonies,
Magistrature coloniale, etc.) ou prétés par les services
métropolitains (personnel détaché des douanes de
France, des Postes et Télégraphes, de l'Enregistrement,
des Ponts et Chaussées, ou encore du corps des médecins
de l'armée coloniale, des vétérinaires ou des officiers
du génie de l'armée métropolitaine, etc.).
Ce personnel, s'il appartient aux cadres coloniaux, est organisé
par décrets et bénéficie du régime des retraites
de la métropole (loi du 4 avril 1924). Pour les détachés
des corps métropolitains, ils sont simplement mis à la disposition
du Ministère des Colonies dans des formes et pour une durée
qui peuvent varier avec les services et les cas, mais ils conservent le
bénéfice de leur statut d'origine, à moins que sur
leur demande, et dans les formes prévues, ils ne passent définitivement
au service colonial correspondant, si c'est possible.
2° Personnel des cadres locaux coloniaux. Ces cadres, créés
pour l'ensemble d'un gouvernement général ou d'une colonie
déterminée, sont recrutés selon les règles
posées par les textes les organisant; ils jouissent d'une retraite
sur la caisse locale de leur colonie et ne peuvent servir dans une autre.
La création d'une caisse générale de retraites a
été décidé par le Parlement. Elle a pour but
d'unifier les retraites et prendra le nom de « Caisse Intercoloniale
».
3° Personnel contractuel. Le régime contractuel est celui des
spécialistes employés pour une période ou une mission
déterminée, ne pouvant donner lieu à l'établissement
de fonctions permanentes.
Ces agents n'ont pas droit à la retraite, ne sont engagés
que pour une durée donnée dans des conditions déterminées
par leur contrat.
Donnons comme exemple, les agronomes spécialistes en coton d'Egypte
et d'Amérique, venus étudier les conditions de la culture
du coton au Soudan, et les naturalistes du Muséum, s'occupant pour
les colonies de questions de leur compétence.
Enfin, dans les périodes de grands travaux, des agents complétant
les cadres locaux des travaux publics pour l'exécution d'un programme
particulier.
Ce personnel contractuel est engagé par contrat débattu
entre les parties. On ne doit engager de contractuels que dans le cas
d'absolue impossibilité de faire remplir la mission qui leur est
dévolue par un agent des cadres coloniaux métropolitains
ou locaux, sauf en ce qui concerne les programmes de T. P. nécessitant
un renfort temporaire.
En ce qui concerne le recrutement du personnel des cadres généraux
coloniaux et des divers cadres locaux, certaines règles générales
sont communes.
Le postulant doit être de nationalité française, avoir
satisfait aux obligations militaires, être âgé de 21
ans au moins et de 30 ans au plus. La limite d'âge peut, sans toutefois
dépasser 35 ans, être prolongée d'une durée
égalé à celle des services militaires et civils donnant
droit à pension de l'Etat ou de la colonie.
La demande du candidat, établie sur papier timbré, devra
être adressée à M. le Ministre des Colonies (Direction
du Personnel et de la Comptabilité), 27, rue Oudinot, à
Paris, accompagnée despièces suivantes :
1° Une expédition en due forme de l'acte de naissance;
2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date
;
3° Un certificat de bonne vie et mœurs ayant moins de trois mois
de date;
4° Un état signalétique et des services militaires ou,
si le candid at n'a pas servi sous les drapeaux, une copie des pièces
indiquant sa situation au point de vue de la loi sur le recrutement de
l'armée;
5 ° Un certificat de visite ou contre-visite délivré
par les médecins militaires, constatant que l'état de santé
du candidat lui permet de servir aux colonies;
6° S'il y a lieu, copies certifiées des titres universitaires
et des références des administrations publiques ou privées
ayant employées le candidat, et de toutes pièces pouvant
permettre d'estimer les services qu'il a pu rendre dans les situations
successives qu'il a tenues.
Pour tout ce qui concerne les admissions et les renseignements sur les
emplois publics, la Direction du Personnel et de la Comptabilité
au Ministère des Colonies, 27, rue Oudinot, à Paris, est
qualifiée pour renseigner. Comme les textes régissant le
personnel et son recrutement sont fréquemment remaniés,
il y aura toujours lieu de s'adresser à ce Service avant d'établir
une demande. Pour les questions mon administratives, climat, géographie,
mouvement économique, coût de la vie, il sera nécessaire
de s'adresser à l'Agence Economique dont dépend la colonie
visée.
On peut considérer que les colonies réunies en gouvernements
généraux et les territoires africains sous mandat sont à
peu près les seuls pays ayant besoin de faire appel à la
Métropole pour la constitution de leurs cadres administratifs;
les anciennes colonies pourvoient par leurs propres ressources au recrutement
des cadres locaux très réduits qu'elles possèdent.
De loin en loin, elles demanderont un agent supérieur des cadres
coloniaux ou métropolitain pour la direction ou la réorganisation
d'un service; on ne peut guère mieux les comparer chacune qu'à
un département français qui trouve toujours dans sa population
les éléments administratifs dont il a besoin.
L'Ecole Spéciale d'Administration, 4, rue Pérou, Paris (6e),
prépare par correspondance à toutes les carrières
administratives coloniales. Renseignements gratuits.
* *
Décorations, Croix, Médailles, Rubans, Insignes. DlETS,
fabricant spécialiste, 26, rue Vivienne, Paris. Téléphone
: Central 37-42.
Fournisseur de tous les Groupements d'Anciens Coloniaux et desColoniaux
en activité.
Pour le confort chez tous, les ETABLISSEMENTS WALLACH FRÈRES, 103
et 105, rue de Tocqueville, à Paris, fournissent tout l'outillage
à main, les appareils électriques, de ventilation, d'aspiration,
de levage, etc.. Réclamez le gros catalogue.
Le Tarif-Album de la Manufacture française d'Armes et Cycles de
Saint-Etienne (Loire), est le livre de chevet de tous les Coloniaux (700
pages, 2 francs, franco).
sommaire
Comment on recrute Le Personnel européen des Colonies
Les principaux services généraux se recrutent ainsi qu'il
suit :
Magistrature. — Les candidats peuvent être nommés sans
concours à l'emploi de juge suppléant s'ils sont licenciés
en droit et ont accompli un stage de deux ans comme avocat.
Une section spéciale de l'Ecole coloniale forme aussi des élèves
devant assurer le recrutement de la Magistrature coloniale. (Voir au chapitre
des Ecoles.)
Juges de paix. — Les emplois de juge de paix aux colonies,dans le
cas où la licence en droit n'est pas exigée, sont en nombre
très restreints et peu rétribués; ils sont, ainsi
que les emplois de greffiers, généralement attribués
au personnel judiciaire d'ordre inférieur résidant dans
la colonie; l'Administration n'a donc pas à faire appel à
des candidats de la Métropole.
Notaires. — Dans les colonies où le notariat a été
organisé, les conditions de nomination des notaires (que les charges
soient vénales ou non) sont à peu près les mêmes
qu'en France. Le postulant doit lui-même s'enquérir de l'étude
susceptible de devenir disponible (fait qui se produit rarement) et adresser
une requête au gouverneur de la colonie, afin d'être autorisé
à se pourvoir devant la Cour d'Appel. Il convient de remarquer
que les Administrations locales trouvent sur place des postulants en nombre
plus que suffisant.
Administrateurs coloniaux (colonies autres que l'Indochine). —
Les Administrateurs coloniaux comprennent deux classes d'Administrateurs
en chef, deux classes d'Administrateurs, deux classes d'Administrateurs-adjoints
et des élèves Administrateurs.
Les Administrateurs coloniaux sont nommés par décret, les
élèves Administrateurs sont nommés par arrêté
du Ministre des Colonies; ils sont recrutés parmi les élèves
brevetés de l'Ecole coloniale.
Les Administrateurs-adjoints de 2e classe proviennent pour trois septièmes
des élèves Administrateurs, trois autres septièmes
sont réservés aux adjoints-principaux et aux adjoints de
lre classe des Services civils des colonies et aux commis principaux des
secrétariats généraux, ayant une année de
stage à l'Ecole coloniale et comptant au moins deux années
de services effectifs aux colonies, dans leurs corps.
Le dernier septième est réservé aux sous-chefs de
bureau de 28 classe des secrétariats généraux des
colonies, aux officiers en activité des armées de terre
et de mer, de moins de 30 ans, ayant au moins quatre ans de services comme
officiers, dont deux aux colonies ou en Afrique du Nord, à condition
d'avoir appartenu au moins un an aux « Affaires indigènes
» ou aux « Renseignements ».
Les Administrateurs reçoivent les soldes ci-après :
Administrateur en chef : de 35 à 44.000 francs;
Administrateur de 1re classe : de 28 à 32.000 fr. ; de 2e classe
: de 24 à 26.000 francs;
Administrateur-adjoint de lre classe : de 18 à 20.000 francs; de
2e classe : de 15 à 16.000 francs;
Elève Administrateur : 12.000 francs.
Dans toutes les colonies, les soldes sont augmentées d'un supplément
colonial, qui est de sept dixièmes à Madagascar et en A.
O. F., de neuf dixièmes en A. E. F. et dans les territoires africains
sous mandat.
En outre, il est perçu une indemnité égale à
douze pour cent de la solde, des indemnités de zones et de cherté
de vie variables avec les postes.
Services civils des colonies. — Ce sont des cadres locaux spécialisés
pour chacun des groupes de l'A. O. F., de l'A. E. F., des territoires
africains sous mandat et de Madagascar.
Ils comprennent, en A. O. F., trois classes d'adjoints-principaux hors
classe, trois classes d'adjoints-principaux, deux classes d'adjoints
et deux classes de commis.
Peuvent être nommés commis de 2e classe :
1° Les anciens sous-officiers, brigadiers et caporaux, comptant quatre
ans de services, ayant satisfait à un examen et classés
pour cet emploi par une commission siégeant au Ministère
de la Guerre.
Les réformés et mutilés de la guerre classés
dans la même forme (aptes au service colonial), mais par le Ministère
des Pensions.
2° Les candidats pourvus d'un diplôme de bachelier, d'un diplôme
de fin d'études d'une des écoles de commerce reconnues par
l'Etat ou d'un diplôme de l'Institut commercial de Paris, du brevet
supérieur de l'Enseignement primaire ou du diplôme de l'Ecole
pratique coloniale du Havre.
Le tiers des vacances d'adjoint de 2e classe peut être attribué
candidats candidats possédant les titres universitaires énumérés
ci-après : licence ès lettres, en droit ou ès sciences,
doctorat en médecine, diplôme supérieur d'études
commerciales des écoles supérieures de commerce reconnues
par l'Etat, y compris l'Ecole des Hautes Etudes commerciales et l'Institut
commercial de Paris, diplômes de l'Ecole coloniale, de l'Ecole des
langues orientales vivantes (langues ou dialectes coloniaux), de l'Ecole
des Chartes, de l'Ecole Navale, de l'Ecole normale supérieure,
de l'Ecole des sciences politiques, de l'Institut national agronomique,
certificat attestant que les candidats ont satisfait aux examens de sortie
de l' Ecole Polytechnique, de
l'Ecole supérieure des Mines, de l'Ecole centrale, de l'Ecole nationale
des Ponts et Chaussées, de l'Ecole spéciale de Saint-Cyr,
de l'Ecole Forestière ou de l'Ecole du Génie maritime, brevets
d'Officiers des armées actives de terre et de mer.
Quelques différences existent dans les titres exigés pour
l'admission dans les diverses colonies.
Les soldes sont augmentées aux colonies d'un supplément
de solde de sept dixièmes à Madasgacar et en A. O. F., de
neuf dixièmes en A. E. F. et dans les territoires africains sous
mandat. En outre, il est perçu une indemnité égale
à douze pour cent de la solde, des indemnités de zones et
de cherté de vie variables avec les postes occupés. Les
soldes sont actuellement de 6.500 francs pour les commis débutant
et elles atteignent 16.000 francs pour les adjoints-principaux hors classe
les plus anciens. En outre, il est perçu une indemnité égale
à 12 % de la solde, des indemnités de zones et de cherté
de vie variables avec les postes. Trésoreries, Postes et Télégraphes,
Travaux Publics, Services d'agriculture et services forestiers, enseignement,
T. S. F., etc.. —
Certains services recrutent du personnel par des concours que la Direction
du personnel au Ministère des Colonies organise chaque fois qu'une
colonie lui en fait la demande. C'est ainsi que les commis de trésoreries
sont recrutés.
Le programme du concours est chaque fois indiqué au Journal Officiel
de la République Française; il correspond habituellement
à une somme de connaissances primaires supérieures, comprise
entre le brevet élémentaire et le brevet supérieur
de l'Enseignement primaire.
Les commis des Postes et Télégraphes subissent
un concours dont le programme est à peu près le même
que celui de la Métropole.
L'instruction première exigée pour ces concours ne nécessitant
pas la production de diplômes est à peu près la même
pour tous les candidats. On y ajoute, selon le service, quelques notions
de législation coloniale d'application courante.
Les soldes sont variables, mais se rapprochent de l'échelle admise
pour le personnel des services civils.
Les concours pour les services de l'Indochine, Douanes, Forêts,
etc., attirant toujours un grand nombre de candidats ont un programme
qui va en se chargeant progressivement.
Le personnel des services des 7 ravaux publics assurant des services très
variés est presque toujours recruté par l'Inspection générale
des I. P., au Ministère des Colonies, 27, rue Oudinot, à
Paris, par concours ou sur le vu des titres présentés, ou
après examen et essai, s'il y a lieu.
Tout ce qui concerne les transports terrestres, maritimes, les chemins
de fer, etc., est rattaché aux T. P.
Les cadres des inspecteurs et ingénieurs des services d'agriculture
et forestiers sont choisis par le « premier bureau » de la
Direction des Affaires économiques au Ministère des Colonies.
C'est le « quatrième bureau » de la même direction
qui recrute les agents des stations de T. S. F. des colonies.
Le personnel de l'Enseignement est choisi par l'inspecteur-conseil de
l'Enseignement public au Ministère des Colonies. En principe les
titres exigés sont ceux qui permettent l'accès des cadres
de la Métropole et généralement les candidats agréés
proviennent de l'Enseignement public de France.
sommaire
LES FONCTIONNAIRES INDOCHINOIS
Les divers services de l'Indochine sont assurés par des cadres
locaux spéciaux.
Les Administrateurs des services civils de l'Indochine comprennent trois
classes d'Administrateurs et quatre classes d'Administrateurs-adjoints
; enfin des élèves Administrateurs.
Les élèves Administrateurs sont recrutés parmi les
élèves brevetés de l'Ecole coloniale inscrits à
la section indochinoise; cinq places au moins leur sont réservées
chaque année.
Les emplois d'Administrateurs-adjoints de 3e classe sont attribués
pour trois septièmes aux élèves Administrateurs et
pour trois septièmes aux rédacteurs des services civils
de l'Indochine, ayant au minimum deux ans de services en Indochine, moins
de 35 ans et ayant subi avec succès les épreuves d'un examen
d'aptitude dont le programme est fixé par arrêté du
Gouverneur général.
Le dernier septième est réservé :
1° Aux rédacteurs de l'Administration centrale des Colonies;
2° Aux lieutenants et assimilés des armées de terre
et de mer en activité, ayant quatre ans de gracie d'officier, dont
deux passés en Indochine, et ayant subi avec succès les
épreuves de l'examen d'aptitude prévu pour les rédacteurs
des services civils de l'Indochine. jusqu'à et y compris le grade
d'Administrateur de 3e classe, l'admission de quelques magistrats, fonctionnaires,
ou officiers ayant un temps déterminé de services en Indochine
est prévue.
Les soldes se montent, en piastres, :
Administrateur de 1re classe, après trois ans 7.671 piastres, 1re
classe 7.389, 2e classe 6.827 , 3e classe 6.264
Administrateur-adjoint hors classe.1re classe 5.700, hors classe 2e classe
5.094, hors classe 3e classe 4.548
Elève Administrateur 3.411 (Le cours de la piastre était
en décembre 1927 de 12 jr. 35.)
Le cadre des bureaux des services civils est ainsi constitué :
Chef de bureau hors classe après 3 ans 6.827 piastres, hors classe
6.264, lre classe 5.982, 2e classe 5.700
Sous-chef de bureau de lre classe 5.094, 2e classe 4.728
Rédacteur de lre classe 4.362, 2e classe 3.411
Les rédacteurs de 2e classe des services civils de l'Indochine
sont recrutés par des concours auxquels peuvent prendre part les
candidats pourvus d'un diplôme de l'Enseignement supérieur
ou ayant satisfait aux examens de sortie de l'une des grandes Ecoles du
gouvernement.
Les candidats désireux de prendre part à ces concours peuvent
s'adresser (quand ils sont annoncés) au Directeur de l'Agence Economique
de l'Indochine, 20, rue la Boétie, à Paris, en indiquant
leur âge, les titres universitaires qu'ils possèdent et leur
situation au point de vue militaire. Des renseignements détaillés
sont envoyés à chaque candidat remplissant les conditions
fixées.
GARDE INDIGENE
La garde indigène, organisée au Tonkin lors de la conquête
fut ainsi définie : une force de police civile à forme militaire,
soumise à l'autorité des résidents, chefs de province.
Ce corps, composé d'indigènes, comporte un cadre français
ne dépassant pas deux pour cent de l'effectif; il a rendu de grands
services lors de la pacification et il continue à remplir consciencieusement
sa tâche. Les actions d'éclat et les pertes qu'il totalise
depuis sa formation lui permettent de prendre rang à la suite des
troupes régulières de l'armée coloniale.
Le cadre français est formé de quatre classes d'inspecteurs,
autant de sous-inspecteurs et de quatre classes de gardes principaux.
Les gardes principaux stagiaires sont recrutés :
1° Pour moitié des vacances parmi les sous-officiers rengagés,
classés pour l'obtention d'un emploi civil (emploi réservé);
2° POUR l'autre moitié parmi les anciens militaires français
des armées de terre et de mer ayant servi comme sous-officiers
dans l'armée active, en possession du brevet de chef de section
et choisis de préférence parmi ceux pourvus du grade d'officier
de complément.
Le nombre de vacances annuelles est très faible.
* *
Madagascar possède aussi une garde indigène, ayant une organisation
analogue à celle de l'Indochine, comprenant trois classes d'inspecteurs
et quatre classes de gardes principaux.
Les trois quarts des vacances dans l'emploi de garde principal de 4e classe
sont réservés aux sous-officiers, brigadiers et caporaux
classés pour cet emploi, en exécution de la loi du 21 mars
1905 et du règlement d'Administration publique du 26 août
1905.
L'autre quart des vacances peut être attribué aux anciens
sous-officiers de l'armée active passés dans la réserve
ou libérés définitivement, choisi de préférence
parmi ceux ayant servi à Madagascar.
Un dixième des emplois d'inspecteur peut être attribué
aux officiers de l'armée active ayant servi ou résidé
à Madagascar.
(Une récente décision du Gouverneur général
de Madagascar indique la suppression très prochaine de la garde
indigène dans la Grande Ile.)
SERVICE DE SANTE
La loi sur l'exercice de la médecine est appliquée aux colonies;
nul ne peut y exercer la médecine ou la pharmacie s'il n'est porteur
d'un diplôme français.
Le Service de santé aux colonies est assuré par les médecins
du Service de santé de l'armée coloniale, puis par les médecins
de l'Assistance médicale qui appartiennent aux cadres locaux ou
sont contractuels.
Des hôpitaux bien organisés se trouvent dans toutes les colonies;
les particuliers y sont admis, contre remboursement des frais d'hospitalisation
au tarif fixé dans chaque pays par le Gouverneur.
Des établissements spéciaux existent pour l'étude
et la recherche des moyens de guérison ou de prévention
de certaines maladies particulières aux régions où
ils existent.
Dans l'intérieur de la colonie, des postes médicaux, souvent
complétés par des infirmeries-ambulances, existent dans
les principaux centres et partout où il est possible d'en installer.
En Indochine, à Madagascar et dans l'Inde française, le
nombre des médecins indigènes permet d'en placer dans tous
les centres importants.
En Afrique occidentale et équatoriale, il sera fait de même
au fur et à mesure que l'Ecole de médecine de Dakar pourra
fournir des médecins indigènes.
Partout les médecins doivent gratuitement leurs soins aux militaires
et aux fonctionnaires, ainsi qu'à leurs familles. Les indigènes
sont soignés gratuitement aux consultations des médecins
et dans des dispensaires ou hôpitaux spéciaux, de jour en
jour plus nombreux, où les médicaments prescrits sont également
délivrés gratuitement.
Le nombre de clients payants, ou pouvant payer, est donc infime et la
clientèle civile permise à tous les médecins militaires
ou civils relevant de l'Administration locale est à peu près
négligeable, sauf en quelques rares points, comme les gros centres
des deltas du Tonkin et de la Cochinchine, où une dizaine de médecins
français ne dépendant pas de l'Administration exerçent
et vivent.
Le médecin européen connaissant les mœurs et la langue
du pays est un précieux agent de pénétration près
de la population indigène.
On ne saurait trop en multiplier le nombre, mais ne le pouvant, pour diverses
raisons, en particulier la dépense budgétaire, on s'efforce,
dès qu'il est possible de le faire, de créer des Ecoles
de médecine, formant des médecins indigènes.
Ces médecins indigènes qui, surtout dans les premières
années, n'avaient qu'une intruction générale et technique
inférieure, n'en ont pas moins rendus les services attendus et
leur niveau intellectuel et professionnel s'est élevé peu
à peu, au point que l'on a déjà pu transformer l'Ecole
de médecine d'Hanoï en Ecole de plein exercice.
Répandus dans le pays qu'ils connaissent bien, auprès de
compatriotes dont ils comprennent toutes les hésitations et scrupules,
ils accomplissent une utile besogne, s'efforçant de faire pénétrer
dans la population les principales nécessités de l'hygiène
moderne.
Aux Antilles et à la Réunion, des médecins civils,
généralement originaires du pays, ayant fait leurs études
en France, assurent le service médical de la même manière
que dans la Métropole.
Les Ecoles de médecine des colonies comportent une section de pharmacie
et des maternités formant des sages-femmes indigènes.
A la Réunion, il est délivré un diplôme local
de pharmacien analogue au diplôme de pharmacien de 2e classe de
France.
Des cadres locaux d Assistance médicale existent dans presque toutes
les colonies, à l'exception des Antilles et de la Réunion.
L'Inspection générale du Service de santé au Ministère
des Colonies, 27, rue Oudinot, à Paris, fournit tous renseignements
aux médecins qui les demandent, en vue de leur admission dans les
cadres locaux des services d'Assistance médicale, s'ils ont moins
de trente cinq ou quarante ans, selon les colonies, ou comme médecins
contrac tuels s'ils sont plus âgés.
sommaire
AVANTAGES ACCORDES AUX FONCTIONNAIRES
Les soldes sont honnêtes; elles permettent de vivre convenablement
selon la situation occupée. Il ne faut pas compter, surtout dans
les échelons de début, quelle que soit la carrière
envisagée, faire des économies considérables; mais
un homme sérieux rentrera toujours largement muni pour passer en
France un congé agréable. Par la suite, l'élévation
en grade, l'augmentation de la solde et l'expérience du pays feront
que les économies augmenteront et les dépenses diminueront
légèrement. Les soldes varient avec chaque colonie par suite
des différences du coût de la vie et il ne faut pas que l'aspirant
colonial se laisse prendre comme les alouettes au miroir par la conversion
en francs des indemnités en piastres de l'Indochine française
ou en roupies des établissements français de l'Inde. Ce
n'est qu'un mirage, car si les soldes sont touchées en piastres,
il ne faut pas oublier que les dépenses sont également payées
en piastres et que 200 piatres par mois à Saigon peuvent se comparer
à 600 francs à Paris, c'est-à-dire au strict nécessaire
pour un célibataire. Dans les mêmes conditions, un ménage
dépensera de 300 à 350 piastres par mois.
Or, le même agent célibataire dépensera un peu plus
de 900 fr. en A. O. F. et environ 1.200 francs en A. E. F.
L'Administration règle les tarifs des indemnités selon le
prix réel de la vie et détermine les indemnités en
conséquence et selon les régions, en tenant compte de tous
les facteurs favorables ou défavorables.
Le seul avantage des soldes en piastres est que les économies réalisées
l'étant en piastres sont forcément plus fortes que celles
réalisées en francs.
La même théorie s'applique aux soldes en roupies des établissements
français de l'Inde.
Les fonctionnaires nouvellement nommés reçoivent, au moment
de leur embarquement, des indemnités de déplacement représentant
leurs frais de voyage en chemin de fer de leur domicile au port d'embarquement.
Les transports par mer ont lieu sur réquisition :
En lre classe pour le personnel des 1re et 2e catégories.
En 2e classe pour le personnel des 3e et 4e
En 3e classe pour le personnel des 5e et 6e
La famille (femme et enfants jusqu'à mariage ou majorité)
peut accompagner le chef de famille et voyage dans les mêmes conditions
depuis le port d'embarquement.
Les congés administratifs de six mois (avec soldes d'Europe) sont
accordés après chaque séjour colonial; ils sont augmentés,
s'il y a lieu, d'une durée proportionnelle à la durée
du séjour dépassant le temps du séjour normal à
la colonie. (Les séjours sont généralement de deux
ans en Afrique, de trois ans en Indochine, à Madagascar, aux Antilles,
à la Guyane, et de cinq ans dans les colonies du Pacifique.)
Des congés de convalescence sont attribués sur la proposition
d'un Conseil de santé.
Dans les postes de l'intérieur, le logement est en principe assuré
suivant les ressources du pays.
Les agents des divers services coloniaux peuvent obtenir, après
vingt-cinq ans de service, des pensions de retraites basées soit
sur le régime métropolitain, soit sur les caisses locales
de retraite de chaque groupe de colonies. Le taux varie suivant la solde
des intéressés et leur ancienneté de service. Des
pensions d'infirmité peuvent être allouées lorsque
l'impossibilité de continuer la carrière provient des fatigues
ou dangers provoqués par le service.
Les veuves ou orphelins mineurs obtiennent également dans divers
cas des pensions ou secours annuels.
Les fonctionnaires coloniaux peuvent obtenir des congés d'un an
sans solde, renouvelables trois fois, leur permettant, s'ils trouvent
la possibilité de créer une affaire, de pouvoir l'essayer
sans perdre leur situation en cas d'insuccès. Nombreux sont ceux
qui, grâce à des congés, ont pu établir de
florissantes entreprises.
sommaire
COMMENT ON SE PREPARE AUX CARRIERES COLONIALES
Un certain nombre d'écoles spéciales préparent les
jeunes gens aux carrières coloniales, officielles ou privées.
Ce sont :
L'Ecole Coloniale, 2, avenue de l'Observatoire à Paris, qui recrute
les différents cadres des services coloniaux.
Les élèves sont divisés en trois catégories
:
Ceux qui se destinent aux carrières administratives;
Ceux qui se préparent à la carrière de la magistrature
coloniale;
Et ceux qui se préparent aux concours pour les carrières
administratives de l'Afrique du Nord.
Les cours commencent en novembre, l'école ne reçoit que
des externes.
Sections admistratives.
A leur sortie de l'école, les élèves brevetés
sont nommés, dans la limite des places mises à leur disposition
par le Ministre :
1° Dans l'Administration centrale des Colonies. — Rédacteurs
stagiaires.
2° Corps des Administrateurs des Services Civils de l'Indochine. —
Elèves-administrateurs.
3° Corps des Douanes et Régies de l'Indochine. — Commis
de lre classe.
4° Corps des Administrateurs coloniaux. Afrique occidentale, équatoriale
et Madagascar. — Elèves-administrateurs.
5° Corps des Secrétariats généraux aux Colonies.
— Sous-Chefs de bureau stagiaires.
6° Administration pénitentiaire aux Colonies. — Commis
principaux de 1re classe stagiaires.
La durée des cours d'instruction est fixée à deux
ans.
Le recrutement des élèves des sections administratives a
lieu au concours.
Conditions exigées pour prendre part au concours.
— Il faut :
1° Etre Français ;
2° Etre âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-trois
ans au plus au 1er janvier de l'année d'admission; cette dernière
limite est prolongée d'un nombre d'années égal à
celui des années passées sous les drapeaux ;
3° Etre titulaire d'un diplôme de bachelier, d'un diplôme
supérieur ou d'un certificat d'études délivré
par l'Ecole des Hautes Etudes commerciales, l'Institut commercial de Paris
ou les Ecoles supérieures de commerce reconnue par l'Etat, ou l'Institut
agronomique, ou d'un certificat d'admissibilité dans les cent cinquante
premiers à l'Ecole Navale, délivré par le Ministre
de la Marine;
4° Justifier d'une aptitude physique suffisante, dans les conditions
prescrites par un arrêté ministériel.
Les candidats doivent adresser leur demande avant le 1er avril
au Ministre des Colonies.
Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes
:
1° Un extrait de l'acte de naissance, dûment légalisé;
2° Un extrait du casier judiciaire;
3° Un certificat de bonnes vie et mœurs;
4° Un des diplômes énumérés dans le paragraphe
3 ci-dessus;
5° Un certificat constatant l'aptitude physique au service colonial.
Ce certificat est délivré :
A Paris, par le Conseil supérieur de santé des colonies
;
A Marseille, Bordeaux, Nantes, le Havre, par les Conseils de santé
institués près des chefs du service des colonies;
Dans les autres villes de France, par l'autorité médicale
militaire;
Une contre-visite médicale a lieu à Paris, avant le commencement
des opérations du concours.
Le concours pour l'admission a lieu au mois de juillet.
Inscriptions.
— Les droits d'inscription sont fixés à 150 francs
paT an.
Les élèves ne sont admis à suivre les cours que sur
le vu du récépissé constatant le versement de ces
droits. S'ils désirent suivre les leçons d'escrime et d'équitation,
ils devront verser le prix de ces leçons en même temps que
le montant des droits d'inscription.
Remises de frais d'études et Bourses.
— Les élèves de la section de la magistrature coloniale
peuvent obtenir des remises de frais d'études et des bourses dans
les mêmes conditions que les élèves des sections administratives.
Section spéciale de la magistrature coloniale.
La durée des cours d'instruction dans la section spéciale
de la magistrature coloniale est fixée à deux ans.
Les candidats au concours d'admission dans la section de la magistrature,
qui a lieu tous les ans dans la deuxième quinzaine d'octobre, doivent
être âgés de vingt ans au moins et de vingt-huit ans
au plus au 1er janvier de l'année où a lieu le concours.
Les candidats font leur demande et fournissent les mêmes pièces
que ceux se destinant aux sections administratives, plus leur diplôme
de licencié en droit. Toutefois la remise de ce diplôme pourra
être ajournée jusqu'à l'ouverture du concours.
Remises de frais d'études et Bourses.
— Les élèves des sections adminitratives et de
magistrature peuvent obtenir des remises de frais d'études soit
complètes, soit partielles. Des bourses et des demibourses (600
et 300 fr.) peuvent être accordées à ces mêmes
élèves, mais elles sont en principe réservées
aux élèves de deuxième année.
Exceptionnellement, les élèves de première année
dont la situation de fortune est digne d'intérêt peuvent
en obtenir si l'état des crédits le permet.
Auditeurs libres.
L'école reçoit des auditeurs libres qui sont admis après
autorisation du Conseil d'administration.
Les auditeurs libres sont soumis au paiement des droits d'inscription
(150 fr. par an). Ils suivent les cours de l'Ecole dont ils ont fait choix
selon leurs besoins, peuvent se présenter aux examens et reçoivent,
s'ils y satisfont, des certificats d'études.
L'Institut National d'Agronomie Coloniale, 2, avenue de la BelleGabrielle,
à Nogent-sur-Marne (Seine), dont les cours durent un an, est une
école d'application recevant des élèves ayant déjà
suivi l'enseignement de l'Institut Agronomique de Paris ou d'Ecoles d'Agriculture,
ou encore pourvus de certains grades universitaires.
Il forme des Ingénieurs d'Agronomie Coloniale pour les plantations
ou les Services d'Agriculture existants dans les colonies.
* *
L'Institut de Médecine Coloniale de la Faculté de Médecine
de Paris forme des médecins connaissant la pathologie coloniale.
L'Ecole du Service de Santé de la Marine et des Colonies, â
Bordeaux, assure le recrutement des médecins militaires coloniaux,
qui vont ensuite passer un an à l'Institut de Médecine et
de Pharmacie Coloniale, 40, allée Gambetta, à Marseille.
L'Enseignement vétérinaire colonial est donné à
l'Ecole vétérinaire d'Alfort (Seine).
Chaire des Pêches et Productions Coloniales, d'origine animale»
dirigée par M. le Professeur Gruvel, 57, rue Cuvier, à Paris.
Laboratoire d'Agronomie Coloniale de l'Ecole des Hautes Etudes dirigé
par M. le Professeur Auguste Chevalier, titulaire de la Mission permanente
d'Etudes des Cultures et Jardins d'essais coloniaux, au Muséum
d'Histoire Naturelle (Jardin des Plantes), à Paris.
Maîtrise de Conférence de Botanique Coloniale, à la
Sorbonne à Paris (Titulaire M. Combes).
Ecole Nationale des Langues orientales vivantes, 2, rue de Lille, Paris.
Cours d'Agriculture et Productions agricoles dans leurs rapports avec
l'industrie, deux fois par semaine, le soir, au Conservatoire National
des Arts et Métiers, 292, rue Saint-Martin, à Paris.
L'Ecole Pratique Coloniale du Havre, 1, rue Dumé-d'Aplemont, le
Havre, fonctionne sous la surveillance de la ville, elle comporte un enseignement
commercial, industriel et agricole. Les cours sont souvent professés
sur les quais ou dans les entrepôts, elle forme de bons éléments
appréciés par la colonisation. Une instruction secondaire
ou primaire supérieure solide est nécessaire pour profiter
utilement de son enseignement. Le maire du Havre reçoit les demandes
de renseignements sur cette école.
Les services et cours de l'Institut Colonial de Marseille, au Prado, Marseille,
rendent aussi de grands services pour la mise en valeur des colonies.
L'Institut Colonial et Agricole de Nancy dépend de l'Univer sité
de cette ville.
L'Ecole de Préparation Coloniale de la Chambre de Commerce de Lyon
contribue aussi à la formation du personnel des entreprises coloniales.
L'Institut Technique Colonial, 4, rue Volney, à Paris, a organisé
depuis un an un cours de préparation coloniale.
L'Ecole de Législation Professionnelle et de Pratique
Coloniale, 6, rue Littré, à Paris, s'est depuis un an adjoint
une section coloniale, les cours ont lieu le soir.
Pour tout ce qui concerne les établissements précités,
les lecteurs pourront s'y adresser directement.
sommaire
DEVOIRS GENERAUX DES FONCTIONNAIRES
Les fonctionnaires et agents coloniaux ont les mêmes droits et les
mêmes devoirs que leurs camarades des services administratifs métropolitains.
Cependant ils sont astreints à des obligations particulières,
d'ordre moral, qui découlent des fonctions qu'ils occupent loin
de la France, dans des conditions souvent difficiles, au milieu d'indigènes
qui observent et jugent toujours avec beaucoup d'à-propos.
Aux colonies, un fonctionnaire ne doit jamais alléguer de raisons
personnelles pour refuser le poste où on l'envoie. Malgré
la faiblesse numérique des cadres ou la diminution imprévue
d'effectifs, le service doit être assuré coûte que
coûte par les fonctionnaires présents au poste.
Un fonctionnaire colonial, digne de ce nom, doit pouvoir exercer des fonctions
multiples, tournées de police, recensement de la population, perception
des impôts, levés de plans, construction de routes, etc..
Il ne doit craindre aucune responsabilité et savoir prendre, sans
hésiter, les initiatives qui s'imposent à son activité.
En un mot, il ne doit avoir qu'un souci : assurer, dans sa modeste sphère,
l'expansion de l'œuvre française outre-mer, et l'essor rationnel
de la colonie qui l'emploie.
Avant la conclusion de l'entente cordiale franco-anglaise, un explorateur
britannique, capitaine d'état-major dans l'armée des Indes,
avait obtenu l'autorisation de parcourir dans tous les sens notre colonie
d'Indochine.
A diverses reprises — pour des buts que l'on devine — il voulut
se... renseigner de trop près sur des questions qu'il n'avait pas
à connaître. Il en fut pour ses frais, ce qui lui fit dire,
sa mission terminée, que « tous les agents français,
à n'importe quel degré de la hiérarchie, avaient
toujours su deviner ses projets et prendre, en temps voulu, toutes les
mesures propres à les déjouer ». Et cela depuis le
Gouverneur général jusqu'aux sergents isolés dans
les blockhauss de la frontière...
N'est-ce point le meilleur témoignage que l'on puisse rendre aux
fonctionnaires français d'outre-mer !
Concluons.
Par suite de l'évolution régulière, quoique lente,
des indigènes, et le développement de leur instruction générale,
certaines fonctions sont dévolues maintenant aux noirs et surtout
aux annamites.
Il s'ensuit que le fonctionnaire européen joue surtout un rôle
d'instructeur, d'inspecteur, de contrôleur, d'éducateur.
Rares sont les « blancs » — en dehors de spécialités
bien déterminées — qui restent des agents manuels d'exécution.
Il importe donc que tout candidat européen à un emploi quelconque
ait l'étoffe d'un chef. Dans tous les grades de la hiérarchie,
chacun doit pouvoir, en toutes circonstances, assumer toutes les responsabilités.
*
Le Tarif-Album de la Manufacture française d'Armes et Cycles de
Saint-Etienne (Loire), est le livre de chevet de tous les Coloniaux (700
pages, 2 francs, franco).
Pour le confort chez tous, les ETABLISSEMENTS WALLACH FRÈRES, 103
et 105, rue de Tocqueville, à Paris, fournissent tout l'outillage
à main, les appareils électriques, de ventilation, d'aspiration,
de levage, etc.. Réclamez le gros catalogue.
sommaire
Comment on obtient une Concession
Des concessions gratuites peuvent être accordées, dans la
plupart de nos possessions, aux Français qui en sollicitent l'obtention;
mais chaque postulant doit, en principe, se rendre dans la colonie pour
choisir en personne et délimiter lui-même le terrain faisant
l'objet de la demande, qui doit être adressée, sur place,
à l'Administration.
L'intéressé peut, toutefois, faire remplir ces formalités
par un mandataire chargé de le représenter auprès
de l'autorité locale et muni, à cet effet, d'une procuration
régulière, en bonne et due forme.
Dans nos anciennes colonies de la Réunion, de la Martinique, de
la Guadeloupe et des Etablissements français de l'Inde, il n'existe
plus de lots gratuits de terres disponibles, car les parties du domaine
public susceptibles d'être concédées ont reçu,
de longue date déjà, leur attribution.
Dans les Etablissements français de l'Océanie, à
Tahiti, Mooréa, Makatea, aux Tuamotu, aux îles Gambier, Tubuai,
Raivavae, Rurutu, Rimatara, le domaine local est nul.
La propriété foncière, très morcelée,
et la plupart du temps indivise, appartient généralement
à l'indigène, qui ne s'en défait que lorsqu'il y
est absolument forcé.
Un arrêté récent interdit de vendre à des citoyens
ou sujets étrangers les propriétés privées
ayant fait à leur origine l'objet d'une concession.
L'Administation possède probablement aux îles Marquises d'assez
vastes étendues de terrains qui ne seront révélées
que par l'établissement du cadastre. Aucun acte n'a, jusqu'à
présent, défini le régime des concessions dans cet
archipel ; aussi le service local ne peut-il procéder qu'à
des ventes de terrains sans aucune garantie, et encore, seulement quand
les terrains sont découverts par les acheteurs eux-mêmes;
les terrains vacants sont revendiqués par les indigènes
tahitiens.
A la Nouvelle-Calédonie, les terres encore libres se trouvent généralement
à une grande distance d'une route, aussi une procédure nouvelle
est étudiée par la colonie afin d'établir un système
de vente de terres par le rachat de certaines propriétés
qu'il serait possible d'acquérir dans ie but de les livrer à
la petite colonisation contre un paiement modique.
En Indochine, à Madagascar, en Afrique Occidentale française
et en Afrique Equatoriale française, le régime des terres
variant un peu avec chaque colonie, est basé sur le système
de l'immatriculation au registre foncier. Des concessions gratuites peuvent
être accordées au moins jusqu'à 100 hectares.
Au commencement, la propriété d'une concession obtenue à
titre gratuit ne peut jamais être que provisoire, et le colon n'est
mis en possession de son titre de propriété définitive
qu'après avoir accompli sut ses terres un ensemble de travaux de
mise en valeur, dont l'exécution s'échelonne, en général,
sur une période de cinq années.
Il importe de signaler que l'exploitation d'un domaine obtenu, même
à titre absolument gratuit, exige de la part du concessionnaire
certaines ressources pécuniaires pouvant lui permettre de faire
face aux dépenses de première installation (construction
des habitations, achat du matériel et du cheptel, défrichement),
et le mettant en mesure de parer, éventuellement, dans la période
des débuts, au rendement insuffisant des récoltes.
D'autre part, il n'est plus accordé de passages gratuits ou à
tarif réduit, ni d'avances d'aucune sorte, aux futurs colons, en
raison de la suppression totale, par le Parlement, en 1908, des crédits
autrefois affectés à l'émigration.
Le capital indispensable pour la mise en valeur d'une concession varie
avec chaque genre d'exploitation et chaque colonie.
On peut estimer qu'un colon connaissant très bien l'agriculture,
le pays où il se fixe et la main-d'œuvre qu'il emploiera doit
disposer de 50.000 francs en Nouvelle-Calédonie et dans les Etablissements
français de l'Océanie.
(A la Nouvelle-Calédonie, les bonnes terres en friches des propriétés
privées se vendent de 100 à 150 francs l'hectare.)
En Afrique Occidentale et en Afrique Equatoriale, il faut au moins 200.000
francs.
A Madagascar, 200.000 francs peuvent aussi permettre de tenter la chance,
mais 400.000 francs assurent le succès.
En Indochine, 250.000 francs pourront permettre un résultat, mais
500.000 francs le déterminent.
A la Martinique, le prix d'un hectare propre à la culture de la
canne à sucre varie entre 5.000 francs et 15.000 francs, à
condition que le domaine ne possède pas de distillerie, sans cela
le prix double.
A la Guadeloupe, l'hectare de très bonnes terres en friches vaut
de 1.000 à 1.500 francs.
Quant à la Réunion, cet heureux pays est complètement
mis en valeur; il ne recherche même pas de capitaux. Les prix des
terres sont très variables par suite de la diversité des
climats et des cultures, mais en général il est élevé.
En ce qui concerne la grande colonisation, il est indispensable de former
des sociétés anonymes françaises. Le cahier des charges
de la concession fixera toujours, même pour les affaires les plus
considérables ou visant les exploitations les plus spéciales,
un minimum de capital calculé afin que la majorité soit
toujours française.
La plus grande partie des administrateurs, le Président du Conseil
d'administration, l'Administrateur-délégué et le
Directeur devront toujours être français, ainsi que les agents
techniques de direction.
La société pourra avoir son siège social à
la colonie, ce qui procure de sérieux avantages fiscaux, mais ne
facilite pas l'introduction des titres sur le marché financier.
sommaire
COMMENT PLACER DES CAPITAUX AUX COLONIES
Les capitaux manquent beaucoup aux colonies, pour leur donner l'essor
économique qu'elles doivent et peuvent prendre.
Il ne s'ensuit pas pour cela que toutes les affaires coloniales indistinctement
soient bonnes à créer et leurs titres à mettre en
portefeuille. Ce qui presse le plus dans toute l'étendue de nos
possessions d'outre-mer, c'est la création ou l'extension de l'outillage.
Généralement cet outillage est obtenu au moyen de capitaux
provenant d'emprunts coloniaux qui, presque tous, sont garantis par l'Etat
français. Ils offrent donc la même sécurité
que la rente française.
Pour les emprunts émis dans les dernières années,
les colonies assurent très souvent le paiement du coupon, net de
tous impôts.
Grâce à cela on peut, en achetant certains titres d'emprunts
coloniaux, se faire un gros revenu fixe, et avoir, en même temps
la perspective de voir son capital s'augmenter dans des proportions intéressantes,
au fur et à mesure de la revalorisation du franc.
Pour les colonies, dont les emprunts ne jouissent pas de la garantie métropolitaine
— certains emprunts indochinois en particulier — on peut faire
remarquer que leur valeur n'est pas inférieure aux premiers, car
l'autorisation du Parlement français n'est donnée qu'à
bon escient, et le service du contrôle financier permanent des colonies
saurait toujours parer aux échéances, comme cela se passe
dans la Métropole.
Certaines valeurs privées jouissent d'une garantie d'Etat. Citons,
au hasard, la Compagnie du Chemin de Fer de Dakar à Saint-Louis,
la Compagnie Française des Chemins de Fer du Yunnam, celle du Chemins
de Fer Franco-Ethiopien, de Djibouti à Addis-Abbéba.
Elles sont à considérer comme leurs similaires de France.
Quant aux titres d'entreprises commerciales, industrielles, agricoles
et forestières, il en est d'excellents. Nous ne pouvons ici nous
livrer à un examen qui sortirait du cadre que nous nous sommes
tracé.
Nous indiquerons seulement un moyen pratique de se rendre compte de ce
que valent ces titres.
Les affaires coloniales sont rarement « isolées ».
Elles appartiennent, au contraire, à des familles souvent nombreuses.
Il faut donc commencer par connaître la mère nourricière,
savoir où elle loge, comment les Conseils d'administation sont
composés, enfin les intérêts et dividendes payés
annuellement par chaque société filiale.
L' « Union Coloniale », dont le siège est 17, rue d'Anjou,
à Paris, publie à peu près tous les ans 1' «
Annuaire des Entreprises Coloniales », gros volume toujours très
précis, consacrant une notice particulière à chaque
entreprise opérant aux colonies.
On trouve dans ces notices la date de formation, le chiffre du capital,
l'indication des dividendes payés dans les dernières années,
l'objet de la société, les sièges d'exploitations,
les matières traitées.
Enfin le Conseil d'administration au complet.
Une table alphabétique des administrateurs permet de voir à
combien de sociétés un administrateur appartient.
Comme pour toutes les affaires de tous les pays, la présence de
certains noms dans un Conseil d'administration peut fixer immédiatement
les intéressés sur la valeur d'une affaire.
Cet annuaire comprend aussi une table des adresses des sociétés,
groupées par rues et par numéros et quand on a pris la pratique
des
entreprises coloniales, grâce à ce volume, l'indication du
domicile d'une société nouvelle suffit pour indiquer ce
qu'elle peut être, car
on reconnaît tout de suite « la famille ».
L' « Annuaire Financier France-Extrême-Orient », publié
par Ernest Martin et Cie, 16, rue Drouot, à Paris, ne traite que
des sociétés opérant en Extrême-Orient, mais
publie sur chacune des notices très complètes, analysant
les comptes rendus des assemblées générales et des
bilans présentés aux actionnaires.
En dehors du placement par achat de titres judicieusement choisis,on peut
encore s'intéresser comme commanditaire à une entreprise
coloniale. Là nous appelons toute l'attention du lecteur sur l'importance
que peut avoir pour lui le contrôle des propositions qui lui sont
faites. Ces sortes d'opérations se font généralement
entre les membres d'une même famille ou dans un cercle très
étroit d'amis où on se connaît et s'apprécie
bien. Elles ne sont pas aisées à réussir dans un
cercle plus étendu, par suite de l'impossibilité pour le
prêteur de pouvoir obtenir des renseignements exacts et complets
sur le débiteur.
Les banques coloniales peuvent procurer des renseignements commerciaux
sur les personnes avec lesquelles elles sont en rapports, mais ces renseignements
ne sont généralement pas suffisants pour permettre de traiter
d'une association en commandite.
Banques et Sociétés d'études dans les Colonies Françaises.
Banque de l'Afrique Occidentale, 38, rue La Bruyère, Paris. (A.O.F.,
Togo, Cameroun, A. E. F. — Banque d'émission.)
Banque Commerciale Africaine, 52, rue Laffitte, Paris. (A. O. F., Cameroun,
A. E. F.).
Banque Française de l'Afrique, 23, rue Taitbout, Paris. (A. O.
F., Togo, Cameroun, A. E. F.)
Crédit Foncier du Sénégal, à Dakar.
Banque de Madagascar, 134, boulevard Haussmann, Paris. (Banque d'émission.)
Compagnie de l'Océan Indien, 10, rue de Châteaudun, Paris.
(Madagascar.)
Comptoir National d'Escompte de Paris, 14, rue Bergère, Paris.
(Agences à Madagascar, correspondant officiel des banques de l'Algérie,
Indochine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et A. O. F.).
Crédit Foncier de Madagascar, 35, rue Pasquier, Paris. (Madagascar,
Réunion.)
Société Bourbonnaise de Crédit, à Saint-Denis
(Réunion).
Banque Auxiliaire Coloniale, 76, rue Taitbout, Paris. (Guadeloupe,Martinique,
Guyane.)
Crédit Martiniquais, Fort-de-France, Martinique.
Banque de l'Indochine, 96, boulevard Haussmann, Paris. (Banque d'émission
Indochine, Nouvelle-Calédonie, Etablissements français de
l'Océanie, Côte Française des Somalis, Etablissements
Français de l'Inde.)
Banque Franco-Chinoise, 74, rue Saint-Lazare, Paris. (Indochine.)
Crédit Foncier de l'Indochine, 51, rue d'Anjou, Paris.
Société Financière Française et Coloniale,
51, rue d'Anjou, Paris. (Indochine, A. E. F-, A. O. F., Madagascar, Côte
Française des Somalis.)
Société Indochinoise de Commerce, d'Agriculture et de Finance,
25, rue du Général-Foy, Paris.
Banque Nationale Française du Commerce Extérieur, 21, boulevard
Haussmann, Paris.
Compagnie de Bordeaux, 18, rue Ferrère, Bordeaux.
Compagnie Générale des Colonies, 282, boulevard Saint-Germain,
Paris.
Compagnie Générale Financière pour la Métropole
et les Colonies, 57, avenue Victor-Emmanuel-III, Paris.
Omnium Colonial, 13, boulevard Haussmann, Paris.
Société Auxiliaire Africaine, 15, rue Vauban, Bordeaux.
Société Financière des Palmeraies, 13, rue Notre-Dame-des-Victoires,
Paris.
Société Générale de Banque pour l'Etranger
et les Colonies, 29, boulevard Haussmann, Paris.
Union Franco-Coloniale et des Pays d'Outre-Mer, 84, rue d'Amsterdam, Paris.
sommaire
Comment on se rend aux Colonies
Les embarquements à destination de FA. O. F., du Togo, du Cameroun
et de l'A. E. F. se font le plus souvent à Bordeaux, à bord
des bateaux des compagnies des a Chargeurs Réunis » et de
navigation « Sud-Atlantique », dont le siège social
est à Paris, 1 et 3, boulevard Malesherbes. Elles utilisent comme
transitaire au départ la maison Ch. Vairon et Cie, 34, rue de Paradis,
Paris, dont l'agence de Bordeaux est 81, quai des Chartrons. L'agence
générale des Chargeurs Réunis » et de la «
Sud-Atlantique » à Bordeaux se trouve 1 et 3, allées
de Chartres; le bureau des passages est chez G. Colson et Cie, 12, cours
du Chapeau-Rouge.
Il est nécessaire de se renseigner auprès de ces maisons
dès que l'embarquement est fixé, afin de connaître
les dates de clôture des expéditions de bagages et marchandises
et celle du chargement du navire. On profite ainsi du tarif de transport
le plus avantageux, petite vitesse quand cela est possible, entre la localité
de départ et Bordeaux. A Paris, le transitaire peut enlever les
bagages à domicile.
Les embarquements pour la Côte Française des Somalis, Madagascar,
l'Indochine, les Etablissements français dans l'Inde, la Nouvelle-Calédonie,
les Nouvelles-Hébrides et les Etablissements français de
l'Océanie se font à Marseille sur les navires de la compagnie
des « Messageries Maritimes », dont le siège est, 8,
rue Vignon, à Paris, et l'agence générale à
Marseille, 3, place Sadi-Carnot. Cette compagnie publie un livret-guide
du passager fort bien fait. Nous lui empruntons ce qui suit. Envoi des
bagages à Marseille avant l'embarquement.
Les passagers ont la faculté d'expédier d'avance à
Marseille leurs bagages, en les adressant à M. l'Agent général
des Messageries Maritimes en gare de Marseille-Arenc, pour les bagages
expédiés par petite vitesse et à domicile, et par
l'entremise de la gare de Marseille-Saint-Charles, pour les bagages expédiés
en grande vitesse.
Les bagages doivent être précédés d'une lettre
d'avis indiquant :
1° Marques, numéros, adresse des colis;
2° Nombre et nature des colis;
3° Nom du passager, sa destination;
4° Nom du paquebot, date du départ.
Sur chaque colis doit être fixée très solidement et
placée d'une façon très apparente une étiquette
portant l'adresse suivante :
« M. l'Agent général des Messageries Maritimes, Marseille
», à la disposition de M. X..., passager à bord du
paquebot X..., partant le.. , à destination de. ..
Les bagages des passagers se répartissent en
trois catégories :
I. — Les bagages de cabine qui ne sont astreints à aucune
taxe et doivent être embarqués par les soins des passagers
eux-mêmes. Ne sont acceptés comme bagages de cabine que les
effets personnels et le linge de rechange.
Les colis-bagages placés dans les cabines ne doivent pas dépasser
les dimensions suivantes : hauteur, 0 m. 36; longueur, 0 m. 80; largeur,
0 m. 40.
II. — Les bagages auxquels les voyageurs désirent avoir accès
pendant la traversée.
La Compagnie attire tout particulièrement l'attention de MM. les
Passagers sur le fait qu'ils doivent prendre soin, lors de l'embarquement
de leurs bagages, de spécifier s'ils désirent avoir accès
à leurs colis pendant la traversée.
Il y aura lieu dans ce cas de porter sur ces colis qui seront arrimés
dans un local spécial, la mention « Soute à bagages
— Prévoyance ».
III. — Les bagages auxquels les passagers ne désirent pas
avoir accès pendant la traversée. Ces bagages devront porter
la mention « Arrimage en cale sans accès pendant le voyage
».
La Compagnie ne peut accepter comme bagages de « prévoyance
» que le linge et les effets à l'usage ordinaire des passagers
ou seulement jusqu'à concurrence de :
1° Par paquebot-poste :
250 kilogrammes par passager payant pour l'usage d'une cabine de luxe,
ou l'usage exclusif d'une cabine de 1re classe.
150 kilogrammes par passager de lre ou 2e classe, payant place entière.
75 kilogrammes par passager de 3e ou 4e classe, payant place entière.
2° Par paquebot-mixte :
250 kilogrammes par passager payant pour l'usage d'une cabine de luxe
ou l'usage exclusif d'une cabine de lre classe.
150 kilogrammes par passager de lre classe, payant place entière.
75 kilogrammes par passager de 2e ou 3e classe, payant place entière.
Les excédents de bagages seront transportés obligatoirement
comme bagages de cale.
Les bagages adressés à la Compagnie sont conservés
gratuitement en dépôt à la disposition de leurs propriétaires,
qui doivent les réclamer au bureau des bagages.
En vue de faciliter l'envoi des bagages à Marseille avant l'embarquement,
il est remis à tous les passagers qui en font la demande à
la Compagnie ou à ses Agents :
1° Un jeu d'étiquettes imprimées correspondant à
chaque catégorie de bagages;
2° Une formule de lettre d'avis à l'adresse de l'Agent général
des Messageries Maritimes, qu'il suffira de compléter en remplissant
les lignes laissées en blanc et de mettre ensuite à la poste
après l'avoir affranchie.
Les bagages expédiés à l'avance doivent parvenir
en gare de Marseille, autant que possible, cinq jours avant le départ
du paquebot. Pour les expéditions faites par P. V., les voyageurs
devront s'informer auprès des Compagnies de chemins de fer des
délais maxima prévus pour le transport jusqu'à Marseille.
Les passagers expédiant leurs bagages à l'avance, de l'intérieur,
sont expressément invités, dans leur intérêt
même, à se présenter la veille du départ, dans
la soirée, de 2 heures à 5 heures, ou au plus tard, le matin
du départ, de 8 heures à 11 heures, munis de leurs billets
de passage, au bureau des bagages pour s'assurer que leurs colis sont
dûment arrivés sous le hangar d'embarquement, en effectuer
la reconnaissance et faire enregistrer leurs bagages de cale. Il n'est
reçu dans l'après-midi du départ que les bagages
de cabine.
Les passagers doivent s'adresser au bureau des bagages situé traverse
Nord de la Joliette (traverse des Messageries, hangar de la Compagnie,
porte P), ou au bureau des bagages situé au Môle de la Pinède,
ou au bureau des bagages situé au Môle E (Cap Pinède,
hangars 7 et 8). Le bureau des renseignements de Marseille indiquera aux
passagers le quai d'embarquement.
NOTA. — La Compagnie décline toute responsabilité
pour les erreurs ou les retards qui viendraient à se produire par
défaut d'instructions précises ou par suite de similitude
de marques et d'adresses et aussi dans le cas où les passagers
auraient négligé de réclamer ou de faire reconnaître
et enregistrer leurs colis au bureau des bagages avant leur embarquement.
Enlèvement des colis à domicile dans Paris.
MM. les Passagers peuvent, en s'adressant au bureau des passages de la
Compagnie, à Paris, 8 bis, rue Vignon (Service des bagages), faire
opérer l'enlèvement à domicile de leurs colis, leur
expédition en petite ou grande vitesse ou leur enregistrement.
Les bagages sont enlevés dans Paris à tous les étages,
descendus de l'appartement occupé par le voyageur, transportés
aux gares et dirigés sur leur destination.
Expéditions en petite ou grande vitesse.
Lorsque le voyageur désire faire expédier ses colis sur
Marseille en petite ou grande vitesse, afin de les trouver à sa
disposition aux hangars d'embarquement de la Compagnie, il doit en faire
la remise dans les délais fixés par la Compagnie des Chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;
par conséquent, il importe que les ordres d'enlèvement et
d'expédition soient donnés par MM. les Passagers 16 jours
ouvrables au moins avant la date fixée pour le départ du
paquebot, pour la petite vitesse, et 8 jours ouvrables au moins avant
cette date pour la grande vitesse.
Transport des bagages de h gare de Marseille-Saint-Charles aux quais d'embarquement.
Les Messageries Maritimes se chargent, à l'arrivée à
Marseille, d'assurer le transport des bagages de la gare Saint-Charles
aux quais d'embarquement.
Les passagers désireux de bénéficier de cette facilité
doivent déposer au Bureau des renseignements, 3, place Sadi-Carnot,
à Marseille, leurs bulletins d'enregistrement du chemin de fer
ou leurs bulletins de consigne, au plus tard la veille du départ
à 4 heures du soir.
Interdiction.
— Les passagers sont responsables de toute infraction commise par
eux aux lois des pays dans lesquels se trouvent les paquebots; il est
donc défendu d'introduire dans les effets à usage des articles
de contrebande ou des lettres; en cas de contravention, le contrevenant
est responsable de toutes les conséquences qui peuvent en résulter,
tant pour lui que pour la Compagnie.
Aucun article inflammable ou de nature à endommager les autres
marchandises n'est admis à bord des paquebots de la Compagnie,
soit comme bagage, soit comme marchandise. Toute personne qui aurait placé
à bord d'un navire quelconque quelque article de cette nature sera
responsable pénalement et civilement de cette infraction et de
ses conséquences.
Doivent être exclus de la catégorie « bagages »
et obligatoirement embarqués comme marchandises sur connaissement
: les vins,liqueurs, spiritueux, armes, munitions et d'une manière
générale toutes les marchandises faisant l'objet d'une réglementation
douanière spéciale.
Dans le cas où des marchandises de cette nature seraient néanmoins
embarquées comme bagages par des voyageurs, la Compagnie décline
toute responsabilité au sujet des conséquences qui en découleraient.
Les frais des amendes ou procès-verbaux qui pourraient en résulter
seraient imputés d'office au passager qui aurait embarqué
ces marchandises.
Une visite très rigoureuse des bagages est passée par le
service de la douane au moment de leur enregistrement.
La Compagnie rappelle à MM. les Passagers que les exportations
de monnaie d'or et d'argent sont actuellement interdites et qu'ils ne
sont autorisés à emporter qu'une somme en billets de banque
ne dépassant pas 5.000 francs.
Conditions de transport des bagages.
La Compagnie ne répond pas des bagages non enregistrés,
même pour avaries ou pertes pouvant se produire pendant la manutention,
tant à l'embarquement qu'au débarquement et au transbordement.
La Compagnie n'est pas responsable des retards, pertes et avaries des
bagages enregistrés pouvant se produire pendant la manutention
tant à l'embarquement qu'au débarquement, non plus que des
dommages provenant des risques ordinaires de la navigation.
La Compagnie décline toute responsabilité pour les bagages
de cabine et pour les objets qui restent, pendant la durée du voyage,
entre les mains des passagers et sous leur surveillance directe.
Les bagages doivent porter une étiquette indiquant d'une façon
lisible le nom du passager, le paquebot sur lequel il s'embarque et son
port de destination.' Cette étiquette doit être apposée
non seulement sur l'enveloppe du colis, mais encore sur le colis lui-même.
La Compagnie n'admet comme bagage de prévoyance que le linge, les
effets à l'usage ordinaire du passager et le harnachement.
Les passagers doivent surveiller leurs bagages dans les opérations
d'embarquement, de tranbordement et de débarquement. Toute réclamation
à raison de bagages perdus doit être faite, sous peine de
déchéance, immédiatement après l'arrivée
ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de l'arrivée.
Les bagages non réclamés sont déposés en Douane
aux frais et risques de leur propriétaire.
Durant les voyages, les passagers pourront être mis de temps en
temps et lorsque les circonstances le permettront en possession de leurs
bagages déposés dans les cales. Les passagers devront à
cet effet s'adresser au commissaire ou à l'officier spécialement
chargé des bagages.
Aucun colis de nature, par sa forme, son volume ou son contenu, à
gêner les passagers, ne peut être placé dans les cabines.
Les passagers doivent suivre à cet égard les indications
du commissaire ou des autres officiers.
Les bicyclettes complètement démontées, roue sur
roue, en caisses fermées et présentant par ce fait peu d'encombrement,
sont assimilées aux autres colis-bagages et soumises à la
même taxe.
Assurance des bagages.
La Compagnie attire tout particulièrement l'attention des passagers
sur l'intérêt qu'il y a pour eux à faire assurer leurs
bagages.
Cette assurance peut être souscrite, moyennant une prime modérée
aux conditions de la police flottante de la Compagnie soit dans ses bureaux,
soit à bord au moment de l'embarquement.
Des brochures reproduisant les clauses et conditions de la police flottante
sur bagages sont tenues gratuitement à la disposition des passagers
dans les bureaux de la Compagnie.
Renseignements généraux.
Les espèces, bijoux, objets précieux et valeurs doivent
être déclarés chargés et taxés comme
valeurs.
Cette taxe est calculée à raison de 1 % ad valorem.
Les espèces, bijoux et objets précieux doivent, en outre,
être obligatoirement assurés aux conditions de la police
flottante de la Compagnie.
Enfants. — Les enfants au-dessous de trois ans sont transportés
gratuitement; de trois à douze ans, ils paient demi-place; au-dessus
de douze ans, ils paient place entière.
Dans le cas où une même famille comprendrait plusieurs enfants
au-dessous de trois ans, la gratuité ne serait accordée
qu'à l'un d'eux et les autres paieraient chacun quart de place.
Il est accordé un lit pour un enfant payant demi-place; mais deux
enfants payant chacun demi-place n'ont droit qu'à une seule couchette.
Les enfants transportés gratuitement n'ont pas de couchettes désignées;
ils doivent coucher avec leurs parents.
Les enfants payant demi-place prennent leurs repas à part; l'accès
des salons et fumoirs leur est formellement interdit. Les parents seront
pécuniairement responsables des dégâts qu'ils pourraient
commettre.
La Société se réserve le droit de refuser des passages
aux mineurs non autorisés.
Il n'est délivré de billets de passage aux enfants au-dessous
de douze ans qu'à la condition formelle qu'ils soient accompagnés
d'une personne prenant charge d'eux pendant toute la traversée.
Réduction aux familles. — Il est accordé aux familles
voyageant par le même paquebot et dont le passage payé à
plein tarif serait équivalent au montant de trois billets de lre,
2e ou 3e classe avec cabine, une réduction de 10 %.
Les familles dont le passage serait équivalent au montant de quatre
billets de 1re, 2e ou 3e classe avec cabine, à plein tarif, ont
droit à une réduction de 15 %.
Dans le terme « famille », on comprend le père, la
mère, les enfants (les fils jusqu'à leur majorité,
les filles jusqu'à leur mariage) ainsi que les ascendants directs
vivant sous le même toit que le chef de famille.
Les précepteurs, les gouvernantes des enfants et les domestiques
voyageant en lre, 2e et 3e classe avec cabine, jouiront également
de la réduction accordée à la famille avec laquelle
ils voyagent, mais ils n'entreront pas en ligne de compte pour la détermination
du nombre des places donnant droit à la réduction.
Des réductions spéciales sur le prix net du passage, déduction
faite du coût de la nourriture, sont prévues pour les familles
nombreuses de nationalité française. Ces réductions
ne peuvent, en aucun cas, être étendues aux ascendants directs.
Elles ne sont pas applicables aux domestiques, gouvernantes ou précepteurs.
Mutilés de guerre français. — Les mutilés réformés
de guerre français ayant au moins 50 % d'invalidité bénéficient,
sur présentation de leur carte d'invalidité, d'une réduction
de 75 % sur le prix net du passage, déduction faite du coût
de la nourriture. Cette réduction est également accordée
à la personne accompagnant un mutilé de guère dont
l'invalidité est de 100 %.
Cette réduction n'est pas accordée aux mutilés voyageant
en 1re classe, paquebot-poste.
Fauteuils de pont.
Des fauteuils de pont, confortables et d'un modèle spécialement
étudié en vue de longs voyages en mer, sont loués
par la Compagnie aux passagers de 1re et de 2e classes.
Pour la location de ces sièges, dont le nombre est limité,
s'adresser à bord, au maître d'hôtel, ou de préférence
avant l'embarquement dans les bureaux de la Compagnie.
T. S. F.
Les paquebots postaux de la Compagnie sont munis d'appareils de télégraphie
sans fil.
La station de T. S. F. de chaque navire est, pendant la traversée,
en communication avec les stations de T. S. F. côtières ou
avec d autres stations de navires pouvant servir d'intermédiaires
avec les stations côtières.
• L'officier radiotélégraphiste du bord indique chaque
jour, par voie d'affiche, les stations côtières ou de bord
avec lesquelles la station de bord est en communication.
Le radiotélégramme peut être expédié
avec ou sans adresse télégraphique, en langage clair ou
secret, dans tous les pays du monde ois les bureaux télégraphiques
sont ouverts au Service International.
La Compagnie Radio-France, reçoit, 166, rue Montmartre, les radiotélégrammes
destinés aux navires en mer et donne tous renseignements sur l'acheminement
de ces radiotélégrammes.
Les indications d'ordre général données ci-dessus
peuvent servir à peu près pour toutes les Sociétés
de navigation. Rappelons les prinpales :
La Compagnie des « Chargeurs Réunis » a comme agents
à Marseille, MM. Worms et Cie, 28, rue Grignan.
Les colis en grande vitesse doivent être adressés en gare
de Marseille-Saint-Charles et les expéditions en petite vitesse
en gare de Marseille-Arenc. Une ligne mensuelle dessert l'Indochine avec
des paquebots mixtes.
La « Compagnie Havraise Péninsulaire de Navigation à
Vapeur », dont le siège social se trouve, 10, rue de Châteaudun,
à Paris, a comme agents à Marseille MM. F. Roche et H. de
Villanfroy, 18, rue de la République; chaque mois un paquebot mixte
se dirige vers la côte française des Somalis, Madagascar
et la Réunion. Les tarifs de passages de cette Compagnie sont relativement
bon marché.
La « Compagnie Française de Navigation à Vapeur »,
dont le siège social est à Marseiie, 15, rue Beauvau, et
l'Agence à Paris, 2, rue Edouard-VII, assure un service régulier
de paquebots le long de la Côte Occidentale d'Afrique. A Marseille,
le transit des bagages est assurée par la « Correspondance
Maritime P.L.M. », 108, boulevard des Dames. Les tarifs des passages
de cette Société sont un peu moins élevés.
Les embarquements pour la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, se font
à Saint-Nazaire tous les vingt-huit jours par le paquebot de la
« Compagnie Générale Transatlantique », 6, rue
Aub er a Paris, assurant le service entre Saint-Nazaire et Cristobal,
en touchant à la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre et
Basse-Terre, puis à la Martinique à Fort-de-France d'où
un service annexe reçoit par transbordement les passagers et marchandises
destinés à la Guyane et débarquant aux ports de Cayenne
et Saint-Laurent du Maroni.
L'A gence générale de la « Compagnie Générale
Transatlantique » se trouve, 14, boulevard de l'Océan, à
Saint-Nazaire.
Par Bordeaux, toutes les quatre semaines, passe un paquebot de la même
Compagnie venant du Havre et se dirigeant sur Cristobal en touchant aux
ports de Pointe-à-Pitre et Basse-Terre à la Guadeloupe et
Fort-de-France à la Martinique. L'Agence de la Compagnie se trouve,
15, quai Louis-XVIII, à Bordeaux.
Prix des passages.
Le prix des passages varie si souvent, par suite des fluctuations du change,
que certaines sociétés, comme les « Messageries Maritimes
)), font paraître un tarif des prix de passages tous les quinze
jours....
sommaire
COMMENT SE RENDRE AU PORT D'EMBARQUEMENT
Le départ du domicile métropolitain doit être calculé
de manière à arriver au port d'embarquement dans la matinée
de la veille du départ du paquebot. Avec juste raison les règlements
administratifs en font une obligation aux fonctionnaires et militaires.
Ce temps est nécessaire pour faire les dernières démarches,
viser le billet de passage par la Compagnie de navigation, reconnaître
et vérifier l'embarquement des bagages précédemment
expédiés, se présenter aux mêmes bureaux.
Après un voyage de nuit souvent long par chemin de fer, une bonne
précaution est de prendre un bain qui délasse et rend dispos
pour les nombreuses petites courses que comportera la journée.
L'employé d'une entreprise particulière profitera d'un instant
de libre pour se présenter à l'agence ou au représentant
de sa maison dans le port; cela facilite toujours les relations en se
connaissant mieux on travaille avec plus d'accord. Cette visite peut aussi
permettre de régler quelques détails paraissant infimes
mais qui influent sur le cours des marchandises et par suite sur les gains
de tous.
Le militaire ou le fonctionnaire devra passer au « Service Colonial
», faire viser ses pièces, puis toucher sa solde.
Si le départ doit avoir lieu à la première heure,
après un dîner normal on rejoindra le bord et on se couchera
tranquillement sans se soucier du tintamarre que les dockers et l'équipage
mèneront presque jusqu'au départ.
Si le départ n'est fixé que pour la fin de la matinée
ou dans l'après-midi, on couchera dans un hôtel et vers neuf
ou dix heures on gagnera le bord en emportant son sac de toilette à
la main.
Aussitôt embarqué, après avoir fait ouvrir votre cabine
un instant par le maître d'hôtel, vous déposez sur
votre couchette votre sac de toilette, votre manteau, vous sortez, le
garçon qui vous accompagne referme la porte qui le restera jusqu'à
l'instant où tous les porteurs de colis de toutes espèces
seront débarqués, et vous monterez sur le pont assister
au départ, à moins que la cloche ne vous fasse rejoindre
la table.
Bagages de cabine.
Il faut disposer du maximum en s'encombrant le moins possible. On peut
avoir, à peu près sur tous les navires, une malle ne dépassant
pas 0m80x Om40xO,m40 ce qui représente quelques centimètres
de plus que les dimensions d'une cantine militaire réglementaire.
Cette malle contiendra 2pantalons kakis, 2 pantalons blancs, 2 vestons
kakis, 2 vestons blancs, des boutons mobiles pouvant garnir simultanément
deux vestons, 6 paires de chaussettes de coton, 4 chemises légères,
2 caleçons légers, 12 mouchoirs de poche, cols, manchettes;
si on en possède, 2 pyjamas, 1 paire de ciseaux, des aiguilles,
du fil blanc, noir et kaki, quelques boutons et boucles de pantalons.
Une grande ceinture de flanelle pouvant faire plusieurs fois le tour du
corps, dans le genre de celle que portent les troupes de l'Afrique du
Nord. On peut aussi y placer une paire de souliers blancs à semelles
de cuir ou mieux de caoutchouc, 1 casquette de voyage ou 1 béret
basque pour le soir; l uniforme, si on en possède un, ou
1 vêtement habillé pour le dîner du soir en première
classe. Dans une valise à soufflets ou dans un sac de voyage, genre
squarmouth, possédant une large ouverture, on placera le casque
colonial toujoursencombrant à loger, les objets de toilette : brosse
à dents, brosse à tête, peigne, rasoir, blaireau,
savon de toilette et à barbe, 1 petite glace de voyage permettant
de se raser (il existe des modèles très petits et légers
forts pratiques et d'un prix peu élevé), 2 serviettes de
toilette en réserve. Un vêtement d'alpaga gris peut se substituer
aux vêtements kakis (reste propre plus longtemps pour les longues
traversées).
Les fumeurs n'oublieront pas le tabac permettant de gagner la première
escale, tous prendront du papier à lettres, un stylographe et de
l'encre dans un flacon à étui en bois ou métal. L'achat
d'une chaise longue est à recommander, elle sera très utile
à bord et après le débarquement elle constituera
le premier objet de votre mobilier.
Vie à bord.
Le matin l'équipage commence dès quatre heures le lavage
du pont et s'il n'existe pas de réveil, la bordée de nettoyage
se charge de le remplacer. Les passagers matinaux profitent de ce réveil
pour aller prendre leur bain ou leur douche dans les cabines à
ce destinées (le service des bains et douches est assuré
par de l'eau de mer) et faire leur ablution avec le broc d'eau douce d'usage;
puis ils prennent leur petit déjeuner, reviennent à la cabine
s'habiller afin d'être en tenue de ville pour huit heures du matin.
Vers onze heures, déjeuner. Après le déjeuner, quand
le (( point » est affiché on va reconnaître le nombre
de milles parcourus depuis la veille et noter les côtes que l'on
pourra apercevoir dans la journée, vers quinze ou seize heures
thé, et vers dix-huit heures dîner, auquel les passagers
de première assisteront en smoking blanc ou noir, ou en uniforme
; les dames s'habilleront. Les passagers de seconde restent en tenue de
ville comme pendant le jour. Le soir après vingt heures, s'il n'y
a pas de fête, on peut reprendre la tenue à volonté
pour la nuit.
Entre les repas, on utilise le temps au mieux. Les débrouillards
ont eu soin de placer leur chaise-longue ou leur fauteuil dans un endroit
convenable, bien abrité du soleil et aéré, du pont
supérieur; ils y resteront jusqu'à leur débarquement,
lisant, travaillant, dormant ou jouant avec leurs voisins.
Malgré les doubles tentes il est de bonne précaution de
rester coiffé du casque dès que l'on approche du tropique
(Dakar et Port-Saïd).
Le soir rentrez dans votre cabine pour y dormir; si vous passez la nuit
sur le pont (chaise-longue), prenez la précaution de vous couvrir
suffisamment, même pendant la traversée de la Mer Rouge.
Attendez pour changer vos effets d'avoir passé une escale où
l'on embarque du charbon, car la poussière de charbon pénètre
partout et tant que le lavage complet du navire n'est pas effectué,
rien ne peut être propre.
Un jour avant l'arrivée à destination on commence à
rassembler ses effets, afin de ne plus avoir qu'à serrer les mains
des compagnons de voyage et débarquer. Dès que le service
de santé a donné libre pratique, il vous est permis de gagner
la terre ferme.
Votre premier contact avec la colonie sera celui que vous prendrez avec
la douane et ses préposés.
Vous aurez eu le soin avant votre départ de faire des listes très
complètes par colis de tout ce qui se trouve dans vos bagages.
N'ayez pas d'alcool cela vous entraînerait à d'interminables
démarches; si vous possédez des armes vous les laisserez
en dépôt à la douane jusqu'à ce que vous ayez
obtenu l'autorisation vous permettant de les introduire dans la colonie.
Grâce à vos listes-inventaires de colis et aux factures des
objets neufs que vous aurez achetés, vous ferez votre déclaration
de douane et payerez vos droits s'il y a lieu.
Ajoutons que le personnel des douanes malgré la très mauvaise
réputation dont il jouit auprès de tous les Coloniaux n'est
pas forcément enclin à voir toujours un fraudeur dans tout
voyageur qui débarque. Allez-y franchement, exposez nettement ce
que vous avez et il vous facilitera votre passage en douane; d'autant
plus que dans certaines colonies les marchandises en provenance de France
sont exemptes de tous droits. Malheureusement les accords internationaux
nous obligent souvent à une législation particulière
comme dans presque toutes les colonies d'Afrique.
Si vous avez le loisir de le faire, avant votre départ, portez
un peu les effets neufs que vous emportez afin que l'on puisse les considérer
comme usagés pour le passage en douane.
sommaire
Comment on vit dans les colonies
Trousseau.
Le trousseau ne sera pas semblable pour deux débutants devant assurer
dans une même colonie des services différents (sédentaire
au chef-lieu, ou actif au fond de la brousse).
Le premier n'aura pas besoin de vêtements kaki, de chaussures de
chasse, ni de matériel de campement, indispensables au second;
mais il lui faudra des effets blancs, des chaussures de ville, etc., dont
l'autre n'aura que faire. Nous allons indiquer un minimum du trousseau
que chacun pourra étendre selon ses besoins et ressources, mais
en prenant bien garde de ne pas s'encombrer inutilement; ou réduire
en arrivant au minimum prévu pour le soldat colonial. Celui-ci
possède un casque, trois complets coloniaux, trois chemises, deux
caleçons, deux serviettes, trois mouchoirs, une ceinture de flanelle,
un pantalon de flanelle, une vareuse en drap, une capote, une couverture,
deux paires de chaussures, et trouve sur place un lit avec moustiquaire.
Le trousseau normal se composera donc de six complets coloniaux en coton,
dont un seul kaki et cinq blancs pour un sédentaire certain. Au
contraire un agent actif prendra sur six complets, trois ou quatre kaki
et le reste en blanc.
Le modèle généralement adopté est celui du
veston à col droit, forme dolman pouvant au besoin recevoir un
faux col et des manchettes; douze faux cols et six paires de manchettes.
Il est bon de prendre deux casques si on va à l'intérieur.
Le modèle militaire protège le mieux, mais il est incommode.
Comme vêtement de saison fraîche, le complet de France avec
lequel on embarque. Une pèlerine imperméable solide soit
en loden de bonne qualité, soit mieux en caoutchouc ciré
à capuchon, d'une marque sérieuse, c'est ce qui résiste
le mieux aux pluies tropicales, ou encore un manteau caoutchouc.
Ne pas oublier, dans le rayon chapellerie, un chapeau de feutre dont la
forme varie selon l'endroit où l'on sert.
Comme chaussures, on embarquera avec une paire de chaussures usagées
suffisantes pour faire le voyage, car à bord on marchera forcément
dans de l'eau de mer qui brûle le cuir et met rapidement les souliers
hors d'usage. Si on use de souliers bains de mer en caoutchouc, ils s'imprègnent
d'eau salée et ne sont plus très utilisables après.
On emportera donc pour le sédentaire : deux paires de chaussures
de ville et deux paires de souliers blancs. Le broussard prendra deux
paires de solides brodequins à soufflets empêchant l'introduction
de l'eau, bien ferrés, ainsi qu'une petite provision de clous de
rechange, une paire de guêtres en cuir (le modèle attaché
avec une courroie entourant la jambe est le plus commode pour la marche).
Une paire de chaussures de ville et deux paires de souliers blancs ou
d'espadrilles à tiges lacées dont nous verrons plus loin
l'emploi.
Une douzaine de paires de chaussettes de coton.
Comme linge : six chemises légères de couleurs variées,
quatre chemises de flanelle de coton pour la saison fraîche, six
caleçons, deux ceintures de flanelle faisant plusieurs fois le
tour du corps (du type de celles en usage dans l'Armée de l'Afrique
du Nord). La ceinture bleue est préférable étant
moins voyante. Douze mouchoirs de poche, six serviettes de toilette, plus
si on le peut.
Un assortiment de mercerie comprenant : des fils de la couleur des effets
emportés, des boutons à coudre et mobiles, des boucles de
pantalon, des aiguilles assorties, surtout pas trop fines (prendre quelques
grosses aiguilles triangulaires, petits carrelets des peaussiers et cordonniers,
afin de pouvoir au besoin réparer du cuir), une alène du
genre de celles de l'Armée est utile, une paire de ciseaux, un
dé à coudre. Il faudra bien prendre soin d'emballer les
aiguilles en les piquant dans un petit morceau de flanelle graissée
ou mieux paraffinée.
Un couteau de poche comprenant une forte lame, un canif grattoir et taille-crayons,
un tire-bouchon, éventuellement un tournevis et un poinçon.
Des lunettes noires ou mieux jaunes foncées pour protéger
les yeux du soleil.
Du papier à lettres et des enveloppes qui ne seront pas gommées
afin d'éviter que l'humidité tropicale ne les rende inutilisables,
des plumes, porte-plume, crayons, encre en poudra ou en comprimés
dans une boîte bien fermée. Un portefeuille ou une boîte
close comprenant vos papiers et photos de famille.
Une douzaine de savons de toilette ou une barre de bon savon blanc de
Marseille, six brosses à dents.
Une dame se constituera un trousseau analogue à celui du sédentaire
en ne prenant que des vêtements d'été de France et
un tailleur en drap pour la saison fraîche.
En Indochine il est plus avantageux de faire faire les vêtements
coloniaux à la colonie par les tailleurs indigènes.
Linge de maison.
Trois paires de grands draps (les lits sont toujours très larges,
il faut pouvoir se remuer à son aise pendant les insomnies de la
période chaude).
Une couverture de laine, trois taies d'oreillers; un débutant achètera
sa moustiquaire à la colonie, car il est peu aisé de trouver
dans la Métropole des moustiquaires convenables en dehors de celles
vendues avec les petits lits de campement.
Deux nappes, une douzaine de serviettes de table. Une douzaine de torchons
(on utilisera aussi à cet usage tous les chiffons possibles, même
les vieux sacs à farine d'Amérique, car les domestiques
indigènes gâchent beaucoup).
Batterie dé cuisine.
On peut réduire ce matériel à sa plus simple expression;
en route, où une marmite généralement en fer battu
et une poêle à frire en tôle permettant de répondre
aux besoins indispensables. On peut aussi prendre une de ces marmites
en aluminium contenant un matériel de popote très complet
; les sybarites peuvent encore le compléter par un de ces paniers-buffets
renfermant un service de table très convenable.
En station, on peut prévoir, en plus de la marmite et de la poêle,
une série de casseroles en aluminium très fort ou en bon
fer battu, ne pas prendre de cuivre ni de fonte; les cuisiniers indigènes
ne pouvant ou ne voulant pas s'en servir, sauf si dans le pays, l'indigène
utilise déjà les récipients de fonte (chose n'existant
que dans de rares colonies), un moulin à café et un filtre
cafetière.
Quant à la vaisselle, qui demande un emballage parfait, il ne faut
songer à emporter que les articles indispensables. Pour la table
: quelques plats, des assiettes, un saladier et une soupière forment
déjà un ensemble permettant de répondre à
tous les besoins. Pour la verrerie, les gobelets (étant d'un emballage
bien plus facile que les verres à pied) sont de beaucoup préférables.
Il sera bon de se munir de grands verres à eau pouvant résister
à la glace.
Les couverts, selon le cas, seront de ruolz ou d'aluminium; y ajouter
aussi quelques couverts de fer étarné pour la cuisine.
Il y aura avantage à ne prendre que des couteaux inoxydables.
Pour la toilette, le mieux est de se munir d'une grande cuvette en fer
émaillé ou en aluminium.
Pour l'éclairage, en dehors des centres pourvus de l'électricité,
on usera de lampes à pétrole, ou de bougies mises dans des
photophores (chandeliers à globe).
Constitution des bagages.
Tout ce matériel sera emballé dans de petites caisses solides
de poids très faible, afin de faciliter la manipulation et les
transports des colis, des malles, de la dimension des cantines militaires
mais de préférence en tôle d'acier zinguée
ou peinte, cadenassées et cordées, représentent le
meilleur emballage, ainsi que les tonnelets étanches en fer.
On peut aussi, quand on connaît d'avance sa destination certaine,
et que cet endroit est atteint directement par des moyens de transports
à grand trafic (chemins de fer ou chaloupes à vapeur), mettre
ce qui constitue le matériel de la maison dans des tonneaux dits
« Pièce d'une ». C'est le système qu'utilisait
autrefois les Troupes de la Marine pour envoyer les effets d'habillement,
et rarement il arrivait des avaries.
Surtout ne prenez jamais ces énormes malles dites chapelières,
encombrantes, peu maniables et pas solides, pas plus que les malles armoires.
La vue des bagages fixe les anciens sur le savoir de l'arrivant.
Literie et meubles.
Si on va loin à l'intérieur, il sera bon de se munir d'une
bonne enveloppe de paillasse en toile ou coutil, ainsi que d'une toile
pour traversin. On remplira sur place ces toiles avec du kapok, du coton,
du crin végétal ou similaire, ou enfin avec de la paille
préparée à la main. Le lit ainsi obtenu sera très
suffisant et on évitera des transports difficiles et onéreux
de matelas que l'on ne pourra pas toujours protéger contre l'humidité.
Matériel de campement.
Pour les déplacements à l'intérieur, quand on sortira
des grandes lignes de communications, il faudra posséder un peu
de matériel de campement. Un lit pliant, d'un des nombreux modèles
du commerce, pesant environ 9 à 10 kilos, sera choisi parmi les
types comptant le moins grand nombre de pièces détachables,
toujours sujettes à se perdre. Une moustiquaire pour ce lit, une
couverture brune si la température l'exige, un siège pliant,
au besoin une table pliante, reposant sur des pieds ou une base solide,
une lanterne ou un photophore suffiront.
Dans le cas où une tente est nécessaire, le meilleur type
est celui ayant la forme d'un prisme et recouvert d'une double toile,
la chaleur est diminuée et la protection contre la pluie mieux
assurée.
La nuit, au campement, on couchera tout habillé et chaussé
avec des espadrilles à tiges ou toutes autres chaussures très
légères. (Il est de toute nécessité de pouvoir
se lever immédiatement et un Européen pieds nus est généralement
incapable de marcher sur un terrain quelconque).
De même dans les endroits où on peut risquer une attaque,
les vêtements de nuit doivent être de couleur très
foncée afin que le porteur ralliant sa troupe et son convoi ne
soit pas immédiatement reconnu par l'adversaire qui concentre ses
efforts sur le cadre blanc.
Un phare d'automobile peut rendre de bons services dans ces cas, en écartant
les animaux et en montrant que le service de sécurité veille,
mais c'est un outil cher et délicat.
Au campement, une pelle carrée, ou mieux, une petite bêche,
peut rendre des services, mais n'est pas indispensable.
Comment on s'arme.
Celui qui est destiné à tenir un emploi de bureau dans une
ville n'a besoin d'aucune arme s'il n'est chasseur, la sécurité
dans nos villes coloniales étant plus grande qu'en Europe. On ne
risque que de petits larcins résultat du chapardage de la domesticité
locale.
Néanmoins la personne voyageant pour conduire du numéraire
ou des matières précieuses se munira d'un bon pistolet à
répétition automatique qui par le nombre de balles susceptibles
d'être tirées en quelques secondes et la rapidité
avec laquelle le rechargement de l'arme peut s'opérer est bien
certainement le meilleur moyen de défense qu'il lui soit possible
d'avoir.
Pour la chasse du gibier moyen, choisissez un fusil solide sans aspérités,
ayant un mécanisme robuste, simple et accessible pour en faciliter
l'entretien et, le cas échéant, la réparation.
Le fusil devra pouvoir utiliser toutes les poudres de chasse, ce qui libérera
son possesseur de tout souci en ce qui concerne les munitions, puisqu'il
pourra utiliser sans risques toutes les cartouches normalement chargées,
même de fabrication étrangère; c'est là un
gros avantage pour le chasseur colonial.
Comme l'on a souvent l'occasion de tirer à balle, il est de toute
nécessité de posséder un fusil dont l'un des canons
soit rayé, afin de tirer le plus loin possible et avec le maximum
de précision.
Il existe aujourd'hui des fusils de chasse dont le côté rayé
permet à la fois le tir du plomb et le tir de précision
à balle. Le tir du plomb dans ces canons rayés donne une
gerbe large et régulièrement dispersée, très
favorable pour les tirs à courte distance et pour les chasses sous
bois.
Les calibres à préférer sont le calibre 16 et le
calibre 12, parce qu'ils sont les meilleurs pour la chasse courante et
ceux pour lesquels il est le plus facile de trouver des munitions.
On trouve en effet dans toutes les grandes maisons de commerce des colonies
des douilles des calibres 16 et 12 percussion centrale, de la poudre et
du plomb; on se servira chez elles pour éviter l'ennui de faire
voyager des munitions, cependant il est bon d'apporter de France une ou
deux douzaines de balles spéciales pour canons choqués,
ces projectiles plus précis que la balle ronde ordinaire, pouvant
ne pas se trouver aisément.
On use, selon le gibier du pays, des plombs des numéros suivants
: 000 ou 00, 0, 4, 6, 10; les oiseaux migrateurs, oies sauvages en particulier,
doivent être tirés à grande distance, et la cuirasse
des plumes n'est pas toujours facile à traverser pour du plomb
petit ou moyen. Quant aux mammifères, ils ne sont pas toujours
à peau dure, en particulier le tigre; tous les anciens Tonkinois
se souviennent de plusieurs tigres tués avec du 4 et même
du 6 par des chasseurs surpris. Une précaution utile, en chasse,
est d'avoir toujours prêtes dans une poche spéciale deux
cartouches à balles ou à chevrotines.
Pour ceux qui rêvent de chasser spécialement la grosse bête,
des fusils rayés à grande puissance, dénommés
« Express », et utilisant des munitions à balles blindées
et demi-blindées, sont indispensables.
L'arsenal sera utilement complété par une boîte contenant
les outils et produits nécessaires à l'entretien des armes.
Des étuis en cuir souple serviront à ranger les armes entre
deux chasses.
Une bonne jumelle aide bien le chasseur, en permettant de reconnaître
au loin les gros animaux, si le pays n'est pas entièrement couvert.
Le Tarif-Album de la Manufacture française d'Armes et Cycles de
Saint-Etienne (Loire), est le livre de chevet de tous les Coloniaux (700
pages, 2 francs, franco).
Instruments d'orientation.
Il existe des cartes de reconnaissance à peu près dans toutes
les colonies, sauf l'A. E. F. L'Indochine possède même les
cartes définitives des deltas du Tonkin et de l'Annam; celle de
Cochinchine est en cours d'exécution. Une grande partie de la Haute
Région du Tonkin est aussi cartographiée. Il sera donc assez
rare d'être complètement dépourvu de cartes.
Si on possède une carte, une simple boussole, forme montre, ou
même breloque, peut suffire pour s'orienter et marcher dans la direction
voulue.
Dans le cas où vous ne possédez aucune carte et voulez lever
votre itinéraire, les procédés de topographie rapide
enseignés dans les écoles militaires, sont à suivre.
La boussole Peigné permet de lever correctement l'itinéraire
parcouru, son emploi est facile et un opérateur un peu habile fait
rapidement une carte de reconnaissance suffisante pour une demande de
concession.
Un travail à la planchette déclinée et à l'alidade
permet de faire une étude pratique pour les travaux qu'un broussard
peut avoir à conduire.
Hygiène et alimentation.
Aux colonies, plus que partout ailleurs, une bonne hygiène s'impose.
Il faut éviter les trop grandes fatigues, et aussi l'inaction.
La vie doit être aussi régulière que possible.
L'alimentation saine, variée et fraîche; on évitera
la consommation exagérée des conserves en boîtes.
La viande fraîche fera souvent défaut; si on a quelque doute
sur sa valeur il sera bon de ne la consommer que bien cuite, afin d'éviter
le ténia. A défaut de viande de boucherie on emploiera largement
la volaille, le poisson et le gibier frais.
Les légumes secs céderont souvent la place aux légumes
verts de l'espèce de ceux de France ou du pays. Quantités
de plantes des pays tempérés ou tropicaux peuvent constituer
un potage fort utile.
On évitera l'abus des boissons alcooliques. Le vin à raison
de cinquante centilitres par jour, ou au plus une bouteille de soixante-dix
centilitres, est salutaire s'il est de bonne qualité.
On fera des provisions en se basant sur le temps qui s'écoulera
entre deux ravitaillements. Il sera bon, selon 1*éloignement, d'avoir
une réserve de vivres pour parer au cas où une caisse n
arriverait pas.
Il faut compter pour de grosses rations cent grammes de légumes
secs par tête, dix grammes de café grillé pour une
tasse, cinq cent soixante grammes de farine permettent de faire sept cents
grammes de pain.
Ne pas oublier sel (au besoin pour salaison), poivre, vinaigre, huile.
Pendant les heures chaudes on évitera de séjourner au soleil
sans nécessité. En saison fraîche on mettra une couverture
sur son lit pour éviter les refroidissements si préjudiciables
au ventre. On évitera de boire entre les repas.
La question de l'eau est d'une grande importance.
Dans une ville elle est réglée plus ou moins bien, mais
presque toujours le moins mal possible, même quelquefois très
bien.
En brousse, il faudra faire une grande attention. Quand un puits sera
le seul moyen d'alimentation, il faudra veiller à son bon entretien
et à sa propreté. Si un cours d'eau passe à proximité,
plus important il sera, meilleure sera son eau, car les eaux de surface
d'un cours d'eau subissent l'action du soleil et arrivent à une
stérilisation très appréciable.
Le passage suivant, extrait de la brochure « Les Eaux souterraines
et de surface dans les Etablissements français de l'Inde)) par
M. C. Lavesvre, ingénieur chef du Service des Travaux publics des
Etablissements français de l'Inde, va le démontrer :
Les bactériologistes anglo-indiens dans leurs études, notamment
celles du Major Clesmesha, ont montré que les caractères
de potabilité de l'eau dans les pays chauds doivent reposer sur
des principes nouveaux. Le Major Clesmesha, et à sa suite les bactériologistes
de l'Inde, ont classé les bactéries en trois caté«
gories :
« 1° Les bactéries très sensibles à l'action
solaire;
« 2° Les bactéries de sensibilité moyenne ;
« 3° Les bactéries insensibles.
Les bactéries de la première catégorie sont détruits
en quelques heures par l'action directe des rayons solaires.
Il. est remarquable que dans cette première catégorie se
trouvent compris les bacilles pathogènes et notamment la série
des colis.
Les bactéries de la deuxième catégorie ne disparaissent
qu'après une exposition assez longue; on trouve parmi eux quelques
bacilles suspects.
Quant à ceux de la troisième catégorie, il résistent
longtemps à cette purification naturelle, mais ils sont inoffensifs.
On comprend tout le parti que l'on peut tirer de semblables constatations.
Si une eau ne contient que des bacilles de la troisième catégorie,
c'est qu'elle n'a été souillée par aucune pollution
récente et quelle que soit la quantité de bactéries
dénombrée par centimètre cube, elle sera absolument
potable si elle ne contient pas de bactéries d'origine intestinale.
Si cette eau contient des bacilles de la deuxième et de la troisième
catégories, il y aura eu pollution d origine intestinale, mais
aussi purification suffisante pour lui enlever tout caractère dangereux.
Les eaux contenant des bacilles de la première catégorie
doivent être proscrites de l'alimentation. Leur pollution est récente..Il
n'y a pas eu de purification, par conséquent, aucune garantie,qu'elles
ne contiendront pas un jour des bacilles pathogènes d'ori( gine
intestinale, bacilles d'Eberth, coli-bacille ainsi que desvibrions de
choléra.
Bien entendu, ces principes n'ont rien d'absolu et pour classer définitivement
une eau, il convient de l'étudier longtemps et d'être certain
qu'elle ne contient jamais des micro-organes de la première catégorie
ni des bacilles de la deuxième catégorie d'origine intestinale.
Toutes les eaux ainsi obtenues devront subir une filtration rigoureuse,
si possible « mécanique » pour enlever tout ce qui
peut s'y trouver comme les petits crustacés qui donnent naissance
au ver de Guinée; et « chimique » pour la stériliser.
La filtration mécanique peut se réaliser par un filtre à
sable, ou même par le passage au travers d'un tissu serré.
La filtration chimique la plus efficace est la javellisation à
raison d'une goutte d'eau de javel par litre d'eau. Mais comme il sera
presque toujours impossible de se procurer ce désinfectant il faudra
utiliser la stérilisation par les procédés Lapeyrère
ou Gabriel Lambert ou Laurent à base de permanganate de potasse.
La poudre Lapeyrère contient :
Permanganate de potasse 3 gr.
Alun de soude pulvérisé 10 gr.
Carbonate de soude 9 gr.
Chaux de marbre 3 gr.
Cette poudre doucement versée dans l'eau (ne pas employer un récipient
zingué) doit teinter l'eau en rouge. Au bout d'un quart d'heure
filtrer sur de la ouate de tourbe pour obtenir de l'eau potable.
Un système de filtres en étain très pratique, et
peu volumineux basé sur ces principes se trouve dans le commerce.
A défaut de toute filtration sérieuse il faudra employer
le procédé le plus radical qui est l'ébullition pendant
vingt minutes. Il faudra bien se garder de verser le liquide dans un autre
récipient, on courrait le risque de contaminer l'eau qui vient
d être stérilisée.
Les débutants ont tout avantage s'ils ne sont dans un centre où
ils peuvent prendre pension dans un hôtel, à se faire admettre
dans une popote formée par quelques camarades. Il ne vivront seuls
que s'ils ne peuvent faire autrement et sont isolés.
Comment on se loge.
Dans les villes et dans les postes définitifs, des constructions
commodes et pratiques existent ; les chambres doivent être aussi
aérées que possible, la lumière doit pouvoir pénétrer
largement partout; cependant on doit pouvoir se protéger complètement
contre le soleil, au moyen de persiennes ou de stores.
Dans la brousse les postes provisoires ou nouveaux ne comprennent guère
que des constructions de fortune ou des cases indigènes aménagées
pour des blancs. Ces habitations ne valent pas les premières, mais
elles sont tout de même très habitables, on y est souvent
plus au frais sous une bonne toiture en herbe sèche que sous la
tôle ondulée chère aux T. P.
Le principal aménagement consiste à établir un béton
ou un carrelage sur le sol; puis un plafond, laissant un matelas d'air
suffisant entre lui et la toiture.
Comment on se renseigne.
Les principaux organes de renseignements concernant les colonies françaises
sont les Agences générales ou économiques qualifiées
chacune pour documenter sur les pays qu'elles représentent respectivement.
L'Agence générale des Colonies, 34, Galerie d'Orléans,
Palais Royal, à Paris, renseigne sur les produits coloniaux en
général. Elle possède un musée contenant des
matières premières provenant des Colonies, permettant aux
industriels et commerçants de pouvoir diriger plus facilement leurs
recherches. Une bibliothèque contenant plus de 15.000 volumes pouvant
être consultés sur place, de 10 heures à midi et de
14 à 17 heures, tous les jours non fériés, sauf du
15 août au 15 septembre, époque de la fermeture annuelle.
Un service de renseignements répond à toutes questions ou
oriente les demandeurs vers l'organe compétent. En particulier,
il conseille les chercheurs d'emplois et fournit aux entreprises coloniales
qui le désirent des listes de postulants pour toutes situations.
Un service des statistiques centralise toutes les statistiques douanières
des colonies et peut fournir tous renseignements détaillés
au commerce sur les débouchés coloniaux, tant à l'importation
qu'à l'exportation.
Un service administratif et un service technique logés 57, boulevard
des Invalides, passent les marchés concernant les fournitures demandées
par les colonies, ils en surveillent l'exécution, assurent la réception
des marchandises et des dirigent vers les ports d'embarquement.
Le montant des commandes annuelles passant par ces services est de 300
millions.
Dans chacun des ports de commerce du Havre, de Nantes, Saint-Nazaire,
Bordeaux et Marseille, un service colonial dépendant de l'Agence
Générale des Colonies assure l'embarquement, le débarquement
du personnel colonial et l'administre pendant son séjour en France.
Les marchandises, matériels et colis de tous genres sont expédiés
ou reçus par les soins du même service.
L'Agence comptable de timbres-poste coloniaux, 80, rue du faubourg Saint-Denis,
à Paris, prépare les émissions de timbres, les expédie
aux colonies et est chargée de la vente au public pour la France.
Les agences économiques qui sont la représentation directe
des gouvernements généraux dont elles dépendent peuvent
guider toute personne étudiant une question pouvant contribuer
au développement de ces colonies; elles ont leurs bureaux aux adresses
ci-dessous :
Agence Economique de l'Indochine, 20, rue la Boétie.
Agence Economique de Madagascar, 40, rue du Général-Foy.
Agence Economique de l'A. O. F., 159, boulevard Haussmann.
Agence Economique de l'A. E. F., 217, rue Saint-Honoré.
Agence Economique des Territoires Africains sous mandat (représentation
du Cameroun et du Togo), 27, boulevard des Italiens.
Les possessions françaises du tour de la Méditerranée
qui ne rentrent pas dans le cadre de cet ouvrage sont représentées
à Paris par :
L'Office de l'Algérie, 10, rue des Pyramides.
L'Office de la Tunisie, 17, Galerie d'Orléans, Palais Royal.
L'Office du Maroc, 21, rue des Pyramides.
La Délégation de Syrie, 156, rue de l'Université.
à midi et de 14 à 17 heures, tous les jours non fériés,
sauf du 15 août au 15 septembre, époque de la fermeture annuelle.
Un service de renseignements répond à toutes questions ou
oriente les demandeurs vers l'organe compétent. En particulier,
il conseille les chercheurs d'emplois et fournit aux entreprises coloniales
qui le désirent des listes de postulants pour toutes situations.
Un service des statistiques centralise toutes les statistiques douanières
des colonies et peut fournir tous renseignements détaillés
au commerce sur les débouchés coloniaux, tant à l'importation
qu'à l'exportation.
Un service administratif et un service technique logés 57, boulevard
des Invalides, passent les marchés concernant les fournitures demandées
par les colonies, ils en surveillent l'exécution, assurent la réception
des marchandises et des dirigent vers les ports d'embarquement.
Le montant des commandes annuelles passant par ces services est de 300
millions.
Dans chacun des ports de commerce du Havre, de Nantes, Saint-Nazaire,
Bordeaux et Marseille, un service colonial dépendant de l'Agence
Générale des Colonies assure l'embarquement, le débarquement
du personnel colonial et l'administre pendant son séjour en France.
Les marchandises, matériels et colis de tous genres sont expédiés
ou reçus par les soins du même service.
L'Agence comptable de timbres-poste coloniaux, 80, rue du faubourg Saint-Denis,
à Paris, prépare les émissions de timbres, les expédie
aux colonies et est chargée de la vente au public pour la France.
Les agences économiques qui sont la représentation directe
des gouvernements généraux dont elles dépendent peuvent
guider toute personne étudiant une question pouvant contribuer
au développement de ces colonies; elles ont leurs bureaux aux adresses
ci-dessous :
Agence Economique de l'Indochine, 20, rue la Boétie.
Agence Economique de Madagascar, 40, rue du Général-Foy.
Agence Economique de l'A. O. F., 159, boulevard Haussmann.
Agence Economique de l'A. E. F., 217, rue Saint-Honoré.
Agence Economique des Territoires Africains sous mandat (représentation
du Cameroun et du Togo), 27, boulevard des Italiens.
Les possessions françaises du tour de la Méditerranée
qui ne rentrent pas dans le cadre de cet ouvrage sont représentées
à Paris par :
L'Office de l'Algérie, 10, rue des Pyramides.
L'Office de la Tunisie, 17, Galerie d'Orléans, Palais Royal.
L'Office du Maroc, 21, rue des Pyramides.
La Délégation de Syrie, 156, rue de l'Université.
Chambres de Commerce coloniales.
Sénégal. — Dakar, Saint-Louis, Rufisque, Ziguinchor,
Kaolack.
Soudan Français. — Bamako, Kayes.
Guinée Française. — Conakry.
Côte d'Ivoire. — Grand-Bassam.
Dahomey. — Porto-Novo.
Cameroun. — Douala.
Madagascar et dépendances. — Tananarive, Tamatave, DiégoSuarez,
Majunga, Nossi-Bé, Morondava, Tuléar, Fort-Dauphin, Farafangana,
Mannanjary, Vohémar, Fianarantsoa, Moremanga, Ambositra. Dzaoudzi
(Comores).
Cochinchine. — Saïgon.
Tonkin. — Hanoï, Haïphong.
Annam. — Tourane.
Cambodge. — Pnom-Penh.
Côte Française des Somalis. — Djibouti. Ile de la Réunion.
— Saint-Denis.
Etablissements Français dans l'Inde. — Pondichéry.
Iles Saint-Pierre-et-Miquelon. — Saint-Pierre.
Martinique. — Fort-de-France.
Guadeloupe. — Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.
Guyane Française. — Cayenne.
Nouvelle-Calédonie. — Nouméa.
Etablissements Français de l'Océanie. — Papeete.
sommaire
LISTE DE JOURNAUX ET PERIODIQUES COLONIAUX PARAISSANT A PARIS ET EN
PROVINCE
JOURNAUX
Le Chasseur Français, renseigne sur tout. Lire sa rubrique "Colonisation".
Abonnement : 10 francs par an, Saint-Etienne.
Le Sud-Ouest Economique, 6, place Saint-Christoly, Bordeaux. publie une
série remarquable de numéros spéciaux sur toutes
les Colonies françaises.
Le Midi Colonial, 42, rue Hallé, Paris, hebdomadaire.
L'Essor Colonial et Maritime (belge), publie une rubrique sur les Colonies
françaises. Bureau à Paris : Institut Colonial français,
4, rue
Volney.
Les Annales Coloniales, 34, rue du Mont- T habor, quotidien.
Le Courrier Colonial, 96, rue de Rivoli, bihebdomadaire.
La Dépêche Coloniale et Maritime,
19, rue Saint-Georges,
QUAOTIDIENS.
L'Economiste Colonial (financ, commerc., minier), 96, rue de Rivoli, hebdomadaire.
La Presse Coloniale, 2, rue des Halles, quotidien.
L'Effort Colonial, 251, faubourg Saint-Honoré, hebdomadaire.
La Parole Coloniale, 20, rue Geoffroy-Lasnier, Paris, hebdomadaire.
BULLETINS ET REVUES PERIODIQUES
Actes et comptes rendus de l'Association « Colonies-Sciences »,
44, rue Blanche, mensuel.
L'Afrique Française, 21, rue Cassette, mensuel.
L'Asie Française, 21, rue Cassette, mensuel.
L'Agronomie Coloniale, 11, rue Victor-Cousin, mensuel.
Bulletin de l'Agence Générale des Colonies, 34, Galerie
d'Orléans, Palais-Royal, mensuel.
Bulletin de l'Agence Economique de l'Afrique Occidentale Française,
159, boulevard Haussmann.
Bulletin du Comité d'Etudes Historiques et Scientifiques de l'Afrique
Occidentale Française, 11, rue Victor-Cousin.
Bulletin Mensuel d'Informations de l'Agence Economique des Territoires
Africains sous mandat, 27, boulevard des Italiens.
Bulletin des Renseignements Coloniaux, mensuel, 42, rue Hallé.
Bulletin de la Société Française des Ingénieurs
Coloniaux, Bourse du Commerce, rue de Viarmes.
Bulletin de la Société de Géographie Commerciale
de Paris, 8, rue de Tournon.
Bulletin de la Société Nationale d'Acclimatation de France,
198, boulevard Saint-Germain.
Bulletin de ta Société de Pathologie Exotique et de sa Filiale
de l'Ouest Africain (Institut Pasteur), 10 fois par an.
Bulletin de l'Union des Chambres de Commerce Françaises à
l'Etranger, aux Colonies et Pays de Protectorat, 4, rue Edouard-VII.
La Gazette Coloniale (économique et financière), 67, rue
de Richelieu.
La Géographie (Bulletin de la Société de Géographie
de Paris), 120, boulevard Saint-Germain.
Informations de l'Agence Economique de Madagascar, 40, rue du Général-Foy,
mensuel.
Bulletin Officiel de la Fédération Nationale des Anciens
Coloniaux, 4, rue Volney, mensuel.
Journal Officiel de la Fédération Nationale des Associations
de Fonctionnaires et Agents Coloniaux, 2, rue des Halles.
Mer et Colonies (Bulletin de la Ligue Maritime et Coloniale), 30, boulevard
des Capucines, mensuel.
Le Monde Colonial Illustré, 11 bis, rue Keppler, mensuel.
L'Outillage Colonial, 17, rue d'Anjou, trimestriel.
Recueil de Législation de Doctrine et de Jurisprudence Coloniales,
27, place Dauphine.
Recueil Général de Jurisprudence, de Doctrine et de Législation
Coloniales, 33, rue de la Chaussée d'Antin, mensuel.
Revue de Botanique Appliquée et d'Agriculture Coloniale (publiée
par le Laboratoire d'Agronomie coloniale de l'Ecole des
Hautes Etudes, dirigée par le professeur Aug. Chevalier), 57, rue
Cuvier, mensuelle.
Revue d'Etnographie et de Sociologie, 27, rue Bonaparte.
Revue de l'Histoire des Colonies Françaises, 28, rue Bonaparte,
trimestrielle.
Revue Indigène, 16 bis, rue Mayet, mensuelle.
Revue de Médecine et d'Hygiène Tropicales, 23, rue de l'Ecolede-Médecine,
trimestriele.
Revue du Monde Musulman, 28, rue Bonaparte.
Pvevue du Pacifique, 22, rue d'Anjou.
Revue des Questions Coloniales et Maritimes, 134, rue de la Pompe (paraît
tous les deux mois).
Revue des Valeurs Coloniales, 142, rue Montmartre, hebdomad.
La Semaine Coloniale, 17, rue Duphot, hebdomadaire.
La Vie Technique Industrielle, Agricole et Coloniale, 18, rue Seguier,
mensuelle.
Chronique bimensuelle de l'Institut Colonial Français, 4, rue Volney.
La Dépêche Coloniale Illustrée, 19, rue Saint-Georges.
L'Expansion Economique, 23, avenue de Messine.
L'Exportateur Français, 1, rue Taitbout.
La France de Demain (Revue du Comité Dupleix), 26, rue de Grammont.
Journal de la Marine Marchande, 190, boulevard Haussmann.
Moniteur Officiel du Commerce et de l'Industrie, 22, avenue Victor-Emmanuel-III.
DÉPARTEMENTS
Annales de l'Institut Colonial de Bordeaux, 16, place de la Bourse, Bordeaux.
Annales du Musée Colonial de Marseille, Prado, Marseille.
Bord eaux Colonial et Maritime, 91, rue Paulin, Bordeaux.
Publications de l'Institut Colonial de Marseille, Prado, Marseille:
Les Cahiers Coloniaux, hebdomadaire.
Bulletin des Céréales et Plantes à Fécule,
mensuel.
Bulletin des Matières Grasses, mensuel.
Bulletin des Caoutchoucs, mensuel.
Lyon-Colonial, 8, rue Sainte-Catherine, Lyon, mensuel.
Bulletin de l'Institut Colonial et Agricole de Nancy.
Bulletin de la Société de Géographie et d'Etudes
Commerciales de Marseille, 5, rue de Noailles, Marseille, trimestriel.
Le Midi Colonial et Maritime, 36, rue Consolat, Marseille.
sommaire
L'ARMEE COLONIALE
Dès 1622, Richelieu créait nos premières «
Compagnies de la Mer ». Elles étaient alors au nombre de
cent, et c'est d'elles que sont sorties, après d'inénarrables
et multiples transformations, dissolutions et réorganisations,
les « Troupes de la Marine ».
Organisées en date du 14 mai 1831, les troupes de la Marine sont
devenues, en 1900, les troupes de l'armée coloniale, avec ses «
Marsouins » (infanterie) et ses « Bigors » (artillerie).
Malgré les vicissitudes et les avatars subis, un même esprit
— celui qui animait les anciens lors des campagnes d'Amérique
et de l'Inde — règne toujours parmi les soldats coloniaux.
La « tradition » a fait de l'armée coloniale le corps
qui possède le plus bel historique de l'armée française,
si riche cependant en faits glorieux.
Partout, où dans l'immensité des brousses lointaines, il
a fallu planter le drapeau français, établir, étendre,
consolider le domaine national d'outre-mer, Marsouins et Bigors étaient
présents, ignorant leurs souffrances, ne comptant jamais leurs
pertes, ne voyant qu'un seul objectif : le but à atteindre.
Et ils l'ont atteint partout, au prix de difficultés souvent inouïes.
Quand le sol national s'est trouvé menacé, toujours l'armée
coloniale fut aux postes les plus périlleux.
En 1709, à Malplaquet, la baïonnette à douille rétablissait
la situation, grâce à l'héroïsme du « Royal
Marine ».
En 1794, quand le Vengeur sombra sous la mitraille anglaise, le capitaine
d'infanterie de marine Soigner coule avec son détachement,
qui a tiré jusqu'au bout.
En 1870, la division bleue s'illustra à Bazeilles, forçant
l'admiration de l'adversaire. Malgré la perte de cette belle division,
les dépôts furent encore en mesure de fournir douze bataillons
de marche à l'armée active.
De 1914 à 1918, le rôle des troupes coloniales, blanches
et indigènes, est encore dans toutes les mémoires. Toutes
les têtes de colonnes d'assaut, à de rares exceptions, furent
formées avec leurs éléments.
Depuis la fin des hostilités, l'armée coloniale n'est pas
restée inactive.
Au Soudan, en Mauritanie, elle a réduit quelques tribus rebelles
et refoulé les pirates du désert.
Au Maroc, dans le Riff, en Syrie, au Tonkin, contre les écumeurs
de toutes sortes, elle continue son rôle...
La colonisation elle-même est l'œuvre entière des Marsouins
et Bigors.
Ces hommes sont de grands bâtisseurs, des perçeurs de route,
des constructeurs de voies ferrées, des organisateurs de marchés.
Ils ont établi le calme et la paix française dans des pays
troublés depuis des siècles. Ils ont attiré à
la France la masse des populations sauvages, préparant ainsi magnifiquement
l'œuvre encore ingrate des administrateurs, qui travaillent au même
but, selon la même tradition.
Et, souvent, il s'est produit ce fait caractéristique que les premiers
de nos fonctionnaires coloniaux, qui organisèrent administrativement
le pays, furent ceux-là mêmes qui, quelques mois auparavant,
en faisaient la conquête comme soldats. Ils avaient troqué
leurs galons contre des broderies.
De même, les premiers commerçants, les premiers planteurs,
les premiers industriels d'une colonie furent presque toujours les militaires
libérés. Aujourd'hui encore, ils forment la majorité
des « civils » fixés aux colonies.
Quand une entreprise cherche un collaborateur européen, si elle
le trouve dans un corps de troupe stationné sur place, elle préfère
attendre sa mise en congé ou sa libération pour l'engager
chez elle ; elle évite ainsi des frais élevés pour
acclimater un débutant qui peut très bien ne pas se plaire
à la colonie dès qu'il y est arrivé.
Aussi ne saurions-nous trop conseiller aux jeunes gens désireux
d'aller aux colonies, pour s'y créer une situation intéressante,
de passer d'abord par les troupes coloniales.
Ces dernières, d'ailleurs, offrent par elles-mêmes de très
sérieux avantages. Une bonne partie de leurs officiers se recrutent
dans ses rangs et les sous-officiers rengagés servent à
l'encadrement de troupes de couleur.
Les officiers ont accès au cadre des administrateurs coloniaux
et des services civils de l'Indochine à peu près à
tous les degrés de la hiérarchie, selon leur grade, leur
âge, leur temps et les fonctions qu'ils ont remplies aux colonies.
(Consulter dans chaque cas la Direction du Personnel au Ministère
des Colonies, 27, rue Oudinot, à Paris.)
Les sous-officiers coloniaux ont accès facilement dans beaucoup
de services locaux, où la préférence leur est donnée
grâce à leur connaissance approfondie du pays, des indigènes,
de leurs coutumes et de leur langue.
sommaire
RECRUTEMENT DES TROUPES COLONIALES
Les bureaux spéciaux des régiments coloniaux et les bureaux
de recrutement reçoivent les demandes d'engagements et de rengagements
au titre du service général des troupes coloniales.
A. — Engagements.
a) Durée : 3, 4, 5 ans sous réserve que l'engagement sera
de durée telle que l'engagé puisse accomplir un séjour
d'au moins deux ans à la colonie, à partir de l'âge
de 20 ans.
b) Conditions nécessaires : 1° avoir 18 ans accomplis; 2°
n'être ni marié, ni veuf avec enfants; 3° n'avoir encouru
aucune des condamnations entraînant l'incorporation dans un bataillon
d'infanterie légère d'Afrique; 4° jouir de ses droits
civils; 5° être de bonne vie et mœurs.
c) Pièces à présenter : bulletin de naissance; certificat
de bonne vie et mœurs; consentement des parents ou des tuteurs.
B. — Rengagements.
a) Durée : 3, 4, 5 ans, renouvelables jusqu'à 15 ans de
services.
b) Conditions nécessaires : avoir moins de 33 ans.
c) Pièces à présenter : certificat de bonne conduite;
certificat de bonne vie et mœurs; livret individuel ou fascicule
de mobilisation.
Le bureau spécial de rengagement créé à la
Caserne de Lourcine, 37, boulevard de Port-Royal, à Paris, donne
tous renseignements nécessaires aux intéressés et
leur facilite l'obtention des diverses pièces nécessaires
à la constitution des dossiers, en outre dès que les postulants
ont été présentés à la visite du médecin
ils sont, dans le cas où ils se trouveraient sans ressources, hébergés
et nourris.
Les postulants peuvent se présenter à la Caserne de Lourcine
tous les jours, dimanche et fêtes exceptés, de 7 h. 30 à
11 h. et de 13 h. à 17 h. 30 mais de préférence le
matin avant 11 heures.
Avantages pécuniaires accordés aux engagés
et rengagés des troupes coloniales.
Solde journalière et haute paye :
Solde journalière liée au service avant 1950 : 0 75, 0 85,
0 95
Solde journalière liée au service après 1950 ; 0
25, 0 35, 045
Haute paye après la durée légale : 1, 1 1 60
Haute paye après 5 ans : 2 30, 2 30, 2 90
Haute paye après 10 ans : 2 60, 2.60, 3
Une prime de 1.250 francs est allouée par année d'engagement
souscrit au-dessus de 18 mois de service légal et jusqu'à
la dixième année de service. Cette prime peut être
payée le jour de l'arrivée au corps.
Solde mensuelle :
Solde mensuelle à Paris. —
Sergent après 18 mois de service 493,90; sergent après 5
ans : 671,50; sergent après 8 ans : 686,50;
sergent après 10 ans : 716,50;
sergent-major après 8 ans : 721 ;
adjudant après 10 ans : 826,90; adjudant-chef après 10 ans
: 850,90.
Les sous-officiers mariés reçoivent en sus des indemnités
mensuelles environ 250 francs.
Une prime de 1.250 francs pour les caporaux et soldats et de 1.475 francs
pour les sous-officiers par année de rengagement est allouée
du lendemain de la durée légale du service et jusqu'à
la 10e année, cette prime peut être payée intégralement
dès le contrat souscrit.
Aux colonies, les militaires des troupes coloniales perçoivent
la solde de France avec des majorations allant des 5/10 aux 9/10. —
En A. O. F. et en A. E. F. ils perçoivent une indemnité
spéciale en sus et en Indochine ils sont payés en piastres.
Le taux de la retraite proportionnelle à 15 ans de services varie
suivant les années de services et les campagnes entre les taux
suivants :
Soldats de 2e et de 1re classe de 1.152 fr. à 1.920 fr.
Caporal de 2.120 fr. à 2.660 fr.
Sergent de 3.772 fr. à 5.775 fr.
Sergent-major de 4.000 fr. à 6.163 fr.
Adjudant de 4.000 fr. à 6.391 fr.
Adjudant-chef de 4.000 fr. à 6.484 fr.
Outre ces divers avantages, les militaires des troupes coloniales qui
se sont fait libérer à la colonie, où il leur est
souvent possible de trouver des situations civiles avantageuses, ont la
faculté d'être rapatriés aux frais de l'Etat, soit
en fin de contrat, soit dans un délai de deux ans après
la libération.
Les jeunes gens âgés de 18 ans peuvent aussi contracter un
engagement de deux ans leur permettant de choisir la colonie où
ils désirent servir (Indochine, Madagascar ou A. O. F.). Ils sont
expédiés directement sur le dépôt des isolés
coloniaux à Marseille et embarqués sur le premier navire
se dirigeant sur la colonie où ils doivent servir.
S'ils se fixent à la colonie, ils peuvent y obtenir leur mise en
congé six mois avant leur libération.
Dans les colonies dépourvues de troupes blanches, des sursis d'incorporation
en temps de paix, qui équivalent en fait à des dispenses
de service actif, peuvent être accordés aux jeunes gens recensés
dans la colonie lors de la formation de leur classe et y résidant
depuis l'âge de dix-huit ans; pour obtenir le bénéfice
de la dispense de service actif; le séjour colonial doit se prolonger
pendant dix ans, non compris bien entendu les congés normaux en
France tous les deux ou trois ans.
Pour toutes les questions concernant le service militaire, on peut se
renseigner : à la Direction des services militaires, au Ministère
des Colonies, 27, rue Oudinot, à Paris; ou à la 8e Direction
(troupes coloniales), au Ministère de la Guerre, boulevard Saint-Germain,
à Paris.
sommaire
Comment on se soigne aux colonies
Les premiers et les meilleurs soins sont ceux qui maintiennent le
moral.
Il est indéniable que les colonies tropicales sont riches d'affections
et de maladies variées. Hier encore très peu connues, beaucoup
mieux aujourd'hui — où l'on dispose d'une thérapeutique
appropriée — on peut affirmer que les cas deviennent de moins
en moins nombreux et surtout, généralement, de moins en
moins graves.
La première condition pour ne pas être atteint est de né
pas y penser, de ne pas être obsédé par la crainte
des maladies. Les sujets qui se trouvent dans ces dispositions d'esprit
feront beaucoup mieux de ne pas quitter la Métropole, où
ils pourront toujours prendre toutes les précautions voulues contre
les épidémies qui sévissent assez régulièrement.
Les soins préventifs résideront surtout dans une bonne hygiène,
un régime alimentaire sain, abondant, sans excès, et comprenant
le plus possible d'aliments frais, particulièrement des végétaux
; peu de viande pendant la saison chaude, une quantité de boisson
suffisante aux repas et sans excès amenant des lourdeurs d'estomac
ou de l'embarras gastrique. Pas d'alcool. Eviter le soleil autant qu'il
sera possible ; avoir toujours la tête couverte d'un bon casque
(le casque rond à bord plat peut convenir pour un sédentaire,
mais un broussard devra prendre un casque garantissant mieux, du genre
du modèle militaire).
Exposer le moins possible au soleil les autres parties du corps et en
particulier ne pas sortir le torse nu, la colonne vertébrale étant
presque
aussi sensible que la tête. Avoir toujours des vêtements larges,
même un peu flottants; ce n'est pas beau, mais c'est bien commode.
On se préservera du paludisme en évitant les moustiques
et on prendra régulièrement, chaque soir de préférence,
en dînant, un comprimé de 0 gr. 25 de chlorhydate de quinine.
11 sera bon de commencer la quininisation préventive dès
le jour du débarquement et de la continuer au moins jusqu'après
l'installation définitive. Dans certaines régions, il faudra
la continuer longuement, dans d'autres on ne la pratiquera qu'à
certaines périodes de l'année. Quand on sera sur le point
d'entreprendre un travail pénible, il sera utile de prendre de
la quinine préventive.
Toute affection intestinale devra être immédiatement traitée.
La constipation, par une purge ou un laxatif et surtout un régime
alimentaire rafraîchissant. La diarrhée sera soignée
de suite par la diète complète, seulement un litre de lait
et autant de thé léger, une purge : sulfate de soude ou
magnésie de 20 grammes et le repos absolu; si en deux ou trois
jours l'état du malade ne s'est pas amélioré, il
devra se rendre près d'un médecin.
Si des symptômes de pesanteurs de l'estomac ou manque d'appétit
se font sentir, on commencera par prendre un purgatif salin (40 ou 45
grammes de sulfate de soude ou de magnésie). Cela peut permettre
d'éviter une affection plus grave.
Tout colonial doit savoir faire un pansement, une injection hydrodermique
dans la fesse, partie où l'on risque le moins d'accident, et pouvoir
donner les premiers soins à un malade ou à un blessé.
En particulier, en cas d'insolation, mettre à l'ombre le malade,
le déshabiller, l'éventer, rafraîchir la tête
par des lotions et attirer le sang aux pieds par des lavages chauds, des
ventouses ou des sinapismes.
Puis le transporter à l'hôpital le plus proche.
En cas de manque complet de médicaments et d'objets de pansement,
on y remédiera en utilisant des moyens de fortune, inspirés
des indications que le docteur Spire, médecin principal des troupes
coloniales, décrivait dans une chronique médicale du journal
LaDépêche Coloniale, intitulé Le Système D
:
Sans pansement, sans antiseptiques, on arrivait cependant à faire
de la bonne besogne. L'eau bouillie, l'huile de palme ou d'arachides stérilisée
par la chaleur, la poudre de charbon de bois, les feuilles de bananes
ou de carludovica assouplies par la chaleur, le savon noir obtenu en saponifiant
l'huile de palme par la cendre des écorces de banane, les bandes
découpées dans les calicots de traite, remplaçaient
les innombrables produits dont on dispose dans les hôpitaux de France.
En utilisant les ressources de la flore locale, on arrivait à suppléer
à l'absence des drogues dont étaient dépourvues les
pharmacies des postes. Tisanes de feuilles d'oranger, de citronnelle,
de cassia africana, de fruits de tamarin, servaient de diurétique.
Le simaruba sauvait les entéritiques. Les graines de courge, de
papaye, les parasités de l'intestin. Une révulsion énergique
s'obtenait par les sucs d'euphorbes, si abondants sur les bords du M'Bomou;
et que de purgatifs empruntés simplement à la pharmacopée
indigène !
L'huile de foie de morue produit un très bon effet sur les plaies,
particulièrement sur celles de grande surface, et les mouches et
moustiques ne s'approchent pas d'une plaie ainsi enduite.
Les feuilles du melalenca viridiflora, appelé niaouli en Nouvelle-Calédonie,
cay tram en Cochinchine et Annam du Sud, existant aussi à Madagascar,
donnent par distillation aqueuse l'essence de niaouli, balsamique et antiseptique
puissant, connu du public sous le nom de « Goménol ».
Le rendement en essence est de un demi à un pour cent du poids
des feuilles.
Cette essence, utilisée en solution dans l'eau bouillie à
la dose de deux pour mille, donne une solution antiseptique énergique,
amenant rapidement la cicatrisation des plaies. On peut aussi l'utiliser
en gargarismes et pour le lavage des fosses nasales en temps de grippe.
Certains guides médicaux sont indispensables.
Parmi les plus récents on peut indiquer :
Conseils d'hygiène aux coloniaux en partance pour l'Indochine;
prix 2 francs.
Conseils d'hygiène aux coloniaux partant pour la Côte d'Afrique;
prix 1 fr. 50.
Ces petites notices, écrites par le docteur Spire, sont imprimées
par la Dépêche Coloniale, 19, rue Saint-Georges, à
Paris (9e).
Elles contiennent d'excellents conseils médicaux et d'hygiène
sociale, ainsi que la composition d'une petite pharmacie particulière.
Le Guide de thérapeutique coloniale, du coût de 10 francs
(Editeurs J.-B. Baillière et fils, 19, rue Hautefeuille, Paris
(6e), par les docteurs Spire et Léger, ex-Directeur de l'Institut
Pasteur de Dakar, donne en 240 pages les indications les plus récentes
et les plus précises sur les affections particulières aux
colonies.
Notions d'hygiène et de médecine à l'usage des coloniaux,
par Henri Maurice, missionnaire apostolique (des R.P. du Saint-Esprit),
docteur ès-sciences; chargé de mission antipaludique par
le Ministère de la Guerre. — Vigot frères, éditeurs,
23, rue de l'Ecole-de-Médecine, Paris. Prix 10 francs. Est un des
bons livres du genre.
Décorations, Croix, Médailles, Rubans, Insignes. DlETS,
fabricant spécialiste, 26, rue Vivienne, Paris. Téléphone
: Central 37-42.
Fournisseur de tous les Groupements d'Anciens Coloniaux et des Coloniaux
en activité.
CONCLUSION
Les colonies offrent un champ immense à notre activité nationale
; elles ont pour l'avenir de grandes possibilités de mise en valeur
immédiate. Les exploitations, quelles qu'elles soient, bien dirigées
par des compétences techniques coloniales, disposant des capitaux
nécessaires, ont toujours eu et auront toujours la plus grande
chance de succès.
Hommes de toutes conditions sociales à la recherche d'une situation,
souvenez-vous que pour réussir aux colonies il faut une triple
sélection physique, morale et intellectuelle, car le vrai colonial
doit pouvoir faire face à tout et n'être jamais pris au dépourvu,
où que ce soit par le manque subit d'un collaborateur immédiat,
ou d'un spécialiste quelconque. En tout temps, et malgré
tout, la marche de l'affaire doit être assurée.
Ne partez pas aux colonies avant d'avoir accompli votre service ilitaire.
L'homme trop jeune résistera beaucoup moins bien. N'y débutez
pas non plus trop âgé; votre résistance physique serait
moindre et vous n'auriez plus la souplesse de caractère indispensable
pour vous assimiler le pays et ses habitants. Pour cela, l'âge de
quarante arts représente la limite maximum et il vaut mieux ne
pas dépasser trente ou trente-cinq ans.Aussitôt arrivé,
apprenez la langue du pays, c'est le seul moyen de bien connaître
l'indigène, d'arriver à comprendre son caractère
et à corriger ses défauts.
Partez célibataire ; quand vous aurez accompli un premier séjour,
vu, étudié la colonie et la vie que vous pourrez y mener,
vous aurez tout le temps nécessaire pour vous décider à
prendre femme ; vous saurez alors faciliter son acclimatement, et vous
ne donnerez pas le spectacle de jeunes ignorants sombrant mutuellement
dans une ridicule nostalgie.
sommaire
Les Expositions coloniales
De 1866 à 1948, on dénombre 35 expositions
coloniales en France et dans le monde.
Curieusement, les premières expositions eurent lieu en Australie
de 1866 à 1876.
La France attendra 1889 pour sa première exposition. On peut y
voir la Galerie des Machines (sa nef principale de 110 mètres de
large par 420 mètres de long, est la plus importante structure
métallique d'Europe, jusqu'à sa démolition en 1909),
lepalais des Beaux-Arts et des Arts libéraux sur le
Champ de Mars, le palais des Industries - le premier bâtiment à
utiliser l'électricité à grande échelle ...
est aussi présenté un « village nègre »
de 400 indigènes, qui constitue une des attractions de l'Exposition.
Il est situé dans une cité exotique édifiée
sur le Champ-de-Mars, avec un pavillon célébrant les colonies
et protectorats français. Par la suite, ces « zoos humains
» susciteront de violentes critiques .
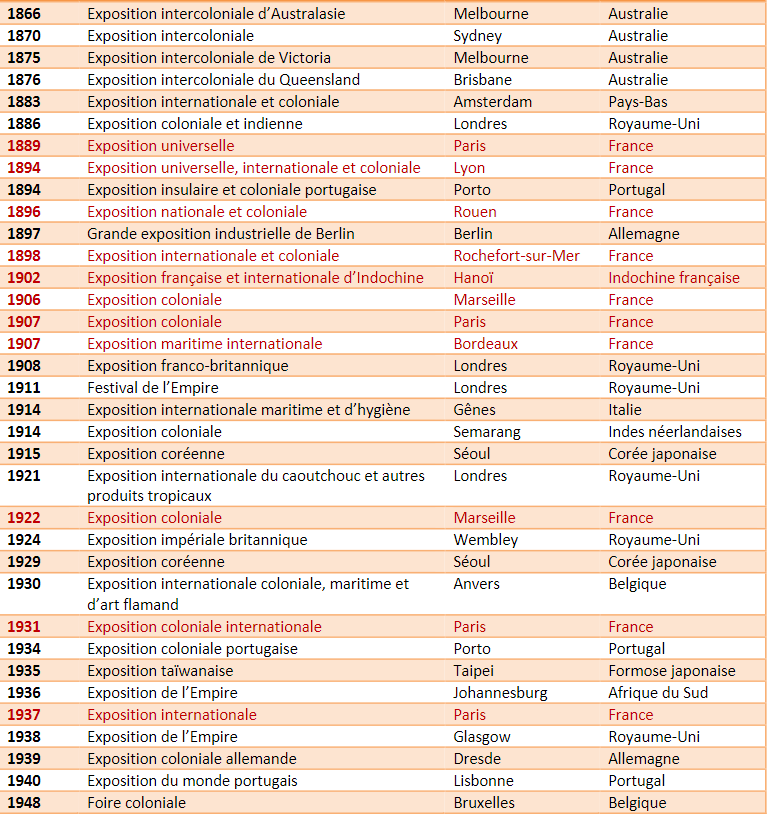
L'Exposition nationale et coloniale de Rouen est une exposition
nationale et coloniale ayant eu lieu à Rouen en 1896 .
Jules Adeline y présente une reconstitution du Vieux Rouen et Louis
Tinayre y présente un diorama de Madagascar.
L'une des attractions de l’exposition est le
« village nègre » — de Soudanais et de Sénégalais,
installé sur le Champ-de-Mars par le photographe Joannès
Barbier. « Tout ce monde de races si diverses et de pays si lointain
se trouve réuni autour d'un petit lac sur lequel flottent des pirogues
faites d'un seul tronc d'arbre et où, tout le jour durant, la multitude
des négrillons plonge à la recherche des "petits sous"
que leur jettent les visiteurs ».
600 000 visiteurs s'y précipitent. Parmi les visiteurs figurent
Jean Lorrain et Octave Uzanne.
Le pavillon normand de l'exposition a été
remonté en 1897 au 9 avenue du Général-Leclerc à
Déville-lès-Rouen.
Après un apogée au début des années
1930, l'exposition coloniale internationale de Paris en 1931 attirant
près d'une dizaine de millions de visiteurs pendant six mois, les
expositions coloniales s'éteignent avec la Seconde Guerre mondiale
et le mouvement de décolonisation.
l’Exposition coloniale Inaugurée le
6 mai 1931, se proposait de promouvoir l’empire français,
surnommé « la plus grande France », et, par extension,
l’ensemble des empires coloniaux européens.
"L’exposition aura atteint son but si, grâce à
elle, beaucoup de jeunes visiteurs sentent naître en eux la vocation
des colonies !"
Paul Reynaud, ministre des colonies.
 Affiche de l’Exposition coloniale, Victor Jean Desmeures
Affiche de l’Exposition coloniale, Victor Jean Desmeures
L’exposition du bois de Vincennes s’inscrivait
dans la tradition des expositions universelles et des expositions coloniales,
vouées à exalter la puissance technologique et civilisatrice
des pays européens et nord-américains. Consacrée
exclusivement aux colonies, elle fut présentée du mois de
mai au mois de novembre 1931, et accueillit près de 8 millions
de visiteurs pour 33 millions de billets vendus.
Le projet était ancien, puisque dès 1910 un député
avait déposé un projet en ce sens, repris après-guerre,
alors que Marseille développait aussi son propre projet, qui se
matérialisa par l’Exposition coloniale de 1922 dans la cité
phocéenne. Le projet parisien fut relancé en 1927 avec le
prestigieux maréchal Lyautey comme commissaire général.
Prenant la forme d’un immense spectacle populaire, véritable
ville dans la ville, l’exposition, longue de six kilomètres,
large de trois et demi, avec ses deux cents bâtiments représentants
les différentes colonies et territoires français et étrangers,
s’étendait sur 110 hectares. La ligne 8 du métro fut
prolongée pour l’occasion, avec la création de la station
« Porte Dorée ». Le Palais des Colonies, seul bâtiment
conçu pour perdurer à l’événement, constituait
le lieu central de l’exposition, présentant d’une part
l’histoire de l’empire français dans une section «
rétrospective », et d’autre part, dans une section de
« synthèse », ses territoires, les apports des colonies
à la France, ainsi que ceux de la France aux colonies.
Un petit train de ceinture permettait de faire rapidement le tour de l’exposition
: à commencer par la section étrangère avec les pavillons
portugais, les huttes congolaises de la Belgique, le temple javanais des
Hollandais, la basilique tripolitaine de l’Italie, la plantation
de Mount Vernon des États-Unis. Il manquait à l’appel
le Royaume-Uni, qui, malgré l’insistance de Lyautey, déclina
l’invitation (en acceptant seulement un stand dans la Cité
des informations). Le gouvernement britannique argua d’autres engagements
financiers, et de négociations en cours pour définir le
statut du Commonwealth. Le train poursuivait vers l’empire français,
présenté en majesté. La grande avenue était
bordée par les pavillons des « vieilles colonies »
(Antilles, Guyane, Réunion, Indes françaises, Océanie),
puis on débouchait sur le clou de l’exposition, à savoir
le temple d’Angkor, dont la flèche de la tour centrale pointait
à 55 mètres de hauteur. Le pavillon de l’Afrique occidentale
française (AOF), inspiré d’un palais fortifié
du Soudan français (ou de la mosquée de Djenné) était
un autre point de repère spectaculaire. Par contraste, le pavillon
de l’Afrique équatoriale française (AEF) était
bien plus modeste, comme s’il ne fallait pas trop insister sur certaines
de ses tragédies, à commencer par l’effroyable construction
de la ligne Congo-Océan à la même époque. Le
pavillon du Maroc, cher à Lyautey, était aussi un passage
obligé de l’exposition. Dans l’esprit d’un palais
de Marrakech, ce pavillon visait à présenter un «
Maroc moderne », un pays neuf, électrifié, à
la pointe du progrès.
Pour rendre l’événement vivant et attractif, des animations
étaient proposées aux visiteurs.
Les spectacles de danse constituaient l’une des attractions les plus
prisées. Dans chaque section, des habitants des colonies amenés
sur place donnaient vie à des villages reconstitués. Des
artisans travaillaient sous les yeux du public, d'autres tenaient des
stands de souvenirs. Bien que le parti pris de l’exposition de 1931
ne consistât plus exactement à recréer les «
zoos humains » tombés en désuétude, alors qu’ils
avaient été courants lors d’expositions coloniales
antérieures, il s’agissait, malgré tout, d’exhiber
des hommes et des femmes pour mieux affirmer le pouvoir de la France sur
ces derniers. Cela n’empêcha pas, au même moment, l’installation
d’un « village kanak » au Jardin d’Acclimatation
dans le bois de Boulogne, une initiative de la Fédération
française des anciens coloniaux, indépendante de l’Exposition
coloniale proprement dite - et qui fit scandale. Au Jardin d’Acclimatation,
les Kanaks furent humiliés par des rôles de cannibales qu’on
avait prévu pour eux, et plusieurs moururent de maladie en raison
des conditions sanitaires déplorables.
Les trois discours de l'Exposition colonial
Dans son ouvrage Le goût des autres.
De l'exposition coloniale aux arts premiers, l'anthropologue Benoît
de l'Estoile distingue trois formes de discours sur les sujets colonisés,
présentes simultanément dans l’exposition : l'une est
"évolutionniste", l'autre "primitiviste", la
dernière "différentialiste".
Dans le cas évolutionniste, la mission coloniale
se trouve justifiée par l'état de sauvagerie des indigènes
au moment de la conquête. Grâce à l'action bienfaisante
de la civilisation européenne, les Africains, en particulier, pourront
sortir de leur état d'enfance à vitesse accélérée,
et entrer dans l'histoire. Les évolutionnistes se fondaient comme
les autres sur une hiérarchie des races, mais l'inscrivaient dans
un schéma progressiste, au sens où les « races inférieures
» étaient susceptible d'évoluer favorablement sous
la houlette bienveillante des colonisateurs.
Le discours primitiviste insistait plutôt
sur les origines, qui se trouvaient valorisées par les "arts
primitifs", précieux témoignages de peuples restés
à l'aube de l'humanité, en dehors de l'histoire, en fusion
avec la nature. Ce discours était finalement l'héritier
lointain du mythe du "bon sauvage", situé en dehors de
la civilisation, et donc non perverti par elle, mais également
privé de ce qui fait l'homme, c'est-à-dire le changement
et l'expérience de l'histoire.
Quant au discours différentialiste, il célèbre
plutôt la diversité des cultures, et assigne à la
colonisation mission de la préserver. La question de la hiérarchie
raciale passe au second plan derrière la "différence",
mais elle n'est pas absente loin s'en faut. Le maréchal Lyautey
se situait plutôt dans la perspective différentialiste. Pour
lui, la colonisation devait maintenir les différences tout en les
surmontant dans un cadre politique commun, celui de l’empire français.
À l'intérieur du Palais de la Porte
Dorée, la fresque de Ducos de la Haille exprime tout à la
fois la perspective évolutionniste (on y voit les colonisateurs
apporter les bienfaits de la civilisation), la perspective primitiviste
(le monde colonial est dépeint comme un éden où les
humains vivent en communion avec la nature et les animaux) et la perspective
différentialiste (elle illustre la variété des cultures
d’un bout à l’autre de l’empire sur lequel «
le soleil ne se couche jamais » comme disaient les Britanniques).
La véritable situation coloniale était
passée sous silence.
Une chape de plomb recouvrait les violences coloniales, les crimes,
tout ce qui était commis au nom de la civilisation, et aussi les
situations ordinaires de domination et d’exploitation comme le travail
forcé. Rien non plus sur les résistances des colonisés
du passé et du présent de l’exposition, au moment pourtant
où des craquements insistants se faisaient entendre dans tous les
empires coloniaux. Rien, enfin, sur les changements subreptices qui se
faisaient jour dans le monde colonial, particulièrement dans les
villes, où des cultures nouvelles, y compris musicales, se frayaient
leur chemin en s’affranchissant du paternalisme pesant des maîtres.
Le caractère propagandiste de l’Exposition coloniale ne pouvait
pas comprendre ce qui relevait de la vie secrète, ou discrète,
des colonisés, leurs espaces à elles et eux, les mondes
de la nuit, les murmures et les chuchotements.
Les surréalistes étaient en pointe pour dénoncer l’exposition : « ne visitez pas l’exposition coloniale ! », tel était le mot d’ordre figurant dans un tract signé notamment d’Aragon, André Breton, René Char, Paul Éluard, tiré deux jours avant l’inauguration. Les surréalistes et leurs alliés communistes étaient les plus radicaux dans leur dénonciation, puisqu’elle critiquait le principe même de la colonisation, par contraste avec les socialistes, et même certains administrateurs coloniaux, qui en fustigeaient les excès. Bien des visiteurs de l’exposition la regardaient d’un œil critique, sans être dupes de la propagande coloniale. Ainsi d’un Senghor, qui terminait tout juste sa khâgne, qui arpenta très songeur les avenues du Bois de Vincennes.
À l’automne 1931, surréalistes et communistes mirent sur pied une contre-exposition intitulée “La vérité sur les colonies”, installée sur l’actuelle place du Colonel-Fabien — là où le siège du PCF est aujourd’hui situé. Cette contre-exposition fustigeait l’exposition officielle, mettait l’accent, au moyen de panneaux, sur les crimes de la colonisation et sur la situation économique précaire des colonies, qui n’étaient aucunement le « bouclier contre la crise » vanté par le gouvernement. Les luttes anticoloniales y étaient aussi à l’honneur, de l’Inde au Maroc en passant par le « lynchage des nègres » aux États-Unis. Une autre salle saluait la politique des nationalités de l’URSS, au moment même où Staline affermissait son pouvoir, menait une répression impitoyable contre les koulaks et affamait les Ukrainiens par millions. La contre-exposition n’attira que quelques milliers de visiteurs, bien loin des foules qui se pressaient Porte Dorée.