LE RELAIS TELEPHONIQUE
Relais et amplificateurs téléphoniques.
Différents moyens d’augmenter la portée des circuits
téléphoniques ont été indiqués aux
pages « Lignes aériennes » et «Lignes souterraines
».
Indépendamment de la pupinisation et du mode de construction
de Krarup * pour les cables, on envisagea d’autres moyens
et, en premier lieu, on pensa à augmenter l'intensité
des courants microphoniques, mais les charbons, en s’échauffant,
se dilataient et perdaient leur mobilité.
Cet inconvénient donna naissance à des microphones à
circulation d’eau.
* Carl Emil Krarup était un ingénieur télégraphique
danois, principalement connu pour l'invention d'un type de câble
chargé , appelé éponyme câble Krarup, qui
a amélioré la transmission des signaux téléphoniques,
en particulier sur les câbles sous-marins .
On peut citer, tout d’abord, le microphone hydraulique du Professeur
Majorana, susceptible de supporter des courants de plusieurs
ampères ;
|
1905 Le premier microphone hydraulique italien
a été conçu par le comte Quirio Majorana
de la Poste italienne. |
 |
Des résultats également satisfaisants furent obtenus avec le microphone Ericsson, dans lequel quatre électrodes creuses sont alimentées de liquide par un réservoir clos; un dispositif de cloisonnement permet de monter ces quatre éléments, soit tous en parallèle, soit en deux séries de deux éléments placées en parallèle.
Les deux premiers de ces microphones furent également employés pour des transmissions radioléléphoniques.
Le problème, qui avait donné naissance à tous ces instruments, devait nécessairement, par analogie, orienter les recherches vers une retransmission semblable à celle qu’on effectue sur les longues lignes télégraphiques.
L’idée d’un tel relais avait été formulée, dès 1878, par Du Moncel, mais, bien que Hughes, qui avait procédé à des expériences, ait déclaré les résultats satisfaisants, il semble que cette idée soit retombée dans l’oubli.
sommaire
1878 un travail intéressant nous a été
communiqué par MM. Elihu Houston et Edwin Thomson sur
un relais téléphonique basé sur l'emploi
du microphone. "Dès le mois de février 1878, j'avais
songé à ce problème, et voici ce que je disais
dans ma communication à l'Académie du 25 février
: Si les vibrations de la lame du téléphone récepteur
étaient semblables à celles du téléphone
transmetteur, il est facile de concevoir qu'en substituant au téléphone
récepteur un téléphone à la fois récepteur
et transmetteur ayant sa pile locale, ce dernier pourrait réagir
comme un relais, grâce à l'intermédiaire de la bobine
d'induction, et pourrait ainsi non-seulement amplifier les sons, mais
encore les transmettre à toute distance; mais il n'est pas prouvé
que les vibrations des deux lames en correspondance soient de la même
nature, et si les sons résultent de rétractions et dilatations
moléculaires, le problème serait beaucoup plus difficile
à résoudre".
Ce sont des expériences à tenter. Eh bien! ces expériences
ont été tentées avec succès par M. Hughes,
qui, ainsi qu'on l'a vu, est parvenu, grâce à la combinaison
du microphone au téléphone, à faire un relais téléphonique.
Le relais de MM. Houston et Thomson ne diffère de celui de M.
Hughes qu'en ce que le microphone, au lieu d'être placé
sur une planche de bois à côté du téléphone,
est fixé sur le diaphragme lui-même du téléphone
et se compose de trois microphones à charbons verticaux que l'on
peut associer en tension ou en quantité, suivant les conditions
de l'application. Le modèle de cet appareil est reproduit dans
la Telegraphic Journal du 15 août 1878, et nous y renvoyons le
lecteur qui voudrait avoir plus de renseignements à ce sujet.
D'un autre côté M. Hughes est parvenu à obtenir
un relais téléphonique par l'intermédiaire de deux
microphones à charbon vertical.
En plaçant sur une planchette deux microphones de ce genre, et
reliant l'un de ces microphones à un troisième servant
de transmetteur, alors que le second est mis en rapport avec un téléphone
et une seconde pile, on entend dans le téléphone les paroles
prononcées devant le microphone transmetteur sans que le relais
téléphonique mette à contribution aucun organe
électro-magnétique.
On peut encore obtenir la reproduction de la parole au moyen d'un microphone,
en fixant sur la même planche que ce microphone un aimant en fer
à cheval entre les pôles duquel est adapté un noyau
de fer doux recouvert de la bobine magnétisante. C'est encore
un système de relais téléphonique qui fonctionne
sans diaphragme électro-magnétique.
M. Ader, de son côté,
vient d'exécuter un modèle de téléphone
qui a aussi son mérite. Le récepteur n'est autre chose
qu'un électro-aimant ordinaire à deux branches, dont l'armature
est soutenue à deux millimètres environ de ses pôles,
par une lame de verre à laquelle elle est collée, et qui
elle-même est fixée à deux supports rigides. Pour
entendre, il suffit de l'appliquer contre l'oreille. Le transmetteur
est une tige mobile de fer ou de charbon qui appuie sur un morceau de
charbon fixe, sans autre pression que son poids, et qui porte une plaque
concave devant laquelle on parle. Ces deux pièces sont disposées
de manière à se mouvoir horizontalement, de sorte que,
quand l'appareil est suspendu, le circuit est forcément disjoint
par ce seul fait, alors qu'il se trouve fermé au moment où
on prend l'appareil pour parler. La parole est très-bien reproduite
avec ce système qui, exécuté dans de plus grandes
dimensions, peut transmettre la parole à une certaine distance.
sommaire
Le Directeur des ateliers de construction des télégraphes
du Brésil M. Bernard Enzmann a dernièrement cherché
une autre solution pour laquelle il a pris des brevets dans plusieurs
pays au commencement de 1888.
Pour plus de détais sur l’emploi de ces diagrammes, consulter
l’ouvrage de M. Blakesley. On Altèrnating currents of
Ehctricity.
Le système d’Enzmann est analogue au système d’exploitation
télégraphique par courant de travail. L’inventeur
emploie des émissions plus ou moins longues de courants alternatifs
rapides; chaque émission de courant comprend un nombre plus ou
moins grand d’ondulations, suivant qu’elle correspond a un
trait ou à un point.
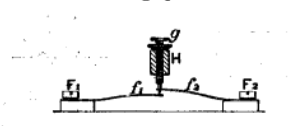 Fig 1
Fig 1
Au bureau transmetteur M. Enzmann se sert d’un manipulateur spécial
(fig 1) pourvu d’un dispositif qui sert à interrompre automatiquement
le courant primaire. Au bureau récepteur les courants alternatifs
traversent les bobines d’un relais téléphonique dont
la membrane enregistre les signaux dans un appareil spécial.
Le relais téléphonique peut naturellement être employé
avec un appareil enregistreur quelconque ou bien donner des signaux
Morse sonores ; la durée de ces derniers est réglée
par la durée de l'émission des courants alternatifs; elle
est courte pour un point, et plus longue pour un trait de l’alphabet
Morse.
M. Enzmann a pu réaliser une économie considérable
dans les frais de piles, car le courant qu’elles fournissent ne
circule pas sur la ligne télégraphique, mais dans un circuit
local seulement. Les piles sont d’ailleurs utilisées alternativement
pour la transmission et la réception; dans le premier cas, elles
fournissent le courant primaire pour la bobine d’induction et dans
le second elles ne servent que pour l’appareil local Morse. Cette
utilisation double d’une même batterie est réalisée
au moyen d’un simple commutateur.
Avec une batterie composée de 2 à 8 grands éléments
Meidinger, on peut produire un courant qui, grâce à la
sensibilité du relais téléphonique, donne de très
bons signaux Morse sur une ligne d’une résistance de 1003300
ohms; on peut aussi tourner, mettre des aiguilles magnétiques
en mouvement, etc.
La sensibilité du relais téléphonique permet également
d’éviter l’emploi de relais de translation, car on
pourra télégraphier directement même à de
grandes distances.
L’installation des bureaux Morse serait fort simplifiée
si chaque bureau réservait une ligne déterminée
exclusivement à la transmission ou la réception. Comme
les deux opérations ne sont pas simultanées, et comme
les signaux émis par je poste expéditeur doivent être
rendus visibles au poste récepteur, l’installation devient
un peu plus compliquée.
La clef d’induction doit donc satisfaire aux deux conditions suivantes
: à l’état de repos, elle doit intercaler le relais
téléphonique dans la ligne télégraphique,
mais en abaissant ce levier, ce relais doit être mis hors circuit
en même temps que la bobine secondaire de l’inducteur doit
être intercalée; d’autre part, le levier abaissé
doit fermer le circuit de la pile à travers la bobine primaire
de l’inducteur pour permettre la production des courants d’induction.
Une clef ordinaire suffit pour la solution du premier problème.
II suffit de la munir d’un levier H (fig. 1 et 2) en laiton mobile
sur une pièce m, elle est attirée contre le contact de
repos c par un ressort et vient se placer sur le contact a quand on
l’abaisse.
Les deux ressorts et f1 f2 vissés sur la planchette servent à
fermer le circuit de la pile P pendant la transmission; /j est un peu
plus élevé que f2 et se trouve sous une vis g qui entre
dans le levier dela clef et dont l’extrémité inférieure
est pourvue d’une pointe isolée.
Quand le levier H est abaissé il établit lé contact
entre f2 et f1 et ferme ainsi la pile P; ensuite H rencontre a et ferme
ainsi le circuit pour les courants alternatifs. Il va sans dire que
les deux clôtures doivent se suivre rapidement, sans quoi il ne
pourrait pas entrer dans la ligne L un nombre considérable de
courants alternatifs produits par l’inducteur.
La bobine d’induction J ne présente rien de particulier.
L’interruption du courant s’effectue de la manière
ordinaire par Un marteau de Wagner.
Le relais téléphonique R est représenté
en coupe et en plan sur les figures 3 et 4. Sur la paroi de derrière
se trouve un aimant S en fër à cheval, fixé au moyen
de la vis B et sur lequel le noyau de l’électro-aimant M
est monté. Devant les pôles de ce dernier, une plaque en
fer Q est disposée de manière à entrer en vibration
quand les bobines de M sont parcourues par des courants alternatifs.
Sur le côté extérieur du cadre se trouve encore
un petit bras s formant un angle et tournant facilement autour de son
axe. L’extrémité de ce bras s repose sur la plaque
Q et oscille avec celle-ci. Le contact entre s et q peut être
réglé à volonté au moyen de la petite vis
q pourvu d'un écrou. Le contact est naturellement moins intime
pendant les vibrations qu’à l’état de repos,
par conséquent, un courant électrique traversant s et
q sera beaucoup affaibli pendant les vibrations de la plaque Q, c’est-à-dire
pendant la transmission d'une série de coulants alternatifs.
Tous les points de contact sont platinés.
En dehors de ces appareils et de l’appareil Morse X, chaque bureau
est pourvu de deux bandes de laiton s munies de 3 bornes pour y fixer
les fils de communication et d’un commutateur U dont le bras repose
sur g pendant la transmission d’une dépêché
et sur N pendant la réception.
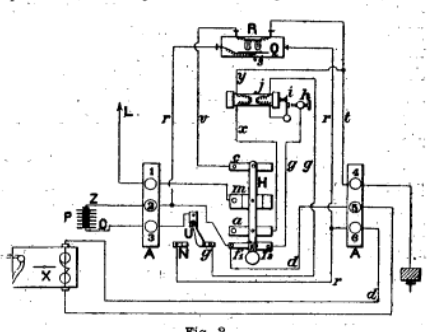 Fig 2
Fig 2 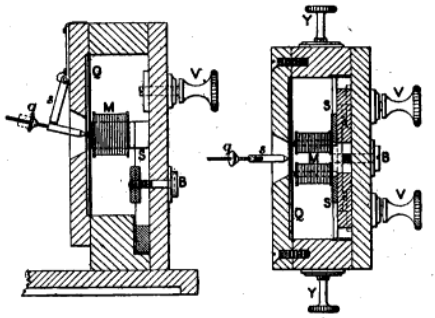 Fig 3 et 4
Fig 3 et 4
La communication entre les appareils est représentée sur
la figure 2 où l’on voit facilement que l’inventeur
a intercalé l’appareil Morse M dans le circuit dd et établi
une dérivation rr dans laquelle le levier s et la plaque Q du
relai se trouvent. L’intensité du courant en dd augmente
par conséquent, et c’est ce qui fait écrire l’appareil
X aussi longtemps que la membrane du relais vibre.
La transmission télégraphique se fait maintenant de la
manière suivante :
Dans le bureau transmetteur, le bras du commutateur u est sur g. Si
le levier H est au repos la pile est ouverte puisque f2 et f1 ne se
touchent pas ; un chemin est ouvert de la ligne L par 1, m et c à
travers les bobines du relais R et par t et 4 à la terre T.
Si le levier H est abaissé, il ferme le circuit de la pile P
du pôle positif C passant par 3, u, g, la bobine primaire de l’inducteur
J et par son interrupteur automatique i, b, par g, f2, f1 et au pôle
négatif et l’interrupteurautomatique commence à fonctionner;
mais, dès que le levier H.arrive sur le contact a, l’inducteur
J émet des courants alternatifs passant d’un côté
par x, a, m. et t dans la ligne L et d’un autre côté
par y, t et 4 à la terre T. L’envoi des courants alternatifs
dure aussi longtemps que H reste en contact avec a.
Comme le bras u du bureau récepteur repose sur N la pile P émet
constamment un courant local en partie par dd et z et en partie par
n, q, s, r. Quand les courants alternatifs arrivent à ce bureau
ils vont de L par 1, m,t et v dans les bobines du relais R et continuent
ensuite par t et 4 jusqu’à la terre, alors l’électro-aimant
M fait vibrer la plaque Q et diminue ainsi le contact entre s et q ;
le eourant passant par l’appareil Morse X se trouve par suite considérablement
renforcé et l’appareil trace un trait ininterrompu tant
que dure la série des courants alternatifs, c’est-à-dire
tant que H reste abaissé au bureau de transmission.
Mais on peut aussi laisser u sur g dans le bureau récepteur.
Dans ce cas l’appareil X ne peut naturellement pas fonctionner
; par contre le relais R fonctionnera comme un parleur et les sons émis
sont de la même durée que les émissions de courants
alternatifs par conséquent R donne pour un abaissement momentané
de la clef au bureau de transmission un son bref correspondant au point
dans l'alphabet Morse et pour un abaissement prolongé un son
plus soutenu correspondant au trait de sorte que les signaux composés
par ces différents sons sont aussi facilement perceptibles que
ceux qui sont écrits sur une bande de papier; la lecture par
l’oreille exigera certainement moins de peine et moins d’attention
soutenue que loisque le commencement et la fin de chaque signal sont
indiqués par un bruit dans la plaque téléphonique.
Rappelons pour terminer comment on s’est efforcé, par d’autres
moyens plus ou moins parfaits, d’arriver à des résultats
analogues au moyen d’un téléphone ou d’un corps
vibrant.
Il faut d’abord mentionner le téléphone harmonique
du Pr. Elisha Gray de Chicago qui a réalisé
la télégraphie multiple
au moyen de diapasons réglés à un son déterminé,
L’appareil fonctionnne avec des courants de pile d’une même
direction. qui sont décomposés en impulsions rapides au
moyen de vibrateurs. (C’est le dispositif imaginé par
Sieur et employé dans l’appel phonique de van
Rysselberghe. N. D. L. R)
Les relais employés par Gray ressemblent au point de vue de leur
fonctionnement électrique aux relais téléphoniques
d’Enzmann, mais Gray a recours à des communications locales
très compliquées avec deux circuits locaux pour empêcher
le payeur de donner de faux signaux.
Le capitaine Zigang a «introduit dans
sa trompette électrique un parleur pour la télégraphie
militaire qui produit les signaux Morse de la même manière
que le relais téléphonique d’Enzmann par des sons
plus ou moins longs; mais Zigang télégraphie simplement
avec des courants de travail et ne donne qu’à son récepteur
un dispositif permettant l’interruption automatique des courants
télégraphiques longs et courts.
Déjà un peu avant MM. Edison,
Smith et Gilliland avaient imaginé
un système télégraphique permettant de communiquer
entre un train en marche et les gares.
Les signaux Morse sont également reproduits dans un téléphone
par des sons plus ou moins longs, les courants alternatifs sont communiqués
à la ligne et au téléphone par l’induction
statique au moyen de charges et de décharges de condensateurs
; ces derniers étaient d’abord chargés d’électricité
alternativement positive et négative par les courants induits
dans la bobine secondaire d’un inducteur voltaïque.
On travaille avec le courant de repos ce qui rend la lecture des signaux
plus difficile parce que les sons émis par le téléphone
ne représentent pas les signaux même mais seulement les
intervalles qui les séparent.
Plus tard Edisson s’est également servi du téléphone
dans son phonoplex pour la reproduction
des signaux Morse mais chaque signal est ici idiqué par un bruit
au commencement et à la fin. Chaque bruit correspond d’ailleurs
à l’émission de deux courants d’induction, un
courant d’ouverture puissant et un courant de fermeture plus faible,
le système a donc une certaine analogie avec celui de Varley
dont nous avons parlé plus haut.
Comme on le sait, le phonoplex était au commencement un duplex
car, comme dans le système van Rysselberghe, les courants destinés
à produire les signaux soit sur un relais soit sur un parleur
étaient amortis par un graduateur pour ne pas agir sur le téléphone,
la bobine du graduateur et une clèf de Morse étaient en
même temps placés dans un circuit local afin d’envoyer
les courants d’induction sur la ligne pour chaque fermeture et
interruption du courant local.
L’abaissement de la clef provoquait d’abord l’interruption
du courant local, mais immédiatement après quand le levier
de la clef arrivait sur le contact de travail il était de nouveau
fermé par l’introduction d’une résistance assez
considérable; quand la clef se relevait, cette dernière
fermeture prenait fin et la première était rétablie
sans la résistance, chaque mouvement de la clef donnait donc
lieu à l’émission d’un onde d’extra-courant.
Edison a plus tard développé son phonoplex en un triplex
en intercalant dans le circuit local d’un deuxième graduateur,
un intercepteur téléphonique automatique analogue à
la trompette de Zigang, ce qui permettait, par l’abaissement de
la clef, d’euvoyer une série de paires d’extra courants
de puissance égale.
L’électrophone ou le phonopore,
de M. Charles Langdon-Davies, présente aussi une certaine analogie
extérieure avec le dispositif de M. Enzmann. Le but de M. Langdon-Davies
est également d’utiliser simultanément la même
ligne pour la télégraphie ordinaire et la téléphonie.
Le phonopore construit en forme de bobine ressemble exactement a une
bobine d’induction ordinaire ; il a également une bobine
primaire, mais au lieu de la bobine secondaire de l’inducteur le
phonopore est muni d’une bobine composée de deux fils isolés
et très longs qui tous les deux sont isolés à un
bout tandis que les deux autres bouts sont reliés par l’appareil
télégraphique ordinaire avec la ligne. Le phonopore est
donc un condensateur et comme tel il peut amener les courants téléphoniques
alternatifs envoyés dans la ligne à un relais spécial
intercalé dans l’un des fils où il les fait agir.
Ce relais actionne un appareil Morse ou parleur, mais d’une manière
presque identique et aussi compliquée que chez Gray, au moyen
de deux circuits locaux et d’un électro-aimant. Le transmetteur
est une clef Morse comprise dans le circuit delà bobine primaire
qui, à l’aide d’un interrupteur automatique sur le
phonopore, envoie une série rapide de courants à travers
la bobine primaire dès que son levier est abaissé, de
sorte que cette bobine agit de nouveau avec les deux autres enroulements
comme un condensateur et la ligne est par conséquent parcourue
par une série de courants alternatifs.
Les téléphones et les appareils analogues sont employés
déjà depuis longtemps pour donner des signaux d’appel.
Il est inutile de rappeler les nombreux appareils de ce genre qui ont
été construits.
Le capitaine Cardew a donné, dans une Conférence,
devant la « Society Tetegraph Enginens, tous les détails
des nombreux essais entrepris dans le but d’utiliser le téléphone
comme récepteur pour la télégraphie
militaire. Lui aussi s’est efforcé de remplacer les
bruits secs dans la plaque téléphonique par des sons plus
ou moins longs et produits par des émissions de courants d’une
durée égale à celle du signal. Ces séries
de courants étaient envoyées par des interrupteurs automatiques
(parleurs de Theiler). L’interrupteur était en partie
compris dans un circuit local formant pour la pile une dérivation
à la ligne télégraphique.
Nous pouvons enfin mentionner les expériences communiquées
à l’Académie des Sciences, par M. Ader,
en 1888.
Ader propose de reproduire les signaux Morse, pour la télégraphie
sous-marine dans un téléphone.
En télégraphiant avec des courant de deux directions il
veut obtenir des sons plus forts et de longueur égale, mais dans
deux téléphones différents, dans l’un appliqué
à l’oreille gauche on n’entendra que les signaux donnés
par des courants positifs tandis que l’oreille droite ne perçoit
que ceux donnés par des courants négatifs. (c'est notre
créateur de la stéréo)
Dans les deux cas on se sert d’un interrupteur automatique et dans
le dernier encore de piles locales qui sont augmentées ou diminuées
selon les uns des couranrs télégraphiques.
C’est ainsi qu’en 1899, la Telegraph
and Téléphone Co offrait une prime d’un million de
dollars à l’inventeur d’un relais téléphonique
analogue au relais télégraphique .
Le principe commun à tous les relais, qui furent tout d’abord
imaginés, est le suivant :
la membrane d’un récepteur est rendue solidaire de la plaque
d’un microphone, à laquelle elle communique tous ses mouvements;
on a ainsi une reproduction du courant d’arrivée, mais la
fidélité plus ou moins grande de celle-ci dépend
essentiellement de la construction de l’appareil, car la membrane
réceptrice, dont le rôle ordinaire est de déplacer
seulement des couches d'air, doit ici entraîner un ensemble doué
d’inertie et engendrant des frottements, d’où une altération
dans la retransmission.
Les divers systèmes se distinguent précisément
par les moyens employés pour tourner cette difficulté.
En 1910, S. G. Brown construisit un relais, dans lequel le microphone
est constitué par une petite pointe de platine s’appuyant
sur une lame de même métal, portée par la piembrane
du récepteur; les vibrations de celte membrane, sous l’action
des courants téléphoniques, provoquent de petites coupures
du circuit microphonique; la résistance de cet intervalle varie
dans de très grandes proportions pour des changements très
faibles de l’écartement des électrodes, de sorte
que des coupures de l’ordre d’une fraction de micron suffisent
pour le fonctionnement de ce relais. Deux ans plus tard, l’inventeur
remplaça ce dispositif par un microphone à granules de
charbon; des essais, effectués entre Londres et Berlin, donnèrent
de très bons résultats.
Nous relevons dans la Zeitschrift fur Fermechanik, les détails
suivants sur un relais téléphonique construit par M. S.
G. Brown.
Le problème du relais téléphonique n'a pas encore
reçu une solution parfaite.
Le renforcement des très faibles courants transmissifs de la
parole parvenant à l'extrémité d'une ligne n'a
pu être encore obtenu avec un degré suffisant d'exactitude
de manière que ces courants renforcés puissent être
acheminés sur une seconde ligne. Pourtant M. G. Brown est arrivé
à un résultat important et pratique.
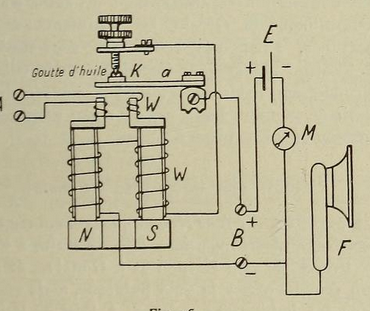 Le dispositif
employé est représenté sur cette figure.
Le dispositif
employé est représenté sur cette figure.
Les courants d'arrivée sont amenés, par les bornes A d'un
enroulement W en fil fin, enroulement dont les nombreuses spires se
trouvent disposées sur les épanouissements polaires d'un
aimant permanent.
Sur les branches de cet aimant glissent les tubes sur lesquels on a
enroulé quelques spires d'un gros fil W du circuit local. Les
courants parasites
prenant naissance dans les tubes en cuivre doivent compenser l'effet
magnétique des courants renforcés du circuit local. Avec
l'enroulement W
se trouve monté en série, outre la batterie locale E,
le récepteur téléphonique F et le contact microphonique
K. La petite lame de contact disposée sur l'armature a, large
d'environ 10 mm, est formée de platine iridié ainsi que
la pointe de la vis de réglage. Cette vis de réglage est
disposée de manière que l'armature a commence à
osciller exactement comme un interrupteur à marteau.
Alors on fait tomber sur le point de contact une goutte d'huile. Dès
ce moment, l'armature cesse d'osciller et le relais se trouve réglé
pour le renforcement des courants. Les effets magnétiques excessivement
faibles des courants transmissifs de la parole en W donnent lieu à
des mouvements très minimes de l'armature, ce qui occasionne
de fortes oscillations de l'intensité du courant du circuit local.
Le contact K doit alors se trouver complètement protégé
contre les ébranlements extérieurs. Le réglage
délicat du contact, nécessaire dans la pratique, constitue
le principal point faible de tout l'appareil, car ce réglage
peut se modifier très vite et très rapidement.
Le relais Erdmann, dans lequel les vibrations
de la membrane réceptrice sont transmises à la membrane
microphonique par une colonne gazeuse en mouvement; Une soupape, en
s’ouvrant plus ou moins sous l’influence de l’électro-aimanl
récepteur, fait varier la pression dans un tube où circule
le gaz, et cette variation agit à son tour sur la membrane du
microphone.
Les relais de ce genre présentaient l’inconvénient
de ne pouvoir fonctionner que dans un seul sens; on pensa tout d’abord
à duplexer la ligne, mais on éprouva de grandes difficultés
à maintenir un bon équilibre, par suite, notamment, des
variations de la résistance d’isolement; dans les expériences
relatées ci-dessus, Brown fit usage d’un commutateur automatique
extrêmement sensible, pour intervertir les connexions suivant
le sens des courants téléphoniques reçus.
Ce mode de permutation était assez délicat, et l’on
chercha à rendre la conversation bi-latérale en faisant
usage de deux relais et en mettant sur chaque branche de la ligne le
récepteur de l’un et le transmetteur de l’autre, suivant
un montage tel que celui de la ligure suivante :
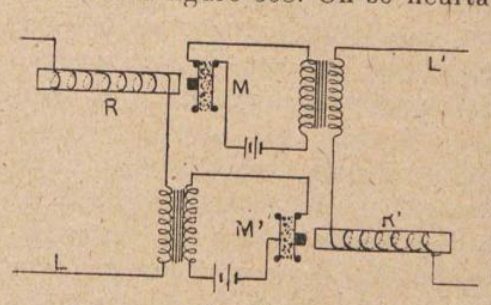
On se heurta alors à des phénomènes de résonance,
qu’on caractérise en disant que les relais forment «
ronfleur » : en effet, si la membrane de l’un des microphones
vient à recevoir une impulsion accidentelle, les courants induits,
qui en résultent, vont se fermer sur la seconde ligne en traversant
le second récepteur; celui-ci, à son tour, réagit
sur son propre microphone, qui induit des courants dans le premier récepteur,
et ainsi de suite, de telle sorte que la vibration est indéfiniment
entretenue.
Pour remédier à cet inconvénient, Edison, en
1912, réalisa le montage en différentiel, représenté
par la figure suivante :
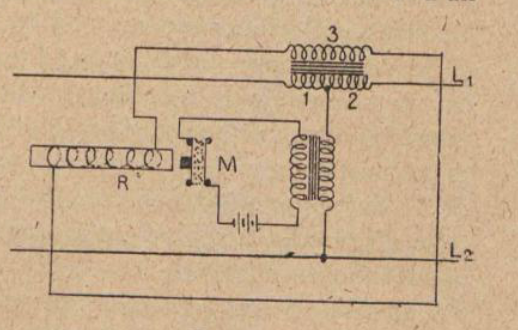 Les courants
de la ligne passent dans les enroulements 1 et 2 d’un transformateur
différentiel; ceux qu’ils induisent dans l’enroulement
3 se rendent dans le récepteur de l’unique relais et agissent
sur le microphone: celui-ci induit à son tour de nouveaux courants,
qui, par son secondaire, en dérivation entre 1 et 2, se partagent
en parties égales sur les deux côtés de la ligne,
si les impédances au départ sont convenablement équilibrées,
mais leur action sur l’enroulement 3 est nulle.
Les courants
de la ligne passent dans les enroulements 1 et 2 d’un transformateur
différentiel; ceux qu’ils induisent dans l’enroulement
3 se rendent dans le récepteur de l’unique relais et agissent
sur le microphone: celui-ci induit à son tour de nouveaux courants,
qui, par son secondaire, en dérivation entre 1 et 2, se partagent
en parties égales sur les deux côtés de la ligne,
si les impédances au départ sont convenablement équilibrées,
mais leur action sur l’enroulement 3 est nulle.
La Western Electric Co obtint un résultat analogue par
le montage en pont de Wheatstone indiqué ci-après :
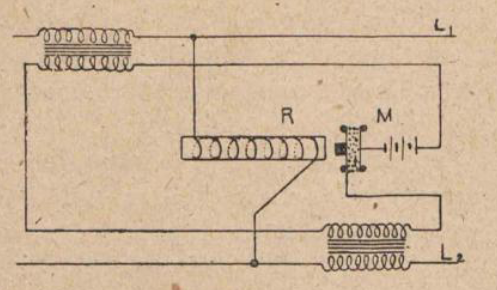 Le récepteur
est en dérivation sur les deux fils de ligne; le microphone agit
dans les primaires de deux bobines dont les secondaires sont en série
sur les fils de ligne, de part et d’autre de la dérivation
: si les impédances sont égales sur les deux branches,
les courants transmis ne peuvent pas passer par la dérivation.
Le récepteur
est en dérivation sur les deux fils de ligne; le microphone agit
dans les primaires de deux bobines dont les secondaires sont en série
sur les fils de ligne, de part et d’autre de la dérivation
: si les impédances sont égales sur les deux branches,
les courants transmis ne peuvent pas passer par la dérivation.
Deux inventions survinrent en téléphonie, qui sont à
considérer comme de grandes conquêtes de la technique moderne:
la bobine Pupin (1899)
et la lampe amplificatrice de de Forest (1906), dont l'utilisation
pratique ne fut pas immédiate.
La question des relais téléphoniques entra dans une phase
nouvelle lorsqu’on pensa à utiliser, pour cet usage, les
tubes à gaz ionisé; en effet, on obtenait,
de la sorte, un retransmetteur absolument dépourvu de toute inertie
mécanique, et on devait arriver à une reproduction beaucoup
plus fidèle de la parole transmise.
Fleming le 16 novembre 1904, breveta le tube redresseur à
deux électrodes, qu'il appela grille oscillatrice.
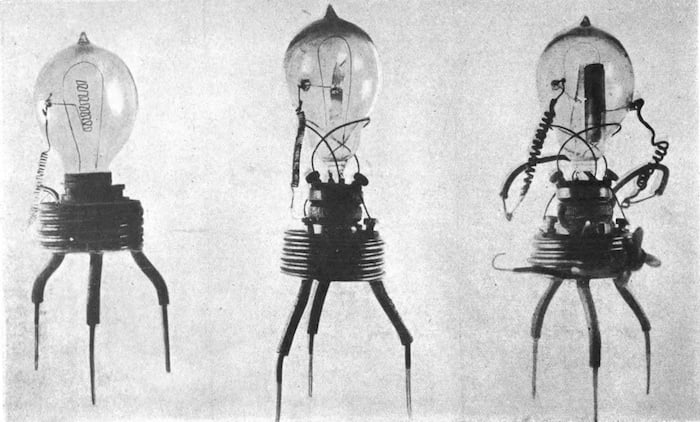 Valve Fleming
Valve Fleming
Puis en 1906 en insérant une grille entre l’anode
et la cathode d'une lampe diode, l'Américain Lee De Forest
invente la première triode nommée Audion
: un tube à vide capable de provoquer l’amplification d’un
signal électrique.
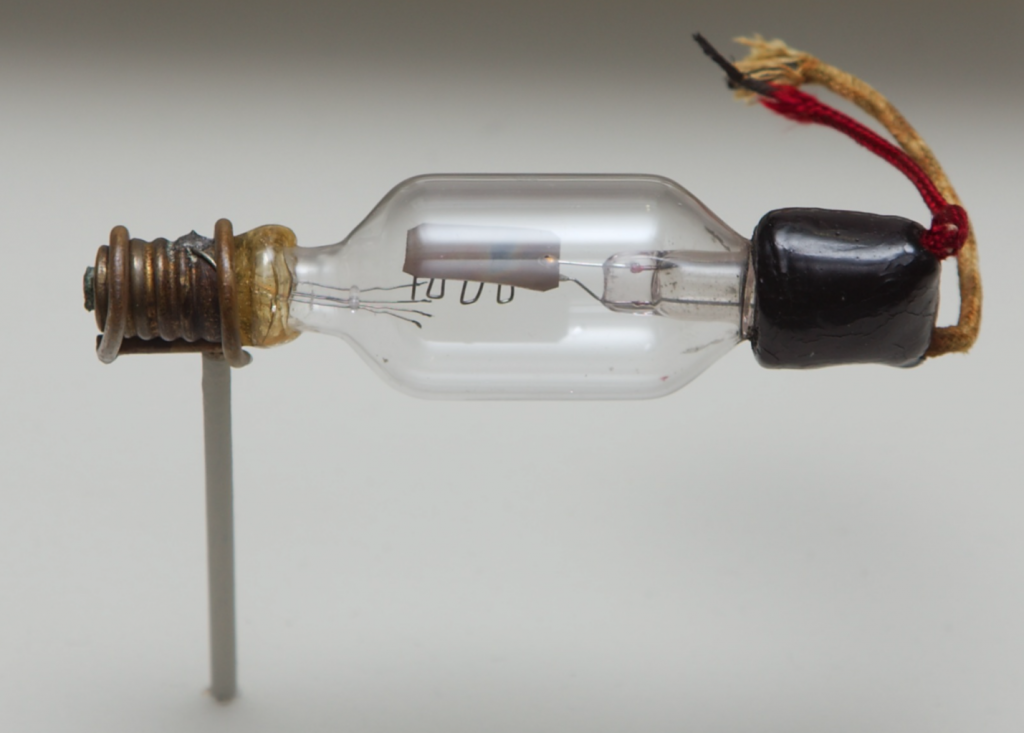 Audion ou Triode |
L'audion consistait
en un tube de verre sous vide contenant trois électrodes :
un filament chauffé, une grille et une plaque. Il est important
dans l'histoire de la technologie car il a été le
premier appareil électronique largement utilisé capable
d'amplifier ; un petit signal électrique appliqué
à la grille pourrait contrôler un courant plus important
circulant du filament à la plaque. La triode Audion d'origine avait plus de gaz résiduel dans le tube que les versions ultérieures et les tubes à vide; le gaz résiduel supplémentaire limitait la plage dynamique et donnait à l'Audion des caractéristiques non linéaires et des performances erratiques. Développé à l'origine comme détecteur de récepteur radio hors site en ajoutant une électrode de grille à la valve Fleming, il a trouvé peu d'utilisation jusqu'à ce que sa capacité d'amplification soit reconnue vers 1912 par plusieurs chercheurs, qui l'ont utilisé pour construire les premiers récepteurs radio amplificateurs et oscillateurs électroniques Les nombreuses applications pratiques pour l'amplification a motivé son développement rapide, et l'Audion original a été remplacé en quelques années par des versions améliorées avec un vide plus élevé. |
Dès 1911, Cooper Hewitt démontra,
à l'aide d’un tube à vapeur de mercure, que, si l’on
enlève le diaphragme d’un récepteur téléphonique
et si on maintient l’électro-aimant à proximité
du tube à gaz ionisé, on peut amener l’espace occupé
par ce gaz à subir des variations de résistance correspondantes
aux ondes sonores, et former ainsi une sorte de transmetteur téléphonique
; un peu plus tard, de Forest a fait la môme démonstration
en employant son récepteur radio-télégraphique
connu sous le nom de audion.
En 1912, Lieben-Reisz construisit un relais dans lequel l’amplification
du courant téléphonique s’obtient en faisant passer
le courant reçu entre deux électrodes placées dans
un tube à vapeur de mercure. Un courant de haute tension passe
dans le tube, entre l’une de ces électrodes et une électrode
auxiliaire, et subit des variations correspondantes à celles
des courants téléphoniques; en connectant deux ou plusieurs
relais semblables en série, on multiplie les effets et, en employant
des transformateurs convenablement construits, on peut relier des circuits
de longueurs inégales et de caractéristiques différentes
vent proposés; les meilleurs résultats furent obtenus
à l’aide de la lampe-valve à trois électrodes,
modification de la valve de Fleming, à laquelle on a adjoint
une électrode supplémentaire, appelée couramment
grille; on trouvera plus loin la description et le fonctionnement de
cette lampe.
Il existe un grand nombre de montages, permettant tous la conversation
dans les deux sens et évitant l’amorçage des oscillations
entretenues, susceptibles de produire un ronflement ou un sifflement
continus, dans les cas où les impédances des deux lignes
raccordées sont inégales.
Tous ces montages peuvent se classer en deux catégories générales
: ceux qui comportent des dispositifs différentiels, avec ou
sans capacités et résistances de compensation; et ceux
qui réalisent l’équilibre à l’aide de
lignes artificielles.
On désigne couramment sous le nom de relais téléphonique
embroché, celui qu’on intercale, d’une façon
permanente, sur un circuit déterminé; le relais téléphonique
d'intercommunication est celui qu’on place sur les cordons des
tableaux téléphoniques, en vue d’améliorer
les communications entre deux circuits quelconques.
sommaire
1917 Le Relais téléphonique embroché, à
transmission d’appels
Installé à Lyon, en 1917, sur le circuit Paris-Marseille
n° 3, en fil de cuivre de 3 mm.5; l’audition est équivalente
à celle qu’on obtient sur deux autres circuits Paris-Marseille,
qui sont en fil de cuivre de 5 millimètres.
L’emploi de relais permet donc de réaliser des économies
considérables sur le prix d’établissement des circuits.
— Ce relais a été construit par le Service d’Etudes
et de Recherches Techniques de l’Administration, à l’aide
d’appareils établis par M. Marius Latour. Il comprend
un amplificateur à deux étages, formé de deux lampes-valves
montées en série, à la partie supérieure
du meuble, et dont les filaments sont alimentés par une batterie,
b, de 6 volts, à travers un rhéostat, placé entre
les deux lampes.
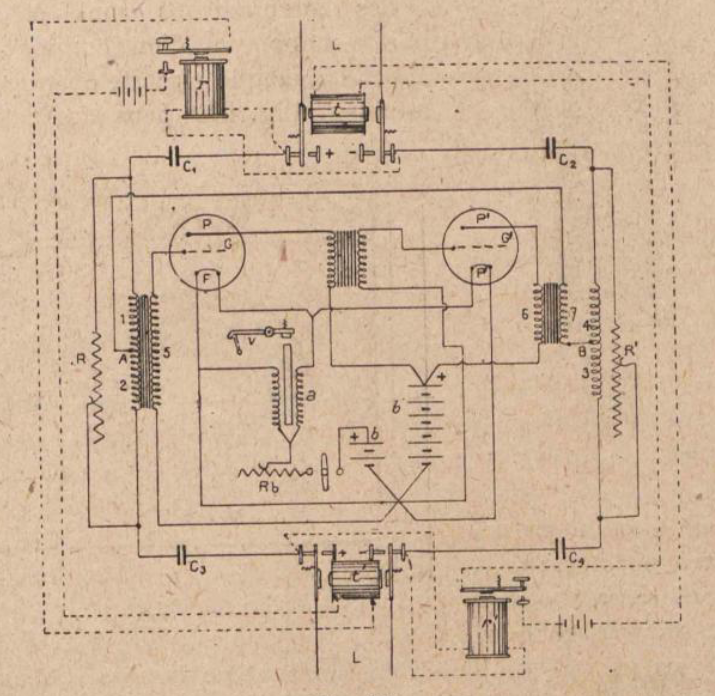
Les deux plaques, P et P', sont portées à un potentiel
positif par une batterie, b', dont la tension peut varier entre 50 et
100 volts, suivant l’isolement de la ligne. Le fonctionnement est
le suivant :
Les enroulements 1, 2, 3, 4 et 5 constituent un seul et même transformateur;
les courants de conversation, arrivant par la ligne, L, ou par L', parcourent
les enroulements 1, 2, 3 et 4; ils sont reproduits, par induction, dans
l’amplificateur par la grille, G, de la lampe de gauche et en sortent,
après amplification, par la lampe de droite et l’enroulement
6 ; ils gagnent la ligne par l’enroulement 7, placé en dérivation
sur le circuit, entre les.points A et B, c'est-à-dire au milieu
des enroulements 1 et 2 d’une part, 3 et 4 d’autre part; deux
résistances de compensation, R et R', shuntant les divers enroulements
du transformateur 1, 2, 3, 4, 5, permettent d’atténuer les
effets du déséquilibre des impédances entre les
deux côtés delà ligne; on les règle à
l’aide de deux manettes placées à l’avant,du
meuble, de telle sorte que, si les impédances des deux sections
deviennent inégales, une partie du courant passe par les résistances
de compensation qui, en diminuant ainsi l’amplification, empêchent
l’auto-excitation du relais. On a là, en réalité,
un montage différentiel, dérivé de celui d’Edison.
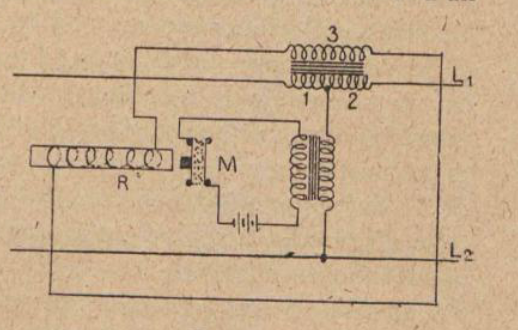 Relais Edisson
Relais Edisson
Les courants de signalisation (courants continus ou alternatifs à
basse fréquence) en traversant les enroulements du relais, pourraient
subir un affaiblissement et parvenir aux bureaux extrêmes avec
une intensité insuffisante.
Un dispositif, analogue à un translateur télégraphique,
et auquel le courant nécessaire est fourni par la machine d'appel
du bureau intermédiaire, assure la réexpédition
de ces signaux. A cet effet, le relais est bloqué par quatre
condensateurs, C, de 4 microfarads chacun ; les deux fils de ligne,
de chaque côté, sont renvoyés à ces condensateurs
par l’intermédiaire des armatures des relais retransmetteurs,
dont les butoirs de repos communiquent également avec l’entrée
et la sortie d’un relais récepteur, rr' ; lorsque des courants
d’appel arrivent de la ligne L, par exemple, ils se rendent dans
le relais récepteur, qui actionne, à son tour, le relais,
transmetteur, t. ; celui-ci, coupant la communication de la ligne, L',
avec les condensateurs, reproduit sur cette ligne les appels venus de
L.
La station de relais est avertie automatiquement, dans le cas où
l’une des lampes est devenue hors d’usage : à cet effet,
l’alimentation des lampes a lieu à travers l’un des
enroulements d’un annonciateur polarisé, a, dont le second
enroulement est relié directement au pôle négatif
de la batterie; le sens donnécde ces courants et le nombre d’ampères-tours
est tel que, lorsque l’allumage est normal, les actions magnétiques
sur le noyau s’annulent; mais, dès que l’un des filaments
devient défectueux, le second enroulement se trouvé prépondérant,
l’armature est attirée et le volet, ç; de l’annonciateur
ferme le circuit d’une sonnerie.
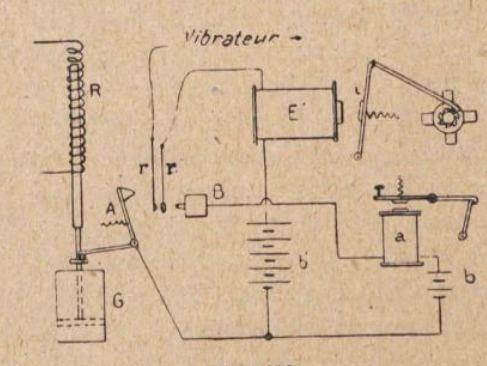
Les opératrices extrêmes peuvent commander à volonté
l’allumage ou l’extinction des lampes du relais; dans ce but,
les relais récepteurs, r et r', peuvent, par une seconde armature,
fermer également le circuit d’un relais à action
différée, R (voir figure ci dessus) rendu très
paresseux par un frein à glycérine, G. Lorsque le circuit
est fermé, l’armature se met lentement en marche, mais la
brièveté des signaux d’appel ne lui permet pas d’accomplir
la totalité de sa course. Par contre, si l’un des extrêmes
envoie un courant prolongé, pendant le temps nécessaire
pour compter lentement jusqu’à 5, l’appendice, A, peut
donner le retour des batteries aux deux ressorts, r et r', reliés
respectivement à un vibrateur et à un électro-aimant
d’allumage, E' ; l’armature de celui-ci agit sur une came
analogue à celle d’un commutateur d’éclairage;
elle allume les lampes si elles sont éteintes et réciproquement;
en outre, l’opératrice entend un son, produit par le vibrateur,
et contrôle ainsi la manœuvre effectuée.
Pour appeler la station de relais, les extrêmes envoient un courant
plus prolongé, d’une durée égale au temps
nécessaire pour compter jusqu'à 20; l’appendice,
A, monte alors jusqu’à ce que le ressort. /' vienne toucher
la butée, B, et fermer le circuit de la batterie d’allumage,
b, sur un annonciateur, a, monté sur la face avant du meuble,
au-dessous de la lampe de gauche.
Pour les cas où les postes extrêmes oublieraient d’éteindre
les lampes, un boulon, placé entre les deux commutateurs de compensation,
permet d’actionner en local le relais, R, et de provoquer l’extinction.
Ce système de relais a été utilisé, pendant
la dernière guerre, notamment pour assurer la liaison entre Gompiègne,
siège du Grand Quartier Général, et Milan, base
du corps expéditionnaire frahçais en Italie. lia été
installé ultérieurement à Lyon, sur le circuit
Paris-Turin.
...
sommaire
En Suisse
Citons ici in extenso, avec la permission de son auteur, M. Mûri,
chef de la division des télégraphes et des téléphones,
l'exposé de ces deux inventions dans sa brochure, publiée
en 1930, « Le développement du téléphone
en Suisse »
C'est la bobine de réactance ou bobine Pupin, imaginée
par le professeur serbe Pupin. Intercalée sur les conducteurs
d'un câble à des intervalles réguliers d'environ
1,8 km, cette bobine a pour effet de diminuer sensiblement l'affaiblissement
de la voix et d'accroître ainsi la portée des communications
téléphoniques. Mais cette invention, à elle seule,
eût été insuffisante pour assurer une audition parfaite
sur de longs câbles; il fallut recourir à un autre dispositif,
au relais ou amplificateur téléphonique qui, inventé
peu avant la grande guerre, reçut dès lors de notables
perfectionnements.
Cette dernière invention a contribué encore plus que la
première à améliorer les communications téléphoniques
par câble. Le but du relais amplificateur est de restituer au
courant de conversation affaibli par la distance la quantité
d'énergie perdue. Il permet non seulement d'augmenter la
portée d'audition de la parole, mais encore, et c'est là
un avantage inestimable, de réduire notablement le diamètre
des conducteurs nécessaires et, partant, le coût des lignes
souterraines. Au lieu des conducteurs de cuivre de 3 mm employés
dans la construction des lignes aériennes on peut,
grâce au relais amplificateur, utiliser des conducteurs de 1 mm
ou d'un diamètre plus petit encore, suivant les circonstances.
Les relais téléphoniques sont groupés dans des
stations dites amplificatrices où, si besoin est, ils sont surveillés
et réglés. Ces stations sont espacées les unes
des autres de 75 à 150 km suivant la constitution des câbles.
Les conducteurs de 1 mm de diamètre doivent être amplifiés
tous
les 70 à 80 km, ceux de 1,5 mm tous les 150 km en moyenne.
La Suisse possède des stations amplificatrices à Brigue,
Lausanne, Berne, Olten, Zurich, St-Gall, Coire, Altdorf, Faido et Lugano.
Pour la mise en valeur pratique des deux inventions retentissantes de
Pupin et de de Forest, la direction des télégraphes suisses
élabora tout d'abord
un programme pour un réseau interurbain souterrain devant rester
limité aux besoins du pays. Mais l'idée d'une interpénétration
téléphonique des pays européens cheminait.
Au printemps 1923 les représentants officiels des Etats de l'Europe
occidentale, la Suisse comprise, se réunirent en conférence
à Paris en vue
d'étudier les voies et moyens propres à développer
uniformément et rationnellement le réseau téléphonique
européen. De cette conférence naquit le
« Comité consultatif international des communications téléphoniques
à grande distance» (aujourd'hui C. C. I. F.). Ce comité
arrêta les programmes de construction et fixa les normes et dispositions
devant régler la téléphonie internationale.
L'exécution du programme suisse dut être activée
en raison de l'électrification générale des grandes
lignes des chemins de fer fédéraux. Conformément
à ce programme une artère principale a été
constituée au travers du territoire national, de Genève
à St-Gall, avec ramifications de Lausanne à Brigue, de
Berne à Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds d'une part
et de Berne à Interlaken d'autre part, d'Olten à Bâle,
d'Olten et de Zurich au Tessin par Lucerne et le Gothard, de Zurich
à Coire et l'Engadine, de Winterthour à Schaffhouse et
de Frauenfeld à Kreuzlingen. Une dernière ramification,
de Lausanne à Yverdon, va très prochainement réaliser
le parachèvement du programme suisse.
Rappelons à ce sujet que l'établissement du premier tronçon
Genève-Lausanne (60 km) du réseau interurbain a été
établi en 1920, dans le court délai
de 4 mois, pour être inauguré la veille de l'ouverture
de la première assemblée de la Société des
Nations.
(Dans la suite il fallut poser sur tronçon un deuxième,
puis un troisième câble, comme il a fallu le faire, au
reste, entre d'autres centres importants tels que Berne et Zurich, Zurich
et Bâle, par exemple.) Le câble pupinisé, à
40 X 2 paires, fut fourni et posé par la maison Siemens et Halske.
Nous citons ce fait parce qu'il marque le point de départ des
efforts entrepris par l'administration des télégraphes
auprès des industriels nationaux, afin que la Suisse devienne
de moins en moins tributaire de l'étranger pour la fourniture
de ses câbles interurbains aussi bien qu'urbains. Ces efforts
ont été couronnés de succès. Les câbleries
de Cossonay, de Cortaillod et de Brougg sont maintenant outillées
pour satisfaire aux exigences de la téléphonie moderne.
L'augmentation énorme des conducteurs souterrains — près
de 1 100 000 km de longueur de fils — est significative de la popularité
toujours plus grande dont jouit l'usage du téléphone au
sein des populations de la Suisse. L'augmentation des conducteurs aériens
— 48 613 km — est plus modeste. La prépondérance
des lignes souterraines est manifeste, ce qui ne veut point dire que
les lignes de poteaux disparaîtront de nos campagnes.
sommaire
En Amérique :
L'un des premiers domaines dans lesquels les valves
(Triode, lampe à vide) ont été utilisées
était la fabrication de répéteurs téléphoniques,
et bien que les performances soient médiocres, elles ont permis
d'améliorer considérablement les circuits téléphoniques
longue distance.
Cette question a fait l'objet d'un rapport de MM. Clark et Osborne (Etats-Unis),
dans lequel les auteurs font un intéressant historique de l'installation
des câbles téléphoniques aux Etats-Unis, et montrent
les étapes successives qui ont conduit à la technique
moderne des câbles à grande distance.
Les premiers circuits en câbles pupinisés utilisés
aux Etats-Unis furent posés en 1902.
La distance couverte n'était que de 17 km, entre New York City
et Newmark dans le New Jersey. Au cours des années suivantes,
la portée des câbles s'accrût et atteignit des distances
de l'ordre de 150 km. Ces câbles primitifs ne contenaient que
des circuits réels.
Ce n'est qu'en 1910 que les problèmes posés par
l'utilisation des circuits combinés ou fantômes —
notamment en ce qui concerne les phénomènes de diaphonie
entraînés par le déséquilibre entre conducteurs
furent résolus et permirent la pose d'un câble destiné
à relier Boston à Neponset (Massachusetts).
L'année 1914 marque le point extrême de l'évolution
des câbles chargés à conducteurs de gros diamètre,
avec la pose du câble de Boston à Washington couvrant une
distance de 724 km.
En janvier 1915, le répéteur téléphonique
à tube à vide fut utilisé pour la première
fois avec succès, lors de l'inauguration de la ligne téléphonique
New York —San Francisco.
On chercha a développer ces installations; mais, on ne tarda
pas à constater que les circuits à 2 fils munis de répéteurs
auraient toujours une portée limitée, en raison des difficultés
d'équilibrage des répéteurs et de l'influence marquée
des phénomènes de diaphonie dans ces circuits. Aussi fut-on
conduit à expérimenter une nouvelle méthode consistant
à utiliser des circuits à 4 conducteurs.
Cette expérimentation mit en évidence des difficultés
d'un autre ordre, notamment celle d'obtenir une courbe d'affaiblissement
à peu près uniforme pour toutes les fréquences
transmises.
En 1932 Il fallut alors, procéder à des études
nouvelles sur la valeur de la charge à donner aux bobines Pupin,
étude qui aboutit au système de pupinisation connu sous
la désignation abrégée H. 44-25, consistant dans
l'introduction tous les 1830 m de bobines de 44 mH. sur les circuits
réels et 25 mH. sur les circuits fantômes. D'après
les auteurs, ce fut le commencement des circuits modernes en câbles
à grande distance en Amérique.
Après cet exposé, MM. Clark et Osborne passent à
la spécification des circuits téléphoniques interurbains
en câbles, signalant qu'ils se borneront à
citer les caractéristiques principales des types de circuits
utilisés aux Etats-Unis en s'efforçant d'en justifier
le choix. Ils passent ainsi en revue : les constantes du câble
interurbain normal utilisé dans le réseau du système
Bell; les caractéristiques des circuits réels et des circuits
fantômes; les conditions d'utilisation des circuits à 2
et à 4 fils; l'inductance et l'espacement des bobines de charge
qui, pour des raisons d'économie, correspondent à des
pas de pupinisation respectivement de 915 et de 1830 m — ; l'espacement
des répéteurs et des régulateurs automatiques de
la transmission — les répéteurs étant placés
à une distance aussi voisine que possible de 80 km, les régulateurs
automatiques, généralement introduits sur les câbles
aériens d'une longueur supérieure à 80 ou 160 km
étant disposés de préférence toutes les
deux stations de répéteurs .
Les auteurs examinent également: les gains de transmission des
répéteurs tant en ce qui concerne les circuits à
4 fils que les circuits à 2 conducteurs; la régularité
de l'impédance en ce qui concerne l'utilisation des circuits
à deux fils et la limitation de la diaphonie, tant à l'émission
la plus importante
pour les circuits à deux fils qu'à la réception
la plus importante pour les circuits à quatre fils . Ils signalent
à ce sujet les précautions prises dans la constitution
des câbles pour séparer l'un de l'autre le groupe des voies
d'aller et le groupe des voies de retour des circuits à 4 fils,
à cause des différences relativement importantes entre
les niveaux de transmission sur les voies d'aller et de retour. Enfin,
ils examinent le problème de 3 a limitation de la distorsion
de phase, très importante dans le cas des longs circuits à
4 fils, et à laquelle on peut dans une certaine mesure porter
remède par l'utilisation de dispositifs appelés «
compensateurs de phases ».
Les auteurs examinent ensuite les caractéristiques de fonctionnement
des câbles. Après avoir défini la perte nette minimum
de puissance en service et indiqué le rôle qu'elle joue
dans la détermination des portées des' câbles selon
leur spécification, ils étudient, avec courbes à
l'appui, les pertes nettes minima de puissance admissibles en service
pour des circuits à deux fils et à quatre fils utilisés
exclusivement pour le trafic terminal. Suit rémunération
des conditions imposées aux caractéristiques techniques
des câbles aux Etats-Unis, de manière à permettre
l'interconnexion des divers réseaux. Ces conditions, relativement
peu différentes de celles qui ont été arrêtées
par le Comité consultatif international des communications téléphoniques
à grande distance, figurent en même temps que ces dernières
au rapport.
L'une des parties les plus intéressantes de l'étude concerne
les conditions à imposer à l'avenir aux câbles téléphoniques
pour la réalisation des très
grandes portées. Les spécifications actuelles permettent
de réaliser dans de bonnes conditions des liaisons atteignant
3000 km. Mais, l'expérimentation effectuée sur des longueurs
de câble à 4 fils dépassant 6000 km a montré
que des modifications devront être apportées aux caractéristiques,
si l'on veut établir de bonnes liaisons à des distances
de cet ordre ou à des distances supérieures.
Il faudra, en particulier, des suppresseurs d'écho plus efficaces.
Les appareils du type ordinaire ne permettent pas, pour des distances
de Y ordre de 6000 km, une exploitation convenable avec la perte nette
de puissance de 9 décibels qu'il est désirable de réaliser.
En ce qui concerne la distorsion de phases, alors que des compensateurs
ne semblent pas nécessaires pour des circuits de l'ordre de 3000
km, il faudra envisager l'utilisation systématique de tels dispositifs
lorsque la distance deviendra double.
Le temps de propagation lui-même, dans un circuit à charge
légère de 6000 km, prend une importance relativement grande;
il devient de l'ordre du quart de seconde dans chaque sens, ce qui est
la limite provisoire fixée par le C. C. I. Tph. pour la communication
entière. En raison de ce temps de propagation, les suppresseurs
d'écho introduisent certains troubles dans l'échange des
communications. En supposant, en effet, les suppresseurs d'écho
distants de 3000 km, le temps de propagation entre ces dispositifs est
de l'ordre du huitième de seconde pour chaque sens de transmission.
S'il y a simultanéité de conversation aux deux extrémités
du circuit, les deux suppresseurs d'écho fonctionnent en même
temps, bloquant chacun
une voie du circuit, et introduisent, de ce fait, dans la conversation,
des trous qui sont appréciables.
Toutes ces considérations montrent que des circuits en câbles
meilleurs que les circuits actuels sont nécessaires pour réaliser
d'une manière satis-
faisante des communications à très.grandes distances.
Peut-être faudra-t-il s'adresser au téléphone par
courant porteur pour résoudre ce problème, la vitesse
de propagation d'un tel courant étant de l'ordre de 160 000 km
à la seconde en tenant compte de l'accroissement du temps de
propagation dû aux appareils.
Comme conclusion de leur rapport, les auteurs signalent que, bien que
le développement de la technique de la téléphonie
à grande distance ait été
très rapide au cours des derniers vingt ans, il n'est pas exagéré
de prévoir pour les vingt ou trente prochaines années
des progrès techniques au moins aussi importants.
sommaire