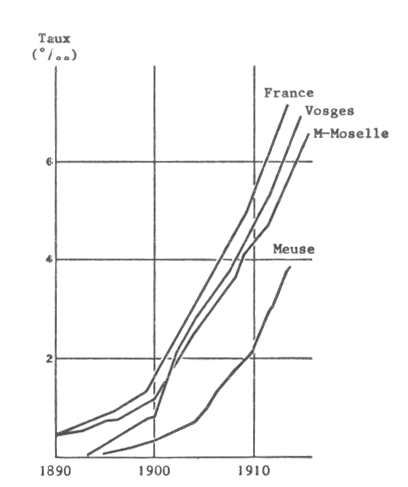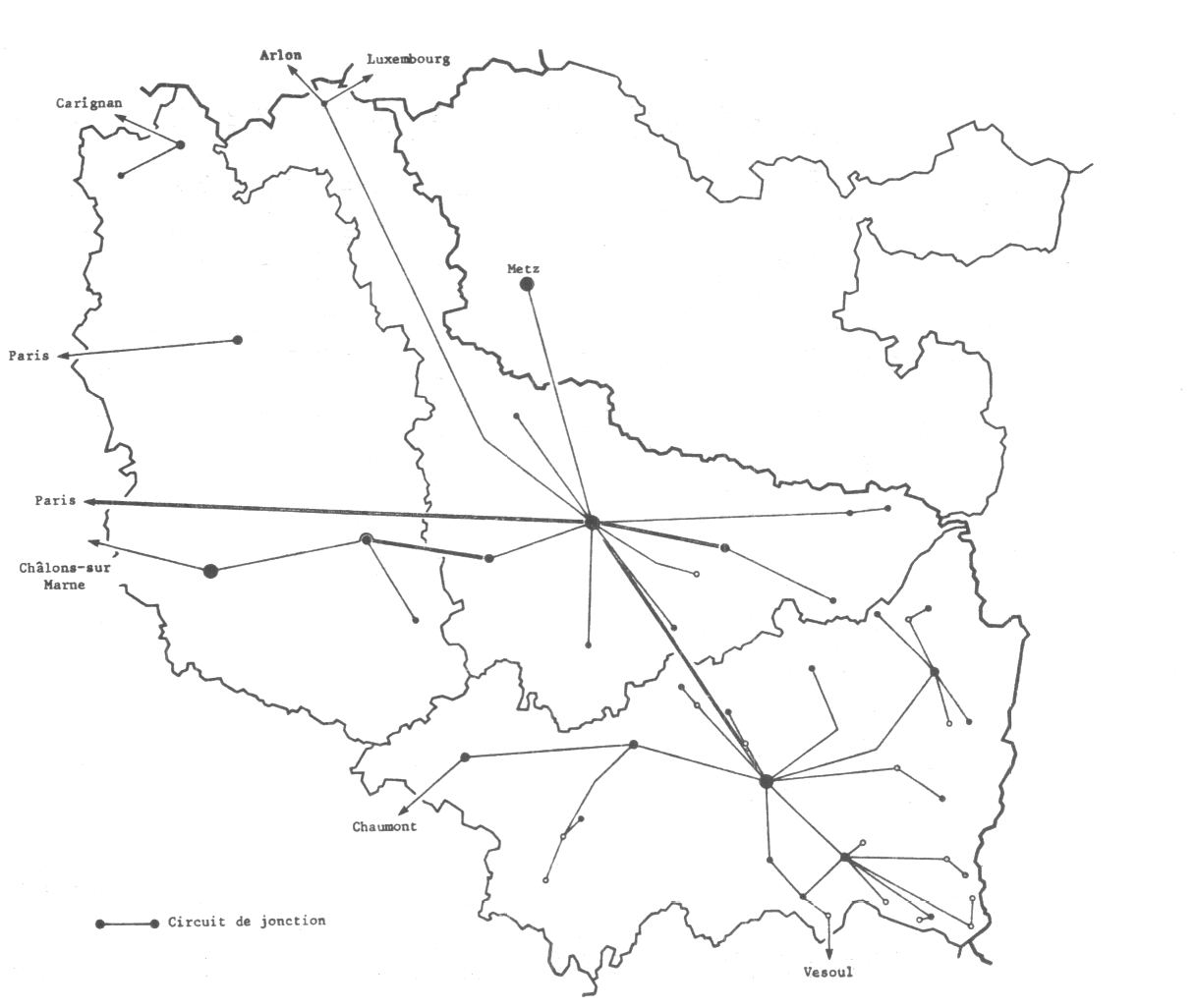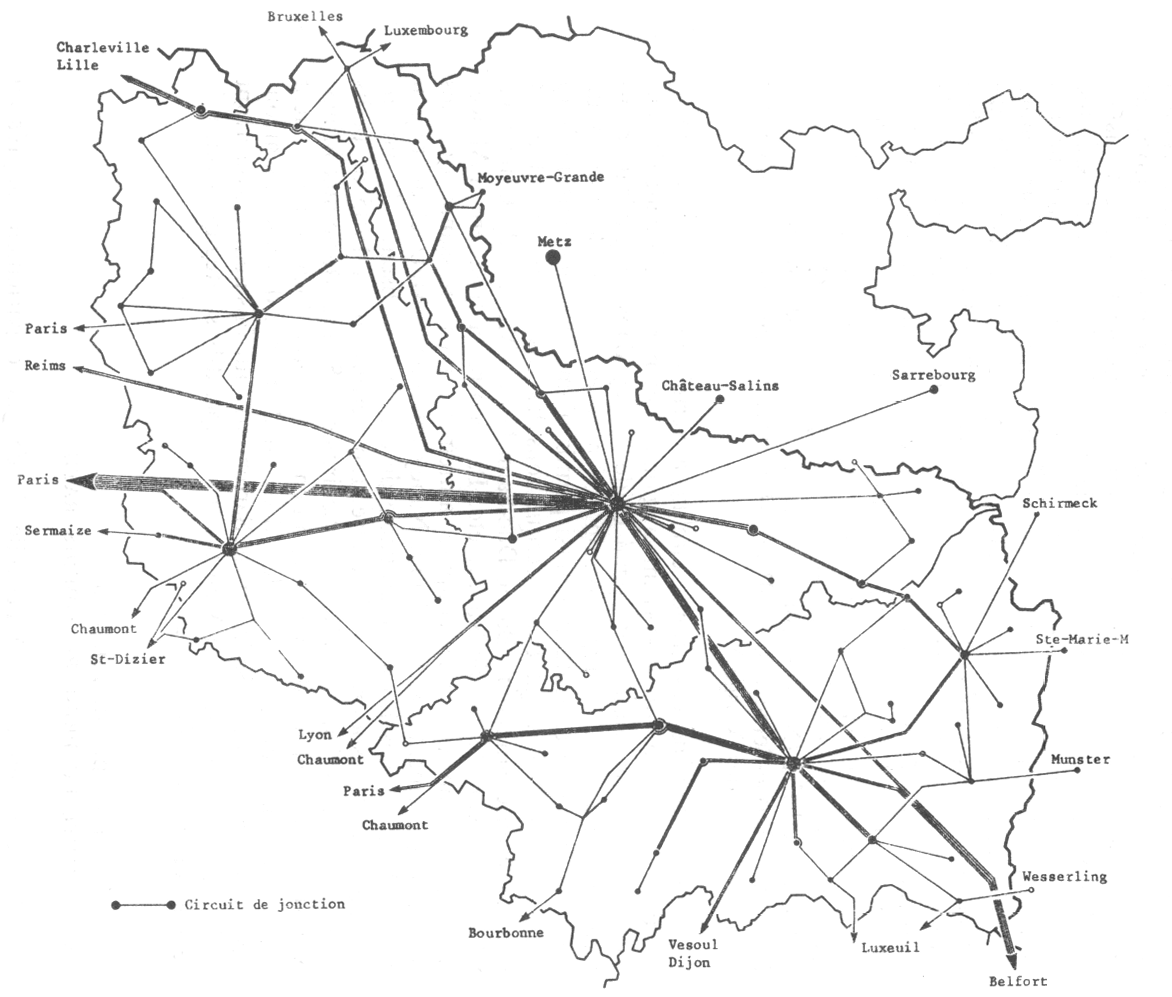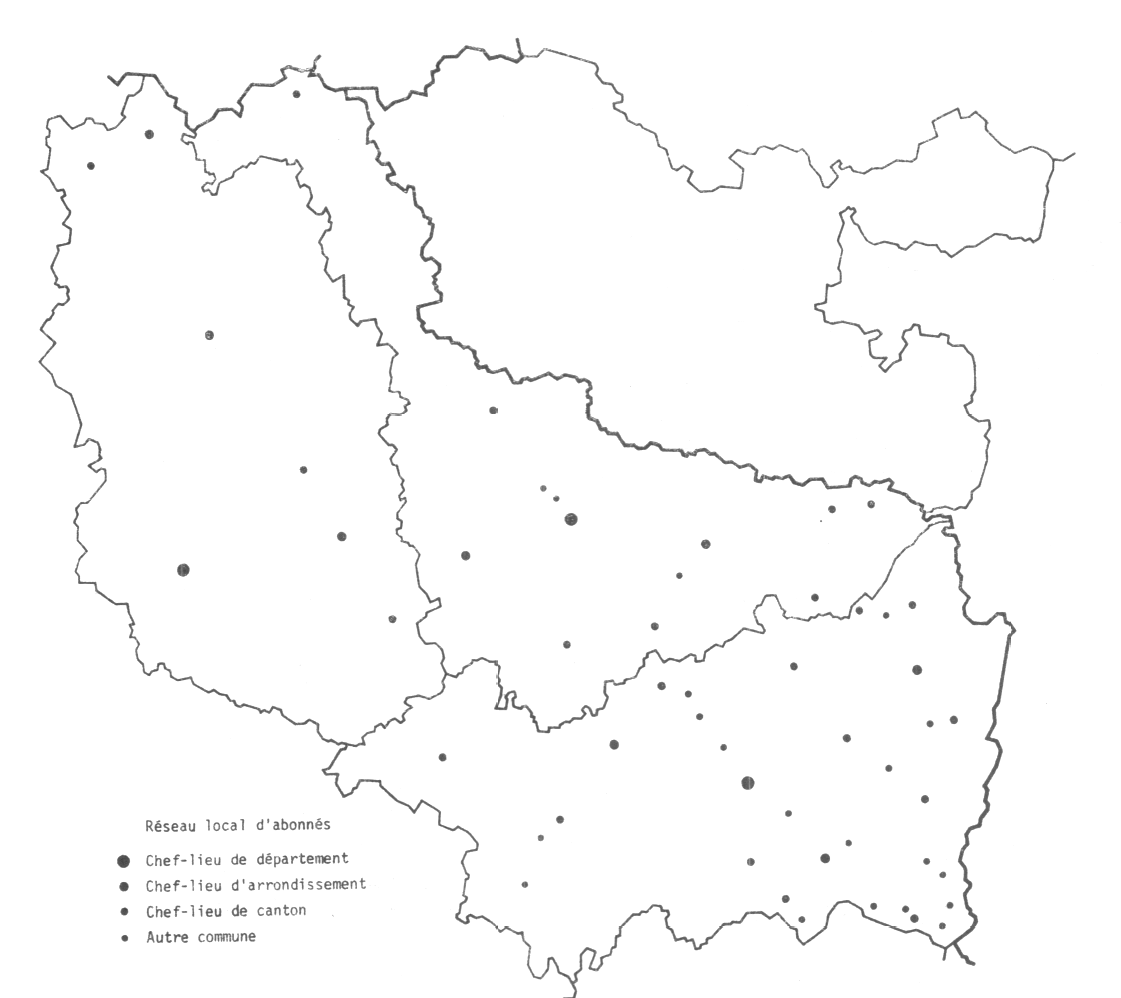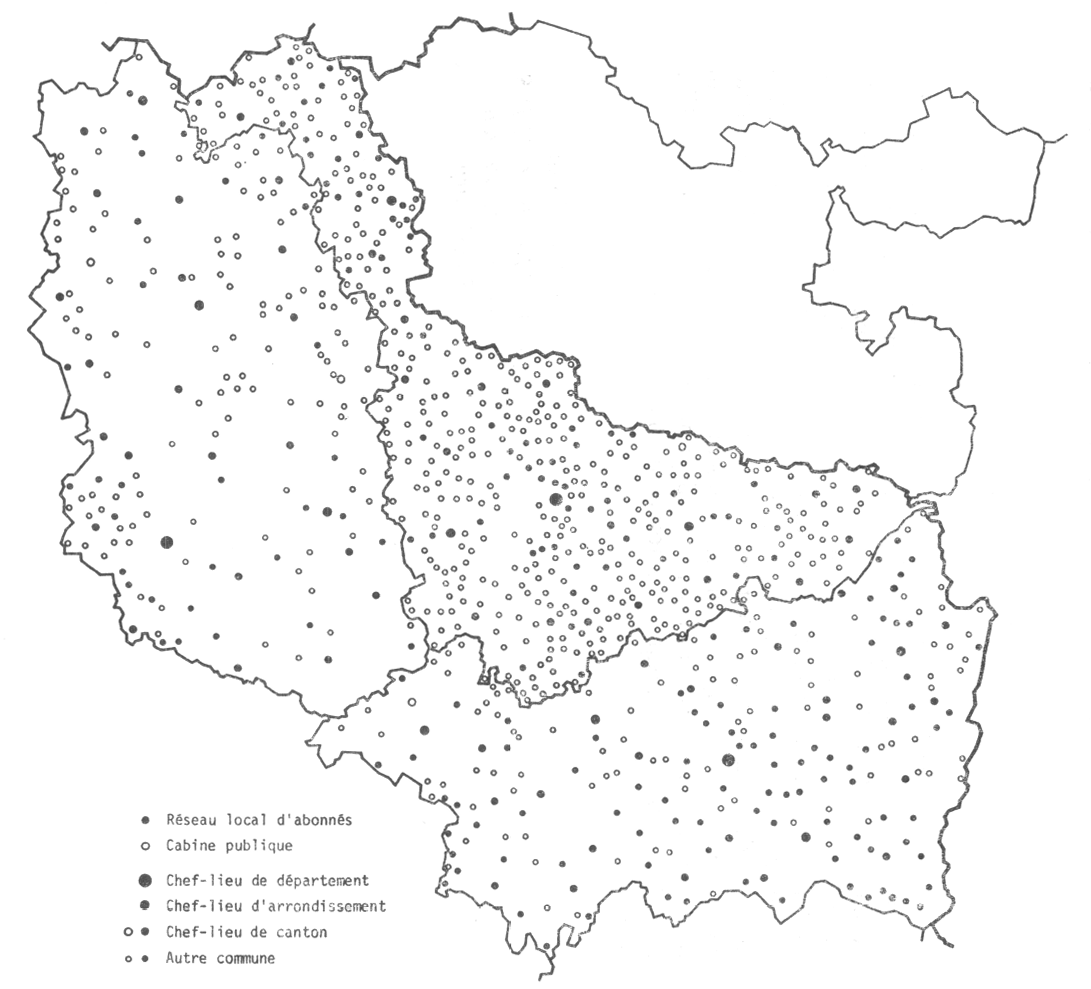Afin d'avoir une vision globale de l'évolution de la technologie
et de l'infrastructure déployée pour développer la
téléphonie en France,
voici des articles qui synthétisent les aspects stratégiques
avant et avec l'arrivée de l'électronique.
1 - Aspect
stratégique du développement du réseau téléphonique
en France de 1879 à 1940.
2- Quelques chiffres
et événements, les techniques électro-mécaniques:
Déploiement du téléphone à Paris et sur
d'autres régions :
2 - Répartition
des abonnés sur PARIS et sa banlieue avant 1950
3 - Développement
dans le Calvados avant 1914
4 - Les
premiers développements du téléphone en Lorraine
avant 1914
5 - Le téléphone
et les transactions internationales avant
1932
6 - L'évolution
du téléphone après les années 1950
: l'électronique le numérique
sommaire
Stratégie politique des télécommunications
jusqu'à la première guerre mondiale
|
Le capitalisme, moteur de l’ouverture
des télécommunications :
|
|
De 1879 à 1940, les réseaux téléphoniques
vont équiper l’espace français. Nous nous ferons l’écho, dans notre seconde
partie, des enjeux technico-industriels à l’œuvre pour
Paris, les villes de province et les campagnes. Mais auparavant, retraçons
les grandes étapes du développement du réseau. Les premières années sont marquées
par la création du réseau de Paris en 1879. Le développement du réseau téléphonique Le souci de service public fut donc un argument important pour la nationalisation des réseaux : reprenant le téléphone, l’Etat pourrait réaliser promptement un système de téléphonie régionale ; il pourrait pratiquer des tarifs inférieurs à ceux de l’industrie privée ; enfin, il aurait du réseau une vision d’ensemble qui éviterait les incohérences inévitables liées à la diversité des interventions. Les députés de l’Assemblée Nationale
votèrent donc, en septembre 1889 la reprise du téléphone
par l’Etat français (à raison de 435 voix contre 65)
et l’exploitation du téléphone fut confiée au
ministère des Postes et Télégraphes. Ainsi, la nationalisation du téléphone n’a
pas conduit à la constitution d’un réseau conçu
à l’échelle de la France. Ce choix allait fournir à l’innovation un cadre très contraignant : le nombre de centraux nécessaires a été huit fois plus important en France que dans les autres pays européens et vingt fois plus grand qu’aux Etats-Unis («toutes choses égales par ailleurs » : M. Corrèze) . La faiblesse des relations transversales du réseau français a frappé les députés se penchant sur la question du téléphone au début du siècle. Il faudra patienter jusqu’à l’automatisation pour que les délais d’attente n’atteignent plus une à trois heures dans les relations entre départements, trois à quatre heures dans les relations à grande distance. La faiblesse des relations transversales tient prohablement
au fait que l’Etat était bien propriétaire du réseau,
mais n’était pas pour autant en mesure de financer ce développement,
et la responsabilité en est revenue aux collectivités locales
(loi du 20 mai 1890) ; par voie de conséquence, l’Etat n’était
pas maître de la configuration de ce réseau, configuration
qui ne reflétait pas la géographie économique de
la France de cette époque. La configuration du réseau téléphonique français du début du XXe siècle apparaît comme résultant de choix peu compréhensibles, à moins de les analyser comme l’expression de restrictions imposées par les notables aux communications, ce qui est la thèse d’Yves Stourdzé, et, conjointement, car cette thèse mérite d’être modulée, comme la traduction en terme d’infrastructure, des besoins en communication de la société de l’époque. On sait en effet que les déplacements de région à région n’étaient pas aussi fréquents que de nos jours. Le contexte est tout différent de celui d’autres pays comme les Etats-Unis où les migrations d’une ville à l’autre, voire de l’Est à l’Ouest, font partie de la civilisation américaine. De plus, en France, il n’y a manifestement pas à cette époque de demande populaire pour le téléphone, et il n’y en aura pas pendant fort longtemps. Plusieurs raisons sans doute à cela. D’abord le téléphone apparaît comme l’instrument des notables, instrument économique et politique. L’exposé des motifs du texte législatif entend d’ailleurs explicitement qu’il convient de restreindre l’usage du téléphone : on peut y lire que c’est la plus sûre des garanties contre son utilisation improductive ou inutile. Notons à ce propos que le «filtre des notables » continue à exercer ses effets dans un grand nombre d’Etats, en Afrique Noire par exemple, où le téléphone n’est pas installé chez l’agriculteur en brousse, mais chez le fonctionnaire ou le commerçant. Dans un cas comme dans l’autre la cherté des tarifs joue évidemment un rôle explicatif important, mais c’est par la faible urbanisation de la France par rapport aux autres pays que l’on peut expliquer une telle situation. De 1889 à 1892, les financements sont assurés
d’abord par la Caisse des Dépôts et Consignations, puis
par un budget annexe. Après les années de guerre, le développement
du réseau téléphonique se présentait dans
des termes différents pour les villes et les campagnes. Dans les
campagnes était en vigueur le système des avances remboursables
; l’équipement était donc fonction de la demande effective.
En 1923, il fallait attendre en moyenne de quatre à
cinq heures pour obtenir une communication interurbaine. Le 30 juin 1923, fut adopté un budget annexe au
budget général pour l’Administration des P.T.T. avec
possibilité d’emprunts spéciaux. Ce budget restait
soumis aux règles générales régissant les
finances publiques. Un plan de redressement pour les télécommunications
(sur dix ans) fut également voté alors, dont les principales
dispositions étaient les suivantes : Avant même l’ouverture du central automatique
de Paris-Carnot, le 22 septembre 1928, de nombreuses villes de province
furent équipées en automatique. Ce fut le cas pour Dieppe
(système Ericsson) ; Vichy, Le Havre, Montpellier, Rennes, Bordeaux,
Lyon (système Strowger) ; Marseille et Nantes (système Rotary)
. Ce n’est donc qu’après 1933-1934 que
les remarques sur le rôle des notables recouvrent leur pertinence.
Nous avons développé ailleurs les débuts
de l’automatisation du réseau téléphonique de
Paris, depuis la mise au concours (octobre 1925) jusqu’au choix du
système Rotary. A propos de choix du R6 par l’Administration, Y.
Stourdzé a avancé une thèse intéressante :
celle de la stratégie de la multinationale I.T.T., mettant volontairement
en concurrence deux filiales (L.M.T. et Compagnie des Téléphones
Thomson Houston) afin de permettre à l’Administration de satisfaire
son désir de ne pas dépendre d’un monopole ; mais,
ce faisant, cette dernière n’aurait choisi qu’une «stratégie
de pseudo-balance entre deux “ filiales ” d’une même
firme multinationale... ». Le développement du réseau téléphonique Laissons à l’auteur cette interprétation qui, pour être intéressante et probablement juste en ce qui concerne la stratégie de la multinationale I.T.T. jouant sur plusieurs claviers simultanément, nous semble toutefois inexacte en ce qui concerne l’Administration. En effet, comme on l’a montré, le choix a été précédé d’une concurrence très sérieuse sur le plan technique. Par ailleurs, l’Administration a exigé de ses fournisseurs l’abandon des droits sur les systèmes qu’elle adoptait pour le réseau. Aussi, la crainte d’un monopole de la part de l’Administration ne devait pas être aussi aiguë dès lors qu’était obtenu contractuellement cet abandon des droits de fabrication et d’installation par le fournisseur choisi, et que la concurrence pouvait jouer de nouveau entre fournisseurs pour la fabrication d’un système déjà choisi (rabais sur les prix de base initiaux conformément aux directives de la Commission des Marchés, comme on l’a signalé plus haut) . Une soixantaine de centraux, équipés en
système R6, furent implantés entre 1928 et 1946. La région
de Lyon en bénéficia particulièrement, avec l’installation
d’un centre à Roanne en 1930, à Saint-Etienne en 1931,
Villeurbanne en 1932, à Tassin, La Mulatière, Caluire, Oullins,
Saint-Fons, Ecully, Champagne en 1937, Vénissieux, Saint-Fons encore,
Bron en 1938, Saint-Didier et Saint-Rambert en 1939. On se heurtait dans les campagnes à un certain
nombre de difficultés. Sur le plan de l’organisation du réseau,
des choix fondamentaux avaient conduit à «la
multiplication du nombre de centres de commutation : de 220 en 1892, il
atteignait 21 500 en 1928, soit, toutes choses égales
par ailleurs, un nombre de centraux 8 fois plus grand que dans les autres
pays européens et 20 fois plus grand qu’aux Etats-Unis. Le système dénommé «automatique
rural » apporta aux usagers l’avantage de la permanence et
de la discrétion du service dans les bureaux de poste et la concentration
des opératrices dans les centres importants. Ce système
n’était cependant que semi-automatique, puisque les abonnés
devaient encore manœuvrer une magnéto et non un cadran. Le système rural retenu par l’Administration française devait répondre à des exigences d’exploitation préalablement définies. Huit entreprises entrèrent en concurrence, et, comme l’Administration entendait ne pas vouloir se contenter d’un choix sur documents, elles durent équiper, à partir de 1929, un groupement, à titre d’essais dans la région Paris extra-muros, comportant chacun de 20 à 30 bureaux, maintenant la desserte d’un grand nombre d’abonnés par un petit nombre de circuits. Au lieu d’intégrer la commutation automatique, qui était une innovation, dans le réseau antérieur, quitte à entreprendre pour cela les réorganisations nécessaires et en retirer les bénéfices au niveau de l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble du réseau, l’Administration, appuyée par les Conseils Généraux, allait fortifier une structure de réseau dépassée technologiquement. Pourquoi de telles décisions techniques ? (Ouvrons une parenthèse à propos des postes téléphoniques de l’Administration française. Le premier poste à cadran (donc relié à un réseau automatique) est le Poste 1924 à colonne. Il a été installé à Paris dès l’automatisation du réseau de la capitale. Le second poste mis en service est le U 43 (Universel 1943), qui doit son qualificatif d’universel au fait qu’il pouvait être équipé d’un cadran lorsqu’il était raccordé à un réseau automatique, ou d’une magnéto à poussoir (remplaçant les postes à manivelle des réseaux à commutation manuelle). Cette astuce technique (la magnéto ayant le même encombrement que le cadran) a permis à l’U 43 d’être installé dans les campagnes (avec magnéto). Lorsqu’un réseau rural passait en automatique, il suffisait de remplacer la magnéto à poussoir par un cadran (poste mis au point au SRCT). Le C 63 (Socotel 1963) résulte d’études menées au C.N.E.T) Le développement du réseau téléphonique La faiblesse de base du «semi-automatique » rural tient à ce qu’il ne remettait pas en cause le réseau antérieur, et en prolongeait les faiblesses. L’amélioration du fonctionnement de l’ensemble du réseau n’est pas l’objectif poursuivi ; il s’agissait plus simplement, d’apporter quelques améliorations pour les usagers, et grâce au mode de financement, de poursuivre l’équipement téléphonique du pays malgré l’absence de moyens budgétaires. Les ingénieurs des Télécommunications mirent en valeur le fait que le système rural était justifié dans les zones à faible densité téléphonique, «même lorsque le centre de groupement était équipé en automatique, et surtout tant que l’exploitation interurbaine n’existait pas, ce qui fut le cas jusqu’en 1950. Mais à partir du moment où le centre de groupement est doté d’un autocommutateur établissant des communications interurbaines et où la densité et le trafic téléphonique ont atteint une certaine valeur, le système rural n’est plus justifié. C’est l’équipement en “automatique intégral” qui s’impose » . L’équipement des réseaux ruraux en
«semi-automatique » débuta dans toute la France en
1936. L’équipement du territoire en réseaux
téléphoniques témoigne d’une situation contradictoire
qui s’est prolongée jusqu’aux années 1960. Géré par des groupes privés pendant une dizaine d’années, le téléphone a été nationalisé dès 1889. Mais, par le système de financement mis en place, ce sont des notables qui détenaient le contrôle réel de l’avenir du téléphone en France. Pourquoi cette décision ? Parce que les problèmes de communication à l’échelle locale étaient gérés par les notables locaux, notamment à travers la presse locale et régionale que la Poste permettait de distribuer et d’acheminer fournissant à la fois un soutien logis¬ tique et un soutien financier (aujourd’hui encore, ne dit-on pas que le routage de la presse est l’une des principales causes du déficit de la Poste ?). Ainsi, pour que le téléphone se développe, il fallait que les notables le souhaitent, c’est-à-dire qu’ils devaient avoir un certain besoin de ce nouveau média de communication, ou, tout au moins, qu’ils devaient ne pas éprouver de crainte particulière à son encontre. Or, c’était bien le cas : «Apparemment... les notables locaux n’avaient rien à attendre du téléphone, instrument de communication point à point sans intermédiaire. Ils défendaient pour leur part, tout comme l’Etat central, une structure pyramidale de transmission, où les intermédiaires jouent un rôle fondamental de “disjoncteur” et de “filtres” institutionnels. Selon eux, le téléphone court-circuitait bien sûr ce réseau, et n’avait donc pas sa place dans le système de communication français ». Outil de dialogue, le téléphone semblait devoir perturber considérablement le «fragile équilibre existant dans le système de la transmission des informations dans ce pays». Les notables locaux, par l’intermédiaire de la procédure de financement avaient donc gardé le contrôle des extensions du réseau. Car, pour que le téléphone se développe, il fallait que les collectivités locales (conseils généraux, chambres de commerce) fassent des avances au Trésor couvrant les frais d’installation du réseau. Et les P.T.T. procédaient au remboursement grâce aux bénéfices d’exploitation sans intérêts. De ce survol historique du développement du téléphone en France, on peut en déduire qu’un modèle hiérarchique précède, accompagne et encadre le développement du réseau téléphonique en France. Comme le montre Y. Stour dzé, les instruments de dialogue, de réversibilité de la communication, furent plus ou moins complètement escamotés au profit d’autres instruments techniques qui trouvèrent plus aisément le financement, l’appui et le soutien des sociétés savantes et des pouvoirs publics comme des institutions industrielles et commerciales . A contrario, le développement en France de la radiodiffusion et de la télévision qui ne contrariaient pas le modèle hiérarchique (et le fortifiant même) furent plus vigoureux. D’ailleurs, si le téléphone lui-même s’est un peu développé à la fin du xix siècle et au début du XX siècle, cela est dû en partie à un malentendu : il était considéré comme un instrument de diffusion. Devant la profusion de systèmes de télécommunications, devant la multiplication des réseaux, les incitations à les utiliser (publicités) , devant les bouleversements technologiques impliquant la mise à la disposition du public de moyens de vidéocommunication, ou de téléinformatique domestique, on peut se demander si la société française a, de nos jours, véritablement abandonné le modèle hiérarchique. Henry Bakis Chercheur au C.N.E.T. Issy-les-Moulineaux |
|
RAPPEL de quelques chiffres et événements, des techniques en cours : - 1897 On compte alors en France 11.314 abonnés, dont 6.425 à Paris- 1900 on fait un premier essai du système automatique Strowger dans les locaux du Ministère du Commerce, pour évaluer ce nouveau système (sans abonné puplique). - 1909 il n'y avait que 44 600 abonnés â Paris. - 1921 Le nouveau réseau de Paris sera structuré autour de 4 centres de jonctions dont le nombre et la localisation auront été déterminés par une étude du trafic. Ce sont en 1922 les bureaux existants de Guyot (nord-Ouest), Combat (nord-est), Daumesnil (Sud-est) et Vaugirard (Sud-ouest). A cette date tout Paris est toujours en manuel. - 1926 Le système Rotary 7A est finalement choisi le 13 octobre, pour équiper PARIS et il est décidé que le système R6, sera implanté dans les villes moyennes de province dès 1928 en commençant par Troyes - 1927 le ROTARY 7A1 une variante du 7A est mise en service pour la première fois dans le monde en France, à Nantes en octobre , fabriquée en France par la société Le Matériel Téléphonique (L.M.T), capable de gérer jusqu'à 10.000 abonnés (au lieu des 20.000 lignes initialement ) Au final la version ROTARY 7A1 est retenue pour une mise en service dans tout Paris - 1928 : mise en service du premier central téléphonique automatique à Paris central "Carnot". A cette occasion on installe chez les abonnés reliés au téléphone automatique un poste à cadran A Paris, il y a 160 000 abonnés. Les travaux de transformation dureront une douzaine d'années, et le nombre des abonnés atteindra environ 350 000 quand ils seront terminés en 1940. La première partie du programme (transformation progressive des bureaux très importants) a déjà reçu une réalisation partielle.
Le programme prévoyait d'accueillir 500 000 abonnés en 1936 dans 42 centraux, alors que le nombre d'abonnés à Paris était seulement de 186 365 en 1931. On peut connaitre l'évolution et la Répartition des abonnés sur PARIS et sa banlieue dans cette rubrique. Pour automatiser la province, on se refert à cet exposé de A. JOUTY INGÉNIEUR EN CHEF DES TÉLÉCOMMUNICATIONS -
LA COMMUTATION TÉLÉPHONIQUE EN PROVINCE La construction d'un réseau de commutation téléphonique
est une oeuvre de longue haleine, dont le but « l'automatique
intégral » semble reculer à mesure que l'on s'en
approche. Pourquoi l'automatique intégral ? A. JOUTY |
Rappel des différents types de commutateurs
automatiques éléctro mécaniques utilisés en
France :
Le réseau téléphonique de Paris intra-muros fut entièrement
automatisé en 1939, juste avant la déclaration de guerre
de la France à l'Allemagne.
La totalité de l’Île-de-France ne sera automatisée
qu’en 1975, et la totalité de la métropole en 1979
soit 66 ans après le début de l'automatisation du réseau
en 1913.
Les premiers commutateurs conçus sont électromécaniques
et à organes tournants, Coexistent en France les systèmes
de type pas à pas (Strowger, famille R6 et SRCT) et les systèmes
de type à impulsions de contrôle inverses (AGF500 et famille
Rotary). Le premier commutateur de type rotatif est installé en
1913, le plus récent est installé en 1971, les dernières
extensions sont commandées en 1978 et le dernier commutateur à
organes tournant est démonté en 1984, avant le changement
du Plan de numérotation téléphonique en France (basculage
à 8 chiffres le 25 octobre 1985 à 23H00.
De par son architecture et pour ne pas trop complexifier l’ensemble,
chaque commutateur à organes tournants ne peut prendre en charge
qu’un maximum de 10 000 abonnés.
STROWGER
Ce commutateur sans enregistreur de numéros
et à contrôle direct est inventé par Almon Strowger
aux États-Unis en 1891, premier modèle de commutateur automatique
mis en service en France, le 19 octobre 1913, à Nice Biscarra.
Il est fabriqué sous licence Strowger Automatic Telephone Exchange
Company par la Compagnie française pour l'exploitation des procédés
Thomson-Houston. Il est équipé de sélecteurs rotatifs
semi-cylindriques à 100 points de sortie (10 lignes téléphoniques
de sortie sélectionnées par niveau, sur 10 niveaux empilés
en hauteur). Un commutateur STROWGER fonctionne de manière saccadée,
en mode pas à pas, littéralement télécommandé
en temps réel par chaque impulsion numérotée au cadran
de l’abonné demandeur, chiffre par chiffre, chaque chiffre
sélectionnant successivement la position de son sélecteur.
Ce mode d’établissement de communication de manière
automatique est le plus élémentaire. Il est parfaitement
adapté aux débuts de l’automatisation du réseau
téléphonique alors que le maillage reste encore relativement
simple et peu dense. Les commutateurs de type STROWGER été
retenus uniquement pour la province. Le STROWGER le plus récent
est mis en service en 1932 à Lyon. Le dernier est démonté
en 1979 à Bordeaux.
AGF 500
Fabriqué par la société LM
Ericsson, mis au point en 1922, ce commutateur d'origine suédoise
est équipé d'enregistreurs de numéros et de sélecteurs
volumineux disposés en éventails constitués d’éléments
rotatifs de base (modèle RVA avec balais de nettoyage des contacts
intégrés) horizontaux en forme de plateau à 25 positions
tournant à 90° groupés par 20 éléments,
donnant 500 points de sortie (25 positions angulaires de sortie pour 20
positions commandées radialement en hauteur correspondant à
20 lignes possibles pour chaque position angulaire). Il est capable de
gérer jusqu'à 10.000 abonnés par cœur de chaîne
si toutes les volumineuses extensions possibles sont installées
; unique mise en service en 1924 en France, à Dieppe. Ce commutateur
fut remplacé en 1960.
ROTARY 7A1
Cette variante française est dérivée
du système ROTARY 7A, équipé à l'origine d'embrayages
magnétiques des arbres rotatifs distribuant l’énergie
motrice au commutateur. Le ROTARY 7A1 est lui équipé d'embrayages
mécaniques des arbres rotatifs plus robustes. Comme le ROTARY 7A
d'origine provenant des États-Unis et conçu et mis au point
en Belgique par la Western Electric filiale d'AT&T en 1914, il est
équipé d'enregistreurs-traducteurs qui permettent, par rapport
aux systèmes fonctionnant en pas à pas d’économiser
des baies de sélecteurs et des étages de sélection
en enregistrant les Préfixes des numéros téléphoniques
demandés (2 chiffres en province, 3 caractères pour la Région
Parisienne) afin de déterminer directement une route « calculée
» par le traducteur qui va analyser ces préfixes par bloc.
Une fois le centre téléphonique à contacter déterminé,
le traducteur commande en différé la rotation des sélecteurs
nécessaires à l’établissement de la communication
en activant les bonnes commandes d’embrayages qui vont connecter
juste le temps nécessaire les arbres d’entraînement
rotatifs des sélecteurs choisis pour les positionner sur les bonnes
positions, et les débrayer au bon moment par un système
d’impulsions de contrôle inverses. Ainsi, tout commutateur
de modèle ROTARY fonctionne de manière régulière
et harmonieuse. Il est pourvu de sélecteurs rotatifs semi cylindriques
à 300 points de sortie (30 lignes téléphoniques de
sortie sélectionnées par niveau, sur 10 niveaux empilés
en hauteur). Il est capable de gérer jusqu'à 10.000 abonnés
par cœur de chaîne, si toutes les volumineuses extensions possibles
sont toutes installées. L'automatisation du réseau de Paris
est décidée en 1926. Le premier ROTARY 7A1 conçu
à partir de 1922 est mis en service dès 1927 à Nantes.
Finalement le ROTARY 7A1 est retenu pour Paris dès 1928 par souci
d'homogénéisation du réseau parisien et ce malgré
la conception entre-temps en 1927 d'une seconde variante : le ROTARY 7A2.
Premier central téléphonique automatique mis en service
dans Paris (Carnot), 23 rue de Médéric : le 22 septembre
1928 à 22 Heures, en présence du Ministre du Commerce, de
l’Industrie, des Postes et Télégraphes Henry Chéron
! Il s’agit d’un ROTARY 7A1. Le second ROTARY 7A1 de Paris sera
mis en service au Centre Téléphonique des Gobelins le 20
juillet 1929 ; il y a assuré un service satisfaisant jusqu’au
7 juillet 1982, soit 53 ans. Le ROTARY 7A1 le plus récent de France
est installé en 1952. Le dernier ROTARY 7A1 de France, celui de
Paris-Alésia (à Montrouge), est désactivé
le 26 juin 1984.
ROTARY 7A2
Cette nouvelle variante française est conçue
en 1927 dans les laboratoires parisiens d'ITT à partir du système
ROTARY 7A1.
Cette version améliorée est en effet nouvellement pourvue
de sélecteurs de débordements de sécurité
améliorant encore la capacité d'écoulement du trafic
téléphonique ; c’est ce que l’on nomme l’acheminement
supplémentaire de second choix. La variante ROTARY 7A2 est le système
à organes tournants le plus développé, mais aussi
le plus cher. Il n’est pas déployé en France bien qu’y
étant conçu, mais est adopté par plusieurs pays,
dont notamment l’Espagne dès la fin de la guerre civile.
R6 (sans enregistreur de numéros)
Ce commutateur à contrôle direct, dont
le nom officiel est ROTATIF 1926, car mis au point en 1926, encore rencontré
sous le nom semi abrégé ROTATIF 6, est implanté dans
les villes moyennes de province dès la fin de 1928 en commençant
par Troyes, ce système français de type pas à pas
étant un hybride qui s'inspire à la fois des systèmes
Rotary et Strowger. Il est de surcroît simplifié à
l'extrême pour être le moins coûteux possible. Par contre,
il est équipé d’Orienteurs à 11 positions (1
position de repos et 10 autres positions pour les 10 chiffres du cadran),
un nouveau groupe d’organes de contrôle commun à plusieurs
sélecteurs à la fois qui permettent de dissocier clairement
la fonction de réception des chiffres composés par l'abonné
de la fonction de recherche et de connexion de la liaison. Chaque étage
de sélecteurs est équipé de son groupe d’Orienteurs.
Chaque Orienteur, qui fonctionne en mode pas à pas, n’est
utilisé que pendant la réception des chiffres numérotés
au cadran du téléphone de l’abonné, puis est
libéré pour aller traiter une autre communication à
établir. Dans le système R6, la notion de point de sélection
ne revêt plus la même importance, l'architecture étant
différente des autres types de commutateurs : en effet, l’astuce
consiste à remplacer les sélecteurs semi cylindriques ou
à plateau des systèmes précités qui à
la fois tournent horizontalement et accomplissent aussi des mouvements
ascensionnels par de simples commutateurs rotatifs semi-circulaires à
51 plots, dédoublés par une astuce de commutation à
relais, soit un élément de sélection uniquement rotatif
à 102 directions. Ainsi, dans le système ROTATIF 1926, les
éléments ne font plus que tourner horizontalement, et n’accomplissent
jamais de mouvements de haut en bas ou de bas en haut, d’où
un prix de revient moindre que tous les autres systèmes à
organes tournants conçus jusques à présent. Ce système
fut développé par l'Ingénieur français Fernand
Gohorel de la Compagnie des Téléphones Thomson-Houston,
en raison du coût élevé des ROTARY 7A, 7A1 et 7A2
américains. 26 commutateurs ROTATIF 1926 à contrôle
direct sont installés en France, le plus récent est installé
en 1939 à Besançon.
R6 (avec enregistreurs de numéros)
Ce commutateur est mis en conception pour les villes
de province de plus grande importance dès 1930. Ce système
est aussi un hybride qui s'inspire des systèmes Rotary et Strowger,
mais il est simplifié et moins coûteux. Bien qu’étant
plus coûteux qu'un R6 à contrôle direct, il permet
une meilleure souplesse dans l'acheminement des communications, tout en
restant moins performant que les ROTARY 7A, 7A1 et 7A2. Un commutateur
R6 avec enregistreurs est un commutateur R6 à contrôle direct
dont les Orienteurs du premier étage de sélecteurs ont été
remplacés par des enregistreurs de numéros qui commandent
en différé, après analyses des préfixes, les
orienteurs des étages de sélecteurs suivants pour acheminer
de manière plus souple et plus optimale les communications en son
propre sein pour les abonnés locaux, ou vers les centres de transit
pour les abonnés plus éloignés. L'agglomération
Lille-Roubaix-Tourcoing est équipée en premier de ce système
en 1933. Le déploiement du ROTATIF 1926 avec enregistreur de numéros
est totalement interrompu en province dès la déclaration
de guerre, et ne reprendra qu'en 1945. Il se poursuivra jusqu'à
l’arrivée de la version modernisée en 1949.
ROTARY 7D
Ce prototype expérimental est installé
en 1937 à Angers, en vue d'équiper la banlieue de Paris
par la société LMT, mais n'est finalement pas retenu en
France pour déploiement. Il est par contre massivement déployé
dans les campagnes de Grande-Bretagne et constitue un meilleur produit
que notre système automatique-rural en déploiement dans
nos campagnes.
R6 N1 (normalisé type 1)
Ce commutateur à enregistreurs, chacun d'entre
eux étant associé à un seul traducteur séparé
et à relais, est mis en service en France dès 1949 à
Rouen, par la CGCT. Ces commutateurs ROTATIF 1926 Normalisés de
type 1 sont équipés de nouveaux traducteurs aussi efficaces
que ceux des ROTARY 7A1 utilisés dans le réseau parisien,
afin de préparer l’automatisation à venir de l’interurbain
automatique. Le ROTATIF 1926 N1 le plus récent est mis en service
en 1959.
ROTARY 7A normalisé
Il est mis au point sur Paris, (avec réduction
de coût de 15%) en 1949, issu de l'expérience acquise durant
les 21 années d'utilisation en France. Le ROTARY 7A NORMALISÉ
le plus récent est mis en service en 1954.
SRCT
De l'acronyme Service des Recherches et du Contrôle
Technique l'ayant conçu, c'est un petit autocommutateur fabriqué
à partir de matériel R6, de catégorie secondaire
et en conséquence destiné au déploiement dans les
campagnes, dans le but de remplacer le système dit automatique-rural
qui était en fait semi-automatique déployé à
partir de 1935 sur instruction de Georges Mandel, Ministre des PTT. Conçu
par l'Ingénieur en chef des Télécommunications Albert
de Villelongue, le SRCT permet d'automatiser les campagnes. La capacité
typique de raccordement est de 900 lignes d’abonnés. Le premier
SRCT est inauguré à Perros-Guirec en 1950.
L43
De son nom complet LESIGNE 43, c'est un commutateur
utilisant le même matériel que le R6 N1 mais il adopte un
principe de sélection différent, sans dispositif Orienteur.
En effet, dans ce système, les sélecteurs sont actionnés
directement par les enregistreurs, à l’aide d’un réseau
de commande par fils distincts des fils véhiculant les conversations
téléphoniques. Mis en service en France dès juillet
1951 à Nancy. Bien que n’ayant pas été massivement
déployé, ce modèle de commutateur a toutefois permis
une mise en concurrence des différents constructeurs, et amènera
à la mise au point ultérieure d’une nouvelle version
améliorée des commutateurs R6. Un total de 13 commutateurs
L43 est mis en service en France. Le
LESIGNE 43 le plus récent est mis en service en 1960.
ROTARY 7A à chercheurs
Équipé de sélecteurs simplifiés
et modifiés à un seul mouvement imitant le R6, il est implanté
à Belle-Épine, en 1953. Cette variante prototype préfigurant
le ROTARY 7B1.
ROTARY 7B1
Issu du ROTARY 7B conçu aux États-Unis
depuis 1927, il est mis au point en France tardivement par la société
LMT. Beaucoup plus économique que les ROTARY 7A, 7A1 et 7A2, mais
avec une capacité d'écoulement moindre car n'étant
équipé que de sélecteurs à un seul mouvement,
comme le R6. Il est également plus sécurisé face
aux risques d’incendie, grâce au remplacement des isolants
en tissus par des isolants en matières synthétiques. Le
premier est installé à Enghien-les-bains en 1954. Il est
largement déployé dans Paris dès 1955. Le ROTARY
7B1 le plus récent est mis en service en 1971. Les dernières
extensions de systèmes ROTARY 7B1 déjà installés
auparavant ont été commandées en septembre 1978.
R6 N2 (normalisé type 2)
Commutateur dont l'ensemble des enregistreurs n'utilise que deux traducteurs
séparés et à relais, il est issu des évolutions
du L43, mis en service en France dès 1958 à Poitiers et
Boulogne, par la CGCT et par l'AOIP. Le ROTATIF 1926 N2 le plus récent
est mis en service en 1962. Les dernières extensions de systèmes
R6 déjà installés auparavant ont été
commandées en octobre 1978, pour équiper des départements
où le plan de numérotation ne dépassait pas six chiffres.
CENTRAL AUTOMATIQUE TOUT RELAIS, à commutation
entièrement effectuée avec des tables de relais, sans organe
tournant : le précurseur en France qui préfigure le Crossbar.
Fabriqué par la Compagnie Générale de Télégraphie
et Téléphonie, mis en service en 1927 à Fontainebleau,
capable de gérer jusqu'à 1000 abonnés, qui s'avère
ultérieurement trop coûteux et trop complexe à entretenir
et à étendre. Il est finalement remplacé en 1943.
CENTRAUX CROSSBAR
PENTACONTA Système entièrement nouveau, conçu par
les sociétés LMT et CGCT, toutes deux filiales françaises
de l'américain ITT. La conception de ce système doit beaucoup
à l'ingénieur Fernand Gohorel qui supervise l'invention
du Multisélecteur à barres croisées. Le radical «
Penta » signifie que les abonnés sont regroupés par
modules primaires de 50. Il s'avère le système électromécanique
pourvu des meilleures capacités d'écoulement du trafic ;
il est retenu pour les très grandes villes françaises pour
cette raison, ainsi que pour les centres de transit interurbains de nouvelle
génération. Chaque commutateur PENTACONTA, bien qu'électromécanique,
possède quelle que soit son importance une chaîne d'enregistrement
des incidents dont le rôle est d'éditer automatiquement une
carte perforée qui détaille le défaut, chaque fois
que le système constate une faute de fonctionnement ; progrès
remarquable pour l'époque où les microprocesseurs ne sont
pas encore inventés. Nous pouvons facilement reconnaître
un commutateur PENTACONTA, par ses éléments sélecteurs
de base qui comportent toujours de manière apparente 14 barres
horizontales. Nous parlons d'ESL pour Équipements de Sélection
de Ligne d'abonné pour un PENTACONTA utilisé en commutateur
d'abonnés, et d'ESG pour Équipements de Sélection
de Groupe pour un PENTACONTA utilisé en centre de transit intercentraux.
289 commutateurs PENTACONTA sont mis en service en France. Le dernier
commutateur électromécanique de type PENTACONTA est commandé
en France en juin 1978, et les dernières extensions sont commandées
en juin 1979. Le dernier commutateur PENTACONTA d’Île-de-France,
celui de Paris-Brune Chaîne Jeux est démonté le dernier
trimestre 1994 et le dernier commutateur PENTACONTA de France, est démonté
à Givors le 6 décembre 1994.
PENTACONTA type 500 (Multisélecteur à 500
points de sortie au niveau des ESL), concernant la France, il est implanté
pour la première fois à Melun le 23 juillet 1955. Ce système
est capable de gérer jusqu'à 17.000 abonnés.
PENTACONTA type 1000 A (Multisélecteur à 1040 points de
sortie au niveau des ESL) dont le premier exemplaire est mis en service
à Albi en 1959.
PENTACONTA type 1000 B (Multisélecteur à 1040 points de
sortie au niveau des éléments ESL et à 1040 points
de sortie au niveau des ESG), développé dans les années
soixante, pour permettre de traiter jusqu'à 50.000 abonnés
ou circuits par cœur de chaîne et pourvoir Paris et les très
grandes villes françaises. Paris en est équipé dès
le 21 janvier 1964.
PENTACONTA CT4 (Centre de Transit 4 fils). Apparu en 1966, fait partie
de la nouvelle génération d'autocommutateurs de transit
interurbains construite à partir du matériel Pentaconta,
mais à commutation sur 4 fils (au lieu de 2 fils). 11 commutateurs
PENTACONTA CT4 ont été déployés en France.
NGC (Nodal de Grande Capacité), de la nouvelle génération
d'autocommutateurs interurbains, est construit à partir du matériel
Pentaconta à commutation sur 2 fils. Le premier des 5 commutateurs
NGC est mis en service en février 1972 en France, à Lyon.
Les NGC sont, avant les évolutions ultérieures, équipés
de Traducteurs Quasi Électroniques (matrices à diodes et
transistor - en totalité abandonnés dès 1975, pour
être remplacés par des Traducteurs Impulsionnels à
Tores encore plus rapides à commuter). Le NGC de Paris St-Lambert
est le premier à être équipé des nouveaux Traducteurs
Impulsionnels à Tores dès sa mise en service le 3 juin 1972.
PENTACONTA type 1000 C (Multisélecteur à 1040 points de
sortie au niveau des ESG). Conçu en 1965 aux États-Unis.
Utilisé en France pour les GCI (Grand Centre de communication Interurbain)
de la nouvelle génération d'autocommutateurs interurbains
destinés à remplacer la génération à
organes tournants, mais à commutation sur 4 fils, avec même
sélecteur mais mise en œuvre différente pour un écoulement
du trafic encore amélioré. Le premier des 32 commutateurs
GCI est mis en service en décembre 1973 en France, à Marseille.
Ils sont équipés de Traducteurs à Programme Câblé,
dérivés des Traducteurs Impulsionnels à Tores, mais
plus adaptés au type de structure des GCI. Avec les débuts
de l'informatique, certains GCI sont ensuite équipés dès
1974 de Traducteurs à Programme Enregistré, et d'une interface
homme-machine informatique primitive comme celui de Marseille St Mauront.
D'ailleurs, les TPE ont vocation à remplacer rétroactivement
les autres types de traducteurs sur les pentaconta et autres CP400 appelés
à ne pas être remplacés rapidement par du matériel
de future génération. Il s'agit d'un nouveau type de Pentaconta
très évolué pour l'époque qui commence à
devenir substantiellement électronique par la création des
Unités de Commande Électroniques en remplacement des Unités
de Commande Électromécaniques initiales.
PENTACONTA type 2000 (Multisélecteur à 2080 points de sortie
au niveau des ESG). Il est aussi bien utilisé en commutateur d’abonnés
de grande capacité (50.000 lignes) qu’en CTU (Centre de Transit
Urbain), essentiellement pour Paris puis Lyon en 21 exemplaires. Il est
construit à partir du matériel Pentaconta à commutation
sur 2 fils. Le premier CTU est inauguré en 1968 à Paris.
Ce Pentaconta accorde une grande part à l'électronique et
sera l'objet d'évolutions, y compris informatiques. Le Pentaconta
2000 dispose d'une interface homme-machine par clavier et console informatique
primitive. Comme le type précédent, le Pentaconta 2000 est
très évolué pour l'époque par l'innovation
des Unités de Commande Électroniques en remplacement des
Unités de Commande Électromécaniques initiales. Il
est mis en service afin de dégorger le trafic dans les très
grandes villes françaises, en attendant l'arrivée des centres
de transit électroniques spatiaux et temporels prévus les
années suivantes.
CP400, (nom complet : CROSSBAR pour PARIS ou CROSSBAR PARISIEN 400) est initialement prévu pour équiper Paris et la 1re couronne. Un prototype à commande centralisée mis en place en France dès le 31 mars 1956 à Beauvais, est issu de la Société Française des Téléphones Ericsson de Colombes. Les CP400 sont pourvus de 400 points de sortie au niveau des Éléments de Sélection de Ligne d'abonné et/ou des Éléments de Sélection de Groupe. Bien que le Directeur Général des Télécommunications de cette époque, Jean Rouvière bataille pour ne pas retenir ce nouveau type de commutateur téléphonique moins performant que le PENTACONTA. Il doit cependant s'incliner en 1957, pour raison économique : le CP400 étant moins coûteux. Finalement, et malgré sa dénomination initiale, le CROSSBAR PARISIEN 400 sera massivement retenu pour équiper les villes moyennes de province… Après une série de différentes versions, il faut attendre l’année 1973 pour que des commutateurs d’abonnés CP400 soient enfin installés dans Paris intra-muros après réalisation des adaptations nécessaires. Le dernier commutateur de type CP400 est commandé en avril 1979 et les dernières extensions sont commandées en novembre 1979 en CP400. Le dernier CP400 de France est démonté à Langon en 1994. Nous pouvons facilement reconnaître un commutateur CP400, par ses éléments sélecteurs de base qui comportent toujours de manière apparente 6 barres horizontales pour 10 barres verticales.
CP400-PÉRIGUEUX. S'ensuit la présérie
de 5 commutateurs CP400-Type PÉRIGUEUX améliorés,
installée dès 1960 à Périgueux.
CP400-ANGOULÊME. Arrive la première série de production
en masse encore améliorée de 115 commutateurs de ce nouveau
type en 1962 avec le premier d'entre eux installé à Angoulême.
Leur capacité peut atteindre 10.000 abonnés. Les commutateurs
CP400-ANGOULÊME sont déployés jusqu’en 1970.
CP400-BRIE-COMTE-ROBERT. Prototype révolutionnaire mis au point
par le prolifique ingénieur des télécommunications
A. de Villelongue et ouvert en 1967, il s'agit du premier commutateur
à signalisation intercentre à Multi Fréquences, au
lieu de la signalisation par impulsions décimales jusqu'alors utilisée.
Gain de temps dans l'acheminement et fiabilisation accrus des communications,
notamment longue distance, avec augmentation de l'écoulement du
trafic. Tous les CP400 précédemment installés sont
rétroactivement convertis à cette nouvelle signalisation,
ainsi que les Pentaconta. Le dernier CP400 est démonté à
Langon en 1994.
CP400-BOURGES. En 1968, la mise au point d'un nouveau prototype installé
à Bourges voit le jour d’une capacité de 8.000 abonnés
destiné aux petites villes.
CP400-TROYES. Puis en 1969, une nouvelle série encore améliorée
de 22 commutateurs CP400-Type TROYES dont le premier est installé
à Troyes. Leur capacité peut atteindre 20.000 abonnés.
Les commutateurs CP400-TROYES sont déployés jusqu’en
1970.
CP400-AJACCIO. En 1969 également, une nouvelle série avec
d'autres améliorations issues du CP400-BOURGES voit le jour à
destination des villes moyennes. Au moins 29 commutateurs de ce type sont
ainsi déployés au 1er janvier 1972.
CP400-CT4 (Centre de Transit 4 fils). Apparu également en 1969
en premier à Grenoble et Tours, fait partie de la nouvelle génération
d'autocommutateurs de transit interurbains construite à partir
du matériel CP400, mais à commutation sur 4 fils. 24 commutateurs
CP400-CT4 ont été déployés en France.
CP400-CUPIDON (Centre Universel Pour l’Interurbain Dans l'Organisation
Nouvelle puis Centre Universel Permettant l’Interconnexion Dans une
Organisation Nouvelle). Puis arrive en 1970 la nouvelle version CP400-CUPIDON
encore améliorée à partir des perfectionnements des
types ANGOULÊME et TROYES, avec de meilleures capacités de
souplesse et d’écoulement de trafic. Leur capacité
peut atteindre 30.000 abonnés. Arrivée très retardée
par la mort brutale de l'ingénieur Albert de Villelongue en août
1967. 415 commutateurs CP400-CUPIDON sont installés en France.
CP400-POISSY. Enfin, dès 1972, une nouvelle série améliorée
est inaugurée à Poissy, dénommée CP400-POISSY,
directement dérivée du CP400-CUPIDON et qui est l'ultime
perfectionnement, en France de ce système suédois, avec
l'adjonction d'un étage supplémentaire d'Aiguilleurs. Le
CP400-POISSY permet de prendre en charge jusqu'à 40.000 abonnés
voire 50.000 par cœur de chaîne à l’aide de certaines
extensions supplémentaires. Il est pourvu de Traducteurs À
Tores (magnétiques), qui permettent de traduire jusqu'à
1000 directions différentes. Ces nouveaux traducteurs sont même
généralisés rétroactivement sur les CP400
précédents ainsi que les PENTACONTA, et même sur certains
ROTARY encore en service en 1972. 322 commutateurs CP400-POISSY sont installés
en France.
CP100, (nom complet : CROSSBAR pour PARIS ou CROSSBAR
PARISIEN 100) est un autocommutateur simplifié, de taille réduite,
dérivé directement du CP400 conçu à l’origine
pour une capacité maximale de 3.000 abonnés. En raison de
son coût réduit, il est utilisé pour automatiser les
campagnes et les très petites villes de France en version typique
de 400 abonnés, ainsi qu’à remplacer les autocommutateurs
SRCT vieillissants. Ils sont déployés massivement en France
à partir de 1964.
|
TOURISME BALNÉAIRE ET TÉLÉPHONE DANS LE CALVADOS 1880 - 1914 Yves Lecouturier Quoi de plus naturel de nos jours de téléphoner
pour réserver son séjour dans un lieu de vacances. Mais
à la fin du siècle dernier et au début du XXe siècle,
le tourisme balnéaire affirmait son développement tandis
que le téléphone balbutiait. C'est sous la Restauration
que naît la pratique des séjours à la mer et celle-ci
se développe sous le Second Empire sous l'impulsion de la bourgeoisie
d'affaires et avec l'apparition du chemin de fer. Gabriel Désert
écrit qu'en 1894 « la Côte Fleurie a dès lors
une situation ferroviaire privilégiée qui est, sans aucun
doute, l'un des éléments de la prospérité
qu'elle connaîtra à la fin du siècle ». Lors de la session d'août 1899, le Conseil Général
est saisi d'un projet de création d'un réseau téléphonique
départemental par le Sous-Secrétariat d'Etat aux Postes
et Télégraphes : « la France n'a pas jusqu'ici profité,
aussi largement que ses voisins, des facilités nouvelles qu'offre
ce merveilleux moyen de communication pour les relations d'affaires et
de famille ». Quant au financement, l'Administration propose la
participation du Conseil Général « dans une large
mesure », des Chambres de Commerce, des Compagnies de Chemin de
Fer de l'Ouest et de Caen à la mer, « en raison des intérêts
qu'elles ont dans la région du littoral », des Caisses d'Epargne
et de Groupements de Souscripteurs. Nous ne possédons que quelques résultats
financiers — du quatrième trimestre 1905 au troisième
trimestre 1909 — mais ceux- ci sont suffisamment éloquents.
Quatre pointes sont perceptibles sur le graphique et concernent toutes
les quatre le troisième trimestre, c'est-à-dire celui de
la saison balnéaire. Si en 1906 la pointe reste limitée,
en revanche, les années suivantes sont exemplaires : en 1907 et
1908, les produits du troisième trimestre représentent le
tiers des produits annuels. La croissance des troisièmes trimestres
est plus forte en 1907 que la croissance annuelle, mais à partir
de 1908, du fait de l'extension du réseau départemental,
la croissance annuelle l'emporte. Désormais tous les nouveaux circuits partent de
Deauville : en octobre 1913, le Conseil Général donne un
avis favorable pour l'établissement de circuits de dégagement.
« dont la construction est nécessitée par le développement
du trafic de Deauville », en direction de Rouen, Cabourg et Villers-sur-Mer
; les circuits 5 et 6 avec Trouville sont aussi projetés. L'Administration
des Postes et Télégraphes peut ainsi répondre sur
les conditions d'exécution du service téléphonique
pendant la saison balnéaire : « il a été reconnu
nécessaire de libérer Deauville de l'intervention de Trou-
ville et pour ce faire de la doter de plusieurs voies directes de dégagement
». Le succès de Deauville est si rapide qu'un second circuit
en direction de Paris est nécessaire. Lors de la session du Conseil
Général, en avril 1914, le Préfet justifie aussi
cette demande : « afin de remédier autant que possible à
l'encombrement qui se produit à certains moments à Deauville
pendant la saison balnéaire, le service des Postes a, depuis votre
dernière session, saisi mon administration d'un projet de création
d'un deuxième circuit Paris-Deauville ». La ville de Deauville
ayant, comme à son habitude, pris en charge la totalité
de l'annuité, le Conseil Général donne son autorisation,
précisant qu' « il serait d'un grand intérêt
que ces travaux fussent exécutés avant l'été
». Du fait de la guerre, la construction de ce circuit n'interviendra
qu'en 1921. Ces besoins ne concernent pas tant de nouveaux circuits que l'amélioration des circuits existants. Rapidement saturés pendant la saison balnéaire, certains doivent être doublés, ainsi Trouville- Paris en 1912. En novembre 1912, le Conseil municipal de Cabourg réclame un deuxième circuit en direction de Caen : « la création d'un doublement de l'unique circuit Caen-Cabourg améliorera considérablement nos relations avec les environs et même avec Paris et la ville de Caen pourra nous être donnée avec quelques minutes d'attente au lieu de 3 ou 4 heures comme cela est arrivé pendant la saison balnéaire ». Ce second circuit est mis en service le 10 juillet 1913. La pression de la saison balnéaire est constamment déterminante. Alors que la participation de la ville de Caen était sollicitée pour les circuits Caen-Cabourg 2 et Caen-Lisieux 2, un conseiller caennais s'exclamait : « cela profitera surtout aux baigneurs ». Bayeux, en 1911, réclame le doublement de son circuit vers Caen, l'unique devant faire face pendant la saison estivale « à un trafic particulièrement actif». Afin de soulager le circuit Caen-Luc, un circuit Caen-Cour- seulles est demandé en 1912 « pour éviter l'encombrement qui, pendant la saison estivale, rendait très difficiles les communications et donnait lieu à de nombreuses et justes réclamations de la part des abonnés et du public ». La Chambre de Commerce de Caen et les villes de Caen, Courseulles, Saint- Aubin-sur-Mer et Bernières participent au service de l'annuité, mais Luc refuse préférant la solution du doublement du circuit Caen-Luc « qui rendrait de très grands services à toutes les stations de Ouistre- ham à Courseulles indistinctement ». Caen-Courseulles est mis en service le 20 mai 1913. Quelques circuits consacrent l'existence de nouvelles cités balnéaires : en 1913 Houlgate est reliée à Cabourg et à Villers-sur-Mer, et cette dernière à Blonville. En août 1912, le Conseil Général examine un nouveau projet d'extension du réseau départemental : sur les 62 circuits projetés, un seul concerne le littoral (Merville-Cabourg). Ce projet démontre que le littoral calvadosien a bénéficié du téléphone bien avant le reste du département. Si Deauville et Trouville sont les deux principaux centres balnéaires, les localités situées entre Bernières et Ouistreham n'en sont pas moins actives. En août 1912, c'est-à-dire en pleine saison, le Conseil municipal de Ouistreham réclame un circuit direct avec Caen car « il est presqu'impossible aux abonnés du téléphone de profiter de leur abonnement à cause de la longueur de temps mise à leur donner la communication avec Caen ». En juin 1913, le Directeur départemental plaide pour un circuit Bénouville- Ouistreham « cette dernière localité étant en situation particulièrement défavorable pour l'écoulement de son trafic téléphonique ». En juin 1914, il propose une réorganisation technique « en vue de faciliter l'exploitation des divers circuits téléphoniques dont l'établissement est prévu ». Les réseaux de Courseulles, Bernières, Saint-Aubin, Langrune et Luc sont groupés de façon à constituer des communications directes : Caen-Bernières-Cour- seulles, Caen-Langrune-Saint-Aubin, Caen-Luc 1 et 2, Courseulles- Bernières-Saint- Aubin et Saint- Aubin-Langrune-Luc. La même lettre propose les circuits Caen-Bénouville-Ouistreham, Villers-sur- Mer-Blonville-Trouville et Cabourg-Houlgate- Villers-sur-Mer. A la veille de la Première Guerre Mondiale, chaque station balnéaire dispose d'au moins un circuit direct ou indirect avec Caen. Les stations les plus fréquentées, Deauville et Trouville, sont directement reliées à Rouen et Paris. Les abonnés du littoral représentent plus du tiers des abonnés du département. En 1905, Trouville et Deauville possèdent 95 abonnés et Caen 187, mais en 1914, les deux cités balnéaires comptent 537 abonnés et Caen 601. Le nombre d'abonnés de la Côte Fleurie est multiplié par cinq entre 1905 et 1914 alors que celui du département ne l'est que par 4,4. Les effectifs augmentent rapidement, mais la qualité de service apparaît mauvaise, voire déplorable. Ainsi lors de la session du Conseil Général, en octobre 1912, le Préfet propose de nouvelles lignes « pour faire face au surcroît de trafic qu'elles ne suffisent plus à assurer » constatant « une insuffisance à peu près générale ». Chaque nouvelle demande est presque toujours justifiée par l'impossibilité d'écouler le trafic pendant la saison balnéaire : la durée d'attente pour Paris varie de 3 à 5 heures, voire plus ! En 1914, l'équipement téléphonique du littoral calvàdosien existe, mais sa situation reste fragile : beaucoup reste à faire pour améliorer le réseau. Le téléphone s'est développé sous la pression des villégiaturistes et des commerçants locaux, mais aussi avec le concours obligatoire des notables conservateurs du Conseil Général. Yves LECOUTURIER |
Les premiers développements du téléphone
en Lorraine (1885-1914) Jean-Paul Martin
|
Le téléphone apparaît en France
vers 1880 dans un environnement économique, socio-culturel
et politique peu favorable à son adoption. Conscient du risque d'une croissance anarchique,
l'Etat se tourne vers le Département et décide en
1900 d'en faire son unique interlocuteur. (2) Les abonnements sont de 2 types : Par le mode de financement qu'il a mis en place,
l'Etat a confié l'avenir du téléphone aux notables
locaux. Pour reconstituer les premiers développements
du réseau téléphonique en Lorraine, nous avons
relevé année par année dans les archives de
l'administration des Postes et les Recueils des Actes administratifs
départementaux les données suivantes : Les municipalités urbaines et les petits centres textiles dont les conseils municipaux sont dominés par le patronat local répondent favorablement et votent les avances nécessaires à l'installation d'un réseau local. Il faut voir dans cette convergence d'initiatives l'explication de l'avance prise par le département des Vosges avant 1900 : 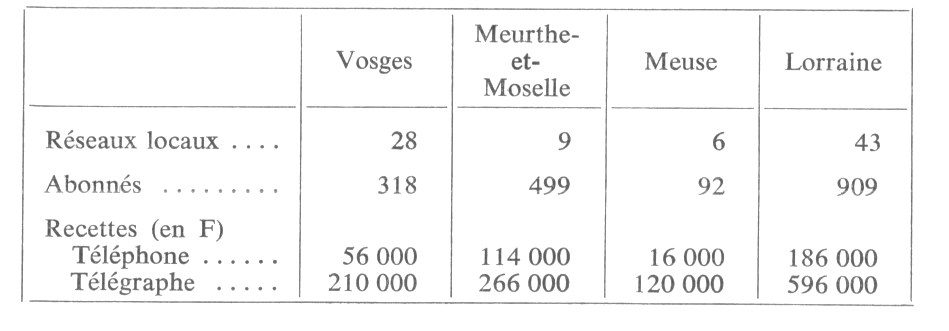 Tableau I. - L'état d'avancement du réseau téléphonique en Lorraine en 1899 Dès 1895 et mieux encore en 1900, on observe
dans les Vosges l'amorce d'un réseau départemental
centré sur Epinal et déjà réticulé
au plan local (carte des circuits téléphoniques en
1900). Durant cette phase où le rôle d'impulsion
est laissé aux particuliers, ce sont les milieux d'affaires
qui sont les vecteurs de diffusion du téléphone. Celui-ci
se diffuse lentement au gré des, initiatives locales et sa
croissance n'est pas encore suffisamment forte pour que s'accusent
les disparités intrarégionales. Une demande potentielle
existe soutenue à la fin du siècle dernier par une
forte croissance des activités industrielles et commerciales,
mais les milieux d'affaires, à l'exception des industriels
vosgiens, n'ont pas réussi à faire passer leurs demandes
auprès des instances départementales. Trois traits caractérisent le développement
du téléphone durant cette phase : un développement
programmé mis en œuvre par les départements,
une croissance rapide accompagnée d'une large diffusion au
plan local, un développement inégal d'un département
à l'autre. Dans les Vosges et la Meurthe-et-Moselle, le développement
du téléphone s'inscrit dans un contexte d'expansion
économique porteur d'une demande autrement plus forte que
dans un département rural et peu urbanisé comme la
Meuse. Les milieux d'affaires intéressés par la construction
des grands circuits interurbains forment des groupes de pression
suffisamment puissants pour que leurs demandes soient prises en
considération par les instances départementales et
inscrites dans les programmes d'extension. Entre 1900 et 1910, le Département des Vosges
a lancé huit emprunts d'un montant global de 2 millions de
francs. Après un effort initial important — deux emprunts
en 1900 de 350 000 F chacun pour la reprise des lignes existantes
et le lancement du premier programme d'équipement —
les sommes allouées au téléphone diminuent
régulièrement : 110 000 F en 1906, 100 000 F en 1908
et 40 000 F en 1910 (7). Or à cette date, l'administration reverse
au département 100 000 F par trimestre à titre de
remboursement des anciennes avances. Elles se voient aussi dans l'obligation, lorsqu'elles
ne possèdent pas de service postal ou télégraphique,
de fournir le local de la cabine, le mobilier de bureau et surtout
de verser les allocations annuelles du gérant et du piéton
distributeur des messages téléphonés. Aucun plan de développement suivi à
court ou moyen terme n'a présidé à l'extension
du réseau téléphonique en Lorraine durant cette
période.
La création de ces grands circuits a permis
de réserver les lignes existantes aux communications intrarégionales
et par conséquent de renforcer la position centrale d'Epinal
et de Nancy dans l'organisation interne du réseau téléphonique
lorrain. La mise en service de circuits de jonction interdépartementaux
a aussi permis d'améliorer les liaisons intra régionales,
mais il s'agit dans presque tous les cas de circuits d'intérêt
local : Vézelise-Mirecourt, Bar-le-Duc-Saint-Dizier, Montmédy-Longuyon,
Charmes-Bayon, Saint-Dié-Nancy, etc. Par contre la frontière
d'Alsace-Lorraine a constitué une coupure autrement plus
puissante que les limites départementales. C'est aussi dans les limites cantonales que s'est
effectuée l'extension du réseau téléphonique
au plan local (fig. 7 et 8 : cartes des communes dotées du
téléphone en 1900 et 1914). Mais comme le souligne le Directeur départemental
des Postes de Meurthe-et-Moselle en 1922, les téléphone
en 1900. nécessités d'administration
ne correspondent pas toujours à la logique économique.
On ne saurait mieux résumer les contraintes
qui ont pesé sur les premiers développements du téléphone
en Lorraine à la fin du siècle dernier. Jean-Paul Martin E.R.A. 214 du C.N.R.S. Université L.-Pasteur Strasbourg |
sommaire
1932 Le téléphone
et les transactions internationales,
A.Albenque
| — Le téléphone joue un rôle
de plus en plus important dans les transactions internationales. Deux grandes commissions suivent de près le développement de ce mode de communication et étudient sans cesse les améliorations à apporter dans ce domaine : - le Comité international des communications téléphoniques a grande distance, qui représente surtout les intérêts des administrations ou entreprises qui assurent les services téléphoniques ; - la Commission de la téléphonie internationale, créée en 1925, lors du troisième Congrès de la Chambre de Commerce internationale, tenu à Bruxelles à cette date ; cette commission représente surtout les intérêts des usagers du téléphone. Des travaux de ces comités, il résulte
que, dans le monde, les États-Unis de l'Amérique du
Nord sont le pays où l'on emploie le plus souvent les communications
téléphoniques : 230,7 communications par an et par
habitant. Le morcellement politique est évidemment
responsable de l'infériorité du continent européen.
Pourtant de sensibles progrès viennent d'être
réalisés en Europe. |
sommaire
Pour illustrer l'évolution majeure de la
commutation dans les années 1950, voici deux études : la
première des laboratoires Bell qui ont étés les pionniers
dans le domaine, puis la deuxième vision concernat la France en
particulier.
I
- Aux Etats-Unis - LA REPRÉSENTATION
DE BELL LABS SUR LA COMMUTATION COMME INFORMATIQUE (OU PAS)
de KIM W. TRACY , ROSE-HULMAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY .
À la fin des années 1920, il
était clair que pour que le réseau téléphonique
puisse évoluer, davantage d'automatisation était nécessaire
pour prendre en charge le réseau téléphonique en
pleine croissance. Dans les années 1930, Stibitz et d'autres ont
commencé à travailler sur la construction d'une série
de machines à relais pour prendre en charge divers aspects de cette
automatisation. À la fin des années 1940, il devenait clair
pour les Bell Labs que la commutation était une forme de calcul
et que l'automatisation informatique serait nécessaire pour répondre
au besoin croissant d'évolutivité du réseau téléphonique.
Mon affirmation est que les Bell Labs ont continué à croire
que la commutation était un calcul, mais l'ont dépeint différemment
au fil du temps en raison de pressions réglementaires et juridiques
externes dues au statut de monopole du système Bell.
Ce document couvre l'évolution de la vision des Bell Labs
et la représentation de la commutation au fil du temps.
En examinant des articles présentés par Bell Labs et d'autres
documents internes, je compare la façon dont la commutation a évolué
d'un problème « informatique » pour être
présentée comme un « contrôle de programme
enregistré » de la commutation.
Cette séparation de l'informatique est devenue urgente car le décret
de consentement de 1956 a rendu difficile pour le système Bell
de poursuivre toute activité autre que le système téléphonique
et les contrats militaires.
Les Bell Labs ont continué à produire de nombreux systèmes
informatiques à l'appui du système téléphonique,
mais ont continué à faire attention à la manière
dont cela était présenté au public. De plus, lorsque
le réseau téléphonique est passé des systèmes
de commutation analogiques aux systèmes de commutation numériques,
les Bell Labs ont continué à promouvoir le contrôle
des programmes stockés même s'il est devenu encore plus informatisé.
Dans le même temps, Bell Labs et AT&T ont non seulement continué
à faire d'importantes recherches en informatique, mais ont intensifié
leurs efforts pour pénétrer plus pleinement le marché
de l'informatique, comme avec son achat de NCR en 1991.
1. Introduction
Les Bell Labs étaient désireux d'appliquer les technologies
informatiques et électroniques en évolution au système
Bell, en particulier pour permettre au système Bell d'être
en mesure de gérer les demandes en croissance rapide sur le réseau
téléphonique. Au milieu des années 1940 et dans les
années 1950, les Bell Labs avaient entrepris de multiples efforts
pour déterminer comment la commutation électronique pouvait
être développée.
À la fin des années 1940, le groupe de recherche sur la
commutation dirigé par Deming Lewis étudiait l'utilisation
du PCM (Pulse Code Modulation) comme moyen de numériser la parole
et de construire des systèmes pour tirer parti de l'électronique
non seulement pour les systèmes de contrôle, mais aussi pour
la commutation, notamment dans l'ESSEX (Experimental Solid State Exchange).
Depuis que le transistor a été récemment inventé
en 1947, il y avait un empressement à appliquer cette technologie
une fois qu'elle deviendrait suffisamment fiable pour remplacer les tubes
à vide, qui étaient considérés comme moins
fiables et gourmands en énergie que les relais. D'autres efforts
de Bell pour appliquer l'électronique à la commutation téléphonique
sont venus du groupe Bell Labs Systems Engineering, dirigé par
Ken McKay. Ces efforts d'ingénierie des systèmes ont été
réalisés dans ce qui est devenu le système ESS n
° 1 installé pour la première fois à Morris,
dans l'Illinois en 1960.
Des pressions externes ont également été exercées
avec le décret de consentement de 1957 interdisant effectivement
à AT&T de concourir dans le secteur informatique. Il
fallait donc s'assurer que la commutation téléphonique ne
soit pas perçue comme une activité informatique. Les Bell
Labs ont produit un certain nombre d'histoires liées à leurs
contributions à l'informatique.
Une histoire récemment redécouverte à partir de 1961
avait une longue histoire de commutation par rapport aux histoires ultérieures.
Le reste de cette histoire interne de 1961 était très similaire
dans son contenu aux efforts ultérieurs. En conséquence,
cette divergence avec la façon dont la commutation téléphonique
était incluse (ou non) dans l'histoire informatique des Bell Labs
m'a incité à rechercher si le changement dans la façon
dont la commutation téléphonique était représentée
de l'informatique à être qualifié de contrôlé
par programme stocké.
2. Histoires informatiques des laboratoires Bell
Le premier document décrivant les contributions des laboratoires
Bell à l'informatique est un rapport interne de 71 pages des laboratoires
Bell datant de 1961. (WD Lewis éd. Contributions du système
Bell aux ordinateurs et au traitement de l'information. Mémorandum
interne des laboratoires Bell, apparemment non publié, 10 juillet
1961).
Ce document comporte une section détaillée (5 pages incluant
les références) sur la commutation téléphonique
ainsi que d'autres sections sur les domaines de l'informatique qui sont
restés dans l'histoire ultérieure des Bell Labs. Ce document
non publié semble être un rapport préparé pour
Ken G. McKay (vice-président de l'ingénierie des systèmes
de 1959 à 1962) et William (Bill) O. Baker (alors vice-président
de la recherche des Bell Labs et plus tard président des Bell Labs).
"Le système Bell n'est pas dans le domaine de l'informatique
commerciale", a-t-il déclaré et expliqué plus
en détail : il s'intéresse de plus en plus à
la commutation électronique, à la transmission de données
et aux techniques numériques pour la transmission de la voix et
de la télévision. Elle doit aussi continuer à assumer
les tâches militaires pour lesquelles elle est particulièrement
qualifiée. Pour ces raisons, il continuera d'être un contributeur
majeur dans les domaines du calcul numérique et du traitement de
l'information.
Le document d'histoire de l'informatique de 1961 a été édité
par W. Deming Lewis, qui dirigeait la recherche sur la commutation et
les sections sont rédigées par ceux qui ont joué
un rôle principal dans les technologies qu'ils décrivent.
Au moment de ce document, Baker était vice-président pour
la recherche (de 1955 à 1973) et soutenait également la
recherche informatique en tant que vice-président. Ce document
a été trouvé par Ed Eckert comme la demande de cet
auteur en novembre 2021 dans les papiers de Bill Baker à Murray
Hill avec les initiales de Baker et de Ken McKay en haut. Bill Baker a
ensuite fortement soutenu la recherche informatique pendant son mandat
de président des Bell Labs (1973-1979).
Des histoires ultérieures pour commémorer le 50e anniversaire
de la fondation des Bell Labs en 1925 ont été créées
au début des années 1980. Ces histoires comprenaient un
document interne sur le rôle des Bell Labs dans l'informatique par
Holbrook et Brown qui a ensuite été développé
par Brown, Holbrook et Doug McIlroy pour un public externe. Ce dernier
document a également été quelque peu révisé.
Tous ces documents ultérieurs ne disent presque rien sur la commutation
téléphonique, par rapport à l'Histoire de 1961.
De plus, Amos Joel, Jr. (que nous avons appelé le père de
la commutation électronique au sein des Bell Labs) a également
édité le volume d'histoire de la commutation de 1982 de
A History of Engineering and Science in the Bell System. Joel a joué
un rôle important dans la transition de la commutation téléphonique
vers l'utilisation de l'électronique, en particulier dans la création
du bureau central électronique Morris (ECO) et du système
de commutation électronique n ° 1 (ESS). Par conséquent,
l'histoire de la commutation téléphonique est devenue complètement
séparée de l'histoire de l'informatique dans ces livres
publiés à l'extérieur et même dans le folklore
interne des Bell Labs.
3. La commutation électronique
aux Bell Labs
Les Bell Labs ont fait plusieurs incursions pour intégrer l'électronique
dans la commutation. Avant la commutation électronique, les systèmes
pas à pas et crossbar étaient les principales plates-formes
de commutation téléphonique électromécanique.
Dans les années 1940, Bell a commencé à envisager
d'utiliser l'électronique pour automatiser la commutation. Après
1947, le transistor était considéré comme encore
plus prometteur que les tubes à vide. L'une des principales décisions
était d'automatiser ou non entièrement le réseau
de commutation avec l'électronique. L'automatisation du réseau
de commutation nécessiterait de passer à quelque chose comme
le multiplexage temporel (TDM) et donc d'abandonner l'utilisation de connexions
physiques de bout en bout (alors appelées «commutation par
répartition spatiale») à l'aide de commutateurs électromécaniques.
L'utilisation de TDM serait plus facilement activée en encodant
les signaux dans quelque chose comme PCM (Pulse Code Modulation) qui utilisait
l'échantillonnage pour traduire les appels vocaux analogiques en
flux binaires de données.
Pour une chronologie approximative des premiers efforts de commutation
électronique aux Bell Labs assemblés par cet auteur, veuillez
vous référer à la figure suivante :
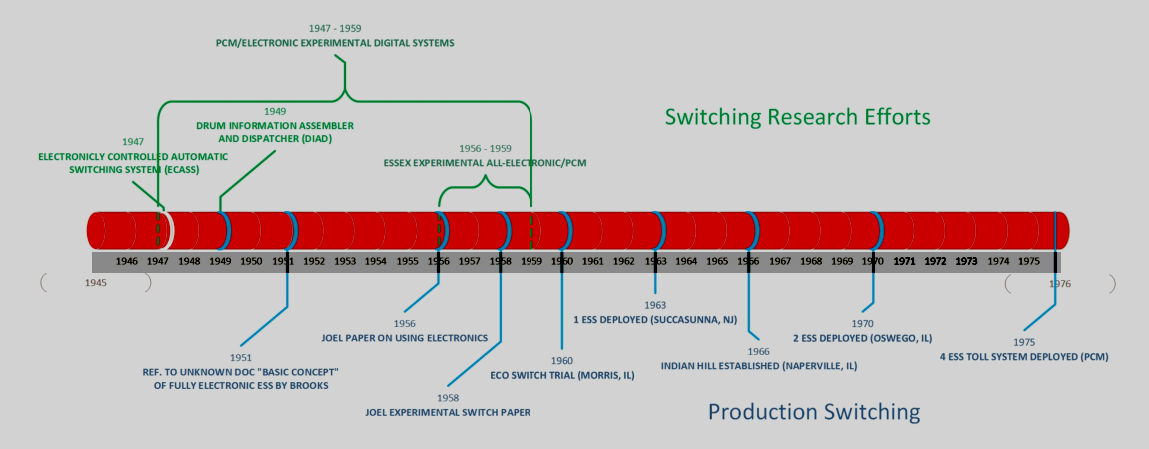
Cette chronologie est séparée en efforts déployés
par l'unité de recherche en commutation (notés en vert et
au-dessus de la chronologie) et les efforts de commutation de production
menés par l'unité d'ingénierie des systèmes
(notés en bleu et en dessous de la chronologie).
Commençant en 1947, le premier effort fut le système de
commutation automatique à commande électronique (ECASS)
qui utilisait des tubes thermioniques (sous vide), des relais secs et
des diodes à gaz à cathode froide pour remplacer les opérateurs
humains.
L'ECASS a continué à utiliser des connexions physiques de
bout en bout, plutôt que de les remplacer par TDM et PCM.
Un système téléphonique automatique utilisant une
mémoire à tambour magnétique, le Drum Information
Assembler and Dispatcher (DIAD) en 1949 a commencé à ressembler
étroitement à un système informatique en utilisant
une mémoire et une commande électronique séparées.
Le DIAD "peut être considéré comme une sorte
d'ordinateur". DIAD a utilisé environ 1 100 tubes à
vide et 2 200 diodes au germanium.
L'unité de recherche sur la commutation a également participé
au développement du PCM, le considérant comme la clé
du multiplexage temporel. L'Experimental Solid State Exchange (ESSEX)
de la recherche sur la commutation a mis en œuvre le PCM dans un
système entièrement à semi-conducteurs qui comprenait
les éléments de commutation.
L'ESSEX a démontré que de tels systèmes entièrement
électroniques étaient réalisables et pouvaient être
considérés comme une forme spécialisée d'ordinateur.
Ce n'est qu'en 1975 qu'il deviendra la conception de commutateur de production
utilisée dans le système Bell avec le 4ESS. Lewis note qu'un
ingénieur système, Chester E. Brooks, avait eu l'idée
d'un commutateur entièrement électronique. en 1951, mais
la seule référence donnée était un article
de Fortune de 1958 par Bello où la prédiction était
que d'ici 1980, le système Bell utiliserait une commutation à
semi-conducteurs basée sur PCM et TDM (ce qui s'est avéré
être à peu près correct). Du côté de
la commutation de production des Bell Labs, Amos Joel Jr. a documenté
les utilisations possibles de l'électronique pour contrôler
le réseau de commutation en 1956 .
Il a ensuite proposé un "commutateur" expérimental
qui a mis en œuvre ces idées dans un système pratique
parallèlement aux travaux de recherche sur l'ESSEX. Joel a pu s'appuyer
sur cette idée pour déployer un essai sur le terrain réussi
en 1960 à Morris, dans l'Illinois (parfois appelé le commutateur
Morris ou alternativement le bureau central électronique, ECO).
Cet essai réussi à Morris a ensuite été transformé
en une version de production qui est devenue le système ESS n °
1. Cette commutation de production est devenue l'histoire publique largement
acceptée de la commutation ainsi que celle partagée au sein
des Bell Labs. Il n'est pas étonnant que Joel ait été
considéré comme le père de la commutation électronique
au sein des Bell Labs. Il faudra attendre le commutateur interurbain 4ESS
et le commutateur local 5ESS pour qu'une structure de commutation entièrement
électronique et numérique soit déployée dans
le système Bell.
Chester E. Brooks était l'auteur de un certain nombre de brevets
américains, dont un pour un "système de commutation
téléphonique automatique électronique" déposé
le 19 novembre 1956 (brevet américain numéro 3 120 581)
qui décrit les opérations du système, y compris l'utilisation
du binaire pour les circuits de contrôle. Une recherche préliminaire
de documents internes de Bell Labs par Brooks vers 1951 n'a pas encore
fourni ces documents, mais cet auteur est convaincu qu'ils existaient.
Notez que le livre Engineering and Operations in the Bell System était
principalement destiné à être un document de formation
pour les nouveaux ingénieurs des Bell Labs et a été
délivré à chaque nouvel ingénieur.
4. Évolution du passage de l'informatique au contrôle
des programmes enregistrés.
En 1953, Deming Lewis (qui était rédacteur en chef du rapport
sur l'histoire de l'informatique des Bell Labs de 1961 a directement lié
les ordinateurs électroniques à la commutation téléphonique
et a détaillé les relations entre eux. Un article de Claude
Shannon en 1949 détaillait les besoins en mémoire d'un central
téléphonique en termes de " bits ", un terme récemment
inventé en 1947 par Tukey. Dans un article de 1979 de John Pierce
où il revient sur l'histoire de la commutation et son rôle,
il relie les efforts pour développer et pousser le PCM comme un
moyen de rendre possible la commutation entièrement électronique.
a été fait non seulement avec Pierce mais aussi avec Shannon
et Oliver comme indiqué dans où ils ont laissé entendre
que le PCM permettrait une commutation téléphonique entièrement
électronique. Les premiers systèmes de commutation électroniques
ont fait une comparaison directe avec un ordinateur, en particulier le
DIAD qui a été lancé en 1949 et la description contient
un chiffre qui assimile le système à un ordinateur avec
la seule différence que l'ALU (unité logique arithmétique)
a été remplacée par le « réseau de connexion
» ou la matrice de commutation. Voir la figure ci dessous pour ce
diagramme du document DIAD.
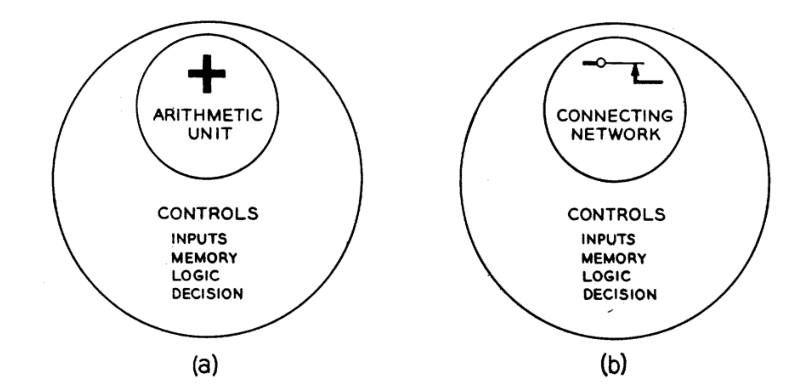 Figure de l'article DIAD 1952 comparant le passage à l'informatique
.
Figure de l'article DIAD 1952 comparant le passage à l'informatique
.
Lewis poursuit en faisant une comparaison directe qui, selon lui, est
particulièrement forte pour le DIAD. Il dit également que
l'ECASS, un système antérieur qui a débuté
en 1947, était également similaire à un ordinateur.
Il fait une comparaison directe avec les Harvard Mark I et II et les ordinateurs
relais Bell montrant une forte ressemblance fonctionnelle avec ces systèmes
de commutation électroniques. Lewis poursuit en disant que les
contributions entre l'informatique et la commutation vont dans les deux
sens, la commutation étant susceptible de contribuer aux "dispositifs
informatiques, à la fiabilité et aux systèmes utilisant
deux ordinateurs ou plus". Ces exemples démontrent que la
pensée, en particulier au sein de l'équipe de Lewis dans
la recherche sur la commutation, était que l'informatique et la
commutation étaient des technologies complémentaires et
qui se chevauchaient.
Le groupe d'ingénierie système de Joel au sein des laboratoires
Bell s'efforçait de fournir des systèmes de commutation
pratiques capables de gérer l'utilisation croissante du réseau
téléphonique. Ce groupe était l'unité d'ingénierie
des systèmes qui était plus directement responsable du déploiement
d'un réseau fonctionnel. Amos Joel avait également proposé
d'utiliser des composants électroniques comme dans et proposé
un système qui n'incluait pas la numérisation du réseau
de commutation mais plutôt uniquement pour le contrôle, tout
comme le modèle DIAD avait utilisé. Il a ensuite utilisé
ce même modèle dans le système de commutation expérimental
déployé à Morris, Illinois en 1960 et dans l' ESS
n ° 1 . Fait intéressant, dans un article du magazine Fortune
en 1958, les Bell Labs semblent avoir déjà décidé
de reporter la fabrication du réseau de commutation entièrement
numérique jusqu'en 1980, en utilisant le PCM comme cela a été
proposé dans l'ESSEX à la fin des années 1950 par
les chercheurs en commutation des Bell Labs. Dans le travail de Joel en
ingénierie des systèmes, il semble clair qu'ils s'étaient
installés sur un modèle de contrôle de programme stocké
de commutation qui durerait jusqu'au milieu des années 1970 déploiement
du 4ESS pour la commutation interurbaine utilisant PCM. Il est donc logique
que le contrôle des programmes stockés différencie
l'approche de Joel du modèle entièrement numérique
sur lequel la recherche sur la commutation avait travaillé et qu'elle
considérait comme l'avenir.
Cette terminologie de "contrôle de programme enregistré"
s'est poursuivie même après que le système de commutation
soit devenu entièrement électronique et numérique
à la fin des années 1970 et 1980 avec le 4ESS et le 5ESS.
Au moment du 4ESS, du 5ESS et de la cession de 1984, la terminologie de
«commande de programme stocké» était enracinée
dans la culture d'ingénierie du système de commutation et
il n'était guère nécessaire de la changer pour devenir
un «ordinateur spécialisé» ou des termes similaires
qui sont plus directement informatisé.
Jusqu'en 1966, les dirigeants d'AT&T, y compris le président
Romnes, continuaient à dire des choses comme "le système
téléphonique est lui-même un ordinateur".
5. Conclusion Au début du développement de la
commutation électronique chez Bell Labs, la commutation téléphonique
était considérée comme une forme spécialisée
d'informatique. Avec les efforts concurrents au sein des laboratoires
pour développer un système de commutation entièrement
électronique par rapport à un système de commutation
partiellement électronique, il était logique d'appeler la
version qui ne remplaçait pas le réseau de commutation "commande
de programme stocké", car elle contrôlait le réseau
de commutation. La version partiellement électronique l'a emporté,
en grande partie pour des raisons pratiques de fiabilité et de
coût. La situation a été compliquée par le
décret de consentement de 1956 en exigeant qu'AT&T n'entre
pas dans le secteur de l'informatique, ce qui explique pourquoi les historiques
de commutation téléphonique et d'informatique ont été
présentés séparément au monde extérieur
aux Bell Labs. Au moment où Bell a déployé une version
entièrement électronique dans les années 1970, le
terme était tellement ancré dans la culture des ingénieurs
de commutation chez Bell Labs qu'il n'était tout simplement pas
logique de changer, en particulier avec la pression continue de ne pas
sembler être dans le marché de l'informatique.
6. Remerciements J'aimerais remercier plusieurs personnes qui
ont contribué à trouver l'histoire de l'informatique des
Bell Labs en 1961.
Tom Misa m'avait poussé du coude pendant des années qu'un
tel document existait et j'ai finalement pris sur moi de faire de mon
mieux pour voir s'il existait. J'ai contacté Al Aho qui m'a référé
à Brian Kernighan qui m'a ensuite référé à
A. Michael Noll. Noll avait parcouru les papiers de Bill Baker et avait
créé un site Web avec certains de ses papiers. Noll m'a
ensuite référé à Ed Eckert de Nokia Bell Labs
qui a pu trouver le document dans les papiers de Baker à l'emplacement
des Bell Labs à Murray Hill, NJ.
Les données de ces
documents sont reprises pour commenter et illustrer la page "naissance
de la commutatition électronique" de ce
site.
II - En France
Chargé de recherche à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine
(CNRS) et chargé de cours à l'Université de Paris
IV, Pascal Griset est spécialiste de l'histoire des télécommunications.
Il prépare une histoire des techniques aux 19 et 21 siècles.
Il vient de publier La croissance économique en France au 19e siècle
(A.. Colin) en collaboration avec Alain Beltran.
LE DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉPHONE EN FRANCE DEPUIS LES ANNÉES 1950 de Pascal Griset
1989 POLITIQUE DE RECHERCHE ET RECHERCHE D'UNE POLITIQUE
Comment est-on passé du « 22 à Asnières
» au téléphone installé dans les voitures particulières
?
Question de maîtrise technologique et de développement industriel,
pensons-nous d'abord. Ce serait pourtant sous-estimer l'importance des
choix politiques, les enjeux mentaux et quelques problèmes de souveraineté
nationale...
La lutte pour le contrôle des télécommunications est un enjeu central pour la détermination des rapports de force entre les Etats et les entreprises à l'orée du 21e siècle. La France à travers ses entreprises fait partie des adversaires qui ont déjà brisé quelques lances sur un terrain pouvant sembler plus ouvert par la dérégulation intervenue aux Etats-Unis. La France est donc présente, avec ses atouts et ses handicaps, dans cet affrontement où ne sont acceptés que les meilleurs. Pourtant, au-delà des paramètres financiers et technologiques, l'évaluation du potentiel français doit également intégrer une analyse des rapports entretenus entre les pouvoirs publics et les entreprises privées dans ce domaine, monopole d'Etat.
Le développement du téléphone en
France après la seconde guerre mondiale montre combien les choix
en matière de télécommunications peuvent être
l'enjeu de rivalités politiques, mais il révèle aussi
les qualités et les limites d'un modèle français
de politique industrielle.
Une politique de recherche et l'industrialisation pour l'indépendance
nationale.
La société française n'a intégré
que très lentement l'importance des télécommunications
pour son avenir économique et culturel. Dès la fin des années
1950, les différentes dimensions du problème apparaissaient
pourtant clairement. Le développement du téléphone
intégrait tout d'abord d'importants enjeux techniques. Le passage
des techniques électromécaniques aux techniques électroniques
en commutation fut une révolution sans précédent
entraînant une impitoyable sélection entre les entreprises
et les nations, seules quelques-unes, pour des raisons à la fois
techniques et financières, pouvant assumer ce grand saut. Le téléphone
est également, à double titre, un enjeu industriel.
L'industrie des télécommunications est devenue une industrie de pointe. Son développement s'intègre dans celui de l'industrie électronique et spatiale, avec les synergies que l'on devine avec le domaine militaire. Les investissements sont colossaux, mais les profits, pour les rares gagnants, sont à leur mesure. Deuxième aspect, l'équipement d'un pays en télécommunications modernes et bon marché est un élément majeur qui participe à la compétitivité des entreprises dans tous les domaines.
Enfin, découlant des éléments précédents, le téléphone et son industrie sont un extraordinaire enjeu politique. Enjeu de politique internationale, car la maîtrise des réseaux de télécommunications internationaux est un élément décisif dans la politique étrangère d'une grande puissance ; enjeu de politique intérieure, car aucune politique industrielle cohérente ne peut se faire en dehors des télécommunications, et tout gouvernement doit donc avoir un contrôle assez étroit de l'évolution de ce secteur.
L'histoire des années 1950 à 1990 nous révèle que des acteurs aux conceptions et aux intérêts différents, voire divergents, étaient concernés par cette activité : l'administration, les industriels, les politiques, les « usagers »... de plus en plus... « consommateurs ». L'administration des PTT était présente à la fois par ses services d'exploitation et par son centre de recherche, le CNET. Les services d'exploitation avaient pour principale préoccupation le développement des capacités du réseau qu'ils géraient. Leur importance dans les processus de décision ne fut pas négligeable, mais ce fut surtout le Centre national d'étude des télécommunications (CNET) qui pesa de tout son poids dans la définition de la politique française des télécommunications. Créé en 1944, confirmé par le gouvernement provisoire, le CNET était une structure interministérielle qui ne prit une véritable importance qu'à partir de 1954 lorsqu'une réforme lui permit de trouver son unité sous la houlette des PTT. Dès lors, sous la direction de Pierre Marzin, le Centre se consacra à sa véritable mission, définie par les textes fondateurs, en s'attachant à coordonner les activités de l'industrie française des télécommunications (1).
Cette industrie était bien faible au regard des besoins d'une grande nation industrialisée. Si dans le domaine des transmissions l'industrie française réussissait à conserver une part importante du marché intérieur, celui de la commutation était en revanche totalement contrôlé par les technologies étrangères. Les deux filiales de ITT, la CGCT et LMT, et la société Ericsson accaparaient au début des années 1960 plus de 65 % des commandes de l'Etat en matériel de commutation (2). Le pouvoir politique mis très longtemps à considérer le téléphone comme une priorité pour le pays. On rattachait volontiers celui-ci aux activités de loisir plus qu'aux biens d'équipements industriels. Les télécommunications furent négligées par le plan Monnet et il fallut attendre l'été 1947 pour qu'une commission de modernisation des télécommunications soit créée. Le programme prévu en 1948 par celle-ci ne fut jamais appliqué. Ce ne fut qu'à partir du 6e et surtout du 7e Plan que les télécommunications furent considérées comme prioritaires (3). Il est vrai que jusqu'à la fin des années 1960 la pression de la demande fut étonnamment faible. Les députés en campagne électorale se voyaient réclamer des écoles, des hôpitaux, pas le téléphone. En 1970, le retard de la France en matière d'équipement téléphonique était donc dramatique. Sa densité téléphonique était de 7,8 lignes principales pour cent habitants contre 11,1 pour l'Italie, 12,3 pour la RFA, 15,3 pour le Royaume-Uni, 33,3 pour les Etats-Unis et 40,9 pour la Suède. Le taux d'automatisation, qui était de 100 % aux Etats-Unis, en Allemagne ou en Italie, de 99 % en Belgique et en Grande-Bretagne, dépassait à peine 75 % en France. Les délais de raccordement étaient extrêmement longs, le téléphone était un luxe : Fernand Raynaud pouvait sans succès chercher à joindre le 22 à Asnières...
1. Une histoire du CNET, à laquelle nous avons collaboré dans le cadre du Centre de recherche en histoire de l'innovation (Paris IV), est à l'heure actuelle sous presse et une large partie des informations a été collectée lors d'interviews des principaux ingénieurs et responsables des télécommunications à l'occasion de cette recherche. Nous remercions tout particulièrement Messieurs Cotten, Docquiert, Letellier, Libois, Lucas, Marzin. Des documents d'archives ont également appuyé notre démarche. Ils ne sont pas répertoriés et leur consultation est à l'heure actuelle impossible.
2. L'International Telegraph and Telephon Company disposait
du marché des télécommunications hors des frontières
de l'Union. Ses filiales françaises impliquées dans la commutation
étaient la Compagnie générale de construction téléphonique
(CGCT) et le Matériel téléphonique (LMT).
3. Voir L.-J. Libois, « La planification
française et les télécommunications », rapport
au Colloque Bernard Gregory, sur « Science et décision »,
Paris, 1979.
Les débuts de la commutation électronique : le pari technologique
Les centraux de commutation, qui sont au réseau
téléphonique ce que l'échangeur est au réseau
autoroutier, ont été, au cœur de l'évolution
technologique du téléphone, l'enjeu économique le
plus important. Au début des années 1950, la commutation
électromécanique était arrivée au bout de
son évolution avec le système Crossbar. En Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis, l'idée d'utiliser l'électronique en commutation
commençait à apparaître. En 1956, le Post Office pouvait
annoncer la création d'un centre de recherche sur la commutation
électronique. Le choix des Britanniques s'était porté
sur le « temporel », c'est-à-dire un système
où l'ensemble des fonctions de commutation était assuré
par l'électronique. Quelques mois plus tard, en mars 1957, les
Bell Laboratories (centre de recherches d'ATT) annonçaient la construction
d'un centre expérimental de commutation électronique .
Leur choix technologique (4) était cependant différent puisqu'ils
avaient choisi le « spatial ». L'électronique n'y intervient
que pour commander des systèmes électro mécaniques.
L'option anglaise entraînait donc une rupture complète avec
les anciens systèmes, alors que les Américains avaient choisi
une évolution permettant d'envisager une introduction plus rapide
de la nouvelle technologie dans les réseaux opérationnels.
Les rapports entre ATT et le CNET avaient toujours été très
cordiaux. Au fil des accords, portant notamment sur des échanges
de brevets, les ingénieurs du CNET avaient fréquemment rencontré
leurs homologues américains dans les fantastiques laboratoires
Bell. Trois ingénieurs du CNET étaient donc présents
au symposium organisé par ATT. De retour en France, ils informaient
Pierre Marzin, directeur du Centre, des projets américains. Ingénieur
parmi les plus brillants de l'avant-seconde guerre mondiale, P. Marzin
rêvait d'un téléphone totalement français,
affranchi de la tutelle américaine. Pressentant les extraordinaires
potentialités d'une filière électronique en commutation,
il créa, en avril 1957, un nouveau département du CNET appelé
RME, recherche sur les machines électroniques. Sa mission : concevoir
un système français de commutation électronique.
Il en confia la direction à Louis- Joseph Libois. Le rôle
leader en commutation électronique échappait donc au service
commutation du CNET, à la grande déconvenue de ses ingénieurs.
Pierre Marzin voulait des hommes totalement détachés de
la commutation classique pour créer un système réellement
nouveau, il cassait les routines des structures en place, créait
un groupe totalement concerné par la nouvelle technologie, liait
la carrière de ces hommes à la réussite de leur mission.
Cette audace s'avéra payante : ces hommes nouveaux croyaient en
l'électronique alors que peu de « commutants », ils
l'admirent plus tard, auraient misé sur le succès à
moyen terme de cette révolution technologique. Les avantages de
l'électronique étaient pourtant considérables : «
Elle apporte des avantages substantiels : la réduction du volume
et du poids, la facilité d'entretien si le matériel est
bien conçu et la diminution de puissance d'alimentation»
(5), estimait le directeur du Laboratoire central des télécommunications
dès 1956.
Le travail des ingénieurs de RME commença par une période de recherche libre destinée à explorer sans a priori les différentes démarches envisageables. Les premières expériences anglo-saxonnes servirent ainsi d'une certaine manière à déterminer « ce qu'il ne fallait pas faire » et toutes les options du CNET s'éloignèrent des choix américains et britanniques. Une première étape vit la réalisation de deux prototypes ANTINEA (1958-1960) et ANTARES (1961-1963). Ils permirent d'évaluer à leur juste mesure les problèmes liés à la nature des composants électroniques et aux méthodes de programmation. Les grandes orientations dans ces domaines fondamentaux purent ainsi être déterminées.
A la fin des années 1950, malgré le développement des transistors, l'électronique reposait encore dans de nombreux cas sur les lampes à vide. Ainsi, ce fut avec des lampes que les Britanniques tentèrent la mise au point de leur central temporel. Ce prototype, que certains n'hésitèrent pas à surnommer « l'usine à gaz », était extrêmement volumineux et peu performant. Il nécessitait un système de climatisation et termina sa carrière en 1963, véritable diplodocus témoin de cette préhistoire de la commutation électronique. Les Britanniques furent ainsi « fâchés » avec le temporel pour deux décennies. Dans le cadre moins ambitieux de la commutation spatiale, les Américains adoptèrent des diodes à gaz dans le premier central réalisé à Morris dans l'Illinois (novembre 1960). Le choix des composants s'avérait donc déterminant pour l'efficacité, la faisabilité du système, mais également pour sa rentabilité. P. Lucas, ingénieur dans l'équipe RME, explique ainsi les grandes options qui inspirèrent les choix français en la matière : « La politique suivie à cette époque fut de chercher à utiliser des composants dont la diffusion probable devait être la plus large possible, c'est-à-dire de coller le plus possible aux technologies de l'informatique dont le marché serait certainement plus large que celui de la communication » (6). Quelle lucidité dans ce choix alors qu'à cette époque les Américains, il est vrai plus favorisés en matière de crédits, développaient des composants spécifiques très coûteux !
La programmation des centraux, autre élément clef, s'avéra être d'une extrême complexité. Ce ne fut que très lentement que les problèmes furent évalués dans toutes leurs dimensions, et les retards de mise au point des systèmes, lorsqu'ils survinrent, furent bien souvent dus à une sous-estimation du temps nécessaire à la programmation. Le programme du central de Morris comportait déjà 50 000 instructions.
Parallèlement à la recherche, l'industrialisation était préparée grâce à la mise en place de structures de coopération avec les industriels. Depuis 1959, l'administration et les industriels avaient en effet joint leurs efforts en matière de commutation au sein d'une société d'économie mixte, la SOCOTEL(7). Le CNET, de par ses statuts, coordonnateur de l'industrie des télécommunications en France, jouait un rôle important dans cet organisme. Invités par le CNET à se joindre à l'effort effectué en matière de commutation électronique, les industriels, qu'ils soient purement français ou filiales d'ITT, se montrèrent très réservés, voire hostiles à cette orientation. Lors de la réunion des membres de SOCOTEL, le 15 décembre 1960, un projet de recherche portant sur le spatial, le SE 400, fut rejeté en raison de l'opposition des industriels qui le jugeaient trop ambitieux. Cette journée reste dans bien des mémoires comme un événement marquant. Les débats furent tellement tendus qu'aucun compte rendu n'en fut réalisé.
4. ATT (American Telegraph and Telephone Company).
Cette gigantesque entreprise disposait jusqu'au début des années
1980 d'un monopole sur les communications téléphoniques
aux Etats-Unis. Elle ne pouvait en revanche pas exporter, ce secteur étant
réservé à l'International Telegraph and Telephone
(ITT).
5. G. Goudet, conférence faite à
la Société des radioélec- triciens, le 20 octobre
1956, publiée dans UOnde électrique, mars 1957.
6. P. Lucas, « Les progrès de
la commutation électronique dans le monde », Commutation
et électronique, 44, janvier 1974.
7. SO. CO. TEL : « Société
mixte pour le développement de la technique de la Commutation dans
le domaine des Télécommunications ». Voir H. Docquiert,
SOCOTEL, Expérience de coopération Etat-Industrie, Paris,
SOCOTEL, 1987, 183 p. Henri Docquiert est l'ancien directeur de cette
société.
Les industriels étaient préoccupés avant tout par le marché français et donc par les contrats des années à venir, qui portaient sur des équipements uniquement électromécaniques (système Crossbar). Leurs ambitions et celles du CNET qui voulait mettre en œuvre une politique à long terme s'accordaient mal. Le projet refusé par SOCOTEL fut dès lors entièrement assumé par RME et, selon P. Lucas, « entra dans la clandestinité ». Rebaptisé SOCRATE, il devint la première réalisation de commutation électronique opérationnelle en France. Il représentait un progrès essentiel dans le domaine de la commutation spatiale. Tout en poursuivant le développement de ces centraux « spatiaux », les ingénieurs du CNET, mis en confiance et forts de leur expérience, purent envisager le développement d'un système complètement électronique dit « temporel ». Si de nombreux contrats d'études furent passés avec les industriels, l'essentiel du travail de recherche sur le temporel fut réalisé au sein des laboratoires du CNET (8).
Le premier prototype de central temporel relié au réseau, PLATON, fut installé à Perros-Guirec le 26 janvier 1970. C'était une première mondiale. Pierre Marzin aimait raconter que les remarques du boucher de la commune sur la qualité des communications l'informaient sur l'avancement de mise au point du central avant même que les rapports de ses ingénieurs n'arrivent sur son bureau. Cette boutade souligne bien l'extrême importance des essais en exploitation réelle pour tout système de commutation, leur caractère parfois décourageant tant de problèmes difficiles à soupçonner en laboratoire pouvant apparaître. PLATON montra la faisabilité technologique de la commutation temporelle ; il restait à en réaliser l'industrialisation.
8 .Les problèmes généraux liés
au financement de la recherche par les commandes publiques sont abordés
par Christian Dilleman, « Les commandes publiques, stratégies
et politiques, » Notes et études documentaires , novembre
1977, 120 p.
Une politique industrielle conquérante
Le CNET orienta la CIT, Compagnie industrielle des téléphones,
filiale de la CGE, vers la technologie la plus en pointe, le temporel,
quitte à réaliser pour elle l'essentiel de l'effort de recherche.
Il semble que la filiale de la CGE, malgré l'intérêt
porté au projet par Ambroise Roux, accueillît la proposition
avec peu d'enthousiasme. Les conditions « très favorables
» proposées par le CNET forcèrent pourtant ces quelques
réticences. Pour mener à bien ce projet, le problème
du transfert de technologie était posé. Transmettre des
plans, des instructions à CIT aurait été totalement
inefficace car la structure d'accueil n'était pas suffisamment
solide pour en tirer parti. Une filiale de CIT, la SLE (Société
lanionnaise d'électronique) fut donc chargée d'assumer la
responsabilité de cette industrialisation. Certains ingénieurs
ayant développé le système au sein du CNET «
désertèrent » celui-ci pour rejoindre la SLE... avec
la bénédiction de leurs supérieurs. Travaillant d'abord
de manière très marginale au sein de la CIT, la SLE réussit
progressivement l'intégration du programme temporel au sein de
l'entreprise. La démarche suivie lors de cette étape cruciale
du développement du temporel fut donc très pragmatique.
Structure légère, la SLE était parfaitement adaptée
à son objectif. Elle joua parfaitement son rôle d'interface
entre le CNET et la CIT. Le développement des études donna,
sans modification fondamentale, le central E10 (9).
9. Outre son réseau de connexion temporel, le central E10 possédait
deux caractéristiques d'avant-garde : les fonctions de commutation
étaient réparties entre plusieurs processeurs spécialisés
et les fonctions de gestion ne concernant pas directement l'écoulement
du trafic étaient exécutées par un calculateur commun
à plusieurs unités de commutation.
Loin de constituer des « logiques » successives, la politique de recherche et la politique industrielle étaient donc bien présentes conjointement dans les orientations prises par P. Marzin dès la fin des années 1950 (10) . En confiant à une entreprise française l'innovation technologique radicale que constituait le temporel, le CNET avait forgé une arme destinée à écarter les filiales d'ITT — celle-ci n'ayant pas suivi l'évolution technologique du temporel — au moment des choix d'équipements. C'était une option risquée, car elle engageait la principale entreprise française dans une voie difficile. Elle était cependant la seule possibilité d'échapper à l'influence prépondérante des capitaux étrangers dans la commutation française et laissait entrevoir de véritables possibilités de développement pour les exportations. Dès 1972, la baisse constante du prix des composants électroniques et la progression rapide des études permettaient au CNET d'être optimiste : « La commutation temporelle arrive plus tôt que ne l'avaient prévu la plupart des techniciens. Sans doute faut-il s'en féliciter, car ainsi pourrons-nous hâter la transformation du réseau en un réseau universel permettant d'acheminer indifféremment de la parole et des données » (11).
Le CNET n'entendait pas pour autant donner un monopole à la filiale de CGE. Dès 1973, l'appel à un autre fournisseur était prévu : « II est proposé d'engager un second constructeur dans la production et l'installation de centraux E10 à partir du programme 1975 », pouvait-on lire dans un rapport. Ce texte poursuivait — et ces quelques mots contiennent l'aboutissement d'une démarche de plusieurs années : « Le choix est à faire entre les sociétés du groupe ITT (LMT, CGCT), STE, SAT et AOIP. Les premières sont à écarter car elles ont choisi de s'attaquer à un créneau différent du marché avec le modèle Eli » (12).
10. Dans une table ronde consacrée à
l'histoire du CNET en 1983, A. Bertho envisageait l'histoire du Centre
comme la succession de trois « logiques », une logique d'exploitation
(1953-1958) précédant une logique de recherche (1958-1968)
débouchant finalement sur une logique de développement (1968-
1974). Cette perspective nous semble masquer la véritable démarche
de Pierre Marzin qui mit, dès la fin des années 1950, la
recherche au service d'un grand projet de restructuration industrielle.
11. C. Abraham, « Situation de la commutation
électronique en France et dans le monde », rapport pour le
département Commutation électronique et automatismes du
CNET, 16 mai 1972.
12. Note du CNET à l'attention de
Monsieur le ministre des PTT, 6 novembre 1973. La note évoquait
ensuite l'AOIP comme susceptible d'assurer une partie de la fabrication
prévue. La place de cette entreprise, qui est une coopérative
ouvrière, est bien particulière dans les projets de l'administration.
Très sévère à son égard, Jacques Darmon
estime : « Son inaptitude à suivre l'évolution rapide
de la technologie, son incapacité à attaquer les marchés
étrangers, ses coûts de production trop élevés
ont rapidement mis l'entreprise hors d'état de soutenir une concurrence
ouverte », Jacques Darmon, Le grand dérangement, Paris, J.-C.
Lattes, 1985, p. 171.
La logique technique devait donc réduire tout « naturellement » la place de LMT et de la GCGT, leur participation à l'équipement du pays passant obligatoirement par une licence sur le matériel temporel. Forte de cette avance technologique, la CIT devait donc se trouver en position de force sur les marchés étrangers. Son matériel, accepté par une administration importante, disposerait d'une crédibilité considérable, ses coûts de production ne seraient pas alourdis par le versement de royalties à une entreprise étrangère. Pour la première fois depuis son arrivée sur le marché français, ITT allait donc se trouver en état d'infériorité technologique face à une entreprise française. La modernisation, en fait le véritable développement tant attendu du réseau téléphonique français pourrait s'appuyer sur une technologie nationale.
Mettre fin au sous-développement téléphonique du pays
II restait à concrétiser ces projets, car, tandis que le CNET réalisait cet effort considérable de recherche, l'équipement du pays en téléphone suivait toujours son rythme d'escargot. Ce fut en fait lors de la présidence de Georges Pompidou que les décisions furent enfin prises pour combler un retard de plus en plus ridicule et pénalisant pour un pays industrialisé. Le rôle de Yves Guéna, ministre des PTT, fut important pour débloquer certaines pesanteurs, la nomination du directeur du CNET, Pierre Marzin, à la tête de l'administration des télécommunications montrant à tous que l'avenir devait être fondé sur une technologie française.
Le premier problème à résoudre était
celui du financement du programme d'équipement. Pour cela, l'emprunt
fut retenu comme la meilleure solution et des sociétés de
financement furent créées pour mobiliser l'épargne
vers le téléphone. La décision fut prise à
la fin de l'année 1969 par la loi autorisant la création
des sociétés de financement des télécommunications.
L'agrément conjoint des PTT et du ministère des Finances
intervint le 24 décembre 1969. Joyeux Noël pour le téléphone
puisque cette organisation, bien que son efficacité fut parfois
contestée, constitua la base de tout son développement futur
] (13)
Quatre sociétés furent créées : FINEXTEL en
février 1970, CODETEL en janvier 1971, AGRITEL en juin 1972, CREDITEL
en octobre 1972.
Pour permettre à l'administration d'être mieux à même d'assumer le développement du téléphone, des réformes de structures furent également réalisées. La création en 1968 de la Direction générale des télécommunications (DGT), la suppression en 1971 du Secrétariat général aux PTT amorçaient l'émancipation des télécommunications, leur plus grande indépendance par rapport aux Postes, dans une administration dont l'unité était cependant préservée. Ainsi, pour la première fois en 1970, le budget des Postes et celui des Télécommunications furent présentés séparément.
Une importante réflexion sur le rôle et l'organisation de l'administration fut également menée. En février 1974, la commission de contrôle parlementaire sur le téléphone rendait un rapport dont les conclusions ne pouvaient qu'entraîner une profonde réforme de l'organisation des télécommunications françaises. « L'activité du ministère des PTT a incontestablement un caractère industriel et commercial... Il faudrait envisager de le scinder en deux administrations distinctes, postes et services financiers d'une part, télécommunications d'autre part. Pour ces dernières un établissement public des télécommunications serait créé », estimaient les députés. Loin d'être destiné à un oubli rapide, ce projet avait reçu un accueil tout à fait positif à l'Elysée : Bernard Esambert, conseiller de Georges Pompidou, avait convaincu le Président et ce dernier était favorable à la réalisation de cette réforme. Bien entendu, des difficultés pouvaient être attendues de la part des syndicats, certaines grèves l'avaient démontré, et il est certain que la mise en place d'un tel changement aurait été délicate (14). Il reste que la volonté politique était affirmée et que ces propos ont un air très familier pour qui suit les débats sur les télécommunications en 1989 ! Au début de l'année 1974 tout semblait donc être en place pour que le plan mis en œuvre par. le CNET puisse enfin aboutir. Des structures de financement étaient en place, une entreprise française disposait d'une avance technologique de plusieurs années sur ITT, une administration des télécommunications plus autonome laissait entrevoir des structures plus souples pour gérer le développement du téléphone.
13. Voir C.-H. Cotten, «Recours au marché
Revue française des télécommunications, numéro
1.
14. Voir à ce propos E. Quéré,
La crise du téléphone : ses causes, les solutions, Paris,
Fédération CGT des Postes et télécommunications,
mars 1976.
La révolution d'octobre
Nous reprennons ici l'expression la plus couramment utilisée
à propos de cette période par le personnel du CNET.
Le décès de Georges Pompidou et les élections présidentielles de 1974, en bouleversant les données politiques, entraînèrent une remise en cause complète de ces projets. Le Conseil des ministres du 16 octobre 1974 annonçait la nomination d'un nouveau directeur général des Télécommunications. Gérard Théry remplaçait Louis-Joseph Libois, le « père » de la commutation électronique française. La nouvelle équipe bouleversa la stratégie mise en place. L'attitude des ingénieurs du Centre lors des années précédentés fut très critiquée. Il leur fut reproché d'avoir été juges et parties dans les contrats d'études passés avec les industriels mais surtout, plus fondamentalement, le CNET fut accusé d'avoir outrepassé ses attributions et d'avoir déterminé par ses options technologiques la politique industrielle de la DGT.
La nouvelle génération de décideurs, arrivée au pouvoir grâce à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, abordait les problèmes de manière totalement différente. Son expérience n'était pas celle de l'Occupation. Elle retenait essentiellement des années 1960 et du début des années 1970 la vision d'une industrie française peu dynamique, surprotégée par une administration excessivement tolérante vis-à-vis des retards et des surcoûts trop souvent observés. A la philosophie économique de Georges Pompidou, encore très interventionniste dans son désir de créer une industrie française capable de lutter à l'échelle internationale, succédait une philosophie plus libérale, du moins dans ses discours. Enjeu industriel essentiel, les télécommunications furent pronfondément touchées par ce changement de cap lié certes à des considérations économiques mais dont les motivations politiques de la nouvelle équipe au pouvoir n'étaient pas absentes. La structure de l'administration fut considérablement modifiée, le rôle et la place du CNET transformés. Le Centre ne dépendait plus directement de la DGT mais d'une nouvelle structure, la Direction des affaires industrielles et internationales (DAII). Celle- ci prenait en main la définition des objectifs industriels, le CNET étant limité à la recherche fondamentale et appliquée. Les ingénieurs du CNET devaient chercher et non décider... La nomination à la tête de la DAII de Jean-Pierre Souviron, ingénieur en chef des Mines, semblait bien montrer que l'heure de la « mise au pas » avait sonné pour le CNET.
De plus, l'un des principes qui avait structuré le CNET à sa création, la liaison entre recherche et contrôle du matériel, fut abandonné. « En politisant le problème des choix industriels et en modifiant le régime de contrôle des prix, l'administration a donc enlevé au CNET une fonction qu'il remplissait bien par le passé (15)». En l'espace de quelques semaines, « l'ensemble de l'organisation qui permettait au CNET de maîtriser le processus d'innovation se trouve remis en cause. Et cela est grave lorsque l'on sait le temps qu'il a fallu pour former des équipes de recherche de haut niveau, c'est-à-dire capables de dominer le processus d'innovation » (16).
Toute la logique qui soutenait le développement du téléphone en France était donc bouleversée. Les orientations destinées à développer une industrie nationale par la dynamique de la recherche étaient abandonnées.
15. Alain Le Diberder, La production des réseaux
de télécommunications, Paris, Economica, 1983.
16. M. Nouvion, U automatisation des télécommunications
, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1982, p. 303. Cette rupture entre
contrôle technique et recherche n'a rien d'anecdotique, elle ne
correspond pas à une lutte entre services pour quelques prérogatives.
Elle peut entraîner une efficacité diminuée pour les
chercheurs, qui perdent le contact avec les équipes de l'industrie.
Quant aux contrôleurs, il leur est plus difficile de se maintenir
par la recherche au niveau des équipes qu'ils sont amenés
à superviser. M. Nouvion peut à ce propos émettre
l'hypothèse selon laquelle « ces décisions prises
trahissent une méconnaissance assez profonde des processus par
lesquels sont introduits l'innovation... ».
Un choix technologique discuté et une organisation industrielle
hésitante
Le principal argument justifiant le démantellement
du projet industriel du CNET — qualifié de « politique
de l'Arsenal » — s'appuyait sur le désir d'obtenir,
grâce à la mise en place d'un marché concurrentiel,
l'équipement téléphonique du pays à un prix
moins élevé. Une consultation fut organisée pour
cela en 1975. L'application de stricts critères de rentabilité
fit préférer le spatial au temporel, ce dernier étant
jugé encore trop cher et peu fiable. Plusieurs systèmes
furent mis en compétition mais aucun n'était contrôlé
par des brevets français. La CIT, orientée depuis des années
vers le temporel, ne disposait d'aucun projet sérieux en ce domaine.
Elle dut s'associer en catastrophe avec le japonais NEC pour proposer
du spatial. En fait, les entreprises les mieux placées dans cette
compétition étaient les filiales d'ITT, grâce au système
de commutation spatial (Metaconta qui deviendra le 11F finalement adopté)
mis au point avec l'aide des ingénieurs du CNET au sein de SOCOTEL...
La voie de garage se transformait en allée royale. Le choix du
spatial prenait à contre-pied la CIT et plaçait ITT en position
de supériorité technologique. Un comble après vingt
ans d'efforts destinés à écarter grâce au rapport
de force technologique la multinationale du marché français
! Les conséquences d'un tel choix apparurent très vite.
Il condamnait l'industrie française de la commutation à
de nouvelles décennies de dépendance vis-à-vis des
Américains. Malgré leur « libéralisme »,
les nouveaux responsables ne pouvaient assumer une telle responsabilité
devant l'opinion et les parlementaires. Une nouvelle tactique devait cependant
être définie puisque l'outil technique élaboré
depuis des années avait été écarté.
La politique de secours fut longue à se dessiner ; pendant plusieurs
mois, la politique industrielle des PTT navigua, c'est le moins que l'on
puisse dire, « dans le flou le plus complet» (17). Aucun choix
clair ne semblait pouvoir être pris : « Les dirigeants des
sociétés s'interrogent sur les alliances souhaitées
par le ministère de l'Industrie et de la recherche tandis que les
pouvoirs publics, Elysées et PTT, paraissent eux-mêmes attendre
que les industriels leur proposent des accords », pouvait-on lire
dans la presse (18). Ce fut en mai que le plan fut finalement arrêté
et exécuté. Le gouvernement opta pour la plus dirigiste
des politiques en imposant aux partenaires industriels l'entrée
de Thomson sur le marché du phone, ce groupe achetant une filiale
d'ITT et la filiale d'Ericson en France. Thomson bénéficia
d'un appui total du gouvernement pour se tailler rapidement une place
en ce domaine qu'elle avait abandonné au terme d'un accord signé
avec ITT... en 1927 (19). Présentée comme le moyen de diminuer
l'importance d'ITT en France, l'arrivée de Thomson était
aussi un épisode des luttes entre industriels français et
impliquait pour CIT un recul certain. Elle marquait la rupture des accords
Thomson-CGE de 1969, le « Yalta de l'électronique française
» qui réservait à CGE le domaine du téléphone.
L'arrivée brutale de Thomson dans le téléphone public
suscita de nombreuses interrogations à une époque où
l'ancien conseiller du président Pompidou, Ambroise Roux, connaissait,
à travers le groupe qu'il dirigeait, la CGE, de nombreux revers.
L'hebdomadaire Le Point évoquait même des explications échappant
à la simple logique industrielle et technique : « Dans ses
principales activités, la CGE vient de perdre tantôt ses
espérances, tantôt son leadership. Echec industriel ou cabale
politique ?... Dans ce pays où tout commence et tout finit par
des airs politiques, il en est que l'on chante sur plus d'un registre,
le gouvernement, V.G.E. en tête, entend casser les reins à
celui qui fut l'ami de Georges Pompidou » (20). Les négociations
furent difficiles, ITT n'accepta de vendre sa filiale LMT qu'en étant
assurée qu'une partie du marché français lui serait
réservée. La « reddition d'ITT » proclamée
par la presse prenait en fait pour de nombreux observateurs l'allure d'une
victoire :
— ITT conservait la maîtrise des brevets clefs sur les centraux
spatiaux.
— Les « royalties » que Thomson devrait verser à
ITT lorsqu'elle voudrait exporter rendrait son matériel fatalement
plus coûteux que celui, presque identique, vendu directement par
ITT.
— La part de marché français réservée
à ITT allait garnir les carnets de commande de sa filiale française
et lui permettait d'envisager, forte de la référence apportée
par une telle commande, de s'attaquer à d'autres marchés
étrangers, notamment les pays arabes.
— Enfin, LMT fut vendu au prix fort, 160 millions de dollars. Quatre
ans plus tard, l'action LMT était cotée à 50 % de
ce prix d'achat !
17. G. Pasturel dans L'Usine nouvelle du 29 janvier
1976.
18 . Henry d'Armagnac dans Le Nouveau Journal
du 3 février 1976 reflète parfaitement l'impression de totale
indécision, non seulement sur les buts, mais également sur
les responsabilités à prendre pour la réorganisation
de l'industrie des télécommunications.
19. Thomson était entré dans
l'industrie téléphonique en 1904 par l'acquisition des établissements
Postel-Vinay. Après un accord avec ITT en 1925, où Thomson
gardait la majorité de la Compagnie des téléphones,
Thomson-Houston ITT reprend l'ensemble du capital en 1927.
20. Le Point, 17 mai 1976.
Le choix spatial fut présenté comme étant
une position d'attente, permettant de laisser au temporel le temps de
mûrir et de profiter d'une baisse sur le prix des composants. L'argument,
apparemment logique, semblait écarter le problème des investissements
à réaliser pour développer de front deux systèmes
différents au sein de plusieurs groupes industriels. Une dernière
tentative pour réaliser l'unité technique de la commutation
française fut effectuée par les ingénieurs du CNET.
Ils s'attachèrent à définir un modèle de central
temporel unique, le El, pouvant être fabriqué par CIT et
Thomson. Encore une fois les ingénieurs se mêlait de politique
industrielle... Ce projet allait complètement à l'encontre
des plans de la DAII bien que le choix d'un système unique permettait
de maintenir la concurrence en répartissant les marchés
entre plusieurs constructeurs (21).
Ce type de concurrence orchestrée par l'administration, la DAII
n'en voulait pas. Elle désirait deux constructeurs totalement autonomes
ayant chacun leur indépendance technologique. Ainsi, ce ne fut
que lorsque Thomson fut capable de présenter sur le marché
un central temporel compétitif, le MT 20, que de nouveau le cap
fut mis vers le temporel dans un partage du marché entre Thomson
et CIT. Cette nouvelle orientation intervenait à peine deux ans
après la consultation de 1975 alors que les unités de production
pour le spatial étaient à peine prêtes ! Le spatial,
présenté a posteriori comme une solution transitoire «
en attendant » le temporel, donna en fait à Thomson le temps
nécessaire pour mettre en place sa propre technique en ce domaine...
au prix d'investissements inutiles et d'une perte de temps extrêmement
préjudiciable pour CIT par rapport à la concurrence étrangère.
La politique menée depuis 1974 s'avérait catastrophique
: comme l'écrivait J.-M. Quatrepoint, « les pouvoirs publics
ont fait de la concurrence et de l'internationalisation leurs maîtres
mots. Mais le mieux n'est-il pas l'ennemi du bien ? Il est des moments,
surtout dans les technologies de pointe, où il faut arrêter
une politique et s'y tenir. La concurrence est une bonne chose si elle
ne tourne pas à l'imbroglio » (22).
21. Lors de la définition du projet E10, le
CNET dans une note au ministre avait bien précisé ce qu'il
entendait par « système unique » : « Tous les
exploitants, dans tous les pays du monde, ont une préférence
pour le système unique. La définition de ce qu'ils entendent
par là peut varier, cependant, système unique signifie au
minimum, d'une part, un seul matériel, pour chaque application
et, d'autre part, système construit par plusieurs fournisseurs,
de manière à faire jouer la concurrence », note du
CNET à l'attention de Monsieur le ministre des PTT, 6 novembre
1973.
22. Le Monde du 30 juillet 1976.
Des résultats décevants et le retour du champion national
La sanction économique de la nouvelle politique fut particulièrement lourde. A l'exportation, la France perdit beaucoup de temps, près de trois ans. S'il est vrai que l'introduction du temporel dans un réseau n'est pas toujours facile, l'avance technologique prise par la France fut comblée par ses principaux concurrents. Certes, de beaux succès furent enregistrés mais ils étaient sans commune mesure avec ceux que l'on pouvait espérer, compte tenu de l'avance du E10 (et de son évolution pour les grands centres urbains, le E12) sur les systèmes étrangers. Georges Pebereau avait évoqué ces risques en 1976 : « Si l'industrialisation du système El 2 prenait un retard d'un an à 18 mois sur le calendrier, cela en serait fait des espérances sur le plan mondial... Le matériel
El 2 doit être fabriqué tel qu'il est conçu actuellement» (23). Au niveau national, la concurrence ne s'instaura pas vraiment. Les prix payés par l'administration n'enregistrèrent aucune évolution favorable pour celle-ci. Certains purent même estimer que la séparation entre la recherche et le contrôle du matériel réalisée en 1975, en privant le CNET d'un atout essentiel, détériora la position de l'administration face à ses fournisseurs.
Le retrait de Thomson de l'industrie du téléphone à l'automne 1983 confirma qu'il n'y avait pas en France la place pour deux groupes en ce domaine. Malgré un très important effort de recherche et la qualité des résultats obtenus, Thomson fut obligé de disperser ses efforts et ne put réellement rentabiliser ceux-ci. D'énormes investissements furent ainsi perdus. « Au lieu de consacrer l'ensemble de ses moyens techniques et financiers au développement du système MT (temporel), Thomson les a dispersés sur cinq systèmes différents de commutation... Cette accumulation de développements simultanés ne pouvait conduire qu'à la catastrophe ... C'est par centaines de millions de francs qu'il faut mesurer l'effet de cette absence de priorité. (24) » L'abandon de Thomson, qui a cédé à CIT ses activités téléphoniques, a renvoyé de fait la structure de l'industrie des télécommunications à ce qu'elle devait être dans les projets mis au point avant 1974. Il est tentant d'expliquer ce revirement par le changement politique intervenu en 1981 et la nationalisation des deux grands groupes industriels Thomson-CSF et CGE. En fait, les nationalisations « n'ont joué dans la genèse de l'accord qu'un rôle marginal » (25). L'intérêt des deux groupes fut prépondérant. Alain Gomez pour Thomson et Georges Peberau pour CGE tirèrent simplement les conséquences des choix catastrophiques de 1975. Dans une situation financière plus que préoccupante, Thomson devait absolument se débarrasser d'activités déficitaires. CGE sut en profiter pour devenir le seul groupe industriel du téléphone en France par sa filiale portant désormais le nom d'Alcatel-Thomson. Analysant les raisons de cet accord, Georges Pebereau déclarait d'ailleurs : « Avant la crise on pouvait gérer des conglomérats, après il faudra se concentrer sur ses métiers » (26)
En lisant dans la presse de cette deuxième année de la première présidence de François Mitterrand, à propos du nouveau montage industriel : « C'est avec près de dix ans de retard ce que souhaitaient faire les hommes de Georges Pompidou », il est tentant de penser que, bien qu'éloignés par leurs camps politiques, les deux présidents se retrouvent, à travers le temps, dans leur volonté de mener une politique industrielle, garante de l'indépendance nationale (27).
Marcel Proust, consommateur pionnier, évoquait déjà le téléphone, cet appareil « où naîtrait si spontanément sur les lèvres de l'écouteuse un sourire d'autant plus vrai qu'il sait n'être pas vu » (28). Sa diffusion fut pourtant particulièrement difficile en France. Son histoire, intimement mêlée à celle de la culture française, rythmée par l'évolution des rapports entre l'administration, l'Etat et l'industrie privée, souligne les effets pervers du monopole d'Etat dans un domaine où, comme l'écrivait joliment J.-J. Chiquelin, « l'enchevêtrement des relations entre l'administration et le privé est d'une luxuriance toute amazonienne ». Le monopole n'est cependant qu'une donnée. Il ne détermine pas fatalement un climat inhibant pour l'industrie. L'exemple de la politique mise en œuvre par P. Marzin montre qu'une administration consciente des intérêts généraux du pays et de son industrie peut être capable de mettre en place un projet ambitieux et dynamique et de le mener à bien lorsqu'elle ne se contente pas de gérer des positions acquises et le pouvoir de services inamovibles. A l'heure où des choix décisifs se présentent pour l'avenir des télécommunications françaises, il semble bien que les idées toutes faites sur le sacro-saint service public ou la miraculeuse séparation de l'entreprise et de l'Etat doivent être laissées de côté. C'est sur un monopole, celui d'ATT, que la puissance des télécommunications américaines fut fondée et l'unanimité ne se réalise pas, loin de là, sur la pertinence de son démantèlement. De même les spéculations sur la déréglementation paraissent exagérer un phénomène dont les conséquences restent encore bien modestes. Les expériences passées et les nouvelles données apparues dans les années 1980 laissent supposer que la France devra adopter quelques principes simples pour se donner toutes les chances du succès. Définir clairement et durablement les responsabilités respectives du secteur privé et de l'administration, quelles que soient leurs parts respectives. Déterminer pour le long terme les choix politiques afin que ne pèsent plus sur les industries les risques de changement de cap intempestifs. Ces facteurs institutionnels ne doivent cependant pas éclipser les paramètres économiques et technologiques. Pour être en mesure de répondre aux défis que représentent les énormes besoins financiers de la recherche et l'internationalisation des marchés, les alliances avec les grands de l'industrie mondiale ne pourront être évitées. Cette dernière remarque se trouve d'ailleurs confortée par le rôle croissant joué par l'informatique dans les télécommunications. D'importantes restructurations industrielles en découleront fatalement, l'accord CGE- ITT l'a récemment démontré.
23. Georges Pebereau, déclaration à Y
Agence nouvelle, 8 juillet 1976.
24. Jacques Darmon, op. cit., p. 94.
25 J.-M. Quatrepoint dans Le Monde du 9 septembre
1983.
26. Déclaration de G. Pebereau au
Quotidien de Taris du 15 septembre 1983.
28. Le Matin du 9 septembre 1983.
27. M. Proust cité par P. Carré,
« Proust, le téléphone et la modernité »,
Revue française des télécommunications, janvier 1988,
p. 55-64.
Quel avenir pour les communications françaises?
Au-delà du domaine des télécommunications, l'histoire industrielle et technique de la France est éclairée par cette étude du téléphone. Les principes pouvant guider l'organisation de la recherche-développement apparaissent par exemple plus clairement. Pour que celle-ci se déroule dans de bonnes conditions, l'existence de la structure responsable, qu'elle soit privée ou d'Etat, doit être liée à la réussite du projet qu'elle entreprend. En créant spécialement RME pour la recherche en commutation électronique, Pierre Marzin avait posé les bases psychologiques de la réussite du projet. Cette capacité à rompre avec les situations acquises est rare en notre pays ! Au cœur de ces problèmes, le rôle décisif de l'innovation dans les rapports de force entre Etats et entre entreprises apparaît. Certes, le poids financier, les structures commerciales sont des éléments essentiels mais lorsque une innovation apporte un progrès réel ou des économies substantielles, elle peut entraîner d'importantes modifications dans les rapports de force au sein d'une branche industrielle. En ce qui concerne spécifiquement les télécommunications, l'innovation technologique nous semble bien ouvrir de courtes périodes durant lesquelles de nouvelles frontières se dessinent entre les groupes industriels. Cette période terminée, les rapports de force se stabilisent pour une période bien plus longue. Il reste que pour profiter pleinement de ce mécanisme, l'entreprise doit y être préparée par une politique de recherche ambitieuse et doit s'engager dans la phase d'industrialisation avec détermination, la vitesse d'introduction de l'innovation sur le marché étant cruciale.
Malgré les occasions perdues, le bilan de l'administration des Télécommunications et de l'industrie française est pourtant positif. Thomson-Alcatel, au sein du groupe CGE, est un candidat sérieux pour les compétitions internationales et a déjà remporté de beaux succès à l'exportation. La France est enfin dotée d'un téléphone moderne complété par de nombreux services dont le Minitel n'est pas le moindre. Recentré sur ses points forts, Thomson a remporté un succès prometteur en vendant son système RITA à l'armée américaine, faisant la preuve de son avance technologique dans les systèmes sophistiqués. L'administration des Télécommunications a su considérablement évoluer pour s'adapter à ses nouveaux objectifs. Une véritable « culture d'entreprise » propre à France-Télécoms, formée autant par les orientations générales que par la réflexion d'un personnel très qualifié sur sa mission, s'est forgée durant cette période (28) . Dotées d'un énorme potentiel scientifique et d'un savoir-faire au tout premier rang mondial, les télécommunications françaises, quels que soient leur organisation et statut futur, devront penser à l'échelle planétaire et se doter de structures où intérêt général, indépendance nationale et compétitivité ne seront pas incompatibles.
28. Sans adhérer aux explications freudiennes de L. Virol, nous pensons avec lui que durant cette période une véritable « identité » de l'administration des télécommunications s'est forgée. Son étude est certainement une clef pour comprendre l'évolution de ce secteur. La réflexion menée par les ingénieurs des télécommunications sur l'avenir de la DGT et du monopole forme, par exemple, un élément très important pour réfléchir aux solutions d'avenir. L. Virol, « L'administration face à l'évolution de la demande, des techniques et des mentalités », dans A. Giraud, J.-L. Missika, D. Wolton (dir.), Les réseaux pensants, Paris, Masson, 1978.
QUELQUES ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Pour que deux correspondants puissent communiquer, leur voix doit être transportée tout au long de lignes téléphoniques. Les moyens utilisés pour cela, et tout particulièrement les cables, relèvent de la « transmission ». Il n'y a cependant pas que deux abonnés, le réseau en comprend des millions et il n'est pas question de relier directement chaque abonné à tous les autres abonnés par un fil. Il faut donc acheminer les communications sur des voies de tailles différentes, les orienter vers le bon destinataire. Le central de commutation est l'élément essentiel de cette distribution des messages, sorte de gare de triage du réseau téléphonique. L'autre grand domaine technique du téléphone est donc la « commutation ».
Le Crossbar fut après la seconde guerre mondiale le modèle de central de commutation le plus développé. Lorsque un abonné appelle son correspondant, la bonne destination est sélectionnée par des systèmes de barres se croisant (Crossbar) en fonction du numéro composé sur le combiné. A chaque numéro correspond une position différente.
L'électronique a donné aux techniques de
commutation de nouvelles possibilités. Le central de commutation
spatial n'est que partiellement électronique, il sélectionne
toujours la bonne connection dans l'espace par le croisement de barres
métalliques. Il est en fait un central Crossbar dont les performances
sont améliorées grâce à des calculateurs électroniques.
Le central de commutation temporel est lui totalement électronique.
Il sélectionne la bonne connection grâce à des systèmes
électroniques commandés par des programmes informatiques.
Il rompt totalement avec la technologie Crossbar, aucune pièce
mécanique n'est en mouvement, la dimension de sélection
n'est plus l'espace mais le temps, la gestion est totalement informatisée.
La commutation temporelle permet de mettre en place le
Réseau numérique a intégration de service (RNIS)
qui transmettra sur un réseau unique l'ensemble des informations,
voix, images, données informatiques.
sommaire

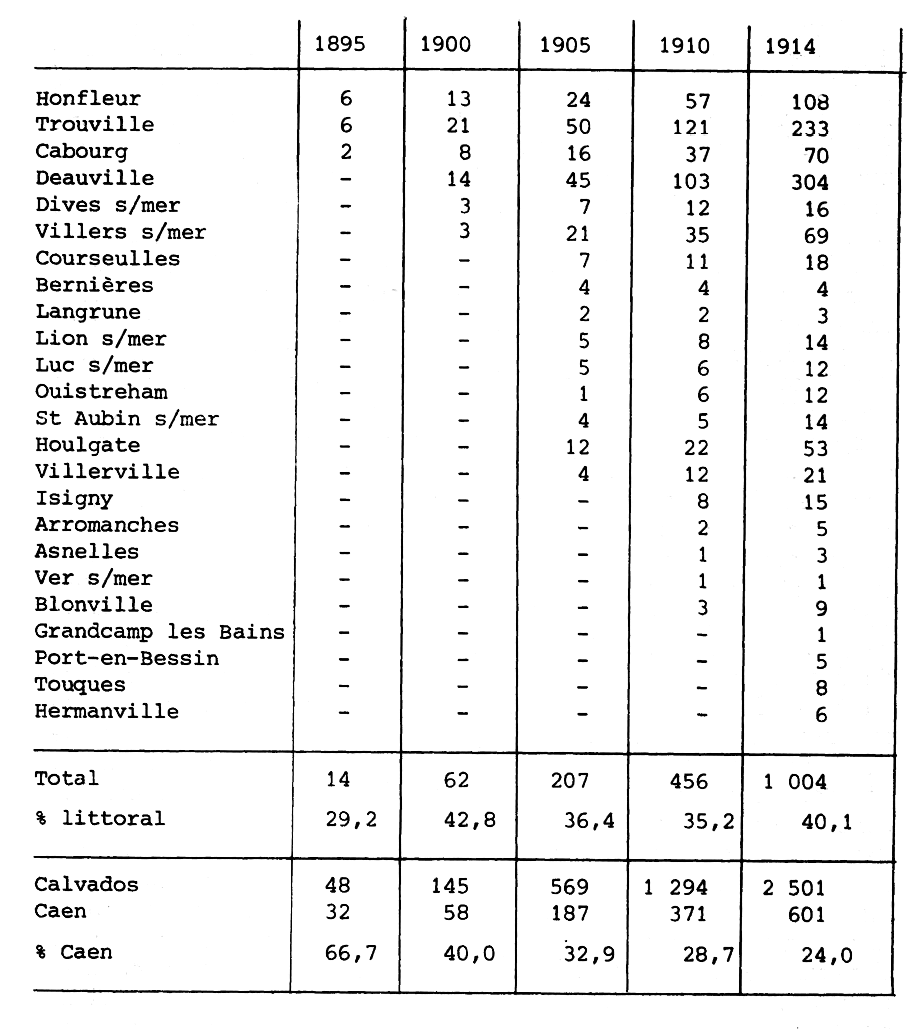 agrandir
agrandir 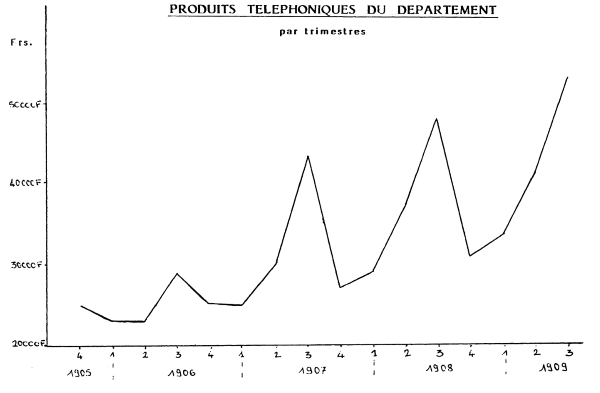
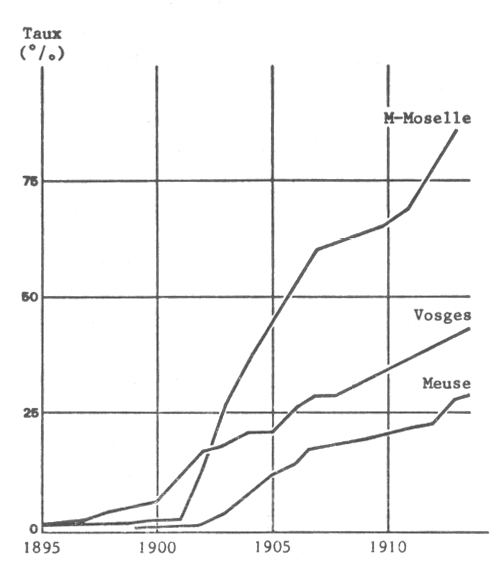 2
2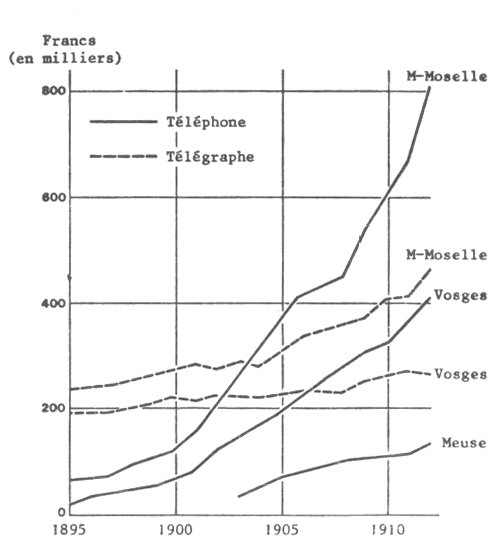 3
3