1895-2025
HISTOIRE DU TELEPHONE EN FRANCE suite de la période
1
A
partir de 1913
Les centres automatiques
1970-1988
Du téléphone au télécommunications
Fin du téléphone électromécanique,
généralisation de l'électronique
Fin du téléphone
fixe, généralisation de l'Internet
annexe - Liste
des ministres des PTT depuis 1878
annexe
- Historique des différents types de commutateurs en France
annexe
- Les architectes des PTT, le patrimoine immobilier
1895 A cette période, le déploiement
de lignes et de téléphones est assez timide si l'on compare
aux Etats Unis et l'Allemagne.
Pour illustrer, en 1893, une première cabine téléphonique
publique est installée à l’intérieur de la
poste de Nanterre.
Dans le courant de l’année suivante, les trois premiers
abonnés au téléphones vont être raccordés
et seront répertoriés sur la liste officielle des abonnés
au téléphone de Paris. La société Cauvin-Yvose,
fabrique de bâches et de sacs, avenue de la République,
premier abonné au téléphone à Nanterre,
bénéficie du numéro 1, la Compagnie française
de charbons pour l’électricité, usine du Moulin-Noir
(au Chemin-de-l’île) a le numéro 2 et la mairie
le numéro 3. À la fin de l’année 1896,
le service ayant entre-temps été nationalisé en
1889, Nanterre comptera dix abonnés au téléphone.
Quelques statistiques suffisent pour visualiser le développement
du "boom téléphonique".
Ainsi, en janvier 1890, le premier annuaire des abonnés de la
ville est publié à Paris, qui contient 6 995 personnes
(dont 823 personnes) classées par ordre alphabétique d'adresse
et de profession.
Les opérateurs téléphoniques de 12 centres-villes
ont trouvé le bon interlocuteur selon ces dernières informations.
Par exemple, on pourrait demander « Pier Tettinger, marchand de
métaux, habitant au 22 rue de Dunkerque et relié au centre
d'appels du boulevard de la Villette ». Des liaisons interurbaines
avec Bruxelles, Le Havre, Rouen, Lille, Reims, Lyon et Marseille étaient
possibles, mais régulières.
La demande croissante de téléphones entraîne la
multiplication des entreprises manufacturières à Paris
: au début du siècle, elles sont plusieurs dizaines (Aboilard,
Grammont, Jacqueson, Charron Bellanger, Gautier & Hugues, Picart-Lebas,
Berthon-Ader, Thomson -Houston , SGT (Société Générale
des Téléphones), SIT (Société Industrielle
des téléphones), J. Dubeuf, LMT (Le Matériel Téléphonique
Constructeur), Radiguet, Burgunder, etc.).
Déja en 1893, il existait des systèmes d'installation de postes téléphoniques en embrochage qui sont des systèmes ou l'on peut trafiquer à plusieurs téléphones sur une seule ligne chacun son tour un seul à la fois, cela afin d'économiser les coûts d'installation sachant que c'est le km de ligne qui revient le plus cher et on pensait aussi à cette époque ce que deviendra la téléphonie automatique.
En 1894, le 16 juillet,
par le décret du 16 juillet 1894 (BO P&T n°14 page 503),
Monsieur Gustave Pierre SÉLIGMANN-LUI est nommé Directeur
du Service Téléphonique de la région de Paris.
Celui-ci partira pour d'autres fonctions le 18 novembre 1896.
En août 1894 dans la « Revue Politique et Parlementaire
» nous avons trouvé, sous la signature de M. Charles
Gide, à cette époque Professeur de Droit à la Faculté
de Montpellier, un article intitulé « Les Téléphones
en France » et qui n'est rien moins qu'élogieux pour
l'Administration.
|
Les Téléphones en France
Article de Charles GIDE, Professeur à la Faculté
de droit de Montpellier. « M. Jules Lemaître place dans la
bouche d'un des héros de son roman Les Rois un mot qui
a fait fortune : « Ce qui me plaît dans Paris, c'est
que tout y arrive cent ans plus tôt qu'ailleurs. »
Ce compliment a agréablement chatouillé la fibre
des Parisiens, et même celle des provinciaux qui prennent
toujours une petite part des compliments adressés à
la capitale. Il y aurait fort à dire sur ce propos. Contentons-nous
de faire remarquer que dans le modeste domaine qui fait l'objet
de cet article le compliment n'est rien moins que mérité.
|
En 1896,
le 1er décembre, par le décret du 12 novembre 1896 (BO P&T
1896 n°14 page 316), le Service Technique Télégraphique
et Téléphonique de Paris et le service des bureaux centraux
télégraphiques et téléphoniques de Paris sont
placés sous l'autorité d'un directeur qui prendra le titre
de Directeur des Services Électriques de la région de Paris.
Donc, à nouveau, la branche Téléphone se retrouve
réunie à la branche Télégraphe.
L'autonomie symbolique acquise en 1892 semble avoir
fait long feu, vis-à-vis de la branche Télégraphique,
mais autonomie maintenue vis-à-vis de la branche Postale...
Par arrêté ministériel du 18
novembre 1896, (BO P&T Annexe 1896 n°11 page 715), Monsieur Pierre
François Édouard DARCQ est nommé, à titre
temporaire, Directeur des Services Électriques (télégraphes
et téléphones) de la région de Paris.
En 1897 On compte
alors en France 11.314 abonnés, dont 6.425 à Paris.
La gestion par nom n'est plus possible, les opératrices n'arrivent
plus à gérer, il est décidé d'attribuer
un numéro à chaque abonné.
Ce premier plan de numérotation prévoit un numéro
à cinq chiffres; le premier désignant le central de
rattachement, les deux suivants le standard et les deux derniers l'identifiant
de l’abonné parmi les 99 lignes de chaque standard.
Un annuaire des abonnés doit donc être édité
et à partir de 1897, il demandé aux usagers d’annoncer
à l’opératrice le numéro et non plus le nom
du correspondant, ce qui souleva nombre de protestations.
Ailleurs, les innovations et progrès continuent, Freidenberg
ingénieur Russe, dépose sous le numéro 543 412
un brevet pour un système de commutation automatique. le 24
septembre 1895, l'Office des brevets des États-Unis
lui a délivré un brevet sous le numéro 546 725.
Sa maquette du central téléphonique du dernier modèle
fut fabriquée à Paris en 1898.
Il n'y eut pas de suite.
En 1898, par le décret
du 15 février 1898 (BO P&T Annexe 1898 n°3 page 261), Monsieur
Arthur PAUTE-LAFAURIE est nommé Directeur des Services Électriques
(télégraphes et téléphones) de la région
de Paris et le restera jusqu'à sa retraite le 30 avril 1900.
| En
1894 Mihajlo
Idvorski Pupin inventa une technologie qui permit de limiter l'affaiblissement
des conversations vocales sur de longues distances, par le biais de
bobines de charge insérées à intervalles réguliers
tous les 1830 mètres sur les liaisons de transmissions.
Ces bobines ont été familièrement désignées par le terme 'Pupin'. Grâce à ces bobines, l'affaiblissement restait identique dans la gamme de fréquences de la voix téléphonique. Il était alors possible de faire des communications longue distance sans passer par des éléments actifs. Bien que la gloire et tous les avantages matériels provenant de l'acquisition du brevet en 1899 par AT&T, il revinrent à Pupin, L'utilisation de bobines en série sur les câbles de communication avait été développée par George Ashley Campbell, à partir d'un article de Oliver Heaviside (1887). AT&T préféra acquérir le brevet de Pupin plutôt que de risquer de ne pas bénéficier de la protection d'un brevet du tout en cas de procès. (A lire pour plus de détails sur la pupinisation) |
 |
Dans le monde et en Europe, des bureaux téléphoniques « à batterie centrale » et munis de lampes de signalisation commencèrent à entrer en service vers 1899, mais en France le retard se fait sentir.
Pour la première fois une grève des Postes éclate à Paris le 18 mai 1899 pour demander une augmentation de salaire. Elle est durement réprimée par le sous-secrétaire d'Etat aux Postes et Télégraphes, Léon Mougeot.
On aura une idée du développement de l'industrie
téléphonique en France, par la statistique ci-après
établie au 1er janvier 1899 :
1. Réscaux urbains :
Nombre de réseaux exploités par l'Etat... 767
Longueur, en kilomètres, des lignes ... 16.094
Longueur, en kilomètres, des fils ..... 189.686
IL Circuits interurbains :
Nombre de circuits 1.288
Longueur, en kilomètres, des lignes . 21.511
Longueur, en kilomètres, des fils ..... 59.975
III. Stations et postas :
Nombre de stations centrales ............. 805
Nombre de cabines publiques ......... 1.261
Nombre de postes d'abonnés .........51.383
IV. Personnel (nombre d'agents) 2.789
V. Nombre de conversations : Urbaines 138.128.082 et Interurbaines
3.098.801
VI. Recettes (En francs) ........13.273.994
VIL Dépenses (En francs) ....10.700.977
L'exposition universelle de Paris 1900 La vie Illustrée du 27 Avril 1900
|
En son éloquent discours d'inauguration de
l'Exposition, M. le Ministre du Commerce, célébrant
le prodigieux essor scientifique du 19 ème siècle,
a rappelé les grandes inventions qui bouleverseront la vie
économique de notre société : la vapeur, l'électricité,
le téléphone. Les cabines téléphoniques des bureaux et des jardins, les plus nombreuses, sont ouvertes, Vincennes excepté, de 7 heures du matin à 11 heures du soir. Le service de ces cabines est effectué par 2 téléphonistes. Les autres, situées dans les galeries, ne fonctionnent que de 7 heures du matin à 7 heures du soir; elles sont desservies par un téléphoniste. Parmi ces cabines, il convient d'en signaler quatre d'un nouveau modèle, parfaitement agencées et éclairées et bien isolées au point de vue acoustique. Les cabines de la rive gauche sont toutes reliées au bureau central téléphonique de la rue Gutenberg. Celles de la rive droite sont reliées avec Desrenaudes ou avec Passy suivant qu'elles sont situées dans les Champs-Elysées ou au Trocadéro. La moyenne quotidienne des communications téléphoniques varie entre 1500 et 1600. |
|
En 1900, par le décret
du 1er mai 1900 (BO P&T Annexe 1900 n°6 page 314), Monsieur André
Mathurin FROUIN est nommé Directeur des Services Électriques
(télégraphes et téléphones) de la région
de Paris.
Il conservera ce poste jusqu'à son départ à la Direction
des Services Télégraphiques de Paris le 18 juin 1907.
Octobre 1900
A Paris, premier essai du système automatique Strowger
dans les locaux du Ministère du Commerce, pour évaluer
ce nouveau système; il n'y avait que des postes privés hors
publique.
 |
Avec l'automatisation apparait le cadran
: Strowger avait aussi en 1896 inventé la numérotation au cadran. (brevet) 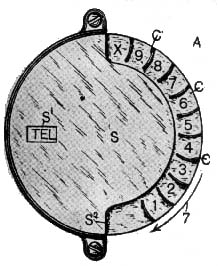
A cette époque, les systèmes rotatifs pas à pas de type Strowger, sont dépourvus d'enregistreurs (de la numérotation), et ce sont les Cadrans Téléphoniques des abonnés qui constituent l’Organe de Commande du commutateur. Dans une telle configuration, il est impératif que chaque cadran téléphonique soit réglé avec grande précision, sous peine d’entraîner de nombreux faux numéros. |
Au 1er janvier 1900 : Nouvelles normes
de fabrication, prescriptions applicables aux constructeurs d'appareils
téléphoniques :
- contacts à frottement pour tous les organes de commutation, interdiction
de l'usage des vis à bois.
- indépendance de tous les circuits (commutation par double rupture).
Dans les postes précédents la borne L2 était commune
à tous les circuits.
A PARIS Un central manuel neuf pour la rive gauche est mis en service en avenue de Saxe.
En 1901, il est décidé
en France, que chaque abonné se voie accorder une ligne.
Ainsi donc, en France, depuis cette année, les lignes partagées
entre plusieurs usagers sont proscrites.
En 1901, le ministre des postes et des télégraphes
Alexandre Millerand nomme E. Estaunié directeur de
l'Ecole professionnelle des postes et télégraphes. Il réforme
alors celle-ci, introduisant les enseignements de langues étrangères
et de culture générale, renouvelant les professeurs, mettant
à jour les programmes. Il organise des conférences dispensées
par des scientifiques de renom tel qu’Henri Poincaré, Paul
Langevin et Pierre Curie.
Il donne également des cours sur les appareils de télégraphie
et téléphonie.
En 1904, l créé le mot «télécommunication»
le définissant comme «la transmission à distance de
la pensée par l’électricité» dans son
ouvrage Traité pratique de télécommunication électrique(télégraphie-téléphonie).
En 1902, l'administration normalise
les appareils comme le poste Pasquet .

 équipé du micro solid-back
équipé du micro solid-back 
Cet appareil a existé en trois versions :
- l'appareil mobile avec son micro fixe,
- le poste mural de même constitution, sauf qu'il ne comporte
pas de clé d'appel car il est toujours installé avec un
appel magnétique,
- l'applique murale sans micro fixe, qui comporte un "combiné"
(poignée supportant le microphone et l'écouteur).
sommaire
En 1904, le mécontentement
des usagers du téléphone prend de l'ampleur sur tout le
territoire national.
A l'initiative du marquis Maurice de Montebello est créée
une association nationale dans le but de défendre les intérêts
des abonnés au téléphone.
Le 14 avril, il diffuse la lettre suivante :
"Monsieur et cher co-abonné",
La question des téléphones est l'ordre du jour. Nous sommes
d'accord pour protester contre une administration tyrannique, coûteuse
et routinière, qui abuse de son monopole et de notre faiblesse,
qui réalise chaque année près de 10 millions de bénéfice
à nos dépens, sans nous donner aucune satisfaction. Mais
il s'agit de rendre nos protestations efficaces. Quelques amis et moi,
nous avons donc pensé que le moment était venu de former
nos intérêts et obtenir de l'administration la réduction
des tarifs promise depuis trois ans, l'amélioration des services
par l'augmentation du personnel et par le perfectionnement du matériel,
en un mot, pour étudier et faire aboutir toutes les réformes
qu'il convient d'apporter au régime téléphonique
actuel.
Si, comme nous le croyons, vous êtes de notre avis, veuillez nous
le faire savoir et vous nous adresserons une convocation pour l'assemblée
générale des abonnés au téléphone
que nous proposons de réunir incessamment .... (voir l'article
L'avenir de la Vienne du 22 avril 1904)
La première assemblée générale de l'Association
des abonnés au téléphone s'est tenue le 15 octobre
1904 sous la présidence de Maurice de Montebello. Et les propos
recueillis montraient bien la tension entre abonnés et administration.
L'Administration des Téléphones en France
Nos lecteurs ont été mis au courant, par les bulletins d'août
et de septembre, de la plainte que M. G. Locke, avocat à la Cour
d'appel, nous
avait adressée et que nous avions transmise à l'Administration,
ainsi que de la suite donnée a cette plainte. Après la lettre
que nous avait fait parvenir à Mr Salomon, Directeur du Cabinet
et du Personnel au Sous-secrétariat des Postes, Télégraphes
et Téléphones, nous avions tout lieu de considérer
l'incident comme clos, M. Loche, étant lui-même, aux termes
de cette lettre déclaré satisfait. Aussi , notre étonnement
fut grand à la réception de la communication ci-dessous,
par laquelle Mr Loche proteste contre les explications de M, Salomon.
Monsieur le Président, Je vois, hélas! que votre Administration
fait aux réclamations transmises par votre Association le même
sort qu'à celles transmises directement par les abonnes. Mais elle
ne devrait pas, au moins, violer aussi outrageusement la Vérité
!
J'apprends par votre numéro de septembre la réponse que
l'on a faite à ma réclamation reproduite dans le bulletin
d'août. Tout d'abord, à là suite de ma réclamation
concernant le refus de me donner mon n° 697.69 demandé au Palais
de Justice (et non au Tribunal de Commerce) je n'ai pas reçu de
visite d'inspecteur, je n'ai donc pas pu « bien accueillir »
des explications qu'on ne m'a pas données, ni « renoncer"
à réclamer mes frais de voiture » qui me sont dus
et que je réclame au contraire énergiquement .
A la suite de ma réclamation, j'ai reçu, le jour même,
un électricien; quand cet ouvrier est entré chez moi, le
timbre sonnait, c'était l'administration qui nie téléphonait
: mon appareil fonctionnait donc ! L 'ouvrier l'a démonté
et c'est alors seulement, après avoir dévissé dès
fils, qu'il a prétendu trouver une interruption qui ne s'est produite
que pendant quelques minutes. Il n'a put en, établir la cause;
à force de chercher, il a trouvé une microscopique tache
de rouille sur le pivot, pour justifier l'administration ! Or, il y a
plusieurs mois que je réclame et je paye l'entretien de mes appareils,
entretien dont est chargée l'Administration. Cette microscopique
tache de rouille ne peut justifier l'Administration; j'en reviens toujours
à mon raisonnement : je paie 400 fr. pour avoir la communication
et faire entretenir mon appareil, celui-ci n'est pas entretenu et on ne
me donne pas de communication ... je réclame le remboursement de
mes 2 francs de voiture !
Je vous prie d'appuyer ma réclamation auprès de l'Administration
et de protester contre les inexactitudes trop nombreuses que l'on trouve
sous l'a plume du « Directeur du Cabinet et du Personnel ».
Veuillez agréer ...............
Naturellement et pas plus que M. Loche, nous n'avons hésité
un instant, et nous avons adressé, le jour même, à
M. le Sous-secrétaire
d'Etat, la lettre ci-dessous.
Paris, le 16 septembre 1904
Monsieur le Sous-secrétaire d'Etat aux Postes et Télégraphes.
Monsieur, lors de la visite que MM. le Marquis de Montebello et Max-Vincent,
Président et Vice-Président de l'Association des Abonnés
au Téléphone, ont eu l'honneur de vous faire, vous avez
bien voulu leur donner l'assurance que des instructions très précises
seraient données à vos divers services pour que les plaintes
et réclamations que notre Association pourrait leur transmettre
fussent examinées avec le plus grand soin. A la date du 28 juillet
dernier, nous vous avons communiqué une réclamation émanant
de M. G. Loche, avocat à la Cour d'Appel, en vous priant de vouloir
bien faire procéder à une enquête très sérieuse
sur cette plainte. A la date du 19 août, une lettre signée
du Directeur du Cabinet et du Personnel nous faisait connaître qu'à
la suite des explications fournies par M Froment, inspecteur, à
M. Loche, ce dernier se déclarant satisfait, « retirait la.
demande qu'il avait formulée primitivement, en vue du remboursement
de ses frais de voiture. » .
Cette lettre, publiée dans notre Bulletin mensuel de septembre,
nous attire la réponse ci jointe de M. Loche. Vous comprendrez
aisément, Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat, qu'il ne nous
est pas possible d'accepter pareils procédés de votre Administration,
et nous sommes convaincus qu'il nous aura suffi de vous les signaler pour
que pareils faits ne puissent plus se produire à l'avenir. Il est
de notre devoir d'appeler l'attention sur ces faits, et nous vous serions
très reconnaissants de vouloir bien prescrire sur cette question
une nouvelle enquête, en donnant les instructions nécessaires
pour que, cette fois, elle soit conduite avec toutes les garanties de
sincérité et d'impartialité que nous sommes en droit
d'exiger, tant en notre nom qu'au nom, des intéressés: qui,
comme M. Loche, ont remis leur cause entre nos moins.
Veuillez agréer, Monsieur le Sous-secrétaire d'Etat, l'hommage
de mes sentiments de haute considération.
Le Président, M. DE MONTEBELLO.
Quelles vont être, après cette seconde plainte, les explications
de l'Administration ?
Nous ne le savons pas encore à l'heure où nous écrivons
ces lignes, bien qu'une quinzaine de jours déjà se soient
écoulés depuis l'envoi de notre
lettre à M.. Bérard. Mais, en tout cas, nous continuons
à réclamer une enquête sérieuse, vraie, sincère,
n'admettant pas de telles réponse erronées de la part de
l'Administration.
Un de nos adhérente, M. le Dr Bosquain, vient d'être aussi
victime d'une série d'incidents qui valent la peine d'être
contés.
Dans le courant du mois de juillet, il fit effectuer au bureau 34 (avenue
Marceau), par sa bonne, le versement de 100 frs pour un trimestre de son
abonnement. En son absence, le reçu de cette somme fut déposé
sur son bureau, et y resta pendant deux ou trois jouis, puis M. le Dr
Bosquain, dans
la hâte d'un départ à la campagne, le classa et ne
le retrouva plus. Quelque temps après, un avis lui parvint, lui
intimidant, avec cette aménité et cette courtoisie qui sont
les caractéristiques de l'Administration, l'ordre de payer le dit
trimestre dans un délai de cinq jours, sous menace de suspension
de ses communications.
Emoi de M. le Dr Bosquain, certain d'avoir eu en sa possession le fameux
reçu et de l'avoir rangé ! Malheureusement, les dimensions
microscopiques de ces reçus facilitent de beaucoup leur perte et,
ne pouvant le représenter, notre adhérent se résigna
à payer une seconde fois ! Mais, suspectant, à bon droit,
semble-t-il, le bureau 34 de négligence, M. Bosmiain informa l'Administration,
par nos soins, de son refus de payer une seconde fois au dit bureau. La
division de la comptabilité nous informa qu'un reçu de 100
fr. serait présenté, le lendemain, au domicile de M. le
Dr Bosquain. Mais, entre temps, ce dernier reçut un ordre téléphonique
d'avoir à effectuer ce versement, sous peine de suspension, au
bureau. de la rue Ballu. Notez que notre adhérent habite rue de
Chaillot ! -,Craignant, avec assez de raison, d'être victime d'une
fumisterie, il préféra attendre qu'on lui présentât
le reçu à domicile. Ce qui fut fait le 15 de ce mois. —
Le second versement fut effectué. Or, le lendemain même de
ce paiement, un premier coup de téléphone avisait M. Bosquain
d'avoir à payer immédiatement au bureau de la rue Ballu,
et un second, au bureau 34 !
M. Bosquain se fâcha, ce qui est assez compréhensible et
expliqua qu'il avait payé, pour la seconde fois, la veille.
Naturellement, à chacun des deux coups de téléphone
en question, nouvelle menace de se voir couper toute communication.
L'affaire en est là ! ..... et les explications
et revendications continuent (voir
le lien ).
On arrive ensuite au sujet de la grève ... voir
le lien
En 1904 Marcel Sembat, député de la Seine, rapporteur
du budget des P&T, présente au parlement un rapport au nom
de la commission du budget, il mentionne : "L'excès du mal,
parfois engendre le remède et la crise téléphonique
a durant l'été dernier, amené la constitution d'un
organisme nouveau et précieux : L'association des abonnés
au téléphone.
La tentative mérite d'être signalée et suivie ...
cette association a de l'avenir et nous présente un exemplaire
typique d'une forme de groupement qui se développera de plus en
plus dans les sociétés futures : les groupements de consommateurs
... " Annonce très prémonitoire.
sommaire
LE RAPPORT En 1905, au nom de l'association,
Maurice de Montebello diffuse un rapport intitulé "La question
des téléphones, le téléphone à l'étranger,
le téléphone en France, le règlement et le tarif,
l'administration et le personnel, le matériel".
Ce dossier très documenté, fait une critique sévère
de la situation du téléphone en France.
Dans son introduction, les deux principales objections formulées
par l'administration des téléphones sur ses incapacités
à résoudre les plaintes des abonnés sont vivement
réfutées.
A la première objection qui porte sure l'insuffisance dont elle
dispose pour améliorer les services téléphoniques,
il est répondu que la bonne marche des services téléphoniques
n'est pas nécessairement subordonnée à une question
budgétaire, ensuite que l'administration des téléphones
n'a jamais demandé les crédits nécessaires ...
A la seconde objection qui prétend que l'état actuel de
l'industrie téléphonique, il n'est guère envisageable
qu'on puisse apporter à la situation présente une amélioration
sensible, il est répliqué que l'industrie téléphonique
a réalisé depuis quelques années des progrès
énormes que l'administration des téléphones feint
d'ignorer .... si dans quelques pays le téléphone fonctionne
très mal, dans beaucoup de pays il fonctionne très bien.
Puis ce rapport fait un état des lieux du service téléphonique
dans les pays étrangers. Il affirme que le service téléphonique
est très satisfaisant aux Etats-Unis ou le téléphone
a pris une extension considérable avec plus de 2 millions de postes
et ou les capitaux engagés s'élèvent à près
de 2 milliards. Le téléphone commencerait à fonctionner
correctement dans 20 grandes villes d'Europe. Ce ne serait guère
qu'à Paris et à Madrid qu'on trouverait encore des méthodes
surannées et un matériel antique. Dans les autres pays l'administration
agissant comme une maison de commerce considère l'abonné
comme un client qu'elle doit attirer et conserver ... Des appareils de
types uniformes, sont mis gratuitement, par l'administration elle même,
à la disposition des abonnés. Ces appareils sont munis de
dispositifs permettant de simplifier les opérations de l'abonné
comme l'avertissement de l'opératrice au décroché
du récepteur, de l'établissement d'une communication et
inversement au raccroché . Le signal de fin de communication est
donné automatiquement sans que l'opératrice ait à
suivre la conversation.
Sur le plan du matériel, le rapport condamne l'emploi de milliers
d'éléments de piles primaires établis aux postes
des abonnés qui a depuis longtemps été reconnu comme
le principal défaut des anciens systèmes , en raison de
la fragilité, des complications et des dépense d'entretien
considérables inhérentes à ce système de piles
... Au contraire la batterie centrale, rendue possible grâce au
génie de Planté, permit de transformer radicalement le fonctionnement
des centraux téléphoniques, en assurant à tou le
système un courant constant et uniforme, dont les générateurs
placés au bureau central et à la portée du personnel
compétent peuvent être aisément et continuellement
vérifiés et entretenus.
La généralisation des systèmes à batterie
centrale a permis, dans les bureaux centraux, d'abandonner d'abord depuis
plus de vingt ans, les premiers commutateurs multiples en série,
puis depuis une dizaine d'années, les commutateurs en dérivation
au profit des commutateur multiples à courant central.
De plus le système à batterie centrale permet de remplacer
les indicateurs électro-magnétiques à volet qui informe
l'opératrice de l'état des lignes par un système
de deux lampes par paire de cordons qui permet à l'opératrice
de suivre, par la vue, toutes les phases de la communication, en évitant
les indiscrétions de sa part, les ruptures prématurées
de communication et une perte de temps considérable ... De ce fait,
une même opératrice peut servir de manière satisfaisante
200 appels par heure .
La suite du texte se poursuit en détaillant la situation du téléphone
en France, et particulièrement à Paris. Reprenant les constatations
faites au parlement par M. Sembat, il est mentionné qu'en France
l'administration considère les abonnés non comme des clients,
mais des contribuables taillables et corvéables à merci.
Les abonnés doivent acheter eux-mêmes les appareils fort
coûteux, de type très variés et très compliqués
qui nécessite la manœuvre énervante du bouton ou d'une
manivelle ... l'abonné est obligé de s'épuiser en
élevant la voix ... il est entravé par une foule de bruits
divers qui empêchent la communication dans de nombreux cas ...
En outre l'opératrice très souvent tarde à répondre
ou transmet inexactement le numéro . Les communications sont très
lentes à établir et elles peuvent être coupées
impestivement ou interrompues par des causes diverses. En cours de communication
il est possible d'attirer l'attention de l'opératrice puisque tout
appel de l'abonné est considéré comme signal de fin.
A la fin d'une communication l'abonné est de manœuvrer le
bouton ou la manivelle, ce qu'il oublie de faire la plupart du temps.
Les lignes sont souvent en dérangement et les réparations
sont longues . Les raccordement nouveaux comme les transferts demandent
des délais de plusieurs semaines.
L'annuaire fourmille d'erreurs et l'administration, au détriment
des abonnées, en a fait un organe de publicité et souvent
un moyen de concurrence déloyale.
Au point de vue de la rapidité des communications, la moyenne d'attente
des bonnes communications est d'environ de deux minutes .... parfois même
la communication est rendue matériellement impossible.
Sur le plan du règlement et du tarif , les récents conflits
soulevés ont montrés dans quel esprit tyrannique, vexatoire
et anticommercial, le règlement imposés aux abonnés
français a été rédigé. Le réglement
serait entaché d'erreurs et d'illégalités. Quant
au tarif il est jugé exorbitant.
En ce qui concerne le personnel, les sous secrétaires d'état
n'ont, au point de vue téléphonique, aucune compétence
technique et paraissent ignorer toutes les règles d'une administration
industrielle et commerciale. Il n'existe aucune école spéciale
pour les ingénieurs téléphonistes qui sont recrutés
au petit bonheur dans les services postaux et télégraphistes
... Les opératrices ne recoivent pas non plus d'enseignement spécial
et c'est au dépens qu'elles font leur apprentissage... Au point
de vue de la discipline, à la tolérance la plus aveugle
succède la sévérité la plus brutale....
La comptabilité n'existe pas. Non seulement le public n'est pas
encouragé aux abonnements, mais au ontraire à le dégoûter
du téléphone.
Quoique l'augmentation du nombre d'abonnés ait été
relativement faible, l'Administration déclare qu'elle se trouve
débordée.
Pour ce qui est du matériel, le rapport affirme qu'aucun progrès
sérieux n'a été accompli par l'administration qui
a laissé en service un matériel abandonné partout
depuis longtemps.
L'énergie électrique est toujours fournie par les piles
primaires placées chez les abonnés. Les commutateur multiples
"en série", rejetés depuis vingt an, sont encore
en usage pour 8000 abonnés parisiens, soit le quart de la totalité.
Quant aux signaux, un grand nombre de multiples sont encore munis de volet
à relever à la main par l'opératrice, un certain
nombre sont pourvus du volet automatique, lequel fonctionne très
irrégulièrement, les derniers enfin sont pourvus de signaux
lumineux, formés par une seule lampe non automatique. Ces trois
systèmes ont d'allieurs tous le même inconveniant, celui
d'obliger l'opératrice à surveiller constamment la communication
entre deux abonnés, d'où perte de temps, indiscrétions
inévitables et erreurs fréquentes
L'administration affirme qu'il n'existe pas de compteurs automatiques
en service; soit mais l'expérience a prouvé que le compteur
contrôlé directement par les opératrices est infiniment
préférable... Pourquoi ne les a t'on pas adoptés
pour l'établissement des conversations taxées ?
Nous ne savons que trop qu'avec le système actuel une opératrice
est surmenée avec 80 abonnés.
Au point de vue des lignes auxiliaires, l'administration s'est enfin décidée
à étudier le système des lignes d'ordre ou de service
pratiqué partout depuis dix ans.
L'installation des nouveaux multiples, actuellement construits depuis
plusieurs mois, sont pour l'auteur du rapport, dans l'incapacité
de fonctionner au mois de juillet 1905, date avancée par l'administration
pour mettre fin à la crise actuelle. De plus ces multiples , loin
de constituer un progrès , entraîneront une complication
de service plus grande encore et l'économie du prix de revient
sera annulée par l'augmentation inévitable du personnel...
L'administration pourrait pourtant bien facilement doter le réseau
parisien d'un système moderne, car la ville de Paris se trouve
dans des conditions extrémement favorables au développement
d'un service téléphonique, aucune ville au monde ne possédant
un réseau d'égouts aussi bien établi, aussi bien
accessible et aussi propice à l'installation de câbles souterrains.
Pour procéder à l'ensembles des transformations, pour tout
le réseau de Paris, il faudrait engager une dépense évaluée
à 250 Fr par abonné, soit environ 10 millions. L'économie
engendrée par la suppression des piles est estimée à
2 millions par ans. En 5 ans, la transformation serait payée par
les économies en résultant. Après ce délai,
l'exploitation présenterait une augmentation de bénéfice
de 2 millions par an .
Le rapport consacre un mince paragraphe au téléphone en
province. Il affirme que le manque absolu d'intérêt que l'Administration
porte au développement du service téléphonique en
province résulte du simple examen des statistiques , qui montrent
que l'ensemble des abonnés de tous les départements réunis
atteint à peine le nombre des abonnés de Paris. Il suffit
de comparer ces statistiques à celles des autres pays pour être
convaincu de l'incurie et de l'incapacité de l'administration des
P&T.
Il est inutile de dire que le service déjà si mauvais à
Paris, est encore bien plus défectueux en province où on
envoie que du matériel de rebus et où le personnel dirigeant
est privé de toute autorité et surtout de toute initiative.
En conclusion ce rapport s'achève par ces trois termes :
Il faut cesser d'avoir recours à des expédients.
Il faut recourir à une transformation radicale des méthodes
et des systèmes
Pour cette transformation, il faut laisser de côté tout amour-propre
mesquin et profiter résoluement et immédiatement des progrès
réalisés.
C'est à une commission extra-parlementaire que devra être
laissé le soin de choisir, parmi les systèmes étrangers,
celui qu'il conviendra d'adopter.
Là est la solution à la cris et pas ailleurs.
Malgré toute l'ampleur de cette contestation et le sérieux
des constats établis, l'administration se trouve dans l'incapacité,
faute principalement de crédits, de remédier à la
situation. Tous les usagers de France, disposent d'un service téléphonique
de très mauvaise qualité et qui leur coute très cher.
sommaire
Pendant ce temps en 1905, les suédois
Betulander et Palmgren travaillent de leur côté sur un
futur système Betulander, et
leur compatriote suèdois Ericsson, propose sur plan, un
système tout à relais – une proposition qui était
bien en avance sur son temps.
En 1905 apparait
le modèle normalisé mural à micro fixe et toujours
à MAGNETO  (appel magnétique)
et batterie pour alimenter le microphone. Cet appareil est aussi appelé
"boite à sel" car sa forme rappelle cet boite qui équipe
chaque cuisine. A l'intérieure de la boite est logée la
pile pour le micro, toujours indispensable pour cette époque; plus
tard la batterie centrale remplacera cette pile.
(appel magnétique)
et batterie pour alimenter le microphone. Cet appareil est aussi appelé
"boite à sel" car sa forme rappelle cet boite qui équipe
chaque cuisine. A l'intérieure de la boite est logée la
pile pour le micro, toujours indispensable pour cette époque; plus
tard la batterie centrale remplacera cette pile.
En 1907, en juillet, par le décret
du 5 juin 1907 (BO P&T 1907 n°7 page 163), les Services Électriques
de la région de Paris sont divisés en trois Directions.
- Direction des Services Téléphoniques
de Paris (chargée du service technique téléphonique
de Paris Intra-muros en plus de l'Exploitation des bureaux téléphoniques
centraux).
- Direction des Services Télégraphiques
de Paris.
- Direction du Service Technique de la région
de Paris (Extra-muros). (chargée en Extra-muros du service technique
télégraphique et du service technique téléphonique).
Par le décret du 18 juin 1907, (JORF du 20
juin 1907, page 4281) :
- Monsieur André Mathurin FROUIN est nommé
Directeur des Services Télégraphiques de Paris,
- Monsieur Edmond Alexandre BOUCHARD est nommé
Directeur des Services Téléphoniques de Paris.
Ainsi, la branche Téléphone de Paris
retrouve en 1907 une partie de l'autonomie acquise en 1892 puis perdue
en 1896. Mais attention, en 1907 l'autonomie retrouvée n'est désormais
valable que pour Paris Intra-muros. (car la région de Paris Extra-muros
demeure encore liée au Télégraphe).
Monsieur Edmond Bouchard occupera le Poste de Directeur
des Services Téléphoniques de Paris jusques au 19 mai 1911
où il sera promu Directeur de l'Exploitation Téléphonique.
1er Nov 1907, les constructeurs d'appareils téléphoniques on l'obligation de monter les récepteurs (écouteurs) en dérivation au lieu d'être en série.
Sur Paris
Jusqu'en 1907, les installations sont réalisées dans Paris
en batterie locale, les postes étant munis d'une magnéto
que l'abonné doit actionner au début et à la fin
des communications. Une première transformation du réseau
de Paris consiste à mettre en oeuvre la batterie centrale pour
l'appel, ce qui supprime les magnétos. Jusqu'alors pour appeler
l'opératrice afin d'obtenir la communication demandée, les
abonnés envoyaient un courant sur la ligne, soit en tournant une
magnéto, soit en actionnant un bouton d'appel relié à
une batterie de piles qui se trouvait chez eux.
L'innovation qui vient des Etats-Unis consiste à
remplacer ces sources particulières de courant par une batterie
centrale c'est-à-dire un puissant groupe de piles dans chaque central.
Il suffit donc aux utilisateurs de décrocher leur combiné
pour établir le contact.
Les travaux de transformation commencés en 1907 se terminent en
1909. Les piles pour l'alimentation des microphones subsistent encore
chez les abonnés après la suppression des magnétos,
mais à partir de 1920 tous les postes du réseau de Paris
sont à "batterie centrale intégrale". Ces modifications
techniques facilitent la vie des abonnés en rendant le geste technique
plus simple. On constate pendant cette période un réel accroissement
du nombre d'abonnés à Paris. De 45 000 au 1er janvier 1910,
le nombre d'abonnés passe à 65 000 en juillet 1914. Cette
progression se ralentit pendant le premier conflit mondial à la
fin duquel on dénombre (31 décembre 1918) 76 000 abonnés
répartis en 16 circonscriptions au centre de chacune desquelles
est implanté un central manuel. La vétusté du réseau
est alors patente, alors que l'incendie du central Gutenberg (18 000 abonnés)
en septembre 1908 et les énormes dégâts provoqués
par les inondations de 1910 avaient déjà souligné
et aggravé sont état défectueux.
sommaire
En
1908, le lundi 28 décembre, est mis en service à
Lyon à titre d'essai, et provisoirement, un Centre Téléphonique
Automatique raccordé à 200 abonnés qui peuvent
alors s'appeler directement entre eux, sans passer par une seule opératrice.
Le système alors expérimenté est du type LORIMER,
c'st un autocommutateur de type rotatif à impulsions, conçu
en 1903 aux U.S.A par les trois frères Lorimer d'origine canadienne.(l'histoire
est intéresante)
Ce commutateur de capacité réduite et expérimental
est installé et testé aux frais de l'inventeur. (Il ne s'agit
donc pas d'une commande de l'Administration en temps que telle, bien qu'expérimentée
par elle...)
Cette expérimentation n'a concerné que 200 des 4.000 abonnés
au téléphone du réseau de Lyon, ces 200 abonnés
étant réputés pour téléphoner fréquemment
: abonnés à fort trafic. (Les 3.800 autres demeurant reliés
aux Commutateurs Multiples Manuels).
Nous ignorons la durée exacte de cette expérimentation qui
était encore en service en Janvier 1911, mais qui un jour se termina
sans explication, vraisemblablement avant la 1ère guerre mondiale.
La compagnie Canadian Machine Telephone fera
faillite en 1923 et le système LORIMER
disparaît à cette date.

| Il y a très peu de documents en Français,
généraliste sur les systèmes automatiques. Le livre référence est "La téléphonie automatique" par H.Milon de 1914 et 1926 que l'on trouve encore en brocante. Ce livre explique en détail tous les systèmes automatiques que nous allons trouver jusqu'en 1926 : Strowger, Lorimer, Rotary, Panel, Ericson, les centres semi auto, à relais ... Le Crossbar sera à l'étude en 1912, et ne sera pas utilisé en France avant les années 1950. Nous nous contenterons d'exposer les généralités des différents systèmes utilisés. |
1908 A PARIS Enfin le central manuel de la rue
de Sablons, est mis en service , il dessert Passy et Auteuil.
Cependant le nombre de quatre centraux seulement annoncé dans les
études de 1891 ne peut être tenu.
Après les modifications de circonscriptions intervenues en 1904
pour rentabiliser au maximum les diponibilités existantes, la ville
de Paris est en 1907-1908 divisée en sept circonscriptions correspondant
â sept centraux téléphoniques.
En 1909 il n'y avait que 44 600 abonnés â Paris.
En 1909, par le décret
du 4 août 1909 (JORF du 5 août 1909, page 8520), il est créé
une Direction de l'Exploitation Téléphonique.
Son premier Directeur est Édouard Estaunié.
Cette date marque la séparation durable d'avec
la Branche Télégraphique, d'où la branche Téléphone
avait été rattachée depuis son invention.
Les branches Téléphones et Télégraphes
ne seront à nouveau réunies qu'en 1941 sous le vocable Télécommunications,
mais entre temps, le téléphone ayant pris tant d'importance,
qu'il s'agira alors de la branche Téléphone qui absorbera
la branche Télégraphe, non l'inverse.
L’inventaire systématique des Annales
des Postes Télégraphes et Téléphones entre
1910 et 1938 — 59 articles et 40 auteurs — livre une chronique
des manières de mesurer les conversations téléphoniques,
et par là les éléments d’une sociogenèse
des normes de gestion de l’opérateur historique français
de télécommunications.
Les Annales des PTT, sous-titrées
Recueil de documents français et étrangers concernant les
Services Techniques et l’Exploitation des Postes, Télégraphes
et Téléphones, prennent la suite des Annales télégraphiques
composées de trois séries (1855-1856, 1858-1865, 1874-1899).
Leur parution à partir de septembre 1910 participe d’une nouvelle
effervescence autour de la question du téléphone.
Depuis le rapport Millerand de 1900, le jugement porté sur le service
téléphonique français, sans cesse plus sévère,
nourrit un intense débat public sur la « crise du téléphone
» : en 1905, une Association des abonnés au téléphone
est créée ; en 1909, une « Direction de l’exploitation
téléphonique » est inaugurée et un premier
recensement des lignes téléphoniques du pays entrepris ;
enfin, les propositions de réforme se multiplient à partir
de 1910.
A partir de 1909 l'administration
des PTT est secouée par les mouvements sociaux qui éclatent
.
L'histoire sociale des PTT est non seulement remarquable par le nombre
et l'activité dee ses assoiations internes de prévoyance
et d'aide, mais aussi par la détermination de ses mouvements de
contestation qui ont été souvent des "premières"
dans la fonction publique.
Rendant l'état responsable du service publique et à ce titre
du secteur assurant la transmissions des informations de la vie économique
et sociale du pays, il interdit les organisations syndicales au sein des
administrations et donc des PTT.
En effet au droit syndical est attaché le droit de grève
et alors, ni les gouvernements ni d'allieurs l'opinion publique ne sont
favorables à une éventuelle grève de fonctionnaires.
Pourtant une première grève des Postes éclate à
Paris le 18 mai 1899 pour demander une augmentation de salaire.
Elles est durement réprimée par le sous-secrétaire
d'Etat aux Postes et Télégraphes, Léon Mougeot. Plus
tard, dans un contexte de préparation de grève générale,
des facteurs parisiens se mettent en grève du 11 au 19 avril
1906, Louis Barthou, ministre des Travaux Publics, des Postes et des
Télégraphes sanctionne les leaders du mouvement.
Dans une situation agitée, en mars 1907, le gouvernement
de Geoarges Clémenceau propose une loi autorisant le droit d'association
pour les fonctionnaires, mais sans y adjoindre le droit syndical.
Jusqu'alors les premières grèves parisiennes ne semblent
avoir eu aucune répercussion dans le reste du pays.
Mai à partir de 1909, les mouvements sociaux vont s'étendre
à tout le territoire national.
En mars 1909 le sous-secrétaire d'Etat aux Postes et Télégraphes,
Jules Simyan, décrète un nouveau système d'avancement
qui restreint fortement les possibilités de promotion; or pour
certaines catégories de personnel, leurs seuls espoirs d'améliorer
leur situation restent l'avancement.
Cette mesure va déclencher la première grève généralisé
des PTT qui touche les télégraphistes, les agnts des bureaux
de poste, les ambulants, les dames employées du télégraphe
et du téléphone et les ouvriers des lignes. Cette grève
va s'étendre aux grandes villes du pays touchant l'exploitation
des communications téléphoniques, interrompant le service
entre Paris et la province, par endroit la gendarmerie a été
mobilisée pour garder les voies ferrées afin de prévenir
le sabotage éventuel des lignes. A Paris, les postiers qui avaient
été arrêtés à la suite des premiers
incidents à l'origine du mouvement sont libérés et
acclamés à leur sortie de prison. On vote la continuation
de la grève. Le personnel féminin se mobilise.
La situation restera très tendue au niveau national durant les
mois d'avril et mai.
En février 1914, de nouvelles manifestations se déclencheront
à Paris.
| Une grave
question : l'État doit-il monopoliser la construction des appareils
téléphoniques ? II y a, hélas! d'autres sujets se rattachant à l'exploitation téléphonique, sur lesquels il y a moins de félicitations à adresser à l'État. La question la plus brûlante aujourd'hui, et qui est tout à fait à l'ordre du jour, est certainement celle de la construction des appareils d'abonnés. Elle intéresse au plus haut point les Parisiens, qui l'ignorent en général ou n'en saisissent pas l'importance. Avant de l'exposer impartialement, examinons rapidement quelles sont les causes principales qui concourent au mauvais fonctionnement, dont se plaignent actuellement les abonnés du réseau de Paris. Ce sont : 1° le développement extrêmement rapide du réseau. Remarquons que ce développement se produit malgré le taux prohibitif de l'abonnement, et l'on en est arrivé à se demander si l'Administration ne maintiendrait pas ce taux avec intention, se sentant incapable de donner satisfaction aux nombreuses demandes éventuelles qui seraient formulées, si une diminution du prix de l'abonnement était consentie. 2° La conservation de la pile alimentant le microphone du poste de l'abonné. Comme nous l'avons vu, en effet, l'État a bien appliqué la batterie centrale au réseau de Paris, mais elle l'a fait avec timidité, reculant devant l'adoption de la batterie centrale « intégrale ». Il s'en suit que cette pile, s'épuisant lentement, est cause d'une transmission défectueuse. 3° L'insuffisance du poste d'abonné, transformé par le batterie centrale. Nous avons examiné plus haut les modifications, apportées au-montage du poste d'abonné, pour permettre son fonctionnement avec le nouveau système. Il faut avoir soin de remarquer, lorsque l'abonné se sert de son appareil, que ses récepteurs sont traversés par tout le courant de la batterie d'accumulateurs, placée au bureau. Dans les postes construits spécialement pour un réseau à batterie centrale, nous savons, au contraire, que les récepteurs sont intercalés dans le circuit primaire avec un condensateur, ce qui leur évite le passage continuel du courant, lorsque l'on fait usage de l'appareil. Ce courant permanent désaimante, en effet, ces organes qui s'affaiblissent bien inutilement. L'Administration, considérant au contraire que les dérangements fréquents des appareils d'abonnés étaient dus au mauvais état de ces appareils, a inscrit au chapitre 22 du budget de 1911 un crédit de 100.000 francs, pour « fourniture à titre onéreux de 2.500 appareils à batterie centrale pour les nouveaux abonnés du réseau de Paris. » Ce petit crédit, en apparence insignifiant, est une indication de la volonté de l'État de fournir lui-même les appareils à tous les abonnés dans un avenir prochain et de créer ainsi un nouveau monopole. Inutile de dire que tous les constructeurs de téléphones, différents groupements d'électriciens, la Chambre de Commerce elle-même s'émurent à cette nouvelle et s'inquiétèrent de voir adopter une décision, qui menaçait de détruire une industrie en plein progrès. Une campagne ardente s'ouvrit alors ; elle est loin d'être terminée. On sait qu'à Paris l'abonné doit fournir son appareil; il a le choix, pour cela, parmi ceux que l'Administration après examen a reconnus comme étant d'un fonctionnement satisfaisant. L'abonné peut donc donner satisfaction à ses idées de goût et d'esthétique ; aussi bien la qualité de l'appareil lui est-elle garantie par le contrôle de l'État. Nous avons vu qu'avec ce système de grands progrès ont été accomplis dans le construction des appareils téléphoniques, surtout en ce qui concerne les microphones. Nous estimons qu'il conviendrait de laisser la porte ouverte à tous perfectionnements. Qu'adviendra-t-il, en effet, si l'État adopte un type unique d'appareils sur tout son réseau ? Ou ce sera l'arrêt du progrès, ou une dépense énorme à chaque perfectionnement nouveau à appliquer. Quant au prix de l'appareil, que l'Administration déclare pouvoir vendre bien meilleur marché que les constructeurs, il faut se rendre compte que les prix actuels s'appliquent à des postes marchant avec piles microphoniques chez l'abonné ; or, ces postes sont beaucoup plus compliqués que les postes nouveaux à créer, qui devraient fonctionner en batterie centrale intégrale. Nous croyons donc, qu'avant d'adopter le principe du monopole, il y aurait lieu de voir si la fourniture des appareils par l'Administration est d'un intérêt général et si elle ne va pas, au contraire, apporter le trouble dans les industries électriques et supprimer l'émulation des fabricants pour la recherche des perfectionnements. De plus, à l'heure où, dans l'industrie, la main-d'œuvre est réduite, grâce à l'emploi de machines perfectionnées, la question se pose de savoir s'il y a lieu, plutôt que de conserver les appareils existants, de supprimer les demoiselles et de matérialiser le rêve de nombreux Parisiens : le téléphone sans téléphonistes. |
Petit rappel : Depuis 1878, la magnéto
était utilisée d'abord massivement aux Usa, permet de remplacer
la petite batterie locale (de courant continue) chez le client réservé
à cet usage.
L'abonné tourne la manivelle qui produit un courant alternatif
sur la ligne téléphonique, il est reçu au centre
manuel sur le tableau de l'opératrice qui voit le petit volet s'ouvrir
et lui signale qu'un client l'appelle.
C'est un grand changement, qui simplifie le dispositif et l'entretien
des téléphones, les techniciens devaient remplacer régulièrement
la batterie locale chez le client. Toutefois il subsistait encore une
batterie pour alimenter le microphone (la fameuse boite à sel du
modèle 1910) pour la plupart des centraux manuels principalement
dans les zones rurales.
En France les téléphones sur le réseau
de l'Etat appelés modèle de téléphone 1910
(Appelé aussi PTT 1910 ou Marty) à magnéto
sont installés sur tous les centraux encore manuels. Il n'y a plus
de bouton + pile pour faire l'appel, la magnéto sert d'avertisseur
pour l'opératrice ou un volet magnétique indique la position
de l'abonné. Il n'y a pas encre de système à lampe
(d'appel et de conversation) sur la majorité des centres manuels.
 PTT 1910 BL avec batterie Locale
,
PTT 1910 BL avec batterie Locale
,  pour
alimenter le microphone sur la plupart des anciens centres manuels.
pour
alimenter le microphone sur la plupart des anciens centres manuels.
| Passé 1900, arrivèrent
les nouveaux centraux manuels avec batterie centrale intégral,
libérant ainsi l'installation chez l'abonné de toute
source électrique, ce qui simplifiera les installations et
réduira considérablement les coûts de maintenance
(moins de déplacements, d'interventions) Avec la batterie centrale intégral : Comment peut-on alimenter simultanément plusieurs téléphones par la même batterie sans que pour autant les courants de conversation se mélangent ? Tout simplement en insérant entre chaque ligne et la batterie centrale , une self qui bloque les courants de conversation et empêche que ceux-ci se referment au travers de la batterie. Cette self sera installée au central manuel car, on va utiliser cette self comme électro-aimant, pour avertir l’opératrice lorsque qu’un courant circule dans la ligne, c’est à dire lorsque l’abonné à décroché son combiné. La self se combine donc avec l’annonciateur. |
 |
A cette époque, on commence
très timidement à installer de grands ensembles de batteries
et groupes électrogènes dans certains centraux téléphoniques
manuel.
Ces batteries alimentaient les lignes téléphoniques, pour
le courant nécessaire au microphone et la conversation et le courant
de sonnerie, la magnéto locale du téléphone de l'abonné
n'était plus nécessaire .
C'est le système à Batterie centrale intégral.

SCHÉMA DE MONTAGE D'UN ANCIEN POSTE D'ABONNÉ. TRANSFORME
POUR LA BATTERIE CENTRALE.
— L, ligne. — L1, L2,. bornes de ligne. — S1, S2, bornes
de sonnerie. — C, condensateur. —- S, sonnerie magnétique.
— Cr. crochet-commutateur fermant le circuit de ligne par le contact
c et le circuit primaire par les contacts a et b. — R, récepteurs.
— I, bobine d'induction. — T, transmetteur. — ZM, CM. bornes
de la pile microphonique PM.
Cependant, ce concept mettra longtemeps avant de se généraliser.
En 1912 on pouvait lire dans le " Bulletin mensuel / Association
des abonnés au téléphone " :
| La question des appareils téléphoniques
aux postes des abonnés a été soulevée
depuis bien longtemps; elle est des plus importantes; elle intéresse
à la fois le public, l'Administration et les constructeurs
; de sa solution dépend en grande partie la bonne marche des
téléphones. Il importe que.ces appareils soient autant que possible d'un type uniforme au moins pour les parties essentielles, qu'ils soient également de très bonne qualité, sinon les communications seront défectueuses, non seulement au préjudice du propriétaire de l'appareil imparfait, mais au préjudice encore de tous ses correspondants; de telle sorte qu'il suffit qu'une partie seulement des appareils fonctionne mal pour que le service tout entier laisse à désirer. II faut en outre que ces appareils puissent être économiquement entretenus et facilement réparés, sous peine dégrever l'exploitation de très gros frais. Enfin il est nécessaire que soit déterminé par qui ces appareils devront être fabriqués et suivant quel type, par qui ils doivent être fournis aux abonnés et à quelles conditions. D'abord l'Anarchie Une Batterie Centrale décentralisée Un Retard de plusieurs années L'Association réclame un Concours Comment se fera l'Échange des Appareils MARQUIS DE MONTEBELO. |
 PTT 1910 pour
batterie centrale ,
PTT 1910 pour
batterie centrale ,  Jacqueson.
Jacqueson.
 Thomson, sur certains centres
manuels.
Thomson, sur certains centres
manuels.
Cependant il subsistait encore chez le client une batterie nécessaire
pour alimenter le microphone dans le cas ou le centre manuel ne pouvait
fournir l'alimentation du courant microphonique, les téléphones
BL à batterie locale (bornes Zm et Cm sur le schéma).
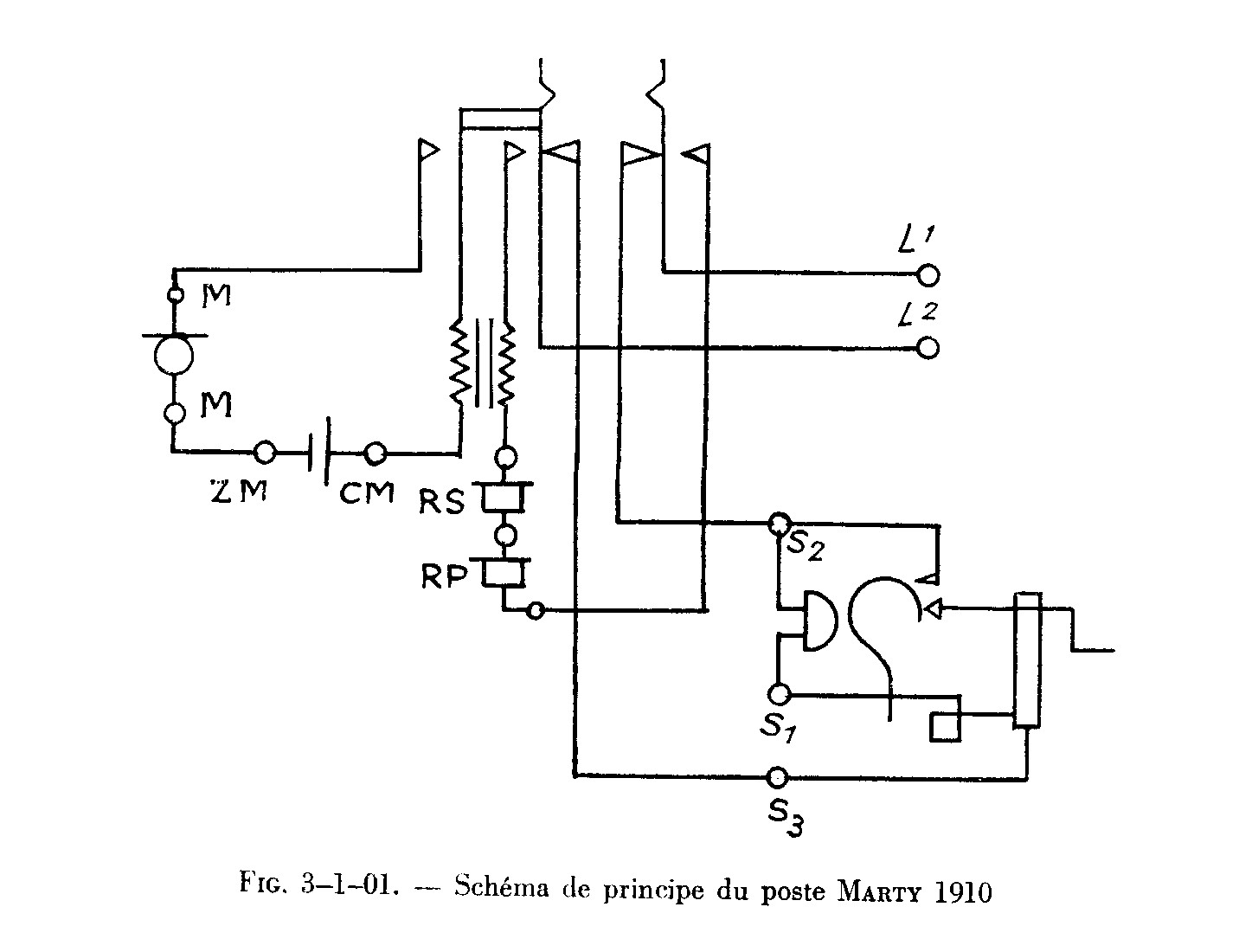 Schéma
du 1910
Schéma
du 1910  Grammont
Grammont Sit
Sit
Plus tard en 1912 l'administration prescrit la modification
des appareils Pasquet en court-circuitant le circuit secondaire à
double rupture
Obligation pour les constructeurs de relier les fils de liaisons à
l'intérieur de l'appareil et suppression des bornes extérieures.
Après 1918 Pour les anciens systèmes encore
en batterie locale, avec l'arrivée des centraux
automatiques, le poste de l'abonné n'aura plus besoin de magnéto
et de pile, c'est simplement en décrochant le combiné du
poste que le central entrera en action pour lui passer une opératrice
dans le cas du semi automatique (cas du Rotary)
ou il numérotera lui même avec un cadran rotatif sur
le poste, composer le numéro de son choix.
En France le mot cadran n’est apparu qu’après 1925. Auparavant,
on utilise les locutions disque transmetteur ou disque automatique ou
encore, combinateur
Adaptation de la numérotation de
Paris évolution ...
sommaire
1909-1910 est une période
d'intense débat public sur la crise du téléphone
et sur son financement.
En particulier en 1910 le sénateur Steeg dépose une
proposition de loi sur la réorganisation financière et administrative
du ministère des P. T. T. La même année le rapporteur
du budget des P. T. T., Charles Dumont, préconise la séparation
du budget général, la tenue de comptes d'exploitation sur
le modèle industriel, la préparation de plans d'équipement.
Tout ceci en matière de téléphone s'appuie sur les
études menées sur le réseau de Paris depuis 1907-1908.
Le programme â réaliser est le suivant
: installer un central autonome pour l'interurbain, reconstruire Gutemberg
qui a brûlé en 1908, installer dans la circonscription de
Gutenberg 4 autres multiples neufs d'une capacité de 10 000 abonnés,
dédoubler 3 circonscriptions , en créer deux autres . .
.
Cela revient , en plus de la construction de 1'Inter et de la reconstruction
de Gutenberg, à créer 9 bureaux nouveaux d'un coup.
Le projet sera déposé en 1914, mais période n'a guère
été propice.
C'est seulement au moment de l'introduction de l'automatique que cela
se révélera possible.
1910 Statistique téléphonique mondiale,
(Elecirical Revieiv).
Au 1er janvier 1910, il existait sur toute la terre un nombre total
d'environ 10.269.000 appareils téléphoniques, avec
une longueur de conducteurs s'élevant à 38.678.000 km
en chiffres ronds ; à la même date, le capital placé
dans les installations téléphoniques se chiffrait par environ
6 milliards de mark, soit 584 mark pour chaque poste téléphonique.
Les chiffres se répartissent comme il suit entre les diverses parties
du monde :

Le tableau ci-après nous renseigne sur l'état du service
téléphonique dans les principaux pays :
 |
Parmi les pays faisant largement usage
du téléphone figurent au premier rang les Etats-Unis
avec environ 70 % de tous les postes téléphoniques existants
et quelque chose comme 65% de la longueur totale de fils. Ensuite vient l'Allemagne qui, de tous les pays d'Europe, est celui possédant le plus grand réseau téléphonique, avec environ 950.000 postes d'abonnés et près de 5,2 millions de km de conducteurs. En troisième lieu nous rencontrons l'Angleterre avec 616.000 appareils et 3 millions de km de conducteurs. En Europe, le trafic interurbain est très développé ; les grandes localités y sont reliées entre elles, le plus souvent, par une ou plusieurs lignes, généralement fort occupées. C'est ainsi que la longueur des lignes interurbaines s'élève en Allemagne à 1.093.000 km, ce qui représente 21,5 % du développement total des conducteurs téléphoniques. Si les données statistiques ci-dessus sont mises en regard de la population des Etats intéressés, on trouve que le tableau prend un autre aspect et la situation se révèle comme plus favorable au profit des petits pays dont la population se compose surtout d'industriels et de commerçants. Le premier rang, encore ici, revient aux Etats-Unis, où l'on rencontre 7,6 postes d'abonnés par 100 habitants. |
Canada 3,7 postes d'abonnés par 100 habitants.
Danemark 3,3
Suède 3,1
Nouvelle Zélande 2,6
Norvége 2,3
Suisse 2,0
Nlle Galles du Sud 1,6
Allemagne 1,5
Angleterre 1.3
On ne rencontre que 0,6 poste d'abonné par 100 habitants en Belgique, 0,5 en France, 0,3 en Autriche, 0,2 en Hongrie et en Italie, 0,1 en Russie et en Espagne.
Pour l'ensemble de l'Europe, sur 1000 habitants, on en trouve seulement 5,4 qui possèdent un appareil téléphonique.
Si l'on envisage les différentes villes prises séparément, on contate que c'est celle de Los Angeles (Californie) qui possède le réseau téléphonique le plus dense existant au monde.
Pour 240.000 habitants, on y trouve 51.000 postes d'abonnés, soit 25,4 postes d'abonné par 100 habitants.
La deuxième place est occupée par Stockholm, avec 58.000 postes d'abonné et 340.000 habitants, soit 17,1 postes d'abonné par 100 habitants.
Relativement au degré de développement de la téléphonie dans les plus grandes villes d'Europe, les chiffres du tableau ci-après ne laissent pas d'offrir un certain intérêt.
Par 100 habitants, on comptait :

L'ensemble du trafic téléphonique, pour
l'année 1909, est évalué à 19.178.500.000
conversations, dont 13.299.900.000 réalisées aux EtatsUnis.
Quant à l'effectif du personnel affecté au service téléphonique
du monde entier, il semble s'élever à 260.000 unités.
1911 Le nouveau standard manuel pour
l'état à vingt-cinq directions, fabriqué par
la Compagnie des téléphones Thomson-Houston
, permet de mettre en communication les abonnés les uns avec les
autres grâce à un bureau central. Il est le premier modèle
de la série de ce type de matériel, normalement utilisé
dans les bureaux centraux.
25 directions  Autres
Standards 1920
Autres
Standards 1920 

En 1911, il est décidé d'équiper le plus
rapidement possible les villes de Nice et d'Orléans
en système automatique STROWGER
à titre expérimental par le nouveau sous-secrétaire
d'État aux P & T Charles Chaumet. L'automatisation est sur
le point de murir.
En vue de la création d'un nouveau bureau central téléphonique destiné à desservir une partie de la circonscription de Desrenaudes et les abonnés du quartier de Montmartre, l'Administration a loué avec promesse de vente, 266, rue Marcadet, un bâtiment que l'on construit actuellement, d'après des plans approuvés par elle.
Le bureau Marcadet desservira une nouvelle circonscription formée de la partie de la circonscription du bureau de Desrenaudes limitée par les voies suivantes : Chemin de fer de l'Ouest-Etat, fortifications, boulevard O'rnano, rue du Mont Cenis, rue des Martyrs, boulevards de Clichy et des Batignolles. Le bâtiment en question recevra, au début, un tableau multiple équipé pour 2.200 lignes d'abonnés et 200 lignes suburbaines, mais il se prêtera facilement, par la suite, à une installation susceptible de desservir 9000 abonnés. Il suffira, en effet, le moment venu, de construire un 2e étage, sans avoir à toucher au ler ; la résistance du plancher haut a été prévue en conséquence.
Ce multiple fonctionnera, bien entendu, à batterie centrale. Son agencement différera peu de celui des multiples des autres bureaux de Paris. Toutefois, il y a lieu de signaler les particularités suivantes :
a) Répétition du signal d'appel. — Chaque relais d'appel commandera deux signaux lumineux placés au-dessus de deux jacks locaux reliés à la même ligne d'abonné, mais situés dans des groupes différents, séparés par au moins deux positions d'opératrice.
Cette disposition permettra d'assurer l'entraide dans des conditions très satisfaisantes : 6 téléphonistes, au lieu de 3 avec le système actuel, pourront répondre aux appels d'un même abonné, ce qui aura pour conséquence, non seulement, d'abréger le délai d'attente de cette réponse, mais encore de répartir entre 5 opératrices, au lieu de 2, le surcroît de travail résultant de l'absence momentanée d'une téléphoniste.
De plus si une lampe d'appel vient à brûler, les appels de l'abonné seront encore reçus par l'autre,
b) Appel sans clé. — L'appel des abonnés, sur les groupes B, se fera automatiquement, par le simple enfoncement de la fiche dans le jack correspondant. Cette nouvelle disposition facilitera le travail des opératrices B dont le rendement sera ainsi accru.
c) Les groupes A ne comporteront pas, au début, de jacks généraux, mais ils seront disposés pour en recevoir ultérieurement, si l'utilité en était reconnue.
d) Les lignes auxiliaires interurbaines seront agencées en vue de leur liaison avec les tables d'annotatrices du nouveau bureau interurbain, à installer rue des Archives (de 1000 circuits et qui sera mis en service le 2 février 1913).
Elles comporteront, dès lors, des signaux lumineux d'occupation, répétés au-dessus des jacks multiplés correspondant à chacune d'elles.
e) Les groupes B et intermédiaires recevront les circuits suburbains de départ desservant les localités situées au Nord de Paris. Les jacks correspondants, multiples de 5 en 5 panneaux, seront pourvus de signaux d'occupation.
f) L'emplacement sera prévu pour l'installation d'un système de compteurs de conversations, du type semi-automatique, ou, de préférence, du type complètement automatique.
sommaire
|
1911 Alors qu'il n'y a pas encore de centre automatique en France, dèjà avec l'expérience d'autres pays, les questions, les reflexions vont bon train : Comparaison, au point de vue économique, des systèmes téléphoniques manuels et automatiques. Schvackstrom-technik, août 1911Tout abonné au téléphone qui échange par jour dix conversations de trois minutes chacune laisse son appareil, sa ligne et son jack local au bureau inoccupés pendant 1.410 minutes sur 1.440. Le rendement de son poste est donc très réduit, puisqu'il est représenté par la fraction 30/1440, rapport du temps utilisé au temps disponible. Un terme de ce rapport peut seul varier entre des limites très restreintes : il est possible, en effet, de donner à plusieurs abonnés la même ligne avec la même extrémité au bureau. Avec 4 abonnés, le rapport ci-dessus devient 120/1440 On voit donc le rôle du coût des installations (appareil, ligne et raccordement au bureau) dans le choix des systèmes de téléphonie et aussi dans les progrès de la technique. Avec les récents systèmes à batterie centrale, les abonnés ont des appareils très simples. Le prix de revient des lignes diminue sans cesse depuis la baisse prolongée du cuivre et l'emploi de fils à faible section. Malgré de multiples perfectionnements et une exploitation de plus en plus complexe, les installations des bureaux sont bien moins dispendieuses qu'auparavant. Le système automatique actuel, comparé aux systèmes ordinaires et surtout au système à batterie centrale, nécessite la même dépense pour les lignes et une dépense triple ou quadruple pour les installations et les appareils. Les causes qui tendent en général à diminuer le rendement des divers systèmes en' exploitation, influent d'une façon plus particulière sur les systèmes automatiques. Dans les bureaux à service manuel en effet, les dépenses courantes d'exploitation peuvent en une certaine mesure suivre les variations du trafic, tandis que les dépenses, dans les bureaux à service automatique atteignent un maximum fixe, invariable avec les fluctuations du trafic. Cette facilité d'accommodation déjà notable avec l'exploitation à batterie centrale est encore accrue avec les systèmes à distribution d'appels, où l'on peut satisfaire au trafic avec un tiers en moins d'employés. |
À partir de 1912,
un nouveau principe de commutateurs automatiques à
barres croisées est mis en
conception par les ingénieurs postaux suédois Gotthilf
Ansgarius Betulander et Nils Gunnar Palmgren,
soucieux de concevoir un nouveau système pourvu de meilleures capacités
d'écoulement que les systèmes rotatifs et pourvus de contacts
plus résistants à l'usure.
Le brevet est déposé le 17 avril
1914 aux USA et est validé le 24 juillet 1917 : le principe
du commutateur téléphonique pourvu de sélecteurs
à barres croisées est alors inventé
Plus tard après murissement et innovations, il s'appellera le système
CROSSBAR et remplacera progressivement
les systèmes rotatifs.
Betulander conçoit aussi sur un système uniquement
réalisé avec des relais, nous le verrons en 1927
à Fontainebleau ou il sera expérimenté.
En 1912, la numérotation
passe à quatre chiffres. Maigre consolation,
les abonnés parisiens voient le numéro du central remplacé
par le nom du central.
Ainsi, le 25e abonné du 12e standard du central Gutemberg se voit
attribuer le numéro Gutemberg 12 25 au lieu du 12225.
On parle alors de numéros alphanumériques (lettres + chiffres).
Dans les communes moins peuplées, l'abonné possède
selon le même principe un numéro de 1 à 4 chiffres
; le 22 à Asnières est le 22e abonné de l'unique
standard du central d'Asnières. Le 40.15 à Marseille est
le 15e abonné du 40e standard du central de Marseille.
C'est en 1912 que M. Chaumet, sous-secrétaire d'Etat
aux Postes et Télégraphes, a décidé
l'établissement de commutateurs semi-automatiques en Rotary
dans les bureaux d'Angers et de Marseille et de commutateurs
automatiques Strowger à Nice
et à Orléans.
Les travaux d'aménagement de ces bureaux
étaient tous entrepris en juillet 1914 quand la guerre éclata.
Malgré la raréfaction de la main-d'œuvre l'équipement
du bureau d'Angers a été achevé et le bureau semi-automatique
mis en service en novembre 1915.
Une petite révolution
en octobre 1912 :
une directive de l’administration des PTT – administration publique
qui perdurera pendant plus d’un siècle – impose alors
l’utilisation du numéro de l’abonné, et les «demoiselles
du téléphone» doivent désormais accueillir
l’abonné par la formule: «Numéro s’il
vous plaît ?»
Soit l’appelant connaît le numéro de l’abonné
qu’il veut contacter et il est branché immédiatement,
soit il l’ignore. En ce cas, si la standardiste connaît le
numéro de tous les abonnés de son secteur, cas fréquent
à l’époque, elle ouvre la communication ou si elle
ne le connaît pas, elle transfère alors l’appel sur
la table des renseignements téléphoniques; ou sur celle
de la surveillante en cas de protestation.
Les abonnés desservis par une opératrice bénéficiaient
de services spéciaux comme le service des abonnés absents,
les télégrammes téléphonés, le service
de l’heure, le dépôt de messages téléphonés,
la demande de communication avec préavis d’appel (c’est
alors le destinataire qui paie le prix de la communication).
Ce changement Manuel - Automatique ne se ferra pas sans commentaires, sans prise de position pour ou contre .... sans polémiques.
En exemple en 1912 Ce sont les Galeries Lafayette qui se modernisent :
En
1913 Ouverture du PREMIER BUREAU TÉLÉPHONIQUE AUTOMATIQUE
DE NICE.
Avec 20 ans de retard sur les Etats-Unis, l’automatisation
des centraux français est engagée en 1913 à Nice
Les Commutateurs Strowger à contrôle direct sont initialement
prévus en commutation urbaine (locale) pour une numérotation
maximale à 5 chiffres.
(rappel : contrôle direct = c'est le cadran du téléphone
qui établie la progression des commutateurs pour sélectionner
la sortie cible, autre abonné)
Le 8 juillet 1912 à Nice, la commande du premier autocommutateur
Strowger a est passée, et été
mis en service le 19 octobre 1913 à Nice,
(reportage science et
vie de 1917 le entre de Nice)
| L'ancienne installation comprenait un multiple manuel
d'un type très ancien, avec jacks généraux à
rupture, et 4 tableaux commutateurs à 100 directions installés
pour satisfaire aux besoins de l'extension. Les installations nouvelles du système l'Automatic Electric Cy se répartissent entre un bureau central, rue Biscarra, et deux bureaux satellites, appelés Magnan et Tabacs, du nom des quartiers qu'ils desservent. Le Bureau Central, situé au 4e étage d'une maison particulière, est équipé pour recevoir 2.400 lignes d'abonnés. Il renferme : 2.400 présélecteurs primaires et 360 secondaires ; 150 premiers sélecteurs ; 200 seconds sélecteurs ; 250 connecteurs (dont 20 rotatifs sur la centaine 4.000 à 4.099 réservée aux abonnés de plusieurs lignes) ; plus 30 premiers sélecteurs pour les communications provenant des satellites. Le satellite Magnan renferme : 200 présélecteurs primaires ; 20 connecteurs. Le satellite Tabacs renferme : 100 présélecteurs primaires ; 10 connecteurs. Le Bureau Central renferme en outre, outre les accessoires obligatoires : répartiteur général, installation d'énergie, salle d'essai, etc., un meuble destiné à l'échange des communications interurbaines, et se composant de : 8 positions d'opératrices pourvues du multiplage des lignes d'abonnés aboutissant au bureau central ; 3 positions d'annotatrices. Les deux dernières positions d'opératrice interurbaine, servaient également de salles de renseignements, et étaient munies de paires de cordons permettant au besoin de donner des communications entre deux abonnés au moyen des jacks généraux du multiple. La transformation des postes d'abonnés avait consisté en la suppression du circuit de sonnerie et en la mise en dérivation sur l'ancien poste du nouveau avec son cadran d'appel et sa sonnerie magnétique, le bureau ayant été préalablement muni du courant d'appel alternatif. Pour les postes à tableaux, on avait adjoint à l'ancien tableau un petit tableau annexe sur lequel ont été reportées la ou les lignes au réseau, et qui-comporte un cadran d'appel, et pour chaque ligne au réseau, un annonciateur d'appel, un voyant d'occupation, une clef d'écoute et de rupture de garde, et une clef de connexion avec chaque poste supplémentaire. La garde du réseau est automatique, et un ronfleur avertit de la fin de communication ou de l'oubli de la manœuvre de rupture de garde, quand la communication avec le poste supplémentaire n'a pas eu lieu. Les relations entre le poste principal et les postes supplémentaires et entre postes supplémentaires ont lieu comme auparavant par l'ancien tableau. Les lignes d'abonnés avaient été reliées directement au nouveau répartiteur, des dérivations provisoires ayant été établies des câbles d'ascension à l'ancien. Certaines dispositions spéciales avaient été prises pour le transfert, de concert avec le constructeur. Le nombre des premiers sélecteurs avait été porté provisoirement de 150 à 180. Tous les numéros non utilisés et tous les niveaux des sélecteurs non occupés avaient été reliés au moyen d'un certain nombre de lignes communes, aux tables de renseignements ou d'annotatrices de façon qu'un abonné même faisant une fausse manœuvre ne tombe jamais dans le vide. Enfin, un tiers-section du meuble interurbain avait été aménagé pour recevoir les abonnés qui, pour une raison ou uneautre, n'auraient pu se servir de leur installation automatique, tout en continuant à pouvoir être desservis selon les procédés de la téléphonie manuelle. Le transfert eut lieu le 19 entre 4 et 7 heures du matin ; il s'effectua simplement en enlevant les fusibles à l'ancien répartiteur et en mettant les bobines thermiques au nouveau. Une certaine confusion régna les deux premiers jours, due en grande partie au fait que les abonnés manœuvraient mal leur disque, laissaient décroché leur récepteur, continuaient à demander les abonnés par l'ancien numéro, etc., mais grâce aux dispositions prises, surtout au fait que tous les appels mal faits aboutissaient à des téléphonistes qui pouvaient donner aux abonnés les indications utiles, et à l'activité déployée par tout le personnel, aussi bien de l'administration que du constructeur, la situation s'améliora rapidement. Dès le 3e jour, les abonnés qui manœuvraient correctement n'avaient plus à souffrir des perturbations causées par les autres, et dès la fin de la semaine le nombre des fausses manœuvres et perturbations diverses était assez réduit pour que le bureau put prendre une allure presque normale ; la plupart des abonnés se déclaraient déjà très satisfaits du nouveau système. Les abonnés reliés aux satellites avaient relativement moins souffert encore que les autres du transfert, par suite de leur petit nombre et de la large extension prévue, ce qui mettait à leur disposition un nombre proportionnellement plus considérable de lignes auxiliaires et d'organes sélecteurs. Il faut noter d'ailleurs une circonstance certainement très favorable, à la réussite de l'opération : l'installation avait été calculée sur le trafic fort de la saison d'hiver, certainement supérieur de 50 % au moins au trafic normal à l'époque du transfert. Une opération, réalisée dans de telles conditions, c'est-à-dire le transfert en une seule fois de 2.000 abonnés d'un système manuel à batterie locale à un système automatique, aurait certainement été désastreux quelle que fut l'excellence des mesures prises par ailleurs, si l'installation automatique avait été calculée juste pour le trafic normal actuel. Enfin, la réfection complète du réseau des lignes, qui avait été faite avec beaucoup de soins, a eu pour résultat de réduire à une proportion infime le nombre des organes sélecteurs ou présélecteurs immobilisés par suite de défauts en ligne |
Le centre de Nice Strowger, sera remplacé par un commutateur R6 le 21 avril 1932
En France, les commutateurs dStrowger ne sont retenus
uniquement que pour l'automatisation de la province.
12 commutateurs de ce type seront mis en service
Avec le système automatique, l'abonné est
muni d'un Cadran comme celui ci 
En 1924, on peut lire dans la Revue des Téléphones,
Télégraphes et TSF: « Il n’y a pas un disque
; il y en avait récemment autant que de systèmes, différent
entre eux par des détails de construction, chaque manufacturier
étant encore jaloux de ses propres idées, de sa propre conception.
On a cherché surtout à faire un disque solide, d’un
fonctionnement régulier et sûr ; en même temps, on
a introduit peu à peu des modifications, dictées par la
technique de l’atelier, susceptibles de rendre la fabrication plus
rapide, les réparations et changements de pièces plus aisés.»
Autant dire que vouloir faire l’inventaire des différents
mécanismes de cadrans relève de l’utopie. (Un
document sur les cadrans inhabituels)
sommaire
| Nouvelle application du phonographe au téléphone.
— On ne manquait pas d'idées en cette année 1913. La démonstration d'une nouvelle application du phonographe au téléphone a été faite récemment à St-Pétersbourg. L'appareil peut être relié à un poste téléphonique quelconque et il est destiné à répondre aux appels durant l'absence de l'abonné. Le fonctionnement est le suivant : l'abonné, avant de s'absenter, remonte l'appareil, agit sur un levier, puis énonce dans le pavillon les indications à donner aux correspondants éventuels, par exemple: « Allô! M. Smith est absent de la ville ; il sera de retour demain matin, appelez le n° 5.735. Au revoir ». L'abonné peut alors abandonner à lui-même l'appareil qui, au dire de l'inventeur, peut répéter la phrase précédente jusqu'à 300 fois. Dès qu'un appel parvient au bureau central et que la sonnerie de l'abonné fonctionne, le phonographe est actionné automatiquement, et l'abonné appelant obtient l'information désirée sur l'endroit où il peut appeler son correspondant. Dès que le dernier mot est énoncé, l'appareil donne le signal de déconnexion au bureau central et revient au point de départ, prêt à répondre à un autre appel .Le nouveau dispositif a des qualités transmissives assez bonnes et supprime les signaux énervants de « non réponse ».. |
1914 1918
le 27 janvier 1914 , McBerty obtient
un premier brevet US1085454 pour
un séleteur rotatif
En 1912, McBerty Amériain, a été transféré
en Belgique par la Wester Eletric pour soutenir le développement
et mettre en place les processus de fabrication de la stratégie
Bell System.
En Europe cette stratégie aboutira par le développement
des systèmes rotatif Rotary pour
les centres urbains, à base de nouveaux sélecteurs :
brevet US1085454A ,
il y aura aussi le brevet US1105811
...
,
il y aura aussi le brevet US1105811
... 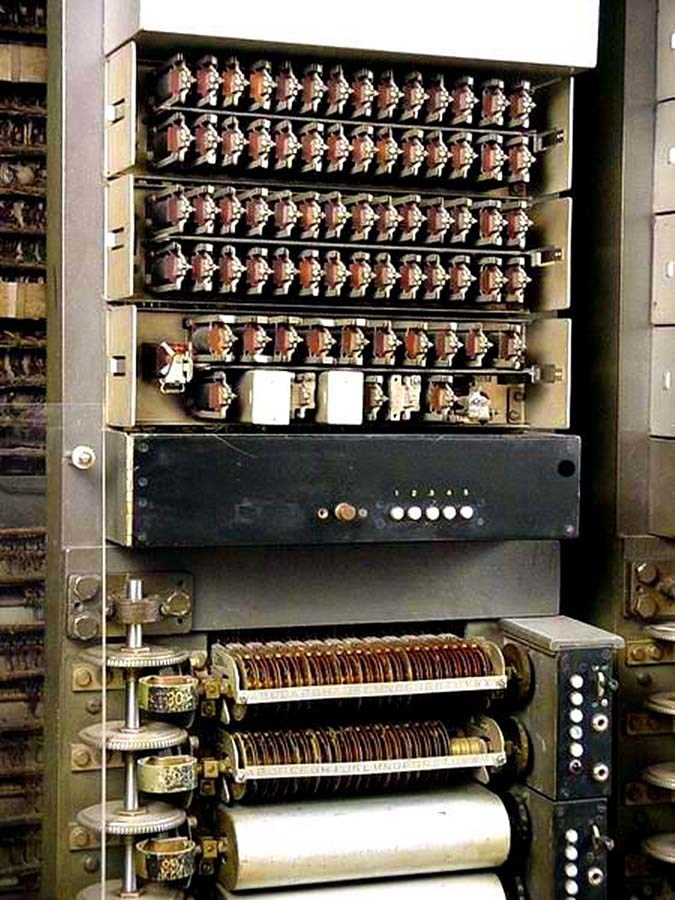 Rotary 7A1
Rotary 7A1
Aux Usa, l'équipe de Western Electric,
développe un autre système, le "Panel"
pour équiper leurs centres urbains et inter urbains.
Par le jeu des alliances, la France entre en guerre
au début du mois d’août 1914 contre l’Allemagne,
aux côtés du Royaume-Uni et de la Russie.
La Première Guerre mondiale, qui fait 1 400 000 victimes françaises
et entraîne de nombreuses destructions dans le nord-est du pays,
se conclut le 11 novembre 1918 en faveur de la Triple-Entente.
Outre le retour de l’Alsace-Lorraine à la France, les
conditions de la paix que Paris souhaite imposer à Berlin lors
du traité de Versailles sont particulièrement dures : la
France compte en effet faire payer les dommages de la guerre à
celle qu’elle accuse d’en être la seule responsable.
 Carte Alsace Lorraine (Voir page
Allemagne)
Carte Alsace Lorraine (Voir page
Allemagne)
La première guerre mondiale
déclenchée en 1914 va stopper le développement
et le déploiement du téléphone en France et en Europe.
Malgrè cela l'administration des P&T poursuit tant bien que
mal sa stragié, ainsi :
En Février 1914, il est décidé d'installer
un Rotary 7A semi-automatique
à Roubaix (2.800 lignes à la mise en service projetée)
et un autre à Tourcoing (1.200 lignes à la mise en service
projetée). Mais ce projet sera reporté avec l'arrivée
de la guerre.
Le système téléphonique semi-automatique
ne diffère pas du système à batterie centrale en
ce qui concerne les postes d'abonnés et l'intervention des opératrices
pour établir une communication.
Le téléphone semi-automatique peut donc être substitué
à notre système actuel de batterie centrale sans apporter
aucun trouble dans les habitudes des abonnés : ce n'est qu'une
question de montage de bureau central.
Dans un bureau central semi-automatique, lorsque l'opératrice
a enregistré le numéro de l'abonné demandé
sur un clavier analogue à celui d'une machine à écrire,
la mise en relation de cet abonné avec l'abonné demandeur
se poursuit automatiquement par des commutateurs tournants.
Donc, plus de fiches, plus de jacks généraux ou particuliers
; le meuble téléphonique est réduit aux proportions
d'une simple table d'aspect très dégagé.
Enfin le système téléphonique semi-automatique se
prête aisément à la transformation en système
entièrement automatique.
Dans ce cas, les postes d'abonnés doivent être remplacés
par des postes spéciaux, mais le montage du bureau central ne doit
subir que des modifications insignifiantes : quelques fils de connexions
à supprimer et le système complètement automatique
est réalisé.
On peut même avoir concurremment dans un même bureau des abonnés
semi-automatiques et des abonnés convertis en automatique pur.
À la différence d'un central manuel, où une opératrice
est affectée à un bloc d'abonnés fixe, dans le cas
du semi-automatique, l'appel est aiguillé vers la première
opératrice disponible. Ce qui répartit plus équitablement
la charge des appels à traiter.
Ensuite, l'opératrice d'arrivée, dite Semi-B,
n'a plus qu'à taper sur le clavier numérique à
touches le numéro d'appel téléphonique urbain
demandé par l'abonné du central manuel, et ensuite le commutateur
s'occupe automatiquement du reste.
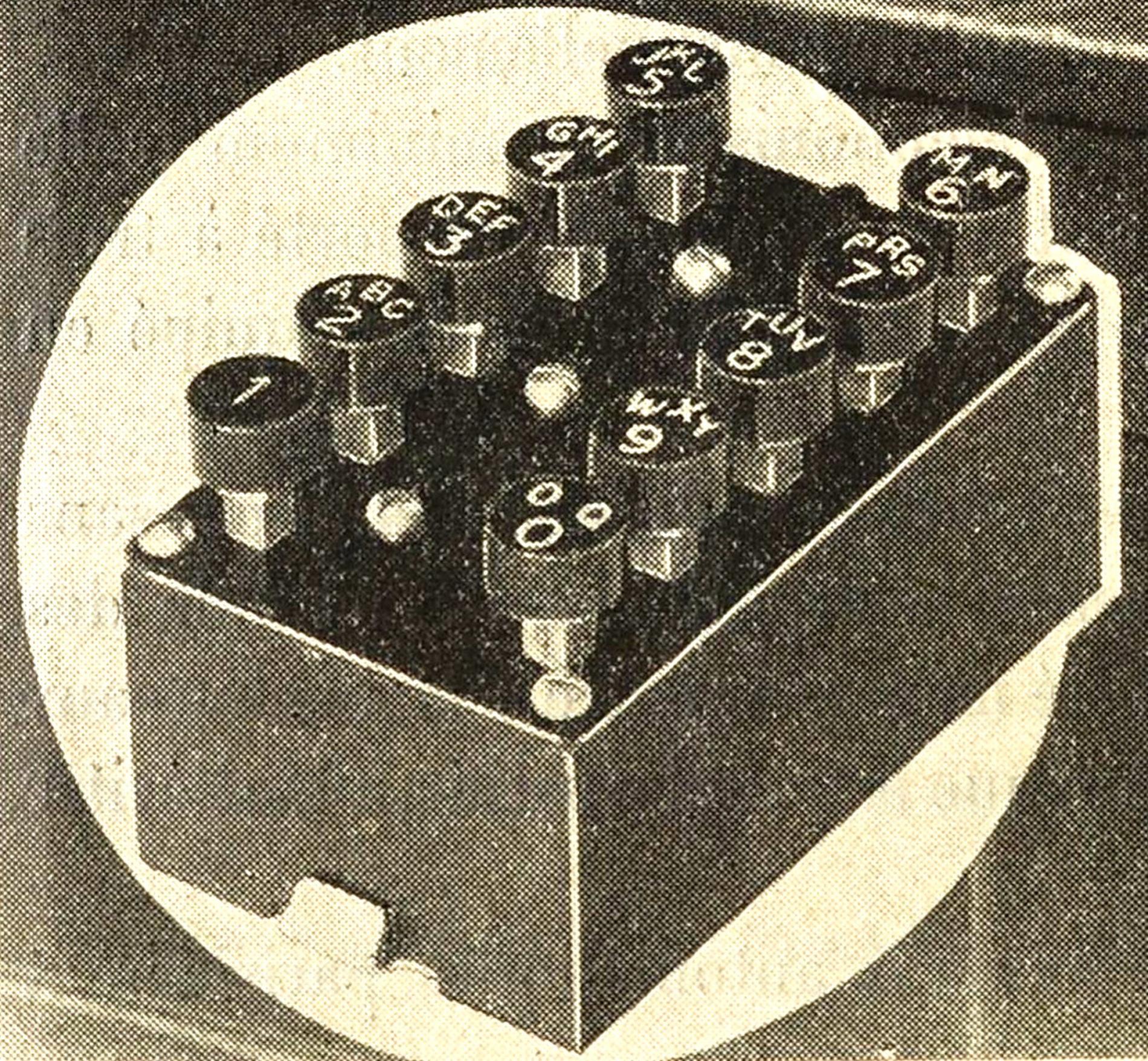 Clavier
d'Opératrices
Clavier
d'Opératrices  Opératrices de Rotary 7A
Opératrices de Rotary 7A
À la différence d'un central manuel, il n'y a plus besoin
d'opératrices intermédiaires pour établir la liaison
téléphonique, et du coup l'on peut diviser par quatre le
nombre d'opératrices.
Une grande simplification et une amélioration du service rendu
sont ainsi obtenues.

En 1915, des ingénieurs français s’aperçoivent
que, grâce à un phénomène technique lié
au mode de communication de l’époque (le « retour »
des téléphones se faisant par la terre, au moyen de piquets
enfoncés dans le sol), il est possible, dans certaines conditions,
d’écouter les conversations adverses. Et ce, d’autant
plus que les premières années de la guerre se feront dans
les tranchées et que les lignes ennemies sont parfois proches de
quelques mètres.
Dès 1916, pendant la bataille de Verdun, un premier poste d’écoute
artisanal donnera de bons résultats, et l’expérience
se généralise avant la création officielle, début
1917, des Sections spéciales d’écoute mises au service
du Service de Renseignements. Celles-ci se composent de techniciens qui
doivent repérer les endroits où des « fuites »
permettent d’intercepter les conversations ennemies et d’interprètes
capables d’écouter, en temps réel, les conversations
ennemies. Le rôle de ces interprètes est d’autant plus
difficile qu’il leur faut comprendre non seulement l’allemand
mais aussi ses différents patois, et être familiarisés,
dans la langue de Goethe comme dans celle de Voltaire, avec la terminologie
militaire. La plupart des interprètes travaillant déjà
pour l’état-major, les sections spéciales se rabattront
sur quelques professeurs et sur des volontaires de la Légion étrangère
d’origine allemande ou suisse.
Durant les deux dernières années de la guerre, les écoutes
téléphoniques rendront d’inappréciables services,
permettant de juger du moral des troupes ennemies, de tenir à jour
ses mouvements et, au niveau des champs de bataille, d’être
informé de ses offensives et de capter les informations destinées
au réglage de l’artillerie. Ajoutons que ces humbles auxiliaires
du Service de Renseignements travaillent dans es tranchées de première
ligne, directement sous le feu des Allemands. Leur travail de repérage
permettra aussi de colmater quelques brèches béantes ouvertes
dans les communications françaises. Leur rôle et même
leur simple existence sont restés, jusqu’à ce jour,
quasi ignorés des historiens.
sommaire
En Novembre 1915 Angers
ouvre le premier centre rotatif semi-automatique
de type Rotary 7A1,
suivront deux centres à Marseille en 1919 et 1927.
En 1916, par le décret du 2
septembre 1916 (JORF 8 septembre 1916 page 8017), il est institué
un Comité Technique des Postes et des Télégraphes.
Ce comité est constitué de spécialistes techniques,
d'ingénieurs et de sommités techniques et scientifiques.
Par son article 2, le comité Technique est obligatoirement saisi
par les services compétents de l'administration de toutes innovations
ou modifications à introduire dans l'outillage postal, télégraphique
et téléphonique, et émet des avis motivés
sur les questions qui lui sont soumises.
Les essais, expériences, recherches reconnus nécessaires
sont effectués par le service d'études et de recherches
techniques des postes et des télégraphes.
Par arrêté du 2 septembre 1916,
le Comité est constitué de 6 sections :
- 1e section. — Matériel postal
- 2e section. — Appareils et installations télégraphiques
- 3e section. — Lignes télégraphiques souterraines,
sous-marines et pneumatiques
- 4e section. — Télégraphie et téléphonie
sans fil.
- 5e section. — Appareils et installations téléphoniques,
- 6e section. — Lignes aériennes, lignes souterraines téléphoniques.
Puis, ultérieurement sont ajoutées
2 sections supplémentaires :
- 7e section. — Radiodiffusion (arrêté
du 13 décembre 1930)
- 8e section. — Moteurs thermiques, automobiles et transports (arrêté
du 2 novembre 1936)
Nota : le Comité Technique des Postes et
Télégraphes apparaît sous la nouvelle dénomination
Comité Technique des Postes, Télégraphes et Téléphones
courant 1927 dans les textes.
Le Comité Technique
des Postes, Télégraphes et Téléphones sera
renommé Conseil Technique des Postes, Télégraphes
et Téléphones par décret n°48-1218 du 19 juillet
1948 (JORF 26 juillet 1948, page 7331).
Le réseau de Paris deviendra, en 1938, le réseau
automatique équipé en matériel ROTARY le plus important
du monde, avec 42 Commutateurs automécaniques ROTARY 7A1,
et en 1939, 18 Commutateurs ROTARY 7A1 équiperont la banlieue
parisienne.
Il me reste une rubrique à compléter
concernant la période de guerre 1914-1918 ou toutes les initiatives
s'arrêtent, la réglementation gouvernementale très
spécifique et restrictive va venir encadrer les services électriques
de communication de l'ensemble de la nation.
La Grande Guerre est le premier conflit pendant lequel les télécommunications
militaires ont pris une grande ampleur et ont joué un rôle
aussi primordial dans le succès des combats.
Je vous recommande de consulter le site "Des
téléphonistes et télégraphistes passerands
en 14-18" qui raconte ces moments.
Les transmissions se faisaient par téléphonie, mais aussi
par télégraphie soit Télégraphie électrique,
soit Télégraphie Par le Sol (T.P.S.) soit Télégraphie
Sans Fil (T.S.F.). On y apprend comment faire de la télégraphie
par le sol (T.P.S.)
« La télégraphie par le sol a été utilisée
dès 1917 pour établir des liaisons à courte distance
(portée 3 km environ).
Elle évitait l’utilisation d’une ligne téléphonique
sujette aux coupures lors des bombardements. »


On a rapidement compris aussi qu’elle pouvait aussi servir de communication
entre 2 galeries de mine sans qu’il soit nécessaire de tirer
du câble entre les 2 boyaux … La réception ne peut toutefois
pas dépasser un rayon de 3 km. Le fil en lui-même est un
fil de terre, donc assez solide, beaucoup plus solide que le fil normal
de téléphone et il est aussi assez court (moins de 100 m).
Il ne peut être coupé que par de l’artillerie, et pas
par le piétinement ou autre. S’il est coupé et qu’il
existe une extrémité qui reste fichée en terre, le
système fonctionne encore. S’il est tout à fait coupé,
il est facile de le faire réparer, même en plein bombardement
par un télégraphiste qui n’a pas besoin d’aller
fort loin pour retrouver la coupure… L’invention a fait l’objet
d’un brevet dès 1910 ; ce n’est donc pas un secret militaire.

En 1915, des ingénieurs français s’aperçoivent
que, grâce à un phénomène technique lié
au mode de communication de l’époque (le « retour »
des téléphones se faisant par la terre, au moyen de piquets
enfoncés dans le sol), il est possible, dans certaines conditions,
d’écouter les conversations adverses. Et ce, d’autant
plus que les premières années de la guerre se feront dans
les tranchées et que les lignes ennemies sont parfois proches de
quelques mètres.
Dès 1916, pendant la bataille de Verdun, un premier poste d’écoute
artisanal donnera de bons résultats, et l’expérience
se généralise avant la création officielle, début
1917, des Sections spéciales d’écoute mises au service
du Service de Renseignements.
Celles-ci se composent de techniciens qui doivent repérer les endroits
où des « fuites » permettent d’intercepter les
conversations ennemies et d’interprètes capables d’écouter,
en temps réel, les conversations ennemies.
Le rôle de ces interprètes est d’autant plus difficile
qu’il leur faut comprendre non seulement l’allemand mais aussi
ses diff érents patois, et être familiarisés, dans
la langue de Goethe comme dans celle de Voltaire, avec la terminologie
militaire.
La plupart des interprètes travaillant déjà pour
l’état-major, les Sections spéciales se rabattront
sur quelques professeurs et sur des volontaires de la Légion étrangère
d’origine allemande ou suisse.
Durant les deux dernières années de la guerre, les écoutes
téléphoniques rendront d’inappréciables services,
permettant de juger du moral des troupes ennemies, de tenir à jour
ses mouvements et, au niveau des champs de bataille, d’être
informé de ses offensives et de capter les informations destinées
au réglage de l’artillerie.
Ajoutons que ces humbles auxiliaires du Service de Renseignements travaillent
dans les tranchées de première ligne, directement sous le
feu des Allemands. Leur travail de repérage permettra aussi de
colmater quelques brèches béantes ouvertes dans les communications
françaises.
Leur rôle et même leur simple existence sont restés,
jusqu’à ce jour, quasi ignorés des historiens.
sommaire
A partir de 1918 Préconisation de généralisation
de l'emploi des magnétos d'appel, en vue de diminuer l'entretien
onéreux des piles d'appel.
Modèles 1918 normalisés par l'administration


 ... Vers 1920 , des contestations
... Vers 1920 , des contestations 
1919 Avec les évolutions, les premiers commutateurs ROTARY 7A semi-automatiques livrés précédemment, sont reconvertis en automatique intégral, c'est le cas de Marseille mis en service en 1919 . Dans cette version il n'y a plus d'opératrice.
Avant de poursuivre, on se doit d'évoquer les
principaux constructeurs en téléphonie Française
:
Durant la période entre 1880 et 1910 des dizaines
de constructeurs ateliers, sociétés oeuvrent pour le développement
de la téléphonie..
Certains fabriqaunts ont produit une multitude de modèles différents
tandis que d'autres se sont contenté d'un ou deux modèles.
Voici une liste non exhaustive des principaux constructeurs; que l'on
retrouve dans cette page .
|
Abdank-abakanowicz : ingénieur et mathématicien
d'origine polonaise, il a construit et commercialisé en 1889
plusieurs modèles de transmetteurs tous équipés
du microphone de son invention. |
Juillet 1921, le second commutateur automatique en France STROWGER monté à Orléans ne sera mis en service, que 8 ans en retard à cause de la première guerre mondiale.
Le nouveau réseau de PARIS sera structuré autour de 4 centres de jonctions dont le nombre et la localisation auront été déterminés par une étude du trafic.
Ce sont en 1922 les bureaux existants de Guyot (nord-ouest), Combat (nord-est), Daumesnil (Sud-est) et Vaugirard (Sud-ouest).
Le nombre et l'emplacement des bureaux centraux sera, lui determiné a la fois par la densité des abonnes et par l'equilibre economique a réaliser entre la longueur des fils d'abonnés, celle des lignes auxiliaires entre centraux sans que jamais l'affaiblissement impose par la longueur d'une ligne oblige à descendre au dessous des standards de transmission fixes au départ.
Pour la première fois l'étude tient compte du réseau suburbain de Paris. Selon le modèle des études anglaises l'adoption du service automatique dans une grande région urbaine conduit géneralement à augmenter le nombre des bureaux et à diminuer leur capacité (on fait ainsi des économies sur la longueur des lignes alors que le problème des opératrices ne se pose plus). Il n'en est pas ainsi géneralement pour les zones intérieures des grandes villes ou la densité téléphonique est telle que les bureaux d'une capacité de 10 000 lignes sont justifiés aussi bien dans le service automatique que dans le service manuel ...
Ce n'est qu'en Banlieue que le nombre le plus économique de bureaux est géneralement plus grand pour l'exploitation automatique que pour l'exploitation manuelle.
Effectivement pour Paris le nouveau plan comprend, outre l'interurbain et les quatres centres de transit, beaucoup plus de bureaux qu'avant 1914, augmentation liée a la fols à l'augmentation globale du nombre des abonnés; et a cet egard le plan de développement de 1922 reprend le plan de 1914 et aux nouvelles exigences techniques.
Un rapport de 1922 en prévoit 43, le nombre des bureaux doit pratiquement être doublé, tous doivent faire l'objet de travaux qui nécessitent parfois le transfert provisoire d'abonnés par 10 000 à la fois...
Parallèlement le réseau de câble est entièrement revu. Dans sa capacité d'abord. Le passage de 60 000 abonnés en 1914 à 120 000 en 1922 et la perspéctive du doublement pour 1932 font prévoir, en 1922, la pose de 331 000 km de circuits nouveaux tant en lignes d'abonnés qu'en lignes auxiliaires sans compter les lignes interurbaines. Ceci a sur le réseau lui-même deux conséquences. D'abord l'augmentation de la capacité maximum des câbles. Toujours isolés au papier et séchés à l'air ceux-ci peuvent contenir jusqu'à 900 paires de fils. Il n'y a toujours pas de câbles pupinisés ou krarupisés à Paris. Ceux-ci n'existent que sur le réseau de banlieue. Enfin les sous-répartiteurs se sont généralisés : pour une raison d'économie dans le calcul de la capacité des câbles mais aussi parce que l'automatisation a montré l'intérêt de pouvoir procéder au basculement de quartiers entier d'un central sur un autre.
En 1923,
par la loi de finances du 30 juin 1923 (art. 70 à 79) (BO P&T
1923 n°15 page 307), l’État dote à nouveau les
P&T d'un budget annexe qui permet sensiblement l'accroissement d'autonomie
et de souplesse budgétaire et qui aboutit à un net accroissement
du nombre d'abonnés au téléphone dès 1925.
Cette loi permet à l'Administration de financer
de plus nombreux projets et d'étendre le réseau téléphonique
global.
La loi de finances du 30 juin 1923 (art. 69) (BO
P&T 1923 n°15 page 307) crée en outre un Conseil dont les
membres sont nommés pour deux ans, par décret, sur proposition
du ministre chargé des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Le Conseil se réunit au moins une fois par mois, et un registre
des délibérations est tenu.
Ce Conseil donne son avis sur toutes les questions
soumises par le ministre.
Le Conseil est obligatoirement consulté sur
:
- les mesures d'organisation générale des
services,
- les cadres, le statut et la rémunération du personnel,
- les taxes, les projets de travaux ou de fournitures constituant des
dépenses de premier établissement,
- les projets de budget et tous autres projets financiers présentés
au parlement,
- les règlements de toutes natures (décrets, arrêtés
généraux) relatifs au service des postes, télégraphes
et téléphones.
- Les programmes d'action avec prévisions détaillées
à 5 ans minimum sont soumis à l'avis du Conseil.
Par le décret du 8 septembre 1923 (JORF du 11 septembre 1923 page
8922), le Conseil prend le nom de Conseil Supérieur des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
Nota : 17 ans avant la création de ce conseil, une proposition
de loi déposée en 1906 par le Député de la
Seine Hector Depasse prévoyait déjà d'instituer un
Conseil Supérieur de Postes, Télégraphes, Téléphones...
Evolution des techniques de transmission du signal
vocal
La commutation est, un élément fondamental de la structure,
de la qualité et de l’économie générale
d’un réseau téléphonique : c’est, en quelque
sorte, l’« industrie lourde » des télécommunications.
Mais, bien entendu, les liens qui permettent de relier entre eux les nœuds
du réseau, jouent également un rôle essentiel. Dans
un réseau téléphonique filaire ces liens correspondent
aux systèmes de transmission. L’évolution des systèmes
de transmission, notamment des systèmes à grande distance,
joue ainsi aussi un rôle essentiel. C’est grâce aux perfectionnements
techniques et technologiques très importants des équipements
de transmission que le coût de revient au kilomètre d’une
liaison téléphonique à grande distance a pu être
abaissé dans des proportions considérables au cours du temps.
On se souvient que l’invention, en 1900, de « bobines de charges
» par Pupin avait permis de réduire l’affaiblissement
subi par des signaux à fréquences vocales sur les câbles
téléphoniques souterrains. Mais avant le début de
la première guerre mondiale, il n'existait seulement que 2 câbles
téléphoniques pupinisés de quelques kilomètres
: Paris-Versailles et Lille-Tourcoing. Il s'agit
plus de câbles suburbains que de câbles réellement
interurbains, étant donné leur faible longueur.
Il faudra attendre après la guerre, pour accroître la portée
des liaisons téléphoniques, grâce aux premiers amplificateurs
analogiques à tubes électroniques, La triode, inventée
par Lee de Forest en 1900, et utilisée d’abord en radiotélégraphie,
fut une véritable révolution technique, car elle offrait
la possibilité de réaliser une véritable amplification
des signaux vocaux transmis en ligne. Au début, les amplificateurs
insérés sur les lignes de transmission jouèrent un
rôle analogue à celui des relais télégraphiques
qui « répétaient » les signaux : aussi furent-ils
couramment appelés « répéteurs téléphoniques
». Déployés sur le réseau de transmissions
ces amplificateurs fragiles nécessitaient une surveillance régulière
et un entretien continu. Ils étaient disposés à intervalles
de 70 Km.
Le premier câble souterrain à grande distance, commandée
le 7 septembre 1923, fut posé entre Paris et Strasbourg : les travaux
débutèrent en 1924 et la mise en service des premiers circuits
eut lieu en 1926. Les stations d’amplification étaient distantes
de 80 à 120 kilomètres.
Comparés aux circuits aériens, les circuits en câbles
présentaient, grâce à leur fort isolement et à
l’équilibrage des conducteurs, une grande stabilité
de fonctionnement, et un rapport signal/bruit élevé.
La pose des câbles se déroula jusqu’en 1939, à
une cadence très régulière, à raison de 700
kilomètres de câbles par an. La technique des « courants
porteurs » faisait ainsi son apparition en France.
L'objectif du câble Paris-Strasbourg est alors, au lendemain de
la Première Guerre Mondiale, de rattacher téléphoniquement
de manière efficace l'Alsace-Lorraine de nouveau réintégrée
dans la Nation Française. L'ouverture officielle à l'exploitation
était le 9 août 1926.
En 1939, le réseau français comprenait environ 10 000 kilomètres
de câbles à grande distance et une centaine de centres d’amplification
: ce réseau câblé était constitué essentiellement
par 12 artères principales rayonnant à partir de Paris et
par quelques câbles sur des itinéraires transversaux tels
que Angoulême – Lyon et Bordeaux – Toulouse – Avignon.
Les 8 000 circuits interurbains en service à cette date avaient
une longueur totale de plus d’un million de kilomètres. En
1974, le nombre de circuits interurbains en France atteignait 160 000,
soit 20 fois plus, alors que le nombre d’abonnés principaux
était multiplié par moins de 6, ce qui montre l’expansion
extraordinaire du trafic interurbain depuis la dernière Guerre
mondiale.
En 1980, le nombre de circuits interurbains dépassait 500 000,
ce qui traduit une croissance moyenne de plus de 20 % par an au cours
de cette période.
Parallèlement, les centraux téléphoniques
automatiques furent perfectionnés permettant ainsi leur installation
dans les grandes villes, ce qui eut pour effet de démultiplier
le trafic.
Ainsi, entre 1920 et 1925 le trafic urbain s'accrut de 26%,
le trafic interurbain de 90% et le trafic international de 282%.
Ces évolutions eurent un coût important ; par exemple,
en 1921 le plan d'investissement du Secrétariat Général
des PTT4 attribua 473 millions de francs pour l'automatisation du réseau
et 562 millions pour les lignes interurbaines. Cette charge financière
contribua à accélérer le débat public, entamé
depuis le début de la décennie 1900, portant sur la dénationalisation
de l'exploitation du réseau téléphonique.
Le texte de la loi de 1923 est issu à la fois du refus d'une dénationalisation
et du constat d'une nécessaire évolution prenant en compte
le caractère particulier de cette administration.
Une offre de rachat de l'intégralité du réseau français
fut même faite par l'entreprise américaine ITT, à
laquelle le secrétaire d'État en charge signifia son refus
en expliquant « que ce serait contraire aux mœurs républicaines
du pays ».
1921 Dans le domaine des radiocommunications, des installations à ondes moyennes et à ondes longues sont mises en service pendant et surtout après la guerre, La radiotélégraphie apparut comme un remède permettant à la France de s’affranchir de la tutelle étrangère, les puissantes installations de Sainte-Assise et de Bordeaux, émettant jusqu'à des distances estimables à 6000 km environ,
sommaire
1923, Création
du ministère des PTT (P & T devient PTT)
Une de ses fonctions est de s’assurer de
la diffusion homogène du réseau téléphonique
sur l’ensemble du territoire national.
Il s’agit là d’une décision exceptionnelle sur
le plan économique puisque, jusqu’en 1936, les parlementaires
se refusèrent aux nationalisations. Pourtant s’il en devient
le gestionnaire unique, l’État ne se préoccupera pas
de l’outil industriel, le secteur de la production restant à
la charge des entreprises privées.
Ce retour de l’État ne sera pas sans conséquence. À
« la reprise du réseau par l’État, la taxe fut
réduite de 600 à 400 Frs et cette réduction amena
un accroissement si rapide du nombre d’abonnés qu’il
fallut modifier entièrement les procédés et les appareils
de mise en communication pour répondre à des besoins (…)
qui ne s’étaient encore manifestés aussi rapidement
dans aucune autre ville,même en Amérique »
En approfondissement de cette idée, l’analyse des bailleurs
de fonds éclaire la logique des choix techniques qui s’est
opérée autour de la constitution des infrastructures. La
loi du 20 mai 1920 définit les modalités de financement
du téléphone : « il appartient aux villes d’apprécier,
avant de s’engager (financièrement), si les avantages que
leurs habitants sont appelés à retirer de leurs communications
interurbaines sont assez grands pour justifier les
engagements et les sacrifices qu’elles ont à imposer ».
Cette loi traduit dans les textes une réalité qui existait
depuis 1890 selon laquelle l’administration des Postes n’investissait
dans des réseaux téléphoniques que là où
des financements locaux avaient déjà préfinancé
l’opération.
Pendant le premier quart du 20e siècle, le téléphone
s’immisça de plus en plus dans l’économie française
telle que ses coûts d’investissement devinrent très
élevés. Cette situation va être à l’origine
d’un débat sur l’autonomisation du ministère des
PTT qualifié « d’industriel » par l’ampleur
de son action et de son caractère commercial. Une façon
pour certains de rompre avec l’unité budgétaire de
l’État et de changer la nature de son
administration. En effet, la rupture du budget unitaire sera réalisée
avec la réforme du budget annexe de l’État en 1923.
La nécessité de financer les investissements des infrastructures
du téléphone par les recettes va amener l’État
à considérer le ministère des PTT comme un ministère
industriel et non plus comme un ministère d’administration.
Ce qui est frappant à la lecture des débats parlementaires
autour de cette loi, c’est la récurrence du thème de
la privatisation du service public. Que ce soit en 1923, en 1990 ou en
2004, les partisans de la privatisation ont recours aux mêmes argumentaires,
toutes époques confondues. L’examen de la réforme des
PTT du 30 juin 1923 permet de remonter aux fondements du budget annexe
dont les problématiques de fond perdureront jusqu’en 1990
.
18 mai 1923 l'Ingénieur, Mr Barnay, dépose un brevet de commutation automatique, le système ROTATIF R6 délivrée 24 janvier 1924.
 51 points |
Ce
système français de type pas à pas
est un hybride qui s'inspire à la fois des systèmes
Rotary et Strowger Le 9 avril 1924, la Compagnie des Téléphones Thomson-Houston rachète alors le brevet de ce système à son concepteur. Il est développé par l'Ingénieur français Fernand Gohorel de la Compagnie des Téléphones Thomson-Houston et ses équipes. Soulignons que ce système de conception française a tout de même été produit par une société devenue entre-temps une filiale française de l'américain ITT le 14 avril 1926 pour la somme de 140 millions de francs, soit 90 millions d'euros (valeur 2015), via un rachat total du capital autorisé par l'assemblée générale des actionnaires à cette date ; opération orchestrée par le Colonel Behn alors patron de l'ITT... Ce système trouve un écho auprès de l'administration des PTT en raison du coût élevé des ROTARY 7A, 7A1 et 7A2 Américains. il équipera les villes moyennes et des zones rurales entre 1928 à 1982. |
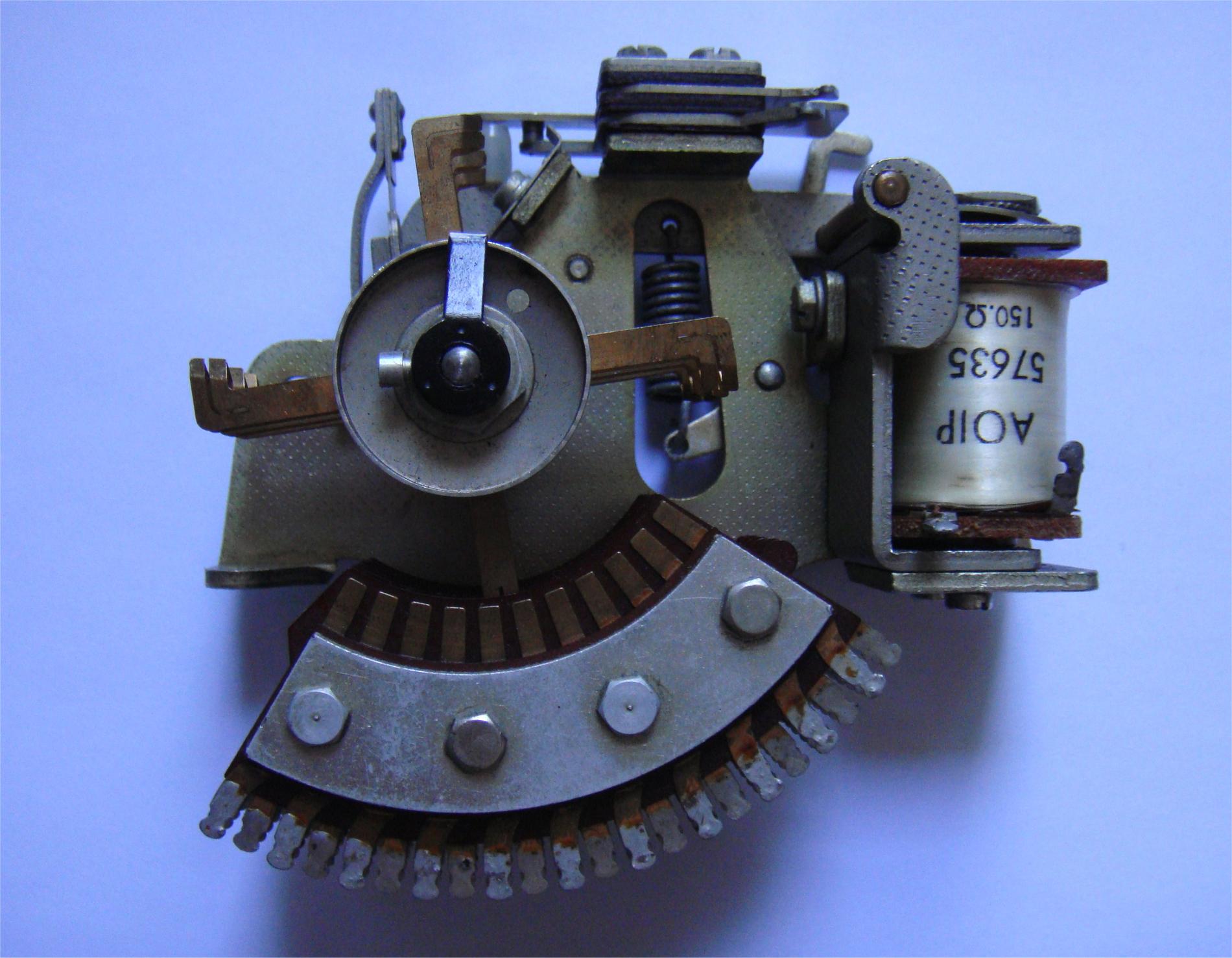 Orienteur 11 points |
1928 mise en service du centre de Troyes.Version
R6 1926
Ce système français de type pas à pas étant
un hybride qui s'inspire à la fois des systèmes Rotary et
Strowger. Il est de surcroît simplifié à l'extrême
pour être le moins coûteux possible.
Au cours de cette période,
qui commence au lendemain de la Première Guerre mondiale et s’achève
à la fin des années 30, une prise de conscience des déficiences
de l’équipement téléphonique français
qui incite les pouvoirs publics à engager un important plan de
redressement et de rénovation,
particulièrement efficace à Paris. Ensuite, à partir
du milieu des années 30, les conséquences indirectes de
la grande crise économique se font sentir ; l’effort d’équipement
téléphonique se ralentit et l’insuffisance des moyens
financiers conduit à l’adoption de solutions, certes peu coûteuses
dans l’immédiat, mais dont les effets pervers se manifesteront
à long terme. Le développement excessif de l’«
automatique rural » est, à cet égard, très
significatif.
De 1880 à 1920 le parc téléphonique français
correspondait à 8 % du parc européen. Les actions entreprises
après la Première Guerre mondiale ont permis de porter cette
proportion à 11 %. Mais, ce ratio baissera à nouveau au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
1932 mise en service de l'agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing
en R6N1.
Le déploiement du ROTATIF 1926 avec enregistreur de numéros
est totalement interrompu en province dès la déclaration
de guerre, et ne reprendra qu'en 1945. Il se poursuivra jusqu'à
l’arrivée de la version modernisée en 1949.
Il sera mis en service à Rouen, en
Mai 1949, 35 Commutateurs R6 N1 seront installés en France
Version- R6 N2 : à X enregistreurs et seulement 2 traducteurs
séparés , issu des évolutions du L43.
27 Commutateurs R6 N2 seront installés en France en commençant
le 22 mars 1958 par Poitiers et à Boulogne-sur-mer.


Enregistreur-Traducteur , R6 de Rouen
Cette loi dote, en surplus de la loi de finances de 1923, l'administration des PTT d'un programme de financement supplémentaire de 644 millions de Francs, réparti sur les exercices de 1924 à 1929 visant notamment à développer les réseaux urbains et interurbains, moderniser et étendre les immeubles téléphoniques.
Ces financements permettront la mise en route la plus rapide possible du téléphone automatique dans le réseau de Paris et de grandes agglomérations à venir prochainement.
En 1924 est créée la société le Taxiphone qui signe avec l’administration des PTT une convention lui permettant non seulement de construire ces postes téléphoniques mais également de les exploiter. Elle installe ses appareils dans les cafés et les restaurants.
Parallèlement, les PTT ouvrent leurs propres cabines publiques dans les bureaux de poste et dans certaines gares.
Ce mode de fonctionnement des cabines publiques durera jusqu’en 1970, date à laquelle les PTT reprennent le contrôle de la gestion des cabines. .
1924 Le premier et unique commutateur ERICSSON AGF500 est mis en service le 21 septembre 1924 à Dieppe sur 1500 abonnés.
Il lui a été préféré le système Rotary 7A/7A1 par l'administration des P & T, la raison alors invoquée était le surcoût de 12% du système suédois lors du choix pour Paris...
La seconde raison est que les baies du commutateur étaient importées directement de Suède, ce qui lésait les travailleurs français, condition éliminatoire à l'époque où nos hommes politiques pensaient vraiment aux citoyens français et à l'emploi en France.
Le commutateur AGF500 de Dieppe fut remplacé le 29 janvier 1960.
En 1925, au mois de
janvier, par le décret du 13 août 1924 publié ultérieurement
(BO P&T 1925 n°1 page 8), il est créé une zone suburbaine
autour des villes de Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Rouen, Le Havre, Nantes
et Roubaix.
Les petits groupes de réseaux qui existaient autour de ces grandes
agglomérations sont supprimés en tant que tels, et unifiés
au sein d'un même réseau, dit réseau suburbain, autour
de chaque ville.
Le but est de préparer techniquement l'automatisation à
venir du réseau téléphoniques de ces villes et agglomérations
environnantes.
 Zone Paris (clic pour
agrandir) de 57 communes
Zone Paris (clic pour
agrandir) de 57 communes
Pour l’équipement du
central de Carnot. Trois systèmes sont en lice, le Strowger,
le système Rotary et le système
suédois Ericsson
Dans le cadre d’un plan de redressement du téléphone,
le gouvernement français lance en 1925 une consultation
pour l’équipement du réseau automatique de Paris.
Situation de l’industrie téléphonique
en France, en 1925.
Il faut bien rappeler que concernant l’automatisation du réseau
de Paris, de la 1ère et de la deuxième couronne, actée
par l’approbation du premier marché le 13 octobre 1926, cette
entreprise ne pouvait pas être une mince affaire, et la France ne
pouvait pas se permettre d’effectuer de choix hasardeux.
Le projet était pharaonique, et devant aboutir au réseau
de téléphone automatique le plus important de toute l’Europe.
Impératifs de départ :
• Un système techniquement fiable et déjà mis
au point.
• Un système capable de conserver l’utilisation des indicatifs
de centraux littéraux utilisés jusques alors en manuel.
Ce qui implique de facto la présence d’enregistreurs de numérotation
dans le système choisi.
• Un ensemble pléthorique de commutateurs intimement connectés
entre-eux, et qui, par facilité d’exploitation et de maintenance
devront tous être du même système.
• Un système qui puisse être disponible le plus rapidement
possible, donc un système présenté par un concepteur-fabricant
ayant financièrement les
« reins solides », et déjà pourvu d’un
solide outil de production implanté surle territoire national.
• Un système si possible de conception française et
entièrement fabriqué en France, par de la main d’œuvre
locale.
Évidemment, à cette époque encore, inutile de rappeler
que les hommes politiques défendent pour leur grande majorité
les intérêts français, la
main d’œuvre locale et l’emploi français.
Situation du secteur des téléphones dans le monde
en 1925 :
Inutile de préciser que le fait de confier la construction du réseau
de Paris à des sociétés étrangères
ou à capitaux étrangers ne fait alors plaisir à personne
en France.
Au niveau des industriels étrangers, il convient de signaler que
dans leurs zones d’influences respectives, seules deux nationalités
sont en mesure de prendre de gros marchés en France.
1) Les USA, via la société International Telephone and Telegraph.
2) L’Allemagne, via la société Siemens.
Inutile de préciser, pour raisons historiques, au sortir d’une
première guerre mondiale particulièrement meurtrière,
qu’il était alors inconcevable que la France commandât
en masse à « l’hydre au casque pointu » l’automatisation
du réseau de Paris...
Acheter quoi que ce soit d’importance et de stratégique à
l’Allemagne était tout simplement inconcevable.
(À titre de contre-exemple, l’on notera que la ligne Maginot
avait été électrifiée par Siemens, et que
du coup, le régime national-socialiste, démocratiquement
élu, avait pu par la suite profiter de tous les plans de la ligne
Maginot pour mieux la contourner en 1940...)
Concernant le Réseau de Paris, Siemens était donc par sécurité
de facto exclu des marchés à venir.
Ne pourraient éventuellement concourir, en tant qu’étrangers,
que les USA .
Situation du secteur des téléphones en France en 1925
:
Ensuite, il y a le principe de réalité. À cette époque,
en France, les sociétés purement françaises de téléphones
sont des Petits Poucets comparées à certaines maisons étrangères...
Leur outil de production étant plus proches de l’atelier que
de l’usine... (nous pouvons citer Plazolles, Burgünder...)
Les fabricants les plus importants en France :
SIT : la société purement française alors
la plus développée est alors la Société Industrielle
des Téléphones, (qui deviendra bien plus tard la CIT-Alcatel).
Or, cette société est alors spécialisée dans
la construction d’équipements terminaux (postes téléphoniques)
et n’a pas l’outil industriel et les capitaux suffisants pour
se lancer dans la fabrication de commutateurs téléphoniques
automatiques. D’ailleurs, elle n’a pas de système à
présenter conçu par elle.
Elle fabrique du Strowger américain. Tout au plus fabriquera-t-elle
pour la province, en appoint de la Compagnie Française Thomson-Houston,
quelques commutateurs Strowger.
Elle N’a pas l’envergure pour se lancer dans un tel projet.
Ne pourrait présenter qu’un système pas-à-pas,
dépourvu d’enregistreurs.
CGTT : La Compagnie Française de Téléphonie
et Télégraphie : société française
à capitaux allemands, d’envergure réduite, et de plus
allemande. Fabrique en France sous licence des commutateurs Strowger Siemens
& Halske.
Est Éliminée de facto politiquement et ne pourrait présenter
qu’un système pas-à-pas, dépourvu d’enregistreurs
: ne pourrait pas gagner le marché.
GRAMMONT : société française des Établissements
Grammont, Essentiellement française, avec présence indirecte
d’Ericsson, et d’ITT dans son capital. Bonne société,
disposant d’un outil de production en France assez développé,
mais qui ne présente pas de système de commutation propre.
Elle ne concourt pas en 1926. Elle sera en mesure de concourir dans des
marchés ultérieurs concernant Paris.
Elle ne pourrait pas présenter de système propre.
ERICSSON : société française, installée
à Colombes (Seine) détenue en partie par le suédois
Ericsson.
Bonne société, fabriquant de bons matériels, dont
son système de commutateur automatique AGF500,
mais avec un outil industriel de taille insuffisante en France. Ses commutateurs
ne sont pas fabriqués en France, mais en Suède.
Ericsson France pourrait être qualifiée de bonne start’up
de l’époque. Elle est en mesure de concourir pour Paris. Il
présente son système AGF500 avec enregistreurs, mais son
système est fabriqué uniquement dans ses usines de Suède
: handicap certain.
LMT : Société Le Matériel Téléphonique
société française à capitaux américains,
il s’agit de la filiale française du groupe ITT. Capitaux
américains pléthorique, société solide, présence
dans plusieurs pays d’Europe et du monde, gros outil de production
en France, et qui plus est perfectionné. Fabriquant de bons produits,
son terminal téléphonique (le poste PTT 1924) ayant été
agréé par l’administration depuis 1924, et présentant
son système de commutation automatique le Rotary
7A1.
Elle est en mesure de concourir pour Paris. Présente son système
de conception belgo-américaine Rotary 7A1, pourvu d’enregistreurs
de numérotation et entièrement fabriqué en France
par la main d’œuvre locale.
Fait figure de favori.
CFTH : Compagnie Française Thomson-Houston. Société
initialement française, chargée d’exploiter en France
les brevets des autocommutateurs Strowger britanniques et développant
à cette époque, un nouveau type de commutateur pas-à-pas,
le R6. Rachetée par l’ITT en avril 1926.
De ce fait, concourra pour Paris, mais fera en sorte de laisser la place
libre à sa sœur jumelle LMT, mais s’implantera beaucoup
pour la province.
Elle est en mesure de concourir pour Paris. Ne peut présenter qu’un
système pas-à-pas, dépourvu d’enregistreurs
:
Elle ne peut techniquement pas gagner la marché.
En conclusion : après examen de toutes les conditions
de départ (techniques et politiques), seules deux sociétés
sur six (ERICSSON et LE MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE) avaient
des chances de gagner le premier appel d’offres, et une seule ayant
en réalité les atouts les plus valables pour réussir.
Mis à part le fait que le système ne pouvait pas être
de conception française (il n’en existait alors pas),il faille
bien admettre que seule la société Le Matériel Téléphonique,
filiale française d’ITT, avait la solidité et la fiabilité
de l’outil de production implanté en France.
De surcroît la société LMTa systématiquement
obéi à toutes les demandes du pouvoir politique français
et des ingénieurs des téléphones.
De ce fait, la société Ericsson ne pouvait pas gagner l’appel
d’offres initial, ne fabriquant pas ses commutateurs téléphoniques
en France.
Le résultat du concours vit en toute logique la victoire de
la société Le Matériel Téléphonique.
Le système Rotary 7A est finalement
choisi le 13 octobre 1926 pour équiper la capitale.
Par la suite, au fur et à mesure de la signature des marchés
ultérieurs, même si, en toute logique, la société
LMT gagne ensuite entre les 2/3et les ¾ des commandes de centraux
téléphoniques Rotary 7A1, les sociétés Grammont
et Ericsson construiront certains des Rotary 7A1 mis en service dans le
réseau de Paris.
En réalité, les marchés seront distribués
par l’administration suivant les capacités de production des
équipements en France de chaque constructeur et il convient d’insister
sur le fait, quoique l’on puisse émettre comme jugement concernant
l’ITT, que seule la LMT possède alors l’outil suffisant
pour faire face à l’essentiel des commandes et au déploiement
massif des commutateurs téléphoniques dans la région
de Paris
C’est une filiale d’ITT (International Telephon and Telegraph
Corporation) qui remporte le marché et installe un matériel
de type Rotary (système de communication rotatif). Outre
des arguments techniques de poids (souplesse tout à fait remarquable
du matériel et meilleur acheminement des communications), ITT achève
de convaincre en proposant la création d’une usine en banlieue.
L'Administration a mis au point en 1931-1932 un nouveau
type de poste mobile 1924 permettant une utilisation aisée comme
poste supplémentaire de tableaux. Le
poste universel PTT 1924 avec ou sans cadran fonction de son raccordement
à une opératrice ou pas

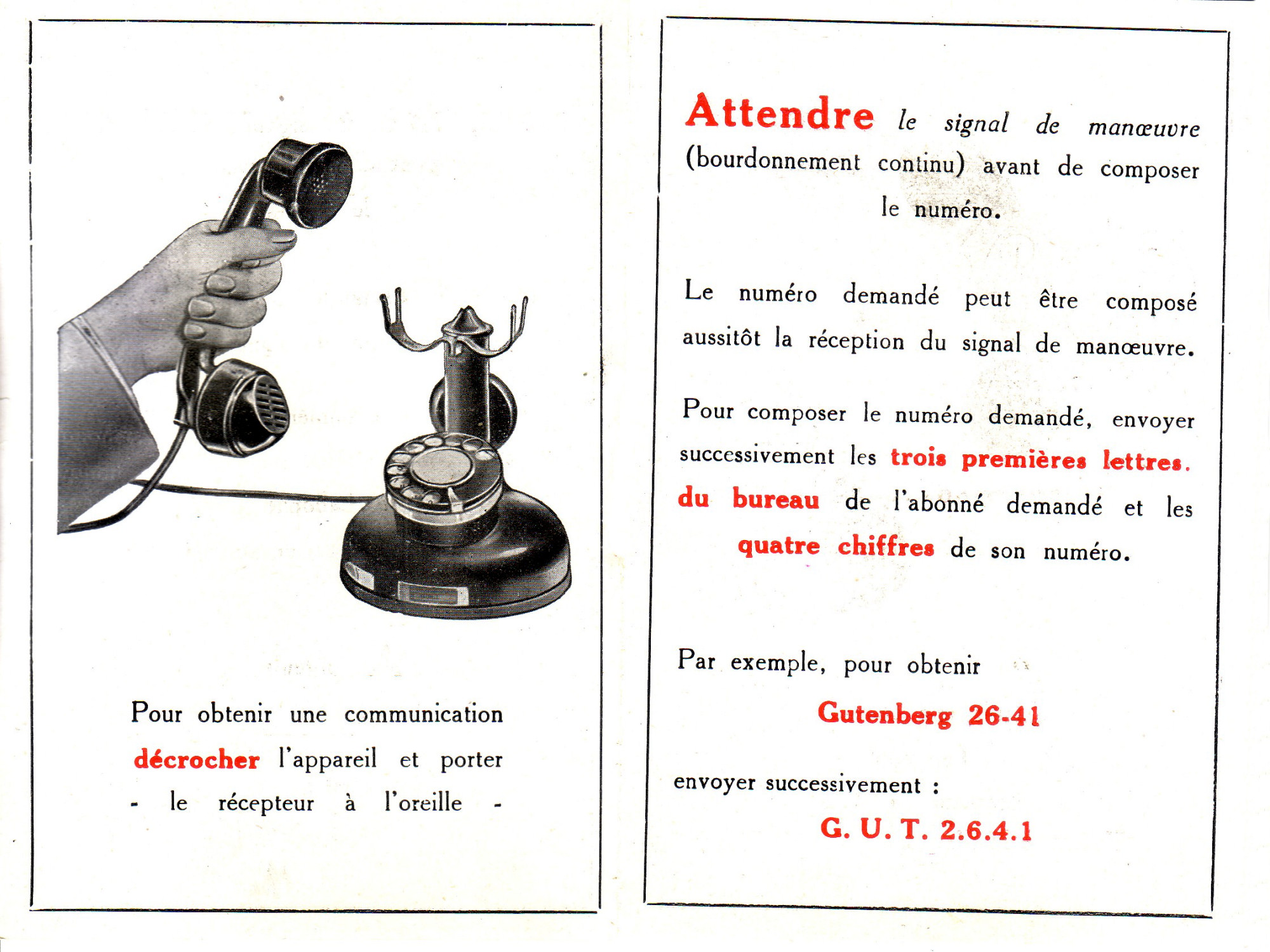

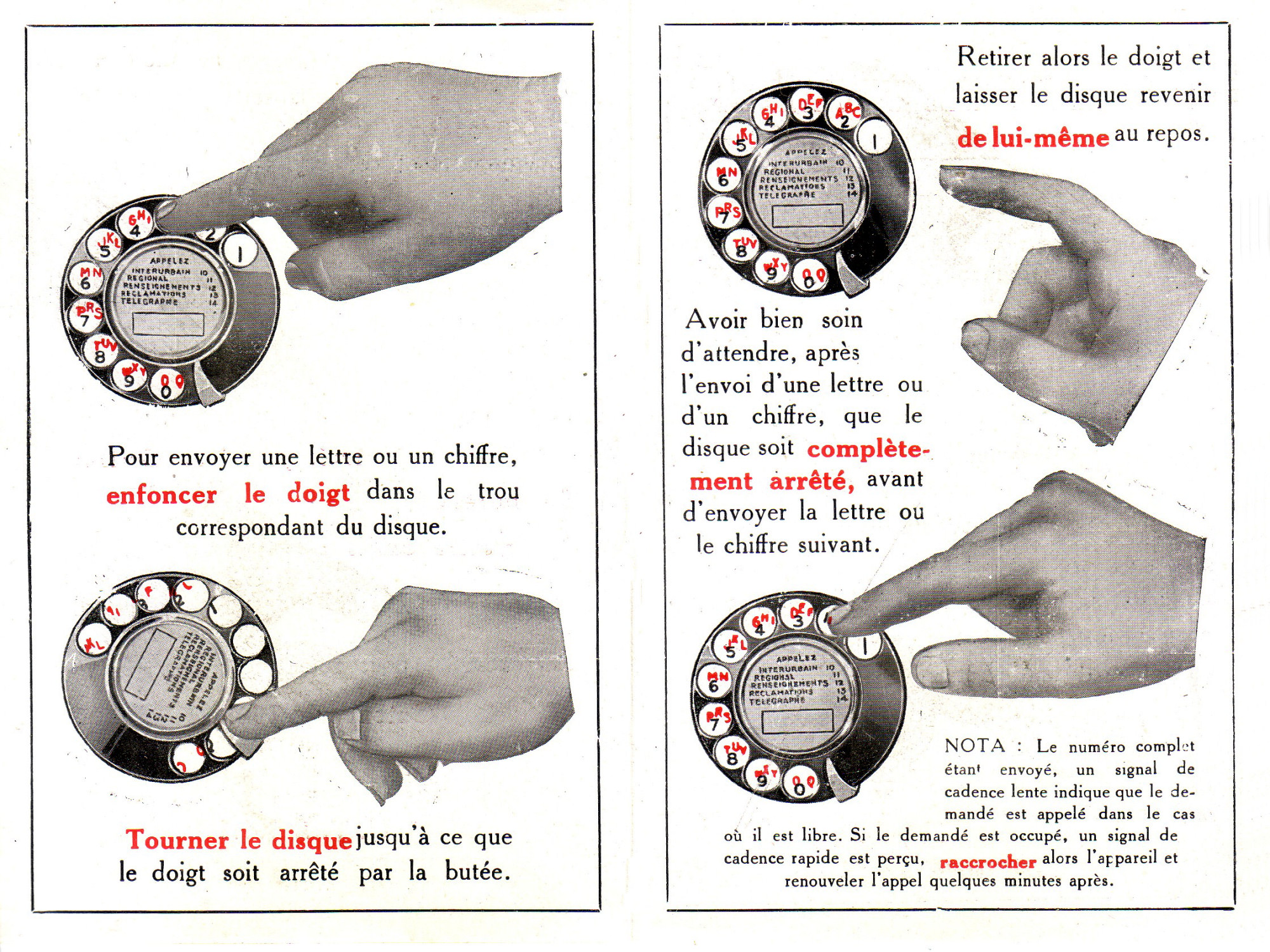
Les postes à BCI 1924 ont été étudiés
spécialement pour avoir de bonne qualité de transmission
et de réception et pour être facilement transformables pour
les réseaux automatiques par la simple adjonction d'un cadran d'appel.
La bobine d'induction produit un renforcement de la transmission. Ainsi
les signaux émis sont ils d'une valeur très supérieure
aux courants parasites et bruits de ligne. Dès lors, même
si le poste récepteur est d'un rendement moyen en réception,
la qualité d'écoute est bonne. Le micro est cette capsule
interchangeable perfectionnée par M.Marzin, Ingénieur des
PTT.
 Schéma PTT 24
Schéma PTT 24 Capsule
micro
Capsule
micro
|
Le modèle de cadran 7010B est issu directement du concours ouvert par l'Administration des PTT le 1er mai 1922 à tous les constructeurs téléphoniques français, pour équiper la gamme de postes téléphoniques de type PTT 1924 déployés dans le réseau téléphonique.
|
 |
Le 15 octobre 1925, l’État ouvre un
concours en vue de choisir le futur type de disque d'appel (cadran) qui
sera retenu par l'administration.
sommaire
En 1926 Une
nouvelle fois, ce fut l'évolution technologique qui troubla le
modèle établi. Au lendemain de la Première Guerre
mondiale, une innovation technologique venue des États-Unis
–les lignes grandes distances que l'on pouvait enterrer – permit
le développement des liaisons téléphoniques interurbaines.
La première à voir le jour en France fut la ligne reliant
Paris à Strasbourg en 1926.
Par le décret du 7 octobre 1926 (BO P&T 1926
n° 28 page 728), la Direction des Lignes Souterraines à Grande
Distance absorbe les services techniques de Paris Extra-muros, y compris
ceux de la zone suburbaine.
Il est créé en métropole 17
Directions Régionales. À leur tête, un Directeur
Régional est chargé dans sa région de diriger l'ensemble
des services postaux, télégraphiques et téléphoniques.
Nota : au 31 décembre 1927, les personnels
des PTT affectés exclusivement au service téléphonique
représentent 18.092 agents, dont 8.981 uniquement pour Paris et
la Région Parisienne, soit 49,6 %, ce qui donne une indication
sur le poids relatif de Paris sur le reste du territoire.
Nota : au 31 décembre 1928, les personnels
des PTT affectés exclusivement au service téléphonique
représentent 20.367 agents, dont 10.455 uniquement pour Paris et
la Région Parisienne, soit 51,3 %, ce qui donne une indication
sur le poids relatif de Paris sur le reste du territoire.
En
1926 il est décidé que le système
R6, sera implanté dans les villes moyennes de province dès
le 14 avril 1928 en commençant par Troyes,
L’arrivée d’ITT est marquée par le rachat des
Téléphones Thomson-Houston, le 14 avril 1926 et quelques
années plus tôt de la maison française Aboilard.
1er avril 1926
Le premier Commutateur Strowger à
étage de présélection double est mis en service
au Havre
Au cours de la seconde guerre mondiale, le Commutateur du Havre est
incendié volontairement le 9 juin 1940.
En ce qui concerne la région parisienne
les choses sont plus complexes. On peut alors distinguer trois niveaux
3 correspondant à une hiérarchie spatiale et tarifaire :
- la banlieue immédiate "déterminée
assez exactement par la zone bénéficiant de la taxe suburbaine
dans ses relations avec Paris" (liste de réseaux fixés
par arrêté ministériel) [zone A].
- la "grande banlieue" qui correspond
à peu près à la zone d'action du central parisien
à trafic direct dit "central régional" [zone B].
- la zone C, la plus éloignée de Paris,
dont les centraux fonctionnent dans les mêmes conditions que les
centraux de province.
La banlieue immédiate [zone A] formée d'une couronne comprenant les communes limitrophes de Paris est appelée "zone suburbaine" ou parfois zone à taxe double car à partir de 1926 les communications échangées, par la voie manuelle, entre Paris et cette zone sont taxées pour deux unités. Dès les premières prévisions, la mise en automatique de la zone suburbaine est liée à celle de la zone urbaine et intégrée dans le même programme d'ensemble. Jusqu'en 1926 les abonnés de banlieue sont reliés au bureau de poste de leur commune, ce qui donne lieu à des réseaux téléphoniques d'importance très inégale, dotés d’un outillage varié et le plus souvent très désuet. L'exploitation en est très difficile et de qualité médiocre. C'est une poussière de réseaux..
Une première opération consiste à
supprimer cet émiettement en groupant les lignes des abonnés
de plusieurs communes dans un central manuel important dont le nom, sans
être celui d'une commune, doit rappeler autant que possible la situation
géographique des abonnés. Il faut aussi, en prévision
de la mise en automatique, que les trois premières lettres de l'indicatif
du central de banlieue correspondent à un nombre à trois
chiffres ne faisant pas double emploi entre eux ni avec tous ceux présents
ou futurs du réseau urbain . Quatre centres de transit (Vaugirard,
Diderot, Carnot, Nord) sont alors créés dans Paris. Pour
éviter le maintien d'opératrices dans les centraux automatiques
suburbains, les communications interurbaines des abonnés de ces
centraux doivent être écoulées par une chaîne
de sélection directe à partir de positions spéciales
à clavier du centre interurbain de la rue des Archives. Cette méthode
qui supprime les "groupes intermédiaires" est par la
suite étendue à tous les centraux de la zone urbaine. La
mise en oeuvre de cette organisation nécessite en banlieue des
opérations importantes d'achats de terrains, de constructions de
bâtiments, de remaniements profonds du réseau des lignes.
Les premiers autocommutateurs suburbains sont mis
en service dans le courant de l'année 1933 :
-"Alésia" équipé
pour 6 000 lignes qui dessert les communes de Montrouge, Malakoff, Gentilly,
Châtillon, Bagneux, Arcueil ;
-"Michelet" équipé pour
4 000 lignes qui dessert Clamart, Vanves, Issy-les-Moulineaux ;
-"Entrepôt" équipé
pour 4 000 lignes desservant Charenton, Alfortville, Maisons-Alfort, Saint-Maurice.
Le programme prévu en 1932 aurait dû ainsi conduire à
l'ouverture jusqu'en 1937 de 21 autocommutateurs suburbains ayant une
capacité totale de 83 000 lignes d'abonnés, mais ce programme
ne fut pas complètement réalisé : à la fin
de l'année 1937 les autocommutateurs suburbains atteignent à
peine la capacité totale de 50 000 lignes. Fin 1939, 14 autocommutateurs
seulement sur les 21 prévus se trouvent réalisés.
Certains autocommutateurs suburbains prévus dès 1932 ne
sont même réalisés que plusieurs années après
la guerre, par exemple celui de "Villette" qui, pour desservir
les localités de Romainville et Noisy-le-Sec, n'est ouvert qu'en
1954 au lieu de 1937, soit avec un retard de 17 ans sur les prévisions
initiales des besoins de l'admi¬ nistration : à partir de 1934,
en effet, des réductions de crédits budgétaires ralentissent
les cadences d'équipement.
En
1927 pour
les numéros parisiens notamment, on prévoit de doter
les appareils d’un nouveau
cadran associant des lettres aux chiffres permettant de composer
les numéros alphanumériques.
 (la notice) Ce modèle
de cadran équipera tous les nouveaux téléphones à
cadran à partir de cette date.
(la notice) Ce modèle
de cadran équipera tous les nouveaux téléphones à
cadran à partir de cette date.
1927
Construction d’une station d’émission à ondes
courtes à Pontoise
A PARIS la disparition totale de l'ancien réseau de gros
câble en égoût est programmée ainsi que le transfert
des sous-répartiteurs, trop vulnérables aux crues et aux
orages, dans des immeubles mieux protégés.
1927 Modèle de Tableaux d'abonnés pour réseaux
à Batterie Centrale ou automatique, à une ligne réseau
et 2 postes supplémentaires. Ce tableau est du type à
leviers et à secret.

 Modèle deTableau e 1927
Modèle deTableau e 1927
En
1927 le ROTARY 7A1
une variante du 7A est mise en service pour la première fois dans
le monde en France, à Nantes, fabriquée en France
par la société Le Matériel Téléphonique
(L.M.T) le samedi 29 octobre 1927, capable de gérer jusqu'à
10.000 abonnés (au lieu des 20.000 lignes initialement )
Pourtant à Marseille, certains ROTARY 7A1 ont été
re dimensionnés pour recevoir jusqu'à 20.000 abonnés.
Au final la version ROTARY 7A1 est retenue pour une mise en service dans
Paris.
En
1927 à Fontainebleau le CENTRAL
AUTOMATIQUE TOUT RELAIS
C'est un autocommutateur entièrement effectuée avec
des relais, sans organe tournant : le précurseur en France
qui préfigure le Crossbar.
Ce système a été testé, en zone rurale à
Bihorel. Fabriqué par la Compagnie
Générale de Télégraphie et Téléphonie
(CGTT), puis il est mis en service en 1927 à Fontainebleau,
capable de gérer jusqu'à 1000 abonnés,
Le Système s'avèrera trop coûteux et trop complexe
à entretenir et à faire évoluer. Il sera finalement
remplacé en 1943.
 Tout
relais à Fontainebleau
Tout
relais à Fontainebleau
Le premier Pabx installé pour le bureau de poste GPO Anglais, a
été mis en service à Debenhams, Wigmore Street, Londres,
le 8 décembre 1923.
1922 La Poste, GPO, adopte le système Strowger
pour le réseau britannique, tout comme l'a fait la France à
partir 1921.
Les inventeurs de systèmes tout relais, Pabx ...
sont nombreux et il y de belles initiatives en France comme le système
L.Chauveau en 1922, bien adapté aux petites installations,
avec un cadran très original.  Lire le document de présentation
Lire le document de présentation
22 septembre 1928
: mise en service du premier central téléphonique automatique
à Paris (au central "Carnot").
A cette occasion on installe chez les abonnés reliés au
téléphone automatique un poste à cadran avec dix
ronds permettant de composer des numéros alphanumériques
qui commencent tous par les trois premières lettres du central.
Ainsi "INV" pour le central "Invalides"
A Lyon deux Commutateurs Strowger sont
installés à Lyon-Franklin (6.000 Lignes) et à
Lyon-Burdeau (7.000 lignes) puis mis en service le 11 mai 1928.
(Ils seront remplacés respectivement le 26 janvier 1952 et le 13
septembre 1969).
Le point en 1928 :
l'Administration française a établi un vaste programme de
transformation de ses installations les plus anciennes, programme qui
comporte, d'une part, le remplacement des installations manuelles usagées
des grandes villes, et, d'autre part, la substitution de petits appareils
automatiques de modèles spéciaux aux tableaux manuels en
usage dans certains bureaux de campagne.
En principe, les bureaux de moyenne importance doivent seuls demeurer
manuels, mais cette règle n'a rien d'absolu.
Services urbains.
— La première partie du programme (transformation progressive
des bureaux très importants) a déjà reçu une
réalisation partielle.
Centraux automatiques déjà
en service : |
Réseaux en cours de transformation
: Rouen : 6 000 abonnés ; Nîmes : 1800 abonnés; Epinal : 1200 abonnés ; Paris : Il y a 160000 abonnés à Paris. Les travaux de transformation dureront une douzaine d'années, et le nombre des abonnés atteindra environ 350 000 quand ils seront terminés. Neuf bureaux automatiques sont déjà commandés et en cours de construction : Carnot, 6000 abonnés (en service) ; Gobelins, 10000; Vaugirard, 8000; Diderot, 10000; Trudaine, 10000; Danton, 10000; Odéon, 6000; Anjou, 10000; Opéra, 10000. |
Le réseau de Paris devant comporter un grand nombre
de bureaux de 10 000 abonnés chacun, les numéros d'appel
comprendront trois lettres et quatre chiffres.
Enfin, on prévoit l'équipement assez prochain des réseaux
de : Nancy; Saint-Etienne; Lyon (Lalande) ; Trouville-Deauville (central
commun à ces deux villes) ; Lille-Roubaix-Tourcoing (central commun
à ces trois villes) ; Bayonne-Biarritz (central commun).
La tendance, à commander, même de très loin, des centraux
automatiques pour y chercher les abonnés demandés par l'interurbain,
est à l'ordre du jour pour l'exploitation des grands circuits interurbains.
Des appareils nouveaux transforment en signaux a fréquences harmoniques
les impulsions de manœuvre à courant continu, et les résultats
permettent d'escompter que, dans un avenir prochain, la téléphonie
interurbaine aura encore fait de grands progrès.
1930 L'automatique
rural ; L'introduction de la téléphonie automatique
dans les campagnes est moins avancée.
La téléphonie automatique fait également de rapides
progrès dans les petites localités rurales où,
fonctionnant sans arrêt jour et nuit, dimanches et fêtes,
elle constitue un immense progrès sur la téléphonie
manuelle, qui ne fonctionne que quelques heures par jour.
Cependant, le problème du service automatique rural est
essentiellement différent de celui du service urbain, puisque dans
les localités rurales, presque toutes les communications sont interurbaines,
catégorie qui ne peut, du moins à l'heure actuelle, être
convenablement traitée par les principes de l'automatique intégral.
Il semble que des systèmes spéciaux combinant à la
fois les avantages de l'automatique pour atteindre les abonnés
quand ils sont demandés, et la souplesse du manuel pour les faire
aiguiller vers l'interurbain par une opératrice et pour imputer
la taxe correspondante, doivent être réalisés.
L'Administration française a installé en 1929 deux
centres d'essai de cette nature, l'un à Mantes-Bonnières,
l'autre dans les environs d'Orléans; deux autres groupements
ont été mis en service en 1930, à Coulommiers
et à Melun.
Divers systèmes ont été expérimentés
: dans la Seine-Inférieure, à Oissel, Bihorel, Sainte-Adresse,
etc. ; dans la Seine-et-Oise, à V élizy, Saint-Cyr, Fontenay-le-Fleury,
et dans la Seine, à Rungis.
D'autres essais seront organisés prochainement sur une plus vaste
échelle et d'après une conception différente, dans
la région de Mantes et dans celle d'Orléans : il
s'agira de transformer en automatiques tous les bureaux manuels situés
dans une zone donnée, ayant pour centre un bureau important (Mantes
ou Orléans).
Cette conception de l'automatique rural mérite une mention
particulière :
Les postes d'abonnés ne recevront aucune modification. Pour obtenir
une communication, un abonné appellera d'abord la téléphoniste
du bureau centre de groupe, au moyen de la magnéto de son
poste, et sans décrocher son appareil.
Si le circuit vers le centre de groupe est libre, ou dès qu'il
le deviendra, la téléphoniste percevra l'appel, rappeilera
l'abonné et prendra sa demande.
Si la communication est demandée pour un réseau ne faisant
pas partie du groupe, elle sera établie comme actuellement par
des procédés manuels.
Si elle est destinée à un abonné d'un des réseaux
du groupe, la téléphoniste appellera automatiquement le
demandé ; les correspondants une fois mis en communication directe,
la téléphoniste aura la faculté de rester en écoute
pour surveiller l'établissement régulier de la communication.
Le raccrochage des appareils libérera tous les organes automatiques
utilisés dans la conversation.

Prenons un exemple dans le groupe de Mantes (fig ci dessus) : si
un abonné de Tilly désire une communication, son appel arrive
à travers les bureaux ruraux de Tilly, Dammartin, Septeuil, à
la téléphoniste de Mantes, si les trois tronçons
du circuit Tilly-Mantes sont libres, ou sinon, dès qu'ils le deviennent.
Dès réception de ce signal, qui consiste dans l'allumage
d'une lampe, la téléphoniste sonne l'abonné. Il décroche
et formule sa demande : s'il demande un abonné d'un réseau
automatique du groupe, tel que Saint-Illiers-la-Ville, par exemple, la
téléphoniste, au moyen de son cadran d'appel, sélectionne
le circuit ou les tronçons de circuit à utiliser pour atteindre
le bureau rural demandé, puis choisit, dans ce bureau, la ligne
de l'abonné désiré.
Dès que celui-ci décroche son appareil, il se trouve en
communication avec le demandeur.
La téléphoniste, en se retirant après s'être
assurée que la conversation est engagée, libère les
portions de circuit qui ne sont pas comprises entre les deux correspondants.
A l'issue de la conversation, les deux interlocuteurs raccrochent et envoient
le signal de fin par quelques tours de magnéto, ce qui ramène
instantanément au repos les organes automatiques ayant servi à
établir la liaison.
De son côté, la téléphoniste, avertie, le cas
échéant, de la fin de la conversation par l'allumage d'une
lampe, libère les organes manuels utilisés. Par mesure de
précaution contre les négligences éventuelles des
abonnés, un dispositif coupe automatiquement les communications
et libère les organes et les circuits six minutes après
l'établissement de la communication.
Les automatiques ruraux de ce type ont été étudiés
pour fonctionner correctement avec les lignes souvent très défectueuses
des abonnés ruraux, et avec un minimum d'entretien. Ils sont alimentés
en courant continu par de petites batteries d'accumulateurs chargées,
soit à distance, à travers les circuits venant du bureau
manuel centre de groupe, soit par le secteur de la localité, à
l'aide de redresseurs appropriés.
Les automatiques ruraux offrent des avantages pour l'Administration, en
libérant les receveuses des petits bureaux du souci d'assurer le
service téléphonique, mais c'est surtout pour les populations
des campagnes qu'ils sont intéressants : aux avantages généraux
attachés à la téléphonie automatique, ils
joignent celui de procurer aux usagers un service aussi prolongé
que celui des villes.
L'économie réalisée sur l'exploitation et la possibilité
de concentrer le service de plusieurs réseaux en un point unique,
permettent même de doter ces réseaux ruraux d'un service
permanent : c'est la possibilité d'appeler, à toute heure
de jour et de nuit, même les dimanches et jours fériés,
le médecin, le vétérinaire, la gendarmerie, etc.
Il faudra attendre le décret du 19 juillet 1935 relatif
à l'établissement du téléphone
automatique-rural pour avoir une stratégie nationale de
développement à base de matériel R6.
A savoir qu'en France, le nombre total des centraux en 1935 était de 26 850, dont 17 486, soit 62,5 %, étaient de petits centraux comptant de 1 à 10 abonnés. Le nombre de téléphones publics était de 3 229.
sommaire
LA TÉLÉPHONIE AUTOMATIQUE PRIVÉE.
— En même temps qu'elle s'introduisait dans les bureaux publics,
la téléphonie automatique pénétrait dans les
installations privées.
Dans ce domaine, ses progrès furent beaucoup plus rapides et on
vit bientôt apparaître une grande variété d'appareils
répondant aux besoins les plus divers.
Les réseaux automatiques privés.
— Les premières installations automatiques construites
pour le service particulier des abonnés furent purement privées,
c'est à dire sans possibilité de communiquer avec les postes
du réseau public. Cette solution n'était pas entièrement
satisfaisante, car elle obligeait les usagers à avoir une double
installation.
Aussi, l'Administration ayant admis les installations mixtes, le téléphone
automatique eut vite fait de trouver son application dans cette catégorie,
qui comporte à la fois des postes supplémentaires (c'est-à-dire
pouvant communiquer avec le réseau public) et des postes privés.
Les premiers communiquent entre eux, avec le réseau public et avec
les postes privés de l'installation; les seconds communiquent entre
eux et avec les postes supplémentaires, mais non avec le réseau
public.
L'automatique pénétra d'abord dans ces installations sous
la forme « semi-automatique ».
Installations mixtes semi-automatiques.
— Elles sont ainsi appelées parce qu'elles permettent l'établissement
automatique partiel ou intégral de certaines communications avec
le réseau privé et le réseau public, sans l'intervention
d'une téléphoniste privée.
Ces installations, qui sont très répandues et le seraient
encore bien davantage si elles étaient mieux connues du public,
sont de types très divers.
Dans les unes, la téléphoniste privée intervient
pour l'établissement de toutes les communications avec le réseau
(départ et arrivée), et l'organe servant à réaliser
ces communications est un tableau avec jacks, fiches, clés, boutons,
lampes ou voyants, analogue aux tableaux des installations purement manuelles.
Dans d'autres, la téléphoniste établit les communications
avec le réseau, au moyen d'organes appartenant en propre aux systèmes
automatiques : boutons à enclenchement, cadrans d'appel, etc.
Dans un troisième type, plus perfectionné encore, l'opératrice
n'intervient que pour établir ou signaler les communications en
provenance du réseau public ; les postes supplémentaires
peuvent se connecter automatiquement et directement au réseau et
l'appeler de même, sans avoir recours à la téléphoniste
privée (ce recours restant toutefois possible si le besoin s'en
fait sentir).
Ces dernières installations, qui sont dites « à prise
directe du réseau », permettent également aux postes
supplémentaires d'envoyer à la téléphoniste
du bureau public le signal de « fin de conversation » et de
se déconnecter eux-mêmes à l'issue de la conversation.
Comme certaines maisons à fort trafic téléphonique
(banques, journaux, grandes industries ou maisons de commerce) dépensent
par jour plusieurs milliers de francs de communications interurbaines
et internationales, et comme les retards apportés par leurs téléphonistes
particulières à envoyer au bureau public les signaux de
fin de conversation ont pour conséquence, non seulement d'immobiliser
inutilement leurs lignes, mais encore et surtout de faire porter au compte
de ces abonnés des unités de conversation supplémentaires,
il est très avantageux pour eux d'envoyer automatiquement au bureau
central le signal de fin, dès que les communications sont achevées.
Un autre avantage de ces installations est de simplifier les manœuvres
de la téléphoniste à un point tel que celle-ci peut
desservir aisément des installations très importantes.
 Meuble pour installation mixte semi-automatique
Meuble pour installation mixte semi-automatique
Installations mixtes purement automatiques.
— Si le réseau public est manuel, on est bien obligé
de conserver une opératrice au moins, pour l'établissement
des communications d'arrivée.
Mais, si le réseau public est lui-même automatique, des autocommutateurs
privés spéciaux permettent :
1° Aux postes intérieurs (supplémentaires et privés)
de communiquer automatiquement ;
2° Aux postes supplémentaires de se mettre automatiquement
en communication avec un poste quelconque du réseau public ;
3° A un abonné quelconque du réseau public de se mettre
lui même automatiquement en communication avec l'un des postes supplémentaires
de l'installation.
Installations automatiques d'immeubles
| - Cette dernière faculté
(automaticité des communications d'arrivée) trouve aussi
son application dans les installations d'immeubles, mises par les
propriétaires à la disposition des locataires et desservies
par les concierges. On sait que le service de ces postes d'immeubles, très répandus à Paris, laisse beaucoup à désirer. Avec les nouveaux appareils, le locataire peut se mettre automatiquement en relation avec un abonné quelconque du réseau public et, réciproquement, si l'on a attribué à son poste un numéro particulier s'ajoutant au numéro d'appel de l'immeuble, un abonné du réseau peut se mettre automatiquement en relation avec lui. Mais on se trouve ici en présence d'une difficulté. Il existe plusieurs systèmes de téléphonie automatique pouvant être utilisés dans les bureaux publics, et ces systèmes peuvent être rangés en deux grandes catégories : les systèmes « à sélection directe », encore appelés « à commande en avant » ou « pas à pas », et les systèmes « à sélection indirecte » ou « à commande en arrière » Jusqu'à présent, les autocommutateurs privés dont nous venons de parler, et qui permettent l'appel automatique des postes supplémentaires par le réseau, ne peuvent fonctionner que dans les réseaux dotés de systèmes à sélection directe. |
 Installation automatique pour immeuble,
Installation automatique pour immeuble, desservant dix postes |
Toutefois, il ne semble pas impossible de surmonter cette difficulté.
Comme on le voit, la téléphonie automatique tend aujourd'hui à se substituer complètement à la téléphonie manuelle, aussi bien dans le domaine public que dans le domaine privé, et c'est dans ses applications à la téléphonie privée que l'automatisme est arrivé au plus haut degré de perfectionnement, parce qu'ici, une plus grande latitude a été laissée dès le début à l'initiative des constructeurs.
Jusqu'à ces temps derniers, la téléphonie automatique n'eût pas été possible, en France, sur les grands circuits interurbains, parce qu'ils étaient en général en mauvais état.
|
Mais l'Administration a entrepris la construction de câbles souterrains à grande distance, renfermant un nombre considérable de conducteurs bien isolés, et pourvus de distance en distance de relais amplificateurs. Elle a déjà mis en service les câbles
suivants : Elle construit actuellement deux autres grands câbles
: |
 |
Vers 1910, il semblait donc que l'essor de la téléphonie
interurbaine fût limité par des conditions physiques insurmontables.
Cependant, les savants se préoccupèrent, dès que
la merveilleuse invention de la lampe triode permit d'amplifier à
volonté les courants alternatifs, d'adapter cette lampe: au fonctionnement
d'amplificateurs téléphoniques pouvant fonctionner indifféremment
dans les deux sens.
Le problème était pratiquement résolu vers 1916 et,
dès la fin de la grande guerre, la téléphonie interurbaine
prit un nouvel essor.
Contrairement à ce que le public aurait pu supposer, les amplificateurs
téléphoniques furent placés, non sur des lignes aériennes
en fil nu, mais sur des câbles souterrains.
Les difficultés de la propagation électrique sur les câbles
souterrains rendaient nécessaire un espacement beaucoup moindre
des stations d'amplificateurs (tous les 150 km environ), mais la stabilité
des constantes de propagation sur les câbles souterrains permettait
de réaliser, en matière de téléphonie interurbaine,
un dosage systématique de la puissance électrique en jeu
en. chaque point du parcours.
Un « Comité consultatif international des communications
téléphoniques » fut créé vers 1920,
pour définir tout ce qui concerne la constitution des câbles
téléphoniques sousterrains, les graphiques de niveaux électriques
sur une transmission donnée, les essais (très nombreux et
délicats) pour vérifier la qualité des lignes interurbaines,
et enfin les règles d'exploitation.
Parmi les détails d'installation techniques, il fallait combattre
les tendances des câbles souterrains à rendre la voie désagréablement
caverneuse.
Le procédé de la « pupinisation », déjà
signalé plus haut, a satisfait ce desideratum. La pupinisation
consiste à mettre en série, environ tous les 4 km, sur chaque
fil souterrain, une bobine de self-induction additionnelle dont l'appoint
donne rigoureusement aux circuits téléphoniques considérés
un affaiblissement à la propagation électrique qui soit
le même pour toutes les fréquences utiles en téléphonie
(400 à 2 000 p/s).
Cependant, en appliquant cette règle théorique, on obtiendrait
des fréquences de coupure qui se placeraient mal dans la gamme
des fréquences utiles et, tant pour obvier à cet inconvénient
que pour diminuer le prix de revient des câbles téléphoniques
souterrains, les quantités de self additionnelles sont un peu inférieures
à ce que donnerait l'application de la règle théorique.
Pour téléphoner à de très grandes distances,
on a également eu à vaincre les phénomènes
d'échos électriques, et les phénomènes d'empiétement
des sons les uns sur les autres.
Tout le travail scientifique qui a été accompli dans cette
branche de la technique moderne est un des plus beaux qui puissent être
cités dans l'histoire des sciences appliquées .
A l'heure actuelle, les communications téléphoniques internationales
ne sont plus limitées par aucune condition de distance, sinon par
les dépenses énormes que représente l'établissement
des câbles souterrains.
La qualité des conversations téléphoniques, sur des
distances qui dépassent parfois 10 000 km, est souvent supérieure
à celle d'une conversation urbaine à Paris. Il n'y a rien
qui doive étonner dans cette remarque que, malheureusement, des
gens non avertis prennent parfois pour un critérium de la mauvaise
qualité du service téléphonique à Paris.
Nous avons dit, en effet, que le jeu des amplificateurs téléphoniques
échelonnés sur les grandes artères internationales
permet de remonter successivement, en des points définis du parcours,
le niveau électrique de la transmission à une valeur rigoureusement
égale à celle qu'il avait au départ. Le prix extrêmement
élevé de l'appareillage qui permet ce résultat limite
pour le moment son usage à la téléphonie interurbaine,
dans laquelle l'unité de conversation est payée très
cher; il est évidemment inapplicable à la téléphonie
urbaine, qui vise d'abord à livrer l'unité de conversation
au meilleur marché possible.
Cependant, même en matière de téléphonie urbaine,
l'étude des niveaux de transmission n'est pas perdue de vue, et
si les dimensions des agglomérations urbaines de quelques grandes
villes posent des problèmes très difficiles à cet
égard, l'effort des techniciens pour les résoudre se poursuit
avec énergie.
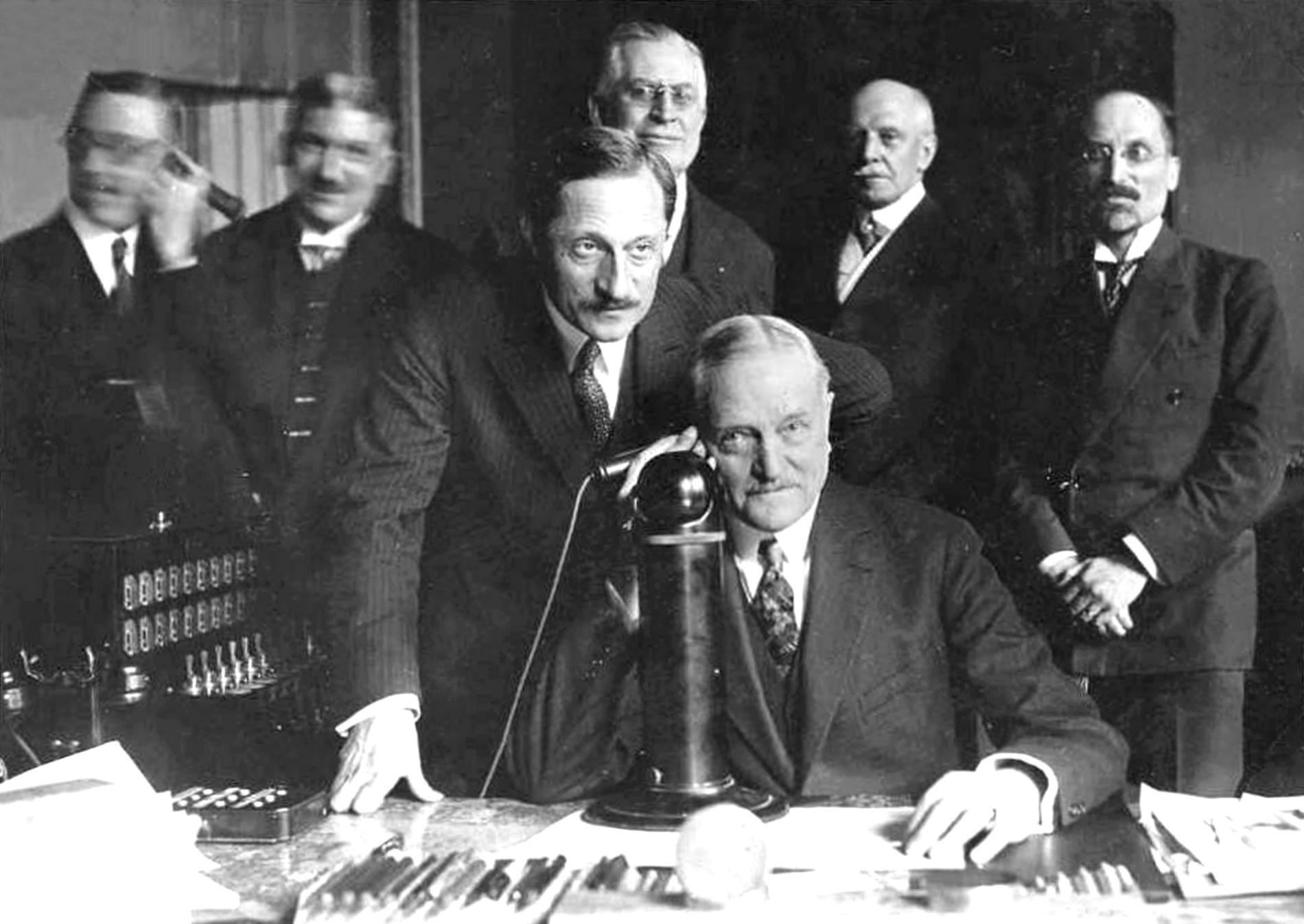 Au téléphone : le Général John Pershing. Debout:
le Ministre des P & T - Maurice Bokanowski. Debout à droite :
M. Henri Milon.
Au téléphone : le Général John Pershing. Debout:
le Ministre des P & T - Maurice Bokanowski. Debout à droite :
M. Henri Milon.Vu dans le Figaro :
Tout se passa fort bien, et l'inauguration officielle fut en tout point réussie. L'inauguration «privée» fut moins triomphale. Néanmoins la majorité des 36 candidats inscrits pour la journée ont obtenu leur communication. M. Schreiber, président de l'Association Nationale des Abonnés, ayant formulé sa demande vers les neuf heures du matin, avait ensuite convié la presse à venir écouter avec lui la voix transocéanique de M. Hahn, représentant des abonnés new-yorkais. La communication était prévue pour huit heures, mais si les écouteurs sortirent de leur mutisme, sur le coup de dix heures et demie, ce ne fut que pour annoncer que les transmissions ne dépasseraient plus Londres, par suite d'une circonstance inconnue.
Cet inévitable flottement des premiers jours n'empêche pas qu'on puisse envisager déjà l'époque où il deviendra courant d'appeler «Visconsin» (sic), «Ashland» ou «Brooklyn», comme on appelle Passy, Ségur ou Élysées.
Le tarif, un tantinet prohibitif, retardera néanmoins l'avènement de cette ère.Tout le monde ne peut pas, évidemment, imiter ce jeune amoureux londonien qui paya 70.000 francs au début de la semaine dernière, la joie d'entendre sa fiancée lui parler tendrement de New York, durant un quart d'heure. Preuve d'amour…ou preuve de richesse?
Le public peut, dès le jour même, bénéficier de la ligne téléphonique transatlantique: vingt appels sont demandés de France pour l'Amérique et seize des États-Unis. La communication est facturée 1.218 francs les trois minutes mais, si elle n'est pas établie, l'usager «a le droit -l'espoir- de l'avoir le lendemain, à la même heure» rapporte Le Gaulois dans son édition du 29 mars. Le journal indique une autre information utile et précieuse à ses lecteurs: «Si votre correspondant est absent on paye 150 francs de... Au fait de quoi ? D'amende ?» Et poursuit: «Pourtant ce n'est pas la faute de l'abonné français si l'autre abonné, celui de New York, est en promenade...»
Le Matin, le 29 mars 1928, rappelle quant à lui, «qu'en pratique l'abonné parisien demande la communication à son central, qui le branche avec l'Inter. L'Inter demande Londres, qui, lui, branche la communication avec le poste émetteur de T.S.F. de Rugby. Les ondes sont captées par le poste de Houlton, aux États-Unis, d'où les paroles s'en vont par fil ordinaire à leur destinataire.» Un cheminement qui explique les difficultés rencontrées par certains particuliers comme le raconte le journaliste du Figaro.
Statistique du téléphone.
- Au 1er janvier 1929, on estimait que le nombre d'appareils téléphoniques installés dans le monde entier était d'environ 33 millions.
Sur ce total, l'Amérique du Nord entrait pour 20 millions, l'Europe pour 9 millions, l'Asie pour 1 million, l'Océanie pour 700000, l'Amérique du Sud pour 500 000, et l'Afrique pour 200 000.
En Europe, la France arrive au troisième rang avec 975000 appareils téléphoniques, dépassée seulement par la Grande-Bretagne avec 1750 000, et l'Allemagne avec 2900000.
Parmi les grandes villes ayant le plus d'abonnés au téléphone, il faut d'abord citer New-York qui compte 1700000 abonnés, ensuite Chicago avec 942000 abonnés, Londres'avec 626000, Berlin avec 472 000, Paris avec 350000.
On compte une centaine de villes ayant chacune plus de 100000 abonnés.
Le nombre annuel de conversations téléphoniques se chiffre par milliards : aux Etats-Unis, il faut compter environ 27 milliards de communications, au Japon presque 3 milliards, en Allemagne et au Canada 2,5 milliards, en Grande-Bretagne 1,4 milliard, en France 750 millions.
Il est particulièrement intéressant de noter ici quelques chiffres sur le développement du réseau téléphonique de Paris.
Au 1er janvier 1929, le nombre des abonnés était quadruple de ce qu'il était au 1er janvier 1909, et double de ce qu'il était au 1er janvier 1919.
Le trafic urbain de Paris se chiffre par 1200000 conversations quotidiennes, et le trafic interurbain atteint jusqu'à 130000 unités de conversation par jour.
Côté transmissions ;
Au fur et à mesure du déploiement du réseau téléphonique
interurbain et transfrontalier, il est apparu de plus en plus compliqué
et coûteux de maintenir le principe "une paire téléphonique
pour une communication téléphonique".
En 1918, aux USA, est inventé le procédé de Multiplexage
Analogique par onde porteuse. Désormais sur une liaison
de transmission il est possible de transmettre deux conversations téléphoniques
simultanément, sans qu'elles se mélangent, grâce à
la Répartition en Fréquences.
En France en 1931, l'ingénieur français
Pierre Marzin, conçoit un procédé de Multiplexage
Analogique par onde porteuse que l'on dénommera Système
Marzin pouvant transmettre 2 voies téléphoniques simultanément.
Puis, les progrès furent continus, on parvint à faire passer
ultérieurement 3 puis 6 conversations téléphoniques
simultanées sur la même liaison métallique de deux
fils à partir de 1942 et plus encore par la suite...
Il fut inventé également le principe du circuit fantôme
qui consista, avec deux liaisons, à créer une troisième
voie, la voie fantôme : c'est à dire qu'avec deux liaisons
métalliques de transmissions, nous pouvions désormais transmettre
1 voie téléphonique supplémentaire portée
entre les deux liaisons métalliques, ce qui permettait d'augmenter
sensiblement le nombre de voies de transmissions avec le même nombre
de liaisons métalliques installées...
Le premier système à courants porteurs à 3 voies
téléphoniques modulées est mis en service entre Londres
et Madrid (avec stations intermédiaires à Versailles, Saumur,
Saintes, Bordeaux, Saint-Sébastien et Saragosse) le 8 juin 1928.
En France, les 2 premiers systèmes à courants porteurs à
3 voies sont mis en service (par LMT) pour les communications interurbaines
:
- le le 5 août 1929 entre Dijon et Annemasse,
- le 5 octobre 1929 entre Marseille et Nice.
Revenons aux commutateurs
1930 Comme nous venons de le voir
la stratégie fixée par l'administration Rotary, R6
, Strowger, est enfin en marche.
Pour le téléphone automatique rural rien n'est encore bien
défini, la demande s'accroit, le retard pèse.
L'heure est venue pour les politiques de débattre devant le Sénat
pour faire le point, exposer la situation ....
Le débat parlementaire du 3 juillet
1930 , présidé par Paul Doumer est très intéressant
pour bien analyser la situation, de notre France et des autres pays en
matière de déploiement du téléphone, des doutes,
des choix, des décisions ... (C'est
long mais intéressant )
En 1931, en raison
du déploiement en cours du téléphone automatique
intégral à Paris, le décret du 6 août 1931
(BO PTT n°19 page 656) réorganise administrativement les services
techniques et téléphoniques dans la région de Paris.
Désormais la zone suburbaine de Paris (les
communes frontalières à la Ville de Paris ainsi que les
communes qui leur sont mitoyennes formant la 1ère couronne) est
placée sous le contrôle de la Direction des Services Téléphoniques
de Paris (Intra-muros).
Décret complété par arrêté
du 26 octobre 1931 (BO P&T 1931 n°27 page 913).
En 1932, l'arrêté
du 22 juillet 1932 (BO PTT 1932 n°16 page 627) fusionne le réseau
téléphonique de Paris intra-muros aux réseaux alentours
dits de la zone suburbaine de Paris des communes mitoyennes pour constituer
un réseau local unique dénommé : Réseau de
Paris.
Cette unification administrative et tarifaire suit
tout simplement la progression du maillage et de l'interconnexion des
centres téléphoniques automatiques de la zone la plus dense
de France : Paris et sa proche banlieue du département de la Seine.
(équivalant aux départements actuels des Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et Paris).
C'est aussi cette même année que le terme
Télécommunication reçoit une définition
officielle, lors de la Conférence Internationale de Madrid de 1932.
Le terme Télécommunication est inventé
en 1903 par M. Édouard Estaunié, alors Directeur de l’École
Nationale des Postes & Télégraphes, lorsqu'il publie
chez Dunod son « Traité pratique de télécommunication
électrique, télégraphie, téléphonie
».
Il s'agit donc de préciser que le mot Télécommunication
est un mot initialement français, inventé en premier en
français et qu'il a été par la suite décliné
dans toutes les autres langues du monde...
Les voyelles é prennent donc l'accent aigu, ceci étant étymologiquement
bien conforme à notre langue française (n'en déplaise
à ceux qui préfèrent baragouiner en globish. Sous-ensemble
de l'anglais réduit à 1 500 mots conservant orthographe
et prononciation classiques et destiné aux francophones)
Télécommunication : toute communication
télégraphique ou téléphonique de signes, de
signaux, d'écrits et de sons de toute nature, par fil ou par radio
ou autres systèmes ou procédés de signalisation électriques
ou visuels (sémaphores).
12 novembre 1932 Lille est mis en automatique R6.
Après l’avènement et le développement
des télécommunications par fil au cours de la seconde moitié
du 19 ème siècle, l’apparition de la radiotélégraphie,
puis l’essor des radiocommunications, constituent l’un des faits
marquants du début du 20 ème siècle.
Là aussi, le développement de la coopération internationale
a été remarquable en temps de paix ; mais les radiocommunications
ont été, en outre, un moyen essentiel de télécommunication
en temps de guerre. Comme en télégraphie, la coopération
et la réglementation internationale en matière de radiocommunications
se révélèrent rapidement nécessaires, d’autant
plus qu’en radiotélégraphie se posait la question du
brouillage entre émissions radioélectriques. Ces brouillages
étaient le plus souvent involontaires. La conférence radiotélégraphique
internationale qui se réunit à Washington en 1927 permis
d’entériner la Convention radiotélégraphique
internationale, où était indiqués les droits et les
devoirs de chaque pays en matière de télécommunications
(fréquence, puissance des émetteurs, localisation des antennes,
etc.).
Avant 1932, il existait deux entités juridiques différentes
en matière de télécommunication, la Conférence
internationale télégraphique et la Conférence internationale
radiotélégraphique. En 1932, ces deux conférences
fusionnèrent pour constituer l’Union Internationale des Télécommunications,
l’IUT37 , qui existe encore de nos jours.
Trois progrès scientifiques importants avaient été
réalisés en 30 ans de recherche dans le domaine des radiocommunications
: le plus important était la diffusion, et non plus seulement la
transmission d’un point à un autre, de messages par radio
; les deux autres étaient le développement des liaisons
avec les avions en vol et l’extension du spectre des fréquences
aux ondes courtes (fréquences supérieures à 3 mégahertz).
Le développement de la radiodiffusion sonore
en France
On ne peut parler des inventions du début du 20 ème siècle,
qui a vu le développement de la télégraphie militaire,
de la TSF, puis de la radiodiffusion sonore, sans évoquer le général
Gustave Ferrié qui porta le télégraphe militaire
français au premier rang dans le monde et qui contribua pour une
large part au développement de la Radio en France. Même après
la fin de la guerre, il chercha à maintenir et à élargir
les liens qui s’étaient noués entre
les équipes de radioélectriciens au cours des années
précédentes.
Les grands problèmes de la propagation des ondes radio nécessitaient,
en outre, la création d’organisations étendant leur
action sur le monde entier. C’est pourquoi le général
Ferrié créa l’Union de Radiotélégraphie
Scientifique Internationale (URSI).
On ne peut évoquer l’œuvre du général Ferrié
sans souligner aussi l’importance prise par le poste de TSF de la
Tour Eiffel. En décembre 1903, M. Eiffel avait proposé de
mettre la tour à la disposition du Génie militaire comme
support d’antenne. Le poste de la tour Eiffel, à l’origine
pauvrement équipé, fut alors transformé en station
permanente de grande puissance ; il deviendra le porte-drapeau de la TSF
française pendant 30 ans. Après la guerre, le général
Ferrié installa, en février 1922, un studio provisoire dans
le pilier Nord de la tour ; c’est ainsi que débutèrent
les premières émissions régulières de radiodiffusion
en France.
Au plan de la technique, la Première Guerre mondiale avait provoqué
un développement industriel extraordinaire des « lampes de
TSF » et des équipements de radiotélégraphie.
Des sommes importantes et une énergie considérable avaient
été dépensées pendant la guerre pour la TSF.
Après l’armistice, tous les éléments étaient
en place pour l’avènement de la radiodiffusion. En Grande-Bretagne,
la BBC commença en novembre 1922 à émettre des programmes
quotidiens à partir de sa station de Londres ; en France, après
quelques premières expériences faites en 1921, c’est
aussi en 1922 que commencèrent les premières émissions
régulières de la tour Eiffel. Le nombre de stations de radiodiffusion
devait croître ensuite très
rapidement : en 1927, on comptait déjà plus de 700 stations
de radiodiffusion sur le seul
territoire des Etats-Unis .
14 février 1933
: mise en service de l'horloge parlante (ODEon 84.00), installée
à l’Observatoire de Paris, par son directeur Ernest Esclangon.
Cette horloge dispose de 20 lignes groupées ; malgré leur
nombre, important pour l’époque, seuls 20 000 appels sont
traités sur les 40 000 présentés le premier jour.
La voix qui donne l’heure est celle de Marcel Laporte, dit Radiolo,
le plus célèbre speaker de Radio-Paris.
En 1934, un décret
de suppressions d'emploi est signé le 17 avril 1934 (BO PTT n°14
page 282).
D'autres décrets de cet ordre se succéderont cette année-là.
Il y aura même la réduction voire la
suppression avec effet rétroactif au 1er août 1933 de multiples
indemnités dues à certaines catégories d'agents des
PTT (décrets du 6 mars 1934 BO PTT n°10 pages 202 à
209).
D'autres décrets suivront en Décembre 1934 (BO PTT 1935
n°3).
L'année 1934 verra aussi la réduction
massive de commandes de matériels neufs.
Il s'agit du contrechoc dû à la crise de
1929 née (comme à l'accoutumée) aux USA qui a
fini par retomber sur l'Europe.
La réduction des crédits intervenue à partir de 1934
restera comme une très dure épreuve dans les PTT et un sérieux
coup d'arrêt dans le développement du réseau téléphonique
français ainsi que dans son automatisation qui ne pourra être
achevée que 45 ans plus tard en 1979.
Le temps perdu dans le non-déploiement des commutateurs automatiques
rotatifs ne sera plus jamais rattrapé avant le début de
la seconde guerre mondiale en 1939 ; les caisses sont vides et l'État
est exsangue.
Au 1" janvier 1935, le nombre des réseaux
automatiques ruraux déjà en service dans les régions
de Paris, Rouen et Rennes principalement, s'élevait à
2.086 et le nombre des abonnés ruraux à 21.064.
Le développement de la commutation automatique
en milieu rural
Le troisième plan de l’équipement téléphonique
français concernait les zones à faible densité de
population, les zones rurales. Quelles solutions convenait-il d’adopter,
afin de desservir au mieux ces populations rurales ?
Lorsque le téléphone prit naissance dans les campagnes françaises,
on se contenta d’installer, dans le bureau de poste de chaque commune,
un commutateur « manuel » auquel aboutissaient, sur «
annonciateurs », les lignes des abonnés locaux. Un ou plusieurs
« circuits locaux » le reliaient à un bureau de poste
plus important et il en était ainsi, de proche en proche, jusqu’à
la sous-préfecture ou jusqu’à une localité assez
importante pour être dotée d’un central téléphonique
disposant de circuits interurbains. Cette exploitation des « tableaux
manuels » par les employés de la poste était loin
de donner une grande qualité de service.
Les procédés automatiques apparurent alors assez vite en
mesure d’apporter des solutions à ce problème. Puisque
les communications locales bénéficiaient de l’automatisme,
les dépenses entraînées par la transformation des
postes d’abonnés, le remaniement ou la création des
lignes et circuits nécessaires, n’apparurent justifiées
que dans les zones à densité téléphoniques
suffisante, telles que les banlieues de grandes villes.
Restait à trouver une solution spécifique pour les campagnes
où le téléphone, comme la population, était
alors très dispersé ; sur les 25 000 réseaux locaux
existant, plus de la moitié comportaient moins de cinq abonnés.
Le projet d’équipement, qui fut proposé par l’administration
des PTT, prévoyait de remplacer les petits commutateurs manuels
des bureaux de poste ou « centres locaux » par de simples
armoires contenant chacune un « semi autocommutateur » robuste
et d’entretien facile, pour concentrer l’exploitation manuelle
dans un « centre de groupement » disposant d’un effectif
spécialisé et assurant la permanence du service. C’est
le système, appelé couramment « automatique rural
», qui fut adopté en 1935.
L’équipement des réseaux ruraux fut entrepris dans
toute la France au début de l’année 1936.
Dénommé « automatique rural », bien qu’il
soit en réalité semi-automatique, le système répondait
aux espoirs mis en lui, tant que les zones équipées restaient
vraiment rurales, c’est-à-dire à faible densité
téléphonique et desservies par des lignes aériennes
et tant que l’exploitation automatique interurbaine n’était
pas introduite au niveau du centre de groupement. Mais, à partir
du moment où un centre de groupement était doté d’un
autocommutateur établissant des communications interurbaines et
où la densité et le trafic téléphonique atteignait
un certain volume, le système rural n’était plus justifié.
Quand il devint nécessaire de passer du service semi-automatique
au service automatique intégral, il fallut donc reprendre entièrement
la constitution des réseaux ruraux et diminuer fortement le nombre
de points de commutation.
Certes, la généralisation de l’automatique rural a
rendu moins urgente l’automatisation des campagnes, mais, en revanche,
elle a retardé notablement l’automatisation intégrale
du territoire français.
En 1935, par le décret
du 19 juillet 1935 (BO PTT 1935 n°23 page 509) relatif à l'établissement
du téléphone automatique-rural et le décret
complémentaire du 30 octobre 1935 (BO PTT 1935 n°33 page 808),
le système téléphonique dit "
système automatique-rural", plus 'automatique' dans le
nom que dans la réalité, est adopté en France, il
se fera avec du matériel R6. Préféré
au système automatique ROTARY 7D au coût jugé trop
élevé (celui-ci sera en revanche déployé massivement
dans les campagnes de Grande-Bretagne et de Suisse), le
système automatique-rural permet cependant de commencer le
désenclavement de plusieurs départements ruraux laissés
pour compte depuis les débuts du téléphone.
Le téléphone automatique rural du type R. 6 doit être
installé dans les 40 départements suivants :
1° Départements à équiper en entier :
Ain. Allier. Ardèche. Ariège. Aude. Arrondissement de
Belfort. Cher. Côte-d'Or. Drôme. Haute-Garonne. Indre. Loiret.
Lot. Lot-et-Garonne. Morbihan. Nièvre. Nord. Hautes-Pyrénées.
Deux-Sèvres. Tarn.Var. Vienne. Haute-Vienne. Yonne.
2° Départements à équiper partiellement
: Aisne. Alpes-Maritimes. Aveyron. Charente. Creuse. Landes. Loire.
Lozère.
Maine-et-Loire. Marne. Meuse. Moselle. Haut-Rhin. Savoie. Seine-et-Oise.
Tarn-et-Garonne.
Ces installations se répartissent en 276 groupes et portent
sur 7.054 autocommutateurs ruraux, qui desservent 55.888 abonnés
et 9.302 cabines.
| L'histoire nous dira que le plan du système
automatique-rural adopté pour la France (décret 1935)
a en fait accru le retard d'automatisation du réseau téléphonique
français dans sa globalité, par rapport au reste de
l'Europe qui n'a pas retenu cette demi solution à coût
réduit. Le système automatique-rural a même par la suite, dans les années soixante, retardé l'automatisation totale des provinces. Par exemple, en 1968, est mis en service un centre automatique-rural à Corté, dans le département de Corse... À la décharge de M. le Ministre des PTT Georges Mandel qui fit en 1935 ce qu'il put avec les moyens du bord, la IIIème République déjà bien ébranlée dans ses fondations profondes était déjà très-essoufflée et noyée dans les scandales à répétitions qui n'allaient pas tarder à l'emporter dans le tourbillon impitoyable que l'Histoire réserve toujours aux plus faibles, aux imprévoyants et aux inconséquents. Sauf rares exceptions notables comme Mr Mandel, la classe politique, était plus préoccupée par sa survie politicienne à court terme que par la modernisation du réseau téléphonique de télécommunications du pays, et encore moins par le réseau de communications routier français pour ainsi dire moyenâgeux.. |
En 1936 La SIT
disparaît, elle est rachetée par la Compagnie Générale
d’Électricité
Grâce à loi de finances du 30 juin 1923,
article 75, qui ouvrit la possibilité d'effectuer des emprunts
via le Ministère des Finances. il y eut un accroissement sensible
du nombre d'abonnés au téléphone en France.
En effet, entre 1924 et 1938, leur nombre passa de 400 000
à un million.
Par contre, le taux d'équipement des ménages français
resta faible même dans les grandes villes, avec, par exemple, quinze
téléphones pour 100 habitants à Paris en 1938
En 1938 Le réseau
téléphonique de Paris intra-muros est entièrement
automatisé le 21 mai en commutateurs ROTARY 7A1, peu
avant la déclaration de guerre de la France à l’Allemagne.
Le réseau de Paris est alors, en 1938 le plus important du monde,
avec 42 commutateurs automécaniques ROTARY 7A1
Suivra les années suivantes jusqu'à 1950 le déploiement
sur la première et la seconde couronne de Paris en 7A1.
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, ITT a de solides bases en Europe.
Soutenue par la diplomatie américaine, la société
dispose d'une réelle puissance.


1938 Modèles de tableaux administratifs : 1+2 , 1+4 et 2+6 à
clés, puis les 1+4, 2+6, 3+10 et 4+12 à jacks.
C'est aussi en France, en 1938, que l'Anglais Alec Reeves qui travaillait
pour l'entreprise LMT (Le Matériel Téléphonique),
dépose le brevet du MIC (Modulation par Impulsions Codées),
qui devait éliminer presque complètement le bruit des transmissions
sur les circuits téléphoniques.
Malheureusement, à cette époque, la technologie de l'électronique
à lampes ne permettait pas de réaliser économiquement
de tels procédés de transmission. Ce sera dans les années
50, que le numérique apparaîtra comme une conséquence
de la nouvelle industrie des ordinateurs dont le développement
a été rendu nécessaire par la deuxième guerre
mondiale, que cette technique ouvrira la porte de la téléphonie
numérique.
En 1939, juste avant la déclaration de
guerre, les premiers câbles coaxiaux furent déployés
à titre expérimental entre Paris et Vierzon et Vierzon et
Limoges et exploités initialement en Basse Fréquence, puis,
une fois convertis après la guerre au multiplexage analogique,
permirent à l'aide d'amplificateurs à tubes électroniques
disposés tous les 9 km d'atteindre une bande passante utile de
4 MHz, et qui permettait de ce fait de transporter 960 voies de conversations
téléphoniques sur le même câble, par Multiplexage
Analogique lorsque le Multiplexage Analogique fut mis ultérieurement
en service. Ces deux câbles sont fabriqués par la société
LTT.
Il faut attendre le 29 juillet 1947 pour qu'un second câble coaxial
soit mis en service en France : Paris - Toulouse. Il s'agira du premier
câble coaxial multiplexé mis en service régulier dans
notre pays.
En 1939, le 1er septembre,
l'Allemagne envahit la Pologne sans déclaration de guerre. En retour,
la France déclare la guerre à l'Allemagne le 3 septembre.
L'Europe se prépare à sombrer, mais ceci est une toute autre
histoire...
Avant tout le reste appelé à se produire
chez nous, avant l'effondrement, la débâcle, la défaite,
les aboiements venus de l'Est, le défilé au pas de l'oie
sous l'Arc de Triomphe, les lois d'exclusion, les lois rétroactives
: comme dans un dernier réflexe nécrotique
d'une IIIème République déjà dissoute, il
est signé le 1er septembre, un décret fixant la situation
des personnels des administrations de l’État en temps de guerre.
(JORF 6 septembre 1939)
Ce décret suspend durant toute la durée des
hostilités tout avancement de grade, de classe et d'échelon
pour tous les personnels de l'État, dont les agents des P.T.T.
(art. 2)
Les procédures disciplinaires sont simplifiées, et permettent
à un simple chef de service de mettre à pied sans traitement
un de ses agents... (art.15)
Les délais de procédure sont réduits de moitié,
(art. 14)
De plus, (art. 15) sont suspendues les dispositions de l'article 65 de
la loi du 22 avril 1905 ci-dessous :
" Tous les fonctionnaires civils et militaires,
tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques
ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes
les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant
leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure
disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant
d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté."
La suspension de l'article 65 de la loi du 22 avril
1905 interdit de facto à tout agent de connaître le motif
et la teneur des preuves, si même elles existent, dont il est accusé.
Le droit d'accès est bafoué d'un trait de plume, le droit
à une défense équitable est de ce fait caduc.
L'État de droit est donc suspendu dès
le 6 septembre 1939 en France, par un Président de la République
et un Président du Conseil qui s'empressèrent, alors que
le monde se dérobait sous leurs pieds, de signer à la va-vite
un décret liberticide contre les propres forces vives de l'État
et ce, bien avant le retour de l'occupant sur la terre de France... L'histoire
a jugé.
C'est grâce à la grande robustesse du système ROTARY 7A1 que Paris parvient à traverser sans trop d'encombre, téléphoniquement, les années d'occupation, malgré toutes les contraintes et les pénuries.
En Mai 1939, le dernier commutateur R6 de province
est mis en service à Besançon. le parc de commutateurs R6
atteint 140.
En 1940, après l'armistice signé
le 22 juin 1940, ce qu'il reste des services de l'État se
réorganise après la débâcle.
Dans les PTT comme dans tout le pays, l'Administration a pour souci durant
toute la durée de l'occupation de gérer "au mieux"
et de survivre aux pénuries de toute nature et à l'absence
de l'état de droit ; situation encore plus précaire en zone
occupée.
La construction du réseau téléphonique est à
l'arrêt, le parc de lignes téléphoniques stagne durant
toute cette période.
Tous les projets concrets sont stoppés. Le gouvernement de facto
s'installe en zone dite libre à Vichy, reconnue pour héberger
un parc d'hôtellerie important ainsi qu'un Centre Téléphonique
de province parmi les plus perfectionnés du moment : un commutateur
R6 Sans Enregistreur récemment mis en service depuis le
4 mai 1937.
L’acte dit loi de l'État français du 15 juillet 1940
portant création d'emplois de secrétaires généraux
restructure le Secrétariat Général des Postes, Télégraphes,
Téléphones. (Le Secrétariat Général
des Postes & Télégraphes ayant été créé
initialement par décrets des 5 et 6 septembre 1916).
Les nouveaux secrétaires généraux mis en place constituent
les relais des Ministres. Ils sont pourvus de prérogatives élargies.
M. Pierre Cathala, qui est avant tout un homme politique, est nommé
secrétaire général des postes, télégraphes,
téléphones, comme en témoigne l’acte dit arrêté
C. M. du 27 juillet 1940 portant délégation de signature
(Bulletin Officiel des PTT n°19 page 290 du 11 août 1940). Quelques
mois plus tard, M. Vincent Di Pace, Ingénieur en chef des postes,
télégraphes, téléphones le remplace en tant
que secrétaire général des postes, télégraphes,
téléphones par l’acte dit décret de l'État
français du 20 décembre 1940 (BO PTT n°1 page 2 du 10
janvier 1941), jusqu'au 24 août 1944. Vincent Di Pace, un temps
inquiété à la Libération d'atteintes à
la sûreté de l'État, bénéficiera d'un
non-lieu de toute charge le 22 mai 1947, pour faits de résistance.
Les matières premières font cruellement défaut notamment
le cuivre. Janvier 1941, la situation du pays en état d'occupation,
de désorganisation, de pénurie et de pillage systématique
impose un rationnement drastique des huiles de graissage utilisées
aux PTT dans les installations destinées à alimenter les
bâtiments et les commutateurs automatiques Rotary 7A1.
Le commutateur R6 à Contrôle
Direct de Caen (Caen I), mis en service le 24 juin 1933, est mis
à l'arrêt en Juin 1940 par une équipe
très soudée d'agents des PTT lors de la débâcle
et véritablement camouflé derrière un mur édifié
en catastrophe dans le central en toute discrétion. Ainsi, le camouflage
ayant été si bien réussi que l'occupant allemand
ne découvrit jamais ce commutateur automatique, si bien qu'il ne
reprendra du service que lorsqu'il sera dés-emmuré en Août
1944 à la libération de cette ville.
En 1940, après la défaite de juin 1940 et
l'instauration de ce que l'on appellera le régime de Vichy, un
comité de coordination des télécommunications impériales
(CCTI) fut créé pour organiser les politiques de télécommunications.
Au cours de la période 1940-1944, l'administration des PTT sera
d'ailleurs complètement remaniée, notamment dans le secteur
des télécommunications. Le premier organe créé
spécifiquement pour la recherche est la « Direction des recherches
et du contrôle technique » ( DRCT ) qui regroupe l'ancien
SERT et le service de vérification du matériel. En 1941,
elle compte 314 personnes dont 28 ingénieurs, dirigées par
Jean Dauvin assisté de Charles Lange. Jean Dauvin s'emploie à
développer un puissant centre de recherches PTT avec des ingénieurs
dont la compétence doit égaler celles de leurs collègues
d'entreprises privées comme la Société française
radio-électrique (SFR).
À la suite de l'armistice du 22 juin 1940, les corps d'ingénieurs
militaires ont été dissous et 80 ingénieurs et 100
agents des transmissions militaires trouvent refuge dans les diverses
administrations des PTT dont certaines, comme le SERT de Lyon, n'étaient
qu'une couverture pour effectuer des tâches militaires.
En 1941, l’acte dit loi de l'État français
du 9 février 1941 (BO PTT n°6 du 28 février 1941) relative
à l'organisation du secrétariat d’État aux communications
(Secrétariat général des postes, télégraphes,
téléphones) crée la Direction des Télécommunications
: la Direction de l'Exploitation Téléphonique et la Direction
de l'Exploitation Télégraphique sont regroupées au
sein d'une même direction et le terme « télécommunications
» apparaît officiellement dans l'organigramme administratif.
Auparavant, dans chaque bureau de poste de France, dans chaque département
du pays, n’existe qu’un service du téléphone (dépendant
de la Direction de l’Exploitation Téléphonique), qui
n’est alors qu’une direction lambda sans marge d'autonomie parmi
les autres directions de cette administration essentiellement postale.
Les bâtiments et leur gestion, y compris ceux abritant les installations
de télécommunications, sont dans la foulée rattachés
à la Direction de la Poste et des Bâtiments également
créée, ce qui revient indirectement au maintien d’une
sorte de droit de regard matériel, donc en partie financier, par
la branche postale sur la branche des télécommunications.
Le premier Directeur des Télécommunications, M. Charles
Lange, est nommé cette même année par acte dit
décret du 9 février 1941 (par maintien sur le poste nouvellement
transformé). Il restera en fonction jusqu'à son départ
en retraite en 1951.
Cette direction autonome trouve même le moyen de développer
un laboratoire de recherche auquel on confie la tache d’étudier
un nouveau modèle d’appareil téléphonique
capable de s’adapter facilement aux nouveaux réseaux téléphoniques
qui se sont développés quelques années au par avant.
C’est ainsi qu’apparaît fin 1941
un nouvel appareil, le type DRCT également appelé
LAURENT du nom de son concepteur alors ingénieur au SRCT
(service de recherche et de contrôle technique), appareil,
référencè sous le N° 326 par l'administration
des PTT,

 Schéma du 326
Schéma du 326
Il se veut universel, c'est-à-dire qu’il s’adapter non
seulement au nouveaux systèmes automatique rural mais également
à tous les systèmes existants, par une astucieuse combinaison
de branchements et pontages réalisés sur le bornier interne
au poste, malheureusement il ne fonctionnera bien que sur les réseaux
à batterie locale alors que l'automatique avec batterie centrale
est déjà bien avancé.
Dès Janvier 1941, la situation
du pays en état d'occupation, de désorganisation, de pénurie
et de pillage systématique impose un rationnement drastique des
huiles de graissage utilisées aux PTT dans les installations destinées
à alimenter les bâtiments et les commutateurs automatiques
Rotary 7A1.
Le 1er mars 1941, les communications téléphoniques
interurbaines sont suspendues dans la Zone Côtière de la
façade ouest du territoire métropolitain composée
des départements suivants (tout ou partie) : Somme, Seine-Inférieure,
Eure, Calvados, Manche, Ille-et-Vilaine, Côte-du-Nord, Finistère,
Morbihan, Loire-Inférieure, Vendée, Charente-Inférieure,
Gironde, Landes, Basses-Pyrénées, Îles Anglo-Normandes.
Concernant la Zone Occupée ainsi que la Zone dite Libre, les communications
interurbaines sont à nouveau autorisées au 1er mars 1941
à l'exception de la Zone Côtière.
Dès le 8 juillet 1942, par une ordonnance publiée
au VOBIF (Bulletin bilingue des Ordonnances du Gouverneur Militaire du
Reich Allemand en France), les israélites n'ont désormais
plus le droit de posséder une ligne téléphonique
à leur nom. Le téléphone leur est alors coupé
et leur ligne téléphonique réattribuée à
des «non-juifs». Les israélites n'ont même plus
le droit d'utiliser la ligne téléphonique d'un ami, ni même
d'utiliser les cabines téléphoniques publiques...
De surcroît, à partir de cette date, tout candidat désireux
de s'abonner à une ligne téléphonique doit d'une
part produire un «Certificat de Non-Appartenance à la Race
Juive» et, fait tout autant infâme, doit souscrire par écrit
pour une durée minimum d'un an à l'engagement suivant :
«Je soussigné X, déclare ne pas être juif, ne
pas souscrire pour le compte d'un juif et m'engage à ne pas mettre
mon installation à la disposition d'un juif».
sommaire
L'invasion de la zone libre, en novembre 1942, conduira
le SERT à abandonner les recherches militaires. La voie est alors
ouverte pour que Jean Dauvin accélère l'évolution
qui va mettre un terme aux pratiques d'avant-guerre où les techniciens
de l'État se cantonnaient dans l'énoncé des problèmes,
l'orientation des études et le contrôle des réalisations.
Pour que les techniciens des administrations soient excellents, il faut
qu'ils disposent de leurs propres laboratoires. Pour Jean Dauvin et Charles
Lange, avec l'expansion rapide des télécommunications, un
laboratoire d'État ne ferait pas concurrence aux laboratoires industriels
privés. Finalement, avec l'appui du ministre à la Production
industrielle Jean Bichelonne, le CNET, créé par acte dit
Loi n°102 du 4 mai 1944, regroupe la plus grande partie des services
rattachés jusqu'alors à la DRCT, et reste, en principe,
un organe interministériel.
En 1942, même si l’acte dit loi de l'État
français n°945 du 17 octobre 1942 relative à l'organisation
du secrétariat d’État aux communications (Secrétariat
général des postes, télégraphes, téléphones)
sépare la Direction de la Poste en créant une nouvelle Direction
des Bâtiment et des Transports, il n'en demeure pas moins que la
gestion des bâtiments demeure toujours séparée de
celle des télécommunications.
Cette « tutelle indirecte » ne sera abolie qu’en 1971
par le décret n°71-609 (articles 1 et 9) du 20 juillet 1971
au terme de 30 années de rivalités et luttes intestines
entre les branches jumelles des P & T.Il en est de même pour
la gestion du personnel qui est mise en œuvre par une Direction du
Personnel qui n'est pas subordonnée à la Direction des Télécommunications.
Cette tutelle prendra également fin en 1971.À partir de
l'année 1942, la France sous occupation allemande sombre un peu
plus dans le noir : même les PTT n'échappent pas à
la tyrannie venue d’outre-Rhin.
En 1943 et 1944, la situation se tendant de plus en plus, le Ministère
de la Production Industrielle et des Communications (dont les PTT dépendent)
fait régulièrement paraître dans la presse l'information
relative au service téléphonique pendant les alertes aux
bombardements : "Il est rappelé au public
que, pendant la durée des alertes, seules les communications téléphoniques
établies par voie entièrement automatique peuvent aboutir
normalement.
Celles qui nécessitent l'intervention d'une opératrice ne
sont établies que si elles sont relatives à des demandes
de secours.
Hormis ce dernier cas, les abonnés munis d'appareils automatiques
sont priés, pendant les alertes, de s'abstenir d'appeler l’interurbain
et éventuellement le régional (à Paris, appels par
le 10 et par le 11)". L'intérêt pour le téléphone
automatique, en temps de guerre, n'en apparaît que plus évident.
D'ailleurs, c'est en 1943 qu'est créée la fonction de Chef
de Centre Téléphonique Automatique, par différenciation,
désormais, de Chef de Centre Téléphonique Manuel.
À partir de Juin 1944 et du Débarquement des Alliés
en Normandie, les appels à la résistance et aux sabotages
de toute sorte se multiplient, y compris aux PTT, pour gêner et
affaiblir le plus possible l'Occupant.
Le commutateur R6 à
Contrôle Direct de Brest (Brest I), mis en service en 1931,
est détruit sous les bombardements alliés en 1944.
Le 27 août 1944, en pleine déroute, l'aviation allemande
lâche une bombe qui explose sur le Centre Téléphonique
ROTARY 7A1 - Paris - ITALIE. Mais par chance, le central et la machine
seront sauvés.
Le 2 octobre 1944, la liberté de trafic téléphonique
est rétablie entre Paris et les départements de la Seine,
Seine-et-Oise, Seine-et-Marne.
Pourtant, au modèle de téléphone 41 Laurent,
suivra l'appareil U43 (Universel 1943)
Sur le plan électrique, le problème de l’anti-local
n’étant pas résolu, ce sont en fait 2 versions qui
apparaissent sur le marché fin 1943.
La première dite « universelle » et portant la référence
331 s’inspire très fortement du type Laurent et est
essentiellement destinée à équiper les réseaux
en automatique rural.
La seconde version dite « BCI » ou batterie centrale
intégrale, de référence 330 est destinée
à remplacer le modèle 1910 dans les zones urbaine de moindre
importance ou la batterie centrale toujours avec opératrice fait
lentement son apparition.

 Capsule micro
Capsule micro 
L'intérêt pour un modèle unique, capable de fonctionner
aussi bien en batterie locale qu'en batterie centrale, était devenu
plus pressant pour deux raisons : tout d'abord une standardisation permettant
par l'emploi de pièces communes une fabrication en plus grand nombre
et ainsi moins chère, ensuite la conception d'un modèle
dit universel permettait une adaptation facile et à moindre coût
à l'évolution technique des réseaux (passage BL à
BC).
sommaire
 Quand Vichy s'appuyait sur les PTT pour surveiller les Français
Paris Le 25 août 1944 au matin, une automitrailleuse allemande
entre au central téléphonique de la rue des Archives.
Quand Vichy s'appuyait sur les PTT pour surveiller les Français
Paris Le 25 août 1944 au matin, une automitrailleuse allemande
entre au central téléphonique de la rue des Archives.
Le contrôle du central est particulièrement important car
il assure les communications téléphoniques à distance.
Les FFI attaquent immédiatement pour empêcher toute tentative
de sabotage. Les Allemands s'y retranchent.
L'attaque continue grâce aux renforts de policiers et de gendarmes.
L'ennemi fait diversion en lançant des opérations contre
la mairie du IIIe arrondissement et le square du Temple
.Le capitaine Dronne, dont le détachement du IIIe RMT est depuis
la veille autour de l'Hôtel de Ville, est sollicité par les
FFI en difficulté pour dégager le central, toujours occupé
par les Allemands et miné par surcroît. Dronne forme deux
groupes : l'un aux ordres du lieutenant Michard, prend la rue des Archives
et pousse des éclaireurs jusqu'à la place de la République.
L'autre commandé par le lieutenant Hélias s'engage dans
la rue du Temple où il essuie des tirs d'armes automatiques. L'adjudant
Caron est mortellement blessé.
L'assaut du central est donné et l'objectif atteint. Les chars
du IIIe RMT du capitaine Dronne arrivent pour seconder les FFI.
L'officier allemand qui a miné le central est contraint de désamorcer
les charges sous le contrôle des hommes du génie et de spécialistes
venus de la Préfecture de Police. 31 Allemands sont faits prisonniers
dont un officier.
L’histoire de la Source K. Extrait de Résistance
PTT
Le 20 juillet 1940, les services d’entretien des lignes souterraines
à grande distance regagnent Paris.
L’accord passé entre l’administration des P.T.T. et les
autorités d’occupation prévoit la reprise en main par
les techniciens français, sous contrôle allemand, de l’ensemble
du réseau, à l’exception des territoires intégrés
au Reich, ou rattachés au protectorat du gauleiter nommé
en Belgique Robert Keller retrouve donc son poste et ses responsabilités.
Ses équipes conservent leur ancienne structure, mais doivent supporter
l’incorporation d’un ou deux pionniers allemands par groupe.
Durant plusieurs mois, la tâche essentielle consiste en une réfection
rapide des grands circuits. Keller, qui nourrit déjà certains
projets, veille à la bonne exécution des travaux. Il stimule
si bien ses hommes que peu à peu la surveillance se relâche
et qu’il parvient à visiter ses chantiers sans être
flanqué de ses indésirables accompagnateurs.
Bientôt même, les équipes d’urgence ne vont plus
avoir d’observateurs à leurs côtés lors des interventions.
C’est au cours de ces quelques mois que Robert Keller établit
un plan d’action avec schéma visant à neutraliser
le réseau des lignes souterraines à grande distance.
On ignore tout des liaisons qu’il eut à cette époque,
car il a emporté ce secret dans sa mort, mais ce qui est certain,
c’est que ce plan parvint en Angleterre puisqu’il figurait parmi
les archives du B.C.R.A.
Minutieusement rédigé, il montrait comment, en quelques
heures, on pouvait bloquer tous les circuits, et isoler téléphoniquement
les centres
vitaux du commandement allemand.
Ce projet, conçu dans le cadre d’un débarquement allié,
aurait été d’une importance capitale en juin 1944 si
son auteur avait encore été là pour le faire appliquer.
Mais la discrétion, bien compréhensive, dont Robert Keller
fit preuve, ne permit à aucun de ses camarades de pouvoir l’utiliser.
Devenu, comme on l’a vu plus haut, représentant du S.R. au
sein de la Direction des Recherches et du Contrôle technique des
P.T.T., le capitaine Combaux s’est assuré le concours de M.
Sueur, ingénieur de ce service.
Les deux hommes ont longuement réfléchi sur les moyens à
mettre en oeuvre pour capter les conversations allemandes qui passent
par les câbles à grande distance.
Sécurisés par l’important dispositif qui contrôle
les circuits, les occupants les utilisent en exclusivité pour leurs
liaisons avec le Reich.
Les lignes : Paris - Reims - Verdun - Metz, reliée à Sarrebruck,
et Paris - Châlons - Nancy - Sarrebourg - Strasbourg reliée
à Appenweier, sont particulièrement surveillées puisqu’elles
mettent en relations toutes les sphères des autorités d’occupation
avec leurs hiérarchies de Berlin.
Combaux et Sueur savent bien que surprendre les communications qui s’échangent
sur ces câbles prioritaires permettrait de percer le secret
des plans allemands, et par là même de leur porter un terrible
coup en faisant bénéficier les Alliés de ces informations.
Seulement atteindre les circuits par les voies normales relève
de l’utopie.
Tous les postes d’amplification, toutes les stations de répéteurs,
sont, ainsi qu’on l’a montré précédemment,
placés sous une surveillance sévère.
Les vérificateurs français qui en assurent le fonctionnement
ne peuvent faire le moindre geste sans éveiller l’attention
des techniciens allemands qui les doublent.
La seule et unique possibilité qui existe, mais combien illusoire
et insensée dans sa réalisation, c’est celle avancée
par M. Sueur : le « piquage sauvage sur câbles »
Pourtant, aussi téméraire et extravagant qu’il soit,
c’est à ce projet que s’attaquent les deux hommes.
Sur le papier, son exécution ne paraît pas insurmontable.
Il faut préparer des amplificateurs spéciaux à grande
impédance d’entrée qui puissent être insérés
dans les circuits sans modifier les impulsions des stations de mesure.
Les câbles étant en effet équilibrés en constantes
électriques fixes, la moindre variation est facilement décelable.
Or, dans le plan établi par Sueur, il conviendrait d’introduire
sur la ligne des appareils et un métrage de câble les reliant
au circuit. Un tel branchement présente de gros risques, car il
entraînerait sûrement une modification des indices sur les
mesures habituelles ; à moins que les appareils espions ne soient
appropriés avec une précision rigoureuse.
C’est un premier obstacle, mais il peut être franchi grâce
à la haute compétence des spécialistes.
Le second palier du projet consiste à louer au plus près
du lieu de dérivation prévu une habitation discrète
dans laquelle on pourrait placer les têtes et les amorces de câble
ainsi que les amplificateurs d’écoutes. C’est le point
qui présente le moins de difficultés, encore que rechercher
une maison libre, présentant des garanties de tranquillité
et de sécurité, sur le parcours des lignes, n’apparaisse
pas aussi simple que cela.
Mais ces deux premiers volets de l’opération imaginée
par Sueur et Combaux ne sont qu’un aimable enfantillage en regard
de ce que représente le dernier, car il s’agit maintenant
d’intervenir sur le câble lui- même.
À partir de là, on entre dans une phase du projet qui semble
irréalisable.
Il faudrait, en effet, en dépit de la surveillance allemande, ouvrir
des fouilles sur la ligne, ce qui peut déjà demander plusieurs
jours ; creuser une tranchée préparatoire au niveau de la
dérivation ; sortir du pavillon loué les amorces préalablement
apprêtées ; accéder au câble en service, l’ouvrir,
dénuder les fils un par un et sélectionner sans erreur ceux
des circuits à mettre en écoute, les couper, les dériver,
puis rétablir vivement le contact afin que l’opération
ne cause pas un trop long dérangement susceptible d’intriguer
les techniciens allemands ; ensuite, remettre tout en place et refermer
les fouilles.
Un travail aussi périlleux, comportant tant de risques, qui pourrait
le faire ?
Ceux qui tenteraient de l’entreprendre devraient être des hommes
aux nerfs d’acier, aux capacités professionnelles affirmées,
connaissant parfaitement le schéma des grands circuits et leurs
particularités, doués d’une audace hors du commun,
et animés d’un esprit patriotique poussé jusqu’à
l’abnégation. De plus, il ne pourrait s’agir que d’une
équipe soudée, habituée à travailler en harmonie
et confiance, dirigée par un responsable lucide aux compétences
certaines, capable de maîtriser les impondérables.
Enthousiaste et sceptique à la fois, le capitaine Combaux posa
la question :
— Un tel chef d’équipe existe-t-il seulement ? —
Oui, répondit M. Sueur, je le connais, c’est l’Ingénieur
Robert Keller.
C’est dans les premiers jours de septembre 1941, la date est imprécise,
que les deux instigateurs de ce projet extraordinaire le soumettent à
Keller. L’entrevue a lieu dans le bureau de M. Sueur, rue Bertrand.
....
Sur Robert Keller, en vérité, reposait le succès
ou l’échec de l’entreprise. Si Sueur pouvait se charger
de l’étude et de la réalisation des amplifi cateurs,
si je pouvais régler l’acquisition du local et les questions
d’exploitation, lui seul était capable de réaliser
l’essentiel, d’accomplir ce tour de force incroyable que représentait
le travail sur câble... »
Que Robert Keller eût refusé à cet instant les propositions
de ses interlocuteurs, et la Source K serait demeurée à
l’état de projet, car aucun technicien des P.T.T. ne réunissait
alors ni les compétences ni les qualités requises. Pas un
ne possédait suffisamment d’ascendant et n’inspirait
assez la confiance pour entraîner une équipe de spécialistes
dans cette voie périlleuse.
Et ceux qui au S.R. choisirent l’initiale K de Keller pour désigner
la source de renseignements vitaux qui leur parvinrent par ce canal ne
pouvaient mieux montrer que c’est à cet homme héroïque
qu’ils durent la somme d’informations sensationnelles dont ils
firent bénéficier les Alliés.
L’acceptation de Robert Keller déclenche le démarrage
de l’opération. Sueur effectue une étude très
poussée pour déterminer le nombre d’amplifi cateurs
nécessaires. Il parvient à la conclusion qu’il faut
en prévoir un minimum de 6.
Leur fabrication délicate, et le coût élevé
de celle-ci, posent un premier problème. Un habile travail d’approche
permet toutefois à l’ingénieur d’acquérir
la complicité active du chef des laboratoires de la Société
anonyme de télécommunications, société privée,
qui travaille exclusivement
pour les P.T.T. M. Lebedinski, russe d’origine, mais naturalisé
français, accepte en effet spontanément de faire construire
dans les ateliers de son entreprise repliée à Montluçon
les pièces détachées des appareils conçus
par M. Sueur.
Grâce aux camions qui font la navette entre l’usine et les
entrepôts demeurés en zone occupée, les éléments
d’amplificateurs passeront sans problèmes la ligne de démarcation.
De son côté, le capitaine Combaux règle la question
des fonds nécessaires à une telle opération.
Doté par les soins du S.R. d’un laissez-passer permanent,
il se déplace à volonté entre les deux zones ; ce
qui lui permet de recevoir du capitaine Simoneau au cours de ses voyages
tout l’argent indispensable à la mise sur pied du projet.
Dans le même temps, le poste P 2 du S.R. fait diligence pour recruter
et former des opérateurs valables.
Tâche ardue assurément, car ceux-ci doivent parler, et surtout
parfaitement comprendre la langue allemande, y compris dans les variations
de la conversation courante. Il leur faut également posséder
le sens de l’initiative et l’instinct de débrouillardise,
vitaux pour leur travail et leur sécurité. Enfin, il va
de soi que pour noter tout ce qu’ils entendront, il leur est indispensable
d’avoir une parfaite maîtrise de la sténo, et de connaître
les structures de fonctionnement des services du Reich.
Le premier opérateur envoyé à Combaux par Simoneau
arrive à Paris le 5 mars 1942 ; c’est le sergent chef Édouard
Jung. Ayant suivi les cours accélérés du centre d’instruction
clandestin du S.R., connaissant parfaitement l’organigramme de la
Wehrmacht et les noms des principaux officiers des différents services
fonctionnant à Paris, c’est un habile spécialiste des
transmissions, Alsacien de naissance, que Simoneau a eu la chance de pouvoir
récupérer.
Nanti de pièces d’identité irréprochables, il
est aussitôt dirigé sur la Compagnie d’Assurances «
La Nationale » où le sous-directeur M. Grimpel et l’agent
général pour la région parisienne, M. Lionel Levavasseur,
lui fournissent la carte accréditive d’inspecteur qui lui
assurera une couverture de premier ordre.
Quelques jours plus tard, Jung parvient à repérer un pavillon
libre sur le parcours du câble dans la Grande Rue de Noisy-le-Grand.
Après quelques démarches, il en obtient la location que
Combaux s’empresse de régler. Située à moins
de 6 mètres de la ligne, cette petite maison offre toutes garanties
par son isolement, et son sous-sol surplombe de peu la route nationale
sous laquelle court le câble Paris-Metz.
Sans perdre de temps, Édouard Jung s’y installe, complétant
l’aménagement sommaire laissé par le propriétaire
de quelques meubles ramenés du marché aux puces de Montreuil.
À peine sur place, sous prétexte de fuites dans les canalisations
d’écoulement, il creuse une tranchée jusqu’à
la haie de clôture bordant la route nationale, puis le mur du sous-sol
est percé afi n de laisser le passage à une gaine de protection.
Le 6 avril 1942, tout est prêt pour recevoir le matériel
d’écoute. Trois jours après, M. Lebedinski fait livrer
les amplificateurs que M. Sueur transporte aussitôt au pavillon
; les têtes de câble et les amorces suivent. Il ne reste plus
sur place qu’à procéder au montage de tout cet équipement
en attente de branchement.
Le 10 avril, c’est chose faite ; la première phase de l’opération
est terminée.
Pendant la durée de ces préparatifs, Robert Keller n’est
pas resté inactif. Après un minutieux examen des schémas
et un relevé de la zone choisie pour la dérivation, il a
mis au point le procédé d’attaque du câble et
réuni l’outillage le plus adapté à cette intervention.
Puis, après mûre réflexion, il a choisi les hommes
lui paraissant les plus qualifiés et les plus audacieux pour entreprendre
un travail aussi difficile.
À chacun d’eux, il a soumis le plan de l’affaire en insistant
sur les risques qu’elle comporte. Sûr de leur fidèle
discrétion, quelle que soit la décision prise, il leur a
demandé de réfléchir avant de donner leur réponse.
Mais celle-ci ne s’est pas fait attendre et, l’un après
l’autre, les six compagnons qu’il a sollicités sont venus
lui dire qu’ils étaient prêts à le suivre dans
cette action dont ils savent mieux que personne qu’elle risque de
les entraîner sur un mortel chemin.
Les affiches collées sur les panneaux de service dans chaque atelier,
dans chaque centre, sont à cet égard éloquentes.
L’administration militaire allemande prévient en effet que
: « Tout endommagement des moyens de transmission sera puni de la
peine de mort. »
Malgré cette menace, dont ils savent bien qu’elle n’est
pas formulée à la légère, les hommes choisis
par Keller n’hésitent pas.
Et aujourd’hui, l’on ne sait pas ce qu’il convient d’admirer
le plus : de cette confiance totale montrée vis-à-vis d’un
chef estimé, mais téméraire, ou de ce tranquille
courage patriotique bien dans la tradition de l’engagement résistant.
Le 2 avril, l’équipe formée par Robert Keller est constituée.
Elle comprend :
Les vérificateurs : Lobreau du centre Paris-Saint-Amand, et Fugier
du centre de La Ferté-sous-Jouarre. Les techniciens sur ligne :
Pierre Guilou, Laurent Matheron, Abscheidt et Levasseur.
Dans le plan prévu par Keller, chacun de ces spécialistes
aura un rôle important à jouer pour lequel, en dehors des
compétences professionnelles, l’audace et le sang-froid ne
devront pas faire défaut. Ce plan, il faut maintenant l’exécuter.
Le 15 avril 1942, Robert Keller crée un défaut artificiel
sur le câble Paris-Metz.
La « Feldschalt-Abteilung » saisit le service de dérangement
des lignes souterraines à grande distance d’une énergique
réclamation, car deux circuits sont interrompus. C’est bien
ce qu’espérait Robert Keller qui, nanti d’une autorisation
de travaux en bonne et due forme signée par l’Administration,
regroupe son équipe et part à la recherche du point de rupture.
Naturellement, celui-ci est découvert à Noisy-le-Grand,
en face du pavillon loué par Édouard Jung.
Le 16 au matin, les fouilles sont entreprises sur le trajet du câble.
Afin de donner le change à d’éventuels curieux, deux
tranchées sont ouvertes à côté de celle dans
laquelle la dérivation doit être effectuée.
Le 17, en fin de matinée, un technicien allemand vient sur place
s’informer de l’état des travaux. Satisfait de la célérité
déployée par les spécialistes français et
des réponses rassurantes qui lui sont faites, il repart aussitôt.
Keller a décidé, pour des raisons de sécurité,
que l’intervention sur le câble se fera de nuit, et il en a
informé Combaux.
Dans la soirée du 18, ce dernier vient rejoindre l’équipe
sur le chantier. Une tente d’intempérie a été
disposée au-dessus de la fouille centrale afin de masquer un peu
les travaux, et de filtrer l’éclairage dispensé par
les lanternes ; des lueurs trop vives pouvant provoquer une réaction
des patrouilles allemandes obnubilées par les consignes sévères
du camouflage lumineux.
Un peu avant 21 heures, Keller, Guillou et Matheron descendent dans la
tranchée et s’attaquent au câble. Sitôt la gaine
de plomb mise à jour, Keller se porte sur la ligne de service et
donne l’ordre aux deux vérificateurs des stations de répéteurs
encadrantes : Lobreau à Paris-Saint-Amand, et Fugier à La
Ferté-sous-Jouarre, de retirer un à un chaque circuit de
l’exploitation durant le temps nécessaire à sa coupure
et à sa dérivation.
C’est ce que font sans hésiter les deux hommes, sous les yeux
mêmes des techniciens allemands, en prétextant un contrôle
des mesures.
Pour eux, la nuit va être longue, car ils vont devoir agir avec
une apparente routine désinvolte devant leurs surveillants, tout
en portant une extrême attention aux directives précises
que leur transmettra Keller. Aucune erreur ne leur est permise, car elle
se répercuterait aussitôt dans les autres centres d’amplifi
cateurs dont le personnel a été laissé en dehors
de l’action.
Dans la fosse, penchés sur leur ouvrage, les trois hommes travaillent
dans un silence tendu. Keller sélectionne les fils, ne quittant
pratiquement pas le téléphone qui assure la liaison avec
les vérificateurs, annonçant tranquillement les références
du circuit à suspendre le temps de l’intervention. Guillou
et Matheron, les mâchoires serrées, s’activent, mesurant
leurs gestes rapides. Ils coupent, décapent, épissurent,
soudent, les mains plongées dans l’inextricable amas de conducteurs,
s’arrêtant un bref instant pour essuyer la sueur, due à
l’effort et à la l’émotion, qui perle à
leur front. Sur la chaussée, Combaux feint de s’affairer à
quelque tâche urgente, veillant à ce que les lueurs qui filtrent
de la tente mal jointe n’alertent pas les servants d’une batterie
de D.C.A. de la Wehrmacht située à moins de 300 mètres
en amont. De temps en temps, une estafette motocycliste allemande passe,
contournant la barrière mobile du chantier, jetant un regard distrait
sur les fouilles. Dans la tranchée, autour du câble, on s’affaire
toujours sur le
même rythme. Soudain, désastre ! une manœuvre un peu
trop rapide entraîne une forte variation de la constante électrique
de l’isolement. Au centre de Paris-Saint-Amand, Lobreau, la gorge
sèche, voit l’aiguille de l’appareil de mesure battre
la chamade. Un bref coup d’oeil sur le côté lui montre
les deux Allemands de service avachis sur leurs chaises, les paupières
lourdes, aux prises avec le traditionnel coup de barre de l’après-minuit.
Ils n’ont rien remarqué ; les minutes passent angoissantes
pour le vérificateur qui devrait réagir, mais que sa complicité
avec l’équipe maintient cloué sur son siège,
le regard fixé sur le cadran témoin. Pourtant petit à
petit, l’aiguille revient vers la zone de sécurité.
Là-bas, sous la tente, Keller et Guillou se démènent
pour rétablir l’isolement. Un quart d’heure encore, et
Lobreau, avec le soulagement qu’on imagine, voit la tension revenir
à son niveau habituel. Trois heures du matin. Cela fait maintenant
six heures que les trois postiers s’acharnent sur les fils ; cinquante-cinq
grands circuits sont déjà dérivés, mais Keller
et ses deux camarades poursuivent leur travail.
À La Ferté-sous-Jouarre, au poste de répéteur,
Fugier, les mains rendues moites par l’énervement, affecte
le plus grand calme en déconnectant puis replaçant ses lignes
sous le regard endormi de ses surveillants. Imperturbable dans la fosse,
Keller continue de donner ses directives tout en refixant les isolants,
cependant que Guillou et Matheron, tantôt accroupis, tantôt
à genoux, les reins brûlants, endoloris par l’effort
constant de recherche d’une meilleure position, maîtrisent
leurs gestes, un peu plus gourds maintenant que la fatigue se fait sentir.
Au-dessus d’eux, sur la route, Combaux, rongé par l’anxiété,
sent les minutes devenir de plus en plus longues au fur et à mesure
que le temps passe. En cette nuit froide d’avril, silencieuse, et
lugubre sous la pâle clarté des candélabres qui diffusent
une faible lumière bleutée, lui seul a tout loisir de laisser
ses pensées s’égarer dans l’évocation du
risque-tout en écoutant les clochers de Noisy et de Neuilly de
chaque côté de la Marne se renvoyer les heures si lentes
à s’écouler. Ses trois compagnons, eux, tendus vers
le but à atteindre, absorbés par leur difficile travail,
ne connaissent pas en ce moment, et c’est heureux pour la réussite
de l’opération, ce dangereux vagabondage de l’esprit.
Quatre heures vingt. Robert Keller replie le schéma qui lui a permis
de sélectionner les circuits. Guillou et Matheron fignolent la
dernière épissure. Le câble est regarni, puis calé
soigneusement au niveau du piquage.
Quatre heures quarante. La dérivation est terminée. Les
trois hommes remontent. Rapidement la fouille est comblée. L’aube
se lève lorsque les dernières pelletées de terre
égalisent le terrain.
Abrutis de fatigue dans la camionnette qui les ramène à
Paris, les auteurs de cette extraordinaire opération demeurent
silencieux.
Réalisent-ils qu’ils viennent d’effectuer un véritable
exploit ?
Soixante-dix grands circuits ont été dérivés,
parmi lesquels ceux qui assurent les liaisons de la Kriegsmarine, de la
Luftwaffe, de la Wehrmacht, et de la Gestapo, entre Paris et Berlin !
Jamais aucun service d’espionnage n’avait rêvé
pouvoir bénéficier d’une telle source !
La dérivation étant effectuée, c’est maintenant
à M. Sueur qu’il appartient de mettre la table d’écoute
en service. Prévenu par le capitaine Combaux de la réussite
de l’opération, il arrive aux premières heures de la
matinée du 19 avril au pavillon de Noisy, accompagné d’un
fi dèle ami, spécialiste des Transmissions de l’État,
M. Deguingamp auquel il accorde toute confiance. Immédiatement,
ils se mettent en devoir de procéder aux raccordements. Laissés
en attente, les fils qui s’épanouissent sur des appareils
appelés « têtes de câble » vont être
reliés aux amplificateurs, puis les postes d’écoute
sont à leur tour branchés. Lorsque Édouard Jung,
informé par Combaux, se présente, tout est pratiquement
prêt à fonctionner. Avec une infinie prudence, les deux techniciens
effectuent les premiers essais. On a choisi le moment où Lobreau
et Fugier auront repris leur service afin qu’ils puissent veiller,
chacun dans leur centre, sur les mesureurs de tension. Mais tout va bien,
le travail accompli par Keller, Guillou, et Matheron ne recèle
aucune imperfection. Jung peut commencer ses longues factions ; la
Source K est opérationnelle !
C’est le 19 avril 1942 dans la soirée, que l’opérateur
du S.R. enregistre les premières conversations; mais c’est
vraiment à partir du 20 que l’écoute porte ses fruits.
En cette seule journée, Édouard Jung intercepte plus de
60 communications.
L’importance du trafic l’oblige alors à sélectionner
parmi ce flot continu les circuits présentant le plus grand intérêt,
et il se contente de relever les liaisons des armes — marine- aviation-armée
de terre — avec le Haut Commandement de Berlin.
Devant un pareil afflux, le capitaine Combaux réclame un second
opérateur, et le S.R. choisit parmi les agents en stage M. Rocard,
jeune licencié d’allemand, ancien lecteur dans une université
d’outre-Rhin.
L’arrivée de ce deuxième spécialiste double
bien sûr le nombre d’informations. Les deux hommes abattent
une besogne écrasante.
Aux heures d’écoute s’ajoute le temps passé à
transcrire à l’encre sympathique, sur des lettres, rapports,
ou contrats, les renseignements les plus importants ; ceux présentant
un moindre intérêt sont acheminés irrégulièrement
par porteur.
À Combaux revient le soin d’organiser la transmission au poste
P 2 du S.R. de toutes ces informations. Il parvient à assurer cette
liaison et le passage de la ligne de démarcation grâce à
un ambulant de la S.N.C.F. ; par la suite, il emploiera également
un garçon des wagons-lits, puis un
mécanicien de locomotive. Arrivés dans le service du capitaine
Simoneau, les renseignements fournis par la Source K sont triés
soigneusement.
Ceux qui peuvent intéresser le gouvernement de Vichy et influencer
sa politique vis-à-vis du Reich sont remis au colonel Rivet qui,
après les avoir analysés minutieusement, décide ou
non de leur envoi au général Revers, chef d’État-major
de Darlan.
Mais les plus vitaux, ceux qui fournissent des indications précieuses
sur les projets allemands, ainsi que ceux qui font état de la situation
militaire et de l’évolution de la stratégie du Haut
Commandement, passent directement du S.R. à 1’I.S. par les
liaisons « Olga », ou par les liaisons radio de l’équipe
du commandant Bertrand, ou encore par les postes de Berne et de Lisbonne.
Afin que leur origine ne puisse être décelée, les
rapports émanant de la Source K subissent par le poste P 2 un démarquage
avant leur transmission à l’échelon supérieur.
Cette précaution interdit une remontée à contresens
de la filière, et elle est d’autant plus facile à assurer
qu’il ne peut y avoir de retours par cette voie-là. Pour compléter
la sécurité, un cloisonnement rigoureux verrouille les maillons
de la chaîne par groupes de deux à quatre unités.
Ainsi, les opérateurs n’ont qu’un seul interlocuteur
Combaux, mais les techniciens des P.T.T., mis à part Sueur et Keller,
ne le connaissent pas. Parallèlement, les agents de liaison ignorent
tout des postiers. En fait, le pivot de l’affaire est le capitaine
Combaux ; en cas d’intervention ennemie, c’est donc lui qu’il
convient de protéger.
Robert Keller l’a parfaitement compris, et il s’y emploiera
le moment venu.
Devant les résultats inespérés des écoutes
sur le câble Paris-Metz, Sueur, Combaux, et Keller envisagent de
réaliser la même opération sur le Paris-Strasbourg.
Une étude fouillée des grands circuits a montré que
les liaisons téléphoniques allemandes empruntent également
ce canal.
En juillet 1942, Robert Keller présente à ses deux amis
le schéma de la dérivation à entreprendre. Entre-temps,
un troisième opérateur
formé par le S.R. a été mis à la disposition
de la Source K par le poste P 2.
Il s’agit d’un jeune Alsacien : Prosper Riss, qui reçoit
également une couverture d’inspecteur d’assurances de
« La Nationale ». Combaux le charge de rechercher un pavillon
libre sur le parcours de la ligne souterraine. Il en trouve bientôt
un à Livry-Gargan dans lequel il s’installe aussitôt.
Sur la demande de Sueur, M. Lebedinski commande les pièces détachées
nécessaires au montage de nouveaux amplificateurs, tandis que Pierre
Guillou, promu depuis peu au grade de chef d’équipe, délimite
sur place le tracé de la tranchée de jonction.
Fin août, l’aménagement du local est terminé
; il ne reste plus qu’à mettre en place les amplificateurs
et à effectuer la dérivation.
Cependant à Noisy-le-Grand, le climat se détériore.
Les Allemands ont décidé d’implanter une forte unité
à l’Est de Paris et, dans cette perspective, un détachement
précurseur sillonne la bourgade afi n de rechercher de nouveaux
cantonnements. Une vaste opération de réquisition de locaux,
de maisons, de chambres commence, au grand dam des Noiséens furieux.
Dans le quartier où se trouve situé le pavillon des écoutes,
la grogne s’affirme particulièrement, et plusieurs réclamations
parviennent à la Mairie pour signaler à la commission de
recensement qu’au lieu de « vouloir imposer à de braves
Français l’hébergement d’officiers allemands,
elle ferait mieux de s’intéresser aux individus suspects,
vivant d’on ne sait quoi, qui hantent un pavillon même pas
trop meublé ».
À ces protestations s’ajoutent des commérages de quartier
qui évoquent l’activité d’espions... allemands
!
Nous sommes à la mi-septembre, et les ragots prolifèrent
de plus en plus.
Prévenu par Édouard Jung, le capitaine Combaux, s’inspirant
de la règle des services secrets : « la sécurité
prime tout », décide alors le repli immédiat de la
station clandestine.
Dans la nuit du 16 au 17 septembre, Robert Keller, Pierre Guillou, et
Laurent Matheron, démontent toute l’installation, colmatent
les têtes de câble, et font disparaître toute trace
de la dérivation. Le lendemain, M. Sueur et Deguingamp viennent
récupérer les amplificateurs qu’ils transportent à
Livry-
Gargan.
Le 18 au soir, plus rien ne subsiste de cinq mois d’écoutes
permanentes.
Le petit pavillon de Noisy-le-Grand retourne à l’anonymat,
prêt à accueillir les indésirables locataires dont
ses murs ont pourtant enregistré les conversations plus secrètes
de leurs dirigeants.

sommaire
Pendant la guerre, surtout en 1944, le réseau interurbain
subit des dégâts importants. A la Libération, on comptait
2 000 coupures et, sur 130 centres principaux, 45 étaient entièrement
détruits ou avaient leur gros œuvre fortement endommagé
; les 85 autres avaient également subi des dégâts.
Au début de cette période et jusqu’en 1948, la tâche
du Service des lignes à grande distance consista essentiellement
à remettre en l’état l’ensemble du réseau.
En ce qui concerne les câbles, il fallait rétablir leur continuité,
reprendre leur « équilibrage » pour permettre la reprise
de l’exploitation du réseau câblé.
Grâce au dévouement du personnel et à l’organisation
méthodique des travaux, cinq mois après la libération
de Paris, 90 % des circuits de 1939 étaient rétablis, mais
la longueur totale de ces circuits ne représentait encore que 60
% de celle d’avant-guerre.
Evolution des télécommunications durant
la Seconde Guerre mondiale
La guerre avait pratiquement arrêter l’expansion du téléphone
dans le monde entier, sauf en Amérique du Nord et dans quelques
pays neutres.
De 1939 à 1946 la croissance du nombre de postes téléphoniques
sera de 40 % en Amérique du Nord. On constatera une forte diminution
du nombre de postes téléphoniques en service dans les pays
les plus gravement touchés par les destructions de guerre : Allemagne,
Pays de l’Est, Japon, etc. On constatera au contraire une forte croissance
du nombre de postes téléphoniques dans les pays neutres
: 43 % en Suisse et 55 % en Suède.
Même en France, les raccordements se poursuivront et l’accroissement
du nombre de postes téléphoniques de toute nature sera de
20 %.
On connaît les progrès techniques et technologiques remarquables
de l’électronique pendant la guerre, en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis. Mais, il serait injuste de ne pas mentionner ce qui a
été fait en France à la même époque,
malgré l’occupation ennemie.
Les laboratoires français, en effet, parvenaient à mener,
dans une semi clandestinité, des recherches, notamment dans quelques
domaines de pointe tels que les ondes décimétriques, la
télévision à très haute définition,
le radioguidage et le radar.
Les laboratoires de l’administration des PTT, eux aussi, poursuivaient
les études déjà engagées sur les systèmes
de transmission à grande distance par courants porteurs et sur
un nouveau système « d’autocommutateurs SRCT ».
| Le SRCT est le Service des Recherches et du
Contrôle Technique l'ayant conçu un petit autocommutateur
fabriqué à partir de matériel R6, de catégorie
secondaire et en conséquence destiné au déploiement
dans les campagnes, dans le but de remplacer le système dit
automatique-rural qui était en fait semi-automatique déployé
à partir de 1935 le SRCT permet d'automatiser les campagnes.
Il s'agit d'un véritable Commutateur à autonomie d'acheminement (et non pas d'un concentrateur de lignes) ; si l'abonné appelant et l'abonné appelé appartiennent au même Commutateur SRCT, la communication est alors établie par ledit commutateur SRCT. Si l'abonné demandé est extérieur, la communication est acheminée vers le centre de groupement (nodal) de rattachement. - La capacité typique de raccordement est de 200, 400 ou 900 lignes d’abonnés au maximum suivant les variantes. - La portée de raccordement entre un Commutateur SRCT et un centre nodal est de 40 km maximum. - Une ou plusieurs "centaines" d'abonnés peuvent être déportées (détachées) du cœur jusqu'à 20 km de distance pour constituer un sous-centre, mais ce sont autant de "centaines" qui sont à déduire de la capacité totale maximale du Commutateur SRCT. A gauche : Prototype laboratoire du système SRCT en 1949. les commutateurs pas à pas à 51 positions empruntés au système R6. 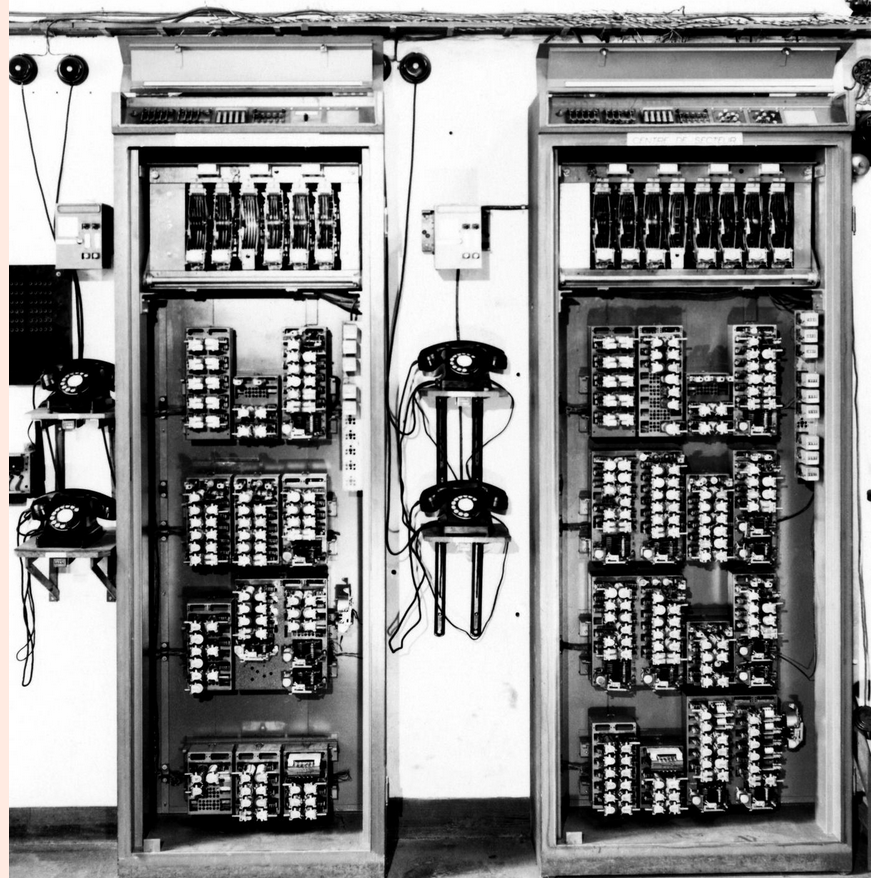
 A droite le commutateur SRCT de Perros-Guirec , c'set le premier Commutateur SRCT mis en service à Perros-Guirec le 5 novembre 1950. Les 4 boîtiers du bas contiennent chacun 1 Enregistreur-Traducteur. - Le système SRCT fut déployé jusques en 1961. |
La reconstruction des branches du réseau téléphonique
et télégraphique français détruites ou endommagées
pendant la guerre commença dès la Libération. Grâce
à l’effort soutenu de son personnel, techniciens et ingénieurs,
l’administration des PTT parvint à remettre en état
très rapidement son réseau interurbain, mais des travaux
importants durent être effectués dans les centraux téléphoniques,
détruits ou très saturés
En 1945, à la Libération, en France, les dégâts
sur les Télécommunications sont considérables :
| Pour ce qui est des installations téléphoniques
elles-mêmes, on peut estimer que 26 centraux automatiques sur
211 et 67 multiples manuels sur 222 ont été détruits
au cours des combats. D’autre part, les troupes allemandes en retraite ont démoli deux grands centraux automatiques à Lille et à Montpellier, 10 multiples manuels et un très grand nombre de bureaux locaux. Un nombre encore plus élevé de centraux a subi de leur part des dégâts plus ou moins graves, entraînant de très nombreuses interruptions de service, de plusieurs jours à plusieurs mois. Quant au télégraphe, les troupes allemandes, au cours de leur retraite, détruisent de nombreuses installations. Au moment de la Libération, 53 % des installations sont inutilisables. Les troupes du Reich se sont livrées à un vandalisme qui rend les remises en service particulièrement délicates. Le 6 juin 1944, les troupes allemandes firent sauter les pylônes des grands centres TSF. Au moment de leur départ, ils détruisirent le centre de Pontoise, la station de Croix d’Hins, celle de Lyon-la-Doua, le centre de Saint-Pierre-des-Corps, ainsi que les stations côtières. Pour ce qui est des lignes souterraines à grande distance, la question se pose en d’autres termes. Relativement peu endommagé lors des événements de 1940, le réseau à grande distance subit des détériorations catastrophiques en 1944 : bombardements massifs des Alliés et très nombreuses coupures de la part des Forces françaises de l’intérieur. Pour gêner les communications allemandes, au cœur des combats du débarquement, le réseau fut méthodiquement neutralisé pour paralyser les communications de l’ennemi. Le réseau français à grande distance, si sa destruction n’a pas été totale, se trouve lourdement endommagé : 85 centres d’amplification sur 130 ont subi d’importants dégâts, 45 bâtiments de centres d’amplification sont entièrement détruits ou presque, enfin 2 000 coupures ont littéralement haché le réseau. L’état dans lequel se trouvent les infrastructures, les multiples coupures de câbles et la destruction des stations de répéteurs ne peuvent permettre l’établissement de transmissions téléphoniques efficaces. Or, rapidement, le rétablissement de ces liaisons, dans le cadre des opérations en cours, s’avère tout à fait essentiel. Cahin-caha, il a lieu. Pierre Mendès France, rentré à Paris en septembre 1944, le constate : « Il n’y a rien. Ni électricité, ni courrier, ni gaz, ni transport. Seulement le téléphone, dont on abuse… ». En effet, pour les alliés du « Signal Corps », assistés de fonctionnaires français, la remise en ordre des liaisons longue distance devient vite un enjeu de taille. |
Le 25 juin 1945, la liberté du trafic téléphonique
est rétablie dans 42 départements français.
Les centraux détruits sont peu à peu
réparés. Certains câbles ont, en outre, été
équipés de matériel moderne (courants de haute fréquence)
qui en a considérablement accru le rendement.
En Septembre 1945, 50.000 abonnés attendent un poste téléphonique.
Cette pénurie de téléphones est due au manque de
matières premières (métaux, isolants, résines
phénoliques), mais les premiers prototypes de postes Universel
43 (U43) sont dorénavant prêts.
Il ne manque que le retour des matières premières en quantités
suffisantes pour lancer la fabrication en masse.
Le réseau téléphonique a besoin d'être reconstruit,
mais le pays est ruiné par quatre années d'occupation
et à la suite de la première réduction de crédits
intervenue à partir de 1934, conséquence indirecte de la
grande dépression de 1929 née aux États-Unis, et
des résiliations massives d'abonnements d'abonnés ruinés,
le retard téléphonique français ne pourra plus être
rattrapé avant une trentaine d'années.
Les derniers travaux de remise en service d'urgence prendront fin en 1948
.
À la Libération, par l'arrêté
du 18 novembre 1944, Jean Dauvin, trop lié au régime de
Vichy, est remplacé par Henri Jannès, responsable des télécommunications
en Afrique du Nord en 1943 et ancien résistant gaulliste. L'ordonnance
de validation n° 45-144 signé par le général
de Gaulle le 29 janvier 1945 conserve le caractère interministériel
du CNET, mais jusqu'en 1954, le CNET dirigé par Henri Jannès
devra coexister avec le Service des recherches et du contrôle technique
(SRCT), créé par le ministère des PTT le 25 avril
1946, et dirigé par Pierre Marzin, ancien adjoint de Jean Dauvin.
Le SRCT deviendra vite un centre de recherches plus important que le CNET.
La Direction générale des Télécommunications
(DGT) poussera à partir de 1953 à l'abandon par le CNET
de son caractère interministériel et à son intégration
de fait dans le SRCT. Les deux organismes fusionnés prendront le
nom de CNET.
En 1946, le 14 janvier, la liberté
du trafic téléphonique est rétablie sur l'ensemble
de la France Métropolitaine.
Selon un nouveau plan de numérotation, l’abonné
disposait d’un numéro en deux parties. La première
était constituée d’un indicatif de série à
deux caractères dans le cas général (identifié
PQ pour préfixe quantitatif) et à trois caractères
pour la région parisienne.
Dans les réseaux urbains des très grandes villes, le nom
des centraux a été conservé, l’abonné
devant en composer les deux ou trois premières lettres. En province,
l’indicatif de série correspondait au nom de la ville. La
deuxième partie du numéro, quatre chiffres (MCDU) désignant
l’adresse de l’abonné dans le commutateur, individualisait
l’abonné. Pour sortir de sa zone de numérotation régionale,
l’abonné devait composer le 16 (indicatif de l’interurbain
automatique national), puis le numéro à deux chiffres caractéristique
du département ou groupe de départements demandé,
suivi du numéro à six chiffres.
La Direction Générale des Télécommunications
est créée par Décret n°46-1016 du 10 mai
1946 du Gouvernement Provisoire de la République Française,
relatif à l’organisation de l’administration centrale
du ministère des Postes, Télégraphes, Téléphones
(BO PTT n°14 du 20 mai 1946). M. Charles Lange (25 octobre 1889 -
23 septembre 1965) est alors maintenu en poste, son action de Résistant
ayant pesé. La Seconde Guerre mondiale
eut au moins deux conséquences majeures sur les télécommunications.
Leur importance stratégique éclata au grand jour avec le
développement des radars ou de la radiotéléphonie
portative.
La recherche en télécommunications apparut comme un élément
stratégique influant directement sur la puissance militaire d'un
pays.
En France la création du CNET (Centre National d'Étude des
Télécommunications) en 1944 visait à répondre
à cet impératif.
En l'espace d'une quinzaine d'année le CNET devint rapidement le
numéro deux mondial dans le domaine de la recherche en télécommunications
derrière les Bell Labs étasuniens, laboratoires de recherche
attachés au géant des télécommunications outre-Atlantique
ATT.
Par ailleurs face à la place que la radio avait prise dans la vie
quotidienne des français pendant les années d'occupation
l'usage du téléphone stagna en France dès le sortir
de la guerre, et ce d'autant plus que le service téléphonique
était absent des les priorités de reconstruction inscrites
dans le premier plan.
La première tâche du CNET est de rétablir un réseau
de télécommunications (téléphone et télégraphe)
en France. Sa première réalisation visible par le grand
public est, en 1953, la retransmission par voie hertzienne du couronnement
d'Élisabeth II.
Néanmoins, ces dix premières années
ont aussi permis au CNET d'inventer des solutions innovantes, comme la
technique des courants porteurs en 1949 mais de connaître un échec
avec le système de commutation L43.
Le retard téléphonique français ne pourra plus
être rattrapé avant une trentaine d'années, d’autant
que le budget annexe des télécommunications, institué
par la loi de finances du 30 juin 1923 articles 70 à 79, était
utilisé en variable d’ajustement par les innombrables gouvernements
de la IVe République qui se succédaient à une rythme
parfois plus rapide que les saisons…
En effet, la IVème République va plonger pour une quinzaine
d'années dans une série de troubles puis de guerres coûteuses
dans toute l'Union Française. De ce fait, la nécessité
d'améliorer le téléphone français, qui est
déjà une évidence pour les Ministres des PTT, passera
hélas en second plan. Le Pays entier est à reconstruire
dans tous les domaines, mais l'argent manque...
En 1946, la France comptait environ
1,27 million d'abonnés et neuf ans plus tard, en 1955,
ce nombre ne dépassera pas les 1,75 millions.
Entre 1955 et 1968 la progression sera légèrement
plus rapide mais restera faible, le nombre d'abonnés dépassera
3,5 millions .
En 1947 Un petit nombre d'appareils de type U43
arrive sur le marché, il ne diffère que par sa magnéto
à manivelle, ce qui entraîne une carcasse bakélite
plus trapue et son combiné qui toute fois, utilise les mêmes
capsules micro et récepteur que le U43.
Il est fabriqué en très petit nombre par Ericsson cet appareil
est très souvent poinçonné (avec goût…)
au fer rouge sur le devant.

Petite anecdote, pour les abonnés encore reliés sur un système
appelé SRCT qui utilisait le mode BL (avec pile),
ce qui obligeait le client à donner un coup de magnéto en
fin de conversation de façon à en avertir l’opératrice.
Bien évidemment, cette manœuvre était souvent oubliée
.
Heureusement avec l'arrivée des systèmes Rotary,
R6.... à batterie centrale, l’opératrice distante
pouvait superviser l’état de la communication.
En 1946, selon un
nouveau plan de numérotation, l’abonné disposait d’un
numéro en deux parties. La première était constituée
d’un indicatif de série à deux caractères dans
le cas général (identifié PQ pour préfixe
quantitatif) et à trois caractères pour la région
parisienne.
Dans les réseaux urbains des très grandes villes, le nom
des centraux a été conservé, l’abonné
devant en composer les deux ou trois premières lettres. En province,
l’indicatif de série correspondait au nom de la ville. La
deuxième partie du numéro, quatre chiffres (MCDU) désignant
l’adresse de l’abonné dans le commutateur, individualisait
l’abonné. Pour sortir de sa zone de numérotation régionale,
l’abonné devait composer le 16 (indicatif de l’interurbain
automatique national), puis le numéro à deux chiffres caractéristique
du département ou groupe de départements demandé,
suivi du numéro à six chiffres.
L’invention du transistor
C’est en 1947 que fut inventé le transistor par trois chercheurs
américains du Bell Telephone Laboratories : John Bardeen, Walter
Brattain et William Shockley.
Le transistor fur présenté pour la première fois
en public par le Bell Telephone Laboratories de New York en 1948. Il s’agissait
alors d’un transistor à pointes au germanium. Trois ans plus
tard, William Shockley découvrit le transistor à jonction
qui allait révolutionner toute la technique de l’informatique,
des télécommunications et de l’électronique
en général. De même que la première moitié
du 20ème siècle avait été dominée par
l’invention de la triode, en 1906, par Lee de Forest, et par la génération
des « tubes radio » qui en dériva, de même la
seconde moitié du 20ème siècle sera dominée
par le transistor et par tous les dispositifs à semi-conducteurs
de plus en plus complexes et de plus en plus performants qui apparaîtront
progressivement sur le marché et qui modifieront profondément
toutes les techniques électroniques. Mais il faudra presque une
dizaine d’années pour que l’on prenne conscience de l’importance
de cette découverte, son utilisation systématique ne commencera,
en effet,
qu’en 1955, lorsque les Bell Telephone Laboratories mettront au point
le « transistor à base diffusée ». En 1956,
Bardeen, Brattain et Shockley recevront le prix Nobel de physique pour
cette découverte.
La période d’après-guerre a été marquée,
en télécommunication par un maintien de la croissance aux
Etats-Unis, par une croissance rapide et régulière de l’Europe
et par une ascension fulgurante du Japon qui a réussi à
tenir, pendant un quart de siècle, le rythme de croissance, le
plus rapide qu’un pays ait jamais connu sur une période aussi
longue. En 1975, l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon
rassemblaient 90 % du parc téléphonique mondial.
En 1948 Le système
ROTARY est reconduit le 18 mars par le Comité
Technique des PTT, moyennant modernisations (Rotary 7A1N).
Après un marché d'essai, dont la mise en service intervient
en 1951 au Vésinet, il est décidé le 9 juin 1953
que l'automatisation du réseau de Paris serait parachevée
en système Rotary 7B1.
Pour les appareils, mis à part l’apparition pour le cadran
d’un disque perforé en plexiglas au environ des année
1950, il faut attendre 1954 pour voir quelques innovations.
Tout d’abord, la mise sur le marché d’un modèle
luxe. Electriquement en tous points identique au modèle BCI il
est réalisé en mélanine blanche ou ivoire
(la bakélite ne pouvant prendre des teintes claires) et porte le
référence 339.
A noter que au environ des années 60, certaines séries seront
réalisées en kralalite, matière qui vieillit très
mal et prend un aspect jaunâtre.



A cette même époque apparaît également une version
murale. Il faut dire que pour les demandeurs de ce type d’appareil
on en était resté au 1924 boîtier tôle format
« kilo de sucre » . Sur le plan électrique, une nouvelle
bobine d’induction est mise au point, nettement plus performante
sur le plan de l’anti-local, elle équipera dorénavant
le modèle universel qui de ce fait prend la référence
328.
Années 1950-1980

 Nouvelle identité visuelle des PTT à partir de 1953
Nouvelle identité visuelle des PTT à partir de 1953
DEBUT DU SYSTEME CROSSBAR, commutateurs à
barres croisées


5 Novembre 1950 Le
premier SRCT est inauguré à Perros-Guirec. Il sera
déployé jusques en 1961
C est un petit autocommutateur fabriqué à partir de matériel
R6, destiné au déploiement dans les campagnes, pour remplacer
le système dit automatique-rural qui était en fait semi-automatique
déployé à partir de 1935 Conçu par l'Ingénieur
en chef des Télécommunications Albert de Villelongue, sa
capacité typique de raccordement est de 900 lignes d’abonnés.
Si l'abonné appelant et l'abonné appelé appartiennent
au même Commutateur SRCT, la communication est alors établie
localement par le commutateur. Si l'abonné demandé est extérieur,
la communication est acheminée vers le centre de groupement (nodal)
de rattachement.
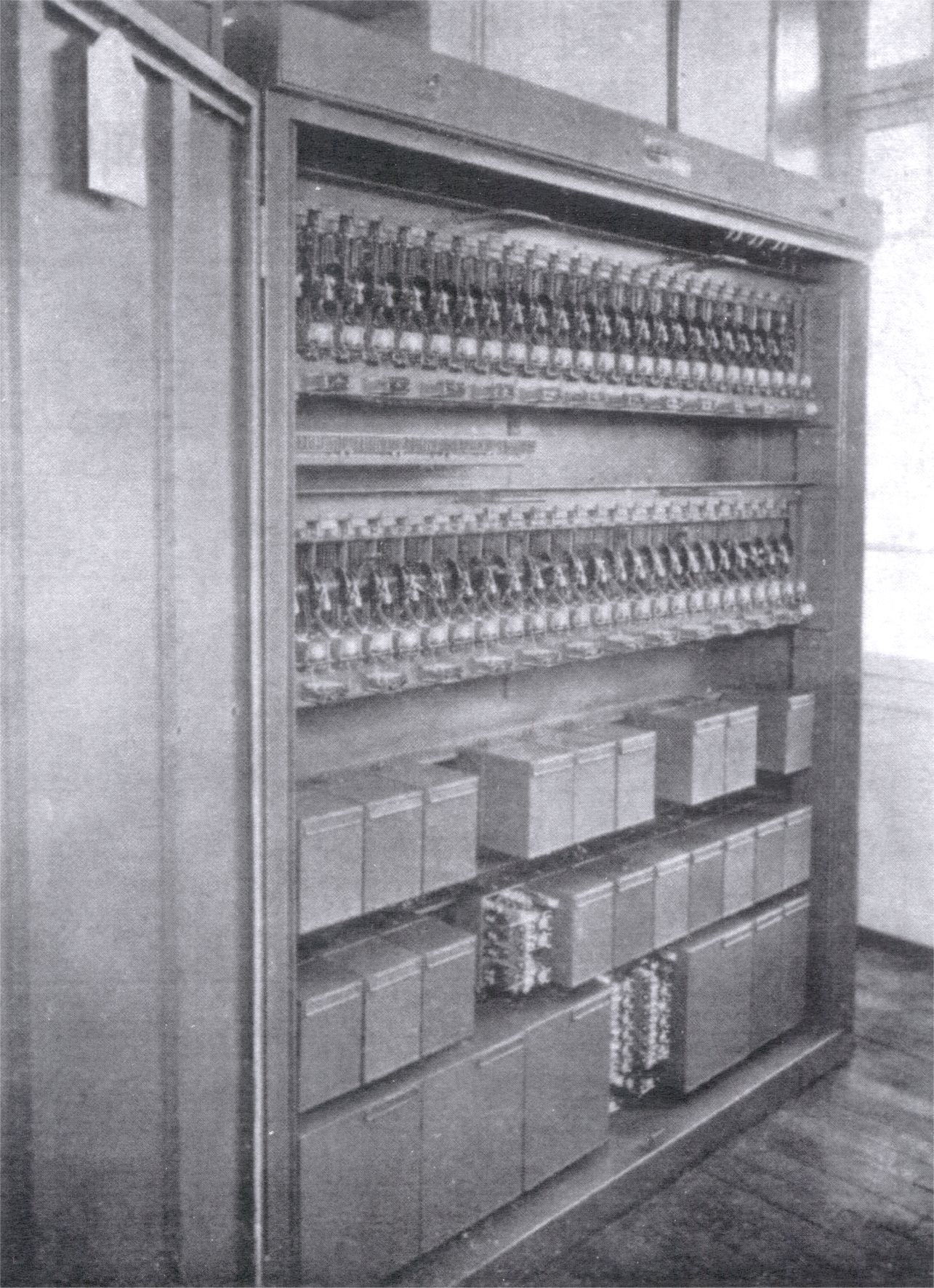 Srct de Perros-Guirec
Srct de Perros-Guirec
Juillet 1951 Le premier commutateur
L43 est mis en service à Nancy
L 43 LESIGNE 43) est un Commutateur, conçu par la Compagnie Industrielle
des Téléphones, à partir de l'année 1943,
utilisant le même matériel que le R6 N1 mais adopte un principe
de sélection différent, sans dispositif Orienteur. En effet,
dans ce système, les sélecteurs sont actionnés directement
par les enregistreurs, à l’aide d’un réseau de
commande par fils distincts des fils véhiculant les conversations
téléphoniques, ce qui permet d'économiser des baies
d'équipements et de faire théoriquement baisser le coût
des Commutateurs.
Le 22 janvier 1948, le Conseil Technique des PTT propose de faire construire
un prototype L43 à Nancy qui sera mis en servie en 1951.
Ce système n'a pas donné beaucoup de satisfaction, seulement
13 Commutateurs L43 seront mis en service en France.
A Paris un centre Interurbain entièrement automatique
de type R6 2FR est conçu à
partir de 1949 par les ingénieurs, chargé d'acheminer jusqu'à
200 communications interurbaines au départ de Paris, simultanément.
C'est la ville de Fontainebleau,
la première destination interurbaine automatique au départ
de Paris, choisie à titre expérimental.
Côté centre R6 à l'hôtel
de la Poste de Fontainebleau, il faut adapter l'ancien système
sans Enregistreur (R6 simple) qui avait été mis en service
en Juin 1942. Le centre doit faire l'objet d'importantes modifications.
En résumé, le Commutateur R6 de Fontainebleau
doit devenir "intelligent" afin de pouvoir dialoguer avec Paris,
en automatique à partir du 26 mai 1951...
Les dernières modifications sont faites,
les essais sont concluants ... il ne reste plus qu'à mettre en
exploitation.
Le 26 mai 1951,
la première relation interurbaine par voie entièrement
automatique est ouverte de Paris vers Fontainebleau.
En 1950 les télécommunications françaises,
se caractérisent pas un réseau vétuste, mal entretenu
et des centraux vieillis,
il y a que 1,4 million de lignes téléphonique, soit
3,3 pour 100 habitants.
Les appels interurbains et internationaux passent par une opératrice,
avec une attente stigmatisée par F. Reynaud dans le “ 22 à
Asnières ” (1955). Peu demandes, donc peu de créations
de lignes, des délais d’attente interminables, jusqu’à
3,5 ans pour satisfaire 90 % des demandes (aux États-Unis 99 %
des demandes sont satisfaites en 3 jours).
Le contingentement des lignes devient impopulaire, les
délais d’attente plus mal perçus.
Fin 1953, 235.200 abonnés, soit 14,70 % du total étaient
desservis par des autocommutateurs ruraux et 225:100, soit 14,07 % par
des standards manuels Les demandes de raccordement téléphonique
passent de 119 000 en 1964 à 442 000 en 1966.
En 1961,le nombre d’abonnés ruraux bénéficiant
de l’automatique intégral atteignait à peine 80 000.
En revanche, l’automatique rural, qui n’exigeait que des investissements
assez réduits, se développait rapidement. Mais l’automatique
rural, avec ses petits autocommutateurs installés dans des bureaux
de poste, conduisit à une véritable prolifération
des « points de commutation » sur le territoire français,
soit près de 30 000 en 1948 !
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les systèmes
de comnutation électromécaniques rotatifs de type Strowger,
R6 ou Rotary, ce dernier étant choisi pour équiper Paris
en 1926, sont en effet apparus dépassés.
En 1944-1945, l'état des télécommunications en France
était tragique.Sur les cent quarante centraux automatiques existants,
trente neuf avaient été détruits par la guerre et
beaucoup étaient hors service. Avec à peine quatre lignes
pour cent habitants, la France avait un retard important sur ses voisins
(sept lignes pour cent habitants en Allemagne, treize en Grande-Bretagne,
quinze aux États-Unis).
Une Commission du plan de modernisation de l'équipement était
bien nommée, mais le Gouvernement parait au plus pressé
:remédier à la pénurie alimentaire et énergétique,
reconstruire les infrastructures routières et portuaires...
Le développement des télécommunications a donc attendu
le Ve Plan(1966) pour être évoqué. Il ne deviendra
une priorité qu'en1975.
A la fin des années 50, une technique nouvelle, plus souple d'exploitation
et dont la simplicité diminuait sensiblement les coûts d'entretien,
semblait prometteuse le Crossbar
.
La téléphonie automatique avait d’abord été réservée aux communications entre abonnés d’une même agglomération. L’établissement de communications interurbaines nécessitait toujours l’intervention de deux opératrices au moins : l’une au central de départ, l’autre au central d’arrivée. L’établissement intégralement automatique des communications posait des problèmes nombreux et complexes : signalisation entre centraux, information de l’abonné demandeur, plan de numérotage régional et national, taxation… C’est pourquoi, jusque vers 1950, l’exploitation interurbaine automatique ne fut mise en œuvre que dans un petit nombre de pays (Suisse, Belgique) ou dans des zones limitées (Bavière, Côte d’azur). De grands pays, comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, y étaient opposés, préférant l’interurbain semi-automatique où les opératrices de départ établissaient et taxaient les communications.
Développement du réseau Télex
en France
Créé par décret en 1946, le réseau télex
français ne comportait encore que 55 abonnés privés
à la fin de 1948, répartis sur quatre centres de commutation
manuels (Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux). En 1950, vinrent s’ajouter
à ces centres Lille et Nancy. Le nombre d’abonnés privés
passa alors à 110. En 1955, le nombre d’abonnés était
encore modeste, 750, tandis qu’à la même date, en Allemagne
fédérale, il atteignait déjà 16 000 ! En revanche,
en Grande-Bretagne, il n’y avait, à la même époque,
que 2 500 abonnés. La France comblera peu à peu son retard
par rapport à la Grande-Bretagne, puisque, à la fin de 1975,
les densités en abonnements principaux télex étaient
très sensiblement les mêmes dans les deux pays (un poste
principal pour 1 000 habitants). Au contraire, l’Allemagne fédérale
consolidera son avance, non seulement en Europe, mais même dans
le monde, son réseau télex étant, à lui seul,
presque aussi important que celui des Etats-Unis
Côté transmissions
En France, la généralisation des systèmes
« à courants porteurs » permit de mettre en
œuvre d’autres méthodes. Dès lors, avec une avance
de plusieurs années sur les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, la
France allait ouvrir l’ère de « l’interurbain automatique
».
L’administration française a été la première,
en novembre 1951, à automatiser entièrement une liaison
aussi importante que Paris – Lyon, soit plus de 50 circuits sur 550
kilomètres. Puis, ce fut l’automatisation d’une grande
liaison par câble coaxial (Paris – Toulouse). On utilisa, pour
cela, le câble mis en service en 1947.
Hélas, si les dispositions techniques étaient satisfaisantes,
la cadence de développement de tous ces équipements et circuits
souffrait des limitations budgétaires. En fait, si l’administration
française des PTT disposait des moyens techniques nécessaires,
ce n’est qu’avec le cinquième et le sixième Plan
qu’elle parviendra à obtenir de l’Etat les moyens financiers
qui lui permettront de développer l’automatisation du trafic
interurbain et de construire les « centres de transit régionaux
» (CTR) indispensables à la modernisation du réseau
de télécommunication français.
Quelques années plus tard, la généralisation de l’exploitation
interurbaine automatique au plan national amenait l’administration
française à se préoccuper d’un plan de numérotage.
Un plan à 8 chiffres fut arrêté en 1955. Ce plan de
numérotage national demeura valable pendant une trentaine d’années.
Il ne sera remanié qu’au début des années 80...
Mais l’événement le plus marquant de cette époque
fut la mise en service du premier câble coaxial du réseau
français. C’est à la veille de la guerre qu’avait
été entreprise la pose d’un câble coaxial de
gros diamètre (5/18 mm), prévu pour 600 voies téléphoniques,
sur l’itinéraire Paris – Toulouse – Bordeaux. Mais
les hostilités entraînèrent l’arrêt des
travaux ; ce n’est qu’en 1947 que la première liaison
Paris – Toulouse par câble coaxial sera effectivement mise
en service.
En fait, c’est seulement à partir de 1950 que l’administration
française s’engagera résolument dans le développement
des artères à grande distance par câbles coaxiaux.
Le premier câble coaxial, conforme aux nouvelles recommandations
du CCITT sera posé entre Lyon et Grenoble. A partir du second semestre
de l’année 1954, le rythme des travaux s’accélère
et le réseau français de câbles coaxiaux se développe
très rapidement jusqu’en 1955, grâce aux programmes
d’infrastructure financés par l’OTAN. Au cours de l’année
1954, on posera 1400 kilomètres de câbles ; mais il faudra
attendre près de 20 ans (1972) pour retrouver cette cadence
Le 5 avril 1952 est inauguré le
câble coaxial Dijon - Nancy. Cette seconde liaison coaxiale
permet la transmission simultanées de 960 voies téléphoniques,
sur une distance de 281 km . Puis en Octobre 1952
l'artère coaxiale Paris - Bordeaux est mise en service, équipée
de 6 répéteurs-régénérateurs à
transistors. Avec l'arrivée du transistor inventé en 1948,
les amplificateurs et les modulateurs analogiques (les multiplexeurs)
se miniaturisèrent, devinrent plus fiables et moins coûteux,
si bien qu'ils furent désormais disposés tous les 4,5 km,
ce qui permit d'atteindre une bande passante exploitable de 12 MHz, soit
2.700 voies à la fin des années 1950. En combinant des câbles
coaxiaux entre eux, en les regroupant nous pouvions multiplier le nombres
de voies de conversations téléphoniques analogiques
C'est grâce à la technologie de Câbles Coaxiaux que
le téléphone interurbain a pu être multiplié,
grandement accru à partir du début des années 1950
sur tout le territoire national.
Le Multiplexage Analogique permettait une qualité de service très-élevée,
allant de 12 voies en paires symétriques (fréquence supérieure
jusque 60 kHz) jusqu'à 10.800 voies téléphoniques
sur un même câble coaxial (fréquence supérieure
jusque 60 MHz), qui perdura jusques à la fin de l'année
1997. Cette technologie analogique fut donc exploitée jusqu'à
son maximum, en employant des câbles métalliques coaxiaux,
si bien que jusque vers la fin des années 1950 la plupart des ingénieurs
des télécommunications ne juraient que par le coaxial qui
permettait de multiplier les voies téléphoniques en utilisant
le spectre de fréquences disponibles.
Les Faisceaux Hertziens
Dès la Libération en Mai 1945, la
France entreprend la réalisation d'une nouvelle manière
de transmettre les conversations téléphoniques à
distance. L'étude ayant débuté discrètement
sous l'occupation en 1941, par des expériences de propagation des
ondes centimétriques dans les environs de Toulon. Pour ce faire,
elle s'inspire de la technologie du radar améliorée par
nos amis britanniques dès le début de la seconde guerre
mondiale (nos amis ayant en cela bénéficié des résultats
prometteurs menés par la France et brevetés à partir
de 1934, que nous avions transférés en Grande-Bretagne in-extremis
avant notre invasion - ce qui permit à la Grande-Bretagne de ne
pas s'effondrer sous le poids de la Luftwaffe).
Le 19 avril 1946, ont lieu pour la première
fois en France les premiers essais de téléphonie transmise
par Faisceau Hertzien en ondes ultra-courtes entre Paris et Montmorency,
en présence de M. le Ministre des PTT - Jean Letourneau qui inaugure
le dispositif installé dans la forêt de Montmorency. L'autre
extrémité située à Paris, est installée
dans les murs du Centre Téléphonique Vaugirard (rue Jobbé-Duval.)
La première liaison expérimentale est de 20 km à
vol d'oiseau et il est possible de transmettre 12 voies téléphoniques
simultanément.
Les voies téléphoniques créées permettent
d'écouler les communications entre Paris et Enghien. L'expérimentation
dure environ un an.
C’est également à la même époque,
en 1951, qu’est installé, en France, le premier faisceau hertzien
de télévision, mis en service par la Radiodiffusion–Télévision
française, entre Paris et Lille.
Mais le véritable point de départ du réseau de faisceaux
hertziens français se situe en 1950, lorsque est décidé
la réalisation, sur les principaux axes stratégiques partant
de Paris, de faisceaux hertziens à grande capacité, en ondes
centimétriques. Comme pour les câbles coaxiaux, le financement
fut assuré en grande partie, à cette époque, par
les crédits de l’OTAN. L’équipe de faisceaux hertziens
du CNET fut chargée des études et de la mise en
exploitation des premières grandes liaisons. La première
liaison expérimentale, réalisée avec ce système,
dit GDH 101 (grande Distance Hertzien), fut établie et essayée
en juin et juillet 1951. Le planning de réalisation de la liaison
Paris – Lille était très serré, car les administrations
française et anglaise des PTT et de Radiodiffusion et Télévision
avaient mis sur pied un projet ambitieux de liaison de télévision
Londres – Paris. L’objectif était de transmettre de Londres
à Paris les images de la cérémonie du couronnement
de la reine d’Angleterre. Les délais furent tenus et, le 2
juin 1953, les images du couronnement d’Elisabeth II parvinrent parfaitement
à Paris. La construction du faisceau hertzien Paris – Strasbourg
fut menée, elle aussi, rapidement : la mise en service eut lieu
en décembre 1953.
L’année suivante, c’était Paris – Lyon, liaison
qui fut prolongée en décembre 1954 jusqu’à Marseille.
Ainsi, ces trois grandes artères de faisceaux hertziens avaient
été mises en place en moins de deux ans.
...
Les liaisons analogiques demeurent sensibles aux parasites et à
l'affaiblissement électrique. Elles demeurent donc chères
à exploiter par l'usage obligatoire d'amplificateurs qui nécessitent
d'être multipliés partout le long des liaisons de transmissions
et d'équipes de techniciens chargés de les étalonner
et dépanner régulièrement.
Au niveau territorial le développement des réseaux
de télécommunication a suivi une évolution différente
à Paris et en province : on constate un centralisme des équipements
et des réseaux de télécommunication de pointe sur
Paris ; alors qu’en province on observe des disparités régionales
et des équipements moins performants dans les zones rurales, moins
peuplées.
L'explosion du trafic téléphonique à partir du début
des années 1960 rendait la situation intenable ; il eût
fallu multiplier sur tout le territoire national le nombre de câbles
multiplexés analogiquement, avec les effectifs qui aillent avec,
dans des proportions tout bonnement utopiques techniquement et matériellement.
Il fallait donc trouver une nouvelle solution technologique... : La Transmission
par Satellites.
Au début des années 50, les télécommunications
françaises disposaient de moyens techniques modernes, tout au moins
en transmission, car, en commutation, le problème de l’adoption
d’un nouveau système devait bientôt se poser ; il apparaissait,
en effet, que le système « L43 » avait des possibilités
limitées et que le Rotary « 7 B I » ne pouvait être
généralisé.
Une mission d’ingénieurs français se rendit en Suède,
à la fin de l’année 1949, puis, quelques mois après
aux Etats-Unis. Les ingénieurs français firent alors connaissance
avec ce que l’on appelait le matériel « crossbar »
; dans ce matériel, sans organes rotatifs, la connexion s’effectue
en actionnant une barre horizontale de sélection correspondant
à une ligne puis une barre verticale correspondant à une
autre ligne, afin d’assurer au point de croisement de ces deux barres
les contacts nécessaires entre les deux lignes (d’où
le nom de « crossbar » ou « barres croisées »).
Le 26 février 1953 le Conseil
Technique des PTT réuni en séance rend alors un avis demandant
d'étudier les dispositions envisagées dans les systèmes
à barres croisées CROSSBAR.
Le principe de la connexion crossbar a été
inventé en 1913 par l’américain J. N. Reynolds, puis
repris en 1917 par le suédois Betulander.
En 1949 qu’un premier central urbain de type crossbar fut construit
dans la ville de Malmö en Suède ; aux Etats-Unis, à
la même époque, les multisélecteurs crossbar étaient
déjà fabriqués industriellement ; toutefois, leur
utilisation n’était pas encore complètement maîtrisée.
En France, les PTT commandèrent, en Avril 1954 par l'administration
pour expérimentation en grandeur nature., un premier central prototype
PENTACONTA de 2 000 lignes, qui fut mis en service en juillet
1955 à Melun. Parallèlement, la société
française des téléphones Ericsson mettait au point
un système crossbar, dit CP 400, qui utilisait un multisélecteur
suédois adapté aux besoins français. Le premier central
CP 400 entra en service, à Beauvais, en mars 1956
En 1953, la France renonce à l’emploi
de lettres pour la numérotation, sauf pour la région parisienne,
qui perdra cette spécificité le 1er octobre 1963.
Le plan de 1946 ayant montré ses limites, on définit
un nouveau plan de numérotation en 1955.
Mai au 1er septembre 1960, il restait encore 17 centraux
manuels desservant plus de 700 abonnés, on était encore
loin des attentes de la population
- Arpajon, Arras, Bagnère,BourgesBray sur Seine, Bressuire, Carcassonne,
Cernay, Chauny, Draguignan, Dunkerque Loches, Moissac, Montelimar, Niort,
Sarcelle, Schirmeck.
En 1954, sont créés
par M. le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones
- Pierre Ferri, les Centres d'Abonnements et d'Entretien (CAE)
par l'arrêté n° 417 du 5 mars 1954. Un CAE est
un Centre Télégraphique et Téléphonique, ou
Recette, ayant la responsabilité dans un ressort territorial déterminé
:
- des abonnements au service téléphonique,
- de l'entretien des installations,
- du relèvement des dérangements des lignes et des installations
- et généralement de la comptabilité téléphonique.
Il s'agit à cette époque d'une nouvelle étape visant
à s'organiser de manière plus autonome, plus détachée
de la branche postale sur l'ensemble du territoire national de manière
plus déconcentrée. En effet, avant la création des
CAE, les télécommunications, (construction, exploitation,
maintenance et activités commerciales), étaient rattachées
aux Directions Départementales des Postes.
En 1954, le Laboratoire national de radioélectricité
(LNR), situé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine, est intégré
au CNET. La mise au point, à la même époque, du Tecnetron
par Stanislas Teszner, préfigure le transistor à effet de
champ. La même époque voit l'émancipation des structures
issues des PTT et l'éloignement, budgétaire et humain, des
entités liées aux armées.
1955 Les différents
types d'autocommutateurs en service sont :
1° Le système Strowger qui est un système à
commutateur du type pas à pas, à commande directe , et qui
est le plus ancien .
Ce système a été installé en France de 1927
à 1931 ; il équipe encore quelques réseaux importants
: Lyon, Bordeaux, Rennes . Il y est progressivement remplacé par
des systèmes plus modernes. Il n'est plus fabriqué en France.
Le matériel récupéré au moment d'une substitution
sert à assurer les extensions nécessaires dans certains
bureaux du même type de Lyon.
2° Le système Rotary premier système à
enregistreurs. Ce système est aussi le premier qui ait utilisé
des appareils uniquement rotatifs.
Il équipe soit sous la forme 7 A, soit sous la forme 7 B1 , plus
moderne , le réseaude Paris et de sa banlieue, ceux de Marseille
et de Nantes.
Le plus ancien central Rotary est celui de Nantes, datant de 1927, suivi
par Paris-Carnot, en 1928.
La modernisation de ce système, sous la forme 7 B1 , a été
faite en 1955 ;
Il est fabriqué en France par les deux Sociétés :
Le Matériel . téléphonique et la Société
des Téléphones Ericsson.
3 ° Le système R6 qui présenta successivement
diverses formes, mais qui fut toujours un système à commutateurs
rotatifs.
Le plus ancien central existant, qui fut aussi le premier de ce modèle,
est celui de Troyes ( 1928 ).
Ce système, sous la forme avec enregistreur ou sans enregistreur,
équipe 60 % des abonnés automatiques de province.
Il a fait l'objet de deux normalisations ; la seconde, nommée R6
N2, est la seule qui fasse désormais l'objet de commandes.
Ce système équipe les grands ensembles de Lille, de la Côte
d'Azur, de la Côte Basque , de Toulouse, de Strasbourg, etc.
Il est fabriqué par la Compagnie générale de Constructions
téléphoniques, la Compagnie industrielle des Téléphones
et l'Association des Ouvriers en Instruments de Précision .
4° Le système L 43 qui utilise le même matériel
que le système R6 mais dont les principes d'utilisation sont différents.
Ce système n'a pas tenu ses promesses. Il n'équipe que des
centraux ayant, à l'heure actuelle, une capacité inférieure
à 10.000 lignes .
5° Les systèmes Crossbar : forme moderne des systèmes
« tout à relais ». Ces systèmes sont au nombre
de deux : le système CP 400, de la Société de Téléphones
Ericsson, dont la première réalisation est celle de Beauvais
(1956), et le système Pentaconta, de la Compagnie générale
de Constructions téléphoniques, mis en service à
Melun en 1955.
Ces systèmes font actuellement l'objet de commandes en cours de
réalisation : Douai, Albi, Mazamet, Colmar, pour le Pentaconta
; Tulle, Périgueux, Grasse, pour le CP 400. Ils constitueront désormais
l'équipement des futurs réseaux de province.
En résumé, ne seront plus commandés en France,
à partir de 1960, que :
— le matériel Rotary 7 B1, pour la région parisienne
et les extensions des quelques centraux Rotary de province ;
— le matériel R6, pour les extensions des centraux de province
équipés en matériel de ce type ;
— les matériels Crossbar CP 400 et Pentaconta, pour équipement
des villes de province qui ne disposent pas encore de l'automatique.
1957 Après les premières études menées sur ces deux prototypes, le Conseil Technique des PTT, dans sa séance du 10 juillet propose à M. le Ministre des PTT de commander des Commutateurs CP400 et PENTACONTA pour commencer progressivement le déploiement en province.
22 mars 1958 mise
en service du premier commutateurs R6 N2 à Poitiers par
la CGTT et à Boulogne-sur-mer le 22 juin 1958 par l' AOIP.
- Le Commutateur ROTATIF 1926 N2 le plus récent de France sera
mis en service le 17 avril 1962 à Annecy.
- Les dernières extensions de systèmes R6 déjà
installés auparavant ont été commandées en
Octobre 1978.
CONSTAT 1960 - 1974
: LA FRANCE NE REDRESSE PAS LA SITUATION HERITEE DE LA GUERRE
Jusqu'à la fin des années 1960, le téléphone
était considéré comme un outil d'entreprise, voire
un gadget pour les ménages. Lorsque le ministère des PTT
s'aperçut qu’en 1965, 372 000 demandes d'abonnements étaient
en instance, l’État prit conscience de la carence. La raison
de cette situation est qu’en 1945, il n’y avait pas d'industrie
nationale dans le domaine des télécommunications, contrairement
à l’Allemagne dont l'entreprise Siemens est un des leaders
mondiaux . Cette absence a peut-être joué sur le fait qu'en
1945, le secteur des télécommunications ne fut pas pris
en compte dans la
reconstruction du pays. Une autre hypothèse est que la France fut
conduite à plusieurs reprises par des gouvernements socialistes,
notamment le front populaire sous lequel ont été signés
les accords de Matignon en 1936. Nous émettons l’hypothèse
que l'idéologie marxiste serait peut-être réfractaire
à l’idée de considérer que la productivité
immatérielle d'un échange téléphonique soit
égale à la production matérielle. Si la prise en
main de l’industrie électrique par le gouvernement russe des
années 1920 peut faire figure de contre-exemple, nous répliquerons
que cette innovation a largement servi aux secteurs industriels russes.
Il ne s’agit pas ici d’opposer idéologie marxiste à
l’innovation technique, mais de trouver des éléments
qui expliqueraient que l’État français n’ait pas
investi dans ce secteur.
Les années 1960 s'avéreront très
compliquées pour le téléphone.
Les temps changent et désormais même les gens "ordinaires"
veulent aussi le téléphone chez eux, en plus de ceux qui
l'ont depuis longtemps : les élites, les sociétés,
les professions libérales et les gros commerçants. Les listes
d'attente s'allongent d'année en année. Bien que les ouvertures
de nouveaux commutateurs téléphoniques s'enchaînent
et s'accroissent à partir de l'arrivée des Commutateurs
Crossbar, le rythme d'ouverture est très insuffisant du fait de
l'explosion de la demande.
La France, au sortir de la seconde guerre mondiale et après la
perte de l'Union Française enchaîne les plans d'austérité,
ce dont l'Administration des PTT continuera à faire les frais,
(ce qui est le cas depuis 1934).
Ainsi, la moitié de la France attend le téléphone,
tandis que l'autre attend la tonalité. M. Michel Maurice-Bokanowski
entre le 5 février 1960 et le 14 février 1962 puis M. Jacques
Marette entre le 15 avril 1962 et le 1er avril 1967 incarneront, bien
malgré eux, le rôle ingrat des Ministres des P et T emblématiques
de la pénurie. Ils seront contraints de faire patienter la population
en promettant de nouvelles réalisations au plus tôt possible...
Le projet de loi de programme consacrée
aux télécommunications prévoit pour les trois années
1960, 1961 et 1962, un montant total d'autorisations d'engagement de 180
milliards, réparties par tranches annuelles de 60 milliards.
La plus grande partie des autorisations de programme proposées
concerne le téléphone et se répartit en construction
de bâtiments, équipement des centraux téléphoniques
et aménagement des lignes (établissement de nouvelles lignes
interurbaines et équipement des réseaux urbains).
Les travaux prévus portent essentiellement sur les opérations
suivantes :
— extension de l'automatique de Paris,
— création de nouveaux centraux automatiques en province,
— extension de certains centraux automatiques de province,
— opérations diverses.
a) Extension de l'automatique de Paris.
Il est prévu pour la région de Paris l'installation de 120.000
lignes nouvelles, par tranches annuelles de 40.000 lignes.
b ) Création de nouveaux centraux automatiques en province.
Les nouveaux centraux automatiques de province prévus représentent
au total 138.000 lignes et intéressent les réseaux suivants
:
Agen, Aix-en-Provence, Angoulême, Annemasse, Arles, Aulnay-sous-Bois,
Bergerac, Béthune, Blois, Bourg, Bourges, Castres, Chalon-sur-Saône,
Chelles, Cholet, Compiègne, Colmar, Côte d'Azur (zone automatique),
Cormeilles-en-Parisis, Creil, Dreux, Eaubonne,Épernay, Lille (
2° et 3' tranches), Logelbach, Lourdes, Louviers,Massy, Montbéliard,
Montluçon, Munster, Péage-de-Roussillon, Pézenas,
Poissy, Ponthierry, Ribeauvillé, Roanne, Saint-Brieuc, Saint-Raphaël,
Saintes, Sarcelles, Saumur, Sedan, Sète, Tarbes, Triel,Vence.
Les extensions projetées portent sur 132.000 lignes et concernent
les réseaux ci-après :
Amiens, Angers, Antibes, Besançon, Béziers, Bordeaux, Cambrai,
Cannes, Charleville, Clermont-Ferrand, Épinal, Houilles, Lorient,
Lyon et banlieue, Maisons-Laffitte, Marseille, Melun, Metz, Mulhouse,
Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Pau et région de Lacq, Perpignan,
Poitiers, Rennes, Rouen, Saint-Dié, Saint-Étienne, Saint-Quentin,
Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tourcoing, Troyes,Versailles.
Équipement des lignes téléphoniques interurbaines.
Le montant total des autorisations de programme prévu à
ce titre s'élève à 48 milliards pour les trois années
considérées.
Aménagement des réseaux urbains.
Dans cette catégorie, pour laquelle sont prévues des autorisations
de programme de 35.750 millions pour la , durée de la loi programme,
rentrent notamment les travaux d'extension et de modernisation des lignes
des réseaux urbains et la pose de câbles suburbains.
...
L'équipement en automatique rural a l'avantage essentiel de permettre
aux abonnés des campagnes de bénéficier de la permanence
du service.
Fin 1953 , 235.200 abonnés, soit 14,70 % du total étaient
des servis par des autocommutateurs ruraux et 225:100, soit 14,07 % -
130 - par des standards ; fin 1958, ces nombres sont devenus respectivement
357.075, soit 17,79 % pour l'automatique rural, et 148.760, soit 7,41
% pour les standards.
Au 1 er juin 1959, 387.000 des 501.000 abonnés ruraux, soit plus
des trois quarts, bénéficient de ce système : l'équipement
en automatique rural des campagnes se poursuit donc. Il est en grande
partie financé au moyen des avances remboursables instituées
par la loi n° 51-1506 du 31 décembre 1951. Pour l'ensemble
du territoire, à la date du 1 er mai 1959, 6,5 milliards de francs
ont déjà été versés en vue d'équiper
en totalité ou en partie les départements intéressés
par la question. La plupart des départements ayant déjà
versé des avances (souscrites par les conseils généraux
ou municipaux et les chambres de commerce ou d'agriculture) ont prévu
la poursuite du financement de l'automatique rural au moyen de versements
annuels jusqu'à l'achèvement complet des travaux. La dépense
restant à engager pour l'achèvement de l'équipement
en automatique rural du territoire peut être évaluée
à 1 5 milliards environ, non compris les dépenses de main-d'œuvre
et de transport de matériel. Au rythme actuel nos campagnes devront
encore attendre 15 ans l'achèvement des travaux.
|
Les différents types d'autocommutateurs
actuellement en service sont : L'administration des P. T. T. envisage-t-elle la
création d'un commutateur spécifiquement français
? |
L' évolution à la fois de la technique et des méthodes d'exploitation entraîne et a déjà entraîné une baisse relative importante des tarifs.
1960 Après
mise en exploitation d'une présérie en Commutateurs PENTACONTA
et d'une présérie de Commutateurs CP400, le Conseil
Technique des PTT émet le 16 novembre 1960 l'avis définitif
suivant :
- de cesser au plus vite toute commande de nouveau Commutateur à
organes tournants
- d'adopter au plus vite :
1 - Le système CP400 pour les réseaux locaux et ceux
de province de structures relativement simples.
2 - Le système PENTACONTA, version de grande capacité
pour les réseaux complexes, comme Paris et la première couronne,
les grandes métropoles comme Marseille et Lyon, ou encore Nice
- Côte d’Azur.-
Après ces deux premiers prototypes et quelques
préséries, les Commutateurs téléphoniques
crossbar français sont normalisés en 1963 sous l'autorité
de la SOCOTEL
et prêts pour un déploiement massif en France.
Les différents systèmes électromécaniques
à barres croisées – type crossbar -déployés
en France sont les suivants :
| -CENTRAL AUTOMATIQUE TOUT RELAIS (prototype), -PENTACONTA type 500 (prototype), -PENTACONTA type 1000 A, -PENTACONTA type 1000 B (dont CT4 et CT4 CIA), -PENTACONTA type 1000 C (GCI), -PENTACONTA type 2000, -CP400-BEAUVAIS (prototype), -CP400-PÉRIGUEUX (présérie), -CP400-ANGOULÊME, -CP400-TROYES, -CP400-BOURGES, -CP400-BRIE-COMTE-ROBERT (prototype), -CP400-AJACCIO, -CP400-CT4, -CP400-CIA, -CP400-CUPIDON, -CP400-POISSY, -CP400-GCU, -CP100. Entre 1300 et 1500 commutateurs crossbar seront déployés en France |
Il a existé en France, à partir de 1966, au moins 185 commutateurs électromécaniques crossbar mobiles, en remorques. Ils étaient destinés aux dépannages en cas de sinistres des installations de télécommunications.
| Après 1963, l'administration met en circulation le modèle de téléphone S63  S=Socotel S=Socotel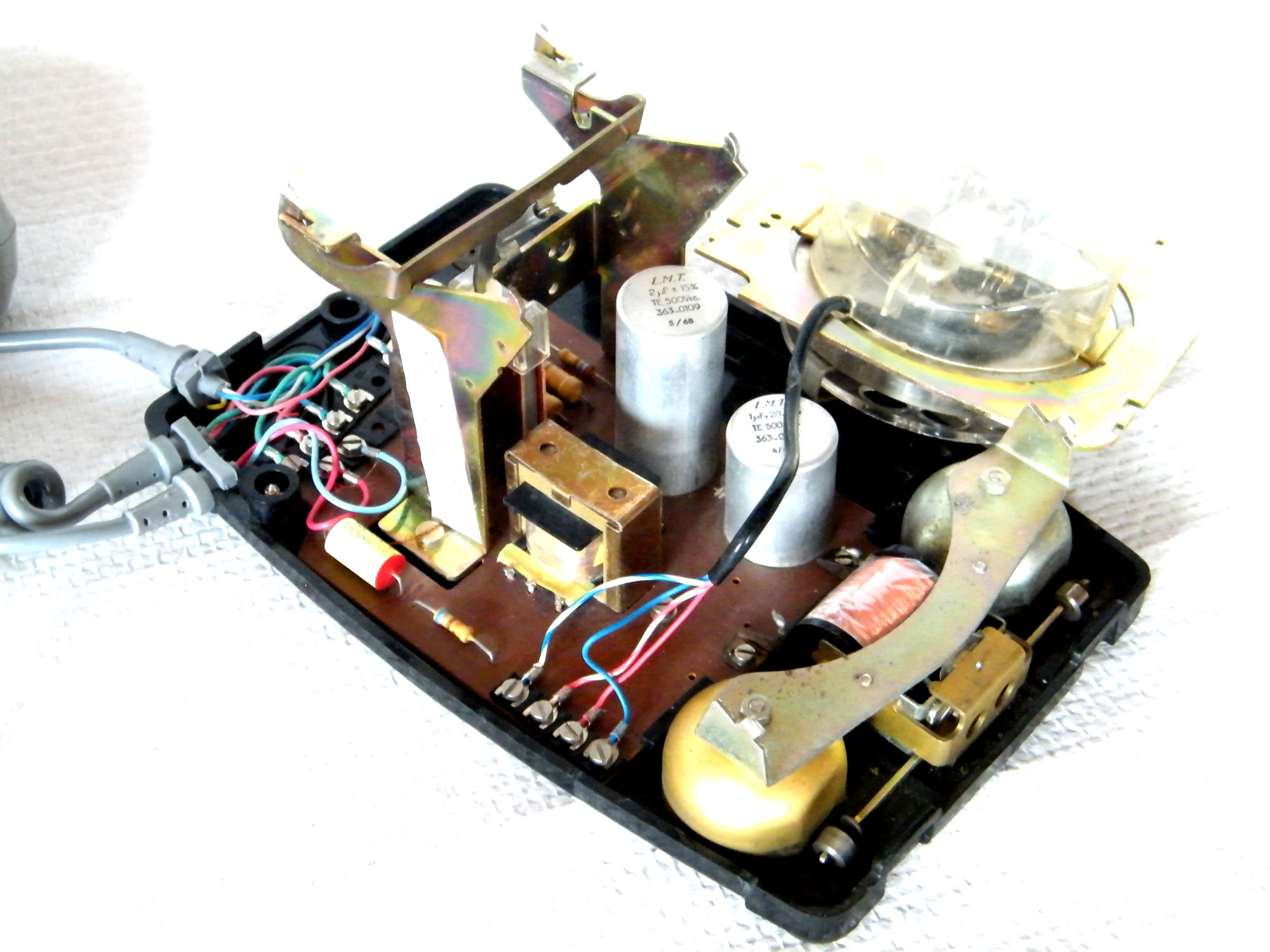 Platine Platine
Commercialisé timidement à partir de 1965/66 ce téléphone gris a une coque en plastique ABS injecté, technologie testée sur les dernières séries de U43, son châssis également en plastique injecté, son câblage sous forme d’un circuit imprimé et sa sonnerie 2 timbres intégrée et réglable. Le cadran est muni d’un cache poussière et sa couronne numérotée est extérieure. A noter également l’apparition d’une version murale ou seule la coque diffère. Il faudra attendre 1972 pour voir apparaitre les poste de 7 couleurs différentes et 1978 pour le clavier à fréquences. |
Les liaisons téléphoniques par câbles
sous-marins
Les liaisons téléphoniques intercontinentales étaient
assurées exclusivement, jusqu’au milieu de ce siècle,
par le moyen des ondes hertziennes de courte longueur d’onde. Cependant,
l’utilisation des seuls moyens radioélectriques ordinaires
ne permit pas, pendant toute la première moitié du 20 ème
siècle, un très grand développement des liaisons
intercontinentales : le prix de la communication demeurait élevé
et le trafic était relativement réduit.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’American Telephone
and Telegraph Compagny, l’AT&T, décide de se lancer dans
la réalisation de liaisons téléphoniques intercontinentales
par câbles sous-marins. En 1956 sera mise en service la première
liaison téléphonique transatlantique, entre l’Ecosse
et Terre-Neuve. Cette liaison (TAT I) est longue de 3 350 kilomètres.
A l’origine, la capacité de la liaison était de 36
communications simultanées. Plus tard, la capacité fut portée
jusqu’à 80 communications simultanées. L’excellente
qualité du service se traduisit presque immédiatement par
une augmentation très rapide du trafic transatlantique.
Une seconde liaison (TAT II) fut mise en service entre la France et Terre-Neuve.
La longueur de cette liaison était de 3 845 kilomètres.
Pendant que se développait ainsi la technique des grands câbles
sous-marins intercontinentaux, la France, de son côté, grâce
aux travaux conduits au Centre National d’Etudes des Télécommunications
et dans l’industrie des télécommunications mettait
au point une technique bien adaptée à des liaisons moins
longues, comme celles de la Méditerranée.
Un premier câble méditerranéen fut mis en service,
par la France, entre Marseille et Alger, à la fin de 1957 et un
autre, entre Perpignan et Oran, en janvier 1962.
Pendant les 20 ans qui suivront la mise en place du premier câble
transatlantique, la technique des câbles sous-marins à amplificateurs
immergés fera des progrès très importants.
En 1963 apparaît une deuxième génération de
câbles : le système à câble coaxial unique se
généralise et se perfectionne. De nouvelles liaisons transatlantiques
de ce type sont mises en service, tous les deux ans environ.
Une troisième génération de câbles basée
sur l’utilisation d’amplificateurs transistorisés est
en cours de développement : l’année 1970 marquera l’avènement
des liaisons sous-marines à grande capacité utilisant des
amplificateurs transistorisés. Le TAT V qui reliera les USA à
l’Espagne en 1970 appartient à cette troisième génération
de câbles.-
En 1975, la quatrième génération de câbles
sous-marins apparaît : les capacités de transmissions dépassent
alors les 3 000 communications simultanées, avec les liaisons «
régionales » mises en service par la France entre Marseille
et Rome, et entre la France et l’Angleterre. Une nouvelle liaison
est établie entre les USA et la France (TAT VI) en 1976.
La capacité de 4 000 communications simultanées est atteinte
(système SG développé par l’AT&T).
Enfin, la cinquième génération de câbles, basée
sur l’utilisation des fibres optiques, fut mise en place à
la fin des années 80. En 1982, la France posait, à titre
expérimental, le premier câble sous-marin à fibres
optiques entre Juan–les–Pins et Cagnes–sur–Mer. Au
plan international, en 1988 fut posé un câble TAT VIII entre
les USA et le France, sa capacité est de plusieurs milliers de
communications simultanées. A l’heure actuelle, en ce début
de 21 ème siècle, c’est encore la technique basée
sur les fibres optique qui est utilisée pour les communications
par câbles.
Quant au nombre total de circuits établis par câbles sous-marins
il a évolué, lui aussi, très rapidement : de l’ordre
de 5 000 en 1965, il atteignait 50 000 en 1975 et approchait 150 000 en
1980.
Ces chiffres montrent l’extraordinaire essor de la technique des
câbles sous-marins. Cette expansion est d’autant plus significative
qu’à partir du milieu des années 60 l’avènement
des télécommunications par satellites a permis aux organismes
de télécommunications de mettre en œuvre de nouveaux
et puissants moyens de transmission pour acheminer leur trafic intercontinental.
Mais la rapidité de croissance du trafic international est telle
que câbles sous-marins et satellites sont devenus plus complémentaires
que concurrents.
sommaire
1965 L'automatisation a de la peine à arriver, la Corse devra encore
attendre un peu :
|
Débat à l'Assemblée nationale
Septembre 1965 |
En 1967, M. Yves
Guéna est nommé, le 6 avril, Ministre des Postes et Télécommunications,
en remplacement de M. Jacques Marette connu pour son intérêt
parfois très relatif pour le téléphone : ce dernier
étant connu pour avoir déclaré : « Le téléphone
est un gadget ». (l'Histoire ne précise pas s'il s'agissait
alors d'une marque d'autodérision et d'humilité eu égard
à l'état du téléphone français de longue
date, ou d'une réelle pensée profonde de M. Marette.) Avant
cette prise de conscience, l'Administration des PTT est contrainte dès
1963, pour faire patienter les candidats abonnés au téléphone,
de distribuer la petite brochure intitulée : "Vous attendez
le téléphone. Pourquoi ?"
M. Yves Guéna prend conscience du retard colossal en matière
de téléphone et est à l'origine de la création
de la Caisse Nationale des Télécommunications (CNT) le 3
octobre 1967 afin de pouvoir rassembler des capitaux sur les marchés
obligataires nationaux et internationaux.
Plutôt que faire du saupoudrage sur le territoire métropolitain,
il décide avec l'aide de l’ingénieur M. Gérard
Théry de deux opérations pilotes localisées : un
plan d'urgence pour automatiser les télécommunications dans
la région de Lille, une des plus sous-équipée de
France ; un autre pour désenclaver la région montagneuse
d'Oyonnax (l'ordre d'automatisation de la zone Oyonnax sera donné
le 14 janvier 1969 par M. le Ministre des P et T - Yves Guéna).
En 1968, M. Pierre
Marzin, précédent Directeur du CNET fraîchement nommé
Directeur Général des Télécommunications le
21 décembre 1967, impulse une restructuration d'importance, en
bataillant jusqu'en Janvier 1971 pour obtenir le rattachement de l'ensemble
du personnel des télécommunications aux Directions Régionales
des Télécommunications. Une nombreuse partie des personnels
d'exécution (notamment des lignes téléphoniques aériennes)
était jusqu'alors encore rattachée aux Directeurs Départementaux
des PTT (autrement dit, certains télécommunicants étaient
jusqu'à cette date placés sous le contrôle hiérarchique
de cadres postiers qui étaient très éloignés
des préoccupations de la technique téléphonique.
Cette situation anachronique prend fin par le décret n° 71-48
du 6 janvier 1971).
En 1969, les
prix sont trois fois plus élevés qu’en Suisse ou en
Grande-Bretagne.
Les points de blocage sont identifiés comme suit :
• sous-évaluation de l’effort nécessaire en termes
de temps, d’investissements et de compétences ;
• spécificité de la politique industrielle et priorité
aux grands médias, radio et télévision ;
• inadaptation et lourdeur de la structure administrative qui fusionne
la poste et le téléphone.
En 1969, à l'élection
à la Présidence de la République de M. Georges Pompidou,
le VIe plan quinquennal (1971-1975) est décidé. Il a pour
objectif de mener à la fin du retard français par l’octroi
de financements accrus qui permettront la construction de nouveaux projets
d’infrastructures d’envergure des télécommunications.
Le 24 septembre 1969, M. le Ministre des Postes et Télécommunications
- Robert Galley annonce, au cours d'une conférence de presse, que
le téléphone français sera entièrement automatisé
en 1976. À cette fin, il annonce que des sociétés
de financement auxiliaires seront prochainement créées pour
accélérer la mise en service de centres téléphoniques
d'abonnés et de transit.
Dans la foulée, l'adoption de la loi n°69-1160 du 24 décembre
1969 autorise désormais la création de sociétés
privées de financement par crédit-bail d'équipements
de télécommunications pour le compte de l'Administration
des P et T. Il s'agit d'une révolution dans les mentalités
en créant des sociétés de financement qui viendront
ajouter leur écot au budget de l'État pour accélérer
le développement du téléphone en France.
À la fin de l'année 1970,
seule l'Alsace est entièrement automatisée en tant que région
complète. (Paris intra-muros l'étant depuis 1938)
En 1971, après le premier décret
n° 71-48 du 6 janvier 1971 relatif à l’organisation régionale
du service des lignes, le décret n° 71-609 du 20 juillet 1971
relatif à l’organisation de l’administration centrale
du ministère des postes et télécommunications, puis
le décret n° 71-610 supprimant le Secrétariat Général
des Postes et Télécommunications initialement créé
par l'acte dit loi de l'État français du 15 juillet 1940
portant création de secrétaires généraux,
le gouvernement donne plus d'autonomie à la DGT dans la gestion
des personnels vis à vis de la Direction Générale
des Postes.
Grâce au décret n° 71-611 du 20 juillet 1971, la DGT
se voit même désormais chargée directement de la formation
de ses personnels fonctionnaires des catégories B, C et D (c'est-à-dire
des non-cadres). Cette autonomie s'accroît grâce au nouveau
décret n° 71-712 du 30 août 1971 qui rattache à
la DGT les derniers personnels des Télécommunications qui
étaient encore placés sous le contrôle des Directeurs
Départementaux des Postes.La restructuration administrative ardemment
souhaitée par M. Pierre Marzin est réalisée et il
peut faire valoir ses droits à une retraite bien méritée.
M. Louis-Joseph Libois est nommé Directeur Général
des Télécommunications le 11 octobre 1971 par décret
de M. le Ministre des Postes et Télécommunications - Robert
Galley.
Séance du
23 Novembre 1972 , Débat
parlementaire du SENAT à
propos du
budget annexe des postes et télécommunications.
A lire sur la
page "Etat des lieux des télécommunications et plus
largement des P.T.T,"
En 1972,
M. Louis-Joseph Libois édicte sa note véritablement refondatrice
qui éclate les Centres d'Abonnements et d'Entretien (CAE)
en deux nouvelles entités types : d'un côté les Agences
Commerciales des Télécommunications (dont les 6 premières
créations test sont déjà effectives au mois de janvier)
et de l'autre les Centres Principaux d'Exploitation (CPE) regroupant
au niveau local les métiers techniques.
1973 Administrativement, la Circulaire n°33 stabilise
l'organisation modernisée des services des Télécommunications
selon trois niveaux :
Direction Générale des Télécommunications
(DGT).
Directions Régionales des Télécommunications (DRT).
Directions Opérationnelles des Télécommunications
(DOT).
L'organisation locale en cellules est pérennisée : Les Centres
Principaux d'Exploitation (CPE).
Les Agences Commerciales des Télécommunications (ACTEL).
Les Subdivisions Lignes (dont les Centres de Construction des Lignes,
les CCL)
Fin des années 1970 : Le téléphone
devient entièrement automatique en France.
sommaire
1973 L’invention du téléphone
portable analogique est attribuée à un ingénieur
de Motorola nommé Martin Cooper, en avril 1973.
Mais saviez vous qu’il existait déjà un aspect de téléphonie
mobile dans les années 50 ? .
Il apparaissait en 1956 sous forme de prototype signé SRA/Ericsson
et pesant … 40Kg. Mais il était réservé à
des gens fortunés puisqu’il était commercialisé
au prix de 3995 USD à l’époque, c’est l’équivalent
aujourd’hui d’environs 6500 euros.
Grâce aux nouvelles technologies du début du siècle,
en particulier la technologie radio développée à
partir des années 40 et celle des cellules hexagonales permettant
d'envoyer et de recevoir des signaux dans trois directions différentes,
le téléphone mobile fut inventé par Martin Cooper,
directeur général de la division communication chez Motorola.
Il passe le premier appel de l'histoire depuis un téléphone
portable en 1973.
1974
- 1988 : LA FRANCE SE RANGE DANS LES PREMIERS RANGS MONDIAUX
Le pari technologique de la commutation électronique
temporelle numérique est engagé et sera gagné.
Dans cette partie du plan de rattrapage, il était également
question de réformer l’administration et son statut. En 1967,
Valéry Giscard d’Estaing avait proposé la création
d’une Compagnie nationale du Téléphone, mais le projet
fut écarté. On parlera cependant plusieurs fois de la création
d’un établissement public sur le modèle d’EDF.
Rien ne se fera en apparence, mais la réalité sera très
proche de cette proposition. La période qui s’ouvrait vit
le bouleversement des structures organisationnelles des Télécommunications
françaises et l’émancipation définitive des
Télécoms de la tutelle postale. Considérant que la
Poste et les Télécommunications avaient des activités
très divergentes et exigeant des organisations caractéristiques,
les différentes réformes vont conduire, au rythme d’une
tous les deux ans, à une autonomie des Télécommunications.
Une fois l’indépendance acquise, un objectif fut fixé
à partir de 1971 : mettre en place une organisation régionale
opérationnelle et capable d’assumer la modernisation des Télécoms
dans tout le pays.
A partir de 1974, on va chercher à rapprocher l’organisation
des Télécommunications de celles des grandes entreprises,
avec la mise en place des techniques de management et de la direction
par objectifs. Une bataille pour le leadership des télécommunications
françaises va être engagée entre le CNET et la Direction
Générale des Télécommunications, et le CNET
sera finalement limité à ses activités de recherche.
Cette bataille rangée s’est déroulée à
l’occasion d’un désaccord sur l’opportunité
de l’introduction d’une nouvelle technologie : la commutation
temporelle . La DGT va hésiter à mettre en place le commutateur
temporel issu des travaux du CNET, qui devait être commercialisée
par la Compagnie Générale d’Electronique, société
produisant des équipements pour les télécoms (câbles,
commutateurs, etc.). Son rejet sera une stratégie de la part de
la DGT pour éviter un monopole de la société CGE
en France. Ainsi, la DGT prendra le contrôle des prix et des matériels
de télécommunication, base de la politique industrielle.
La DGT va ensuite lancer un appel d’offre afin de choisir l’équipement
de commutation à mettre en place en France dans le cadre de la
technologie intermédiaire, nommée « spatiale ».
Les candidats sont nombreux et c’est la société Thomson
qui semble le plus intéresser la DGT. En choisissant la technologie
proposer par Thomson, la DGT va donc ainsi créer un concurrent
à la CGE.
A dater de 1977, suite à la Conférence d’Atlanta, la
communauté internationale se convertit au temporel, et la DGT est
leader, subventionnant à la fois Thomson et la CGE, devenus concurrents.
Finalement, le grand gagnant sera la société CIT-Alcatel
(qui n’est alors qu’une P.M.E.) et ce grâce à un
transfert de technologie du CNET.
Par-delà les conflits et les malentendus inévitables, ces
réformes constituent un préalable à la nouvelle politique
industrielle voulue par la DGT, fondée sur la concurrence entre
les constructeurs, de façon à obtenir une qualité
de matériel irréprochable. Le pari est ainsi gagné
: la France, par le biais de ses commandes et subventions publiques, et
d’un transfert de technologie, aura réussi à passer
de sa situation de « pays retardé » à celle
du pays qui tirera le mieux son épingle du jeu, par le biais d’une
entreprise devenue acteur majeur de la scène mondiale des télécommunications.
Au niveau international, la DGT demandera du reste aux deux sociétés
au niveau du marché temporel (Thomson et la CGE) de travailler
ensemble pour
ce qui concerne l’exportation .
Valéry Giscard d’Estaing nomme un nouveau Directeur Général
des Télécommunications, M. Gérard Théry :
la saga du Delta LP prend naissance : elle consiste à accroître
de manière soutenue le parc le Lignes Principales (ce que l'on
appellera le Plan Théry). Le même jour, le 16 octobre 1974,
le décret n°74-890 accroît encore les marges de manœuvres
de la Direction Générale des Télécommunications.
Les Directions Opérationnelles et Techniques (DOT) sont généralisées
dans toute la France et demeurent sous la coupe des Directions Régionales
des Télécommunications. Les DOT supervisent un, deux voire
trois départements. Les établissements opérationnels
sont organisés selon le schéma « CCL/ACTEL/CPE»
qui va persister 23 ans.
Ce schéma correspond à une vision du cycle de vie de la
ligne téléphonique : création en CCL, vente en ACTEL,
exploitation et service après-vente en CPE. Chacun de ces établissements
inclut environ cent cinquante personnes. À ceci s'ajoutent des
fonctions en back-office comme : les CRT (Centre de Renseignements des
Télécommunications) qui sont les services des renseignements
téléphoniques, les Centres Télégraphiques,
les CFRT (Centre de Facturation et de Recouvrement des Télécommunications).
Un intéressant document du projet
de loi de finnance de 1976, on prévoie déjà les
systèmes électroniques à venir.
Le 13 mai 1976 constitue un tournant pour le téléphone français
: dès l’été 1978, l’on ne commandera plus
aucun autocommutateur électromécanique. Seuls les centraux
électroniques seront commandés désormais. Les autocommutateurs
électroniques temporels seront commandés pour les villes
moyennes, tandis que les grandes métropoles seront équipées
d’autocommutateurs électroniques spatiaux, étant donné
que seules ces machines puissent supporter les contraintes de fonctionnement
dans les grandes villes. Il s’agit là du choix de la raison
adopté en urgence, les autocommutateurs temporels n’étant
encore pas en mesure de résister aux grandes villes avant une dizaine
d’années de perfectionnements nécessaires.
Mémoire de Remi Gilardin La "libéralisation
des télécommunications en France"
qui fait une analyse détaillée de la période 1981-1996.
En 1966, la première liaison numérique métallique
expérimentale MIC (Modulation par Impulsion et Codage) à
36 voies temporelles est mise en service, en exploitation entre Paris-Bonne
Nouvelle et Chaville. Commence la vraie révolution dans les télécommunications
modernes.
Arrivent ensuite les commutateurs entièrement électroniques
qui constituent Faisant suite au salon international Intelcom 77 qui se
déroule à Atlanta du 9 au 14 octobre 1977, ou il est décidé
que seuls des systèmes temporels seront désormais conçus
à l'avenir en France.
Les principes de base des commutateurs de type temporel sont de répartir
les fonctions du système dans plusieurs calculateurs (Par exemple,
le partage de charge se fait entre le multienregistreur, le taxeur et
le traducteur dans le cas de la famille E10)
et de coder numériquement par échantillonnage les conversations
vocales et d’assurer leur acheminement via un nouveau système
de transmission et de multiplexage entièrement numérique
le système MIC qui permet d’accroître la capacité
d’écoulement du trafic.
Alors, évidemment, les deux grandes familles téléphoniques
(Analogiques et Numériques), ont dû cohabiter pendant encore
30 années entre 1970 et 2000, car l'on ne pouvait pas d'un claquement
de doigts changer en une nuit le Tout Analogique pour le Tout Numérique...
Durant l'année 1974 une véritable
"maladie" appelée Contact-Ventouse , que personne
n'attendait, ciblant massivement les contacts des Multisélecteurs
PENTACONTA et CP400 est découverte.
Le CNET prend l'affaire en main et étudie le phénomène
: il s'agit d'une usure en forme de cratère dont sont frappés
les contacts tronconiques des Multisélecteurs, et qu'il n'y a rien
à faire (sauf à procéder à des remplacements
massifs au fur et à mesure de l'apparition de la "maladie").
L'année 1974 marque alors un tournant qui laisse entrevoir le besoin
de remplacer sans tarder les Commutateurs électromécaniques,
notamment les Commutateurs d'Abonnés installés en zone à
fort trafic ainsi que les Centres de Transit Électro-Mécaniques
qui fonctionnent, de par leur rôle, en trafic par définition
intensif.
En 1975, le Pentaconta
et le CP400 équipaient plus de 70 % du réseau national.
Le dernier Commutateur Crossbar de France est commandé
en 1979 et les dernières extensions également.
En 1975, le 1er février : passation de pouvoirs entre M.
Pierre Lelong et M. Aymar Achille-Fould qui devient nouveau Secrétaire
d'État aux Postes et Télécommunications. En effet,
la grande grève de 1974 a laissé des traces et le Pouvoir
a préféré procéder au remplacement de M. Lelong
qui avait déclaré lors d'une conférence de presse
: « Travailler dans un centre de tri est, si j'ose dire, l'un des
métiers les plus idiots qui soient. »Son successeur ne demeurera
qu'une petite année au 20, avenue de Ségur. Préfère
démissionner en raison de rumeurs non-avérées de
conflit d'intérêt pour les signatures de marchés à
venir.
Le 10 avril 1975, l’automatisation du réseau téléphonique
de la Région Parisienne commencée le 22 septembre 1928 est
totalement achevée au bout de 47 années, par la mise
en service d'un Centre de Secteur Socotel S1 de 200 lignes à Forêt-le-Roi
(91).
Le 12 janvier 1976, M. Norbert Ségard devient
Secrétaire d’État autonome aux Postes et Télécommunications.
De par son action et sa force de travail colossale, il incarnera en tant
qu'homme politique, les années les plus dynamiques du rattrapage
téléphonique de notre pays.
La Fin des Commutateurs
Strowger de types pas à pas est annoncée
Tels qu'ils ont été initialement étudiés,
les commutateurs Strowger ne permettent qu'une Numérotation locale
à 5 puis 6 Chiffres.
Ils ne peuvent pas, en l'état, franchir l'étape de la Numérotation
à 8 Chiffres programmée pour le 25 octobre 1985.
Ainsi pour ces Commutateurs, deux solutions s'offrent :
1er cas : arrêt des Commutateurs de types pas à pas avant
le passage à la Nouvelle Numérotation à 8 Chiffres
en 1985.
2ème cas : remplacement des unités d'Enregistreurs d'origine
à 6 chiffres, par des unités d'Enregistreurs électroniques.
La solution d'arrêt de la totalité des Commutateurs de
types pas à pas a été décidée en
raison d'une part du coût d'adaptation (qui eût été
toutefois possible) mais aussi du fait que les chaînes de commutation
interurbaines de ces Commutateurs de province se sont avérées
largement sous-dimensionnées au fur et à mesure de l'accroissement
du trafic interurbain dans les années 1960-1970, dû à
un changement des usages.
Ainsi, les chaînes interurbaines des Commutateurs de types pas à
pas fonctionnaient-elles en surcharge permanente, ce qui a motivé
l'arrêt total de ces machines avant 1985.
La Fin des Commutateurs
Rotary est annoncée
Le dernier Commutateur d'Abonnés à
organes tournants de cette famille est arrêté le 26 juin
1984 à Montrouge, avant le changement du Plan de numérotation
téléphonique en France (basculage à 8 chiffres le
25 octobre 1985 à 23H00).
En effet, il aurait été trop coûteux d'adapter les
Commutateurs à organes tournants à l'adjonction de 2 chiffres
supplémentaires (ce qui eût été néanmoins
faisable).
- Le dernier Commutateur de type rotatif à impulsions de contrôle
inverses de France est un Commutateur de Transit ROTARY 7A1, Vaugirard
CTRY. Mis en service le 16 novembre 1929, il est désactivé
courant Juillet 1985, soit après plus de 55 années de service
continu révolu !
La Fin des Commutateurs
Crossbar est annoncée
Il est décidé que les types de
Commutateurs Crossbar les plus anciens et les plus primitifs seront démontés
en 1984-85 juste avant le passage à la Nouvelle Numérotation
à 8 chiffres du 23 octobre 1985, tandis que les types les plus
perfectionnés seront, eux, adaptés au nouveau plan de numérotage
moyennant adaptations pouvant aller jusques à l'électronisation
de leur Unité de Commande initialement construite en technologie
purement électromécanique (à relais)
Le dernier Commutateur d'abonnés Crossbar de France, un Pentaconta
1000 est désactivé à Givors (LZ23) le 6 décembre
1994.
Il a existé en France, à partir de 1966, au moins 185 Commutateurs
électromécaniques crossbar mobiles, en remorques.
Ils étaient destinés aux dépannages en cas de sinistres
des installations de télécommunications.
 Confolen
Région Poitou
Confolen
Région Poitou
En 1979, suite à l'instruction officielle
(1065 cab 42) du 19 octobre 1978 de M. le Secrétaire d’État
aux P et T - Norbert ségard, de nouvelles évolutions en
terme d'organisation sont mises en place sous l'impulsion de M. Gérard
Théry, le DGT. Sont créées 9 Délégations
de Zone des Télécommunications (DZT), échelon intermédiaire
entre les Directions Régionales des Télécommunications
et la DGT.
Cette réorganisation qui faisait doublon avec les DRT ne dure pas.
Ces Délégations de Zone des Télécommunications
sont supprimées par l'instruction officielle (1008 cab 6) du 1er
mars 1982 de M. le Ministre des PTT - Louis Mexandeau, suite à
l'alternance politique.
C'est aussi en 1979 que l’automatisation
du réseau téléphonique de l’hexagone commencée
en 1913 est totalement achevée après 66 années de
dur labeur.
- Le 28 novembre 1979, le dernier Centre Téléphonique manuel
de Métropole (Alando, dans le département de Haute-Corse
(2B)) est supprimé et les abonnés sont transférés
sur un commutateur automatique ;
- Le 15 décembre 1979, les deux derniers Centres Téléphoniques
manuels de Saint-Georges de l'Oyapock et Régina en Guyane sont
également remplacés par l'automatique intégral.
- Le métier d'opératrice des télécommunications,
Les demoiselles du téléphones, disparaît et les dernières
agentes sont reclassées sur d'autres métiers (en général
dans les CPE sur des métiers techniques ou dans des fonctions de
back-office au téléphone, comme le service du 12
- les renseignements téléphoniques ou encore dans les ACTEL
pour celles qui ont la fibre commerciale et un bon contact client).
À noter que l’on emploie toujours le terme opératrice
au féminin, alors qu’il existait aussi des opérateurs
des télécommunications qui opéraient séparément
en brigade de nuit, le travail de nuit étant alors interdit par
l’article L213-1 du code du travail au personnel féminin jusqu’au
20 juin 1987.
Fin 1980, la France rattrape son retard : 16 millions de lignes
et 25 millions de postes de toute nature, les délais moyens de
raccordement sont réduits de 16 mois en 1973 à 3 mois en
1981.
La DGT réalise des gains de productivité : 25 agents pour
1000 lignes en 1971, 9 en 1981.
Le réseau public de transmission de données par paquets
Transpac ouvre en 1978.
La RCB Rationalisation des Choix Budgétaires,
et la transformation de la direction générale des Télécommunications.
(Etude de Marie Carpenter)
En 1969, en France, le parc téléphonique de quatre millions
de lignes principales représentait une densité téléphonique
de 7,8 lignes pour 100 habitants, un des taux des plus faiéles
des pays industrialisés.
En 1981, le parc de 18 millions représentait un taux de 30 %, plaçant
la France au 16e rang mondial. Le délai moyen de raccordement était
de 16 mois en 1967. Il fut réduit à 4 mois en 1980. Au lieu
de 5 000 cabines téléphoniques en 1969, la France en comptait
100 000 en 1980. Le taux d’automatisation passa quant à lui
de 65 % des lignes en 1968 à environ 100 % en 1979.
Les dates et l’ampleur de la réussite peuvent expliquer une
tentation d’accorder à l’initiative de la rationalisation
des choix budgétaires (RCB) une part – plus ou moins importante
– de la responsabilité de ce succès de la direction
générale des Télécommunications (DGT). Pour
l’adoption des budgets de programme, par exemple, la DGT fut identifiée
comme un secteur aux limites de l’économie « marchande
» où « cette doctrine s’est particulièrement
affirmée ». Elle fut également considérée
comme une des deux réussites, avec le ministère de la Défense,
en ce qui concerne la modernisation de la gestion.
Cependant, les récits de cette époque
citent rarement la RCB parmi les explications de cette sortie de crise
des télécommunications pendant les années 1970. Un
des acteurs principaux du lancement de la RCB au sein du service des Programmes
et des études économiques (SPEE) à la DGT ne met
pas non plus en valeur l’apport de cette initiative et s’en
souvient plutôt comme une « galère » qui a rapidement
« disparu dans les sables ».
Au moment de l’annonce officielle de la mise en place
de l’opération RCB à la fin des années 1960,
une réforme importante de la DGT était déjà
en cours. La publication des rapports Chanet en 1967 en fut une manifestation
importante. Les groupes de travail associés à cet audit
préconisèrent alors deux réformes administratives
importantes nécessaires pour réussir enfin le rattrapage
téléphonique : une autonomie partielle accompagnée
d’une réorganisation importante avec une décentralisation
vers les régions accompagnée d’un suivi très
rigoureux des indicateurs de performance au niveau central. Ces réformes
administratives furent entreprises entre juillet 1968 et mars 1972 en
parallèle d’une réorganisation profonde de la DGT à
tous les niveaux.
Au moment du séminaire RCB tenu au château
d’Artigny à Tours, du 7 au 9 février 1969, la DGT avait
déjà posé les fondations de sa sortie de ce «
flot d’irrationalité » qui avait contribué à
l’état lamentable du téléphone en France. La
réforme fondamentale de la DGT entamée à partir de
la fin des années 1960 a donc été menée en
parallèle des mesures issues de la RCB introduites au sein de cette
administration. L’approche et les méthodes RCB étaient
compatibles avec celle préconisée par les rapports Chanet.
En particulier, en ce qui concerne la décentralisation vers les
directions régionales, les objectifs et les techniques adoptés
furent très complémentaires et la DGT apparaît dès
lors comme ayant constitué un terrain propice pour les ambitions
et les méthodes de modernisation de la gestion promues par la RCB.
Cependant, les limites de la RCB en tant que «
programme de maximation sous contraintes » limitèrent son
impact au sein de la DGT pour qui a concerné les décisions
qui relevaient des choix technologiques où l’avenir est très
incertain et où l’influence de la politique industrielle est
omniprésente.
Finalement, les spécificités des Télécoms
et de la Poste rendaient difficilement « transférables »
leurs choix organisationnels vers d’autres administrations françaises.
En particulier, au sein des télécoms, la présence
des sociétés de financements et les recettes grandissantes
qu’elles ont générées ont accordé une
certaine autonomie de la DGT dans ses investissements et ses projets futurs
– sous condition, bien sûr, de toujours pouvoir démontrer
un suivi budgétaire rigoureux. Autant la RCB a pu aider pour poursuivre
ce dernier objectif et pouvoir ainsi renforcer l’autonomie de la
DGT et faciliter la décentralisation qui permit le déploiement
rapide du nouveau réseau, autant elle a pu être perçue
comme inadaptée vis-à-vis de l’ampleur des nouveaux
projets entrepris par la DGT à partir de 1978.
Un souffle de réforme plane autour de la DGT dans les années
1960 :
Un acteur important de la RCB au sein de la DGT,
René-François Bizec, note l’importance du rôle
– et des ambitions – de Valéry Giscard d’Estaing
en tant que ministre des Finances du gouvernement Pompidou en expliquant
que la création de la direction de la Prévision dans son
ministère répondit à un double objectif : «
d’une part mettre la main sur les grands mécanismes d’élaboration
des décisions concernant les grands investissements publics et
d’autre part, essayer de contrôler autant que faire se peut
la trop grande indépendance de la direction du Budget ».
Il précise aussi que « l’Élysée et Matignon
étaient très bien pourvus de “grands camarades”,
experts en matière de politique industrielle mais Giscard lui aussi
voulait mettre son nez dans la politique industrielle ». Finalement,
René-François Bizec explique que « le souffle de la
micro-économie fondée, pour ce qui est de la France, par
Maurice Allais, Jacques Lesourne, Marcel Boiteux… touchait les hauts
fonctionnaires ».
En accueillant les participants à un séminaire
de RCB en novembre 1969, en tant que ministre de l’Économie
et des Finances, Valéry Giscard d’Estaing insista sur le besoin
de modernisation, en regrettant : « cette espèce de mélancolie
qui s’est emparée du corps social français, non pas
depuis quelques mois mais depuis quelques années, et qui est le
sentiment d’une certaine inefficacité ou incapacité.
Cela résulte non pas du fait que nous serions devenus plus inefficaces
ou plus incapables qu’avant, mais simplement que nous avons découvert
qu’en réalité nos structures n’étaient
pas adaptées aux nécessités économiques contemporaines
».
Il argumenta également pour défendre
la place de la concurrence et son rôle pour inciter les acteurs
à se réformer : « ce qui a été réformé,
ou ce qui commence à l’être, ce sont les parties de
l’État qui sont aux frontières de la compétition
extérieure. Par exemple, dans le secteur de la Défense nationale,
il est très frappant de voir que ce sont des entreprises de type
finalement quasi commercial, qui sont amenées à réviser
assez rapidement leurs structures ; dans le domaine de l’économie
et des finances ce sont les secteurs des entreprises qui rendent un service
de type quasi compétitif qui ont été obligés
de se remanier, par exemple, la SEITA. Par contre, tout le noyau dur de
l’administration, qui n’est pas gagné par la compétition,
aurait une tendance naturelle à demeurer inchangé ».
Valéry Giscard d’Estaing avait déjà
évoqué cette société nationale, la SEITA,
en tant que président de la Commission des finances en 1967, avec
sa proposition de création d’une Compagnie national du téléphone.
En plus de la SEITA, qui était un service du ministre des Finances
avant d’être transformé en établissement public,
il cita EDF dont la personnalité civile et l’autonomie financière
lui permettaient de « mettre en œuvre des méthodes modernes
de gestion industrielle et utiliser des modes de financement adaptés
à une structure où le rendement des investissements est
particulièrement élevé ». Dans un article paru
en novembre 1968 dans l’hebdomadaire des républicains indépendants,
Réponses, pour défendre l’idée d’une Compagnie
nationale du téléphone, il présenta ce projet comme
« l’exemple même d’un changement qu’un pays
moderne doit imposer à ses structures s’il veut vivre avec
son temps ». Pour remédier à la situation de pénurie
persistante en France, les actions nécessaires, selon lui, ne se
limitaient ni aux progrès technologiques initié par les
ingénieurs du Centre national d’études des télécommunications
(CNET), ni à un accès à des ressources financières
plus importantes que celles prévues dans le Ve Plan. Il fallait,
arguait-il, se doter d’une organisation efficace pour les opérations
du téléphone, différentes de celles de la Poste et
des chèques postaux et posait la question ainsi : « comment
croire que la règlementation classique budgétaire, déjà
paralysante pour une administration classique, est adaptée au développement
du téléphone, qui constitue une industrie électronique
de pointe ? ». Il concluait que « contre un tel changement,
toutes les forces de conservatisme, de la routine et de la paresse d’esprit
sont évidemment liguées » et insistait sur le fait
que, pour éviter qu’elles ne triomphent, « il ne suffit
pas de modifier les textes, il faut surtout avoir le courage de réformer
le réel ».
Lors d’un débat avec le ministre des
PTT de l’époque, Yves Guéna, Valéry Giscard
d’Estaing insista à nouveau sur l’efficacité d’une
organisation privée mais il n’obtint que la création
d’un groupe de travail chargé d’examiner les problèmes
posés par l’organisation du service du téléphone.
Les réformes nécessaires de la DGT en phase avec
les prémisses de la RCB : 1968-1974
Les déclarations de Valéry
Giscard d’Estaing au sujet de la nécessité de réorganiser
les télécommunications faisaient écho à celles
– grandissantes – des usagers mécontents et des ingénieurs
des télécommunications frustrés des conséquences
de l’état délabré du réseau téléphonique
français à l’époque du « 22 à Asnières
». La nomination de Pierre Marzin, directeur du CNET, à la
tête de la DGT en décembre 1967 marqua le début d’une
série de réformes importantes mettant cette administration
sur une trajectoire de croissance, d’augmentation de productivité
et d’innovation qui fit date dans l’histoire des opérateurs
de télécommunications. Une partie importante de ces réformes
eut lieu pendant la décennie de mise en œuvre de la RCB (1968-1978)
et ces initiatives parallèles sont parfois imbriquées. Pour
éviter de confondre ce qui relève des réformes en
cours avant le lancement des programmes de la RCB, il est nécessaire
de bien préciser les réformes liées aux « rapports
Chanet ».
En 1967, Henri Chanet, polytechnicien et inspecteur des Finances, fut
chargé d’étudier les conditions de la mise en place
d’un « plan de rattrapage… sous le triple aspect du financement,
des structures internes et de la politique industrielle ». Yves
Guéna, ministre des PTT, créa deux comités «
Finances-PTT » et « Industrie-PTT » qui se penchèrent
sur les questions à résoudre pour redresser la situation
de retard français vis-à-vis des autres pays développés
dans un horizon de 12 ans, c’est-à-dire à l’horizon
1980. Le langage des rapports Chanet rappelle celui de la RCB, en évoquant
notamment la « recherche d’un optimum économique »
mais leurs objectifs étaient triples : assurer un niveau de financement
suffisant – estimé à 60 milliards de francs –,
introduire une meilleure organisation administrative et technique et organiser
les relations entre l’industrie et l’État.
En tant que Premier ministre, Georges Pompidou était
déjà en train de s’attaquer au retard grandissant du
téléphone français avec une augmentation 20 % des
investissements pour le budget de l’année 1968. Bernard Esambert,
son conseiller technique, se souvient de la difficulté éprouvée
par Michel Debré face à cet arbitrage. Présent à
la réunion entre lui et Yves Guéna, il rappelle : «
il considéra que cet arbitrage était justifié parce
qu’il avait lui-même reçu les travaux des comités
PTT-Industrie et PTT-Finances. Il était donc parfaitement conscient
du problème. Cependant, d’un autre côté, il était
le ministre de l’Économie et des Finances et le tenant de
la rigueur budgétaire et financière. Il était donc
déchiré entre sa conscience des besoins et la nécessité
de planifier rigoureusement son budget. Il était très ému
à la fin de la réunion ».
Pour les ingénieurs des télécommunications,
il fallait rompre avec cette politique « au fil de l’eau »
qui avait mené « à l’asphyxie progressive du
réseau ». Un nouveau mode de financement fut alors introduit
à travers la création d’abord de la Caisse nationale
de Télécommunications (CNT). Il fut suivi, par la suite,
de la création de sociétés de financement privées
et, finalement, d’une société de financement publique.
Ces organismes combinèrent deux innovations : l’émission
de titres avec la signature de l’État français par
le biais du réseau bancaire et pas seulement par le recours aux
« seuls comptables des PTT » et la possibilité, pour
la DGT, d’utiliser les fonds progressivement par une méthode
d’achat sous forme de crédit-bail ou de leasing. Dans la mise
en place de cette réforme importante, une dernière bataille
fut gagnée en décembre 1969 quand le ministère des
Finances accepta que ces sociétés de financement soient
exonérées de l’impôt sur les sociétés.
Grâce à ces dispositifs financiers mis en place entre 1967
et 1975 pour surmonter la « prudente gestion de père de famille
», la DGT se libéra d’abord de la rigidité budgétaire
de la rue de Rivoli. Elle évita également le transfert de
ses moyens vers les autres branches des PTT. En 1977, 38 % de son financement
provint de la CNT, 22 % des sociétés de financement et 40
% (20 milliards de francs) de l’autofinancement. Ceci lui permit
alors d’expliquer que « les Télécoms se financent
sans recours à l’impôt. Les ressources proviennent des
client actuels (autofinancement) et des anticipations des recettes futures
(financement externe) ».
Les rapports Chanet insistèrent sur la nécessité
d’accompagner l’augmentation des dépenses dans le réseau
téléphonique avec une réorganisation profonde de
la structure de la DGT pour que les « directions horizontales ou
fonctionnelles » telles que celles du personnel, des bâtiments
et du budget ne soient plus partagées avec la direction générale
des Postes sous la coordination d’un secrétaire général.
En termes organisationnels, cette structure devint de plus en plus claire
et autonome à partir du 1967 avec la création de quatre
services et directions successivement . Dès 1968, la direction
de l’Équipement fut créée, ainsi que le service
des Programmes et des études économiques (SPEE) qui joua
un rôle important dans l’adoption des outils RCB au sein de
la DGT. En 1971, furent créés le service du personnel de
la DGT, et la direction des Affaires commerciales, financières
et internationales. Le poste du Secrétaire général
aux PTT fut supprimé la même année malgré les
protestations des syndicats qui y voyaient « l’amorce d’une
scission entre la poste et les télécommunications ».
Bernard Esambert, conseiller auprès du président Pompidou,
explique avoir égaré le décret du renouvellement
du Secrétaire général des Postes et avoir ainsi «
mis fin de fait à l’existence du secrétariat général
[…] et à ces transferts que je considérais comme néfastes
du téléphone vers la Poste et les services financiers ».
À partir de 1972, les directeurs régionaux
des télécommunications devinrent responsables de leurs objectifs
et moyens en négociant directement avec la direction générale
au sein d’une enveloppe budgétaire. Cette délégation
de pouvoir mit progressivement fin aux directions départementales
communes à la Poste et aux Télécommunications. Le
combat politique intense nécessaire pour aboutir à cette
séparation et à cette délégation des pouvoir
fut mené par Pierre Marzin, directeur général à
l’époque, et Gérard Théry, le responsable nommé
au SPEE et futur directeur. La DGT profita également de cette réorganisation
pour renouveler les équipes sur ce terrain stratégique pour
le rattrapage et pour le faire en fonction des compétences et pas
simplement de l’ancienneté. Dans le but d’avoir ses compétences
en quantité suffisante pour la mise en œuvre du rattrapage,
une dernière réforme cruciale consista à obtenir
la possibilité de recruter hors concours. Entre 1974 et 1977, la
création du nouveau statut d’« inspecteurs sur titre
» (INSTI) permit à la DGT d’offrir des postes à
1 515 diplômés d’écoles d’ingénieurs
ou de titulaires de 3e cycle ou de diplômes équivalents.
Une accélération de la transformation de la DGT : 1974-1981.
Même si la situation de la DGT commença
à changer de manière significative à partir de 1967
et des mesures prises en termes organisationnels et de financement et
initiées par la publication des rapports Chanet, la crise du téléphone
ne fut pas pour autant réglée. En parallèle des efforts
consentis en matière d’investissement dans le VIe Plan, l’accroissement
spectaculaire de la demande donna l’impression que le sketch comique
de Fernand Raynauld « le 22 à Asnières », connu
dans les années 1960, restait d’actualité. Une croissance
de 30 % de la demande en 1971 fut suivie par une croissance plus forte
encore de 34,4 % en 1972. Louis-Joseph Libois qui succéda à
Pierre Marzin à la tête de la DGT en 1971, reconnut que la
demande réelle des Français pour le téléphone
correspondait au double de ce que prévoyait la DGT. Les prévisions
du Plan furent revues à la hausse mais la crise du téléphone
s’invita néanmoins dans l’élection présidentielle
de 1974. Dans la série des archives de la Présidence de
la République de 1974 à 1981, une note non-signée
datée de mars 1973 et intitulée « Réflexions
sur la crise du Téléphone » critique ouvertement la
direction des Télécommunications et conclut ainsi : «
il n’est pas possible de laisser “pourrir” la crise du
téléphone. Un changement est inéluctable : le problème
est de le décider, et de trouver des hommes qui acceptent de l’assumer.
Il doit créer, en même temps, un choc psychologique aussi
bien vis-à-vis de l’opinion publique que des cadres des télécommunications,
comme cela fut le cas lors de la réforme de 1968 ».
Élu président de la République
en 1974, Valéry Giscard d’Estaing nomma Gérard Théry
comme directeur des Télécommunications. En parallèle
de sa responsabilité pour le SPEE depuis sa création, Gérard
Théry avait également été nommé directeur
de Paris en 1972. En avril 1975, Valéry Giscard d’Estaing
annonça un « Plan d’Action Prioritaire » dans
le cadre du VIIe Plan pour redresser la situation des télécommunications
et développer un « téléphone pour tous »
en France. Il y fixait des objectifs ambitieux en termes de taux d’équipement,
de qualité de service, de développement de nouveaux services,
de redéploiement de l’industrie par une politique d’achat
sélective et de mise en œuvre d’une politique ambitieuse
de recrutement et d’intéressement du personnel. La réalisation
de ces objectifs nécessita des autorisations de programme de 120
milliards de francs au cours du VIIe Plan40, ce qui représentait
une augmentation importante comparée aux 45 milliards de francs
disponibles lors du VIe Plan.
Cette décision prise en 1975 valut reconnaissance
de l’amélioration qui avait été apportée
au fonctionnement de la DGT depuis la mise en place des autres recommandations
des groupes du travail qui avaient contribué aux rapports Chanet.
Ces changements concernaient, d’un côté, la gestion
des effectifs de la DGT et, de l’autre, le remaniement de la filière
industrielle en amont. Le premier volet de réorganisation est complémentaire
aux objectifs de la RCB et, entre 1968 et 1973, les mesures prises pour
réformer la DGT inclurent l’adoption des budgets de programmes
et la modernisation de la gestion administrative parallèles avec
l’introduction de la RCB.
Un deuxième volet de changements importants
dans le secteur concernait les relations entre l’acheteur qu’était
la DGT et ses fournisseurs principaux, les équipementiers de télécommunications.
Il s’agissait à la fois de rompre à la fois avec une
forte dépendance vis-à-vis des deux fournisseurs étrangers
qu’étaient l’américain ITT et le suédois,
Ericsson et avec une relation étroite et exclusive avec la Compagnie
générale d’électricité (la CGE). Bernard
Esambert explique avoir bloqué discrètement le renouvellement
des décrets concernant le renouvellement de deux structures qui
regroupaient les fournisseurs – Socotel et Sotelec – pour éviter
des manœuvres de fixation de prix abusifs. Finalement, en ce qui
concerne la CGE, Bernard Esambert explique : « Dans les télécoms,
elle a été le réceptacle des commandes à partir
de 1968 et elle a intégré de nombreux ingénieurs
du CNET. Elle avait la bénédiction de l’État
mais elle en voulait toujours davantage. Son rôle de lobbyiste n’est
plus à démontrer. Il a parfaitement fonctionné sur
les télécoms mais à un point tel qu’il n’était
plus souhaitable à l’époque de lui laisser le quasi-monopole
de ce secteur. Nous devions trouver un deuxième champion des télécommunications
». La table est donc dressée pour l’introduction du
groupe Thomson dans le secteur des télécommunications, chose
faite en 1975 au moment de la consultation internationale pour la commande
de commutateurs pour le déploiement du réseau lors du rattrapage.
Sur ce deuxième volet des réformes organisationnelles de
la DGT et, notamment, de sa politique d’achat, c’est la politique
industrielle voulue par la direction générale qui influença
les choix technologiques et la mise en place de nouvelles pratiques en
lien étroit avec le plus haut niveau de l’État. La
direction des Affaires industrielles, créée en 1974 et devenue
la direction des Affaires industrielles et internationales (DAII) par
la suite, coordonna ses initiatives à travers ses attributions
de contrôle des prix et de contrôle technique du matériel.
Le Centre national d’études des télécommunications
(CNET) perdit dans la réforme son rattachement direct à
la direction et devint alors un service de la DAII orienté vers
la recherche.
La création du SPEE et le projet pilote de la RCB : 1968
Gérard Théry rappelle que
« les premiers actes de développement du téléphone
remontent à 1968 et il s’agissait bien de décisions
dont on pouvait dire qu’elles étaient quasiment régaliennes
et qui venaient de l’Élysée : créer un état-major
à la direction générale des Télécommunications,
la renforcer, et lui donner tous les outils favorables à cette
croissance ».
En plus de la nécessité d’un
système de financement durable et d’une autonomie vis-à-vis
des autres activités du ministère des PTT, les rapports
Chanet identifièrent clairement la nécessité pour
la DGT de décentraliser la prise de décision pour la coordination
des travaux nécessaires au rattrapage. Pour cela, elle prôna
l’adoption aux échelons régionaux de méthodes
de travail « permettant l’analyse correcte des problèmes
et la définition des solutions les meilleures » et insista
« sur la nécessité, pour répondre à
ces tâches, de disposer d’un organe de recherche opérationnelle
doté d’effectifs et de moyens de calcul suffisants ».
La création d’une direction spécifique fut proposée
pour la coordination nécessaire entre les études économiques,
l’équipement et l’exploitation. Pour parvenir à
un processus d’équipement « logique, cohérent
et sûr », les rapports Chanet préconisèrent
donc des études au niveau régional sur la base d’une
programmation définie au niveau central par une nouvelle direction
qui devrait également promouvoir une comptabilité analytique
pour « permettre l’établissement, au niveau régional,
des comptes de gestion et d’un tableau de bord économique
».
Nommée « Service des programmes et
des études économique » (SPEE), cette direction fut
créée par Pierre Marzin dès sa nomination comme directeur
en 1968. Le premier responsable du SPEE fut Gérard Théry,
futur directeur général et qui était alors l’un
des « jeunes loups » désignés à l’époque
comme « la bande des quatre, dite des colonels » qui œuvraient
pour la nomination de Pierre Marzin à la tête de la DGT.
Les rapports Chanet insistèrent en premier lieu sur la priorité
à accorder à l’automatisation intégrale des
installations d’abonnés. Très impliqué dans
la rédaction des rapports Chanet, Gérard Théry est
considéré comme ayant été derrière
une « décision anti-démagogique » importante
consistant à développer et automatiser le réseau
interurbain avant d’« ouvrir en grand le robinet des nouveaux
abonnés ».
Le ministère des PTT était un des
sept ministères qui participaient à l’étude
pilote de la RCB lancée dès janvier 1968 et la mission fut
menée par le SPEE, nouvellement créé au sein de la
DGT. Gérard Théry invita alors Jean-Bernard Hauser, ingénieur
du corps des Mines à prendre un poste de responsabilité
au SPEE. Jean-Bernard Hauser se souvient être « arrivé
en même temps que cette demande [d’étude RCB] du Budget
et, donc, mon premier travail a été de lancer cette équipe
».
Le premier projet mené par Jean-Bernard Hauser
au sein du SPEE était l’étude d’un choix technologique
fondamental pour le rattrapage et pour le développement d’une
industrie française des télécommunications. Cette
étude, nommée « Commutation électronique »,
devait évaluer le potentiel de deux systèmes électroniques
alternatifs en développement au CENT : le premier, Périclès,
à Paris, et le deuxième, Platon, à Lannion en Bretagne.
Les différences entre les deux systèmes concernaient à
la fois l’état réel d’avancement technologique
et le coût final de leur déploiement. La recherche sur le
premier système était en cours au CNET depuis 1957 et visait
à développer un système de commutation électronique
avec une connexion physique ou « spatiale ». Le deuxième,
développé depuis 1962, visait un système de commutation
entièrement électronique ou « temporelle ».
La recherche sur la commutation spatiale était plus avancée
et son déploiement était moins dépendant des avancées
technologiques dans le domaine des composants électroniques que
le système de commutation temporelle. Cependant, le système
de commutation temporelle du CNET était plus innovant et les télécommunications
françaises étaient en avance par rapport aux autres pays
grâce à la proximité des services de commutation et
de transmission installés en Bretagne. Ses progrès se nourrissaient
également de liens forts avec l’industriel installé
sur place : la CGE. L’arrivée à maturité de
la recherche sur la commutation électronique temporelle offrait
donc à la DGT la possibilité de sortir de l’emprise
des technologies étrangères fournies par les filiales françaises
d’ITT et de Ericsson. Pour réaliser une comparaison réaliste
des deux technologies naissantes, cependant, une étude poussée
des conséquences de leur déploiement dans le réseau
fut jugée nécessaire.
Le directeur du CNET à l’époque,
Louis Joseph Libois, présente ce projet comme une étude
« des grandes options concernant l’équipement du réseau
». Elle fut préparée « selon des méthodes
relevant, dans leurs grandes lignes, de l’analyse coût-efficacité
». Il y est précisé néanmoins que « la
commutation électronique, en tant que technique, étant encore
au stade de l’expérimentation, il n’était donc
pas possible de calculer un bilan coût/avantage totalement quantifié
ni de proposer un véritable programme d’introduction de ces
commutateurs dans le réseau. L’étude pilote a néanmoins
permis d’identifier les variantes entrant en concurrence ainsi que
leurs échéanciers de mise au point industrielle. Une méthodologie
d’étude de coût a été dégagée.
L’analyse du “marché”, c’est-à-dire,
du nombre de commutateurs dont le réseau aura besoin complète
la première phase de l’étude. On dispose ainsi de presque
tous les éléments nécessaires à la comparaison
des solutions selon divers critères. Le groupe d’étude
juge cependant opportun d’approfondir sa connaissance de l’aspect
industriel du problème : les sources d’information à
ce sujet sont difficilement exploitables ».
Avec Jean-Bernard Hauser, l’équipe mobilisée
pour cette étude impliqua René-François Bizec, qui
était à la direction de la Prévision, avant de venir
à la DGT un spécialiste de la recherche opérationnelle,
ainsi qu’un ingénieur du CNET, Henri Bustarret. Cet ingénieur
des télécommunications avait été auparavant
au commissariat au Plan. Selon les souvenirs de Jean-Bernard Hauser :
« à l’époque cette commutation temporelle apparaissait,
pour pas mal de gens, comme quelque chose d’assez bizarre. Tout le
monde avait l’habitude de penser à des connexions spatiales
». L’équipe de l’étude pilote de la RCB
mena une série d’entretiens avec des personnes du CNET et
à l’extérieur pour appréhender le potentiel
des deux. D’abord, en rencontrant les deux équipes, «
ce que cette technique d’interview a mis en lumière –
autant pour moi qui n’y connaissait rien mais aussi pour Bustarret
– c’est que les gens de Périclès nous ont expliqué
qu’ils avaient une machine qu’ils essayaient de faire fonctionner
sans qu’il y ait trop de bugs [depuis un temps assez long]…
par contre, l’équipe de Lannion avaient quelque chose qui
semblait marcher. Il y avait des pilotes de 300, 400 et 1 500 lignes à
un ou deux endroits et ça semblait bien fonctionner ». L’équipe
a ensuite procédé à un circuit d’entretiens
auprès des industriels, Alcatel et Ericsson, pour évaluer
les coûts prospectifs et « la conclusion qu’on a ramenée
était que non seulement le système temporel semblait marcher
mais que, en fait, les prospectifs de coûts semblait tout à
fait compétitifs – à moyen terme évidemment
– avec le système traditionnel ».
Dans un article au sujet de l’intérêt
de transposer des méthodes de planification et de programmation
dans le domaine de la recherche, Louis-Joseph Libois semble faire référence
à cette étude pilote de la RCB. Il y cite l’exemple
d’une situation en recherche où une décision technique
de grande importance devint nécessaire pour trancher entre deux
alternatives qui se concurrençaient sur les plans techniques et
économiques et y explique que « en commutation électronique,
la situation était analogue entre systèmes de type «
spatial » et systèmes de type « temporel »…
le choix, en ce qui concerne le CNET, devait être effectué
en 1970 selon l’objectif fixé il y a trois ans. En fait, il
vient de l’être récemment et l’on passe maintenant
à la seconde phase de l’objectif : la définition pour
1973 d’un système unique de commutation électronique
basé sur les choix effectués par le CNET en 1970.
En raison de la nature encore expérimentale
de la commutation électronique, la DGT insista sur le fait que
l’étude ne pouvait pas proposer un programme d’introduction
de ces commutateurs mais considéra qu’elle avait « néanmoins
permis d’identifier les variantes entrant en concurrence ainsi que
leurs échéanciers de mise au point » et une analyse
plus approfondie du marché allait permettre de disposer de «
presque tous les éléments quantitatifs nécessaires
à la comparaison des solution selon divers critères ».
Jean-Bernard Hauser a le souvenir d’une étude
courte et succincte : « on a passé trois ou quatre mois là-dessus
et pour une bonne partie pour arriver à maîtriser les choses
et à préparer un questionnaire d’interview et à
essayer de bien comparer tout ça. Pour créer le papier,
on avait une technique d’ingénieur. Donc, je ne pense pas
qu’on ait fait cent pages ! ». L’étude ne fut pas
non plus largement diffusée : « le document n’était
pas très formel parce que c’était quand même
un dossier sensible. C’était plutôt destiné d’une
part à Marzin et, de l’autre à Libois. Il a dû
y avoir un nombre limité de destinataires primaires ». Néanmoins,
il se souvient quand même que, quand l’étude a été
présentée par Gérard Théry à Pierre
Marzin, « ce papier a amené une prise de conscience interne
tout à fait forte sur ce point… je pense que le statut de
l’équipe de Lannion a été largement remonté…
ça a aidé à la prise de conscience ». Jean-Bernard
Hauser a également un souvenir « d’une réunion
où Libois avait expliqué que c’était formidable
et qu’il avait réussi à obtenir des prix objectifs
qui étaient nettement en baisse de 15 % par rapport à la
première mouture et que donc c’était extrêmement
intéressant ».
Finalement, pour Jean-Bernard Hauser, cette étude
était peu représentative de ce qu’était la RCB
: « Ce que l’on a fait n’avait rien à voir avec
la méthodologie RCB. Le grand modèle que l’ingénieur
mettait sur la RCB, c’était l’étude qui était
discutée en long et en large au cours de la présentation
[de la RCB] c’était l’étude de rentabilité
de Paris-Lyon en TGV, en valorisant l’économie de temps qu’y
mettaient les gens. La RCB à l’époque était
quand même très inspirée de la recherche opérationnelle,
de l’idée qu’en mettant en place les techniques mathématiques,
on allait pouvoir gagner des choses ». Il rappelle également
« qu’il y a eu un séminaire qui a duré une semaine
à Marly en septembre 1968 pour présenter les choses. Il
n’y avait pas d’instruction mais l’idée de base
était qu’il faut mettre à plat les procédures
budgétaires pour essayer de trouver une méthode pour arriver
à éviter que les gens fassent leur technique par silo vertical
pour les envois, les transports, etc. et avoir un regard général
sur tout ça »
Les spécificités de la DGT dans la mise en œuvre
de la RCB
Jean-Bernard Hauser participa à l’écriture
d’un article publié dans la Revue de la RCB en 1971 qui compare
les systèmes de gestion de la Poste, des Télécommunications
et du ministère de l’Équipement et les trois expériences
indépendantes menées dans chaque organisme. Les auteurs
se félicitent « d’une étonnante convergence des
idées » et expliquent que « les grandes lignes des
procédures prévues se sont toutes inspirées des techniques
de management des grands groupes industriels qui, malgré leur taille
égale ou supérieure à celle de nos Ministères
et leur diversité de production, réussissent à allier
souplesse et efficacité ». Sept idées sont présentées
comme « classiques » :
- définition des programmes avec objectifs
et indicateurs ;
- affectation des responsabilités de réalisation
;
- décentralisation à tous les niveaux
;
- crédits globaux non affectés par
nature ;
- décisions « tactiques » laissées
aux responsables ;
- contrôle de gestion des organes décentralisés
à travers la comptabilité de gestion et les indicateurs
d’objectifs ;
- une politique du personnel qui permet le développement
d’une direction par objectif.
Même si les trois administrations se ressemblent
dans la mesure où elles fournissent toutes un service bien défini
grâce à une infrastructure industrielle importante, l’analyse
d’un tableau comparatif des caractéristiques justifie, selon
les auteurs, le fait que leurs priorités divergent. L’Équipement
bénéficiant, par exemple, d’une souplesse financière
grâce aux crédits des collectivités locales et n’ayant
qu’une faible proportion d’exploitation dans ces activités,
était fondée à ne pas adopter aussi rapidement les
travaux sur le système de gestion que les deux autres administrations.
Sa priorité fut la définition des objectifs des directions
départementales d’équipement (DDE) suite au regroupement
Construction-Travaux Publics, suivi par la mise en place de la nouvelle
organisation et des budgets de programme. Pour sa part, Les Postes priorisent
la conception d’un système d’indicateurs pour pallier
les manquements de son appareil statistique. Les Télécommunications,
au contraire, disposaient d’une base statistique satisfaisante grâce
aux remontées des commutateurs et pouvaient se concentrer, plutôt,
sur l’analyse des coûts où la difficulté résidait
dans la séparation des dépenses d’exploitation et d’investissement
dans les services des lignes.
Pour le reste, les problèmes rencontrés dans les trois administrations
se ressemblent. Les auteurs reconnaissent le surcroît du travail
imposé par la préparation des budgets et leur contrôle.
En contrepartie, il est nécessaire que le système soit crédible
et que ses dirigeants ne changent pas les règles en modifiant les
attributions des budgets en cours d’exercice. Il est nécessaire
également de former les personnes concernées et de poursuivre
les actions pendant plusieurs années. Finalement, les auteurs évoquent
un défi plus fondamental dans les efforts déployés
pour faire adopter une gestion rigoureuse : « Comment le faire dans
un cadre administratif conçu de telle façon que le responsable
n’a pas le choix de son personnel, n’a pratiquement aucune action
ni sur leur carrière, ni sur leur rémunération, qu’il
ne peut que difficilement choisir entre deux moyens concurrents pour atteindre
le même but (l’exemple le plus classique étant l’arbitrage
entre faire soi-même, et recourir à l’extérieur)
et qu’il n’a pas le plus souvent la responsabilité de
l’organisation. Le Budget de l’État fixe impérativement
beaucoup trop d’éléments plus de huit mois avant l’exercice
pour que tout soit parfaitement prévu ».
Malgré ces difficultés en ce qui concerne
la gestion du personnel, entre 1972 et 1977, la DGT présenta annuellement
une série de mesures pour l’adoption de trois types d’initiatives
de la RCB : les études analytiques, le budget de programme et la
modernisation de la gestion.
Les études analytiques
Lors des présentations des missions
RCB du ministère des PTT auprès de la Commission interministérielle
de RCB, les études analytiques furent initialement présentées
de manière très synthétique. Il s’agit notamment
des études sur le lancement d’un nouveau navire câblier
en 1971 et sur le système général de traitement des
objets de correspondance qui comportaient trois grandes branches : l’étude
du réseau, des établissements et des matériels en
1972. L’étude du nouveau navire câblier fut utilisée
« pour le choix d’équipement, ainsi que différentes
autres études effectuées par la DGT, notamment sur l’optimisation
des réseaux urbains et interurbains ». Les explications devinrent
plus détaillées à partir de 1973. Les objectifs de
l’étude de l’optimisation des réseaux qui durèrent
entre 1973 et 1976 étaient d’améliorer l’enchaînement
entre la prévision, la planification, la programmation et l’équipement
d’extension des réseaux et la détermination de leur
structure globale et leurs composants pour améliorer la qualité
et baisser le coût unitaire des investissements66. En 1974, ces
études s’orientèrent vers la capacité optimale
des réseaux de sécurité et, en 1975, le programme
SIMEX pour le routage et la technique d’ensemble des faisceaux de
jonctions dans les régions se compléta avec le programme
PLANEX pour le réseau interurbain. Une nouvelle étude fut
lancée également en 1975 pour aborder le sujet de la politique
d’acheminement dans les réseaux locaux. Une dernière
étude fut lancée en 1977 pour le développement d’un
système de prévision de la demande à moyen terme
et pour permettre la planification du déploiement du réseau
téléphonique au niveau local, régional et national
jusqu’en 1985.
Les études sur les produits nouveaux lancées
également en 1973 se concentrèrent sur la commutation électronique,
pour examiner si les besoins du réseau national étaient
en adéquation avec ceux de l’exportation avec d’autres
études concernant la téléinformatique et l’appel
unilatéral. Dès 1972, on évoqua une étude
de la visiophonie avec un premier programme de réseau interne au
CNET à élargir à un réseau commuté
entre Paris et l’Ouest de la France68. En 1974, ces études
sur les produits nouveaux furent élargies avec une étude
économique au sujet des différentes méthodes pour
établir un réseau de télécommunications «
avec des mobiles » et une nouvelle étude analytique concerna
le comportement des abonnés pour améliorer les décisions
concernant la politique de tarification et de développement des
réseaux avec des échantillons de ménages et d’entreprises
dans deux régions pilotes.
Entre 1976 et 1977, une étude intitulée
« panel d’abonnés » développa une base
descriptive des abonnés à un niveau plus fin que celui de
la région pour permettre une modélisation du comportement
téléphonique, prévoir le trafic et nourrir des études
de tarification. Cette méthode d’amélioration de la
connaissance de la consommation fut choisie pour son coût peu élevé
et sa grande efficacité dans le but d’effectuer « une
analyse systématique des moyens les plus adaptés pour atteindre
l’objectif qui est la satisfaction de l’abonné ».
Le budget des programmes et la modernisation de la gestion
Entre 1972 et 1975, deux activités
majeures furent entreprises par la DGT : l’organisation du budget
de programmes à travers l’organisation et l’introduction
d’un système de comptabilité de gestion dans les directions
régionales pour accompagner la modernisation des méthodes
de gestion avec un suivi des tableaux de bord. Le détail de la
mise en place de ces initiatives fut présenté par Jean-Bernard
Hauser et René-François Bizec dans un article paru dans
la Revue de la RCB en 1971. Les étapes décrites étaient
envisageables grâce à la décentralisation de la prise
de décision vers les directeurs régionaux entreprise suite
à l’adoption des recommandations des rapports Chanet et à
l’augmentation du budget d’autorisation de programmes. Le
ministère des PTT fut présenté en 1972 comme le seul
à avoir mis en place les cinq éléments d’un
budget de programmes.
Hauser et Bizec expliquent que les Télécommunications «
ont pu très rapidement appliquer les méthodes de rationalisation
des choix budgétaires » et ils présentent l’application
de la RCB comme une amélioration de la gestion inspirée
des grandes entreprises privées et publiques, en citant en particulier
Bell Canada, AT&T et l’administration des Télécommunications
suédoise. Il en découle que l’organisation des télécoms
doit « chercher à dégager un maximum de ressources
propres – quelles que soient les possibilités d’emprunt
extérieur – c’est-à-dire augmenter leur cash flow.
À tarif fixe, il existe deux moyens : choisir le mieux possible
les investissements à réaliser et essayer de comprimer les
frais de fonctionnement ». Les deux étapes correspondantes
du processus sont présentées : la préparation du
budget d’investissement dans un contexte décentralisé
et la mise en place d’un système de « plan-programme-budget
» et de contrôle de gestion a posteriori qu’ils décrivent
comme « capable de suppléer les lacunes des règles
administratives ».
Entre 1968 et 1971, le budget annuel d’investissement
de la DGT avait doublé pour atteindre six milliards de francs.
Ces investissements d’extension de réseau se déroulaient
sur trois ans et se succédaient, nécessitant une coordination
entre les dépenses pour des bâtiments, pour des autocommutateurs
et pour des équipements de transmission. Un tiers des investissements
concernaient l’interurbain qui était organisé au niveau
national mais les choix d’investissement pour les deux autres tiers
du budget concernaient l’échelon régional où
les directeurs « peuvent être considérés comme
des entrepreneurs libres des choix techniques et maîtres de la cohérence
des investissements ».
Lors de la préparation du VIe Plan démarré
en 1971, trois objectifs furent priorisés : l’automatisation
de l’ensemble du réseau français avant 1977, le raccordement
de nouveaux abonnés et le renouvellement d’équipements
anciens. Des études financières lancées au SPEE permirent
de calculer une fourchette de nombre d’abonnés et d’en
déduire un délai moyen de raccordement. Les directeurs régionaux
furent sollicités sur la base de ces chiffres nationaux estimés
pour chiffrer les crédits nécessaires pour atteindre ces
objectifs et les estimations donnèrent lieu à des discussions
pour fixer des « enveloppes » budgétaires. Ces budgets
comportaient des coûts de raccordement de nouveaux abonnés
ainsi que des coûts d’investissements pour des opérations
plus lourdes comme l’installation d’immeubles de bureaux et
des centres de transit.
Ce système d’enveloppe correspondait
à la vision décentralisée de la DGT prévue
dans le rapport Chanet de 1967 et il « a rencontré l’entière
approbation des Directeurs régionaux ». Elle remplaça
un système qui empêchait jusque-là les télécommunications
de coordonner les travaux de manière rationnelle et que Gérard
Théry considérait comme « vraiment soviétique
» car il obligeait les directeurs régionaux à solliciter
séparément différents « bureaux » au
niveau central des PTT pour investir dans les bâtiments, la commutation
et les lignes. Gérard Théry se souvient qu’à
cette époque : « les bureaux règnent et les directeurs
régionaux ne sont rien par voie de conséquence ; il y a
toujours des bâtiments qui ont été construits et qui
attendaient la commutation ou bien on ne pouvait pas mettre la commutation
car il n’y a pas de bâtiment et quand on a le bâtiment
et la commutation, on n’a pas de transmission, il n’y a pas
de lignes ». Michel Feneyrol, ancien membre du SPEE, se souvient
: « Durant la période 1970-1975, le SPEE s’est efforcé
budget après budget, de faire sauter des contraintes sur la gestion
». Un autre cadre de la DGT, Denis Varloot, précise qu’un
objectif précis de Gérard Théry était explicitement
de « faire sauter un maximum de paragraphes et de sous-paragraphes
» pour sortir de la répartition administrative des fonds
qui ne permettaient aucun transfert en cours d’année des investissements
fléchés pour une utilisation très spécifique
– celle prévue au sous-paragraphe en question. Cette souplesse
était d’autant plus nécessaire que les règles
budgétaires exigeaient la dépense « dans l’année
de l’intégralité des sommes mises à disposition
en début d’année, sauf à perdre le reliquat
».
Après la décentralisation du processus
budgétaire, le deuxième volet du nouveau système
de gestion à la DGT était le développement d’un
système comptable pour appréhender les coûts et permettre
un contrôle de gestion. Comme l’expliquent Hauser et Bizec,
« il ne sert à rien de mettre en place une procédure
relativement perfectionnée de préparation des budgets d’investissements
si les réalisations des investissements programmés se font
à n’importe quel prix et si les coûts de fonctionnement
ne sont pas rigoureusement analysés de façon à permettre
une préparation cohérente du budget de fonctionnement ».
Deux objectifs sont donnés pour un tel système comptable
:
- chiffrer clairement les dépenses pour les
responsables pour pouvoir les contrôler et, si nécessaire,
apporter rapidement des actions correctrices ;
- fournir des éléments pour le choix
d’investissements, de tarification et les problèmes d’organisation
en répondant à des questions telle que « quel est
le prix de la pose d’un poste téléphonique à
Paris ? ».
La spécificité de la comptabilité
analytique pour le secteur des télécoms s’explique
par la coexistence de deux activités différentes avec deux
types de dépenses. La première consiste à entretenir
et exploiter les réseaux existants à travers des programmes
de fonctionnement. En 1971, cette activité représentait
40 % du total soit quatre milliards de francs. Ce budget est rigide et
les dépenses sont répétitives et mises en œuvre
à des niveaux de responsabilité relativement faibles. Pour
suivre et analyser ces dépenses, une liste de 200 activités
fut créée avec des sous-fonctions regroupées en neuf
fonctions. Ces activités élémentaires « correspondent
le plus souvent à l’exécution des tâches analogues
et doivent permettre l’imputation des charges homogènes mesurables
par une unité commune et en particulier l’affectation facile
de l’ensemble des personnels ». À chaque activité
étaient associés une unité d’œuvre, des
indicateurs d’objectifs et, si possible, une délégation
des responsabilités. Au sein de chaque activité étaient
distinguées les dépenses d’entretien, d’exploitation
ou de travaux neufs. Selon son niveau hiérarchique, chaque unité
organisationnelle pouvait exercer entre 10 et 100 activités élémentaires
et une même activité pouvait exiger la participation de plusieurs
unités.
Le deuxième type de dépenses dans les télécommunications
concerne les investissements qui demandaient l’affectation à
un compte de travaux appelés « chantier ». En 1971,
ces dépenses représentèrent 60 % du budget des télécommunications,
soit six milliards de francs. Les activités élémentaires
concernées par ce type de dépense ne s’établirent
pas sur une base nationale comme pour les dépenses opérationnelles.
Cependant, pour des investissements de petite taille et répétitifs,
comme la pose de téléphone simple dans un logement, un mécanisme
de chantiers permanents fut établi. Pour
décentraliser et développer une « direction par objectifs
», les informations sur les coûts des moyens utilisés
étaient communiquées aux « unités de base »
de l’organisation, situées au niveau des centres locaux.
Deux expériences furent menées pour développer le
système à mettre en place. La première expérience
eut lieu dans la région de Nancy en 1969. Les données y
furent exploitées manuellement et l’objectif déclaré
qui était d’obtenir des résultats « exploitables
» par l’ensemble des régions en 1970 fut atteint. La
deuxième expérience concerna la région de Toulouse
et fit appel à une société d’études,
la SEMA. Elle était plus ambitieuse puisqu’elle était
marquée par la volonté d’adopter un traitement informatique
de l’information, ce qui ralentit l’expérience. Il était
prévu que cinq régions reprennent le système d’analyse
comptable en 1972, ce qui correspondait à « une extension
relativement lente » et reflétait la nécessité
de prévoir un traitement mixte avec « des pavés informatiques
prenant en charge les manipulations de données les plus lourdes
mais la synthèse restant faite à la main ».
Trois utilisations de l’outil comptable
étaient envisagées.
L’utilisation la plus simple concernait les études et la planification
car la statistique standard - avec des informations sur les prix de revient
des produits et les recettes - existait déjà avec une comptabilité
plus sommaire. La mise au point d’un système plus détaillé
exigeait, par contre, la participation des équipes comptables à
des études économiques pour éviter que ces équipes
« ne s’enferment dans leur technicité ».
La deuxième utilisation prévue pour l’outil comptable
était les tableaux de bord pour des responsables avec des éléments
clés à suivre régulièrement. Ces éléments
devaient comprendre les objectifs fixés par et pour le responsable
et les éléments des tableaux devaient être mis à
jour tous les deux mois, tous les quatre mois, ou tous les ans en fonction
de leur variabilité. Les données devaient être synthétisées
de la façon la plus simple possible, en présentant des séries
temporelles d’évolution avec des graphiques, des ratios rapportant
les dépenses à une unité d’œuvre et une
comparaison de ratios entre unités semblables. Après un
an d’expérience, il était prévu de jumeler ces
tableaux de bord avec un système de gestion par objectifs. Finalement,
la troisième utilisation de l’outil comptable était
la sensibilisation des responsables à l’effort de réduction
de coûts. Une expérience pilote de budget prévisionnel
détaillé accompagné d’objectifs précis
fut lancée à Nancy en 1972 mais les responsables considérèrent
alors comme « peu probable que l’on puisse rapidement obtenir
des résultats probants » et que « il ne s’agira
guère que d’une action de sensibilisation ».
Même si le budget d’équipement
de la DGT fut déjà présenté sous forme de
budget de programmes pour la loi de finances de 1972, l’objectif
de faire la même chose pour les dépenses de fonctionnement
posa des problèmes « plus délicats ». Guy Berger,
en tant que représentant du ministère des PTT à la
Commission, exprima le souhait que cette réforme profonde puisse
aboutir en 1974 ou 1975 mais nota qu’« il convient cependant
d’être prudent et de ne pas procéder à des réformes
qui ne soient que de présentation et ne représentent qu’un
habillage des pratiques traditionnelles dans l’étude et la
gestion des crédits ». Une expérimentation de la nouvelle
méthode d’attribution d’emplois par enveloppes salariales
eut lieu en 1974. Les efforts se concentrèrent à nouveau
en 1975 sur les investissements avec une différenciation entre
un « noyau » pour un programme minimum concernant essentiellement
des opérations d’extension et un programme complémentaire.
En 1977, la DGT présenta cette initiative
concernant les budgets des programmes comme un ensemble de mesures contribuant
au bon fonctionnement de l’organisation actuelle et à son
développement : « En ce qui concerne les télécoms,
à chacun des services seront associés un programme finalisé
et des programmes d’action, ainsi qu’un bilan financier qui
sera établi afin d’en apprécier le taux de rentabilité
globale. Ceci implique la nécessité de faire apparaître
l’ensemble des dépenses qui contribuent à la réalisation
des objectifs aussi bien en équipement qu’en fonctionnement,
et à prendre en compte des crédits d’origines diverses,
budgétaires et extra-budgétaires (paiement des sociétés
de financement, fonds de concours). La structure du budget de programmes
comprendra trois groupes de programmes qui correspondent aux services
fournis par les télécommunications : le service téléphonique,
les services complémentaires et services nouveaux, les programmes
de soutien. Chaque groupe de programmes est divisé en trois ou
quatre programmes d’action et est accompagné d’objectifs
qualitatifs et quantitatifs ainsi que d’un bilan financier qui permet
de comparer les charges et les produits ».
Dans le groupe de travail sur les structures des
programmes, les initiatives de la DGT sont considérées comme
ayant les trois propriétés recherchées : flexibilité,
possibilité d’agrégations multiples et possibilité
de traitement automatisé. Le rôle de la structure des programmes
fut présenté comme étant, en premier lieu, la base
de la gestion interne et, ensuite le cadre de la discussion budgétaire.
Elle ne fut pas considérée comme contribuant à l’éclairage
des choix. Le système de calcul de coûts de la DGT se servit
d’un des trois exemples de systèmes déjà mis
en place dans l’administration française en expliquant qu’il
« permet de déterminer rapidement et systématiquement
les coûts des réalisations d’ensemble, sans nécessiter
d’étude spécifique. Elle a pour but de satisfaire deux
objectifs : à court terme, éclairer les responsables sur
l’évolution de l’unité dont ils ont la charge,
et, à long terme, fournir des éléments pour les décisions
de choix d’investissements, de tarification, et pour les problèmes
d’organisation ».
En ce qui concerne le tableau de bord des directeurs
régionaux, Guy Berger, limita également les attentes de
la Commission tout en mettant en avant le progrès déjà
obtenu en expliquant : « il est évident que les indicateurs…
ne sont pas des instruments qui permettent aux directeurs et au ministère
de prendre des décisions. Mais, depuis trois ou quatre ans, nous
avons établi à l’échelon global un certain nombre
de priorités qui sont assorties d’indicateurs globaux quantifiés.
Il s’agit de l’écoulement du trafic et de l’automatisation
intégrale des réseaux téléphoniques. Ces priorités
permettent de quantifier l’effort à faire et de répartir
ensuite les efforts entre des grands programmes. Elles permettent également
de choisir entre les programmes à un niveau élevé
et au niveau gouvernemental ».
Dès octobre 1972, en effet, les directions
régionales des télécommunications disposèrent
d’un tableau de bord avec une triple mission :
- au niveau de la région, il s’agit
de donner au directeur régional un outil de gestion synthétique
alimenté à la fois par la comptabilité de gestion
et les statistiques et qui lui permette de comparer chaque bimestre les
réalisations aux objectifs pour modifier, si besoin est, ses plans
d’action (notion d’auto-contrôle) ;
- au niveau des relations direction générale
– direction régionale, le tableau de bord doit progressivement
fournir un support aux négociations périodiques sur les
objectifs et les moyens, en particulier dans le cadre budgétaire
annuel ;
- au niveau de la direction générale,
le regroupement des tableaux de bord des directions régionales
en un tableau consolidé permet d’une part aux services fonctionnels
d’effectuer un suivi de la réalisation des objectifs qui les
concernent et d’autre part à un département «
contrôle de gestion » spécialement créé
à cet effet d’assurer la fiabilité des informations
et d’effectuer des analyses globales ».
Pour développer un processus de gestion par
objectifs, les directeurs régionaux eurent à leur disposition
un service national de conseil.
En 1974, ce système fut amélioré en l’adaptant
aux besoins des gestionnaires et en intégrant un plan de fonction
des comptables pour développer un audit interne et rechercher une
plus grande cohésion avec le système d’informations
statistiques. Une interface fut développée avec le système
PRORLI pour que la partie « chantiers » de la comptabilité
de gestion contribue à la rationalisation de l’ordonnancement
des travaux de lignes. L’expérience pilote de Strasbourg fut
reproduite à Marseille. Les analyses régionales contribuèrent
en 1975 à une réflexion sur la gestion des télécommunications
et le tableau de bord du directeur général s’ajouta
au dispositif décentralisé. L’ensemble de ces mesures
de modernisation de la gestion permirent à la DGT de conclure ce
volet en 1977 en expliquant que : « l’aide à la décision
est facilitée par le développement d’outils de gestion
tels que les applications informatiques, les fichiers techniques, la comptabilité
de gestion, PRORLI, les tableaux de bord individuels, etc.
Le tableau de bord du Directeur Général et la Delta
LP
La nomination de Gérard Théry
à la direction des Télécommunications en 1974 s’accompagna
d’une nouvelle réorganisation et d’une modification profonde
du fonctionnement de la DGT. Les objectifs de cette nouvelle direction
étaient clairement en phase avec les recommandations des rapports
Chanet dont Gérard Théry fut un acteur central. Avec l’élection
de Valéry Giscard d’Estaing, la nécessité de
résorber le retard du téléphone en France était
reconnue au plus haut niveau de l’État. Son expérience
à la tête du SPEE et son succès en tant que directeur
des Télécommunications à Paris permirent également
à Gérard Théry de bénéficier de la
confiance du conseiller technique au Secrétariat général
de l’Élysée, François Polge de Combret, un proche
du Président.
Le programme « téléphone pour
tous » du VIIe Plan représenta un virage définitif
du rattrapage des télécommunications en France à
partir du 1975. Les cinq objectifs du programme dépassèrent
cependant le simple cadre d’une augmentation massive des investissements
pour fixer un cadre ambitieux pour la réforme de l’organisation
et de son environnement industriel :
- un taux de pénétration qui permit
enfin de rattraper le retard ;
- un niveau de qualité de service important
;
- un développement de la gamme de services
;
- la restructuration de l’industrie avec des
objectifs d’exportation et d’emplois ;
- une politique de recrutement et d’intéressement
du personnel.
En plus du simple rattrapage (objectifs 1 et 2),
les ambitions de Gérard Théry s’étendirent clairement
au-delà du rattrapage vers le développement d’une dynamique
d’innovation (objectifs 3). La création de la DAII correspondit
à la nécessité perçue par la nouvelle direction
de séparer la recherche de la fonction achat. Cette centralisation
du pouvoir décisionnel permit une transformation de l’écosystème
français des télécommunications (objectif 4), longtemps
dans l’ombre des fournisseurs étrangers, mais elle fut largement
et longtemps contestée par les ingénieurs du CNET. Pour
pouvoir poursuivre ses ambitions, la DGT réalisait toutefois qu’il
fallait faire ses preuves et démontrer des gains de productivité
importants qui nécessitaient un accroissement des effectifs et
un engagement collectif de la part de l’ensemble du personnel (objectif
5).
Les orientations de Gérard Théry vers
la modernisation de la gestion des télécommunications françaises
représentèrent le fruit d’une évaluation méthodologique
des techniques de management observées de près lors des
voyages d’études entrepris pendant son année au CNET
en 1967. Il convainquit Pierre Marzin de faire venir des conseillers canadiens
de Bell Canada pour conseiller la DGT dans la mise en place du système
de gestion inspiré du fameux « Bell System » de l’opérateur
américain, AT&T. Denis Varloot au SPEE explique a posteriori
la nature « presque clandestine » de ces initiatives «
car le directeur général, Pierre Marzin, ne voulait pas
être entravé dans sa démarche par la direction du
Budget, l’une des directions horizontales du ministère, attachée,
bien sûr, à l’orthodoxie et aux détails des règles
de la comptabilité publique. L’idée était de
commencer à savoir comment on utilisait l’argent. Dans cette
affaire, l’expérience et l’assistance des conseillers
de Bell Canada furent révélatrices et précieuses
».
Un aspect central du « Bell System »
était la décentralisation de la prise de décision
vers le terrain, accompagnée d’objectifs clairement identifiés
pour les décisionnaires. La complexité de cette décentralisation
était identifiée explicitement dans l’introduction
par Henri Chanet aux rapports des groupes de travail : « toujours
à propos des structures administratives, il me semble pouvoir vous
être utile que nous complétions notre rapport, sur les points
qui concernent la déconcentration au profit des directeurs régionaux
des télécommunications, par l’indicateur d’une
réflexion qui, sans être restrictive, marque l’intérêt
de certaines précautions dans la réalisation de cette déconcentration.
Il nous a paru que celle-ci, pour n’avoir pas de conséquences
déraisonnables ou simplement hétérogènes,
devait être assortie d’un contrôle a posteriori des résultats
obtenus permettant aussi de porter sur les responsables un jugement sûr.
Il nous a semblé que l’organisation de ce contrôle risquait
de mettre en cause les conceptions et les institutions actuelles et que
le cadre d’un problème aussi délicat débordait
largement celui de la mission que vous nous aviez confiée »101.
Cette complexité rendit difficile l’élargissement
de la méthode des enveloppes mise en place pour les investissements
et rendue possible par les restructurations successives dès 1968
et par l’augmentation importante des investissements grâce
à la création des sociétés de financement.
En tant que représentante du ministère des PTT, Jacqueline
Simon rappelle que l’augmentation importante du taux de croissance
de la productivité aux télécommunications –
10 % encore en 1974 – représentait « un des taux le
plus élevés au monde ». Elle souligne de même
que les PTT furent les premiers investisseurs et les premiers emprunteurs
sur le marché financier, dépassant largement EDF et insiste
sur le fait que « nous ne sommes pas une administration classique.
Nous sommes des industriels ». En conclusion, elle appelle à
une reconnaissance du problème des budgets du personnel : «
il faut bien se rendre compte de ce hiatus. Les directeurs régionaux,
responsables de la réalisation d’un taux très élevé
de développement, peuvent planifier leurs investissements à
l’intérieur d’une enveloppe triennale glissante, mais
ils ne peuvent pas planifier le recrutement d’un seul agent ! Je
ne crois pas qu’il y ait beaucoup d’entreprises qui puissent
fonctionner dans ces conditions ».
En 1975, la DGT annonça que la décentralisation
des budgets d’investissement à travers le système d’enveloppes
pour les directeurs régionaux déjà en place depuis
le début des années 1970 allait s’étendre aux
budgets du personnel. L’objectif de ce nouveau système d’enveloppes
était « de donner aux chefs des services extérieurs
une liberté de choix aussi grande que possible ». Avec la
création des directions opérationnelles, les directions
régionales avaient, à partir de 1975, la responsabilité
de l’ensemble des investissements dans leur territoire ainsi que
l’autonomie nécessaire pour les affecter.
Un tableau de bord fut développé par
le SPEE comme outil de pilotage de la production en coopération
avec une équipe d’étude externe, la SEMA, et en s’appuyant
sur les conseils du cadre de Bell Canada venu soutenir les efforts de
modernisation de la gestion, Robert Brulé. Les indicateurs choisis
lors d’une réunion du 16 janvier 1975 inclurent des éléments
quantitatifs mais aussi qualitatifs.
Les indicateurs suivis mensuellement dès
le 1er janvier 1975
1. Produits budgétaires
2. Accroissement net du parc de lignes principales (LP)
3. Demande nette (téléphone) : Court terme & Long terme
4. Demande satisfaite (téléphone) : Court terme & Long
terme
5. Lignes principales non automatiques : Court terme & Long terme
6. Production d’équipements de commutation (téléphone)
7. Accroissement du parc d’abonnés (télex)
8. Demande nette (télex)
9. Demande satisfaite (télex)
10. Production d’équipements de commutation (télex)
11. Production des groupes primaires sur les artères de transmission
12. Production de circuits interurbains
13. Taux d’attente de tonalité < 3 secondes
14. Taux d’attente de tonalité < 10 secondes
15. Taux d’efficacité intra ZAA106
16. Taux d’efficacité extra ZAA
17. Dérangement pour 100 lignes principales
18. Vitesse de relève des dérangements (seuil 2 jours)
19. Vitesse de relève des dérangements (seuil 7 jours)
20. Taux d’appels interurbains efficaces au départ de Paris
À travers ce tableau de bord des directeurs
régionaux, Gérard Théry pilota personnellement l’accélération
du rattrapage. Il réunit quatre d’entre eux tous les mois
et les résultats mensuels de chaque région furent partagés
avec l’ensemble du personnel en publiant les résultats dans
« En direct », donnant lieu à un effet puisant d’émulation.
La page de résultats concernant le nombre de lignes principales
raccordées se nomma « Delta LP ».
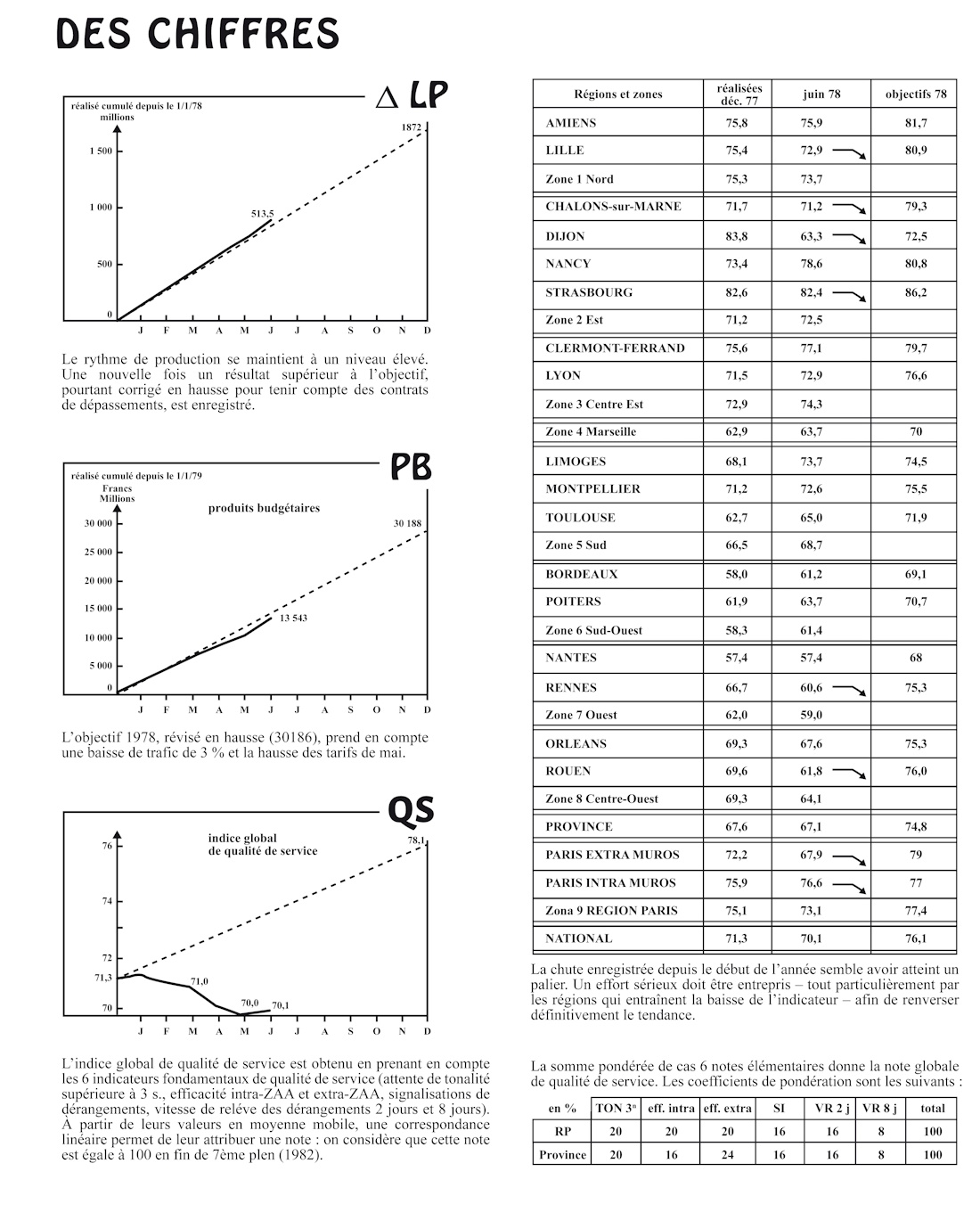
Ainsi, le rythme du rattrapage s’accéléra
et atteignit l’installation de deux millions de lignes par an. L’accroissement
de la productivité se ressentit particulièrement au niveau
des directions régionales et opérationnelles mais «
pour ces hommes qui avaient attendu si longtemps leur heure, le Delta
LP était un peu le symbole de leur reconnaissance. Enfin, ils allaient
avoir les moyens d’agir et de rattraper le temps perdu ». L’amélioration
de la motivation des équipes était perceptible chez l’ensemble
du personnel sur le terrain. Ainsi, un agent du service du Contrôle
Technique explique que les tableaux de bord étaient facilement
compris par les équipes même si « on avait un peu moins
de temps par chantier. Alors que d’habitude on passait un mois sur
un chantier, on n’y passait plus que deux semaines »
L’évolution importante des gains de productivité réussie
par les quelques 115 000 collaborateurs de la DGT au cours des années
1970 s’accompagna d’efforts importants en formation ainsi qu’en
recrutement, notamment des 1 615 INSTI. Ces nouveaux cadres servirent
notamment dans la fonction de plus en plus importante de contrôle
du nombre grandissant de sous-traitants nécessaires pour réussir
le rattrapage sans trop embaucher. La création des Centres régionaux
d’enseignement des télécommunications (CRET) en 1972
sous la responsabilité des directions régionales permit
une croissance significative de la formation continue du personnel interne.
Pour les futurs embauchés, à l’École nationale
supérieure des Télécommunications s’ajoutèrent
deux autres écoles : l’École nationale supérieure
des Télécommunications de Bretagne à Brest en 1977
et l’Institut national des Télécommunications (INT)
à Évry en région parisienne.
À partir de 1976, la DGT demanda également une « prime
de croissance » pour faire reconnaître les efforts du personnel112.
Au lieu du 110 Fr par mois demandé au ministère de l’Économie
et des Finances, la prime accordée s’éleva à
200 Fr seulement pour l’année 1976 et augmenta à 300
Fr en 1978.
Avec le suivi mensuel des indicateurs et la prime de croissance annuelle,
la DGT mit donc en place les derniers éléments organisationnels
considérés comme nécessaires pour obtenir les résultats
espérés par les rapports Chanet. Entre 1974 et 1976, l’évolution
de la mise en place du système du tableau de bord à la DGT
figura dans les rapports de la Commission de RCB mais, en interne, l’initiative
marqua les esprits sous son intitulé final de « Delta LP
». Pour construire « le réseau le plus moderne au monde
», cependant, les effectifs de la DGT se souviennent surtout de
l’époque « Delta LP » comme moteur d’un changement
important de culture et « la période qui débute à
la fin des années 1960 pour s’achever dix ans plus tard reste
dans notre mémoire, sous l’appellation des années de
rattrapage, le synonyme de changements tous azimuts, dans les matériels,
dans les modes de gestion, dans le management ».
À partir de 1978, l’équipe de Gérard Théry
s’appuya sur le succès du rattrapage pour impulser les efforts
d’innovation de la DGT à travers de multiples projets. Le
réseau de transfert de données, Transpac, exploita la norme
X25 développée au CNET. Les expériences de services
télématiques à Vélizy pour le vidéotex
et en Ille-et-Vilaine pour l’annuaire électronique donnèrent
plus tard lieu à l’aventure Minitel. En 1980, Valéry
Giscard d’Estaing signa lui-même un éditorial pour annoncer
le lancement d’un satellite de télécommunications,
Télécom 1. Même si d’autres projets entrepris
à cette époque comme la visiophonie expérimentée
à Biarritz, le télécopieur grande diffusion (TGD)
et de nouveaux services pour les secteurs bancaire et aérien, n’eurent
pas le même succès, la DGT fut reconnue comme le centre d’un
système d’innovation qui dirigea l’évolution d’une
partie du secteur de la haute technologie en France. Son influence dépassa
parfois les seules activités de télécommunication,
notamment en ce qui concerne son soutien au projet de carte à puce,
à court terme pour sécuriser les cabines téléphoniques
mais, surtout, à plus longue échéance, pour développer
une expertise française dans le domaine.
En ce qui concerne le développement du réseau, la réorganisation
importante entreprise depuis 1968 se poursuivit avec la création
de neuf délégations de zone à titre expérimental
à partir de 1978. Ces zones furent créées pour dialoguer
directement avec la DGT et fixer les objectifs et les moyens. Les enveloppes
notifiées aux zones furent ensuite notifiées aux régions.
Cependant, cette « entorse au découpage administratif »
fut mal accueillie par les ministères de l’Intérieur
et du Budget, ainsi que par les élus territoriaux. Une opposition
forte à cette réforme de la part des directeurs régionaux
et des organisations syndicales l’empêcha de prendre racine
et la mesure fut une des rares initiatives de Gérard Théry
à être supprimée par son successeur, Jacques Dondoux,
à sa nomination en 1981.
La Bataille du téléphone
C ’est ainsi que l’historienne Marie Carpenter baptisa la politique
engagée de 1974 à 1981 sous le septennat de Valéry
Giscard d’Estaing pour rénover les télécommunications
françaises et offrir enfin aux Français un téléphone
moderne. Récit de la « bataille » par celui qui l’a
dirigée.
En 1974, année de l’élection
du nouveau Président, la situation du téléphone français
était calamiteuse. Outre le sketch malicieux de Fernand Raynaud
sur le 22 à Asnières, un slogan ironique résume la
situation : « La moitié des Français attendent le
téléphone, l’autre moitié la tonalité
».
Pourtant, sous les deux mandats des présidents précédents,
des mesures avaient été prises pour tenter de remédier
à cette indigence : renforcement de la Direction générale
des télécommunications, création de la Caisse nationale
des télécommunications en 1967, création de 1970
à 1972, de quatre sociétés de financement du téléphone
: Finextel, Codetel, Agritel et Creditel. Mesures qui, malheureusement,
n’étaient pas à la cote pour résoudre la difficulté
à laquelle notre économie était confrontée.
L’un des paradoxes français était d’avoir, au
cours des années, laisser se perpétuer un retard considérable
de son équipement téléphonique, aussi surprenant
aux yeux des observateurs étrangers, que celui de notre réseau
autoroutier. Le premier ministre des PTT du septennat, Pierre Lelong eut
le mérite d’obtenir la suppression d’un système
malthusien et néfaste, celui des avances remboursables, sortes
de prêts sans intérêt consentis le plus souvent par
des collectivités locales.
L’histoire jugera la période 74–81
avec plus d’objectivité que moi. Il était indispensable
de prendre de la hauteur. Les énormes problèmes posés
par la crise du téléphone français exigeaient des
responsables politiques que les solutions fussent imaginées enfin
sous un angle stratégique et non du petit bout d’une lorgnette
budgétaire.
Les décisions stratégiques
Le 23 avril 1975, le président de la République
déclara que le redressement de la situation du téléphone
français était une priorité nationale. Cinq objectifs
furent proposés : le développement du téléphone
pour tous les Français sur l’ensemble du territoire ; passer
d’un taux d’équipement des ménages de 25 % à
un taux de 75 %, comparable à celui des principaux pays industrialisés
; une bonne qualité de service portant sur l’écoulement
du trafic, l’attente de tonalité et l’état des
lignes d’abonnés ; l’extension de la gamme de services
: Télex, téléinformatique, transmission de données,
fac-similé, téléconférence, radiotéléphone
; le redéploiement de l’industrie des télécommunications
en vue de l’accroissement des volumes produits et des exportations
; enfin, la mise en œuvre d’une politique ambitieuse de recrutement
et d’intéressement du personnel.
La mise en œuvre
Les objectifs étant ainsi clairs et quantifiés,
un suivi mensuel de la production de lignes (baptisée dans notre
jargon (Delta LP) et de la qualité de service (IQS)
fut mis en place ; de même fut fixé un premier objectif de
productivité : 10 agents pour 100 lignes en 1980 contre plus de
20 en 1974, puis 8 agents pour 100 lignes, comparable aux chiffres de
la plus performantes des compagnies de téléphone, la suédoise
Televerket.
Au 31 décembre 1980, l’objectif était
atteint : de 1974 à 1980, le nombre de lignes est triplé
et passe de 6 millions à 20 millions, la qualité de service
est entièrement restaurée ; la productivité atteint
celle de la Suède, leader des compagnies de téléphone
sur cet indicateur, le délai de raccordement des abonnés
est drastiquement réduit, de quelques années à quelques
jours.
Du scepticisme…
L’ambition d’un tel programme déclencha
un certain scepticisme, pour ne pas dire des quolibets. J’entendis
susurrer qu’un tel programme était infaisable. Certains conseillèrent
de « travailler les statistiques » et de remplacer le compte
des lignes dites principales, par celui des postes de toute nature, qui
totalise l’ensemble des postes secondaires des entreprises. Nous
rejetâmes d’un commun accord des procédés aussi
peu honnêtes.
Les hommes
Norbert Segard, le ministre des PTT, nous soutenait
à fond, veillant intelligemment à ce que la Poste ne fût
pas trop jalouse de la priorité dont jouissaient les Télécom.
L’ensemble des hommes était puissamment motivé, à
commencer par les directeurs régionaux (en majorité polytechniciens),
les chefs d’établissement, l’ensemble des cadres et du
personnel administratif. Passé la grande grève que nous
avions vécue à l’automne 1974, les puissants syndicats
des PTT – qui ne dit mot consent – témoignèrent
d’une neutralité relativement positive. Il est vrai que la
situation calamiteuse du téléphone français avait
provoqué chez les personnels le sentiment d’une intense frustration.
Notre honneur était donc en jeu et nous avions tous l’espoir
de sortir de ce programme la tête haute.
Une industrie à réveiller
Nous étions encore à une époque
de la Ve République où l’industrie était considérée,
au plus haut niveau de l’État, comme l’un de nos biens
les plus précieux. Or, l’industrie du téléphone
était sclérosée du fait de son organisation, un cartel
volontairement organisé sous la IVe République et regroupant
les deux filiales du puissant groupe américain ITT, celle du groupe
suédois Ericsson, la Compagnie générale d’électricité
et une microscopique coopérative ouvrière. Depuis longtemps,
le vœu du président du groupe Thomson était d’entrer
sur le marché du téléphone, jugé lucratif.
Ce groupe était fortement exportateur de systèmes militaires
: il justifiait assurément sa place de fournisseur de la DGT, car
disposant d’un puissant réseau à l’exportation,
il lui serait plus facile de vendre les équipements de télécommunications
aux gouvernements étrangers, aux administrations ou compagnies
de téléphone de nombreux pays.
Le souci d’instaurer une concurrence légitime
aux industriels se traduisit par le lancement d’un grand appel d’offres
sur la fourniture de matériel de commutation (l’architecture
des réseaux téléphoniques s’articule autour
des autocommutateurs, qui en constituent le pivot). Je passerai sur les
étapes difficultueuses d’une mutation décisive de l’industrie.
À l’issue du processus, Thomson et CGE devinrent les deux
leaders français d’un marché promis à une forte
croissance. Le premier remporta une première et importante commande
en Égypte ; le second, par mimétisme (et auparavant cantonné
à des exportations symboliques à l’Île Maurice
et à Malte), remporta un succès significatif en Irlande.
Des technologies nouvelles à promouvoir
Une priorité majeure était en même
temps de promouvoir les technologies nouvelles. Le système de commutation
temporelle E10, initialement développé par le Cnet, (Centre
national d’études des télécommunications), fut
proposé par la CGE et retenu comme système d’avenir,
bien que le premier autocommutateur expérimental, installé
à Poitiers, ne donnât pas satisfaction. À l’issue
de l’appel d’offre, 200 000 lignes furent commandées
à la CIT (Compagnie industrielle des téléphones),
filiale de la CGE ; elles furent livrées en temps et en heure.
Cette entreprise, assoupie jusque-là faute de concurrence, fut
réveillée par un patron de choc, Christian Fayard.
Un ambitieux programme d’équipement
fut ainsi lancé dans les trois domaines majeurs de la commutation,
des transmissions et des lignes, auquel l’industrie, dopée
par le niveau des commandes, sut répondre dans des conditions remarquables
de délai, de qualité et de prix. François de Combret,
conseiller technique à l’Élysée, sut avec talent
le mettre en musique, le suivre de près après avoir préparé
le terrain auprès des puissantes directions du ministère
de l’Économie et des Finances, toujours méfiantes lorsqu’il
s’agit de grands projets.
Pour financer cet ambitieux programme, le directeur général
de la Caisse des Dépôts, Philippe Marchat, créa à
l’initiative de l’Élysée et malgré les
objections du directeur du Trésor, une nouvelle société
de financement, Francetel, qui permit, par sa contribution, de financer
enfin les importants investissements nécessaires.
Innover : le Minitel
Dès lors que notre pays allait enfin disposer
d’un réseau téléphonique moderne, de nouvelles
questions se posaient. Comment valoriser ce réseau ? Quelles technologies
disponibles ? Quelles diversifications ? Quels services nouveaux proposer
au marché ? Comment maintenir à l’industrie du téléphone,
tournant à plein régime pour permettre un accroissement
de 2 millions de lignes par an, un plan de charge suffisant pour éviter
un décrochage dans la production et, partant, la fermeture d’usines
?
Le vidéotex, baptisé plus tard Minitel,
était dans les cartons du Cnet qui, sans tambour ni trompette,
l’avait développé en laboratoire. Une maquette de ce
nouveau service fut présentée à une exposition internationale
à Dallas en 1977.
“Le Président Giscard d’Estaing
fut immédiatement conquis par les perspectives qu’offrait
le Minitel.”
Les Télécom anglaises avaient lancé
un produit équivalent sous le nom de Prestel. On doit l’idée
du Minitel français à Jean-Pierre Souviron.
Pour que le service pût connaître un véritable essor,
il fallait un terminal bon marché. Pour voir si cela était
possible, un appel d’offres fut lancé. La réponse industrielle
démontra la faisabilité d’une telle hypothèse.
Le ministre Norbert Ségard, ingénieur de formation lui aussi,
nous soutint à fond. Deux projets furent ainsi mis en œuvre
: un serveur vidéotex à Vélizy, sorte d’auberge
espagnole où seraient invités tous fournisseurs d’information
intéressés : administrations, presse, banques, assurances,
météo, SNCF, et tous services d’informations possibles
; la fourniture d’un annuaire électronique aux abonnés
au téléphone de l’Ille-et-Vilaine.
Le président est conquis
Une démonstration fut organisée à
l’Élysée devant le Président Giscard d’Estaing,
immédiatement conquis par les perspectives qu’offrait ce nouveau
média, et qui, dès lors, donna sans plus tarder son feu
vert au lancement d’un tel programme.
En novembre 1978, un nouveau conseil restreint eut
lieu qui en décida le lancement officiel. Raymond Barre, Premier
ministre, jugeant le projet « insuffisamment libéral »,
n’émit humoristiquement d’objections que pour la forme.
Le projet était défendu par un avocat de poids, André
Giraud, ministre de l’Industrie. Jean-Claude Trichet, nouveau conseiller
technique à l’Élysée, ingénieur des Mines
de Nancy avant d’accéder au prestigieux corps de l’Inspection
des Finances, en était de son côté le zélateur
inspiré et ne ménagea ni sa peine, ni sa plume, pour aider
à son aboutissement.
Le même conseil restreint décida le lancement
du satellite de télécommunication Télécom
1.
Pierre Huet, conseiller d’État, fit
en sorte que le droit du Minitel fut celui du code des PTT sur la liberté
de toute correspondance et non du droit de l’audiovisuel, ce qui
eût étouffé le projet dans l’œuf.
Ainsi fut lancé l’annuaire électronique,
qui trouva en Jean-Paul Maury un directeur de projet de haute volée
pour promouvoir la plus importante base civile de données pour
l’époque et permettre ultérieurement sa généralisation
à la France entière.
Un projet qui dérangeait
En une France trop souvent réfractaire au
changement, des oppositions s’élevèrent. Le ministre
de l’Information le premier pourfendit le projet. La presse régionale
se crut menacée. François-Régis Hutin, directeur
général d’Ouest-France à l’époque,
leva l’étendard de la révolte, sans grand succès
il est vrai. Le PDG du journal Sud-Ouest, Jean-François Lemoine,
se déclara favorable au projet dont il fut l’un des précurseurs
; même position favorable des Dernières Nouvelles d’Alsace.
Avec le recul, les témoins de l’époque admettront que le Minitel, loin d’être un danger pour les journaux, était au contraire leur meilleur allié, piqûre réellement indolore et meilleur vaccin pour affronter la future et violente tempête de l’Internet.
Je ne m’étendrai pas sur les multiples innovations en attente sur notre table de travail : télécopieur à grande diffusion, carte à puce telle qu’imaginée par le créatif Roland Moreno, câblage en fibre optique de la ville de Biarritz et lancement dans cette ville d’un service expérimental de visiophonie ; téléalarme pour les personnes âgées, etc.
Dans le même temps le Cnet, sous la houlette de
Maurice Bernard, futur directeur des études de l’École
polytechnique, se réorganise pour accompagner les développements
technologiques avec le maximum d’efficacité.
Une grande aventure humaine
Ainsi inspirée par les plus hautes instances
de l’État, la « Bataille du téléphone
» fut une belle aventure, qui nous mobilisa tous et nous rendit
pour la plupart heureux, à commencer par le ministre Norbert Ségard,
hélas déjà atteint de la maladie qui l’emporta.
Il m’est impossible d’établir une liste exhaustive des
ingénieurs de talent qui furent les acteurs enthousiastes de cette
aventure passionnante. Jean Syrota, successeur de Jean-Pierre Souviron,
supervisa l’ensemble des opérations technologiques et industrielles
avec maestria, selon un rythme approprié et réaliste, veillant
de surcroît avec Émile Julier et Michel Toubin à la
rigueur des marchés considérables que nous passions à
l’industrie.
sommaire
La RCB moins présente à la DGT
Ces nouvelles initiatives de lancement de nouveaux produits et
services et de réorganisation en délégations de zones
ne figurent pas dans les rapports de la Commission de RCB. En 1978 et
1979, la DGT fut même absente du rapport de synthèse de la
Commission de RCB mais elle y réapparut en 1980 avec un système
de contrôle de gestion, intitulé « SG85 », destiné
à améliorer qualitativement les informations et à
consolider l’utilisation des outils et méthodes de gestion
existant. Un nouveau système comptable fut annoncé pour
identifier en temps réel l’écart entre les objectifs
et la réalisation. Un dossier d’allocation de ressources de
base établit « les couples objectifs / moyens entre la DGT
et les services » et définit l’infrastructure à
mettre en place, accompagnée d’un traitement comptable capable
de fournir la situation des effectifs selon les responsabilités
et les activités et d’analyser les coûts correspondants.
En 1981, la DGT prépara la poursuite de la mise en place du système
« SG85 » en passant de la gestion des lignes à la gestion
des matériels. Une application comptable, testée à
Amiens, se prolongea en matière de gestion de trésorerie.
L’informatisation progressive de la gestion du matériel permit
une meilleure maîtrise de l’évolution des stocks et
une procédure d’agrément technico-économique
rigoureuse pour les lignes fut accompagnée d’une expérimentation
de la décentralisation des objectifs et des enveloppes. L’ensemble
des initiatives de décentralisation organisationnelle se poursuivirent
: le tableau de bord du DGT se perfectionna, le système comptable
se fiabilisa, et le dialogue « objectifs-moyens » entre direction
et services à travers l’analyse de gestion et l’intégration
des résultats financiers s’approfondit.
La dernière fois qu’est évoquée la DGT dans
un rapport RCB, on conclut « en matière de gestion du personnel,
la connaissance de l’utilisation des effectifs s’est approfondie
avec l’amélioration des outils de prévision et de suivi.
Enfin, la déconcentration des responsabilités en matière
de fonctionnement a été accentuée, notamment par
la mise en place d’enveloppes allouées aux cellules de base
».
Le bilan de l’expérience de la RCB à la DGT
Au moment du lancement de la RCB, la DGT s’apprêtait à
se lancer dans les études économiques poussées, avec
le soutien des rapports Chanet et la création du SPEE. René-François
Bizec propose deux explications à l’enthousiasme initial manifesté
par les ingénieurs des télécoms en matière
de RCB. En premier lieu, Bizec explique que « le mode était
au TGV avec les ingénieurs des Mines aux manettes. Comme pour le
nucléaire. La mode était aussi au Concorde développé
sous la houlette de l’Armement. Le programme de rattrapage du logement,
quant à lui, était bien entendu aux mains des Corps des
Ponts. Que pouvait-il rester pour que le Corps des Télécoms
puisse bien travailler efficacement ? Il sera en tout cas utile de profiter
du souffle de pragmatisme qui soufflait à travers la maison Giscard
d’Estaing ! ». Selon Bizec, cependant, les raisonnements présents
derrière ces études étaient multiples : « Ces
études avaient un objectif avoué : moderniser la gestion
des télécommunications en y incluant le bénéfice
des expériences extérieures en matière de calcul
économique. Elles avaient aussi un but caché : utiliser
la maîtrise, en interne, des instruments économiques et mathématiques
pour bien positionner la modernité de la DGT face à la Poste.
Et, plus inavouable encore, nous positionner face ou contre l’archaïsme
de la gestion des administrateurs des PTT et de leur relation de pouvoir
avec les syndicats, les réseaux “de compagnonnage”, etc.
».
Ces études furent également une opportunité d’apprentissage
importante pour des ingénieurs des télécommunications.
En ce qui concerne l’étude de l’optimisation de l’étalement
en coûts actualisé de construction de lignes mené
par Jean-Bernard Hauser, par exemple, René-François Bizec
considère qu’il s’agit d’un travail qui «
pour n’avoir eu qu’un effet relativement faible a été
un important levier pédagogique, vis-à-vis des praticiens
des directions régionales des télécoms. Qui disait
réseau de distribution disait intervention dans les DRT où
des services de programmation étaient mis en place à ce
moment-là ; les études de recherche opérationnelle
proposées à nos jeunes collègues de région
étaient l’occasion de dialoguer autour de ces méthodes
et de le familiariser avec un corpus plus large d’études économiques
». Nicolas Curien rejoint une nouvelle équipe d’Études
économiques au service des Programmes et affaires financières
(SPAF) en 1977 en tant qu’économiste et considère que
« son atout principal réside dans sa cohésion et dans
sa forte légitimité que lui confère un solide ancrage
sur les procédures de la “maison” DGT : nos modèles
de prévision de la demande, qui sont régionalisés,
servent directement au processus interne d’allocation budgétaire
; nos simulations nationales nourrissent les travaux de préparation
des VIe, VIIe puis VIIIe plans quinquennaux ; nos coûts économiques
servent de référence à la direction des affaires
commerciales pour la fixation pour la fixation des tarifs ».
Un premier défi rencontré à la fin des années
1960, cependant, fut le manque de personnel qualifié et la difficulté
de faire travailler ingénieurs et fonctionnaires du ministère
des Finances sur des sujets techniques. Pierre Lestrade, présent
à la création du SPEE, considère que « dès
lors qu’on a laissé s’intégrer au SPEE [une pratique
où] des gens qui arrivaient de l’extérieur et qui n’avaient
jamais été sur le terrain, l’affaire s’est mise
à assez mal marcher. Les travaux qu’ils ont faits n’ont
pas été reconnus comme corrects par les gens du terrain
et ça a sombré dans la querelle ». En ce qui concerne
l’étude prospective au sujet de commutation temporelle, Jean-Bernard
Hauser dit avoir eu « l’impression d’avoir fait des choses
qui concernaient le travail interne du CNET et donc on n’avait pas
à mettre le nez dedans, moi en tout cas ». Pour ce choix
de filière de commutation, René-François Bizec considère
que cette première étude RCB à la DGT présentait
l’avantage d’être menée conjointement avec le CNET
et la direction de la Prévision mais il rappelle que cette dernière
« a d’ailleurs vite laissé tomber les choses. Trop technique
pour les Finances ».
Dans leur présentation des trois premières années
des initiatives RCB au sein de la DGT, Hauser et Bizec soulignent que
l’extension du projet pilote aux vingt autres régions «
nécessite la formation de beaucoup de gens, 1 à 2 ans de
délais et la mise en œuvre d’une équipe importante
». Tout en insistant sur la nécessité de poursuivre
cette phase d’extension, ils insistent sur les difficultés
à surmonter pour toutes les applications informatiques. Ils concluent
qu’« il ne serait possible d’aller plus vite avec des
projets plus ambitieux que s’il existait dans chaque service gestionnaire,
comme c’est le cas aux États-Unis et au Canada, une équipe
de qualité disponible pour la diffusion des méthodes nouvelles
de gestion ou plus généralement du changement non axée
sur la résolution des problèmes stratégiques ou tactiques
du service. Cela, dans l’état actuel des organisations administratives
françaises est très difficile ».
Pierre Lestrade considère aussi qu’il a, lui-même, commis
une erreur méthodologique lors de la généralisation
de l’expérimentation de la comptabilité analytique
conduite en 1969 à Nancy. Il explique que la première phase
de découpage des activités fut achevée dans la précipitation
autour de la recherche des chiffres qui soient assez facilement utilisables.
Pour cela, on s’autorisa alors des simplifications qui ne posèrent
guère de problèmes concernant les investissements mais se
révélèrent plus problématiques concernant
les dépenses de fonctionnement pour lesquelles un rapprochement
systématique des prévisions avec les résultats se
serait imposé. Mis sous pression pour généraliser
rapidement l’expérimentation, Pierre Lestrade regrette que
« cette erreur-là n’ait jamais pu être corrigée
».
Gérard Théry, responsable du SPEE pendant les premières
années de l’application de la RCB avant d’être
nommé directeur général, considère que les
secteurs des Télécommunications et de la Poste constituent
des cas particuliers car « il y avait un revenu et il y avait des
recettes, tandis que dans les administrations “non marchandes”,
il n’y avait pas de compte de résultat ». Il considère
que les autres administrations comme la Santé et la Police devaient
faire face à un besoin d’optimisation car « le prix
de la vie n’était pas infini et le prix de la sécurité
non plus ». Selon Gérard Théry, « pour une entreprise
qui a ses propres recettes comme les télécoms ou La Poste,
le problème de la RCB se posait d’une façon extrêmement
différente ».
Dans son analyse du paradoxe de la RCB, Olivier Favereau souligne les
difficultés à la faire appliquer aux organisations complexes
que représentent certaines administrations. En différenciant
entre les activités dont le succès dépend d’une
meilleure organisation et celles qui peuvent être « optimisées
à travers une approche marchande ou néoclassique pour les
économistes », cette distinction permet déjà
de tirer un premier bilan du rôle de la RCB dans la transformation
de la DGT. La modernisation de sa gestion à travers la décentralisation
et le tableau de bord correspond à la démarche positive
du paradigme organisationnel (à la droite du tableau). Les instruments
analytiques de la RCB, par contre, relèvent d’une démarche
normative (à la gauche du tableau) et n’étaient pas
adaptés aux besoins de la DGT.
Les arbitrages qu’elle fut amenée à rendre dans ses
choix technologiques et sa gestion de la filière dépassèrent
largement le contexte d’un environnement maîtrisé et
transparent qui est nécessaire pour que les prix seuls servent
de signal utile à orienter ses choix.
Olivier Favereau conclut que l’émergence d’une théorie
de la firme plus riche et basée sur une meilleure appréhension
des méthodes d’apprentissage organisationnelles est nécessaire
pour bien analyser la réussite très mixte de la RCB. L’exemple
de la transformation de la DGT pendant la période de rattrapage
et de développement de nouveaux produits et services enrichit notre
compréhension de telles méthodes d’apprentissage organisationnelles.
Cette transformation concerna l’organisation dans son ensemble et
ses résultats furent largement remarqués : « …
le rétablissement spectaculaire de la situation du téléphone
a été opéré par un personnel motivé
et enthousiaste. L’autonomie obtenue par les chefs de service, la
reconnaissance gagnée pour le corps des techniciens constituaient
les clefs principales qu’il fallait posséder. Mais aucune
entreprise n’aurait pu réussir un exploit de cette dimension
sans une grande autonomie dans son fonctionnement. Ainsi, commencent à
apparaître, de façon peut-être parfois un peu larvée,
les modes de gestion qui ressemblent à ce qui se pratiquait dans
le secteur privé, sans que pour autant on ait eu à l’époque
la moindre intention d’aller vers une privatisation, mais parce que
c’était tout de même la seule façon de gérer
dynamiquement un organisme sclérosé depuis tant d’années.
On ne parlait pas encore de compétitivité mais à
l’époque nous avons étonné l’étranger
».
L’ampleur de cette transformation sectorielle
est ainsi décrite comme un « grand projet » mobilisant
un attelage « hybride Administration-Entreprises » capable
« de se doter de ressources propres indexées sur son activité
et à l’abri de la direction du Budget ».
Pour Gérard Théry, l’optimisation
des investissements de la DGT par la décentralisation et l’automatisation
du réseau correspond à « deux traductions d’un
phénomène, d’une évolution, d’un processus
qui n’était pas RCB stricto sensu mais qui était un
problème d’optimisation d’une organisation industrielle
». L’ensemble des mesures prises dépasse largement le
cadre d’une optimisation des moyens au sein d’un service public
sous contraintes budgétaires. On voit émerger pendant cette
période les prémisses de ce qu’allait devenir la DGT
par la suite – une entreprise.
sommaire
En 1982, un an après l'alternance politique
en France et l'élection de M. François Mitterrand à
la Présidence de la République, M. le Ministre des PTT -
Louis Mexandeau milite en 1982 pour un retour à l'orthodoxie administrative,
en provoquant par le décret n° 82-636 du 21 juillet 1982 des
nominations de Commissaires de la République de Département
et de Région dans les affaires des Télécommunications,
notamment dans les programmes d’investissements des PTT dont ils
deviennent les décideurs, au détriment des Directeurs Régionaux
des Télécommunications...
Cette perte manifeste d'autonomie qui renvoie la Direction Générale
des Télécommunications quasiment à la situation d’avant
1941 provoque un tollé des Ingénieurs des Télécommunications.
Ils s'insurgent mais doivent plier. Par ce même décret, les
DOT perdent en autonomie, voire disparaissent de fait lorsqu'une DRT ne
compte qu'une seule DOT. Ce retour aux sources sera cependant de courte
durée.
À la fin 1982, le Réseau Commercial des Télécommunications
comporte en France métropolitaine 169 Agences Commerciales des
Télécommunications, ainsi que 318 Téléboutiques
rattachées et 3 Téléboutiques mobiles : soit 490
points.
La mobilité est à l'ordre du jour
:
Il faudra attendre 1983 pour la validation du premier téléphone
mobile (analogique) à être commercialisé, le Motorola
DynaTAC 8000X par la FCC (Federal Communications Commission). La commercialisation
de ce téléphone à nécessité 15 ans
de développement avec l'aide du Dr.Martin Cooper, et plus de 100
millions de dollars en coûts de recherche.
L' appareil reste tout de même très imposant: mesurant 25cm
sans compter l'antenne et pesant 783 grammes, on est encore loin du téléphone
d'aujourd'hui que l'on peut glisser dans sa poche. La batterie intégrée
proposait une autonomie de 60 minutes en communication, mais présentait
le défaut majeur de nécessiter 10 heures pour être
rechargée grâce au chargeur d’origine (une heure avec
un nouveau modèle de chargeur sorti plus tard.
Ce téléphone était vendu sur le marché au
prix de 3995 $ et était disponible en trois coloris: gris sombre,
gris et blanc, et blanc clair.
Dans les années 1980, le
coaxial a atteint ses limites, l'’évolution s’accélère
avec une nouvelle génération de fibres dites «
monomodes » mise en œuvre pour la première fois en France
sur la liaison Lannion-Perros en 1983. Dès 1985, le remplacement
des anciens câbles coaxiaux par des câbles à fibre
optique pour le réseau interurbain français est décidé.
Les fibres vont également offrir une seconde jeunesse aux câbles
sous-marins incapables d’acheminer des émissions de télévision
et difficilement adaptables pour la numérisation des réseaux.
Le 1er câble transatlantique à fibre optique fût posé
en 1988, depuis, de nombreux câbles à fibres optiques ont
été posés, ceinturant le monde avec des capacités
de plus en plus grandes, permises par l’évolution des technologies
de multiplexage de fibres optiques. Depuis 1995, les câbles à
fibres optiques sont équipés de répéteurs
« tout optique » avec des fibres dopées à l’erbium
(métal de la famille des terres rares) qui compensent sans régénération
optoélectronique l’atténuation du signal dans la fibre
(environ tous les 70 km pour les câbles transatlantiques, comme
le câble Apollo, 100 km en terrestre). Les besoins ne cessent de
croître avec le développement d’Internet. On ne parle
plus en nombre de circuits, mais en capacité.
En 1984, le retour aux sources administratif décidé
en Juillet 1982 se brisera net contre le mur des réalités
mondiales et se conclura par un réveil brutal avec le démantèlement
aux États-Unis de l'opérateur unique AT&T, qui tomba
sous le coup de la loi fédérale antitrust...
1984
Mise en place du système de tarification
des communications téléphoniques « bleu, blanc,
rouge ».
En 1985, après ces 3 années de blocage, un rapport
édité par l'Association des Ingénieurs des Télécommunications
préconise un changement de statut vers celui de Société
Nationale reprenant quasi identiquement les propositions du Ministre de
l'Économie et des Finances rédigées dans le projet
de loi du 5 octobre 1967, Valéry Giscard d'Estaing qui proposait
déjà la création à partir du 1er janvier 1969
d'une « Compagnie Nationale du Téléphone ».
En outre, le décret n°85-336 du 12 mars 1985
autorise l'Administration, à la demande des abonnés, à
la vente de certains matériels téléphoniques, en
plus des matériels obligatoirement fournis dans l'abonnement du
service téléphonique qu'il a souscrit.
Cet événement constitue la première brèche
dans le système de redevance par location-entretien des terminaux
téléphoniques, dans l'histoire de l'Administration (avant
cette date, seule la location-entretien était autorisée
par le législateur).
Malgré des aménagements successifs, le plan
de numérotation est arrivé à saturation au milieu
des années 80.
une grande réforme de la numérotation s’imposait, mais
il a fallu procéder par étapes pour tenir compte du déploiement
progressif des commutateurs électrotechniques.
En 1985, on a décidé de découper la France métropolitaine
en deux zones : dans chacune l’abonné bénéficiait
d’un numéro régional à 8 chiffres, mais en Ile-de-France
s’ajoutait un préfixe de zone, le 1, contrairement au reste
du pays. On conservait le 16 comme préfixe interzones.
Ce nouveau plan de numérotation, qui entrera en vigueur le 25 octobre
1985, constituait une transition devant conduire au plan actuel, conforme
aux normes internationales E/164, opérationnel depuis le 18 octobre
1996.
En dehors de l’Ile-de- France conservant son indicatif régional
1, le territoire national a été découpé en
quatre zones auxquelles on a attribué les chiffres, 2, 3, 4 et
5, chacun étant précédé du préfixe
interzones, le 0. A ces deux premiers chiffres (EZ), il fallait ajouter
les huit autres (AB PQ MC DU) identifiant l’abonné.
A ce plan national de numérotation dont la gestion a été
confiée à l’ART par la loi de réglementation
des télécommunications de 1996, s’est superposé
un plan de numérotation européen, l’ETNS (European
telephony numbering Space) dont les numéros sont accessibles, via
un préfixe international unique, à partir des 49 pays membres
de la CEPT
En 1986, après une nouvelle alternance politique et le retour
de la droite au gouvernement entraînant la 1ère cohabitation
dès le 16 mars 1986, l'heure est à la libéralisation.
Le 20 mai 1986, au cours d'une conférence de presse, M. le Secrétaire
d’État à la Poste et aux Télécommunications
- Gérard Longuet déclare, dans une définition qui
lui semble toute personnelle : "Je serai un défenseur du Service
Public."
Au mois de Juin 1986, trois mois après son arrivée aux affaires,
M. le Secrétaire d’État à la Poste et aux Télécommunications
- Gérard Longuet s'adresse dans un courrier qui se veut rassurant
à l'ensemble du personnel des PTT.Dans le
même temps, M. le Secrétaire d’État à
la Poste et aux Télécommunications -
Gérard Longuet ouvre ce qu'il dénomme des "chantiers
de liberté", qui consistent, sur des périmètres
bien délimités, à tester la mise en concurrence de
la Direction Générale des Télécommunications
par des exploitants du secteur privé qui se porteraient candidats.
sommaire
Les quatre "chantiers de liberté" ouverts sont :
1 Cabines Publiques - projet abandonné en 1988, nonobstant le lobbying
zélé de deux élus qui déjà en 1985
ne juraient que par la privatisation des cabines téléphoniques,
comme si par magie, le vandalisme allait miraculeusement cesser -,
2 Radio Messagerie Unilatérale - débouchera sur l'arrivée
de OPERATOR de TDF le 30 novembre 1988, qui sera racheté par France
Télécom le 1er juin 1995, les autres concurrents fermant
leur service l'un après l'autre car non rentable...
3 Radiotéléphone - débouchera sur le NMT-F 1G de
SFR le 30 mars 1989, qui sera d'ailleurs acheminé intégralement
à travers la France et le monde, par... France-Télécom
et son réseau téléphonique commuté...
4 Réseaux Télématiques à valeur ajoutée
(Liaisons Louées) - ouverture à la concurrence en 1987,
mais sans réel succès...
Deux consortiums Suez-Olivetti-Télésystèmes et IBM-Paribas-Sema
Metra s'étant intéressés de loin à l'aubaine,
mais ayant vite passé leur tour...
Le décret n°86-1064 du 29 septembre 1986 remplace par des Circonscriptions
Tarifaires les Circonscriptions de Taxe téléphoniques formellement
citées dans le décret n°56-823 du 14 août 1956.La
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication (dite Loi Léotard) préfigure de grandes
évolutions statutaires imminentes.
Le 7 octobre 1986, il est créé, en remplacement à
la Direction Générale à la Stratégie, une
Mission à la Réglementation Générale par décret
n°86-1083 de M. le Président de la République - François
Mitterrand. la Mission à la Réglementation Générale
est présentée "pour rajeunir le droit des P et T".
Dans les faits, elle prépare la dérèglementation
du secteur des télécommunications et la privatisation du
secteur...
Son responsable est M. Jean-Pierre Chamoux.
Le 10 décembre 1986, le gouvernement de cohabitation décide
le remplacement de M. le Directeur Général des Télécommunications
- Jacques Dondoux, souhaitant en cela solder le contentieux datant de
1981, lui même engendré par le précédent contentieux
datant de 1974.
 Création de France Telecom
Création de France Telecom
Une marque intitulée FRANCE TELECOM est créée
et enregistrée à l'INPI le 14 novembre 1986 dans
le domaine des télécommunications.
Depuis le 1er décembre 1986, le poste téléphonique
n'est plus obligatoirement fourni par l'administration lors d'une mise
en service de ligne téléphonique.
En 1987, au 1er janvier, la note de service n°114T du 8 décembre
1986 créant le Service des Grands Comptes entre en vigueur.
Le but est désormais de regrouper et de gérer séparément
du reste des abonnés les services de télécommunications
des plus grands groupes de France : 50 groupes majeurs, 2.000 grandes
entreprises et 200.000 entreprises moyennes.
Cette réorganisation permet de pouvoir proposer directement des
services adaptés à cette clientèle spécifique
et stratégique.
Le 13 janvier 1987, moins d'un mois après sa nomination à
la tête de la Direction Générale des Télécommunications,
M. Marcel Roulet crée et organise un département Communication,
axe qu'il considère prioritaire pour asseoir une identité
de marque de l'Entreprise "Télécom" qui reste
à créer et à faire connaître.
C’est au mois de Juillet 1987 où pour la première
fois, apparaît sur les factures téléphoniques bimestrielles
des administrés, ainsi que sur les prospectus l’abréviation
« TELECOM » à la place de la mention administrative
habituelle PTT - Télécommunications.
Cette identité transitoire durera jusqu’en Janvier 1988 inclus
sur les documents officiels de l’administration des télécommunications.
Le 30 juin 1987,
le Livre Vert de la Commission Européenne sur le développement
du marché commun des services et équipements des télécommunications
est édité (après son adoption à l'unanimité
de la Commission Européenne le 11 juin 1987). « Livre
vert 1» « Livre vert
2»
C'est un coup de tonnerre qui enjoint la libéralisation du
secteur des télécommunications par sa mise en concurrence
progressive, comme n'importe quel autre bien de consommation.
Suite à ce Livre Vert, M. le Ministre-délégué
chargé des P et T - Gérard Longuet transmet le 25 août
1987 aux partenaires sociaux et à la CNCL le Texte de travail n°1
pour un avant-projet de loi sur les télécommunications,
visant notamment à préparer la dissolution de l'Administration
des Postes et Télécommunications.
Dès le 24 septembre 1987, le décret n°87-775
crée la première brèche dans le monopole de l'Administration
des P et T, en ouvrant la location à des tiers des liaisons spécialisées
et de certains réseaux téléphoniques et télématiques.
(chantier de liberté)
Le décret n°87-888 du 30 octobre 1987 autorise désormais
l'Administration des postes et des télécommunications à
vendre sans restriction au public tous types de matériels de télécommunications
tels les terminaux téléphoniques.
Auparavant, les postes téléphoniques n'étaient proposés
qu'en Location-entretien mensuelle par l'Administration des Télécommunications
- une timide expérimentation ayant certes été tentée
par arrêté du 30 juillet 1985 pour la vente du modèle
de poste Modulophone au prix public de 400 francs.
- Onze mois plus tard en Septembre 1988 : France-Télécom
commercialise alors à la vente son premier téléphone,
le modèle "Contact Ambiance" au prix de 540 francs TTC,
dans son réseau de 600 Agences Commerciales.
A cette époque, l'informatisation supprime environ un tiers des
postes de travail en back-office. Les personnels ainsi libérés
sont affectés aux agences commerciales ou à de nouvelles
fonctions (vendeurs) pour commercialiser des abonnements téléphoniques,
des terminaux, des accessoires ou des fax.
La première vague de libéralisation imposée par la
Commission Européenne, celle des services à valeur ajoutée,
ne verra jamais de concurrents se déclarer.
En 1988, la Direction Générale des Télécommunications
se renomme France-Télécom le 1er janvier, mais conserve
juridiquement son statut d'administration centrale.
Il s'agit alors de la création d'une marque à vocation uniquement
commerciale. FRANCE TELECOM devient en fait le nom de marque de la Direction
Générale des Télécommunications.
D’ailleurs, les documents officiels à destination du public
précisent bien désormais que : « FRANCE TELECOM désigne
l’Administration des Télécommunications » et
ce, jusqu’au mois de Décembre 1990 inclus.
Le premier document réglementaire paru au Bulletin Officiel PTT
citant nommément FRANCE TELECOM est une instruction du 14 janvier
1988 relative à l'exploitation télégraphique du régime
intérieur.
Un plan média national est alors massivement déployé
dans tout le pays basé sur des affiches, des articles de presse,
des visuels TV et des accroches radiodiffusées basés sur
un leitmotiv très osé intitulé : « Entrez dans
la 4e dimension.», ou encore : « La 4e dimension, vivez tout
l'espace en même temps. »
Après la réélection de M.
François Mitterrand à la Présidence de la République,
la première cohabitation prend fin. M. Paul Quilès est alors
nommé le 13 mai 1988 Ministre des Postes, des Télécommunications
et de l'Espace.
Il s'adresse aux agents des PTT par un courrier en date du 18 mai 1988,
qui se veut, lui aussi, rassurant...
À partir du 15 mai 1988, tous les payements par chèques
à l'Administration des Télécommunications doivent
désormais être libellés à l'ordre de France-Télécom.
But affiché : renforcer l'identité de la marque France-Télécom.Au
mois de Septembre 1988, France-Télécom quitte le 20, avenue
de Ségur, qui est alors aussi l'adresse du Ministère des
PTT, pour emménager dans son nouveau siège au 6, place d'Alleray
à Paris et ce, jusqu'en fin 2011.
En 1989, après la réélection de M. le Président
de la République - François Mitterrand marquant la fin de
la cohabitation, M. le Ministre des Postes, des Télécommunications
et de l'Espace - Paul Quilès lance le Débat Public sur la
réforme des PTT, qui préfigure la Réforme des PTT
de 1990.
Huit mille (8.000) réunions sont organisées dans tous les
services des PTT entre les agents et les supérieurs hiérarchiques.
Plus d'une centaine auditions publiques. 7 colloques se tiennent à
travers la France.
Des projections de débats par le réseau interne des VIF
sont diffusées dans plusieurs dizaines de centres. 10 millions
de questionnaires sont diffusés au grand public dans les bureaux
de postes et dans les agences commerciales France-Télécom,
d'où l'institut de sondage SOFRES tire une étude d'opinion.
À partir du 6 décembre 1988, M. Hubert
Prévot, haut fonctionnaire, énarque mais aussi syndicaliste,
est missionné par le gouvernement en démineur des risques
de conflits sociaux d'envergure, grâce à sa connaissance
des réseaux syndicaux, ce qui permit au gouvernement aux affaires
d'accomplir une transformation majeure que tous les gouvernements précédents
avaient échoué à concrétiser depuis 1967.
Le 23 juin 1989, M. le Premier Ministre - Michel Rocard déclare
avec le plus grand sérieux en clôture du dernier colloque
du Débat Public : « Il n'a jamais été question,
il ne sera jamais question de privatisation. » ; déclaration
surprenante s'il en est, lorsque l'on songe à ce qui arrivera par
la suite en relisant sa déclaration ici...
Après un premier rapport d'étape remis le 31 mars 1989,
M. Hubert Prévot remet le 31 juillet 1989 son rapport au gouvernement
qui préconise la création de deux personnes morales de droit
public qui ne peuvent ignorer les lois du marché : La Poste et
France-Télécom.
Le 8 septembre 1989, M. le Ministre des PTE - Paul Quilès, dans
une déclaration officielle adressée aux Organisations Syndicales
des PTT déclare : «Toute réflexion doit exclure l'idée
même de privatisation, des PTT. Ce service public est et restera
dans le patrimoine national, sous contrôle des pouvoirs publics.»
Le 27 octobre 1989, M. le Ministre des PTE - Paul Quilès, publie
le bilan de la concertation.
Le 8 novembre 1989, M. le Premier Ministre - Michel Rocard rend ses conclusions
dans un communiqué de presse : un projet de loi de réforme
de l'Administration doit être présenté au printemps
1990 aux organisations syndicales.
Le 13 novembre 1989 est créée en interne à France-Télécom
une Mission à l'Évolution des Télécommunications
(MET), présidée par M. Michel Féneyrol chargée
de coordonner en interne les travaux relatifs à la préparation
de la réforme des Postes, Télécommunications et Espace.
Le 19 mai 1989, il est créé, en remplacement de la Mission
à la Réglementation Générale, une Direction
de la Réglementation Générale, par le décret
n°89-327 signé par M. le Premier Ministre - Michel Rocard.
À la date du 5 juin 1989, les Agences Commerciales France-Télécom
adoptent officiellement une nouvelle image extérieure, en y intégrant
le nouveau logotype apparu en février-mars 1988. La société
Design et Stratégie a été retenue pour cette opération.
sommaire
En 1990, le 27 juin à 22H00, le projet de loi dit de « Réforme
des PTT » est voté à l'Assemblée Nationale
en troisième et dernière lecture.
En 1991, le 1er janvier, conformément à la loi n°90-568
au 2 juillet 1990, l'Administration des Postes et Télécommunications
est liquidée.
Ses biens et personnels sont séparés et répartis
en deux entités principales distinctes : La Poste d'un côté
et France-Télécom, tous deux Exploitants Autonomes de Droit
Public, structure juridique novatrice qui permet d’employer et de
recruter des fonctionnaires, recrutements qui auraient été
impossibles sous la forme d’un Établissement Public Industriel
et Commercial.
La loi de finances n°90-1168 supprime au 1er janvier 1991 l'existence
du Budget Annexe de l'Administration des Postes et Télécommunications.
|
FRANCE TÉLÉCOM EST HÉRITIÈRE
D'UNE LONGUE TRADITION ADMINISTRATIVE, SOURCE D'ATOUTS ET DE VULNÉRABILITÉS Ce n'est que le 1er janvier 1991, suite à
la loi de juillet 1990, que cette administration prendra une forme
juridique proche de celle d'un EPIC (établissement public
industriel et commercial) et dont la quasi-totalité des salariés
sont fonctionnaires. |
sommaire
Le dernier commutateur d'abonnés Crossbar de France, un Pentaconta 1000 sera désactivé à Givors (LZ23) le 6 décembre 1994.
| Paru dans "Le Monde" Le 6 décembre dernier à Givors, dans la région lyonnaise, les 25 000 derniers abonnés raccordés à un central téléphonique électromécanique ont basculé dans l'ère de l'électronique. A l'instar des autres 31,6 millions d'usagers, ils vont pouvoir bénéficier de toute la palette de services proposés par France Télécom : facturation détaillée, transfert d'appel, conversation à trois, signal d'appel, etc. La France devient ainsi le premier grand pays développé doté d'un réseau téléphonique entièrement électronique. Dans le bâtiment abritant le dernier Crossbar encore en fonctionnement, les cliquetis se sont arrêtés. Le commutateur E 10 d'Alcatel a pris le relais. Les centraux téléphoniques électromécaniques Crossbar étaient apparus en France en 1955. Ce n'est en effet que dix ans après la fin de la guerre que le gouvernement avait pu commencer à s'attaquer, timidement, à la modernisation des télécommunications. Auparavant, il avait fallu parer au plus pressé : remédier aux pénuries d'aliments et de matières premières, reconstruire les infrastructures. Les centraux Crossbar, conçus en 1919 par deux suédois Nils Palmgren et Gotthilf Betulander , tiraient leur nom de leur technologie. Ce n'était plus des organes rotatifs qui assuraient les connexions comme pour leurs prédécesseurs, les Strowger et les Rotary, mais une matrice croisée de barres métalliques. En 1975, les Crossbar assuraient le raccordement de 6,7 millions d'abonnés sur un total de 9 millions de lignes installées. Deux marques approvisionnaient l'Hexagone : le Pentaconta. fabriqué par deux filiales d'ITT, la CGCT et LMT, et le CP400, réalisé par ce qui était alors la filiale française d'Ericsson, la CIT, et par une coopérative ouvrière, l'AOIP. D'un extrême à l'autre |
En 1997, au 1er janvier, l'Exploitant Autonome de Droit
Public France-Télécom est transformé en Entreprise
Nationale France-Télécom, sous statut juridique de Société
Anonyme, par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996.
Le personnel fonctionnaire conserve son statut
à titre individuel dont le droit à avancement et promotion,
mais les recrutements par concours externes cessent définitivement,
alors que l'article 5 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 autorisait
à titre transitoire le recrutement externes de fonctionnaires jusques
au 1er janvier 2002... Promesse pourtant légale qui ne fut en fait
jamais mise en application...
La loi du 2 juillet 1990 transforme l'administration France Télécom
en un établissement de droit public,
sommaire
Suite du changement :
Les systèmes spatiaux électroniques sont nés
à partir des années 1950 des études faites,
pour introduire l'électronique et l'informatique dans les centraux
crossbar. La nouvelle approche devait bouleverser l'architecture des centraux,
avec l'apparition de la commande centrale par calculateur à programme
enregistré.
En parallèle, des études furent entreprises pour le remplacement
des sélecteurs crossbar électromécaniques par du
matériel plus rapide et plus compact, ce qui a donné naissance
à plusieurs filières de systèmes
Le mouvement pour faire évoluer les centraux électromécaniques
avait commencé par des tentatives pour électronifier certains
organes spécialisés comme les traducteurs, certains auxiliaires
de signalisation ou des organes de commande dans lesquels une grande partie
des relais pouvait être remplacée par des logiques à
transistors.
Cela a abouti à des solutions hybrides de systèmes semi-électroniques.
Ils sont ainsi nommés parce que leur réseau de connexion
utilise encore un point de croisement à contacts métalliques.
On peut citer, dans cette catégorie le système Métaconta
avec son minisélecteur Métabar (un commutateur crossbar
miniature).
Ensuite, les systèmes sont entièrement électroniques
en remplaçant les points de croisement par un composant électronique,
transistor ou thyristor.
Quand, en 1975, la France a mis en route son plan de rattrapage, elle
a préféré, pour des raisons de coût, le système
à minisélecteur crossbar Métaconta.
Ce système, installé massivement à partir de 1978,
lui a permis de doubler la taille de son réseau en moins d’une
décennie.
Les derniers centraux de ce type ont été mis en service
dans le réseau français en 1985.
Les systèmes temporels :
La France réussit en particulier sous l'impulsion du CNET,
une première mondiale avec la mise en service du central public
à commutation temporelle PLATON, à Perros-Guirec près
de Lannion, en Côtes-du-Nord, en 1970. Ce système
devait par la suite être industrialisé sous l’appellation
E10.
En téléphonie temporelle, ce n'est plus le signal électrique
analogique engendré par la parole de l'abonné qui est commuté
ou échangé entre centraux, mais les valeurs de ce signal
à des instants successifs régulièrement espacés.
Dans l'étage d'entrée du central, le signal de parole doit
donc subir tout un traitement pour prélever, mesurer et coder les
amplitudes des échantillons, avant envoi vers le correspondant.
Puis, inversement, à partir des codes reçus, on restaure
le signal sous sa forme analogique avant envoi sur la ligne de l'abonné.
L’équipement du réseau français, à la
fin des années 1990, se partage dans l’ensemble entre
trois systèmes :
- les cenraux E10, Alcatel. Jean-Yves Marjou en a
retracé l'historique
(en pdf) de 1940 à 2003.
- les cenraux MT ALCATEL et MET, filiale commune de MATRA et d’ERICSSON
Le dernier Crossbar de France sera arrêté en 1994,
le Réseau Téléphonique Français devenu
entièrement électronique est rendue publique dans La
Lettre de France Télécom de Février-Mars 1995.
Fin 2001, l’opérateur historique, France Télécom
(Groupe France Télécom) était le sixième opérateur
mondial de télécommunications fixe en termes de chiffre
d’affaires
L’ouverture à la concurrence du marché français
des télécommunications a fait passer son volume de 22.7
milliards d’euros en 1998 à 32 milliards en 2002. La France
est le cinquième marché de l’OCDE pour les services
de télécommunications (et le troisième de l’Union
européenne).
Le trafic de téléphonie fixe a baissé depuis 1998
en nombre de minutes, en raison de la substitution du fixe par le mobile
et, les années suivantes, de l’accès Internet commuté
par l’accès large bande.
Les services de téléphonie fixe demeurent toutefois le plus
important segment du marché , devant les services mobiles .
La fibre se déploie pour atteindre tous les pays du monde, pour la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et laccès à internet...
Avec les mobiles, Internet, la transmission instantanée de photos, de vidéos, de sons, nos usages bouleversent notre vie privée et le contrôle de nos données. Le satellite, incapable d’offrir des capacités de transmission comparable, est devenu une technologie d’appoint, encore nécessaire pour le transport et surtout la diffusion des signaux de télévision.
En septembre 2004,
l'État français cède une partie de ses actions pour
passer en dessous de la barre des 50 %
France Télécom devient alors une entreprise privée.
Cent-quinze ans après sa nationalisation, le téléphone
redevient privé en France. 
Depuis le 1er juin 2006, France Télécom tend à
commercialiser l'ensemble de ses produits dans le monde sous la seule
marque commerciale Orange

Au 31 décembre 2015, les particuliers n'étaient
plus que 6,6 millions. Il y a dix ans, ils étaient encore
23 millions !
Pour les professionnels, c'est encore 11 millions d'abonnés
qui utilisent le réseau téléphonique commuté
pour leurs appels téléphoniques.
sommaire
2017 à partir de cette
date, c'est le règne de la téléphonie
mobile :
Après le premier appel avec un téléphone mobile
Motorola en 1973 par Martin Cooper, et les premiers appareils commercialisés
aux Usa en 1983, c'est en 1986 qu'est créé le premier
réseau français de téléphonie
mobile sous la dénomination de Radiocom 2000.
Radiocom 2000 est la norme 1G ou première génération.
La liaison (téléphonique) entre le radiotéléphone
et le réseau téléphonique est réalisé
par l'intermédiaire d'un relai radio.
Ce n'est pas vraiement un téléphone mobile indépendant
du réseau commuté, il faudra attendre un peu.
La liaison (téléphonique) entre le radiotéléphone
et le réseau téléphonique est réalisé
par l’intermédiaire d’un relai.
Chaque relai couvre une zone géographique appelée «
cellule ». C’est pourquoi on parle parfois de réseaux
« cellulaires » .
Lorsqu'un mobile sort d’une cellule, il peut « s'inscrire »
sur la cellule adjacente.
Lors du lancement du Radiocom 2000, la communication était perdue
lorsque le mobile sortait de la cellule d'inscription précédant
l'appel.
L’ajout de la fonction de « hand over » permet de continuer
la communication en changeant de zone de couverture.

Cette dernière évolution technique a coûté
le rapatriement de tous les mobiles pour mettre à jour le logiciel
de gestion du mobile !
En 1988, le réseau Radiocom 2000 compte jusqu’à
60.000 abonnés et plus de 90 % des appareils sont installés
à bord de véhicules.
Son utilisation est avant tout professionnelle et on est très loin
d’un phénomène de masse.
Son abandon au profit exclusif de la norme GSM est fait en l’an
2000.
Le GSM (global system for mobile communications),
est la norme (1G) mise au point en 1982 qui utilisait les fréquences
de la bande des 900, puis des 1 800 MHz. Mais il faudra attendre 1987
pour que les choix technologiques soient finalisés.
C’est en 1991 que Alcatel effectue la première communication
expérimentale.
Il à fallu attendre le début des années 90 pour que
le téléphone mobile soit assez petit et bon marché
pour intéresser le grand public.
A partir de ce moment, le portable s'est très rapidement popularisé
à l'échelle mondiale jusqu'à devenir le moyen de
communication le plus utilisé de nos jours.
 De son côté, France
Télécom ne compte pas rater son virage numérique,
lance le Bi-Bop en 1993. à Strasbourg en 1991 en
expérimentation. Bi Bop est basée sur la Norme CT2, à
contrepied de la tendance du moment, puisqu’il ne se base pas
sur la norme GSM
De son côté, France
Télécom ne compte pas rater son virage numérique,
lance le Bi-Bop en 1993. à Strasbourg en 1991 en
expérimentation. Bi Bop est basée sur la Norme CT2, à
contrepied de la tendance du moment, puisqu’il ne se base pas
sur la norme GSM
Son principal point fort : il est quatre fois moins cher que la téléphonie
mobile d'alors, mais il ne parvient pas à s’imposer et sera
arrêté en 1997 pour ses 46 000 abonnés qui reçurent
une offre préférentielle de bascule sur les GSM (Itineris)
.
En 1991 , les normes 2G ou deuxième génération
étaient basées essentiellement sur le service voix,
autrement dit c'est une époque où un téléphone
servait avant tout à... téléphoner.
Les réseaux de téléphonie mobile sont basés
sur des cellules au centre desquelles est située la station de
base (BTS en anglais).
Elles se chevauchent pour couvrir toute une zone géographique.
Dans les zones urbaines, elles n'ont que quelques centaines de mètres
de diamètre, avec un flux de transmission très élevé,
mais celui-ci peut atteindre une trentaine de kilomètres dans les
zones rurales ou côtières, où la densité d'utilisateurs
est réduite. à la station de base BTS, avec sa tour équipée
d'antennes, on ajoute des sous-stations sur un site peu élevé
et sur les murs des immeubles. Dans les villes, on peut avoir recours
à des boucles radio, enterrées ou courant sur les murs,
constituées de fils ou de rubans de cuivre reliant les répéteurs
et rayonnant au niveau du sol. Dans les rues encaissées, les tunnels
ou les bâtiments, on utilise aussi des câbles rayonnants dont
le revêtement extérieur est usiné de telle sorte que
le champ créé par l'âme centrale s'échappe
vers l'extérieur.
Il existe d’autres normes 2G à travers le monde, mais le GSM
européen est celui qui connait le plus grand succès.
Il y a plusieurs raisons à ce succès. Tout d’abord,
il s’agit d’une norme européenne qui permet d’utiliser
son téléphone dans tous les pays ayant adopté cette
norme. Sur le plan technique, le réseau GSM est idéal pour
les communications de type « voix » (téléphonie).
Le GSM s'impose dans le monde entier; les cellules
constituaient alors des cercles de 50 km de rayon et impliquaient pour
l'appareil des puissances de 8 W.
Avec les normes adoptées en 1991, les mobiles ont une puissance
plus limitée: 2 W pour les GSM 900 MHz, 1 W pour les GSM 1 800
MHz (ou DCS 1 800).
En France, les réseaux ont d'abord été exploités
en 900 MHz par les opérateurs Itinéris (devenu Orange)
et SFR. Le troisième venu, Bouygues Telecom, hérita de la
bande des 1 800 MHz.
Avec le développement du nombre d'abonnés, les deux premiers
décidèrent de lancer des appareils double bande, 900 et
1 800 MHz.
Le GSM 900 utilise la bande 890-915 MHz pour l'envoi des données
numériques, et la bande 935-960 MHz pour la réception des
informations numériques.
Le GSM 1 800 utilise la bande 1 710-1 785 MHz pour l'envoi, et la bande
1 805-1 880 MHz pour la réception.
Supporté par la téléphonie mobile,
le premier SMS (Short Message Service) a été envoyé
, le 3 décembre 1992, par un ingénieur en télécommunications
qui utilisa son ordinateur afin d’envoyer ”Merry Christmas”
(Joyeux Noël !) au téléphone d’un des dirigeants
de Vodafone, au Royaume-Uni.
Le protocole SMS était en fait déjà
intégré à la norme GSM 03.40 depuis 1990.
Le célèbre format de moins de 160 caractères devait
à l’origine servir à la diffusion de messages de service
provenant des opérateurs.
Au départ, ces derniers étaient convaincus que les consommateurs
allaient continuer à privilégier les appels ! L’histoire
leur a manifestement donné tort. En 1994, le Nokia 2010 a été
l’un des premiers terminaux permettant de saisir des SMS, grâce
au T9 (Littéralement, texto sur 9 touches), qui permettait de saisir
des messages alphanumériques à partir du clavier numérique
d’un téléphone portable.
On inventa alors le GPRS (general packet radio service), qui permet
un débit de 115 kbits/s, par
la mise en commun de plusieurs canaux (multiplexage). En utilisant les
mêmes réseaux, il devenait possible d'avoir accès
à Internet via le Wap ou d'envoyer des courriels.
Pour pouvoir transmettre de la vidéo, télécharger
des chaînes de télévision et des films, permettre
la visiophonie, envoyer des MMS (multimedia messaging service)
avec photos, il a fallu passer à la troisième génération
ou 3G.
La 3G, c'est-à-dire l'UMTS (universal mobile telecommunications
system). C'est un standard mondial, sur lequel l'Europe et l'Asie sont
en avance (l'iPhone d'Apple n'est pas 3G, malgré son prix exorbitant).
Deux réseaux seulement ont acquis la licence: Orange et SFR. Le
débit de transmission est, au minimum, de
384 kbits/s, mais peut monter jusqu'à 2 Mbits/s, voire
3,60 Mbits/s (3G +).
Pour ce faire, il a été nécessaire de remanier entièrement
les réseaux et d'utiliser des fréquences radio différentes:
1 920-1 980 MHz pour la voie montante, 2 110- 2 170 MHz pour la voie descendante
dans un premier temps.
Comme ces modifications d'infrastructures coûtent fort cher, les
opérateurs utilisent, selon les zones et les appareils, le système
EDGE (iMode haut débit pour Bouygues Telecom), qui permet
les téléchargements et l'envoi de MMS, mais pas la réception
de chaînes TV ni la visiophonie.
Cela leur donne le temps de construire leurs nouveaux réseaux.
Dans tous les cas, les téléphones restent compatibles GSM-GPRS.
Pour obtenir un débit élevé et renforcer le réseau
de téléphonie mobile, les antennes relais se sont peu à
peu déployées sur le territoire au fur et à mesure
du déploiement de la 4G ou quatrième génération.
En 2018 on parlait de l'arrivée de la 5G (projet Spectra),
10 fois plus rapides que la 4G.
Selon son dernier rapport publié durant l’été
2022, 4,1 millions de Français sont abonnés à
une formule 5G, alors que l’on dénombre 66,9 millions
de clients 4G dans le pays.
Alors qu'en 2G et 3G, la voix transite par le Réseau Téléphonique
Commuté, (par les commutateurs téléphoniques "nationaux"
et "internationaux" , en 4G toutes les communications (et la
signalisation) sont transitées en IP par Internet.
Mars 2022, Orange frappait un grand coup
en annonçant l'extinction prochaine de ses réseaux 2G et
3G.
Le réseau 2G d'Orange disponible sur le territoire français
s'éteindra ainsi en 2025, tandis que son réseau 3G sera
lui fermé d'ici à 2028.
Au niveau européen, l'opérateur historique entend par ailleurs
fermer ses services 2G et 3G à horizon 2030.
Pour la 3G de Bouygues Telecom, les antennes 3G seront mises hors service
en 2029/2030, idem pour SFR.
L'opérateur historique a justifié cette décision
par la généralisation de la 4G sur l'ensemble du territoire
« L’arrêt de la 2G et 3G permettra à
Orange d’optimiser la gestion de ses réseaux et de les faire
évoluer vers des technologies plus sécurisées, résilientes,
économes en énergie et modernes telles que la 4G et la 5G
», faisait ainsi savoir la direction d'Orange début mars.
La décision de l'opérateur français suit celles de
différents acteurs mondiaux, dont AT&T, qui a récemment
décidé de fermer ses propres services 2G et 3G.
Pour l'état-major de l'opérateur historique, l'extinction
des réseaux 2G et 3G permettra une meilleure « expérience
client sur mobile, avec une meilleure qualité de la voix via la
technologie VoLTE, un débit plus élevé, une latence
plus faible et une sécurité renforcée, tout cela
sans impact majeur sur les offres pour la quasi-totalité des clients
»
Pendant la majeure partie de l'ère de la 3G, les smartphones ont
permis aux utilisateurs de découvrir les joies de la navigation
web en mobile, de partager des vidéos virales, de mettre à
jour des statuts et de se connecter avec des personnes du monde entier.
Tout cela reste bien évidemment possible grâce aux réseaux
4G, à la 5G ou encore au Wi-Fi. Pour autant, certains smartphones
seront alors obsolètes.
Cela veut dire que la dernière étape à franchir sera
de se passer du RTC (aussi fin 2030), des lignes fixes, des commutateurs
téléphoniques numériques.
Pour plus de détails sur la téléphonie mobile,
allez sur ce lien.
| Les grandes étapes de la politique
et de la réglementation des télécommunications
en France 1988 La directive CE sur l’équipement terminal ouvre à la concurrence le marché de l’équipement terminal 1990 La directive ONP de la CE libéralise les services à valeur ajoutée et les services de données pour les entreprises et les groupes fermés d’usagers 1991 France Télécom devient un opérateur indépendant de droit public 1995 La Direction générale des postes et télécommunications (DGPT) publie un document public de consultation sur la concurrence dans les télécommunications. Mars 1996 Le Parlement adopte le projet de loi sur les licences expérimentales, avec entrée en vigueur immédiate Juillet 1996 Libéralisation des infrastructures alternatives Juillet 1996 Entrée en vigueur de la loi de réglementation des télécommunications Juillet 1996 Création de France Télécom 1996 Décrets d’application de la nouvelle loi (licences, fixation des redevances d’interconnexion, partage du coût net du service universel) ; Approbation de l’offre de référence de France Télécom pour l’interconnexion et publication en janvier 1997 Création de l’Autorité de régulation des télécommunications (ART), organe indépendant de régulation sectorielle Printemps 1997 Octroi de licences à des opérateurs concurrents pour le réseau public et la téléphonie vocale, valables à compter du 1er janvier 1998 1 janvier 1998 Ouverture à la concurrence du marché des télécommunications en France Janvier 1998 Introduction de la sélection appel par appel pour les appels internationaux et les appels nationaux longue distance Janvier 2000 Introduction de la présélection du transporteur pour la téléphonie longue distance 2000 Attribution de 54 licences dans la boucle locale radio (BLR) en France métropolitaine et dans les DOM-TOM 2000 Publication du décret sur le dégroupage de la boucle locale 2001 Attribution de deux licences UMTS 2001 Introduction de l’offre forfaitaire pour les communications téléphoniques Internet Janvier 2002 Introduction de la présélection du transporteur pour les communications locales 2002 Attribution d’une troisième licence UMTS 2003 Discussion de la nouvelle loi sur les télécommunications |
|
Évolution du parc de lignes téléphoniques
commutées |
Transition du téléphone analogique vers le tout numérique.
les deux grandes familles téléphoniques (Analogiques et Numériques), ont dû cohabiter pendant 30 années entre 1970 et 2000, car l'on ne pouvait pas d'un claquement de doigts changer en une nuit le Tout Analogique pour le Tout Numérique...
Le réseau téléphonique français
a ainsi cumulé simultanément jusqu'à la totalité
des 6 grandes familles de commutateurs téléphoniques entre
1970 et 1979 (Rotatifs pas à pas à contrôle direct
déjà convertis en contrôle indirect, Rotatifs pas
à pas à contrôle indirect, Rotatifs à contrôle
par impulsions inverses, Crossbar, Semi-électroniques et Numériques
temporels de 1ère génération), combinées avec
les deux familles de transmissions (Analogiques et Numériques).
Nous pouvons dire que ce fut le grand écart, et que les convertisseurs
analogique vers numérique et numérique vers analogique,
installations très coûteuses et volumineuses florissaient
partout, au fur et à mesure de la numérisation très
progressive du réseau...
Très-progressivement, le réseau des transmissions
fut donc numérisé jusqu'à l'être totalement
en 1997 (l'Île-de France l'étant dès Avril 1993),
ainsi que l'ensemble des commutateurs les plus anciens (à commutation
analogique-spatiale) fut progressivement remplacé ;
- les systèmes à organes tournants
éliminés du réseau en Juillet 1985.
- les systèmes électromécaniques crossbar éliminés
du réseau téléphonique le 6 décembre 1994.
- les systèmes semi-électroniques spatiaux éliminés
du réseau téléphonique le 27 novembre 2000.
Numérisation du téléphone français
Mi 1975 : 0,82 % des abonnés sont sur
réseau temporel (Commutation et Transmissions confondues : 62.000
sur 7,553 millions d'abonnés.)
Fin 1976 : 2,38 % des abonnés sont sur réseau temporel (Commutation
et Transmissions confondues : 200.000 sur 8,39 millions d'abonnés.)
Fin 1982 : 14,8% des Commutateurs Téléphoniques sont de
type Électroniques Temporels. Les Transmissions Interburbaines
sont numérisées à 23,5%.
...
Fin 1991 : 79% des Commutateurs Téléphoniques sont de type
Électroniques Temporels. Les Transmissions Interburbaines sont
numérisées à 86%. Les Transmissions Locales à
plus de 99%.
Fin 1993 : 86,4 % des Commutateurs Téléphoniques sont de
type Électroniques Temporels. Les Transmissions Interburbaines
sont numérisées à 90,6%. Les Transmissions Locales
à 100%.
Le 31 mars 1994 : M. le Directeur Général de France Télécom
Charles Rozmaryn présente officiellement le plan de modernisation
du Réseau Téléphonique Métropolitain, en remplaçant
sur plusieurs années d'ici l'an 2000 (à hauteur de 20 à
25 milliards de francs par an) le cœur du réseau téléphonique
constitué d'artères de cuivre, par des artères de
fibre optique, au débit inégalable, à la souplesse
et à la fiabilité accrues (100.000 km de câbles).
Fin 1994 : Les Transmissions Interburbaines sont numérisées
à 95%. Les Transmissions Locales à 100%.
Fin 1997 : Plus de 95 % des Commutateurs Téléphoniques sont
de type Électroniques Temporels. Les Transmissions Interburbaines
sont numérisées à 100%. Les Transmissions Locales
à 100%.
Fin 2000 : 100 % des Commutateurs Téléphoniques
sont de type Électroniques Temporels.
Les Transmissions Interburbaines sont numérisées à
100%. Les Transmissions Locales à 100%.
|
En 2020, le nombre de personnes ayant un
téléphone portable en France s’élèvait
à 54 millions. Dans le monde début 2023 : 10 chiffres
clés : |
Contrairement à une idée reçue, le
passage d’une génération à une autre ne s’accélère
pas. Il est plutôt d’une durée constante.
Il y a plusieurs raisons à ce phénomène : d’une
part la complexité des systèmes augmente exponentiellement
d’une génération à une autre et d’autre
part chaque génération nécessite l’installation
d’antennes relais spécifiques.
Cette opération, appelée « déploiement »,
prend du temps, de une à plusieurs années.
Il faut enfin qu’une génération soit utilisée
un certain temps, quelques années au moins, pour que le déploiement
soit rentabilisé.
Chaque génération finance ainsi la suivante, les revenus
de la 2G/3G ayant par exemple financés la 4G ... Oui la technologie
peut aller très vite mais la rentabilité est le nerf de
la guerre des télécommunications.

Schéma général de la téléphonie
.
Les centraux téléphoniques de dernière génération
sont numériques mais sont encore des centres de commutation.
Les téléphones fixes restants sont encore reliés
au RTC.
La voix des téléphones fixes et mobiles est commutée
par les centres de commutations du réseau national et les centres
du réseau international mondial lors d''une communication internationale.
La fermeture
du Réseau Téléphonique Commuté :
|
2018
. Orange (ex France Télécom) a mis en place un plan
de fermeture du RTC pour
les 9,4 millions d'abonnés
encore en fixe. Un grand nombre de pays européens ont déjà
entamé l’arrêt du RTC. Le RTC, pour « Réseau
Téléphonique Commuté », est la technologie
historique utilisée pour fournir un service de téléphonie
fixe. Par ailleurs, l’arrêt du RTC (technologie
historique de téléphonie fixe) ne veut pas dire arrêt
de la téléphonie fixe. 2021
Les Français sont entrés dans l’ère des
technologies de l’information et de la communication il y a
20 ans. 2022 L’opérateur Orange a fermé
des dizaines de boutiques en un an, dont, récemment, son
navire amiral des Champs-Elysées. Un mouvement qui s’inscrit
dans le cadre d’une réflexion du groupe sur le périmètre
de son réseau de distribution. 2023-2026 Orange prévoit de basculer
200 boutiques supplémentaires dans une filiale dédiée
à la distribution. |
liste des ministres des PTT depuis 1878
|
Président de la République
|
Ministère
|
Ministre
|
| JULES GREVY 1879-1887 | Postes et télégraphes | Adolphe COCHERY |
| Postes et télégraphes | Jean SARRIEN | |
| Félix GRANET | ||
| Présidence du Conseil, finances, chargé des postes et télégraphes | Maurice ROUVIER | |
| SADI CARNOT 1887-1894 | Présidence du Conseil, finances chargé des postes et télégraphes | Pierre TIRARD |
| Finances, chargé des postes et télégraphes | Paul PEYTRAL | |
| Présidence du Conseil, finances, chargé des postes et télégraphes | Pierre TIRARD | |
| Présidence du Conseil, commerce, industrie et colonies, chargé des postes | ||
| Commerce, industrie et colonies, chargé des postes | Jules ROCHE | |
| SADI CARNOT 1887-1894 | Commerce et industrie, chargé des postes et télégraphes | Jules ROCHE |
| Jules SIEGFRIED | ||
| Commerce, industrie et colonies chargé des postes et télégraphes | Jules SIEGFRIED | |
| Jean TERRIER | ||
| Jean MARTY | ||
| Commerce, industrie, postes et télégraphes | Jean MARTY | |
| Victor LOURTIES | ||
| JEAN CASIMIR-PERIER1894- 1895 | Commerce, industrie, postes et télégraphes | Victor LOURTIES |
| Félix FAURE 1895-1899 | Commerce, industrie, postes et télégraphes | André LEBON |
| Gustave MESUREUR | ||
| Henri BOUCHER | ||
| Emile MARUEJOULS | ||
| Paul DELOMBRE | ||
| EMILE LOUBET 1899-1906 | Commerce, industrie, postes et télégraphes | Paul DELOMBRE |
| Alexandre MILLERAND | ||
| Georges TROUILLOT | ||
| Fernand DUBIEF | ||
| Georges TROUILLOT | ||
| ARMAND FALLIERES 1906-1913 | Commerce, industrie, postes et télégraphes | Georges TROUILLOT |
| Travaux publics, postes et télégraphes | Louis BARTHOU | |
| Alexandre MILLERAND | ||
| Louis PUECH | ||
| Charles DUMONT | ||
| Victor AUGAGNEUR | ||
| Jean DUPUY | ||
| RAYMOND POINCARÉ 1913-1920 | Travaux publics, postes et télégraphes | Jean DUPUY |
| Commerce, industries postes et télégraphes | Alfred Louis MASSE | |
| Louis MALVY | ||
| Raoul PERET | ||
| Marc REVILLE | ||
| Gaston THOMSON | ||
| Etienne CLEMENTEL | ||
| Commerce, industrie, agriculture, travail, postes et télégraphes | Etienne CLEMENTEL | |
| Commerce, industrie, postes et télégraphes | Etienne CLEMENTEL | |
| Etienne CLEMENTEL | ||
| RAYMOND POINCARÉ 1913-1920 | Commerce, industrie, postes et télégraphes, transports maritimes et marine marchande | Etienne CLEMENTEL |
| Louis DUBOIS | ||
| Travaux publics, chargé des postes, télégraphes, téléphones | Yves LE TROQUER | |
| PAUL DESCHANEL 18 février-21 septembre 1920 | Travaux publics, chargé des postes, télégraphes, téléphones | Yves LE TROQUER |
| Commerce, industrie, postes et télégraphes | Louis LOUCHEUR | |
| Pierre-Etienne FLANDIN | ||
| GASTON DOUMERGUE 1924-1931 | Commerce et industrie chargé des postes, télégraphes et téléphones | Eugène RAYNALDY |
| GASTON DOUMERGUE 1924-1931 | Commerce et industrie, chargé des postes, télégraphes et téléphones | Charles CHAUMET |
| Fernand CHAPSAL | ||
| Louis LOUCHEUR | ||
| Maurice BOKANOWSKi | ||
| Commerce, industrie, postes et télégraphes | Henry CHERON | |
| Commerce, industrie, chargé des postes, télégraphes, téléphones | Georges BONNEFOUS | |
| Postes, télégraphes, téléphones | Louis GERMAIN- MARTIN | |
| Julien DURAND | ||
| GASTON DOUMERGUE 1924-1931 | Postes, télégraphes, téléphones | André MALLARMé |
| Georges BONNET | ||
| Charles GUERNIER | ||
| PAUL DOUMER 1931-1932 | Postes, télégraphes, téléphones | Charles GUERNIER |
| Commerce, postes, télégraphes et téléphones | Louis ROLLIN | |
| ALBERT LEBRUN 1932-1940 | Postes, télégraphes et téléphones | Henri QUEUILLE |
| André Laurent EYNAC | ||
| Jean MISTLER | ||
| Paul BERNIER | ||
| André MALLARMé | ||
| Georges MANDEL | ||
| Robert JARDILLIER | ||
| Jean-Baptiste LEBAS | ||
| Fernand GENTIN | ||
| Jean-Baptiste LEBAS | ||
| Jules JULIEN | ||
| Postes, télégraphes, téléphones, transmissions | ||
| Travaux publics et transmissions | Ludovic-Oscar FROSSARD | |
| Transmissions | André FEVRIER | |
| Economie nationale et finances | Yves BOUTHILLIER | |
| Communications | Robert GIBRAT | |
| Production industrielle et communications | Jean BICHELONNE | |
| GOUVERNEMENT
PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 1944-1946 |
Postes, télégraphes, téléphones | Augustin LAURENT |
| Eugène THOMAS | ||
| Jean LETOURNEAU | ||
| Eugène THOMAS | ||
| VINCENT AURIOL 1947-1954 | Postes, télégraphes, téléphones | Eugène THOMAS |
| Président du Conseil du plan et délégué du Président du Conseil pour les postes, télégraphes et téléphones | Félix GOUIN (Ministre d’Etat) |
|
| VINCENT AURIOL 1947-1954 | Postes, télégraphes et téléphones | Eugène THOMAS |
| France d’outre-mer | Paul RAMADIER | |
| Présidence du Conseil | Robert SCHUMAN | |
| André MARIE | ||
| Présidence du Conseil et Affaires étrangères | Robert SCHUMAN | |
| Présidence du Conseil | Henri QUEUILLE | |
| Postes, télégraphes, téléphones | Eugène THOMAS | |
| Charles BRUNE | ||
| VINCENT AURIOL 1947-1954 | Postes, télégraphes, téléphones | Charles BRUNE |
| Joseph LANIEL | ||
| Pierre FERRI | ||
| RENE COTY 1954-1959 | Travaux publics, transports et tourisme | Jacques CHABAN- DELMAS |
| Postes, télégraphes téléphones | Edouard BONNEFOUS | |
| Affaires économiques et financières | Robert LACOSTE | |
| Paul RAMADIER | ||
| Finances, affaires économiques et plan | Félix GAILLARD | |
| Pierre PFLIMLIN | ||
| Pas d’intitulé | ||
| RENE COTY 1954-1959 | Postes, télégraphes, téléphones | Eugène THOMAS |
| CHARLES DE GAULLE 1959-1969 | Postes, télégraphes, téléphones | Bernard CORNUT- GENTILLE |
| Postes et télécommunications | Bernard CORNUT- GENTILLE | |
| Michel MAURICE- BOKANOWSKI | ||
| Jacques MARETTE | ||
| Yves GUENA | ||
| André BETENCOURT | ||
| Yves GUENA | ||
| GEORGES POMPIDOU 1969-1974 | Postes et télécommunications | Robert GALLEY |
| Hubert GERMAIN | ||
| Jean ROYER | ||
| Hubert GERMAIN | ||
| FRANCOIS MITTERRAND 1981-1995 | Postes et télécommunications | Louis MEXANDEAU |
| Industrie et recherche, chargé des postes et télécommunications | Laurent FABIUS (Ministre) Louis MEXANDEAU (Ministre Délégué) |
|
| Redéploiement industriel et commerce extérieur, chargé des postes et télécommunications | Edith CRESSON (Ministre) Louis MEXANDEAU (Ministre Délégué) |
|
| Postes et télécommunications | Louis MEXANDEAU | |
| Industrie, Postes et télécommunications et tourisme | Alain MADELIN | |
| FRANCOIS MITTERRAND 1981-1995 | Postes, télécommunications | Gérard LONGUET |
| Postes, télécommunications et espace | Paul QUILLES | |
| Economie, finances et budget, chargé des postes et télécommunications | Pierre BEREGOVOY (Ministre d’Etat) Jean-Marie RAUSCH (Ministre Délégué) |
|
| Postes et télécommunications | Emile ZUCHARELLI | |
| Industrie, postes, télécommunications et commerce extérieur | Gérard LONGUET | |
| José ROSSI | ||
| JACQUES CHIRAC 1995-2002 | Technologies de l’information et de la Poste | François FILLON |
| Industrie, de la Poste et des télécommunications | Franck BOROTRA |
Historique des différents types de commutateurs automatiques en France
|
STROWGER (sans
enregistreur de numéros - à contrôle direct),
commutateur inventé par Almon Strowger aux États-Unis
en 1891, premier modèle de commutateur automatique mis en
service en France, le 19 octobre 1913, à Nice Biscarra. Les commutateurs électromécaniques à barres croisées - type CROSSBAR Ensuite les commutateurs ont adopté la nouvelle
technologie de matrices de contacts à barres croisées
(crossbar) consistant en des mouvements de faible amplitude de deux
jeux de barres rectangulaires, chaque jeu étant croisé
l’un par rapport à l’autre à angle droit,
et chaque barre étant commandée par un relais. CENTRAL AUTOMATIQUE TOUT RELAIS, à
commutation entièrement effectuée avec des tables
de relais, sans organe tournant : le précurseur en France
qui préfigure le Crossbar. Les commutateurs électroniques de type spatial Arrivent les commutateurs à calculateur électronique
central (mais dont la transmission des conversations dans le réseau
de connexions demeure maintenue sous forme analogique, par un courant
modulé à la fréquence de la voix de chaque
interlocuteur, en mobilisant pour chaque conversation en cours et
pendant toute sa durée, l’emploi d’une liaison
physique de bout en bout via le réseau de transmission des
télécommunications par multiplexage analogique). Ces commutateurs permettent à moindre coût et sans nécessiter de mises au point pointues nécessaires aux commutateurs temporels alors encore en développement, de combler rapidement le retard criant du téléphone en France, même s'ils sont moins perfectionnés que les commutateurs temporels. Ils sont aujourd'hui entièrement désinstallés en France depuis la fin de l'année 2000, d'une part à cause de l'usure des parties non électroniques dégradant leur fiabilité sous le poids des années de service et d'autre part ne supportant pas le nouveau service Présentation de l'Identité du Demandeur (PID) mis en service en France le 1er septembre 1997. Concernant les prototypes : SOCRATE (nom complet : Système Organique
de Commutation Rapide Automatique à Traitement Électronique)
est mis en service avec succès en France en 1964 à
Lannion. Afin d’éviter les pertes de signal, le réseau
de connexion est construit à partir de simples multisélecteurs
électromécaniques crossbar de type CP400. Il est équipé
de plusieurs calculateurs périphériques dénommés
« multienregistreurs » qui constituent de fait un commutateur
décentralisé. Il s’agit de l’invention du
principe de partage de charge de calcul dans plusieurs organes décentralisés,
qui sera ultérieurement adopté dans tous les commutateurs
de type temporel, principe qui permet d’assurer la fiabilité
du système grâce à la redondance des organes
de calculs. Il fonctionna jusqu'en 1972. Concernant les types adoptés officiellement en Conseil restreint le 13 mai 1976 par le Président de la République Valéry Giscard d'Estaing en présence du Secrétaire d'État aux Postes et Télécommunications Norbert Ségard : MÉTACONTA 11F des sociétés
françaises CGCT et LMT commandé dès 1976. Il
est équipé du nouveau MINISÉLECTEUR miniaturisé
à contacts de type MÉTABAR (16 lignes sur 16 niveaux)
implanté sur circuit imprimé conçu initialement
pour le prototype MÉTACONTA 11A de la CGCT. À noter
l’existence en France de 2 commutateurs MÉTACONTA 11A
utilisés à Paris et à Reims en Centres de Transit
Internationaux. LE 11F reprend la partie électronique du
calculateur central du prototype E11 de la LMT. La mise en service
planifiée en France dès 1978 à Paris, Lyon
et Marseille, n'est effective qu'en septembre 1979, en premier à
Clamart au central Paris-Michelet ; Lyon suit en octobre 1979. Ce
système est capable de gérer 64 000 abonnés
par cœur de chaîne. 115 commutateurs MÉTACONTA
11F sont installés en France. Le MÉTACONTA 11F le
plus récent est mis en service en 1985. Le démontage
des commutateurs MÉTACONTA 11F a commencé en 1994.
Le dernier est démonté en fin 2000. Les commutateurs électroniques de type temporel Puis arrivent les commutateurs entièrement électroniques qui constituent la vraie révolution dans les télécommunications modernes. Faisant suite au salon international Intelcom 77 qui se déroule à Atlanta du 9 au 14 octobre 1977, il est décidé que seuls des systèmes temporels seront désormais conçus à l'avenir en France. Les principes de base des commutateurs de type temporel sont de répartir les fonctions du système dans plusieurs calculateurs (Par exemple, le partage de charge se fait entre le multienregistreur, le taxeur et le traducteur dans le cas de la famille E10) et de coder numériquement par échantillonnage les conversations vocales et d’assurer leur acheminement via un nouveau système de transmission et de multiplexage entièrement numérique développé à la même époque : le système MIC (Modulation par Impulsion et Codage) qui permet d’accroître la capacité d’écoulement du trafic: PLATON : Premier essai de mise en service
temporaire du premier commutateur temporel au monde (Prototype Lannionnais
d'Autocommutateur Temporel à Organisation Numérique),
en France, à Perros-Guirec en janvier 1970. Le basculement
définitif des abonnés sur ce nouveau commutateur est
effectif le 13 mars 1970. PLATON est capable de gérer 800
abonnés. Ce système est inventé par les ingénieurs
des télécommunications du CNET, implanté depuis
1963 à Lannion, sous la houlette de Louis-Joseph Libois,
leur directeur3. À partir du commutateur PLATON, les commutateurs
électroniques de type temporel sont capables d'accepter la
numérotation depuis l'abonné de départ en fréquences
vocales (DTMF) en plus d'accepter la numérotation à
impulsions décimales en vigueur en France depuis 1913. Hors de France, notons l'existence des commutateurs de type temporel suivants : 1000-S12 de ITT en Belgique qui fait aujourd'hui
partie du groupe franco-américain Alcatel-Lucent État actuel du parc de commutateurs publics
téléphoniques Performances et caractéristiques des commutateurs -Capacité de raccordement d'abonnés
par commutateur : en France suivant les époques, les modèles
et le cœur de cible de clientèle recherché, de
100 à 100 000 abonnés. Jusqu'à 10 000 abonnés
pour les types rotatifs ; jusqu'à 50 000 abonnés pour
les types crossbar ; jusqu'à 65 000 abonnés pour les
types électroniques spatiaux ; jusqu'à 100 000 abonnés
(limite fixée réglementairement, mais extensible jusqu'à
200 000) pour les type temporels de troisième génération. Taxation à distance (Télétaxation
/ Télécomptage) La relève : La technologie
VoIP |
sommaire
Direction générale des Postes ; Direction de l'équipement
et des transports (1865-1950), le patrimoine immobilier des PTT vu par
Le métier et le travail des architectes des PTT
:
Au XIXe siècle, la prise à bail d'immeubles suffisait à
la quasi-totalité des besoins de l'Administration des Postes et
des Télégraphes, qui ne possédait encore en
1900, qu'une petite trentaine d'immeubles
abritant des hôtels des Postes, construits
le plus souvent avec l'aide des architectes des villes concernées.
C'est en 1901 qu'apparut le cadre des architectes des PTT avec
la création du Service des travaux d'architecture de l'Administration
des Postes et des Télégraphes [NOTE n° 6, 1901 (pp.
185-195) : arrêté ministériel du 30 avril 1901 réglementant
le service des travaux d'architecture.] .
Ce service était rattaché à la Direction du matériel
et de la construction, 3e bureau (bâtiments).
Les architectes au nombre de trois résidaient, dans un premier
temps, uniquement à Paris. Chacun des trois architectes
était chargé d'une circonscription, comprenant un nombre
déterminé de départements et de quartiers de Paris.
Le nombre d'architectes ne cessa d'augmenter les années suivantes
pour atteindre le nombre de dix en 1906.
Toutefois, en 1914, celui-ci est réduit à huit au maximum
par voie d'extinction : arrêté du 31 mars 1914 fixant le
cadre des architectes de l'administration des Postes et des Télégraphes.]
Cependant, il atteint le nombre de treize en 1920 et le décret
du 23 mars 1923, organisant le Service d'architecture fixe à vingt-huit
le nombre d'architectes, dont treize résidant à Paris
et quinze au chef-lieu des régions de Bordeaux, Châlons-sur-Marne,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Orléans, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.
En 1944, leur nombre s'élève à 38
: arrêtés des 21 mars et 30 octobre 1944 organisant le service
d'architecture des Postes, Télégraphes et Téléphones.]
.
En 1967, il est le même, dont 20 à Paris.
Leur recrutement et leur statut
Les architectes des PTT étaient recrutés sur titres. En
1923, les conditions à remplir étaient au nombre de cinq
:
- être Français ;
- être diplômé par le Gouvernement ;
- exercer depuis dix ans au moins la profession d'architecte à
la résidence ;
- avoir subi les épreuves d'un concours sur titres Le candidat
devait fournir un dossier comportant toutes pièces d'état
civil et justificatives de sa qualité ainsi qu'une liste détaillée
des titres et références qu'il pouvait invoquer (diplômes,
titres honorifiques, qualités civiles, travaux déjà
exécutés, etc.)
Le Comité consultatif des Bâtiments civils et Palis nationaux
dressait alors la liste des candidats par ordre de mérite.] devant
le Comité consultatif des Bâtiments civils et des Palais
nationaux ;
- être âgé de 35 ans au moins et de 50 ans au plus.
Ces conditions ont varié dans le temps. En 1968, pour faire face
aux besoins croissants de constructions neuves, fut instituée la
procédure de l'agrément, valable dix ans renouvelable, qui
permettait de faire appel à un nombre plus important d'architectes
et de profil varié.
Les PTT recherchaient alors tous candidats ayant un minimum d'expérience
pratique et dont le savoir-faire dans la région où ils postulaient
était reconnu.
Bien que la doctrine et la jurisprudence s'accordassent à reconnaître
le statut de fonctionnaire aux architectes du cadre et même aux
architectes agréés, ils n'en présentaient pas moins
des spécificités : la possibilité d'avoir une clientèle
privée, la responsabilité du constructeur de l'ouvrage,
l'absence de droit à pension civile, le mode de rémunération.
Les attributions et les honoraires :
Les architectes ont pour missions de construire, agrandir, transformer,
entretenir ou procéder à la réfection des bâtiments
de toute nature (hôtels, bureaux centraux, télégraphiques
et téléphoniques ou immeubles spéciaux) commandés
par l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.
L'architecte agit, dans tous les cas, sous l'autorité des chefs
de service de l'administration centrale ou départementaux.
Par la suite, avec l'augmentation du nombre des constructions, la possibilité
de faire appel à un architecte qui n'appartient pas au cadre des
architectes des PTT, est permise.
A partir de 1923, les architectes sont saisis par les directeurs régionaux
et les chefs de service de toute question relevant de leur compétence
: expertises, études relatives aux achats de terrains et d'immeubles,
inspection des immeubles, études et résolutions des questions
de location et enfin, surveillance des travaux de construction des immeubles
que des propriétaires font bâtir pour les louer à
l'Administration.
Des vérificateurs, des réviseurs des travaux de bâtiments
et des dessinateurs-projeteurs, assuraient des fonctions complétant
celles de l'architecte.
La collaboration des services des PTT avec l'architecte a fait l'objet
d'un article dans le numéro 187, juillet 1971, de la revue Postes
et Télécommunications.
Les honoraires des architectes des PTT étaient déterminés
par dés textes fixant les barèmes.
En 1901, les architectes recevaient ainsi une allocation fixe
annuelle de 2500 francs, supprimée dès 1906, ainsi que
des honoraires calculés à raison de 5 % sur le montant des
travaux neufs exécutés et de 3 % sur celui des travaux de
révision.
En 1923, le pourcentage était calculé en fonction
du montant net des mémoires : 5 % jusqu'à 50 000 francs,
puis 4 % au dessus.
Accroissement du parc immobilier des PTT et évolution du travail
des architectes
Dès la fin du XIXe siècle, l'accroissement du trafic postal
et télégraphique et l'émergence du téléphone
créent de nouveaux besoins en bâtiments. Fréquemment,
les bureaux sont situés en des « lieux ne réunissant
pas les conditions requises sous le rapport de l'aménagement ou
de la salubrité et quelquefois même à ce double point
de vue».
Ainsi, l'administration des Postes et Télégraphes a publié
un plan de construction de bureaux de poste dits simples (gérés
par une seule personne) et composés
Ceux-ci étaient en grande majorité situés dans les
campagnes. Déjà bien développée après
la Première Guerre mondiale, l'activité des architectes
des PTT n'a cessé de se développer pendant l'entre-deux-guerres
et encore davantage surtout après la Seconde Guerre mondiale, compte
tenu de l'effort de reconstruction, mais aussi du développement
des services des PTT, surtout téléphoniques.
Si en 1939, le parc immobilier atteignait déjà 800
000 m2, il atteignit 3 795 000 m2 en 1950.
En 25 ans, de 1946 à 1967, les PTT ont doublé leur capital
immobilier, de 1 280 000 m2 en 1946 à 5 758 000 m2 en 1966
.
Le style architectural des bâtiments des PTT
En ce qui concerne le style architectural des bâtiments, il est
à noter que l'administration des Postes, Télégraphes
et Téléphones a toujours eu le souci de faire en sorte que
les bureaux de poste et autres bâtiments s'intègrent dans
le paysage et ne dérogent pas au style architectural local.
Ainsi le Bulletin d'information, de documentation et de statistique°2
de 1934, dans un article intitulé : « le style architectural
dans les bâtiments postaux » fait état d'une circulaire
adressée aux directeurs régionaux, départementaux,
chefs de service et architectes des PTT fixant les conditions dans lesquelles
doivent s'ériger les bâtiments des PTT. Cette demande a été
suivie d'effet durant des décennies. Ainsi, les matériaux
de construction étaient choisis dans les carrières avoisinantes.
Un aspect remarquable de ce fait est mentionné dans le présent
instrument de recherche c(construction du bureau de Volvic).
La revue des PTT de France, n° 4, juillet-août 1956, dans un
article ayant pour titre « l'administration des PTT au festival
d'architecture - salon des artistes français » fait état
de constructions de bâtiments de style « régional »
et même de style « outre-mer ».
Cet article mentionne les réalisations et le nom de leurs architectes.
En outre, la revueBulletin d'information des PTT, à partir de 1963
cette revue s'est appelée Postes et Télécommunications.
Elle est consultable à la Bibliothèque historique des Postes
et des Télécommunications qui rend compte mensuellement
des réalisations et aménagements (agrandissement, rénovation,
construction) des édifices des PTT (date de mise en service, avec
photographies et noms des architectes).
Pour certains bâtiments techniques cependant les architectes devaient
se conformer à des contraintes fonctionnelles liées aux
nécessités d'exploitation, les obligeant de déroger
à ce principe (centres de tri du courrier, centraux téléphoniques).
Enfin, le cursus de formation des élèves de l'Ecole nationale
supérieure des PTT chargée de former les futurs administrateurs
des PTT et ingénieurs des télécommunications comprenait
des cours d'architecture.
Gaston Ernest
INTERET DU FONDS de documentation
Ce fonds permet de réaliser des études monographiques sur
certains bâtiments parisiens et provinciaux des PTT. Riche de nombreux
plans, il permet aussi une étude architecturale assez détaillée
de l'œuvre de et d'effectuer une comparaison avec d'autres architectes
des PTT en activité durant l'entre-deux-guerres. Une analyse comparative
avec les prescriptions de l'Administration des PTT permettrait aussi d'étudier
la latitude prise par l'architecte par rapport aux exigences fonctionnelles
et esthétiques du commanditaire.
Une autre piste de recherche offerte par le présent fonds, quoique
moins riche, porte sur l'association des architectes des PTT. Il serait
intéressant de connaître l'activité de l'association
et son influence sur les décisions prises par l'Administration
des PTT concernant le cadre des architectes des PTT.
Les plans, très nombreux pour certains bâtiments, ont fait
l'objet d'une annexe détaillée [NOTE Cette annexe est basée
sur une note du 4 avril 1986 de la Direction des archives de France relative
à l'établissement de fiche-bordereau pour les cartes et
les plans.]
Ils n'ont pas été extraits des dossiers et ne possèdent
pas de cotes spécifiques.
Enfin, les archives ont été conditionnées dans 28
cartons Dimab, soit 9,3 mètres linéaires. Les photographies
ainsi que les négatifs ont été rangés dans
des pochettes en polypropylène.
sommaire




