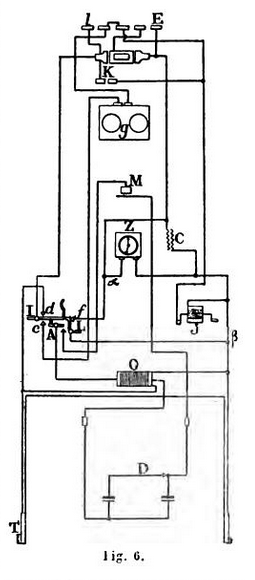|
1877-1895
HISTOIRE DU TELEPHONE EN FRANCE
|
Petit rappel de la situation en France, après
la période ou l'on communiquait par messages écrits et transportés
par une personne, un cavalier, est arrivé la période du
télégraphe optique de Chappe,
à l'époque le plus grand système de télégraphe
optique au monde, presque exclusivement à des fins administratives
et militaires . Vers 1800, le développement de l'électricité
fit naître l'ère du télégraphe électrique.
En 1832 Samuel Morse s'inspira des travaux de ses prédécesseurs
pour inventer un système simple et robuste : le télégraphe
électrique.
Il y a aura bientôt cent quatre vint dix ans naissait le monopole
des télécommunications. Le 2 mai 1837, Louis-Philippe
signait en effet une loi réglementant le télégraphe
de Claude Chappe au profit exclusif de l'Etat. C'est cette loi qui, jusqu'à
la modification du code des PTT cinquante ans plus tard en 1987, a régi
télégraphe, téléphone, radio et télévision
en France et inspiré de nombreuses législations étrangères.
 clic
pour agrandir
clic
pour agrandir
Au service de gouvernements forts ou absolus, le télégraphe
aérien, inventé par Claude Chappe, a pu s'établir,
s'étendre et fonctionner sans problèmes jusqu'en 1830, et
cela sans la protection d'aucune loi. Tout change avec l'avènement
de Louis-Philippe, période où souffle déjà
le vent du libéralisme.
Jusque-là, le télégraphe avait été
au service exclusif de l'Etat, quoique sa rapidité (pour l'époque)
aurait bien intéressé les milieux d'affaires, surtout les
banquiers. Claude Chappe avait un moment songé à mettre
sa découverte au service du commerce et même de la presse,
mais Bonaparte, sous le Consulat, s'y était opposé. Un
financier, Alexandre Ferrier, après consultation des plus éminents
juristes du moment, décide de créer des lignes télégraphiques
privées en France, fonde une compagnie à cet effet et met
en route une première ligne entre Paris et Rouen. L'administration
télégraphique, fort inquiète, réalise qu'étant
maintenant dans un Etat de droit, elle est sans protection juridique.
Son directeur, Alphonse Foy, tente d'obtenir la promulgation d'une loi
garantissant le monopole de l'Etat, et soumet à plusieurs reprises
des projets au président du conseil. Mais
le ministre de l'intérieur a, en ces années 1831-1834, d'autres
préoccupations plus urgentes, il se contente, par des manœuvres
dilatoires, à la limite de la légalité, de décourager
Ferrier et ne se presse pas de faire étudier et voter une loi.
Les choses restent en l'état jusqu'en 1836,
année où éclate un scandale
à Bordeaux. Depuis quelque temps, les agents de change et les
assidus de la Bourse de cette ville commencent à trouver étrange
le " flair " particulier de deux banquiers bordelais, les frères
Blanc. Entre 1834 et 1836, afin de connaître avant tout le monde
la clôture des cours de la vente à la Bourse de Paris. Le
piratage a été rendu possible par la corruption d'un agent
télégraphique de Tours, qui ajoutait discrètement
le chiffre du cours aux messages envoyés par l'État. Ceux-ci,
un ou deux jours avant l'arrivée du courrier transmettant la cote,
vendent avant la baisse, ou achètent avant la hausse, réalisant
de fructueuses opérations sur la vente d'Etat, le fameux 3 %, base
des fortunes de l'époque. La divulgation
de cette manœuvre a contribué au vote de la loi de 1837 sur
le monopole public des communications télégraphiques.
Plus tard en 1850 Louis Napoléon Bonaparte permettra
l’usage du télégraphe pour la correspondance privée
tout en maintenant le monopole, c’est le début du service
public.
sommaire
Ce n'est qu'en 1844 que le gouvernement français songea
sérieusement à étudier la question de la télégraphie
électrique, alors que en 1838, Morse
était déjà venu à Paris, présenter
son télégraphe (le plus évolué pour cette
époque) à l'Institut de France auprès du baron von
Humboldt, François Arago et d'autres scientifiques, Morse
avait obtenu son brevet le 18 août 1838, premier brevet
au monde pour son télégraphe électrique traçant
(qui écrit) .
Le télégraphe de Morse utilisait un cylindre sur
lequel un ruban de papier était entraîné par un mécanisme
d'horlogerie, un stylet encré relié à l'armature
de l'électro-aimant récepteur traçait les impulsions
courtes et longues sur le papier en mouvement (point et trait) .
Morse a inventé l'alphabet Morse permettant de traduire les séquences
de traits et points en caractères alphabétiques (peut importe
la langue).

Cependant, Alphonse Foy administrateur des lignes télégraphiques
françaises, responsable de plus de 1 000 opérateurs de stations
de télégraphe optique, dont la plupart étaient
analphabètes, doutait que son peuple puisse apprendre l'alphabet
Morse.
En 1839, sans autre justification, Foy informa Morse
que son système ne sera pas en France !!!
Cependant, Foy organisa une mission en Angleterre pour étudier
le télégraphe électrique à aiguilles en expérimentation
depuis 1837 par Cooke et Wheatstone.
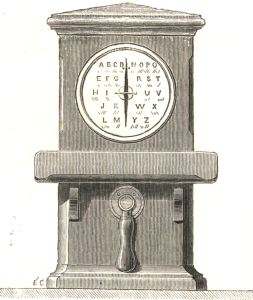
Foy demanda à Louis-François
Breguet, petit-fils d'Abraham-Louis Breguet et fournisseur
régulier du télégraphe optique, de fabriquer un télégraphe
électrique à aiguilles reproduisant les mouvements du sémaphore
pour faciliter la transition de la télégraphie optique à
la télégraphie électrique en France.
Le télégraphe Breguet-Foy qui en a résulté
utilisait deux aiguilles, ce qui pouvait montrer huit positions
sémaphoriques différentes.
Il fut d'abord expérimenté entre Paris, Saint-Cloud et Versailles
en 1842.
Depuis 1833, elle est dirigée par Louis Breguet, qui développe l’activité de son père en se lançant dans la construction d’appareils scientifiques.
En 1845, il est récompensé pour ses travaux sur la télégraphie électrique par la Légion d’honneur. Il est élu à l’Académie des sciences en 1874.
1842, des tests approfondis ont été effectués simultanément avec les équipements télégraphiques optiques utilisés la nuit.
Les expériences ont clairement montré que les performances du télégraphe électrique étaient de loin supérieures à celles du télégraphe optique.
Un essai comparatif de télégraphes électriques a ensuite été effectué le long de la voie ferrée entre Paris (Gare Saint-Germain) et Rouen en mai 1845.
Trois types d'équipements différents ont été testés: le télégraphe à deux aiguilles Cooke et Wheatstone, le télégraphe à deux aiguilles Breguet et un télégraphe d'écriture élaboré cette année-là par M. Dujardin.
Suite aux tests effectués les 11 et 18 mai 1845, les équipements Breguet ont été installés cette même année sur la ligne ferroviaire Paris-Rouen entre Paris et Lille. Breguet a très vite remplacé le télégraphe à deux aiguilles à deux fils par un télégraphe pas à pas à un fil plus avancé (similaire au télégraphe à pointeur Wheatstone et Cooke).
Le télégraphe Breguet, également appelé télégraphe français, était un équipement standard sur les chemins de fer français pendant de nombreuses années, il a même été exporté au Japon, où le service télégraphique public a été inauguré en utilisant le télégraphe de Breguet et modifié pour l’utilisation de caractères japonais.
En 1851, le réseau Français possède 5 000 km de lignes pour 556 stations. Puis sera de 23 000 stations en 1864 et 55 000 en 1877 pour 4587 bureaux.
Le premier câble sous-marin international a été posé en 1851 entre l’Angleterre et La France, le télégraphe s'étend sur le monde.
La principale réalisation de la télégraphie électrique, en plus de faire de l’information un produit de valeur et d’améliorer sensiblement la sécurité et la fiabilité du transport ferroviaire, a été la création d’une infrastructure de télécommunication internationale; une condition préalable au développement des télécommunications mondiales.
|
Les progrès de la télégraphie
électrique furent timides , jusqu'à l'arrivée
de M. de Vougy comme directeur général des
ligues télégraphiques, le 28 octobre 1853. S'en
suivi un système de télécommunication plus
efficace La victoire entraîne l'annexion par le Reich de l'Alsace (excepté le Territoire de Belfort) et d'une partie de la Lorraine (Moselle actuelle), que la France ne récupérera qu'en 1918 à la suite de la Première Guerre mondiale.
Carte Alsace Lorraine 1871-1918 , Voir la page Allemagne. |
 |
TÉLÉGRAPHIE MUSICALE À PARIS.
On propose maintenant d'utiliser à Paris le système de télégraphie musicale de La Cour, en liaison avec le projet de M.Bourbouze d'envoyer des messages télégraphiques sans fil. M. Bourbouze a eu l'idée, pendant le siège de Paris en 1870, de se servir de la Seine comme d'un conducteur, de manière que la ville assiégée puisse communiquer avec les provinces sans que l'ennemi s'en doute. Des essais ont effectivement prouvé que le plan était réalisable, mais avant qu'il puisse être mis en pratique, l'armistice a été déclaré, et le dispositif est devenu inutile. M. Bourbouze a récemment présenté de nouveau son idée et propose d'utiliser l'eau des canalisations de la ville comme conducteur. Chacun ayant l'appareil simple nécessaire pourrait alors apprendre à télégraphier pour lui-même. Chaque maison serait une station, et n'importe quel citoyen pourrait converser avec des amis dispersés dans tous les quartiers de la ville sans bouger de son domicile. A ce projet quelque peu optimiste, il y a une objection fatale : c'est que le résultat serait une nouvelle Babel ; car des centaines de personnes télégraphieraient simultanément, et à moins que chaque dépêche n'ait une caractéristique facilement reconnaissable, une confusion inextricable s'ensuivrait.
Comme indiqué au début, on suggère que le télégraphe musical de M. La Cour pourrait fournir un moyen de transmettre des dépêches distinctes. L'invention a été décrite récemment dans le 'SUPPLÉMENT SCIENTIFIQUE AMÉRICAIN', mais les gravures ci-jointes, que nous tirons de 'La Nature', serviront à rendre son mode de fonctionnement plus clairement compréhensible...
En 1870 Alfred Niaudet neveu de Mr Louis Bréguet , organisait le service télégraphique de l’armée du Rhin ; enfermé à Metz, il créa un système de communications aériennes pour tromper le blocus. Habillé en civil, il s’en échappait pour rejoindre les armées de la Défense nationale.
On ne va pas trader à revoir ce Mr Niaudet quelques années plus tard, contribuer à l'histoire qui nous intéresse : le téléphone.
1873 A cette date, le télégraphe est rattaché à l’administration des Postes.
Le 6 décembre, l’Assemblée Nationale vote la fusion de la poste appartenant au ministère des finances et du télégraphe au ministère de l’intérieur.
Celle ci ne deviendra effective que dans les années 1876 et 1877.
sommaire
Transmettre la parole à distance avec l'électricité
1854 Les travaux de Charles Bourseul,
alors ingénieur Français au télégraphe décrit
le concept de la téléphonie dans un article.
Le professeur allemand Philipp Reis, avait construisit
un instrument reproduisant des sons électriquement, mais suscitèrent
pourtant peu d'intérêt.
Il faudra attendre encore 20 ans et les travaux de A.G.
Bell pour réaliser le premier appareil de téléphone
breveté à cette époque .
Bien avant 1876 les téléphones
acoustiques étaient d'usage dans beaucoup de maison, propriétés,
bureaux, entreprises ... pour communiquer d'un point à un autre
sur une courte distance : voir la page "Téléphone
acoustique".
En France, ce fut une tête couronnée qui
affirma l'existence et vanta le mérite de la nouvelle découverte
issue du génie américain A.G.Bell.
L'Empereur du Brésil, don Pedro I er, qui venait de visiter
l'Exposition universelle de Philadelphie en 1876 , et avait été
mis par l'inventeur au courant de tous ses travaux, il arriva à
Paris, à la fin de l'année 1876.
Dans Les
Annales Télégraphiques de 1876 , l'administration
des télégraphes n'est pas très bavarde, voici ce
que l'on peut lire page 613 :
Télégraphe parlant
On fait certain bruit depuis quelques jours autour d'une « véritable
merveille télégraphique », pour employer l'expression
dont on s'est servi.
On viendrait de découvrir tout dernièrement le moyen de
transmettre la parole à des distances quelconques. Il suffirait
de parler a portée
du télégraphe pour se faire entendre d'un bout a
l'autre de l'Europe. On chanterait a New-York et l'on entendrait à
Londres.
Le morceau de musique joué à Paris serait entendu à
Vienne, et réciproquement. On pourrait, avec un fil télégraphique,
faire assister toute la province a l'audition d'un opéra nouveau,
— de la vraie musique de chambre, cette fois —
Rien n'empêcherait de louer son fil télégraphique
et d'entendre a domicile le meilleur orchestre du monde. J'en passe...
L'avenir nous réserve très-vraisemblablement de pareilles
surprises; mais n'allons pas si vite.
La nouvelle est vraie en principe : on peut transmettre des sons par un
fil électrique; on peut même reproduire, tant bien que mal,
à distance, une mélodie, c'est exact; la nouvelle est vieille,
et il n'est pas inutile de rétablir les faits sous leur véritable
jour.
Après l'exposition de Philadelphie ou l'on dévoile
au monde le téléphone de Bell, la nouvelle se propage
vite par la presse d'abord aux Usa, dans les journaux locaux, puis en
Angleterre, en Allemagne et enfin France dans la presse scientifique comme
"Les Annales Télégraphiques", dans des rapports
de scientifiques comme celui du plus illustre Th.
Du Moncel , de même dans les nombreuses conférences
que Bell organise.
Les articles publiés dans les numéros du
25 Mai et du 25 Juin 1877, pages 559 et 596, du "Le journal télégraphique",
revèlent tardivement aux scientifiques les progrès en télégraphie,
les noms et travaux de Reis et Paul de la Cour :
En 1860, Philipp
Reis, a produit un "téléphone"
qui pouvait transmettre des notes de musique, et même un mot ou
deux zézayant ; et une dizaine d'années plus tard, M. Cromwell
Fleetwood Varley, F.R.S., un électricien anglais connu, a breveté
un certain nombre de dispositifs ingénieux pour appliquer le "téléphone
musical" pour transmettre des messages en divisant les notes en signaux
courts ou longs, après le code Morse, qui pourrait être interprété
par l'oreille ou par l'œil en leur faisant marquer un papier en mouvement.
Ces inventions n'ont pas été mises en pratique ; mais quatre
ans après, Herr Paul la Cour, un inventeur danois, a expérimenté
un appareil similaire sur une ligne de télégraphe entre
Copenhague et Fredericia dans le Jutland. Dans celui-ci un diapason vibrant
interrompait le courant qui, après avoir traversé la ligne,
traversait un électroaimant, et attirait les branches d'un autre
diapason, lui faisant frapper une note comme la diapason émetteur.
En brisant la note à la station émettrice avec une touche
de signalisation, le message était entendu comme une série
de bourdonnements longs et courts. De plus, les bourdonnements étaient
amenés à s'enregistrer sur papier en transformant le récepteur
électromagnétique en relais, qui actionnait une imprimante
Morse au moyen d'une pile locale
Dans la revue
"Le monde illustré" du 17 Mars 1877
on annonce brièvement ce nouveau procédé de communication
.
 Agrandir
Agrandir
Durant toute l’année 1877, Graham Bell va
assurer la promotion de son invention. A Salem (Massachusetts) devant
600 personnes il discute ave un interlocuteur de Boston, situé
à 22 kilomètres. L’expérience, qui a un grand
retentissement, est rapportée par le journal américain «The
Scientific», relayé en France par « Le Siècle
» qui conclut : « ... On entendait tousser, chanter, on
reconnaissait la voix des personnes. Bref, toute la gamme des sons humains
peut être transmise par le fil électrique ».
Au Usa, depuis mai 1877 commence alors
l'essor du téléphone quand Bell présente au public
son invention sous une nouvelle forme imaginée par le professeur
Preece : "the Hand Telephone" ou
"Téléphone à Main" aussi appelé
"butterstamp" aux Usa.
   Bell Bell |
 |
Après des mois d'améliorations et d'expositions publiques de son invention aux États-Unis, Alexander Graham Bell se marie le 11 juillet 1877 à Cambridge, dans le Massachusetts. Son épouse, Mabel, était la fille de Gardiner Green Hubbard, un sponsor de longue date de son travail, qui seulement deux jours auparavant avait été élu administrateur de la nouvelle Bell Telephone Company..
Après avoir créé la Bell Telephone
Company, Graham Bell, soucieux de protéger son invention, s’embarque
pour l’Europe le 4 août 1877 pour y déposer ses brevets.
Première étape, Plymouth, où il présente son
appareil à une assemblée de scientifiques anglais remplis
d’admiration devant son fonctionnement.
Le couple Bell s'embarqua pour l'Angleterre, emportant
avec eux une réserve de téléphones pour ce qui était
censé être un court voyage de noces comprenant quelques activités
promotionnelles, mais la grossesse précoce de Mabel rendait conseillé
un séjour plus long. Ils ne furent de retour en Amérique
– avec leur petite fille – que le 10 novembre 1878.
Pendant ce temps, les Bell s'installèrent à
Londres, mais les conférences et les engagements commerciaux de
l'inventeur l'amenèrent dans de nombreux endroits en Grande-Bretagne
et en Irlande, ainsi que – il s'est avéré – à
Paris, à au moins trois reprises.
Ce qui suit est un bref compte rendu de ces voyages, s'appuyant en grande
partie sur les informations contenues dans les lettres familiales mises
à disposition sur Internet par la Bibliothèque du Congrès
des États-Unis. On tente de replacer ces voyages dans le contexte
auquel ils appartiennent, c'est-à-dire les débuts de l'histoire
du téléphone en France.
En Europe, l'épopée du téléphone commence
d'abord en Angleterre, au retour de l'exposition de Philadelphie,
Sir W. Thomson (Britannique).
présente le téléphone de Bell comme la "merveille
des merveilles", au sein de l'association britanique réunie
à Glasgow en septembre 1876.
Très impressionné par la découverte
de Bell et la démonstration
auquel il assista le 25 juin 1876 à
l'Exposition universelle de Philadelphie, Sir William Thomson,
obtint une nouvelle démonstration en privé le lendemain
et avant de s'embarquer pour l'Angleterre, il est passé par Boston,
c'est la que Bell lui a donné un ensemble de téléphones
comme ceux qu'il avait vus à Philadelphie, c'est à ce moment
que commence l'aventure du téléphone en Europe.
Si on relit la presse française de l'époque dans le Petit Parisien du 31 mars 1877, on y découvre les premiers propos sur le Téléphone
| GAIS PROPOS On annonce une merveilleuse découverte : la sécurité des maris en voyage, la tranquillité des femmes jalouses, la joie des hommes politiques et des diplomates ! Demandez, mesdames et messieurs, demandez le téléphone. Bien entendu, la chose nous vient d'Amérique, cette terre féconde en inventions, en attractions de toute sorte. Il n'a pa suffi à l'Amérique d'inonder l'Europe de clowns et de doctoresses, d'acrobates et de Barnums; non contente de faire désolations à Oifenbach et à Blondin, de donner un asile aux Mormons et à quelques douzaines de sectes également bizarres, elle vient d'inaugurer le téléphone. L'expérience a été, parait-il concluante. On donnait un concert à New-York et les exécutants étaient à Philadelphie. Eh bien! mesdames et messieurs, interrogez les dilettantes qui assistaient au concert; personne n'a perdu la moindre vocalise de la prima donna le plus léger trille du ténor; aucune nuance de l'ophicléide n'est restée en route; tous les mugissements du violoncelle sont arrivés à destination avec une exactitude parfaite. Très sérieusement, le téléphone offre d'inépuisables ressources. Un mari soupçonné par sa femme se prétend-il obligé de passer toutes les soirées à son ministère ? Madame installe subrepticement un téléphone communiquant avec le bureau conjugal, et acquiert bientôt la conviction que l'infidèle n'y met jamais les pieds. Pas le plus léger bruit qui signale la présence du coupable. Le bureau reste vide, le téléphone n'apporte aucun son. Un jeune étudiant en droit affirme t'il à sa famille qu'il travaille toute l'après-midi, chez son répétiteur ? Ici, encore, l'emploi du téléphone est indiqué. Qne M. de Lorgeril éprouve un pressant besoin d'assurer le roi de son dévouement, que M. de Rajuste veuille mettre-son cœur enflammé aux pieds du Saint-Père, ces honorables pourront se satisfaire, sans le moindre déplacement, sans frais de voyage le téléphone ne sera-t-il pas là . Et quelle admirable application du nouvel instrument au régime parlementaire. Sans se déranger, sans affronter un aréopage toujours inquiétant, le député prononcerait un discours au milieu de ses électeurs charmés et attendris il parlerait à Brives, à Dunkerque ou à Landernau, et le téléphone porterait ses paroles à Versailles, où elles seraient recueillies par les sténographes. Le même appareil transmettrait la réponse de l'adversaire. MM. Mitchel ou Tristan Lambert interrompraient, M. Grévy les rappellerait à l'ordre, toujours par téléphone. Au lieu d'orateurs à la Chambre, on aurait ainsi des orateurs en chambre, une forme nouvelle du parlementarisme. A la rigueur, un député empêché par un enrouement ou par une partie de pêche, pourrait se faire remplacer par quelqu'un de ses électeurs doué d'une belle voix de tambour :de ville ou le chantre de la paroisse. PIERRE BENOIT. |
Dans la presse technique, "Extrait
de l'exposé sur l'électricité de TH Du Moncel"
(en pdf avec les gravures)
Puis à peine un an plus tard en juillet
1877 , M. WH Preece, qui devint
plus tard Sir William Preece, ingénieur
en chef de la poste, avec Bell présentent le téléphone
à la British Association à Plymouth.
Dans la presse scientifique, en 1877-78,
voici ce qu'écrit Th. Du Moncel, notre Scientifique
Français 
Ce téléphone, en effet, reproduisait les mots articulés,
et ce résultat dépassait tout ce que les physiciens avaient
pu concevoir. Cette fois ce n'était plus une conception que l'on
pouvait, jusqu'à preuve contraire, traiter de fantastique : l'appareil
parlait, et même parlait assez haut pour n'avoir pas besoin d'être
placé contre l'oreille.
Côté administration des Télégraphes, dans les
Annales
télégraphiques page 180-181 , page 218 à
224 on décrit les appareils de Bell en 1876, page 267 on reprend
les informations du journal officiel sur une liaison entre New-York et
Philadelphie, un peu de théorie sur le téléphone
de Bell et Varley page 537 à 542 , on parle déjà
des progrès comme le téléphone d'Edison,
page 548 à 551.
En pages 552 à 60 on décrit l'exposé de Preece
à Plymouth Angleterre ... l'administration s'intéresse
surtout à la télégraphie, ne voyant pas venir que
le téléphone va profondément changer le moyen de
communiquer.
Le 25 Juillet 1977 Bell déposera le brevet no 119 626 en France , "pour des perfectionnements dans la téléphonie électrique ou la transmission des sons comme dépêches télégraphiques, ainsi que dans les appareils téléphoniques.
C'est aussi la revue scientifique "Le journal télégraphique" du 25 septembre 1877 qui présente cette découverte
| La téléphonie. Le Journal télégraphique a déjà à plusieurs reprises entretenu ses lecteurs des expériences faites dans des directions différentes par MM. Elisha Gray, Graham Bell et Paul la Cour pour développer l'idée primitive de Reiss sur la transmission du son par l'électricité. Les articles publiés dans nos numéros du 25 Mai et du 25 Juin derniers, pages 559 et 596, ayant fait connaître avec quelques développements les résultats des essais de M. La Cour, nous nous occuperons surtout ici des études des autres inventeurs parmi lesquelles, celles de MM. Graham Bell et Elisha Gray ont déjà obtenu des résultats remarquables. M. Bell s'est attaché plus spécialement à perfectionner son instrument en vue de la reproduction de la voix humaine, tandis que M. Gray cherche d'une manière générale la reproduction du son ou le perfectionnement du système électro-harmonique. Aucun des deux inventeurs n'exclut, d'ailleurs, les expériences spéciales faites par l'autre. M. Graham Bell a organisé dans différentes villes des Etats-Unis des séances publiques où des phrases de conversation et des discours tout entiers sont transmis par le fil télégraphique. Dans d'autres occasions il a transmis des mélodies et autres productions musicales. D'après le Télégraphie Journal, vol. V, page 65, M. Bell a fait à Salem sur son système une conférence que son appareil téléphonique reproduisait en même temps à Boston, soit à une distance de 29 km. On prétend même que l'auditoire de Boston aurait entendu, quand l'orateur a cessé de parler, les applaudissements de l'auditoire de Salem. Le 23 du même mois des expériences semblables auraient été faites également avec succès entre les deux mêmes villes, non plus avec la parole humaine, mais avec un orgue et avec un cornet. Un peu plus tard, elles furent tentées sur une plus grande échelle entre Boston et Providence, avec des circuits de 190 et de 240 kilom. D'après le Journal of the telegraph (vol. X, pag. 100,102 et 107), les essais auraient rencontré alors beaucoup plus d'obstacles que sur des lignes courtes. L'on serait parvenu cependant à distinguer les paroles et même à reconnaître les particularités de timbre de voix de différents orateurs. L'imprésario Strakosch, dont le nom est bien connu aussi en Europe, s'est déjà emparé de la nouvelle invention. Il a donné dans différentes grandes villes des Etats-Unis des concerts où, en dehors des productions musicales ordinaires, il a fait entendre des morceaux exécutés dans une autre ville et transmis par l'appareil téléphonique. Les résultats ainsi obtenus ont encouragé un riche particulier, M. Williams, à faire établir entre ses propriétés la première ligne expressément affectée à la téléphonie. Cette ligne dont l'étendue est de 8 kilomètres fonctionnerait très-bien et permettrait d'entretenir à cette distance une conversation aussi facilement que si les interlocuteurs se trouvaient dans la même pièce. Quant aux dispositions de l'appareil téléphonique de Bell, voici la description qu'en donne M. Cardarelli dans Elettricista (tome lor, page 56). « L'appareil transmetteur se compose essentiellement d'un petit tube en laiton, d'un diamètre de 7cm. Une des ouvertures est fermée par une membrane tendue extrêmement mince au milieu de laquelle est collé à l'extérieur un petit disque de fer doux de forme ronde ou allongée. Ce petit disque est placé tout près des pôles d'un électro-aimant à une distance que des vis micrométriques permettent de régler à volonté. L'appareil est disposé de façon qu'on puisse parler dans le tube. Le fil de la bobine de l'électro-aimant communique avec la ligne et par celle-ci avec le récepteur à l'autre station. Le récepteur est également très-simple; il se compose d'un électro-aimant à une seule bobine, enfermé dans un tube de fer qui, entre autres fonctions, a pour effet de condenser l'intensité du champ magnétique. L'ouverture du tube de fer est fermée par une feuille de fer doux très-mince fixée par un seul point au tube qui dans toutes ses autres parties peut vibrer librement. Cette feuille mince de fer est influencée par les courants qui traversent la bobine de l'électro-aimant et répète par conséquent les vibrations de la membrane du transmetteur. Les deux appareils, le transmetteur et le récepteur, sont montés sur des caisses de résonnance pour renforcer le son. « Quand une parole où note est émise dans le tube par la voix ou l'instrument, la membrane vibre à l'unisson avec elle et le morceau de fer doux: en face de l'électro-aimant vibre également et induit dans ce dernier une série de courants électriques qui passent par là ligne et la bobine de l'électro-aimant du récepteur de la station de réception. La feuille mince de fer doux du récepteur est aimantée et désaimantée à l'unisson avec les vibrations de l'air dans le tube du transmetteur. Ainsi le son ou la parole articulée se transmet fidèlement d'une extrémité de la ligne à l'autre ». D'un autre côté, MM. Cecil et Léonard Wray (Télégraphie Journal, vol. V, page 38) ont récemment imaginé une nouvelle forme de téléphone que l'on peut considérer comme inspirée directement par l'invention primitive de Reiss. Dans leur système, MM. Wray font usage d'une membrane intermédiaire entre la voix et la membrane de transmission. Cette dernière consiste en une feuille mince de gutta-percha au milieu de laquelle est fixée une petife rondelle de platine portant deux fils de cuivre recourbés et plongeant dans deux godets remplis de mercure. La rondelle peut ainsi être mis en communication continue avec un pôle d'une pile sans que la membrane soit en aucune façon gênée dans ses vibrations. Au-dessous de la rondelle est une pointe en platine à une distance qui peut être réglée par une vis micrométrique, de façon qu'à chaque oscillation de la membrane la pile soit fermée et ouverte une fois. Le récepteur se compose de deux électro-aimants juxtaposés avec des noyaux libres d'un côté qui reproduisent les vibrations de la membrane. Le son est également renforcé par une disposition de résonnance. Malgré les beaux résultats obtenus de nos jours avec la téléphonie, il nous paraîtrait encoire prématuré de se prononcer dès maintenant sur son application pratique et durable. L'avenir nous dira prochainement, sans doute, si ce nouveau mode de communication électrique est appelé à sortir des limites des succès de cabinet et des expériences de curiosité, pour entrer dans le domaine plus vaste de l'exploitation pratique qui subirait alors une transformation radicale. |
sommaire
A la réunion annuelle de l'association Britannique
(BAAS) à Plymouth au mois de septembre 1877,
on apprit les progrés fait depuis et W.Preece,
avec la participation de Bell, ils firent la première démonstration
pratique avec la fameuse paire de Hand-Téléphones amené
par WH Preece.
Dans le bulletin scientifique du journal, le Phare de
la Loire, on peut lire :
« C’est Monsieur Breguet qui a joui du précieux avantage
de tenir entre ses mains et d’essayer, à son aise, le téléphone.
Pareil à saint Thomas, il a pu croire parce qu’il a vu et
touché. Aussi s’est-il empressé de faire part à
l’Académie des Sciences de l’étonnement que lui
a inspiré le merveilleux appareil américain, non seulement
par les résultats incroyables obtenus, mais aussi par la simplicité
des organes qui le composent. La pureté de la voix humaine et ses
nuances sont si bien conservées que l’on peut reconnaître
la voix de la personne qui parle »
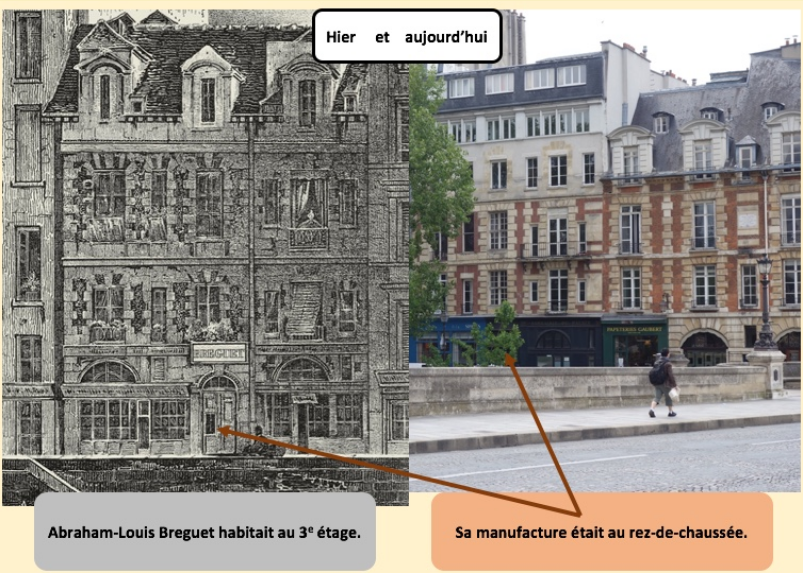 39
quai de l’Horloge Paris
39
quai de l’Horloge Paris
Puis début novembre 1877 Breguet installe
le téléphone dans ses ateliers du 39 quai de l’Horloge
pour que tout le monde puisse l’essayer :
« Nous eûmes le plaisir de voir l’atelier de M. Breguet
et le cabinet de travail où se trouvait alors le seul téléphone
double qu’on connût en France. M. Breguet nous fit voir l’appareil
et nous pûmes assister à une expérience concluante.
On prévint par une sonnerie les ouvriers qui se trouvaient au troisième
étage. Ils prirent tour à tour le téléphone
en mains et communiquèrent dans le cabinet de travail leurs impressions,
des appréciations sur la température ; ils lurent des fragments
de journal, comptèrent, et enfin l’un d’eux, qui avait
une jolie voix, électrisa positivement, sans jeu de mot, le grand
air de ‘La Fille de Madame Angot’. La voix sortit de l’instrument
un peu nasillarde, mais fort nette, et avec ses nuances les plus faibles.
C’était stupéfiant ! Beaucoup de hauts personnages,
de magistrats, de littérateurs, de généraux, furent
reçus par Monsieur Breguet et l’écoutèrent avec
attention, curieux surtout de voir le téléphone. Après
avoir vu par eux-mêmes, après avoir parlé, chanté
eux-mêmes, ils s’en allaient satisfaits et émerveillés
».
La Maison Breguet du quai de l’Horloge ne désemplit pas pendant
qu’Antoine expérimente le téléphone devant ses
amis académiciens, et des représentants de diverses sociétés
savantes. Les commentaires sur les résultats sont unanimes : «
c’est merveilleux ».
Enfin, le 2 novembre 1877, Alfred Niaudet, le cousin d’Antoine,
présente officiellement le téléphone Bell à
la société française de physique. Les nombreuses
démonstrations sont irréfutables mais un peu décevantes
sur le plan technique car les conversations sont perturbées par
le brouhaha de la foule présente.
Graham Bell charge alors Antoine Breguet et Cornelius Roosevelt, un ingénieur
électricien d’origine américaine, de faire connaître
le téléphone en France. En premier lieu, Antoine Breguet,
soucieux de préserver la réputation de haute qualité
de la Maison, améliore l’aspect extérieur du téléphone.
On peut lire dans le Petit Journal :
« L’industrie parisienne, si délicate toujours, n’a
pas tardé à faire une jolie chose d’un assez gros bilboquet,
et le téléphone que nous a montré Monsieur Breguet
est véritablement un joli petit objet, quand on le compare à
l’appareil rustique apporté de Londres ».
En se lançant dans l’industrie du téléphone,
la Maison Breguet n’aura de cesse d’en améliorer les
performances, l’aspect pratique et l’esthétique
A. Niaudet termine en annonçant que M. Bell lui avait formellement
promis de venir bientôt à Paris et d’y prendre la parole
dans une réunion scientifique. Ce sera une fête pour les
admirateurs de l’heureuse invention du téléphone.
 Téléphone Bréguet
Téléphone Bréguet
Entre temps le beau père de Bell G. Hubbard envoi à A. Graham Bell qu'il surnommait Alec, un courrier de recommandations et principalement de joindre le nouveau partenaire pour la France
|
Cher Alec : Vos deux "gribouillis" sont arrivés
hier. M. Pollok dit de ne pas retirer de brevets à
l'étranger avant d'en faire la demande ici, car ce faisant,
vous faites dépendre ce brevet de la durée de vie
du brevet anglais et raccourcissez sa durée de vie de trois
ans. Nos brevets durent dix-sept ans l'anglais pour quatorze ans
seulement. Nous nous en sortons très bien avec les téléphones.
De nouvelles commandes arrivent tous les jours. M. Roosevelt navigue demain. J'espère
que vous n'avez rien fait en France, je pense que vous aimerez
beaucoup M. Roosevelt et que l'arrangement vous plaira. Il
dépend de votre approbation. Je suis toujours à toi. Gardiner G. Hubbard. |
Les premières démonstrations en France
se font au Congrès Scientifique du Havre en septembre 1877
| Plusieurs savants venant de Plymouth (Angleterre)
sont présents au Congrès Scientifique du Havre qui se
tient peu après les séances de l'Association Britannique
en aout 1877 comme raconté ci dessus. . "Ils ont assistés aux expériences de M. Bell, ils ont fait fonctionner eux-mêmes le téléphone. Ils ont pu converser avec des amis, à une distance de plusieurs centaines de mètres, et ce n'est pas sans une légitime émotion qu'ils reconnaissaient la voix de ceux qui parlaient au loin, en approchant l'oreille de l'ouverture du Téléphone à la station d'arrivée" (La Nature, 1877). En septembre 1877, les frères Alexandre et Louis Poussin, deux industriels Elbeuviens (de la ville d'Elbeuf, Seine-Maritime, France), lisent dans le journal scientifique "la Nature" un article donnant la description d'un "admirable instrument appelé le Téléphone inventé par le professeur américain Monsieur Graham Bell"(voir i dessous). Les frères Poussin, très intéressés par les nouvelles applications de la science, se rendent à Paris pour rencontrer Antoine Bréguet. Emporté par l'enthousiasme de celui-ci qui vient de déclarer à l'Institut : "depuis que j'ai ce magique petit instrument, je ne dors plus", ils demandent à A.Breguet de construire sur ses indications (sous licence C.Roosvelt) une paire de téléphones. Après l'avoir expérimenté, ils décident d'en faire profiter les membres de la Société Industrielle d'Elbeuf. Cette société, créée par leur père en 1857, réunit tout ce que la ville compte de notables, industriels et commerçants. En décembre 1877 l'Industriel Elbeuvien écrit :"aujourd'hui, un téléphone est à la disposition des membres de la Société Industrielle qui pourront ainsi confirmer tout ce que nous avons déjà dit de cet appareil extraordinaire". Le président de la société, Monsieur Pelletier, s'empresse de nommer une commission chargée d'étudier l'appareil. Cette commission organise le 11 décembre 1877 une expérience décisive : un téléphone Bell est installé dans le local de la société, un fil d'une longueur d'environ six cent mètres va sur la tour Saint-Jean et revient vers un deuxième Téléphone situé dans une autre pièce de la société. Les expériences faites hier ont parfaitement réussi. A une très grande distance et dans deux pièces fermées, la commission, divisée en deux groupes, a pu correspondre. La parole, un peu affaiblie à la vérité, est parfaitement claire et permet même de distinguer la personne qui parle. Tous les sons, toutes les syllabes s'entendent parfaitement bien. Une boîte à musique dont les sons sont assurément peu intenses, placée à l'une des stations, a fait entendre à l'autre extrémité les mêmes sons, avec la plus grande pureté, et l'on distinguait même très bien le timbre de l'instrument. L'audition était la même que si la boîte à musique avait été placée à quelque distance de l'oreille" (l'Industriel Elbeuvien, décembre 1877). |
Les téléphones fabriqués par sa société
ont précédé Bell en France. Une correspondance de
fin octobre et début novembre 1877 indique que son beau-père
en avait envoyé un carton à un certain Le Gay, au 3,
rue Scribe à Paris, destiné aux « agences scandinaves
et autres ». Mais ni Niaudet ni Breguet n'était au courant
de cette livraison.
(Dans la lettre de Hubbard à Bell, 2 novembre 1877. Ce «
Chal Le Gay, pour lequel Hubbard avait demandé à Bell le
13 novembre d'envoyer cinquante appareils supplémentaires, pour
fournir à plusieurs personnes des téléphones pour
essai, est peut-être le marchand parisien Charles Le Gay, mentionné
, en ce qui concerne les exportations de vin vers les États-Unis,
dans le livre Franco-American Commerce / Statements and Arguments in Behalf
of American Industries. Against the Proposed Franco-American Commercial
Treaty, San Francisco, 1879. Il peut également être le même
personne dont le décès a été rapporté
par le New York Times du 10 janvier 1909 : « Paris 9 janvier –
Charles Le Gay, ancien Américain, qui vivait à Paris depuis
quelques années, et qui est décédé ).
Le 10 décembre 1877, une expérimentation téléphonique
est tentée avec succès entre Bordeaux et Margaux
(distantes de 25 km) et Bordeaux et Soulac (distantes de 95 km) par la
Société Industrielle où les paroles, les voix, et
les musiques émises de chaque extrémité sont audibles
et compréhensibles par l'autre extrémité de chaque
liaison.
La Ville de Rouen découvre le Téléphone le
12 décembre 1877
( vous pouvez lire le compte rendu dans le
Bulletin 1877 de la Société industrielle de Rouen de
cette présentation)
| Messieurs Gouault et Dutertre,
membres de la Société Industrielle de Rouen, présentent
le Téléphone Bell lors d'une conférence publique
organisée dans la grande salle de l'Hôtel de ville de
Rouen (Seine-Maritime, France). La Société Industrielle de Rouen se définit à l'époque comme "une association ouverte à toutes les bonnes volontés, étudiant les applications des découvertes de la science, cherchant à propager l'instruction technique, s'efforçant de vulgariser les procédés industriels, en un mot, travaillant à faire la lumière ". Elle regroupe près de 700 membres de toutes origines, chaque département français est représenté ainsi que la plupart des pays étrangers (Etats-Unis, Russie, Allemagne, Angleterre, Suisse, Espagne, Belgique, Hollande,...). Monsieur Gouault présente l'appareil : "le Téléphone que je vais décrire et expérimenter est le cornet acoustique portatif. Il remplit les fonctions alternatives de transmetteur lorsqu'il reçoit la voix, et de récepteur lorsqu'il l'apporte à l'oreille. Cet appareil se compose d'un pavillon, destiné à recevoir la bouche ou l'oreille. Derrière ce pavillon, une membrane métallique en fer doux, de un à deux dixième de millimètres d'épaisseur, est tendue entre deux pinces annulaires en bois réunies par des vis en cuive. Cette membrane est l'appareil vibrant destiné à recevoir l'impulsion de la parole ou à la reproduire. Derrière cette plaque, et à une distance mesurée par une fraction de millimètre, se trouve un système composé d'une bobine entourée d'un fil de cuivre isolé et d'un aimant central. Les deux fils de la bobine ressortent de la gaine en bois de l'appareil par deux bornes ; l'un est mis en communication avec un fil télégraphique aboutissant au récepteur ; l'autre est conduit à la terre, comme dans les appareils télégraphiques ordinaires" (Bulletin de la Société Industrielle de Rouen, 1878). Cette description très scientifique cède parfois la place à une description plus terre à terre : "l'appareil de Monsieur Graham Bell se compose essentiellement de deux parties ayant assez l'aspect des patères en bois qui servent à retenir les draperies" (le Journal de Rouen, 1877). Monsieur Gouault donne ensuite le principe du Téléphone : "le premier principe, d'ordre philosophico-physiologique, est antérieur à Bell ; le second principe, d'ordre purement physique, était connu de la science et était implicitement renfermé dans la loi de Lentz. Bell a eu le bonheur d'en trouver le premier, je crois, une application pratique". Enfin Messieurs Gouault et Dutertre réalisent une série d'expériences qui réussissent parfaitement. Ils montrent qu'il est possible d'entretenir une conversation à distance, un deuxième poste étant installé dans l'hôtel de la gendarmerie, à plus de 300 mètres de la salle de conférence. Ils présentent également leurs essais sur de longues distances : le petit appareil que vous avez sous les yeux a été expérimenté par Monsieur Dutertre et moi-même jusqu'à 300 kilomètres de résistance locale. Monsieur Bréguet affirme avoir perçu les sons que transmet le téléphone avec des résistances de 1000 kilomètres ! Les expériences faites sur des fils de lignes ont été moins concluantes, en raison même de la grande sensibilité de l'appareil. C'est qu'en effet les fils voisins des lignes télégraphiques, soumis à des courants électriques intenses, agissent par induction sur le fil télégraphique. Ces courants induits se superposent à l'action principale du Téléphone et la troublent d'une manière sérieuse. C'est ainsi que lors d'une expérience opérée sur un fil de ligne de l'Etat, j'ai entendu très distinctement, superposés à la voix transmise, les bruits donnés par trois télégraphes ordinaires du service. On reconnaissait très nettement le fonctionnement d'un Morse, d'un Bréguet et d'un Hughes. En dehors de ces actions et de ces inconvénients extérieurs qu'un service général téléphonique ne comporterait pas, la transmission par l'appareil de Bell se fait, sur les fils de ligne, à des distances importantes. On peut citer les expériences faites il y a quelques semaines, entre Paris et Mantes, à une distance de 58 kilomètres, lesquelles ont parfaitement réussies". Monsieur Gouault termine sa conférence en présentant ce que pourrait être les premières applications du téléphone : "il remplacera, dans un avenir rapproché, les tuyaux accoustiques des habitations privées et des manufactures. Il rendra de grands secours, en campagne, pour les services des avant-postes, des reconnaissances des aérostats militaires. On peut espérer même l'utiliser pendant les batailles, lorsqu'il sera devenu plus puissant. Il aura d'ailleurs toujours cet immense avantage de n'exiger la présence d'aucun télégraphiste, et de permettre, dans des cas graves, la relation directe du général en chef avec les commandants des camps engagés. Son emploi est dès à présent indiqué pour les expériences de tir au polygone, dans le but de remplacer l'espèce de langage télégraphique constitué par les sonneries au clairon. Enfin Monsieur Bell fait des recherches pour en réaliser l'application à la télégraphie transatlantique et il a la conviction d'y réussir dans un avenir très rapproché". Le lendemain, Monsieur Gouault organise une deuxième conférence pour le public. Dans son rapport annuel de janvier 1878, le président de la société s'en félicite : "la présence de la foule qui est venue entendre la conférence publique et gratuite a affirmé le succès que notre collègue avait eu la veille". Voici comment le Journal de Rouen relate la conférence : "l'orateur, après avoir rappelé qu'un simple jouet avait été le précurseur du téléphone, a présenté l'instrument et minutieusement décrit les pièces dont il se compose, puis il a cherché à exposer la manière dont se fait la perception des sons. Toutes les fois, a-t-il dit, que nos sens se trouvent placés dans des circonstances différentes, mais semblables par leur résultante matérielle, ils transmettent au cerveau les mêmes impressions, et notre individu se croit absolument dans des conditions identiques ; c'est ce qui fait que les amputés croient percevoir une sensation dans le membre qu'ils n'ont plus ; qu'avec le stéréoscope, nos yeux croient voir des objets en relief, en examinant une image plate. |
| La première liaison téléphonique,
le Premier Communiqué de Presse Le 18 décembre 1877, Monsieur Gouault, invité par la Société Industrielle d'Elbeuf, donne, "devant un auditoire d'élite, une conférence sur le Téléphone". Après avoir présenté l'appareil, il passe aux expériences. Voici comment le Bulletin de la Société Industrielle d'Elbeuf relate les faits : "au moyen des appareils de Messieurs Poussin, une communication a été établie entre le local de la Société Industrielle et l'Hôtel de Ville. Le conférencier et d'autres personnes ont pu converser avec les personnes placées dans ce dernier local. Des phrases ont été échangées ; la sonnerie d'une montre, produite à l'Hôtel de Ville, s'est faite entendre très distinctement dans la salle où avait lieu la conférence ; on a pu, de la même manière, entendre l'air et les paroles d'un couplet de chanson". Enfin, grâce à la complicité de l'Inspecteur des lignes télégraphiques de Rouen, Monsieur Gouault va soulever l'enthousiasme de son auditoire. Réalise-t-il alors qu'il va effectuer la première liaison téléphonique "commerciale" en Normandie et probablement le premier communiqué de presse français ? Le Téléphone Bell est alors relié par un fil qui, tiré du local de la Société Industrielle, rejoint le bureau télégraphique puis emprunte la ligne télégraphique Elbeuf - Rouen. Voici le commentaire du bulletin de la Société Industrielle : "une communication a pu être établie entre le local de la conférence et la guérite télégraphique de la gare Saint-Sever à Rouen, et vers 10 heures et demie du soir, Monsieur Gouault transmettait la dépêche téléphonique suivante : "Président Société Industrielle d'Elbeuf à Président Société Industrielle de Rouen. Une conférence très intéressante sur le téléphone a été faite ce soir à la Société Industrielle d'Elbeuf, par Monsieur Gouault, ingénieur. Mis en communication avec Rouen grâce à l'obligeance de Monsieur le Directeur des Télégraphes, le conférencier transmet cette dépêche oralement pour être communiquée aux journaux : un incendie qui menaçait de prendre de graves proportions s'est déclaré ce soir rue de l'Hospice. Un ouvrier a été sérieusement brulé au bras et à la poitrine. On est actuellement maître du feu". "Les termes de cette dépêche ont été répétés mot par mot, par la personne qui la recevait à Rouen : la transmission avait donc parfaitement réussie". A cette date on pouvait acheter une paire de téléphones pour la somme de 15 francs ce qui équivalait 2 jours de travail pour un ouvrier qualifié. |
Parallèlement,
fin 1877 , Cornelius Roosevelt
Américain (et cousin du futur Président des USA) qui a quitté
sa patrie en octobre 1877 pour s'établir en France; s'intéresse
aux applications de l'électricité, principalement au télégraphe,
multiplie les démarches auprès de l'administration des Postes
et Télégraphes pour obtenir une autorisation d'installer
un réseau de lignes privées et exploiter un brevet de "Télégraphe
de quartier" en mars 1877, qu'il n'obtiendra pas mais qui lui permettra
de bien connaître l'organisation des Postes et Télégraphes
et de rencontrer les grands directeurs.
Roosevelt informé sur l'invention du téléphone de
BELL, se rend à Washington pour rencontrer le beau père
de Bell, Gardiner Hubbard et lui propose d'acheter les droits français
de son brevet pour l'exploiter en France.
Bell accepte l'accord de Roosvelt et se mettra en relation avec A.
Niaudet (neveu de Mr
Louis Bréguet) qu'il rencontra en Angleterre à la
réunion de Plymouth, car Antoine Breguet
fils parle l'Anglais et est aussi membre de la " Society
of telegraph Engineers
sommaire Graham Bell charge alors Antoine Breguet et Cornelius
Roosevelt, de faire connaître le téléphone en France.
En premier lieu, Antoine Breguet, soucieux de préserver la réputation
de haute qualité de la Maison, améliore l’aspect extérieur
du téléphone. Ci dessous deux lettres de correspondance entre Bell et
Niaudet sont échangées, la première rédigée
par Alfred Niaudet, le 8 novembre 1877, quelques jours après la
première démonstration d’un téléphone
en France ; Au moment de son mariage, Bell avait fait de son beau-père
le seul dépositaire de ses droits de brevet dans les cinq pays
européens (Grande-Bretagne, France, Belgique, Allemagne et Autriche)
où il avait déposé ou était sur le point de
le faire. Une fois en Grande-Bretagne, où un agent avait déjà
été nommé, il devint de plus en plus préoccupé
par le développement du secteur téléphonique sur
le continent, en partie parce qu'il pensait que si Hubbard le plaçait
sous sa supervision, il pourrait obtenir un revenu supplémentaire
face à l'augmentation des dépenses familiales. Mabel était
certainement du même avis, comme le montre une lettre du 25 octobre
à sa belle-mère, Eliza Symonds Bell « Ensuite, il
y a ses brevets en France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche et en
Italie. Tous sauf le dernier sous le contrôle de mon père
en tant qu'administrateur, mais bien sûr, quand il est si loin et
qu'il a tant de choses à occuper à la maison, il ne peut
pas gérer l'entreprise aussi bien que quelqu'un ici pourrait le
faire…
C'est donc A.Breguet qui présenta officiellement
le premier téléphone à la séance du
29 octobre 1877 de l'académie des sciences.
Voici comment un journaliste du quotidien " le Temps " relate
l'événement :
" le succès n'a pas répondu complètement aux
espérances des opérateurs. Les sons entendus étaient
peu distincts et les communications avec la salle du premier étage
beaucoup plus difficiles qu'elles ne l'auraient été avec
un tube acoustique "
Antoine Bréguet qui connaissait
bien l'administration des P&T, réussit à organiser un
rendez vous entre A.G. Bell et Mr Pierret, le directeur
des Postes et Télégraphes (qui ne s'appelle pas encore
les PTT). Quelques jours plus tard,
On peut lire dans le Petit Journal :
« L’industrie parisienne, si délicate toujours, n’a
pas tardé à faire une jolie chose d’un assez gros bilboquet,
et le téléphone que nous a montré Monsieur Breguet
est véritablement un joli petit objet, quand on le compare à
l’appareil rustique apporté de Londres ».
En se lançant dans l’industrie du téléphone,
la Maison Breguet n’aura de cesse d’en améliorer les
performances, l’aspect pratique et l’esthétique.
Le 2 Novembre 1877,
en FRANCE , Alfred Niaudet et Antoine Breguet
expérimentent " le téléphone"
devant des membres de l'institut et du collège de France. Voici
un extrait de l'exposé
de A. Niaudet "Mémoires de la Société des
ingénieurs civils" : Volume 30 année 1877.


« Cher Monsieur, merci infiniment pour votre intéressante
lettre et pour les journaux que vous m’avez transmis. Je serai à
Paris pendant six ou huit jours et j’espère vous y rencontrer.
Je vous envoie un journal contenant les comptes rendus de ma conférence
ici. Les remarques de Sir William Thomson ont été si brillantes
qu’elles devraient certainement être traduites en français
– et auront un grand poids. En hâte, vôtre, sincèrement.
Alexander Graham Bell. »
La seconde écrite par Alexander Graham Bell le lendemain, 9 novembre,
à Alfred Niaudet. Lettre autographe signée au physicien
Théodore Schneider.

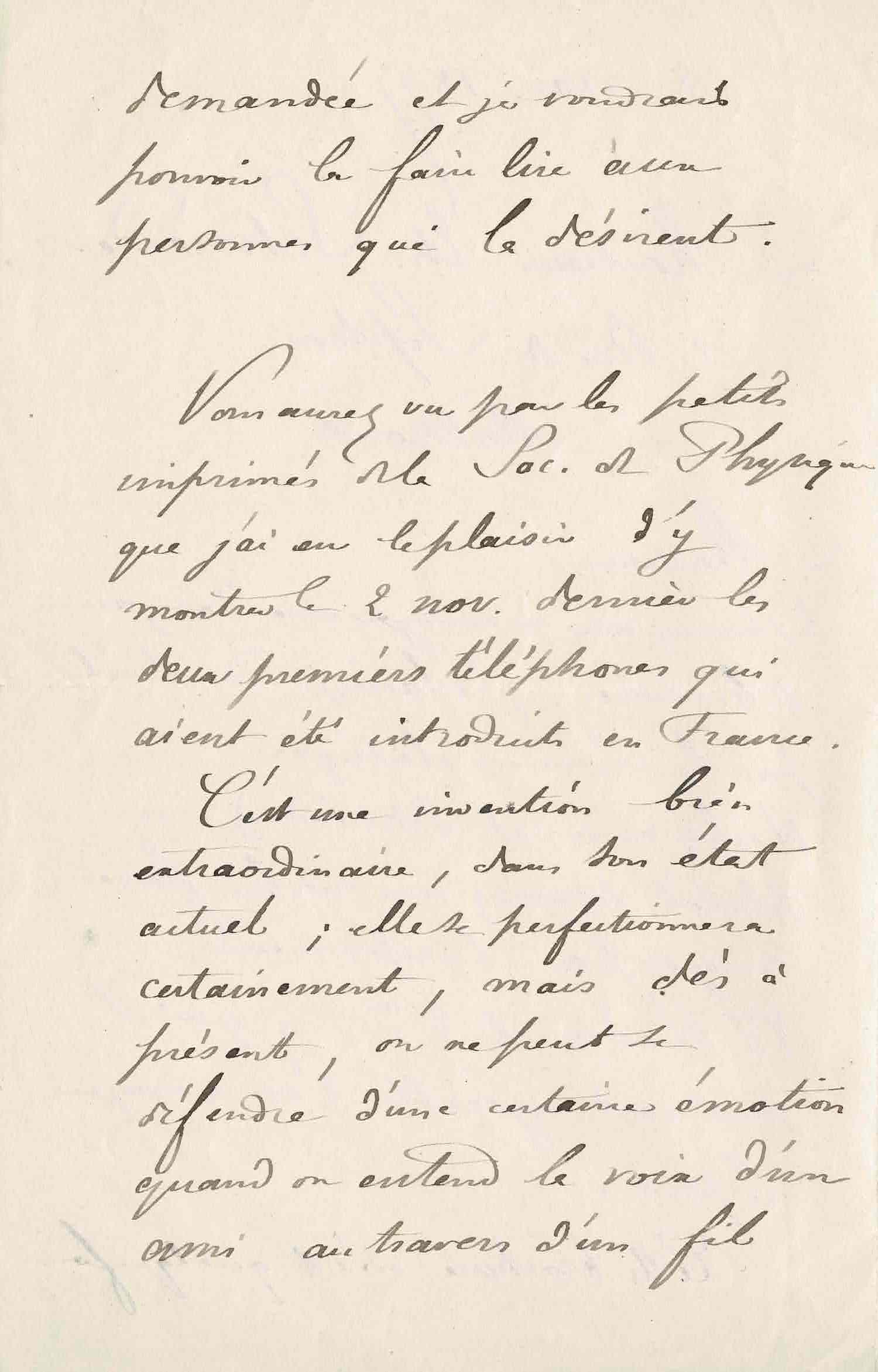
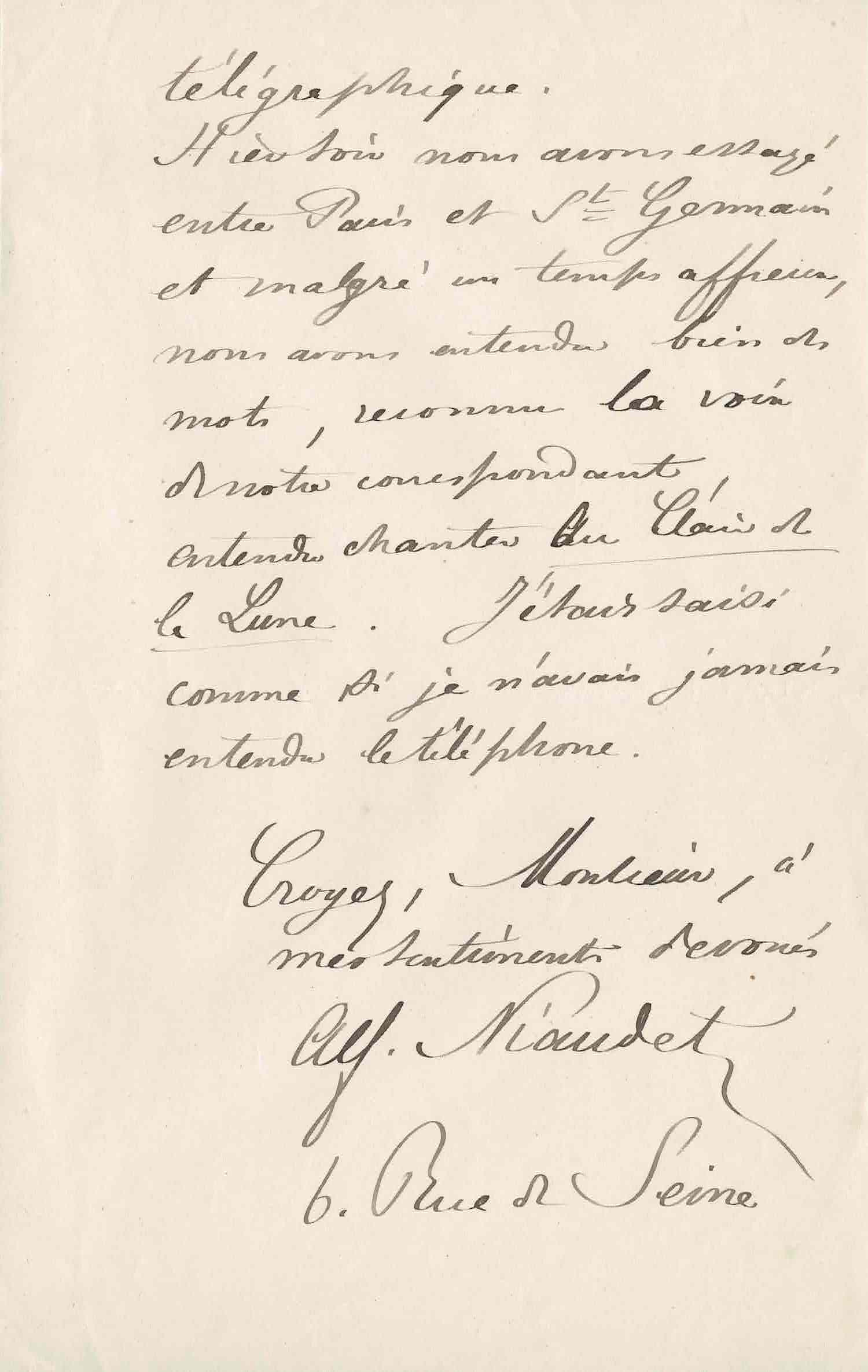
« Monsieur, Pourriez-vous m’envoyer une douzaine de brochures
(éclairage industriel par la lumière électrique –
Heilmann et Schneider) ou plutôt pourriez-vous me les faire envoyer
par l’imprimeur Vve Bader et Cie à qui il me serait agréable
d’en envoyer le prix. Cette brochure m’est quelque fois demandée
et je voudrais pouvoir la faire lire aux personnes qui la désirent.
Vous aurez vu par les petits imprimés de la Soc. de Physique que
j’ai eu le plaisir d’y montrer le 2 novembre dernier, les deux
premiers téléphones qui aient été introduits
en France.
C’est une invention bien extraordinaire, dans son état actuel
; elle se perfectionnera certainement, mais dès à présent,
on ne peut se défendre d’une certaine émotion quand
on entend la voix d’un ami au travers d’un fil télégraphique.
Hier soir, nous avons essayé entre Paris et St Germain et malgré
un temps affreux, nous avons entendu bien des mots, reconnu la voix de
notre correspondant, entendu chanter Au Clair de la Lune. J’étais
saisi comme si je n’avais jamais entendu le téléphone.
Croyez, Monsieur, à mes sentiments dévoués. Alf.
Niaudet. 6 rue de Seine »
Trois jours plus tard, Bell a référé l'affaire à
Hubbard : Il m'a semblé qu'il serait peut-être possible de
faire en sorte que les brevets continentaux nous profitent maintenant
comme demain si un arrangement pouvait être pris pour me nommer
agent général pour ces brevets jusqu'à l'organisation
des sociétés. là avec une commission [...] Il faut
faire quelque chose ici tout de suite sur le continent si j'avais le pouvoir
en la matière je pourrais négocier avec profit je pense.
Telle était la situation lorsque Bell effectuait son premier voyage
à Paris.
sommaire
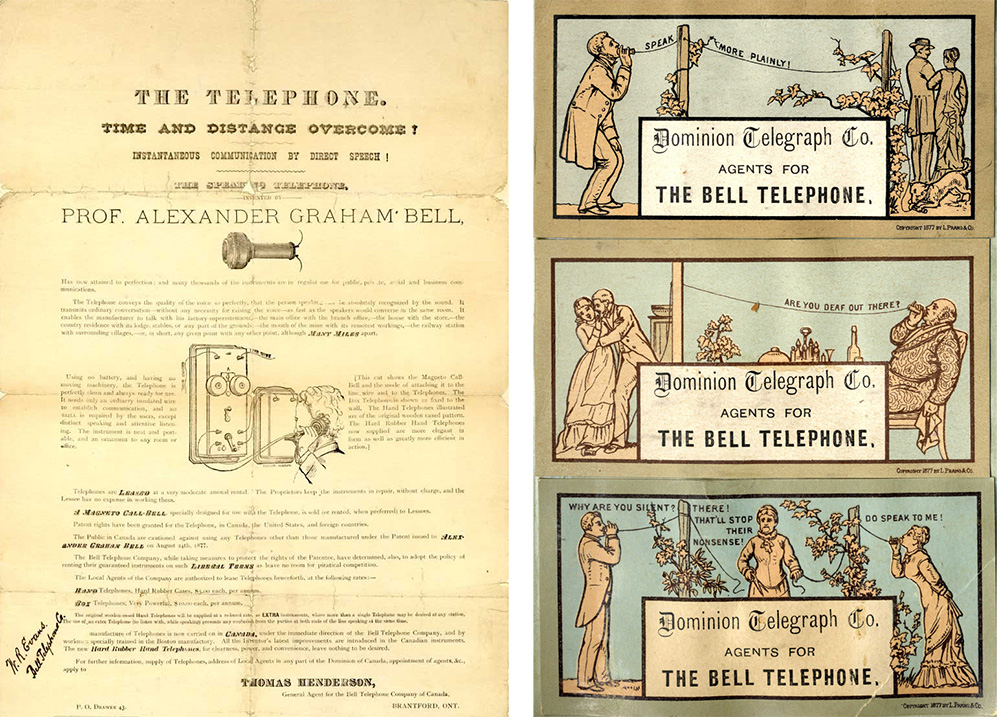
Bell arrive à PARIS le 21 novembre,
le soir tout juste arrivé de Londres, Bell s'assoit dans sa chambre
de l'hôtel Wagram pour écrire une lettre à sa femme.
Il avait à peine eu le temps de lui raconter la mer agitée
qu'il avait rencontrée entre Folkstone et Boulogne, qu'à
huit heures il fut interrompu par la visite de Niaudet. Après un
entretien de deux heures et demie, il reprend sa lettre : Niaudet se chargera
de traduire et de publier en France une conférence non précisée
de Bell.
Le lendemain, Bell devait voir Le Gay et un autre marchand appelé
Aymler, ainsi que le chef des Télégraphes français,
Pierret, et le ministre de la Guerre, à qui il comptait
donner des téléphones à des fins expérimentales.
Bell et Pierret conviennent de faire des essais sur les lignes télégraphiques
de l'état.
Dès le lendemain A.G Bell communique sur une ligne
spéciale de son domicile de Paris avec Léon Say
au ministère des finances et des postes et télégraphes
puis avec le ministre de la guerre.
Bell a notamment rencontré Antoine Breguet et son
père, Louis F. C. Breguet et ils obtiennent quatre licences
pour la production de postes téléphoniques en France
.
Le 25 novembre Niaudet transporta les nouveaux téléphones Breguet à la Société Française de Physique, où il annonça que Bell « lui avait promis » formellement de venir prochainement prendre la parole lors d'une réunion scientifique ». Niaudet a également fait une démonstration du téléphone à l'École Polytechnique lors de l'ouverture du cours de physique de Jules Jamin et, le 7 décembre, à la Société des Ingénieurs Civils.
Concernant le voyage de Bell, il existe également
une lettre non datée de Mabel à son mari, qu'elle a dû
écrire le jour même de son départ, juste après
avoir reçu un télégramme de lui de Folkstone Harbour
demandant, entre autres, une lettre d'Aymler *. qu'il avait probablement
oublié d'emmener avec lui. Mabel lui dit de manière encourageante
que plus elle y pense, plus il lui semble important qu'il soit à
Paris.
(* Aymler ou le supposé John Aylmer, ingénieur
civil, au 4, rue de Naples, qui fut en 1877 secrétaire honoraire
en France de la Society of Telegraph Engineers de Londres, et fut nommé
en 1881 secrétaire de la commission britannique pour l'Exposition
internationale d'électricité qui devait se tenir, à
Paris cette année-là.)
Aucun autre document n’a été trouvé permettant
d’établir la durée du séjour de Bell à
Paris. Ce fut vraisemblablement court et – malgré sa prétendue
promesse à Niaudet de s’adresser à la communauté
scientifique – sans aucun engagement public, à en juger par
le silence de la grande presse parisienne. Néanmoins, certains
des cinq journaux examinés, Le Figaro, La Presse, Le Temps, Le
Gaulois et le Journal des Débats, contenaient des informations
sur le téléphone à ces dates. Ils ont notamment fait
état d'une réunion de Louis Breguet avec des journalistes
le 28 novembre, au cours de laquelle il a montré les appareils
et déclaré qu'il les avait essayés avec succès
entre Paris et Mantes-la-Jolie, distantes de 58 km, et qu'il avait l'intention
de répéter l'expérience avec Nancy. Étonnamment,
le 14 décembre, Le Temps publiait un long article sur le téléphone
sous le titre « Chronique », écrit à la première
personne mais non signé, dont le dernier paragraphe contient une
référence intrigante à ce qui a pu être l'impression
que Bell avait de son expérience. voyage:
Il semble qu'au début M. Graham Bell n'ait pas été
enchanté de l'accueil qu'il a reçu en France ; on aurait
pu le prendre pour un excentrique ; c'est l'excuse que la routine oppose
habituellement au progrès.
Hubbard n'a pas répondu aux demandes de Bell pour un rôle
plus actif dans la gestion de l'introduction du téléphone
dans les pays où son gendre lui avait confié le contrôle
des droits de brevet.
Dans le cas de la France, il a décidé de son propre chef
de nommer Cornelius Roosevelt comme concessionnaire. Cousin germain
du futur président américain Théodore Roosevelt,
il appartenait à une riche famille new-yorkaise et était
retourné en Amérique après l'échec de ses
initiatives visant à introduire la télégraphie privée
en France – ce qu'on appelle le télégraphe de quartier
ou « télégraphe de quartier ».
Son frère Hilborne Lewis, qui était l’un des associés
de Hubbard dans le secteur téléphonique, l’a peut-être
recommandé en raison de sa connaissance de la langue et des coutumes
française.
Le 1er décembre, Cornelius rentra en France avec une lettre de
présentation pour Bell.
Décembre 1877
A.Niaudet et C. Roosevelt créent la "Société
Anonymes des Téléphones Bell"
C’est la première société de téléphonie
créée en France . Son siège social est situé
au 1, rue de la Bourse, à Paris.
La Société Anonyme des Téléphones Bell sera
présente à l’exposition universelle de 1878.
C’est là où Cornélius Roosevelt rencontre Frederic
Allen Gower et que les deux hommes
décideront de travailler ensemble.
En décembre 1877,
A.G.Bell réalise une communication gare Saint Lazare entre Paris
et Saint Germain
voici ce que l'univers illustré du 22 décembre 1877
rapporte sur l'Expériences faites à Paris avec le téléphone
Siemens


En même temps Breguet faisait une expérience
concluante entre Mantes la Jolie et Paris.
Dans la lettre datée du 29 novembre, Hubbard félicitait
chaleureusement son porteur. Le lendemain, il écrivit en privé
à Bell :
« Je pense que vous aimerez beaucoup M. Roosevelt et que l'arrangement
vous plaira. Cela dépend de votre approbation. Le 11 décembre,
il a insisté uniquement sur la première partie du message
: « J'espère que vous serez satisfait de M. Roosevelt »,
ajoutant : « Il n'a pas autant d'expérience en affaires que
certains, mais il est tout à fait honnête et est plus capable
de organiser une entreprise pour la France que quiconque que nous pourrions
vous envoyer. »
Rien n'indique que Bell ait osé être ouvertement en désaccord
avec Hubbard sur cette question, mais il a certainement pris son temps
pour rencontrer Roosevelt. Il semble que cela ne se soit produit qu'à
l'occasion d'un nouveau voyage. à Paris, où il arriva probablement
le samedi 19 janvier 1878, cette fois après avoir traversé
la Manche de Douvres à Calais.
Cinq jours plus tard seulement, il était de retour à Londres,
selon une lettre datée du 25 janvier de sa femme à sa belle-mère,
qui donne de précieux détails sur ses déplacements
: *
"Il a eu un entretien avec les meilleurs avocats parisiens que
M. Roosevelt a engagés pour poursuivre une entreprise qui contrefait
les brevets d'Alec. Ils ont d'abord dit que le brevet ne valait rien parce
qu'il avait été demandé trop tard, mais Alec a réussi
à les convaincre que l'affaire n'était pas aussi désespérée
qu'ils l'avaient pensé et ils entameront immédiatement la
procédure. Il faudra néanmoins deux ans pour prouver si
le brevet est valide ou non, et les contrefacteurs continueront probablement
à se fabriquer. mais les poursuites en dissuaderont d'autres qui
étaient sur le point de commencer à fabriquer, et dans deux
ans M. Roosevelt aura le temps de s'établir et de faire de bonnes
affaires même si le brevet échoue. Le gouvernement français
reconnaît Alec et c'est une très bonne chose. M. Roosevelt,
qui a consacré il y a quelque temps de longs mois et d'importantes
sommes d'argent à tenter en vain d'obtenir du gouvernement l'autorisation
de construire des lignes privées et de créer une District
Telegraph Co. à Paris, affirme qu'Alec a accompli en une demi-heure
ce que personne d'autre n'a fait. pourrait faire, à savoir obtenir
que M. Perret, sous-ministre des Télégraphes, offre de construire
aux frais du gouvernement un nombre illimité de lignes téléphoniques
privées, et de lui donner toutes les facilités pour essayer
le téléphone sur toutes les lignes gouvernementales.. M.
Roosevelt dit que cela lui a coupé le souffle. Le gouvernement
va ériger une ligne téléphonique de Paris à
Versailles, sur 20 milles, et, à la demande d'Alec, a commencé
dès le lendemain à installer une ligne pour M. Roosevelt.
Alec rendit visite à M. Léon Say, ministre des Finances,
et aux ministres de la Guerre et de la Marine. Lorsque M. Roosevelt a
dit à M. Léon Say que l'impératrice Eugénie
avait demandé à Alec de lui montrer le téléphone,
il a été d'accord avec M. Roosevelt en pensant qu'il serait
bon que le maréchal Mac Mahon le voie d'abord, et il lui demandera
de nommer un jour"
* Depuis l'hôtel Wagram, Bell avait écrit
à sa femme une lettre décontractée, non datée,
portant uniquement la mention « samedi », et qui contient
une description amusante de ses compagnons de voyage dans le train de
Londres à Douvres. Il lui raconte également que sa première
démarche à Paris a été d'envoyer une note
informant Roosevelt de son arrivée.
Selon la lettre de Mabel du 25 janvier, Bell était absent depuis
six jours et est revenu le 24, ce qui concorde avec le fait qu'il soit
parti le 18 et soit arrivé à Paris le 19, un samedi. Un
deuxième voyage plus tôt à Paris devrait être
écarté, entre autres raisons parce que la mère de
Bell lui a écrit ainsi qu'à Mabel le 25 février,
leur disant que Mme Hubbard lui avait envoyé certaines de leurs
lettres : « nous sommes donc assez bien au courant de vos actions.
, jusqu'à ce que vous partiez une seconde fois pour Paris, d'où
nous espérons que vous êtes déjà revenu. Il
est probable que deux lettres non datées de Mabel à son
mari correspondent à ce voyage. Ces lettres pourraient avoir été
envoyées les 20 et 23 janvier et commencer respectivement par «
J'imagine que vous travaillez dur avec M. Roosevelt... » et «
Je n'écrirai qu'une courte note cette fois-ci... »
Dans cette lettre du 25 janvier, écrite juste après le retour
de Bell de Paris, Mabel dit à sa belle-mère qu'« il
devra y retourner dans quinze jours ».
Bell s'était certainement senti obligé de réagir
aux appels de détresse venant de France. Son instrument était
simple et facile à copier, si bien qu'au moins un commerçant
parisien avait réussi à avoir des téléphones
prêts à être vendus à Noël. Il s'agissait
de Guillaume Walcker, propriétaire du Bazar du Voyage, un
grand magasin place de l'Opéra. (Voir, par exemple, Le Figaro du
25 décembre 1877, Le Temps du 30 décembre 1877 et Le Gaulois
du 27 janvier 1878. L'annonce du Figaro a probablement été
motivée par la publicité du téléphone de Walcker
que le journal diffusait la veille)
Roosevelt a immédiatement commencé à annoncer dans
la presse que la Maison Breguet avait été choisie comme
fabricant exclusif et à avertir les fabricants sans licence qu'ils
seraient poursuivis en justice. Mais en vain. Selon une source, Walcker
« fabriquait et vendait environ deux ou trois mille » téléphones
« au mépris des brevets de Bell ». (George Lewis Gower,
frère de Frederick, pionnier du téléphone, dans une
lettre au Chicago Daily Tribune, 3 septembre 1879)
Cette fois, le séjour de Bell à Paris lui valut quelques
articles payants dans au moins deux journaux de la ville. Les rapports
retrouvés se ressemblent, bien qu'ils diffèrent sur les
dates, et font état de manifestations téléphoniques
chez Say ainsi que d'un dîner offert à Bell par son concessionnaire,
en présence de « plusieurs savants français ».
Il est étonnant que Mabel, toujours si désireuse de vanter
les exploits de Bell auprès de sa mère, n'ait pas fait référence
à cette rencontre dans la lettre citée ci-dessus.
Dans les archives, on retiendra aussi que le 8 janvier 1878, une expérimentation Téléphonique avait été tentée avec succès à Marseille, entre deux téléphones, par deux ingénieurs britanniques MM. Brown et Payne. un téléphone est installé rue Pavé-d'Amour, dans les bureaux du Télégraphe Sous-marin, l'autre téléphone est installé à proximité du Château Borély, à une distance de 4500 mètres.
A Londres pour organiser la logistique de ses conférences
Bell, fait appel à Fréderic
Allen Gower, jeune éditeur du journal "Providence
Press".
Récit dans "Le figuier 1878 "
"L'année scientifique et industrielle"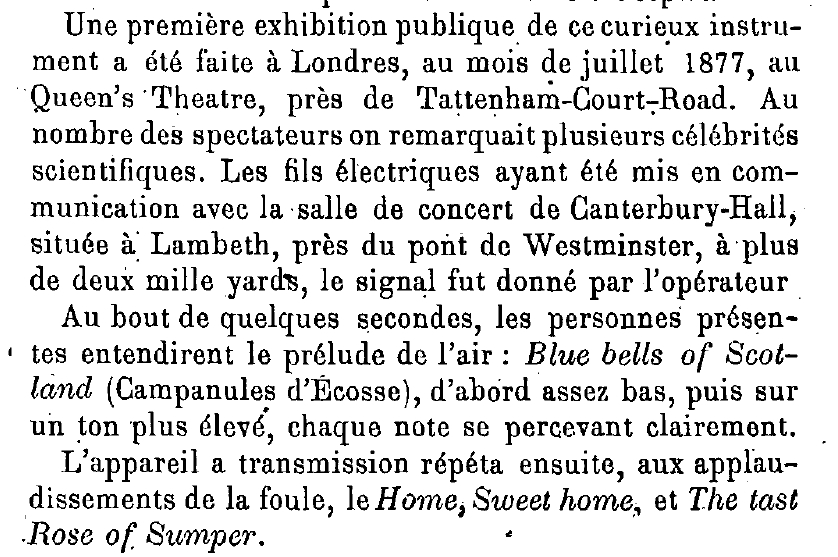
Le mémoire lu par Bell
à la société des ingénieurs télégraphistes
de Londres le 31 octobre 1877 et a
été reproduit clans le journal de la société.
Cet appareil nommé "the William's coffin" a été donné au musée des postes et télégraphes puis au musée des arts et métiers en 1920. Appareil avec un ou deux récepteur/émetteur (sans microphone)
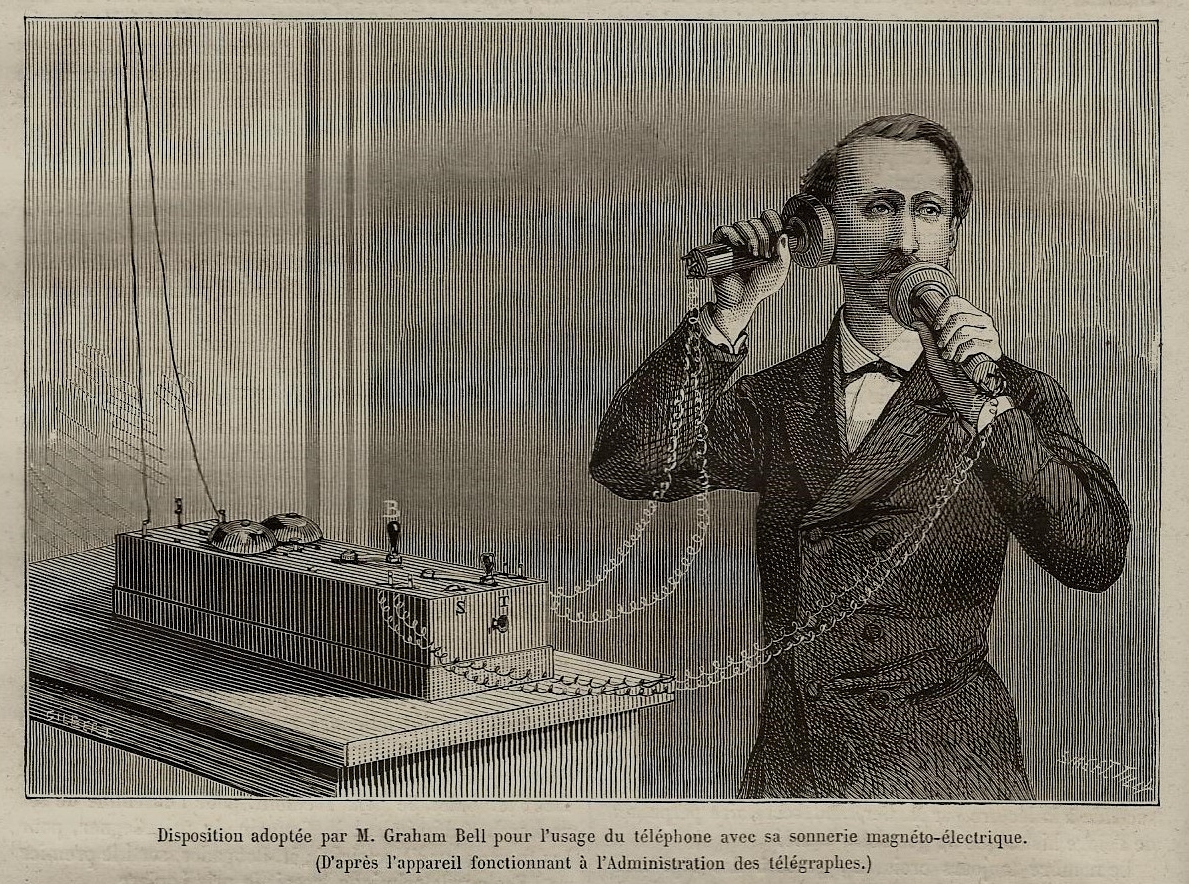 Lire aussi dans la nature
Lire aussi dans la nature

Petite histoire et parenthèse importante
pour la suite du développement du téléphone en France
et en Angleterre : Frederick Allen Gower
travailla comme éditorialiste chez Providence Press et Star
en 1871. Il est dit que Gower rencontra Bell par hasard,
lorsqu'il perdit un pari avec un autre membre du personnel, le perdant
devant interroger le "fou" qui a pensé qu'il était
possible de transmettre la voix humaine sur des fils télégraphiques.
Intrigué par les idées de Bell, Gower devint agent de
presse de Bell, puis partenaire d'affaires et conseiller en chef,
ce qui en fit un homme riche.
Selon un article paru dans le journal Providence en 1940, Gower aurait
convaincu Bell que le téléphone était une invention
pratique destinée à un usage autre que commercial.
Le journal "LA
NATURE" du 23 Mars 1878, du 27 AVRIL 1878, du 4
MAI 1878.... reproduis presque en totalité la conférence
de M. Bell. faite pour la revue 'La Nature'.
Ce document, inédit en France, nous paraît offrir une importance
capitale ; nous le recommandons à l’attention de nos lecteurs.
sommaire
Les premiers téléphones en France sont alors installés
entre le laboratoire et l'atelier sur deux étages différents
de la maison des Breguet au 39 Quai de fl'Horloge, en 1878, la
production de téléphones commence.
Antoine Breguet a présenté son téléphone à
l'Académie française des sciences en 1878.
C'est A. Bréguet fils début
1878 qui fut chargé, pendant 5 ans de construire les téléphones
pour la France, dans les ateliers Breguet 39 quai de l'horloge à
Paris

Compte tenu que aux US, Watson fabriquait manuellement quelques appareils
Bell, on peut considérer que ce bâtiment est donc le plus
ancien lieu de production d’équipements de télécommunications
au monde.
La maison Breguet chargé de fabriquer les téléphones
brevet bell en améliore l'aspect et la fiabilité.
 |
Dans le petit monde des collectionneur, on appelle ce modèle LA POIRE , savez vous d'ou vient ce petit nom ? Réponse : D'une page publicitaire vu dans "La Tribune des inventeurs, 1891" "Non, messieurs ! La poire téléphone
n’est pas seulement un merveilleux appareil scientifique, mais
encore son prix peu élevé, la solidité de sa
construction, la rapidité de son installation, la facilité
de son emploi, les services infinis qu’elle rendra la mettent
au premier rang des découvertes modernes d’un usage
réellement pratique. " Modèle Breguet entre
fin 1877 et début 1878 "Pour la France", collection
Jean Godi |
Ces appareils
étaient vendus 30 francs à l'époque ce qui équivaut
à 350 € actuels, ils étaient
accompagnés de La
Notice  .
.Avec les mises en garde, les explications du pourquoi on en trouve encore beaucoup qui n'ont pas de marque ... |
 |
Lisons le reste de cette notice
Les téléphones peuvent servir à établir
des communications entre deux points ou plusieurs pièces d'une
maison ou d'un édifice quelconque, soit pour des besoins purement
domestiques, soit pour des usages commerciaux, industriels ou administratifs.
Les observations suivantes pourront servir de guide aux personnes qui
auront à établir des communications de ce genre avec le
téléphone Bell.
1 - pour obtenir le maximum d'effet il faut avoir dans chaque endroit
deux téléphones à main, c'est à dire deux
de ces cornets représentés par la figure suivante

Quant on écoute, on en met un à chaque oreille; il est clair
qu'on entend mieux avec deux oreilles qu'avec une seule et d'ailleurs
en procédant ainsi, on se garanti contre les bruits extérieurs
qui ne peuvent que troubler.
Quant on parle, on présente devant la bouche l'un des cornets et
on parle dans l'embouchure; mais en même temps on garde le second
téléphone à l'oreille pour saisir les moindres interruptions
de son interlocuteur.
2 - Avant de parler à son correspondant, à son employé,
il faut l'avertir qu'on va parler et, en général il faut
une sonnette comme nous le dirons tout à l'heure.
Cependant si l'un des interlocuteurs A est à son bureau et que
le téléphone soit placé assz près de son oreille,
il entendra que B l'appelle, si B crie un peu fort à l'autre bout
du fil et si A a l'habitude d'entendre ses appels.
On peut même entendre un cri poussé à l'extrémité
B dans toute la pièce A si les conditions sont favorables.
Cette manière de faire pourra être employée quand
l'un des interlocuteurs ne pourra pas à raison de son grade ou
de sa position sociale être sonné par l'autre.
3 - On peut d'ailleurs disposer les choses d'une manière dissymétrique
comme-suit :
Le bureau A n'a pas de sonnette, il n'a qu'une paire de téléphone
et un bouton d'appel. Quand le correspondant A veut appeler B il presse
le bouton et fait marcher la sonnerie B; la conversation s'engage entre
A et B; car le bureau B a, outre sa sonnerie, deux téléphones
pour parler et entendre. Mais il n'a pas dans ce second bureau B de bouton
d'appel. En résumé donc A peut appeler B; mais B ne peut
pas appeler A. Cela suffira dans un grand nombre de cas.
Pour réaliser cette combinaison on pourra placer un fil spécial
pour la sonnerie et se servir comme fil de retour de l'un des conducteurs
du téléphone. Ce sera le plus économique et le plus
simple quand la distance ne sera pas grande, car le prix du fil spécial
de la sonnerie sera plus élevé.
Si au contraire la distance est grande il faudra faire usage d'une combinaison
spéciale pour employer les fils mêmes du téléphone
pour faire fonctionner la sonnerie. Cette combinaison sera du genre de
celle que alons faire connaître ci-après.
4 - Dans le cas général c'est à dire dans le cas
ou A et B pourront se sonner indifféremment dans les deux sens,
il y aura dans chaque bureau deux téléphones, un bouton
pour appeler le correspondant, une sonnette électrique pour être
appelé par lui, une pile pour fournir le courant aux appels et
enfin un support pour les téléphones au sujet duquel nous
allons entre dans quelques détails.
Ce support ou tablette présentent deux patères sur lesquelles
on place les téléphones. L'une des ces patère est
fixe, mais l'autre est mobile autour d'un axe et fait un petit mouvement
de bascule quand le poids du téléphone change son équilibre.
Ce déplacement entraine un changement de communication; si le téléphone
est à la patère, la ligne est en communication avec la sonnerie;
si au contraire on prend le téléphone à la main,
la patère remonte aussitôt, en basculant, la ligne en communication
avec le téléphone.
La manœuvre se fait de la manière suivante : A presse son
bouton d'appel, la sonnerie de B se met à tinter; B presse à
son tour son bouton en réponse et la sonnerie de A se fait entendre.
Aussitôt chacun des deux correspondants prend ses deux téléphones
dans ses mains et la conversation commence.
Quand elle est achevée, chacun replace ses téléphones
sur leur patère et chaque bureau se retrouve sur sonnerie; c'est
à dire prêt à recevoir les appels de l'autre.
5 - Si un bureau doit communiquer avec plusieurs autres, si par exemple
le Directeur d'une usine veut parler successivement à tous ses
contremaîtres, il suffira dans le bureau central d'une seule paire
de téléphones qu'on emploiera sur l'une des lignes aboutissant
aux bureaux secondaires.
Il faudra dans ce bureau central :
-une sonnerie commune pour toutes les lignes,
-un tableau indicateur faisant savoir quelle ligne a appeler, un bouton
d'appel pour chaque ligne, pour appeler le poste correspondant,
-un commutateur pour chaque ligne pour mettre cette ligne en rapport,
soit avec le tableau indicateur (position d'attente), soit avec le bouton
d'appel (position temporaire) soit enfin avec les téléphones
(position de correspondance).
-Une paire de téléphone.
Il n'y aura pas lieu d'avoir ici le système de patère mobile
faisant commutaeur dont nous avons parlé plus haut; mais il sera
indispensable dans chacun des bureaux ou stations secondaires.
Le 2 Janvier 1878 est indiqué dans "La Nature" : Très-récemment, dans une soirée donnée à la préfecture maritime de Cherbourg, on fut fort étonné, au milieu des salons, d’entendre sonner un vulgaire clairon de la troupe. Le son en était apporté du bout de la digue par un téléphone dont le perfectionnement est dû à M. Collard. M. du Moncel, en rapportant ce fait piquant, a indiqué rapidement en quoi consiste le perfectionnement; mais bien que M. Bréguet ait donné aussi son explication, nous ne sommes pas assez sûr d’avoir bien compris, pour rien dire de plus à nos lecteurs
En 1881, Antoine Breguet transforme l’horlogerie
familiale en société anonyme sous la dénomination
« Maison Breguet » avec pour objet « la construction,
l’installation et le commerce » de matériel électrique
(télégraphie, téléphonie, signaux, éclairage,
transmission de force à distance, etc.).

Bell n'a pas pu protégé son brevet dans
tous les pays car son invention s'est très vite propagée.
En Belgique, le premier brevet d’importation relatif au téléphone
fut déposé par Alexandre Graham Bell, d’Edimbourg (Ecosse),
professeur de physiologie vocale à l’Université de
Boston (États-Unis), le 27 juillet 1877, sous le n°
42696, et accordé le 16 août de la même année.
Le brevet français porte la date du 25 juillet 1877.
Nous donnons ci-après les diverses revendications de Graham Bell.
Comme elles n’ont jamais été reproduites, en Belgique
du moins, nous pensons que leur publication est destinée à
attirer l’attention de tous ceux qui s’intéressent à
cette admirable invention.
Nous transcrivons en observant l’ordre indiqué dans le dit
brevet.
1° Dans un téléphone électrique, la combinaison
d’un aimant tubulaire avec une membrane en fer, acier ou autre matière
susceptible d’action inductive, comme cela a été ci-dessus
décrit;
2° Dans un téléphone électrique, la combinaison
d’une membrane en fer, acier ou autre matière susceptible
d’une action inductive avec un aimant tubulaire, de manière
que la membrane en fer soit en contact avec un des pôles de l’aimant
tubulaire et libre de vibrer dans le voisinage de l’autre pôle,
le tout devant fonctionner de la manière indiquée et décrite
;
3° Dans un téléphone électrique, comme cela a
été ci-dessus décrit et illustré, un aimant
tubulaire devant être employé pour parler ou pour entendre,
à l’effet de conduire les sons dans la direction de la plaque
ou s’écartant de la plaque;
4° Dans un téléphone électrique, comme cela a
été ci-dessus décrit et illustré, l’emploi
d’un aimant servant de poignée pour lever le téléphone
soit à la bouche, soit à l’oreille;
5° Dans un téléphone électrique, la combinaison
avec un aimant tubulaire et une plaque métallique, d’une bobine
de fil métallique isolé remplissant complètement
l’intérieur du téléphone, comme cela a été
ci-dessus indiqué et illustré;
6° Dans un téléphone électrique, un aimant tubulaire
composé comme cela a été ci-dessus indiqué
et décrit;
La méthode pour produire des ondulations dans un courant voltaïque
continu en augmentant ou diminuant graduellement la puissance de la batterie,
comme cela a été ci-dessus décrit;
7° La méthode de transmission électrique des sons vocaux
ou autres, en faisant varier l’intensité d’un courant
électrique, d’une manière proportionnelle aux variations
de la densité produite dans l’air par les dits sons;
8° La méthode de transmettre électriquement des sons
vocaux ou autres, en faisant varier l’intensité et la polarité
d’un courant, suivant une manière proportionnelle à
la vélocité et à la direction du mouvement des particules
de l’air pendant la production des sons;
9° L’union sur un circuit électrique et à l’aide
de ce circuit, de deux ou d’un plus grand nombre de téléphones
construits pour opérer comme il a été dit, de sorte
que si l’armature platine de l’un ou de l’autre des dits
instruments soit mobilisée d’une manière quelconque,
les armatures de tous les autres téléphones sur le même
circuit seront mobilisées de la même manière et que
si l’armature de transmission est mobilisée ou mise en vibration
par un son, des sons similaires seront produits par le mouvement ou vibration
de l’armature des autres téléphones sur le circuit
;
10° Dans un système de télégraphie électrique
ou téléphonie consistant en des instruments transmetteurs
et récepteurs réunis sur un circuit électrique. Je
revendique la production, dans l’armature de chaque instrument récepteur,
d’un mouvement donné quelconque, en soumettant la dite armature
à une attraction variante d’une intensité, quel que
soit le mode de production de cette variation dans l’aimant et d’où
je revendique la production d’un son ou de plusieurs sons par l’armature
de l’instrument récepteur, en soumettant la dite armature
à une attraction dont l’intensité varie, de manière
à mettre l’armature dans cette forme de vibration qui caractérise
le son ou les sons donnés;
11 ° La combinaison avec un électro-aimant d’une plaque
en fer, acier ou autre matière susceptible d’une action inductive
qui peut être mise en vibration par le mouvement de l’air ambiant
ou par l’attraction d’un aimant ;
12° Conjointement avec une plaque et électro-aimant, les moyens
ci-dessus décrits ou leurs équivalents, pour ajuster la
position des deux, de sorte que sans se toucher, ils peuvent être
montés aussi près l’une de l’autre que possible
;
13° Dans un téléphone électrique, la combinaison
avec la plaque d’un aimant ayant des spères sur l’extrémité
ou les extrémités de l’aimant les plus rapprochées
de la plaque, comme cela a été ci-dessus décrit;
14° La combinaison avec un téléphone électrique,
tel que ceux ci-dessus décrits, d’une boîte sonore,
telle que celles ci-dessus décrites ;
15° Conjointement avec un téléphone électrique
ci-dessus décrit, l’emploi d’un tube pour transmettre
aussi bien que pour recevoir ces sons passant par le téléphone,
comme cela a été ci-dessus décrit;
16° Dans un téléphone électrique, la combinaison
avec un aimant permanent et une armature plaque, d’un pôle
en fer doux formant le noyau pour la bobine, comme cela a été
ci-dessus décrit;
17° Dans un système de télégraphie dans lequel
le récepteur vibrant opère l’organe interrompant le
circuit, d’un circuit local indépendant du dit récepteur,
comme cela a été décrit, d’un organe vibratoire
servant à interrompre le courant pour le dit circuit local, consistant
en un bras à ressort léger dont l’extrémité
libre déborde la portion vibrante du récepteur, conjointement
avec une portion du récepteur et conjointement avec une pointe
de contact dans le dit circuit, avec laquelle le dit bras établit
et interrompt le contact comme cela a été décrit;
et
18° Le télégraphe autographe, comprenant la combinaison
d’une série de transmetteurs et de fils transmetteurs, un
seul fil de ligne, des récepteurs correspondants en nombre avec
les transmetteurs accordés à un diapason pour vibrer en
unisson avec la succession d’impulsions électriques transmises
de leurs transmetteurs respectifs, organes vibratoires pour interrompre
le circuit, dont un pour chaque récepteur et un circuit local et
fil récepteur pour chacun de ces organes vibratoires, la série
des fils portant sur du papier préparé, le tout pour fonctionner
comme il a été ci-dessus décrit.
Un second brevet fut déposé à Bruxelles, le i3
février 1878, sous le n° 44273B, et accordé
le 28 février de la même année.
Voici quelles sont les revendications indiquées par Graham Bell
dans ce brevet :
1° La méthode sus décrite pour produire ou transmettre
des notes musicales à l’aide de courants ondulatoires d’électricité
et à l’aide desquels deux ou un plus grand nombre de signaux
ou dépêches peuvent être transmis simultanément
sur un seul circuit dans la même ou dans des directions opposées;
2° L’emploi dans un système de télégraphie
multiple à courants ondulatoires d’électricité,
d’instruments récepteurs dont les armatures sont accordées
à des diapasons définis, de manière à vibrer
seulement quand un son de même diapason est transmis, comme cela
a été ci-dessus écrit;
3+ Un système de télégraphie dans lequel le récepteur
est mis en vibration par l’emploi de courants ondulatoires d’électricité,
comme cela a été ci-dessus décrit;
4° La combinaison sus décrite d’un aimant permanent ou
autre corps susceptible d’une action inductive, avec un circuit fermé,
de manière que la vibration de l’un occasionne des ondulations
électriques dans l’autre ou dans lui-même et se revendique
cette disposition, que l’aimant permanent soit mis en vibration dans
le voisinage du fil de conduite formant le circuit ou que le fil de conduite
soit mis en vibration dans le voisinage de l’aimant permanent ou
soit que le fil de conduite et l’aimant permanent soient tous les
deux simultanément mis en vibration dans le voisinage l’un
de l’autre;
5° La méthode pour produire des ondulations dans un courant
voltaïque contenu par la vibration ou mouvement de corps susceptibles
d’une action inductive ou par la vibration ou mouvement du fil de
conduite lui-même dans le voisinage de ces corps, comme cela a été
ci-dessus décrit.
Le payement des premières annuités de ces deux brevets ayant
été négligé, conformément à
la loi du 24 mai 1854, par les arrêtés des 7 avril et 21
août 1881, la déchéance de ces deux brevets fut prononcée.
D’où il résulte qu’en Belgique, de même
qu’en France et dans beaucoup d’autres pays, les premiers brevets
de l’inventeur du téléphone sont tombés dans
le domaine public.
Toutefois il n’en est pas de même en Amérique et en
Angleterre où tous les droits de l’inventeur ont été
sauvegardés.
En Angleterre et en France, Bell enchaîne les démonstrations
et fait parler la presse scientifique, il établit
la première liaison téléphonique intercontinentale
(36 Km) entre Douvres et Calais sur un seul fil (télégraphique)
et retour par la terre.
Dans l'univers illustré page 754 du
1 décembre 1877, nous lisons dans "la France"
que le téléphone vient de fonctionner entre la France et
l'Angleterre.
Deux cornets acoustiques aimantés ont été placés
la semaine dernière a Saint-Margaret, sur la côte
anglaise, près de Douvres, et a Sangatte, près de
Calais, puis reliés entre eux par un fil métallique.
Des conversations ont été échangées ainsi
à travers le détroit, les résultats obtenus ont paru
très satisfaisants aux inspecteurs des lignes de Douvres et de
Calais.
Les téléphones qui ont servis à cet événement
sont aujourd'hui chez un collectionneur
Australien 
sommaire
Les lecteurs du journal scientifique "La Nature" découvrent le "téléphone parlant "pour la première fois dans la presse spécialisée.
 |
 Schéma de principe (La nature de 1877) 
  Page 274, 275 et 276, (extrait du journal la nature de 1877) 
 et aussi
et aussi  (en
1878) (en
1878)Page 383, 384 |
Il est facile de comprendre que ce dispositif peut
être varié de mille façons différentes, mais nous nous bornerons au modèle
que nous venons de décrire qui est le plus pratique.
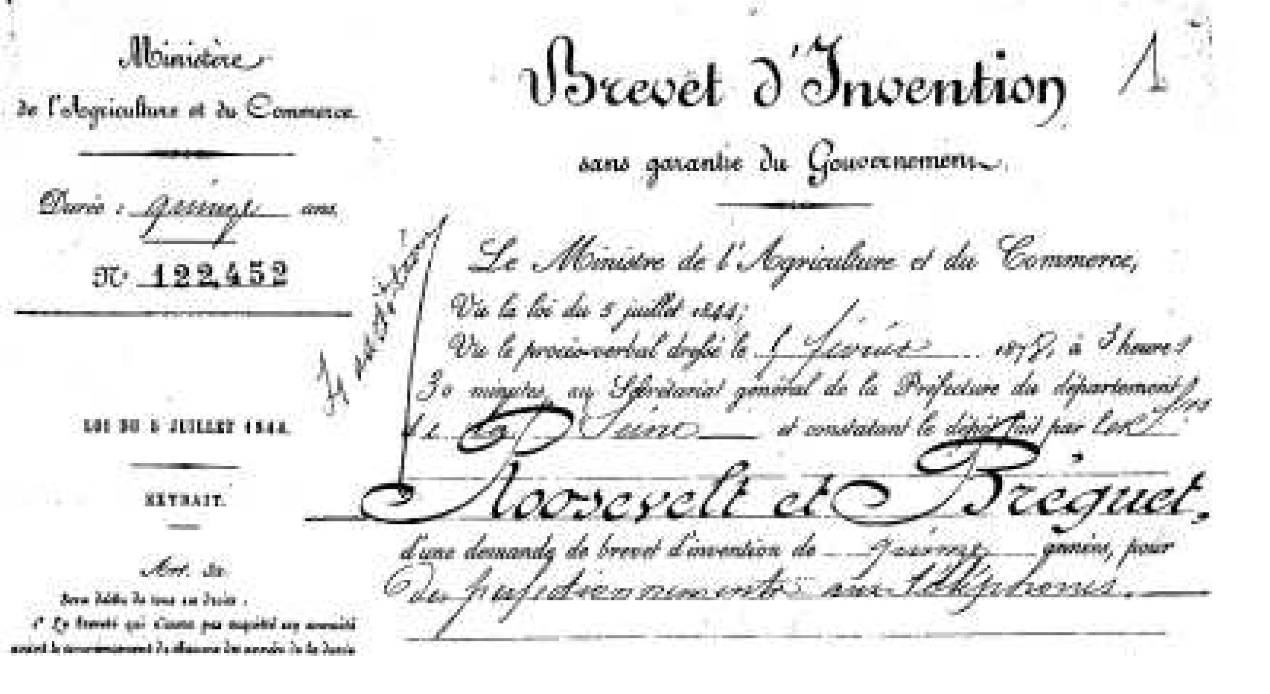
Brevet 122 452 déposé pr M.Brandon au nom de Cornelius
Roosevelt et Louis François clément Breguet le 5 février
1878.
Cette coopération Breguet Roosevelt dura jusqu'à la fin de 1878, date à laquelle Roosevelt racheta à Breguet ses droits sur les brevets déposés en commun au cours de l'année contre une somme de 5000 francs.
 |
Cette affichette annonce une conférence sur le téléphone et le phonographe donnée par Antoine Bréguet le 12 mai 1878 à Bernay. On doit à ce brillant physicien la construction
de la machine de Gramme, des travaux sur le téléphone
et l'invention, avec Clément Ader, du Théâtrophone. |
En 1878 Léon Leseur édite un ouvrage sur les conférences scientifiques qu'il a éffectué à Thonon et à Annecy pour présenter le téléphone
Donc
- Les grandes villes sont reliées par le télégraphe,
mais il reste à établir les communications entre les bourgs
et les villages…
- Les installations téléphoniques nécessaires aux
particuliers servent avant tout pour des communications locales.
- Les postes et Télégraphes considèrent que ce n'est
pas à eux de créer des réseaux de communications
téléphoniques urbains et locaux. L'administration des Télégraphes
a déjà bien du mal à faire face aux nombreux problèmes
que suscite son rattachement à celle des Postes.
La diversité des techniques qui apparaissent sur le marché,
depuis le télégraphe électrique au téléphone
en 1875, traduit l’attitude de l’État de ne pas développer
les innovations lui-même et de laisser l’initiative privée
s’en charger. Le cas de figure du réseau téléphonique
est en ce sens exemplaire.
|
L'Exposition
universelle de Paris de 1878 Se trouvant en rapport avec les membres d'une commission
officielle qui s'occupait d'organiser la section d'électricité,
pour l'Exposition universelle de 1878, au palais du Champ de Mars,
Don Pedro Empereur du Brésil, fit connaître
à cette commission le téléphone magnétique
du physicien de Boston. La Maison Breguet et Niaudet contre-attaquent
les faussaires en développant des versions modifiées/améliorées
du téléphone. |
En juin 1878, Frederick Allen Gower,
ancien assistant de Bell, arriva d'Angleterre, rejoignit Roosevelt et
commença également à travailler sur le téléphone,
sa première réalisation étant probablement une nouvelle
modification du modèle de la Box qu'il avait breveté avec
son nouveau partenaire en septembre.
Gower Brevet français 126 511, déposé le 12 septembre
1878, « Perfectionnements dans le téléphone BOX»
Dans la lettre, Roosevelt faisait également appel à l'honneur
de Bell : "Les Edison et Gray avec Phelps ont combiné leurs
intérêts et ont fait beaucoup de bruit ici en exposant à
l'Exposition, devant la presse, etc. à en juger par leur ton, on
pourrait imaginer que Bell était un imposteur et un tricheur".
Ce même été, à l'occasion de l'Exposition universelle,
Roosevelt et Gower s'inquiétaient beaucoup de l'intérêt
suscité à Paris par les travaux téléphoniques
de Thomas Alva Edison et d'autres inventeurs américains, comme
Elisha Gray et George May Phelps.
Le 7 septembre 1878 , après que Roosevelt eut tenté
en vain de voir Bell à Londres, ils lui écrivirent ensemble
une lettre lui demandant d'attendre « un coup écrasant »
: « une grande exposition » de ses téléphones
améliorés, qui aurait lieu entre Paris-Londres-Versailles.
Cependant, Bell n'y est pas allé. Son humeur de cette époque
se reflète clairement dans une lettre qu'il a envoyée à
sa femme le 9 septembre depuis Greenock, en Écosse, où pendant
une courte période il a repris avec plaisir l'enseignement de la
parole aux sourds :
"Une chose, je suis tout à fait déterminé,
c'est de ne plus perdre de temps ni d'argent au téléphone.
Si je dois donner encore plus de mon temps, ce doit être pour l'objet
qui me tient le plus à cœur. Si c'est absolument Il est nécessaire
pour les intérêts de M. Roosevelt que j'aille à Paris,
il doit payer mes frais de Greenock à Paris et retour – et
me rémunérer pour mon temps – sinon je ne songerai
pas à bouger. Je suis allé deux fois à Paris pour
M. Roosevelt à. des dépenses et des désagréments
considérables pour moi et ma présence n'était pas
absolument nécessaire, bien qu'il me l'ait laissé croire,
je n'ai pas l'intention d'y aller une troisième fois, j'en ai assez
du téléphone et j'en ai fini avec ça – sauf
pour jouer. chose pour amuser mes moments de loisirs"
Si l’on considère que lorsque Bell effectua son premier voyage
à Paris en novembre 1877, Roosevelt n’était pas encore
entré en scène, ses propos suggèrent qu’il revint
dans la ville dans l’intérêt du concessionnaire après
son premier entretien avec lui en janvier 1878. Aucune correspondance
familiale ni article de presse faisant référence à
ce troisième voyage n'ont été retrouvés, mais
un quatrième est bien documenté. Cette fois, la priorité
de Bell dans l’invention du téléphone était
en jeu, comme Hubbard l’avait exprimé sans ambages dans une
lettre du 26 septembre, faisant référence à l’Exposition
universelle.
" Les journaux de ce pays ont été
remplis d'annonces et d'annonces indiquant que des médailles d'or
ont été décernées à M. Gray et à
M. Edison et aucune à vous. Cette annonce nous fait un grand préjudice,
et nous pensons qu'elle a été obtenue grâce à
des représentations frauduleuses, et que l'attribution finale ne
sera décernée que le 21 octobre. Le président du
jury estime que l'invention est si merveilleuse qu'elle n'a pu être
réalisée que par un scientifique et un électricien.
Les agents de Gray ont prétendu que Gray était un scientifique
et un électricien, alors que vous ne l'étiez pas ;
et que vous lui avez volé l'invention. Maintenant, nous voulons
que vous vous rendiez immédiatement [à] Paris à nos
frais, que vous emmeniez les lettres de Gray avec vous, que vous voyiez
le président et le jury et que vous fassiez votre propre explication.
Cela suffira, n'importe qui lors d'une petite conversation verra que vous
en savez assez pour avoir inventé le téléphone et
que vous êtes à la fois scientifique et électricien.
J'ai également envoyé par la poste le livre de Prescott
du téléphone qui contient la mise en garde de Gray, montrant
à quel point il en savait peu, et une copie de votre brevet pour
montrer qu'il était disponible deux semaines avant son dépôt28.
Votre intérêt pécuniaire dans cette affaire est trop
grand pour être négligé, et votre honneur est également
quelque peu en jeu.".
Les informations de Hubbard n’étaient pas tout à
fait exactes. Ce que le jury a réellement fait n'a pas été
de priver Bell d'un prix mais de le mettre au même niveau que ses
rivaux Gray et Edison en décernant à chacun d'eux la plus
haute distinction, une « grande médaille », pour leur
travail téléphonique, qui chez Edison Le cas de Reconnaissait
également son invention du phonographe. Edison fut d'ailleurs fait
Chevalier de la Légion d'Honneur. Bell semble avoir pris la décision
de manière plutôt sportive.
Le 20 octobre, il se trouve de nouveau à l'Hôtel Wagram,
prêt à assister le lendemain à la cérémonie
officielle de remise des prix, après quoi il partira immédiatement
pour Londres puis pour Oxford, où le philologue Max Müller
l'a invité à donner une série de conférences
sur discours, son dernier engagement scientifique avant de partir pour
l'Amérique.
(Bell a dû donner une idée de ses intentions, car dans une
courte lettre datée du 9 octobre, Roosevelt lui a dit poliment
que le jour qu'il fixerait lui conviendrait, et il a ajouté avec
un certain ressentiment : « Mais je dois vous dire que votre
visite, à part le plaisir de vous voir ne nous sera plus d'une
grande valeur maintenant, car le temps est passé et il est trop
tard. Que Gray et Edison aient porté atteinte à votre réputation,
cela ne fait aucun doute, comme je vous l’ai écrit à
plusieurs reprises, et même si vous parvenez à « démolir
efficacement leurs affirmations », le temps est passé.)
Le seul document retrouvé de ce voyage à Paris est une lettre
datée du 20 octobre écrite à Mabel par Adam Scott,
l'un des compagnons de voyage de Bell, et continuée sur la même
feuille de papier par Bell lui-même. Après avoir fait un
reportage en plaisantant sur un dîner chez Roosevelt la veille au
soir, Scott continue avec une nouvelle importante :
"Ce matin (dimanche) Alec a été présenté
au comte du Moncel et l'a complètement converti à ses vues".
Ceci est particulièrement important parce que du Moncel est une
grande autorité ici et s'est laissé induire en erreur par
le parti Gray et Edison. » Il est vexé d'avoir ainsi fait
une injustice à Alec, et arrangera les choses. " La deuxième
édition de son Livre sur le téléphone serait publiée
cette semaine, et Alec était arrivé juste à temps
pour arrêter les épreuves " Du Moncel corrigera les
vues données dans le livre, et j'irais plus loin sans la prudence
de garder les preuves réelles sous silence "
Il a donné à Alec un exemplaire de la première édition
et Alec est en train de la lire, pour prendre connaissance de son contenu,
car les épreuves de la deuxième édition doivent lui
être envoyées ce soir..."
Bell, écrivant après Scott, confirme la bonne nouvelle
et ajoute :
" Mon arrivée ici est des plus heureuses en ce moment.
La Western Union publiera probablement des extraits de l'ouvrage de Du
Moncel " mais quel triomphe ce sera pour ton père de pouvoir
descendre sur la Western Union avec la deuxième édition
!! "
Une lecture comparée des deux premières éditions
de Le téléphone, le microphone et le phonographe de Du Moncel
montre bien le dénouement de cet épisode, en effet très
favorable à la prétention de Bell.
Des changements majeurs apparaissent à deux endroits dans la
deuxième édition : les paragraphes traitant de la question
de priorité entre Gray et Bell dans le point « Un coup d'oeil
historique » qui ouvre l'ouvrage (pp. 7-9, correspondant à
8- 10 dans la première édition), et tout le point «
Part de M. Elisha Gray dans l'invention du téléphone »
(pp. 57-61, correspondant aux 56-60 de la première édition.
Septembre
1878 Letter from Cornelius Roosevelt & Frederic Gower to
Alexander Graham Bell
 Octobre
1878 Lettre de Cornelius Roosevelt à Alexander Graham
Bell, 9 octobre
Octobre
1878 Lettre de Cornelius Roosevelt à Alexander Graham
Bell, 9 octobre 
Bell de son côté se montre visionnaire, voici le texte d'une conférence faite en Angleterre fin 1878 :
| " la nature simple et économique du téléphone rend possible la mise en relation de chaque domicile, bureau ou usine avec un bureau central, de façon à lui donner le bénéfice de communications directes avec ses voisins pour un prix n'excédant pas celui du gaz ou de l'eau on peut concevoir que les câbles des fils téléphoniques pourront être posés, souterrainement ou suspendus en l'air, communiquant par des fils de branchement avec des domiciles privés, maisons de campagne, magasins, usines, les réunissant ainsi par des fils principaux au bureau central où les fils pourront être connectés suivant la demande, établissant ainsi des liaisons directes entre deux lieux quelconques de la ville je crois même que, dans l'avenir, les fils réuniront les bureaux centraux d'une ville à l'autre, et qu'un homme pourra converser d'un bout du pays à l'autre ". |
Après l’exposition universelle
de 1878 Cornélius Roosevelt
et Frederic Allen Gower,
décident de travailler ensemble.
Automne 1878 les deux Américains venus en France pour développer
les interêts de Bell, deviennent associés dans le but d'accélérer
la mise en place de réseaux téléphoniques.
Arrivé vers octobre ou novembre 1878, Gower s'installe d'abord
chez Roosvelt. ils se mirent à la tâche, déposant
4 brevets en quelques mois pour tous les accessoires utiles à une
utilisation commerciale : sonnerie, câbles ...
Gower s'occupa de racheter et développer des ateliers de construction
pour la production d'appareils téléphoniques.
Le 31 octobre 1878, Bell a navigué de Liverpool à Québec, pour ensuite faire face à une longue période de litige en matière de brevets aux États-Unis. Gower, qui a déclaré plus tard dans une interview qu'en France, le brevet de Bell « était malheureusement trop tard pour avoir une valeur juridique ». », continua à travailler sur l'invention de son ami, publia les résultats et déposa de nouveaux brevets auprès de Roosevelt, le dernier le 18 juin 1879. Le 6, le gouvernement français avait lancé un appel à propositions pour établir des réseaux téléphoniques de service public.
Les démonstrations faites par Alexander Bell en Angleterre et les développements commerciaux qui en ont résulté ont montré que le téléphone, bien qu'encore un produit immature essayant de trouver son application, avait un grand potentiel commercial. Pour Bell et ses associés, il était clair qu'après avoir obtenu les brevets américains, leur invention devait également être protégée en Europe.Le premier pays à déposer une demande de brevet fut la Grande-Bretagne, un choix évident pour de nombreux inventeurs américains de l’époque. Pour Bell, c'était très intéressant, car les droits étrangers n'étaient pas inclus dans l'accord d'association et pouvaient constituer pour lui une source de revenus supplémentaires. Pour obtenir son brevet britannique, affaire compliquée et comportant toujours le risque d'une publication préalable, il passe un accord avec les frères canadiens Brown. Cependant, cet effort a échoué et c’est par une voie différente que Bell a obtenu le brevet britannique 4 765 en 1876. Ce brevet ne contrôlait cependant que le récepteur téléphonique, alors que le brevet britannique d’Edison contrôlerait l’émetteur.
Bientôt, Bell s'est organisée pour obtenir des droits de brevet dans d'autres pays européens. Là encore, il a rencontré les mêmes problèmes. Obtenir un brevet en Europe était compliqué car chaque pays avait sa propre loi sur les brevets. En novembre 1877, il écrivit à Hubbard : J'ai déposé des brevets en Italie, en Norvège, en Suède et au Danemark, mais aucun brevet n'est accordé aux Pays-Bas ou en Suisse et si je ne vends pas rapidement ici, l'Europe sera inondée de téléphones bon marché en provenance de Hollande et de Suisse. .
Les brevets scandinaves ont été obtenus grâce au fait qu’un ingénieur civil norvégien nommé Jens Hopstock a, de sa propre initiative, déposé des brevets scandinaves au nom de Bell. Le reconnaissant Bell lui a donné une licence de deux ans . Cependant, le brevet allemand avait été perdu parce que Bell était arrivé trop tard selon les règles de la loi allemande sur les brevets.
Et en effet, la société allemande Siemens & Halske, déjà un fabricant électrique dominant actif dans le domaine de la télégraphie – entre autres moteurs électriques et dynamos –, a rapidement produit des téléphones bon marché. Obtenir un brevet aux Pays-Bas était impossible car le droit des brevets y avait été suspendu en 1869. Et en France, la demande de brevet était menacée parce que la téléphonie menaçait le système télégraphique gouvernemental.
Faire des affaires dans tous ces différents pays s'est avéré encore plus difficile. Les gouvernements ont agi différemment et les partenaires commerciaux locaux potentiels n’ont pas toujours été choisis judicieusement. Et Edison était un adversaire sérieux en Grande-Bretagne en raison de sa position en matière de brevets, et non en raison du succès de son entreprise. Puis, après pas mal de difficultés, Edison et Bell unissent leurs forces et créent la « United Telephone Company Ltd. » (brevet de Bell et Edison) le 13 mai 1880.
Dans l'ensemble, le voyage en Europe aurait pu sensibiliser le public au nouveau phénomène de la téléphonie, mais d'un point de vue commercial, il n'a pas été très réussi. Pour Alexander Bell personnellement, faire des affaires ne faisait pas partie de ses meilleures capacités, comme il le reconnut quelques années plus tard lorsqu'il écrivait : Je ne suis pas un homme d'affaires et je dois admettre que les relations financières me déplaisent et ne correspondent pas du tout à mon métier.
Cependant, d’autres ont désormais compris le potentiel commercial du télégraphe parlant. Pas seulement en Angleterre, mais dans toute l'Europe du Nord.
sommaire
Si quelques effets du microphone ont été découverts
à différentes époques avant M. Hughes, on n'y avait
prêté qu'une médiocre attention, puisque la plupart
n'ont même pas été publiés.
Après les travaux de Hughes, c'est
un autre américain Thomas
Edison, fin 1877 qui va apporter les premières évolutions
nécessaires au téléphone de Bell : le microphone
à charbon et la bobine d'induction
30 juillet 1877 Edison dépose un deuxième brevet qui montre l'utilisation de la bobine d'induction pour amplifier le courant microphonique. Avec les téléphones à pile, le problème est plus complexe, à cause de l'emploi d'une pile qui doit être commune à deux systèmes d'appareils, et de la bobine d'induction qui doit être intercalée dans deux circuits distincts. Dans ce dispositif, la planchette d'acajou porte au milieu une petite étagère C pour y poser les deux téléphones par leur partie plate. La sonnerie S est mise en action par un parleur électromagnétique P qui peut servir, par l'adjonction d'une clef Morse M au système, à l'échange d'une correspondance en langage Morse, si les téléphones faisaient défaut, ou pour l'organisation de ces téléphones eux-mêmes. Au-dessous de ce parleur, est disposé un commutateur à bouchon D pour mettre la ligne en transmission ou en réception, avec ou sans sonnerie, et enfin au-dessous de la planchette étagère C, est disposée, dans une petite boîte fermée E, la bobine d'induction destinée à amplifier les courants voltaïques. Quand le commutateur est placé sur réception, la ligne correspond directement soit au parleur, soit au téléphone récepteur, suivant le trou dans lequel le bouchon est introduit; quand, au contraire, il est placé sur transmission, la ligne correspond au circuit secondaire de la bobine d'induction. Dans ces conditions, la manœuvre ne peut plus être automatique; mais comme ce genre de téléphone ne peut être appliqué avec avantage que pour la télégraphie et que ce sont alors des personnes habituées aux appareils électriques qui en font usage, cette complication ne peut présenter d'inconvénients. 19 décembre 1877 Edison dépose un brevet à Paris no 121 687 pour "des perfectionnements dans les instruments pour contrôler par le son, la transmission des courants électriques et de la reproduction des sons correspondants au lointain" 30 juillet 1877 Edisson dépose un brevet de microphone. Il se compose d'un bouton de poudre de carbone molle comprimée, de la taille d'une pièce de dix pence, placée entre deux disques de laiton, contre l'un desquels appuie un diaphragme de fer. La parole dans l'embouchure fait vibrer le diaphragme et produit des variations de la résistance. 
 (photos de l'original).
(photos de l'original). |
  |
Edison ayant revendiqué la priorité
de la découverte du Microphone, sir
William Thomson; un des plus grands physiciens d'Angleterre, membre
de la Société royale de Londres, trancha le différend
par une lettre dont nous extrayons les passages suivants :
« Au plaisir que le public a éprouvé en prenant connaissance
de ces magnifiques découvertes qui, sous le nom de téléphone,
de microphone et de phonographe, ont tant étonné le monde
savant, est venu se mêler dernièrement, très inutilement,
j'ai besoin de le dire, un des incidents les plus regrettables qui puissent
se produire. Il s'agit d'une réclamation de priorité accompagnée
d'accusation de mauvaise foi, qui a été lancée par
M. Edison contre une personne dont le nom et la réputation sont
depuis longtemps respectés dans l'opinion publique.
« Avant de faire intervenir le public dans une semblable affaire,
M. Edison aurait dû, évidemment, établir sa réclamation
en montrant avec calme la grande similitude qui pouvait exister entre
son téléphone à charbon et le microphone de M. Hughes
qui l'avait suivi. Mais par son attaque violente contre M. Hughes, par
son accusation de piraterie, de plagiat, d'abus de confiance, il a ôté
tout crédit à sa réclamation aux yeux des personnes
compétentes. Rien d'ailleurs n'est moins fondé que ces accusations.
Les magnifiques résultats présentés par M. Hughes,
avec son microphone, ont été décrits par lui même
sous une .forme telle qu'il est impossible de mettre en doute qu'il n'ait
travaillé sur son propre fonds et en dehors de toutes les recherches
de M. Edison qu'il n'avait pas le
plus petit intérêt à s'approprier.
« Il est vrai que le principe physique appliqué par M. Edison
dans son téléphone à charbon, et par M. Hughes dans
son microphone, est le même, mais il est également le même
que celui employé par M. Clérac dans son cylindre à
charbon, qu'il avait donné à M. Hughes et à d'autres,
en 1866, pour des usages pratiques importants, appareil qui, du reste,
dérive entièrement de ce fait signalé, il y a longtemps,
par M. Du Moncel, que l'augmentation de pression entre deux conducteurs
en contact produit une diminution dans leur résistance électrique.
Ce principe du microphone et de la bobine d'induction va se généraliser
et contribera au développement du téléphone dans
le monde entier.
Schéma de la batterie locale et bobine
d'induction pour amplifier le courant microphonique

A termes tous les téléphones du monde
entier seront équipés de la bobine d'induction et du micro
à charbon .
En dehors de Edison et
Navez, nous avons découvert dans la rubrique Le
microphone de Hughes les revendications et les polémiques
que cela engendre , les autres plus importantes réclamations sont
celles de Berliner, Donough,
Dutertre, Wcntwork-Lacelles-Scott, Weyher,
"Microphone" et " transmetteur téléphonique"
La question des téléphones semble maintenant
s'être éclaircie dans ce sens que tout téléphone
d'avenir doit être muni d'un transmetteur spécial.
C'est la question du transmetteur qui est la principale et celle du téléphone,
c'est-à-dire du récepteur, est devenue secondaire. L'on
peut employer presque indifféremment l'un quelconque des divers
systèmes de téléphone, sous condition d'avoir un
bon transmetteur. Telles sont les raisons qui ont, dans ces derniers temps,
amené les inventeurs à se préoccuper, pour ainsi
dire, exclusivement de perfectionner le transmetteur.
Les formes les plus diverses furent données par
la suite, aux microphones à charbon. On peut citer les microphones
de: Crossley (1878), Gower (1878), Ader (1899), Baillehach'e (1880), Locht-Labyc
(1880), Paterson, Boudet, Maiche, d’Arsonval
(1880), d’Argy (1882),Berliner (1887), White (1897), dont le système
est connu sous le nom de solid-back.
| Les premiers dispositifs de M. Dutertre
se rapprochent du microphone de Hughes, et les expériences
auxquelles ils ont donné lieu sont rapportées dans les
journaux de Rouen de février 1878 ; mais à cette date,
M. Hughes avait déjà fait voir les siennes, et d'ailleurs,
jusqu'aux communications de ce dernier savant à la Société
Royale de Londres, on n'avait prêté aucune attention
aux travaux entrepris dans cet ordre d'idées. microphone Berliner n'est à proprement parler qu'un transmetteur téléphonique du genre de celui de Pollard dont la lame vibrante est constituée par une lame de charbon sur laquelle viennent appuyer, du côté opposé à l'embouchure, une ou deux vis métalliques en rapport avec le circuit téléphonique, et qui constituent les pièces fixes du contact. On mentionne dans le brevet que ces pièces peuvent être constituées avec du charbon; de sorte que l'on pourrait admettre que ce serait M. Berliner qui aurait le premier combiné les transmetteurs à charbon. Les brevets de M. Donough et de M. Berliner, sont plutôt des parleurs microphoniques que des microphones basés sur les variations de résistance du circuit téléphonique, suivant l'amplitude des vibrations d'un diaphragme, |
Des microphones à poudre de Lippens, Hughes
et Trouvé que l'on pouvait déjà
trouver dans les catalogues :

Le brevet de microphone Anglais d'Edison, qui est
le plus ancien date, en effet, du 30 juillet 1877, et son brevet
Américain du 15 décembre 1877.
Mais ce qui est surtout curieux dans le brevet de Berliner,
c'est qu'il indique aussi l'emploi des bobines d'induction pour
augmenter l'intensité des sons téléphoniques et qu'il
montre que le récepteur peut n'être autre qu'un appareil
exactement semblable au transmetteur.
Nous ferons toutefois remarquer que cet appareil, comme le précédent,
était un transmetteur microphonique et non un microphone, du moins
dans le sens que M. Huges avait donné à ce mot dans l'origine.
En plus du microphone à charbon , il y eut le microphone à condensateur de Varley, de Pollard de Herz qui n'ont pas étés exploités, le microphone à charbon étant bien plus simple et performant.
Dès l’apparition du téléphone,
Siemens s’intéresse à cette nouvelle technique, il
a alors plus de 63 ans ! Il dépose un premier brevet à Paris
dès le mois de janvier 1878 pour un appareil utilisant la même
technique que celui de Bell.
En 1878 Bourseul dans
son Lot natal, travaille aussi sur le microphone à charbon :
|
1878 : RAPPORT SUR LES TRAVAUX
DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES, Séance du 2 décembre 1878 : OBJET
DE LA SÉANCE : Ce travail se concrétisera en
1879, Bourseul imagine
un microphone à grenaille : "deux charbons de cornue
cylindriques sont enfoncés dans un manchon de caoutchouc
très souple. |
Parallèlement en 1878, Breguet continu ses travaux, que l'on peut lire dans un Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, ou il publia :
| PHYSIQUE APPLIQUÉE. Sur quelques modifications
nouvelles apportées au téléphone.
« J'ai l'honneur de présenter à
l'Académie les intéressants résultats que j'ai
obtenus d'après les indications de MM. Garnier et
Pollard, ingénieur des constructions navales à
Cherbourg.» |
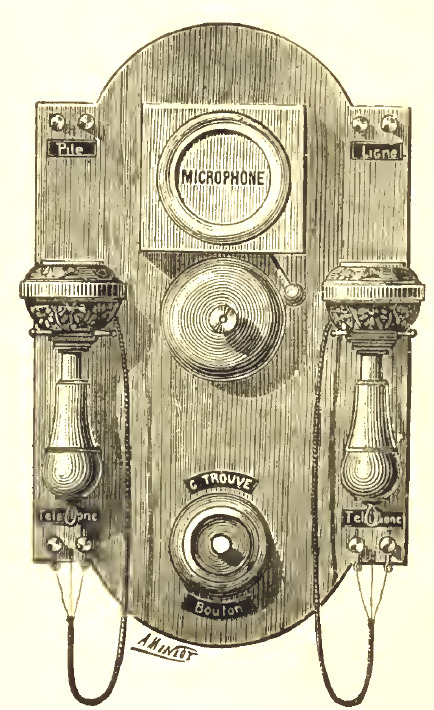 Poste
Trouvé après
1878
Poste
Trouvé après
1878 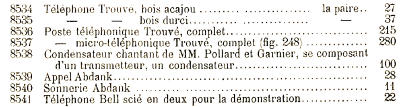 Les prix d'époque.
Les prix d'époque.
1878-1879 Les deux premières années de l'arrivée du téléphone en Frarnce, font l'objet de dépôt de nombreux brevets, en voici un extrait :
|
Nombreux sont ceux qui déposaient des brevets. En Télégraphie et Téléphonie on en dénombrait :
en 1874 : 100
en 1875 : 100
en 1876 : 98
en 1877 : 114
en 1878 : 168
en 1879 : 141
en 1880 : 223
...
En 1881 ce sera le microphone Dolbear à condensateur . brevet US 239 742 A, 5 avril 1881 qui restera sans succès
D'autres améliorations du microphone qui sont les plus anciennes plus ou moins connues seront celles de Ducretet, Bonis, Crossley, Gaiffe, Trouvé, Lippens et de Courtois, Breguet, D'Arsonval, Maiche, Berthon, Mildé, Ochorowicz , Abdank ... et Clémént Ader :
| Clément
Ader, comptera beaucoup pour le développement du téléphone
en France et en Europe. Né le 2 avril 1841 à Muret  il obtint à Toulouse, son baccalauréat à 15 ans. C'est un élève très sérieux, particulièrement doué en mathématiques. En 1857 s'ouvre une nouvelle section dans l'établissement : une école industrielle amenant un diplôme d'ingénieur équivalent aux Arts et Métiers. Ader fait partie de la première promotion, d'où il sortira diplômé en 1861. On pense qu'il prépara les concours d'entrée aux Grandes Écoles, mais soit il ne se présenta pas aux concours, soit il échoua. Ses études terminées, il se mit en quête d'une situation stable. |
Lorsque
la guerre de 1870 éclate et s’il
ne participe pas aux combats, Ader prend contact avec le ministre
de la Guerre afin de mettre ses compétences d’inventeur
au service de la nation, notamment au travers d’un projet de
cerf-volant conçu pour emporter un être humain dans les
airs afin d’observer les positions ennemies. Satisfait d’avoir
obtenu l’autorisation d’utiliser le polygone de Toulouse
pour ses expérimentations, Ader n’a pas le temps de rendre opérationnel son prototype, et le tumulte politique de l’après-conflit coupe court à ses recherches. Après la guerre, il travaille dans une entreprise de céramique (Douarche, à Castelnaudary), où il profite du matériel et du personnel pour perfectionner un planeur de son invention. L’inventeur fait jouer le réseau de son correspondant afin d’obtenir à Paris une salle pour montrer au public son « planeur en plumes », espérant ainsi attirer l’attention d’un investisseur. Malgré ses efforts, l’exposition du planeur en 1874 dans les salons de l’atelier de photographie où Nadar immortalise les personnalités à la mode ne lui apporte aucun soutien financier, et suscite parfois même des sarcasmes. Ader décide néanmoins de rester à Paris – le seul endroit où il peut mettre en œuvre ses projets – et réussit à convaincre son père de venir s’installer avec lui. Il tente alors de publiciser un brevet qu’il a déposé en 1866 pour un « système de chemin de fer, dit rail amovible. Avec l’aide de son père qui se fait cocher intermittent, il construit son prototype et dépose un nouveau brevet, puis promène son attelage à Paris, au jardin des Tuileries ou au parc des Buttes-Chaumont, où il conduit parfois jusqu’à trente enfants. Malgré les recensions enjouées de la presse, il ne trouve toujours pas d’acquéreur pour son invention. |
| Clément Ader peut sembler n’être
qu’un bricoleur de talent, sans réelles préoccupations
scientifiques. En réalité, il s’intéresse
de près aux récentes avancées et communications
de l’Académie et des revues spécialisées
qu’il lit afin de se tenir informé : ses inventions sont
pour la plupart directement liées aux derniers progrès
savants et industriels. Mais au-delà de ces préoccupations
concrètes, il ambitionne lui aussi de participer à l’avancée
de la science, même lorsqu’elle n’est pas en lien
direct avec ses activités techniques. Ainsi, ses carnets (Carnets intitulés « Recherches » : Fonds ADER, doc. 2349) portent la trace de questionnements liés au rayonnement solaire, à l’électricité spatiale, à l’« obscure action du magnétisme sur la gélatine », à l’induction magnétique terrestre, et même à l’éther, dont la preuve de l’existence est alors au cœur du débat scientifique international, puisque les expériences d’Abraham Michelson et Edward Morley interrogeant la réalité de la notion (jusqu’à ce qu’Albert Einstein, expert au bureau des Brevets à Berne, publie en 1905 un article remettant en cause l’idée d’éther et de temps absolu). Dans les années 1880, Ader ne possède pas de formation scientifique suffisante pour résoudre définitivement la question, bien qu’il s’y essaie, comme en témoignent plusieurs pages de calculs et croquis dans ses carnets. La communauté savante lui reconnaît certains mérites : deux de ses mémoires sont présentés et lus à l’Académie des sciences Ader a ainsi conservé plusieurs cartes de visite obtenues auprès de scientifiques plus ou moins influents (comme Jules Janssen, académicien et directeur de l’Observatoire de Paris, ou Gabriel Lippmann, maître de conférences à la Faculté des sciences), griffonnées de quelques notes de circonstances sur l’intérêt de leur rencontre. On perçoit ainsi le travail qu’Ader réalisait pour constituer et entretenir ses contacts jusque dans les enceintes de l’Académie. Désormais inventeur-entrepreneur à plein temps, Ader organise son travail autour de sa demeure parisienne, rue de l’Assomption, qui lui sert d’atelier pour la plupart de ses projets. Ses correspondants s’adressent à lui en tant qu’ingénieur, comme le montrent ses échanges épistolaires avec clients et fournisseurs – auprès desquels il possède une réputation, puisque certains d’entre eux connaissent la nature particulière et parfois hors du commun de ses exigences, et l’invitent à ajouter des plans précis à plusieurs de ses commandes. Ader possède ainsi tout un réseau de relations professionnelles dans le milieu des artisans et constructeurs d’instruments. Par ailleurs, il salarie un petit groupe d’ouvriers, relativement fidèle à son service sur le long terme, pour réaliser certains projets. Enfin, il travaille avec le cabinet d’agents de brevets Armengaud jeune, après avoir quitté son ancien agent Émile Barrault – le centralien, visiblement chagriné par la rupture de leur collaboration une fois la réputation d’Ader établie et ses affaires florissantes, l’appelle « mon cher ami » et tente visiblement de le circonvenir par ses flagorneries (Lettre d’Émile Barrault à Clément Ader, 31 décembre 1881) . Le statut et l’activité d’Ader témoignent donc d’un milieu d’inventeurs-entrepreneurs suffisamment vivace pour faire vivre plusieurs agents de brevets sur la place de Paris, et illustrent bien ce moment précis (avant que la grande entreprise n’absorbe ces vocations au siècle suivant) où les avancées conjointes de l’industrie et des savoirs scientifiques rendent possible l’existence d’une profession libérale (parfois abusivement qualifiée d’ingénieur-conseil) qui produit de l’invention en continu en vue de bénéfices le plus souvent industriels, mais parfois aussi militaires ou administratifs. La liste de brevets déposés par Ader et gérés par le bureau Armengaud jeune est impressionnante, et s’enrichit de plus d’une centaine de dépôts et additions de modifications en l’espace de quelques années seulement. C’est par ailleurs au cours des années 1880-1890 qu’Ader se consacre en grande partie à son projet d’avion, l’Éole tout d’abord puis l’Avion II et l’Avion III. Les archives contiennent l’intégralité de son échange de lettres, souvent estampillées « Secret défense » ou « Confidentiel », avec le ministère de la Guerre, suite aux contrats qu’il signe avec l’État en 1892 et 1894 et aux difficultés d’exécution qui s’ensuivent. Cette histoire a été amplement documentée et nous en apprend peu sur le statut d’entrepreneur d’invention à la fin du siècle : nous nous permettons donc de renvoyer à la bibliographie en ce qui concerne les échecs d’Ader en matière aéronautique. La dernière partie de l’activité inventive d’Ader s’organise autour de la télégraphie et de la télégraphie sans fil, puisqu’il participe à la mise en place de communications longue distance, Le dernier succès d’Ader concerne la propulsion automobile, à laquelle il consacre ses recherches dès lors que l’engouement pour ce moyen de transport se généralise, ce qui lui permet de réinvestir certains résultats de travaux effectués pour les moteurs de ses avions. Il dépose plusieurs brevets, et signe initialement un nouveau contrat avec la Société générale des téléphones devenue Société industrielle des téléphones, avant que ses moteurs ne soient repris par une société anglaise, qui commercialise les voitures Ader – dont plusieurs modèles de course qui obtiendront des prix, l’ingénieur s’étant toujours passionné pour la vitesse. |
Revenons au téléphone et abordons le
sujet qui peut déranger certaines personnes :
Ader poursuit un but: se consacrer à la construction d'un appareil
volant. Il en possède les données, il a une confiance absolue
dans la réussite, (depuis 1871...) mais il sait aussi que la réalisation
de ses machines exigera des moyens financiers considérables. Il
va les demander à une invention susceptible de les lui procurer
en lui apportant une fortune.
Là aussi il a vu juste. Il s'agit du téléphone
. Nous sommes quelques mois avant l'Exposition de 1878 , Ader reçoit
la visite d'un savant de ses amis, Du Moncel,
et, comme la conversation se porte sur la chronique d'une revue américaine
qui parle vaguement d'une nouvelle invention, le téléphone
de Graham Bell, il est amené à faire part au visiteur
de ses propres travaux sur le même sujet.
Ader qui n'avait jamais rien écrit sur le téléphone
commence un récit en 1921, alors qu'il avait 80 ans et que les
faits qu'il relate datait de plus de 40 ans...
Ader évoque son intérêt pour la téléphonie
: J’étais un ami de Du Moncel
; un jour, c’était quelques années avant l’exposition
de 1878, il me montra un article d’une revue américaine où
on parlait vaguement pour la première fois de téléphone.
En même temps, il m’apportait un de ces livres: Exposé
de l’électricité. Tome III, Hachette 1856.
ouvert à la page 110 – Transmission électrique de la
parole – Pour votre édification, il est indispensable que
vous lisiez cet ouvrage dans l’intérêt de l’honneur
français. Vous voyez, me dit-il, on y pensait avant vous et avant
les américains.
Selon les textes, la rencontre avec Du Moncel date "de quelques mois"
ou "des quelques années" avant l'exposition de 1878,
mais comme Ader dit : "Le récepteur ne ressemblait en rien
à celui que Bell venait d'imaginer", on peux supposer raisonnablement
que le téléphone avait déjà été
inventé et que Du Moncel, avec la curiosité scientifique
qu'il avait, en connaissait le fonctionnement... Il est peu probable que
Du Moncel ait seulement montré à Ader son vieux livre alors
qu'il en écrivait un nouveau, très documenté, dont
la deuxième édition fut publié en novembre 1878.
Dans les papiers d'Ader, après sa mort un dossier que nous devons
à M. Georges de Manthé (gendre d'Ader) dans son livre "Le
père de l'aviation"., on y trouve : un chapitre "Commencement
de mon futur ouvrage sur les origines du téléphone"
ou Ader, écrit
"... Au milieu d'une planchette j'avais enfoncé une pointe
qui venait s'appuyer contre une deuxième semblable plantée
sur un bout de buis, le tout formant pupitre avec les deux pointes reliées
à un circuit.
"Le récepteur ne ressemblait en rien à celui que Bell
venait d'imaginer (nous serions donc après 1876), ni comme principe,
ni comme forme. Il se composait simplement d'une autre plaquette de cinq
à six centimètres de longueur, dans laquelle j'avais plaqué
un fil de fer doux de un millimètre de diamètre et de quarante
environ de longueur qui prenait dans l'intérieur d'une petite bobine
dont il formait le noyau et qui, de l'autre bout, était soudé
à une petite masse de cuivre (le hasard avait voulu que ce fut
un bouton de porte ... première pièce venue).
"Transmetteur et récepteur avec une pile Leclanché
étaient dans le même circuit.
"Mon père, installé dans une chambre, m'aidait et parlait
sur le transmetteur avec une inlassable patience. Le récepteur
à l'oreille, j'écoutais ... C'était un bruit de vibrations
informes accompagnées de crépitements que les interruptions
de contact des pointes produisaient. Cela dura quelques jours et même
quelques semaines.
"J'accusais le contact de s'oxyder sous l'étincelle de retour,
mais, après nettoyage, polissage et même platinage, l'effet
n'était pas meilleur.
"J'avais un crayon de charpentier sous ma main. L'idée me
vint de détacher un bout de sa mine et de l'interposer entre les
contacts du transmetteur.
"Aussitôt que l'expérience fut reprise j'entendis clairement
la voix de mon père qui récitait pour la centième
fois le même conte ou la même fable.
"Mes instruments très rudimentaires n'étaient guère
présentables; à peine les fis-je voir à des amis
de la maison ... qui d'ailleurs, eux, n'y comprirent rien.
"Je ne pris aucun brevet, ajournant cette dépense pour
plus tard, lorsque j'aurais perfectionné mes appareils,
et le temps s'écoula.
Cependant ..." Et, comme dans un feuilleton, le manuscrit s'arrête
sur ce mot. Son livre sur "son" invention du téléphone
était terminé....
Et il n'avait pris aucun brevet, dommage !
Ses carnets portent la trace des très nombreuses expériences
qu’il réalise et qui aboutissent en 1878 au dépôt
d’un nouveau brevet pour un procédé téléphonique
de son invention.
|
Les expériences de C. Ader en 1878
: Téléphones sans diaphragme et sans aimant Puis Ader construit un téléphone sans diaphragme, sans aimant et sans bobine.
sommaire En face de ces armatures sont placés six petits électro-aimants microscopiques, chacun d'eux pouvant être réglé séparément à l'aide d'une vis. C'est M. Marcel Deprez qui a employé, le premier, ces petits électro-aimants dans ses enregistreurs pour éviter l'inertie magnétique des électro-aimants plus gros, inertie qui produit un retard dans l'aimantation et par suite dans l'inscription des phénomènes. Les six petits électro-aimants sont tous disposés en tension et agissent simultanément sur leurs armatures dans le même sens avec une très grande rapidité. Avec ce récepteur, la parole peut être entendue à 5 ou 6 mètres de distance en employant le transmetteur que nous avons décrit, mais le réglage en est fort difficile, car la membrane est trop sensible à la chaleur et à l'humidité.  brevet N°127 180, du 28 octobre
1878 "Récepteur électrophone parlant
à haute voix"
brevet N°127 180, du 28 octobre
1878 "Récepteur électrophone parlant
à haute voix" Nous gardons le souvenir d'une conférence dans laquelle l'appareil, parfaitement réglé quelques heures auparavant, a complètement refusé de se faire entendre devant un public aussi attentif que bienveillant, comme doit le faire tout instrument bien élevé dans une expérience publique. Aujourd'hui (1881) M. Ader emploie de préférence son téléphone à surexcitation magnétique (p. 247) comme récepteur, les résultats sont presque aussi puissants et beaucoup plus sûrs qu'avec l'électrophone. |
Depuis les expériences de M. Ader, M. Boudet de Paris a construit un téléphone récepteur analogue dans lequel la planchette de bois est remplacée par un diaphragme d'acier. Cet appareil reproduit la parole avec le parleur microphonique du même auteur en employant un seul élément Leclanché.
Le
développement du téléphone et sa commercialisation
peut commencer :
Jusqu'au tout début des années 1880, le modèle dominant
: celui de la télégraphie, ne permit pas aux innovateurs
de penser en d'autres termes.
Le télégraphe et ses usages étaient ancrés
dans un système simple et transparent. Les messages écrits
étaient portés dans les bureaux ouverts, publics. On ne
pouvait se défaire tout de suite de l'idée que c'était
là le seul mode pratique de télécommunications.
Alors qu'en Allemagne, Von Stephan utilisa d'emblée le téléphone
comme un simple auxiliaire du télégraphe, y compris aux
Etats-Unis, l'idée de réseau organisé n'a pas été
envisagée immédiatement. Ce ne sera pas le cas en France.
sommaire
Voici raconté dans les grandes lignes les moments les plus importants,
mais il faut aussi raconter la petite histoire de ceux qui ont poussés
au développement du téléphone en France :
A Cherbourg en janvier deux ingénieurs en
construction navale avaient mis au point un téléphone selon
le principe d'Edison. Les essais ont étés fait à
la préfecture maritime .
D'autres expériences ont lieu comme à Nantes, à
Clermont Ferrand, à Lyon à La Chapelle St
Mesmin c'était l'abbé Godefroy qui avait équipé
son séminaire de 4 postes .... , la plupart par des bricoleurs
en quête d'amélioration des appareils. C'était empirique,
chacun dans l'espoir de déposer un brevet et permettre de développer
un commerce.
Des particuliers ou des services furent les premiers à s'équiper
de téléphones (reliés point à point) pour
un usage privé sans pouvoir communiquer avec l'extérieur.
Cependant il devint possible de louer une ligne télégraphique
pour relier deux appareils téléphoniques
Le Figaro déjà pourvu d'un réseau à tubes
acoustiques pour communiquer en interne s'équipa en 1879 du téléphone
pour communiquer à l'extérieur.
De même certains journaux Le temps, Le Moniteur ... s'équipèrent
de réseau similaires.
Dans l'industrie les installations sont nombreuses. Antoine
Bréguet va beaucoup contribuer à faire connaître
le téléphone en France.
Il fait des démonstrations à l'Institut, à la Société
des Ingénieurs Civils et installe dans ses ateliers le téléphone
Bell afin que tout le monde puisse l'essayer : " beaucoup de hauts
personnages, de magistrats, de littérateurs, de généraux,
furent reçus par Monsieur Bréguet. Ils s'en allaient satisfaits
et émerveillés " (le Téléphone expliqué
à tout le monde, Giffard, 1878).
Voici à ce propos ce que nous lisons dans L’écho
du Nord rendant compte d'expériences téléphoniques
faites dans les mines de Ferfay le 5 mars 1878 :
« Il s'agissait principalement d'étudier l'emploi possible
des téléphones dans les charbonnages.
L'essai a pleinement réussi. Les interlocuteurs placés les
uns au haut, les autres au fond d'un puits, ont pu correspondre aisément
à une distance de 350 mètres ; un air de musique a été
joué et aucune note n'a échappé aux oreilles qui
devaient le recueillir.
Toutefois on a constaté qu'on entendait beaucoup mieux sur le sol
que en sous le sol.
La cause de cette déperdition du son est expliquée par la
submersion du câble qui, dans les mines, reçoit perpétuellement
l'eau des cuvelages. »
Enfin, à la suite d'expériences faites le 31 mars
dernier, la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée
(PLM) décidait l'installation d'appareils téléphoniques
dans toutes les gares importantes de son réseau.
En Fevrier 1878 on pouvait lire dans le "Journal
Télégraphique"
| Note de M. L. DE CHAMPVALLIER. (Extrait dei Comptes-rendus
de l'Académie dei seteneet de Farii, T. LXXXVI, N° 5).
L'hôtel de l'Ecole de l'artillerie, à
Clermont, est relié au village de la Fontaine-du-Berger
(champ de tir) par un fil télégraphique de 14 kilomètres;
ce fil passe par le bureau central télégraphique de
Clermont sans entrer dans l'intérieur de ce bureau Toutes nos expériences sont faites avec un seul fil, avec communication à la terre aux deux extrémités de la ligne. |
|
ÉLECTRICITÉ. – Sur le téléphone. Note de M. IZARN. « J'ai installé, depuis quelques semaines,
au lycée de Clermont, un téléphone dans
un fil unique d'une cinquantaine de mètres, qui, traversant
la grande cour du lycée, va du laboratoire de Physique, où
il s'accroche à un bec de gaz, à une pièce
placée près de la loge du concierge, où il
s4accroche à un autre bec de gaz. Quoi qu'il en soit, l'Administration des télégraphes aurait intérêt à établir ses prises de terre à une distance aussi grande que possible des tuyaux de gaz, pour ne pas être exposée à voir ses correspondances saisies au passage, dans certains cas, par tout particulier ayant le gaz à sa disposition. » |
Ces expériences se font par dizaine dans tout le pays, tout le monde veut éxpérimenter ce nouvel instrument merveilleux capables de transporter la voix.
| Application du téléphone
à bord du croiseur le Desaix. Note de M. TREVE.
Dans une de ses dernières sorties, le Desaix
avait à la remorque un vieux navire, l'Argonaute servant,
dans l'escadre d'évolution, au tir des torpilles d'exercice. |
sommaire
Même après un an et
demi après l'invention, il n'y a guerre que la presse scientifique
qui relate ces événements, il n'y a pas encore de débouché
pour cet instrument qui ne sert que pour converser de point
à point entre de rares utilisateurs.
L'un des premiers réseau en France : Retournons en Normandie, la ou la première liaison a été établie en décembre 1877.
| En juillet
1878, M. Dutertre installe un fil téléphonique
entre sa demeure particulière et la mairie de la petite commune
de La Vaupalière dont il est le maire. Puis peu à peu, il ajoute de nouveaux fils: il relie le garde champêtre distant de 1600 mètres, le receveur des contributions, distant de 2000 mètres. Et en mai 1879, il fait la demande officielle pour un réseau avec 6 stations : j'ai l'intention de faire construire un réseau complet de lignes aériennes qui relieraient à la Mairie la recette des contributions indirectes, dont le receveur est un conseiller municipal et le domicile du garde-champêtre. Les mêmes poteaux serviraient à supporter des fils spéciaux mettant en communication la Mairie avec le presbytère et la maison de l'adjoint au maire plus le prolongement de la ligne vers ma demeure particulière. Les avantages généraux de cette installation seraient de relier les extrémités de la commune avec la Mairie d'où seraient expédiés des ordres, il serait facile d'obtenir promptement les secours des sapeurs pompiers ou de la gendarmerie. En mai 1880 M. Dutertre obtient du Ministre, avec avis favorable du préfet, l'autorisation de relier son réseau à Maromme, le chef lieu de canton situé à 4 km de La Vaupalière. Voici la description du réseau : "l'appareil choisi est celui de Gower (système de Bell perfectionné). Des études comparatives ont fait reconnaître que le système Bell est encore celui qui a la supériorité pour transmettre les caractères distinctifs de la voix M. Dutertre a ajouté un ingénieux petit système avertisseur, pour qu'il fût possible de savoir sans retard si quelqu'un se trouvait à l'appareil sollicité pour répondre immédiatement. Le fil est supporté à l'aide d'isolateurs mobiles dits à queue. La portion du fil susceptible d'être en contact avec le support est entourée d'un morceau de caoutchouc vulcanisé. Dans une grande étendue du parcours, les supports-isolateurs sont piqués aux arbres de la forêt le long de la route qui conduit à La Vaupalière. Une fois en haut de la côte, les isolateurs sont apposés contre les maisons; puis, sur un espace d'environ deux kilomètres, ils sont attachés à des poteaux placés de 90 mètres en 90 mètres. En face de la mairie, un certain nombre de fils devant provenir de différentes directions et attendant une destination sont réunis dans un tuyau, traversent le chemin sous terre et arrivent au système receveur. Pendant ce cours trajet les fils sont chacun revêtus d'une couche de gutta-percha ; cet enduit a pour but d'isoler les courants. Là, chaque fil est mis en rapport avec un commutateur suisse. Par le moyen de cet appareil, on établit la communication avec le point téléphonique avec lequel on doit correspondre.
Les essais sont tout à fait concluants et
certifiés par le docteur Laurent, membre de la Société
Industrielle de Rouen, qui rapporte: j'ai entendu distinctement
les paroles et les phrases émises par les personnes qui ont
communiqué avec moi par le téléphone administratif
de M. Dutertre.
En novembre 1880, M. Dutertre présente à ses collègues de la Société Industrielle, un projet de "téléphonie administrative dans les communes rurales et de son application au service public". II montre tout d'abord la supériorité du téléphone sur le télégraphe : "pour un service télégraphique il faut un employé spécial, un employé initié aux difficultés de la marche de l'appareil télégraphique. Avec l'appareil téléphonique, point de complications semblables. Tout le monde est apte à parler dans un cornet téléphonique, à mettre le cornet à l'oreille, à écouter. Il suffit d'une explication fort simple, d'une démonstration élémentaire pour permettre à même une personne dont l'instruction est très restreinte, pour ne pas dire nulle, de correspondre par le téléphone. ".
M. Dutertre insiste ensuite sur les profits que chaque commune rurale doit retirer du téléphone : "je mentionnerai tout d'abord les communications qui doivent avoir lieu dans la commune. Quand il est nécessaire de recourir au garde champêtre, il faut avoir sous la main quelqu'un à envoyer chez ce fonctionnaire, il faut écrire l'ordre à transmettre, remarquez la vitesse d'exécution avec l'emploi du téléphone. Une communication verbale est rapidement faite et allège le fardeau bureaucratique. Actuellement, il faut de trois à cinq jours pour les communications de commune à commune.
Les intérêts agricoles eux mêmes ont une part considérable à attendre du téléphone administratif. Les dépêches astronomiques, le cours des denrées, certains conseils urgents, etc... pourront être propagés dans un bref délai parmi les habitants. Il n'est pas jusqu'à l'administration militaire pour le recrutement; lors d'une levée d'hommes, en cas de guerre, et même la stratégie qui n'aient à profiler largement de l’installation en question.
En cas d'incendie, on ne saurait encore contester qu'il soit du devoir de l'autorité municipale de recourir le plus promptement possible, à tous les moyens, pour faire appel aux personnes capables de porter secours. II en sera de même s'il arrive un accident.
Un aune point essentiel que je ne puis passer sous silence, c'est l'assistance médicale dans les campagnes. Vous remarquerez que notre petite commune, comme bien d'autres, est trop petite pour posséder un médecin et un pharmacien. Les habitants sont obligés, pour se faire soigner, de s’adresser à un praticien domicilié à une distance plus ou moins gronde ; le médecin n'est pas chez lui, est en tournée, quelquefois dans une commune avoisinant La Vaupalière ; il retourne fort tard à son domicile où il trouve l'adresse du malade de La Vaupalière. Le médecin, harassé de fatigue renverra au lendemain matin la visite à faire. Avec l'installation d'un appareil téléphonique quelle différence ! Un appareil serait placé chez le médecin cantonal chargé de la médecine chez les indigents et le médecin le plus voisin de la commune. Le médecin pourrait être prévenu par le téléphone, chez lui et dans les communes où il est en tournée, Il pourrait en passant à chaque station téléphonique, s'informer s'il est demandé. On peut dire de même pour ce qui concerne le pharmacien et l'obtention de médicaments urgents.
Ainsi encore, au moment des élections, pour les renseignements nombreux que les autorités réclament ,cette installation sera on ne peut plus utile.
M. Dutertre propose ensuite la formation d’un
réseau plus complet qui relierait 13 communes du canton de
Maromme.
Enfin, pour rentabiliser le réseau, M. Dutertre propose que le téléphone administratif soit autorisé à servir les particuliers pour les communications privées Cela créerait une source de revenus qui pourrait être employée : premièrement à la défalcation des premières dépenses d'installation , deuxièmement à la satisfaction des frais d'entretien , troisièmement à la rémunération des employés ou des personnes employées à la manipulation et au soin des appareils.
Est-il nécessaire de préciser que ce projet fut présenté au Conseil Général et au préfet, qu'il fut jugé intéressant mais que, personne n'y donna suite mis à part une demande d'enquête du Ministre en juin 1881 qui écrivait alors : 'j'ai tout lieu de craindre aujourd'hui que la ligne ne serve à tout autre chose qu'à l'usage auquel elle était primitivement destinée." Heureusement pour M.Dutertre, une discrète vérification des gendarmes permet au préfet de répondre : "le fil ne sert que dans un intérêt administratif et général".
Malgré le support du docteur Laurent, membre de la Société Industrielle de Rouen, qui argumenta sur la supériorité d’un réseau téléphonique entre communes rurales par rapport au télégraphe, Louis Dutertre qui avait construit et entretenu ce réseau à ses propres frais dans le souci de l’intérêt administratif et général dut se résoudre à en arrêter les améliorations en l’absence de certitudes durables de la part des autorités. |
| De la Téléphonie administrative
dans les communes rurales et de son application au service public.
septembre 1881 RAPPORT sur l'installation faite par M. Dutertre, maire de La Vaupalière, membre de la Société industrielle, etc PAR M. le D'' LAURENT. SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 1881. ( que vous trouverez à cette adresse https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1225841/) MESSIEURS, Dès le mois de février qui suivit
la conférence (février 1878), M. Dutertre a installé
un fil entre sa demeure particulière, à La Vaupalière,
et la mairie. Puis, peu à peu, il a ajouté de nouveaux
fils à La Vaupalière même plus tard, en avril
1880, il a relié cette commune avec le chef-lieu du canton. Mes essais ont donc été aussi variés
que possible pour m'éclairer sur les avantages de cette installation. La téléphonie administrative dans
les communes rurales est une innovation. Malheureusement, dans notre
beau pays, tout ce qui est innovation rencontre le plus souvent
des entraves diverses et puissantes. On a à compter avec
la routine, l'ignorance, les préventions, les superstitions,
etc. Aussi, dois-je dire qu'il a fallu la force de conviction et
la méritante persévérance de notre collègue
pour ne pas être rebuté et ne pas renoncer entièrement
à cette entreprise d'utilité publique. Car, il ne
s'agit pas d'une exploitation privée, mais bien d'un réseau
qui a pour but les intérêts de la commune, les intérêts
du canton et les intérêts départementaux. Je
dois ajouter que c'est à ses frais, avec ses propres deniers,
que M. Dutertre a installé et entretient ce service administratif.
Ne sachant pas si la ligne téléphonique serait autorisée
à fonctionner, et si, par conséquent, elle avait l'espoir
d'une existence plus ou moins durable, notre collègue a cru
devoir s'arrêter dans la voie des améliorations. Cette
ligne marche aujourd'hui telle qu'elle a été disposée
tout d'abord. A La Vaupalière, sous la main du secrétaire
de la mairie, dans la maison commune, est placé un appareil
téléphonique. A chaque point avec lequel a lieu la
communication existe un autre appareil téléphonique. Messieurs, notre collègue, M. Dutertre, en
établissant le téléphone administratif de La
Vaupalière à Maromme, s'est surtout préoccupé
de servir les intérêts de sa commune et de la région
qu'il habite. Il a étudié la formation d'un réseau
qui comprendrait tout le canton de Maromme. Je croirais sortir du cadre de cet exposé en essayant d'esquisser les ramifications que réclameraient ces divers services dans chaque commune. Après ce que je viens de dire, il suffit de les énoncer pour avoir une idée satisfaisante de leur utilité et de la facilité de leur établissement. Avant de clore ce rapport, permettez-moi de vous
lire un passage emprunté à un livre paru récemment
(1881) sur les télégraphes, par Ternant (Bibliothèque
des Merveilles), page 54. En facilitant les communications entre les communes
d'un même canton, en facilitant les communications entre les
habitants de ces communes, on multiplie les éléments
de progrès, on augmente les moyens de développement
de l'intelligence, et par cela même de développement
du commerce et de l'industrie, on ouvre la véritable voie
de prospérité d'un pays quel qu'il soit, tout en contribuant
aussi à assurer son bien-être. CONCLUSIONS. Le comité d'utilité publique a l'honneur de proposer 1° De solliciter le concours de la Société industrielle en faveur d'un projet qui, d'ailleurs, émane d'un de ses membres; 2° Que MM. les membres de la Société veuillent bien inviter son Bureau à prier M. le Préfet de soumettre à l'approbation de MM. les membres du Conseil général l'achèvement du réseau téléphonique du canton de Maromme. Le fonctionnement de ce réseau servirait de type à l'établissement de réseaux semblables dans les autres cantons de la Seine-Inférieure. |
sommaire
Beaucoup de constructeurs et d'ingénieurs réaliseront de merveilleux sytèmes, des téléphones plus ou moins astucieux, élégants ... pour le bonheur des collectionneurs d'aujourd'hui, retenons les principaux :
Aboillard - Ader - Atea - Bailleux -Berliner - Berthon - Blake - Bourseul - Breguet - Burgunder - Charron-Bellanger - Crossley - D'Arsonval - Delafon - Digeon - Duchatel - Ducousso - Dunyach-Leclerc - Edison- Eurieult - Gallais - Grammont - Jacqueson - La Séquanaise - Maiche - Milde - Morlé-Porché - Morse - Albank - Nee - Ochorowiz - Pasquet - Pernet - Picart-Lebas - Radiguet - Roulez - Rousselle-Tournaire - S.I.T - Tavernier - Vande-Meerssche - Wery -Wich .... (voir la page les téléphones)
En premier on trouve dans le livre "Le téléphone expliqué à tout le monde" de Giffard en février 1878, un bon aperçu des faits, des discours, des croyances .... de l'état de l'art à cette date.
Dans la presse scientifique dès 1878 et 1879 comme dans le premier numéro de "La lumière électrique" de 1879", on trouve la description du dispositif Ducretet , Perrodon, Siemens ... Récits de Th Dumoncel
Modèle Ducretet 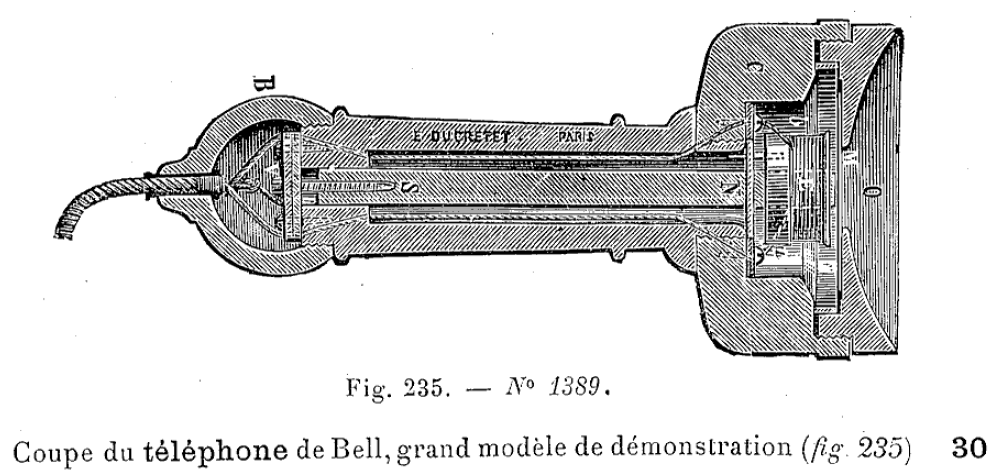 Du catalogue Ducretet, 30 Francs de l'époque.
Du catalogue Ducretet, 30 Francs de l'époque.
  |
 |
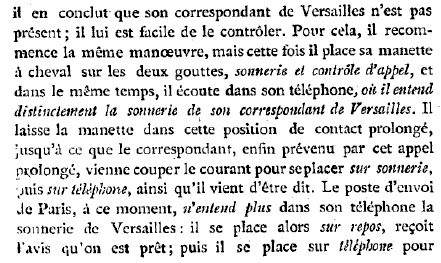 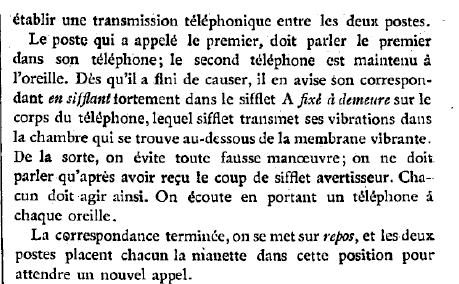  |
 |



 ....
....
...
 ...Cet appareil
sera déployé en Allemagne et ses colonies, aujourd'hui ils
sont rares.
...Cet appareil
sera déployé en Allemagne et ses colonies, aujourd'hui ils
sont rares.
sommaire
Ader continue ses expérimentations et déposa plusieurs
brevet dont :
Brevet du 02 décembre 1879 US222118
MAGNET-TELEPHONES.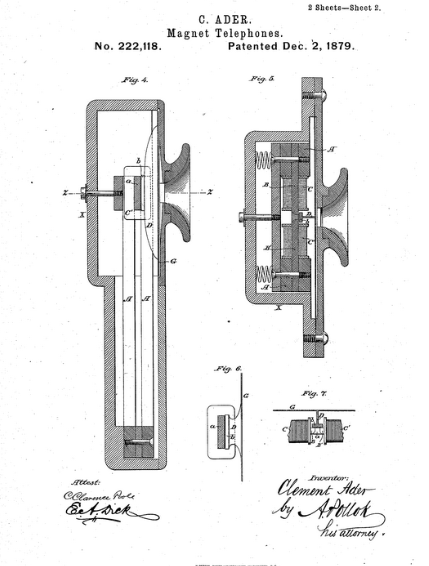
Brevet du 27 février 1879 Récepteur
téléphonique à vibration moléculaire électro-magnétique,
vue dans le Scientific American Supplément 178

Récepteur téléphonique à vibrations moléculaires
électromagnétiques de Ader :
Principe de 1878  et
et  au Musée de Muret
au Musée de Muret
Cornelius Roosevelt et Frederic
Gower, deux représentants d’Alexander
Graham Bell à Paris, vont avoir connaissance du brevet
Electrophone d’Ader et proposer à l’inventeur de s’associer
avec eux dès 1879 .
Brevet du 26 juillet 1879 n° 131974, Système
de téléphone à pôles magnétiques concentrés
Avec Gower Ader collabore et invente
un dispositif de signal d'appel pour bureau central de la Compagnie des
téléphones Gower.
Brevet du 30 septembre 1879 n° 132944, Système d'avertisseur
téléphonique sans pile, à signal visible, l'exploitation
fugace de cet appareil fonctionnait assez mal dans le central téléphonique
Gower,


Et aussi un Système d'étude expérimental de Ader
sensé démontrer l'existence de la "surexcitation",
il est composé d'un aimant, d'une plaque de tôle retenue
par deux clous et en avant, d'une pièce de fer qui doit être
le "surexcitateur"

 vu au Musée de Muret
vu au Musée de Muret
Par la suite, son récepteur à gros anneaux remplacera les
téléphones Trouvé (de type Bell) et équiperont
les transmetteurs Crossley déjà installés
sur les premiers réseaux de Province de Gower.
| Brevet du 28 févier
1880 n° 135667, Système de postes téléphoniques
et appareils employés à cet effet.133337 Brevet du 24 octobre 1879- Téléphone récepteur à pôles magnétiques surexcités. 30 mai 1882- Addition. 19 avril 1883- Addition. 9 mai 1883- Addition. 13 septembre 1883- Addition. 27 février 1884- Addition. 12 mai 1884- Addition. 21 avril 1885- Addition  En fait on a reconnu que l'utilité de cet anneau était mal démontrée par l'expérience : |
 |
Sur ses controverses, le "surexcitateur" d'Ader d'une efficacité douteuse, mais fortement "médiatisé", serait une invention politique ?
Ader reçu le prix de physique assorti d'une
somme de 3000 fr par l'Académie des sciences.
Puis il mettra au point le premier téléphone mobile , micro
fixe à charbon, pour mettre sur une table ou un bureau 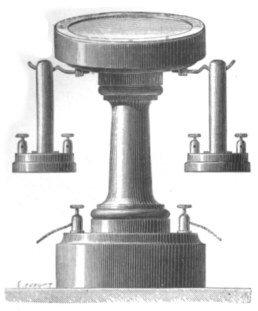
Brevet du 20 avril 1880 US226584
"Visible Signal for Telephones" 
Le téléphone de Bell a été conservé
comme récepteur. Il ne faut pas, en effet, se laisser tromper par
l'apparence.
Dans le récepteur Ader comme dans le récepteur Gower, on
fait usage d'un barreau aimanté d'une plaque vibrante en tôle
de fer et d'une bobine d'induction. Seulement, dans le récepteur
Ader, le barreau aimanté est replié en arc de cercle, pour
que les deux pôles de l'aimant agissent sur la membrane vibrante.
Mais, qu'il soit droit ou circulaire, c'est toujours le barreau aimanté
du récepteur M. Graham Bell.
ADER s'attacha tellement à sa première découverte
que, la perfectionnant sans cesse, il ne prit pas moins de cinquante brevets
successifs entre 1878 et 1884.
Nous le relirons un peu plus tard que Ader écrivit à M.
Chaumet, sous-secrétaire aux postes, pour l'informer qu'il était
disposé à donner à l'État la marque des récepteurs-Ader
"dont il pourrait exclusivement se servir". La réponse
vint à quelque temps après sous la sous forme d'un avertissement
de l'administration des P.T.T. lui réclamant le paiement de sa
ligne téléphonique personnelle. Ader, inventeur des
appareils téléphoniques français, répondit
qu'il ne paierait pas, laissa couper sa ligne et jamais plus de sa vie
n'eut de téléphone à son domicile.
A cette Période dans la presse
locale on peut découvrir à cette même période
l'invention de Edison le PHONOGRAPHE
Dans La
Semaine du Clergé
du 10 Octobre 1877 figure le premier article relatif à
l'invention du phonographe, signé Le Blanc.
Sous le pseudonyme de ce chroniqueur scientifique se cache l'abbé
Lenoir, un ami de Charles Cros.
Pour la première fois, le mot phonographe est employé pour
désigner l'invention décrite quelques mois plus tôt
par le poète dans son pli cacheté adressé le 18 avril
1877 à l 'Académie des Sciences.
Ouvrons une parenthèse sur le phonographe d'Edison
:
la même année que Charles Cros, le 17 juillet 1877, Thomas
A Edison décrit un appareil qui enregistre un message télégraphique
sur du papier qui ensuite pouvait être envoyé de nouveau
par télégraphie. Il en conclut qu'un message téléphonique
peut être enregistré de la même manière.
On a là l'exemple d' une fécondation croisée de deux
techniques, celle du télégraphe et du téléphone.
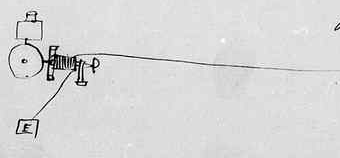 (clic surimage pour voir le document origine).
(clic surimage pour voir le document origine).
Le matin suivant, il se rend compte qu'il n'enregistre pas seulement un
message mais un son.
18.- Juillet 1877 - Esquisse d'un " appareil parlant " 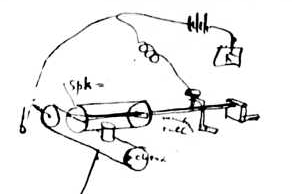
Une fois esquissé, il fera réalisé le prototype par
son assistant John Kruesi du 4 au 6 décembre 1877. Thomas A Edison
teste alors la nouvelle machine en chantant "Mary had a little lamb."
A sa grande surprise, la " machine parlante " répèta
la chanson.
Il en fit ensuite la démonstration dans les bureaux du Scientific
American à New York City qui relate l'évènement dans
son édition du 22 décembre 1877. Auparavant, Thomas A Edison
avait déposé sa demande de brevet le 19 décembre
1877 pour son "phonographe".
Le brevet fut accepté le 17 fèvrier 1878 et décrivait
un appareil très simple.

 Archives Edison "
The Edison papers "
Archives Edison "
The Edison papers "
Antoine Bréguet,
dans la Revue des deux mondes de juillet-août 1878 sur «
La Transmission de la parole : le phonographe, le microphone, l’aérophone
», insiste sur l’aptitude du Nouveau Monde à concevoir
mais surtout mettre en œuvre les avancées du progrès
technique.
" Aux Etats-Unis, tout devient franchement commerce…
Thomas Edison est peut-être l’exemple le plus frappant de notre
époque d’un physicien prodigieusement fécond qui n’est
jamais tenté de recherches abstraites…
Nous avions annoncé, il y a déjà plus de six mois,
qu’un appareil capable d’enregistrer les sons de la voix humaine
était sur le point de faire son apparition. Cette prophétie,
alors presque téméraire, s’est réalisée
aujourd’hui. Plusieurs esprits distingués s’occupaient
à la fois de trouver une solution de ce séduisant problème.
C’est à l’Amérique que revient la gloire d’avoir
présenté le premier phonographe, le seul encore pour le
moment. Il est difficile de concevoir un appareil plus simple que celui
d’Edison."
A propos de ces deux inventions le Téléphone et le
Phonographe il y a un beau récit d'un journaliste Maurice
Dreyfous à Paris, en 1913
| " Ce
qu'il me reste à dire : un demi siècle de choses vues
et entendues (1848-1900)" : ... J'étais installé rue de la Bourse depuis fort peu de temps, lorsque je reçus la visite d'un jeune journaliste prodigieusement débrouillard, qui était accompagné d'un Américain à grosses lunettes d'or, parlant fort mal le français, lequel avait nom Roosevelt. Tous deux m'invitèrent à venir voir, dans une boutique située juste en face de chez moi, un instrument bizarre, que Roosevelt désignait sous le nom de plume électrique. (Il prononçait « le ploume électric ».) C'était la plus stupide de toutes les inventions. Elle consistait en une sorte de petite batterie électrique actionnant une aiguille, prise dans un tube. On écrivait en tenant le tube comme un porte-plume. L'aiguille toujours en mouvement piquait d'une série de petits trous un papier sur lequel, on étendait, au moyen d'un. rouleau de l'encre d'imprimerie. Grâce à ce dispositif, on pouvait faire un nombre indéfini de copies. C'est cet objet inepte que le groupe d'Américains installé rue de la Bourse considérait comme des plus extraordinaires et destiné à les enrichir. Ce groupe d'Américains comportait trois personnages principaux : Roosevelt déjà nommé, Graham Bell, que les autres avaient l'air de considérer comme un personnage de médiocre importance, et enfin, un homme actif, insinuant, toujours en vedette, aimable, empressé, qui n'était ni grand ni petit, plutôt gras que maigre. Alors que les autres jargonnaient à peine le français, il le parlait à peu près bien, mais avec un accent difficile à définir, ni anglais, ni allemand, ni français non plus. Il parlait pour eux tous, il était le metteur en œuvre de toute l'aventure.. Il n'avait pas le sol, et il eût été très difficile de lui assigner une profession définie. Il se targuait vaguement du titre de docteur en médecine, mais il ne se parait jamais de ce titre dans ses relations qui, alors, n'étaient pas très étendues. Il se contentait de s'appeler, avec une aimable simplicité, Cornélius Herz. A côté de la plume électrique, il y avait trois inventions : 1 - Une lampe électrique au charbon dont l'un des charbons était en forme de tige comme celui des appareils de démonstration, en usage dans les laboratoires d'étude, tandis que l'autre, là résidait la nouveauté était en forme de pion de damier. Un mouvement d'horlogerie l'animait d'un va-et-vient et la largeur de la surface productrice d'étincelles multipliait les ressources d'incandescence. Nos inventeurs comptaient beaucoup sur cette lampe je crois que leurs espoirs ont été déçus. Tout au moins a-t-elle eu l'avantage de servir de guide aux ingénieurs qui ont créé les lampes électriques au charbon encore en usage aujourd'hui. 2 - Il y avait bien aussi, dans la boutique où nos inventeurs exhibaient la plume électrique, un drôle de joujou, une drôle de mécanique. Au moyen d'un cornet, d'une sorte de porte-voix retourné, on envoyait des paroles sur un petit appareil posé sur un cylindre bardé comme un perdreau d'une pâte sur laquelle on collait une feuille d'étain très mince. Tout en parlant dans le cylindre, on tournait une petite manivelle qui faisait reculer le cylindre à mesure qu'on parlait. Puis, cette première manœuvre étant terminée, on actionnait la manivelle dans le sens opposé, et la mécanique répétait, avec une voix de polichinelle essoufflé, ce qu'on venait de dire dans le cornet récepteur. Ces messieurs comptaient sur cette amusante machine pour l'exploiter sur les champs de foire. Ils l'avaient, dès le premier jour, appelée phonographe. 3 - Enfin, dans la même boutique, se trouvait un petit appareil dont ses importateurs voyaient vaguement l'application pratique. Il se composait d'une paire de tubes de bois surmontés d'une rondelle qui leur donnait l'aspect d'une patère de rideaux. Tout un mécanisme spécial s'y trouvait enfermé, les deux appareils étaient reliés entre eux par un fil métallique, recouvert de soie. On mettait l'un d'eux devant sa bouche, et l'autre à l'oreille du voisin, le voisin, alors, entendait ce qui avait été dit dans l'autre tube. C'était encore un joujou. Toutefois ce joujou, présenté à l'Académie des Sciences par l'illustre Bréguet, avait déjà été pris au sérieux dans le monde savant. Lorsque l'Académie des Sciences fut appelée à le voir, il n'en existait que deux exemplaires. C'était le téléphone de Graham Bell. Elle le reçut avec une curiosité froide et défiante. Au sortir de la séance, Graham Bell n'eut rien de mieux à faire que de le replacer dans la boutique de la rue de la Bourse, où il fonctionna pour la joie des voisins. A quelques jours de là, Graham Bell et Cornelius Roosevelt, flanqués de l'inévitable Cornelius Herz, tout joyeux, me racontaient le succès d'une première expérience qu'ils venaient d'exécuter entre une maison de la rue Vivienne, et une maison de la place de la Bourse située à une centaine de mètres de celle-ci. C'est là que fut donné le premier coup de téléphone qui ait retenti en France, et peut-être même en Europe. Cornélius Herz se démena, intrigua jusqu'à ce qu'il eût abordé le ministre compétent, et obtenu de lui l'autorisation de se servir des lignes télégraphiques pour faire un essai de conversation entre Versailles et Paris. L'expérience réussit, on causa entre le palais de Versailles, et le cabinet du Ministre. Le lendemain, l'invention. du téléphone était lancée. Il ne restait plus qu'à la vulgariser pour arriver à l'exploiter. C'était là une grosse affaire. Cornelius Herz s'y employa, avec intelligence et ténacité. Il ne se faisait point faute de chercher, partout où il le pouvait, les gens qui consentiraient à s'abonner au téléphone, même en payant très bon marché. Il n'en trouvait guère. Le phonographe réussit beaucoup plus facilement que le téléphone. Le jeune journaliste qui marchait de pair avec la troupe d'Américains, eut l'idée ingénieuse d'organiser des auditions du phonographe dans une salle du boulevard des Capucines, ordinairement consacrée à des conférences. La première représentation du phonographe est restée pour lui et pour moi quelque chose de mémorable. La stupéfaction des invités, en entendant cette mécanique, qui parlait toute seule, fut bien l'une des impressions les plus bouffonnes que jamais des hommes aient ressenties. Un employé spécial faisait un boniment qu'il commençait chaque fois en ces termes « Monsieur le phonographe, parlez-vous français ? » L'appareil ripostait en nasillant Oui,monsieur. Oui, oh! alors c'est très bien! » Nos auditeurs se tordirent de rire, mais leur gaîté devint délirante lorsqu'on eut placé des chanteurs de l'Opéra devant l'appareil et quand la mécanique proclama, sur l'air de Guillaume Tell, et avec des accents de baryton traduits par Polichinelle A mon pays je dois la vie, Il me devra la liberté Le tout se terminait par un couac et par un bruit de friture spécial et jusqu'alors inconnu. Pendant tout l'hiver, chaque soir, moyennant dix ou vingt sous par personne, le phonographe proclama, devant des salles pleines, qu'il parlait français ; qu'il était très bien et qu'il avait été inventé par Edison. Puis chose assez curieuse pendant bien des années, les représentations de phonographes furent abandonnées aux seuls tenanciers des baraques foraines. Quant au téléphone, il a subi bien des transformations, mais il n'en reste pas moins que l'appareil de Graham Bell, en sa forme primitive ou à peu près, existe encore d'une façon courante dans certains postes téléphoniques. On eut bien vite oublié la quasi indifférence qui l'a accueilli à son début au temps où Roosevelt et ses partners coiffés de leur idée « du ploume électric» ne le présentaient qu'en seconde ligne. Maurice Dreyfous Paris, 1913 |
C'est Tivadar Puskas, Hongrois et collaborateur favori d'Edison, qui inspiré par les commutateurs télégraphiques à barres, conçut le premier l'idée du commutateur téléphonique central, ainsi que l'atteste le témoignage d'Edison, en possession de la famille de Puskâs
Le 5 décembre 1878 Puskas représentant des intérêts de Thomas Edison en Europe, fonde La Société du Téléphone Edison .
C’est la deuxième société de téléphonie en France, Puskas dans une maison de l'avenue de l'Opéra, ouvre le premier central téléphonique parisien.
Sur les téléphones du début, le courant microphonique ne parcourait pas de grandes distances, c'est Edison qui trouva le moyen de solutionner ce handicap en introduisant la bobine d'induction permettant de franchir de grandes distances.
 La bobine
La bobine
 schéma
de connexion entre deux postes avec piles
schéma
de connexion entre deux postes avec pilesLa sonnerie
 Dans
un premier temps les vibrations faites par l'appareil suffisait pour se
manifester comme sur l'appareil Gower ou Siemens,
Dans
un premier temps les vibrations faites par l'appareil suffisait pour se
manifester comme sur l'appareil Gower ou Siemens, En 1878 C'est Watson qui adapta la sonnerie au besoin du téléphone pour appeler le correspondant. Les sonneries d'appel appliquées aux services téléphoniques ont été combinées de diverses manières. Quand on emploie les sonneries trembleuses, il devient nécessaire d'employer une pile, plus tard en 1879 Edison Brevetea la "Magnéto Electric Machine", la fameuse "magnéto" qui équipera beaucoup d'appareils dans le monde.
Relier les abonnés entre eux : en 1878 c'était la prochaine étape a franchir.
| Un récepteur, un transmetteur, une pile, une
bobine, une sonnette, un bouton ou une magnéto et des fils
: nous avons tous les ingrédients pour
pouvoir communiquer d'un point à un autre, et pour communiquer
à travers un réseaux de personnes, il ne manquait plus
qu'un organe central pour mettre en connexion les abonnées.
C'est le début des centraux manuels gérés par des opérateurs. (Voir la rubrique Bell son invention, le premier switchbord de New Haven ... ) Communément appelé RTC, le « Réseau Téléphonique Commuté », est la technologie historique utilisée pour fournir un service de téléphonie fixe. Il est à différencier du réseau physique en cuivre (la boucle locale cuivre) qui est le support physique et qui aboutit le plus souvent à une prise physique dans les locaux des abonnés. La boucle locale cuivre permet la transmission de la téléphonie via le RTC, |
.jpg)
 Ader
Gower
Ader
Gower 
Les commutateurs (switchboard) des premiers bureaux centraux téléphoniques
à PARIS étaient identiques aux commutateurs utilisés
par le télégraphe.
Les lignes étaient unifilaires et reliées à
l'une des barres du commutateur, les barres de l'autre série communiquaient
«chacune avec un appareil».
Un bouchon (bâton de cuivre) établissait la connection entre
les barres métalliques.
C'était la terre qui bouclait le circuit et reliant les
abonnés deux à deux.
En même temps en 1878, M.Bourbouze publiait
le résultat de ses expérimentations : Suppression du fil
de retour dans l'emploi du téléphone.
Note de M. Bourbouze.
J'ai l'honneur de faire connaître à l'Académie
les résultats que j'ai obtenus en appliquant au téléphone
la disposition qui est employée en télégraphie.
Hier, dans l'ancien collège Rollin,
j'ai fait une série d'expériences qui peuvent se résumer
ainsi. Mon collaborateur, M. Barraud, et moi, nous étant placés
aux extrémités du jardin, c'est-à-dire à 70
mètres de distance, nous avons d'abord, pour nous assurer du fonctionnement
du téléphone, correspondu au moyen du double câble;
puis, nous avons supprimé un fil, et nous avons, chacun de notre
côté, fermé le circuit par la terre, au moyen de lames
de cuivre doré d'environ 1 mètre de long et 2 centimètres
de large, enfoncées dans le sol du jardin à 40 o u 50 centimètres
de profondeur. Nous avons pu constater que les sons se produisaient alors
avec bien plus de netteté. Lorsqu'on supprimait la communication
avec la terre, aucun son n'était perceptible.
Guidé par les résultats que j'ai obtenus pour la télégraphie
sans fils, je me propose de répéter ces expériences
dans les conditions où je me suis déjà placé;
j'aurai l'honneur de présenter à l'Académie le résultat
de ces nouvelles recherches. »
 Tivadar Puskás Ingénieur et
inventeur Hongrois qui après avoir étudié le
droit à Vienne, des études d'ingénieur à
l'université de Budapest, émigre en 1866
à Londres, puis en 1873 part travailler aux
États-Unis, où il collabora avec Thomas Edison
et son équipe, pour créer le « Telegraph Exchange
», un multiplex qui aboutit à la construction du premier
centre manuel expérimental, il fut inauguré par la Bell
Telephone Company à Boston en 1877.
Tivadar Puskás Ingénieur et
inventeur Hongrois qui après avoir étudié le
droit à Vienne, des études d'ingénieur à
l'université de Budapest, émigre en 1866
à Londres, puis en 1873 part travailler aux
États-Unis, où il collabora avec Thomas Edison
et son équipe, pour créer le « Telegraph Exchange
», un multiplex qui aboutit à la construction du premier
centre manuel expérimental, il fut inauguré par la Bell
Telephone Company à Boston en 1877.
En février 1878, en collaboration avec Edison, il introduit le phonographe en Europe puis décide de s'installer à Paris. Après l’exposition universelle de 1878, il se rapproche de Josuah Franklin Bailey qui représente les intérêts d’Elisha Gray. Les deux hommes s’associent avec Georges Alexis Godillot qui leur amène le capital nécessaire pour créer une nouvelle société. En contrepartie, ce dernier impose un de ses jeunes ingénieurs, Louis Alfred Berthon, pour le poste de directeur technique. La société A. Berthon et Compagnie, dite Société du Téléphone Edison, a pour objet « l’exploitation des brevets français apportés à la Société pour les téléphones parlants et leurs accessoires En 1879 Puskás reviendra en Hongrie et, en collaboration avec son frère (Ferenc), il construisent des centraux manuels sur le territoire de l'empire austro-hongrois, ainsi que le premier véritable centre téléphonique manuel de grande envergure à Paris en premier, en Europe, à Marseille, à Budapest ... . |
La légende raconte
que le mot « Allô ! »
(ou « ha-lo ! ») utilisé
internationalement pour les appels téléphoniques vient du
hongrois, parce que le pionnier du téléphone Tivadar Puskás
lors de son premier essai répondit : « Je vous entends »,
ce qui se dit en hongrois : hallom,
et les étrangers qui assistaient à cette expérience
reprirent ce mot sous la forme d'une onomatopée, qui devint internationale
— à l'exception des Italiens qui disent pronto!, des Portugais
qui disent estou?/estou, sim?, ou des Japonais qui disent mushi mushi.
Selon une autre source, ce mot viendrait du terme anglais, «
haloo » utilisé par les bergers normands installés
en Angleterre après l’invasion de Guillaume le Conquérant
au XIème siècle, pour s’appeler ou pour rassembler
leurs moutons.
Selon les dictionnaires le mot
proviendrait d’une salutation que les marins anglais échangeaient
d'un bateau à l'autre et qui s’apellait « Hallow
».
«allô » est la version
française de «hello »
La forme écrite de « Hello » n’est apparue qu'après
1880 alors que le mot est devenu la salutation la plus courante au téléphone
en Amérique et par la suite dans le monde entier.
Le 21 août 1879, le premier central téléphonique européen,
The Telephone Company Ltd, ouvre à Londres. Il est situé
au 36 Coleman Street. The Telephone Company Ltd avait une capacité
de 150 lignes et a ouvert avec environ 8 abonnés.
1878, création de l’École Supérieure de Télégraphie Ou l’émergence d’un nouveau métier : ingénieur des télégraphes.
Les modalités d’intégration à l’École sont quasiment identiques à celles en vigueur aujourd’hui. Il y a bien sûr les élèves de l’École Polytechnique, classés d’après leur rang de sortie dans les télégraphes. Il existe également un concours externe, ouvert aux licenciés ès sciences, aux anciens de l’École Polytechnique, de l’École Normale…
Mais l’École est aussi destinée à offrir des chances de promotion au personnel télégraphiste. Ils doivent réussir un concours interne.
 |
Louis-Adolphe
Cochery, président du Congrès de l'Union
postale à Paris en 1878, fut le fondateur de l’École,
il en attend deux effets de cette sélection. Le premier est social : si l’origine des candidats est variée, leur avancement dans le service après leur sortie a lieu dans des conditions identiques. Les distinctions d’origine disparaissent définitivement. Le second effet sera d’enrichir le corps des ingénieurs : « donner à l’État, des fonctionnaires, non seulement au courant de la science actuelle, mais prêts encore à en hâter les progrès ». |
C’est lui qui y fit installer l’électricité, d’importation toute récente en Europe.C’est pourquoi l’argot de l’X a désigné cette lumière par le terme de « merca ». Avec l’invention du télégraphe électrique par Samuel Morse en 1837 et la mise au point du téléphone par Alexander Graham Bell aux États-Unis en 1876, les premiers besoins en formation se font rapidement et cruellement sentir.
Le lundi 4 novembre 1878 s’ouvre l’École Supérieure de Télégraphie, ancêtre de l’ENST, le Service des Télégraphes vient d’être uni à celui des Postes au sein d’un Sous-secrétariat des Finances.
Sur le plan administratif on est en pleine réorganisation
: l'heure n'est peut-être pas bien choisie pour prendre en charge
une invention nouvelle.
| Puis le 1er mars 1878, Adolphe
Cochery fut nommé,
au sein du sous-secrétariat d'État aux Finances,
directeur du service des Postes et Télégraphes,
fonction qui fut transformée en ministère à
part entière le 5 février 1879. Il occupera ce poste dans huit gouvernements successifs jusqu'au 30 mars 1885. Il fut à l'origine de l'Exposition internationale d'Électricité (Paris, 1881) et présida la première Conférence pour la protection des câbles sous-marins. Ci-contre : gravure représentant M. le Ministre des Postes & Télégraphes - Adolphe Cochery - par Néraudau - Musée de la Poste. |
 agrandir
agrandir |
La diversité des techniques qui apparaissent sur
le marché, depuis le télégraphe électrique
au téléphone en 1875, traduit l’attitude de l’État
de ne pas développer les innovations lui-même et de laisser
l’initiative privée s’en charger. Le cas de figure du
réseau téléphonique est en ce sens exemplaire.
Adopter le modèle du télégraphe
et développer un grand réseau public ?
Ou bien en concéder l'exploitation à des compagnies autorisées
?
En ce début d'année 1879 la balance penche plutôt en faveur de la concession pour bien des raisons.
La concession ne représenterait pas une innovation
absolue. Il y a des précédents.
C'est une procédure prévue par la loi de 1851 qui régit
le monopole des communications en France et elle a été abondamment
utilisée pour le développement des lignes de télégraphie
sous-marine. Sur le plan juridique, il n'y a donc pas de problème.
L'exploitation sous forme de concession est à la mode dans les
milieux économiques.
Les capitaux français se désengagent peu à peu des
grosses opérations du type compagnie de Chemin de fer et se portent
volontiers vers des secteurs à mi-chemin de l'industrie et des
services souvent protégés par des monopoles comme les Compagnies
urbaines du gaz, de l'eau ou des omnibus qui se multiplient alors.
Enfin l'application stricte du monopole d'exploitation des réseaux
de communications par l'État ne semble pas indispensable dans le
cas du téléphone.
Elle se justifie surtout (pour des raisons de sécurité)
dans le cas des grands réseaux capables de couvrir l'ensemble du
territoire.
Or le téléphone en 1879 est bien loin de prétendre
à de semblables performances. Au cours de l'année 1878 on
s'est enquis des possibilités réelles de la nouvelle technique
: elles semblent minces.
En pratique, jusqu'en 1884, date de l'ouverture de la première
« ligne longue » entre Boston et Baltimore, on ne saura pas
réaliser de liaison intermédiaire.
Dès lors la sécurité de l'État ne semble pas
exiger que l'administration, qui a d'autres chats à fouetter, se
réserve l'exploitation des réseaux locaux.
|
La décision du ministre est prise : on
procédera par concessions, mais par concessions provisoires
de cinq ans renouvelables. Cet arrêté en substance : - précise la durée des autorisations concédées à l'industrie privée pour 5 années. Autorisations éventuellement renouvelables. - précise que l’État peut racheter de plein droit les équipements de l'industrie privée quand il le souhaite, à un prix négocié par les deux parties, ou en cas de désaccord par des experts. - ajoute que l'exploitation sera soumise au contrôle de l’État : les agents du Service du Télégraphe désignés par le Ministre pourront pénétrer dans les locaux téléphoniques à toute heure du jour ou de la nuit pour y exercer le contrôle qu'il appartiendra d'accomplir. - fixe les conditions, notamment financières d'entrée dans le dispositif, de versement de cautions pour couvrir leur faillite éventuelle, droit d'usage annuel, redevances régulières de l'industrie privée. - précise que les tarifs et les conditions tarifaires seront fixés par le Ministre des P&T à sa volonté. - ajoute que les tarifs proposés aux clients devront être les mêmes pour tous (dans le réseau considéré), les tarifs de faveur étant strictement interdits. |
| Trois Compagnies téléphoniques exploitant,
l'une le système Bell, l'autre le système Edison, la
troisième le système Gower, sont actuellement établies
à Paris, pour desservir les communications spéciales
qui seraient demandées par des établissements ou des
particuliers. Un arrêté récent du Ministre des
postes et des télégraphes (le France a réglé
les clauses et conditions auxquelles les communications pourraient
être installées et exploitées. Nous résumons ici les principales dispositions de cet arrêté. Les fils extérieurs de communication sont établis et entretenus par le service télégraphique, aux frais exclusifs des permissionnaires et à la charge par eux de se munir des autorisations nécessaires auprès des municipalités ou des propriétaires d'immeubles qui seraient affectés par la présence des fils et de payer les indemnités voulues. Aucune responsabilité n'incombe à l'Etat à raison de l'exécution des travaux ni des dérangements ou interruptions éventuelles qui pourraient se produire. Les concessionnaires restent chargés de l'introduction des fils dans l'intérieur des immeubles et de l'installation des bureaux et des appareils dont le système employé devra avoir reçu l'approbation du Ministre des postes et télégraphes. L'autorisation implique le droit, pour les permissionnaires, de mettre, selon le cas, pour l'usage des correspondances, chacun des établissements reliés aux différents bureaux centraux en communication directe, soit avec ces bureaux, soit entre eux; mais, en aucun cas, ces correspondances ne pourront avoir d'autre objet que les usages personnels des clients de l'entreprise, toute communication faite par ces clients au profit de tiers étant rigoureusement interdite. Les tarifs à percevoir par abonnement seront soumis à l'approbation du Ministre. Is devront être établis sur des bases uniformes pour tous les clients de l'entreprise, tout tarif de faveur étant interdit, sauf pour les établissements publics de l'Etat ou de la Ville qui seraient desservis par l'entreprise, en faveur desquels le Ministre se réserve le droit de déterminer une réduction dans les limites de 50 pour cent du tarif applicable aux particuliers. L'exploitation sera soumise au contrôle de l'Etat. L'entrepreneur paiera à l'Etat, à titre de droit d'usage du téléphone, une redevance annuelle égale au dixième des recettes brutes encaissées par l'entreprise, cette redevance ne pouvant, pour une année entière, être moindre de cinq mille francs. Comme garantie des dépenses d'établissement et d'exploitation de l'Etat et des redevances à lui dues, l'entrepreneur doit déposer: 1° avant la délivrance de l'autorisation, un cautionnement de 20 mille francs jusqu'à l'entier achèvement des travaux et un second cautionnement de 5 mille francs jusqu'à la fin de l'entreprise; 2° dans le mois qui suit la date de l'autorisation, un cautionnement de 20 mille francs, jusqu'à la fin de l'entreprise. Les autorisations sont personnelles et ne peuvent être transférées sans l'autorisation expresse du Ministre. Elles ne confèrent aucun privilège pour l'entrepreneur, ni aucune obligation pour l'Etat, en matière d'autorisation ou d'exploitation concurrente. Elles sont annulées ou peuvent être retirées, sans indemnité, de la part de l'Etat, faute par l'entreprise d'avoir satisfait aux clauses et conditions de l'acte de concession ou en cas de faillite. L'Etat se réserve la faculté de racheter, à toute époque, les droits des concessionnaires ou de faire l'acquisition des systèmes d'appareils exploités par eux, sans surélévation provenant des droits de brevet. ... |
A la demande du ministre A. Cochery, le 5 juillet 1879
des expériences sont réalisées sur le réseau
télégraphique civil de Paris à Versailles, puis d'Asnières
à Sceaux.
Elles et se sont révélées peu concluantes, le système
Allemand Siemens-halske est définitivement écarté
au profit du système Edison.
Les expériences de transmission téléphonique de l'armée
n'ont pas été plus encourageantes.
Le Téléphone offre incontestablement le
plus frappant exemple de la rapidité avec laquelle, de nos jours,
se propagent dans le monde entier les inventions réellement utiles.
Accueilli d'abord avec une certaine défiance, considéré
tantôt comme un instrument de laboratoire, tantôt comme un
jouet scientifique, grâce à des perfectionnements de détail,
il ne tarde pas à s'imposer, non seulement aux savants, mais encore
à tous ceux qui s'intéressent aux applications de la science,
comme la solution parfaite du problème de la transmission instantanée
de la parole.
Les chiffres nous démontre qu'aujourd'hui les capitales et les
villes, qui se font remarquer par l'activité de leur commerce ou
leur industrie, possèdent des réseaux de communication téléphonique
dont le développement s'est accru d'une manière surprenante.
Le succès de celle découverte, unique dans l'histoire des
conquêtes de la science, s'explique par les facilités que
le public trouve à leur emploi pour l'expédition des affaires
courantes, les économies de temps qu'il permet de réaliser,
etc., etc.
Les différents régimes sous lesquels fonctionne l'exploitation
des réseaux téléphoniques sont les suivants :
1° Régime de la liberté absolue, sous la seule
observation des règlements de police ou de voirie. Dans ce régime,
les réseaux téléphoniques sont assimilés à
une industrie quelconque. l'État n'intervient aucunement dans l'exploitation.
C'est le système adopté aux États-Unis, en Suède
et en Norvège, et dans la plupart des colonies anglaises.
2° Régime de l'exploitation par l'État. Ce
mode d'exploitation est établi en Europe, en Allemagne en Suisse
et en France (du 1er septembre 1889).
3° Régime d'exploitation définitive, c'est-à-dire
l'organisation sous le contrôle de l'État, dans des conditions
de durée assez étendue, et suivant une réglementation
offrant assez de garantie et de stabilité
4° Enfin le Régime d'exploitation provisoire, ou les
concessions ne sont accordées que pour un nombre d'années
très limitées et insuffisantes, où la réglementation
administrative n'a pas encore un caractère définitif et
pourrait être modifiée d'un jour à l'autre par les
pouvoirs constitués.
Ce système d'exploitation provisoire a été appliqué
en France pendant dix ans, mais on en a reconnu les inconvénients,
aussi le gouvernement a-t-il renoncé à un provisoire qui
n'a plus de raison d'être pour les téléphones au degré
de perfectionnement où déjà ils sont parvenus; il
est revenu au régime d'exploitation par l'État à
la date du 1" septembre 1889
En France, nous avons toujours la déplorable habitude de nous montrer
méfiants pour les nouvelles inventions, ou trop légers à
leur égard, et de ne songer à les adopter qu'après
une longue application à l'étranger; nous perdons toujours
ainsi un temps précieux.
L’exemple de la France sera rapidement suivi,
en1880, par l ’Angleterre, la Belgique, le Danemark, la Hollande,
la Norvège, la Suède, l’Allemagne;
en 1881 par l'Autriche, l ’Italie, le Portugal, la Suède;
en 1872 par la Hongrie, la Russie;
en 1883 par la Chine;
en 1885 par l ’Espagne.
Alors que les premiers centraux
manuels s'installent, en 1879
Daniel et Thomas Connolly avec J.McTighe Américains
de Grande Bretagne, mettent au point le premier commutateur
téléphonique automatique au monde, il sera perfectionné
en 1881, et breveté en 1883
Il sera présenté à l'exposition universelle de 1881
à PARIS
|
1879 Le combiné téléphonique. c'est un perfectionnement qui se fait naturellement . Le concept d'un appareil portatif monobloc qu'un
utilisateur de téléphone tiendrait contre son oreille
et devant sa bouche est apparu à Londres peu après
l'invention officielle du téléphone. Bien que les
premiers brevets de CE McEvoy et GE Pritchett n'aient pas donné
lieu à des appareils commerciaux en 1877, RG Brown
de New York a réussi l'année suivante à concevoir
un combiné émetteur-récepteur combiné,
qu'il a utilisé dans un central téléphonique
local dans le district. de la "Bourse de New York". Ayant
peu de succès dans la promotion de l'appareil ailleurs aux
États-Unis, Brown partit pour la France pour devenir ingénieur
électricien à la Société
Générale des Téléphones
à Paris. Là, ses créations trouvèrent
un écho et leurs adaptations furent largement utilisées
en Europe, où elles devinrent connues sous le nom de téléphones
français .
   Principalement utilisés par les opératrices de centre manuel, afin de se libérer une main. Le Combiné Berthon
|
sommaire
En 1879, le ministre des Postes et Télégraphes,
Albert Cochery, décide de créer une commission d’examen
pour tenter de savoir ce que valent vraiment les différents systèmes
téléphoniques.
L’expérience a lieu le 5 juillet 1879, dans la salle 25 du
bureau central des Télégraphes entre Paris, Versailles,
Asnières et Sceau.
Le système allemand Siemens est alors définitivement écarté
au profit du système américain d’Edison : «
On a essayé les téléphones Siemens et Halske.
Ce dernier ne portait pas jusqu’à Versailles et l’appel
n’était même pas entendu ! ».
L'arrêté relatif aux autorisations d'établissements
de communications téléphoniques le 26 juin 1879 (BO P&T
1879 n° 17 page 585), le Ministre des Postes et des Télégraphes
Adolphe Cochery autorise les entrepreneurs de l'industrie privée
(qualifiés dans le texte de Permissionnaires) à construire
et à exploiter dans certaines villes des réseaux téléphoniques
en fixant ses clauses et conditions.
Il y aura trois demandes de concessions, pour l'organisation de réseaux
téléphoniques formulées par des sociétés
présentant des garanties suffisantes et furent admises , trois
sociétés détentrices de brevets américains
chargés d'établir et d'exploiter pendant cinq ans des réseaux
dans quatre importantes villes de France : Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux.
Les centres manuels avec opératrices étaient déjà
largement utilisés aux Usa, en France sauf dans quelques rares
d'installations privées, il n'y avait encore pas de standard manuel
pour interconnecter les utilisateurs du téléphone.
L'usage jusqu'à maintenant était de relier deux points,
deux téléphones par une liaison privée ou une liaison
télégraphique louée.
|
La première
société à demander une concession est
la Compagnie du Téléphone Gower
Roosvelt la CdTG Gower
à cette date avait racheté les ateliers Rodde
du 9 boulevard Magenta, ainsi que la collaboration de Rodde
qui lui aussi avait cherché à mettre au point un nouveau
téléphone.
Cornélius Rossvelt
qui possède les droits d'exploitation Bell , et Gower,
avaient déjà en décembre 1878 brevetés
une modification du téléphone Bell " le téléphone
chronomètre" : brevet du 3 décembre
1878. C'est l'appareil qui est présenté à
la l'Académie des sciences du 27 janvier 1879. " M. Stroh a appelé l'attention des
membres de la Société des ingénieurs télégraphistes
et électriciens de Londres sur les difficultés qu'on
avait à fabriquer du bon acier à aimants en Angleterre
. Deux morceaux coupés dans la même barre donnent des
résultats différents . Paris offrait un espace excellent
car il n’y avait pas besoin de creuser des tranchées
ou de créer une canalisation spéciale : on utilisa
le réseau d’égouts dont la Ville de Paris a été
dotée par Belgrand pour la construction des lignes téléphoniques
souterraines. De plus, l’une des spécificités
de la ville (et de la préfecture) de Paris est d’avoir
imposé à la compagnie de renoncer aux fils aériens
et d’emprunter le réseau des égouts. Ceci se
révéla fort utile au niveau de la connectivité,
étant donné qu’il fallait relier plusieurs points
diversement espacés par des lignes disposées de manière
à permettre le plus grand nombre de liaisons directes, avec
une longueur la plus petite possible. Le réseau d’égout
s’y prêtait justement. Nous pouvons imaginer le visage
qu’aurait eu Paris, si la ville avait été quadrillée
par des fils aériens à l’image de New York ou
de San Francisco du début du 20e siècle. Le 30 septembre 1879, le premier central
téléphonique manuel de France est ouvert à
Paris. Les abonnés, contre toute attente ne reçoivent
pas un numéro. Il faut dire que le téléphone
ne concerne au départ qu'une élite peu nombreuse,
voire même confidentielle... Ainsi donc, chaque abonné
d'un réseau téléphonique est-il simplement
identifié par son Nom de famille ; éventuellement
complété par son Prénom en cas de doublon ;
voire par sa profession ! Cet usage peu mathématique, voire
surprenant, perdurera toutefois jusqu'en 1896 ! |
|
La deuxième
société à
demander une concession est la "Société
Française de Correspondance Téléphonique",
|
|
Le 8 septembre 1879 la
troisième société, est la future "
Société Française des Téléphones
" SFT, avec le système Edison.
|
Il s'ensuit un jeu de transfert de capitaux et de concessions
d'exploitation assez compliqué entre hommes d'affaires :
- Le 21 août 1879, l'État transfère à M. Charles
Wallut, directeur du Crédit Mobilier, l'autorisation en date du
27 juin 1879 accordée initialement à M. Adrien Hébrard,
à la demande de ce dernier.
- Le 23 septembre 1879, l'État transfère à M. Léon
Soulerin, Ingénieur, l'autorisation en date du 12 juillet 1879
accordée initialement à M. Louis-Alexandre Foucher de Careil,
à la demande de ce dernier.
Il apparaît probable que les deux sociétés Compagnie
du Téléphone (Système Gower) et Société
Française de Correspondance Téléphonique, aient employé
les services de deux sénateurs de la République pour négocier
plus aisément l'obtention auprès de l’État des
deux concessions (27 juin 1879 et 12 juillet 1879), puis que ces deux
sénateurs se soient ensuite retirés.
Les premiers postes téléphoniques installés
par la Société Générale
sont des Gower ou des Edison puis des Crossley et enfin des appareils
Ader de types mobiles ou muraux.
sommaire
Les trois sociétés détentrices de brevets américains
sont donc chargés d'établir et d'exploiter pendant cinq
ans des réseaux dans quatre importantes villes de France : Paris,
Lyon, Marseille et Bordeaux. On s'aperçoit vite que ces trois systèmes
ne sont pas compatibles entre eux (interconnectables).
| Vu dans le Journal Télégraphique de
Octobre 1879 T rois Compagnies téléphoniques exploitant, l'une le système Bell, l'autre le système Edison, la troisième le système Gower, sont actuellement établies à Paris, pour desservir les communications spéciales qui seraient demandées par des établissements ou des particuliers. Un arrêté récent du Ministre des postes et des télégraphes (le France a réglé les clauses et conditions auxquelles les communications pourraient être installées et exploitées. Nous résumons ici les principales dispositions de cet arrêté. - Les fils extérieurs de communication sont établis et entretenus par le service télégraphique, aux frais exclusifs des permissionnaires et à la charge par eux de se munir des autorisations nécessaires auprès des municipalités ou des propriétaires d'immeubles qui seraient affectés par la présence des fils et de payer les indemnités voulues. Aucune responsabilité n'incombe à l'Etat à raison de l'exécution des travaux ni des dérangements ou interruptions éventuelles qui pourraient se produire. - Les concessionnaires restent chargés de l'introduction des fils dans l'intérieur des immeubles et de l'installation des bureaux et des appareils dont le système employé devra avoir reçu l'approbation du Ministre des postes et télégraphes. - L'autorisation implique le droit, pour les permissionnaires, de mettre, selon le cas, pour l'usage des correspondances, chacun des établissements reliés aux différents bureaux centraux en communication directe, soit avec ces bureaux, soit entre eux; mais, en aucun cas, ces correspondances ne pourront avoir d'autre objet que les usages personnels des clients de l'entreprise, toute communication faite par ces clients au profit de tiers étant rigoureusement interdite. - Les tarifs à percevoir par abonnement seront soumis à l'approbation du Ministre. Us devront être établis sur des bases uniformes pour tous les clients de l'entreprise, tout tarif de faveur étant interdit, sauf pour les établissements publics de l'Etat ou de la Ville qui seraient desservis par l'entreprise, en faveur desquels le Ministre se réserve le droit de déterminer une réduction dans les limites de 50 pour cent du tarif applicable aux particuliers. - L'exploitation sera soumise au contrôle de l'Etat. - L'entrepreneur paiera à l'Etat, à titre de droit d'usage du téléphone, une redevance annuelle égale au dixième des recettes brutes encaissées par l'entreprise, cette redevance ne pouvant, pour une année entière, être moindre de cinq mille francs. Comme garantie des dépenses d'établissement et d'exploitation de l'Etat et des redevances à lui dues, l'entrepreneur doit déposer: 1° avant la délivrance de l'autorisation: un cautionnement de 20 mille francs jusqu'à l'entier achèvement des travaux et un second cautionnement de 5 mille francs jusqu'à la fin de l'entreprise; 2° dans le mois qui suit la date de l'autorisation: un cautionnement de 20 mille francs, jusqu'à la fin de l'entreprise. - Les autorisations sont personnelles et ne peuvent être transférées sans l'autorisation expresse du Ministre. Elles ne confèrent aucun privilège pour l'entrepreneur, ni aucune obligation pour l'Etat, en matière d'autorisation ou d'exploitation concurrente. Elles sont annulées ou peuvent être retirées, sans indemnité, de la part de l'Etat, faute par l'entreprise d'avoir satisfait aux clauses et conditions de l'acte de concession ou en cas de faillite. - L'Etat se réserve la faculté de racheter, à toute époque, les droits des concessionnaires ou de faire l'acquisition des systèmes d'appareils exploités par eux, sans surélévation provenant des droits de brevet. |
En même temps, la Compagnie des Chemins de Fer du
Nord, qui s'intéresse aussi au téléphone pour remplacer
ses télégraphes, se livre à des recherches et dès
1880 réussit une première transmission entre Paris et Saint-Quentin
(140 kilomètres).
L'amplificateur-répéteur n'existe pas encore et il faut
utiliser du fil à forte section très lourd.
Ce premier essai de liaison interurbaine est réalisé sur
la voie ferrée qui passe entre Marest et Quierzy ... où
il faudra attendre encore 40 ans avant l'arrivée du téléphone.
Le jeu de transfert de capitaux et de concessions d'exploitation
bat son plein.
D'un côté :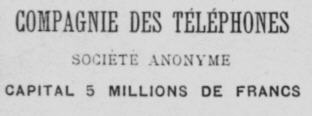
- le 2 février 1880, est fondée officiellement la Compagnie
des Téléphones. ex Compagnie
du Téléphone Gower Roosvelt , chargé
d'exploiter les réseaux de Marseille Lyon Nantes Bordeaux Lille
et Le Havre et Paris .
Son Président est M. Amédée Jametel, Banquier
du Crédit Mobilier à Paris . Cette société
est créée à l'occasion de l'absorption de la Société
Française de Correspondance Téléphonique
en grande difficulté (alors détenue par M. Léon Soulerin)
par la Compagnie du Téléphone Gower
(alors détenue par M. Charles Wallut) .
A Paris se trouvent le bureau central, situé au siège social
66, rue Neuve-des-Petits-Champs à Paris, et un bureau annexe à
La Villette avec 30 lignes, mais 4 nouveaux bureaux sont en construction.
Au mois d’octobre 1880, 200 abonnés sont déjà
reliés et 130 attendent leur tour. La société installe
chez ses abonnés le téléphone Gower.
Son but est « la création et l’exploitation en France
et dans les Colonies Françaises de réseaux téléphoniques
».
Au mois d’octobre 1880, 200 abonnés sont déjà
reliés et 130 attendent leur tour. La société installe
chez ses abonnés le téléphone Gower.
En province, la compagnie a ouvert un réseau à Lyon avec
23 abonnés « reliés », à Marseille avec
25 abonnés et à Nantes avec 19 abonnés (octobre 1880).
Elle est aussi installée à Bordeaux, Lille et Le Havre où
les discussions sont en cours avec les municipalités, au Havre
c'est la guerre ave la compagnie des téléphones qui demande
des droits trop élevés.
La société installe chez ses clients de province le téléphone
à crayons de charbon de John Crossley
sommaire
Au 2 février 1880, il ne reste plus que deux sociétés
exploitant le téléphone en France.
Le 2 avril 1880, l'État transfère ensuite à M. Amédée
Jametel, fondateur de la Compagnie des Téléphones, les deux
concessions d'exploitation téléphonique accordées
les 27 juin 1879 et 12 juillet 1879 détenues jusques alors par
MM Wallut et Soulerin, à la demande de ces derniers.
Le 23 Avril 1880, l'État transfère ces deux concessions
directement à la personne morale de la Compagnie des Téléphones,
à la demande de son Président, M. Amédée Jametel.
Reste de l'autre côté : la SFT
| Le 27 mars 1880, La Banque Franco-Égyptienne
fonde la Société Française
des Téléphones (Système Edison et
autres), en rachetant la Société Berthon et Cie.
Au mois d’octobre 1880, 240 abonnés sont raccordés et 330 sont en attente de construction ; le bureau central est situé au 45, avenue de l’Opéra, et deux bureaux auxiliaires fonctionnent. La société installe chez ses clients l’appareil à pupitre Edison-Phelps mais reçoit de nombreuses plaintes du fait du fonctionnement très délicat du microphone Edison qui demande de fréquents déplacements chez les clients pour le remettre en état. Le 21 avril 1880, l'État transfère à la Société Française des Téléphones (système Edison et autres), fondée par la Banque Franco-Égyptienne, la concession d'exploitation accordée le 8 septembre 1879 détenue jusques alors par M. Alfred Berthon, à la demande de ce dernier. |
 |
LA Fusion :
Trois sociétés, trois systèmes. On
comprend les problèmes d’interconnexion qui surgissent rapidement.
Les deux systèmes trop différents des deux
sociétés restantes n'arrivent pas à raccorder leurs
nouveaux abonnés. De plus la ville de Paris avait donné
une autorisation mais provisoire aux deux sociétés pour
utiliser les égouts, envisage de réglementer la situation
et de prélever une redevance pour cela.
La société Edison tente de rarccorder ses clients en aérien,
mais d'une part cela était trop couteux, et d'autres parts de nombreux
propietaires refusaient la fixation de câbles aux toitures et façades
de leur habitations.
Devant ce problème, John Harjes représentant
de la Société Française des Téléphones,
et la banque Franco-Egyptienne renouent les contacts avec la Compagnie
des Téléphones, contribue au rapprochement des deux sociétés
trouvant l'une et l'autre leur intérêt financier. De plus
la Compagnie des Téléphones trouve intéressant de
pouvoir récupérer les brevets Edison et de pouvoir augmenter
sa capacité de production. Pour la Société Générale
des Téléphones , cette alliance devait lui permettre de
se développer en province et retrouver une existence légale.
Pour ces raisons c'est la Compagnie des Téléphones qui va
absorber l'autre société, bien que cella n'arrangeait pas
Edison.
- Le 16 et 17 août 1880, est fondée officiellement
la Société Générale
des Téléphones. Cette société,
présidée par Amédée Jametel, est créée
dans le but prévisionnel de fusionner la Compagnie des Téléphones
(Gower) et la Société Française des Téléphones
(Système Edison et autres).
Edison tenant à ce que son nom apparaisse dans la nouvelle société,
s'en sort satisfait
- le 7 et 30 octobre 1880, au cours de la première assemblée,
la fusion entre la Compagnie des Téléphones (Gower) et la
Société Française des Téléphones Système
Edison et autres, est officialisée. La
Société Générale des Téléphones
est pérennisée.
Le directeur nommé de la SGT
est Henri Lartigue, ex directeur de la Compagnie des Téléphones.
|
Le 10 décembre 1880,
l'État transfère enfin à M. Amédée
Jametel, Président de la Société
Générale des Téléphones,
la concession d'exploitation accordée le 8 septembre 1879
détenue depuis le 21 avril 1880 par la Banque Franco-Égyptienne,
à la demande de cette dernière. La SGT « inaugura le service téléphonique de Paris avec 400 souscripteurs, le 30 septembre 1879. Fin 1880 la SGT compte plus de 450 abonnés sur Paris et 460 en attente de raccordement. Et chaque abonné ne passe pas plus d'un appel par jour en moyenne. |
| le téléphone acoustique de
Mr Léger : Article du 01 janvier 1880 de la revue "Le
Panthéon de l'industrie" QUEL est le véritable avenir réservé au téléphone ? Bien que l'on puisse dire que ses applications en sont encore à la période d'essai, on peut affirmer, dès aujourd'hui, sans témérité, que cet instrument n'acquerra jamais une puissance suffisante pour se substituer au télégraphe électrique, dans les communications à des distances dépassant quelques kilomètres, et que, pour les communications à des distances relativement très-faibles, il ne pourra remplacer utilement les simples appareils acoustiques, qui sont infiniment plus commodes. En somme, il existe actuellement deux grands modes de communication à distance : l'électricité, qui transmet les signaux d'une extrémité de la terre a l'autre ; les ondes sonores, qui les transmettent très-commodément entre les diverses pièces d'un même édifice. Le téléphone, appareil mixte, dans lequel le courant électrique sert à la transmission des ondes sonores, donne tout naturellement des résultats moyens, transmettant la parole à des distances médiocres et exigeant quelques-unes des ressources, comportant quelques-uns des embarras, causant quelques-unes des dépenses du télégraphe lui même. On ne peut donc attribuer qu'à un engouement irréfléchi l'empressement qu'ont mis quelques particuliers à démolir les tubes acoustiques dans leur hôtel ou leur usine, à leur substituer les fils du téléphone, et à installer des piles gênantes, coûteuses, malpropres, dangereuses même, à la place des simples pavillons de porte-voix ou des simples embouchures qui leur avaient rendu jusque-là, sans frais et sans embarras, de si excellents services. Mais laissons là cette manie passagère, qu'explique l'enthousiasme inspiré par tonte nouveauté. On s'apercevra rapidement qu'on n'a pas absolument besoin d'une pile voltaïque pour demander ses chaussettes à son valet de chambre, et que le tube acoustique accomplit plus sûrement et plus simplement une pareille besogne. Et pour qu'on n'éprouve aucune hésitation à y venir ou à y revenir, pour qu'on n'accuse pas, comme on l'a osé faire, ces tubes d'avoir une trop faible portée, nous examinerons l'état vrai de la question, en signalant le point de perfection auquel ces tubes ont été amenés par l'unique spécialiste de ce genre dé construction, M. Léger, qui étudie depuis vingt cinq ans les questions d'acoustique pratique. Nous demanderons même à nos lecteurs la permission de ne pas sortir des beaux ateliers de la rue Saint-Denis, 156, sans signaler à leur attention deux autres créations de M. Léger, dont une se rapporte également à l'acoustique. Notons tout d'abord ce fait que M. Léger, dans la construction de ses canalisations acoustiques, emploie exclusivement le fer-blanc, c'est-à-dire, comme on sait, la mince tôle de fer étamée. Il y a, de ce choix, deux raisons principales : l'économie, qui condamne les tubes de cuivre, et le besoin d'éviter les sels vénéneux qui ne tardent pas à se développer sur la surface du même métal, et, dans le cas actuel, peuvent nuire gravement à la santé. Maintenant, on adresse aux tubes acoustiques deux grands reproches : la faible portée qu'ils auraient et qui limiterait leur emploi à de très-petites distances, la difficulté qu'y rencontreraient les ondes sonores à franchir les coudes, ce qui rendrait leur emploi presque impossible, les communications en ligne droite étant un fait exceptionnel. Appliquées aux tubes de M. Léger, ces objections n'ont aucune portée ; nous ne le prouverons non par des théories, mais par des faits incontestables, attestés dans des rapports officiels à la Société d'Encouragement, à la Société des Sciences industrielles, à l'Académie nationale, à l'Institut des Arts industriels, etc. Nous trouvons là l'indication d'un tube acoustique installé dans un grand hôtel du faubourg Saint Honoré, établissant, malgré la présence de seize coudes, des communications parfaitement distinctes, à 135 mètres de distance. Dans la maison du Bon Marché, qui possède quinze appareils établis par M. Léger, plusieurs de ces appareils ont plus de 125 mètres de développement, et l'un d'entre eux, qui atteint 200 mètres, n'a pas moins de trente-cinq coudes. Nous pourrions signaler des circonstances tout à fait semblables dans les 800 mètres de tubes établis à Noisiel, dans l'usine de M. Menier, dans les vingt et un appareils que possède l'hôtel du même industriel au parc Monceaux, etc., etc. ; mais nous pensons, que les exemples précédents suffisent a éclairer nos lecteurs sur les services que peuvent rendre es appareils installés par M. Léger dans les hôtels, les bureaux,, les magasins, les ateliers, les restaurants, sur les bateaux à vapeur, etc. N'oublions pas, du reste, que ces appareils ont obtenu, seuls parmi les appareils acoustiques, six médailles et un diplôme d'honneur dans les Expositions et à la suite de rapports entièrement favorables dus à diverses Sociétés savantes. Nous avons dit comment M. Léger avait étudié, pendant un quart de siècle, le perfectionnement des appareils acoustiques. Parmi les améliorations qu 'il y a réalisées, il en est deux qui nous paraissent particulièrement remarquables : C'est d'abord' l'emploi d'un système d'embranchement qui permet de communiquer à la fois, très commodément. dans diverses directions, et c est ensuite une embouchure en forme dé conque, qui concentre les paroles émises à 4 ou 5 mètres de distance, et permet, soit de communiquer sans se déplacer, soit d'entendre la conversation de malfaiteurs réunis dans un bureau pour le dévaliser. La construction des porte-voix et des cornets acoustiques, étudiée par M. Léger avec un zèle non moins persévérant, s'est enrichie d'une multitude de types très-habilement appropriés aux divers cas de surdité. L'idée du plus remarquable de tous a été inspirée à M. Léger par un hasard heureux. Mis en possession d'un cornet biauriculaire très défectueux, sans valeur aucune, mais construit d'après une idée très juste du docteur Constantin Paul, il l'étudia, le remania, le transforma, réussit à en faire le plus merveilleux cornet acoustique qu'on eût connu jusque-là. Mis au courant: de ce qui s'était passé, le docteur Constantin Paul, après des expériences multipliées à l'hôpital Saint-Antoine, encouragea l'habile constructeur qui-avait si admirablement interprété et développé sa pensée, l'aida même de ses conseils, et aujourd'hui le cornet auriculaire dans les mille formes que M. Léger. lui a données, opère dè véritables miracles. Nous en citerons deux. Un sourd-muet, qui avait perdu l'oui à l'âge de deux ans que Hall considérait comme affecté d'une surdité congénitale. et qui avait été instruit, comme tel, dans le langage des sourds-muet, qui fut pris tout à coup d'une stupéfaction voisine de la terreur lorsque muni du cornet Léger, il entendit parler pour la première fois de sa vie, sans comprendre (il l'écrivit lui-même) aucune des paroles qu'on lui adressait. Un autre exemple attesté par un certificat : une ieune fille du monde, âgée de seize ans, sourde-muette de naissance, put, grâce au cornet Léger, assister aux concerts, aux auditions musicales que son infirmité lui avait jusque-là empêché de fréquenter. Dans sa forme la plus complète, le cornet
biauriculaire comprend : deux oreillons en fer-blanc terminés
par des olives en ivoire qu'on introduit dans le conduit: de chaque
oreille; deux tubes en caoutchouc, munis à l'intérieur
d'un ressort à boudin en fil de fer émaillé,
et s'embranchant sur un tube unique terminé par un pavillon
placé devant la poitrine ; une bride passant sur la tète
et retenant en place les deux oreillons, de façon que les
mains restent entièrement inoccupées. Une application
très-curieuse de cet appareil consiste à retourner
le pavillon sur la poitrine, pour s'ausculter soi-même. Le
cornet Léger est, du reste, dans tous les cas, un excellent
stéthoscope. Nous n'insistons pas, ne voulant pas. d'ailleurs,
diviser l'attention de nos lecteurs, qui doivent, à cette
heure, considérer, comme nous, les inventions acoustiques
de M. Léger comme un des plus remarquables progrès'
de la science industrielle. |
1880 Faisons
le point de la situation en Europe Extrait du Journal Télégraphique
de janvier 1880
Le téléphone en ville (Téléphone exchanges),
par M. ROTHEN, Directeur-adjoint des télégraphes Suisse.
| On entend souvent les personnes qui ne s'occupent
pas directement des applications de l'électricité, demander
pourquoi le bruit qui s'est fait autour du téléphone
il y a deux ans, a cessé aussi subitement et si de ce silence
on doit conclure que la nouvelle invention a été abandonnée.
Ces personnes oublient que c'est le propre de toute invention, après avoir au moment de son apparition, surtout si elle présente des effets aussi merveilleux que le téléphone, surexcité tous les esprits, d'entrer dans une période de calme relatif, de recueillement où l'invention se consolide et se perfectionne. C'est dans cette période que se trouve aujourd'hui le téléphone. Toutefois, l'accueil qu'il a reçu du public est bien différent d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Bien qu'il y ait certainement en Europe un nombre assez considérable de téléphones en activité, il est pourtant incontestable qu'il ne s'y est pas encore complètement acclimaté et vulgarisé. Son établissement souvent ne répond qu'à une satisfaction de curiosité, d'autres fois qu'à des besoins superflus. La masse du public n'y songe pas et n'étant sollicitée par aucun désir de communications plus fréquentes, plus faciles que celles dont la télégraphie ordinaire la fait jouir, oublie complètement le téléphone. Il n'est pas rare de trouver des villes considérables où pas un seul appareil téléphonique n'est en activité. En Amérique, les choses sont toutes différentes. Là, le téléphone est devenu comme une nécessité de la vie moderne. Dans presque toutes les villes de quelque importance il existe des réseaux téléphoniques plus ou moins étendus, établissant entre les clients de l'entreprise des communications directes. Ainsi à Washington il y a plus de 200, à Chicago plus de 1200 maisons reliées ainsi entre elles par des fils téléphoniques. Ce nouveau système de communication est si apprécié en Amérique que son extension ne s'arrête pas et que l'on peut prévoir le moment où la moindre ville aura son réseau spécial de téléphones. Le téléphone ainsi appliqué, nous paraît offrir au commerce et aux relations de famille de tels avantages qu'au moment où se font aussi, dans quelques grandes villes européennes, des tentatives pour l'implanter dans les habitudes de la vie quotidienne, une étude des téléphone exchanges américains et des moyens de les adapter aux conditions de nos moeurs et de nos usages européens, nous paraît présenter un intérêt tout particulier d'actualité. En Amérique, le réseau téléphonique d'une ville se compose d'un ou de plusieurs offices centraux d'où rayonnent dans toutes les directions des fils aboutissant chacun à la maison d'un des clients de l'entreprise. Tout possesseur d'un téléphone peut ainsi être mis en communication directe avec tous les autres. S'il y a 400 abonnés dans une ville, un abonné quelconque a la faculté d'entrer en communication directe avec les 399 autres. Avec le nombre des abonnés, la valeur du téléphone s'accroît naturellement pour chacun d'eux, puisque cette augmentation étend le cercle de ses relations possibles. Une fois le premier noyau formé, l'augmentation du nombre des abonnés d'une même ville se produit sûrement comme s'augmente nécessairement avec le temps la crisetallisation autour d'un noyau plongé dans une solution saturée et cette augmentation tend même à progresser par un mouvement accéléré, jusqu'au jour où il est donné satisfaction à tous les besoins de communication. Dès qu'il a atteint une certaine étendue, les services que peut rendre dans une ville le réseau téléphonique, sont incomparables. C'est le malade qui désire à chaque instant conférer avec son médecin ou c'est ce dernier qui tient à être constamment informé de la marche de la maladie. Ce sont les fournisseurs auprès de qui il faut provoquer immédiatement l'envoi des objets nécessaires pour répondre à une exigence imprévue; c'est le commissionnaire dont ou a besoin pour une course, pour le transport de colis ou de malles; c'est l'intervention de la police ou des pompiers que réclame un accident ou un commencement d'incendie; c'est le moyen de se procurer un supplément de marchandises pour satisfaire à une commande dont l'importance dépasse le stock disponible; pour le banquier, c'est la facilité d'obtenir immédiatement la garantie qu'il peut en toute sécurité payer la traite présentée inopinément à sa caisse, etc., etc. On pourrait aisément multiplier le nombre de ces exemples, mais les quelques-uns que nous venons de résumer suffisent pour faire ressortir combien les communications téléphoniques peuvent épargner de temps, de courses et de peines pour atteindre plus vite et, en supprimant les intermédiaires, plus sûrement au but désiré. Aussi ne nous étonnerons-nous pas de trouver dans les journaux américains un concert unanime d'éloges de la part de ceux qui font usage de ces communications téléphoniques et l'expression de leur désir d'en conserver la jouissance, alors même que cette jouissance leur coûterait beaucoup plus cher. En dehors des réseaux dont nous venons de parler, il existe aussi des lignes téléphoniques indépendantes, par exemple, celles qui relient les bureaux d'un industriel à son usine, le comptoir d'un, commerçant à sa maison d'habitation. Or, si l'une de ces deux stations téléphoniques particulières est en communication avec le réseau général, l'autre s'y trouve naturellement aussi. Quelquefois, le réseau général est établi d'une manière un peu différente. Du bureau central les fils rayonnent aussi dans toutes les directions, mais sur chaque fil il y a plusieurs abonnés intercalés. Ce système revient bien meilleur marché que le premier, car il demande moins de fils; et ceux-ci étant généralement des fils souterrains, tiennent une place importante dans l'ensemble des frais d'installation. Mais il a le grand inconvénient de ne pas assurer le secret absolu des communications. Le premier est donc préférable malgré l'augmentation des dépenses d'établissement. En se rendant compte des services énormes que peut rendre dans une ville un réseau téléphonique, l'on est amené à se demander pourquoi Ton n'a pas songé plus tôt à en installer dans les villes européennes. Il y a à cela différentes raisons dont deux nous paraissent surtout importantes ; la première, c'est que les téléphones perfectionnés sont encore trop peu connus; la seconde c'est que les Administrations télégraphiques font obstacle à l'installation de réseaux téléphoniques comme entreprises privées. Occupons-nous d'abord de la première raison. Il y a beaucoup de personnes qui croient le téléphone encore dans l'état d'enfance où il se trouvait il y a deux ans, époque où les résultats obtenus n'étaient pas, en effet, assez encourageants pour provoquer sa prompte vulgarisation. La reproduction de la parole était incertaine, extrêmement faible et n'était saisissable que par une oreille exercée. L'on entendait bien qu'on parlait, mais peu de personnes étaient en état de reconnaître les mots proférés. Même avec les téléphones perfectionnés, l'on peut observer des faits analogues. Certaines personnes n'arrivent à saisir les paroles prononcées à l'extrémité de la ligne qu'à moins de recourir aux meilleurs téléphones connus. Depuis sa première apparition, le téléphone a subi d'innombrables modifications et soi-disant améliorations. La plupart d'entre elles ont disparu peu de temps après leur apparition et il n'en a subsisté qu'un petit nombre. On peut diviser ces dernières en deux catégories : téléphones sans pile et téléphones avec pile; ou bien encore les distinguer en téléphones où le même instrument sert de transmetteur et de récepteur et téléphones avec transmetteur spécial. Les spécimens les plus connus des téléphones perfectionnés sans pile, sont le téléphone Siemens et le téléphone Gower. Le premier dont le Journal télégraphique a donné une description détaillée (vol. IV, page 304) est excellent. Il se distingue par une reproduction parfaite du son articulé, par un appel très caractéristique qui peut s'entendre même d'une chambre voisine et par un réglage facile. En le réglant il faut seulement avoir soin de ne pas chercher à atteindre la dernière limite de clarté et de force, car pour y arriver l'on doit rapprocher l'aimant aussi près que possible du diaphragme sans toutefois que ce dernier se courbe sous l'influence de l'attraction. Mais le diaphragme se trouve presque alors à l'état d'équilibre instable, et la moindre influence, par exemple un changement de température, suffit à le dérégler. Avec l'habitude du réglage du téléphone, un pareil accident est sans importance, mais entre des mains inexercées il devient, comme nous avons pu nous en convaincre plus d'une fois, un obstacle sérieux à l'usage du téléphone. - Le téléphone Gower se présente sous la forme d'une boîte cylindrique de peu de hauteur qu'on applique le long d'une paroi. A l'orifice central est fixé un tube flexible en caoutchouc avec embouchure en forme d'entonnoir. Un sifflet à l'intérieur de la boîte tient lieu de la petite trompette d'appel du téléphone Siemens. L'aimant a la forme d'un demi-cercle avec pôles recourbés vers le centre dans la direction du diamètre. Chaque pôle est armé d'une bobine ovale. Le diaphragme est assez grand et épais. Les appréciations relatives aux effets du téléphone Gower sont très contradictoires ; quelques-unes le prônent comme un des meilleurs sinon le meilleur des téléphones, tandis que d'autres le considèrent comme ne donnant pas des résultats satisfaisants. N'ayant pas eu l'occasion de l'expérimenter personnellement, nous nous abstiendrons de nous prononcer sur sa valeur. Quant aux téléphones à pile où à transmetteur spécial, ils ont, tout d'abord, par rapport aux autres, un grand désavantage, celui de nécessiter l'emploi d'une pile; mais cet inconvénient est racheté par d'autres bonnes qualités. Nous citerons comme spécimens principaux de ces téléphones, le transmetteur Blake, le transmetteur Edison et le téléphone électrochimique du même inventeur. - Le transmetteur Blake est une sorte de microphone. Extérieurement, il affecte la forme d'une boîte verticale suspendue à une paroi, avec embouchure sur la face antérieure et quatre serre-fils. Derrière l'embouchure se trouve un diaphragme ordinaire métallique. Quant à l'intérieur de la boîte, en voici la disposition. En arrière et au centre du diaphragme est fixée perpendiculairement une tige en métal ou en charbon de cornue extrêmement courte, qu'un ressort fait presser légèrement contre le diaphragme. Derrière la tige et appuyant contre elle au moyen d'un second ressort, se trouve un cylindre compacte de noir de fumée. La partie de la petite tige qui touche ce cylindre est appointie et si la tige est, un charbon de cornue, cette pointe est platinée pour assurer un bon contact. Quand maintenant le diaphragme est mis en vibration par la voix humaine ou autrement, la tige exerce, par secousses, des pressions réitérées contre le cylindre de noir de fumée et la résistance électrique de celui-ci varie en conformité de ces pressions. Les deux ressorts qui soutiennent la tige ^ le cylindre de noir de fumée, font partie d'un circuit Métrique local où sont en outre intercalés une pile de quelques éléments, de préférence Leclanché ou Callaud, et le fil primaire d'une petite bobine d'induction. Lorsque 'instrument est intercalé pour la transmission, le courant continu prend donc le chemin suivant. Partant du pôle positif de la pile il passe à travers la tige et le cylindre de noir de fumée; puis il parcourt le fil primaire de la bobine d'induction et retourne au pôle négatif de la pile. L'intensité de ce courant continu variant suivant la pression exercée par le diaphragme sur la tige et le cylindre de noir de fumée, ces variations produisent dans le fil secondaire de la bobine des courants d'induction que le fil de ligne conduit à l'autre station où ils passent par un téléphone Bell ordinaire ou toute autre espèce de téléphone perfectionné. L'appel s'effectue au moyen d'une sonnerie qu'actionne un courant électrique. Dans le système Blake, l'installation téléphonique exige l'emploi d'un permutateur pour interrompre le circuit local et intercaler la sonnerie quand les téléphones sont au repos. Le système du réglage de la pression est simple et ingénieux. - Le transmetteur d'Edison ressemblant beaucoup à celui de Blake, nous nous bornerons à indiquer les parties par lesquelles il en diffère. Un petit cylindre creux en laiton est collé par une matière isolante au diaphragme. Ce cylindre presse en trois points sur un disque en charbon de cornue d'un diamètre d'environ 16mm, revêtu du côté du diaphragme d'un dépôt galvanique de cuivre. Ce disque repose sur un autre disque de noir de fumée, de même diamètre et d'un millimètre d'épaisseur environ, lequel à son tour appuie contre une plaque métallique. Une vis sert à régler la pression. Le récepteur est un téléphone Bell, de préférence du système modifié par M. Phelps sous le nom de « Pony-Crown-Telephone. » Il est très petit et possède un aimant recourbé en cercle qui sert en même temps de poignée. Il suffit de un à trois éléments Leclanché pour produire le courant local qui circule dans le transmetteur à charbon et le fil primaire de la bobine d'induction. La « Gold and Stock Telegraph Company» à New-York qui paraît investie des droits d'exploitation de ce téléphone, combine les deux instruments avec une sorte de petit pupitre qui porte, en outre, une sonnette d'appel, un permutateur automatique et un petit bouton de contact pour l'appel. Le transmetteur est fixé par un bras à la gauche du pupitre, ce qui permet de lui donner la position convenable pour correspondre, tout en laissant les deux mains libres. Au côté droit du pupitre est suspendu à une corde en double fil métallique le téléphone Phelps. Le crochet qui maintient ce téléphone dans les moments de repos, n'est autre chose que le permutateur automatique. En décrochant le téléphone, le permutateur se déplace, intercale la pile locale et généralement établit les communications nécessaires. Quand le téléphone Phelps est suspendu à son crochet, le transmetteur et le récepteur sont exclus du circuit, et à leur place se trouve intercalée la sonnerie d'appel. Nous avons pu nous convaincre, par notre propre expérience, de l'efficacité de ce téléphone. C'est le plus parfait que nous connaissions. La reproduction de la parole y est extrêmement distincte et n'a rien de confus. Les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les communications téléphoniques et même celles qui ont l'ouïe un peu dure, saisissent néanmoins dès le premier moment tout ce qui est transmis par ce téléphone. Si, au lieu d'un seul récepteur, on en emploie deux, en en appliquant un à chaque oreille, la conversation n'est pas troublée par les bruits extérieurs même très-forts. L'usage de ce téléphone n'est donc pas limité à des locaux tranquilles. Son prix est, il est vrai, un peu élevé. Tandis, eu effet, qu'un couple de téléphones Siemens coûte 87 frs. 50. et un couple de téléphones Gower 200 frs, deux pupitres Edison-Phelps reviennent à 470 francs. Depuis bientôt un an, on parle d'un nouveau téléphone d'Edison, c'est-à-dire d'un récepteur électrochimique qui, dans l'installation que nous venons de décrire, remplacerait le récepteur Phelps et qui donnerait de merveilleux résultats. Ce récepteur est basé sur le principe déjà appliqué par M. Edison dans son électromotographe. Comme d'ordinaire, il comporte un diaphragme, mais ce diaphragme est en mica. Au centre est fixée une tige mince de quelques centimètres de longueur, dont la pointe recourbée, repose sur un cylindrique de chaux imbibé d'une solution d'hydrate de potasse et d'acétate de mercure. Les impulsions électriques engendrées dans le fil secondaire de la bobine d'induction à la station correspondante, s'écoulent à la terre par la tige et par le cylindre de chaux. Quand on tourne le cylindre, le frottement considérable de la chaux a pour effet d'avancer un peu la pointe de la tige et le diaphragme se courbe légèrement vers l'intérieur, prenant une forme concave; mais chaque courant qui passe de la pointe au cylindre diminuant le frottement, la tige revient en arrière et, le diaphragme peut, suivant la force et durée du courant, arriver à reprendre plus ou moins exactement la forme plane. Les impulsions du courant se transforment donc mécaniquement en vibrations du diaphragme de mica. L'inconvénient de ce téléphone consiste dans l'obligation de tourner le cylindre avec une manivelle aussi longtemps qu'on doit recevoir. A la réunion annuelle des naturalistes américains, à Saratoga en 1879, ce téléphone, exhibé par M. Edison lui-même, a produit une grande sensation. Nous avons lu aussi de divers côtés des appréciations très-enthousiastes, mais ne le connaissant que par les comptes-rendus, nous ne pouvons juger ce système d'après nos expériences personnelles. Un fait, toutefois, qui s'est produit récemment, serait de nature à éveiller nos doutes à son égard. Une Administration télégraphique ayant, à notre connaissance demandé l'automne dernier à un électricien renommé des Etats-Unis, l'envoi d'un couple des meilleurs téléphones qui existent en Amérique, cet électricien n'a pas même mentionné le téléphone électrochimique, et ce sont les transmetteurs à charbon et les téléphones Phelps qu'il a choisis. Quoi qu'il en soit, l'inefficacité de tel ou tel système n'est plus un obstacle à la généralisation du téléphone. Il existe actuellement des spécimens assez parfaits pour que, dans toutes les conditions, n'importe qui puisse s'en servir sans incertitude ni confusion. Passons maintenant à la seconde raison qui nous paraît entraver la généralisation rapide des téléphones en Europe. En Amérique il n'y a pas de monopole télégraphique. Les Sociétés téléphoniques n'ont à compter qu'avec les propriétaires dont elles empruntent le terrain pour poser leurs lignes. En Europe, le téléphone est, avec raison, regardé comme relevant du monopole de la télégraphie. Les intéressés ont bien cherché à faire placer le téléphone en dehors des communications i électriques dont l'exploitation est réservée à l'Etat, mais ces prétentions ne résistent pas à l'examen impartial de la question. Il suffit de se demander ce que la loi a, par le monopole de la télégraphie, entendu attribuer à l'Etat pour reconnaître de suite que le mode de transmission électrique n'est pas limité aux communications dont le sens se révèle par l'intermédiaire de la vue et qu'il s'étend à celles dont la connaissance parvient à l'esprit par le canal de l'oreille. S'il y avait là pour le téléphone un titre à échapper au monopole légal, il en serait de même pour nombre d'appareils qu'utilise depuis longtemps la télégraphie électrique, par exemple, les parleurs, les récepteurs à cloche, etc. Du moment que le courant engendré à l'extrémité d'une ligne se traduit à l'autre extrémité par un langage intelligible, il y a télégraphie électrique. Or, la fonction du téléphone rentre évidemment dans les limites de cette conception. Partant de ce point de vue, les Administrations ne sauraient considérer les installations téléphoniques privées comme échappant à leur action et elles doivent ou les prohiber complètement ou les soumettre à un droit de concession. Admettons même le cas peu probable où une jurisprudence étroite arguerait, dans certaines législations, des termes d'une loi qui n'a pu prévoir le téléphone, Pour contester à l'Etat ses droits régaliens, il serait toujours facile, ce semble, d'obtenir des pouvoirs publics une nouvelle loi ou une modification plus compréhensive de la loi existante, qui soumettrait le téléphone au monopole qui est à la base du service télégraphique. Telle a été, en effet, l'attitude des Administrations télégraphiques dans tous les pays où le téléphone a cherché à s'implanter. En Angleterre, l'Office britannique a paru, d'abord, vouloir interdire les circuits téléphoniques, et s'il semble maintenant revenu de cette idée première, ce n'est qu'en imposant aux établissements de ce genre une redevance assez élevée. En France, les Compagnies téléphoniques ont dû, pour pouvoir poser leurs fils et ouvrir leur exploitation, se pourvoir de concessions de l'Etat, concessions toujours révocables et soumises aussi à des redevances déterminées. En Suisse, chaque kilomètre de fil téléphonique est imposé d'une redevance annuelle de dix francs et la concession n'est donnée que sous des clauses spéciales garantissant le secret des dépêches télégraphiques proprement dites. Les autres Administrations ont, sans doute, garanti leurs droits par des précautions de même nature. Actuellement où le téléphone est encore dans son enfance, ces précautions peuvent suffire ; mais cet enfant grandira et il y a lieu de craindre qu'en dépit de toutes ces restrictions, le téléphone ne vienne briser un jour le monopole télégraphique, si les Administrations ne se décident pas dès maintenant à le monopoliser complètement, c'est-à-dire à établir et à exploiter elles-mêmes les réseaux téléphoniques. Dans notre opinion, c'est en entrant hardiment dans cette voie que l'Etat pourra lutter efficacement contre les atteintes à son monopole, car les circuits téléphoniques nous paraissent appelés à un tel avenir qu'ils ne tarderont pas à accaparer toutes les communications intérieures des villes. Que fera-t-on alors ? Essaiera-t-on de mettre en communication le bureau central de l'Etat et les bureaux centraux des exploitations téléphoniques indépendantes ? Mais ne serait-ce pas là un commencement d'abdication ? Ce résultat fatal, il faut donc le prévenir à temps, et le moyen c'est d'englober le téléphone dans la télégraphie ! Il va sans dire que cette absorption n'empêcherait point d'accorder aux particuliers des concessions pour des lignes téléphoniques isolées, de même que l'Etat concède actuellement des lignes télégraphiques d'intérêt privé. Cette ligne isolée ne porte aucun préjudice au monopole gouvernemental tant qu'elle reste indépendante du réseau Public, mais ce qu'il ne faut pas aliéner, même contre de redevance élevée, ce sont les réseaux urbains, car c'est toujours chose difficile que de racheter des privilèges une fois qu'on les a laissés échapper. Ce que butent aux Gouvernements les rachats des chemins de fer ce qu'a coûté à l'Office britannique le rachat de ses télégraphes, est un exemple et une leçon. Pour nous bien pénétrer de cette vérité que les «téléphone exchanges » ne sont que de la télégraphie, jetons un coup d'œil sur la manière dont ces entreprises ont organisé leurs Offices centraux dans les villes américaines. Tous les fils qui desservent différents souscripteurs aboutissent à un centre commun, chacun d'eux passant par un électro-aimant spécial devant lequel une plaque légère couvre un numéro qui est le numéro de l'abonné. Quand celui-ci — le client 23, par exemple — pousse son bouton d'appel, le couvercle de l'électroaimant correspondant tombe et le numéro 23 apparaît. Un certain nombre d'agents, jeunes garçons et jeunes filles, surveillent continuellement ces numéros et aussitôt que le couvercle tombe, on prévient par l'appel « hallo » le client N" 23, celui-ci répond: «je désire être mis en communication avec tel numéro, par exemple le numéro 47.» Ce désir est communiqué au «switchman» qui dirige le grand permutateur (switch) qui se trouve au milieu de la salle. Le switchman (souvent il y en a plusieurs) a à sa disposition un certain nombre de petites cordes métalliques se terminant à chaque extrémité par une fiche. Il prend une de ces cordes, place une des fiches dans le trou 23; l'autre dans le trou 47 et les deux clients se trouvent en communication directe. Toutes ces opérations demandent moins de temps que leur description. Souvent le bureau central est organisé de façon que le demandeur d'une communication est avisé, par les mots «ail right», quand l'Office central a établi la communication demandée et que la fin de l'entretien des deux interlocuteurs est indiquée à l'Office central par un nouveau signe qui frappe à la fois l'oreille et l'œil et attire ainsi l'attention des employés sur les deux numéros dont la communication peut être interrompue. Les dispositions de détail varient légèrement, suivant les Sociétés et les instruments qu'elles emploient. Nous nous bornerons à décrire, dans ses détails, l'une des méthodes les plus en usage et dont la connaissance peut donner l'idée du mode de fonctionnement. Supposons que le nombre de souscripteurs soit assez grand pour qu'ils ne puissent être tous réunis dans un seul et même permutateur. On augmente alors le nombre de ces derniers qui s'élève quelquefois à 10 et même à 20. Au-dessous de la rangée des permutateurs est disposée une série de rails métalliques isolés l'un de l'autre et passant devant chacun d'eux. Au commencement du service, les switchinen se rangent à l'une des extrémités de la série des permutateurs. Le premier client demandant une communication, est desservi par le premier switchman qui, après avoir accompli sa tâche, vient se mettre à l'extrémité de la rangée de ses collègues; c'est au second switchman à desservir le second client et ainsi de suite. I Chaque switchman reste avec son client jusqu'à ce qu'il se soit assuré que la communication demandée est bien établie. Le long des permutateurs sont disposés un certain nombre de « switchman's téléphones. » Dans ces téléphones portatifs, le transmetteur et le récepteur sont réunis en une seule pièce, de sorte que quand on porte le récepteur à l'oreille, le transmetteur se trouve devant la bouche. Le switchman met la fiche de la corde téléphonique dans le trou du client et le prévient par l'exclamation « hallo » ou « well, sir ? » Ayant appris avec quel numéro le client désire être abouché, si ce numéro se trouve dans un autre permutateur, il détache la corde du téléphone et la fixe avec l'autre fiche à un rail non encore occupé. Alors il se rend au permutateur où figure le numéro demandé, place la fiche d'une corde dans le ti*ou en question et avec une seconde corde également à fiche, il frappe trois fois sur une plaque qu'une pile met en communication avec la terre. La sonnerie de la personne appelée fonctionne et avec son téléphone le switchman se met en communication avec le client. Aussitôt cette communication établie, l'autre fiche de la corde est fixée au rail qui la relie au premier permutateur et le switchman peut alors correspondre avec les deux clients et les informer qu'ils sont reliés en circuit direct. Chaque rail communique avec la terre par l'intermédiaire d'un relais très-sensible. Quand les deux clients ont fini leur entretien, l'un d'eux presse son bouton d'appel, le relais réagit, ferme une pile locale dans l'Office central et un signal très-apparent indique que tel et tel rail devient libre, sur quoi on retire les fiches. Avec le nombre des clients, les difficultés de l'Office central augmentent rapidement, comme on a pu le voir par l'article publié dans notre dernier numéro, p. 583; mais MM. Haskins et Wilson seraient, paraît-il, arrivés, par une combinaison ingénieuse, à triompher de ces difficultés. Il serait trop long de donner ici la liste de toutes les villes américaines qui possèdent déjà des téléphone exchanges avec un nombre plus ou moins grand de souscripteurs. Disons seulement qu'à Cincinnati où il y a plus de 800 souscripteurs, les demandes de communications faites à l'Office central dépassent 6000 par jour; En Europe, c'est dans les villes anglaises que les communications téléphoniques semblent prendre le plus facilement. Londres, Manchester, Liverpool, Glasgow, Shèffield, Hull, Durham, Birmingham ont déjà leurs télé phone Compagnies; quelques-unes de ces villes même en ont deux ou trois se faisant concurrence. A Manchester, on se propose de relier téléphoniquement entre elles les places de Boehdale, Oldham, Ashton, Bolton, Bury, Middleton, Stalybridge et Stockport. Sur le continent, nous ne trouvons guère encore à nommer que Paris, où trois Compagnies de téléphones se sont constituées et ont commencé par se faire la guerre jusqu'à ce qu'elles aient trouvé plus profitable à leurs intérêts de s'amalgamer. Quant à l'application du téléphone à des lignes particulières, elle est très-répandue. On en trouve dans les stations de chemin de fer, les hôpitaux, les châteaux, les grands établissements industriels, même les églises. Ce sont les célèbres brasseurs Bass et C° qui ont peut-être le réseau particulier le plus complet, avec leurs 12 fils partant d'un bureau central vei-s leurs différents établissements. La Soufheni-Railroad-Pittsburgh-Washington Gy a remplacé ses appareils télégraphiques par des téléphones. Le téléphone est établi à Windsor Castle et au palais Buckinghnm. Les journaux Le Figaro et Le Temps ont leurs circuits téléphoniques. Pour les téléphones exchanges, les fils doivent la plupart du temps être des fils souterrains, par cette raison déjà que ces réseaux sont établis à l'intérieur des villes, et aussi à cause du grand nombre de fils qui doivent rayonner du bureau central dans toutes les directions. La nouvelle invention de M. Brooks qui consiste à réunir les fils dans des tubes à gaz remplis de pétrole, semble avoir beaucoup facilité l'établissement de ces réseaux La règle des Compagnies téléphoniques est de procéder exclusivement par location. La jouissance des lignes, des instruments et l'entretien des uns et des autres sont assurés aux souscripteurs moyennant une redevance annuelle fixe En Amérique cette location annuelle est de 7.5 à 8 dollars; à Londres, on demande 20 £ si la ligne ne dépasse pas 1600m de longueur; à Paris le loyer varie entre 500 et 1000 francs. Nous avons jeté un rapide coup-d'oeil sur le mouvement téléphonique qui se prépare à envahir l'Europe. Notre génération peut se féliciter d'être dotée de cette nouvelle facilité de communication qui, par le temps qu'elle fait gagner journellement, tend à prolonger la vie, mais, nous le répétons encore une fois, le moment est venu pour l'Etat de prendre en main l'exploitation de ce moyen merveilleux de communication, car les telephones exchanges ne tarderont pas à devenir une puissance qu'il sera plus tard difficile de déposséder. sommaire |
Jusqu’à l’année 1881, année
de l’Exposition universelle qui s’est tenue à Paris,
les pouvoirs publics ne portèrent pas attention à la diffusion
du téléphone, ce qui explique qu’il ne fut pas une
priorité des politiques officielles d’équipement. Entre
l’alternative d’un financement par l’État ou la
concession, c’est la seconde qui fut choisie. C’est d’ailleurs
la règle générale depuis Louis Philippe et le télégraphe.
D’autres raisons motivèrent le choix de la concession. La
première raison est que l’administration du télégraphe
est en crise. Le développement d’une nouvelle technique nécessite
beaucoup d’investissements et
l’administration n’est pas en mesure de les apporter. «
En 1877, une des premières décisions du gouvernement républicain,
revenu au pouvoir après l’intermède Mac Mahon, a été
de provoquer la fusion, au sein d’un même ministère
des Postes et Télégraphes, puisque jusqu’alors la poste
dépendait du ministère des Finances et les télégraphes
du ministère de l’Intérieur. (…) Par ailleurs,
la tendance économique générale est à la multiplication
des concessions, en particulier des régies urbaines : compagnies
des eaux ou des tramways électriques ». Or, jusqu’en
1884, la technique du téléphone n’autorise que des
réseaux urbains, il parait logique d’adapter le même
système de concession. Ainsi, le ministère des PT laisse
le soin à l’initiative privée de développer
l’ensemble de l’exploitation téléphonique de Paris.
Le système de la concession, procédure qu’ont également
connue les chemins de fer, fut par conséquent adopté pour
permettre de garder un certain contrôle.
Revenons sur Clément Ader, devenu l'INGENIEUR-CONSEIL
DE LA SGT qui lui achète les droits d'exploitation de ses brevets
.
Il a innové et construisit ses premiers appareils dans les ateliers
Bréguet, Ils sont équipés d'un microphone
à crayon de charbon de sa conception et de deux écouteurs
aussi de sa conception. Ader ne sera pas salarié de la soiété,
il préféra se contenter d'un intéressement et des
droits d'exploitation négociés avec la SGT. Ceal lui permit
d'acheter un pied à terre sur Paris, 68 rue de l'Assomption ou
il installe son laboratoire.
Ader revenant aux fondamentaux de Hughes et de Crossley, construit
le microphone composé de 10 bâtons en charbon montés
sur 3 traverses.
Il est très simple à fabriquer et pas onéreux, facile
à installer, ne nécessite aucun réglage : il est
donc très avantageux.
 Le microphone de Crossley
(à gauche ) et le micro Ader
Le microphone de Crossley
(à gauche ) et le micro Ader 



Brevet US274246A approuvé
le 20 Mars 1883
Le téléphone longue distance d’Edison les concurrençait
sur le territoire américain et la conquête du marché
français ouvrait ainsi de nouveaux débouchés.
....
 ..
.. 


Ces modèles sont aujourd'hui recherchés par tous les collectionneurs
de vieux téléphones .
En 1880 le système Crossley est installé
sur les réseaux de Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes, puis sera
commercialisé par la SGT jusuq'en 1890 pour la province.

 Microphone Crossley à charbon qui inspira Ader.
Microphone Crossley à charbon qui inspira Ader.
1880 vu dans L’électricité N°19 du 5 octobre
1880 L’électrophone Louis Maiche
(son parcours en détail)
Le système de communications téléphoniques
imaginé par M. Louis Maiche se compose de deux appareils qui
sont tous deux semblables à celui que nous allons décrire
et qui sont mis en rapport A. une distance quelconque par un fil télégraphique.
  L’électrophone de ce physicien se compose d’une boite en bois AA ayant environ 25 centimètres de côté, devant laquelle se place la personne qui veut parler. L’intérieur de cette caisse est doublé d’une seconde caisse en verre B, isolée de la première pur une épaisse couche de ouate CC ; c’est cette caisse en verre qui reçoit les ondes sonores produites par la parole et transforme le mouvement vibratoire de l’air en action mécanique se résumant par une différence de pression sur deux billes en charbon D, qui fixées à deux charnières E E reçoivent le courant électrique d’une pile composée d’un ou deux éléments et transmettent les différences d’intensité résultant des différences de pression à un téléphone Identique situé à une distance quelconque et servant de bobine d’induction au moyen des conducteurs ordinaires. La bobine d’induction, les boules en charbon et les conducteurs qui les relient sont disposés de manière à n’avoir jamais besoin d’être touchés ni réglés. L’appareil, tel qu’il est sur le dessin, peut fonctionner indéfiniment sans aucune espèce de réparation et entre toutes les mains. A gauche se trouve un petit bouton G, semblable à ceux des sonneries électriques d’appartement. Quand on parle à une distance de la cloche en verre, qui peut aller jusqu’à plusieurs mètres, celle-ci vibre à l’unisson de l’air, et ses vibrations se transforment instantanément et complètement en effets mécaniques se traduisant par des différences de pression des deux boules en charbon, lesquelles déterminent dans la bobine les courants induits qui peuvent être recueillis à la station d’arrivée de la même manière qu’ils ont été produits, c’est-à-dire à l’aide de la bobine de Ruhmkorff du récepteur. Les mouvements moléculaires du verre, dont la surface est cent fois plus grande que celle du disque vibrant d’un téléphone ordinaire, acquièrent une grande intensité en se concentrant ou se totalisant sur le point où reposent les boules en charbon. L’intensité des effets ainsi accumulés permet de donner aux boules en charbon et aux pièces qui les supportent des dimensions et un poids qui assurent une parfaite stabilité et dispensent de toute espèce de réglage, en se plaçant bien au-dessus de toutes les causes de dérangement. Il n’y a plus rien là qui rappelle le microphone, et cependant la sensibilité de l’appareil est si grande qu’une résistance de quinze cents kilomètres n’empêche pas d’entendre distinctement les battements d’une montre et le souffle de la respiration. Parmi les expériences les plus intéressantes qui ont eu lieu sur l’électrophone, nous citerons l’essai qui a été fait entre la Chambre des députés et le Sénat ; un autre entre le Bureau central des lignes télégraphiques de Paris et celui de Versailles. Deux autres postes sont établis dans les conditions les moins favorables qui puissent se présenter, sans que le résultat en soit influencé en quoi que ce soit. L’un relie les forges d’Antoigné (Sarthe) à la gare de Monbizot ; l’autre, partant également des forges d’Antoigné, relie cet établissement avec les bureaux de M. Chappée, leur propriétaire, situés au Mans, à une distance de 28 km environ. Le fil est disposé sur les poteaux ordinaires qui supportent les fils de l’État et ceux de la Compagnie du chemin de fer de l’Ouest. Le voisinage de ces fils n’a rien de nuisible ; le retour se fait par la terre comme dans les installations télégraphiques ordinaires. Dans l’atelier de M. Louis Maiche, que nos abonnés pourront visiter, à notre recommandation, en nous en adressant la demande, nous avons pu entendre une conversation en intercalant dans le circuit un morceau de bois blanc d’une épaisseur d’un décimètre, et même une cloche de verre, sans que le son de la voix fût très notablement diminué. Pour exécuter ces belles et curieuses expériences, il faut appliquer de chaque côté de la substance intercalée une feuille d’étain semblable à celle d’un condensateur. Cette circonstance montre admirablement l’extrême facilité que les courants d’induction ont à se propager malgré les obstacles dont leur route est semée. Elle permet de concevoir l’espérance que le courant téléphonique ainsi constitué puisse être utilisé pour faire franchir à la parole humaine des mers profondes. |
Dès que les premiers réseaux téléphoniques
urbains furent installés en France, la lutte s'engagea entre les
constructeurs d'appareils.
Certains réseaux étaient exploités par la Société
générale des téléphones, d'autres restaient
la propriété de l'État,
Évidemment, la Société n'admettait sur ses réseaux
que les appareils dont elle possédait les brevets; mais l'État
restait libre d'adopter pour son service tels appareils qui lui convenaient;
il avait intérêt même, tout en n'admettant que des
instruments de premier choix, à établir la concurrence entre
les fabricants, de façon à faire profiter les abonnés
des perfectionnements que cette concurrence ne manquerait pas de faire
naître.
Pour le bonheur des collectionneurs d'aujourd'hui, le nombre des types
de téléphones, d'abord restreint, augmenta rapidement, à
mesure que la téléphonie elle-même se développait.
En juin 1880, Cornéluis Herz
suivant ses travaux pour la téléphonie il put faire entendre
son "condensateur parlant".
c'est un téléphone à condensateur étudié
pour s'affranchir des longues distances. Mais ce sysème ne sera
jamais adopté en pratique.
En 1881 M. le Dr Herz voulut faire l'expérience de ses appareils
dans des conditions réellement pratiques.
Un certain nombre de lignes télégraphiques de l'État
furent mises à sa disposition, et il put même opérer
sur un câble sous-marin, entre Brest et Penzanec (Angleterre).
Avec ce câble, dans lequel les transmissions télégraphiques
présentent tant de difficultés, on obtint la transmission
assez nette de la parole, Avec les lignes télégraphiques
aériennes la réussite fut plus complète.
Les expériences furent faites, avec succès, d'Orléans
à Blois, puis d'Orléans à Tours. On transmit
ensuite d'Orléans jusqu'à Poitiers, Angoulème,
et enfin Bordeaux, où la distance atteignit 457 kilomètres.
La transmission était parfaitement nette, et les conversations
se faisaient avec la plus grande facilité.
On voulut obtenir davantage; on porta la distance à 1140 Km.
A cet effet, on opéra entre Brest et Tours, en passant par Paris.
A cette distance énorme, on put envoyer et recevoir distinctement
des mots et des phrases.
...
La Compagnie des chemins de fer du Nord fit faire plusieurs expériences
de téléphonie à grande distance entre Paris et Saint-Quentin
et entre Paris et Amiens (retour par Creil). La longueur de la ligne sur
laquelle on opérait dans ces dernières conditions, est de
260 kilomètres environ.
La Compagnie des chemins de fer de l'Est, ainsi que les autres
Compagnies se livrèrent aux mêmes expériences ou se
prêtèrent à celles que l'on voulut faire sur des distances
plus grandes encore.
M. de Parville écrivait à ce sujet : « On a fait au
mois d'août 1880, des expériences intéressantes sur
les transmissions téléphoniques à l'administration
centrale des télégraphes et sur nos principales lignes de
chemins de fer. Après les incertitudes et les tâtonnements
de la première heure, le téléphone entre définitivement
dans le domaine de la pratique.
Déjà, aux États-Unis, on se sert du téléphone
dans les principales grandes villes pour correspondre d'un quartier à
l'autre. Tout porte à croire que Paris va posséder à
bref délai son réseau téléphonique. Chaque
particulier pourra se faire entendre d'un bout à l'autre de la
ville et converser à l'aise à quelques lieues de distance.
Nous croyons bon, à ce propos, de faire connaître sommairement
les résultats des essais qui sont en cours d'exécution.
A l'administration, les expériences entreprises sur l'initiative
du Ministre des Postes et des Télégraphes ont lieu entre
Paris et Versailles, Asnières et Sceaux.
« La distance entre Paris et Versailles est de 21 kilomètres;
entre Paris et Asnières, de 8 kilomètres; entre Paris et
Sceaux, de 10 kilomètres.
Les téléphones sont installés à Paris dans
la salle n° 25 du bureau central, au milieu de laquelle fonctionnent
sans interruption plus de 100 appareils Hughes et Morse. Il était
bon de savoir si, malgré le bruit des manipulations, on pourrait
se servir utilement des téléphones.
« Les téléphones sont en relation avec les fils télégraphiques
ordinaires. Jusqu'aux fortifications, c'est-à-dire sur un parcours
de 4 kilomètres, les fils sont enfermés dans des câbles
; c'est seulement hors de Paris que la ligne devient aérienne jusqu'à
destination. Les transmissions se font par un seul fil. Le retour a lieu
par la terre.
« Dans une première expérience, la communication avec
le sol a été faite en commun avec celle des autres appareils;
dans une seconde, on a relié avec la terre hors de Paris ; dans
une troisième, seulement, à Asnières. Les transmissions
ont été excellentes dans tous les cas, mais naturellement
encore plus accentuées dans la troisième expérience.
« Les essais du bureau central ont été
exécutés avec le téléphone Edison, le
seul à à notre avis, qui, dans l'état, actuel des
choses, donne des résultats satisfaisants aux grandes distances.
Les premières expériences effectuées mettent hors
de doute que l'articulation de la voix est bonne et que les sons se distinguent
nettement avec le téléphone Edison. Pendant plus de deux
heures, les différents employés de l'administration ont
pu communiquer avec leurs collègues des bureaux télégraphiques
de Versailles, Asnières et Sceaux. Les cours de la Bourse ont été
transmis ainsi sans erreur. Les noms propres ont seulement produit de
l'hésitation chez quelques agents. Il semble préférable
de les transmettre lettre par lettre, comme s'il s'agissait de communications
télégraphiques ..............
« Les expériences entreprises par les chemins de fer sont
encore plus concluantes.
Au chemin de fer de l'Ouest, M. Noblet, chef du service télégraphique,
a mis en service un téléphone Edison entre Paris et Saint-Germain
(21 km.), Paris et Mantes (37 km.), Paris et Rouen (140 km.). On se sert
du fil télégraphique aérien sur les poteaux de Saint-Germain;
il est bon de dire toutefois que ce fil est réuni dans un câble,
sur une longueur de 400 mètres environ, avec les autres fils de
la ligne dans la traversée des tunnels.
Les transmissions se font très nettement, plus rapidement et plus
commodément qu'avec les appareils télégraphiques.
Les résultats obtenus de Paris à Mantes ont été
excellents.
De Paris à Rouen la parole arrive nette aussi ; l'intensité
du son est seulement un peu affaiblie ; certains mots doivent être
répétés.
« Sur la ligne du Nord, M. Lartigue a établi un téléphone
Edison, de Paris à Creil (50 km.), de Paris à Creil
par Pontoise (65 km.), de Paris à Amiens avec retour par Creil
(260 km).. Sur les deux premières lignes les communications n'ont
rien laissé à désirer. On a pu parler sans perdre
un mot de la conversation. Sur la troisième, après un parcours
de 260 kilomètres, les sons sont arrivés affaiblis ; pratiquement,
la limite de transmission semble atteinte; il faut élever la voix
et répéter quelquefois le même mot pour pouvoir se
faire entendre. On ne saurait encore dire si l'affaiblissement des sons
est dû à la grande distance franchie ou aux. pertes de courant
résultant des dérivations à la terre.
« Au chemin de fer de l'Est, le téléphone
Edison a été employé entre Paris et Lagny (28 km.)
et Paris et Meaux (40 km.). De l'avis unanime, les transmissions ont été
parfaites........
« En somme, il n'y a aucun doute à avoir maintenant sur ce
point. On peut, en se servant des fils aériens ou souterrains porter
la voix nettement et assez fort à plus de 50 kilomètres
avec le téléphone à charbon et à pile d'Edison;
on peut parler aussi facilement à 5 kilomètres avec le téléphone
magnétique de Phelps, Gray, Gower, en s'isolant du bruit des voitures
et des conversations. Mais le téléphone ne rendra de services
réels aux chemins de fer et aux particuliers que sur des distances
peu grandes; il est évident qu'il y aura surtout avantage à
établir des communications entre les points extrêmes de la
ville et principalement entre le centre de la zone suburbaine et les petites
villes ou les groupes de villas des environs.
Le téléphone Edison reste très pratique dans ces
conditions d'exploitation.
« En résumé, il résulte de ces détails
qu'il est aujourd'hui parfaitement démontré qu'avec des
lignes convenables on peut transmettre la parole à des distances
qui sont, en pratique, largement suffisantes pour assurer le service téléphonique
d'une grande ville. C'est un progrès. »
La même année, le général de Nansouty, qui
a créé au sommet du pic du Midi-de-Bigorre, dans le département
des Hautes-Pyrénées, un observatoire météorologique,
fit installer sur la montagne un téléphone qui met la station
scientifique du pic en communication avec la station télégraphique
de la petite ville do Bagnères-de-Bigorre. La distance est de 26
kilomètres.
D'autres installations téléphoniques particulières
furent également établies à Paris et dans plusieurs
villes de province.
en1880, par : l’Angleterre, la Belgique, le Danemark, la Hollande, la Norvège, la Suède, l’Allemagne;
en 1881 par: l'Autriche, l’Italie, le Portugal, la Suède;
en 1882 par : la Hongrie, la Russie;
en 1883 par la Chine;
en 1885 par l’Espagne
Dès 1880, une prospection commerciale fut entreprise
par la S.G.T. pour constituer des réseaux dans différentes
grandes villes de province.
La S.G.T. mit en service successivement les réseaux de
- Lyon, le 15 octobre 1880,
- Marseille, le 15 décembre 1880,
- Nantes, le 15 janvier 1881,
- Le Havre, le 15 avril 1881,
- et Bordeaux le 30 juin 1881.
| Le
premier appareil téléphonique à la Présidence
de la République fut installé en novembre 1880. On a procédé à l'Elysée, sous la surveillance du bureau télégraphique, à la pose et installation d'un téléphone dans le cabinet du président de la République. Cet appareil est relié par des fils spéciaux aux bureaux de la présidence de la Chambre, à ceux de la présidence du Sénat et à tous les ministères. Voici comment la presse de l'époque rapporta l'évènement : "On a procédé il y a quelques jours à la pose de l'appareil qui est relié par des fils spéciaux aux bureaux de la Présidence de la Chambre des Députés, à ceux de la Présidence du Sénat et aux différents ministères, de manière que le chef de l'Etat puisse communiquer verbalement avec tous les membres du gouvernement chaque fois qu'il sera nécessaire". Mais en fait cette installation fut réalisée à l'insu du Président. Le poste "Ader" du Président Grévy  et
et  Monsieur
Cochery Ministre des Postes et Télégraphes Monsieur
Cochery Ministre des Postes et Télégraphes Ecoutons Clément Ader relater dans ses mémoires comment les choses se sont réellement passées : "Monsieur Grévy était Président de la République, Monsieur Cochery Ministre des Postes et Télégraphes et Monsieur Caël Directeur de la région télégraphique de Paris. Le téléphone était peu connu à cette époque. Le Président ne témoignait aucun désir de l'avoir et cependant il fallait, dans ses hautes fonctions, qu'il en eût un à portée de main, sur sa table de travail. Un jour, à l'insu du Président, nous installâmes une ligne téléphonique depuis le ministère des Télégraphes jusqu'au bureau de l'Elysée, aboutissant à un téléphone placé sur le bureau du Président". Lorsqu'il entra dans son cabinet, l'appareil attira tout de suite son attention. Le régisseur, prétextant une raison de service, s'y trouvait déjà. Le Président lui demanda : "que signifie cet objet ?, d'où vient-il ? C'est Monsieur Cochery qui a donné l'ordre de le placer là. Dans ce cas, ce doit être un instrument utile !" Et aussitôt le régisseur présente l'appareil au Président en lui expliquant la manière de s'en servir. Pendant ce temps, Monsieur Caël assurait la communication avec le Ministre. On devine l'équivoque qui suivit ces préparatifs. "Mais c'est la voix de Cochery que j'entends, s'écria le Président... Merci cher ami de m'avoir réservé cette surprise. Je ne m'attendais pas à une telle satisfaction !...Merci encore ! " Et Monsieur Cochery, déconcerté par ces remerciements inattendus, ne trouvait à répondre que des : "Ah!...Ah!...bien...très heureux, Monsieur le Président, si j'ai pu vous être agréable !". |
Fin 1880 La France compte
3039 abonnés au téléphone sur le réseau public
de Paris plus 1812 abonnés hors de Paris.
En 1880, le
réseau téléphonique de Paris n'avait que 440 kilomètres
de développement.
Ader continue ses expérimentations, et dépose
de très nombreuses additions à son brevet initial,
ainsi qu’un nouveau brevet pour un appareil permettant de retransmettre
stéréophoniquement (c’est-à-dire en reproduisant
la spatialité de l’écoute grâce à deux
micros et deux écouteurs) une représentation
théâtrale
 Brevet du 13 janvier 1882 US257453
TELEPHONIC TRANSMISSION OF SOUND FROM THEATERS
Brevet du 13 janvier 1882 US257453
TELEPHONIC TRANSMISSION OF SOUND FROM THEATERS
|
1881 l’exposition internationale d’électricité de 1881. Le directeur de cette exposition n'est autre que
Cornélius Herz . Le journal La Lumière
électrique entama une campagne en faveur de l'Exposition
projetée, et contribua puissamment à amener son succès.
L’exposition de M. Edison au Palais de l’Industrie,
occupe deux salons formant à eux seuls une exposition complète
et unique. Le Ministère des Postes et Télégraphes aux commandes.
La plus importante exposition téléphonique
fut celle de la S.G.T . Ce qui détermina le triomphe de la téléphonie,
à l'Exposition d'électricité, celui d'abord
la distribution, à l'intérieur du palais, d'un certain
nombre
Entre le palais du Trocadéro et un autre
palais hâtivement bâti sur le champ de Mars, la galerie
des machines, la galerie du travail, l'exposition sur l'histoire
de l'industrie abritent les merveilles du « siècle
de l'industrie ».
A l'exposition universelle de 1881, on pourra
voir fonctionner le premier commutateur
téléphonique automatique au monde. (brevet automatic
telephone-exchange 22.458 de 1979 ). |
Trente postes téléphoniques
à pupitre Ader sont disponibles sur l'exposition pour communiquer
sur l'ensemble de l'exposition.
Afin de s'isoler du bruit ambiant ils étaient installés
dans des guérites en bois, capitonné à l'intérieur
. Ce sont ces même premières cabines téléphoniques
que l'on commencera à installer sur les réseaux en 1885
!
On découvre ainsi dans les allées de l'exposition les nouveaux
appareils de Wheatstone destinés à la transmission automatique
des dépêches par l'appareil Morse et «augmentant donc
dans une large proportion la capacité des lignes.
Une grande place est accordée également aux appareils imprimeurs
de Dujardin, D'Arlincourt, Bijeon, Digney ou bien encore Hughes. Ces appareils,
ainsi que les appareils autographiques de Meyer et Lenoir issus des travaux
de Caselli, posent les jalons des futurs développements du télex
à partir de la fin des années 1920 et de la télécopie
dans la première moitié des années 1970. Outre les
progrès techniques, l'exposition laisse entrevoir l'importance
croissante de la télégraphie électrique. Depuis l'exposition
de 1867, la télégraphie a confirmé et accentué
son rôle économique et stratégique. Le réseau
des câbles sous-marins dépasse alors la longueur totale de
60 000 milles marins. De réelles évolutions se sont manifestées
dans les modes de réalisation des câbles. De véritables
progrès ont vu le jour dans la technique de pose dans les fonds
sous-marins. Quant aux tentatives de transmissions stimultanées
sur un même fil (transmissions en temps partagé), elles viennent
d'aboutir avec les travaux de Wheatstone, de Meyer et surtout avec les
recherches accomplies par le télégraphiste français
Emile Baudot.
Le téléphone, quant à lui, n'occupe qu'une place
médiocre à l'exposition. L'accueil qui lui a été
fait en 1877 quand Antoine Bréguet l'a présenté à
l'Académie des sciences, est loin d'être enthousiaste. Ce
n'est que discrètement et après bien des pressions —
dont celle de l'empereur du Brésil — qu'il trouve une modeste
place, «perdu» dans des collections d'appareils télégraphiques.
Si le télégraphe et les techniques qui s'y rapportent (dont
le «télégraphe parlant» de Graham Bell) occupent
donc en 1878 un certain espace, nombreux sont les chroniqueurs qui se
plaignent du peu de place accordée aux autres applications de l'électricité
:
Les démonstrations emportèrent l'adhésion des journalistes
mais pas celui du public qui était plutôt interessé
par le phonographe d'Edison.
Le résultat obtenu fut l'inverse de celui attendu.
L'autre succès est le Théatrophone
de Ader , sous l'initiative de Antoine Breguet il réalisa l'installtion
de transmetteurs Ader à l'Opéra de Paris. Des récepteurs
étaient disponibles dans un salon de l'exposition pour pouvoir
écouter à distance ce qui était joué à
l'Opéra.
La maison Breguet et la SGT reçurent un diplôme d'honneur
à l'issue de l'exposition. Clément Ader reçu une
médaille d'or.
Avec plus de 900 000 visiteur, l'Exposition de 1881 réussit,
comme on le sait, au delà de toutes les espérances.
Aussi, dans l'année qui suivit, le Gouvernement français
voulut-il témoigner sa reconnaissance à l'initiateur d'une
manifestation si heureuse pour notre pays, en nommant M. le docteur Herz
officier de la Légion d'honneur.
M. LARTIGUE donne quelques renseignements sur l'installation
des lignes téléphoniques à Paris .
Les fils sont partout doubles , pour éviter l'induction . Pour
les auditions de l'Opéra , il existait dix microphones de chaque
côté de la rampe ; les récepteurs étaient divisés
en 10 séries , de 8 chacune ; chaque microphone correspondant à
8 téléphones , places en tension , destinés chacun
à l'oreille droite d'un auditeur , et le microphone symétrique
à 8 téléphones destinés à l'oreille
gauche . Le récepteur était le téléphone Ader
å surexcitateur . Le courant était fourni à chaque
microphone par 15 éléments Leclanché fonctionnant
successivement par séries de 3 : la bobine intercalée dans
le circuit avait un circuit inducteur dont la résistance était
1 ohm,5 et un circuit induit de 150 ohms . Chaque bobine du récepteur
avait une résistance de 40 ohms : la résistance totale de
chaque récepteur est de 80 ohms .
La société SGT lance en 1881 le Théâtrophone, sur une idée de C.Ader.
 Ecouteurs
à l'exposition
Ecouteurs
à l'exposition  Transmetteurs
Transmetteurs
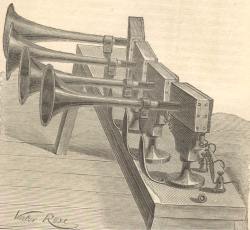 à l'Opéra
à l'Opéra
La SGT se distingua lors de l’exposition internationale d’électricité
de 1881, avec la mise en place dans l’enceinte de l’exposition
du « théâtrophone»
permettant d’entendre les spectacles donnés à l’Opéra
ou à la Comédie française.
Des micros sont installés de chaque côté de la scène
de l'Opéra Garnier et permettent d’écouter l’opéra
en restant chez soi. Il s'agit de simples micro au carbone à simple
phase, une technologie ancienne qui ne permettait pas un très bon
rendu acoustique et musical. Même si les micros sont installés
de chaque côté de la scène cela ne signifie pas que
le spectacle était retransmis en stéréo.
Le système sera rapidement étendu à d'autres salles
de spectacle. Le Tribut de Zamora de Charles Gounod fut le premier opéra
de l’histoire à être retransmis via des fils téléphoniques
dans un autre immeuble. Au lendemain de la quinzième représentation,
on pouvait lire dans Le Ménestrel du 22 mai 1881 : « [Le
téléphone] a été mis en communication avec
la salle de l’Opéra, à l’heure même des
représentations. Réussite complète ! On entendait
parfaitement, rue Richer [dans les magasins de l’Opéra], les
voix de Mmes Krauss, Dufrane, Janvier, celles de MM. Sellier, Melchissédec
et Lorrain, dans Le Tribut de Zamora. » « C'est très
curieux. On se met aux oreilles deux couvre-oreilles qui correspondent
avec le mur, et l'on entend la représentation de l'Opéra,
on change de couvre-oreilles et l'on entend le Théâtre-Français,
Coquelin, etc. On change encore et l'on entend l'Opéra-Comique.
Les enfants étaient charmés et moi aussi »
...
Inventeur et maître d’œuvre de ce système qui fut
l’un des clous de cette exposition, Clément Ader fut récompensé
par une médaille d’or
Ce succès contribua à renforcer les liens entre Ader et
la Société générale des téléphones.
C’est au cours de l’année 1881, en effet, que cette dernière
devint propriétaire des inventions de Clément Ader et qu’elle
s’assura sa collaboration exclusive en matière de téléphonie.
On pouvait lire dans la revue "L'Electricien" de 1881, l'article
de A. NIAUDET .
| Il a été fait ces jours derniers entre
l'Hippodrome et les bureaux de la Compagnie internationale des Téléphones
, 15 , place Vendôme , une expérience intéressante
. L'orchestre de l'Hippodrome , qui joue dans la journée et
le soir pour les deux représentations quotidiennes , a été
entendu par de nombreux invités réunis place Vendôme
. Il y avait là 96 récepteurs téléphoniques
; chaque auditeur en ayant deux , 48 personnes pouvaient entendre
à la fois . Nous allons entrer dans quelques détails sur les dispositions prises par le docteur J. Moser pour obtenir ce résultat . Grâce à la complaisance de l'administration de l'Hippodrome et à celle de la Société générale des Téléphones , on a pu faire usage des deux fils qui servent habituellement à la direction de l'Hippodrome qui compte parmi les abonnés du réseau de Paris . Mais de ces deux fils , il en fallait un pour l'échange des conversations , ordres donnés , avis transmis , etc. , etc. , tout à fait indispensables pour mener à bien une opération exécutée , comme celle - ci , entre deux points éloignés . Il ne restait donc plus qu'un seul fil pour l'audition musicale . Voici comment les appareils étaient disposés à l'Hippodrome . Il y avait 25 transmetteurs microphoniques montés sur une planche unique , placée elle - même un peu inclinée sur l'horizon tale et au - dessus du chef d'orchestre . Les microphones étaient , bien entendu , au - dessus de la planche , protégés de la poussière par une boîle légère . La planche elle - même était suspendue par quatre cordes . La pile agissant sur ces microphones était composée de 5 accumulateurs Reynier - Faure au début ; l'intensité du courant était indiquée par un galvanomètre Deprez placé dans le circuit ; on la maintenait sensiblement constante en ajoutant à ces 3 accumulateurs un autre , puis un autre , jusqu'au nombre total de 9. Le résultat aurait pu être obtenu également avec 5 éléments Danvell modèle Reynier , qui ont une très faible résistance et une constance absolue . Le courant de la pile est dérivé entre les 25 microphones , puis dans les 24 fils primaires de 24 bobines d'induction , montés par 2 en série et 12 en dérivation . L'intensité du courant est de 12 ampères environ . Les 24 circuits secondaires des 24 bobines d'induction sont groupés par 4 en série et 6 en dérivation . La résistance de chacune est de 300 ohms , soit pour leur ensemble 1200 ohms . La ligne de l'hippodrome , de 3512 mètres de longueur , aboutit 66 , rue des Petits - Champs , à l'un des bureaux de la Société générale des Téléphones auquel aboutit également la ligne de la place Vendôme qui est très courte . Avec le raccordement à la rue des Petits - Champs , la communication était établie . Les récepteurs du type Ader étaient groupés par 16 en série et 6 en dérivation . La netteté de l'audition a été parfaite et il a paru que tous les auditeurs , ceux de l'après - midi et ceux du soir , partaient satisfaits . Nous ne croyons pas qu'on puisse contester qu'il y ait là un progrès sensible sur le mode d'installation mis en œuvre entre l'Opéra et le palais de l'Industrie , lors de l'Exposition d'électricité de 1881. Il y avait d'un côté 10 microphones et de l'autre 80 récepteurs ; mais la moitié seulement des récepteurs était en service à la fois ; il y avait donc en fait 4 récepteurs par microphone avec 2 fils , soit en tout 20 fils . La réduction du nombre des fils facilitera la pose ; elle diminuera le coût de l'installation , et par suite permettra un plus grand nombre d'applications . L'expérience de M. Moser a été faite avec un seul fil , parce que le second avait un autre usage ; mais nous ne prétendons pas que , dans d'autres cas , il faille n'employer qu'un fil ; tout au contraire , nous pensons qu'il conviendra généralement d'unir ainsi deux fils pour éviter les bruits d'induction . Nous dirons en terminant que dans les dispositions de M. Moser la principale nouveauté consiste dans l'association en dérivation des 25 microphones , dans l'association des 24 fils secondaires des bobines d'induction en tension et en quantité comme on fait avec des éléments de pile . P.-S. – Nous apprenons au moment de mettre
sous presse que la Société technique russe a été
chargée , par la Direction de l'Exposition d'électricité
à Saint - Pétersbourg , d'établir entre l'Exposition
et le Grand Opéra des auditions téléphoniques
. Cette expérience pratique est intéressante , mais on voit qu'elle a été dépassée par celle de Paris . |
Antoine Breguet avec Clément Ader, qui présentent le « théâtrophone », audition téléphonique de l’Opéra, ce qui constitue le plus grand succès de l’Exposition internationale. En même temps, il lance la construction de nouveaux ateliers au 19, rue Didot dans le quartier de Plaisance (14e arrondissement) dont il ne verra pas l’achèvement. Surmené, Antoine Breguet succombe à 31 ans, le 8 juillet 1882, à un accident cardio-vasculaire. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise.
Durant la première moitié des années 1880, cette
collaboration fut intense et, en 1884, Clément Ader était
à l’origine de près de 74 brevets et certificats d’addition.
L’implication de Ader dans la téléphonie lui permet
par ailleurs d’élargir son réseau d’influence
: impressionné par le succès de l’installation au Palais
de l’industrie, Adolphe Cochery, ministre des Postes et Télégraphes,
le fait nommer chevalier de la Légion d’honneur :
Pendant près de vingt ans, Clément Ader fut donc un collaborateur
essentiel de la Société des téléphones.
Ader écrivit à M. Chaumet, sous-secrétaire aux postes,
pour l'informer qu'il était disposé à donner à
l'État la marque des récepteurs-Ader "dont il pourrait
exclusivement se servir". (Ader fournira dans sa vie d'autres marques
de désintéressement).
La réponse vint à quelque temps après sous la sous
forme d'un avertissement de l'administration des P.T.T. lui réclamant
le paiement de sa ligne téléphonique personnelle. Ader,
inventeur des appareils téléphoniques français, répondit
qu'il ne paierait pas, laissa couper sa ligne et jamais plus de sa vie
n'eut de téléphone à son domicile.
Le succès général de la téléphonie
à l'Exposition d'électricité de Paris détermina
la création de la correspondance téléphonique en
France.
Déjà l'Amérique avait pris les devants, et appliqué
sur une assez grande échelle cette invention au service du public,
pour remplacer le télégraphe électrique. On mit plus
de temps en France à l'adopter. L'administration des télégraphes
suscitait toutes sortes de difficultés et d'obstacles à
une méthode de correspondance rapide, dont elle redoutait, à
bon droit, la concurrence pour la télégraphie électrique.
Ces résistances, toutefois, ne pouvaient durer. Trois compagnies
s'étaient créées à Paris, pour exploiter les
correspondances par le téléphone, et chacune avait adopté
des appareils différents.
Devant se développer après le succès
de l'exposition, les demandes abondent et pour faire face la SGT doit
quitter son petit atelier qui ne prduit qu'une centaine de poste par mois.
Celle i décide alors à procéder à une augmentation
de capital et pour aller plus vite il est nécessaire de dissoudre
la société et d'en recréer une autre . Ce sera fait
le 4 novembre 1881 lors d'une assemblée extraordinaire.
Les nouveaux statuts de la " Société
Générale des Téléphones, Réseaux téléphoniques
et Constructions électriques" sont déposés
le 16 novembre.
(Les noms de Gower et Edison ont disparus !!)
Son siège social rue Neuve-des-Petits-Champs est transféré
au 41 rue Caumartin en 1882.
Les activités de la SGT sont alors :
- L'exploitation des réseaux téléphoniques de Paris
et des plus importantes villes.
- La construction et la vente des appareils électriques
- Les industries se rapportant à la fabrication de câbles
électriques et à l'emploi du caoutchouc et de la gutta percha.
Le nombre des abonnés inscrits à Paris, à la Société
générale des Téléphones, qui n'était
que de 1602 vers la fin de 1881, était un an plus tard de 2394.
C'était une augmentation de 792 abonnés en un an; en province,
l'augmentation était de 664 dans le même laps de temps; ce
qui formait un total de 3846 abonnés au 30 septembre 1882.
Nantes : Un appareil téléphonique affecté au service
des abonnés (cabine publique) fut installé à cette
époque à l'hôtel de la bourse, ainsi qu'à la
préfecture.
L'ancienne société
des téléphones est liquidée
: Extrait dans "Le Courrier du Finistère" du
10 décembre 1881, on y lisait :
| Le Journal général d'Affiches publie
l'avis suivant : La Société générale des Téléphones, systèmes EDISON, GOWER et autres, en liquidation, a l'honneur d'inviter MM. les actionnaires à déposer leurs actions au siège social, 66, rue des Petits-Champs, à Paris, en exécution de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre courant, à l'effet : 1° D'échanger ces actions contre des récépissés provisoires, contre lesquels il leur sera délivré un nombre identique d'actions, entièrement libérées, de la Société générale des Téléphones (réseaux téléphoniques et construction électriques) société anonyme au capital de 45 millions de francs, en formation, dont les statuts sont aux minutes de Mr DUP0UR, notaire à Paris, à la date du 8 aovembre 1881, ??? la constitution définitive de cette Société. 2° De recevoir, sur les actions de la Société en liquidation, les intérêts calculés à raison de cinq pour cent l'an, du l er janvier au 31 octobre 1881, sur les sommes dont les actious étaient libérées, sous déduction des impôts résultant des lois de finance. 3° D'user du droit de préférence qui leur est réservé jusqu'au 10 décembre inclusivement, à la souscription au pair, de 17300 scions de la Société générale des Téléphones (réseaux téléphoniques et constructions électiriques) avec irréductibilité, à raison d'une action de la nouvelle Société pour une action de la Société en liquidation. MMrs actionnaires devront accompagner le dépôt de leurs titres du premier versement de 125 franc sur chaque action de la Société générale des Téléphones (réseaux téléphoniques et constructions électriques) qu'ils ont l'intention de souscrire, versement à opérer an crédit de la Société en formation. Dans le cas où à l'expiration du délai qui leur est réservé pour user de ce droit de souscription, soit après le 1er Décembre, les 17.300 actions n'auraient pas toutes été souscrites, MM. les actionnaires souscripteurs en seront prévenus par un avis inséré au Journal des annonces légales et par lettre recommandée, et ils devront déclarer, dans le délai de trois jours, s'ils entendent souscrire les actions ainsi disponibles, et ce, an prorata des actions possédées par eux, sinon, ils seraient considérés somme ayant abandonné leurs droits. |
D'autres innovations : 1880-1882 Paul
Bert et d'Arsonval
 Le premier modèle
février 1880 construit par Ducretet
Le premier modèle
février 1880 construit par Ducretet
Téléphone magnétique à
pôles concentriques La Lumière Electrique, 12 août
1882, et Académie des Sciences, 7 août 1882
Voici l’opinion du célèbre électricien anglais M. Preece, au sujet de cet instrument (congrès de Sou» thampton) : « D’Arsonval a, de son coté, perfectionné le récepteur Bell. Il a placé la bobine dans'un puissant champ magnétique de forme annulaire, de façon à concentrer sur elles les lignes de force. La bobine induite est noyée entièrement dans le champ magnétique. Les effets sont considérablement augmentés. L’augmentation de l’ampleur de la voix ne s’accompagne nullement de la perte d’articulation, comme cela a lieu d’ordinaire, la parole est reproduite sans aucun changement du timbre », D’après l'éminent directeur du post-office de Londres, cet appareil était le seul, transmettant avec une parfaite netteté, les consonances si variées du the anglais . Nouveaux microphones En commun avec Paul Bert (Biologie et journal « La Nature », 1879) Au cours des recherches sur la surdité, je fus amené, avec Paul Bert, à m’occuper du microphone pour essayer d’utiliser les propriétés amplificatrices de l’instrument primitif de Hughes. Comme il arrive en bien des cas, nous avons trouvé autre chose que ce que nous cherchions. Par des perfectionnements successifs de notre premier appareil, nous arrivâmes à combiner différents instrument qui donnèrent d’excellents résultats pour la téléphonie pratique. Les premiers en date sont fondés sur le groupement des contacts microphoniques en quantité. Microphones à réglage magnétique,
en commun avec Paul Bert (Académie
des Sciences, i 5 mars 1880 et « La Lumière Electrique
», ti novembre 1882) |
sommaire
Dès 1880 le standard téléphonique
: l'organe central ou sont raccordés toutes les lignes
de téléphone des clients pour pouvoir les mettre en relation
est expliquée dans cette rubrique Réseaux
et Centraux manuels. qui décrit l'aspect technique du centre,
des raccordements et aussi des conditions de travail des opératrices
à l'époque.
Quant au mot standard téléphonique, il vient certainement
de l'anglais stand (debout), position des opératrices
devant le tableau (switchbord).
Centre urbain  ,
petit centre à 25 lignes
,
petit centre à 25 lignes
Dans les premiers centraux, les
demoiselles étaient debout pendant de longues heures.
Le 1er décembre 1880, le service téléphonique
des premiers bureaux téléphoniques parisiens exploités
par la Société Générale des Téléphones
devient permanent, 24 heures sur 24.
La récupération et l'ouverture des Centraux Téléphoniques
Manuels à Paris, par la Société Générale
des Téléphones (notamment telles qu'annoncées dans
la presse d'époque) :
Bureau A : 27, avenue de l'Opéra (premier central mis en service
en France, le 30 septembre 1879, par la société des Téléphones
Edison), 1er bureau.
Bureau S : 66, rue Neuve-des-petits-champs (mis en service le 3 octobre
1879, par la Compagnie des Téléphones Système Gower
- hors service le 26 août 1882), 2ème bureau.
Bureau B : 4, rue de Logelbach (mis en service en 1880), 3ème bureau.
Bureau C : 2, quai de Seine / 204, boulevard de la Villette (mis en service
en 1880), 4ème bureau.
Bureau D : 10, place de la République (mis en service le 1er décembre
1880), 5ème bureau.
Bureau G : 62, rue du Bac (mis en service le 20 décembre 1880 -
hors service avant Novembre 1884), 6ème bureau.
Bureau I : 80, rue de Passy (mis en service le 10 février 1881),
7ème bureau.
Bureau L : 42, rue Lafayette (mis en service le 20 août 1882), 8ème
bureau.
Bureau M : 25, rue Étienne Marcel (mis en service le 28 juin 1883),
11ème bureau.
Bureau O : 65, rue d'Anjou-Saint-Honoré (mis en service le 8 novembre
1883), 12ème bureau.
Bureau E : 24/26, rue de Lyon (déjà en service en 1883),
Bureau F : 20, avenue des Gobelins (déjà en service en 1883),
Bureau G : 183, boulevard Saint-Germain (déjà en service
en 1883),
Bureau H : 123, rue Lecourbe (déjà en service en 1883),
Bureau Provisoire : Champs de Mars (Exposition Universelle - mis en service
du 1er mars au 31 octobre 1889).
Le réseau de 430 Km au moment de la fusion des
compagnies s’agrandit rapidement pour atteindre 820 Km en 1881.
Cette extension a permis de nouveaux points d’accès se traduisant
par de nouveaux abonnés.
Au commencement de 1881, la SGT comptait déjà sept bureaux
centraux desservant son réseau de Paris et avait construit plus
de trois cents lignes.
« Le nombre des abonnés s’est élevé de
454 à 1240, sur lesquels 905 sont reliés. Le nombre de communications
demandées en une semaine, qui était de 4000 en octobre,
a atteint 45 000 la semaine dernière ; il a plus que décuplé.
Dès le début des années 1880, des
évolutions vinrent améliorer le fonctionnement des Tableaux
d'abonnés et faciliter le travail des Opératrices.
De nouveaux Tableaux à Cordons Monocordes font leur apparition.
- Sur un Tableau à Monocorde, chaque ligne bifilaire d'abonné
aboutit désormais d'une part sur un cordon bifilaire pourvu en
son extrémité d'une fiche mâle à deux pôles
et d'autre part, en parallèle, un Jack-Knife (femelle) à
simple rupture toujours encastrée dans le Tableau, couplé
avec l'annonciateur et sa clef d'écoute reliée au poste
de l'Opératrice si elle est actionnée.
- Lorsqu'un Annonciateur bascule, l'Opératrice actionne désormais
seulement la clef d'écoute de l'abonné demandeur qui met
directement son combiné ou son casque d'observation en conversation
avec l'abonné demandeur (sans avoir désormais besoin de
brancher son combiné ou son casque avec sa fiche dans une prise
différente à chaque prise d'appel.... Simplification des
tâches)
- Puis l'Opératrice actionne la clef d'écoute de l'abonné
demandé pour rentrer en relation avec lui, et s'il répond,
l'Opératrice relie le cordon monocorde de l'abonné demandeur
avec la fiche mâle dans le Jack-Knife (femelle) de l'abonné
demandé.
- En fin de conversation, l'abonné demandeur actionne à
nouveau l'Annonciateur, qui fait basculer à nouveau le volet, et
qui donne le signal au tableau à l'Opératrice pour retirer
le cordon monocorde de l'abonné demandeur du Jack-Knife de l'abonné
demandé.
Schéma général de fonctionnement du bureau central,
afin de mettre en communication deux abonnés.
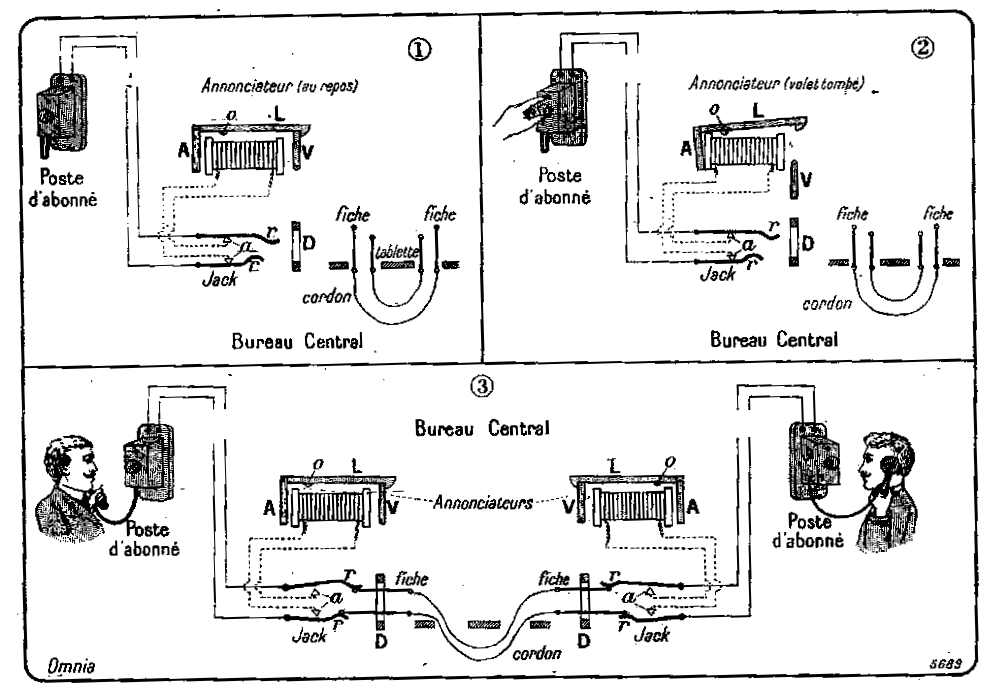
Rappel : il n'y a pas encore la batterie centrale à cette
époque. Les postes d'abonnés sont équipés
de piles (batterie)
Vers la moitié des années 1880, des évolutions vinrent
améliorer le fonctionnement des Tableaux d'abonnés et faciliter
le travail des Opératrices.
De nouveaux Tableaux à Cordons Dicordes font leur apparition.
Directement inspirés des Tableaux Monocordes, les Tableaux Dicordes
en reprennent le principe en l'améliorant... En effet, dans un
Tableau Monocorde, il faut autant de cordons Monocordes munis de fiches,
autant de clefs d'écoute et autant de boutons d'appel qu'il y a
d'abonnés sur un Tableau.
Aussi, les Tableaux Dicordes remplacèrent rapidement les Tableaux
Monocordes qui étaient, au niveau de leur architecture technique,
désormais simplifiés :
- Désormais, il n'y avait plus que le nombre d'organes nécessaires
à la liaison des différents Jack-Knife d'abonnés,
correspondant au nombre maximal possible de liaisons à l'heure
de la journée la plus chargé.
Ce qui amène à une réduction du prix de fabrication
par l'élimination d'organes redondants, une simplification de leur
maintenance, et de leur utilisation facilitée pour les Opératrices.
- Sur un Tableau à Dicordes, chaque ligne bifilaire d'abonné
aboutit désormais seulement à un Jack-Knife (femelle) à
double rupture toujours encastré dans le Tableau, couplé
avec un annonciateur d'appel.
- Lorsqu'un Annonciateur bascule, l'Opératrice, munie d'un cordon
Dicorde, n'a qu'à brancher une première fiche d'un cordon
Dicorde disponible sur le Jack-Knife de l'abonné demandeur et actionner
la clef d'écoute dans une première position, clef d'écoute
qui équipe désormais ce cordon Dicorde pour relever l'appel
et noter la demande de l'abonné.
- Puis, une fois la demande notée, de brancher la seconde fiche
de ce même cordon Dicorde sur le Jack-Knife (femelle) de l'abonné
demandé, puis d'actionner à nouveau la clef d'écoute
dans une seconde position pour rentrer en contact avec l'abonné
demandé par un bouton d'appel relié à ce même
cordon Dicorde.
- Si l'abonné demandé répond, l'Opératrice
remet dans sa position d'origine la clef d'écoute du cordon Dicorde,
ce qui met en relation les deux abonnés, et déconnecte l'Opératrice
de la conversation en cours.
- En fin de conversation, l'abonné demandeur actionne à
nouveau l'Annonciateur, qui fait basculer à nouveau le volet, et
qui donne le signal au tableau à l'Opératrice pour retirer
le cordon monocorde de l'abonné demandeur du Jack-Knife de l'abonné
demandé.
En fait, il a été conçu un nouveau type de cordons,
le Cordon Dicorde, d'un modèle très élaboré,
qui permet de simplifier à la fois les opérations à
accomplir par les Opératrices ainsi que la construction de ces
nouveaux Tableaux.
Le 26 août 1882, la Société Générale
des Téléphones quitta son siège du 66, rue neuve-des-petits-champs,
pour le 41, rue Caumartin, à Paris.
En cette occasion, le Bureau S, sis au 66, rue neuve-des-petits-champs,
est mis définitivement hors service à cette même date.
A l'Exposition internationale d'électricité de 1881 était exposé les Commutateurs manuels, qui ont servis à concevoir ceux utilisés en France à cette l'époque par Tivadar Puskás (voir plus haut)
Dès le début, dans les bureaux centraux
téléphoniques urbains , devenus déjà assez
importants, on reconnut la nécessité de permettre à
une seule opératrice, malgré le nombre élevé
des abonnés, de terminer seule l'établissement d'une communication
demandée.
Avec la croissance des abonnés et des centraux manuels, d'ingénieux
systèmes permettaient d'établir des connections entre abonnés
de bureaux différents avec le concours d'opératrices pour
manœuvrer. Cela allongeait les temps d'établissement des mises
en relation et amenait de l'affaiblissement sur les communications.
Plus tard pour y remédier, Scribner inventa le «
multiplage » des jacks terminaux des lignes d'abonnés,
c'est-à-dire la dérivation sur chaque ligne d'abonné,
à intervalles réguliers, d'un nombre de jacks égal
au nombre des opératrices du central téléphonique.
Ce concept s'appliqua aux grandes villes comme Paris.
sommaire
La demoiselle du téléphone
appelé téléphoniste ou opératrice à
l'extérieur de la France, était une personne, presque toujours
féminine sauf au tout début, qui actionnait un standard
téléphonique pour établir les communications entre
usagers dans les premières décennies de la téléphonie,
jusque dans les années 1960 en France..
L'expression demoiselle du téléphone, caractéristique
de la téléphonie française, remonte à une
période où le réseau téléphonique commuté
n'était pas automatisé. Les plus célèbres
figures de ce microcosme sont les « demoiselles du téléphone
», ainsi appelées parce que cette catégorie de personnel
était recrutée exclusivement parmi des jeunes filles célibataires,
dont l'éducation et la morale sont irréprochables.
Durant les premières décennies de la téléphonie,
elles perdaient généralement leur emploi lorsqu'elles se
mariaient.
Leur fonction est de prendre les demandes d'appel des abonnés,
puis de les mettre en relation. Leur poste de travail est constitué
d'un tableau à prises jack et de cordons appelés dicordes,
servant à connecter les abonnés entre eux.



Regardons la face cachée , côté
Bureau central manuel , installation
des câbles, des lignes avec les étapes de déploiement
du réseau de Paris.
Le travail des demoiselles du téléphone était
réputé éprouvant pour les nerfs, particulièrement
en heure de pointe où malgré le faible nombre d'abonnés,
les appels pouvaient être incessants. Cependant, dès les
années 1900, elles disposaient de congés payés d'un
mois, de tarifs réduits pour les billets de train et d'un médecin
du travail. À Paris, en plus de leur salaire, elles recevaient
une prime pour couvrir leurs frais de logement et une indemnité
de repas.
Ces demoiselles sont aussi des cibles parfaites pour les clients mécontents
du service. On leur reproche leur mauvaise humeur ainsi que la lenteur
d'établissement des communications.
Dans le contexte du début du XXe siècle, les abonnés
sont surtout des gens fortunés qui ne supportent pas que le «
petit personnel » ait autant d'influence sur leurs affaires. Pourtant,
des concours d'efficacité sont organisés pour améliorer
la qualité du service : on met en compétition des opératrices
pour assurer le maximum de connexions à l'heure. Les records sont
de l'ordre de 400 établissements de connexion à l'heure,
qui correspond à une communication toutes les dix secondes.
Dans une de ses Chroniques au Figaro, Marcel Proust
décrit sa fascination pour le travail des «Demoiselles du
téléphone», ces «vierges vigilantes par qui
les visages des absents surgissent près de nous», qu'il reprend
presque littéralement dans Le côté de Guermantes
à propos de la conversation téléphonique du Narrateur
et de sa grand-mère,
| Un matin, Saint-Loup m’avoua qu’il avait
écrit à ma grand’mère pour lui donner de
mes nouvelles et lui suggérer l’idée, puisqu’un
service téléphonique fonctionnait entre Doncières
et Paris, de causer avec moi. Bref, le même jour, elle devait
me faire appeler à l’appareil et il me conseilla d’être
vers quatre heures moins un quart à la poste. Le téléphone
n’était pas encore à cette époque d’un
usage aussi courant qu’aujourd’hui. Et pourtant l’habitude
met si peu de temps à dépouiller de leur mystère
les forces sacrées avec lesquelles nous sommes en contact que,
n’ayant pas eu ma communication immédiatement, la seule
pensée que j’eus, ce fut que c’était bien
long, bien incommode, et presque l’intention d’adresser
une plainte : comme nous tous maintenant, je ne trouvais pas assez
rapide à mon gré, dans ses brusques changements, l’admirable
féérie à laquelle quelques instants suffisent
pour qu’apparaisse près de nous, invisible mais présent,
l’être à qui nous voulions parler et qui, restant
à sa table, dans la ville qu’il habite (pour ma grand’mère
c’était Paris), sous un ciel différent du nôtre,
par un temps qui n’est pas forcément le même, au
milieu de circonstances et de préoccupations que nous ignorons
et que cet être va nous dire, se trouve tout à coup transporté
à ces centaines de lieues (lui et toute l’ambiance où
il reste plongé) près de notre oreille, au moment où
notre caprice l’a ordonné. Et nous sommes comme le personnage
du conte à qui une magicienne, sur le souhait qu’il en
exprime, fait apparaître dans une clarté surnaturelle
sa grand’mère ou sa fiancée en train de feuilleter
un livre, de verser des larmes, de cueillir des fleurs, tout près
du spectateur et pourtant très loin, à l’endroit
même où elle se trouve réellement. Nous n’avons,
pour que ce miracle s’accomplisse, qu’à approcher
nos lèvres de la planchette magique et à appeler - quelquefois
un peu trop longtemps, je le veux bien - les Vierges Vigilantes dont
nous entendons chaque jour la voix sans jamais connaître le
visage, et qui sont nos Anges gardiens dans les ténèbres
vertigineuses dont elles surveillent jalousement les portes ; les
Toutes-Puissantes par qui les absents surgissent à notre côté,
sans qu’il soit permis de les apercevoir ; les Danaïdes
de l’invisible qui sans cessent vident, remplissent, se transmettent
les urnes des sons ; les ironiques Furies qui, au moment que nous
murmurions une confidence à une amie, avec l’espoir que
personne ne nous entendait, nous crient cruellement : « J’écoute
» ; les servantes toujours irritées du Mystère,
les ombrageuses prêtresses de l’Invisible, les Demoiselles
du téléphone !
Et aussitôt que notre appel a retenti, dans la nuit pleine d’apparitions sur laquelle nos oreilles s’ouvrent seules, un bruit léger - un bruit abstrait - celui de la distance supprimée - et la voix de l’être cher s’adresse à nous. C’est lui, c’est sa voix qui nous parle, qui est là. Mais comme elle est loin ! Que de fois je n’ai pu l’écouter sans angoisse, comme si devant cette impossibilité de voir, avant de longues heures de voyage, celle dont la voix était si près de mon oreille, je sentais mieux ce qu’il y a de décevant dans l’apparence du rapprochement le plus doux, et à quelle distance nous pouvons être des personnes aimées au moment où il semble que nous n’aurions qu’à étendre la main pour les retenir. Présence réelle que cette voix si proche - dans la séparation effective ! Mais anticipation aussi d’une séparation éternelle ! Bien souvent, écoutant de la sorte, sans voir celle qui me parlait de si loin, il m’a semblé que cette voix clamait des profondeurs d’où l’on ne remonte pas, et j’ai connu l’anxiété qui allait m’étreindre un jour, quand une voix reviendrait ainsi (seule, et ne tenant plus à un corps que je ne devais jamais revoir) murmurer à mon oreille des paroles que j’aurais voulu embrasser au passage sur des lèvres à jamais en poussière. Extrait de Le côté de Guermantes (À la recherche du temps perdu de Marcel Proust) |
La difficulté à établir les communications
a inspiré Fernand Raynaud qui en a fait un sketch comique, Le 22
à Asnière.
...
On était, dès cette époque, accoutumé à
construire dans les grandes villes des centraux téléphoniques
urbains pouvant recevoir chacun jusqu'à 10000 abonnés. Pour
desservir un tel central, il fallait un minimum d'une centaine de positions
de dames employées, et encore davantage s'il y avait à prévoir
dans une très grande ville des intercommunications entre plusieurs
centraux, la réalisation de ces intercommunications diminuant évidemment
le rendement de chaque opératrice.
Dans les années 1880-1930, la tendance a été
d'augmenter la commodité des manœuvres de l'opératrice,
de façon à augmenter son rendement.
Les clés d'appel et d'écoute dont elle se sert ont été
rendues plus ou moins automatiques, de telle sorte que le temps pris pour
servir chaque appel soit réduit au minimum. Les cordons de l'opératrice
d'une position urbaine sont devenus très compliqués, et
toute une série d'électro-aimants, avec des câblages
enchevêtrés, viennent jouer en temps utile sur chaque cordon
pour permettre à la téléphoniste de ne pas s'immobiliser
sur un appel qu'elle a commencé à servir. D'autres électros,
montés également sur chaque cordon, comptent les conversations
de chaque abonné, en discernant si la conversation a été
efficace ou non. Chaque cordon est enfin muni d'électros et de
lampes de signalisation spéciales pour que l'opératrice
soit avertie du raccrochage de l'appareil chez chaque abonné en
conversation.
Dans une grande ville comme Paris, nous sommes arrivés à
faire assurer par des téléphonistes l'écoulement
de 160 demandes de communication à l'heure. C'est un chiffre tout
à fait remarquable, surtout si l'on songe qu'à Paris, il
y a une quarantaine de séries téléphoniques différentes,
et que presque toujours une demande de communication émanée
d'une série est à destination d'une autre.
A la fin de l'année 1891, 812
demoiselles du téléphone sont comptabilisées en France.
sommaire
1881 La compagnie de téléphone
européenne Edison Gower-Bell d'Europe a été créée
le 28 octobre 1881.
Ses zones d'opérations couvraient toute l'Europe continentale,
à l'exception de la France, de la Turquie et de la Grèce.
Elle a été créée
pour contrôler les brevets et les intérêts commerciaux
d’Alexander Graham Bell , de Thomas Edison et de Frederic Allan Gower,
des États-Unis, qui détenait auparavant une franchise de
la Bell Telephone Company en Nouvelle-Angleterre au début des années
1880.
En France au commencement de 1881, la Société
générale des Téléphones comptait déjà
7 bureaux centraux desservant son réseau
de Paris, et avait construit plus de 300 lignes.
Cette Société avait en plus établi
des réseaux téléphoniques dans de Grandes villes
de province.
Le prix de l'abonnement avait été fixé par un arrêté
ministériel à 600 francs par an pour le réseau de
Paris et à 400 francs pour les réseaux de province.
- A Lyon, le réseau a progressé assez rapidement.
Depuis 1881, les habitants de cette ville peuvent en cas d'accident grave
ou d'incendie, prévenir instantanément le bureau central
de police. Cinq bureaux de police étaient reliés à
cette époque avec le bureau central : le bureau du 2° arrondissement,
rue Sorbier; du 3° arrondissement, rue Annonay ; du 4e arrondissement,
rue Soleysel ; du 5e arrondissement, rue Bourgneux, et à l'abattoir
de Mattetières.
- A Nantes, le téléphone fut reçu avec faveur.
Dès le mois de mai 1881, c'est-à-dire quelques mois à
peine après son ouverture, le réseau de la Société
générale avait atteint un développement de 20 kilomètres
et desservait plus de 40 abonnés dans cette ville
- Au Havre, le réseau téléphonique établi
en 1881, atteignit rapidement 100 abonnés; la Société
des Téléphones inaugura au mois d'août 1881, un service
de petits facteurs ou commissionnaires pour courses, ou port de petits
paquets, dépêches télégraphiques, échantillons,
etc. Mais ce service ne dura que quelques jours ; il fut supprimé
sur l'injonction du ministre des postes et des télégraphes.
- A Bordeaux, le réseau téléphonique,
installé en 1880, se développait rapidement. En juillet
1881, la Société générale des Téléphones
desservait déjà dans cette ville plus de 50 abonnés.
La Chambre de commerce de Bordeaux fit relier plusieurs locaux, dépendant
de son administration, au bureau central. Elle permit aussi l'organisation
à la Bourse, d'un bureau spécial d'où chaque abonné
du réseau, sur la présentation de sa carte d'abonnement,
pouvait être mis en communication avec les autres abonnés.
Plusieurs industriels sont, depuis 1881. reliés directement avec
leurs succursales situées dans un autre quartier de la ville que
la maison-mère.
En raison du développement rapide de son réseau téléphonique,
la Société générale des Téléphones
décida qu'à partir du 15 novembre 1881, le service aurait
lieu à Bordeaux, sans interruption, nuit et jour.
- A Paris, à l'Institut, quai Conti, les salles des diverses
académies sont, depuis le mois de décembre 1881, reliées
entre elles par des appareils téléphoniques, et les bureaux
des diverses sections en séance sont en relation directe avec le
personnel des secrétariats perpétuels pour demander les
renseignements ou les manuscrits dont ils peuvent avoir besoin.
- A Saint-Etienne (Loire), des postes téléphoniques
furent établis en 1881, reliant entre eux les bureaux de police.
Le téléphone fut également installé dans d'importantes
maisons de cette localité, des fabriques de rubans, d'armes à
feu, de quincaillerie, de verrerie, de coutellerie, et surtout dans toutes
les grandes exploitations houillères de la ville et des environs.
- A Angoulême, un service téléphonique entre
l'École d'artillerie, l'arsenal de la Madeleine et les autres établissements
militaires fut établi au commencement de 1881. Soit par suite de
l'indifférence du public, qui regardait le téléphone
comme un simple jouet sans utilité pratique, soit surtout par suite
des nombreuses difficultés élevées par l'administration,
qui craignait l'absorption du télégraphe par le téléphone,
jusqu'en 1882, ce nouveau mode de transmission avait, en somme, fait peu
de progrès en France.
sommaire
A l'époque, une prodigieuse confusion
régnait, non dans la question scientifique , mais dans l'exploitation
industrielle du téléphone.
Plus de deux cents appareils avaient été décrits,
construits, brevetés, pour assurer la transmission de la parole
à de grandes distances.
Les compagnies exploitant les brevets Graham Bell, Edison, Elisha Gray,
Gower, Blake, Crossley, Ader, etc., se disputaient le privilège
d'exploiter les correspondances par le téléphone. Cent et
un inventeurs réclamaient leur part au soleil de la gloire, ou
plutôt de l'argent, et personne n'était en état de
voir juste dans cette véritable tour de Babel de l'électricité.
Les savants, égarés au milieu de cette nuée de perfectionnements
ou prétendus tels, étaient dans l'impossibilité de
porter un jugement à leur sujet.
Il fallait qu'un grand coup fût porté, pour faire jaillir
la lumière au milieu des ténèbres de ces questions,
pour apporter l'équité, la justice, dans tant de controverses
intéressées.
Ce grand coup fut frappé, cet événement désiré
se produisit, et ses conséquences ne se firent pas attendre.
Au mois de juillet 1881, s'ouvrit à Paris, le concours universel
d'électricité auquel étaient conviées toutes
les nations des deux mondes.
Comme l'imposant aréopage de ses jurys internationaux comptait
la fine fleur de la science européenne, on put examiner avec connaissance
de cause et avec maturité toutes les questions que soulevait la
téléphonie au point de vue scientifique ou industriel, et
la lumière ne tarda pas à se faire.
Les divers systèmes de téléphonie à l'Exposition
d'électricité de Paris en 1881,
— Succès du téléphone de M. Graham Bell.
— Les auditions de l'Opéra et leur influence pour la vulgarisation
de la téléphonie.
— Établissement de la correspondance par le téléphone
en Amérique et en Europe.
— Le transport à grande distance reste le seul desideratum
de la téléphonie.
— Limites actuelles de la portée du téléphone.
— Les appareils téléphoniques du Dr Herz pour les transmissions
à grandes distances.
— Système de M. Van Rysselberghe, de Bruxelles.
— Le système Hopkins et les expériences de transmission
à grande distance faites en 1883, de New- York à Chicago
et Cleveland.
Au moment où s'ouvrit, à Paris, l'Exposition internationale
d'électricité, les systèmes électriques en
compétition étaient à peu près les suivants
:
1° Le téléphone magnétique de M. Graham Bell,
avec son transmetteur et son récepteur identiques, fonctionnant
sans pile électrique et seulement par les courants ondulatoires
provoqués par un aimant, appareil
2° Le téléphone musical de M. Elisha Gray;
3° Le téléphone à transmetteur de charbon de
M. Edison, avec son récepteur particulier.
4° Le téléphone Gower, constitué essentiellement
par la disposition circulaire de l'aimant et la large surface vibrante
du transmetteur; appareil
5° Le téléphone Crossley, peu différent du téléphone
Ader et qui avait fait ses preuves en Angleterre;
6° Le téléphone Ader, résultant de la réunion
du microphone de Hughes et du récepteur Gower, avec addition de
certains procédés reconnus avantageux pour renforcer le
courant électrique.
« J'en passe et des meilleurs, » ainsi que dit don Ruy Gomez
au roi d'Espagne, au 5ème acte à'Hernani. L'épithète
élogieuse que nous fournit le poète nous permet de passer
courtoisement sous silence une nuée d'appareils qui, par leur variété
et leur complication, jetteraient le plus grand trouble dans l'esprit
du lecteur, si nous voulions les étudier de près.
A l'Exposition universelle d'électricité, le téléphone
musical de M. Elisha Gray, le téléphone à transmetteur
de charbon de M. Edison, et le téléphone
Gower, furent absolument distancés par le téléphone
Ader.
Le récepteur "Ader à petit anneau" deuxième version
Impossible de retracer d'une façon précise la genèse de ce récepteur, les médias d'époque consultés sont tous restés silencieux à ce propos, mais il a des pistes à suivre...En abandonnant le "surexcitateur" (partie essentielle de l'appareil...), Ader aurait donc "proposé" un second type de récepteur.
Toujours dans le "Cours d'installations téléphoniques" de H. Milon de 1923, on trouve les dessins et la description de ce récepteur Ader :

 Dans les types Ader plus récents (fig.7), la poignée
est indépendante de l'aimant, et celui-ci est constitué par des
barreaux demi-circulaires disposés à plat dans le boîtier.
Deux séries de ces barreaux superposés sont placés en regard
l'une de l'autre, avec les pôles de même nom en opposition, de façon
à former une sorte d'aimant circulaire avec deux pôles diamétralement
opposés.
Dans les types Ader plus récents (fig.7), la poignée
est indépendante de l'aimant, et celui-ci est constitué par des
barreaux demi-circulaires disposés à plat dans le boîtier.
Deux séries de ces barreaux superposés sont placés en regard
l'une de l'autre, avec les pôles de même nom en opposition, de façon
à former une sorte d'aimant circulaire avec deux pôles diamétralement
opposés. Sur ces pôles on fixe les équerres de fer doux qui doivent supporter les noyaux des bobines. Cette forme a l'avantage d'être peu encombrante, et de permettre de donner à la poignée ou au support une forme quelconque, adaptée au mode d'emploi de l'appareil et à la convenance de la personne qui l'utilise; mais elle ne permet pas l'emploi d'aimants aussi puissants. (Que le modèle à surexcitateur).
Comme le récepteur "Ader" n'a donné lieu à aucun brevet de la part d'Ader, on peut supposer qu'il a été développé par le bureau d'étude de la Société générale des téléphones
Après la création de SGT
en 1880, comment se passe un projet de réseau pour les villes qui
en ont l'intention ?
A savoir : c'est en mai 1880 que la première demande a été
déposée à la Compagnie des Téléphones
de PARIS avant la création de la SGT.
voici l'exemple de LILLE, renouvelant sa demande à la SGT,
débattue par le Conseil Municipal à la Séance du
Mardi 7 Juin 1881
|
M. Rochart présente le rapport suivant
au nom de la Commission des travaux : Enquête ouverte par l’administration |
Pour Lille, l'aventure commence, le bureau est installé au 3 de la place de la gare, les lignes sont construites sur le toit des immeubles, le réseau est inauguré le 1er mai 1882 avec 26 lignes et 94 demande sont en attente. Le 1er avril 1883 se sera le tour de de Roubaix-Tourcoing qui ouvrira son réseau.
1882
Antoine Breguet décédera en 1882, son partenaire Alfred
Niaudet en 1883, et Louis Breguet, a près de 80 ans
est incapable de supporter ces malheurs, il meurt une quinzaine de jours
après Niaudet. Il semble que l'usine de production de téléphone
de Breguet ait été reprise par Clément Ader.
En juillet 1882, le Ministre des Postes et Télégraphes
obtint un crédit de 250 000 Francs destiné à expérimenter
l'exploitation de réseaux téléphoniques dans certaines
villes de province.
A. Cochery émet un décret qui permet l'établissement
et l'usage des lignes télégraphiques d'intérêt
privé.
Ce qui permet de pouvoir relier des lignes privées au réseau
télégraphique de l'état ou bien de relier entre eux
deux établissements privés.
Les frais d'établissement sont de 250 francs par km de ligne, les
frais d'entretien sont de 20 francs par an et par km de ligne et
l'état prélève un droit d'usage de la ligne de 15
francs par an et par km de ligne
Dès 1882
- la Société Générale des Téléphones,
la souveraine, s'inquiète des trop nombreux constructeurs qui commençaient
à proposer des téléphones pour les installations
domestiques et à lui faire de l'ombre
- la Société général
des téléphones obtint du gouvernement de pouvoir
relier sur un même fil à abonnement réduit, deux abonnés
habitant un même immeuble.
Un appareil spécial installé à chaque étage
permet à chacun des locataires de communiquer avec tous les abonnés
du réseau et réciproquement.
Dans les administrations importantes, la Société générale
des Téléphones a eu l'idée d'installer des petits
réseaux téléphoniques destinés à desservir
tous les services intérieurs. De petites lignes, partant des bureaux
des différents chefs de services d'une même administration,
viennent aboutir à un tableau central à plusieurs directions
; ces lignes peuvent être en nombre illimité.
Le tableau central étant relié lui-même au bureau central du réseau de la Société, il s'ensuit que chaque chef de service peut, de son bureau, être directement mis en communication, non seulement avec ses collègues, mais avec tous les abonnés du réseau.
 |
La figure gauche représente un de ces tableaux
à plusieurs directions, qui est la réduction d'un
bureau central d'administration. La figure droite est un poste central mobile composé
d'une planchette horizontale supportant une boîte forme pupitre,
en acajou, noyer ou bois noir, sur laquelle sont montés des
leviers qui font office de commutateurs Jack-Knives, et qui contient
la bobine d'induction, les communications et le crochet commutateur
automatique pour mettre le poste sur sonnerie ou sur téléphone,
crochet auquel on suspend l'appareil téléphonique
combiné. |
 |
 |
La Société a donné une forme encore plus pratique aux postes centraux destinés à desservir ces réseaux locaux; elle a construit des postes mobiles, aussi gracieux que commodes, comportant chacun un nombre plus ou moins grand d'annonciateurs et de commutateurs et qui permettent à chaque chef de service d'être relié directement aux autres chefs de service ou à leurs subordonnés sans passer par un poste central commun. Tous les services si nombreux de la Compagnie générale Transatlantique, dans son hôtel de la rue Auber, sont ainsi reliés entre eux et de plus sont, mis en communication, par un poste central spécial, avec le réseau de Paris. C'est le type parfait de ces d'installations.
Outre que cette prodigalité de lignes, dont l'utilité n'est pas toujours démontrée, est une charge pécuniaire, elle est surtout une grande source d'embarras pour les personnes qui ont à s'adresser à ces administrations. On ne sait sur quelle ligne on doit sonner pour avertir la personne avec laquelle on a besoin de s'entretenir. Il arrive souvent qu'un chef de service se trouve dérangé pour un autre, ce qui est un ennui pour lui et une perte de temps pour celui qui demande.
Remarquons en passant que dans plusieurs administrations un certain nombre de lignes téléphoniques relient différents services directement avec le réseau de Paris.
Ces inconvénients sont dus à l'incompétence pratique des personnes qui sont chargées de faire faire ces installations.
Il est facile de les éviter, en concentrant sur un même point toutes les lignes appartenant à une même administration.
C'est d'ailleurs ce qu'ont fait plusieurs administrations bien avisées, sur les conseils de personnes compétentes.
Toute personne ayant à s'adresser à ces administrations correspond directement avec un fonctionnaire chargé spécialement de ce service.
Selon la nature du renseignement demandé, celui-ci le fournit immédiatement ou met le demandeur en communication directe avec le service ou la personne intéressée.
De la sorte, nul n'est dérangé inutilement et toute demande reçoit une prompte solution. Economie de temps et d'argent.
|
Beaucoup de maisons de commerce
un peu importantes, à Paris et dans les grandes villes
de province,
possédaient déjà le téléphone. Les municipalités de Marseille, de Lyon, de Bordeaux organisèrent des réseaux dits municipaux. |
Les postes de pompiers, les bureaux d'octroi, les commissariats
de police et les divers grands services de l'administration de chaque
ville furent reliés à un poste central placé à
la mairie. Les villes du Havre, de Rouen, suivirent cet exemple , d'autres
moins importantes s'y rallièrent. La province devança
Paris dans cette voie.
Mais ces réseaux municipaux, sauf deux ou trois, comme ceux de
Marseille, de Lyon, de Calais, sont absolument fermés et, contrairement
à ce qui existe dans tous les autres pays, il serait difficile
de trouver dans la liste des abonnés des réseaux urbains,
une ligne téléphonique pouvant permettre au public de
se mettre en rapport, soit avec un poste de police, soit avec un poste
de pompiers, en cas de sinistre ou d'incendie .C'est seulement en 1889
que fut établie une ligne téléphonique reliant
le réseau de Paris avec l'état-major des sapeurs-pompiers
,quartier général d'incendie).
Vers la fin de 1882, en même temps que l'on s'occupait de l'installation
d'un réseau téléphonique à Nice, on établissait
un poste de téléphone près de cette ville, au sommet
du Mont-Vinaigre, le point le plus central des montagnes de l'Estérel.
On a construit sur le Mont-Vinaigre une maisonnette où se tiennent
deux gardiens chargés de donner le signal lorsque des incendies
se déclarent dans la forêt de l'Estérel. Toutes
les maisons forestières de l'Estérel sont reliées
entre elles par un réseau téléphonique qui communique
avec l'inspection centrale dont le siège est à Fréjus
A PARIS : A partir de 1882 cependant le réseau se structure
et ses caractéristiques techniques se mettent en place. Borné
par les fortifications le réseau téléphonique parisien
s'organise autour de 9 puis 12 bureaux "centraux". Ceux-ci
sont bien entendu manuels.
L'établissement des communications se fait ainsi : Quant
un abonné veut parler à un autre il peut se présenter
deux cas :
1° le second abonné habite le même arrondissement téléphonique,
c'est le cas le plus simple ;
2° le second abonné habite un autre arrondissement ; la téléphoniste
du bureau À, appelée par le premier abonné, appelle
le bureau D, qui appelle à son tour le second abonné".
Hormis l'adoption précoce des circuits â deux fils, choix
"moderniste" dont on ne cessera par la suite de féliciter
la S. G. T. les caractéristiques du réseau sont encore
très frustes. Tous les câbles sont isolés, sur le
modèle des câbles sous-marins, â la gutta percha*
II n'existe que deux types de câbles. D'une part les lignes auxiliaires
qui relient entre eux les bureaux. D'autre part les câbles qui
desservent les abonnés : les deux fils constituant chaque circuit
sont réunis dans les égouts en câbles de sept paires
toronnées et protégées par une enveloppe de plomb.
Le reseau a cependant fait l'objet de quelques choix de structure déliberès.
Ainsi la société explique que "tous les fils qui
joignent les divers bureaux centraux de Paris passent tous par un point
central situe 27 avenue de l'Opéra. On aurait pu établir
des lignes allant par le chemin le plus court du bureau A a chacun des
autres, du bureau B a tous ceux des lettres suivantes, du bureau C aux
suivants etc. Cette méthode aurait même diminué
la longueur totale de câble employé a ce service. On a
cependant preferé le système du point central d'ou rayonnent
les fils venant de tous les bureaux" .
Cela permet de tirer parti des rosaces sur lesquelles les fils correspondant
a chaque abonné sont disposés a l'aboutissement des câbles
"si on reconnait que le bureau C fait un usage peu actif de ses
fils auxiliaires avec D tandis que les communications entre D et I sont
actives et sont quelquefois retardées par le manque de lignes,
la manœuvre a faire est facile... On disjoint un fil double CD
a son extremite C dans la rosace et on le relie a un cable libre venant
du
bureau I.
Cette adaptation du réseau au trafic observe ne vaut pas seulement
pour les lignes auxiliaires. Pour faciliter le travail des opératrices
"il y a lieu de réunir (sur les tableaux) autant que possible,
les abonnes en groupes sympathiques, si on nous permet cette expression,
c'est-a-dire en groupes de personnes causant le plus habituellement
ensemble. Cette distribution des abonnes n'est pas une chose une fois
faite ; il y a des mutations fréquentes pour diverses raisons
changement, de domicile d'un abonné, arrivée d'un nouvel
abonné, etc.
Ce type de gestion du réseau correspond à un petit réseau.
Parallèlement , après Cornéluis
Herz, des travaux sont repris et développés par un électricien
belge, M. Van Rysselberghe, directeur du service météorologique
de Bruxelles, ils ont donné des résultats dans le monde
scientifique , mais l'idée et les études préliminaires
sont entièrement dues au docteur Herz.
Les essais de M. Van Rysselberghe furent faits entre Paris
et Bruxelles, le 17 mai 1882, à une distance de 544
kilomètres.
M. Van Rysselberghe, outre qu'il supprime l'induction dans les fils
voisins, comme l'avait fait son prédécesseur, est arrivé
à ce résultat remarquable, de pouvoir faire fonctionner
en même temps, et sur un même fil, un appareil téléphonique
et un appareil télégraphique.
La revue "L'Electricen" nous raconte :
Des expériences téléphoniques très intéressantes
, et qui peuvent avoir des conséquences praliques importantes
, ont été faites , le mois dernier , entre Paris et Bruxelles
. M. van Rysselberghe , directeur du service
météorologique de Belgique , inventeur du nouveau procédé
, a , d'une part , perfectionné le téléphone ,
et de l'autre , il a trouvé un système faisant disparaitre
l'induction occasionnée par les lignes télégraphiques
. Enfin , il a atteint ce résultat remarquable de pouvoir faire
travailler , en même temps , sur un même fil , un appareil
télégraphique et un appareil téléphonique
, en sorte que l'on peut à la fois sur ce fil faire passer une
conversation et un échange de dépêches .
Voici , par exemple , deux messages qui ont été envoyés
simultanément le 17 mai 1882 .
Par le Morse on a transmis ce qui suit :
A Monsieur Call , directeur - ingénieur des télégraphes
. Je prie monsieur le directeur - ingénieur Caël de recevoir
par Morse , de Bruxelles à Paris , mes compliments les plus affectueux
; la présente dépêche passée , en même
temps qu'un télégramme téléphonique , à
M. le ministre Cochery , sur l'unique fil qui nous relie en ce moment
.
En même temps le téléphone dictait le message
suivant :
A Monsieur COCHERY , ministre des postes
et des télégraphes . Je suis heureux de transmettre à
M. le Ministre des postes et des télégraphes de France
, au nom de l'administration des télégraphes de Belgique
, la première dépêche téléphonique
Transmise entre Bruxelles et Paris , par une méthode due à
M. van Rysselberghe et permettant de transmettre par un même fil
des télégrammes ordinaires en même temps que des
dépêches parlées .
Je suis certain d'être l'interprète de M. le Ministre des
travaux publics de Belgique en exprimant à M. le Ministre des
postes et des télégraphes de France toute la satisfaction
que nous éprouvons en constatant la possibilité d'augmenter
encore les relations entre les deux pays .
Dans d'autres expériences, faites avec beaucoup d'attention,
par l'administration française, en 1882, entre Paris et Nancy,
on a fait franchir à la
voie 555 kilomètres. Pendant une heure les ingénieurs
conversèrent entre eux d'une gare à l'autre, au moyen
du fil de la ligne télégraphique.
Bien mieux que les Américains avec le
système Hopkins à la même époque,
des expériences faites en France, avec le téléphone
de M. le Dr Cornélius Herz, on a pu transmettre
la parole beaucoup plus loin, puisqu'on a pu parler de Tours à
Brest, en passant par Paris, sur une longueur de circuit de 1140
kilomètres, avec le fil de fer de 4 millimètres des
télégraphes
.1882-1883 Evolution du téléphone
dans le monde en nombre d'abonnés
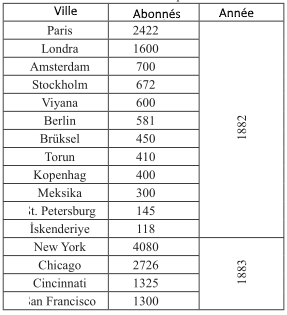 Derrière
les Etats unis, la France est plutôt bien équipée.
Derrière
les Etats unis, la France est plutôt bien équipée.
1883 la SGT décide
de leur faire un procès pour contrefaçon pour essayer
d'enrayer cette concurence.
La SGT est représenté par Armengaud Jeune, ingénieur
conseil et administrateur de la société, et J.E.Engrand
avoué de 1ere instance auprès du tribunal de la Seine.
Suivirent des saisies descriptives chez certains constructeurs et fait
assigner devant le tribunal de la Seine des sociétés dont
: La Société anonyme Maison Bréguet; Maiche, Lenczewski,
Journaux, De Locht-Labye , Beillahache, M portevin fils... Mildé
fils, la Société du gaz de nice , Bert et D'Arsonval,
D'Argy ...
A.Jeune expert en brevet tend à prouver que les appareils dérivent
des brevet français d'Edison pour l'emploi du micro à
charbon et de la bobine d'induction.
Le régime des réseaux exploités
par l'Etat fut également fixé par un arrêté
en date du 1er janvier 1883.
Pour diminuer la dépense à la charge de l'Etat, l'Administration
admit le principede la contribution de l'abonné en vue de l'établissement
de la ligne : l'abonné avance une certaine somme et l'Etat le
rembourse en ne lui faisant pas payer ses futures redevances annuelles.
L'abonnement est moins élevé que celui de la S.G.T., il
est de 200 Francs pour les réseaux de moins de 200 abonnés
et 150 Francs pour les autres mais contrairement à la S.G.T qui
fournit le poste, les abonnés doivent acheter leurs appareils.
L'Etat installe le poste et fournit les piles et les accessoires moyennant
une redevance supplémentaire de 75 Francs. Pour la même
prestation et pour un réseau de plus de 200 abonnés, le
coût à la S.G.T est donc de 400 Francs et 425 Francs pour
un réseau d'Etat.
l'État qui a certes concédé les réseaux
de certaines villes à l'industrie privée, n'en a pas pour
autant renoncé à ses droits, et décide d'ouvrir
en propre des réseaux téléphoniques dans d'autres
villes, moins peuplées, donc moins favorables à l'essor
du téléphone.
Ainsi, le 1er avril 1883, l'Administration ouvre-t-elle à l'exploitation
téléphonique les réseaux téléphoniques
des villes de Reims et de Roubaix-Tourcoing puis Saint
Quentin le 31 décembre 1883.
De son côté la Société Générale
mettait en service ses derniers réseaux :
- Calais le 1er juillet 1883,
- Rouen le 15 juillet 1883,
- Alger le 26 juillet 1883,
- et Oran le 10 août 1883.
 |
En 1883, l’architecte du nouvel Hôtel
de ville de Paris ouvre un marché pour l’installation
d’un service complet de 400 sonneries électriques d’alarme,
d’un service d’incendie de 45 postes et d’un système
de 100 porte-voix pour la correspondance des cabinets. En 1884, Charles Mildé a l’idée d’améliorer légèrement le microphone d’Argy et dépose un brevet à son seul nom, spoliant alors l’inventeur |
   |
1883 les ingénieurs et
électriciens travaillent encore pour améliorer les
performances du téléphone .
Paru dans la lumière électrique
|
Au 1er janvier 1883, la Société générale
des Téléphones comptait 2.692 abonnés à Paris
et 1.500 dans les autres départements.
En septembre de la même année,
le nombre total des abonnés de la Société s'élevait
à 4.739, répartis de la manière suivante :
Paris, 2.992; Lyon, 528 ; Marseille, 336 ; Bordeaux, 280; le Havre, 191;
Lille, 128; Nantes, 89; Saint-Pierre-lès-Calais,85; Rouen, 62;
Oran, 30; Alger,18.
A Rouen, le réseau ne put être établi qu'en 1883.
Une des causes du retard qu'a subi l'établissement
définitif des lignes dans cette ville provient de la difficulté
qu'éprouva la Société à obtenir des propriétaires
l'autorisation de poser les supports sur les toits de leurs immeubles.
Saint-Pierre-les-Calais (Calais-Saint-Pierre depuis la fusion des deux
municipalités), aujourd'hui le premier centre manufacturier du
Pas-de-Calais, est une des villes de France où le téléphone
a pris le plus rapide accroissement.
Au 1er décembre 1883, son réseau téléphonique
comptait 87 abonnés, tandis que Rouen n'en avait à la même
époque que 63 pour une population plus que triple.
Un certain nombre d'installations téléphoniques furent faites,
dans le courant de cette année, chez des propriétaires d'usines
de Paris et des environs qui ont leurs fabriques et leurs maisons reliées
par une ligne téléphonique privée.
Au 31 décembre 1883, la SGT compte 3 039 abonnés.
|
A PARIS, Le plus gros central, Opéra,
a 603 abonnés ; le plus petit rue Lecourbe en a 50. Mais la répartition par centraux a évolué. Le quartier de l'Opéra y compris le secteur de la rue Lafayette compte toujours un fort pourcentage d'abonnés mais le coeur du système s'est déplacé vers les quartiers industriels et commerciaux de la rue Etienne Marcel et de la place de la République. |
 |
Le musée Grévin fut mis en communication
avec le concert de l'Eldorado. Tous les soirs des auditions téléphoniques
théâtrales avaient lieu au musée.
Plus tard ce musée fut également relié aux théâtres
des Nouveautés et des Variétés.
En 1883, l'État qui a certes concédé
les réseaux de certaines villes à l'industrie privée,
n'en a pas pour autant renoncé à ses droits, et décide
d'ouvrir en propre des réseaux téléphoniques dans
d'autres villes, moins peuplées, donc moins favorables à
l'essor du téléphone, mais à des conditions tarifaires
et de services proposés plus avantageuses que ne l'offre la S.G.T
dans les villes concédées.
Ainsi, le 1er avril 1883, l'Administration ouvre-t-elle à l'exploitation
téléphonique les réseaux téléphoniques
des villes de Reims et de Roubaix-Tourcoing !
sommaire
Dans le département de Seine-et-Oise, 12 postes
téléphoniques reliaient entre eux les établissements
des grandes fabriques Decauville.
Les fils aboutissent à Petit-Bourg, Évry et Corbeil; de
sorte que les chefs de gare de ces trois localités peuvent prévenir,
par le téléphone, M. Decauville de l'arrivée en gare
de ses marchandises.
Depuis le l° septembre 1883, les grandes compagnies de chemins de
fer de France ont adopté le téléphone comme appareil
avertisseur concurremment avec le télégraphe.
A cette époque, la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest reliait
par une ligne téléphonique ses deux grandes gares de Paris,
Montparnasse et Saint-Lazare.
Des postes téléphoniques dits postes de secours furent posés
à la gare Saint-Lazare, ainsi que dans les stations de Bois-Colombes
et Colombes embranchement.
sommaire
Le succès qui venait de couronner les efforts de la Société
générale des Téléphones, avait fait comprendre
aux plus incrédules toute la valeur de la nouvelle invention et
l'avenir qui lui était réservé.
Aussi, dans la session ordinaire de 1882, le ministre des postes et des
télégraphes demanda aux Chambres et en obtint un crédit
de 250.000 francs destiné à expérimenter l'exploitation
de réseaux téléphoniques dans certaines villes de
province.
Pour diminuer les dépenses de premier établissement, l'administration
fit participer l'abonné aux frais de construction de la ligne;
voici les bases du régime sous lequel les réseaux de l'État
sont exploités d'après l'arrêté du 1er janvier
1883.
La part contributive de l'abonné aux frais d'installation est :
Pour les lignes aériennes dans le périmètre de distribution
gratuite des télégrammes par kilomètre de fil simple
de.................................. 150 francs
Pour les lignes souterraines : En câble multiple............. 500
francs, En câble simple............... 900 francs
En dehors du périmètre de distribution gratuite, les fils
sont considérés comme des lignes privées, et soumis
aux règlements spéciaux. Les appareils sont également
fournis par l'abonné.
Ainsi un abonné, relié au bureau central par un fil de 1
kilomètre, aura à payer au moment de la mise en service
de sa ligne :
Pour 1 kilomètre de ligne....... 150 francs
Pour achat d'appareil............. 133 francs
Pour piles et installations........ 75 francs
Soit un total de...................... 300 francs
sommaire
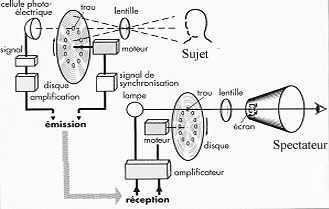 |
|
Le chant du téléphone. On découvre ce qu'on appellera plus tard le "larsen" , phénomène redouté ds acousticiens et musiciens.
| On désigne ainsi un phénomène
très curieux que plusieurs expérimentateurs ont déjà
signalé, et sur lequel de récentes observations de M.
Deckert, de Vienne, attirent plus particulièrement l'attention.
Il consiste dans ce fait qu'un téléphone placé
dans des conditions déterminées, peut, en quelque sorte,
entretenir sa propre vibration et faire entendre un son indéfiniment
prolongé. Les dispositions à prendre pour réaliser
l'expérience sont très simples en elles-mêmes,
ne demandent qu'un peu de soin et de bons appareils : un microphone
de grande sensibilité étant mis en court circuit sur
sa batterie et le fil primaire de sa bobine d'induction, on place
un téléphone, de préférence bipolaire,
de construction soignée, en face et à faible distance
du microphone. Si, dans ces conditions, on vient, en soufflant ou
en sifflant, à ébranler la couche d'air qui sépare
les deux appareils, le récepteur téléphonique
rend un son qui pourra ne cesser que lorsque le courant qui actionne
le microphone aura pris fin. Le son émis est assez intense et de hauteur variable, selon les appareils utilisés; il persiste lorsqu'on intercale un diaphragme de faible épaisseur; un tube de même diamètre que l'intervalle le renforce, de même que l'adjonction de quelques éléments de pile. Avec des appareils de précision, le téléphone chante dès qu'on le touche légèrement, ou même parfois spontanément. On a donné diverses explications de ce phénomène : une l'attribue à l'action du courant dont les variations se traduiraient par des effets calorifiques, puis acoustiques, la fréquence des vibrations allant en s'affaiblissant ; une autre en fait une théorie purement acoustique. La plus plausible et la plus complète de ces théories paraît être celle qu'en donne M. A.-W. Lamberg; elle repose sur ce fait connu, que le passage d'un courant constant par un contact imparfait, mobile et élastique, met en vibration le conducteur lui-même, qui produit une sorte de bourdonnement : ce serait le cas du microphone. Pour expliquer le chant du téléphone, M. Lamberg distingue trois périodes : la première impulsion part de la membrane du microphone, dont le mouvement vibratoire est modifié par suite du mouvement de l'atmosphère ambiante; le contact des charbons devient plus parfait et la résistance diminuant, le courant primaire acquiert plus d'intensité : cela se traduit dans la deuxième période par des courants induits qui influencent le magnétisme du téléphone; enfin le troisième terme de cette série est le phénomène acoustique de la vibration de la. colonne d'air qui se trouve entre les diaphragmes des deux appareils. Entre ces trois moments il s'exercerait une action réciproque, analogue k celle qui se produit entre le système inducteur et l'induit d'une dynamo qui s'amorce et qui tendrait à renforcer le phénomène jusqu'à son maximum d'intensité. Quoi qu'il en soit de l'exactitude de ces causes, le chant du téléphone, ainsi provoqué par le seul rapprochement convenable des deux principaux organes téléphoniques, serait susceptible d'être transmis à distance et deviendrait le sujet d'applications nouvelles très intéressantes , dont quelques-unes sont déjà brevetées. |
En 1884, au 31 mars,
la S.G.T dessert en tout et pour tout 11 villes avec un
total de 5.079 abonnés en France+Algérie, dont 3.227
pour Paris.
(Nous parlons bien d'abonnements réels 1 abonnement=1 ligne téléphonique reliée au central, et non pas du nombre de "postes de toute nature", notion flatteuse qui permettait de doubler artificiellement le nombre d'abonnés au téléphone, en comptant les multiples téléphones souvent branchés en parallèle sur les lignes... Ces deux notions étant souvent confondues par erreur dans les divers ouvrages rédigés a postériori).
Les 11 villes desservie sont : Paris, Lyon, Marseille,
Bordeaux, Nantes, Lille, le Havre, Rouen, Saint-Pierre-lès-Galais,
Alger et Oran.
En 1884 furent mis en service les réseaux de Halluin, Troyes, Nancy,
Dunkerque et Elbeuf.
La concession accordée à la S.G.T. en 1879 arrivant à
terme en 1884, cette expérience avait pour but de fournir de précieux
renseignements sur l'un ou l'autre mode d'exploitation, le 19 juin
1884, paraît au Journal Officiel, page 3187, un Rapport
daté du 4 mai 1884 adressé au Président de
la République, sur l'organisation des services des Postes et des
télégraphes avant et depuis l'année 1878. Ce rapport
est chargé de faire le point, notamment sur le développement
téléphonique en France depuis 1879.
Les termes de la nouvelle concession furent consignés dans le cahier
des charges du 18 juillet 1884. Ils reproduisaient les principales clauses
de celui de 1879 :
- La concession est accordée pour cinq ans,
- Le permissionnaire paie à l'Etat, à titre de droit d'usage,
10 % des recettes brutes,
- L'Etat construit et entretient les réseaux aux frais des concessionnaires
et peut à tout moment racheter le matériel de l'entreprise.
De son côté le permissionnaire est chargé de l'introduction
des fils à l'intérieur des immeubles, d'installer les téléphones
chez les souscripteurs, d'assurer le service téléphonique
en installant les centraux et en rémunérant les techniciens
et les demoiselles du téléphone.
Il y est détaillé qu'en seulement une année d'exploitation,
la ville de Reims compte une densité d'abonnés par habitants
supérieure à celle des villes placées sous concession
privée de la S.G.T depuis 4 années. (23 abonnés pour
10.000 habitants pour Reims) supérieure à la meilleure densité
d'une ville sous concession de la S.G.T (allant de 3 à 22 abonnés
pour 10.000 habitants)
En conclusion, en une seule année d'exploitation, l'Administration
des Postes et Télégraphes fait mieux que la S.G.T en 4 années
d'exploitation...
L'arrêté du 26 juin 1879 est remplacé
par l'arrêté du 18 juillet 1884 (BO P&T 1884 n°20
page 845) autorisant à nouveau l'industrie privée à
demander, à partir du 8 septembre 1884, une nouvelle autorisation
d'exploitation, et fixant le cahier des charges.
Dans la foulée, la seule société privée qui
exploite encore des réseaux téléphoniques en France,
la Société Générale des Téléphones,
parvient à faire renouveler sa concession pour 5 années
de plus.
L’Etat crée la première ligne importante,
reliant le réseau de la ville de Reims au palais de la bourse
de Paris, qu’il équipe de cabines téléphoniques.
Jugeant certainement la situation précaire, la S.G.T. diminua ses
investissements. Elle céda à l'Etat le réseau de
Lille et mit en service son dernier réseau à Saint-Etienne
le 15 juillet 1884.
Par contre les affaires de l'Etat devenaient florissantes
et en 1884 furent mis en service les réseaux de Halluin, Troyes,
Nancy, Dunkerque et Elbeuf.
Le premier réseau Normand fut celui d'Elbeuf
mis en service le 25 novembre 1884 avec 46 abonnés.

 |
LES
CABINES TÉLÉPHONIQUES Avant la fin de 1884, on commença l'installation de cabines téléphoniques publiques à Paris et dans quelques villes de province. Ces cabines, qui rendent tant de services, existent actuellement, à Paris, dans tous les bureaux de postes et télégraphes et les bureaux centraux de la Société générale des Téléphones, au nombre de 82 à Paris, et 77 dans les villes de province. |
Ce service fut ouvert au public le 1er janvier 1885.
Fin 1885, Paris compte 35 cabines enregistrant chacune une trentaine de communications hebdomadaires
|
Le Président
de la République française. |
|
Article
premier.
|
| Toute personne
peut, à partir des cabines téléphoniques mises
par l'Étatà la disposition du public, correspondre,
soit avec une autre personne placée dans une cabine téléphonique
de la même ville, soit avec un abonné du réseau. La taxe à percevoir pour l'entrée dans les cabines publiques est fixée, par cinq minutes de conversation : A Paris, à 0 fr. 50 Dans toutes les autres localités de France, d'Algérie et de Tunisie, à 0 fr. 25 |
|
Article
2.
|
|
Des communications
téléphoniques à distance peuvent être
mises à la disposition du public. Fait à
Paris, le 31 décembre 1884. Signé : JULES GRÉVY. |
Depuis cette époque toute personne est admise à
communiquer avec n'importe quel abonné au réseau de Paris
aux conditions suivantes :
Les personnes non abonnées au service téléphonique
du Paris, payent une taxe de 50 centimes pour cinq minutes de conversation.
Dans toutes les autres localités de France, d'Algérie et
de Tunisie, 23 centimes.
Le gouvernement délivre aux abonnés de Paris, sur
la présentation de leur contrat, une carte d'abonnement,
dont le prix est de 40 francs par an, et qui leur permet de communiquer
dans tous les bureaux téléphoniques et bureaux de quartiers
de la Société générale des Téléphones
indistinctement.
La Société générale des Téléphones
remet à tous ses abonnés, sur la présentation de
leur contrat d'abonnement, des cartes de communication, leur donnant droit
de communiquer gratuitement dans tous les bureaux de quartiers de la Société
générale des Téléphones, mais dans ses bureaux
seulement.
Chaque abonné a droit à autant de cartes qu'il a d'abonnements.
Les cercles et les établissements publics, tels que cafés,
restaurants, hôtels, etc, abonnés aux réseaux téléphoniques
concédés à l'industrie privée, sont autorisés
à mettre le téléphone à la disposition de
leurs membres ou clients, moyennant le payement d'un abonnement double
de celui qui est fixé par le tarif applicable aux abonnés
ordinaires.
Le deuxième abonnement perçu par le permissionnaire revient
intégralement à l'État.
Le produit des communications par cabine publique est entièrement
acquis à l'État dans les réseaux de l'État
; dans les réseaux de la Société, il se partage entre
l'État et la Société.
Après neuf heures du soir, le public n'était pas admis toutefois
àtéléphoner dans les cabines de Paris; depuis le
1er avril 1887, un certain nombre de cabines ont été mises
à sa disposition après neuf heures dans les bureaux suivants
:
Toute la nuit : bureau n° 44, rue de Grenelle ;
Jusqu'à minuit : bureau n° 92, rue Boissy-d'Anglas .
...................................... 11, avenue de l'Opéra;
.......................................89, au Grand-Hôtel;
11 heures du soir: bureau n° 5, place de la République;
.......................................17, rue des Halles ;
.......................................26, gare du Nord ;
.......................................33, boni, de l'Hôpital;
.......................................45, av. des Ch.-Elysées
:
.......................................91, boul. Saint-Denis.


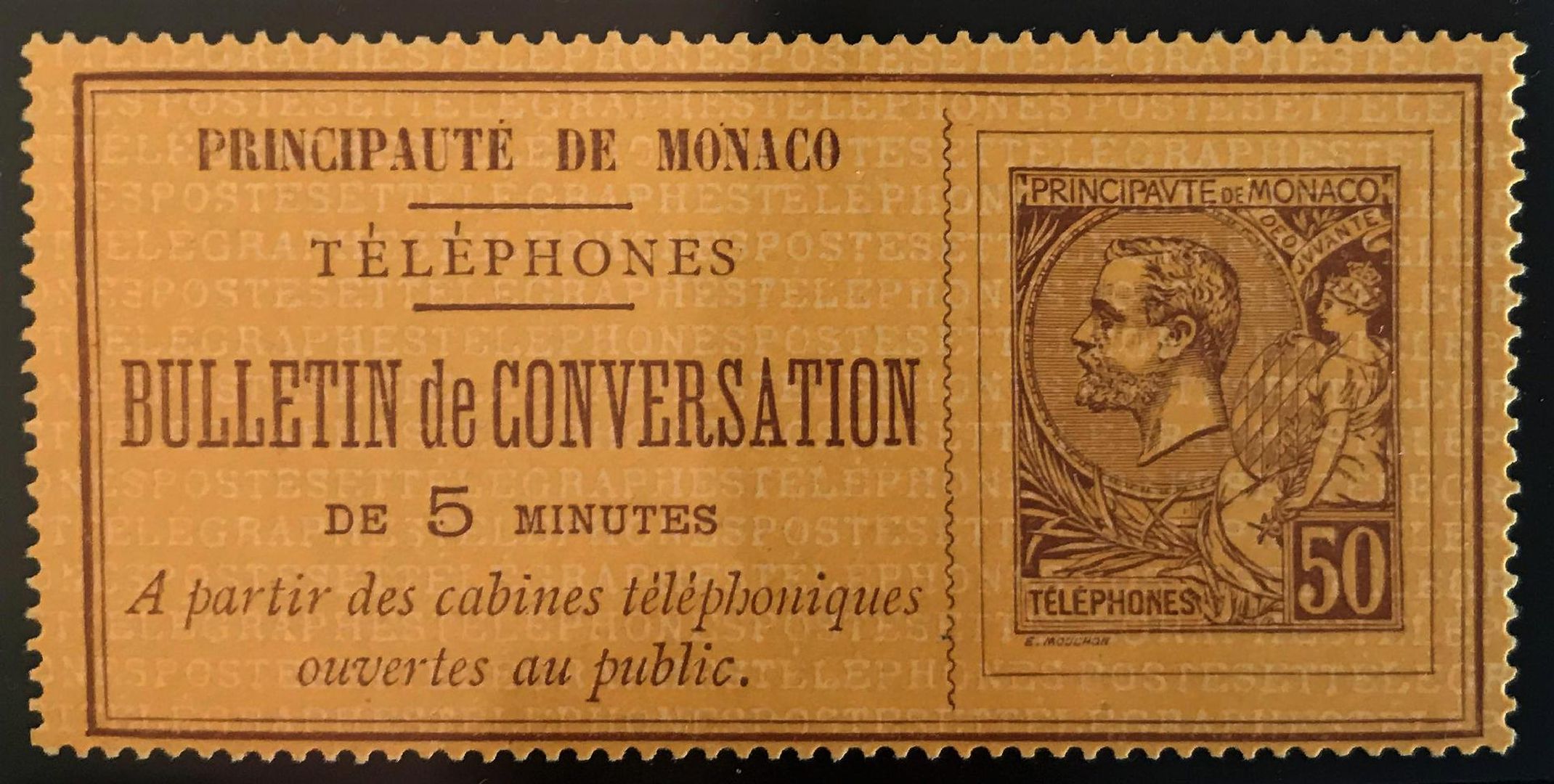
1883 - 1885 à NICE
jeudi 14 juin 1883 Le Petit Niçois nous apprend qu’une
entreprise de la ville vient d'installer un téléphone, qui
serait le troisième à Nice.
À noter qu’il s’agit encore de liaisons point à
point et que, d’un poste d’appel, on ne peut joindre que le
seul correspondant auquel le câble vous relie.
« Téléphones. – Un troisième téléphone
a été établi hier à. Nice.
C’est la Société générale de transports
qui l’a fait établir pour mettre en communication ses bureaux
de la rue Gubernatis avec ses remises situées au quartier Riquier.
On sait qu’il existait déjà deux téléphones
dans notre ville : l’un entre la Caisse de Crédit et la Villa
de M. Sicard à Saint-Jean ; l’autre entre le Théâtre
Français et le café de la Maison Dorée. »
Un autre article du Petit Niçois paru le 6 mars 1885 écrit
« Téléphone. – À la suite d’une
démarche auprès de M. le ministre des postes et télégraphes,
des avantages plus sérieux viennent d’être accordés
à notre ville pour l’établissement d’un réseau
téléphonique. M. Cochery persiste toujours – il est
vrai – à refuser une exploitation quelconque des téléphones,
exploitation qu’il ne saurait concéder à une cité
sans être immédiatement assiégé de demandes
analogues, mais il consent, en faveur de Nice, à une nouvelle réduction
dans le chiffre des abonnements pour commencer les travaux.
Ce chiffre, qui avait déjà été réduit
à 80 au lieu de 200, se trouve maintenant fixé à
50. Dans ces conditions excellentes nous espérons que nos concitoyens
s’empresseront de profiter des faveurs accordées par le gouvernement
à la ville de Nice et que prochainement fonctionnera parmi nous
cet utile et rapide moyen de communication. »
1885
L'affaire de contrefaçon de 1882 intentée par la SGT
refait surface.
Les avocats de la SGT produisent un document pour instruire le futur procès
( à lire dans la lumière électrique du 21 mars 1885),
pour Louis Maiche la conclusion est sans appel "Ce parleur de M.Maiche
reproduit tous les caractères distinctifs du système Edison";
L.Maiche ne peut pas luter contre la mauvaise foi de la puissante et souveraine
SGT. Et c'est pareil pour les autres sociétés poursuivies
: La Société anonyme Maison Bréguet; Lenczewski,
... Bert et D'Arsonval, d'Argy, Mildé ....
Cela entraina la faillite de Locht Labye ainsi que d'autres constructeurs.
1885 Avec la constructions des appareils télégraphiques
et des progrès ininterrompus, les lignes aériennes n'avaient
pas évoluées depuis plus de trente ans sous le règne
des télégraphes jusqu'à ce que Lazare Weiller,
Ingénieur chercheur et inventeur se livre dans l'atelier de son
usine à des expériences sur la conductivité de l'électricité
par les métaux et lorsqu'il est à Paris, travaille dans
un laboratoire du Collège de France. Il met au point un alliage
qu'il nomme "bronze siliceux" ou "bronze phosphoreux"
et qui allait révolutionner le transport du courant électrique
car le bronze siliceux est bien plus avantageux sur tous les plans
pour construire nos réseaux téléphoniques.
On peut lire l'étude de 1885 "Construction
des réseaux électriques aériens en fils de bronze
siliceux" de Vivarez, Henry.
1885 Conformément aux conventions passées
entre le ministre des postes et télégraphes et la Société
générale des Téléphones, les abonnés
du réseau téléphonique de Paris pourront prochainement
expédier et recevoir leurs dépêches télégraphiques
par le téléphone. A cet effet, on procède actuellement
à l'établissement, dans le bureau télégraphique
central de la rue de Grenelle-Saint-Germain, d'un service téléphonique
qui fonctionnera de jour et de nuit.
Les télégrammes échangés dans ces conditions,,
seront soumis à la taxe du tarif en vigueur ; mais les abonnés
qui voudront profiter de cette nouvelle mesure, devront contracter un
abonnement supplémentaire, dont le ministre a fixé le montant
à la somme de 50 francs par an.
Toujours en 1885 , en revenant du Portugal où il a effectué
des expériences à grande distance, M. Van Rysselbergh
a eu une entrevue avec M. Cochery au sujet de l'installation
des communications téléphoniques entre Rouen et le Havre,
Les travaux sont déjà commencés dans les bureaux
télégraphiques de ces deux villes et, d'ici peu de temps,
les abonnés des réseaux pourront correspondre entre eux,
comme le font déjà ceux d'Anvers et de Bruxelles.
1885 Le
gouvernement s'occupa de la réception et de la transmission des
dépêches télégraphiques par téléphones.
Conformément à une convention passée entre le Ministre
des Postes et des Télégraphes et la Société
générale des Téléphones, depuis le 15 février
1885, les abonnés du réseau téléphonique de
Paris peuvent expédier et recevoir leurs dépêches
télégraphiques par le téléphone. Un service
téléphonique qui fonctionne de nuit et de jour est établi
à cet effet dans le bureau télégraphique central
de la rue de Grenelle.
Les télégrammes échangés dans ces conditions
sont soumis à la taxe du tarif en vigueur ; mais les abonnés
qui veulent profiter de cette mesure doivent contracter un abonnement
supplémentaire, dont le montant fixé par le ministre, est
de 50 francs par an.
Le texte des dépêches adressées aux abonnés
de ce service doit être précédé du mot : TÉLÉPHONE.
Toute dépêche téléphonée est en même
temps confirmée par écrit par le service ordinaire des tubes
pneumatiques.
La Société générale des Téléphones,
étant responsable vis-à-vis de l'État de l'acquittement
des taxes à percevoir pour les dépêches transmises
par téléphone, peut exiger que chaque abonné à
ce service spécial lui constitue une provision eu rapport avec
l'usage qu'il compte en faire.
Les dépêches en langues étrangères ne peuvent
être transmises par téléphone.
L'administration supérieure a pris les dispositions suivantes concernant
la façon d'utiliser les bons de réponses payées dans
le cas des télégrammes téléphonés à
domicile :
1° L'autorisation de conserver et utiliser les bons de réponse
sera donnée au receveur du bureau n° 44, au lieu et place des
agents de la Société.
2° Toute dépêche avec réponse payée, restituée
au poste central après avoir été transmise par téléphone
à l'abonné, sera envoyée au bureau n° 44.
3° Le bureau n° 44 établira le bon de réponse dans
tous les cas de dépêches téléphonées,
le conservera s'il en a l'autorisation, et l'appliquera eh établissant
les taxes à un télégramme expédié par
le bénéficiaire
du bon.
4° Si l'autorisation n'a pas été donnée, le bon
sera inséré dans le télégramme à expédier
par les tubes au destinataire. Sur l'adresse du télégramme
et sur le reçu, il sera fait mention de l'envoi du bon.
Nota. — L'abonnement annuel de 50 francs, mentionné ci-dessus,
donne, en même temps, le droit d'user du service des communications
interurbaines, c'est-à-dire de communiquer avec tous les réseaux
téléphoniques reliés ou à relier à
celui de Paris, dans les conditions prévues par l'arrêté
ministériel du 2 février 1887.
Par suite de cette convention, il fut décidé que la transmission
des télégrammes par téléphone pourrait être
faite clans plusieurs villes, notamment à Bordeaux et à
Marseille. Il fut décidé, en outre, que des cabines téléphoniques
publiques seraient placées dans certains bureaux des postes et
télégraphes de ces villes.
En 1885 Edouard ESTAUNIÉ ingénieur
des télégraphes, réalise avec son collègue
Émile Brylinski le premier dispositif permettant de mesurer les
courants électriques dans les lignes téléphoniques.
Ce système obtiendra une médaille de bronze à l'Exposition
Universelle de Paris en 1889.
À partir des Tableaux Monocordes puis Dicordes
à Batterie Locale, la fabrication se normalise. On les appelle
usuellement les Tableaux Standards à Batterie Locale. Les
Tableaux Standards à Batterie Locale sont fabriqués pour
10, 25, 50, 100 voire 200 abonnés...
Lorsque l'on dépassait ce nombre d'abonnés, l'on pouvait,
sans trop de gêne pour l'Opératrice "du meuble",
en accoler un second contre le premier, étant donné que
les cordons avaient une longueur suffisante pour raccorder deux abonnés
de deux meubles différents.
Il n'en allait pas de même dans les grandes villes, où l'on
se heurtait au nombre élevé d'abonnés rattachés
à un seul Central Téléphonique... Ce qui amenait
à accoler un nombre élevé de Tableaux Standards au
fur et à mesure de l'accroissement du nombre de lignes d'abonnés...
Pour contourner cette difficulté, il était nécessaire
de créer entre les différents meubles, des lignes auxiliaires,
sorte d'intermédiaires électriques disponibles entre deux
meubles...
Du coup, deux Opératrices étaient désormais nécessaires
pour établir une conversation entre deux abonnés rattachés
au même Central Téléphonique mais sur des meubles
éloignés... Ce qui nécessitait plus de personnel,
plus de manœuvres, plus de délai pour établissement
de la conversation et plus de risques d'erreurs...
Ce sont dans les grandes villes (Paris ou Marseille, par exemple) que
le travail d'Opératrice s'avère alors le plus pénible,
le plus stressant, le plus usant... N'est pas Opératrice pendant
plusieurs années qui le veut, mais qui le peut...
Parfois, aux heures les plus chargées, plus aucune ligne auxiliaire
entre certains meubles d'un même Central Téléphonique
n'était disponible, et il était nécessaire de différer
les appels, source de limitation et de fort mécontentement des
usagers...
Avec l'expérience, il a été constaté qu'au
delà de 500 abonnés, l'exploitation des Tableaux ainsi regroupés
devenait particulièrement lourde et pénible pour les Opératrices.
Il était donc nécessaire, pour les grandes villes de trouver
de nouveaux procédés de Commutation...
C'est en 1883 que la Western Electric Company invente
une technique révolutionnaire : le Multiplage.
Le Multiplage est un mode de conception et de raccordement
qui permet de créer un Tableau pouvant regrouper et commuter jusqu'à
10.000 abonnés !
Sans aucun intermédiaire, une Opératrice peut désormais
relier chaque abonné demandeur de sa section avec n'importe quel
abonné demandé du même Tableau Multiple, directement,
sans aucun intermédiaire.
Cette évolution majeure va autoriser l'amélioration de l'exploitation
téléphonique manuelle dans les grandes villes, pour un certain
temps.
Les premiers Commutateurs Multiples, construits à partir de 1885,
sont des Commutateurs Multiples en Série, à Batterie Locale.
Un Commutateur Multiple en Série est donc un Commutateur
de grande capacité, qui est exploité par plusieurs Opératrices
simultanément.
Mais comme pour un Commutateur de petite capacité, une Opératrice
ne s'occupe que de 100 ou 200 abonnés...
Chaque Opératrice est donc en charge de "ses" abonnés,
sur la partie du meuble qu'elle exploite.
Pour "ses" abonnés dont elle est en charge, l'Opératrice
dispose sur sa partie de meuble d'un Jack dédié à
chaque abonné, comme pour les centres de petite capacité.
Mais dans un Centre de grande capacité, chaque Opératrice
dispose en plus de Jacks Généraux et d'un nombre de clefs
de manœuvres suffisant qui lui permettent de joindre, pour "ses"
abonnés demandeurs n'importe quel abonné demandé
de ce même Central, directement, sans avoir besoin de faire appel
à une seconde Opératrice intermédiaire.
Cette solution, qui sera déployée dans le monde à
partir de 1885 permettra une meilleure exploitation téléphonique
dans les grandes villes, et de moins pénibles conditions de travail
pour les Opératrices.
De surcroît les Commutateurs Multiples en Série à
Batterie Locale les plus récents voient leurs Annonciateurs à
volet basculant remplacés par des ampoules à incandescence,
qui en s'allumant signalent à l'Opératrice que tel ou tel
abonné demandeur souhaite joindre le Central, et s'éteignent
lorsque les conversations téléphoniques sont terminées
et que les abonnés demandeurs ont renvoyé un appui sur le
bouton d'appel ou un tour de manivelle.
L'opératrice n'a désormais plus à relever physiquement
le volet basculant à la fin de chaque conversation, ce qui permet
une économie de gestes pour l'Opératrice.
En revanche, les Commutateurs Multiples en Série,
s'ils offrent une réelle amélioration dans l'exploitation
téléphonique, sont porteurs de certains défauts de
conception.
En effet, avant d'utiliser un Jack Général, il est d'abord
nécessaire d'effectuer un test d'occupation, pour savoir si un
Jack Général est libre ou déjà occupé
par une conversation en cours.
Ce test se fait par le deuxième fil de l'abonné (fil b)
au moyen d'une seule et même pile de test commune à tout
le bureau.
Or, en cas de mauvais isolement de certains abonnés, le résultat
des tests s'en trouve souvent faussé, ce qui entraîne des
erreurs d'exploitation et des fausses manœuvres par les Opératrices
ainsi induites en erreur.
De plus, les Commutateurs Multiples en Série souffrent de câblages
et de contacts très nombreux, très complexes, ce qui entraîne
beaucoup de temps perdu dans la maintenance et la recherche des pannes.
Enfin, leur défaut majeur réside dans le fait qu'en cas
d'extension nécessaire, lorsque l'on souhaite rajouter un ou plusieurs
meubles dans le Commutateur Multiple en Série déjà
en service, il faut obligatoirement couper l'ensemble des lignes générales,
pendant toute la durée des travaux, ce qui rend le Commutateur
Multiple en Série à peu près inutilisable jusqu'à
la fin de tout travail d'extension...
Affublés de ces défauts, les Commutateurs Multiples en Série
sont remplacés à partir de 1892 aux USA par de nouveaux
Commutateurs Multiples en Parallèle
sommaire
LES COMMUNICATIONS INTERURBAINES
C'est aussi en 1885, que le gouvernement entreprit l'établissement
des lignes téléphoniques interurbaines.
Le 16 janvier de cette année, deux communications à longue
distance furent mises à la disposition du public entre Rouen et
le Havre (192 kilomètres).
Les abonnés du réseau téléphonique de ces
deux villes peuvent correspondre entre eux à partir de leur domicile,
en payant une taxe de 1 franc par cinq minutes de conversation.
Entre Auxerre et Clamecy, sur le canal de l'Yonne, une installation téléphonique
établie par l'administration des ponts et chaussées, avec
des appareils du système Ader, relie, entre elles, toutes les écluses
sur une longueur de 63 kilomètres. 40 postes fonctionnent parfaitement
bien depuis 1883.
Du reste, depuis 1882, la direction technique des télégraphes,
des départements du Nord et du Pas-de-Calais, avait appliqué
ce système de communication aux canaux de ces deux départements.
Aux mines d'Anzin, une installation analogue de 38 postes téléphoniques,
faite par la Société générale des Téléphones,
en 1883, relie toutes les gares de la Compagnie et toutes les fosses de
la région.
En janvier 1886, le
nombre total des abonnés, en France, était de 7.173.
répartis sur 22 réseaux.
Onze de ces réseaux, exploités par la Société
générale des Téléphones, formaient un total
de 6.180 abonnés.
A cette époque l'État fit construire des lignes téléphoniques
entre Paris et Reims, Rouen et le Havre, Lille et Roubaix-Tourcoing.
En juillet de la même année le téléphone fut
substitué au télégraphe pour relier les différentes
stations du chemin de fer à voie étroite de Vahnondois (Aisne)
Vu dans le journal de physique : théorie du téléphone
magnétique transmetteur.
 |
Mercadier 1886
téléphone à réception multiple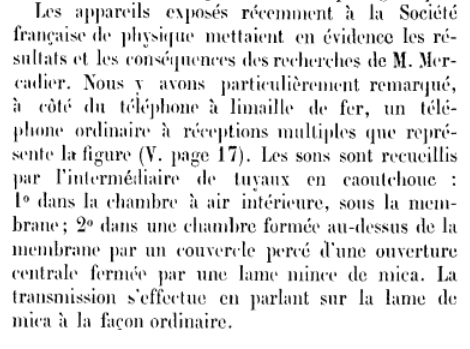 |
Le 24 février 1887,
à huit heures du matin, a été inauguré le
service de la correspondance téléphonique entre Paris
et Bruxelles.
La distance est de 333 kilomètres.
A la Bourse de Paris, le public a l'usage de deux cabines dont l'une est
affectée aux communications d'une façon permanente.
A Bruxelles, une cabine accessible jour et nuit est installée au
bureau du dépôt des télégrammes. Une seconde
cabine, établie près de la grande salle des réunions,
est ouverte au service pendant les heures de la Bourse seulement.
Extrait du journal La Nature, n°714 du 21 février 1887 :
| Samedi dernier, 29 janvier, a eu lieu l’inauguration
officielle de la ligne téléphonique de Paris à
Bruxelles. Toutes les personnes invitées à cette cérémonie
ont été vivement frappées de la netteté
et de la clarté des communications. On a mis aussi à
l’étude les moyens à adopter pour relier la ligne aux postes d’abonnés des deux réseaux ce qui lui donnerait une valeur considérable. On a également essayé, la semaine dernière, de transmettre à Bruxelles la musique de l’Opéra de Paris ; l’expérience a bien réussi et Sa Majesté la Reine a pu entendre de son palais tout un acte de Faust. Actuellement la ligne relie deux cabines respectivement placées dans les bourses des deux capitales. Elle est aérienne sur tout son parcours, sauf dans l’intérieur de Paris, depuis la porte de la Villette jusqu’à la Bourse ; dans cette partie elle est faite suivant le système Fortin Hermann, qui, comme on le sait, supprime les effets de retardation présentés par les lignes souterraines ordinaires et place celles-ci dans des conditions analogues à des fils aériens. La ligne comprend deux fils, aller et retour, de bronze siliceux de 3 millimètres de diamètre, se croisant à chaque poteau. C’est à cette disposition, ainsi qu’à l’emploi d’un métal de haute conductibilité, qu’est due la netteté de la transmission. Les appareils placés dans les cabines des deux bourses, sont ceux qui sont employés dans tous les postes d’abonnés ; on n’à pas eu besoin d’avoir recours à des téléphones très sensibles, comme sur la ligne de Paris à Reims. |
Il y a aujourd’hui neuf mois que l’ouverture
du service téléphonique de Paris à Bruxelles
a eu lieu : les résultats obtenus ont dépassé
les espérances, et l’encombrement de cette ligne est devenu
tel à certaines heures de la journée, qu’il a fallu
songer à doubler le service en établissant une seconde
ligne dont la construction, est, ou va être terminée.
Nous croyons donc intéressant de résumer les conditions
d’installation techniques qui ont permis de réaliser effectivement
ces communications, et d’utiliser la ligne aux communications
télégraphiques et téléphoniques simultanées.
Disons tout d’abord que la netteté des transmissions téléphoniques
entre Paris et Bruxelles n’emprunte absolument rien aux vertus
particulières des transmetteurs et récepteurs téléphoniques
employés. Tous les microphones et téléphones
expérimentés ont donné sensiblement les mêmes
résultats satisfaisants. La facilité relative des transmissions
tient simplement à la nature de la ligne, à double fil,
en bronze phosphoreux ou siliceux de très grande conductibilité
et aérienne, dans la plus grande partie de sa longueur qui
est de 320 km, soit 640 km de fil total. Cette ligne comporte trois
tronçons distincts, l’un en bronze phosphoreux, le deuxième
en bronze siliceux, le troisième en câbles enfermés,
système Fortin-Hermann, de la Chapelle à la Bourse de
Paris. La résistance totale de la ligne ne dépasse pas
1 600 ohms, ce qui, joint à l’emploi du double fil contribue
à assurer une excellente transmission téléphonique.
La ligne est anti-inductée par un croisement des deux fils
à chaque poteau ; ils se substituent l’un à l’autre
dans le prolongement de chaque ligne et égalisent les effets
d’induction des nombreux fils télégraphiques parallèles
voisins par une succession de boucles dans lesquelles ces effets d’induction
étant égaux et de signes contraires, s’annulent
à peu près complètement. Les appareils employés à Paris sont des microphones d’Arsonval avec des récepteurs d’Arsonval ou Aubry. À Bruxelles on fait usage des microphones Berliner ou Dejongh avec des récepteurs Bell. Les piles qui desservent le circuit microphonique (les deux postes fonctionnent avec des bobines d’induction) sont à Paris, les éléments de Lalande et Chaperon ; à Bruxelles des piles Leclanché, modèle à sac de M. Warnon. Les combinaisons des circuits assez complexes exigés aux deux bureaux où aboutissent les lignes, Bourse de Paris et Bourse de Bruxelles, sont toutes faites à partir d’un tableau général. La figure montre les dispositions d’ensemble de ce tableau pour le poste de la Bourse de Paris : toutes les communications des circuits entre eux s’établissent à l’aide de crochet Sieur, dont la manœuvre est très rapide et qui donnent des contacts très sûrs. |
Le nombre des cabines aux Bourses des deux villes a été doublé.
Aux termes d'une convention établie entre les gouvernements français et belge, le tarif d'abonnement des correspondances téléphoniques entre Paris et Bruxelles est établi ainsi qu'il suit :
Mensuellement, pour un usage quotidien
de 10 minutes consécutives ou moins........ 100 fr.
plus de 10 minutes jusqu'à 20 minutes........200 fr.
plus de 20 minutes jusqu'à 30 minutes....... 300 fr.
plus de 30 minutes jusqu'à 40 minutes....... 400 fr.
plus de 40 minutes jusqu'à 60 minutes ...... 300 fr.
plus de 60 minutes jusqu'à 70 minutes....... 530 fr.
plus de 70 minutes jusqu'à 80 minutes....... 600 fr.
et ainsi de suite en augmentant de 30 francs par période de 10 minutes.
Voici le régime des abonnements :
Les correspondances de plus de 10 minutes s'opèrent en une ou plusieurs séances de 10 minutes au maximum; la communication n'est maintenue à l'expiration de chaque période de cette durée que s'il n'y a aucune autre demande en instance. Le montant des taxes est perçu par anticipation.
La durée de l'abonnement est d'un mois au moins; elle se prolonge de mois en mois par tacite reconduction. L'abonnement peut être résilié de part et d'autre moyennant avis donné quelques jours à l'avance.
Il n'est fait aucun décompte de taxe à raison d'une interruption de service d'une durée de 2 heures au moins. Passé ce délai de 24 heures, il est remboursé à l'abonné, pour chaque période nouvelle de 24 heures d'interruption, un trentième du montant mensuel de l'abonnement.
Jusqu'à disposition contraire à concerter entre les administrations des postes et télégraphes, les correspondances du régime de l'abonnement ne sont point admises durant les heures de la tenue des Bourses de Bruxelles et de Paris.
Les communications d'État jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes d'État.
La date de la mise en vigueur du régime d'abonnement n'est pas encore fixée.
Voici les documents officiels concernant ce nouveau service :
|
CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE PARIS
A MARSEILLE
Nous donnons ci-après la description de l'installation de la ligne
téléphonique qui relie Paris à Marseille.
En raison des distances considérables que l'on est parvenu à
franchir, cette ligne fait, en quelque sorte, époque dans l'histoire
de la téléphonie.
— Le lecteur aura ainsi un aperçu de la construction des lignes
téléphoniques interurbaines.
De la Bourse de Paris, elle est souterraine jusqu'à la gare de
Vincennes, place de la Bastille; elle devient aérienne sur le reste
du parcours. Elle suit le chemin de fer de Vincennes jusqu'à la
ligne de Grande Ceinture, par laquelle elle rejoint le chemin de fer de
Paris à Mulhouse.
Elle quitte cette ligne à Troyes, et va rejoindre, à Dijon,
la ligne de Marseille.
Son développement est. en chiffres ronds, y compris les croisements,
changements, etc., de 1.000 kilomètres, soit pour le circuit complet,
de 2.000 kilomètres.
S'écartant quelque peu de la ligne principale de Paris à
Marseille, les fils téléphoniques passent par Troyes, Dijon,
Arles, Marseille. Ils sont en cuivre de haute conductibilité. Leur
diamètre est de 4,Smm. Le poids est d'environ 146 kilogrammes par
kilomètre et le prix de 2 fr. 30 le kilogramme.
La construction de la ligne téléphonique de Paris à
Marseille a coûté près d'un million.
La longueur moyenne des couronnes est de 200 mètres.
Le raccordement s'opère suivant le mode de jonction adopté
pour les lignes télégraphiques, à l'aide de manchons
et non de ligatures, le tout recouvert d'une soudure spéciale.
Il se trouve donc une soudure tous les 200 mètres de fil courant
; il faut ajouter à ce nombre considérable de points de
jonction, les soudures placées aux croisements des conducteurs,
supérieurs et inférieurs.
Les conducteurs placés en tète des appuis, sont posés
ainsi : le premier fait face à la voie, le second est fixé
du côté opposé à 50 centimètres au-dessous
de l'autre. En ligne, c'est-à-dire hors des villes et en libre
parcours, ils sont alternés de kilomètre en kilomètre,
pour l'atténuation des effets d'induction.
Sur certains points où les dispositions du réseau ordinaire
le permettent, les croisements n'ont été faits que de deux
en deux kilomètres. Ce cas se présente pour quelques départements.
Par contre, à proximité des grandes nappes de fils des lignes
principales des départements du Rhône ou des Bouches du-Rhône,
l'alternat des fils de bronze se trouve beaucoup plus rapproché.
Pour la traversée de certains tunnels qu'il n'était pas
possible d'éviter, on a raccordé les sections aériennes
à l'aide de câbles du type Fortin-Hermann, composés
de fils de cuivre de haute conductibilité, enfilés séparément
dans des chapelets de petits cylindres en bois paraffiné, puis
tordus ensemble au nombre de six, permettant d'établir deux autres
circuits téléphoniques. La torsade entière est contenue
dans un tube de plomb très épais, dont les sections sont
réunies à l'aide de manchons spéciaux
sommaire
Les figures ci contre montrent le mode de raccord par manchons employés dans la construction des lignes en fil de bronze. |
- Les deux fils traversent le manchon et se recouvrent comme ci-dessus. Mais, en outre, un fil de bronze de 1 millimètre de diamètre passe entre les brins principaux et s'enroule ensuite d'un côté sur le fil de ligne, de l'autre sur la tringle de croisement. Le tout, d'une grande solidité, est noyé ensuite dans la soudure. |
L'oeuvre des ambulances urbaines a décidé,
au commencement de 1887, d'employer le téléphone
pour mettre l'hôpital Saint-Louis, où est établi le
premier poste de secours, en communication avec les postes avertisseurs
destinés à signaler les accidents et à demander des
secours. Ces postes, au nombre de vingt-neuf, pour le moment, sont placés
chez les pharmaciens et dans les bureaux de police et reliés par
des lignes souterraines spéciales : ils fonctionnent actuellement
et rendent les plus grands services.
Au Havre, les grands paquebots sont souvent obligés de rester plusieurs
heures en rade en attendant l'heure de la marée pour pouvoir entrer,
et lorsqu'ils arrivent pendant la nuit ou par un temps brumeux, il est
impossible de les signaler à la Compagnie Transatlantique, qui
ne peut, par conséquent, prendre les dépêches ou les
passagers.
Aussi cette Compagnie a fait relier téléphoniquement, en
1888, la rade du Havre avec la ville et,
par suite, avec Paris, puisqu'il existe déjà une communication
téléphonique entre les deux villes.
La Compagnie a mouillé en rade une bouée téléphonique
de forme cylindro-conique, qui est reliée par un câble avec
la terre.
Tous les grands bateaux de la Compagnie étant pourvus d'une installation
téléphonique, il suffit de relier le téléphone
à bord avec la bouée.
Le nombre des abonnés reliés aux différents réseaux
de la Société générale des Téléphones
était :
1880 de 537 en 1881 -- 1 893
1882 -- 3 519 en 1883 -- 4 804
1884 -- 5 636 en 1885 -- 5 694
1886 -- 6 748 en 1887 -- 7 588
1888 -- 8 549
répartis dans onze réseaux.
La Société générale des Téléphones
paye à l'État une redevance de 10 % sur les recettes brutes
de tous les réseaux qu'elle possède en France. Elle paye
également, à la ville de Paris, un droit de passage des
fils téléphoniques dans les égouts, qui est calculé
à tant par mètre de fil. Ce droit augmente dans la même
proportion que la longueur des câbles.
Les redevances payées à l'État et à la ville
de Paris se sont élevées pour
1879 à la somme de fr. . .2.424.70
1880 ............................16.082.30
1881.............................79.463.72
1882...........................277.502.94
1883...........................417.384.19
1884...........................523.637.06
1885...........................543.718.46
1886...........................659.324.99
1887...........................717.804.23
1888...........................813.415.92
Pendant la période de 1880 à 1888, l'État a reçu
pour prélèvements divers........ 3.729.422 fr. 47
En 1887, arrive la première liaison internationale entre Paris et Bruxelles. Il en coute une taxe de 3 Francs pour cinq minutes de conversation.
1888
En octobre 1888, le gouvernement, préoccupé d'assurer l'extension des communications téléphoniques, étudie une combinaison nouvelle.Cette combinaison est destinée à permettre l'établissement de réseaux téléphoniques dans les villes qui n'en sont pas encore dotées, sans obliger l'État à immobiliser un capital, et à lui assurer en outre, au bout d'un petit nombre d'années, sans qu'il ait eu à s'exposer à aucun risque ni à supporter aucune charge, la valeur importante que représente un réseau téléphonique.
Elle fit l'objet d'un projet de loi qui fut voté par les deux Chambres et promulgué le 22 décembre 1888.
Voici la convention passée entre l'État et la ville de Limoges, qui doit servir de base à l'établissement de tous les réseaux urbains
| Entre les
soussignés : M. le Directeur général des Postes et des Télégraphes, agissant au nom et pour le compte de l'État, sous la réserve de l'approbation de II. Le Ministre des Finances, d'une part, Et M. Fourneau (Léon), chevalier de la Légion d'honneur, adjoint, agissant aux lieu et place de M. Tarrade (Adrien), maire, absent, au nom et pour le compte de la ville de Limoges, en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du dix octobre mil huit cent quatre-vingt-huit, d'autre part, il a été convenu et stipulé ce qui suit : |
|
Article
premier.
|
| Un réseau
téléphonique sera établi par les soins de l'administration
des Postes et Télégraphes pour l'usage des habitants
de la ville de Limoges, dans un délai de quatre mois à
partir du jour où le présent traité sera devenu
définitif. La ville de Limoges avancera à l'État : 1° Toutes les dépenses de premier établissement; 2° Les frais d'entretien et d'exploitation du réseau. Celle double obligation prendra fin lorsque la Ville sera remboursée de ses avances, en exécution des articles 3 et 4 ci-après. |
|
Article
2.
|
| Les dépenses
d'établissement afférentes à la construction
et à l'installation du poste central téléphonique
et des appuis nécessaires pour recevoir quatre cents fils sont
fixées à forfait à la somme de dix-huit mille
quatre cent cinquante-sept francs (18.457 fr.). Celles afférentes à la construction des lignes sont fixées à cent cinquante francs (150 fr.) par kilomètre de fil. Les sommes avancées à titre de dépenses d'établissement seront versées avant l'exécution des travaux. Les frais d'entretien seront calculés à raison de vingt francs (20 fr.) par an et par kilomètre de fil. Les frais d'exploitation seront calculés à raison de deux mille francs (2.000 fr.) par an et par cinquante abonnés ou fraction de cinquante abonnés, et d'une somme complémentaire de mille francs (1.000 fr.) par an et par vingt-cinq abonnés on fraction de vingt-cinq abonnes en plus des cinquante premiers abonnés. |
| Les sommes
avancées à titre de frais d'entretien et d'exploitation
seront versées avant la mise en exploitation des lignes. Tous les versements seront faits à titre de fonds de concours à la caisse du trésorier général du département. |
|
Article
3.
|
| L'État sera propriétaire des lignes construites, mais il délègue, dès à présent, à la ville, le droit d'encaisser à son profit toutes les sommes qui seront dues par les abonnés, soit comme contribution aux frais d'établissement de leurs lignes, soit comme abonnement pour l'usage de ces lignes, jusqu'à concurrence des sommes avancées à l'État pour dépenses de premier établissement, d'entretien ou d'exploitation. |
|
Article
4
|
| L'État
se réserve la faculté de mettre à toute époque
fin à la dite délégation en remboursant à
la Ville les sommes dont elle sera restée à découvert
du chef des versements effectués à l'État. Si ce remboursement était rendu nécessaire par l'adoption d'un projet confiant à l'industrie privée l'exploitation des réseaux téléphoniques appartenant à l'État, il pourrait n'être effectué qu'en prenant pour bases les termes et conditions auxquels se ferait la concession de cette exploitation; mais, dans ce cas, les avances faites par la Ville produiraient intérêts au taux de quatre pour cent. |
|
Article
5
|
| La ville de Limoges s'engage par avance à adopter les mesures de comptabilité usuelles qui seraient jugées nécessaires pour assurer le contrôle des recettes dont le recouvrement lui est attribué par la présente convention. |
|
Article
6
|
| Toute disposition résultant d'actes législatifs ou réglementaires, ou de décisions administratives en vigueur ou à intervenir en ce qui concerne les réseaux téléphoniques de l'État, s'appliquera de plein droit an réseau téléphonique de Limoges. |
|
Article
7
|
| La présente convention sera soumise à l'approbation des Chambres. |
|
Article
8
|
| Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge de la ville de Limoges.Fait double à Limoges le 14 octobre mil huit cent quatre-vingt-huit. |
|
Signé
: L. POUMEAU, adjoint.
Signé : G. COULON. |
En 1887, en France,
l'exploitation interurbaine manuelle est complètement généralisée
entre toutes les villes qui sont équipées d'un réseau
téléphonique urbain déjà en service.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'expérience de l'industrie privée, sévèrement
encadrée par l’État, n'a pas été une
réussite en terme de développement du nombre de réseaux,
d'accroissement des réseaux, de souscription de nouveaux clients
et encore moins de leur satisfaction.
À cet échec, deux explications sont avancées. Suivant
ses propres opinions de pensée, l'on pourra choisir celle qui nous
satisfera le mieux, mais peut-être la vérité est-elle
située quelque part entre ces deux options :
1) la Société Générale des Téléphones
accuse l’État d'avoir dès le départ entravé
la libre entreprise administrativement par une sur-réglementation
et surtaxé de manière trop lourde et inconséquente
les recettes, sans considérer les dépenses d'investissement
et les frais d'exploitation à engager avant de pouvoir produire
des profits taxables.
2) l’État accuse la S.G.T de plus penser à rétribuer
grassement ses actionnaires, plutôt que d'investir dans l'ouverture
de nouveaux réseaux, dans leur développement et dans l'embauche
de personnel en nombre suffisant pour faire évoluer les réseaux
et le service.
Les centraux manuels ont atteint les bornes de leurs
possibilités.
Les gains de productivité se font essentiellement en augmentant
la productivité du personnel (rationalisation du travail des opératrices,
chronométrage) ce qui conduira d'ailleurs aux grandes grèves
de 1906-1909.
L'autre possibilité d'obtenir les gains de productivité
porte sur l'organisation du réseau. C'est pourquoi paraissent les
premiers articles théoriques sur l'organisation des réseaux
des grandes villes et du réseau parisien en particulier.
Il faut par exemple tenir compte dans la prévision du nouveau réseau
de la longueur des fils. Plus il y a de centraux, moindre est la longueur
de chaque ligne d'abonné et on obtient donc un coût d'établissement
moins élevé ainsi qu'une meilleure qualité de transmission
puisque, en l'absence de tout dispositif d'amplification dans le réseau
de Paris, l'affaiblissement est directement proportionnel à la
longueur du câble.
En revanche avec les centraux manuels que l'augmentation du nombre des
abonnés a amenés à la limite supérieure de
leurs capacités, la nécessité ,inhérente au
réseau de la S. G. T, de passer au moins par deux centraux pour
la majorité des communications devient un obstacle considérable
â la rapidité d'établissement des communications.
En outre, le passage par deux centraux fait perdre en affaiblissement
ce que l'on, gagnait en raccourcissant les lignes d'abonnés. Enfin
la multiplication des centraux multiplie les opératrices dont le
salaire est devenu le poste le plus lourd dans l'exploitation du réseau.
La S. G. T. palliait ces inconvénients en bricolant les lignes
auxiliaires ou en groupant les abonnés par affinité. Dans
un réseau â 10 000 abonnés, il n'en est plus question.
1888 : l’École Professionnelle des Postes et Télégraphes évolue.
Dix ans après sa création, l’École Supérieure de Télégraphie accomplit sa première transformation en devenant l’École Professionnelle des Postes et Télégraphes.
Elle comporte donc deux sections : à la section des élèves-ingénieurs s’était ajoutée une section d’élèves-administrateurs. Plus d’un demi-siècle avant la création de l’École nationale d’administration (ENA), on avait jugé que la gestion, elle aussi, réclamait une formation supérieure et des techniques propres.
Parmi les directeurs de l’École, on remarque Léon Thévenin, dont le nom reste associé au célèbre théorème qu’il énonça et qui constitue, encore de nos jours, un outil d’analyse des systèmes électriques linéaires.
Édouard Estaunié lui succèdera en 1901. Célèbre à plus d’un titre, il a largement marqué l’évolution de l’École. Ce polytechnicien, grand commis de l’État et romancier connu, inaugura des cycles de leçons données par des conférenciers extérieurs à l’administration ; Henri Poincaré et Pierre Curie en firent partie. Il introduisit également des cours de culture générale, emmenant même les élèves au Louvre le dimanche matin ; comme quoi la question des humanités ne date pas d’hier ! É. Estaunié donna ainsi à l’École cet élan de haute université qu’elle n’a cessé de présenter et de développer depuis lors. C’est lui qui, en 1904, forgea le terme de « télécommunication » en voulant faire la synthèse de tous les « appareils » et de toutes les disciplines enseignées sous sa responsabilité.
C'est en 1889 que
se déroule le processus de nationalisation du Téléphone
français et son assimilation au sein de l'Administration des P &
T .
En
1889, le 26 mars, la Chambre des Députés forme une
Commission pour examiner un projet de loi autorisant entre autre, le rachat,
via le financement de la Caisse des Dépôts, des réseaux
exploités par la Société Générale des Téléphones.
Le 10 avril 1889, une lettre ministérielle de M. le Président
du Conseil des Ministres - Pierre Tirard (également en charge de l'Administration
des P & T) avertit le Président de la Société Générale
des Téléphones de l'intention de l’État de mettre
fin à la jouissance de l'autorisation accordée à la SGT
à compter du 1er septembre 1880. Le Ministre demande en outre au Président
d'évaluer la valeur totale des biens de la société.
Le 23 avril 1889, le Président de la Société Générale
des Téléphones rejette en bloc les demandes formulées dans
la lettre ministérielle en s'y opposant clairement.
16 Juillet 1889 : Nationalisation du
Téléphone Français
Chaque ingénieur est accompagné par un Commissaire de Police et d'une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris. Il en sera de même pour toutes les villes de province ou des colonies concernées par cette nationalisation.
Le 16 juillet 1889 la loi votée qui en découle
est promulguée le jour même et publiée au JORF le 27 juillet
1889 (page 3685). Un décret d'application du 14 septembre 1889 qui débloque
les fonds nécessaires au rachat suit (BO P&T 1889 n°9 page 543).
L’État est autorisé à racheter, en 10 annuités,
les réseaux téléphoniques appartenant à la Société
Générale des Téléphones.
À compter de cette date, l’État engage la nationalisation
du Téléphone, et les crédits de fonctionnement et de développement
nécessaires seront ouverts pour 1889 et 1890 au budget ordinaire du ministère
nouvellement en charge du Téléphone : le Ministère du Commerce,
de l'industrie et des Colonies.
La concession faite à la Société générale
des Téléphones en 1879, pour une durée de 5 ans, en vertu
de laquelle elle exploitait les réseaux téléphoniques de
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Le Havre, Nantes, Saint-Etienne, Alger,
Oran et Saint-Pierre-les-Calais, a été renouvelée en 1884
pour une nouvelle période quinquennale ; elle atteignait le terme fixé
à sa durée le 8 septembre 1889.
Dès 1886, M Granet, ministre des Postes et des Télégraphes,
s'était préoccupé de trouver un régime définitif.
Le 18 janvier 1887, il déposa à la Chambre des députés
un projet de loi accordant le monopole de l'exploitation de tous les réseaux
téléphoniques pendant trente-cinq ans, à la Société
générale des Téléphones, qui devait se constituer
sous le nom de Société fermière, à charge par celle-ci
de payer une redevance à l'État, qui serait devenu seul propriétaire
à l'expiration de la concession.
La Chambre repoussa sans débat le projet de convention, le 19 mars 1889.
La situation étant devenue entière, le gouvernement dut se préoccuper
de présenter un nouveau projet ayant pour base l'exploitation des réseaux
téléphoniques par l'État. D'après l'enquête
effectuée par le Secrétariat des Postes (*), l'installation de
réseaux téléphoniques est en cours dans 18 départements
situés pour la plupart dans le Nord, la Région Parisienne et la
Basse-Normandie.
Partout ailleurs, les réseaux départementaux restent à
l'état de projet ou sont carrément repoussés comme dans
la Manche, lé Finistère, les Côtes-du-Nord, la Vendée
et les Basses-Alpes.
(*) « Le grand réseau téléphonique », Le Journal
de Montmédy, 21/9/1899. L'article entrevoit pour le téléphone
en France un avenir radieux...
Le 13 août 1889, le Président du Conseil de Préfecture de Police de la Seine publie une Ordonnance mandatant M. Jousselin, expert, pour procéder à l'inventaire complet des valeurs immobilières et mobilières (matériels) de la SGT.
Le 21 août 1889, une nouvelle lettre ministérielle confirme au Président de la Société Générale des Téléphones confirme l'intention du Ministre chargé des P & T de mettre fin à l'autorisation d'exploitation ; de désigner d'un commun accord l'expert mandaté par le Conseil de Préfecture de Police de la Seine pour établir la valeur de l'entreprise ; de se préparer à remettre à disposition de l'Administration des P & T l'intégralité des locaux et des équipements de la Société Générale des Téléphones.
Le 23 août 1889, le Président de la Société Générale des Téléphones rejette en bloc pour la seconde fois les demandes formulées dans la lettre ministérielle.
Le 24 août 1889, dans une ultime lettre ministérielle adressée au Président de la Société Générale des Téléphones, M. le Président du Conseil des Ministres - Pierre Tirard le met en demeure de remettre à disposition de l'Administration des P & T l'intégralité des locaux et des équipements de la Société Générale des Téléphones à la date du 1er septembre 1889, et ce, au nom de la continuité du service des téléphones qui ne sauraient être interrompus.
Le 30 août 1889, un arrêté de M. le Président du Conseil des Ministres autorise l'utilisation de la force publique pour prendre possession de tous les locaux de la Société Générale des Téléphones à la date du 1er septembre 1889.
Nous donnons ci-après le texte d'un décret du 20 octobre 1889 (l'État ayant pris possession de tous les réseaux téléphoniques le 1er septembre) paru au Journal officiel du 23 du même mois ayant pour objet d'autoriser et de réglementer la transmission téléphonique des télégrammes
|
|
Article premier.
Les abonnés aux réseaux téléphoniques
urbains peuvent expédier et recevoir des télégrammes
par la ligne qui les rattache à ces réseaux. |
La transmission de ces télégrammes est effectuée gratuitement, sauf l'exception visée ci-après ; mais elle est subordonnée au dépôt préalable d'une provision destinée à garantir le remboursement de la taxe télégraphique. Dans les villes comportant un réseau souterrain, l'abonné qui se propose d'user de la disposition qui précède est tenu de verser annuellement, et d'avance, une redevance de 50 francs.
|
Article 2.
Les localités autres que les chefs-lieux
de canton peuvent être reliées à un bureau
télégraphique au moyen d'un fil téléphonique. |
Ce fil et le bureau téléphonique qui le dessert sont établis avec la participation des communes intéressées. La part contributive de ces communes aux frais de premier établissement est fixée à 100 fr. par kilomètre de ligne neuve à construire, ou à 50 fr. par kilomètre de fil à établir sur appuis déjà existants et à 300 fr. pour fournitures d'appareils et installation du poste téléphonique. |
|
Article 3.
|
|
Dans les localités
possédant une recette des postes, le service téléphonique
est confié au receveur.
Dans toutes les autres, le gérant des bureaux téléphoniques et son suppléant sont désignés par le maire après avoir été agréés par le directeur départemental. Ils devront être remplacés sur la demande de l'administration. Ils bénéficient sur la transmission des télégrammes des mêmes remises que les gérants des bureaux télégraphiques municipaux. Ils prêtent le même serment professionnel. |
|
Article 4.
|
| Toute personne peut expédier et recevoir
des télégrammes par une ligne téléphonique
municipale. La transmission de ces télégrammes est effectuée gratuitement, mais elle est subordonnée au payement de la taxe télégraphique. Le payement de cette taxe est effectué entre les mains du gérant du bureau téléphonique. Si ce gérant n'est pas en même temps receveur des postes, ses recettes et ses dépenses sont comprises dans la comptabilité du bureau télégraphique avec lequel il communique. |
|
Article 5.
|
| Tout télégramme destiné à être distribué par un bureau téléphonique municipal est soumis à des frais d'exprès à moins que la municipalité n'ait pris ses dispositions pour que cette distribution puisse s'effectuer gratuitement. |
|
Article 6.
|
| Un télégramme ne peut être téléphoné, soit par une ligne urbaine, soit par une ligne municipale, que s'il est écrit en français, en langue claire et si son texte n'excède pas cinquante mots. |
|
Article 7.
|
| .Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. |




 modèle
Bell tabatière
modèle
Bell tabatière 
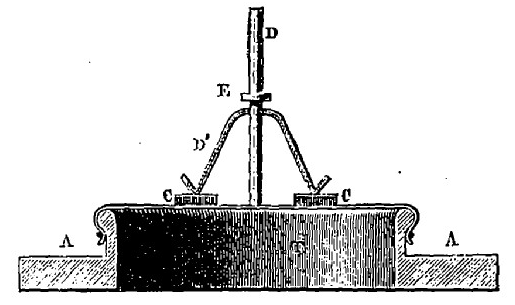

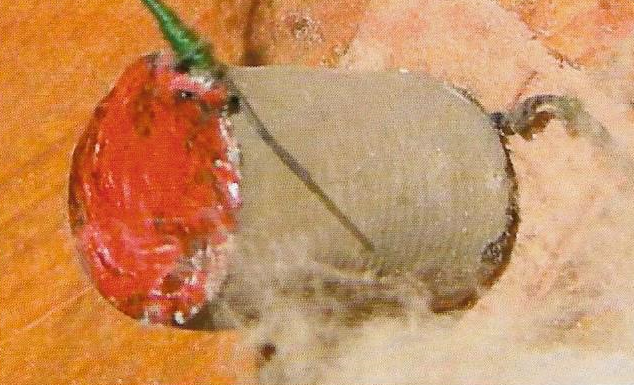










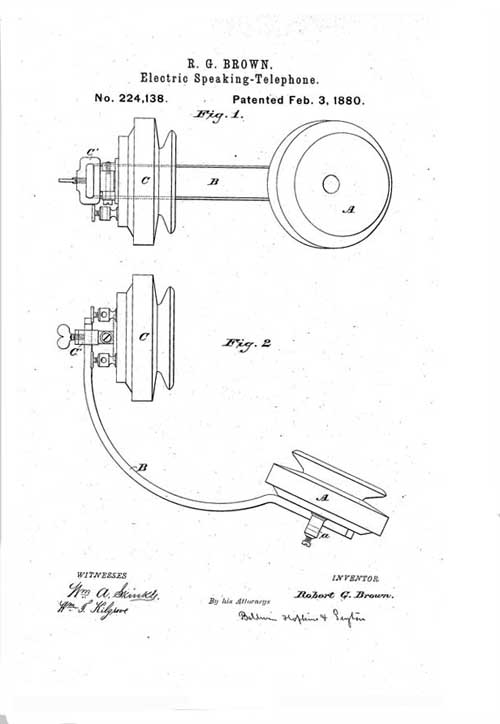
 Pour
opératrice.
Pour
opératrice.  Autre
Modèle Plus tardif, qui équipera des téléphones
mobiles Ader et Berthon.
Autre
Modèle Plus tardif, qui équipera des téléphones
mobiles Ader et Berthon.  Modèle
Radiguet
Modèle
Radiguet 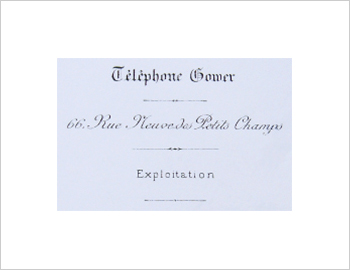


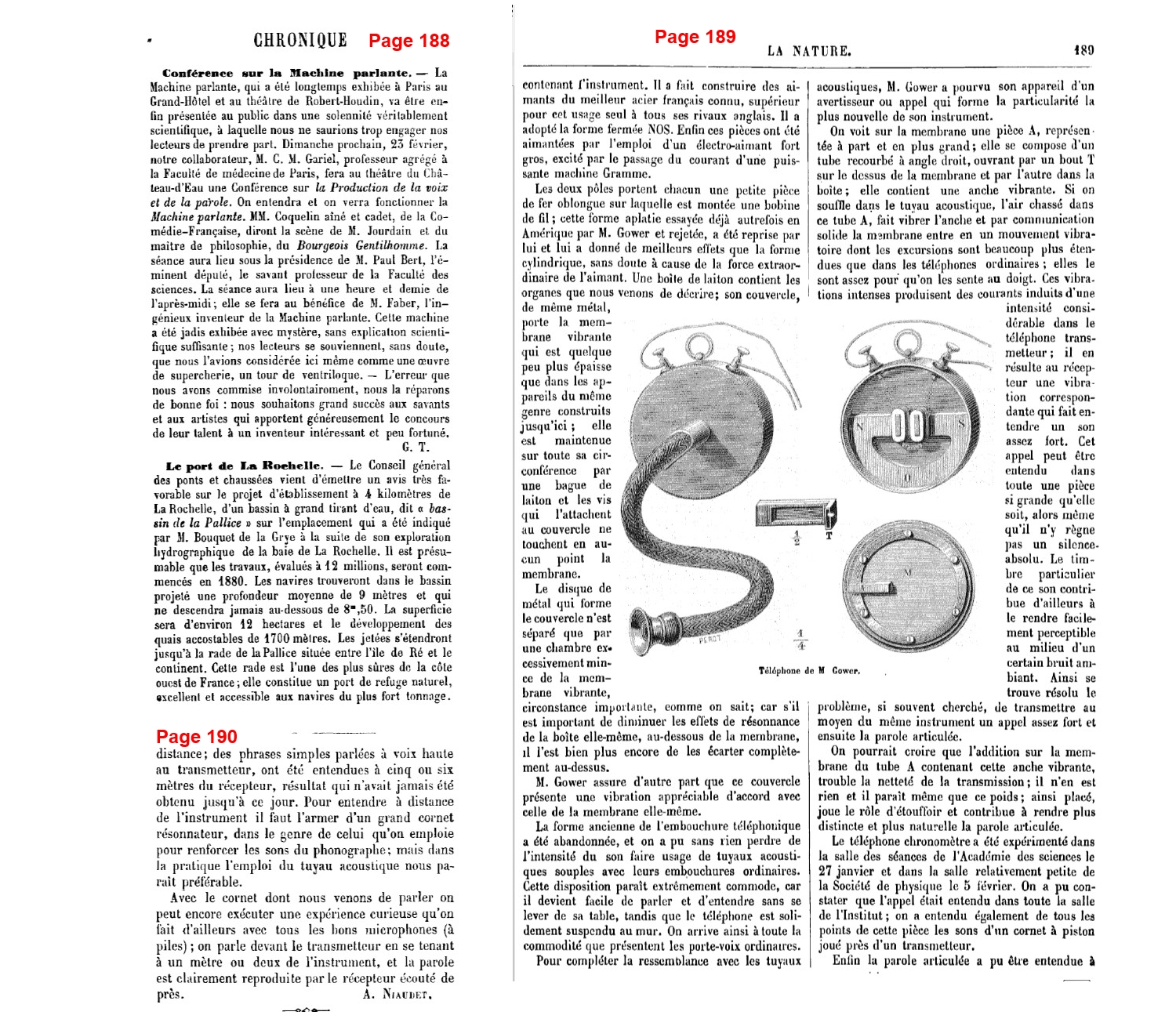


 Modèle
Anglais Gower-Bell
Modèle
Anglais Gower-Bell 










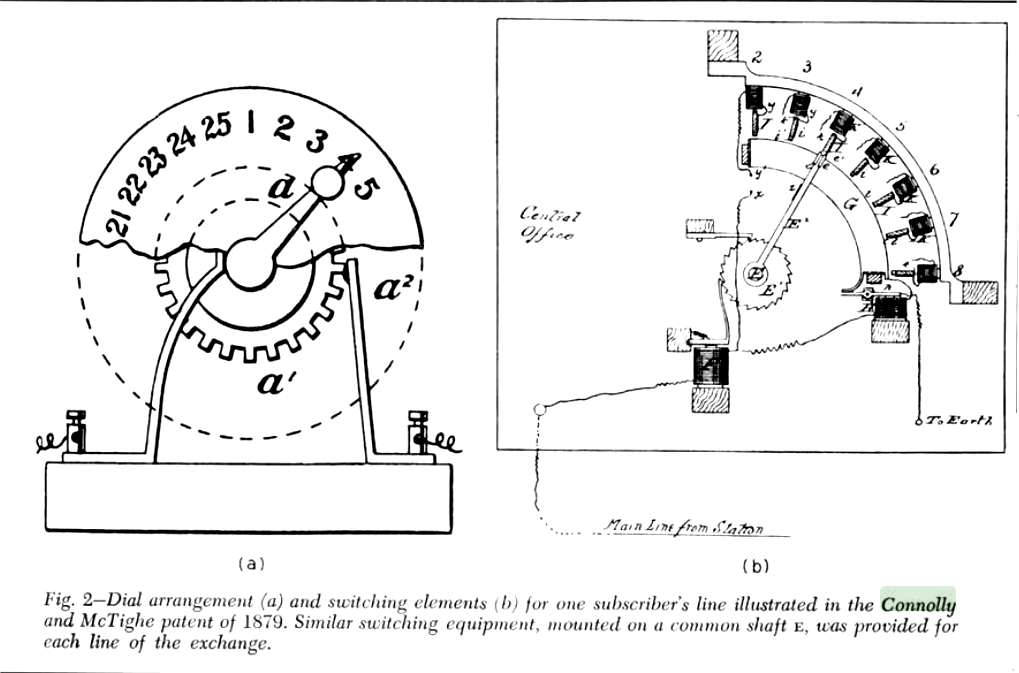


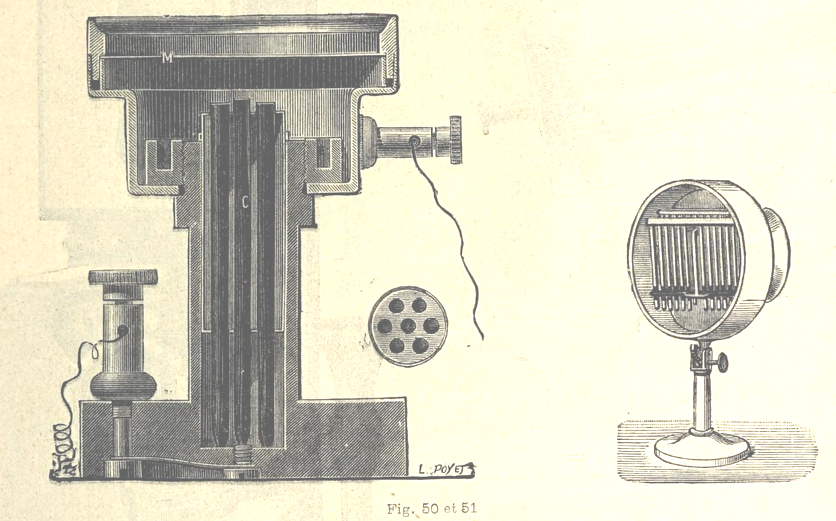




















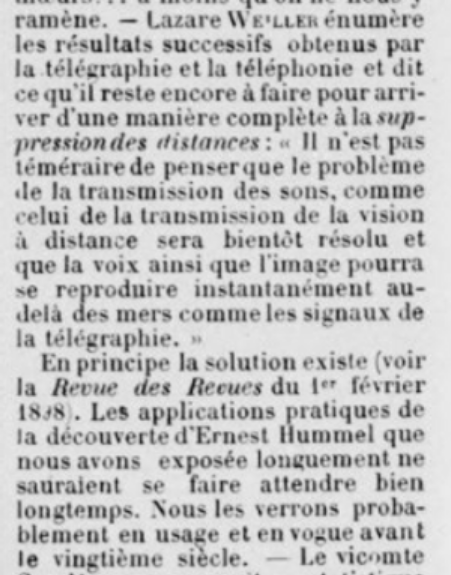









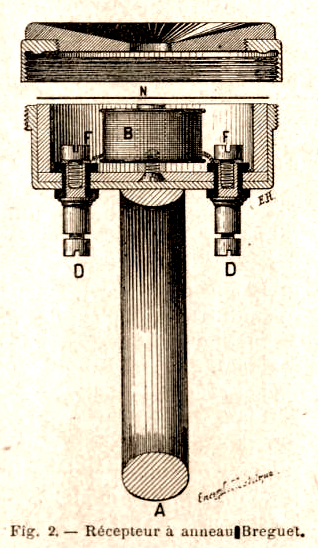


 Sit mural
Sit mural  Sit
sur pieds
Sit
sur pieds  Berthon-Ader
Berthon-Ader


 Cliquez sur un étage pour voir en détail
Cliquez sur un étage pour voir en détail 
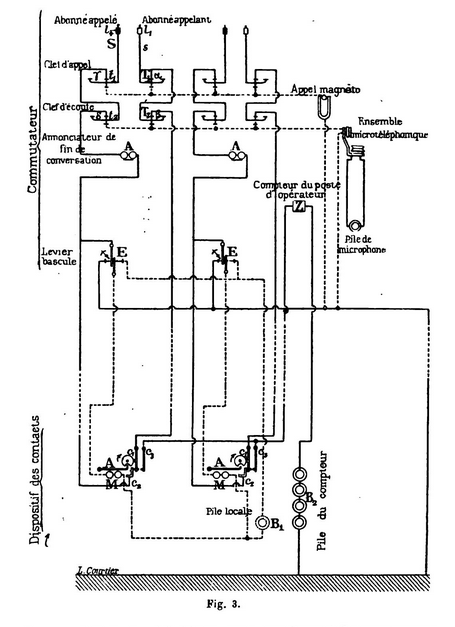
 La construction
de la clé à levier se trouve représentée
à la fig. 4.
La construction
de la clé à levier se trouve représentée
à la fig. 4.