Deuxième histoire, les télécommunications à Asheville en Caroline du Nord (Article de Carissa Pfeiffer , bibliothécaire, Collections spéciales du comté de Buncombe)
1875 - 1910 HISTOIRE DU TÉLÉPHONE
ILLUSTRÉ PAR HERBERT N. CASSON Publié le 27 août
1910, ÉDITION DE LA VAIL COMPANY, COSHOCTON, ÉTATS-UNIS
PRÉFACE
Trente-cinq ans plus tard, et hop !
L'art naissant de la téléphonie a atteint son apogée.
Trois millions de téléphones sont désormais disséminés
à l'étranger, et sept millions sont concentrés
ici, dans son pays natal.
Le téléphone a tellement dépassé le ridicule
qui, comme beaucoup s'en souviennent, l'avait initialement accueilli,
qu'il est aujourd'hui considéré comme allant de soi dans
la plupart des endroits, comme s'il faisait partie intégrante
des phénomènes naturels de notre planète. Il a
si merveilleusement développé les possibilités
de la conversation – cet « art où l'homme rivalise
avec l'humanité entière » – qu'il est aujourd'hui
une aide indispensable à quiconque aspire à une vie confortable.
L'inconvénient d'être sourd et muet à l'égard
de tous les absents, qui était universel avant l'avènement
du téléphone, a heureusement été surmonté
; et j'espère que cette histoire, qui raconte comment et par
qui il a été créé, sera un précieux
ajout aux bibliothèques américaines.
C'est une histoire que le téléphone lui-même pourrait
raconter, s'il pouvait parler d'une voix qui lui soit propre. Elle n'est
ni technique, ni statistique, ni exhaustive. Elle est si brève,
en fait, qu'un deuxième volume pourrait facilement être
consacré à la description des carrières des leaders
du téléphone dont les noms ont été omis
involontairement dans ce document– des hommes indispensables, par
exemple, comme William R. Driver, qui a signé plus de chèques
pour le téléphone, et des plus importants, que quiconque
; Geo. S. Hibbard, Henry W. Pope et WD Sargent, trois vétérans
qui connaissent la téléphonie sous toutes ses formes ;
George Y. Wallace, le dernier survivant des pionniers des Rocheuses
; Jasper N. Keller, du Texas et de la Nouvelle-Angleterre ; WT Gentry,
figure centrale du Sud-Est, et les présidents de compagnies de
téléphone suivants : Bernard E. Sunny, de Chicago ; EB
Field, de Denver ; D. Leet Wilson, de Pittsburg ; LG Richardson, d'Indianapolis
; Caspar E. Yost, d'Omaha ; James E. Caldwell, de Nashville ; Thomas
Sherwin, de Boston ; Henry T. Scott, de San Francisco ; HJ Pettengill,
de Dallas ; Alonzo Burt, de Milwaukee ; John Kilgour, de Cincinnati
; et Chas. S. Gleed, de Kansas City.
Je suis profondément redevable à la plupart de ces hommes
pour les informations présentées ici ; ainsi qu'à
des pionniers, aujourd'hui décédés, comme OE Madden,
le premier agent général ; Frank L. Pope, le célèbre
expert en électricité ; CH Haskins, de Milwaukee ; George
F. Ladd, de San Francisco ; et Geo. F. Durant, de Saint-Louis.
HNC
PINE HILL, NY, 1er juin 1910.
sommaire
I LA NAISSANCE DU TÉLÉPHONE
II LA CONSTRUCTION DE L'ENTREPRISE
VI UTILISATEURS NOTABLES DU TÉLÉPHONE
VII LE TÉLÉPHONE ET L'EFFICACITÉ NATIONALE
VIII LE TÉLÉPHONE À L'ÉTRANGER
En cette année 1875, quelque peu lointaine,
où le télégraphe et le câble transatlantique
étaient les choses les plus merveilleuses du monde, un jeune
et grand professeur d'élocution s'activait désespérément
dans un atelier de mécanique bruyant situé dans une rue
étroite de Boston, non loin de Scollay Square. C'était
un après-midi de juin très chaud, mais le jeune professeur
avait oublié la chaleur et la crasse de l'atelier. Il était
entièrement absorbé par la fabrication d'une machine quelconque,
une sorte d'harmonica rudimentaire avec une anche à ressort,
un aimant et un fil. C'était un jouet des plus absurdes. Il ne
ressemblait à rien d'autre qui ait jamais été fabriqué,
quel que soit le pays. Le jeune professeur y travaillait depuis trois
ans et cela l'avait constamment déconcerté, jusqu'à
ce que, par cet après-midi torride de juin 1875, il entende un
son presque inaudible – un faible TWANG – provenant de la
machine elle-même.
L'espace d'un instant, il resta stupéfait. Il s'attendait à
un tel bruit depuis plusieurs mois, mais il survint si soudainement
qu'il en fut surpris. Ses yeux brillèrent de joie et, fou d'impatience,
il se précipita vers une pièce voisine où se tenait
un jeune mécanicien qui l'assistait.
« Fais claquer l'anche, Watson ! » s'écria
le jeune professeur, apparemment irrationnel. Il y avait une de ces
étranges machines dans chaque pièce, apparemment, et les
deux étaient reliées par un fil électrique. Watson
avait fait claquer l'anche de l'une des machines et le professeur avait
entendu le même son provenant de l'autre. Ce n'était rien
de plus que le léger claquement d'un ressort d'horloge ; mais
c'était la première fois dans l'histoire du monde qu'un
son complet était transporté le long d'un fil, reproduit
parfaitement à l'autre extrémité et entendu par
un expert en acoustique.
Ce tintement du ressort d'horloge fut le premier petit cri du nouveau-né,
émis dans le vacarme assourdissant d'un atelier d'usinage et
entendu avec bonheur par un homme dont l'oreille avait été
habituée à reconnaître l'étrange voix du
petit nouveau-né. Là, au milieu des courroies volantes
et des roues qui s'entrechoquaient, le bébé téléphone
naquit, aussi faible et impuissant que n'importe quel autre bébé,
et « sans autre langage qu'un cri ».
Le professeur-inventeur, qui avait ainsi sauvé
le petit enfant de la science, était un jeune Écossais-Américain.
Son nom, désormais aussi connu
que le téléphone lui-même, était Alexander
Graham Bell. Il était professeur d'acoustique et étudiant
en électricité, probablement le seul homme de sa génération
à pouvoir concentrer ses connaissances des deux disciplines sur
le problème du téléphone. Pour d'autres, ce son
extrêmement faible aurait été aussi inaudible que
le silence lui-même ; mais pour Bell, ce fut un coup de tonnerre.
C'était un rêve devenu réalité. C'était
une chose impossible, devenue si facile en un éclair qu'il avait
du mal à y croire. Ici, sans pile, avec un courant électrique
équivalent à celui produit par deux aimants, toutes les
ondes d'un son avaient été transportées le long
d'un fil et retransformées en son à son extrémité.
C'était absurde. C'était incroyable. C'était quelque
chose que ni le fil ni l'électricité n'avaient jamais
fait auparavant. Mais c'était vrai.
Aucune découverte n'a jamais été aussi accidentelle. C'était le dernier maillon d'une longue série de découvertes. C'était le fruit d'une recherche persévérante et délibérée. Depuis six mois ou plus, Bell connaissait déjà la théorie exacte du téléphone ; mais il n'avait pas réalisé que le faible courant ondulatoire généré par un aimant était suffisamment puissant pour transmettre la parole. On lui avait appris à sous-estimer l'incroyable efficacité de l'électricité.
Bell lui-même était non seulement un professeur des lois de la parole, si compétent qu'il était professeur à l'Université de Boston. Son père, ses deux frères, son oncle et son grand-père avaient également enseigné les lois de la parole dans les universités d'Édimbourg, de Dublin et de Londres. Pendant trois générations, les Bell avaient été professeurs de la science de la parole. Ils avaient même contribué à créer cette science par plusieurs inventions. Le premier d'entre eux, Alexander Bell, avait inventé un système de correction du bégaiement et d'autres défauts de la parole. Le second, Alexander Melville Bell, était le doyen des élocutionnistes britanniques, un homme à l'esprit créatif et d'une aisance rhétorique des plus impressionnantes. Il était l'auteur d'une douzaine de manuels sur l'art de parler correctement, ainsi que d'une langue des signes des plus ingénieuses qu'il appelait « parole visible ». Chaque lettre de l'alphabet de cette langue représentait une certaine action des lèvres et de la langue ; une nouvelle méthode était donc offerte à ceux qui souhaitaient apprendre des langues étrangères ou parler leur propre langue plus correctement. Et le troisième de ces Bells, l'inventeur du téléphone, hérita du génie particulier de ses pères, à la fois inventif et rhétorique, à tel point qu'enfant, il avait construit un crâne artificiel, à partir de gutta-percha et de caoutchouc indien, qui, lorsqu'il était animé par un soufflet d'air provenant d'un soufflet à main, prononçait effectivement plusieurs mots d'une manière presque humaine.
Le troisième Bell, le seul de cette remarquable famille qui nous concerne à cette époque, était un jeune homme, âgé d'à peine vingt-huit ans, lorsque son oreille entendit le premier appel du téléphone. Mais il était déjà un homme remarquable. Il avait fait ses études à Édimbourg, sa ville natale, et à Londres ; il avait acquis, d'une manière ou d'une autre, des notions d'anatomie, de musique, d'électricité et de télégraphie. Jusqu'à l'âge de seize ans, il n'avait lu que des romans, de la poésie et des récits romantiques mettant en scène des héros écossais. Puis il quitta la maison pour devenir professeur d'élocution dans diverses écoles britanniques et, à sa majorité, il avait fait plusieurs découvertes mineures sur la nature des voyelles. Peu après, il rencontra à Londres deux hommes distingués, Alexander J. Ellis et Sir Charles Wheatstone, qui firent bien plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé pour orienter Bell vers le téléphone.
Ellis était président de la Société philologique de Londres. Il fut également le traducteur du célèbre ouvrage « Les Sensations du son », écrit par Helmholtz, qui, de 1871 à 1894, fit de Berlin le centre mondial de l'étude des sciences physiques. Ainsi, lorsque Bell, jeune passionné, courut trouver Ellis pour lui raconter ses expériences, Ellis l'informa qu'Helmholtz avait déjà fait les mêmes choses plusieurs années auparavant, et de manière plus complète. Il fit venir Bell chez lui et lui montra ce qu'Helmholtz avait fait : comment il avait maintenu des diapasons en vibration grâce à la puissance d'électro-aimants et comment il avait fusionné les sons de plusieurs diapasons pour reproduire la complexité de la voix humaine.
Or, Helmholtz n'avait pas cherché à inventer un téléphone, ni aucun autre moyen de transmission de messages. Son but était de mettre en évidence les bases physiques de la musique, et rien de plus. Mais le fait qu'un électro-aimant puisse faire vrombir un diapason était nouveau pour Bell et très attrayant. Cela le séduisit immédiatement en tant qu'étudiant en art oratoire. Si un diapason pouvait être fait chanter par un aimant ou un fil électrifié, pourquoi ne serait-il pas possible de fabriquer un télégraphe musical – un télégraphe avec un clavier de piano, permettant d'envoyer simultanément de nombreux messages sur un seul fil ? À l'insu de Bell, plusieurs dizaines d'inventeurs travaillaient alors sur ce problème, qui s'avéra finalement très difficile à résoudre. Mais cela lui donna au moins un point de départ, et il se lança aussitôt dans sa quête du téléphone.
Comme il se trouvait alors en Angleterre, sa première visite fut naturellement de rendre visite à Sir Charles Wheatstone, le plus célèbre expert anglais en télégraphie. Sir Charles avait acquis son titre grâce à de nombreuses inventions. Scientifique simple d'esprit, il traita Bell avec la plus grande gentillesse. Il lui montra une ingénieuse machine parlante, fabriquée par le baron de Kempelin. À cette époque, Bell avait vingt-deux ans et était inconnu ; Wheatstone, soixante-sept ans, était célèbre. La personnalité de ce scientifique chevronné imprégna si vivement l'esprit du jeune Bell, impressionnable, que la grande passion pour la science devint désormais le motif principal de sa vie.
De ce sommet d'ambition glorieuse, il fut précipité, quelques mois plus tard, dans les profondeurs du chagrin et du découragement. La Peste Blanche s'était abattue sur le foyer d'Édimbourg et avait emporté ses deux frères. Plus encore, elle avait marqué le jeune inventeur lui-même. Seul un changement de climat, disait son médecin, pouvait le mettre hors de danger. Alors, pour sauver sa vie, lui, son père et sa mère quittèrent Glasgow et arrivèrent dans la petite ville canadienne de Brantford, où, pendant un an, il lutta contre sa tendance à la tuberculose et assouvit son anxiété en enseignant la « Parole Visible » à une tribu d'Indiens Mohawks.
À cette époque, il était devenu
évident, tant pour ses parents que pour ses amis, que le jeune
Graham était destiné à devenir un génie
créatif. Grand et souple, il avait le teint pâle, un grand
nez, des lèvres charnues, des yeux noirs de jais et des cheveux
noirs de jais, coiffés haut et généralement ébouriffés
en un chignon bouclé. Par son tempérament, c'était
un véritable bohémien scientifique, avec les idéaux
d'un savant et le tempérament d'un artiste. C'était un
homme passionné, plus dévoué aux idées qu'aux
gens ; et moins susceptible de maîtriser ses propres pensées
que d'être dominé par elles. Il manquait de perspicacité,
au sens commercial du terme, et connaissait très peu les petits
détails pratiques de la vie quotidienne. Il était toujours
intense, toujours absorbé. Lorsqu'il s'attaquait à un
problème, celui-ci devenait aussitôt une arène passionnante,
où s'ébattait une course de chars d'idées et de
fantaisies inventives.
Dès son enfance, il était fasciné par le système
de « parole visible » de son père. Il le connaissait
si bien qu'il avait un jour étonné un professeur de langues
orientales en répétant correctement une phrase sanscrite
écrite en caractères de « parole visible ».
Lorsqu'il vivait à Londres, son enthousiasme le plus captivant
était l'instruction d'une classe de sourds-muets, qu'il croyait
pouvoir apprendre à parler grâce à l'alphabet de
la « parole visible ». Il fut si profondément impressionné
par les progrès de ces élèves et par le pathétique
de leur mutisme qu'à son arrivée au Canada, il se demandait
laquelle de ces deux tâches était la plus importante :
l'enseignement des sourds-muets ou l'invention d'un télégraphe
musical.
À ce stade, et avant que Bell n'ait commencé
à expérimenter son télégraphe, l'histoire
se déplace du Canada au Massachusetts.
Il semble que son père, alors qu'il donnait une conférence
à Boston, ait évoqué les exploits de Graham auprès
d'une classe de sourds-muets ; peu après, le Conseil scolaire
de Boston écrivit à Graham pour lui offrir cinq cents
dollars s'il venait à Boston et introduisait son système
d'enseignement dans une école pour sourds-muets récemment
ouverte. Le jeune homme accepta avec joie et, le 1er avril 1871, franchit
la ligne et devint Américain pour le restant de ses jours.
Pendant les deux années qui suivirent, son travail télégraphique fut mis de côté, voire oublié. Son succès comme professeur auprès des sourds-muets fut soudain et retentissant. Ce fut la sensation pédagogique de 1871. Il obtint une chaire à l'Université de Boston et rassembla autour de lui tant d'élèves qu'il osa ouvrir une ambitieuse « École de physiologie vocale », qui devint aussitôt une entreprise rentable. Pendant un temps, il sembla avoir peu d'espoir d'échapper au fardeau de ce succès et de devenir un inventeur, lorsque, par une heureuse coïncidence, deux de ses élèves lui apportèrent précisément le type de stimulation et d'aide pratique dont il avait besoin et qu'il n'avait pas reçu jusque-là.
L'un de ces élèves était un petit
garçon sourd-muet de cinq ans, nommé Georgie Sanders.
Bell avait accepté de lui donner des cours particuliers pour
350 dollars par an ; et comme l'enfant vivait chez sa grand-mère
à Salem, à seize miles de Boston, il fut convenu que Bell
s'installerait chez la famille Sanders. Là, non seulement il
trouva un vif intérêt et une sympathie pour ses inventions,
mais il fut également autorisé à utiliser la cave
de la maison comme atelier.
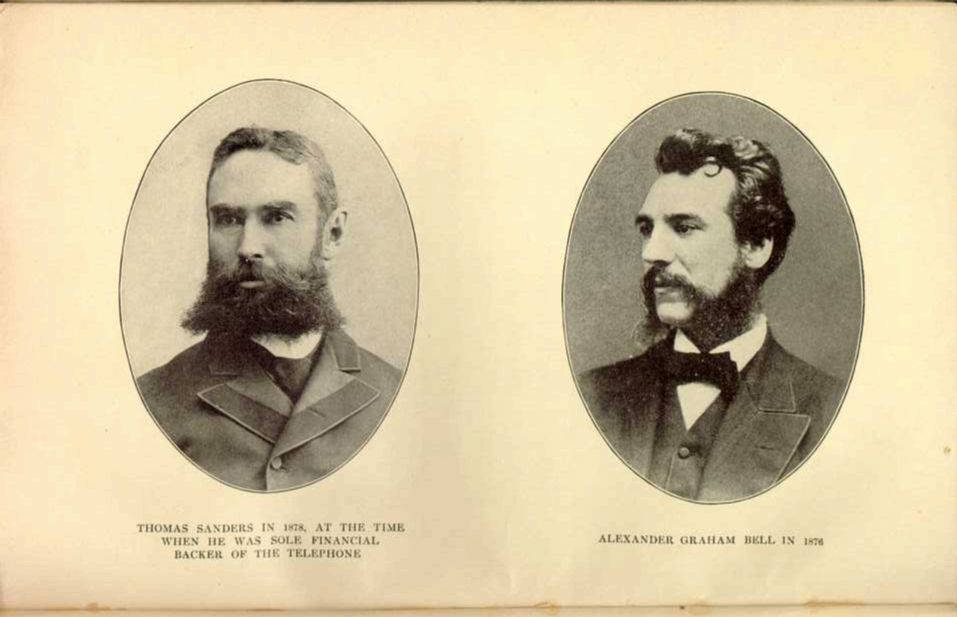 T.Sanders et A.G. Bell
T.Sanders et A.G. Bell
Pendant les trois années qui suivirent, cette
cave fut son refuge favori. Il la joncha de diapasons, d'aimants, de
piles, de bobines de fil, de trompettes en fer-blanc et de boîtes
à cigares. Personne en dehors de la famille Sanders n'était
autorisé à y entrer, car Bell craignait de se faire voler
ses idées. Il allait même jusqu'à faire ses courses
dans cinq ou six magasins, de peur que ses intentions ne soient découvertes.
Avec la discrétion d'un conspirateur, il travaillait seul dans
cette cave, généralement la nuit, ignorant complètement
que le sommeil était une nécessité pour lui et
pour la famille Sanders.
« Souvent, au milieu de la nuit, Bell me réveillait »,
raconte Thomas Sanders, le père de Georgie. « Ses
yeux noirs brillaient d'excitation. Me quittant pour descendre à
la cave, il se précipitait à la grange et commençait
à m'envoyer des signaux par ses fils expérimentaux. Si
je remarquais une amélioration dans sa machine, il était
ravi. Il sautait et tournoyait dans une de ses « danses guerrières
», puis allait se coucher, satisfait. Mais si l'expérience
échouait, il retournait à son établi et essayait
une autre méthode. »
La deuxième élève qui joua un rôle
déterminant dans la carrière de Bell fut une jeune fille
de quinze ans, Mabel Hubbard.
Elle avait perdu l'ouïe, et par conséquent la parole, à
la suite d'une scarlatine alors qu'elle était bébé.
C'était une jeune fille douce et attachante, et Bell, avec son
ardeur et son entêtement, s'éprit complètement d'elle
; quatre ans plus tard, il eut le bonheur de la prendre pour épouse.
Mabel Hubbard encouragea Bell avec ferveur. Elle suivit chaque étape
de ses progrès avec le plus vif intérêt. Elle écrivit
ses lettres et copiait ses brevets. Elle l'encouragea lorsqu'il se sentait
vaincu. Et grâce à sa sympathie pour Bell et ses ambitions,
elle amena son père – un avocat bostonien réputé
du nom de Gardiner G. Hubbard – à devenir son principal
porte-parole et défenseur, un véritable apôtre du
téléphone.
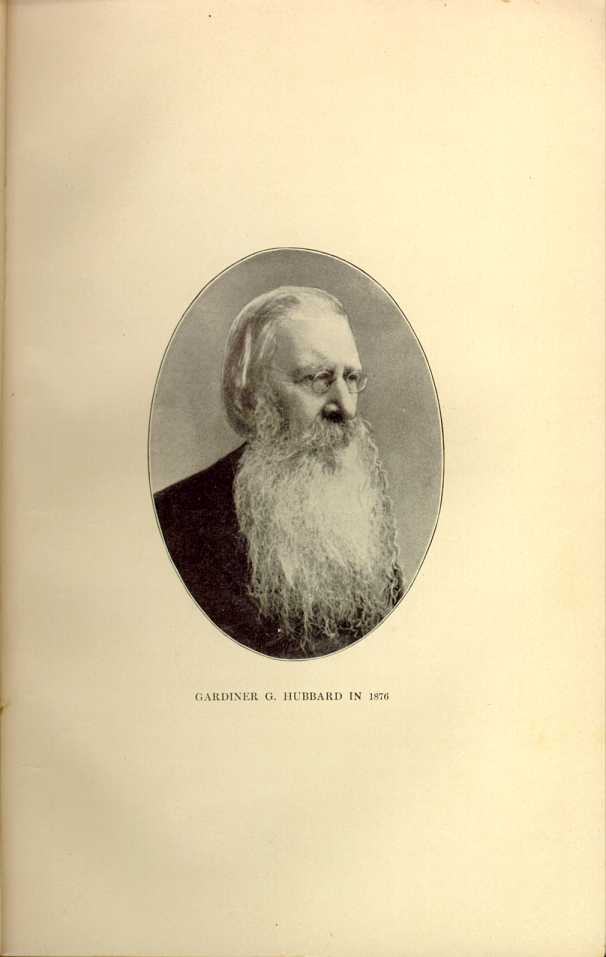 Hubbard
Hubbard 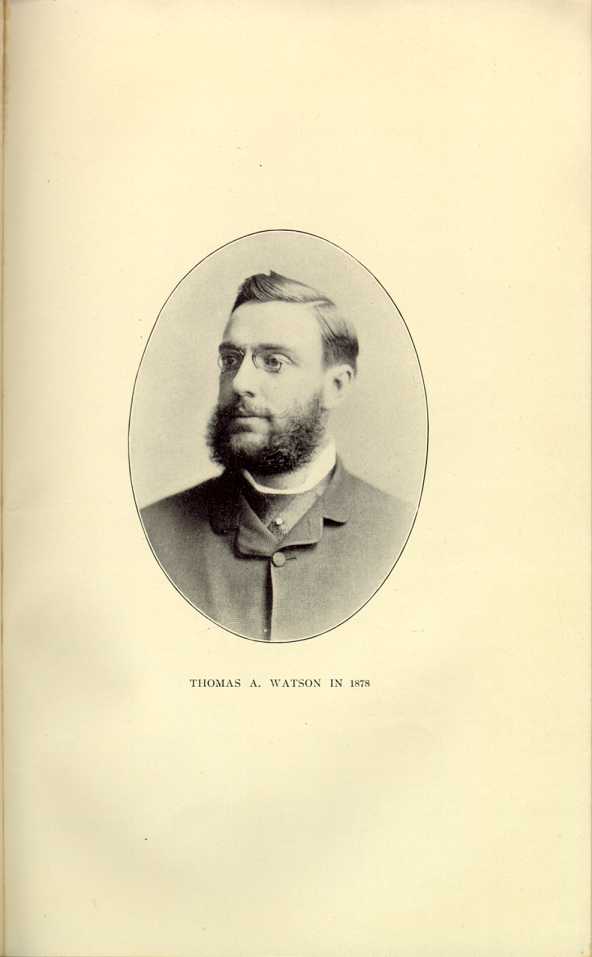 Watson
Watson
Hubbard découvrit pour la première fois les efforts inventifs de Bell un soir où celui-ci lui rendait visite chez lui à Cambridge. Bell illustrait certains mystères de l'acoustique à l'aide d'un piano. « Savez-vous », dit-il à Hubbard, « que si je chante la note « sol » près des cordes du piano, la corde « sol » me répondra ? » « Et alors ? » demanda Hubbard. « C'est un fait d'une importance capitale », répondit Bell. « C'est la preuve que nous aurons peut-être un jour un télégraphe musical, qui enverra simultanément sur un fil autant de messages qu'il y a de notes sur ce piano. »
Plus tard, Bell osa confier à Hubbard son rêve fou de transmettre la parole par un fil électrique, mais Hubbard le railla. « Vous dites n'importe quoi », dit-il. « Ce genre de chose ne pourrait être qu'un jouet scientifique. Vous feriez mieux d'abandonner cette idée et de vous lancer dans votre télégraphe musical, qui, s'il réussit, vous rendra millionnaire. »
Mais plus Bell travaillait sur son télégraphe
musical, plus il rêvait de remplacer le télégraphe
et son langage des signes encombrant par une nouvelle
machine qui transmettrait, non pas des points et des traits, mais la
voix humaine. « Si je peux faire parler un sourd-muet »,
disait-il, « je peux faire parler le fer. » Pendant des
mois, il hésita entre les deux idées. Il n'avait qu'une
conception très vague de ce que serait cette machine porteuse
de voix. Au début, il imagina une harpe à une extrémité
du fil et un porte-voix à l'autre, afin que les cordes de la
harpe reproduisent les tons de la voix.
Puis, au début de l'été 1874, alors qu'il réfléchissait à cette harpe, la vague silhouette d'un nouveau chemin apparut soudain devant lui. Il n'avait pas oublié la « Parole Visible » pendant tout ce temps, mais avait expérimenté deux machines remarquables : le phonautographe et la capsule manométrique, grâce auxquelles les vibrations du son étaient clairement visibles. Si ces appareils pouvaient être améliorés, pensa-t-il, on pourrait apprendre aux sourds à parler par la VUE, en apprenant un alphabet de vibrations. Il parla de ces expériences à un ami de Boston, le Dr Clarence J. Blake, et celui-ci, chirurgien et auriste, lui dit naturellement : « Pourquoi n'utilisez-vous pas une VRAIE OREILLE ? »
Une telle idée n'était jamais venue à Bell, et n'aurait probablement jamais pu l'être ; mais il l'accepta avec empressement. Le Dr Blake prépara une oreille sur la tête d'un mort, ainsi que le tympan et les os qui l'accompagnaient. Bell prit ce fragment de crâne et le disposa de manière à ce qu'une paille touche le tympan à une extrémité et un morceau de verre fumé mobile à l'autre. Ainsi, lorsque Bell parlait fort dans l'oreille, les vibrations du tympan laissaient de minuscules marques sur le verre.
Ce fut l'un des incidents les plus extraordinaires de
toute l'histoire du téléphone. Pour un observateur non
initié, rien n'aurait pu être plus horrible ni plus absurde.
Comment aurait-on pu interpréter la joie macabre de ce jeune
professeur au visage pâle et aux yeux noirs, debout, chantant,
chuchotant et criant avec ferveur à l'oreille d'un mort ? Quel
genre de sorcier, de goule ou de fou devait-il être ? Et à
Salem, en plus, berceau de la
superstition magique ! Bell n'aurait certainement pas été
bien accueilli s'il avait vécu deux siècles plus tôt
et s'était fait prendre en flagrant délit de magie noire.
Quel rapport y avait-il entre l'oreille de ce défunt et l'invention du téléphone ? Beaucoup. Bell remarqua combien le tympan était petit et fin, et pourtant combien il pouvait transmettre des vibrations à travers des os lourds. « Si ce minuscule disque peut faire vibrer un os », pensa-t-il, « alors un disque de fer pourrait faire vibrer une tige de fer, ou du moins un fil de fer. » En un éclair, l'idée d'un téléphone à membrane lui vint à l'esprit. Il imagina deux disques de fer, ou tympans, éloignés l'un de l'autre et reliés par un fil électrifié, captant les vibrations du son à une extrémité et les reproduisant à l'autre. Il était enfin sur la bonne voie et possédait une connaissance théorique de ce que devait être un téléphone parlant. Il restait à construire une telle machine et à trouver le meilleur moyen d'exploiter le courant électrique.
Puis, comme si Fortune avait soudain senti qu'il remportait
trop facilement ce succès prodigieux, Bell fut repoussé
par une avalanche d'ennuis. Sanders et Hubbard, qui avaient financé
ses expériences, annoncèrent brusquement qu'ils ne paieraient
plus s'il ne se consacrait pas au télégraphe musical et
ne cessait de perdre son temps avec des jouets auditifs qui ne pourraient
jamais avoir de valeur financière. Ce que ces deux hommes demandaient
pouvait difficilement être refusé, car l'un d'eux était
son mécène le mieux rémunéré et l'autre
le père de la jeune fille qu'il espérait épouser.
« Si vous désirez ma fille », dit Hubbard, «
vous devez abandonner votre stupide téléphone. »
L'« École de physiologie vocale » de Bell, dont il
avait tant espéré, avait également connu une fin
peu glorieuse. Il avait été trop absorbé par ses
expériences pour la maintenir. Son poste de professeur avait
été abandonné, et il n'avait d'autres élèves
que Georgie Sanders et Mabel Hubbard. Il était pauvre, bien plus
pauvre que ses associés ne le pensaient. Son esprit était
déchiré et distrait par les appels contradictoires de
la science, de la pauvreté, des affaires et de l'affection. Déversant
ses chagrins dans une lettre à sa mère, il écrivait
: « Je commence à comprendre les soucis et les angoisses
d'être inventeur. J'ai dû abandonner tous mes élèves
et tous mes cours, car la chair et le sang ne pouvaient plus supporter
longtemps une telle pression. »
Alors qu'il traversait ce bourbier de désespoir, il fut appelé à Washington par son avocat spécialisé en brevets. N'ayant pas les moyens de payer un tel voyage, il emprunta le prix d'un billet aller-retour à Sanders et s'arrangea pour loger chez un ami à Washington, afin d'économiser une note d'hôtel qu'il ne pouvait pas payer. À cette époque, le professeur Joseph Henry, qui connaissait mieux la théorie de l'électricité que tout autre Américain, était le grand homme de Washington ; et le pauvre Bell, dans son doute et son désespoir, résolut de se précipiter vers lui pour lui demander conseil.
Puis eut lieu une rencontre qui mérite d'être
historique. Pendant tout un après-midi, les deux hommes travaillèrent
ensemble sur l'appareil que Bell avait apporté de Boston, tout
comme Henry avait travaillé sur le télégraphe avant
sa naissance. Henry était désormais un vétéran
de soixante-dix-huit ans, avec seulement trois années d'expérience
à son actif, tandis que Bell en avait vingt-huit.
Un long demi-siècle les séparait ; mais le jeune homme
avait découvert un Fait Nouveau que le sage, malgré toute
sa sagesse, ignorait.
« Vous êtes en possession du germe d’une grande invention
», dit Henry, « et je vous conseille d’y travailler
jusqu’à ce que vous l’ayez achevée. »
« Mais », répondit Bell, « je n’ai pas
les connaissances électriques nécessaires. »
« Prends-le », répondit le vieux scientifique.
« Je ne saurais vous dire à quel point ces deux mots m'ont
encouragé », a déclaré Bell plus tard, en
décrivant cet entretien à ses parents. « Je vis
trop dans une atmosphère de découragement pour les activités
scientifiques ; et une idée aussi chimérique que la transmission
de sons vocaux semblerait à la plupart des esprits difficilement
réalisable pour qu'on y consacre du temps. »
À cette époque, Bell avait déménagé
son atelier de la cave de Salem au 109 Court Street, à Boston,
où il avait loué une chambre à Charles
Williams, un fabricant de matériel électrique. Thomas
A. Watson était son assistant, et Bell et Watson habitaient
tous deux à proximité, dans deux petites chambres bon
marché. Le loyer de l'atelier et des chambres, ainsi que le salaire
de Watson, neuf dollars par semaine, étaient payés par
Sanders et Hubbard. Par conséquent, à son retour de Washington,
Bell fut contraint, conformément à son contrat, de se
consacrer principalement au télégraphe musical, même
si son cœur était désormais tourné vers le
téléphone. Pendant exactement trois mois après
son entretien avec le professeur Henry, il continua à avancer
sur ces deux fronts, jusqu'à ce que, par cet après-midi
mémorable et chaud de juin 1875, le son du ressort d'horloge
retentisse sur le fil, donnant naissance au téléphone.
Dès lors, Bell ne nourrit qu'un seul objectif : il conquit Sanders et Hubbard. Il fit de Watson un passionné. Il oublia son télégraphe musical, sa « parole visible », ses cours, sa pauvreté. Il abandonna une profession qui le rendait déjà célèbre localement. Et il s'attaqua à ce nouveau mystère de l'électricité, comme Henry le lui avait conseillé, se rassurant sur le fait que Morse, qui n'était que peintre, avait surmonté ses difficultés électriques, et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'un professeur d'acoustique n'en fasse pas autant.
Le téléphone existait désormais, mais c'était l'invention la plus récente et la plus fragile du pays. Il n'avait pas encore prononcé un mot. Il fallait l'enseigner, le développer et l'adapter au monde des affaires, pourtant irritable. Il fallait tester toutes sortes de disques, certains plus petits et plus fins qu'une pièce de dix cents, d'autres en tôle d'acier aussi lourde que le bouclier d'Achille. Dans tous les ouvrages de science électrique, rien ne pouvait aider Bell et Watson dans ce voyage à travers un pays inconnu. Ils étaient aussi désemparés que Colomb en 1492. Ni eux ni personne d'autre n'avaient acquis la moindre expérience dans la conception d'un jeune téléphone. Personne ne savait quoi faire ensuite. Il n'y avait rien à savoir.
Pendant quarante semaines – de longues semaines
exaspérantes – le téléphone ne put faire plus
que siffler et émettre d'étranges bruits inarticulés.
Ses éducateurs n'avaient pas appris à le manier. Puis,
le 10 mars 1876, IL PARLA. Il dit distinctement :
« MONSIEUR WATSON, VENEZ ICI, JE VEUX VOUS VOIR. » Watson,
qui se trouvait au sous-sol, raccrocha le combiné et, tout joyeux,
monta trois étages pour annoncer la bonne nouvelle à Bell.
« Je vous entends ! » cria-t-il, essoufflé. «
J'entends les MOTS. »
Bien sûr, il n'était pas facile pour le
jeune téléphone de se faire entendre dans cet atelier
bruyant. Personne, pas même Bell et Watson, ne
connaissait son étrange petite voix. Habituellement, Watson,
doté d'une ouïe remarquablement fine, écoutait ;
et Bell, élocutionniste professionnel, parlait. Et de jour en
jour, le timbre du petit instrument s'éclairait – une nouvelle
note dans l'orchestre de la civilisation.
Le jour de son vingt-neuvième anniversaire, Bell
reçut son brevet n° 174 465 Document
en pdf
– « le brevet le plus précieux jamais délivré
» dans un pays. Il avait créé quelque chose de si
novateur qu'il n'existait aucun nom pour le désigner dans aucune
langue du monde. En le décrivant aux fonctionnaires de l'Office
des brevets, il fut obligé de le qualifier de « progrès
de la télégraphie », alors qu'en réalité,
il n'en était rien. C'était aussi différent du
télégraphe que l'éloquence d'un grand orateur du
langage des signes d'un sourd-muet.
D'autres inventeurs avaient travaillé du point
de vue du télégraphe ; ils n'ont jamais obtenu, et n'ont
jamais pu obtenir, de meilleurs résultats que les signes et les
symboles. Bell, lui, travaillait du point de vue de la voix humaine.
Il a croisé les sciences de l'acoustique et de l'électricité.
Son étude de la « parole visible » avait entraîné
son esprit au point de pouvoir VOIR mentalement la forme d'un mot lorsqu'il
le prononçait. Il savait ce qu'était une parole et comment
elle agissait sur l'air, ou l'éther, qui transportait ses vibrations
des lèvres à l'oreille. Spécialiste de la nature
de la parole depuis trois générations, il savait que pour
la transmission des mots parlés, il devait y avoir « une
action pulsatoire du courant électrique, l'exact équivalent
des impulsions aériennes ».
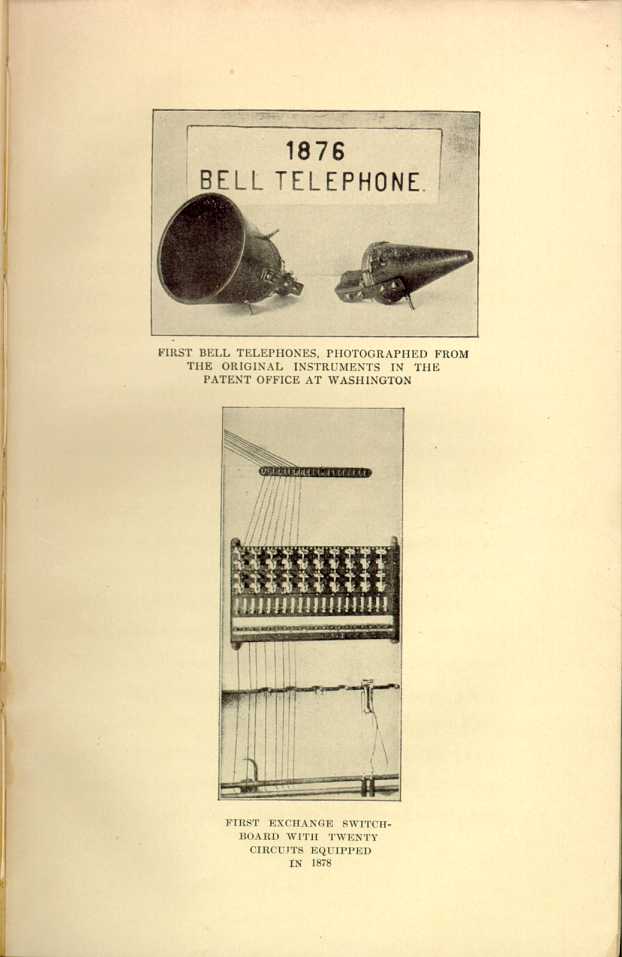
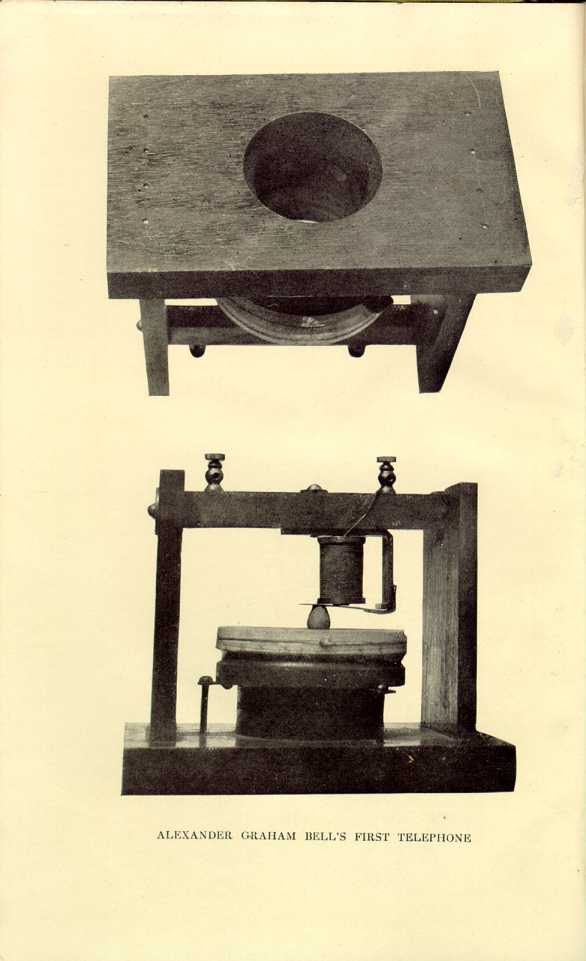
Bell en savait juste assez sur l'électricité, et pas trop. Il ignorait la différence entre le possible et l'impossible. « Si j'avais su plus sur l'électricité et moins sur le son », disait-il, « je n'aurais jamais inventé le téléphone. » Ce qu'il avait accompli était si étonnant, si téméraire, qu'aucun électricien qualifié n'aurait pu y penser. C'était « la véritable audace de l'invention », et pourtant, ce n'était en aucun cas une découverte fortuite. C'était le fruit naturel d'un esprit qui avait été amené à rassembler les matériaux adéquats pour un tel produit.
Comme si les étoiles de leurs cours travaillaient pour ce jeune magicien du fil parlant, l'Exposition du Centenaire de Philadelphie ouvrit ses portes exactement deux mois après que le téléphone eut appris à parler. C'était une occasion exceptionnelle de faire connaître au monde entier ce qui avait été accompli, et heureusement, Hubbard était l'un des commissaires du Centenaire. Grâce à son influence, une petite table fut installée au Département de l'Éducation, dans un espace étroit entre un escalier et un mur, et sur cette table fut déposé le premier des téléphones.
Bell n'avait aucune intention d'aller lui-même au Centenaire. Il était trop pauvre. Sanders et Hubbard n'avaient jamais fait plus que payer son loyer et les frais de ses expériences. Pour ses trois ou quatre années d'invention, il n'avait encore rien reçu – rien que son brevet. Pour survivre, il avait été contraint de réorganiser ses cours de « parole visible » et de se remettre sur pied dans sa profession négligée.
Mais un vendredi après-midi, vers la fin juin, sa bien-aimée, Mabel Hubbard, prenait le train pour le Centenaire ; il se rendit à la gare pour lui dire au revoir. C'est là que Mlle Hubbard apprit pour la première fois que Bell ne partirait pas. Elle tenta de la persuader et de la supplier, sans succès. Puis, alors que le train démarrait, laissant Bell sur le quai, la jeune fille affectueuse ne put plus se contrôler et fut prise d'une violente crise de larmes. Sur ce, Bell, sensible, tel un véritable Sir Galahad, se précipita à la suite du train en marche et sauta à bord, sans billet ni bagage, oubliant sa classe sociale, sa pauvreté et tout le reste, sauf la détresse de cette jeune fille. « Je n'ai jamais vu un homme, dit Watson, aussi amoureux que Bell. »
Il se trouve que cette visite impromptue au Centenaire s'avéra être l'un des actes les plus opportuns de sa vie. Le dimanche après-midi suivant, les juges devaient effectuer une visite d'inspection spéciale, et M. Hubbard, après bien des difficultés, avait obtenu la promesse qu'ils consacreraient quelques minutes à examiner le téléphone de Bell. À ce moment-là, il était exposé depuis plus de six semaines, sans attirer l'attention de quiconque.
Le dimanche après-midi, Bell était à sa petite table, nerveux et pourtant confiant. Mais les heures passèrent sans que les juges n'arrivent. Il faisait une chaleur intense et ils avaient de nombreuses merveilles à examiner. Il y avait la première lumière électrique, la première lieuse à grains, le télégraphe musical d'Elisha Gray et la merveilleuse exposition de télégraphes d'impression présentée par la Western Union Company. Lorsqu'ils arrivèrent à la table de Bell, à travers un fouillis de pupitres et de tableaux noirs, il était 19 heures, et tous les hommes du groupe avaient chaud, étaient fatigués et affamés. Plusieurs annoncèrent leur intention de rentrer à leur hôtel. L'un d'eux prit un combiné téléphonique, le regarda d'un air absent, puis le reposa. Il ne le porta même pas à son oreille. Un autre juge fit une remarque désobligeante qui déclencha un rire aux dépens de Bell. Puis un événement des plus merveilleux se produisit – un incident qui ferait un chapitre des « Divertissements des Mille et Une Nuits ».
Accompagné de son épouse, l'impératrice
Thérèse, et d'une pléiade de courtisans, l'empereur
du Brésil, Dom Pedro de Alcantara, entra dans la salle, s'avança,
les mains tendues, vers Bell, déconcerté, et s'exclama
:
« Professeur Bell, je suis ravi de vous revoir. » Les juges
oublièrent aussitôt la chaleur, la fatigue et la faim.
Qui était ce jeune inventeur, au teint pâle et aux yeux
noirs, pour être l'ami des empereurs ? Ils ignoraient, et Bell
lui-même l'avait oublié sur le moment, que Dom Pedro avait
autrefois visité sa classe de sourds-muets à l'université
de Boston. Il s'intéressait particulièrement à
ce type d'œuvre humanitaire et avait récemment contribué
à l'organisation de la première école brésilienne
pour sourds-muets à Rio de Janeiro. Ainsi, avec Dom Pedro, grand
et blond, au centre, les juges et les scientifiques – ils étaient
une cinquantaine en tout – se lancèrent avec un enthousiasme
inhabituel dans les débats de cette première exposition
téléphonique.
Un fil avait été tendu d'un bout à l'autre de la pièce, et tandis que Bell se dirigeait vers l'émetteur, Dom Pedro prit le récepteur et le porta à son oreille. L'attente fut intense. Personne ne savait vraiment ce qui allait se passer, lorsque l'Empereur, d'un geste théâtral, leva la tête du récepteur et s'exclama, l'air stupéfait : « Mon Dieu, il parle ! »
Puis vint au récepteur le plus ancien scientifique du groupe, le vénérable Joseph Henry, dont les encouragements à Bell étaient si opportuns. Il s'arrêta pour écouter et, comme le dit plus tard l'un des spectateurs, personne ne pouvait oublier l'expression de crainte qui se lut sur son visage en entendant ce disque de fer parler d'une voix humaine. « Ceci », dit-il, « est plus près de renverser la doctrine de la conservation de l'énergie que tout ce que j'ai jamais vu. »
Puis vint Sir William Thomson, plus tard connu sous le nom de Lord Kelvin. Sa présence était tout à fait appropriée, car il était le plus grand électricien du monde à l'époque et avait été l'ingénieur du premier câble transatlantique. Il écouta et apprit ce qu'il ignorait lui-même : un corps métallique solide pouvait capter de l'air toutes les innombrables vibrations produites par la parole, et que ces vibrations pouvaient être transportées le long d'un fil et reproduites à l'identique par un second corps métallique. Il hocha solennellement la tête en se levant du récepteur. « Ça parle », dit-il avec emphase. « C'est la chose la plus merveilleuse que j'aie jamais vue en Amérique. »
Ainsi, l'un après l'autre, ce groupe d'hommes remarquables écoutèrent la voix du premier téléphone, et plus ils en savaient sur la science, moins ils étaient enclins à en croire leurs oreilles. Plus ils étaient savants, plus ils s'interrogeaient. Pour Henry et Thomson, les maîtres de la magie électrique, cet instrument était aussi surprenant que pour le commun des mortels. Et tous deux eurent la noblesse d'avouer franchement leur étonnement dans les rapports qu'ils rédigèrent en tant que juges, lorsqu'ils décernèrent à Bell un certificat de récompense. « M. Bell a obtenu un résultat d'un intérêt scientifique transcendant », écrivit Sir William Thomson. « Je l'ai entendu prononcer distinctement plusieurs phrases… J'étais stupéfait et ravi… C'est la plus grande merveille jamais réalisée par le télégraphe électrique. »
Jusqu'à près de 22 heures ce soir-là,
les juges discutèrent et écoutèrent tour à
tour au téléphone. Puis, le lendemain matin, ils apportèrent
l'appareil au pavillon des juges, où, pendant le reste de l'été,
il fut pris d'assaut par les juges et les scientifiques. Sir William
Thomson et sa femme couraient
d'un bout à l'autre du fil, tels des enfants ravis. Et c'est
ainsi que ce petit instrument rudimentaire, jeté dans un coin
perdu, devint la vedette du Centenaire. Il ne figurait que dix-huit
mots dans le catalogue officiel, et là, il était acclamé
comme la merveille des merveilles. Il avait été conçu
dans une cave et né dans un atelier d'usinage ; et maintenant,
de tous les cadeaux que notre jeune république américaine
avait reçus pour son centième anniversaire, le téléphone
était honoré comme le plus rare et le plus apprécié
de tous.
LA CONSTRUCTION DE L'ENTREPRISE
Après la naissance du téléphone
à Boston, son baptême au Bureau des brevets et son accueil
royal au centenaire de Philadelphie, on pouvait supposer que sa vie
serait désormais paisible et agréable.
Mais comme il s'agit d'histoire, et non d'une fiction, il faut noter
le fait très surprenant que le jeune nouveau venu ne reçut
ni accueil ni attention du grand monde des affaires. « C'est un
jouet scientifique », dirent les commerçants. « C'est
un instrument intéressant, bien sûr, pour les professeurs
d'électricité et d'acoustique ; mais il ne peut jamais
être une nécessité pratique. Autant proposer d'installer
un télescope dans une aciérie ou d'atteler un ballon à
une fabrique de chaussures. »
Le pauvre Bell, au lieu d'être applaudi, fut assailli
de moqueries. C'était un « imposteur », un «
ventriloque », un « excentrique qui prétend pouvoir
parler à travers un fil ». Le Times de Londres qualifia
pompeusement le téléphone de dernière imposture
américaine et donna de nombreuses
raisons sérieuses pour lesquelles la parole ne pouvait être
transmise par fil, en raison de la nature intermittente du courant électrique.
Presque tous les électriciens – ceux qui étaient
censés s'y connaître – déclarèrent que
le téléphone était une invention impossible ; et
ceux qui ne le dénoncèrent pas ouvertement comme un canular
crurent que Bell avait découvert par hasard une utilisation bizarre
de l'électricité, qui ne pourrait jamais avoir la moindre
utilité pratique.
Bien qu'arrivé tard dans la lignée des inventeurs, Bell dut essuyer moqueries et adversités. L'accueil réservé à son téléphone par le public lui fit sympathiser avec Howe, dont la première machine à coudre fut détruite par une foule de Boston ; avec McCormick, dont la première faucheuse fut qualifiée de « croisement entre un char Astley, une brouette et une machine volante » ; avec Morse, que dix Congrès considérèrent comme une nuisance ; avec Cyrus Field, dont le câble transatlantique fut dénoncé comme « un phénomène fou d'ignorance obstinée » ; et avec Westinghouse, traité d'idiot pour avoir proposé « d'arrêter un train avec du vent ».
L'idée même de parler à une plaque de tôle était si nouvelle et extraordinaire que l'esprit normal la répugnait. Pour l'ouvrier comme pour le scientifique, c'était incompréhensible. C'était trop bizarre, trop étrange, pour être utilisé hors du laboratoire et du musée. Personne, littéralement, ne comprenait son fonctionnement ; et le seul homme à proposer une solution claire au mystère était un mécanicien de Boston, qui soutenait qu'il y avait « un trou au milieu du fil ».
Ceux qui parlaient pour la première fois dans une cabine téléphonique ressentaient une sorte de trac. Ils se sentaient ridicules. Agir ainsi semblait absurde, surtout lorsqu'il fallait crier à tue-tête. De toute évidence, le confort que pouvait procurer ce nouveau dispositif était largement compensé par la perte de dignité personnelle ; et rares étaient ceux qui avaient assez d'imagination pour imaginer le téléphone comme faisant partie intégrante de leur travail quotidien. Le banquier disait que cela pourrait convenir aux épiciers, mais que cela ne servirait jamais au secteur bancaire ; et l'épicier disait que cela pourrait convenir aux banquiers, mais que cela ne servirait jamais aux épiciers.
Alors que Bell mettait au point son invention à Salem, un rédacteur en chef afficha le titre « Sorcellerie de Salem ». Le New York Herald écrivit : « L’effet est étrange et presque surnaturel. » Le Providence Press ajouta : « Difficile de résister à l’idée que les puissances des ténèbres y soient en quelque sorte mêlées. » Et le Boston Times écrivit, dans un éditorial ironique : « On peut désormais courtiser sa femme en Chine aussi bien qu’à East Boston ; mais l’aspect le plus grave de cette invention est le pouvoir effroyable et irresponsable qu’elle donnera à la belle-mère moyenne, qui pourra ainsi faire entendre sa voix aux quatre coins du globe. »
En 1876, des centaines de capitalistes astucieux scrutaient les villes américaines, cherchant avec perspicacité des opportunités commerciales. Mais aucun d'entre eux ne proposa à Bell d'acheter son brevet. Aucun ne se présenta pour un contrat d'État. Et aucun parlement, ni aucun conseil municipal, ne se porta volontaire pour offrir à la population un service téléphonique bon marché et efficace. Quant à Bell lui-même, il n'était pas un homme d'affaires. Dans tous les aspects pratiques des affaires, il était aussi incompétent qu'un Byron ou un Shelley. Il avait fait sa part, et il restait maintenant à des hommes aux compétences diverses de s'approprier son téléphone et de l'adapter aux usages et aux conditions du monde des affaires.
Le premier homme à entreprendre cette œuvre fut Gardiner G. Hubbard, qui devint peu après le beau-père de Bell. Lui aussi était un homme d'enthousiasme plutôt que d'efficacité. Il n'était ni riche ni expérimenté en affaires, mais il était admirablement qualifié pour introduire le téléphone auprès d'un public hostile. Son père avait été juge à la Cour suprême du Massachusetts ; lui-même était avocat et avait principalement exercé en droit. En 1876, c'était un homme d'apparence respectable, avec des cheveux blancs longs et une barbe patriarcale. C'était une figure familière à Washington et bien connue des hommes publics de son époque. Compagnon polyvalent et divertissant, tour à tour prospère et pauvre, et toujours optimiste, Gardiner Hubbard devint un élément indispensable en tant que premier agent de promotion du téléphone.
Aucun autre citoyen n'avait fait autant pour la ville de Cambridge que Hubbard. C'est lui qui avait assuré l'approvisionnement en gaz de Cambridge en 1853, l'approvisionnement en eau potable et la construction d'un tramway jusqu'à Boston. Il avait traversé le Sud en 1860 dans l'espoir patriotique d'éviter la guerre de Sécession imminente. Il avait convaincu le Parlement de fonder la première école publique pour sourds-muets, l'école qui avait attiré Bell à Boston en 1871. Et il avait été pendant des années un ardent défenseur des améliorations de la télégraphie et de la poste. Ainsi, en tant que promoteur de projets d'intérêt général, Hubbard n'était en aucun cas un novice. Sa première démarche pour capter l'attention d'une nation indifférente fut de faire de la publicité. Il comprit que cette nouvelle idée du téléphone devait être familière au public. Il parlait téléphone jour et nuit. Chaque fois qu'il voyageait, il emportait deux de ces instruments magiques dans sa valise et faisait des démonstrations dans les trains et les hôtels. Il s'adressait à tous les hommes influents qu'il croisait. C'était un véritable « vieux marin » du téléphone. Aucun interlocuteur potentiel n'était autorisé à s'échapper.
Pour promouvoir cette campagne de publicité,
Hubbard encouragea Bell et Watson à réaliser une série
d'exploits sensationnels avec le téléphone. Un fil télégraphique
entre New York et Boston fut emprunté pendant une demi-heure
et, en présence de Sir William Thomson, Bell envoya une mélodie
sur la ligne de 380 kilomètres. « Entendez-vous ? »
demanda-t-il à l'opératrice du côté new-yorkais.
« Élégamment », répondit l'opératrice.
« Quel air ? » demanda Bell. « Yankee Doodle »,
fut la réponse.
Peu après, alors que Bell était en visite chez son père
au Canada, il acheta tout le fil de la ville et le fixa à une
clôture en fer forgé entre la maison et un bureau télégraphique.
Puis il se rendit dans un village distant de 13 kilomètres et
envoya des bribes de chansons et des citations shakespeariennes sur
le fil.
Un grand nombre de personnes niaient encore la transmission
de la parole par fil. Lorsque Watson discutait avec Bell lors de manifestations
publiques, certains rédacteurs en chef parlaient avec scepticisme
du « suppositif Watson ». Pour faire taire ces sceptiques,
Bell et Watson préparèrent un test des plus rigoureux
du téléphone. Ils empruntèrent la ligne télégraphique
entre Boston et l'observatoire de Cambridge, et y branchèrent
un téléphone à chaque extrémité.
Puis, pendant trois heures ou plus, ils entretinrent la PREMIÈRE
conversation téléphonique soutenue, chacun prenant soigneusement
des notes de ce qu'il disait et de ce qu'il entendait. Ces notes furent
publiées dans des colonnes parallèles du Boston Advertiser
du 19 octobre 1876 et prouvèrent sans l'ombre d'un doute que
le téléphone était désormais un succès.
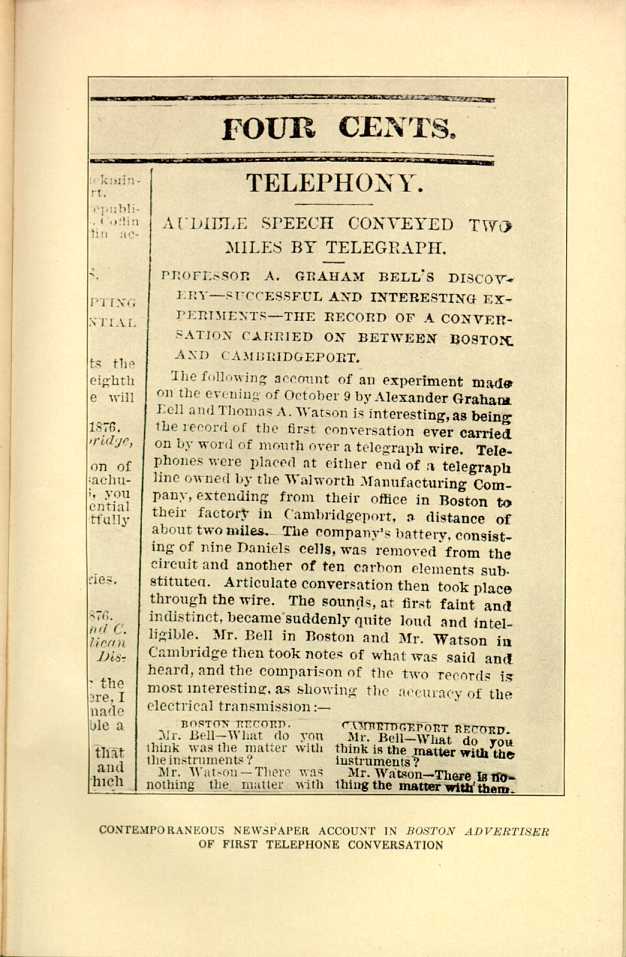
COMPTE RENDU CONTEMPORAIN DE JOURNAL À BOSTON ANNONÇANT
LA PREMIÈRE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE
Après cela, les événements se succédèrent
rapidement. Une série de dix conférences fut organisée
pour Bell, à cent dollars chacune, ce qui constituait la première
rémunération qu'il recevait pour son invention. Sa première
eut lieu à Salem, devant un auditoire de cinq cents personnes,
et Mme Sanders, la vieille dame maternelle qui avait hébergé
Bell à l'époque de son expérience, était
fièrement assise sur l'un des sièges du premier rang.
Un poteau fut dressé à l'avant de la salle, soutenant
l'extrémité d'un fil télégraphique reliant
Salem à Boston. Watson, qui devint le premier orateur public
par téléphone, envoya des messages de Boston à
divers membres de l'auditoire. Un compte rendu de cette conférence
fut envoyé par téléphone au Boston Globe, qui annonça
le lendemain matin :
« Cette dépêche spéciale du Globe a été
transmise par téléphone en présence de vingt personnes,
qui ont ainsi été témoins d’un exploit jamais
tenté auparavant : l’envoi de nouvelles sur un espace de
seize milles par la voix humaine. »
Cette dépêche du Globe réveilla les rédacteurs en chef avec un sursaut inattendu. Pour la première fois, ils commencèrent à remarquer l'apparition d'un nouveau mot dans la langue et d'une nouvelle idée dans le monde scientifique. Aucun journal n'avait fait la moindre mention du téléphone pendant les soixante-quinze jours qui suivirent l'obtention du brevet de Bell. Aucun des nombreux journalistes qui se pressaient au centenaire de Philadelphie n'avait considéré le téléphone comme un sujet d'intérêt public. Mais lorsqu'une chronique fut envoyée par téléphone au Boston Globe, le monde entier de la presse fut en émoi. Mille plumes écrivirent le nom de Bell. Des demandes de répétition de sa conférence lui parvinrent de la part de Cyrus W. Field, le vétéran du câble transatlantique, du poète Longfellow et de bien d'autres.
Étant orateur de profession, Bell sut tirer le meilleur parti de ces occasions. Ses conférences devinrent des divertissements populaires. Elles étaient données dans les plus grandes salles. Lors d'une conférence, deux Japonais furent amenés à parler dans leur propre langue, par téléphone. Lors d'une deuxième conférence, un orchestre joua « The Star-Spangled Banner » à Boston, et fut entendu par un auditoire de deux mille personnes à Providence. Lors d'une troisième conférence, Signor Ferranti, de Providence, chanta un extrait des « Noces de Figaro » devant un auditoire bostonien. Lors d'une quatrième conférence, une exhortation de Moody et une chanson de Sankey furent diffusées sur la corde vibrante. Et lors d'une cinquième conférence, à New Haven, Bell fit seize professeurs de Yale alignés, main dans la main, et parlèrent à travers leurs corps – un exploit qui était alors, et qui l'est encore aujourd'hui, presque inimaginable.
Très lentement, ces conférences et l'activité
infatigable de Hubbard repoussèrent le ridicule et l'incrédulité
; et, au cours du joyeux mois de mai 1877, un certain Emery débarqua
dans le bureau de Hubbard, en provenance de la ville voisine de Charlestown,
et loua deux téléphones pour vingt
dollars réels – la première somme jamais déboursée
pour un téléphone. C'était le premier signe, faible,
qu'une nouveauté comme le téléphone pouvait voir
le jour ; et jamais aucune somme ne parut plus précieuse que
ces vingt dollars à Bell, Sanders, Hubbard et Watson. C'était
le maigre premier fruit de la fortune.
Fortement encouragés, ils rédigèrent
une petite circulaire qui fut la première publicité pour
le téléphone.
Ce document, d'une simplicité étonnante aujourd'hui, était
pourtant surprenant pour un esprit de 1877. Il affirmait modestement
que le téléphone était supérieur au télégraphe
pour trois raisons :
(1) Aucun opérateur qualifié n’est requis, mais une
communication directe peut être établie par la parole sans
l’intervention d’une tierce personne.
(2) La communication est beaucoup plus rapide, le nombre moyen de mots
transmis en une minute par le sondeur Morse étant de quinze à
vingt, par téléphone de cent à deux cents.
(3) Aucune dépense n'est nécessaire, ni pour son fonctionnement
ni pour sa réparation. Il ne nécessite ni batterie ni
mécanisme complexe. Son économie et sa simplicité
sont inégalées.
À cette époque, la seule ligne téléphonique
au monde reliait l'atelier des Williams à Boston au domicile
de M. Williams à Somerville.
Mais en mai 1877, un jeune homme nommé E.T. Holmes, qui
dirigeait une entreprise d'alarmes anti-intrusion à Boston, proposa
de relier quelques téléphones à ses lignes. Ami
et client de Williams, il proposa ce projet, mi-blague, mi-sérieux.
Hubbard saisit rapidement l'occasion et prêta aussitôt une
douzaine de téléphones à Holmes. Sans demander
la permission, Holmes se rendit dans six banques et installa un téléphone
dans chacune d'elles. Cinq banquiers ne protestèrent pas, mais
le sixième, indigné, ordonna de retirer « ce jouet
». Les cinq autres téléphones pouvaient être
reliés par un commutateur dans le bureau de Holmes, et ainsi
naquit le premier central téléphonique, minuscule et rudimentaire.
Il fonctionna là pendant plusieurs semaines, servant de système
téléphonique le jour et d'alarme anti-intrusion la nuit.
Les banquiers ne payèrent rien. Ce service leur fut offert à
titre d'exposition et de publicité. La petite étagère
avec ses cinq téléphones ne ressemblait pas plus aux merveilleux
centraux d'aujourd'hui qu'un canot à un Cunarder, mais c'était
incontestablement le premier endroit où plusieurs fils téléphoniques
se rejoignaient et pouvaient être unis.
Peu après, Holmes sortit ses téléphones
des banques et lança une véritable affaire téléphonique
auprès des compagnies de messagerie express de Boston. Mais à
cette époque, plusieurs centraux avaient été ouverts
pour les affaires courantes, à New Haven, Bridgeport, New York
et Philadelphie.
Un homme du Michigan était également arrivé, qui
avait eu l'audace de demander une agence d'État : George W. Balch,
de Détroit. Il fut si bien accueilli que Hubbard lui accorda
avec joie tout ce qu'il demandait : un droit perpétuel sur tout
l'État du Michigan. Balch n'eut pas à payer un centime
d'avance, hormis son billet de train, et, bien avant d'avoir atteint
l'âge de plusieurs années, il avait vendu son bail pour
une belle fortune d'un quart de million de dollars, honnêtement
gagnée grâce à son initiative et à son esprit
d'entreprise.
En août, alors que le brevet de Bell avait seize
mois, 778 téléphones étaient en service. Pour Hubbard,
optimiste, cela semblait être un succès. Il décida
que le moment était venu d'organiser l'entreprise et conclut
un accord simple qu'il baptisa « Bell
Telephone Association ».
Cet accord accordait à Bell, Hubbard et Sanders trois dixièmes
chacun des brevets, et à Watson un dixième. IL N'Y AVAIT
PAS DE CAPITAL. Il n'y en avait pas à acquérir. Les quatre
hommes détenaient alors un monopole absolu sur le marché
du téléphone ; et tous les autres étaient tout
à fait disposés à le leur accorder.
Le seul homme qui avait de l'argent et osait miser sur
l'avenir du téléphone était Thomas Sanders, et
ce n'était pas principalement pour des raisons professionnelles.
Lui et Hubbard étaient attachés à Bell principalement
par sentiment, car Bell avait débarrassé le jeune fils
de Sanders de son mutisme et allait bientôt épouser la
fille de Hubbard.
De plus, Sanders ne s'attendait pas, au départ, à avoir
besoin d'autant d'argent. Il n'était pas riche. Son entreprise,
qui consistait à découper des semelles pour des fabricants
de chaussures, ne valait à aucun moment plus de trente-cinq mille
dollars.
Pourtant, de 1874 à 1878, il avait avancé les neuf dixièmes
des fonds dépensés pour le téléphone. Il
avait payé le loyer de Bell, le salaire de Watson, les dépenses
de Williams et le coût de l'exposition du Centenaire. Les cinq
mille premiers téléphones, et plus encore, furent fabriqués
avec son argent. Et tant de longs et coûteux mois s'écoulèrent
avant que Sanders ne trouve un soulagement, qu'il fut contraint, bien
contre sa volonté et son sens des affaires, d'étirer son
crédit au bord de la rupture pour aider Bell et le téléphone.
Désespérément, il signa note après note
jusqu'à ce qu'il se retrouve avec un total de cent dix mille
dollars. Si le nouveau « jouet scientifique » réussissait,
ce dont il doutait souvent, il serait le citoyen le plus riche de Haverhill
; et s’il échouait, ce qu’il craignait profondément,
il serait en faillite.
Une série de rebuffades décourageantes força peu à peu Sanders à comprendre que le monde des affaires refusait d'accepter le téléphone comme un article de commerce. C'était un jouet, un accessoire, une merveille scientifique, mais pas une nécessité pour le commun des mortels. Les capitalistes le traitèrent exactement comme ils avaient traité le projet de câble transatlantique lors de la visite de Cyrus Field à Boston en 1862. Ils admirèrent et s'émerveillèrent, mais pas un seul homme ne souscrivit un seul dollar. De plus, Sanders comprit très vite que le moment était particulièrement défavorable à la création d'une nouvelle entreprise. C'était une période de troubles et de suspicion. Entre la faillite de Jay Cooke, l'impasse Hayes-Tilden et l'éclatement d'une centaine de bulles financières ferroviaires, l'actualité était bien peu propice à l'investissement.
Il était impossible à Sanders, Bell ou
Hubbard d'élaborer un plan précis. Quel qu'il fût,
ils n'avaient pas d'argent pour le mettre à exécution.
Ils croyaient tenir quelque chose de nouveau et de merveilleux, que
quelqu'un, quelque part, serait prêt à acheter. En attendant
l'arrivée de ce génie, ils ne pouvaient que patauger et
accepter les affaires les plus proches et les moins chères. Ainsi,
tandis que Bell, dans ses éloquentes éloges, dépeignait
sous les applaudissements d'un public enthousiaste un service téléphonique
universel, Sanders et Hubbard louaient des téléphones
deux par deux à des hommes d'affaires qui utilisaient auparavant
les lignes privées de la Western Union Telegraph Company.
Cette grande entreprise était alors leur ennemi naturel et inévitable.
Elle avait englouti la plupart de ses concurrents et cherchait à
monopoliser tous les moyens de communication par fil. Le plus bel espoir
qui planait sur Sanders et Hubbard était que la Western Union
finisse par racheter les brevets de Bell, comme elle en avait déjà
acquis bien d'autres. Dans un moment de découragement, ils avaient
proposé le téléphone au président Orton,
de la Western Union, pour 100 000 dollars ; et Orton avait refusé.
« À quoi cette entreprise pourrait-elle bien servir »,
demanda-t-il aimablement, « d'un jouet électrique ? »
Mais outre l'exploitation de ses propres lignes, la Western Union fournissait à ses clients divers types de télégraphes à impression et à cadran, dont certains pouvaient transmettre soixante mots par minute. Ces instruments de précision, croyait-elle, ne pourraient jamais être remplacés par une curiosité scientifique telle que le téléphone. Et elle continua à le croire jusqu'à ce qu'une de ses filiales, la Gold and Stock, signale que plusieurs de ses machines avaient été remplacées par des téléphones.
La Western Union sortit aussitôt de son indifférence.
Il fallait mettre un terme à cette infime atteinte à ses
activités. Elle réagit rapidement et créa l'«
American Speaking-Telephone Company
», dotée d'un capital de 300 000 dollars et comptant parmi
ses employés trois inventeurs de l'électricité,
Edison, Gray
et Dolbear.
Forte de toute sa richesse et de son prestige, elle s'abattit sur Bell
et sa petite garde du corps. Elle piétina le brevet de Bell avec
aussi peu d'inquiétude qu'un éléphant peut l'être
lorsqu'il piétine une fourmilière. À la stupéfaction
totale de Bell, elle annonça froidement qu'elle possédait
« le seul téléphone original » et qu'elle
était prête à fournir « des téléphones
de qualité supérieure dotés des dernières
améliorations apportées par les inventeurs originaux –
Dolbear, Gray et Edison ».
Le résultat fut étrange et inattendu. Le groupe Bell, au lieu d'être évincé du marché, fut immédiatement propulsé à un niveau supérieur dans le monde des affaires. L'effet fut comparable à celui de la Standard Oil Company qui se lançait dans la fabrication d'avions. En un éclair, le téléphone cessa d'être un « jouet scientifique » pour devenir un article de commerce. Il commença pour la première fois à être pris au sérieux. Et la Western Union, cherchant à protéger ses lignes privées, devint involontairement un indicateur pour guider les capitalistes vers le téléphone.
Les proches de Sanders, nombreux et riches, vinrent à son secours. La plupart étaient des hommes d'affaires réputés : les Bradley, les Saltonstall, Fay, Silsbee et Carlton. Ces hommes, ainsi que le colonel William H. Forbes, ami des Bradley, furent les premiers capitalistes à investir, pour des raisons purement commerciales, dans les brevets de Bell. Deux mois après que la Western Union eut donné son soutien massif au téléphone, ces hommes créèrent une société exclusivement axée sur la Nouvelle-Angleterre et y déposèrent cinquante mille dollars.
En peu de temps, Hubbard, ravi, se retrouva à
louer des téléphones à raison de mille dollars
par mois. Il n'était plus promoteur, mais directeur général.
Des gens faisaient la queue pour trouver des agences.
De petits centraux téléphoniques rudimentaires étaient
installés dans une douzaine de villes. L'esprit de confiance
et d'entreprise régnait ; et la prochaine étape, clairement,
était de créer une organisation commerciale. Aucun des
associés n'était compétent pour entreprendre une
telle entreprise. Hubbard manquait d'aptitudes pour l'organisation ;
Bell n'en avait aucune ; et Sanders était attaché à
ses intérêts dans le cuir.
Voilà enfin, après quatre années d'efforts héroïques,
les matériaux de base pour bâtir une entreprise de téléphonie.
Mais qui allait être le constructeur, et où le trouver
?
Un matin, l'infatigable Hubbard résout le problème.
« Watson », dit-il, « il y a un jeune homme à
Washington qui peut gérer cette situation, et je veux que tu
ailles voir ce que tu en penses. » Watson s'y rendit, fit un rapport
favorable et, environ un jour plus tard, le jeune homme reçut
une lettre de Hubbard lui offrant le poste de directeur général,
pour un salaire de trois mille cinq cents dollars par an.
« Nous comptons », dit Hubbard, « sur vos compétences
en gestion, votre fidélité et votre zèle indéfectible.
» Le jeune homme répondit par une de ces lettres solennelles,
plus courantes au XIXe siècle qu'au XXe. « Ma foi dans
le succès de l'entreprise est telle que je suis prêt à
lui faire confiance », écrivit-il, « et je suis convaincu
que nous établirons l'harmonie et la coopération essentielles
au succès d'une entreprise de ce genre. » Une semaine plus
tard, le jeune homme, Theodore N. Vail,
prit ses fonctions de directeur général dans un petit
bureau de Reade Street, à New York, et la construction de l'entreprise
commença.
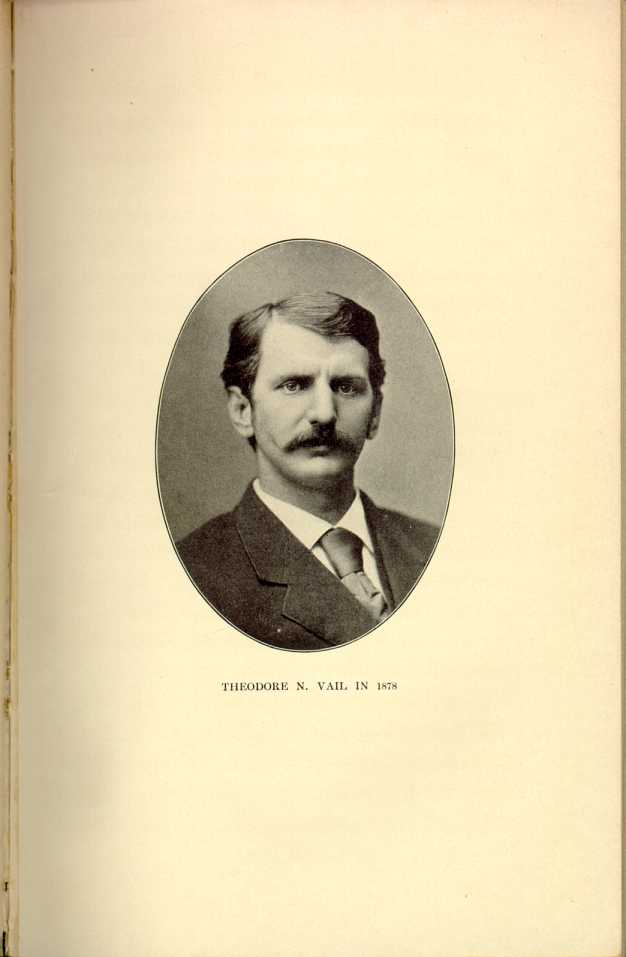 N.Vail
N.Vail
L'arrivée de Vail au moment critique soulignait que Bell
était l'un des inventeurs les plus chanceux. Il ne fut pas privé
de son invention, comme cela aurait pu facilement arriver. Un à
un, des hommes compétents arrivèrent pour l'aider, dotés
de toutes les compétences requises par l'évolution de
la situation. La concentration des facteurs était telle que toute
l'affaire semblait avoir été préparée à
l'avance. À peine Bell apparut-il sur scène que ses seconds
rôles, chacun à son tour, reçurent leur réplique
et prirent part à l'action. Aucun de ces hommes n'aurait pu faire
l'œuvre d'un autre. Chacun était unique et indispensable.
Bell inventa le téléphone ; Watson le construisit ; Sanders
le finança ; Hubbard le lança ; et Vail en fit une entreprise
commerciale.
Le nouveau directeur général n'avait,
bien sûr, aucune expérience du secteur téléphonique.
Personne d'autre non plus. Mais, comme Bell, il s'est acquitté
de sa tâche avec une aptitude des plus surprenantes. Il était
membre de la famille historique Vail de Morristown, dans le New Jersey,
qui exploitait la Speedwell Iron Works depuis quatre ou cinq générations.
Son grand-oncle Stephen avait construit les moteurs du Savannah, le
premier paquebot américain à traverser l'Atlantique ;
et son cousin Alfred était l'ami et le collaborateur de Morse,
l'inventeur du télégraphe. Morse avait vécu plusieurs
années dans la propriété familiale des Vail à
Morristown ; c'est là qu'il installa sa première ligne
télégraphique, un cercle de cinq kilomètres autour
de la Iron Works, en 1838. Lui et Alfred Vail expérimentèrent
côte à côte la fabrication du télégraphe,
et Vail finit par recevoir une fortune pour sa part du brevet Morse.
C'est ainsi que le jeune Théodore Vail apprit l'histoire dramatique
du Morse auprès de sa mère. Enfant, il jouait près
de la première ligne télégraphique et apprenait
à y insérer des messages. Son jouet préféré
était un petit télégraphe qu'il avait construit
lui-même. À vingt-deux ans, il partit vers l'Ouest, dans
le vague espoir de posséder une ferme prospère ; puis
il reprit la télégraphie et, quelques années plus
tard, il se retrouva au service postal de l'État à Washington.
En 1876, il était à la tête de ce département,
qu'il réorganisa entièrement. Il introduisit le système
des sacs dans les wagons postaux et combattit le gaspillage et la maladresse.
De ce fait, il était le seul homme aux États-Unis à
avoir une vision globale de tous les chemins de fer et télégraphes.
Il était donc bien plus apte que d'autres à développer
l'idée d'un système téléphonique national.
Au milieu de ce ménage administratif, il rencontra Hubbard, qui venait d'être nommé par le président Hayes à la tête d'une commission sur le transport du courrier. Hubbard et lui étaient constamment réunis, dans les trains comme à l'hôtel ; et comme Hubbard avait toujours deux téléphones dans sa valise, les deux hommes devinrent rapidement des passionnés. Vail se surprit à se représenter l'avenir du téléphone, et lorsqu'on lui proposa d'en devenir le directeur général, il était devenu si confiant que, comme il le dira plus tard, il « était prêt à quitter un emploi gouvernemental avec un petit salaire pour un emploi téléphonique sans salaire ».
Ainsi, tout comme Amos Kendall avait quitté la
Poste trente ans plus tôt pour fonder le télégraphe,
Theodore N. Vail quitta la Poste pour fonder le téléphone.
Il avait dirigé plus de trois mille cinq cents employés
des Postes et avait développé un système couvrant
toutes les zones habitées du pays. Son expérience était
donc extrêmement précieuse pour démêler les
méandres du téléphone. Ligne par ligne, il élabora
une méthode, une
politique, un système. Il introduisit une vision plus large du
secteur téléphonique et balaya toute tentative de vente.
Il persuada une demi-douzaine de ses amis de la Poste d'acheter des
actions, si bien qu'en moins de deux mois, la première «
Bell Telephone Company » fut créée, avec un capital
de 450 000 dollars et un parc de douze mille téléphones.
La première mesure prise par Vail fut naturellement
de renforcer les bases de cette petite entreprise et d'empêcher
la Western Union de l'effrayer et de la pousser à capituler.
Il envoya immédiatement une copie du brevet de Bell à
chaque agent, avec ordre de tenir bon face à toute opposition.
« Nous détenons les seuls brevets téléphoniques
originaux », écrivit-il ; « nous avons organisé
et lancé l'entreprise, et nous n'avons pas l'intention de la
laisser nous voler par une quelconque société. »
À un agent, qui brandissait la plume blanche, il écrivit
:
Vous avez une trop grande idée de la Western Union. Si elle était
concentrée dans votre ville, vous pourriez la craindre ; mais
elle n'y est représentée que par un seul homme, et il
a probablement bien plus à faire que de téléphoner.
Reconnaître que vous ne pouvez pas rivaliser avec son influence
alors que vous en faites votre métier n'est pas vraiment pertinent.
Une douzaine d'entreprises peuvent toutes se tourner vers la Western
Union, mais elles n'emporteront pas avec elles tous leurs amis. Je vous
conseille de poursuivre et de conserver votre avantage actuel. Nous
devons organiser des entreprises suffisamment dynamiques pour mener
la bataille, car il est tout simplement inutile de créer une
entreprise qui succombera à la première opposition qu'elle
rencontrera.
Ensuite, après avoir encouragé ses agents profondément alarmés, Vail entreprit d'élaborer une politique commerciale bien définie. Il durcit les contrats et les rendit valables pour cinq ans seulement. Il confina chaque agent à un seul endroit et se réserva le droit de relier une ville à une autre. Il créa un département chargé de collecter et de protéger toutes les nouvelles inventions concernant le téléphone. Il accepta de prendre une partie des redevances en actions, si une entreprise locale préférait payer ses dettes de cette manière. Et il prit des mesures pour standardiser tous les appareils téléphoniques en contrôlant les usines qui les fabriquaient.
Ces diverses mesures s'inscrivaient dans le plan de Vail visant à créer un réseau téléphonique national. Son idée maîtresse, dès le départ, n'était pas la simple location de téléphones, mais plutôt la création d'une société fédérale qui serait un partenaire permanent de l'ensemble du secteur téléphonique. Même à cette époque de petites choses, et au milieu de la confusion et des turbulences des pionniers, il élabora la politique générale qui prévaut aujourd'hui ; ce qui explique en grande partie le fait qu'il y ait aux États-Unis deux fois plus de téléphones que dans tous les autres pays réunis.
Vail arriva à peu près comme Blücher à la bataille de Waterloo : un peu en retard, mais à temps pour empêcher les forces téléphoniques d'être mises en déroute par la vieille garde de la Western Union. À peine installé à son poste de direction, la Western Union jeta la confusion dans toute l'armée Bell en lançant l'émetteur Edison. Edison, qui était alors bien lancé dans sa carrière de magicien, avait fabriqué un instrument d'une vivacité remarquable. Il était incontestablement supérieur aux téléphones alors en usage, et les locataires des téléphones Bell réclamaient d'une seule voix « un émetteur aussi performant que celui d'Edison ». Cela, bien sûr, ne pouvait pas se faire en un instant, et les cinq mois qui suivirent furent les jours les plus sombres de l'enfance du téléphone.
Comment concurrencer la Western Union, qui disposait d'un émetteur supérieur, d'une multitude d'agents, d'un réseau de fils, de quarante millions de capitaux et d'un droit de préemption sur tous les journaux, hôtels, chemins de fer et droits de passage ? Tel était le problème immédiat auquel le nouveau directeur général était confronté. Chaque progrès devait être défendu. Plusieurs de ses capitaines désertèrent, et il fut contraint de prendre le contrôle de leurs échanges non rentables. Il n'y avait guère de courrier qui ne lui apportât un message de découragement ou de défaite.
Afin de se concilier un public hostile, les tarifs téléphoniques avaient été partout trop bas. Hubbard avait fixé un prix de vingt dollars par an pour l'utilisation de deux téléphones sur une ligne privée ; et lorsque les centraux furent mis en service, le tarif dépassait rarement trois dollars par mois. Les abonnés étaient nombreux, principalement des fonctionnaires et des politiciens. À Saint-Louis, l'une des rares villes à pratiquer un prix raisonnable, les neuf dixièmes des commerçants refusèrent de s'abonner. À Boston, la première borne payante fonctionna trois mois avant de rapporter un dollar. Même en 1880, lors de la première Convention nationale du téléphone à Niagara Falls, l'un des délégués exprima très justement la situation générale en déclarant : « Nous étions tous dans une incertitude enthousiaste. Nous étions pleins d'espoir, mais, analysés, ces espoirs étaient bien vagues. Il n'y avait probablement pas une seule entreprise capable d'affirmer qu'elle gagnait un centime, ni même qu'elle espérait en gagner un. »
Surtout dans les grandes villes, où la Western Union avait le plus de pouvoir, la vie des pionniers du téléphone était jalonnée de difficultés et d'aventures. À Philadelphie, par exemple, un jeune homme déterminé, Thomas E. Cornish, fut attaqué comme s'il était soudainement devenu un ennemi public, alors qu'il entreprenait d'établir le premier service téléphonique. Aucun fonctionnaire ne lui accorda le permis de poser des fils. Ses ouvriers furent arrêtés. Les ouvriers de l'imprimerie et du télégraphe l'avertirent qu'il devait démissionner ou être expulsé. Lorsqu'il demanda de l'argent aux capitalistes, ceux-ci lui répondirent qu'il pouvait aussi bien louer des guimbardes que des téléphones. Finalement, il fut contraint de recourir à la stratégie là où les arguments avaient échoué. Il avait reçu un ordre du colonel Thomas Scott, qui voulait une ligne entre sa maison et son bureau. Le colonel Scott était président du Pennsylvania Railroad, et donc un homme du plus grand prestige de la ville. Aussi, dès que Cornish eut installé cette ligne, il laissa ses hommes travailler à poser d'autres lignes. Lorsque la police intervint, il leur montra la signature du colonel Scott et fut laissé tranquille. Il installa ainsi quinze lignes avant que le truc ne soit découvert ; et peu après, avec huit abonnés, il fonda le premier central de Philadelphie.
Comme on peut l’imaginer, de telles luttes n’ont pas rapporté beaucoup d’argent au trésor de la société mère ; et les lettres écrites par Sanders à cette époque prouvent que la situation était difficile.
Voici l’une des questions posées à
Hubbard par Sanders, surchargé de travail :
« Comment voulez-vous que je puisse honorer une traite de deux
cent soixante-quinze dollars sans un dollar en caisse, et avec une dette
de trente mille dollars qui nous guette ? » « Le salaire
de Vail est assez modeste », poursuivit-il dans une seconde lettre,
« mais je ne sais pas vraiment d'où il vient. Bradley est
terriblement déprimé et découragé. Williams
me harcèle pour de l'argent et mon crédit personnel ne
me le permettra pas. J'ai avancé deux mille dollars à
la Compagnie aujourd'hui, et Williams doit en recevoir trois mille de
plus ce mois-ci. Son jour de paie est arrivé et son capital ne
lui permettra plus de tenir le coup. Si Bradley baisse les bras, je
vous dévoilerai mon dernier plan désespéré.
»
Et si l'entreprise avait peu d'argent, son crédit était encore plus faible. Un jour, Vail avait commandé une petite quantité de marchandises à un marchand nommé Tillotson, du 15 Dey Street, à New York. Ce dernier répondit que les marchandises étaient prêtes, tout comme la facture, qui s'élevait à sept dollars. Par une étrange coïncidence, le magnifique bâtiment de la New York Telephone Company se dresse aujourd'hui à l'emplacement du magasin de Tillotson.
Mois après mois, la petite Bell Company vivait
au jour le jour. Aucun salaire n'était versé intégralement.
Souvent, pendant des semaines, il n'était pas payé du
tout. Dans le carnet de Watson, on trouve des notes concernant cette
période : « J'ai prêté cinquante cents à
Bell », « J'ai prêté vingt cents à Hubbard
», « J'ai acheté une bouteille de bière –
dommage qu'on ne puisse pas boire de bière tous les jours ».
Plus d'une fois, Hubbard aurait eu faim si Devonshire, l'unique employé,
n'avait pas partagé avec lui le contenu d'un seau à provisions.
Chacun des membres du petit groupe était assailli de railleries
et de tentations. On offrit à Watson dix mille dollars pour son
dixième de participation, et il hésita trois jours avant
de refuser.
Les compagnies ferroviaires proposèrent à Vail un salaire
plus élevé et plus sûr, s'il prenait en charge leur
entreprise postale. Quant à Sanders, sa folie fit couler beaucoup
d'encre à Haverhill. Un capitaliste de Haverhill, EJM Hale, l'arrêta
dans la rue et lui demanda : « N'avez-vous pas une bonne affaire
de cuir, Monsieur Sanders ? » « Oui », répondit
Sanders. « Eh bien », dit Hale, « vous feriez mieux
d'y penser et d'arrêter de jouer des instruments à vent.
»
Le banquier de Sanders, lui aussi, s'inquiéta un jour et lui
demanda de passer à la banque. « Monsieur Sanders »,
dit-il, « je vous serais reconnaissant de bien vouloir retirer
ce stock de téléphone de la banque et de me remettre à
la place votre billet de trente mille dollars. J'attends l'inspecteur
dans quelques jours, et je ne veux pas me faire prendre avec ce truc
en banque. »
Puis, au cœur de cette dépression, le pauvre Bell revint d'Angleterre, où lui et sa femme étaient partis en lune de miel, et annonça qu'il n'avait pas d'argent ; qu'il n'avait pas réussi à créer une entreprise de téléphonie en Angleterre ; et qu'il lui fallait mille dollars immédiatement pour régler ses dettes urgentes. Il était profondément découragé et malade. Alors qu'il était à l'hôpital général du Massachusetts, il écrivit un appel à l'aide à la petite entreprise en difficulté qui luttait désespérément pour protéger ses brevets. « Des milliers de téléphones sont désormais en service dans tout le pays », dit-il, « et pourtant je n'ai pas encore touché un centime de mon invention. Au contraire, mes recherches me coûtent largement cher, car la seule valeur de la profession que j'ai sacrifiée au cours de mes trois années de travail s'élève à douze mille dollars. »
Heureusement, arriva, presque dans le même courrier
que la lettre de Bell, une autre lettre d'un jeune Bostonien nommé
Francis Blake, annonçant la bonne
nouvelle : il avait inventé un émetteur aussi performant
que celui d'Edison et préférait le vendre contre des actions
plutôt que de l'argent comptant. Si jamais un homme se présentait
comme un ange de lumière, c'était bien Francis Blake.
La possession de son émetteur plaça instantanément
la Bell Company sur un pied d'égalité avec la Western
Union en matière d'appareils.
Cela encouragea les quelques capitalistes qui avaient investi et en
incita d'autres à se manifester. La situation générale
des affaires s'était alors stabilisée et, en quatre mois,
la compagnie comptait vingt-deux mille téléphones en service
et s'était réorganisée pour devenir la National
Bell Telephone Company, dotée d'un capital de
850 000 dollars et dont le colonel Forbes était le premier
président. Forbes reprit alors la charge si longtemps portée
par Sanders.
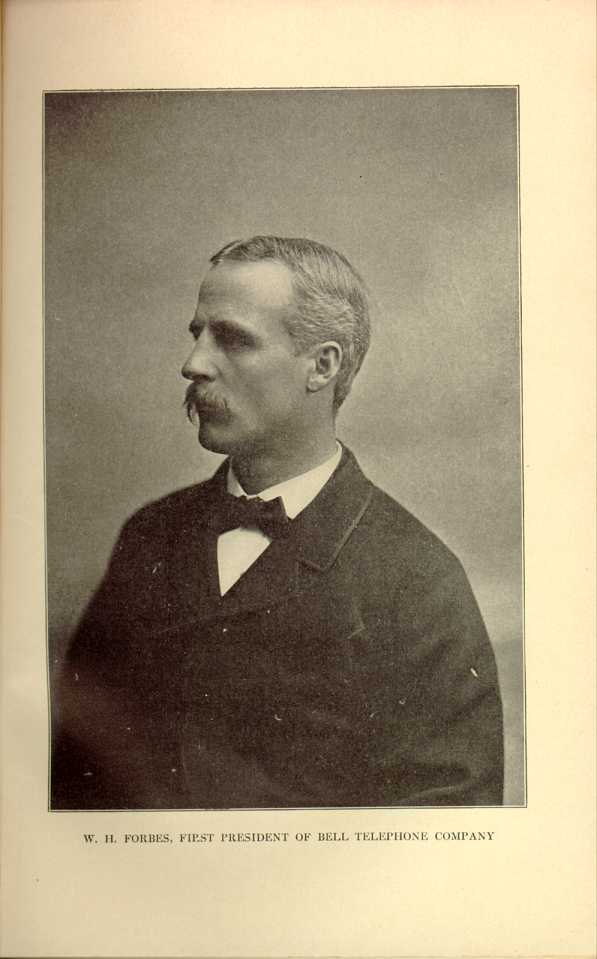 W. H. FORBES, PREMIER PRÉSIDENT DE LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE
BELL
W. H. FORBES, PREMIER PRÉSIDENT DE LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE
BELL
Fils d'un marchand des Indes orientales et gendre de
Ralph Waldo Emerson, il était Bostonien de caste brahmane. C'était
un homme imposant, à la fois populaire et efficace, et son leadership
dans cette crise fut d'une immense valeur.
Cette réorganisation plaça l'industrie du téléphone
entre les mains d'hommes d'affaires compétents à tous
les niveaux. Elle mit fin à la période héroïque
et expérimentale. Dès lors, le téléphone
comptait de solides alliés dans le monde financier. Il était
attaqué par la Western Union et par des inventeurs rivaux, jaloux
des prouesses de Bell. Il était à moitié privé
de ressources par des tarifs bas et paralysé par des appareils
maladroits. Il était malmené et critiqué par un
public impatient. Mais l'art de le fabriquer et de le commercialiser
avait enfin pris la forme d'une entreprise commerciale. C'était
désormais une entreprise, luttant pour sa survie.
LA TENUE DE L'ENTREPRISE
Pendant dix-sept mois, personne ne contesta la prétention
de Bell à être l'inventeur original du téléphone.
Tout l'honneur, quel qu'il soit, lui avait été accordé
librement, et personne ne s'avança pour dire qu'il ne lui revenait
pas de droit. Personne, à notre connaissance, n'en avait le désir
ardent. Personne n'imaginait que le téléphone ne serait
jamais qu'une bizarrerie scientifique. Il était si nouveau, si
inattendu, que, de Lord Kelvin jusqu'aux messagers des bureaux de télégraphe,
ce fut une surprise incompréhensible. Mais après que Bell
eut expliqué son invention lors de conférences publiques
devant plus de vingt mille personnes, après qu'elle eut été
exposée pendant des mois au Centenaire de Philadelphie, après
que plusieurs centaines d'articles furent parus dans les journaux et
les revues scientifiques, et après que des téléphones
eurent été vendus dans diverses régions du pays,
une telle succession de prétendants et de contrefacteurs commença
à apparaître que le public oublieux en vint à croire
que le téléphone, comme la plupart des inventions, était
le fruit de multiples réflexions.
Tout comme Morse, seul inventeur du télégraphe américain en 1837, fut confronté à soixante-deux rivaux en 1838, Bell, seul inventeur en 1876, se retrouva deux ans plus tard quasiment assailli par les « prétendants de Tichborne » du téléphone. Les inventeurs qui avaient été ses concurrents dans la tentative de produire un télégraphe musical se persuadèrent d'avoir inconsciemment fait autant que lui. Tout détenteur d'un brevet télégraphique ayant utilisé l'expression courante « fil parlant » avait la possibilité de construire une histoire plausible d'invention antérieure. D'autres présentèrent des revendications si vagues et insaisissables que Bell n'aurait guère été plus surpris si les héritiers de Goethe avaient exigé une part des redevances téléphoniques au motif que Faust avait parlé de « construire un pont dans l'air en mouvement ».
Ce tourbillon d'inventeurs et de prétendants stupéfia Bell et déconcerta ses bailleurs de fonds. Mais ce n'était rien de plus que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Il s'agissait d'un brevet – « le brevet le plus précieux jamais délivré » – et pourtant l'invention elle-même était si simple qu'elle pouvait être reproduite facilement par n'importe quel élève intelligent ou mécanicien ordinaire. Fabriquer un téléphone était comme le tour de Colomb de dresser un œuf debout. Rien n'était plus facile pour ceux qui savaient comment faire. Et c'est ainsi que, alors que le petit modèle rudimentaire du téléphone original de Bell se trouvait à l'Office des brevets, ouvert et sans protection, si ce n'est par quelques phrases que des avocats habiles pouvaient éluder, la guerre des brevets la plus coûteuse et la plus persistante qu'un pays ait jamais connue s'est déclenchée inévitablement, pendant onze ans et au cours de laquelle SIX CENTS PROCÈS.
La première attaque contre la jeune entreprise de téléphonie fut lancée par la Western Union Telegraph Company. Elle fonça tête baissée sur Bell, poussant trois inventeurs de front : Edison, Gray et Dolbear. Elle s'attendait à une victoire facile ; en réalité, la disparité entre les deux adversaires était si flagrante qu'il semblait peu probable qu'une compétition se produise. « La Western Union va engloutir les spécialistes du téléphone », déclarait l'opinion publique, « tout comme elle a déjà englouti toutes les avancées de la télégraphie. »
À cette époque, il faut le rappeler, la Western Union était la seule société d'envergure nationale. C'était la plus puissante compagnie d'électricité du monde et, comme Bell l'écrivait à ses parents, « probablement la plus grande entreprise ayant jamais existé ». Elle bénéficiait non seulement de quarante millions de dollars de capital, mais aussi du prestige des Vanderbilt et de la faveur des financiers du monde entier. De plus, elle s'inscrivait en tout point dans la lignée des pionniers du téléphone, car elle aussi était une compagnie de télégraphie. Elle possédait des droits de passage le long des routes et sur les toits des maisons. Elle avait le monopole des hôtels et des bureaux des compagnies ferroviaires. Où que Bell se tourne, le fil électrique de la Western Union se trouvait sur son chemin.
Dès le départ, la Western Union s'appuya davantage sur sa force que sur le bien-fondé de sa cause. Son principal expert en électricité, Frank L. Pope, avait passé six mois à examiner les brevets de Bell. Il avait acheté tous les livres aux États-Unis et en Europe susceptibles de faire référence à la transmission de la parole et avait engagé un professeur maîtrisant huit langues pour les traduire. Lui et ses hommes pillèrent bibliothèques et bureaux de brevets ; ils fouillèrent, fouillèrent, interrogèrent, et ne trouvèrent rien d'intéressant. Dans son rapport final à la Western Union, M. Pope annonça qu'il n'existait aucun autre moyen de fabriquer un téléphone que celui de Bell et recommanda l'achat des brevets de Bell. « Je suis absolument incapable de découvrir un appareil ou une méthode anticipant l'invention de Bell dans son ensemble », déclara-t-il ; « et je conclus que son brevet est valide. » Mais les dirigeants de la grande entreprise refusèrent de prendre ce rapport au sérieux. Ils le rejetèrent et chargèrent Edison, Gray et Dolbear de concevoir un téléphone susceptible de concurrencer celui de Bell.
Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, une période de concurrence féroce s'ouvrit, considérée comme l'âge des ténèbres du téléphone. La Western Union racheta plusieurs centraux Bell et lança une guerre acharnée contre les autres. Conforme à sa taille, elle revendiquait tout. Elle présenta Gray comme l'inventeur original du téléphone et ordonna à ses avocats d'engager immédiatement une action contre la Bell Company pour violation du brevet Gray. Cette action autoritaire, espérait-elle, ramènerait rapidement le petit groupe Bell à l'humilité et à la soumission. Chaque matin, la Western Union s'attendait à voir le drapeau blanc flotter au-dessus du siège social de Bell. Mais aucun drapeau blanc n'apparaissait. Au contraire, la nouvelle arriva que la Bell Company avait recruté deux éminents avocats et était prête à livrer bataille.
L'affaire débuta à l'automne 1878 et dura un an. Puis elle connut une fin soudaine et inattendue. L'avocat principal de la Western Union était George Gifford, peut-être le plus compétent des avocats en brevets de son époque. Il connaissait parfaitement le monde des brevets, de l'Alpha à l'Omega ; et au fil du procès, il acquit la conviction de la validité du brevet de Bell. Il informa la Western Union, confidentiellement, bien sûr, que sa thèse ne pouvait être prouvée et que « Bell était l'inventeur originel du téléphone ». La meilleure solution, suggéra-t-il, était de retirer leurs plaintes et de conclure un accord. Ce sage conseil fut suivi, et le lendemain, le drapeau blanc fut hissé, non pas par le petit groupe de combattants de Bell, regroupés dans un minuscule bureau de deux pièces, mais par la puissante Western Union elle-même, si arrogante au début de l'affrontement.
Un comité de trois représentants de chaque
camp fut nommé et, après des mois de discussions, un traité
de paix fut rédigé et signé. Aux termes de ce traité,
l'Union occidentale acceptait…
(1) Admettre que Bell était l’inventeur original.
(2) Admettre que ses brevets étaient valables.
(3) Se retirer du secteur du téléphone.
La Bell Company, en échange de cette reddition, accepta :
(1) Pour acheter le système téléphonique Western
Union.
(2) De payer à Western Union une redevance de vingt pour cent
sur toutes les locations de téléphone.
(3) Se tenir à l’écart du commerce du télégraphe.
Cet accord, qui devait rester en vigueur pendant dix-sept ans, fut un coup de maître diplomatique de la part de Bell Company. C'était la Magna Charta du téléphone. Il transforma un concurrent géant en ami. Il ajouta au système Bell cinquante-six mille téléphones dans cinquante-cinq villes. Et il propulsa la vaillante petite entreprise vers un tel sommet de prospérité que son action s'envola jusqu'à atteindre mille dollars l'action.
La Western Union avait perdu son procès, pour plusieurs raisons très simples : elle avait tenté d'exploiter un système téléphonique sur des lignes télégraphiques, un projet qui a toujours échoué ; elle avait une faible idée des possibilités offertes par le secteur du téléphone ; et ses agents, déjà très occupés, avaient peu de temps, de connaissances ou d'enthousiasme à consacrer à la nouvelle entreprise. Malgré toute sa puissance, elle s'est retrouvée dépassée par ce groupe compact d'hommes triés sur le volet, jeunes, zélés, bien dirigés et protégés par un brevet des plus invulnérables.
Le téléphone Bell prit alors sa place aux côtés du télégraphe, du chemin de fer, du bateau à vapeur, du Harvester et des autres nécessités d'un pays civilisé. Ses jours de pionnier étaient révolus. Finis le ridicule et l'incrédulité. Chacun savait que les gens de Bell avaient battu la Western Union et s'empressa de se joindre au grand Te Deum d'applaudissements. Cinq mois après la signature de l'accord, une réorganisation s'imposa ; et l'American Bell Telephone Company fut créée, avec un capital de six millions de dollars. L'année suivante, en 1881, douze cents nouvelles villes furent inscrites sur la carte téléphonique et les premiers dividendes furent versés : 178 500 dollars. Et en 1882, le téléphone connut un tel essor que le système Bell fut multiplié par deux, avec plus d'un million de dollars de bénéfices bruts.
À ce stade, tous les pionniers du téléphone,
à l'exception de Vail, disparaissent de l'histoire.
- Thomas Sanders vendit ses actions pour un peu moins d'un million de
dollars et en perdit bientôt la majeure partie dans une mine d'or
du Colorado. Sa mère, qui avait été une si bonne
amie de Bell, vit sa fortune doubler.
- Gardiner G. Hubbard se retira des affaires et, comme il était
impossible à un homme d'un tempérament aussi ardent de
rester oisif, il se lança dans la National Geographic Society.
- Le Colonel Sellers, il avait réalisé son rêve
de millions (pour le téléphone) ; à sa mort, en
1897, il était riche, tant financièrement que par l'affection
de ses amis.
- Charles Williams, dans l'atelier duquel furent fabriqués les
premiers téléphones, vendit son usine à la Bell
Company en 1881 pour une somme inestimable. Thomas
- A. Watson démissionna à la même époque,
se retrouvant non plus salarié, mais millionnaire. Plusieurs
années plus tard, il établit une usine de construction
navale près de Boston, qui se développa jusqu'à
employer quatre mille ouvriers et construire une demi-douzaine de navires
de guerre pour la marine américaine.
- Quant à Bell, premier instigateur de l'industrie du téléphone,
il fit ce qu'on aurait pu attendre d'un véritable bohémien
scientifique : il offrit tous ses biens à sa future épouse
le jour de leurs noces et reprit son activité d'instructeur pour
sourds-muets. Peu de rois, voire aucun, avaient offert un cadeau de
mariage aussi riche ; et personne, dans aucun pays, n'a jamais obtenu
et gaspillé une immense fortune aussi fortuitement que Bell.
Lorsque la Bell Company lui offrit un salaire de dix mille dollars par
an pour rester son principal inventeur, il refusa joyeusement, prétextant
qu'il ne pouvait pas « inventer sur commande ». En 1880,
le gouvernement français lui décerna le prix Volta de
cinquante mille francs et la Croix de la Légion d'honneur. Il
a reçu de nombreux honneurs depuis lors et a suscité de
nombreux intérêts. Il a été pendant trente
ans l'une des personnalités les plus brillantes et les plus pittoresques
de la vie publique américaine. Mais aucune de ses réalisations
ultérieures ne peut être comparée à ce qu'il
a accompli dans une cave de Salem, à vingt-huit ans.
Ils étaient tous devenus riches, ces premiers amis du téléphone, mais pas de façon fabuleuse. Personne, à cette époque, et il n'y en a plus eu depuis, n'était devenu multimillionnaire grâce à la vente de services téléphoniques. Si la Bell Company avait vendu ses actions au prix le plus élevé atteint en 1880, elle aurait reçu moins de neuf millions de dollars – une somme colossale, mais pas trop importante pour financer l'invention du téléphone et l'essor d'un art et d'une industrie nouveaux. C'était moins que la valeur des œufs pondus au cours des douze derniers mois par les poules de l'Iowa.
Mais, comme on peut l'imaginer, lorsque la nouvelle de l'accord Western Union fut connue, l'histoire du téléphone devint un conte de fées couronné de succès. Théodore Vail fut invité à un banquet par ses anciens amis de la poste de Washington, et on porta un toast à sa mémoire, le surnommant « le Monte-Cristo du Téléphone ». On disait que le coût réel de l'usine Bell ne représentait qu'un vingt-cinquième de son capital, et que chaque quatre cents d'investissement était ainsi devenu un dollar. Même Jay Gould, emporté par ces histoires au-delà de sa prudence habituelle, se précipita à New Haven pour racheter la compagnie de téléphone, pour découvrir plus tard que ses bénéfices étaient inférieurs à ses dépenses.
À la grande stupéfaction de la Bell Company, elle apprit bientôt que les difficultés de la richesse sont aussi nombreuses que celles de la pauvreté. Elle fut assaillie par une multitude de promoteurs et d'argueurs financiers, qui s'abattirent sur elle et sur le public comme une nuée de sauterelles depuis dix-sept ans. En trois ans, cent vingt-cinq sociétés concurrentes furent créées, défiant ouvertement les brevets de Bell. L'objectif principal de ces sociétés n'était pas, comme celui de la Western Union, de se lancer dans une activité téléphonique légale, mais de vendre des actions au public. La valeur nominale de leurs actions s'élevait à 225 000 000 $, bien que peu d'entre elles aient jamais envoyé de message. Une société d'une impertinence inhabituelle, sans argent ni brevets, avait capitalisé son audace à 15 000 000 $.
Comment préserver l'entreprise ainsi créée ? Tel était désormais le problème. Aucun des associés de Bell n'avait été de simples agioteurs. À un moment donné, ils s'étaient même engagés à ne vendre aucune de leurs actions à des tiers. Ils avaient financé leur entreprise de la manière la plus honnête et la plus simple ; et ils étaient farouchement opposés aux bandits financiers dont le but était de transformer le secteur de la téléphonie en une escroquerie et un jeu de hasard. Au début, après avoir tenu tête à la Western Union, ils espéraient faire une bouchée des agioteurs. Mais c'était un espoir vain. Ces sociétés fictives, constatèrent-ils, ne se battaient pas ouvertement, contrairement à la Western Union.
Toutes sortes de rumeurs néfastes circulèrent
alors au sujet du brevet Bell.
D'autres inventeurs – certains honnêtes hommes, d'autres
imposteurs éhontés – furent amenés à
raconter des histoires étrangement inventées d'inventions
antérieures. Le mouvement Granger était alors un acteur
politique majeur dans le Middle West, et sa peur aveugle des brevets
et des « monopoles » se retourna violemment contre la Bell
Company. Quelques sénateurs et capitalistes légitimes
furent érigés en figures de proue de la croisade. Et une
clameur retentissante s'éleva dans les journaux contre «
les taux élevés et les monopoles » afin de détourner
l'attention du public du véritable enjeu : les entreprises légitimes
face aux bulles spéculatives des sociétés par actions.
Parmi tous les inventeurs qui s'emparèrent des
lauriers de Bell, le plus crédible et le plus persistant fut
Elisha Gray. Il refusa de se soumettre à
la décision défavorable du tribunal. Plusieurs années
après sa défaite, il proposa de nouvelles armes et de
nouvelles méthodes d'attaque. Il devint plus hostile et irréconciliable
; et jusqu'à sa mort, en 1901, il ne renonça jamais à
sa prétention d'être l'inventeur du téléphone.
La raison de cette persévérance est évidente. Gray
était un inventeur professionnel, un homme hautement compétent
qui avait débuté sa carrière comme apprenti forgeron
et était devenu professeur à Oberlin. De son vivant, il
avait gagné plus de cinq millions de dollars grâce à
ses brevets.
En 1874, lui et Bell se livraient une course acharnée pour savoir
qui inventerait le premier un télégraphe musical –
quand, hop ! Bell, grâce à ses connaissances en acoustique,
changea brusquement de cap et inventa le téléphone, tandis
que Gray poursuivait sa route.
Comme tous ceux qui étaient en quête d'un meilleur instrument
télégraphique, Gray entrevoyait la possibilité
de transmettre la parole par fil et, par une coïncidence des plus
étranges, il déposa une réclamation à ce
sujet le JOUR MÊME où Bell déposait sa demande de
brevet. Bell était arrivé le premier. Comme l'indique
le registre, la cinquième inscription ce jour-là était
: « AG Bell, 15 $ » ; et la trente-neuvième inscription
était « E. Gray, 10 $ ».
Il y avait une grande différence entre la mise en garde de Gray et la demande de Bell. Une mise en garde est une déclaration selon laquelle l'auteur n'a rien inventé, mais croit être sur le point de le faire ; tandis qu'une DEMANDE est une déclaration selon laquelle l'auteur a déjà perfectionné l'invention. Mais Gray n'oublia jamais qu'il avait semblé, un temps, si proche du prix d'or ; et sept ans après avoir été écarté par l'accord de la Western Union, il réapparut avec des revendications plus vastes et plus précises.
Après avoir examiné toutes les preuves des différents procès Gray, il apparaît qu'il y avait trois Gray bien distincts : d'abord, Gray le MOQUEUR, qui examina le téléphone de Bell au Centenaire et déclara que ce n'était « rien d'autre que le télégraphe du vieil amant. Il est impossible de fabriquer un téléphone parlant fonctionnel selon le principe exposé par le professeur Bell… Les courants sont trop faibles » ; ensuite, Gray le CONVERTI, qui écrivit franchement à Bell en 1877 : « Je ne revendique pas le mérite de l'avoir inventé » ; et enfin, Gray le RÉCLAMANT, qui s'efforça de prouver en 1886 qu'il en était l'inventeur original. Sa véritable position dans cette affaire fut un jour décrite avec justesse et humour par son associé, Enos M. Barton, qui déclara : « De tous ceux qui n'ont PAS inventé le téléphone, Gray était le plus proche. »
Il est désormais évident que le téléphone
ne doit rien à Gray. Aucun téléphone Gray n'est
en service dans aucun pays. Gray lui-même, comme il l'a admis
devant le tribunal, a échoué lorsqu'il a tenté
de construire un téléphone selon les principes énoncés
dans son avertissement. Le dernier mot sur toute cette affaire a été
récemment prononcé par George C. Maynard, qui a fondé
l'entreprise de téléphonie à Washington. M. Maynard
a déclaré :
M. Gray était un ami intime et précieux, mais ce n'est
pas manquer de respect à sa mémoire que de dire qu'il
s'est trompé sur certains points de l'affaire du téléphone.
Aucun sujet n'a jamais été étudié aussi
minutieusement que l'invention du téléphone parlant. Aucun
brevet n'a jamais été soumis à des attaques aussi
acharnées de toutes parts que celui de Bell ; et aucun inventeur
n'a jamais été plus complètement disculpé.
Bell fut le premier inventeur, et Gray non.
Après Gray, le plus sérieux adversaire de Bell fut le professeur Amos E.Dolbear, du Tufts College. Comme Gray, il avait écrit une lettre d'applaudissements à Bell en 1877. « Je vous félicite, monsieur », dit-il, « pour votre formidable invention, et j'espère la voir supplanter tous les télégraphes existants, et que vous réussirez à obtenir la richesse et l'honneur qui vous sont dus. » Mais un an plus tard, Dolbear présenta un téléphone d'opposition. Il ne s'agissait pas d'une imitation de celui de Bell, insista-t-il, mais d'une amélioration d'un appareil électrique fabriqué par un Allemand du nom de Philip Reis en 1861.
C'est ainsi qu'apparut le « téléphone Reis », qui n'en était pas un, au sens pratique du terme, mais qui servit pendant neuf ans ou plus d'arme contre les brevets de Bell. Le pauvre Philip Reis lui-même, fils d'un boulanger de Francfort, en Allemagne, avait espéré fabriquer un téléphone, mais il avait échoué. Sa machine fonctionnait par un courant intermittent et ne pouvait donc pas transmettre les vibrations infiniment délicates de la voix humaine. Elle pouvait transmettre la hauteur d'un son, mais pas sa qualité. Au mieux, elle pouvait transmettre une mélodie, mais jamais une phrase prononcée. Reis, plus tard, comprit que sa machine ne pourrait jamais servir à la transmission de conversations ; dans une lettre à un ami, il parle d'un code de signaux qu'il a inventé.
Au cours de ses trois années d'expérimentation, Bell avait fabriqué une machine Reis, bien qu'à l'époque il n'en ait jamais vu. Mais il l'abandonna rapidement, la jugeant sans utilité pratique. Professeur d'acoustique, Bell savait que la seule exigence indispensable d'un téléphone est de transmettre la totalité d'un son, et pas seulement sa hauteur. Des scientifiques comme Lord Kelvin, Joseph Henry et Edison avaient vu le petit instrument Reis des années avant que Bell n'invente le téléphone ; mais ils le considéraient comme un simple jouet musical. « Ce n'était en aucun cas un téléphone parlant », déclara Lord Kelvin. Et Edison, tentant de présenter la machine Reis sous son meilleur jour, admit avec humour que lorsqu'il utilisait un émetteur Reis, il « savait généralement ce qui allait arriver ; et sachant ce qui allait arriver, même un émetteur Reis, purement et simplement, reproduit des sons qui ressemblent presque à ce qui était transmis ; mais lorsque l'interlocuteur ne savait pas ce qui allait arriver, il était très rare qu'il reconnaisse un mot. »
Au cours du procès Dolbear, une machine Reis
fut présentée au tribunal et suscita beaucoup d'hilarité.
Elle pouvait grincer, mais pas parler. Experts et professeurs se débattirent
avec elle en vain. Elle refusait de transmettre une seule phrase intelligible.
« Elle PEUT parler, mais elle NE LE FERA PAS », expliqua
l'un des avocats de Dolbear. Il est désormais généralement
reconnu que si une machine Reis, encrassée et hors service, transmettait
un mot ou deux de manière imparfaite, elle était construite
sur de mauvaises bases. Ce n'était pas plus un téléphone
qu'un chariot n'est un traîneau, même s'il est possible
d'enchaîner les roues et de les faire glisser sur trente ou soixante
centimètres. Le juge Lowell a déclaré, en rendant
sa célèbre décision :
Un siècle de Reis n'aurait jamais permis de produire un téléphone
parlant par une simple amélioration de la construction. Il incomba
à Bell de découvrir que l'échec était dû
non pas à la qualité de fabrication, mais au principe
adopté comme base de la démarche. […] Bell découvrit
un nouvel art : la transmission de la parole par l'électricité,
et sa prétention n'est pas aussi vaste que son invention. […]
Suivre Reis, c'est échouer ; mais suivre Bell, c'est réussir.
Après la victoire sur Dolbear, l'action Bell s'envola ; et plus elle montait, plus se multipliaient les contrevenants et les spéculateurs boursiers. Attirer la Bell Company devint presque un sport national. N'importe quel prétendant, avec la moindre histoire d'invention antérieure, pouvait trouver un spéculateur pour le soutenir. Ils arrivèrent, un groupe hétéroclite, « certains en haillons, d'autres sur des canots, d'autres encore en robes de velours ». L'un d'eux prétendit avoir fait des merveilles avec un cerceau de fer et une lime en 1867 ; un deuxième possédait une table merveilleuse aux pieds de verre ; un troisième jura avoir fabriqué un téléphone en 1860, mais n'en sut rien avant de voir le brevet de Bell ; et un quatrième raconta l'histoire saisissante d'avoir entendu un ouaouaron coasser grâce à un fil télégraphique tendu jusqu'à une cave de Racine, en 1851.
Cette période de comédie atteignit son paroxysme lors de la célèbre affaire Drawbaugh, qui dura près de quatre ans et remplit dix mille pages de preuves. Ayant échoué face à l'Allemand Reis, les adversaires de Bell invoquèrent alors un inventeur américain nommé Daniel Drawbaugh et lancèrent une campagne médiatique bruyante. Pour s'assurer la sympathie du public pour Drawbaugh, on prétendit qu'il avait inventé un téléphone et un standard téléphonique complets avant 1876, mais qu'il était dans une telle « pauvreté absolue » qu'il ne pouvait obtenir de brevet. Cinq cents témoins furent interrogés ; et un tel émoi général s'éleva que les avocats de Bell furent contraints de prendre l'attaque au sérieux et de riposter avec toutes les munitions dont ils disposaient.
Le fait est que Drawbaugh était mécanicien dans un village près de Harrisburg, en Pennsylvanie. Ingénieux, mais peu inventif, il aimait faire étalage de ses talents mécaniques devant les agriculteurs et les villageois. Abonné au Scientific American, il avait pris l'habitude de copier les inventions d'autrui et de les présenter comme les siennes. C'était un véritable inventeur. Plus de quarante exemples de cette habitude imitative furent présentés au procès, et il fut sévèrement critiqué par le juge, qui l'accusa d'avoir « délibérément falsifié les faits ». Sa passion dominante pour l'imitation ne fut apparemment pas atténuée par la perte de ses droits sur le téléphone, puisqu'il réapparut sur la scène publique en 1903 sous les traits d'un inventeur de Marconi.
La défaite de Drawbaugh fit grimper à nouveau l'action Bell et déclencha une armée d'opposants, dignes de Xerxès, qui se fit appeler « Overland Company ». Ayant appris qu'aucun plaignant ne pouvait battre Bell devant les tribunaux, cette société rassembla les perdants et se présenta avec une corbeille pleine de brevets. Plusieurs puissants capitalistes entreprirent de payer les frais de cette aventure. Des fils furent tendus ; des actions furent vendues ; et l'entreprise parut si sérieuse pendant un temps que lorsque les avocats de Bell demandèrent une injonction contre elle, leur demande fut refusée. Ce fut le coup le plus dur que les gens de Bell eurent reçu en onze ans de litige ; et l'action Bell dégringola de trente-cinq points en quelques jours. Les sociétés contrefaisantes surgirent comme des gourdes dans la nuit. Et tout se passa joyeusement pour les promoteurs jusqu'à ce que l'Overland Company soit expulsée du tribunal, faute de preuves, si ce n'est « les rebuts et la lie des affaires précédentes – les coups de talon trouvés dans les verres à la fin de la bagarre ».
Mais même après cette défaite des
plaignants, la bagarre n'était pas terminée. Ils projetèrent
ensuite d'obtenir par la politique ce qu'ils ne pouvaient obtenir par
la loi : ils incitèrent le gouvernement à intenter une
action en annulation des brevets de Bell. Ce fut une manœuvre audacieuse
et désespérée, qui permit aux promoteurs des sociétés
papetières de vendre des actions pendant plusieurs années
encore.
Le litige fut rouvert, de Gray à Drawbaugh. Chaque bataille fut
relancée ; et, bien sûr, les fonctionnaires du gouvernement
finirent par comprendre qu'on les utilisait pour tirer les marrons du
feu. L'affaire fut abandonnée de belle mort et fut officieusement
classée sans suite en 1896.
Au total, la Bell Company a mené treize procès
d'intérêt national, dont cinq ont été portés
devant la Cour suprême de Washington.
Elle a également mené cinq cent quatre-vingt-sept autres
procès de natures diverses ; et, à l'exception de deux
litiges contractuels mineurs, elle n'a JAMAIS PERDU UN PROCÈS.
Son expérience constitue une accusation irréfutable contre notre système de protection des inventeurs. Aucun inventeur n'a jamais eu un titre plus clair que Bell. En 1884, l'Office des brevets lui-même a mené une enquête de dix-huit mois sur tous les brevets téléphoniques et a déclaré : « C'est à Bell que le monde doit la possession du téléphone parlant. » Pourtant, son brevet était constamment sous le feu des critiques et n'a jamais été garanti. Des sociétés par actions, dont le capital papier totalisait plus de 500 000 000 $, ont été créées pour le détruire ; et, du début à la fin, le succès du téléphone reposait bien moins sur le monopole des brevets que sur la construction d'une entreprise bien organisée.
Heureusement pour Bell et ses hommes, ils étaient
défendus par deux juristes chevronnés, rarement, voire
jamais, n'ayant d'égal en termes de travail d'équipe et
d'efficacité : Chauncy Smith et James J. Storrow. Ces deux hommes
formaient une alliance merveilleuse. Smith était un avocat à
l'ancienne, digne, imposant et impressionnant, à la manière
de Webster. En 1878, lorsqu'il entra en fonction pour défendre
la petite Bell Company contre l'imposante Western Union, Smith était
devenu l'avocat en brevets le plus réputé de Boston.
C'était un homme corpulent et trapu, rappelant Benjamin Franklin,
avec son visage rasé de près, ses longs cheveux bouclés
aux pointes, sa redingote, son col montant et son chapeau de castor.
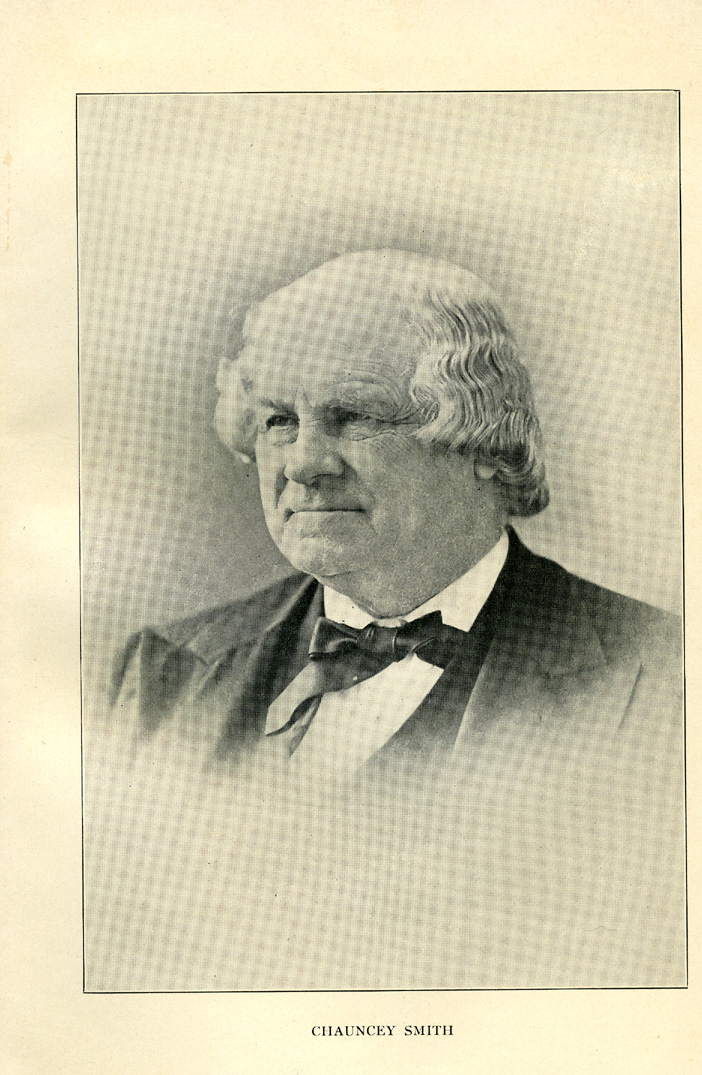 Smith
Smith 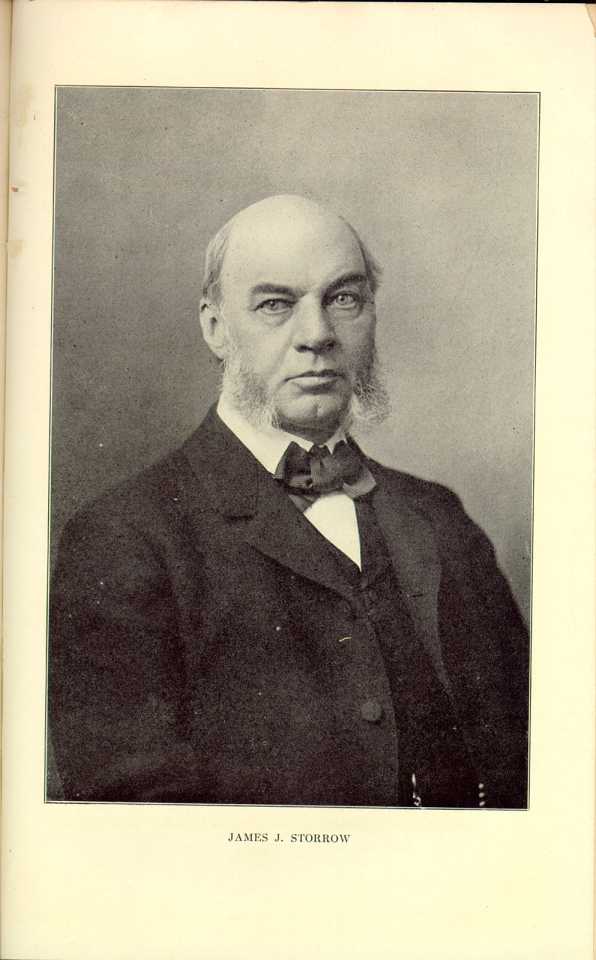 Storrow
Storrow 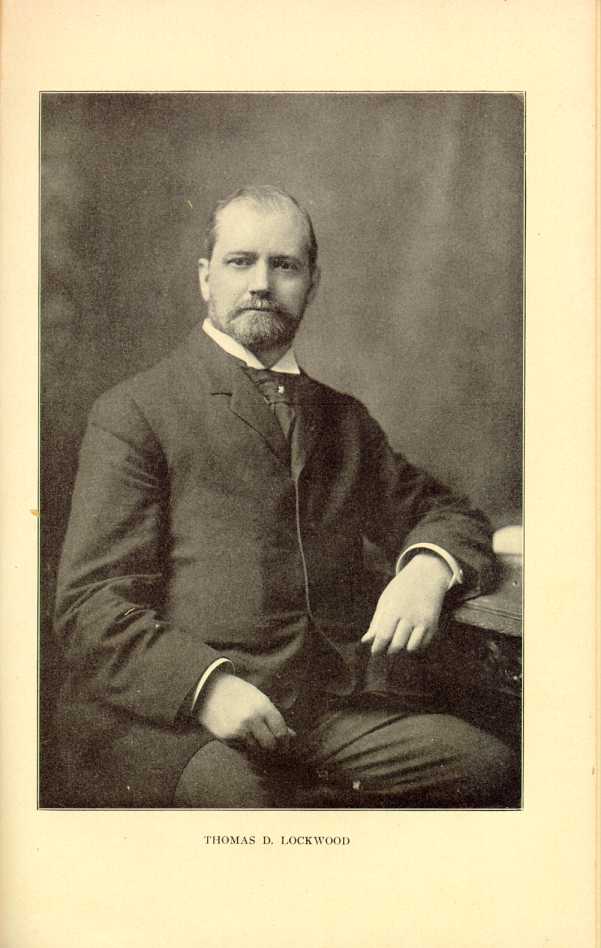 Lockwood,
Lockwood,
Storrow, au contraire, était un homme de petite
taille, calme, bavard et une véritable encyclopédie d'informations
précises. Il était si minutieux que, lorsqu'il devint
avocat chez Bell, il passa d'abord un été entier dans
sa maison de campagne de Petersham à étudier les lois
de la physique et de l'électricité. Il ne fut jamais le
moins du monde spectaculaire. Une seule fois, au cours des onze années
de procès, il perdit son sang-froid. Il attaqua la crédibilité
d'un témoin qu'il avait fait témoigner, mais qui avait
été manipulé par les avocats de la partie adverse.
« Mais cet homme est votre propre témoin », protestèrent
les avocats. « Oui », s'écria Storrow, habituellement
d'une voix douce ; « il était mon témoin, mais maintenant
c'est votre menteur. »
L'efficacité de ces deux hommes fut grandement accrue par un
troisième : Thomas D. Lockwood, choisi par Vail en 1879 pour
créer un département des brevets. Deux ans auparavant,
Lockwood avait assisté à une conférence de Bell
à Chickering Hall, dans l'État de New York, et était
un « Thomas incrédule ». Mais une étude plus
approfondie du téléphone le transforma en passionné.
Doté d'une mémoire aussi précise qu'un système
de classement et d'un don pour l'invention, Lockwood était tout
désigné pour créer un tel département. C'était
un homme né pour ce domaine. Et il a vu le nombre de brevets
électriques passer de quelques centaines en 1878 à quatre-vingt
mille en 1910.
Ces trois hommes étaient les défenseurs des brevets de Bell. Tandis que Vail développait la jeune entreprise de téléphonie, ils l'empêchèrent d'être démantelée dans une orgie de concurrence spéculative. Smith prépara le plan de défense complet. Grâce à sa sagacité et à son expérience, il put dégager les principes généraux sur lesquels Bell avait le droit de se défendre. Habituellement, il clôturait l'affaire, et il était extrêmement efficace lorsqu'il déclamait, d'une voix grave : « Je soutiens, Votre Honneur, que la littérature mondiale ne contient aucun passage expliquant comment la voix humaine peut être transmise électriquement, avant le brevet de M. Bell. » Sa mort, comme sa vie, fut dramatique. Il était debout dans la salle d'audience, luttant contre un contrefacteur, lorsqu'au milieu d'une sentence, il s'écroula, accablé par la maladie et les responsabilités qu'il avait assumées pendant douze ans. Storrow, d'une autre manière, était tout aussi indispensable que Smith. C'est lui qui construisit la superstructure de la défense de Bell. Il était maître du détail. Son esprit était vif et incisif ; et certaines de ses instructions seront étudiées aussi longtemps que l'art de la téléphonie existera. On aurait pu le comparer, en action, à une mitrailleuse Gatling à tir rapide ; Smith était un canon de cent tonnes, et Lockwood le fabricant des munitions.
Smith et Storrow avaient trois arguments principaux qui n'ont jamais été et ne pourront jamais être réfutés. Au moins cinquante des plus éminents avocats de l'époque ont tenté de les réfuter, sans succès. Le premier était le récit clair et direct de Bell sur sa méthode, qui a réprimandé et déconcerté la foule des prétendants. Le deuxième était le fait historique que les plus éminents électriciens d'Europe et d'Amérique avaient vu le téléphone de Bell lors du Centenaire et l'avaient déclaré NOUVEAU – « non seulement nouveau, mais merveilleux », a déclaré Tyndall. Et le troisième était le fait très significatif que personne n'a contesté la prétention de Bell à être l'inventeur original du téléphone avant que son brevet n'ait atteint dix-sept mois.
Le brevet lui-même était un document remarquable. C'était un véritable gibraltar de sécurité pour la Bell Company. Pendant onze ans, il fut attaqué de toutes parts, sans jamais être ébranlé. Il couvrait un art entier, et pourtant, il fut préservé tout au long de sa vie. Imprimé intégralement, il occuperait dix pages de ce livre ; mais son cœur réside dans la dernière phrase : « La méthode et l'appareil permettant de transmettre télégraphiquement des sons vocaux ou autres, en provoquant des ondulations électriques, de forme similaire aux vibrations de l'air accompagnant lesdits sons vocaux ou autres. » Ces mots exprimaient une idée inédite. Impossible de l'éluder ou de la surmonter. Il n'y avait que trente-deux mots, mais en six ans, ils représentaient un investissement d'un million de dollars chacun.
Maintenant que les clameurs de cette grande guerre des brevets se sont apaisées, il est évident que Bell n'a reçu ni plus de crédit ni plus de récompense qu'il ne le méritait. Le téléphone n'existait pas avant qu'il en fabrique un, et depuis, personne n'a trouvé d'autre solution. Des centaines d'hommes brillants tentent depuis plus de trente ans de surpasser Bell, et pourtant, tous les téléphones du monde sont toujours fabriqués selon le système découvert par Bell.
Aucun inventeur ayant précédé Bell n'a fait plus, dans l'invention du téléphone, que de l'aider indirectement, de la même manière que Fra Mauro et Toscanelli ont contribué à la découverte de l'Amérique en réalisant la carte et le plan qui ont été utilisés par Colomb. Bell a été aidé par son père, qui lui a enseigné les lois de l'acoustique ; par Helmholtz, qui lui a enseigné l'influence des aimants sur les vibrations sonores ; par Koenig et Leon Scott, qui lui ont enseigné l'infinie variété de ces vibrations ; par le Dr Clarence J. Blake, qui lui a donné une oreille humaine pour ses expériences ; et par Joseph Henry et Sir Charles Wheatstone, qui l'ont encouragé à persévérer. De manière encore plus indirecte, il a été aidé par l'invention du télégraphe par Morse ; par la découverte par Faraday du phénomène d'induction magnétique ; par le premier électro-aimant de Sturgeon ; et par la pile électrique de Volta. Tous les scientifiques avaient accompli, de Galilée et Newton à Franklin et Simon Newcomb, ont aidé Bell de manière générale, en créant une atmosphère et une habitude de pensée scientifiques. Mais lors de la conception du téléphone, personne n'était avec Bell ni avant lui. Il l'a inventé le premier, et seul.
sommaire
LE DÉVELOPPEMENT DE L'ART
Quatre entreprises utilisatrices de fils étaient déjà présentes à la naissance du téléphone : les services d’alarme incendie, d’alarme antivol, de télégraphe et de coursiers. Au début, comme on pouvait s’y attendre, le modeste petit téléphone était considéré comme un parent pauvre parmi ces entreprises. Pour le grand public, ce n’était qu’un simple jouet scientifique ; mais quelques hommes, peu nombreux, dans ces métiers de poseur de fils, y virent une lueur d’espoir de créer une entreprise de téléphonie. Ils installèrent des téléphones sur les fils alors en service. À mesure que ceux-ci devinrent populaires, ils en ajoutèrent d’autres. Chacun de leurs clients souhaitait pouvoir parler à tous les autres. Ainsi, après avoir entrepris de fournir un service téléphonique, ils se trouvèrent bientôt confrontés au problème d’ingénierie le plus complexe et le plus déroutant des temps modernes : la construction, autour du téléphone, d’un mécanisme qui lui permettrait d’accéder au service universel.
Le premier de ces hommes fut Thomas A. Watson, le jeune mécanicien engagé comme assistant par Bell. Il entreprit un travail qui requiert aujourd'hui une armée de vingt-six mille personnes. Il dirigea pendant deux ans l'ensemble du département d'ingénierie et de fabrication de l'entreprise téléphonique et, en 1880, avait déposé soixante brevets pour ses propres suggestions. C'est Watson qui prit le téléphone tel que Bell l'avait conçu, un véritable jouet, avec sa membrane si délicate qu'un souffle chaud la déréglait, et le transforma en une machine plus robuste. Bell avait utilisé un disque de peau de batteur d'or fragile, avec une plaque de tôle collée en son centre. Il ne put croire, un temps, qu'un disque tout en fer vibrerait sous la légère influence d'une parole. Mais lui et Watson remarquèrent que plus la plaque était grande, plus la communication était fluide, et ils abandonnèrent aussitôt la peau de batteur d'or et n'utilisèrent que le fer.
Watson passa également des mois à expérimenter avec des disques de fer de toutes sortes et de toutes tailles, afin de trouver celui qui transmettrait le mieux le son. Si le fer était trop épais, découvrit-il, la voix se transformait en un cri strident à la Punch-and-Judy ; et s'il était trop fin, la voix devenait un gémissement creux et sépulcral, comme si l'orateur avait la tête dans un tonneau. D'autres mois furent également consacrés à déterminer la taille et la forme appropriées de la cavité d'air devant le disque. Ainsi, une fois le téléphone perfectionné, EN PRINCIPE, il fallut une année entière pour le sortir de la catégorie des jouets scientifiques, et une ou deux années supplémentaires pour le présenter comme il se doit au monde des affaires.
Jusqu'en 1878, tous les appareils téléphoniques Bell étaient fabriqués par Watson dans la petite boutique de Charles Williams, rue Court, à Boston – un bâtiment depuis longtemps transformé en théâtre à cinq cents. Mais l'entreprise devint rapidement trop importante pour l'atelier. Les commandes accusèrent cinq semaines de retard. Les agents s'agitèrent et s'inquiétèrent. Il fallut agir rapidement ; des licences furent donc accordées à quatre autres fabricants pour la fabrication de sonnettes, de standards, etc. À cette époque, la Western Electric Company de Chicago avait commencé à fabriquer les téléphones Gray-Edison contrefaits pour la Western Union, si bien que six groupes de mécaniciens se mirent bientôt à se creuser la tête sur ce nouveau système de communication.
En 1880, la production d'appareils téléphoniques était abondante, mais avec une trop grande variété de modèles. Les robes d'été de cette année-là ne présentaient pas toutes autant de styles et de fantaisies. L'étape suivante, si l'on voulait parvenir à une certaine uniformité, consistait clairement à racheter et à regrouper ces six entreprises ; et en 1881, Vail l'avait fait. Il s'agissait de la première fusion de l'histoire du téléphone. C'était une étape d'une importance capitale. Sans elle, l'industrie du téléphone aurait été déchirée par les guerres civiles entre inventeurs rivaux.
Dès lors, la Western
Electric devint le siège de l'industrie téléphonique.
C'était le Grand Magasin, tous les chemins y menaient. Où
qu'une idée naisse, tôt ou tard, elle frappait à
la porte de la Western Electric pour y trouver une forme concrète.
C'est là que se trouvaient les ouvriers qualifiés qui
devinrent les artisans de l'industrie téléphonique. Et
c'est là aussi que se trouvaient nombre des inventeurs et ingénieurs
les plus talentueux, qui contribuèrent le plus au développement
des câbles et des standards téléphoniques d'aujourd'hui.
À Boston, Watson avait démissionné en 1882 et, un an ou deux plus tard, un nouvel arrivant, E.T. Gilliland, le remplaça. Cet homme remarquable était un ami du téléphone dans le besoin. Il avait été fabricant d'appareils électriques à Indianapolis, jusqu'à ce que la politique de consolidation de Vail le fasse entrer dans le groupe central des pionniers et des éclaireurs. Pendant cinq ans, Gilliland montra la voie en développant des équipements plus performants et moins coûteux. Il tira le meilleur parti d'une situation extrêmement difficile. Il était si habile, si ingénieux, qu'il trouvait invariablement le moyen de démêler les problèmes mécaniques qui embarrassaient les premiers agents téléphoniques, et ce, sans les obliger à investir des sommes importantes. Il s'empara des idées et des appareils alors existants et les utilisa pour faire traverser à l'industrie téléphonique la période la plus critique de son existence, où il y avait peu de temps et d'argent à risquer en expérimentations. Il prit par exemple le standard à chevilles du télégraphe et le développa jusqu'à son apogée, à un point que personne d'autre n'aurait pu imaginer. C'était le standard le plus pratique et le plus complet de son époque, et il résista à tous les concurrents jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le type de standard moderne, beaucoup plus élaboré et coûteux.
En 1884, autour de Gilliland à Boston et de la Western Electric à Chicago, se forma un groupe de mécaniciens et de bacheliers, de très jeunes hommes pour la plupart, dont la réputation n'était pas à déplorer. Ils se lancèrent, en partie pour gagner leur vie, mais surtout pour le plaisir, dans les difficultés de ce nouveau secteur, alors peu connu et encore moins prestigieux. Ces jeunes aventuriers, dont la plupart sont encore en vie, devinrent les artisans de l'histoire industrielle. Ils furent incontestablement les fondateurs de la science actuelle de la téléphonie.
Le problème qu'ils abordèrent avec tant
de légèreté était bien plus vaste qu'ils
ne l'imaginaient. C'était un véritable Gibraltar d'impossibilités.
C'était, à première vue, un cauchemar : tisser
un tel réseau de fils, avec des centres interconnectés,
capable de relier n'importe quel téléphone à tous
les autres. Ni les livres ni les universités ne leur apportaient
d'aide. Watson, qui avait acquis quelques connaissances, était
devenu constructeur naval. L'ingénierie électrique, en
tant que profession, n'était pas encore née. Quant à
leur expérience télégraphique, si elle les a certainement
aidés pendant un temps, elle les a lancés dans une mauvaise
direction et les a conduits à faire bien des choses qui ont dû
être annulées par la suite.
Le courant électrique particulier auquel ces jeunes pionniers ont dû faire face est peut-être la force la plus rapide, la plus faible et la plus insaisissable au monde. C'est une chose si étonnante que toute description paraît irrationnelle. Aussi doux qu'un léger rayon de soleil et aussi rapide qu'un éclair, il est si faible que le courant électrique d'une simple lampe à incandescence est 500 000 000 fois supérieur. Refroidissez une cuillerée d'eau chaude d'un seul degré, et l'énergie libérée par le refroidissement fera fonctionner un téléphone pendant dix mille ans. Attrapez la larme d'un enfant et vous aurez suffisamment d'énergie hydraulique pour transmettre un message vocal d'une ville à l'autre.
Tel était le minuscule Génie du Fil, qu'il fallait protéger et dresser à l'obéissance. C'était le plus vulnérable de tous les esprits électriques, et il avait tant d'ennemis. Des ennemis ! Le monde en était peuplé. Il y avait la foudre, son frère aîné, qui le frappait de coups meurtriers. Il y avait les courants télégraphiques et de lumière et d'énergie, ses cousins puissants et malveillants, qui le poursuivaient et l'assaillaient dès qu'il s'aventurait trop près. Il y avait la pluie, la neige fondue, et toutes sortes d'humidités, prêtes à l'enlever. Il y avait les rivières, les arbres et les particules de poussière. On aurait dit que toutes les forces de la nature, connues et inconnues, conspiraient pour contrecarrer ou anéantir ce gentil petit messager, invoqué par la magie d'Alexander Graham Bell.
Tout ce que ces jeunes gens avaient reçu de Bell
et Watson était cette partie du téléphone que nous
appelons le récepteur.
C'était pratiquement l'essentiel de l'invention de Bell, et elle
est restée telle qu'il l'a conçue aujourd'hui. C'était
alors, et c'est toujours, l'instrument le plus sensible jamais utilisé
en usage général, quel que soit le pays. Il ouvrait un
nouveau monde sonore. Il pouvait faire écho au pas d'une mouche
marchant sur une table, ou répéter à La Nouvelle-Orléans
le bavardage d'un enfant new-yorkais. Voilà ce que les jeunes
gens recevaient, et c'était tout. Il n'y avait aucun standard
téléphonique d'aucune importance, aucun câble de
valeur, aucun fil véritablement adéquat, aucune théorie
des tests ou des signaux, aucun central téléphonique,
AUCUN SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE QUEL QU'IL SOIT.
Quant aux premières lignes téléphoniques de Bell, elles étaient aussi simples que des cordes à linge. Chaque petit fil était indépendant, avec un appareil à chaque extrémité. Il n'y avait ni opératrices, ni standards, ni centraux. Mais le temps était venu où plus de deux personnes souhaitaient participer à une même conversation. C'était une utilisation plus large du téléphone ; et si Bell lui-même l'avait prévue, il n'avait pas encore élaboré de plan pour la mettre en œuvre. Voici le nouveau problème, et un problème des plus prodigieux : comment relier trois téléphones, ou trois cents, ou trois mille, ou trois millions, de manière à pouvoir en connecter deux au pied levé.
Et ce n'était pas tout. Ces jeunes hommes devaient non seulement lutter contre le mystère et les « pouvoirs de l'air » ; ils devaient non seulement protéger leur minuscule messager électrique et créer un système de câbles électriques sur lequel il pourrait circuler en toute sécurité ; ils devaient faire plus. Ils devaient rendre ce système si simple et infaillible que chacun – sauf les sourds-muets – puisse l'utiliser sans aucune expérience préalable. Ils devaient éduquer le Génie du Fil de Bell afin qu'il obéisse non seulement à ses maîtres, mais à quiconque – quiconque pouvait lui parler dans n'importe quelle langue.
Sans doute, si les jeunes gens s'étaient arrêtés pour considérer l'ensemble de leur vie et de leur œuvre, certains auraient-ils fait marche arrière. Mais ils n'avaient pas le temps de philosopher. Ils étaient comme le garçon qui apprend à nager en étant poussé dans l'eau profonde. Une fois l'industrie du téléphone lancée, il fallait la maintenir ; et à mesure qu'elle se développait, des congestions se succédaient. Deux solutions s'offraient à eux : soit il fallait maintenir l'activité pour l'adapter à l'appareil, soit il fallait développer l'appareil pour suivre le rythme de l'activité. Les téléphonistes, la plupart du moins, choisirent le développement ; et les brillantes inventions qui rendirent certains d'entre eux célèbres furent dictées par la nécessité et le désespoir.
La première amélioration notable apportée à l'invention de Bell fut la fabrication de l'émetteur, en 1877, par Émile Berliner. Ce fut également une histoire d'amour. Berliner, un jeune Allemand pauvre de dix-neuf ans, avait débarqué à Castle Garden en 1870 pour tenter sa chance. Il trouva un emploi de « sorte de laveur de bouteilles à six dollars par semaine », dit-il, dans un magasin de produits chimiques à New York. Le soir, il étudiait les sciences dans les cours gratuits de Cooper Union. Puis, un pharmacien nommé Engel lui offrit un exemplaire du livre de physique de Müller, ce qui fut précisément le stimulant dont son esprit créatif avait besoin. En 1876, fasciné par le téléphone, il entreprit d'en construire un selon un plan différent. Quelques mois plus tard, il réussit et fut ravi de recevoir son premier brevet pour un émetteur téléphonique. Il avait alors gravi les échelons du métier de laveur de bouteilles pour devenir commis dans une mercerie à Washington ; mais il était encore pauvre et aussi peu pratique que la plupart des inventeurs. Joseph Henry, le Sage du monde scientifique américain, était son ami, bien que trop âgé pour lui apporter la moindre aide. Par conséquent, lorsqu'Edison, deux semaines plus tard, inventa à son tour un émetteur, la prétention de Berliner fut un temps totalement ignorée. Plus tard, la Bell Company racheta le brevet de Berliner et prit sa défense. Il y eut une succession apparemment interminable de retards – quatorze années de retards extrêmement vexatoires – jusqu'à ce que la Cour suprême des États-Unis décide finalement que Berliner, et non Edison, était l'inventeur original de l'émetteur.
Du début à la fin, l'émetteur a
été le fruit de plusieurs réflexions. Son idée
de base est la variation du courant électrique par variation
de la pression entre deux points. Bell l'a incontestablement suggérée
dans son célèbre brevet, où il a décrit
« l'augmentation et la diminution de la résistance ».
Berliner fut le premier à en construire un. Edison l'améliora
considérablement en utilisant du carbone mou au lieu d'une pointe
en acier. Un professeur du Kentucky, David E. Hughes,
initia une nouvelle voie de développement en adaptant un téléphone
Bell en « microphone », un petit instrument fantastique
capable de détecter le bruit d'une mouche marchant sur une table.
Francis Blake, de Boston, transforma un microphone
en un émetteur pratique. Le révérend Henry Hunnings,
un pasteur anglais, eut l'idée heureuse d'utiliser du carbone
sous forme de petits granulés. Et l'un des experts de Bell, nommé
White, perfectionna l'émetteur Hunnings pour lui donner
sa forme actuelle (1910).
L'émetteur et le récepteur semblent désormais constituer
une langue et une oreille artificielles aussi complètes que l'ingéniosité
humaine peut les concevoir. Ils sont devenus de plus en plus élaborés,
jusqu'à ce qu'aujourd'hui un appareil téléphonique,
posé sur un bureau, contienne jusqu'à cent trente pièces
séparées, ainsi qu'une cuillerée de sel de granules
de carbone scintillants.
Après l'émetteur, vint le problème
des BRUITS MYSTÉRIELS.
C'était peut-être le plus étrange et le plus déroutant
de tous les problèmes téléphoniques. En réalité,
le téléphone avait rendu audible un nouveau monde sonore
merveilleux. À cette époque, tous les fils étaient
simples et pénétraient dans la terre à chaque extrémité,
créant ce qu'on appelait un « circuit de mise à
la terre ». Et cette connexion avec la terre, qui est en réalité
un puissant aimant, provoquait toutes sortes de bruits étranges
et insolites sur les fils téléphoniques.
Des bruits ! Jamais une oreille humaine n'avait entendu un tel brouhaha
de bruits insignifiants. Il y avait des crépitements et des bouillonnements,
des saccades et des grincements, des sifflements et des cris. Il y avait
le bruissement des feuilles, le coassement des grenouilles, le sifflement
de la vapeur et le battement d'ailes des oiseaux. Il y avait des clics
de fils télégraphiques, des bribes de conversation d'autres
téléphones, et d'étranges petits cris stridents
qui ne ressemblaient à aucun son connu. Les lignes est-ouest
étaient plus bruyantes que celles nord-sud. La nuit était
plus bruyante que le jour, et à l'heure fantomatique de minuit,
pour une raison étrange que personne ne connaît, la tourmente
battait son plein. Watson, à l'esprit fantasmagorique, suggéra
que ces sons étaient peut-être des signaux provenant des
habitants de Mars ou de quelque autre planète sociable. Mais
les jeunes téléphonistes, pragmatiques, s'accordèrent
à attribuer la faute à « l'induction » –
un mot vague qui désignait généralement l'ingérence
naturelle de l'électricité.
Quels que soient ces bruits mystérieux, ils étaient une véritable nuisance. La pauvre petite entreprise de téléphonie était harcelée, au point de perdre la raison. On aurait dit un chien avec une boîte de conserve attachée à la queue. Où qu'il aille, il était poursuivi par ce vacarme insolite. « Nous avions honte de présenter nos factures », a déclaré AA Adee, l'un des premiers agents ; « car même si un homme parlait clairement au téléphone, son langage avait tendance à ressembler au Choctaw à l'autre bout du fil. »
On essaya solennellement toutes sortes de dispositifs
pour faire taire les fils, et chacun se révéla généralement
aussi futile qu'une incantation. Que faire ? Pas à pas, les téléphonistes
furent repoussés. Ils furent battus. Il n'y avait aucun moyen
de faire taire ces bruits.
À contrecœur, ils convinrent que le seul moyen était
d'arracher les extrémités de chaque fil de la terre contaminée
et de les relier par un second fil. C'était l'idée du
« circuit métallique ». Cela signifiait
une augmentation effroyable de l'utilisation du fil. Cela obligerait
à reconstruire les standards et à inventer de nouveaux
systèmes de signalisation. Mais c'était inévitable
; et en 1883, alors que la polémique battait son plein, l'un
des jeunes hommes le fit discrètement entrer en service sur une
nouvelle ligne entre Boston et Providence. L'effet fut magique. «
Enfin », dit le directeur ravi, « nous avons une ligne parfaitement
silencieuse. »
Ce jeune homme, petit et mince, de vingt-deux ans et
paraissant plus jeune, n'était autre que J.J. Carty, désormais
le premier des ingénieurs en téléphonie et presque
le créateur de sa profession. Trois ans plus tôt, il avait
timidement demandé un emploi d'opérateur au central de
Boston, à cinq dollars par semaine, et avait montré une
telle aptitude pour ce travail qu'il en fut bientôt nommé
capitaine. À trente ans, il devint une figure centrale du développement
de l'art de la téléphonie.
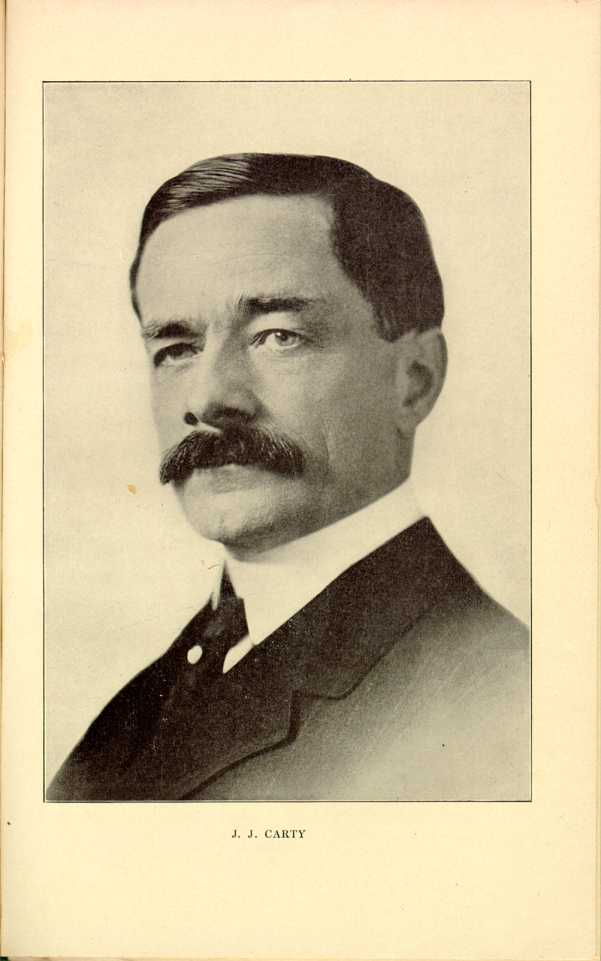 J.J.
Carty
J.J.
Carty
L'œuvre de Carty est connue des téléphonistes du
monde entier ; mais son histoire – qui il est et pourquoi –
est nouvelle. Tout d'abord, il est Irlandais, Irlandais pur sang. Son
père avait quitté l'Irlande enfant en 1825. Pendant la
guerre de Sécession, son père fabriquait des armes à
feu à Cambridge, où naquit le jeune John Joseph ; il fabriqua
ensuite des cloches pour les clochers des églises.
Mécanicien d'instinct, il était fier de son métier.
Il pouvait déterminer le poids d'une cloche à son son.
Moses G. Farmer, l'inventeur de l'électricité, et Howe,
le créateur de la machine à coudre, étaient ses
amis.
À cinq ans, le petit John J. Carty fut emmené par son
père à l'atelier où étaient fabriquées
les cloches. Il fut profondément impressionné par la force
magique d'un grand aimant, capable de soulever de lourds poids comme
des plumes. Au lycée, sa matière préférée
était la physique ; et pendant un temps, lui et un autre garçon
nommé Rolfe – devenu un homme de science distingué
– menèrent leurs propres expériences électriques
dans la cave de la maison Rolfe. Ils y possédaient un télégraphe
« Tom Pouce », un téléphone qu'ils avaient
tenté d'améliorer et un fouillis de fils électriques
inextricable. Dès qu'ils en avaient les moyens, ils se rendaient
dans un magasin voisin qui fournissait du matériel électrique
aux professeurs et aux étudiants de Harvard. Ce magasin, avec
son atelier à l'arrière, semblait aux deux garçons
un véritable paradis ; Et lorsque Carty, un jeune homme de dix-huit
ans, fut contraint de quitter l'école à cause de sa mauvaise
vue, il courut aussitôt chercher le poste prestigieux de garçon
à tout faire dans ce trésor de merveilles. Ainsi, lorsqu'il
devint opérateur au central téléphonique de Boston,
un an plus tard, il avait déjà développé
à un degré remarquable son génie naturel pour la
téléphonie.
Depuis lors, Carty et l'industrie du téléphone
ont évolué ensemble, toujours avec une certaine avance.
Aucun autre homme n'a abordé
l'appareil téléphonique à autant de niveaux. Il
a combattu les méthodes fragiles et maladroites, qui menaient
d'un problème à l'autre. Il a découvert comment
faire avec les fils ce que Dickens faisait avec les mots. « Faisons-le
bien, les gars, et nous ne ferons plus de mauvais rêves »,
telle a été sa devise. Et, couronnement de son œuvre,
il a tracé les contours de la profession d'ingénieur en
téléphonie selon les lignes les plus larges et les plus
complètes.
Chez Carty, l'ingénieur évolua vers l'éducateur.
Sa branche de l'American Telephone and Telegraph Company devint l'Université
du Téléphone. Étudiant par nature, il appréciait
particulièrement les écrits de Faraday, le précurseur,
de Tyndall, l'exégète, et de Spencer, le philosophe.
En 1890, il rassembla autour de lui un groupe restreint de diplômés
universitaires – il en compte aujourd'hui soixante dans son équipe
– afin de léguer au téléphone un corps d'ingénieurs
loyaux et efficaces.
Le problème suivant auquel étaient confrontés les jeunes gens du téléphone, dès qu'ils eurent échappé au vacarme des bruits mystérieux, était la nécessité de descendre les fils dans les rues de la ville et de les enterrer. Au début, ils les avaient tendus sur des poteaux et des toits. Ils l'avaient fait, non pas parce que c'était bon marché, mais parce que c'était la seule solution possible, pour autant que l'on sache à cette époque de maternelle. Un fil téléphonique exigeait une manipulation des plus délicates. L'enterrer, c'était l'étouffer, le rendre terne, voire totalement inutile. Mais maintenant que le nombre de fils était passé de centaines à des milliers, la méthode aérienne était dépassée. Certaines rues des grandes villes étaient devenues noires de fils. Les poteaux avaient atteint quinze mètres de haut, puis vingt, vingt-quatre, vingt-quatre. Finalement, la plus haute de toutes les lignes de poteaux fut construite le long de West Street, à New York. Chaque poteau était un imposant pin de Norvège, dont le sommet s'élevait à quatre-vingt-dix pieds au-dessus de la chaussée et portait trente traverses et trois cents fils.
Des poteaux, les fils débordèrent bientôt
jusqu'aux toits, jusqu'à recouvrir onze mille toits rien qu'à
New York. Ces toits devaient être entretenus, et leurs cheminées
étaient les ennemis mortels des fils de fer. Plus d'un fil, en
moins de deux ou trois ans, était réduit à l'état
de rouille. Comme si ces ennuis ne suffisaient pas, il y avait les tempêtes
hivernales, qui pouvaient anéantir les revenus d'une année
en une seule journée. Les tempêtes de neige fondue étaient
les pires. Les fils étaient alourdis par la glace, souvent un
kilo et demi de glace par mètre de fil. Ainsi, entre la neige
fondue, la corrosion, le coût des réparations de toiture
et le manque de place pour d'autres fils, les téléphonistes
se trouvaient entre le diable et le fond – entre l'urgente nécessité
d'enterrer leurs fils et l'inexorable constatation de leur ignorance.
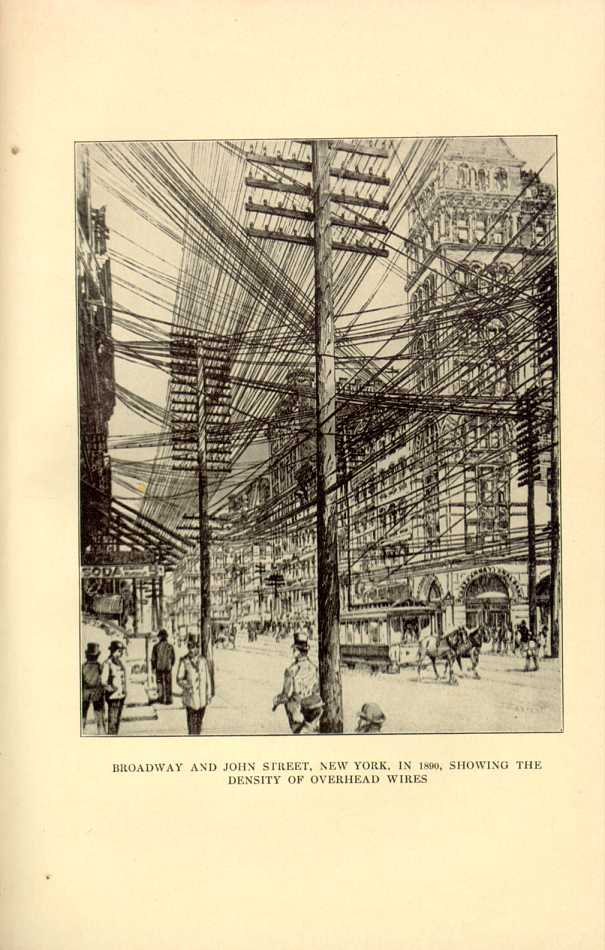
D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE PRISE ENTRE BROADWAY ET JOHN STREET,
NEW YORK, EN 1890, MONTRANT LA DENSITÉ DES FILS AÉRIENS
Heureusement, lorsque ce problème est survenu, l'industrie du téléphone était déjà bien établie. Elle avait dépassé ses débuts de moquerie et d'incrédulité. Elle versait des salaires, des traitements et même des dividendes. De toute évidence, elle était arrivée sur le marché juste à temps – après le télégraphe et avant les tramways et l'éclairage électrique. Dix ans plus tard, elle n'aurait peut-être pas survécu. Un appareil aussi fragile qu'un téléphone pour bébé aurait difficilement pu se protéger des puissants courants électriques qui se sont généralisés en 1886 s'il n'avait pas d'abord trouvé un moyen de se cacher sous terre.
La première déclaration en faveur d'un système souterrain fut faite par la société de Boston en 1880. « Il pourrait être opportun de placer l'ensemble de notre système sous terre », déclara le directeur, profondément perplexe, « dès qu'une méthode pratique sera trouvée pour y parvenir. » Toutes sortes de théories circulaient, mais Theodore N. Vail, qui était habituellement l'homme à l'imagination constructive en cas d'urgence, entreprit en 1882 une série d'expériences concrètes à Attleborough, dans le Massachusetts, afin de déterminer précisément ce qui pouvait et ce qui ne pouvait pas être fait avec des fils enfouis dans le sol.
Une tranchée de huit kilomètres fut creusée le long d'une voie ferrée. Le travail fut réalisé facilement et à moindre coût grâce à une méthode permettant d'économiser de la main-d'œuvre : l'attelage d'une locomotive à une charrue. Cinq charrues furent démontées avant la fin des travaux. Ensuite, des câbles furent posés dans cette tranchée, recouverts de toutes sortes de revêtements. La plupart, bien sûr, étaient enveloppés de caoutchouc ou de gutta-percha, à la manière d'un câble sous-marin. Une fois tout en place, la locomotive, prête à l'emploi, fut attelée à une énorme remorque en bois, qui rejetait la terre labourée dans la tranchée et recouvrait les câbles sur une profondeur de trente centimètres. C'était la pose de câbles la plus professionnelle que l'on puisse réaliser à l'époque, et elle réussit, sans être brillante, mais suffisamment pour encourager les ingénieurs du téléphone à poursuivre.
Quelques semaines plus tard, les deux premiers câbles réellement utilisés furent posés à Boston et Brooklyn ; et en 1883, l'ingénieur J.P. Davis s'attela à la tâche herculéenne de mettre en place un système souterrain complet dans la ville de New York, rongée par les câbles. Il y parvint malgré une avalanche d'explosions provoquées par des fuites de gaz, et un manque criant d'experts et de matériaux standards. Il fallut essayer toutes sortes de solutions de fortune pour remplacer les conduits en tuiles, inconnus en 1883. On utilisa d'abord des tuyaux en fer, puis de l'asphalte, du béton, des caisses de sable et du bois créosoté. Quant aux fils, ils étaient d'abord enveloppés de coton, puis torsadés en câbles, généralement de cent fils chacun. Et pour éviter la moindre trace d'humidité, source de mort subite du courant téléphonique, ces câbles étaient systématiquement imprégnés d'huile.
Ce type de câble rempli d'huile a assuré la pérennité de l'industrie téléphonique pendant six ans. Mais ce n'était pas le modèle définitif. Ce n'était qu'une version préliminaire, la meilleure qui ait pu être fabriquée à l'époque. Aucun n'est utilisé aujourd'hui. En 1888, Theodore Vail lança une deuxième série d'expériences pour voir s'il était possible de fabriquer un câble mieux adapté aux délicats courants électriques du téléphone. Un jeune ingénieur du nom de John A. Barrett, qui s'était déjà imposé comme expert en trouvant un moyen de tordre et de transposer les fils, fut chargé de s'attaquer à ce problème. Vermontois économe, Barrett alla travailler dans un petit hangar en bois au fond d'une fonderie de Brooklyn. Dans cette fonderie, il avait découvert une machine unique permettant de mouler du plomb chaud autour d'un câble de fils torsadés. Ce fut une découverte remarquable. Elle signifiait des COUVERTURES ÉTROITES. Elle signifiait une victoire sur le plus redoutable des ennemis : l'humidité. Cela signifiait également que les câbles pouvaient désormais être fabriqués plus longs, avec moins de manchons et d’épissures, et sans l’huile, qui avait toujours été une nuisance absolue.
Après avoir tendu le câble, Barrett entreprit de le produire à moindre coût et, par hasard, découvrit un moyen de le rendre immensément plus efficace. À l'époque, tous les fils étaient enveloppés de coton, et son projet était de trouver un matériau moins coûteux qui répondrait au même usage. Un de ses ouvriers, un Virginien, suggéra l'utilisation de ficelle de papier, utilisée dans le Sud pendant la guerre de Sécession, lorsque le coton était rare et cher. Barrett se mit aussitôt à la recherche de ficelle de papier dans le Sud et en trouva. Il en acheta un baril dans une petite usine de Richmond, mais après un essai, elle se révéla trop fragile. Si ce papier pouvait être posé à plat, se dit-il, il serait plus résistant. C'est alors qu'il entendit parler d'un génie fantaisiste qui avait inventé un ruban de papier enroulé sur du fil de fer à l'usage des modistes.
Du fil de capot enroulé de papier ! Qui aurait
pu imaginer un lien entre cela et le téléphone ? Pourtant,
cette astuce était exactement ce dont Barrett
avait besoin. Il expérimenta jusqu'à ce qu'il mette au
point une machine qui froissait le papier autour du fil, au lieu de
l'enrouler fermement. Ce fut la touche finale. Pendant un temps, ces
câbles enroulés de papier furent imprégnés
d'huile, mais en 1890, l'ingénieur F.A. Pickernell osa
se fier à l'étanchéité de la gaine de plomb
et posa un câble à âme sèche, le premier du
type moderne, dans une rue de Philadelphie. Ce câble fut l'événement
de l'année. Il était non seulement moins cher, mais aussi
le meilleur câble parlant jamais raccordé à un téléphone.
Ce que Barrett avait fait devint bientôt évident.
En enveloppant le fil de papier, il l'avait en réalité
rembourré d'AIR, le meilleur isolant possible. Ce n'était
pas le papier, mais l'air qu'il contenait qui avait amélioré
le câble. L'omission de l'huile ajoutait de l'air. Barrett comprit
alors qu'il avait simplement reproduit dans un câble, autant que
possible, les conditions des lignes aériennes, séparées
uniquement par de l'air.
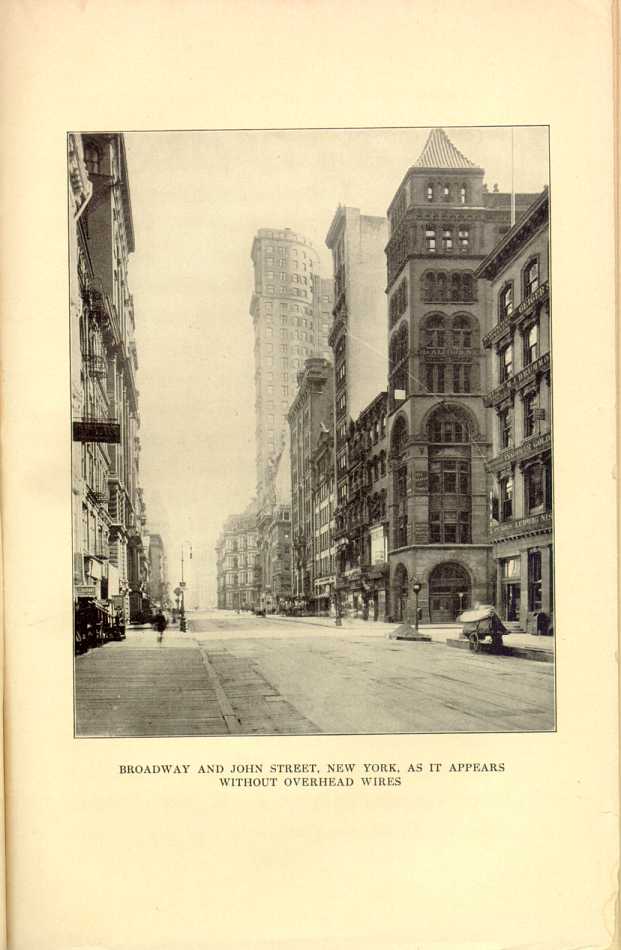 BROADWAY ET JOHN STREET,
NEW YORK, TEL QU'IL APPARAÎT SANS FILS AÉRIENS
BROADWAY ET JOHN STREET,
NEW YORK, TEL QU'IL APPARAÎT SANS FILS AÉRIENS
En 1896, on comptait trois cents mille kilomètres de fils soigneusement enveloppés de papier et déposés dans des cercueils de plomb sous les rues des villes. Aujourd'hui, les compagnies Bell affiliées en possèdent six millions. Au lieu de noircir les rues, les fils conducteurs du téléphone sont désormais invisibles sous la chaussée et s'enroulent dans les sous-sols des immeubles comme une nouvelle sorte de lierre métallique. Certains câbles sont si gros qu'une seule bobine pèse vingt-six tonnes et nécessite un camion géant et un attelage de seize chevaux pour la transporter jusqu'à son emplacement. Jusqu'à douze cents fils sont souvent regroupés dans une seule gaine, chaque câble reposant librement dans un petit conduit qui lui est propre. On y accède par des regards d'accès où il passe sous les rues et, dans de petits boîtiers de commutation disposés à intervalles réguliers, il est effiloché en paires de fils distinctes qui finissent par former des téléphones.
En pleine campagne, on trouve encore des fils électriques, qui sont les plus efficaces pour communiquer. Dans les banlieues, on trouve de jolis poteaux verts avec un seul câble gris suspendu à un fil épais. Un poteau téléphonique est généralement fabriqué à partir d'un arbre de soixante ans, cèdre, châtaignier ou genévrier. Sa durée de vie est de douze ans seulement, si bien qu'un seul poteau coûte encore plusieurs millions de dollars par an aux compagnies de téléphone. Aux États-Unis, le nombre total de poteaux utilisés par les compagnies de téléphone et de télégraphe couvrait autrefois, avant leur abattage, une superficie aussi grande que l'État de Rhode Island.
Mais le plus grand triomphe de la pose de câbles eut lieu lorsque New York entra dans l'ère des gratte-ciels, et que des centaines d'immeubles, aussi hauts que les chutes du Niagara, s'élevèrent telles une chaîne de falaises magiques sur le rocher précieux de Manhattan. Ici, le travail des ingénieurs en téléphonie fut si bien fait que, bien que chaque pièce de ces immeubles à flanc de falaise soit équipée de son téléphone, on ne voit ni poteau, ni traverse, ni fil. On ne distingue que les extrémités d'un immense système. À peine un nouveau gratte-ciel est-il construit, que les téléphones sont en place, reliant instantanément ses occupants au reste de la ville et à la majeure partie des États-Unis. Dans l'un de ces immeubles monstrueux, le Hudson Terminal, un câble relie le sous-sol au toit et s'étend jusqu'à trois mille bureaux. Ce puissant geyser de câbles pèse cinquante tonnes et, s'il était étiré en une seule ligne, relierait New York à Chicago. Pourtant, il est aussi invisible que les nerfs et les muscles du corps humain.
Au cours de cette évolution du câble, le fil lui-même fut repensé. Vail et d'autres avaient remarqué que, parmi toutes les variétés de fils disponibles sur le marché, aucune n'était parfaitement adaptée à un système téléphonique. Le premier fil téléphonique était en fer galvanisé, qui avait au moins l'avantage primitif d'être bon marché. Puis vint le fil d'acier, plus résistant mais moins durable. Mais ces fils étaient bruyants et ne conduisaient pas bien l'électricité. Ils découvrirent qu'un fil téléphonique idéal devait être en argent ou en cuivre. L'argent était hors de question, et le fil de cuivre était trop mou et fragile. Il ne pouvait pas supporter son propre poids.
Le problème était donc soit de rendre le fil d'acier plus conducteur, soit de produire un fil de cuivre suffisamment résistant. Vail opta pour la seconde solution et donna aussitôt l'ordre à un fabricant de Bridgeport de commencer les expériences. Un jeune expert nommé Thomas B. Doolittle se mit aussitôt au travail, et le premier fil de cuivre étiré, rendu résistant par un procédé assez simple, apparut. Vail en acheta trente livres et les dispersa dans différentes régions des États-Unis, afin d'observer l'effet des différents climats sur lui. On peut encore en voir un morceau dans la propriété Vail de Lyndonville, dans le Vermont. Ce fil étiré fut ensuite mis à rude épreuve en étant tendu entre Boston et New York. Cette ligne fut un brillant succès, et le nouveau fil fut salué avec grande joie comme le serviteur idéal du téléphone.
Depuis lors, le fil de cuivre n'a guère posé de problèmes, si ce n'est son prix. Il était quatre fois meilleur que le fil de fer, et quatre fois plus cher. Chaque kilomètre, doublé, pesait 90 kilos et coûtait trente dollars. Sur les longues lignes, où il devait être aussi épais qu'un crayon à papier, la dépense semblait ruineuse. Lorsque la première paire de fils fut tendue entre New York et Chicago, par exemple, on constata qu'elle pesait 400 000 kilos – la charge complète d'un train de marchandises de vingt-deux wagons ; et le coût du métal nu s'élevait à 130 000 dollars. Depuis lors, l'utilisation du fil de cuivre par les compagnies de téléphone a été si massive qu'un quart du capital investi dans le téléphone est allé aux propriétaires des mines de cuivre.
Pendant plusieurs années, les cerveaux des téléphonistes se sont concentrés sur ce problème : comment réduire les dépenses en cuivre. Un dispositif étrange, qui semblerait relever du simple fantasme d'un inventeur s'il n'avait pas déjà permis aux compagnies de téléphone d'économiser quatre millions de dollars ou plus, est connu sous le nom de « circuit fantôme ». Il permet de transmettre trois messages simultanément, là où seuls deux auparavant circulaient. Une double voie permet de transporter trois trains de conversation de front, un exploit rendu possible par la disposition capricieuse de l'électricité, et totalement inconcevable dans le domaine ferroviaire. Cette invention, qui se rapproche le plus jusqu'à présent de la téléphonie multiple, a été conçue par Jacobs en Angleterre et Carty aux États-Unis.
Mais c'est en persuadant les fils fins de fonctionner
aussi efficacement que les fils épais que l'on a économisé
le plus d'argent en cuivre – littéralement des dizaines
de millions de dollars. Cela a été réalisé
en fabriquant de meilleurs émetteurs, en isolant les fils plus
fins avec de l'émaille plutôt qu'avec de la soie, et en
plaçant des bobines d'une certaine nature à intervalles
réguliers sur les fils. L'invention de ce dernier dispositif
a surpris les téléphonistes comme un éclair. Elle
est venue de l'extérieur – du laboratoire silencieux d'un
professeur de Columbia, arrivé
aux États-Unis comme jeune immigrant hongrois quelques années
auparavant. De ce professeur, Michael J. Pupin, est née
l'idée de « charger » une ligne téléphonique
de manière à renforcer le courant électrique. Cela
permettait à un fil fin de transporter aussi loin qu'un fil épais,
et permettait ainsi d'économiser jusqu'à quarante dollars
par fil et par kilomètre. En récompense de son ingéniosité,
une pluie d'or s'abattit sur Pupin, le rendant instantanément
aussi riche qu'un grand-duc de son pays natal.
Installer les fils téléphoniques et les protéger contre d'innombrables dangers est aujourd'hui un métier hautement qualifié, qui fait vivre quinze mille familles. C'est le métier des chefs de fil et de leurs hommes, une troupe d'araignées humaines qui tissent sans cesse des fils sous les rues et au-dessus des champs verdoyants, dans le lit des rivières et sur les pentes des montagnes, les rassemblant en masse dans les villes et les étalant dans les fermes et les villages. Raconter les activités d'un chef de fil, au cours de sa semaine de travail ordinaire, constituerait à lui seul un livre d'aventures captivant. Même une blanchisseuse, avec un seul fil à linge non électrique de cent mètres à manipuler, a souvent bien des soucis. Mais les chefs de fil de Bell Phone ont en charge autant de fil qu'il en faudrait pour produire DEUX CENTS MILLIONS DE CORDES À LINGE – dix chacun pour chaque famille des États-Unis ; et ces lignes ne sont pas ponctuées de pinces à linge, mais d'instruments électriques des plus délicats.
Les chefs des lignes doivent détecter les problèmes sous mille et une formes. Un petit garçon a peut-être lancé un serpent sur les fils ou enfoncé un clou dans un câble. Un citoyen autonome a peut-être déplacé son téléphone d'une pièce à l'autre. Une pluie soudaine a-t-elle projeté son humidité fatale sur un joint non essuyé. Ou encore un câble sous-marin a-t-il été écrasé par le Lusitania. Mais quel que soit le problème, un système téléphonique ne peut être arrêté pour réparation. Il ne peut être récupéré et mis en cale sèche. Il doit être réparé ou amélioré par une sorte de vivisection pendant son fonctionnement. C'est une unité imbriquée, un être vivant et conscient, mi-humain, mi-machine ; et une blessure, en un seul endroit, peut provoquer douleur ou maladie dans tout son vaste corps.
Et tout comme les particules d'un corps humain changent tous les six ou sept ans, sans perturber le corps, de même les particules de nos systèmes téléphoniques ont changé à plusieurs reprises sans aucune interruption du trafic. Le flot constant de nouvelles inventions a nécessité plusieurs reconstructions complètes. Peu ou rien n'a jamais été laissé à l'usure. Le système de New York a été reconstruit trois fois en seize ans ; et plus d'un standard coûteux est parti à la casse à trois ou quatre ans. Entre réparations, inventions et nouvelles constructions, les différentes compagnies Bell ont dépensé au moins 425 millions de dollars au cours des dix premières années du XXe siècle, sans entraver un seul jour le torrent incessant de conversations électriques.
Le couronnement d'un système téléphonique actuel n'est pas tant le simple téléphone lui-même, ni le labyrinthe et le kilométrage de ses câbles, mais plutôt le merveilleux mécanisme du standard. C'est la partie qui restera toujours mystérieuse pour le public. On le voit rarement, et il demeure un mystère aussi grand pour ceux qui l'ont vu que pour ceux qui ne l'ont pas vu. Toute explication est vaine. On pourrait aussi bien espérer apprendre le sanscrit en une demi-heure que comprendre un standard en l'explorant. Il ne ressemble à rien de ce que l'homme ou la nature ont jamais créé. Il défie toute métaphore et toute comparaison. Il est impossible de le montrer par la photographie, ni même par le cinéma, car une grande partie de son contenu est dissimulée dans son boîtier en bois. Et rares sont ceux, voire aucun, qui sont initiés à ses mystères intérieurs, hormis ceux qui font partie de son propre cortège d'inventeurs et de serviteurs.
Un standard téléphonique est une pyramide
d'inventions. S'il est adulte, il peut comporter deux millions de pièces.
Il peut être éclairé par quinze mille minuscules
lampes électriques et alimenté par autant de fils que
la distance entre New York et Berlin. Son coût peut atteindre
mille pianos ou l'équivalent de trois miles carrés de
fermes dans l'Indiana. Les dix mille cheveux de sa tête sont non
seulement numérotés, mais enveloppés de soie et
peignés d'une manière si merveilleuse que chacun d'eux
peut être relié à un autre en un éclair.
Quelle coiffure ! Quelles bouffées, quelles tresses et quels
relais de boucles ! Quiconque veut apprendre le maximum de ce qui peut
être réalisé avec des cheveux cuivrés d'un
rouge Titien doit étudier la coiffure fantastique d'un standard
téléphonique.
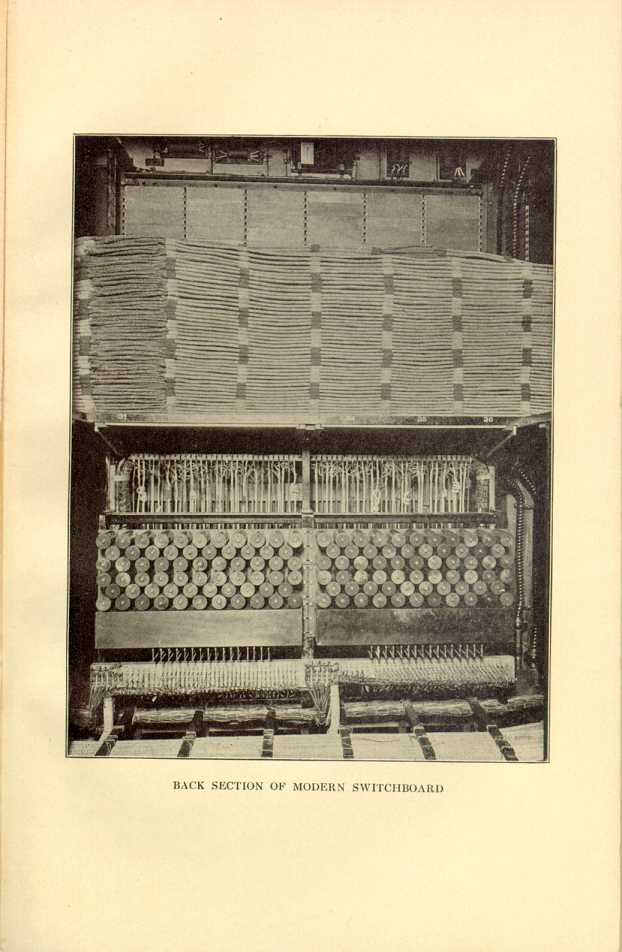 PARTIE ARRIÈRE DU TABLEAU DE COMMANDE MODERNE
PARTIE ARRIÈRE DU TABLEAU DE COMMANDE MODERNE
S'il n'y avait pas de standard téléphonique, il y aurait toujours des téléphones, mais pas de système téléphonique. Pour connecter cinq mille personnes par téléphone, il faut cinq mille fils, si ces fils aboutissent à un standard téléphonique ; or, sans standard, il faudrait 12 497 500 fils, soit 4,999 pour chaque téléphone. Il pourrait tout aussi bien y avoir un système nerveux sans cerveau qu'un système téléphonique sans standard téléphonique. S'il y avait eu initialement deux entreprises distinctes, l'une propriétaire du téléphone et l'autre du standard téléphonique, aucune n'aurait pu exploiter l'entreprise.
Plusieurs années avant que le téléphone ne soit doté de son propre standard téléphonique, il utilisait les tableaux conçus pour le télégraphe. Simples comme des brouettes, ils devinrent absurdement inadaptés dès que l'industrie téléphonique commença à se développer. Puis vinrent les adaptations à foison. Chaque responsable téléphonique devint inventeur par la force des choses. Il n'y avait aucune source d'information et chaque central faisait de son mieux. Des centaines de brevets furent déposés. Et en 1884, une idée assez précise de ce que devait être un standard téléphonique s'était imposée.
L'homme qui a le plus contribué à la création
du standard téléphonique, et qui en est un fervent adepte
depuis plus de trente ans, est un inventeur modeste et peu connu, toujours
vivant et actif, nommé Charles E. Scribner.
Sur les neuf mille brevets relatifs aux standards téléphoniques,
Scribner en détient au moins six cents. Depuis 1878, année
où il a inventé le premier « interrupteur jackknife
», Scribner est le génie du standard téléphonique.
C'est lui qui en a perçu le plus clairement les exigences. Des
centaines d'autres l'ont aidé, mais Scribner fut le seul à
persévérer, à ne jamais demander de facilité
et à devenir finalement le maître de son art.
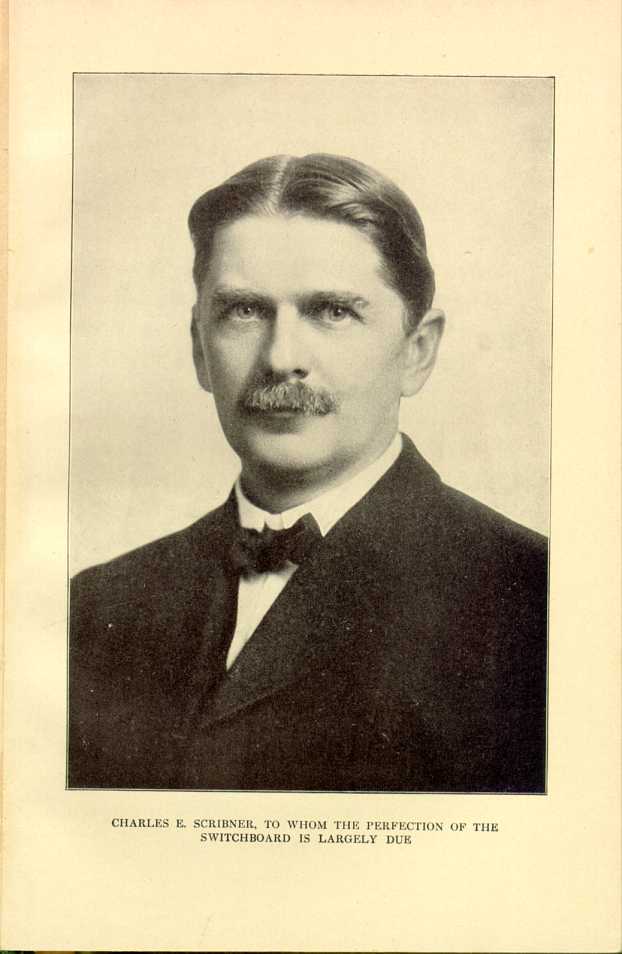
CHARLES E. SCRIBNER, À QUI LA PERFECTION DU STANDARD EST EN GRANDE
PARTIE DUE
Le génie particulier de Scribner s'explique peut-être
en grande partie par sa naissance en 1858, l'année de la pose
du câble transatlantique ; sa mère était alors profondément
intéressée par ce projet et soucieuse de son succès.
Son père était juge à Tolède ; mais le jeune
Scribner ne montrait aucune aptitude pour les méandres du droit.
Il préférait les enchevêtrements de fils et de systèmes
miniatures, que lui et plusieurs autres garçons avaient construits
et appris à utiliser. Ces garçons avaient un bienfaiteur
en la personne d'un vieux célibataire nommé Thomas Bond.
Il ne s'intéressait pas particulièrement à la télégraphie.
Il était marchand de peaux. Mais il fut séduit par l'intelligence
des garçons et leur donna de l'argent pour acheter davantage
de fils et de piles. Un jour, il remarqua une invention du jeune Scribner
: un répéteur télégraphique.
« Cela pourrait faire ta fortune », dit-il, « mais
aucun mécanicien de Toledo ne peut t'en fabriquer un modèle
correct. Tu dois aller à Chicago, où l'on fabrique des
appareils télégraphiques. » Le garçon suivit
volontiers son conseil et se rendit à l'usine Western Electric
de Chicago. C'est là qu'il rencontra par hasard Enos M. Barton,
le directeur de l'usine. Barton remarqua que le garçon était
un génie et lui offrit un emploi, qu'il accepta et qu'il occupe
depuis. Telle est l'histoire de l'entrée de Charles E. Scribner
dans l'industrie du téléphone, où il s'est révélé
quasiment indispensable.
Son œuvre monumentale a été le développement du standard téléphonique multiple, un problème bien plus complexe que la construction des pyramides ou le creusement du canal de Panama. Les premiers standards étaient devenus trop encombrants dès 1885. Ils étaient suffisants pour cinq cents fils, mais pas pour cinq mille. Dans certains centraux, il fallait jusqu'à une demi-douzaine d'opératrices pour traiter un seul appel ; le brouhaha et la confusion devenaient insupportables. Il fallut trouver un moyen plus pratique et plus silencieux, et c'est ainsi qu'est né le standard multiple. L'idée rudimentaire d'un tel système avait germé dans l'esprit d'un Chicagoan nommé L.B. Firman, en 1879 ; mais il devint agriculteur et abandonna son invention dès ses débuts.
Dans le tableau multiple, tel qu'il a été
développé par Scribner, les fils sortants sont dupliqués
afin d'être à la portée de chaque opératrice.
Un appel local peut ainsi être répondu immédiatement
par l'opératrice qui le reçoit ; et toute opératrice
débordée par une charge de travail soudaine peut être
aidée par ses collègues. Chaque fil entrant dans le tableau
est divisé en plusieurs extrémités, et grâce
à un « test d'activité », inventé par
Scribner, une seule de ces extrémités peut être
utilisée à la fois. La limite normale d'un tel tableau
est de dix mille fils, et le restera toujours, à moins qu'une
race de géantes aux longs bras n'apparaisse, capable d'atteindre
une plus grande étendue de tableau. Actuellement, une entreprise
de plus de dix mille lignes nécessite un deuxième central.
Le tableau multiple était extrêmement coûteux. Il devint de plus en plus sophistiqué jusqu'à coûter un tiers de million de dollars. Les téléphonistes se creusèrent la tête pour trouver un produit moins cher pour le remplacer, et ils échouèrent. Les tableaux multiples engloutirent des capitaux comme un désert engloutit de l'eau, mais ils gagnèrent dix secondes à chaque appel. C'était un argument irréfutable en leur faveur, et en 1887, vingt et un d'entre eux étaient en service.
Depuis lors, le standard téléphonique a subi trois ou quatre reconstructions. Il semblait n'y avoir aucune limite aux demandes du public ni à la créativité de Scribner. Des changements constants furent apportés au système de signalisation. Le premier signal, utilisé par Bell et Watson, consistait en une simple tape sur le diaphragme avec l'ongle. Peu après, un « buzzer » apparut, puis la sonnerie magnétoélectrique. En 1887, Joseph O'Connell, de Chicago, conçut l'utilisation de minuscules lumières électriques comme signaux, une idée brillante, car une lumière électrique ne fait aucun bruit et est visible de jour comme de nuit. En 1901, JJ Carty inventa la « sonnerie de pont », un moyen de relier quatre maisons à un seul fil, avec un signal différent pour chacune. Cette idée rendit possible la « ligne partagée » et créa immédiatement un essor de l'utilisation du téléphone par les agriculteurs entreprenants.
En 1896, les standards téléphoniques connurent une révolution. Tout fut repensé. Au lieu de piles individuelles, une pour chaque téléphone, une grande pile commune fut installée dans le central lui-même. Cela permit une meilleure signalisation et une meilleure communication. Le coût des piles fut réduit et leur gestion confiée à des experts. L'uniformisation fut instaurée. Le principe fédéral fut introduit dans le fonctionnement du système téléphonique. Mieux encore, il gagna quatre secondes sur chaque appel. Le premier de ces standards centralisés fut installé à Philadelphie ; d'autres villes suivirent l'exemple aussi vite qu'elles purent supporter les coûts de reconstruction. Depuis, des standards entièrement automatiques sont apparus. Rares sont ceux qui ont été mis en service, car un standard, comme le corps humain, doit être semi-automatique. Pour offrir un service optimal, un expert sera toujours nécessaire pour se mettre entre le standard et le public.
Le résultat final de toutes ces évolutions
des standards téléphoniques, des signaux et des batteries
est l'émergence du central téléphonique moderne.
C'est le plexus solaire du téléphone. C'est le point vital.
C'est le siège du standard. Ce n'est pas une invention, comme
le fut le téléphone. C'est un mécanisme en pleine
évolution, inachevé et qui ne le sera peut-être
jamais ; mais il a déjà suffisamment évolué
pour devenir l'une des merveilles du monde électrique. Il n'existe
probablement aucun autre élément de l'équipement
d'une ville américaine aussi sensible et efficace qu'un central
téléphonique.
L'idée du central téléphonique est un peu plus ancienne que celle du téléphone lui-même. Des centraux téléphoniques existaient avant l'invention du téléphone. Thomas B. Doolittle en possédait un à Bridgeport, utilisant des instruments télégraphiques. Thomas BA David en possédait un à Pittsburg, utilisant des machines télégraphiques à imprimer, dont l'utilisation demandait peu de compétences. Et William A. Childs en possédait un troisième, réservé aux avocats, à New York, qui utilisait d'abord des cadrans, puis des machines à imprimer. Ces petits centraux avaient pour vocation de réaliser le travail accompli aujourd'hui par le téléphone, et ils le faisaient tant bien que mal, de la manière la plus rudimentaire et la plus coûteuse. Ils ont contribué à préparer le terrain pour le téléphone, en constituant de petites circonscriptions qui étaient prêtes à l'accueillir dès son arrivée.
Bell lui-même fut peut-être le premier à entrevoir l'avenir du central téléphonique. Dans une lettre adressée à des capitalistes anglais en 1878, il déclarait : « Il est possible de relier chaque maison, bureau ou usine à une station centrale, afin de lui permettre de communiquer directement avec ses voisins. […] On peut concevoir que des câbles téléphoniques puissent être posés sous terre ou suspendus, reliés par des fils secondaires aux habitations, magasins, etc., et reliés par le câble principal à un central téléphonique. » Cette prophétie remarquable est aujourd'hui devenue obsolète, aussi obsolète que « L'Origine des espèces » de Darwin ou « La Richesse des nations » d'Adam Smith. Mais à l'époque où elle fut écrite, ce n'était qu'un rêve des plus fantaisistes.
Lorsque le premier central téléphonique naquit à Boston, en 1877, il était le fruit du travail d'une entreprise d'alarmes anti-intrusion dirigée par E.T. Holmes, un jeune homme dont le père avait lancé l'idée de protéger les biens par des fils électriques en 1858. Holmes fut le premier homme pragmatique à oser proposer des services téléphoniques. Il avait acquis deux téléphones, les numéros six et sept, les cinq premiers étant partis à la casse ; il les fixa à un fil dans son bureau d'alarmes anti-intrusion. Pendant deux semaines, ses amis d'affaires jouèrent avec les téléphones, comme des enfants avec un jouet fascinant ; puis Holmes cloua une nouvelle étagère dans son bureau et y plaça six téléphones à cabine alignés. Ceux-ci pouvaient être connectés aux fils de l'alarme et deux des six fils pouvaient être reliés par un fil. Rien de plus simple, mais c'était l'avènement d'une nouvelle idée dans le monde des affaires.
Le central Holmes se trouvait au dernier étage d'un petit immeuble, et dans presque toutes les autres villes, le premier central était situé le plus près possible du toit, en partie pour économiser le loyer et en partie parce que la plupart des fils étaient tendus sur les toits. De même que le téléphone lui-même était né dans une cave, le central était né dans un grenier. En général, chaque central était une ramification d'une autre entreprise utilisant des fils. C'était un assemblage de bric-à-brac. Presque chaque élément de son équipement avait été conçu pour d'autres usages. À Chicago, tous les appels arrivaient à un seul garçon, qui les hurlait aux opérateurs dans un micro. Dans une autre ville, un garçon recevait les appels, les inscrivait sur des feuilles blanches et les faisait rouler jusqu'aux standardistes. Il n'y avait pas de système de numérotation. Chacun était appelé par son nom. Même en 1880, alors que New York comptait mille cinq cents téléphones, les noms étaient encore utilisés. Et comme les premiers téléphones étaient utilisés à la fois comme émetteurs et comme récepteurs, une règle très importante était généralement affichée : « Ne parlez pas avec vos oreilles et n'écoutez pas avec votre bouche. »
Décrire l'un de ces premiers centraux téléphoniques dans le silence d'une page imprimée est une tâche absolument impossible. Seul un langage bruyant pouvait transmettre l'impression voulue. Un rédacteur en chef qui visita le central de Chicago en 1879 en dit : « Le vacarme est presque assourdissant. Les garçons se précipitent comme des fous, tandis que d'autres installent ou retirent des chevilles d'un cadre central comme s'ils étaient des fous engagés dans un jeu de renard et d'oie. » La même année, E.J. Hall écrivait depuis Buffalo que son central avec douze garçons était devenu « un véritable chaos ». Avec les méthodes maladroites de l'époque, il fallait de deux à six garçons pour traiter chaque appel. Et comme il y avait généralement une sorte de chamaillerie entre les garçons et le public, chacun criant à tue-tête, on peut imaginer qu'un central téléphonique était un endroit bruyant et frénétique.
Les garçons, en tant qu'opérateurs, se révélèrent être des échecs complets et constants. Leurs péchés d'omission et de commission rempliraient un livre. Entre le rognage des standards, les jurons contre les abonnés, les tours de passe-passe avec les fils et les rugissements en toute occasion comme de jeunes taureaux de Basan, les garçons des premiers centraux contribuèrent pleinement aux difficultés de l'entreprise. On ne pouvait rien faire avec eux. Ils étaient immunisés contre tous les systèmes de discipline. Comme les BRUITS MYSTÉRIELS, ils ne pouvaient être contrôlés et, d'un commun accord, ils furent abolis. À la place du garçon bruyant et tapageur vint la fille docile à la voix douce.
Si jamais l'afflux de femmes dans le monde des affaires
fut une bénédiction, ce fut lorsque les garçons
des centraux téléphoniques furent remplacés par
des filles. C'est là que se manifesta le plus l'influence de
la touche féminine. Une voix douce et aiguë, des doigts
adroits, une courtoisie patiente et une attention particulière
– ces qualités étaient précisément
celles que le téléphone exigeait de ses employés.
Les filles étaient plus faciles à former ; elles ne perdaient
pas de temps en conversations de représailles ; elles étaient
plus prudentes ; et elles étaient beaucoup plus susceptibles
de donner « la réponse douce qui apaise la colère
».

SECTION D'UN CENTRAL TÉLÉPHONIQUE TYPIQUE DE NEW YORK
Sous le régime des garçons, un appel téléphonique signifiait « Chahut » et cinq minutes ; sous le régime des filles, c'était le silence et vingt secondes. Au lieu de ce brouhaha incessant, un nouveau type d'échange apparut : un lieu calme et tendu, où plusieurs dizaines de jeunes femmes s'asseyaient et répondaient au langage des voyants du standard. De temps à autre, et rarement, les voyants lumineux clignotaient trop vite pour ces phonistes expertes. Pendant la panique de 1907, il y eut une heure de folie où presque tous les téléphones du quartier de Wall Street furent sonnés par un spéculateur désespéré. Les standards étaient illuminés. Quelques filles perdirent la tête. L'une d'elles s'évanouit et fut transportée aux toilettes. Mais les autres lancèrent des navettes de conversations volantes jusqu'à ce que, en un seul échange, quinze mille conversations aient été possibles en soixante minutes. Il y a toujours des filles en réserve pour de telles situations explosives, et lorsqu'on voit les mains d'une opératrice trembler et qu'elle présente une tache rouge sur chaque joue, on l'emmène et on lui accorde une pause jusqu'à ce qu'elle retrouve son calme.
Ces téléphonistes sont la partie humaine
d'une immense machine de communication. Elles tissent un réseau
de conversations qui se transforme
à chaque minute. Combien de combinaisons possibles avec les cinq
millions de téléphones du Bell System, ni quel kilométrage
incroyable de conversation, personne n'a jamais osé l'imaginer.
Mais quiconque a vu une fois la longue file de bras blancs s'agiter
devant les lumières du standard doit avoir l'impression d'avoir
vu le pouls même de la vie de la ville.
En 1902, la New York Telephone Company ouvrit une école, la première du genre au monde, pour l'éducation de ces filles du téléphone. Cette école est cachée au milieu des gratte-ciels, mais dix-sept mille filles la découvrent chaque année. C'est une école très particulière et exclusive. Elle accepte moins de deux mille de ces filles et en refuse plus de quinze mille. Pas plus d'une fille sur huit est à la hauteur de ses critères ; et elle refuse allègrement autant d'étudiantes par an que trois Yale ou Harvard.
Cette école est également unique en ce qu'elle est gratuite, verse cinq dollars par semaine à chaque élève et lui offre un emploi après l'obtention de son diplôme. Mais elle exige que chaque élève soit en bonne santé, vive d'esprit, s'exprime clairement et fasse preuve d'un certain équilibre et d'une certaine vivacité d'esprit. La présence d'esprit, qui, selon Herbert Spencer, devrait être enseignée dans toute université, est inculquée de diverses manières au tempérament de la téléphoniste. On lui apprend également le don de la concentration, afin qu'elle puisse mémoriser la situation du standard, comme un joueur d'échecs mémorise la disposition des pièces. Et elle est d'autant plus bienvenue dans cette étrange école si elle est jeune et n'a jamais exercé d'autres métiers, où la rapidité et la vigilance sont moins requises.
Peu importe les millions de dollars dépensés en câbles et standards téléphoniques, la qualité du service téléphonique dépend de la femme au bout du fil. C'est elle qui accueille le public à chaque étape. Elle est la réceptrice de tous les trains de conversation ; elle est la maîtresse des autoroutes du fil ; et on attend d'elle qu'elle livre instantanément à destination chaque passager. On exige d'elle plus que de tout autre serviteur du public. Ses clients refusent de faire la queue et d'attendre tranquillement leur tour, comme ils le font volontiers dans les magasins, les théâtres, les salons de coiffure, les gares et partout ailleurs. Ils ne la voient pas à l'œuvre et ignorent son travail. Ils ne remarquent pas qu'elle répond à un appel en moyenne trois secondes et demie. Ils sont pressés, sinon ils ne seraient pas au téléphone ; et chaque seconde dure une minute. Tout retard est une offense personnelle directe qui laisse une impression profonde dans leur esprit. Et ils ne sont pas enclins à se rappeler que la plupart des retards et des erreurs sont commis non pas par les filles expertes, mais par des personnes négligentes qui persistent à appeler de mauvais numéros et à ignorer les subtilités de l’étiquette téléphonique.
La vérité sur la téléphoniste américaine, c'est qu'elle est devenue si efficace que nous attendons désormais d'elle un modèle de perfection. Pour rendre justice à cette jeune femme, il faut reconnaître qu'elle a fait plus que quiconque pour introduire la courtoisie dans le monde des affaires. Elle a contribué à abolir la rudesse et la vulgarité d'antan. Elle a permis aux grandes entreprises de fonctionner plus harmonieusement que les petites entreprises il y a un demi-siècle. Elle nous a montré comment dénouer les frictions dans la conversation et nous a enseigné des raffinements de politesse qui étaient rares, même chez les Beau Brummel d'avant l'ère du téléphone. Qui, par exemple, avant l'arrivée de la téléphoniste, appréciait la différence entre « Qui êtes-vous ? » et « Qui est-ce ? » Ou qui d'autre nous a autant inculqué la valeur de l'intonation ascendante, comme une habitude de langage plus douce ? Cette propagande de la politesse est allée si loin qu'aujourd'hui, l'homme qui profère des grossièretés ou des injures au téléphone est exclu de son usage. Il est rejeté, car inapte à une communauté d'usagers du téléphone.
Et maintenant, pour que cette histoire du développement du téléphone ne soit pas décevante, il faut braquer les projecteurs sur cet immense ensemble d'ateliers où ont été fabriqués les trois cinquièmes des appareils téléphoniques du monde : la Western Electric. L'usine mère de cette entreprise globe-trotter est la plus grande du vaste arrière-cour de Chicago, et onze usines plus petites – ses enfants – sont disséminées sur toute la planète, de New York à Tokyo. Pour résumer, c'est une entreprise de 26 000 personnes et d'un chiffre d'affaires de 40 000 000 de dollars ; et les appareils téléphoniques qu'elle produit en une demi-journée valent cent mille dollars – soit dit en passant, autant que la Western Union a refusé de payer les brevets de Bell en 1877.
La Western Electric est née à Chicago, dans les cendres du grand incendie de 1871 ; elle a grandi jusqu'à sa grandeur actuelle tranquillement, sans fêter ses anniversaires. Au début, elle ne fabriquait pas de téléphones. Aucun n'avait encore été inventé ; elle fabriquait donc des appareils télégraphiques, des alarmes antivol, des stylos électriques et autres appareils similaires. Mais en 1878, lorsque la Western Union tenta, sans grand succès, de concurrencer la Bell Company, la Western Electric accepta de fabriquer ses téléphones. Trois ans plus tard, une fois cette brève période de concurrence terminée, la Western Electric fut reprise par les gens de Bell et demeure depuis lors le grand atelier du téléphone.
L'usine principale de Chicago n'a rien de particulièrement remarquable du point de vue de la production. On y trouve les inévitables scieries, fonderies et ateliers d'usinage. On y entend la folle valse des fuseaux qui font tournoyer les fils de soie et de coton autour des fils de cuivre, un spectacle très similaire à celui que l'on peut observer dans n'importe quelle fabrique de tresses. On y fabrique des lampes électriques, cinq mille par jour, comme partout ailleurs, sauf qu'elles sont si petites et si délicates qu'on les croirait conçues pour des palais de fées.
Les opérations réalisées avec le fil dans les usines de Western Electric sont trop nombreuses pour qu'un simple étranger puisse s'en souvenir. Certains fils sont enroulés de ruban adhésif à une vitesse de 14 000 kilomètres par jour. D'autres sont façonnés en formes fantastiques qui ressemblent à d'absurdes monstres marins, mais qui ne sont en réalité que les systèmes nerveux de tableaux de distribution. D'autres encore sont torsadés en câbles au moyen d'une douzaine de tambours tourbillonnants – un spectacle vertigineux, car chaque paire de tambours tourne en sens inverse. L'ennemi inévitable d'un câble étant l'humidité, chaque câble est enroulé sur une immense bobine et roulé dans un four jusqu'à ce qu'il soit aussi sec que de la cendre. Il est ensuite placé dans une camisole de force en plomb, scellée aux deux extrémités, et transporté dans un wagon de marchandises en attente.
Aucune autre entreprise n'utilise autant de fil et de caoutchouc dur, ni autant de tonnes de tiges de laiton, que Western Electric. Elle utilise également mille livres de platine, plus cher que l'or, pour la fabrication de ses transmetteurs téléphoniques. Ce métal est importé de l'Oural. Le fil de soie vient d'Italie et du Japon ; le fer pour les aimants, de Norvège ; le ruban adhésif, de Manille ; l'acajou, d'Amérique du Sud ; et le caoutchouc, du Brésil et de la vallée du Congo. Au moins sept pays doivent coopérer pour rendre possible la transmission d'un message téléphonique.
La caractéristique la plus extraordinaire des usines Western Electric est peut-être la multitude de ses inspecteurs. Aucune autre usine, pas même un chantier naval gouvernemental, n'en compte autant. Rien n'est trop petit pour échapper à ces limiers de l'inspection. Ils testent chaque minuscule disque de mica et en jettent neuf sur dix. Ils testent chaque téléphone par conversation réelle, installent chaque standard et testent chaque câble. Un seul émetteur, une fois terminé, a dû passer trois cents examens ; et une seule tirelire doit compter dix mille pièces de cinq cents avant d'être diffusée dans le monde extérieur. Sept cents inspecteurs montent la garde dans les deux principales usines de Chicago et de New York. C'est un nombre ruineux, du point de vue de la rentabilité ; mais le fait inexorable est que dans un système téléphonique, rien n'est insignifiant. Il est construit sur des principes si altruistes que la moindre atteinte à l'un de ses composants est l'affaire de tous.
Comme d'habitude, lorsque nous examinons l'histoire
d'une entreprise qui s'est développée et s'est répandue
sur la terre, nous trouvons un homme ; et la Western Electric ne fait
pas exception à la règle. Son homme, toujours en pleine
forme et actif après quarante ans de direction, s'appelle Enos
M. Barton. Sa carrière est typiquement américaine, celle
d'un homme d'entraide. Il fut messager télégraphique à
New York pendant la guerre de Sécession, puis opérateur
télégraphique à Cleveland. En 1869, son salaire
fut réduit de cent dollars par mois à quatre-vingt-dix
dollars ; il quitta alors l'entreprise et fonda la Western Electric
dans un petit atelier de mécanique miteux. Plus tard, il s'installa
à Chicago, prit Elisha Gray comme associé et développa
une activité de fabrication de matériel télégraphique.
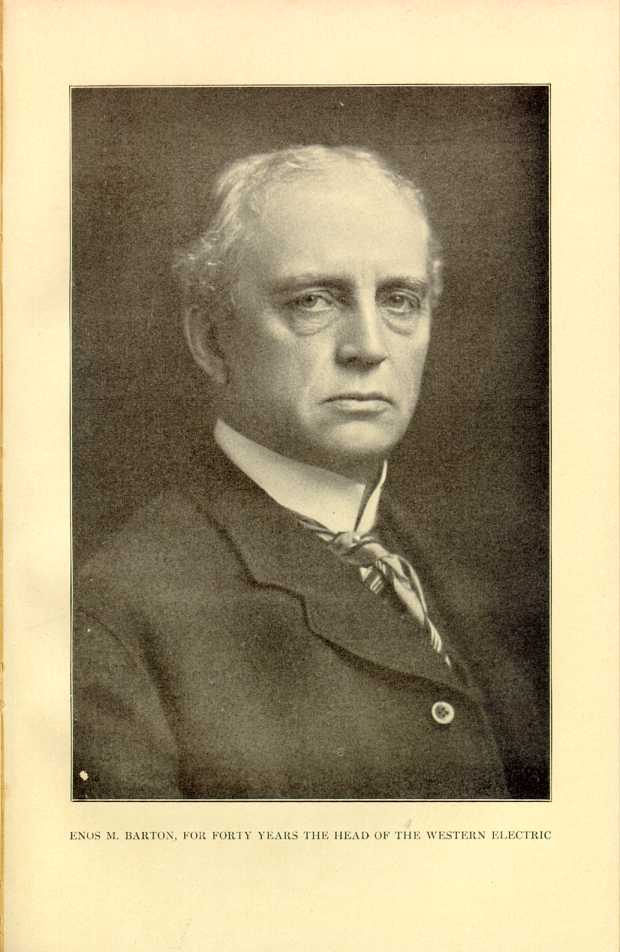
ENOS M. BARTON, PENDANT QUARANTE ANS À LA TÊTE DE LA WESTERN
ELECTRIC
Lors de l'invention du téléphone, Barton faisait partie des sceptiques. « Je me souviens bien de mon dégoût », disait-il, « lorsqu'on m'a annoncé qu'il était possible de transmettre des conversations par fil. » Quelques mois plus tard, il découvrit un téléphone et en devint aussitôt l'un des apôtres. En 1882, son usine était devenue l'atelier officiel des Bell Companies. C'était le siège de l'invention et de la fabrication. C'est là que se réunissait un groupe remarquable de jeunes hommes, brillants et aventureux, qui osaient miser leur avenir sur le succès du téléphone. Et toujours à leur tête se trouvait Barton, sorte de standard humain, qui les reliait tous et les tenait occupés.
En apparence, Enos M. Barton ressemble beaucoup à l'ancien président Eliot de Harvard. Il a la parole lente, les manières simples et une rare perspicacité en affaires. Il n'était pas un organisateur au sens moderne du terme. Sa politique consistait à choisir un homme, à le placer à un poste de responsabilité et à le juger sur ses résultats. Les ingénieurs pouvaient devenir comptables, et les comptables devenir ingénieurs. Un tel plan a bien fonctionné à l'époque, lorsque l'art de la téléphonie était encore en gestation et qu'il n'existait aucune source d'autorité sur les problèmes téléphoniques. Barton est aujourd'hui l'évêque émérite de la Western Electric ; et la grande industrie est désormais dirigée par un groupe de jeunes escrocs, avec HB Thayer à sa tête. Thayer est un Vermontois qui a gravi les échelons de l'expérience, des plus bas échelons aux plus hauts. C'est un Yankee typique : mince, rusé, infatigable et doté d'un sens de la justice implacable qui le rend apte à diriger vingt-six mille personnes.
Ainsi, comme nous l'avons vu, le téléphone tel que Bell l'a inventé n'était qu'un brillant début dans le développement de l'art de la téléphonie. Ce fut une naissance d'elfe – un esprit insaisissable et délicat qu'il fallait cultiver jusqu'à sa maturité. C'était comme une âme, pour laquelle il fallait créer un corps ; et personne ne savait comment fabriquer un tel corps. S'il était né dans un pays moins dynamique, il serait peut-être resté faible et sous-développé ; mais pas aux États-Unis. Ici, en un an, il était devenu célèbre, et en trois ans, il était devenu riche. Le brevet invincible de Bell fut bientôt étayé par des centaines d'autres. Une politique d'ouverture fut adoptée pour l'invention. Les changements se succédèrent à un tel point que les experts de 1880 seraient perdus aujourd'hui dans les méandres d'un central téléphonique.
En trente ans, l'art de l'ingénieur en téléphonie est passé des expériences les plus grossières et maladroites à une profession rigoureuse et complète. Comme l'a si bien dit Carty : « Au début, nous abordions invariablement chaque problème par le mauvais bout. Si on nous avait demandé de charger un troupeau de bovins sur un bateau à vapeur, notre méthode aurait consisté à engager un Hagenbeck pour dresser le bétail pendant deux ans, afin qu'il soit capable de monter à bord du navire dès qu'il donnerait le signal ; mais aujourd'hui, si nous devions expédier du bétail, nous serions capables de fabriquer une goulotte graissée et de le faire glisser à bord en un clin d'œil. »
Le monde de la téléphonie possède désormais ses propres normes et idéaux. Il possède son propre langage, un phonème incompréhensible pour les non-initiés. Il compte autant de disciplines distinctes que la médecine ou le droit. Rares sont les hommes, une demi-douzaine tout au plus, dont on peut aujourd'hui dire qu'ils possèdent une connaissance générale de la téléphonie. Et, aussi sage soit-il, un expert en téléphonie ne peut jamais atteindre la perfection, en raison de l'incroyable diversité des domaines qui touchent ou concernent sa profession.
« Personne ne connaît tous les détails aujourd'hui », a déclaré Theodore Vail. « Il y a quelques jours, je me promenais dans un central téléphonique et j'ai vu quelque chose de nouveau. J'ai demandé à M. Carty de m'expliquer. C'est notre ingénieur en chef, mais il n'a pas compris. Nous avons appelé le directeur. Il ne savait pas, et il a appelé son assistant. Il ne savait pas, et il a appelé l'ingénieur local, qui a pu nous expliquer ce que c'était. »
Pour résumer ce développement de l’art de la téléphonie – pour présenter une vue d’ensemble – on peut le diviser en quatre périodes :
1. Expérience. 1876 à 1886. C'était l'époque des inventions, sans experts ni autorités. Les appareils téléphoniques étaient composés de bricoles et d'adaptations. C'était l'époque du fil de fer, des émetteurs imparfaits, des circuits de mise à la terre, des opérateurs auxiliaires, des tableaux de distribution à piquets, des batteries locales et des lignes aériennes.
2. Développement. 1886 à 1896. Durant cette période, les amateurs deviennent ingénieurs. Le type d'appareil approprié est découvert et amélioré jusqu'à atteindre un haut niveau d'efficacité. C'est à cette époque qu'apparaissent le standard multiple, le fil de cuivre, les opératrices, les câbles souterrains, les circuits métalliques, la batterie commune et les lignes longue distance.
3. Expansion. De 1896 à 1906. C'était l'ère du grand commerce. C'était l'automne où les téléphonistes et le public commençaient à récolter les fruits de vingt années d'investissement et de travail acharné. C'était l'époque du tarif des messages, des postes de paiement, des lignes agricoles et des autocommutateurs privés.
4. Organisation. 1906–. Avec le succès de la bobine Pupin, le téléphone connut un essor considérable. Il devint moins local et plus national. Il commença à relier ses composantes dispersées. Il découragea le gaspillage et l'anarchie liés aux doublons. Il apprit à son aîné, mais plus petit frère, le télégraphe, à coopérer. Il se rapprocha plus étroitement de la volonté du public. Et il progresse aujourd'hui, sur les deux voies de la standardisation et de l'efficacité, vers son idéal d'un système téléphonique universel pour toute la nation. Le maître-mot du développement téléphonique actuel est celui-ci : l'organisation
L'EXPANSION DE L'ENTREPRISE
L'industrie du téléphone n'a véritablement commencé à se développer et à s'étendre à l'échelle mondiale qu'en 1896, mais c'est Théodore Vail qui a donné le ton dès ses débuts, alors que le téléphone était encore un bébé. En 1879, Vail écrivait dans une lettre à l'un de ses capitaines :
« Dites à nos agents que nous avons une proposition pour relier les différentes villes à des fins de communication personnelle et pour organiser par d’autres moyens un GRAND SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE. »
C'était un discours courageux à l'époque, où il n'y avait pas autant de téléphones dans le monde qu'aujourd'hui à Cincinnati. C'était un discours courageux à l'époque des fils de fer, des standards téléphoniques à chevilles et des diaphragmes bruyants. La plupart des téléphonistes ne considéraient cela que comme du bavardage. Ils ne voyaient aucun avenir commercial au téléphone, sauf dans les services à courte distance. Mais Vail était sérieux. Son expérience antérieure à la tête du service postal ferroviaire l'avait élevé à un point de vue plus élevé. Il savait la nécessité d'un système de communication national plus rapide et plus direct que le télégraphe ou la poste.
« J'ai compris que si le téléphone pouvait parler un mile aujourd'hui, disait-il, il parlerait à cent miles demain. » Et il persistait, malgré les moqueries, à affirmer que le téléphone était destiné à relier les villes et les nations aussi bien que les individus.
Quatre mois après avoir prophétisé le « grand système téléphonique », il encouragea Charles J. Glidden, célèbre pour ses tournées mondiales, à construire une ligne téléphonique entre Boston et Lowell. Ce fut la première ligne interurbaine. Elle était bien placée, car les propriétaires des usines de Lowell résidaient à Boston, et elle réalisa un léger bénéfice dès le départ. Ce succès encouragea Vail à réaliser un exploit. Il résolut de construire une ligne entre Boston et Providence, et il y fut si obstiné que, face au refus de la Bell Company, il prit le risque et se lança seul. Il organisa une société d'habitants bien connus du Rhode Island – surnommée la « Compagnie des Gouverneurs » – et construisit la ligne. Ce fut un échec au début, et elle fut surnommée « La Folie de Vail ». Mais l'ingénieur Carty, par une heureuse pensée, DOUBLA LE FIL, établissant ainsi en un instant deux nouveaux facteurs dans le secteur du téléphone : le circuit métallique et la ligne longue distance.
La Bell Company se rangea aussitôt du point de
vue de Vail, acheta sa nouvelle ligne et se lança dans ce qui
semblait être l'entreprise téméraire de tendre un
double fil de Boston à New York. Ce serait non seulement la plus
longue de toutes les lignes téléphoniques, tendues sur
dix mille poteaux, mais aussi une ligne de luxe, construite en cuivre
rouge brillant, et non en fer. Son coût s'élèverait
à soixante-dix mille dollars, une somme colossale à cette
époque de misère.
Une telle extravagance suscita une vive opposition et de nombreuses
moqueries. « Je n'accepterais pas cette ligne comme un cadeau
», déclara l'un des responsables de la Bell Company.
Mais lorsque la dernière bobine de fil fut étirée et que le premier « Bonjour » fut lancé de Boston à New York, la nouvelle ligne connut un succès retentissant. Elle transporta des messages dès le premier jour ; et plus encore, elle propulsa l'industrie téléphonique vers un niveau supérieur. Elle balaya le préjugé selon lequel le service téléphonique ne pouvait devenir qu'une affaire de quartier. « Ce fut le salut de l'industrie », déclara Edward J. Hill. Elle marqua un tournant dans l'histoire du téléphone, marquant la fin de l'ère des petites choses et le début de l'ère des grandes choses. Aucun homme, aucune centaine d'hommes, ne l'avait créée. C'était l'aboutissement de dix années d'inventions et d'améliorations.
Pendant que cette ligne historique était tendue, Vail poursuivait sa politique de « grand système téléphonique » en créant l'American Telephone and Telegraph Company. Ce fut là aussi un coup de maître. C'était l'introduction de la méthode d'organisation par équipes et par lignes. Elle accomplissait pour les quarante ou cinquante Bell Companies ce que Von Moltke avait accompli pour l'armée allemande avant la guerre franco-prussienne. Il s'agissait de la création d'une société centrale qui relierait toutes les sociétés locales et qui posséderait et exploiterait elle-même les moyens par lesquels ces sociétés sont unies. Cette société centrale devait s'attaquer à tous les problèmes nationaux, posséder tous les téléphones et toutes les lignes longue distance, protéger tous les brevets et être le siège de l'invention, de l'information, du capital et de la protection juridique de l'ensemble des Bell Companies.
Rarement une société a été créée avec un capital aussi modeste et un objectif aussi vaste. En 1885, son capital social ne dépassait pas 100 000 dollars, mais son objectif déclaré n'était rien de moins que d'établir un système de communication par fil pour l'humanité. Voici, selon ses propres termes, les objectifs de cette société : « Relier un ou plusieurs points dans chaque ville, village ou localité de l'État de New York à un ou plusieurs points dans chaque autre ville, village ou localité dudit État, ainsi que dans chaque autre État des États-Unis, du Canada et du Mexique ; et chacune de ces villes, villages et localités sera reliée à chaque autre ville, village ou localité desdits États et pays, ainsi que par câble et par tout autre moyen approprié au reste du monde connu. »
Ainsi se réalisa le rêve de Vail, et pendant neuf ans, il travailla d'arrache-pied pour le réaliser. Il resta en poste jusqu'à ce que les différentes parties de l'entreprise se soient consolidées et que son projet de « grand système téléphonique » soit lancé et bien compris. Il se lança alors dans une série d'entreprises pittoresques, jusqu'à ce qu'il se constitue une fortune considérable ; et récemment, en 1907, il revint à la tête de l'entreprise téléphonique et acheva l'œuvre d'organisation entreprise trente ans auparavant.
Lorsque Vail se tourna vers le téléphone,
l'entreprise était déjà en pleine enfance. Bien
établie, elle n'avait pas encore atteint sa pleine maturité.
Son époque pionnière était révolue. Autonome
et disposant d'un peu d'argent en banque, elle n'aurait cependant pas
pu supporter le trafic qu'elle supporte aujourd'hui. Elle avait encore
trop de problèmes à résoudre et une trop grande
inertie générale à surmonter. Il fallait la préserver,
la former, l'éduquer, la populariser. Et l'homme finalement choisi
pour remplacer Vail était, à bien des égards, le
leader idéal pour une telle période préparatoire.
– John Elbridge Hudson – était le nom du nouveau
chef du service du téléphone. C'était un homme
d'âge mûr, né à Lynn et élevé
à Boston ; originaire de Nouvelle-Angleterre depuis longtemps,
ses ancêtres avaient fondu du minerai de fer à Lynn sous
le règne de Charles Ier. Avocat de profession, il était
professeur d'université par tempérament. Sa spécialité,
en tant qu'homme d'affaires, était le droit maritime ; et son
passe-temps était la collection de livres rares et de gravures
anglaises anciennes. Il maîtrisait parfaitement le grec et l'aimait
beaucoup. En toute occasion, il utilisait la langue de Périclès
dans ses conversations ; et poussa même cette préférence
jusqu'à rédiger ses notes commerciales en grec. Il était
avant tout un érudit, puis un avocat, et, accessoirement, une
figure centrale du monde du téléphone.
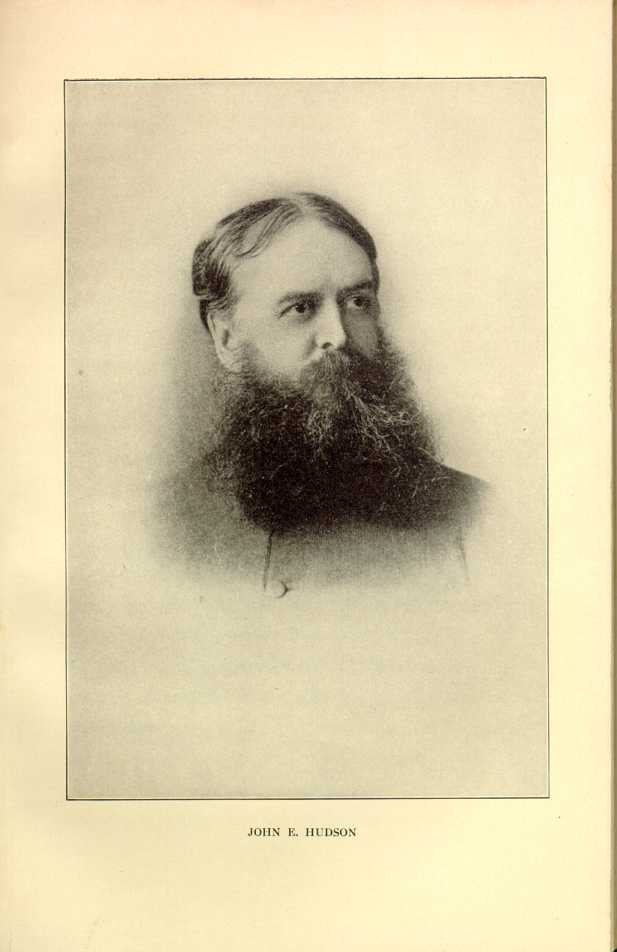 JOHN E. HUDSON
JOHN E. HUDSON
Mais il était d’une valeur inestimable pour
l’industrie du téléphone à cette époque
d’avoir à sa tête un homme du calibre intellectuel
et moral de Hudson. Il lui a donné du tonus et du prestige. Il
a bâti son crédit. Il l'a préservée de tout
soupçon de malversation. Il a conservé ses acquis. Et
il a préparé la voie à l'expansion en empruntant
cinquante millions pour des améliorations et en renforçant
considérablement la puissance et l'influence de l'American Telephone
and Telegraph Company.
Hudson resta à la tête du secteur téléphonique
jusqu'à sa mort, en 1900, et vécut ainsi assez longtemps
pour assister à l'avènement de l'ère des grandes
entreprises. Sous son régime, de grandes avancées furent
réalisées dans le développement de cet art. L'entreprise
était propulsée en tous points par ses dirigeants. Chacun
à sa place, s'efforçant d'offrir un service un peu meilleur
qu'hier – telle était la devise de l'ère Hudson.
Il n'y avait pas de génie prééminent. Chaque avancée
importante était le fruit de la coopération de nombreux
esprits et des impératifs d'un trafic en pleine expansion.
En 1896, lorsque le système Common Battery marqua le début d'une nouvelle ère, l'ingénieur du téléphone maîtrisait parfaitement ses problèmes les plus simples. Il était capable de gérer ses fils, quel qu'en soit le nombre. À cette époque aussi, le public était prêt pour le téléphone. Une nouvelle génération avait grandi, débarrassée des préjugés de ses pères. On s'était éloigné de l'idée reçue selon laquelle les communications par fil étaient un luxe onéreux réservé à quelques-uns. Le téléphone était, en réalité, un nouveau nerf social, si nouveau et si novateur qu'il fallut près de vingt ans avant qu'il ne s'impose pleinement et que le corps social ne développe l'instinct de l'utiliser.
Non pas que les difficultés des ingénieurs du téléphone fussent terminées, car elles ne l'étaient pas. Elles semblaient devenir chaque année plus nombreuses et plus complexes. Mais en 1896, suffisamment de progrès avaient été accomplis pour justifier une avancée. Pendant les dix années suivantes, l'histoire du téléphone fut marquée par l'EXPANSION. Avec le système de paiement forfaitaire en vigueur, tous les clients payaient le même prix annuel et utilisaient ensuite leur téléphone aussi souvent qu'ils le souhaitaient. C'était une méthode simple, la plus satisfaisante pour les petites villes et les régions agricoles. Mais dans une grande ville, un tel système s'est avéré suicidaire. À New York, par exemple, le prix a dû être porté à 240 dollars, ce qui a élevé le téléphone au-dessus de la masse des citoyens, au même titre qu'un piano ou un diamant. Un tel plan étranglait l'activité. Il excluait les petits utilisateurs. Il encombrait les lignes d'appels non sollicités. Il offrait un service insuffisant à certains et excessif à d'autres. La situation était très insatisfaisante.
Comment étendre le service tout en le rendant
moins cher pour les petits utilisateurs ? Tel était le nœud
gordien. Et celui qui a incontestablement le plus contribué à
le dénouer fut Edward J. Hall. M. Hall fonda l'entreprise
de téléphonie à Buffalo en 1878 et, sept ans plus
tard, devint responsable du trafic longue distance. Il était
alors, et est toujours, l'un des hommes d'État du téléphone.
Depuis plus de trente ans, il est le « facilité »
de l'industrie, suggérant, interrogeant et critiquant sans cesse.
Vif et impartial, doué d'un talent pour aller à l'essentiel
sans pitié, Hall s'est également montré un fervent
défenseur de l'amélioration et de l'extension du service
téléphonique. C'est lui qui a libéré les
agents du joug des redevances, leur permettant de payer un pourcentage
des recettes brutes. Et c'est lui qui a « débloqué
la situation », comme dirait un bûcheron, en suggérant
le système de TAUX DE MESSAGE.
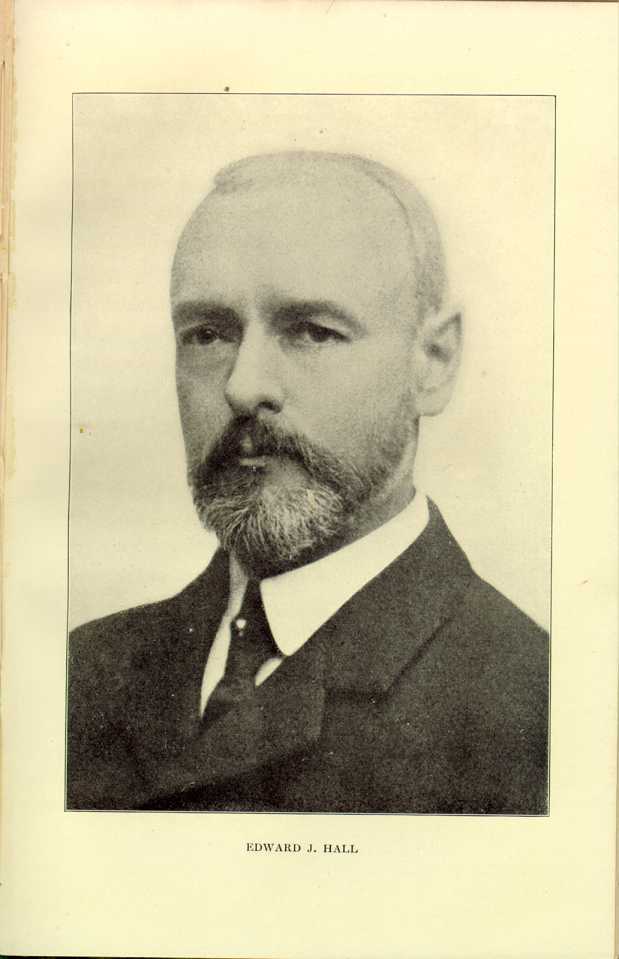 EDWARD
J. HALL
EDWARD
J. HALL
Grâce à ce système, développé à son apogée par UN Bethell à New York, un utilisateur du téléphone paie un prix minimum fixe pour un certain nombre de messages par an, et un supplément pour tous les messages dépassant ce nombre. Le gros utilisateur paie plus, et le petit moins. Cela ouvrit la voie à une expansion du secteur téléphonique que Bell, dans ses rêves les plus idylliques, n'avait jamais imaginée. En trois ans, après 1896, le nombre d'utilisateurs avait doublé ; en six ans, il était quatre fois plus ; en dix ans, il était huit pour un. Grâce au tarif des messages et à la borne de paiement, le téléphone était désormais en voie de devenir universel. Il était adapté à tous les types et à toutes les conditions de vie. Une grande entreprise, équipée de fils téléphoniques en tous points, pouvait désormais verser cinquante mille dollars à la Bell Company, tandis qu'un jeune immigrant irlandais, fraîchement arrivé à New York, pouvait offrir cinq sous et se voir offrir un système téléphonique de cinquante millions de dollars.
Une fois le débit des messages bien établi,
Hudson mourut – s'écroulant subitement au moment où
il s'apprêtait à monter dans un wagon. Frederick P.
Fish, également avocat et Bostonien, le remplaça.
Fish était un homme populaire, optimiste, au tempérament
irrésistible. Il poussa la politique d'expansion jusqu'à
battre tous les records. Il emprunta des sommes faramineuses –
150 000 000 $ à un moment donné – et les investit
dans une campagne de développement effrénée. Il
exigea toujours plus de clients, toujours plus, jusqu'à ce que
ses capitaines, tels un attelage de trente chevaux au galop, deviennent
quasiment incontrôlables.
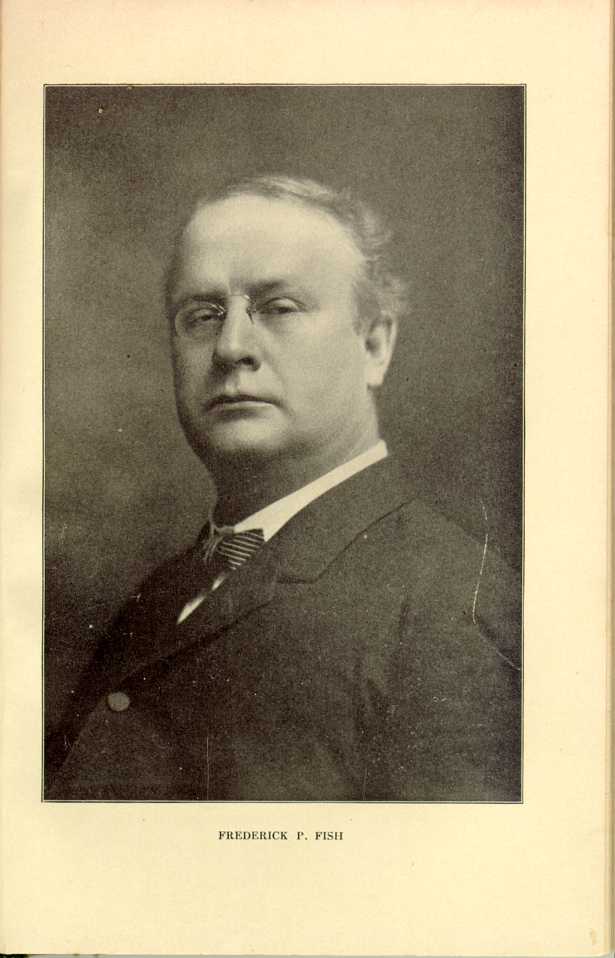 FREDERICK P. FISH
FREDERICK P. FISH
C'était une période rapide et effrénée. Le pays tout entier brûlait d'une passion pour la prospérité. Après des générations de conflits, les hommes aux grandes idées avaient enfin mis en déroute les hommes aux idées modestes. Le gaspillage et la folie de la concurrence avaient partout poussé les hommes à la coopération. Les usines étaient reliées entre elles et les usines entre elles, dans un vaste mutualisme industriel tel qu'aucune autre époque, peut-être, n'en a jamais connu. Et comme le téléphone est essentiellement l'instrument du travail collaboratif et de l'interdépendance, il s'est soudainement retrouvé accueilli comme le plus populaire et le plus indispensable de tous les moyens de communication entre les hommes.
Pour décrire cette croissance en une seule phrase,
nous pourrions dire que la compagnie de téléphone Bell
a obtenu son premier million de capital en 1879 ; son premier million
de bénéfices en 1882 ; son premier million de dividendes
en 1884 ; son premier million de surplus en 1885. Elle avait déboursé
son premier million pour les frais juridiques en 1886 ; avait commencé
à envoyer un million de messages par jour en 1888 ; avait tendu
son premier million de kilomètres de fil en 1900 ; et avait installé
son premier million de téléphones en 1898. En 1897, elle
avait tissé autant de toiles d'araignée de fil que la
puissante Western Union elle-même ; en 1900, elle avait deux fois
plus de kilomètres de fil que la Western Union, et en 1905 CINQ
FOIS plus. La progression fulgurante des Bell Companies durant cette
période d'expansion fut telle qu'en 1905, elles avaient dépassé
tous
les pays européens réunis, non seulement par la qualité
du service, mais aussi par le nombre de téléphones en
service. Et ce, sans un centime d'argent public, sans la protection
d'un tarif, ni le prestige d'un bureau gouvernemental.
En 1892, Boston et New York communiquaient avec Chicago,
Milwaukee, Pittsburgh et Washington. La moitié de la population
des États-Unis
était à portée de voix. Le THOUSAND-MILE TALK avait
cessé d'être un conte de fées. Plusieurs années
plus tard, l'extrémité ouest de la ligne fut prolongée
par-dessus les plaines jusqu'au Nebraska, permettant ainsi à
la parole de Boston d'être entendue à Omaha. Lentement
et avec beaucoup d'efforts, le public apprit à remplacer le téléphone
par les voyages. Un salon spécial pour les appels longue distance
fut aménagé à New York pour inciter les gens à
prendre l'habitude de parler avec d'autres villes. Des taxis étaient
envoyés chercher les clients ; et lorsqu'un client arrivait,
il était escorté sur des tapis orientaux jusqu'à
une cabine dorée, drapée de rideaux de soie. C'était
la célèbre « salle neuf ». Par de tels attraits
et bien d'autres, une idée plus large du service téléphonique
fut donnée au public ; jusqu'en 1909, au moins dix-huit mille
conversations New York-Chicago ont eu lieu, et les revenus provenant
des messages strictement longue distance étaient de vingt-deux
mille dollars par jour.
En 1906, la Rocky Mountain Bell Company était
déjà devenue une entreprise de dix millions de dollars.
Elle débuta à Salt Lake City avec une
centaine de téléphones, en 1880. Puis elle s'étendit
sur une superficie de quatre cent treize mille miles carrés –
une vaste Terre Solitaire aux ressources inexploitées. Ses poseurs
de lignes tâtonnèrent à travers des forêts
denses où leurs perches ressemblaient à des cure-dents
à côté des pins et des cèdres imposants.
Ils ceignirent les montagnes et étendirent les prairies de fil
de fer, jusqu'à ce que ces lieux isolés soient réunis
et rendus conviviaux. Ils chassèrent les Indiens, qui convoitaient
le fil brillant pour leurs boucles d'oreilles et leurs bracelets ; et
les ours, qui prenaient le bourdonnement des fils pour celui des abeilles
et persistaient à ronger les perches. Avec un optimisme des plus
héroïques, la Rocky Mountain Bell Company persévéra
jusqu'à créer, en 1906, un réseau de communication
de cent dix mille miles pour l'extrême Ouest.
Chicago, cette année-là, comptait deux cent mille téléphones en service sur une superficie de deux cents miles carrés. L'entreprise avait été bâtie par le général Anson Stager, lui-même riche et capable d'attirer le soutien d'hommes tels que John Crerar, H. H. Porter et Robert T. Lincoln. Depuis 1882, elle verse des dividendes et, en une année glorieuse, son action a grimpé à quatre cents dollars l'action. Les anciens – ceux qui, en 1878, escaladaient les toits et installaient des fils de fer partout où ils le pouvaient sans être chassés – contrôlent encore pour la plupart la société de Chicago.
Mais comme on pouvait s'y attendre, c'est New York qui battit les records à l'avènement de l'expansion du téléphone. L'arrivée des grandes entreprises s'y déchaîna avec la force d'un raz-de-marée. Le nombre d'utilisateurs bondit de 56 000 en 1900 à 810 000 en 1908. En une seule année d'activité intense et intense, 65 000 nouveaux téléphones furent installés sur les bureaux ou accrochés aux murs, soit en moyenne un nouvel utilisateur toutes les deux minutes de travail.
Des tonnes, voire des centaines de tonnes, de téléphones furent transportés par camions depuis l'usine et installés dans les foyers et les bureaux new-yorkais. La demande ne cessa de croître, si bien qu'aujourd'hui, New York compte plus de téléphones que la France, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse réunies. New York est devenue une ville inabordable. Si l'on additionne tous les téléphones de Londres, Glasgow, Liverpool, Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield, Bristol et Belfast, on en comptera à peine autant que ceux qui transmettent les conversations de cette seule ville américaine.
En 1879, l'annuaire téléphonique de New York se résumait à une petite fiche, affichant deux cent cinquante-deux noms ; aujourd'hui, il est devenu un trimestriel de huit cents pages, tiré à un demi-million d'exemplaires, et nécessitant vingt chariots, quarante chevaux et quatre cents hommes pour assurer sa distribution. Il y a trente ans, il n'existait qu'un seul petit central téléphonique miteux ; aujourd'hui, on en compte cinquante-deux, véritables centres névralgiques d'un vaste système de cinquante millions de dollars. Aussi incroyable que cela puisse paraître aux étrangers, il est vrai que dans un seul immeuble new-yorkais, le Hudson Terminal, on trouve plus de téléphones qu'à Odessa ou à Madrid, plus que dans les deux royaumes de Grèce et de Bulgarie réunis.
Le simple fonctionnement de ce système nécessite une armée de plus de cinq mille filles. La simple tenue de leurs dossiers requiert deux cent trente-cinq millions de feuilles de papier par an. La simple rédaction de ces dossiers use cinq cent soixante mille crayons à papier. Et le simple fait de servir à ces filles une tasse de thé ou de café à midi oblige la Bell Company à acheter chaque année six mille livres de thé, dix-sept mille livres de café, quarante-huit mille boîtes de lait concentré et cent quarante barils de sucre.
Les innombrables fils de ce réseau new-yorkais
vibrent de conversations à chaque instant du jour et de la nuit.
Ils sont le plus au repos entre trois et quatre heures du matin, même
si, même à ce moment-là, on compte généralement
dix appels par minute. Entre cinq et six heures, deux mille New-
Yorkais sont éveillés et au téléphone. Une
demi-heure plus tard, ils sont deux fois plus nombreux. Entre sept et
huit heures, vingt-cinq mille personnes ont appelé vingt-cinq
mille autres personnes, de sorte qu'il y a autant de personnes qui communiquent
par fil qu'il y en avait dans toute la ville de New York à l'époque
révolutionnaire. Et ce n'est que l'aube de la journée.
À huit heures et demie, le bruit est doublé ; à
neuf heures, il est triplé ; à dix heures, il est sextuplé
; et à onze heures, le vacarme est devenu un incroyable tourbillon
de cent quatre-vingt mille conversations par heure, avec cinquante nouvelles
voix qui s'élèvent aux centraux chaque seconde.
C'est « le pic de la charge ». C'est le summum de la communication. C'est le niveau de service le plus élevé que le téléphone ait jamais été amené à offrir dans une ville. Et c'est une merveille du monde, pour les hommes et les femmes doués d'imagination, au même titre que les aciéries de Homestead ou les gigantesques turbines qui traversent l'océan Atlantique en quatre jours et demi.
Quant aux hommes qui l'ont bâtie : Charles F. Cutler est décédé en 1907, mais la plupart des autres sont toujours en vie et actifs. Union N. Bethell, qui remplace Cutler à la tête de la New York Company, en est le directeur opérationnel depuis dix-huit ans. C'est un homme perspicace et empathique, doté d'une rare sagacité pour résoudre les problèmes complexes, un président d'un nouveau genre, qui considère son travail comme une sorte d'obligation envers le public. Et tout comme les étrangers se rendent à Pittsburgh pour voir l'industrie sidérurgique à son apogée ; tout comme ils se rendent dans l'Iowa et au Kansas pour voir le New Farmer, de même ils font des pèlerinages au bureau de Bethell pour apprendre le métier de la téléphonie.
Ce système téléphonique new-yorkais, sans équivalent, s'est développé sans jamais connaître la rivalité de la concurrence. Mais dans de nombreuses autres villes, et notamment dans le Middle West, un ensemble d'entreprises indépendantes a vu le jour en 1895. L'époque des brevets originaux était révolue, et les Bell Companies se sont retrouvées libérées des frais de litige pour finalement se retrouver empêtrées dans un imbroglio de duplications. En quelques années, on comptait six mille de ces petites entreprises à la Robinson Crusoé. En 1901, elles avaient mis en service plus d'un million de téléphones et affirmaient disposer d'un capital de cent millions.
La plupart de ces entreprises étaient nécessaires et contribuèrent grandement à l'expansion du secteur téléphonique vers de nouveaux territoires. Il s'agissait en fait de petites associations mutuelles regroupant une douzaine ou une centaine d'agriculteurs, dont l'objectif était d'obtenir un service téléphonique à prix coûtant. Mais il existait d'autres entreprises, probablement un millier ou plus, organisées par des promoteurs qui fondaient leurs espoirs sur l'impopularité des Bell Companies et sur le mythe de leur richesse colossale. Au lieu d'étendre légitimement les lignes téléphoniques à des communautés qui n'en possédaient pas, ces promoteurs se mirent à imposer le problème complexe d'un système redondant aux villes qui les autorisaient à le faire.
C'est ainsi que, sous couvert de concurrence, la duplication des réseaux a commencé à engendrer des nuisances et des gaspillages dans la plupart des villes américaines. L'industrie du téléphone était encore si jeune, si peu appréciée même par les responsables et les ingénieurs du secteur, que le public considérait l'installation d'un deuxième ou d'un troisième système téléphonique dans une ville comme une innovation tout à fait envisageable et souhaitable. « Nous avons deux oreilles », a déclaré un promoteur ; « pourquoi ne pas avoir deux téléphones ? »
Cette duplication s'est poursuivie joyeusement pendant des années avant que l'on découvre généralement que le téléphone n'est pas une oreille, mais un système nerveux ; et qu'une expérience telle que la duplication d'un système nerveux n'a jamais été tentée par la nature, même dans ses humeurs les plus frivoles. La plupart des gens s'imaginaient qu'un système téléphonique était pratiquement identique à un système d'éclairage au gaz ou à l'électricité, souvent dupliqué, ce qui permettait des tarifs plus avantageux et un meilleur service. Il leur a fallu des années pour découvrir que deux compagnies de téléphone dans une même ville équivalaient soit à un service réduit de moitié, soit à un coût doublé, tout comme deux casernes de pompiers ou deux bureaux de poste.
Certaines de ces sociétés dupliquées ont construit une usine complète et ont fourni un bon service local, tandis que d'autres se sont révélées être de simples bulles boursières. La plupart d'entre elles étaient surcapitalisées, dépendant de la sympathie du public pour compenser les déficiences de leur équipement. L'une d'elles, qui avait imprimé cinquante millions de dollars de stock destiné à la vente, a été vendue aux enchères en 1909 pour quatre cent mille dollars. Au total, vingt-trois de ces bulles ont éclaté en 1905, vingt et une en 1906 et douze en 1907. Le taux de mortalité de ces sociétés isolées a été si élevé que, lors d'une récente convention d'agents téléphoniques, le marteau du président était fait de trente-cinq morceaux de bois, prélevés sur trente-cinq standards de trente-cinq sociétés disparues.
Une étude portant sur douze villes à système unique et vingt-sept villes à double système montre qu'il y a environ onze pour cent de téléphones en plus sous le double système, et que lorsque le second système est installé, un utilisateur sur cinq est obligé de payer pour deux téléphones. Les tarifs sont identiques, qu'une ville possède un ou deux systèmes. Les entreprises de duplication ont augmenté leurs tarifs dans seize villes sur vingt-sept et les ont réduits dans une seule. Aux États-Unis dans leur ensemble, ce sont aujourd'hui pas moins de deux cent cinquante mille personnes qui paient pour deux téléphones au lieu d'un, ce qui représente un gaspillage économique d'au moins dix millions de dollars par an.
Une analyse objective de l'ensemble du mouvement téléphonique indépendant montrerait probablement qu'il s'agissait d'abord d'un stimulant, suivi, comme c'est généralement le cas, d'une réaction. Il a incontestablement été pendant plusieurs années un stimulant pour les Bell Company. Mais il n'a pas tenu ses promesses de tarifs avantageux, de meilleur service et de dividendes élevés ; il n'a guère contribué, voire rien, à améliorer les appareils téléphoniques, ne produisant rien de nouveau, si ce n'est le standard automatique – une invention brillante, qui en est maintenant à sa phase expérimentale. Dans l'ensemble, il s'agit peut-être d'un mouvement réactionnaire et gênant dans les villes, et d'un mouvement progressiste parmi les agriculteurs.
En 1907, la vague avait épuisé ses forces. Elle ne déferlait plus aisément sur le vaste océan d'espoir, mais était brisée et détournée par les difficultés du quotidien. Un à un, les promoteurs du téléphone comprirent les limites d'une entreprise isolée et demandèrent à être intégrés au groupe Bell. En 1907, quatre cent cinquante-huit mille téléphones indépendants furent reliés par fil à la compagnie Bell la plus proche ; et en 1908, trois cent cinquante mille autres suivirent. Après ce raz-de-marée vers la politique de consolidation, il subsistait encore un assez large éventail d'entreprises indépendantes ; mais elles avaient perdu leurs rêves et leurs illusions.
Comme on pouvait s'y attendre, le mouvement indépendantiste produisit un certain nombre de dirigeants locaux compétents, mais aucun d'importance nationale. Les Bell Companies, en revanche, étaient dirigées par des hommes qui, depuis un quart de siècle, étudiaient les problèmes téléphoniques d'un point de vue national. À leur tête, à partir de 1907, se trouvait Theodore N. Vail, revenu avec éclat, au moment précis où il était nécessaire, pour achever le travail commencé en 1878. Il avait été absent pendant vingt ans, travaillant au développement de l'énergie hydraulique et à la construction de tramways en Amérique du Sud. Dans le premier acte du drame téléphonique, c'est lui qui donna à l'entreprise une base commerciale et posa les premiers principes de sa politique. Dans les deuxième et troisième actes, il n'eut pas sa place ; mais lorsque le rideau se leva sur le quatrième acte, Vail redevint le personnage central, debout, cheveux blancs, parmi ses capitaines, et faisant avancer l'achèvement du « grand système téléphonique » dont il avait rêvé lorsque le téléphone avait trois ans.
C'est ainsi que l'industrie téléphonique fut créée par Vail, conservée par Hudson, développée par Fish, et est aujourd'hui en cours de consolidation par Vail. Elle est en train de se fédérer au sein d'un formidable Bell System – une fédération d'entreprises autonomes, unies par une société centrale, la plus active de toutes. Elle n'est plus protégée par aucun monopole de brevet. Quiconque est suffisamment riche et téméraire peut se lancer dans ce secteur. Mais elle bénéficie de tous les avantages incommensurables que sont une longue expérience, une masse considérable, des spécialistes hautement qualifiés et un capital abondant. « Le Bell System est fort », explique Vail, « parce que nous sommes tous liés ; et la réussite de l'un d'entre eux est donc l'affaire de tous. »
Le système Bell ! Voilà le motif du développement du téléphone américain. Voici l'idée la plus complète qui ait traversé l'esprit d'un ingénieur en téléphonie. Ce système Bell est déjà devenu si vaste, si proche d'un système nerveux national, qu'il est incomparable. Il est si répandu que peu de gens ont conscience de sa grandeur. Il s'étend sur plus de cinquante mille villes et communes.
Si tout était réuni en un seul lieu, ce
Bell System, cela donnerait à Telephonia une ville aussi grande
que Baltimore. Elle contiendrait la moitié des propriétés
téléphoniques du monde. Sa richesse réelle s'élèverait
à 760 000 000 $ et ses revenus seraient supérieurs à
ceux de la ville de New York.
Une partie du patrimoine de la ville de Telephonia se compose de dix millions de poteaux, soit autant qu'il en faudrait pour construire une clôture de New York à la Californie, ou pour ériger une palissade autour du Texas. Si les habitants de Telephonia souhaitaient utiliser ces poteaux chez eux, ils pourraient les planter en pieux le long de leurs quais et disposer d'un bassin de vingt-cinq mille acres ; ou si leur ville avait une superficie de cent soixante-dix kilomètres carrés, ils pourraient ériger un mur d'enceinte à sept couches avec ces poteaux.
Du fil aussi ! Onze millions de kilomètres ! Cette ville de Telephonia serait la capitale d'un empire du fil. Tous les habitants de l'État de New York ne pourraient pas porter ce fardeau de fil. Mettez tous les habitants de l'Illinois d'un côté et la richesse en fil de Telephonia de l'autre, et bien avant que la dernière bobine ne soit installée, les Illinoisiens seraient dans les airs.
Que ferait cette ville dans la vie ? Elle fabriquerait les deux tiers des téléphones, des câbles et des standards téléphoniques de tous les pays. Près d'un quart de ses citoyens travailleraient dans des usines, tandis que les autres s'occuperaient de six mille centraux téléphoniques, permettant ainsi aux citoyens des États-Unis de communiquer entre eux au rythme de sept mille millions de conversations par an.
L'armée de soldats qui se rendait chaque matin au travail à Telephonia serait composée de cent dix mille hommes et femmes, principalement des filles, autant de filles que celles qui rempliraient le Vassar College cent fois et plus, ou le double de la population du Nevada. Alignez ces hommes et ces femmes, faites-les défiler dix de front, et six heures s'écouleraient avant que la dernière compagnie n'arrive à la tribune. En file indienne, cette foule de Telephoniens formerait un mur vivant de New York à New Haven.
Telle est l'extraordinaire ville dont Alexander Graham Bell fut l'unique résident en 1875. Elle s'est construite sans le soutien d'aucune grande banque ni d'aucun multimillionnaire. Il n'y a eu ni Vanderbilt, ni Astor, ni Rockefeller, ni Rothschild, ni Harriman. Aujourd'hui encore, seuls quatre hommes possèdent jusqu'à dix mille actions de la compagnie centrale. Ce système Bell est l'œuvre d'une vie d'hommes défavorisés, pour la plupart encore en vie et actifs. À de rares exceptions près, chaque élément a été fabriqué aux États-Unis. Aucun autre organisme industriel de taille comparable n'a une dette aussi faible envers l'étranger. De par son origine, son développement et son apogée d'efficacité et d'expansion, le téléphone est aussi essentiellement américain que la Déclaration d'Indépendance ou le monument de Bunker Hill.
UTILISATEURS REMARQUABLES DU TÉLÉPHONE
Ce que l'on pourrait appeler la téléphonisation de la vie urbaine, faute d'un terme plus simple, a considérablement transformé notre mode de vie par rapport à celui de l'époque d'Abraham Lincoln. Elle nous a permis d'être plus sociables et coopératifs. Elle a littéralement aboli l'isolement des familles séparées et a fait de nous les membres d'une seule et même grande famille. Le téléphone est devenu un véritable organe du corps social, au point que nous concluons des contrats, témoignons, plaidons des procès, faisons des discours, demandons en mariage, décernons des diplômes, interpellons les électeurs et faisons presque tout ce qui relève de la parole.
Dans les magasins et les hôtels, ce trafic téléphonique a connu une croissance presque déconcertante, car ce sont des lieux de rencontre entre de nombreux intérêts. Les cent plus grands hôtels de New York comptent vingt et un mille téléphones, soit presque autant que le continent africain et plus que le royaume d'Espagne. En moyenne, ils envoient six millions de messages par an. Le Waldorf-Astoria, à lui seul, dépasse tous les immeubles résidentiels avec mille cent vingt téléphones et cinq cent mille appels par an ; tandis que les seules commandes de Noël qui arrivent en trombe chez Marshall Field ou John Wanamaker atteignent les trois mille.
La question de savoir si le téléphone contribue le plus à concentrer la population ou à la disperser reste entière. Il est indéniable qu'il a rendu possible la construction des gratte-ciel et contribué ainsi à la création d'un type de ville totalement nouveau, jamais imaginé même dans les contes de fées des nations antiques. Le gratte-ciel a dix ans de moins que le téléphone. Il est aujourd'hui généralement considéré comme le bâtiment idéal pour les bureaux. C'est l'un des rares types d'architecture que l'on puisse qualifier d'américain. Son efficacité est due en grande partie, voire principalement, au fait que ses habitants peuvent faire leurs courses aussi bien par téléphone que par ascenseur.
Il semble qu'aucune activité ne soit rendue plus pratique par le téléphone. On l'utilise pour appeler les chasseurs de canards dans l'Ouest canadien lorsqu'une volée d'oiseaux arrive ; et pour diriger les mouvements du dragon dans le grand opéra « Siegfried » de Wagner. Lors du dernier match de football Yale-Harvard, il a transmis des nouvelles quasi instantanées à cinquante mille personnes dans diverses régions de la Nouvelle-Angleterre. Lors de la course de la Coupe Vanderbilt, ses fils entouraient la piste et signalaient chaque gain ou incident des voitures de course. Et lors de spectacles aussi coûteux que celui du tricentenaire de Québec en 1908, où quatre mille acteurs allaient et venaient sur une scène de quatre acres, chaque ordre était donné par téléphone.
Les fonctionnaires, même aux États-Unis, ont mis du temps à abandonner l'usage désuet et plus digne des documents écrits et des messagers en uniforme ; mais ces dix dernières années, une révolution radicale a eu lieu à cet égard. Le gouvernement par téléphone ! C'est une idée nouvelle qui a déjà fait son chemin dans les services fédéraux les plus performants. Quant au Congrès actuel, il est allé jusqu'à prévoir un système spécial, dans les deux chambres, afin que toutes les annonces officielles puissent être entendues par fil.
Garfield fut le premier président américain
à posséder un téléphone. Un appareil d'exposition
fut installé gratuitement chez lui en 1878, alors qu'il était
encore membre du Congrès. Ni Cleveland ni Harrison, par humeur
changeante, n'utilisèrent souvent le fil magique. Sous leur régime,
il ne restait qu'un seul téléphone inutilisé à
la Maison-Blanche, utilisé par les domestiques plusieurs fois
par semaine. Mais avec McKinley, un nouvel ordre de choses s'installa.
Pour lui, le téléphone était plus qu'une nécessité.
C'était un passe-temps, un sport exaltant. Il était le
seul président à apprécier pleinement le confort
de la téléphonie. En 1895, assis dans sa maison de Canton,
il entendit les acclamations de la Convention de Chicago. Plus tard,
il y mena la première campagne présidentielle pour le
téléphone et s'entretint avec ses responsables dans trente-huit
États. Il en vint ainsi à considérer le téléphone
avec une plus grande estime que n'importe lequel de ses prédécesseurs
et en fit l'éloge à de nombreuses occasions publiques.
« Il nous rapproche tous », était sa phrase favorite.
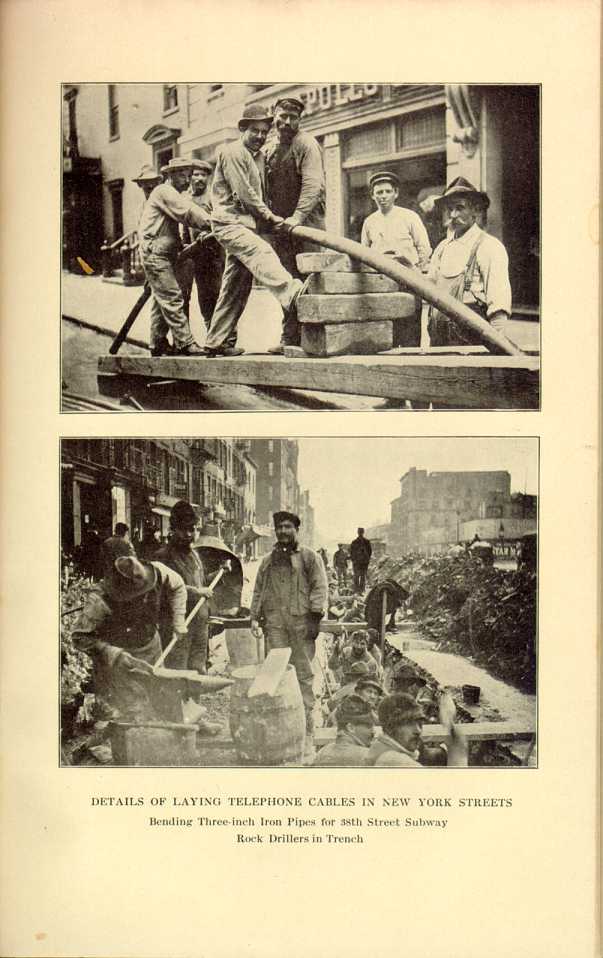
DÉTAILS DE LA POSE DE CÂBLES TÉLÉPHONIQUES
DANS LES RUES DE NEW YORK
Cintrage de tuyaux en fer de 7,6 cm pour le métro de la 38e Rue
Pour Roosevelt, le téléphone était principalement destiné aux urgences. Il l'utilisa pleinement lors de la Convention de Chicago de 1907 et de la Conférence de la Paix de Portsmouth. Mais avec Taft, le téléphone redevint le moyen de communication habituel. Il a introduit au moins une nouvelle habitude téléphonique : parler longue distance avec sa famille chaque soir, lorsqu'il est absent. Au lieu du téléphone solitaire de l'époque Cleveland-Harrison, la Maison-Blanche dispose désormais de son propre autocommutateur – le Main 6 –, doté d'un faisceau de fils qui relie chaque pièce ainsi que le central le plus proche.
Après les fonctionnaires, les banquiers furent peut-être les derniers à accepter les facilités du téléphone. Ils mirent du temps à abandonner l'idée fausse selon laquelle aucune affaire ne peut se faire sans trace écrite. James Stillman, de New York, fut le premier banquier à prévoir l'ère du téléphone. Dès 1875, alors que Bell apprenait à son jeune téléphone à parler, Stillman risqua deux mille dollars dans un projet visant à établir un système rudimentaire de communication par fil, qui deviendra plus tard le premier central téléphonique de New York. Aujourd'hui, le banquier le plus proche de son téléphone est probablement George W. Perkins, du groupe de banquiers JP Morgan. « C'est le seul homme », dit Morgan, « capable de lever vingt millions en vingt minutes. » Le plan de Perkins pour une téléphonie rapide consiste à préparer une liste de noms, de dix à trente, et à passer de l'un à l'autre aussi vite que l'opératrice peut les composer. Récemment, un autre membre de la banque Morgan a proposé d'agrandir son parc téléphonique. « Que gagnerions-nous à avoir plus de fils ? » a demandé l'opératrice. « Si nous devions installer un câble de six cents paires, M. Perkins le garderait occupé. »
L'exploit le plus brillant du téléphone dans le monde financier eut lieu lors de la panique de 1907. Au plus fort de la tempête, un samedi soir, les banquiers new-yorkais se réunirent pour une conférence presque désespérée. Ils décidèrent, par mesure d'urgence et d'autoprotection, de ne pas envoyer d'argent liquide aux banques occidentales. À minuit, ils téléphonèrent aux banquiers de Chicago et de Saint-Louis. Ces derniers, à leur tour, se concertèrent par téléphone et, le dimanche après-midi, appelèrent les banquiers des États voisins. La nouvelle se répandit ainsi de téléphone en téléphone, jusqu'à ce que, le lundi matin, tous les banquiers et principaux déposants soient informés de la situation et se préparent à la collaboration qui évitera une catastrophe générale.
Quant aux courtiers de Wall Street, ils effectuent la quasi-totalité de leurs transactions par téléphone. Leur bourse compte six cent quarante et une cabines, chacune étant le terminus d'un fil privé. Une maison de courtage comptera une année de conversation ordinaire pour envoyer cinquante mille messages ; et il y en a une qui, l'année dernière, en a envoyé deux fois plus. De tous les courtiers, celui qui a finalement le plus accompli par téléphone fut incontestablement E.H. Harriman. Dans le manoir qu'il fit construire à Arden, il y avait cent téléphones, dont soixante reliés aux lignes longue distance. Ce que le pinceau est à l'artiste, ce que le ciseau est au sculpteur, le téléphone l'était à Harriman. Il a bâti sa fortune grâce à lui. Il était dans sa bibliothèque, sa salle de bains, sa voiture privée, son campement dans la nature sauvage de l'Oregon. Aucune transaction n'était trop importante ou trop complexe pour être réglée par ses lignes. Il a sauvé le crédit de l'Erie par téléphone – il lui a prêté cinq millions de dollars alors qu'il était alité chez lui. « Il est esclave du téléphone », écrivait un journaliste de magazine. « Absurde », répliqua Harriman, « il est mon esclave. »
Le téléphone est arrivé à point nommé pour empêcher les grandes entreprises de devenir lourdes et aristocratiques. Le contremaître d'une compagnie charbonnière de Pittsburg peut désormais, depuis son bureau souterrain, parler au président du Steel Trust, installé au vingt-et-unième étage d'un gratte-ciel new-yorkais. Les conversations à distance, en particulier, sont devenues indispensables aux entreprises dont les usines sont dispersées et géographiquement mal placées – comme les filatures de Nouvelle-Angleterre, par exemple, qui utilisent le coton du Sud et vendent une grande partie de leur production au Middle West. Pour les entreprises qui vendent des denrées périssables, une conversation instantanée avec un acheteur dans une ville lointaine a souvent permis d'économiser un wagon ou une cargaison. Les traiteurs, comme les conditionneurs de viande, qui furent parmi les premiers à comprendre ce que Bell avait rendu possible, ont considérablement accéléré la croissance de leur activité grâce aux conversations interurbaines. Depuis dix ans ou plus, les Cudahy communiquent chaque matin entre Omaha et Boston, par l'intermédiaire de mille cinq cent soixante-dix kilomètres de fil.
Dans le raffinage du pétrole, la Standard Oil Company, à elle seule, envoie, depuis son bureau de New York, deux cent trente mille messages par an. Dans la fabrication de l'acier, une analyse chimique est effectuée sur chaque chaudron de fonte en fusion, dès son acheminement vers le raffinage, et cette analyse est transmise par téléphone au sidérurgiste, afin qu'il sache exactement comment chaque pot doit être manipulé. Pour le flottage des grumes sur les rivières, au lieu d'avoir des relais de crieurs pour empêcher les grumes de se coincer, on utilise désormais un fil le long de la berge, avec un téléphone branché à chaque point dangereux. Pour la construction des gratte-ciel, il est désormais courant d'avoir un fil temporaire tendu verticalement, afin que l'architecte puisse se tenir debout au sol et s'entretenir avec un contremaître assis à califourchon sur une poutre nue à cent mètres de hauteur. Et dans le secteur de l'éclairage électrique, le courant est entièrement distribué par ordres téléphoniques. Pour doter New York des sept millions de lampes électriques qui ont aboli la nuit dans cette ville, il faut douze centraux téléphoniques privés et cinq cent douze téléphones. Toute l'énergie qui crée cette lumière artificielle est produite dans une seule station et acheminée vers vingt-cinq centres de stockage. Minute après minute, son flux est piloté par un expert, assis à un central téléphonique comme un pilote à la barre d'un paquebot.
La première compagnie maritime à s'intéresser au téléphone fut la Clyde, qui disposait d'une ligne reliant le quai à ses bureaux en 1877 ; et la première compagnie ferroviaire fut la Pennsylvania, qui, deux ans plus tard, fut convaincue par le professeur Bell lui-même de l'essayer à Altoona. Depuis, cette compagnie est devenue la principale bénéficiaire de l'art de la téléphonie. Elle compte cent soixante-quinze centraux, quatre cents opérateurs, treize mille téléphones et trente-cinq mille kilomètres de lignes – un réseau plus étendu que celui de la ville de New York en 1896.
Aujourd'hui, le téléphone prend la mer à bord des paquebots et des navires de guerre. Ses fils attendent au quai et au dépôt, permettant ainsi à un touriste de s'asseoir dans sa cabine et de parler avec un ami dans un bureau éloigné. C'est l'un des miracles les plus incroyables de la téléphonie qu'un passager à New York, sur le point de partir pour Chicago par un express rapide, puisse téléphoner à Chicago depuis le salon d'un Pullman. Lui-même, sur le plus rapide de tous les trains, n'arrivera à Chicago que dix-huit heures plus tard ; mais les mots rapides peuvent faire le voyage, et RETOUR, pendant que son train attend le signal du départ.
Dans l'exploitation des trains, les compagnies ferroviaires ont attendu trente ans avant d'oser faire confiance au téléphone, tout comme elles ont attendu quinze ans avant d'oser faire confiance au télégraphe. En 1883, quelques compagnies utilisaient le téléphone à petite échelle, mais en 1907, lorsqu'une loi rendit les télégraphistes très coûteux, le téléphone prit une ampleur générale. Plusieurs dizaines de compagnies l'utilisent désormais, certaines l'utilisant comme un complément à la méthode Morse, d'autres comme un substitut complet. Il s'est déjà avéré être le moyen le plus rapide d'acheminer les trains. Il accomplit en cinq minutes ce que le télégraphe faisait en dix. Et il a permis aux compagnies ferroviaires d'embaucher du personnel plus qualifié pour les bureaux plus petits.
Dans la collecte d'informations, bien plus que dans le transport ferroviaire, l'ère du téléphone est arrivée. Le Boston Globe fut le premier journal à recevoir les nouvelles par téléphone. Plus tard, le Washington Star, relié au Capitole par un fil, gagna une heure sur ses concurrents. Aujourd'hui, les journaux du soir reçoivent la plupart de leurs informations par fil, à la Bell plutôt qu'en Morse. Cela a entraîné une spécialisation des reporters : un homme court chercher les nouvelles, un autre les écrit. Certains reporters ne viennent jamais au bureau. Ils reçoivent leurs missions par téléphone et leurs salaires par courrier. Certains sont même autorisés à téléphoner directement à un linotype, qui les imprime sur sa machine, sans même gratter un crayon. C'est, bien sûr, la méthode idéale de collecte d'informations, rarement possible.
Un journal de premier ordre, comme le New York World, dispose aujourd'hui de vingt lignes principales et de quatre-vingts téléphones. Ses appels sortants s'élèvent à deux cent mille par an et ses appels entrants à trois cent mille, ce qui signifie que chaque édition du matin, du soir ou du dimanche reçoit en moyenne sept cent cinquante messages. Un journal ordinaire d'une petite ville ne peut se permettre un tel service, mais l'United Press a récemment mis au point une méthode coopérative. Elle transmet les informations par téléphone, par un seul fil, à dix ou douze journaux simultanément. En dix minutes, mille mots peuvent ainsi être diffusés dans une douzaine de villes, aussi rapidement que par télégraphe et à bien meilleur marché.
Mais c'est dans les situations de crise dangereuse, lorsque la sécurité semble tenir à une seconde, que le téléphone est à son meilleur. C'est l'instrument des urgences, une sorte de sentinelle omniprésente. Lorsque l'opératrice du central téléphonique entend un appel à l'aide – « Vite ! L'hôpital ! » « Les pompiers ! » « La police ! » – elle attend rarement le numéro. Elle le connaît. Elle est entraînée à gagner des demi-secondes. Et c'est dans ces moments-là, si jamais, que les utilisateurs d'un téléphone peuvent apprécier sa valeur d'assurance. Nul doute que si un roi Richard III était vaincu sur un champ de bataille moderne, son cri instinctif serait : « Mon royaume pour un téléphone ! »
Lorsqu'une intervention immédiate est nécessaire
à New York, les fils de la police peuvent déclencher une
alerte générale en cinq minutes sur tout son vaste territoire
de 780 kilomètres carrés. Récemment, lorsqu'une
conduite de gaz s'est rompue à Brooklyn, soixante jeunes filles
ont été immédiatement appelées aux centrales
de ce quartier pour alerter les dix mille familles menacées.
Lorsque le malheureux Général Slocum a pris feu, un mécanicien
d'une usine du front de mer a vu les flammes et a eu la présence
d'esprit d'appeler les journaux, les hôpitaux et la police. Lorsqu'un
jeune enfant est perdu, qu'un détenu s'est évadé
de prison, que la forêt est en feu ou qu'une menace météorologique
se profile, les sonneries du téléphone annoncent la nouvelle,
tout comme les nerfs résonnent de douleur lorsque le corps est
en danger. Dans un cas tragique, l'opératrice de Folsom, au Nouveau-Mexique,
a refusé de quitter son poste avant d'avoir prévenu sa
population d'une inondation qui s'était produite dans les collines
surplombant le village. Grâce à son courage, presque tous
furent sauvés, même si elle-même se noya au standard.
Son nom – Mme SJ Rooke – mérite d'être rappelé.
Si une catastrophe ne peut être évitée, c'est généralement le téléphone qui apporte les premiers secours aux blessés. Après la destruction de San Francisco, le gouverneur Guild du Massachusetts lança un appel en faveur de la ville sinistrée aux trois cent cinquante-quatre maires de son État ; et grâce à la générosité de la Bell Company, qui achemina gratuitement les messages, ceux-ci furent délivrés aux derniers maires les plus éloignés en moins de cinq heures. Après la destruction de Messina, une commande de bois pour la construction de dix mille nouvelles maisons fut envoyée par câble à New York et téléphonée aux bûcherons de l'Ouest. Cette commande fut exécutée si rapidement que, le douzième jour après l'arrivée du câblogramme, les navires étaient en route pour Messina avec le bois. Après l'inondation de Kansas City en 1903, alors que la ville inondée se retrouvait sans chemin de fer, sans tramway ni éclairage électrique, c'est le téléphone qui maintint la cohésion de la ville et apporta des secours aux points dangereux. Et après l'incendie de Baltimore, le central téléphonique fut le dernier à s'arrêter et le premier à se relever. Ses employées restèrent assises sur leurs tabourets au standard jusqu'à ce que les vitres soient brisées par la chaleur. Puis elles tirèrent les couvertures sur le tableau et sortirent. Deux heures plus tard, le bâtiment était en cendres. Trois heures plus tard, un autre bâtiment était loué à la périphérie de la ville, encore intacte, et les chefs des lignes étaient au travail. En un jour, un système de fils était mis à la disposition des fonctionnaires municipaux. En deux jours, ceux-ci étaient reliés aux lignes longue distance ; et en onze jours, un standard de deux mille lignes était en parfait état de marche. Cet exploit reste un record en matière de reconstruction.
Dans l'urgence absolue de la guerre, le téléphone est presque aussi indispensable que le canon. C'est du moins ce que croyaient les Japonais, qui opéraient leurs armées par téléphone lorsqu'ils repoussaient les Russes. Chaque corps de troupes japonais avançait tel un ver à soie, laissant derrière lui un fil de cuivre rouge étincelant. Lors de la bataille décisive de Moukden, l'armée du ver à soie, aux mille pattes, rampa contre les armées russes en un vaste croissant, long de cent soixante kilomètres. Grâce à ce fil rouge étincelant, les différentes batteries et régiments furent organisés en quinze divisions. Chaque groupe de trois divisions était relié à un général, et les cinq généraux étaient reliés au grand Oyama lui-même, assis à seize kilomètres en arrière de la ligne de tir et transmettant ses ordres. Chaque régiment s'élançait, l'un des soldats portait un appareil téléphonique. S'ils maintenaient leur position, deux autres soldats accouraient avec une bobine de fil. De cette façon, et sous le feu des canons russes, deux cent cinquante kilomètres de fil furent tendus sur le champ de bataille. Comme le disaient les Japonais, c'est ce « téléphone volant » qui permit à Oyama de manipuler ses forces aussi habilement qu'une partie d'échecs. C'est également au cours de cette guerre que les soldats du Mikado installèrent la plus coûteuse de toutes les lignes téléphoniques, à 203 Meter Hill. Une fois le fil tendu jusqu'au sommet de cette colline, la forteresse de Port-Arthur était à leur merci. Mais l'ascension leur avait coûté vingt-quatre mille vies.
Sur les sept millions de téléphones que comptent les États-Unis, environ deux millions se trouvent aujourd'hui dans des fermes. Un agriculteur américain sur quatre est en contact téléphonique avec ses voisins et le marché. L'Iowa arrive en tête des États agricoles. Dans l'Iowa, ne pas avoir de téléphone, c'est appartenir à ce qu'un Londonien appellerait le « dixième submergé » de la population. L'Illinois arrive en deuxième position, suivi de près par le Kansas, le Nebraska et l'Indiana ; et en bas de la liste, en matière de téléphones agricoles, se trouvent le Connecticut et la Louisiane.
Le premier agriculteur à découvrir l'utilité du téléphone fut le maraîcher. Puis vint le riche agriculteur de la vallée de la Rivière Rouge, tel Oliver Dalrymple, du Dakota du Nord, qui découvrit que grâce au téléphone, il pouvait semer et récolter 12 000 hectares de blé en une seule saison. Puis, il y a à peine six ans, une véritable croisade téléphonique éclata parmi les agriculteurs du Middle West. Les progrès des ingénieurs de Bell avaient rendu possibles des téléphones bon marché, mais de bonne qualité ; et les histoires sur les possibilités offertes par le téléphone devinrent les ragots favoris de l'époque. Un agriculteur avait empêché l'incendie de sa grange en téléphonant à ses voisins ; un autre avait réalisé un bénéfice supplémentaire de cinq cents dollars sur la vente de son bétail en téléphonant au meilleur marché ; un troisième avait sauvé un troupeau de moutons en annonçant rapidement l'approche d'une tempête de neige ; un quatrième avait sauvé la vie de son fils en transmettant un message instantané au médecin ; et ainsi de suite.
Comment le téléphone a sauvé une récolte fruitière de trois millions de dollars au Colorado, en 1909, est l'histoire la plus souvent racontée dans l'Ouest. Jusque-là, les gelées printanières étouffaient les bourgeons. Aucun agriculteur ne pouvait être sûr de sa récolte. Mais en 1909, les fruiticulteurs achetèrent des pots de fumigation – trois cent mille ou plus. Ils les placèrent dans les vergers, prêts à être allumés à tout moment. Ensuite, une alliance fut conclue avec le Bureau météorologique des États-Unis afin que, dès que le Roi du Gel descendait du nord, un avertissement puisse être téléphoné aux agriculteurs. Juste au moment où le Colorado était encore tout rose sous les fleurs de pommiers, le premier avertissement arriva. « Préparez-vous à allumer vos pots de fumigation dans une demi-heure. » Puis les agriculteurs téléphonèrent aux villes les plus proches : « Le gel arrive ; venez nous aider dans les vergers. » Des centaines d'hommes se précipitèrent dans la campagne, à cheval et en chariot. Une demi-heure plus tard, le dernier avertissement arriva : « Allumez ; le thermomètre affiche vingt-neuf degrés. » L'artillerie des pots de fumigation fut incendiée et continua de brûler jusqu'à la nouvelle du retrait des forces glacées. Ainsi, chaque agriculteur du Colorado possédant un téléphone put sauver ses fruits.
Dans certains États agricoles, l'enthousiasme pour le téléphone est tel que des rassemblements de masse sont organisés, avec de somptueux discours sur le thème général « De bonnes routes et des téléphones ». Grâce à cette croisade téléphonique, on compte aujourd'hui près de vingt mille groupes d'agriculteurs, chacun disposant d'un réseau téléphonique commun, et la moitié d'entre eux ayant suffisamment d'initiative pour relier leurs petits réseaux de fils au vaste réseau Bell. Ainsi, au moins un million d'agriculteurs ont été rapprochés des grandes villes autant que de leurs propres granges.
L'apport du téléphone à l'avènement des grandes récoltes est une histoire intéressante en soi. En résumé, on pourrait dire que le téléphone a parachevé le mouvement d'économie de main-d'œuvre initié par la moissonneuse McCormick en 1831. Il a permis à l'agriculteur de se libérer du gaspillage lié au fait d'être son propre garçon de courses. Aux États-Unis, la distance moyenne entre la grange et le marché est de 15 kilomètres, de sorte que chaque trajet économisé représente une journée de travail supplémentaire pour un homme et son équipe. Au lieu de faire des allers-retours, souvent inutiles, l'agriculteur peut désormais rester chez lui et s'occuper de son bétail et de ses récoltes.
Jusqu'à présent, peu d'agriculteurs ont
appris à apprécier la valeur de la qualité du service
téléphonique, comme ils l'ont fait dans d'autres domaines.
Le même homme qui paie six fois le prix des meilleures semences
et qui n'accepte que du bétail de qualité dans son étable
se contentera du service téléphonique le plus médiocre
et le plus fragile, sans autre excuse que son prix bas. Mais il s'agit
d'une phase transitoire de la téléphonie agricole. Le
coût d'un système agricole efficace est aujourd'hui si
faible – pas plus de deux dollars par mois – que les lignes
actuelles, de mauvaise qualité, finiront tôt ou tard par
disparaître, au même titre que la faucille, le fléau
et tous les autres appareils bon marché et peu rentables.
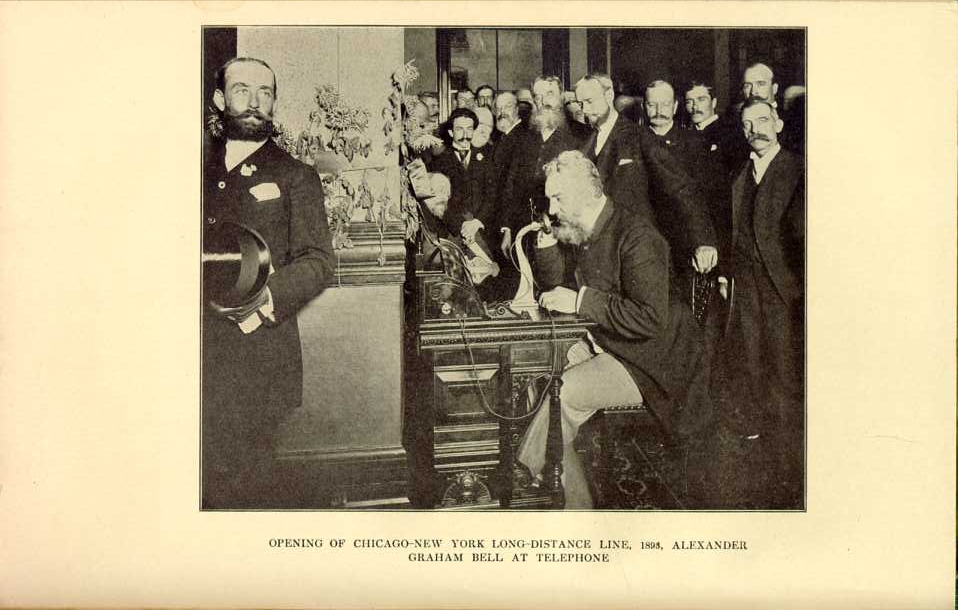
OUVERTURE DE LA LIGNE LONGUE DISTANCE CHICAGO-NEW YORK, 1893, ALEXANDER
GRAHAM BELL AU TÉLÉPHONE
LE TÉLÉPHONE ET L'EFFICACITÉ NATIONALE
L'importance majeure du téléphone réside dans le fait qu'il a achevé d'éliminer les éléments ermites et gitans de la civilisation. De manière presque idéale, il a rendu possible l'intercommunication sans déplacement. Il a permis à un homme de s'installer définitivement au même endroit tout en restant en contact personnel avec ses semblables.
Jusqu'aux derniers siècles, une grande partie du monde était probablement ce qu'est aujourd'hui le Maroc : une région sans véhicules à roues ni même routes. On raconte l'histoire mythique d'un merveilleux porte-voix qu'Alexandre le Grand possédait, lui permettant d'appeler un soldat à dix milles de distance ; mais rien ne pouvait remplacer la voix humaine, si ce n'est les drapeaux et les feux de signalisation, ou tout autre moyen de transport plus rapide que la vitesse d'un cheval ou d'un chameau à travers des plaines non nivelées. La première sensation de rapidité est sans doute venue avec le voilier ; mais celui-ci était le jouet des vents, et il était peu fiable. Lorsque Colomb osa entreprendre son célèbre voyage, il mit cinq semaines à traverser l'Espagne jusqu'aux Antilles, son meilleur record journalier étant de deux cents milles. La rapidité des voyages en bateau à vapeur d'aujourd'hui ne commença qu'en 1838, lorsque le Great Western traversa l'Atlantique en quinze jours.
Quant aux systèmes organisés d'intercommunication, ils étaient inconnus même sous le règne d'un Périclès ou d'un César. Il n'y eut pas de bureau de poste en Grande-Bretagne avant 1656, soit une génération après le début de la colonisation de l'Amérique. Il n'y eut pas de malle-poste anglaise avant 1784 ; et lorsque Benjamin Franklin était ministre des Postes à Philadelphie, une réponse par courrier de Boston, lorsque tout allait bien, ne nécessitait pas moins de trois semaines. Il n'y eut même pas de route goudronnée dans les treize États-Unis avant 1794 ; ni même de timbre-poste avant 1847, année de la naissance d'Alexander Graham Bell. Cette même année, Henry Clay prononça son mémorable discours sur la guerre du Mexique à Lexington, dans le Kentucky, et il fut télégraphié au New York Herald pour un coût de cinq cents dollars, battant ainsi tous les records précédents en matière de collecte d'informations. Onze ans plus tard, le premier câble établit un langage des signes instantané entre Américains et Européens ; et en 1876, le téléphone, parfaitement utilisable à distance, fit son apparition.
Aucune invention n'a été plus opportune que le téléphone. Il est arrivé au moment précis où il était nécessaire à l'organisation des grandes cités et à l'unification des nations. Les idées et les énergies nouvelles de la science, du commerce et de la coopération commençaient à remporter des victoires partout dans le monde. Le premier chemin de fer venait d'arriver en Chine ; le premier parlement au Japon ; la première constitution en Espagne. Stanley se déplaçait tel un minuscule point lumineux au cœur du continent noir. L'Union postale universelle avait été fondée dans une petite salle à Berne. Le mouvement de la Croix-Rouge avait douze ans. Un Congrès international d'hygiène se tenait à Bruxelles et un Congrès international de médecine à Philadelphie. De Lesseps avait achevé le canal de Suez et examinait Panama. L'Italie et l'Allemagne venaient de se constituer en nations ; la France avait finalement balayé l'Empire et la Commune pour instaurer la République. Et grâce aux nouvelles agences que sont les chemins de fer, les bateaux à vapeur, les journaux bon marché, les câbles et les télégraphes, les races civilisées de l'humanité avaient commencé à se souder pour former une véritable unité.
Pour les États-Unis, en particulier, le téléphone était un ami dans le besoin. Après cent ans de croissance, la République était encore une confédération lâche d'États distincts, plutôt qu'une grande nation unie. Elle venait de s'effondrer pendant quatre ans, séparée par un large gouffre de sang ; et avec deux drapeaux, deux présidents et deux armées. En 1876, elle hésitait à mi-chemin entre le doute et la confiance, entre les vieux problèmes politiques du Nord et du Sud, et les nouveaux enjeux industriels du commerce extérieur et du développement des ressources matérielles. L'Ouest s'ouvrait. Les Indiens et les bisons étaient repoussés. Il y avait une ligne de chemin de fer d'un océan à l'autre. La population augmentait au rythme d'un million par an. Le Colorado venait d'être baptisé nouvel État. Et le problème de savoir si les États-Unis pouvaient rester unis, s'ils pouvaient ou non se transformer en une nation organique sans perdre l'esprit d'entraide et de démocratie restait sans réponse.
Il est difficile de réaliser aujourd'hui à quel point les États-Unis étaient jeunes et primitifs en 1876. Pourtant, le fait est que nous avons deux fois plus d'habitants qu'à l'époque de l'invention du téléphone. Nous avons deux fois plus de blé et deux fois plus d'argent en circulation. Nous avons trois fois plus de chemins de fer, de banques, de bibliothèques, de journaux, d'exportations, de valeurs agricoles et de richesse nationale. Nous avons dix millions d'agriculteurs qui gagnent quatre fois plus d'argent que sept millions d'agriculteurs en 1876. Nous dépensons quatre fois plus pour nos écoles publiques et nous mettons quatre fois plus d'argent à la caisse d'épargne. Nous avons cinq fois plus d'étudiants dans les universités. Et nous avons tellement révolutionné nos méthodes de production que nous produisons aujourd'hui sept fois plus de charbon, quatorze fois plus de pétrole et de fonte, vingt-deux fois plus de cuivre et quarante-trois fois plus d'acier.
En 1876, il n'y avait pas de gratte-ciel, pas de tramways, pas d'éclairage électrique, pas de moteurs à essence, pas de machines à relier, pas de vélos, pas d'automobiles. L'Oklahoma n'existait pas, et la population combinée du Montana, du Wyoming, de l'Idaho et de l'Arizona était à peu près égale à celle de Des Moines. C'est cette année-là que le général Custer fut tué par les Sioux ; que le fragile pont ferroviaire en fer s'effondra à Ashtabula ; que les « Molly Maguires » terrorisèrent la Pennsylvanie ; que le premier fil du pont de Brooklyn fut tendu ; et que Boss Tweed et Hell Gate furent tous deux détruits à New York.
Le Grand Orme, sous lequel les patriotes révolutionnaires s'étaient réunis, se dressait encore sur Boston Common. Daniel Drew, le financier new-yorkais, né avant l'adoption de la Constitution américaine, était toujours en vie ; tout comme le commodore Vanderbilt, Joseph Henry, A.T. Stewart, Thurlow Weed, Peter Cooper, Cyrus McCormick, Lucretia Mott, Bryant, Longfellow et Emerson. La plupart des personnes âgées se souvenaient de la mise en service du premier train ; les personnes d'âge moyen se souvenaient de l'envoi du premier message télégraphique ; et les élèves des lycées se souvenaient de la pose du premier câble transatlantique.
Les grands-pères de 1876 aimaient raconter comment Webster s'opposait à l'intégration du Texas et de l'Oregon à l'Union ; comment George Washington déconseillait d'inclure le fleuve Mississippi ; et comment Monroe avertissait le Congrès qu'un pays qui s'étendait de l'Atlantique au Middle West était « trop vaste pour être gouverné autrement que par une monarchie despotique ». Ils racontaient comment Abraham Lincoln, lorsqu'il était maître de poste de New Salem, transportait les lettres dans sa casquette en peau de raton laveur et les livrait à vue ; comment, en 1822, le courrier était transporté à cheval et non par étapes, afin d'assurer le service le plus rapide ; et comment la nouvelle de l'élection de Madison mit trois semaines à parvenir aux habitants du Kentucky. Lorsqu'il était question du télégraphe, ils racontaient comment, à l'époque révolutionnaire, les patriotes utilisaient un système de signalisation appelé « télégraphe de Washington », composé d'un poteau, d'un drapeau, d'un panier et d'un tonneau.
Ainsi, en 1876, la jeune République était
encore proche de son enfance. Tant par ses sentiments que par ses méthodes
de travail, elle vivait proche de l'époque des cabanes en rondins.
Nombre des anciennes méthodes lentes subsistaient, celles qui
étaient suffisamment rapides à l'époque des diligences
et des briquets. Il y avait soixante-dix-sept mille kilomètres
de voies ferrées, mais mal construites et courtes. Il y avait
des industries manufacturières qui employaient deux millions
quatre cent mille personnes, mais chaque métier était
fragmenté en un chaos de petites unités concurrentes,
chacune en guerre avec les autres. Il y avait de l'énergie et
de l'esprit d'entreprise au plus haut degré, mais pas d'efficacité
ni d'organisation. Aussi peu que nous le sachions, en 1876, nous rassemblions
principalement les plans et les matières premières pour
la
construction du monde des affaires moderne, avec sa vie rapide et intense
et sa structure nationale d'immenses industries coordonnées.
En 1876, l'ère de la spécialisation et de la communauté d'intérêts était à son apogée. Le cordonnier avait cédé la place à l'usine sophistiquée, où soixante-dix hommes collaboraient pour fabriquer une chaussure. Le marchand qui vivait jusque-là au-dessus de son magasin s'aventurait désormais à s'installer en banlieue. Nul n'était plus un Robinson Crusoé autosuffisant. Il était une fraction, un élément d'un mécanisme social, qui devait nécessairement rester en contact étroit avec de nombreux autres.
Une nouvelle forme de civilisation interdépendante était sur le point de se développer, et le téléphone arriva à point nommé pour la rendre fonctionnelle et pratique. C'était le déploiement d'un nouvel organe. De même que l'œil était devenu télescope, la main machine et les pieds chemins de fer, la voix devint téléphone. C'était un nouveau moyen de communication idéal, rendu indispensable par de nouvelles conditions. La prophétie de Carlyle s'était réalisée : « On ne peut plus lier les hommes à des hommes par des colliers de cuivre ; il faudra les lier par des méthodes bien plus nobles et plus astucieuses. »
Les chemins de fer et les bateaux à vapeur avaient
amorcé cette œuvre de rapprochement entre les hommes par
des « méthodes plus nobles et plus astucieuses ».
Le télégraphe et le câble étaient allés
encore plus loin, permettant à tous les peuples civilisés
de se voir, de communiquer grâce à une sorte d'alphabet
muet et sourd. Puis vint le téléphone, permettant une
communication directe et instantanée, permettant aux peuples
de chaque nation de se parler. Ce fut l'aboutissement d'une longue série
d'inventions. C'était la clé de voûte. C'était
l'ultime amélioration qui permit aux nations interdépendantes
de se gérer et de rester unies.
Faire transporter des lettres par les chemins de fer
et les bateaux à vapeur a beaucoup contribué à
l'évolution des moyens de communication. Faire transporter des
signaux par le fil électrique l'a été davantage,
en raison de la transmission instantanée d'informations importantes.
Mais faire transporter la parole par le fil électrique a été
LE PLUS important, car cela a mis tous les concitoyens face à
face et a rendu le message et la réponse instantanés.
L'invention du téléphone a appris au génie de l'électricité
à faire mieux que de transmettre des messages dans la langue
des signes des muets. Elle lui a appris à parler. Comme l'a si
bien dit Emerson :
Nous avions des lettres à envoyer. Les courriers ne pouvaient
aller ni assez vite ni assez loin ; leurs chariots cassaient, leurs
chevaux fourvoyaient ; les mauvaises routes au printemps, les congères
en hiver, la chaleur en été… ils ne parvenaient pas
à faire bouger leurs chevaux. Mais nous avons découvert
que l'air et la terre étaient chargés d'électricité
et qu'ils allaient toujours dans notre direction, exactement comme nous
le voulions. ACCEPTAIT-IL UN MESSAGE ? Aussi bien ? Il n'avait rien
d'autre à faire ; il le porterait en un rien de temps.
Quant à la valeur exacte du téléphone pour les États-Unis, en dollars et en cents, personne ne peut le dire. Un statisticien a estimé à trois millions de dollars par jour les économies réalisées grâce au téléphone. Ce montant peut être bien trop élevé, ou trop faible. Il ne peut s'agir que d'une estimation. La seule façon adéquate d'estimer la valeur du téléphone est de considérer la nation dans son ensemble, de la considérer comme une entreprise en activité, et de constater qu'une telle nation serait absolument impossible sans son service téléphonique. Nous pourrions avoir une sorte de république plus lente et moins performante, avec de petites unités industrielles, de longues heures de travail, des salaires plus bas et des méthodes plus maladroites. La perte financière serait énorme, mais plus grave encore serait la perte de QUALITÉ DE VIE NATIONALE. Inévitablement, une nation sans téléphone est moins sociale, moins unie, moins progressiste et moins efficace. Elle appartient à une espèce inférieure.
Comment créer une civilisation organisée et rapide, au lieu d'une barbarie chaotique et lente ? Tel est le problème universel de l'humanité, qui n'est pas encore totalement résolu aujourd'hui. Comment développer une science de l'intercommunication, née lorsque les animaux sauvages ont commencé à se déplacer en troupeaux et à se protéger de leurs ennemis par un langage de signaux de danger, et démocratiser cette science jusqu'à ce que la nation entière devienne consciente d'elle-même et capable d'agir comme un seul être vivant ? Tel est l'aspect de ce problème universel qui a finalement nécessité l'invention du téléphone.
L'utilisation du téléphone a engendré une nouvelle habitude mentale. L'humeur morose et léthargique s'est dissipée. La vieille habitude du « demain » a été remplacée par le « Fais-le aujourd'hui » ; et la vie est devenue plus tendue, plus alerte, plus vive. Le cerveau a été libéré de l'attente d'une réponse, ce qui constitue un gain psychologique de grande importance. Il reçoit sa réponse immédiatement et est libre de se consacrer à d'autres sujets. La mémoire est moins sollicitée et l'ESPRIT ENTIER peut être consacré à chaque nouvelle proposition.
Un nouvel instinct de vitesse s'est développé, bien plus pleinement aux États-Unis qu'ailleurs. « Aucun Américain ne va lentement », disait Ian Maclaren, « s'il a la possibilité d'aller vite ; il ne s'arrête pas pour parler s'il peut parler en marchant ; et il ne marche pas s'il peut monter à cheval. » Il est aussi heureux qu'un enfant avec un nouveau jouet lorsqu'un record de vitesse est battu, lorsqu'une paire de chaussures est fabriquée en onze minutes, lorsqu'un homme pose douze cents briques en une heure, ou lorsqu'un navire traverse l'Atlantique en quatre jours et demi. Même les secondes sont désormais comptées et divisées en fractions. Le temps moyen, par exemple, pour répondre à un appel téléphonique d'un opérateur new-yorkais est désormais de trois secondes et deux cinquièmes ; et même ce minuscule atome de temps s'épuise à grand-peine.
Comme le disait un Français plein d'esprit, l'un de nos plus vifs regrets est de ne pouvoir travailler avec nos pieds, lorsque nous sommes au téléphone. Nous considérons comme une victoire sur l'hostilité de la nature le fait de réaliser une heure de travail en une minute, ou une minute de travail en une seconde. Au lieu de dire, comme les Espagnols : « La vie est trop courte ; que peut faire une personne seule ? », un Américain est plus enclin à dire : « La vie est trop courte ; il faut donc que je fasse le travail d'aujourd'hui aujourd'hui. » Consommer toute une vie d'énergie – telle est la stratégie américaine – et l'économiser pour obtenir les meilleurs résultats. Obtenir une réponse à une question en cinq minutes grâce à un fil électrique, au lieu de deux heures par le lent cheminement d'un coursier – telle est la méthode qui correspond le mieux à notre passion pour l'instantanéité.
C'est l'une des rares lois sociales dont nous soyons assez sûrs : une nation s'organise proportionnellement à sa vitesse. Nous savons qu'une nation roulant à quatre milles à l'heure doit rester une immense masse inerte de paysans et de villageois ; sinon, si, après des siècles de lents labeurs, elle devait constituer une grande ville, celle-ci s'effondrerait tôt ou tard sous son propre poids. C'est ainsi que Babylone s'est élevée et est tombée, puis Ninive, Thèbes, Carthage et Rome. La simple masse, inorganisée, devient son propre destructeur. Elle meurt d'encombrement et de congestion. Mais lorsque la fusée de Stephenson a filé à quarante-neuf milles à l'heure, que le télégraphe de Morse a transmis ses signaux de Washington à Baltimore, et que le téléphone de Bell a fait vibrer les vibrations de la parole entre Boston et Salem, une nouvelle ère a commencé. Vint l'ère de la vitesse et des nations finement organisées. Des villes d'une taille sans précédent sont apparues, mais maintenues si étroitement ensemble par un réseau de rails d'acier et de fils de cuivre qu'elles sont devenues plus alertes et coopératives que n'importe quel petit hameau de huttes en terre sur les rives du Congo.
Il n'est peut-être pas exagéré d'affirmer que le téléphone est aujourd'hui le principal facteur de cohésion entre toutes sortes d'individus, si l'on considère qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis soixante-dix mille actionnaires de Bell et dix millions d'utilisateurs du service téléphonique. Deux cent soixante-quatre fils traversent le Mississippi dans le réseau Bell ; et cinq cent quarante-quatre traversent la ligne Mason et Dixon. C'est le téléphone qui contribue le plus à relier les cottages, les gratte-ciel, les manoirs, les usines et les fermes. Il ne se limite pas aux experts ou aux diplômés universitaires. Il touche aussi bien les riches que les riches. Il parle toutes les langues et dessert tous les métiers. Il contribue à prévenir le sectarisme et les querelles raciales. Il offre un lieu de rencontre commun aux capitalistes et aux salariés. Il est si essentiellement l'instrument de tous, en fait, qu'on pourrait presque le considérer comme un emblème national, comme la marque de fabrique de la démocratie et de l'esprit américain.
Dans un pays comme le nôtre, où quatre-vingts nationalités sont représentées dans les écoles publiques, le téléphone revêt une importance particulière en tant qu'élément du système digestif national. Il prévient la prolifération des dialectes et favorise l'assimilation. La vie américaine est telle que les humbles immigrants venus d'Europe du Sud, avant même d'être arrivés il y a six ans, ont pris l'habitude du téléphone et ont relié leurs petites boutiques au vaste réseau d'intercommunication. Dans la communauté de Brownsville, par exemple, colonisée il y a plusieurs années par un afflux de Juifs russes venus de l'East Side de New York, on compte aujourd'hui autant de téléphones qu'en Grèce. Et dans l'East Side grouillant lui-même, il existe un seul central téléphonique, sur Orchard Street, qui possède plus de fils que tous les centraux d'Égypte.
Il existe peu d'idéaux plus nobles en matière de démocratie pratique que celui que nous propose l'ingénieur du téléphone. Son objectif va bien au-delà de la fourniture de téléphones à ceux qui en ont besoin. Il s'agit plutôt de rendre le téléphone aussi universel que le robinet d'eau, de mettre à portée de voix chaque unité économique, de relier à l'organisme social toute personne dont on peut avoir besoin à tout moment. De même que le cliquetis de la moissonneuse signifie le pain, le ronronnement de la machine à coudre signifie les vêtements, le rugissement du convertisseur Bessemer signifie l'acier, et le cliquetis de la presse signifie l'éducation, de même la sonnerie du téléphone est devenue synonyme d'unité et d'organisation.
Déjà, grâce au câble, au télégraphe et au téléphone, aucune ville du monde civilisé n'est à plus d'une heure de distance. Nous avons même parcouru la Terre d'un câblogramme en douze minutes. Nous avons permis à n'importe quel New-Yorkais d'engager la conversation avec n'importe quel autre New-Yorkais en vingt et une secondes. Nous ne nous sommes pas contentés d'établir un système de transport permettant de partir n'importe où n'importe quand depuis n'importe où ; nous ne nous sommes pas non plus contentés d'établir un système de communication faisant des nouvelles et des ragots le bien commun de toutes les nations. Nous sommes allés plus loin. Nous avons établi dans chaque grande région peuplée un système de communication qui met chaque homme à l'écoute de tous et qui élimine si magiquement le facteur de distance que les États-Unis se retrouvent à cinq mille kilomètres de voisins, côte à côte.
Cet effort pour conquérir le Temps et l'Espace relève avant tout de l'instinct du progrès matériel. Raccourcir les kilomètres et allonger les minutes – telle a été l'une des passions maîtresses de l'humanité. Ainsi, la vérité fondamentale concernant le téléphone est qu'il est bien plus qu'un simple accessoire. Il ne doit pas être classé au même titre que les rasoirs de sûreté, les pianistes et les stylos-plume. Il n'est rien de moins que l'outil ultra-rapide de la civilisation, qui accélère le mécanisme pour un service social plus efficace. Il est le symbole de l'efficacité et de la coopération nationales.
Tout cela, le téléphone le fait, pour
un coût total pour la nation d'environ 200 millions de dollars
par an – soit à peine plus que ce que gagnent les agriculteurs
américains en dix jours. Nous le payons au même prix que
les pommes de terre, un tiers de la récolte de foin ou un huitième
du maïs. Sur chaque centime dépensé en électricité,
un centime est consacré au téléphone. Nous pourrions
régler notre facture de téléphone et avoir plusieurs
millions de dollars de plus si nous supprimions un verre d'alcool sur
quatre et la fumée de tabac. Quiconque loue une machine à
écrire,
utilise le tramway deux fois par jour ou fait cirer ses chaussures une
fois par jour peut, pour la même dépense, bénéficier
d'un excellent service téléphonique. Le simple fait de
pelleter la neige d'une seule tempête en 1910 a coûté
à la municipalité de New York autant que cinq ou six années
de téléphone.
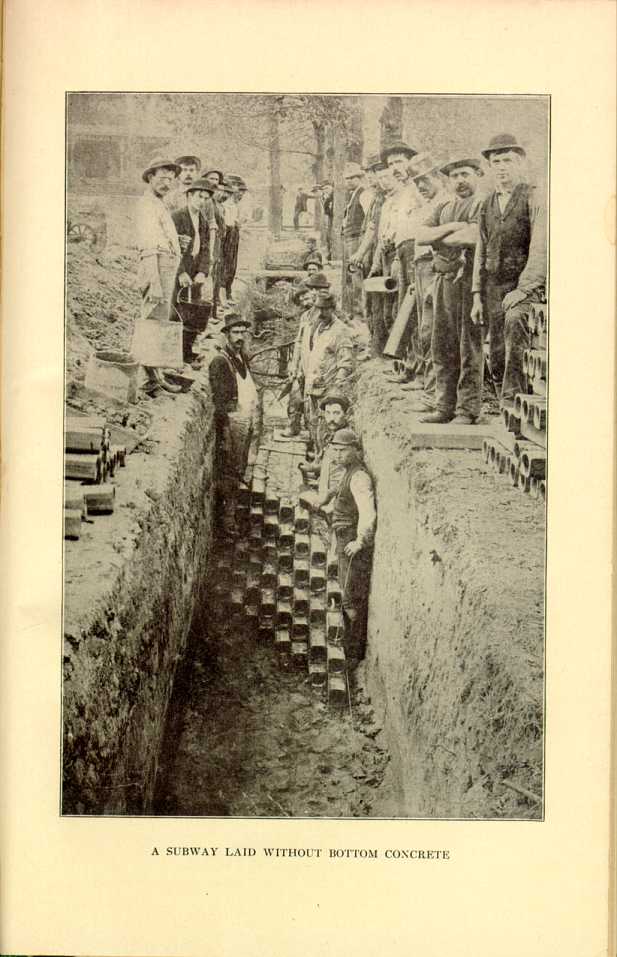
Ce prix incroyablement bas de la téléphonie est encore loin d'être généralement perçu, principalement pour des raisons psychologiques. Un téléphone n'est pas impressionnant. Il est léger. Il ne ressemble pas au Singer Building ou au Lusitania. Ses fils, ses standards et ses batteries sont dispersés et dissimulés, et rares sont ceux qui ont l'imagination suffisante pour les imaginer dans toute leur complexité. Si seulement il était possible de réunir la centaine de bâtiments téléphoniques de New York sur une seule et même vaste place, et si les deux mille employés, les trois mille agents d'entretien et les six mille opératrices se rendaient chaque matin au travail avec fanfares et banderoles, alors peut-être y aurait-il cette force d'impression indispensable pour que toute idée d'envergure soit toujours transmise au public.
Faute de pièce de sept cents et demi, la téléphonie à cinq cents existe désormais, même dans les plus grandes villes américaines. Pour cinq cents, quiconque le souhaite dispose d'un système téléphonique complet, un système prêt jour et nuit, prêt à l'emploi dès qu'il en a besoin. Ce système a pu coûter entre vingt et cinquante millions, et pourtant, on peut le louer pour un huitième du prix d'une voiture. Même en téléphonie longue distance, le coût d'un message est dérisoire comparé au prix d'un billet de train aller-retour. Un appel de New York à Philadelphie, par exemple, coûte soixante-quinze cents, tandis que le trajet en train coûte quatre dollars. De New York à Chicago, un appel coûte cinq dollars, contre soixante-dix dollars en train. Comme l'a dit Harriman : « Je ne peux pas me rendre de chez moi à la gare pour le prix d'un appel jusqu'à Omaha. »
Dire quels ont été les bénéfices nets, pour l'ensemble des personnes ayant investi dans le téléphone, relèvera toujours plus ou moins de la conjecture. La croyance générale selon laquelle d'immenses fortunes ont été amassées par les heureux détenteurs d'actions Bell est une exagération entretenue par les promoteurs de sociétés sauvages. De telles fortunes n'ont jamais été faites. « Je ne crois pas », déclare Theodore Vail, « qu'un seul homme ait jamais gagné un million grâce au téléphone. » Il est peu probable que des fortunes rapides s'acquièrent dans les sociétés qui n'émettent pas d'actions diluées et ne capitalisent pas leurs franchises. Au contraire, jusqu'en 1897, les détenteurs d'actions des sociétés Bell avaient versé quatre millions sept cent mille dollars de plus que la valeur nominale ; et lors de la récente consolidation des sociétés de l'Est, sous la présidence d'Union N. Bethell, les nouvelles actions valaient en réalité huit millions de dollars de moins que les actions retirées.
Au début, peu de compagnies de téléphone réalisaient des bénéfices. Elles avaient sous-estimé le coût de construction et d'entretien. Denver prévoyait un coût de deux mille cinq cents dollars et a dépensé soixante mille dollars. Buffalo, qui s'attendait à payer trois mille dollars, a dû débourser cent cinquante mille dollars. De plus, elles ont découvert, à contrecœur, qu'un central de deux cents dollars coûte plus de deux fois plus cher qu'un central de cent dollars, en raison du trafic plus important. Habituellement, un dollar versé à une compagnie de téléphone est réparti comme suit :
Loyer ……….......… 4c
Impôts ………......... 4c
Intérêts ……............. 6c
Surplus …….........… 8c
Entretien …............... 16c
Dividendes …........… 18c
Main-d'œuvre ………. 44c
—-
............................. 1,00 $
La plupart des problèmes tarifaires (et leur nom est légion) sont nés d'une incompréhension du secteur téléphonique. En fait, jusqu'à récemment, il ne se connaissait pas lui-même. Il persistait à s'en tenir à une vision locale et individualiste de son activité. Il tardait à installer des téléphones dans les endroits non rentables. Il s'attendait à ce que chaque appareil soit rentable. Dans de nombreux États, les opérateurs téléphoniques et le public ont négligé le fait le plus crucial : l'interdépendance des membres d'un réseau téléphonique.
Un téléphone en soi n'a aucune valeur. Il est aussi inutile qu'une anche découpée dans un orgue ou qu'un doigt arraché à une main. Il n'est même pas décoratif ni adaptable à un autre usage. Il n'a rien à voir avec un piano ou une machine parlante, qui ont une existence distincte. Son utilité n'est proportionnelle qu'au nombre d'autres téléphones qu'il dessert. ET CHAQUE TÉLÉPHONE, OÙ QU'IL SOIT, AJOUTE DE LA VALEUR À TOUS LES AUTRES TÉLÉPHONES CONNECTÉS AU MÊME RÉSEAU. En un mot, la clé des tarifs équitables.
Bien des téléphones, pour le bien commun, doivent être installés là où ils ne sont pas rentables. À tout moment, une urgence soudaine peut survenir et les rendre momentanément inestimables. Depuis l'avènement de l'automobile, il n'existe aucun recoin d'où il ne soit absolument nécessaire, de temps à autre, d'envoyer un message. Ce principe a récemment été appliqué de manière très concrète par la Pennsylvania Railroad, qui a installé à ses frais cinq cent vingt-cinq téléphones chez ses ouvriers d'Altoona. De même, il est clairement du devoir social de la compagnie de téléphone d'étendre son réseau jusqu'à ce que chaque point soit couvert, puis de répartir ses frais bruts aussi équitablement que possible. L'ensemble doit supporter l'ensemble – telle est la philosophie des tarifs qui doit finalement être reconnue par les législateurs et les compagnies de téléphone. Bien sûr, cela ne peut jamais être réduit à un système ou à une formule. Ce sera toujours une question d'opinion et de compromis, exigeant beaucoup d'habileté et de patience. Mais les problèmes sérieux seront rares une fois ses principes fondamentaux compris.
Comme toutes les inventions permettant de gagner du
temps, comme le chemin de fer, la moissonneuse-batteuse et le convertisseur
Bessemer,
le téléphone, en dernière analyse, NE COÛTE
RIEN ; C'EST SON ABSENCE QUI COÛTE. LA NATION QUI A LE PLUS DE
COÛTS EST LA NATION QUI N'EN A PAS.
LE TÉLÉPHONE À L'ÉTRANGER
Le téléphone a eu lieu près
d'un an avant que l'Europe ne prenne connaissance de son existence.
Il n'a reçu aucune attention publique jusqu'au 3 mars 1877, date
à laquelle l'Athenaeum de Londres en fit mention en quelques
phrases prudentes. Il n'a pas été bien accueilli, sauf
par ceux qui souhaitaient passer une soirée divertissante. Et
pour le monde commercial tout entier, il a été, pendant
quatre ou cinq ans, une sorte de Billiken scientifique, qui n'a jamais
pu être d'aucune utilité aux gens sérieux.
L'un après l'autre, plusieurs Américains enthousiastes se précipitèrent en Europe, rêvant de nations avides de systèmes téléphoniques, et ils échouèrent l'un après l'autre. Frederick A. Gower fut le premier d'entre eux. C'était un chevalier d'affaires aventureux qui renonça à son contrat d'agent en échange du droit de devenir propagandiste itinérant. Plus tard, il rencontra une prima donna, tomba amoureux d'elle et l'épousa, abandonna la téléphonie pour l'aérostation et perdit la vie en tentant de traverser la Manche.
Ensuite, ce fut William H. Reynolds, de Providence, qui avait acheté cinq huitièmes du brevet britannique pour cinq mille dollars, et la moitié des droits sur la Russie, l'Espagne, le Portugal et l'Italie pour deux mille cinq cents dollars. L'accueil qui lui fut réservé est illustré par une lettre de lui, conservée. « Je travaille à Londres depuis quatre mois », écrit-il ; « Je suis allé à la Banque d'Angleterre et ailleurs ; et je n'ai pas trouvé un seul homme prêt à investir un seul shilling dans le téléphone. »
Bell lui-même se précipita en Angleterre
et en Écosse pour sa tournée de noces en 1878, espérant
que son invention serait appréciée dans
son pays natal. Mais d'un point de vue commercial, sa mission fut un
échec total. Il reçut de nombreux dîners, mais aucun
contrat ; il revint aux États-Unis appauvri et découragé.
L'optimiste Gardiner G. Hubbard, beau-père de Bell, se lança
alors contre l'inertie européenne et créa les compagnies
de téléphone internationales et orientales, qui restèrent
lettre morte.
La même année, même Enos M. Barton, le sage
fondateur de la Western Electric, se rendit en France et en Angleterre
pour y implanter un commerce d'exportation de téléphones,
mais échoua.
Ces hommes compétents ont vu leurs plans contrariés
par l'indifférence du public, et souvent par une hostilité
ouverte. « Le téléphone n'est guère mieux
qu'un jouet », disait la Saturday Review ; « il étonne
un instant les ignorants, mais il est inférieur au système
bien établi des tubes à air. » « Que deviendra
l'intimité de la vie ? » demandait un autre rédacteur
en chef londonien. « Que deviendra le caractère sacré
du foyer domestique ? » Les écrivains rivalisaient d'imagination
pour dénigrer Bell et son invention. « C'est ridiculement
simple », disait l'un. « Ce n'est qu'un tube électrique
parlant », disait un autre. « C'est une forme compliquée
de porte-voix », disait un troisième. Aucun rédacteur
en chef britannique ne pouvait d'abord concevoir une quelconque utilité
au téléphone, sauf pour les plongeurs et les mineurs de
charbon. Le prix, lui aussi, suscita un tollé général.
Des flots de téléphones jouets étaient vendus dans
les rues à un shilling pièce ; Et bien que le gouvernement
demandait soixante dollars par an pour l'utilisation de ses télégraphes-imprimeurs,
la population protestait vivement contre le fait de payer la moitié
de ce prix pour le téléphone.
En 1882 encore, Herbert Spencer écrivait : « Le téléphone
est très peu utilisé à Londres et est inconnu dans
les autres villes anglaises. »
Le premier homme d'importance à se passionner pour le téléphone fut Lord Kelvin, alors un jeune scientifique anonyme. Il avait vu les téléphones originaux au Centennial de Philadelphie et en était si fasciné que l'impulsif Bell les lui avait offerts. Lors de la réunion suivante de l'Association britannique pour l'avancement des sciences, Lord Kelvin les exposa. Il fit plus encore. Il devint le défenseur du téléphone. Il mit sa réputation en jeu. Il raconta l'histoire des tests effectués au Centennial et assura aux scientifiques sceptiques qu'il n'avait pas été trompé. « Tout cela, mes propres oreilles l'ont entendu », dit-il, « me l'ont transmis avec une netteté indéniable par ce disque de fer circulaire. »
Les scientifiques et les experts en électricité
étaient, pour la plupart, divisés en deux camps. Certains
affirmaient que le téléphone était impossible,
tandis que d'autres affirmaient que « rien ne pouvait être
plus simple ». Presque tous s'accordaient à dire que l'initiative
de Bell n'était qu'une plaisanterie. Mais Lord Kelvin persista.
Il martela la vérité : le téléphone était
« l'une des inventions les plus intéressantes de l'histoire
des sciences ». Il fit une démonstration avec une extrémité
du fil dans une mine de charbon. Il se tenait aux côtés
de Bell lors d'une réunion publique à Glasgow et déclara
:
« Les appareils qu'on appelait téléphones avant
Bell étaient aussi différents du téléphone
de Bell qu'une série de claquements de mains est différente
de la voix humaine. Il s'agissait en fait de claquements électriques
; Bell avait alors l'idée – une idée totalement originale
et inédite – de donner une continuité aux chocs,
afin de reproduire parfaitement la voix humaine. »
Un à un, les scientifiques furent contraints de prendre le téléphone au sérieux. Lors d'un test public, un professeur réputé, encore sceptique, fut invité à envoyer un message. Il s'approcha de l'appareil avec un sourire incrédule et, prenant toute cette démonstration pour une plaisanterie, cria dans le micro : « Salut, mon pote ! » Puis il attendit une réponse. Son expression se transforma en une expression de stupeur extrême. « Il est écrit : “Le chat et le violon” », haleta-t-il, et il se convertit aussitôt à la téléphonie. Grâce à ces tests, les hommes de science furent convaincus et, vers le milieu de l'année 1877, Bell reçut un « accueil enthousiaste » lorsqu'il s'adressa à eux lors de leur congrès annuel à Plymouth.
Peu après, le Times de Londres capitula. Il fit volte-face et porta le téléphone aux nues. « Soudain et silencieusement, l'humanité entière est à portée de voix et d'écoute », s'exclama-t-il ; « rien n'était plus désirable et plus impossible. » Le journal suivant à quitter la foule des moqueurs fut le Tatler, qui déclara dans un éditorial : « Nous ne pouvons qu'être impressionnés par l'image d'un enfant humain commandant à la force la plus subtile et la plus puissante de la nature de propager, tel un esclave, un murmure à travers le monde. »
Peu après les scientifiques et les éditeurs, la noblesse fit son apparition. Le comte de Caithness ouvrit la voie. Il déclara publiquement : « Le téléphone est la chose la plus extraordinaire que j'aie jamais vue de ma vie. » Un matin d'hiver de 1878, la reine Victoria se rendit en voiture chez Sir Thomas Biddulph, à Londres, et, pendant une heure, elle parla et écouta au téléphone Kate Field, assise dans un bureau de Downing Street. Mlle Field chanta « Kathleen Mavourneen », et la reine la remercia par téléphone, se déclarant « extrêmement heureuse ». Elle félicita Bell lui-même, présent, et lui demanda s'il lui serait permis d'acheter les deux téléphones ; Bell lui en offrit alors une paire en ivoire.
Cet incident, comme on peut l'imaginer, contribua grandement à établir la réputation de la téléphonie en Grande-Bretagne. Un fil fut aussitôt tendu jusqu'au château de Windsor. D'autres furent commandés par le Daily News, l'ambassadeur de Perse et cinq ou six lords et baronnets. Puis arriva une commande qui porta les espoirs des opérateurs téléphoniques au plus haut point, émanant de la banque JS Morgan & Co. C'était la première reconnaissance des « sièges des puissants » du monde des affaires et de la finance. Un petit central, doté de dix fils, fut rapidement mis en service à Londres ; et le 2 avril 1879, Theodore Vail, le jeune directeur de la Bell Company, envoya une commande à l'usine de Boston : « Veuillez fabriquer cent téléphones portables pour l'exportation dès que possible. » Le commerce extérieur avait commencé.
Puis un coup de tonnerre survint, une catastrophe totalement imprévue. Alors que quelques entreprises dynamiques commençaient à voir le jour, le ministre des Postes proclama soudain que le téléphone était une sorte de télégraphe. Selon une loi britannique, le télégraphe devait être un monopole d'État. Cette loi avait été votée six ans avant la naissance du téléphone, mais peu importait. Les opérateurs téléphoniques protestèrent et argumentèrent. Tyndall et Lord Kelvin avertirent le gouvernement qu'il commettait une erreur indéfendable. Mais rien ne pouvait être fait. De même que les premiers chemins de fer avaient été qualifiés de routes à péage, le téléphone fut solennellement déclaré télégraphe. De plus, pour ajouter à l'humour absurde de la situation, le juge Stephen, de la Haute Cour de justice, prononça le dernier mot qui imposa légalement le téléphone à être un télégraphe, et appuya son opinion par une citation du dictionnaire Webster, publié vingt ans avant l'invention du téléphone.
Après avoir conquis ce nouveau rival, que faire ensuite ? Le ministre des Postes l'ignorait. Il n'avait, bien sûr, aucune expérience en téléphonie, pas plus que ses fonctionnaires du service télégraphique. Il n'y avait ni manuel ni université pour l'instruire. Son télégraphe était alors, comme aujourd'hui, un échec commercial. Il ne rapportait pas sa vie. Il n'osa donc pas prendre le risque de construire un second réseau de lignes et finit par consentir à accorder des licences à des entreprises privées.
Mais la confusion persistait. Afin de forcer la concurrence,
selon les théories académiques de l'époque, des
licences furent accordées à treize entreprises privées.
Comme on pouvait s'y attendre, la plus compétente avala rapidement
les douze autres. Si on l'avait laissée tranquille, cette entreprise
aurait pu offrir un bon service, mais elle était entravée
et encadrée par une réglementation jalouse. Elle était
contrainte de verser un dixième de ses bénéfices
bruts à la Poste. Elle devait se tenir prête à vendre
avec un préavis de six mois. Et dès qu'elle eut installé
un système de télégrammes longue distance, le ministre
des Postes s'abattit sur elle et le lui confisqua.
Puis, en 1900, la Poste abandonna toutes ses obligations envers l'entreprise
titulaire de la licence et lança une concurrence ouverte. Elle
entreprit de lancer un second système à Londres et, deux
ans plus tard, découvrit son erreur et proposa de coopérer.
Elle accorda des licences à cinq villes qui exigeaient une propriété
municipale. Ces villes se lancèrent courageusement, tambour battant,
enchaînant les mésaventures et finissant par abandonner.
Même Glasgow, première ville à posséder le
réseau municipal, connut son Waterloo avec le téléphone.
Elle dépensa un million huit cent mille dollars pour une installation
obsolète à sa sortie, l'exploita un temps à perte,
puis la vendit à la Poste en 1906 pour un million cinq cent vingt-cinq
mille dollars.
Ainsi, du début à la fin, l'histoire du téléphone en Grande-Bretagne a été une véritable « comédie d'erreurs ». On compte aujourd'hui, dans les deux îles, moins de six cent mille téléphones en service. Londres, avec ses six cent quarante miles carrés de maisons, en compte un quart, et en gagne dix mille par an. Aucune amélioration majeure n'est en cours, la Poste ayant annoncé qu'elle reprendrait et exploiterait toutes les entreprises privées le 1er janvier 1912. Le chaos bureaucratique, semble-t-il, va perdurer indéfiniment.
En Allemagne, la bureaucratie est la même, mais avec moins de soutien. Le monopole gouvernemental est total. Quiconque commet le délit de louer un service téléphonique à ses voisins est passible de six mois de prison. Là encore, le ministre des Postes a régné en maître. Il a imposé le secteur du téléphone au modèle postal. L'habitant d'une petite ville doit payer un tarif aussi élevé pour un service modeste que l'habitant d'une grande ville pour un service important. L'efficacité est satisfaisante, mais pas de vitesse ni de records. Les ingénieurs allemands n'ont pas suivi de près les progrès de la téléphonie aux États-Unis. Ils ont préféré concevoir leurs propres méthodes et ont ainsi créé un assortiment hétéroclite de systèmes, bons, mauvais et indifférents. Au total, l'investissement s'élève probablement à soixante-quinze millions de dollars et le parc téléphonique totalise neuf cent mille téléphones.
Le téléphone a toujours eu la faveur du Kaiser. Il avait pour habitude, lorsqu'il préparait une partie de chasse, de faire installer un fil spécial jusqu'au quartier général de la forêt, afin de pouvoir converser chaque matin avec son cabinet. Il a décerné des diplômes et des distinctions par téléphone. Même son ancien chancelier, von Bülow, a reçu son titre de comte de cette manière informelle. Mais le premier ami du téléphone en Allemagne fut Bismarck. Le vieil Unificateur comprit immédiatement son utilité pour maintenir l'unité nationale et fit construire une ligne entre son palais de Berlin et sa ferme de Varzin, distantes de trois cent trente kilomètres. Cette ligne fut construite dès l'automne 1877, et ce fut la première ligne longue distance d'Europe.
En France, comme en Angleterre, l'État s'est emparé du téléphone dès que les pionniers en ont été les auteurs. En 1889, il a pratiquement confisqué le réseau parisien et, après neuf ans de litiges, a versé cinq millions de francs à ses propriétaires. Avec ces débuts téméraires, le système s'est effondré. Il a rassemblé l'ensemble le plus complet des erreurs commises par d'autres nations et en a inventé plusieurs de ses propres mains. Presque tous les maux connus de la bureaucratie ont été développés. Le système tarifaire a été bouleversé ; le tarif forfaitaire, qui ne peut être autorisé avec profit que dans les petites villes, a été appliqué dans les grandes villes, et le tarif des messages, applicable uniquement aux grandes villes, l'a été dans les petites localités. Les opératrices étaient empêtrées dans un labyrinthe de règles de la fonction publique. Elles n'avaient pas le droit de se marier sans l'autorisation du directeur général des Postes ; et elles ne pouvaient en aucun cas oser épouser un maire, un policier, un caissier ou un étranger, de peur de trahir les secrets du standard.
Il n'y avait ni plan national, ni normalisation, ni équipe d'inventeurs et d'améliorateurs. Chaque utilisateur était tenu d'acheter son propre téléphone. Comme l'a dit George Ade : « À Paris, tout ce qui est fixé au mur est susceptible d'être un téléphone. » Ainsi, avec un équipement médiocre et des lourdeurs administratives, le système français est devenu ce qu'il est aujourd'hui : l'exemple le plus flagrant de ce qu'il ne faut pas faire en téléphonie.
Il y a à peine autant de téléphones en France qu'il devrait y en avoir à Paris. Il n'y en a pas autant qu'à Chicago. Les Parisiens exaspérés ont protesté. Ils ont présenté une pétition de trente-deux mille signatures. Ils ont même organisé une « Ligue des Kickers » – une organisation unique au monde – pour exiger un service de qualité à un prix équitable. Les pertes quotidiennes dues à la téléphonie bureaucratique sont devenues énormes. « Une employée maladroite dans un central téléphonique m'a coûté cinq mille dollars le jour de la panique de 1907 », a déclaré George Kessler. Mais le gouvernement tire un bénéfice net de trois millions de dollars par an de son monopole téléphonique ; et jusqu'en 1910, année de la création d'un comité d'amélioration, il ne s'est pas soucié du désagrément du public.
Paris reçut une leçon marquante en matière d'efficacité téléphonique en 1908, lorsque son central téléphonique principal fut totalement détruit par un incendie. « Construire un nouveau standard », disaient les fabricants européens, « prendra quatre ou cinq mois. » Un jeune Chicagoais dynamique fit son apparition. « Nous installerons un nouveau standard en soixante jours », dit-il ; « et nous acceptons de payer six cents dollars par jour de retard. » Jamais un travail aussi rapide n'avait été réalisé. Mais c'était l'occasion pour Chicago de montrer de quoi elle était capable. Paris et Chicago sont distantes de six mille cinq cents kilomètres, soit douze jours de voyage. Le standard devait mesurer cent quatre-vingts pieds de long et comporter dix mille fils. Pourtant, la Western Electric le termina en trois semaines. Il fut transporté d'urgence par six wagons de marchandises jusqu'à New York, chargé sur le vapeur français La Provence et déposé à Paris en trente-six jours ; de sorte qu'à l'expiration de ces soixante jours, il fonctionnait à plein régime avec une équipe de quatre-vingt-dix opérateurs.
La Russie et l'Autriche-Hongrie comptent aujourd'hui environ cent vingt-cinq mille téléphones chacune. Elles sont au coude à coude dans une course qui n'a jamais été aussi rapide. Dans chaque pays, le gouvernement a négligé le téléphone. Il a affamé le secteur par manque de capitaux et n'a déployé aucun effort pour le développer. En dehors de Vienne, Budapest, Saint-Pétersbourg et Moscou, il n'existe aucun système de communication filaire d'importance. L'impasse politique entre l'Autriche et la Hongrie anéantit tout espoir immédiat d'une vie plus heureuse pour le téléphone dans ces pays ; mais en Russie, un changement de politique récent pourrait ouvrir une nouvelle ère. Des permis sont désormais offerts à une entreprise privée dans chaque ville, en échange de 3 % des recettes. Grâce à cette avancée, la Russie a pris le dessus de manière inattendue et est désormais, pour les téléphonistes, le pays le plus libre d'Europe.
Dans la petite Suisse, l'État a toujours été propriétaire, mais avec moins de préjudices pour l'économie qu'ailleurs. Ici, les autorités ont même délaissé le télégraphe au profit du téléphone. Elles ont compris l'importance du fil parlant pour maintenir la cohésion de leurs villages de vallée ; elles ont donc traversé les Alpes à la sauvette avec un système téléphonique bon marché et quelque peu fragile, capable de transmettre soixante millions de conversations par an. Même les moines de Saint-Bernard, qui secourent les voyageurs bloqués par la neige, ont désormais équipé leur montagne de cabines téléphoniques.
Le téléphone le plus haut du monde se trouve au sommet du Mont Rose, dans les Alpes italiennes, à près de cinq kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Il est relié à une ligne qui va jusqu'à Rome, afin qu'une reine puisse parler à un professeur. Dans ce cas, la reine est Marguerite d'Italie et le professeur est Signor Mosso, l'astronome, qui étudie le ciel depuis un observatoire du Mont Rose. À ses frais, la reine a fait tendre ce fil par une équipe de monteurs de lignes, qui ont glissé et pataugé sur la montagne pendant six ans avant de le faire fixer. La situation générale en Italie est similaire à celle de la Grande-Bretagne. Le gouvernement a toujours monopolisé les lignes longue distance et s'apprête maintenant à racheter toutes les entreprises privées. Il n'y a que cinquante-cinq mille téléphones pour trente-deux millions de personnes – autant qu'en Norvège et moins qu'au Danemark. Et dans de nombreuses provinces du sud et de Sicile, le tintement de la sonnerie du téléphone est encore un son inhabituel.
La principale particularité des Pays-Bas est
l'absence de plan national, mais plutôt un patchwork, semblable
au manteau multicolore de Joseph. Chaque ingénieur municipal
a conçu son propre type d'appareil et l'a fait fabriquer sur
mesure. De plus, chaque entreprise est légalement clôturée
dans un périmètre de dix kilomètres, de sorte que
la Hollande est parsemée de systèmes rudimentaires, tous
différents les uns des autres.
- En Belgique, il existe un système gouvernemental depuis 1893
; il y a donc unité, mais pas d'entreprise. L'usine est vétuste
et trop petite.
- L'Espagne possède des entreprises privées, qui fournissent
un service relativement bon à vingt mille personnes.
- La Roumanie en compte deux fois moins.
- Le Portugal possède deux petites entreprises à Lisbonne
et Porto.
- La Grèce, la Serbie et la Bulgarie n'en comptent que deux mille
chacune.
- La petite île glacée d'Islande en compte quatre fois
moins ; et même
- en Turquie, qui était une terre interdite sous le régime
de l'ancien sultan, les Jeunes Turcs importent des boîtiers téléphoniques
et des bobines de fil de cuivre.
- Il existe un pays européen, et un seul, qui ait adopté
l'esprit du téléphone : la Suède.
La téléphonie y a connu un essor fulgurant. La Poste l'a
laissée de côté ; et mieux encore, elle a eu un
homme, un bâtisseur d'entreprise d'une force et d'un talent remarquables,
nommé Henry Cedergren. Si cet homme avait été nommé
maître du téléphone en Europe, l'histoire aurait
été différente. Par son engagement incessant, il
a fait de Stockholm la ville la mieux desservie par le téléphone
en dehors des États-Unis. Il a propulsé son pays jusqu'à
ce qu'avec cent soixante-cinq mille téléphones, il se
classe quatrième parmi les nations européennes. Depuis
sa mort, le gouvernement est entré en scène avec un système
dupliqué, et une guerre a été déclenchée,
chaque année plus coûteuse et absurde.
- L'Asie, avec ses huit cent cinquante millions d'habitants, compte
encore moins de téléphones que Philadelphie, et les trois
quarts d'entre eux se trouvent sur la minuscule île du Japon.
- Les Japonais étaient des téléphonistes enthousiastes
dès le début. Ils disposaient d'un central téléphonique
très fréquenté à Tokyo en 1883. Celui-ci
compte aujourd'hui vingt-cinq mille utilisateurs, et pourrait en compter
davantage s'il n'avait pas été freiné par la politique
particulière du gouvernement. Les fonctionnaires qui gèrent
le système sont des hommes compétents. Ils pratiquent
un prix équitable et réalisent dix pour cent de bénéfice
pour l'État. Mais ils ne parviennent pas à suivre la demande.
L'une des plus étranges aberrations de la propriété
publique est qu'il existe aujourd'hui à Tokyo une LISTE D'ATTENTE
de huit mille citoyens qui proposent de payer pour le téléphone
et ne peuvent l'obtenir. Et lorsqu'un Tokien décède, sa
franchise téléphonique, s'il en possède une, est
généralement inscrite dans son testament comme un bien
de quatre cents dollars.
- L'Inde, deuxième sur la liste asiatique, ne compte pas plus
de neuf mille téléphones, soit un pour trente-trois mille
habitants ! Moins nombreux, en réalité, que dans cinq
gratte-ciel de New York. Les Indes néerlandaises et la Chine
n'en comptent que sept mille chacune,
- mais la Chine a récemment progressé. Un fonds de vingt
millions de dollars doit être consacré à la construction
d'un système national de téléphone et de télégraphe.
Pékin présente aujourd'hui avec émerveillement
et ravissement un nouveau central impeccable, doté de deux centraux
téléphoniques à dix mille fils. D'autres sont en
construction à Canton, Hankou et Tien-Tsin. À terme, le
téléphone prospérera en Chine, comme il l'a fait
dans le quartier chinois de San Francisco. Après le siège
de Pékin, l'impératrice de Chine ordonna qu'un téléphone
soit installé dans son palais, à portée de son
trône de dragon ; et elle se montrait très amicale envers
tout représentant du commerce des « sons de foudre parlants
», nom chinois de la téléphonie.
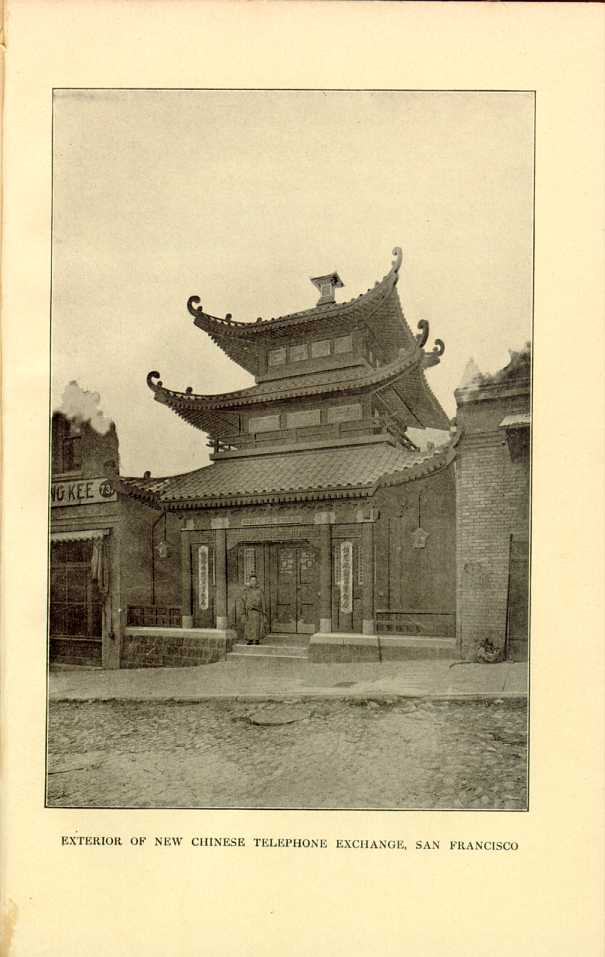

LE NOUVEAU CENTRAL TÉLÉPHONIQUE CHINOIS DE SAN FRANCISCO
- En Perse, le téléphone a récemment
fait son apparition, comme par magie. Un nouveau Shah, dans un élan
de confiance, a installé une ligne téléphonique
entre son palais et la place du marché de Téhéran,
et a invité son peuple à lui parler chaque fois qu'il
avait des griefs. Et ils ont parlé ! Ils ont parlé si
librement et ont tenu un langage si éloquent que le Shah a fait
sortir ses soldats et les a attaqués. Il a tiré sur le
nouveau Parlement et a été aussitôt chassé
de Perse par le peuple en colère. Il semble donc que le téléphone
devrait être populaire en Perse, bien qu'il n'en existe actuellement
pas plus de vingt.
- En dehors de Buenos-Ayres, l'Amérique du Sud compte peu de
téléphones, probablement pas plus de trente mille. Dom
Pedro du Brésil, qui s'était lié d'amitié
avec Bell lors du Centenaire, a introduit la téléphonie
dans son pays en 1881 ; mais en trente ans, elle n'a pas réussi
à atteindre dix mille utilisateurs. Le Canada en compte exactement
autant que la Suède : cent soixante-cinq mille. Le Mexique en
compte peut-être dix mille ; la Nouvelle-Zélande vingt-six
mille ; et l'Australie cinquante-cinq mille.
- Tout en bas de la liste des continents se trouve l'Afrique. L'Égypte et l'Algérie en comptent douze mille au nord ; l'Afrique du Sud britannique en compte autant au sud ; et dans les vastes étendues qui les séparent, il n'y en a guère plus d'un millier. Quiconque s'aventure en Afrique centrale entendra encore le battement du tambour de bois, véritable langage gestuel des indigènes. Un fil de cuivre traverse la région du Congo, posé là sur ordre de l'ancien roi de Belgique. Le tendre fut probablement l'œuvre la plus audacieuse de l'histoire des poseurs de lignes téléphoniques. Il y avait un tronçon de sept cent cinquante milles dans la jungle centrale. Des fourmis blanches mangeaient les poteaux de bois et des éléphants sauvages arrachaient les poteaux de fer. Des singes jouaient à chat perché sur les lignes et des sauvages volaient le fil pour en faire des pointes de flèches. Mais la ligne fut maintenue et, aujourd'hui, les conversations sur le caoutchouc et l'ivoire sont animées.
On peut donc presque dire du téléphone qu'« il n'y a ni parole ni langage là où sa voix ne soit entendue ». On trouve même mille milles de son fil en Abyssinie et cent cinquante milles aux îles Fidji. En gros, il y a aujourd'hui dix millions de téléphones dans tous les pays, employant deux cent cinquante mille personnes, nécessitant vingt et un millions de kilomètres de fil, représentant un coût de quinze cents millions de dollars et assurant quatorze milliards de conversations par an. Et pourtant, les hommes qui ont entendu le premier faible cri du téléphone naissant sont encore vivants, et loin d'être vieux.
Aucun pays étranger n'a atteint le niveau
élevé de téléphonie américain.
Les États-Unis comptent huit téléphones pour cent
habitants, alors qu'aucun autre pays n'en compte la moitié.
Le Canada arrive en deuxième position, avec près de quatre
pour cent ; et la Suède en troisième.
L'Allemagne compte autant de téléphones que l'État
de New York ; et la Grande-Bretagne autant que l'Ohio.
Chicago en compte plus que Londres ; et Boston deux fois plus que Paris.
Dans toute l'Europe, avec ses vingt nations, on compte un tiers de téléphones
en moins qu'aux États-Unis. Proportionnellement à sa population,
l'Europe n'en compte qu'un treizième.
Les États-Unis écrivent deux fois moins de lettres que l'Europe, envoient un tiers moins de télégrammes et parlent deux fois plus au téléphone. La famille européenne moyenne envoie trois télégrammes par an, trois lettres et un message téléphonique par semaine ; tandis que la famille américaine moyenne envoie cinq télégrammes par an, sept lettres et onze messages téléphoniques par semaine. Cette seule nation, qui possède six pour cent de la terre et représente cinq pour cent de l'humanité, possède soixante-dix pour cent des téléphones. Et cinquante pour cent, soit la moitié, de la téléphonie mondiale, est désormais comprise dans le système Bell de ce pays.
Seules six nations européennes s'en sortent plutôt bien : les Allemands, les Britanniques, les Suédois, les Danois, les Norvégiens et les Suisses. Les autres comptent moins d'un téléphone pour cent habitants. Le petit Danemark en compte plus que l'Autriche. La petite Finlande offre un meilleur service que la France. Les téléphones belges sont ceux qui coûtent le plus cher : deux cent soixante-treize dollars pièce ; et les téléphones finlandais sont les moins chers : quatre-vingt-un dollars. Mais un téléphone en Belgique rapporte trois fois plus qu'un téléphone en Norvège. En général, la leçon à retenir en Europe est la suivante : le téléphone est ce qu'une nation en fait. Son utilité dépend du bon sens et de l'esprit d'entreprise avec lesquels on l'utilise. Il peut être un atout précieux ou une nuisance.
Trop de gouvernement ! C'est la raison fondamentale
de l'échec dans la plupart des pays.
Avant l'invention du téléphone, le télégraphe
était devenu un monopole d'État ; et le téléphone
était considéré comme une espèce de télégraphe.
Les fonctionnaires ne voyaient pas qu'un système téléphonique
était un problème hautement complexe et technique, bien
plus comparable à une fabrique de pianos ou à une aciérie.
Ainsi, chaque fois qu'un groupe de citoyens établissait un service
téléphonique, les fonctionnaires le regardaient avec jalousie
et le lui retiraient généralement. Le téléphone
est ainsi devenu une partie du télégraphe, qui fait partie
de la poste, qui fait partie du gouvernement. C'est une fraction d'une
fraction d'une fraction – un simple rameau de bureaucratie. Dans
de telles conditions, le téléphone ne pouvait prospérer.
Le plus étonnant est qu'il ait survécu.
Géré selon le plan américain, le téléphone à l'étranger pourrait atteindre le niveau américain. Il n'y a aucune raison raciale à l'échec. La lenteur et le manque de service sont les conséquences naturelles d'une approche du téléphone comme s'il s'agissait d'une route ou d'une caserne de pompiers ; et toute nation qui adopte une conception appropriée du téléphone, qui ose le confier à des personnes compétentes et le renforcer par des capitaux suffisants, peut s'assurer un service aussi réactif et rapide que son cœur le souhaite. Certaines nations sont déjà sur la bonne voie. La Chine, le Japon et la France ont envoyé des délégations à New York – « la Mecque des téléphonistes », pour apprendre l'art de la téléphonie à son apogée. Même la Russie a sauvé le téléphone des mains de ses bureaucrates et le propose désormais gratuitement aux entrepreneurs.
Dans la plupart des pays étrangers, le service téléphonique s'accélère progressivement. L'engouement pour la téléphonie « bon marché et désagréable » s'estompe ; et l'idée que le téléphone est avant tout un instrument de VITESSE gagne du terrain. Un service longue distance plus rapide, à des tarifs doublés, est largement plébiscité. Les courses lentes apprennent la valeur du temps, première leçon de téléphonie. Nos faucheuses et nos faucheuses desservent désormais soixante-quinze pays. Nos tramways circulent dans toutes les grandes villes. Le Maroc importe nos montres à un dollar ; la Corée découvre le gaspillage que représente le fait de laisser neuf hommes creuser avec une seule bêche. Et tout cela implique des téléphones.
En trente ans, Western Electric a vendu pour soixante-sept millions de dollars d'appareils téléphoniques à l'étranger. Mais ce n'est qu'un début. Installer un téléphone pour cent personnes en Chine représenterait une dépense de trois cents millions de dollars. Doter l'Europe d'un équipement aussi performant que celui dont disposent actuellement les États-Unis nécessiterait trente millions de téléphones, avec les câbles et les standards téléphoniques adéquats. Et si la téléphonie pour tous n'est pas encore une question d'actualité dans de nombreux pays, tôt ou tard, dans l'implacable élan de la civilisation, elle deviendra réalité.
Peut-être que dans cet avenir lointain de paix et de bonne volonté entre les nations, lorsque chaque pays fera pour tous les autres ce qu'il sait faire de mieux, les États-Unis seront généralement reconnus comme la source de compétences et d'autorité en matière de téléphonie. Ils pourront être appelés à reconstruire ou à exploiter les réseaux téléphoniques d'autres pays, de la même manière qu'ils fournissent aujourd'hui du pétrole, de l'acier, des rails et des machines agricoles. De même qu'un acheteur avisé demande aujourd'hui du champagne à la France, des jouets à l'Allemagne, du coton à l'Angleterre et des tapis à l'Orient, il apprendra à considérer les États-Unis comme le berceau naturel du téléphone.
L'AVENIR DU TÉLÉPHONE
Au printemps 1907, Theodore N. Vail, un homme robuste,
au teint rouge et aux cheveux blancs, supervisait la construction d'une
grande grange dans le nord du Vermont. Sa maison se dressait non loin
de là, sur un terrain vallonné qui surplombait la ville
de Lyndon et, bien au-delà, à travers des forêts
de conifères, jusqu'à l'imposante montagne Burke. Sa ferme,
d'une superficie de près de 25 kilomètres carrés,
s'étendait derrière la maison, dans un grand ovale de
champs et de bois, avec plusieurs dizaines de chalets dans les clairières.
Ses poneys gallois et ses vaches suisses broutaient l'herbe de mai,
et les hommes s'affairaient aux charrues, aux herses et aux semoirs.
Près de trente ans s'étaient écoulés depuis
qu'il avait été appelé à créer la
structure commerciale de la téléphonie et à élaborer
le plan général de son développement. Depuis, il
avait accompli bien d'autres choses. La seule ville de Buenos-Ayres
l'avait payé davantage, simplement pour l'avoir dotée
d'un système de tramways et d'éclairage électrique,
que les États-Unis pour avoir mis le téléphone
à l'échelle commerciale. Il était désormais
riche et à la retraite, libre de profiter de son travail de loisir
à la ferme et d'oublier les ennuis de la ville et du téléphone.
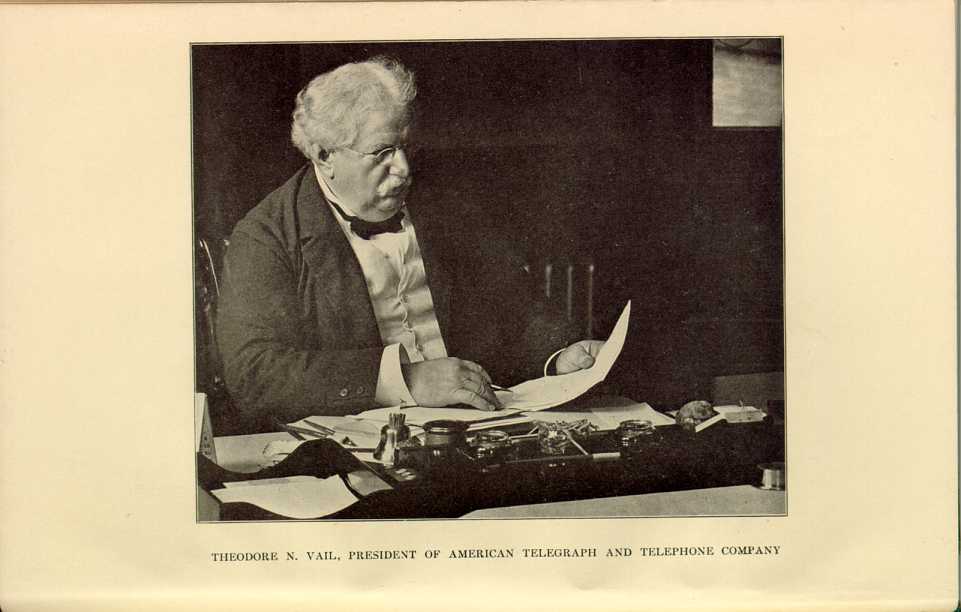
THEODORE N. VAIL, PRESIDENT OF AMERICAN TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY
Mais, alors qu'il se tenait parmi ses constructeurs
de granges, arriva de Boston et de New York une délégation
de directeurs de téléphonie.
La plupart appartenaient à la « vieille garde » de
la téléphonie. Ils avaient combattu sous les ordres de
Vail à l'époque des pionniers ; et maintenant, ils étaient
venus lui demander de revenir dans le secteur du téléphone,
après vingt ans d'absence. Vail rit à cette suggestion.
« N'importe quoi », dit-il, « je suis trop vieux.
J'ai soixante-deux ans. » Les administrateurs persistèrent.
Ils évoquèrent la panique qui s'approchait et la nécessité
d'une main de fer à la barre jusqu'à la fin de la crise,
mais Vail refusa toujours. Ils évoquèrent le bon vieux
temps et les vieux souvenirs, mais il secoua la tête. «
Toute ma vie », dit-il, « j'ai voulu être agriculteur.
»
Ils dressèrent alors un tableau de la situation téléphonique. Ils lui montrèrent que le « grand système téléphonique » qu'il avait conçu était inachevé. Il en était l'architecte, et il était détruit. L'industrie téléphonique était dynamique et prospère. Sous la brillante direction de Frederick P. Fish, elle avait connu une croissance fulgurante. Mais elle était encore loin du SYSTÈME dont Vail avait rêvé dans sa jeunesse ; aussi, lorsque les directeurs lui présentèrent son projet inachevé, il capitula. L'instinct de perfection, qui est l'une des caractéristiques dominantes de son esprit, le poussa à consentir. C'était l'appel du téléphone.
Depuis ce matin de mai 1907, de grandes choses ont été
accomplies par les professionnels du téléphone et du télégraphe.
Le système Bell a traversé la panique sans une égratignure.
Au plus fort du doute et de la confusion, Vail a écrit une lettre
ouverte à ses actionnaires, avec son sens pratique et celui de
l'agriculteur. Il a écrit :
« Notre bénéfice net des dix derniers mois s'élève
à 13 715 000 $, contre 11 579 000 $ pour la même période
en 1906. Nous avons maintenant plus de 18 000 000 $ en banque ; et nous
n'aurons pas besoin d'emprunter d'argent pendant deux ans. »
Peu après, le travail de consolidation commença.
Les entreprises qui se chevauchaient furent fusionnées. De petits
groupes locaux de télécommunications, plusieurs milliers,
furent reliés aux lignes nationales. Une politique de publicité
remplaça le secret, devenu une habitude à l'époque
des litiges en matière de brevets. Visiteurs et journalistes
y trouvèrent une porte ouverte. Des publicités éducatives
furent publiées dans les magazines les plus populaires. Le corps
des inventeurs fut stimulé pour résoudre les problèmes
des communications longue distance. Et, en échange d'un chèque
de trente millions, le contrôle de l'historique Western Union
fut transféré des enfants de Jay Gould aux trente mille
actionnaires de l'American Telephone and Telegraph Company.
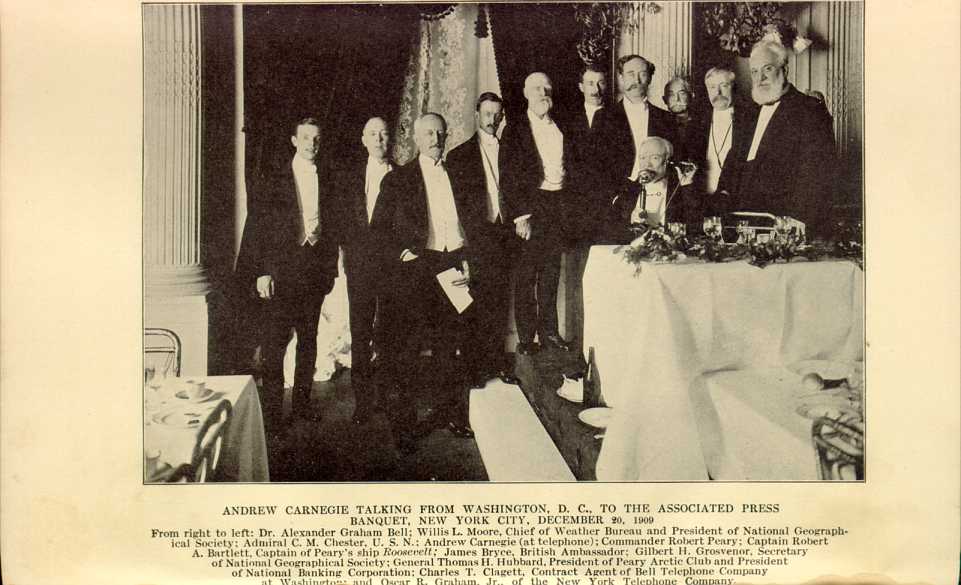
ANDREW CARNEGIE S'ADRESSE DE WASHINGTON, D.C., AU BANQUET DE L'ASSOCIATED
PRESS, NEW YORK, LE 20 DÉCEMBRE 1909
De droite à gauche : Dr Alexander Graham Bell ; Willis
L. Moore, chef du Bureau météorologique et président
de la National Geographic Society ; amiral C. M. Chester,
U.S.N. ; Andrew Carnegie (au téléphone) ; commandant
Robert Peary ; capitaine Robert A. Bartlett, capitaine du Roosevelt,
navire de Peary ; James Bryce, ambassadeur britannique ; Gilbert
H. Grosvenor, secrétaire de la National Geographic Society ;
général Thomas H. Hubbard, président du Peary Arctic
Club et président de la National Banking Corporation ; Charles
T. Clagett, agent contractuel de la Bell Telephone Company à
Washington ; et Oscar R. Graham, Jr. de la New York Telephone Company.
De ce qui a été fait, nous pouvons donc émettre une hypothèse quant à l'avenir du téléphone. Ce « grand système téléphonique », qui n'existait il y a trente ans que dans l'imagination de Vail, semble être à portée de main. Les vendeurs de journaux eux-mêmes le crient haut et fort. Et s'il n'existe, bien sûr, aucun modèle précis du meilleur système téléphonique possible, nous pouvons désormais entrevoir les grandes lignes du plan de Vail.
Ce plan n'a rien de mystérieux ni de menaçant. Il n'a rien à voir avec les combines et les complots de Wall Street. Personne ne sera évincé, sauf les promoteurs des sociétés de papier. Le fait est que Vail organise un système Bell complet pour la même raison qu'il a construit une grande grange confortable pour ses vaches suisses et ses poneys gallois, au lieu d'une demi-douzaine de petits hangars inconfortables. Il n'a jamais été un « grand financier » cherchant à jongler avec les profits sur les pertes des autres. Il applique simplement au secteur du téléphone le même bon sens que tout agriculteur utilise dans la gestion de sa ferme. Il construit une Grande Grange, métaphoriquement, pour le téléphone et le télégraphe.
De toute évidence, le système téléphonique du futur sera national, permettant à deux personnes d'un même pays de communiquer entre elles. Il ne sera pas concurrentiel, car aucun agriculteur n'envisagerait un seul instant de gérer son exploitation selon des principes concurrentiels. Il fonctionnera selon une organisation hiérarchique, pour reprendre une expression militaire. Chaque entreprise locale continuera de gérer ses propres affaires et d'exercer pleinement la vertu fondamentale de l'entraide. Mais il y aura aussi, comme aujourd'hui, un organisme central d'experts chargé de gérer les affaires plus vastes, communes à toutes les entreprises. Ni séparation ni sécession d'un côté, ni bureaucratie de l'autre : telle est l'idée typiquement américaine qui sous-tend le système téléphonique idéal.
Dans un tel système, la hiérarchie commencera par le directeur local. De lui, elle s'élèvera jusqu'aux directeurs de la compagnie d'État ; puis, plus haut encore, jusqu'aux directeurs de la compagnie nationale ; et enfin, surtout les chefs d'entreprise, jusqu'au gouvernement fédéral lui-même. L'échec de la propriété publique du téléphone dans tant de pays étrangers ne signifie pas que les compagnies privées auront un pouvoir absolu. Bien au contraire. Trente ans d'expérience montrent qu'une compagnie téléphonique privée est susceptible d'être beaucoup plus obéissante à la volonté du peuple que s'il s'agissait d'un ministère. Mais c'est un axiome de la démocratie qu'aucune compagnie, aussi bien gérée soit-elle, ne sera autorisée à contrôler un service public sans être tenue strictement responsable de ses propres actes. À mesure que la politique deviendra moins un jeu et davantage une responsabilité, le téléphone du futur sera sans doute supervisé par une sorte de comité public, qui aura le pouvoir de traiter les plaintes et d'empêcher les doublons et l'escroquerie des abreuvoirs.
À mesure que cette supervision fédérale deviendra de plus en plus efficace, la crainte actuelle du monopole diminuera, tout comme ce fut le cas pour les chemins de fer. C'est un fait, bien que généralement oublié aujourd'hui, que les premiers chemins de fer des États-Unis ont été exploités pendant dix ans ou plus selon un plan anti-monopole. Les voies étaient gratuites pour tous. N'importe qui possédant une charrette à roues à boudin pouvait la conduire sur les rails et concurrencer les locomotives. Il y avait un fouillis insouciant de trains et de wagons, tous retenus par l'attelage le plus lent ; et cela a continué sur certains chemins de fer jusqu'en 1857. À cette époque, les gens ont compris que la concurrence sur une voie ferrée était absurde. Ils ont permis que chaque voie soit monopolisée par une seule compagnie, et l'ère de l'expansion a commencé.
Personne, certes, ne regrette aujourd'hui la disparition du conducteur de camion indépendant. Il était bien plus arbitraire et coûteux qu'aucune compagnie ferroviaire n'a jamais osé l'être ; et à mesure que le pays se développait, il devenait impossible à gérer. Il n'était pas le plus apte à survivre. Pour le bien commun, on l'empêcha de concurrencer le chemin de fer et on lui apprit à coopérer en transportant du fret entre les dépôts. À sa grande surprise, il trouva cela bien plus rentable et agréable. Il avait été évincé d'un emploi pénible pour en trouver un bon. Et, par un processus d'évolution similaire, les États-Unis dépassent rapidement les petites compagnies de téléphone indépendantes. Celles-ci finiront par, une à une, s'élever, comme le conducteur de camion, à une valeur sociale supérieure, en s'intégrant au réseau téléphonique principal.
Jusqu'en 1881, le Bell System était aux mains d'un groupe familial. C'était une entreprise strictement privée. Le public, sollicité pour son lancement, avait refusé. Mais après 1881, il passa sous le contrôle des petits actionnaires et y resta sans interruption. C'est aujourd'hui l'une de nos entreprises les plus démocratisées, distribuant salaires et dividendes à plus de cent mille foyers. Il a parfois été exclusif, mais jamais sordide. Il n'a jamais été assoiffé de dollars, ni frénétiquement influencé par le virus des paris boursiers. Il y a toujours eu en lui une veine sentimentale qui le maintenait en contact avec la nature humaine. Aujourd'hui encore, chaque chèque de l'American Telephone and Telegraph Company porte l'image d'un joli Cupidon, assis sur une chaise où il a posé un épais livre, et bavardant gaiement dans un téléphone.
On peut s'attendre à des changements radicaux dans un avenir proche, maintenant que le Bell System et la Western Union collaborent. D'un trait de plume, cinq millions d'utilisateurs de téléphone ont déjà été inscrits au crédit de la Western Union ; et chaque bureau téléphonique Bell est désormais un bureau télégraphique. Trois messages téléphoniques et huit télégrammes peuvent être envoyés simultanément sur deux paires de fils : c'est l'un des récents miracles de la science, qui doit maintenant être expérimenté à grande échelle. La plupart des fils téléphoniques longue distance, soit plus de trois millions de kilomètres, peuvent être utilisés à des fins télégraphiques ; et un tiers des fils de la Western Union, soit huit cent mille kilomètres, peuvent, moyennant quelques modifications, être utilisés pour les communications téléphoniques.
La Western Union loue vingt-deux mille cinq cents bureaux, ce qui contribue à faire de la télégraphie un luxe réservé à quelques privilégiés. Elle emploie des messagers aussi nombreux que l'armée qui a accompagné le général Sherman d'Atlanta à la mer. Ces deux postes de dépenses diminueront lorsqu'un fil Bell et un fil Morse pourront être acheminés vers un terminal commun, et lorsqu'un télégramme pourra être reçu ou délivré par téléphone. Il y aura aussi un gain, peut-être le plus important, à retirer le petit messager des rues et à l'envoyer soit à l'école, soit apprendre un métier utile.
Le fait est que les États-Unis sont le premier pays à avoir réussi à mettre le téléphone et le télégraphe sur des bases appropriées.
Ailleurs, soit les deux sont très éloignés,
soit le téléphone n'est qu'un simple complément
du service télégraphique. Selon le nouveau plan américain,
les deux ne sont pas concurrents, mais complémentaires. L'un
est un complément à l'autre.
La poste envoie un colis ; le télégraphe en transmet le
contenu ; mais le téléphone n'envoie rien. C'est un appareil
qui permet la conversation entre deux personnes séparées.
Chacun des trois possède un domaine distinct, de sorte qu'il
n'y a jamais eu de motif de jalousie entre eux.
Faire du téléphone une annexe de la poste ou du télégraphe est devenu absurde. On envoie aujourd'hui dans le monde presque autant de messages par téléphone que par lettre ; et on compte trente-deux fois plus d'appels téléphoniques que de télégrammes. Aux États-Unis, le téléphone est devenu le grand frère du télégraphe. Il génère six fois plus de revenus nets et huit fois plus de fil. Et il transmet autant de messages que le total combiné des télégrammes, des lettres et des passagers des trains.
Cette tendance universelle à la consolidation a engendré une variété de problèmes qui mobiliseront les cerveaux les plus brillants du monde de la téléphonie pendant de nombreuses années. Comment tirer profit de l'organisation sans en subir les conséquences, devenir fort sans perdre sa rapidité, devenir systématique sans perdre l'audace et l'audace d'antan, transformer sa main-d'œuvre en une armée de spécialistes ultra-rapides sans perdre la vue d'ensemble de la situation ? Telles sont les énigmes du nouveau type, auxquelles les téléphonistes de la prochaine génération devront trouver les réponses. Elles illustrent la nature des missions importantes que le téléphone offre à un jeune homme ambitieux et doué d'aujourd'hui.
« Les problèmes n'ont jamais été aussi vastes ni aussi complexes qu'aujourd'hui », déclare JJ Carty, chef des ingénieurs téléphoniques. L'éternel combat demeure entre les grandes et les petites idées, entre ceux qui voient ce qui pourrait être et ceux qui ne voient que ce qui est. La course aux records est toujours d'actualité. Déjà, la standardiste trouve la personne recherchée en trente secondes. C'est un dixième du temps qu'il fallait aux premiers centraux ; mais c'est encore trop long. C'est une demi-minute précieuse. Il faut la réduire à vingt-cinq, vingt ou quinze secondes.
La bataille des inventeurs pour gagner des kilomètres se poursuit. La distance à laquelle on peut tenir une conversation est passée de vingt à deux mille cinq cents kilomètres. Mais ce n'est pas suffisant. Certains êtres humains civilisés sont séparés de douze mille kilomètres et partagent des intérêts communs. Lors de la révolte des Boxers en Chine, par exemple, des Américains à Pékin auraient volontiers donné la moitié de leur fortune pour l'utilisation d'une paire de fils électriques avec New York.
Aux premiers temps du téléphone, Bell aimait à prophétiser que « le temps viendra où nous parlerons par-delà l'Atlantique » ; mais cela était considéré comme une fantaisie poétique jusqu'à ce que Pupin invente sa méthode de propulsion automatique du courant électrique. Depuis lors, l'ingénieur le plus conservateur discute du problème de la téléphonie transatlantique. Quant aux poètes, ils rêvent désormais du jour où un homme pourra parler et entendre sa propre voix lui parvenir du monde entier.
Le problème immédiat, à longue distance, est bien sûr de pouvoir communiquer de New York au Pacifique. Les deux océans ne sont plus qu'à trois jours et demi de distance par chemin de fer. Seattle réclame un fil vers l'Est. San Diego en veut un à temps pour l'Exposition universelle du canal de Panama en 1915. Les fils sont déjà tendus jusqu'à San Francisco, mais ne peuvent être utilisés au stade actuel de la technique. Et les capitaines de Vail travaillent maintenant avec une hâte presque essoufflée pour lui offrir, comme cadeau d'anniversaire, une conférence à travers le continent depuis sa ferme du Vermont.
« Je vois un système téléphonique universel pour les États-Unis dans un avenir très proche », déclare Carty. « Il y a une statue de Seward dans une rue de Seattle. L'inscription dessus dit : “Vers un pays uni”. Mais lorsqu'un habitant de l'Est se tient là, il ressent l'isolement de cet État du Far Western, et il le ressentira toujours, jusqu'à ce qu'il puisse parler d'un bout à l'autre des États-Unis. Pour ma part », poursuit Carty, « je crois que nous parlerons par-delà les continents et les océans. Pourquoi pas ? N'y a-t-il pas plus de cellules dans un corps humain qu'il n'y a d'habitants sur la Terre entière ? »
Un futur Carty pourrait résoudre le problème abandonné du fil unique et diviser la facture de cuivre en deux en rétablissant le circuit de mise à la terre. Il pourrait transmettre la vision aussi bien que la parole. Il pourrait perfectionner un système de troisième rail pour les trains en mouvement. Il pourrait concevoir un matériau isolant idéal pour remplacer le verre, le mica, le papier et l'émail. Il pourrait établir un code universel, afin que toutes les personnalités importantes aux États-Unis disposent de numéros d'appel permettant de les localiser instantanément, comme le sont les livres dans une bibliothèque.
Un autre jeune homme pourrait créer un service commercial de grande envergure, une tâche que les téléphonistes sont encore trop spécialisés pour accomplir. Celui qui s'en chargera sera un homme à l'esprit complet. Il sera aussi proche de l'homme moyen que de l'art de la téléphonie. Il connaîtra les ragots de la rue, les revendications des syndicats et les politiques des gouverneurs et des présidents. La psychologie du fermier occidental le concernera, ainsi que le ton de la presse quotidienne et les méthodes des grands magasins. Son objectif sera de connaître la subtile chimie de l'opinion publique et d'adapter le service téléphonique aux humeurs et aux besoins changeants de l'époque. IL ADAPTERA LA TÉLÉPHONIE COMME UN VÊTEMENT AUX HABITUDES DES GENS.
De plus, maintenant que le secteur du téléphone est devenu fort, sa préoccupation principale doit être de développer les qualités, et non les défauts, de la force. Sa devise doit être « Ich dien » – Je sers ; et il appartiendra aux futurs hommes d'État du téléphone d'illustrer cette devise dans toutes ses déclinaisons pratiques. Ils s'occuperont de tout et expliqueront, et encore d'expliquer et de tout s'occuperont. Ils éduqueront et éduqueront encore, jusqu'à créer un public expert. Ils enseigneront par des images, des conférences et des expositions. Ils afficheront des cartes et des diagrammes dans les cabines téléphoniques, afin que celui qui attend un appel puisse s'instruire un peu et passer le temps plus agréablement. En un mot, ils s'occuperont de ces innombrables détails qui font la perfection du service public.
Le système Bell a déjà fait un pas important dans cette direction en organisant ce que l'on pourrait appeler un service de prospective. C'est là que se trouvent les voyants du secteur. Lorsqu'il s'agit de construire de nouvelles lignes ou de nouveaux centraux, ces hommes étudient la situation en se projetant dans l'avenir. Ils préparent un « plan fondamental », décrivant ce que l'on peut raisonnablement espérer dans quinze ou vingt ans. Invariablement optimistes, ils prévoient la croissance, mais pas du tout la décroissance. Grâce à leurs conseils, les différentes compagnies Bell disposent désormais de vingt-cinq millions de dollars de matériel de réserve, attendant que le pays se développe. Même à New York, la moitié des gaines de câbles sont vides, en prévision de la construction de la grande ville de huit millions d'habitants prévue pour 1928. Il existe peut-être peu de preuves plus impressionnantes d'optimisme et de confiance pratique qu'un nouveau central téléphonique, dont les deux tiers des câbles attendent les entreprises de demain.
À terme, ce département de prospective s'agrandira. Si un chef de génie apparaît, il pourrait devenir le premier véritable corps de sociologues pragmatiques, capable de substituer des faits au fatras actuel de théories. Il établira un « plan fondamental » pour l'ensemble des États-Unis, indiquant le centre de chaque industrie et les principaux axes de circulation. Il partira du principe fondamental que PARTOUT OÙ IL Y A INTERDÉPENDANCE, IL Y A FORCÉMENT DE LA TÉLÉPHONIE ; il établira donc des cartes d'interdépendance, montrant les groupes industriels et financiers largement dispersés, ainsi que les lignes qui les tissent pour former un modèle de coopération nationale.
Jusqu'à présent, aucune nation, pas même la nôtre, n'a perçu toute la valeur du téléphone longue distance. Rares sont ceux qui ont l'imagination nécessaire pour imaginer ce qui a été rendu possible et pour réaliser qu'une conversation en face à face peut avoir lieu, même à des milliers de kilomètres de distance. Il est également inconcevable qu'un homme dans une ville lointaine puisse être localisé aussi facilement que s'il était tout près. C'est trop incroyable pour être vrai, et il faudra peut-être attendre l'arrivée d'une nouvelle génération avant que cela ne soit considéré comme acquis et mis en pratique librement. En fin de compte, il ne fait aucun doute que la téléphonie longue distance sera considérée comme un atout national de la plus haute valeur, car elle permet d'éviter une grande partie de l'énorme gaspillage économique que représentent les voyages.
Rien de ce que la science peut dire n'atténuera
jamais le charme d'une conversation à distance, et peut-être
un jour viendra-t-il un interprète qui la présentera à
nos yeux sous forme d'image animée. Il nous permettra de suivre
les mots qui volent dans une conversation de Boston à Denver.
Nous filerons d'abord vers Worcester, traverserons l'Hudson sur le haut
pont de Poughkeepsie, bifurquerons vers le sud-ouest à travers
une douzaine de villes minières jusqu'aux abords de Philadelphie,
franchirons la Susquehanna, zigzaguerons le long des Allegheny jusqu'aux
ténèbres de Pittsburg, traverserons l'Ohio à Wheeling,
survolerons Columbus et Indianapolis, franchirons la Wabash à
Terre Haute, entrerons à Saint-Louis par le pont Eads, traverserons
Kansas City, traverserons le Missouri, longerons les champs de maïs
du Kansas, puis poursuivrons notre route avec le chemin de fer de Santa
Fe, traverserons de vastes plaines et franchirons le bord du Grand Canyon,
jusqu'à Pueblo et la majestueuse ville de Denver. Quatre mille
cinq cents kilomètres parcourus par mille tonnes de fil de cuivre
! De Bunker Hill à Pike's Peak EN UNE SECONDE !
Dans son autobiographie, Herbert Spencer fait allusion au fait impressionnant que, pendant que l'œil lit une seule ligne de caractères, la Terre a parcouru cinquante kilomètres dans l'espace. Or, en téléphonie, ce serait un voyage lent. C'est une vérité simple et quotidienne que de dire que, pendant que l'œil lit ce tiret, le son d'un téléphone peut être transmis de New York à Chicago.
Il existe de nombreuses raisons de croire que, pour les idéalistes pragmatiques du futur, l'étude suprême sera la force qui rendra de tels miracles possibles. Six milliards de dollars, soit un vingtième de notre richesse nationale, sont actuellement investis dans le développement de l'électricité. L'ère de l'électricité n'est pas encore arrivée ; mais elle est proche ; et nul ne peut prédire l'éclat du résultat lorsque les esprits créatifs d'une nation se concentreront sur la maîtrise de cette force mystérieuse, plus puissante et plus subtile que toute autre force que l'homme ait pu maîtriser.
Énergie douce et maîtrisée, l'électricité est nouvelle. Elle n'a ni passé ni pedigree. Elle est plus jeune que beaucoup de gens d'aujourd'hui. Parmi les sages de Grèce et de Rome, peu connaissaient son existence, et aucun ne l'utilisait concrètement. Les plus sages savaient qu'un morceau d'ambre, frotté, attirait les substances plumeuses. Mais ils considéraient cela comme de la poésie plutôt que de la science. Une jolie légende racontait chez les Phéniciens que les morceaux d'ambre étaient les larmes pétrifiées de jeunes filles qui s'étaient jetées à la mer par amour non partagé, et chaque perle d'ambre était très prisée. Elle était portée comme une amulette et un symbole de pureté. Pendant deux mille ans, personne n'aurait imaginé que son cœur d'or renfermait le secret d'une nouvelle civilisation électrique.
Même en 1752, lorsque Benjamin Franklin fit voler son célèbre cerf-volant sur les rives de la Schuylkill et captura le premier éclair en conserve, on ne connaissait pas précisément l'énergie électrique. Son paratonnerre fut considéré comme une insulte à la divinité céleste. On le rendit responsable du tremblement de terre de 1755. Et ce n'est qu'avec la généralisation du télégraphe Morse que les hommes osèrent envisager le coup de foudre de Jupiter comme un possible serviteur de l'humanité.
Ainsi, lorsque Bell inventa le téléphone, il surprit le monde avec une idée nouvelle. Il devait créer la pensée autant que la chose. Ni Jules Verne ni H.G. Wells ne l'avaient prévu. L'auteur des Mille et Une Nuits avait imaginé un tapis volant, mais ni lui ni personne d'autre n'avait imaginé une conversation volante. Dans toute la littérature ancienne, il n'existe pas un seul vers qui s'applique au téléphone, à l'exception peut-être de cette phrase expressive de la Bible : « Et une voix se fit entendre. » De nos jours, le téléphone est devenu un fait banal de la vie quotidienne ; et nous oublions souvent que son émerveillement est devenu plus grand et non moins grand ; et qu'il reste encore beaucoup d'honneur et de profit à gagner pour l'inventeur et le scientifique.
Le flot de brevets électriques n'a jamais été aussi important. Il y en a littéralement plus en un seul mois que le nombre total de brevets délivrés par l'Office des brevets jusqu'en 1859. Le Bell System compte trois cents experts, payés pour tester toutes les nouvelles idées et inventions ; et avant que ces mots ne soient publiés, de nouvelles utilisations et de nouvelles méthodes auront été découvertes. Il n'y a donc aucun danger immédiat que l'art de la téléphonie soit moins fascinant à l'avenir qu'il ne l'a été par le passé. Il restera le lutin le plus séduisant et le plus insaisissable qui ait jamais ouvert la voie à un continent noir de phénomènes mystérieux.
Il reste encore à un futur scientifique la tâche de nous montrer en détail le rôle exact du courant téléphonique. Un tel homme étudiera les vibrations comme Darwin étudiait la différenciation des espèces. Il étudiera comment la voix d'un enfant, parlant de Boston à Omaha, peut faire vibrer plus de 500 000 kilos de fil de cuivre ; et il inventera un système temporel plus précis, adapté au téléphone, capable d'accomplir autant de choses en une seconde qu'un homme en une journée, transmettant à chaque tic-tac de l'horloge de vingt-cinq à quatre-vingt mille vibrations. Il étudiera les différentes vibrations des nerfs, des fils et de l'air sans fil, nécessaires à la transmission de la pensée entre deux esprits séparés. Il expliquera comment une pensée, née dans le cerveau, passe le long des fils nerveux jusqu'aux cordes vocales, puis, par les vibrations de l'air sans fil, jusqu'au disque de l'émetteur. À l'autre bout de la ligne, le second disque recrée ces vibrations, qui frappent les fils nerveux d'une oreille et sont ainsi transmises à la conscience d'un autre cerveau.
Ainsi, malgré tout ce qui a été accompli depuis que Bell a ouvert la voie, le téléphone demeure le summum des merveilles électriques. Aucun autre appareil ne fait autant avec si peu d'énergie. Aucun autre n'est plus enveloppé d'inconnu. Même les pionniers aux cheveux gris, qui ont vécu avec le téléphone depuis sa naissance, ne peuvent comprendre leur protégé. Quant au pourquoi et au comment, il n'y a pas encore de réponse. Il est aussi vrai de la téléphonie aujourd'hui qu'en 1876 : un enfant peut utiliser ce que les plus sages ne peuvent comprendre.
Voici un minuscule disque de tôle. Je parle – il vibre. Il vibre différemment à chaque son. Il vibre par milliards. Il vibre différemment. Il y a un second disque à des kilomètres, peut-être à quatre mille cinq cents kilomètres. Entre les deux disques court un fil de cuivre. Tandis que je parle, un frémissement électrique parcourt le fil. Ce frémissement est modelé par le frémissement du disque. Il fait vibrer le second disque. Et le frémissement du second disque reproduit ma voix. Voilà ce qui se passe. Mais comment, tous les scientifiques du monde ne peuvent le dire.
Le courant téléphonique est un phénomène éther, disent les théoriciens. Mais qu'est-ce que l'éther ? Personne ne le sait. Sir Oliver Lodge a supposé que c'était « peut-être la seule chose substantielle dans l'univers matériel » ; mais personne ne le sait. Rien ne nous guide dans ce pays inconnu, si ce n'est un panneau indicateur pointant vers le haut et portant le seul mot : « Peut-être ». L'éther de l'espace ! Voici un Eldorado pour les scientifiques du futur, et celui qui le premier parviendra à le cartographier contribuera grandement à la découverte du secret de la téléphonie.
Un jour, qui sait ?, viendra peut-être la poésie
et le grand opéra du téléphone. Des artistes viendront
peut-être dépeindre la merveille des fils qui vibrent de
mots électrifiés, et le romantisme des standards qui vibrent
des secrets d'une grande ville. Déjà, Puvis de Chavannes,
par l'un de ses superbes panneaux de la bibliothèque de Boston,
a admis le téléphone et le télégraphe dans
le monde de l'art.
Il les a incarnés sous la forme de deux figures volantes, suspendues
au-dessus des fils électriques, avec l'inscription suivante en
dessous : « Par le merveilleux pouvoir de l'électricité,
la parole traverse l'espace et, rapide comme l'éclair, porte
les nouvelles du bien et du mal. »
Mais ces conjectures aléatoires sur l'avenir du téléphone pourraient bien être bien loin de la réalité. En ces temps glorieux, il est vain de prédire. L'inventeur a partout mis le prophète à la porte. La réalité a pris le pas sur l'imagination. Lorsque Morse, par exemple, installait sa première petite ligne de fil autour des usines sidérurgiques de Speedwell, qui aurait pu prévoir trois cent cinquante mille kilomètres de câbles sous-marins, qui transmettent aux océans les nouvelles du monde entier ? Lorsque le minuscule bateau de Fulton, aussi petit qu'une bouilloire, remonta l'Hudson jusqu'à Albany en deux jours, qui aurait pu prévoir les colosses d'acier, longs de deux cents mètres, capables de couper l'océan Atlantique en deux dans le même temps ? Et lorsque Bell, dans un atelier miteux de Boston, entendit le cliquetis d'un ressort d'horloge sur un fil électrique, qui aurait pu prévoir l'imposante structure du système Bell, bâtie par la moitié des téléphones du monde et par l'investissement de capitaux plus importants que ceux consacrés à la création de toute autre association industrielle ? Qui aurait pu prévoir comment les sonneries téléphoniques ont fait sonner le glas des anciennes méthodes et en ont inauguré de nouvelles ; pour faire sonner le glas des retards et de l'isolement, et pour faire sonner l'efficacité et la convivialité d'un peuple véritablement uni ?
Voila la belle histoire d'Asheville en Caroline
du Nord recueilli à la bibliothèque des collections spéciales
du comté de Buncombe.
Article de Carissa Pfeiffer , bibliothécaire, Collections spéciales
du comté de Buncombe.
Sonnerie des 10 000 premiers téléphones d'Asheville,
1885-1925
Les smartphones sont si omniprésents aujourd'hui qu'on oublie
facilement les merveilles de la communication moderne que représentaient
leurs prédécesseurs. Le télégraphe était
révolutionnaire, mais présentait quelques limitations
majeures : les messages devaient être transmis et reçus
par des opérateurs maîtrisant le code Morse, et un seul
message pouvait être envoyé à la fois.
Parmi ceux qui expérimentaient des améliorations, il y
avait l'inventeur Alexander Graham Bell, basé à Boston,
qui s'intéressait au son et à la parole depuis son adolescence,
et un jeune électricien qui lui servait d'assistant, Thomas Watson.
À peu près à la même époque où
Asheville planifiait et installait ses premiers poteaux télégraphiques,
Bell et Watson travaillaient sur des brevets et testaient des modèles
permettant de transmettre la parole humaine sur les fils télégraphiques.
En 1877, les habitants de Boston et d'autres grandes villes pouvaient
louer « deux téléphones à usage social reliant
une maison d'habitation à tout autre bâtiment » pour
20 dollars par an (ou 40 dollars pour les entreprises).
La première compagnie de téléphone d'Asheville
À Asheville et dans l'ouest de la Caroline du Nord, comme dans
d'autres régions où l'American Bell Telephone Company
(prédécesseur d'AT&T, du nom d'Alexander Graham Bell)
n'avait pas encore mis en place de service, la tâche reposait
sur des initiatives indépendantes. En 1885, cinq hommes fondèrent
l'Asheville Telephone Company avec la mission (assez verbeuse) détablir,
ériger et entretenir dans les comtés de Buncombe, Haywood,
Henderson et Madison, dans l'État de Caroline du Nord, ou dans
un ou plusieurs desdits comtés, un système de téléphones
avec tous les centraux, bureaux, poteaux, fils, instruments, machines,
outils et toutes autres choses nécessaires actuellement utilisées
ou qui peuvent ou peuvent être utilisées à l'avenir
en rapport avec les instruments connus sous le nom de téléphones,
afin de créer et d'entretenir un système complet de service
téléphonique dans un ou plusieurs desdits comtés
.
L'avocat Calvin Monroe McLoud, qui avait joué un rôle déterminant
dans l'installation du télégraphe à Asheville des
années auparavant, faisait partie de l'entreprise, tout comme
le législateur Richmond Pearson, l'homme d'affaires Norman W.
Girdwood, le directeur des chemins de fer FA Stikeleather et le maire
EJ Aston. L' Asheville Citizen encourageait les habitants à envisager
d'intégrer leurs entreprises et leurs résidences au réseau
afin que le service téléphonique – « un besoin
ressenti depuis longtemps, une nécessité absolue »
– puisse enfin commencer.
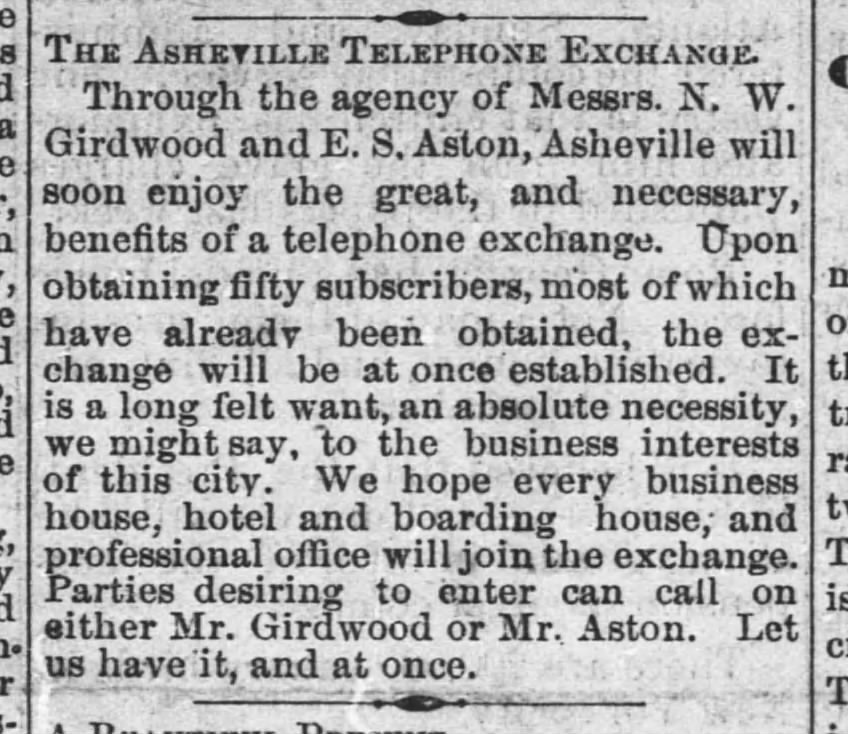 The Asheville Citizen , 10 septembre 1885
The Asheville Citizen , 10 septembre 1885
À la fin de l'année, l'infrastructure commençait
à prendre forme. Milton Ledford, un « tireur de fils »,
tendit les fils téléphoniques et le journal prédit
que « bonjour » – un mot devenu populaire grâce
au téléphone – « résonnerait d'un bout
à l'autre de la ville ».
Naturellement, il a fallu apprendre à utiliser les nouvelles
technologies. L' Asheville Citizen a eu la gentillesse de publier des
rappels, par exemple, pour demander à l'opérateur de vous
mettre en relation avec votre correspondant, par exemple en utilisant
des numéros plutôt que des noms, et pour indiquer le début
et la fin de la conversation.
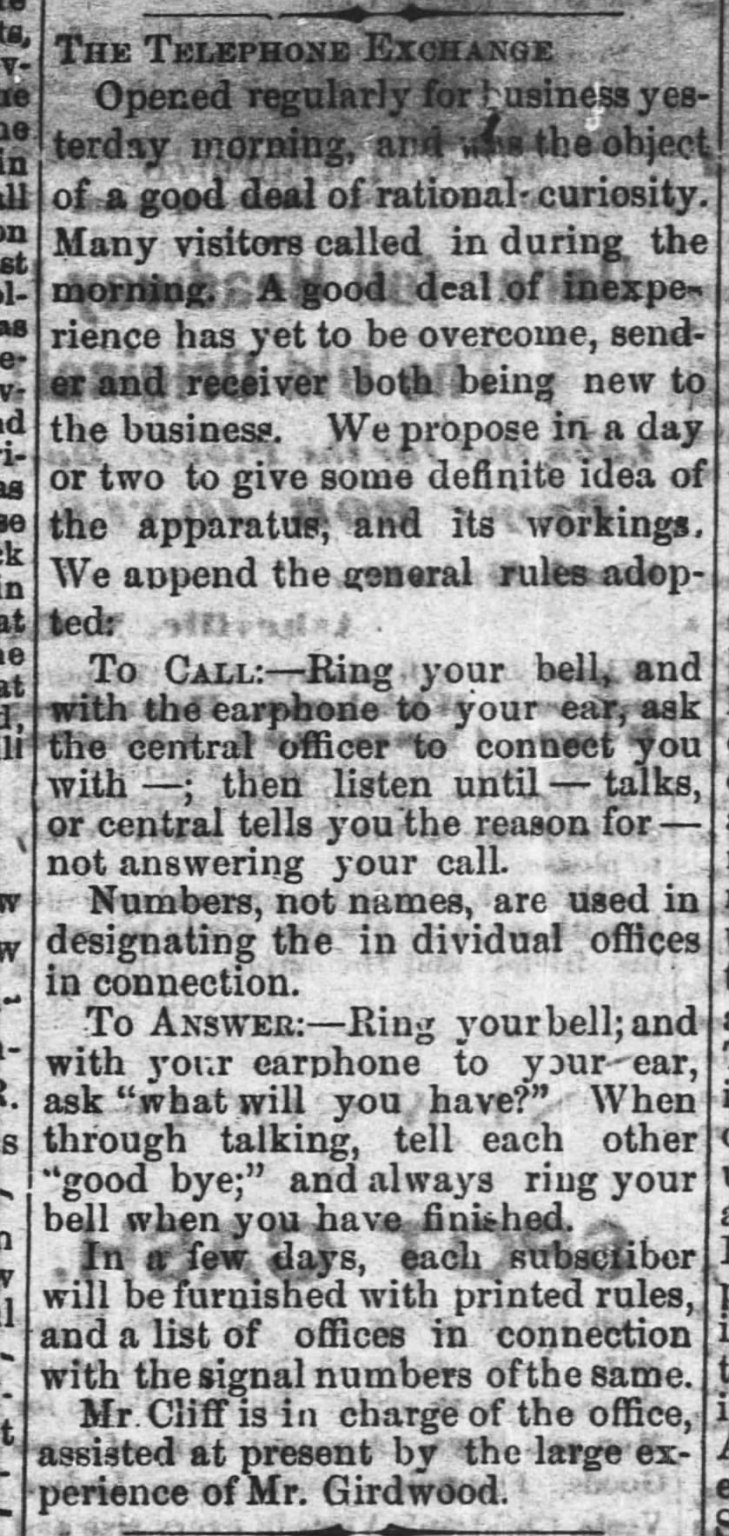 The
Asheville Citizen, 2 janvier 1886
The
Asheville Citizen, 2 janvier 1886
En janvier 1887, le central téléphonique local comptait
environ soixante-dix abonnés, reliés par « environ
soixante-dix miles de fil ». Les rédacteurs du Citizen
ont remarqué : « Ce n'est qu'en 1876, à l'Exposition
universelle de Philadelphie – onze ans plus tard – que le
téléphone fut présenté comme un nouvel appareil
et que l'on s'en amusait comme s'il s'agissait d'un simple câble
scientifique. Depuis lors, ses fils ont créé des toiles
d'araignée dans nos villes et se sont étendus entre les
villes et les villages de tout le continent. »
Hélas, ce premier service local fut de courte durée. Ailleurs
dans le pays, le « système Bell » suivit de près
les centraux locaux, causant souvent des problèmes, car Bell,
cherchant à dominer le marché, refusait de vendre ou de
louer des équipements aux indépendants et, plus grave
encore, refusait l'interconnexion de leurs systèmes.
Au moins certains résidents d'Asheville (y compris les rédacteurs
du Citizen ) hésitaient à inviter la « gigantesque
entreprise monopolistique » de Bell/AT&T dans la ville pour
« engloutir » le service local. D'autres considéraient
Bell comme une fatalité. En fin de compte, les autorités
municipales ont accueilli Bell favorablement, et l'entreprise locale
a fermé boutique.
Après une interruption de service de plusieurs mois,une deuxième
itération du service téléphonique, cette fois assurée
par Southern Bell, la compagnie d'exploitation régionale de Bell,
a été relancée en juillet 1889.
 The
Asheville Citizen , 13 juillet 1889
The
Asheville Citizen , 13 juillet 1889
La deuxième compagnie de téléphone d'Asheville
:
Passons à septembre 1898. Au milieu des reportages sur l'annexion
d'Hawaï, l'affaire Dreyfus, l'épidémie de fièvre
jaune et les publicités pour les corsets, les vélos et
la bière, The Asheville Gazette rapportait : « Un nouveau
téléphone arrive en ville. »
Après 9 ans de service Bell, les dangers de son monopole ont
commencé à faire surface : une « enquête minutieuse
de trois mois » a montré que Southern Bell facturait aux
résidents d’Asheville des tarifs « 40 % plus élevés
que dans d’autres endroits de même taille, et que le service
reçu n’était pas le meilleur. »
Incapable de convaincre Southern Bell de baisser ses tarifs, le Asheville
Board of Trade a offert 5 000 $ à une entreprise du Wisconsin,
Proctor & Sons, pour établir un service concurrent, à
condition qu'elle n'augmente pas ses tarifs pendant 25 ans, ni ne vende
à Bell.
La nouvelle Asheville Telephone Company, dirigée par HP Proctor,
WS Proctor et Mme Charity Rust Craig, facturait des tarifs annuels de
24 $ pour les entreprises et de 16 $ pour les résidences, tandis
que Bell facturait respectivement 40 $ et 30 $.
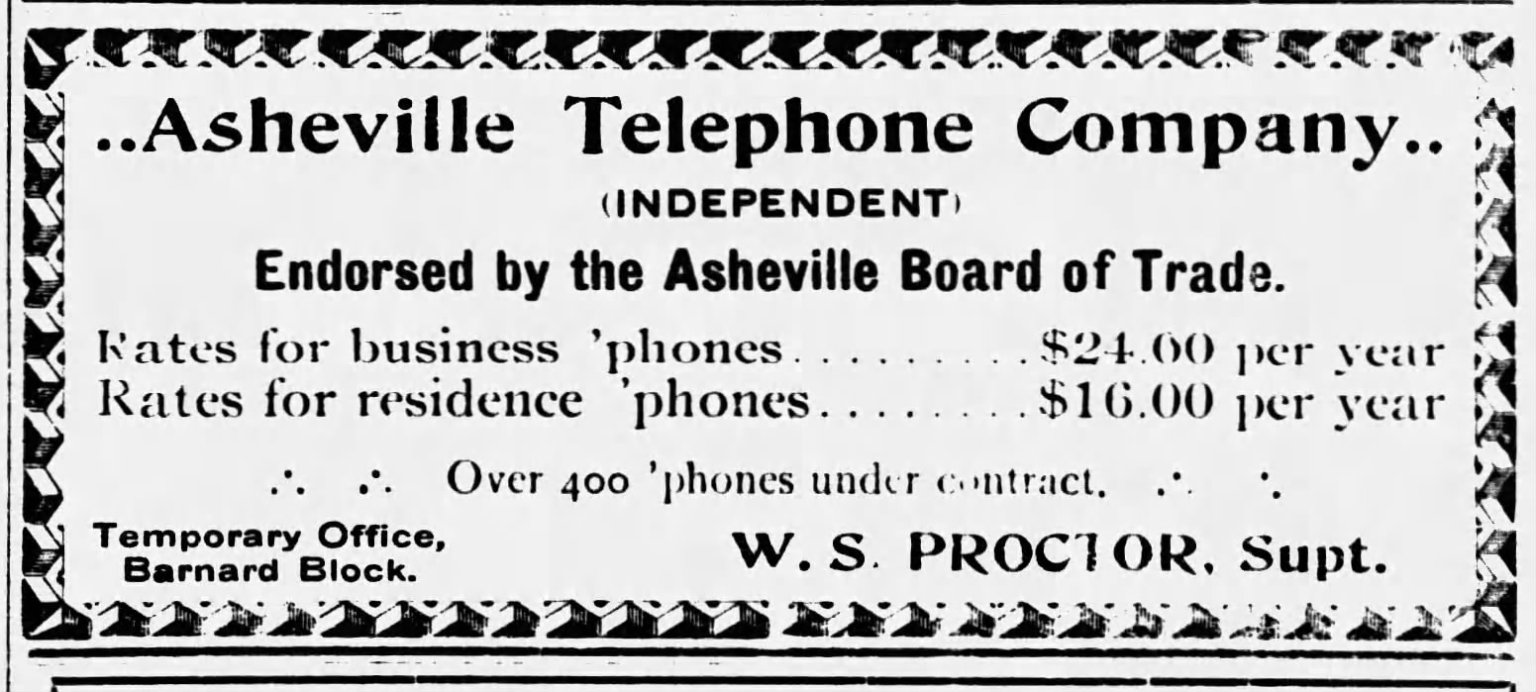
Publicité dans The Asheville Daily Citizen 5 novembre 1898
L'enthousiasme était au rendez-vous.
De nombreux abonnés ont opté pour la compagnie indépendante,
notamment les bureaux de la Southern Railroad et l' Asheville Citizen.
Certains ont conservé leur ancien numéro de téléphone,
mais ont rappelé aux appelants qu'ils devaient se connecter via
le nouveau central indépendant plutôt que via le système
Bell, car les services ne fonctionnaient pas. Le Citizen a exhorté
les particuliers et les entreprises à adopter le service indépendant
en un front uni, et à ne pas se laisser intimider ni séduire
par Bell avec de nouveaux tarifs plus bas qu'elle refusait de proposer
auparavant.
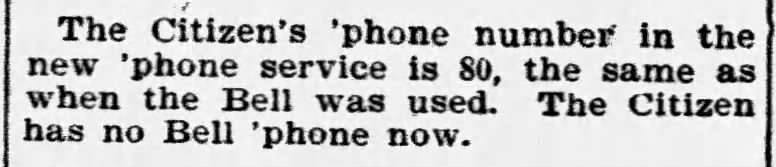
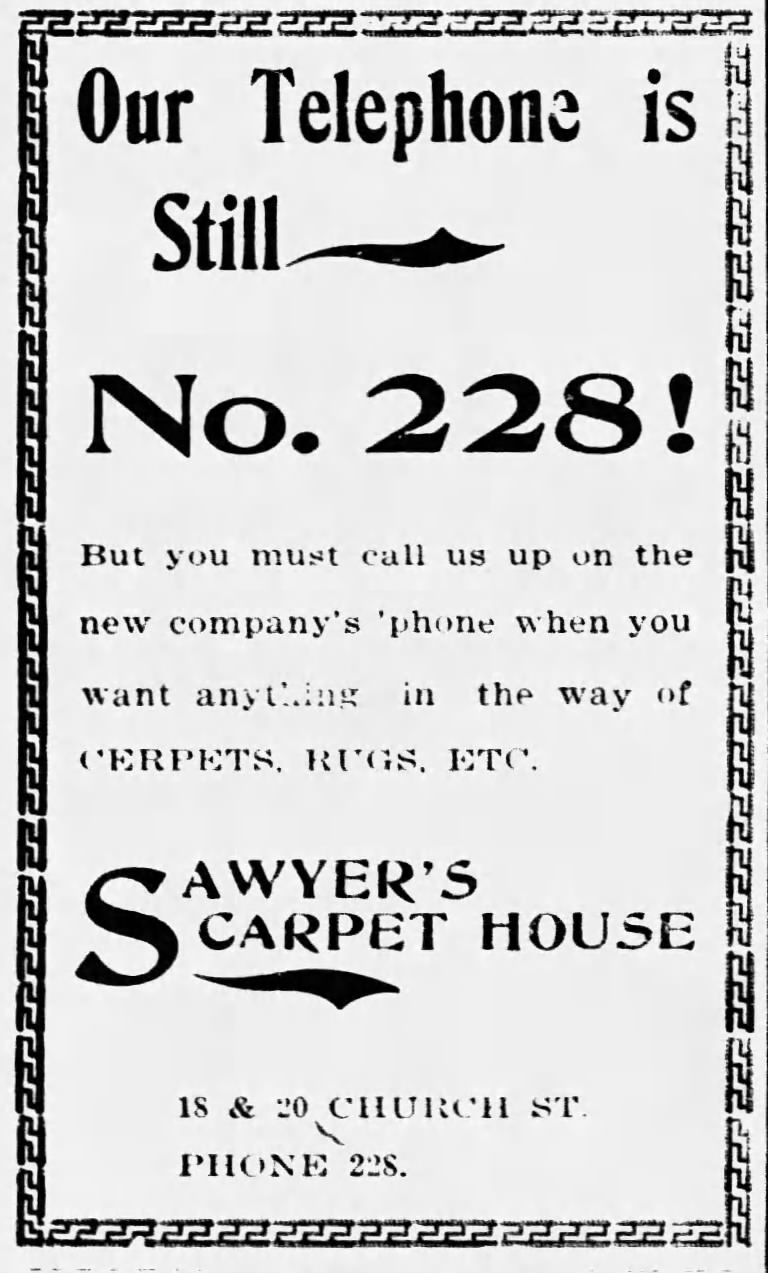
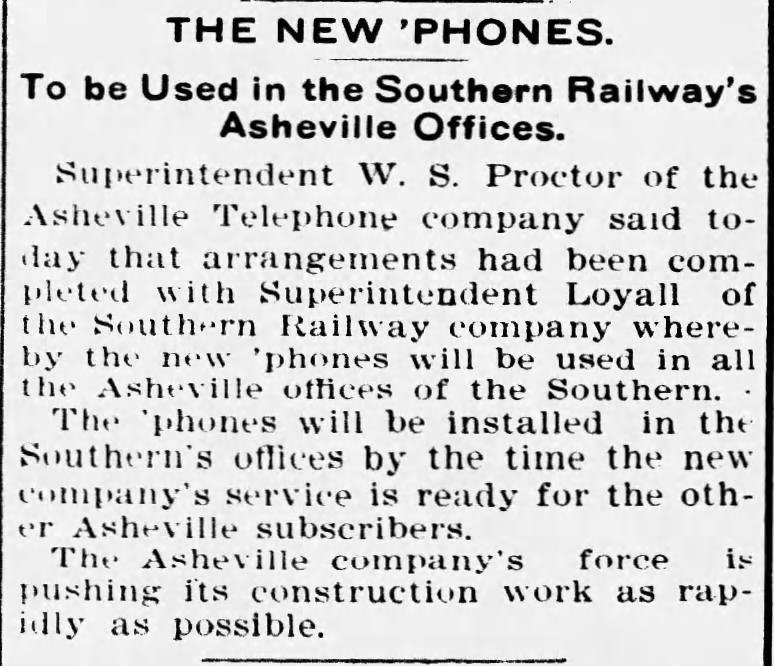
Annonces : Asheville Citizen, 1er février 1899, Asheville Citizen,
2 février 1899 et Asheville Citizen , 22 décembre 1898
Malgré les retards dans la mise en place du service,
en août 1899, la compagnie de téléphone indépendante
Asheville servait 600 clients et employait 10 femmes qui travaillaient
comme standardistes dans le « bureau d'accueil » au 11 Patton
Avenue.
Le service indépendant reliait les clients d'Asheville à
70 autres à Hendersonville, et plus à Brevard, Sapphire,
Skyland et Arden et plus tard à Waynesville, Spartanburg, Fairview,
Leicester, Swannanoa, Black Mountain, Montreat, et plus encore plus
de 40 connexions en dehors d'Asheville au total en septembre 1901, englobant
un rayon de 40 miles.
Pendant ce temps, Bell travaillait à un service
largement intégré et standardisé.
Le 24 septembre 1901, le même article, félicitant la compagnie
de téléphone indépendante pour ses plus de 40 connexions,
annonçait l'achèvement de la ligne téléphonique
longue distance par Southern Bell, reliant Asheville à «
presque toutes les villes des États-Unis de plus de 6 000 habitants
» via des connexions passant par Spartanburg ou Charlotte. Cela
représentait plus de 40 États et territoires, soit plus
de 10 000 stations.
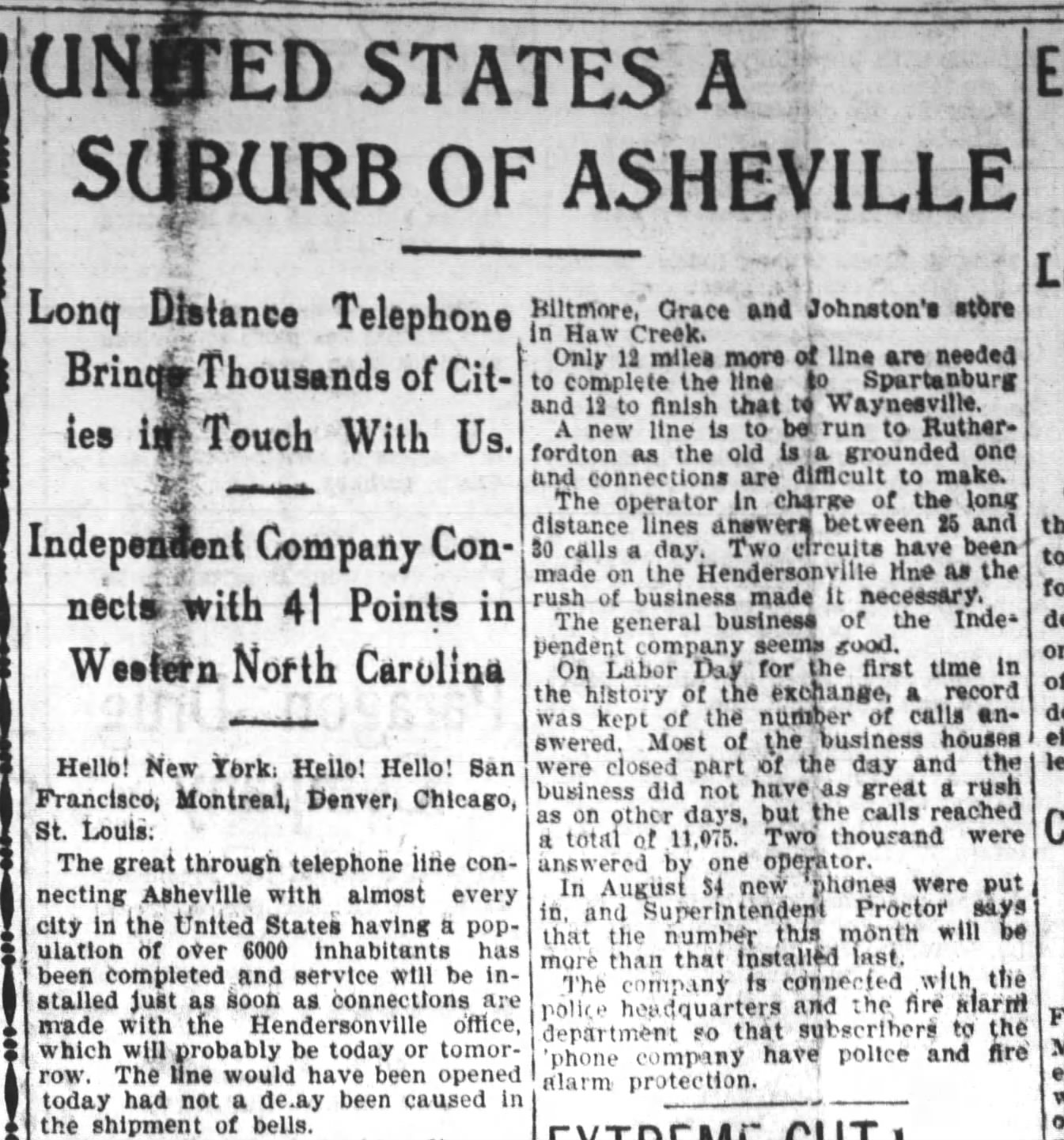 The Asheville Citizen , 24 septembre 1901
The Asheville Citizen , 24 septembre 1901
En 1903, avec 1 028 téléphones installés, «
proportionnellement au nombre de résidents de son territoire
», la Asheville Telephone Company détenait « probablement
» le record mondial du nombre d’abonnés.
 The
Asheville Citizen , 13 janvier 1903
The
Asheville Citizen , 13 janvier 1903
Le glas sonne pour les indépendants
Mais secrètement, la compagnie de téléphone
d’Asheville était en difficulté.
L'entreprise locale, hélas, perdait des milliers de dollars par
an. Plus elle gagnait de clients, plus elle devait investir dans du
matériel et du personnel supplémentaires, mais ses tarifs
étaient si bas qu'ils ne pouvaient les maintenir. En 1900, elle
avait acheté un nouveau standard multiplex à 4 000 dollars,
qui, deux ans plus tard, était déjà trop petit
pour Asheville. Les coûts des matériaux et les salaires
avaient augmenté, en partie à cause des grèves.
À l’été 1903, cinq ans seulement après
avoir promis de ne pas augmenter les tarifs ni de vendre à Bell,
un rachat fut proposé – et rapidement, les émotions
furent vives.
Une réunion en juillet 1903 fut « une affaire torride »,
marquée par « une bagarre » entre des hommes vraisemblablement
opposés sur la question. Ce mois-là, Southern Bell acquit
une participation majoritaire dans l'Asheville Telephone Company, fusionnant
ainsi sous le nom d'Asheville Telephone & Telegraph Company. L'objectif
était de stabiliser les tarifs à un niveau raisonnable,
de bénéficier du réseau plus étendu et des
meilleurs équipements de Bell, et de réduire le nombre
de poteaux téléphoniques (un seul ensemble de connexions
suffirait alors que l'infrastructure précédente avait
été doublée).
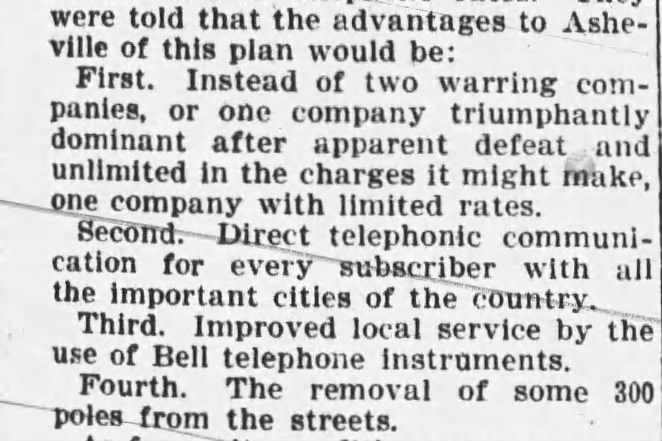 The Asheville Citizen , 26 juin 1903
The Asheville Citizen , 26 juin 1903
Le public n'était pas satisfait. Pourquoi vendre à Bell
? Pourquoi ne pas voir si une autre entreprise indépendante pourrait
reprendre le service à des tarifs raisonnables ? La Asheville
Telephone Company n'avait pas encore fait faillite ; pourquoi ne pas
simplement la laisser augmenter ses tarifs suffisamment pour dégager
des bénéfices ?
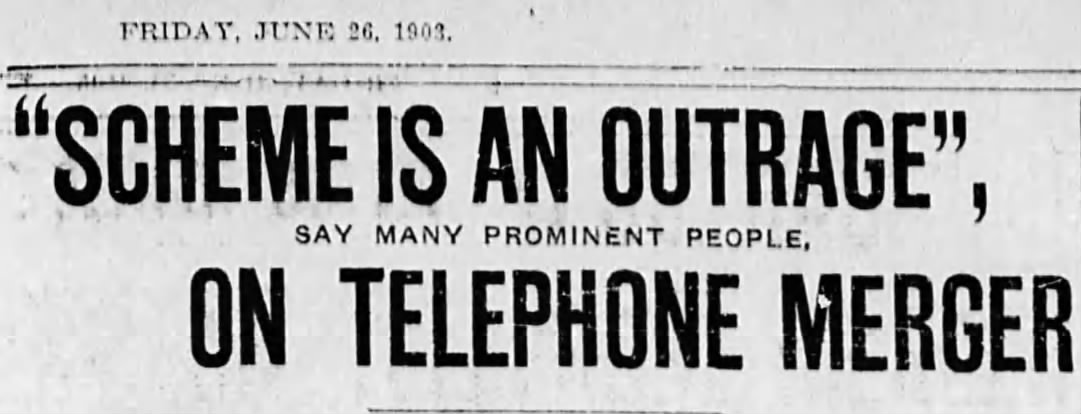 The
Asheville Citizen , 26 juin 1903
The
Asheville Citizen , 26 juin 1903
L'accord fut conclu, malgré des débats houleux et une
« lutte acharnée » menée par les habitants
de la ville. Le 23 octobre 1903, « la plus grande foule jamais
vue à une réunion du conseil municipal était présente
» lors d'une réunion qui s'éternisa jusqu'à
2 h 30 du matin.
Lorsque la fumée s'est dissipée (métaphoriquement),
Asheville envisageait une franchise de 33 ans avec une augmentation
de tarif de 60 % pour les cinq années suivantes, après
quoi « l'entreprise pourrait facturer ce qu'elle veut ».
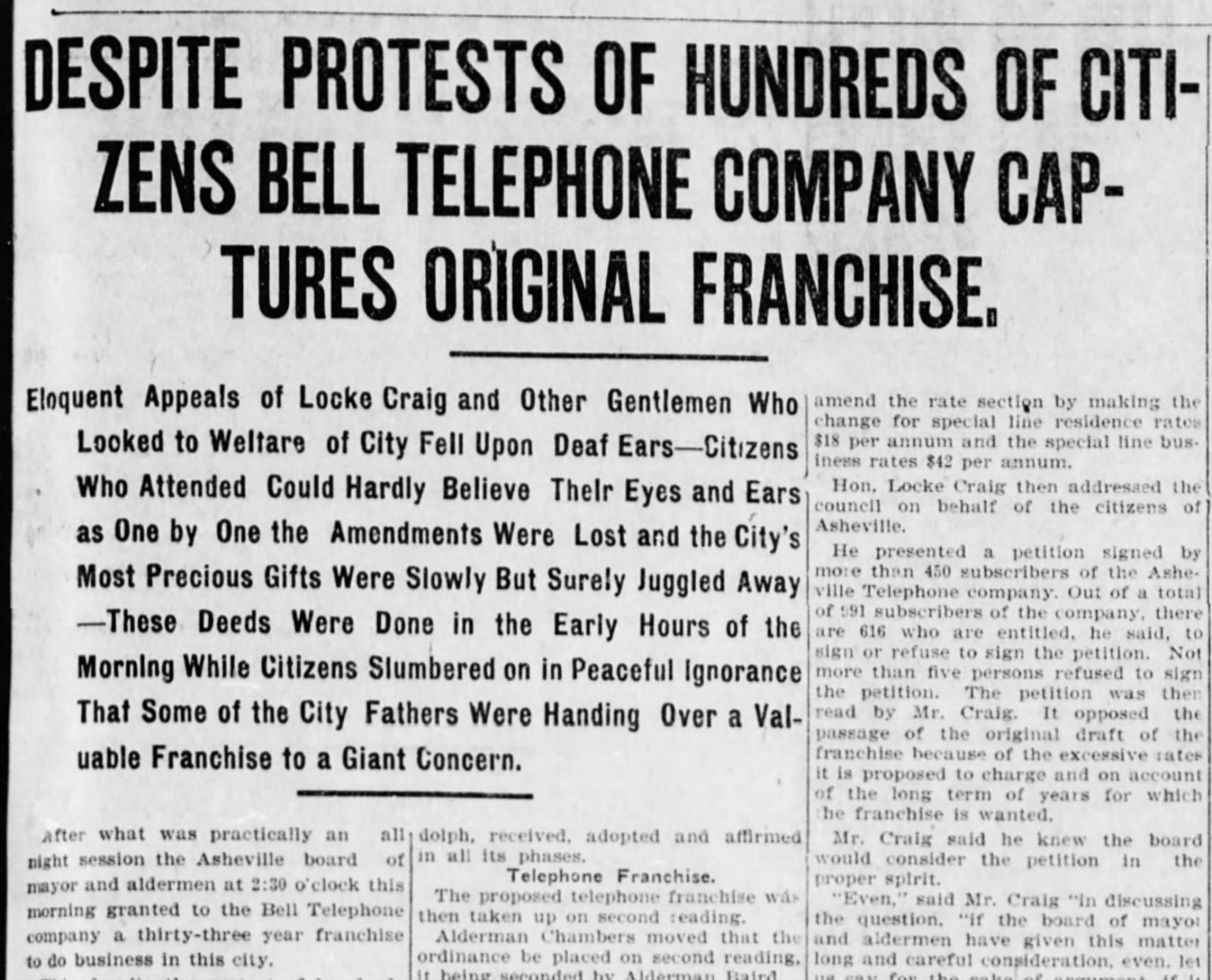 The Asheville Citizen , 24 octobre 1903
The Asheville Citizen , 24 octobre 1903
L'annuaire téléphonique de 1904 (exemplaire
conservé aux Collections spéciales du comté de
Buncombe, réf. NC 917.5688 ASH 1904 ) indique que WS Proctor
est toujours en poste comme directeur, mais travaille désormais
sous la direction de WT Gentry, président de Southern Bell. Et
regardez ces connexions longue distance, grâce au réseau
Bell !
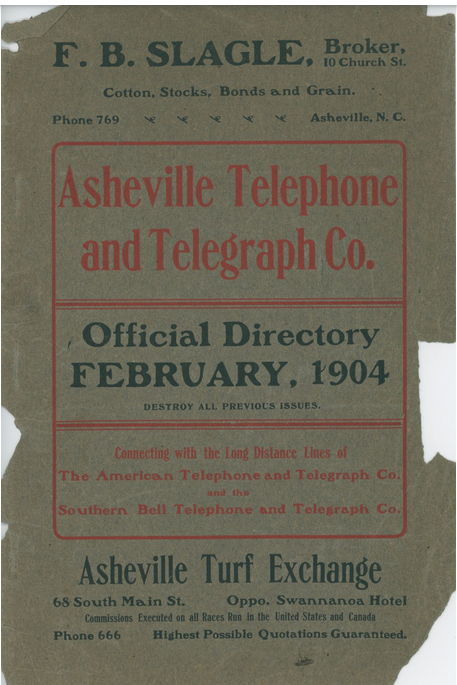
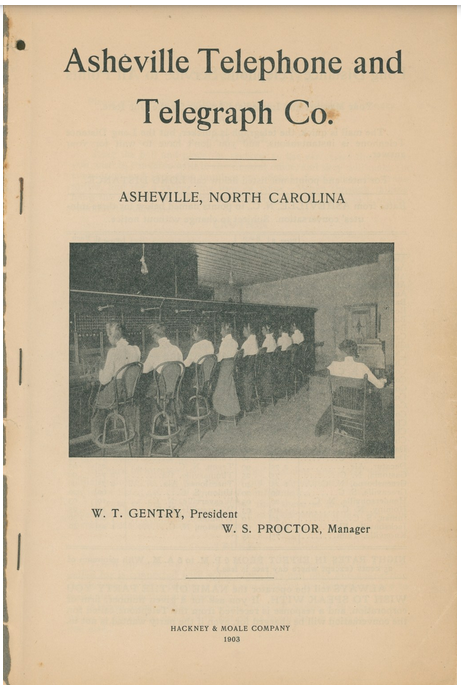
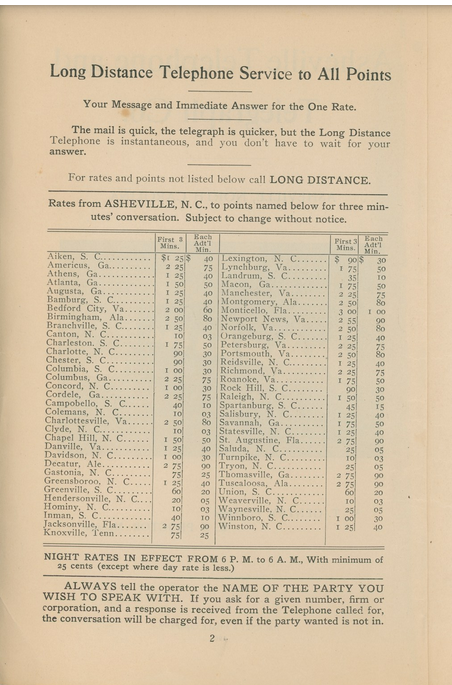
La compagnie de téléphone et de télégraphe
d'Asheville
Malgré les critiques, la transaction a indéniablement
apporté des améliorations. Les lignes ont continué
à être étendues. Le matériel a été
remplacé. Et, en 1906, la Asheville Telephone and Telegraph Company
avait déménagé de ses anciens bureaux de Patton
Avenue vers un nouveau central téléphonique, salué
comme « le plus moderne jamais construit ».
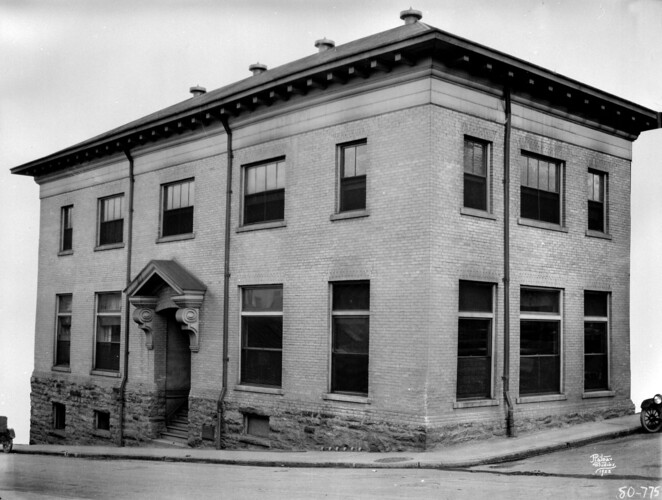

Bâtiment du central téléphonique en 1922 et en 1995.
Photographie de Zoe Rhine, employée de la bibliothèque.
(Notez l'aile arrière ajoutée dans les années 1920
— et la prochaine fois que vous passerez, cherchez le panneau «
Southern Bell Tel. & Tel. Co. » !)
Situé sur Walnut Street entre North Lexington
Avenue et Rankin Avenue (l'entrée se trouve aujourd'hui au 25
Rankin), ce bâtiment en briques de deux étages comportait
une salle de pause pour les opérateurs avec « des chaises
et des salons confortables, les derniers périodiques et un poêle
sur lequel les jeunes femmes pouvaient réchauffer leurs déjeuners
ou cuisiner ce qu'elles désiraient », ainsi qu'un nouveau
standard « de conception la plus récente et la plus moderne
» conçu pour gérer un trafic téléphonique
important, en particulier pendant la saison touristique estivale.
De nouveaux téléphones ont également été
installés chez les clients : « une amélioration
considérable par rapport aux anciens, car il n'est plus nécessaire
de sonner pour joindre le central. Il suffit de décrocher le
combiné et un voyant rouge s'allume au standard pour signaler
à la personne qui répond que son attention est requise.
»
Les Hello Girls
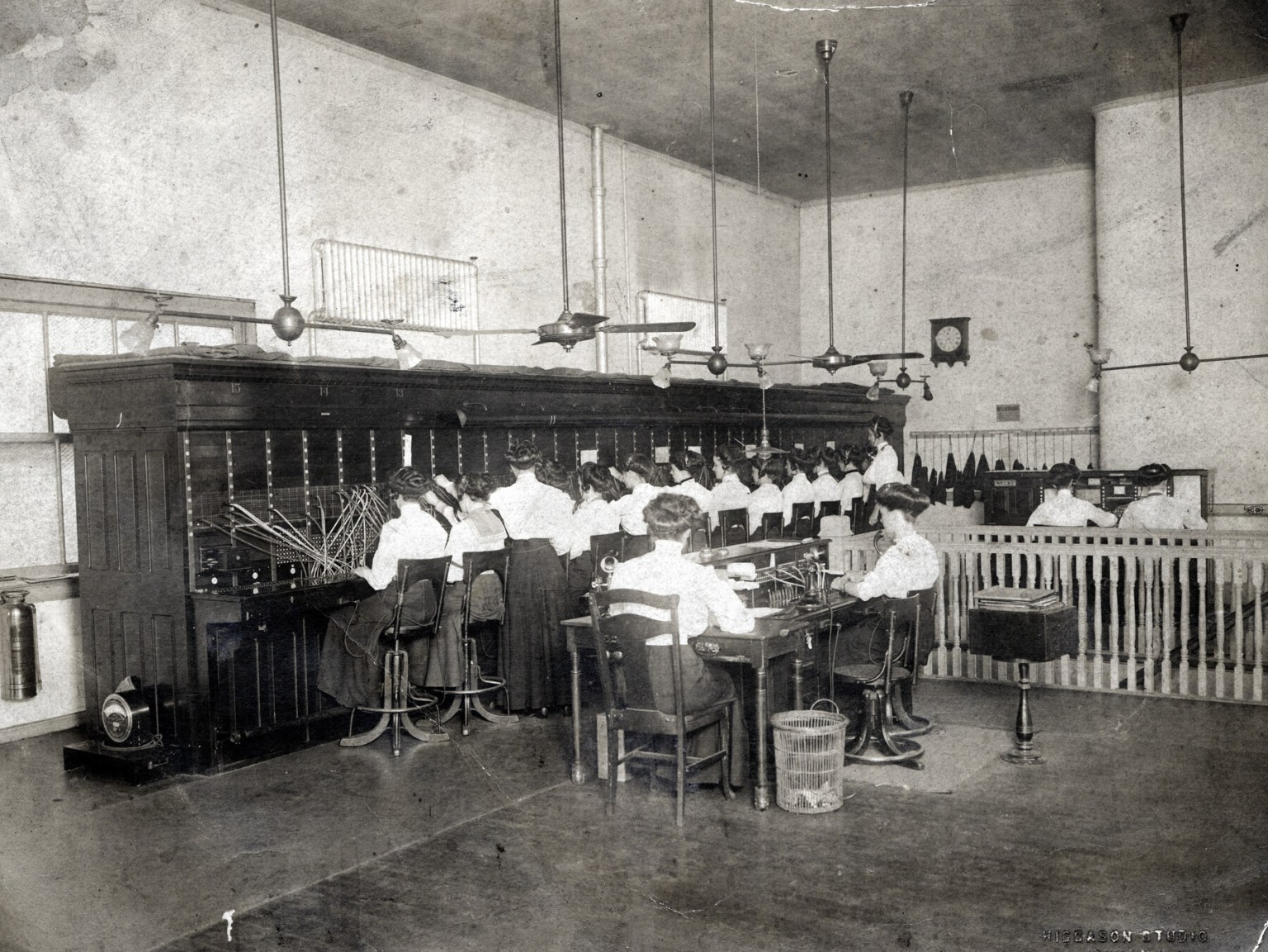 Central d'Asheville, non daté.
Central d'Asheville, non daté.
Bien que les télégraphistes aient été
majoritairement des hommes, le travail au téléphone –
où les opérateurs devaient parler aux clients – est
rapidement devenu un métier genré et féminin. Socialisées
dans la priorité donnée à la politesse, au souci
du détail et à la qualité de l'élocution,
les femmes – en particulier les femmes blanches célibataires,
nées dans le pays et issues de la classe moyenne – étaient
considérées comme particulièrement aptes à
servir de « machine humaine ». (Les hommes et les garçons,
en revanche, étaient enclins aux farces et aux jurons.)
Le travail des opératrices téléphoniques était
connu du public, car les utilisateurs devaient interagir avec elles
pour passer des appels. On se rendait même au central téléphonique
pour voir les « hello girls » à l'œuvre.
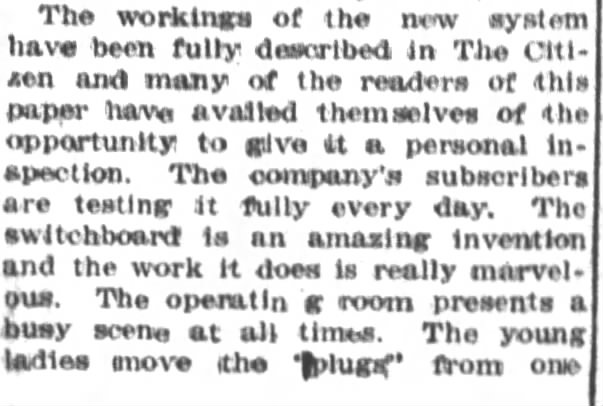
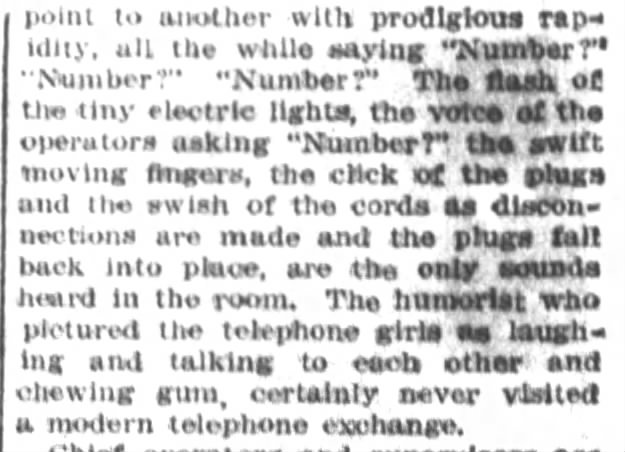
The Asheville Citizen , 23 décembre 1906
Ce n'était pas une tâche facile.
L'une des raisons pour lesquelles il fallait garantir aux opérateurs
une salle de pause confortable était la tension du service. «
Le poste d'opérateur est éprouvant », souligne l'article.
« Un abonné impatient et irritable risque d'irriter une
jeune fille nerveuse, empêchée par le règlement
de répondre autrement qu'une réponse prédéfinie
à toute déclaration, aussi désagréable soit-elle.
»
En plus de l'impolitesse, les opérateurs téléphoniques
devaient se contenter de connaître (et de garder) les secrets
de la ville.
Dès 1887, une opératrice d'Indianapolis notait que, bien
que ne connaissant pas personnellement les usagers du téléphone
qu'elle servait, « je sais précisément quel genre
d'hommes ils sont pour les entendre parler au téléphone.
Je suis parfois horrifiée par le langage employé par ces
hommes qui, en société et parmi leurs amis, sont considérés
comme des gens bien. Je pense à de nombreux membres éminents
de l'Église qui font parfois rougir les jeunes filles qui les
écoutent par leurs conversations téléphoniques.
»
Lors d'une réunion du Rotary Club d'Asheville en 1919 (on comptait
alors 5 608 téléphones en service à Asheville),
les Rotariens visitèrent les locaux de la Compagnie de téléphone
et de télégraphe d'Asheville. Après le déjeuner,
les « bonjour » leur offrirent un bouquet de fleurs et une
carte contenant un rappel plein d'humour :
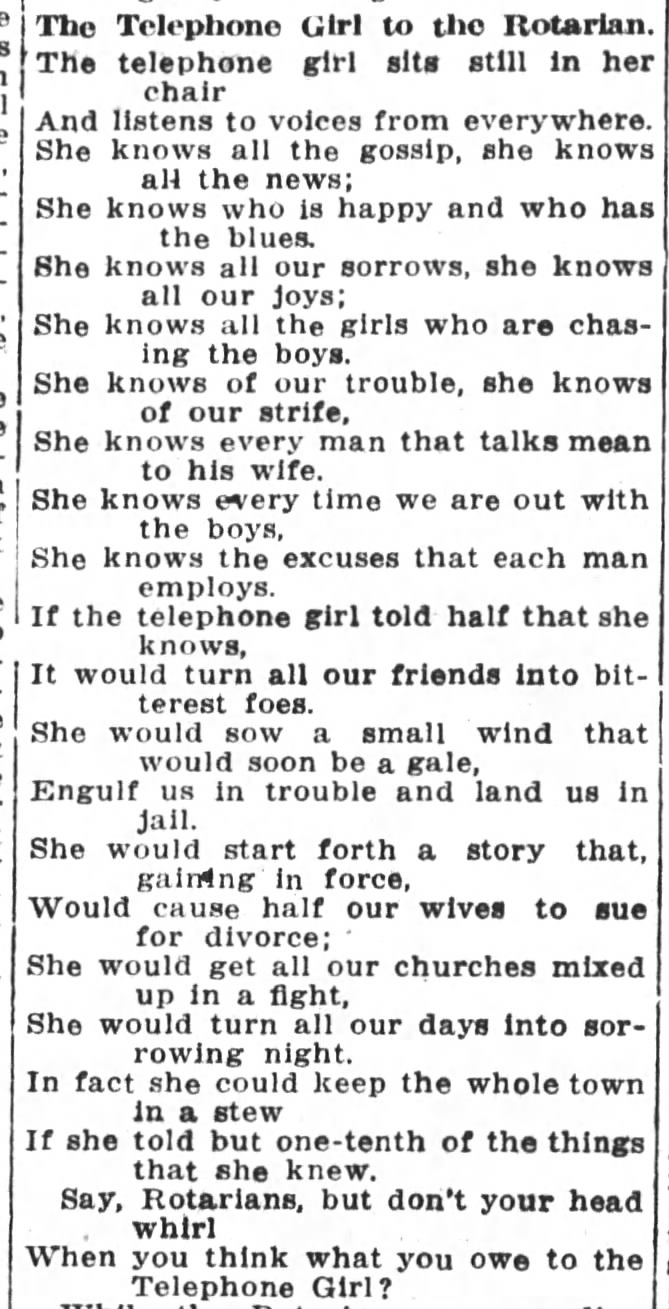 The Asheville Citizen , 8 août 1919
The Asheville Citizen , 8 août 1919
En 1922, le téléphone n'était plus
considéré comme un luxe, mais comme une « nécessité
absolue ».
Quatre-vingt-seize opérateurs connectaient facilement entre 100
000 et 150 000 appels par jour, et le journal rapportait que plus de
6 000 téléphones avaient été installés
à Asheville – « le plus grand nombre de téléphones
par habitant de toutes les villes du Sud », rapportait le journal.
Asheville était une ville bavarde.
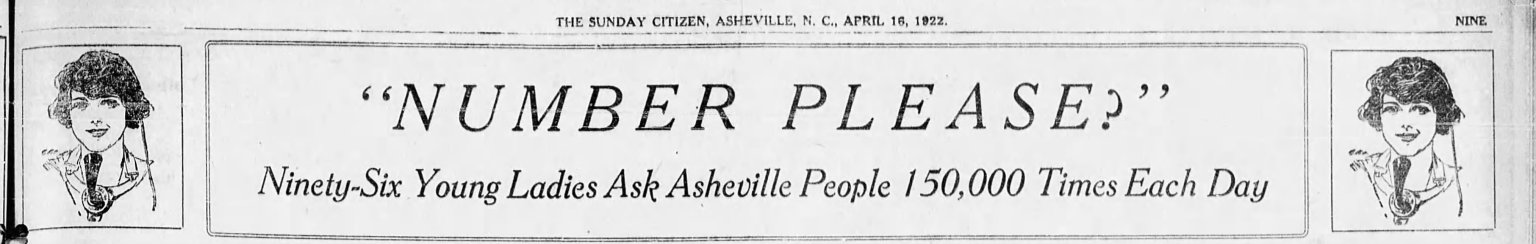 The Asheville Citizen
, 16 avril 1922
The Asheville Citizen
, 16 avril 1922

Bâtiment Southern Bell Exchange, salle de l'opérateur téléphonique,
1922.
Le 10 000e téléphone
Southern Bell a racheté les actions restantes de l'Asheville Telephone and Telegraph Company le 1er août 1923.
Le 15 décembre 1925, le 10 000e téléphone fut installé au domicile de RL Sessoms, à Lakeview Park. La ville et la compagnie Southern Bell marquèrent cet événement par un déjeuner à l'hôtel George Vanderbilt, au cours duquel le maire John H. Cathey, Holmes Bryson, président de la Chambre de commerce, et MB Speir, directeur de Southern Bell pour les Carolines, firent des discours. [xliv]
Le discours de M. Speir de 1925 sur la croissance du téléphone soulignait un point surprenant : sa qualité locale.
Alors que les téléphones d'Asheville étaient
autrefois principalement utilisés pour les affaires pendant les
mois d'été (saison touristique), « ces dernières
années, son entreprise réalise la majeure partie de ses
activités en automne, en hiver et au printemps. Ceci témoigne,
rapporte l'Asheville Times , de l'élargissement des bases économiques
de la vie communautaire. »
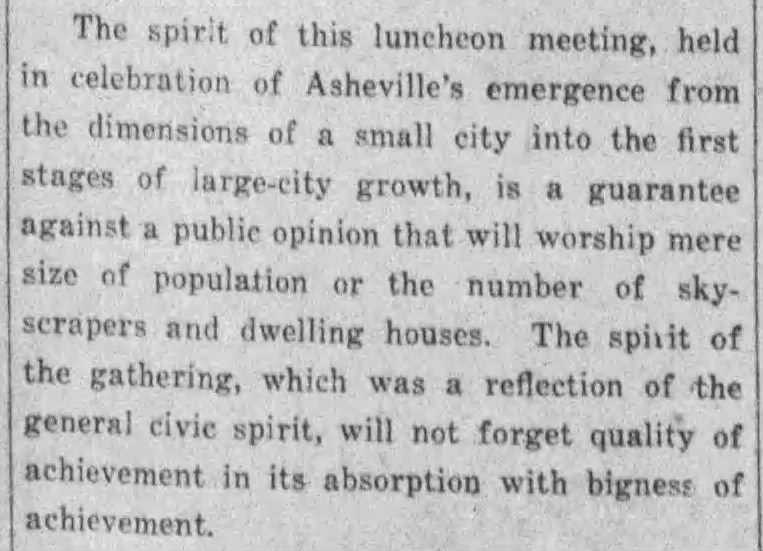 The
Asheville Times , 16 décembre 1925
The
Asheville Times , 16 décembre 1925
Réferences :
Bibliothèque du Congrès, « Téléphone
et télégraphe multiple », documents de la famille
Alexander Graham Bell à la Bibliothèque du Congrès.
https://www.loc.gov/collections/alexander-graham-bell-papers/articles-and-essays/telephone-and-multiple-telegraph/
[ii] « La première publicité téléphonique,
utilisée l'année suivant la délivrance du brevet
original, proposait de fournir des téléphones «
pour la transmission de la parole articulée par des instruments
distants de moins de vingt miles », reproduite dans Watson, Thomas
A., The Birth and Babyhood of the Telephone , un discours prononcé
devant la troisième convention annuelle des pionniers du téléphone
d'Amérique à Chicago, le 17 octobre 1913. https://www.gutenberg.org/files/54506/54506-h/54506-h.htm
[iii] Avis de constitution dans The Semi-Weekly Asheville Citizen, 1er
octobre 1885, page 1. https://www.newspapers.com/article/the-semi-weekly-asheville-citizen-incorp/131033223/
[iv] « Le central téléphonique d'Asheville »,
The Asheville Citizen , 10 septembre 1885, page 1 https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-beginning-of-tel/121613170/
[v] « M. Milton Ledford est le « tireur d'élite »
le plus efficace d'Asheville… » ??dans The Asheville Citizen,
31 décembre 1885, page 1. https://www.newspapers.com/article/the-semi-weekly-asheville-citizen-milton/131040339/
[vi] Krulwich, Robert. « Une histoire (étonnamment) brève
de "Hello" », NPR, 17 février 2011. https://www.npr.org/sections/krulwich/2011/02/17/133785829/a-shockingly-short-history-of-hello
[vii] « Les fils téléphoniques sont en train d'être
tendus… » dans The Semi-Weekly Asheville Citizen , 9 décembre
1885, page 1 https://www.newspapers.com/article/the-semi-weekly-asheville-citizen-post-o/128961902/
[viii] « Le central téléphonique », The Asheville
Citizen, 2 janvier 1886, page 1. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-how-to-use-a-tel/121613385/
[ix] « Téléphonique » dans The Asheville Citizen
, 12 février 1887, page 1. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-ashevilles-tele/130188918/
[x] « Cela fait seulement une dizaine d'années que…
» dans The Asheville CItizen, 23 mars 1887, page 2. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-telephone-takeov/130189088/
[xi] Mueller, Milton. Service universel : concurrence, interconnexion
et monopole dans la construction du système téléphonique
américain . (Syracuse, NY : Université de Syracuse, 2013).
https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=books
[xii] « La question du téléphone » dans The
Asheville Citizen , 21 juin 1888, page 1. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-the-question-of/131083188/
[xiii] « Téléphone » dans The Daily Sun ,
20 juin 1888, page 4. https://www.newspapers.com/article/the-daily-sun-pro-bell-telephone-service/131084428/
[xiv] « Réunion des échevins » dans The Daily
Sun , 4 août 1888, page 4. https://www.newspapers.com/article/the-daily-sun-asheville-telephone-compan/131034331/
[xv] « L'opposition a disparu ici, mais la cloche n'a pas pris
sa place, et la question est : pourquoi ? Car le téléphone
est plus nécessaire ici que jamais. » The Asheville Citizen
, 18 décembre 1888. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-local-telephone/131084676/
[xvi] « Un nouveau téléphone arrive en ville »
dans The Asheville Gazette , 10 septembre 1898. https://www.newspapers.com/article/the-asheville-times-new-phone-coming-to/131088088/
[xvii] « Nouveau système téléphonique »
dans The Asheville Daily Citizen , 1er novembre 1898. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-proctor-sons-n/131035801/
[xviii] « Bonjour ! Quelques mots d'avertissement sur la question
du téléphone » dans The Asheville Citizen , 6 mars
1899. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-fighting-back-be/131095581/
[xix] « Service téléphonique étendu »
dans The Asheville Daily Citizen , 17 août 1899. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-proctors-teleph/131092840/
[xx] « Connectez-vous avec Waynesville », Asheville Daily
Gazette, 17 novembre 1899, page 1, https://www.newspapers.com/article/the-asheville-times-waynesville-telehon/131098161/
[xxi] « Bonjour, Spartanburg ! » dans The Asheville Daily
Citizen , 9 avril 1900, page 1, https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-asheville-teleph/131098693/
[xxii] « Bonjour Fairview ! » dans The Asheville Daily Citizen
, 19 juillet 1900, page 8. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-asheville-teleph/131098887/
[xxiii] « Bonjour, Leicester ! » dans The Asheville Weekly
Citizen , 12 octobre 1900, page 5. https://www.newspapers.com/article/the-asheville-weekly-citizen-leicester-t/131099091/
[xxiv] « Système téléphonique longue distance
: des lignes dans toute la Caroline du Nord occidentale dans les 60
prochains jours », dans The Asheville Citizen , 27 avril 1901.
https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times/131099874/
[xxv] « Les États-Unis, une banlieue d'Asheville »
dans The Asheville Citizen , 24 septembre 1901, page 1. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-bell-connects-as/131100148/
[xxvi] « Un téléphone pour treize personnes »
dans The Asheville Weekly Citizen , 13 janvier 1903, page 7. https://www.newspapers.com/article/the-asheville-weekly-citizen-asheville-t/131405258/
[xxvii] « Les États-Unis, une banlieue d'Asheville »
dans The Asheville Citizen , 24 septembre 1901. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-bell-connects-as/131100148/
[xxviii] « Grande amélioration de l'équipement ménager
» dans The Asheville Daily Citizen , 2 mars 1900, page 1. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-new-switchboard/131445368/
[xxix] « Un téléphone pour treize personnes »
dans The Asheville Weekly Citizen , 13 janvier 1903, page 7. https://www.newspapers.com/article/the-asheville-weekly-citizen-asheville-t/131405258/
[xxx] « Syndicat local n° 238 », dans The Electrical
Worker : Journal officiel, Fraternité internationale des ouvriers
en électricité, juin 1903, page 58. https://www.yumpu.com/en/document/view/21822768/1903-06-june-electrical-workerpdf-international-brotherhood-of-
[xxxi] « Résumé des nouvelles locales » dans
The Asheville Weekly Citizen , 3 juillet 1903, page 1. https://www.newspapers.com/article/the-asheville-weekly-citizen-telephone-m/131391047/
[xxxii] « La réunion téléphonique était
chaleureuse et intéressante » dans The Asheville Weekly
Citizen , 3 juillet 1903, page 1. https://www.newspapers.com/article/the-asheville-weekly-citizen-telephone-m/131390588/
[xxxiii] « La Chambre de commerce consent, lors d'une réunion
tenue hier, à la fusion des compagnies de téléphone
» dans The Asheville Weekly Citizen , 26 juin 1903, page 7. https://www.newspapers.com/article/the-asheville-weekly-citizen-advantages/131401574/
[xxxiv] « Malgré les protestations de centaines de citoyens,
la compagnie de téléphone Bell s'empare du droit de vote
initial. » The Asheville Citizen , 24 octobre 1903, page 1. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-october-23-meeti/131450773/
[xxxv] Annuaire officiel de la Asheville Telephone and Telegraph Co.,
février 1904. Disponible pour recherche au BCSC, réf.
NC 917.5688 ASH 1904
[xxxvi] « Le nouveau service téléphonique d'Asheville
» dans The Asheville Citizen , 23 décembre 1906, pages
9-10. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-new-building-on/131454015/
[xxxvii] Ibid.
[xxxviii] « Des électriciens sont là pour réparer
le tableau électrique » dans The Asheville Citizen, 2 septembre
1906. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-new-switchboard/131455912/
[xxxix] Lipartito, Kenneth. « Quand les femmes étaient
des interrupteurs : technologie, travail et genre dans l'industrie du
téléphone, 1890-1920 », The American Historical
Review , vol. 99, n° 4 (octobre 1994), 1075-1111. https://doi.org/10.2307/2168770
.
[xl] « Le nouveau service téléphonique d'Asheville
» dans The Asheville Citizen , 23 décembre 1906, page 9.
https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-new-building-on/131454015/
[xli] « Le téléphone comme aide à Satan »
dans The Asheville Citizen , 18 juin 1887, page 1. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-the-telephone-as/130189573/
[xlii] « Les Rotariens d'Asheville sont les invités des
« Hello » Girls » dans The Asheville Citizen , 8 août
1919, page 7. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-rotary-club-visi/131454537/
[xliii] « Un numéro, s'il vous plaît ? » 96
jeunes femmes demandent aux habitants d'Asheville 150 000 fois par jour,
dans The Asheville Citizen , 16 avril 1922, page 9. https://www.newspapers.com/article/asheville-citizen-times-asheville-teleph/131451174/
[xliv] « Installera le 10 000e poste mardi prochain » dans
The Asheville Times , 13 décembre 1925, page 40. https://www.newspapers.com/article/the-asheville-times-10000th-telephone-i/131457471/
[xlv] « Asheville franchit une étape importante »
dans The Asheville Times, 16 décembre 1925, page 4. https://www.newspapers.com/article/the-asheville-times-10000th-telephone-l/131459086/
L'histoire des télécommunications à
Asheville ne commence pas avec le téléphone, l'objet de
ce site mais comme partout dans le monde avec l'arrivée du télégraphe.
Article de Carissa Pfeiffer , bibliothécaire, Collections spéciales
du comté de Buncombe
Exploiter la modernité : le Telegraph arrive à Asheville
Aux XIXe et XXe siècles , le télégraphe
a révolutionné les communications longue distance.
Inventé par Samuel Morse et Alfred Vail
dans les années 1830, le « télégraphe magnétique
de Morse » (comme il était appelé dans l' Asheville
Messenger ) reposait sur un réseau de fils télégraphiques
qui transmettaient les signaux électriques d'un bureau télégraphique
à un autre.
Dans les années 1840, le journal d'Asheville annonçait
l'existence de nouveaux réseaux de communication reliant des
villes comme Washington, D.C., Baltimore, New York et Philadelphie.
Il fallut attendre des décennies entre le moment où Morse
envoya à Vail le premier message historique « Qu'a fait
Dieu ! » et celui où Asheville rejoignit le réseau
avec un message inaugural différent, commençant par «
Criez la bonne nouvelle ! ».
Le financement était un problème.
Les spéculations concernant la construction de lignes télégraphiques
reliant Asheville à Salisbury en 1869 se sont révélées
fausses, mais un « important télégraphiste de Richmond
» a suggéré que cela pourrait se faire grâce
à un financement public.
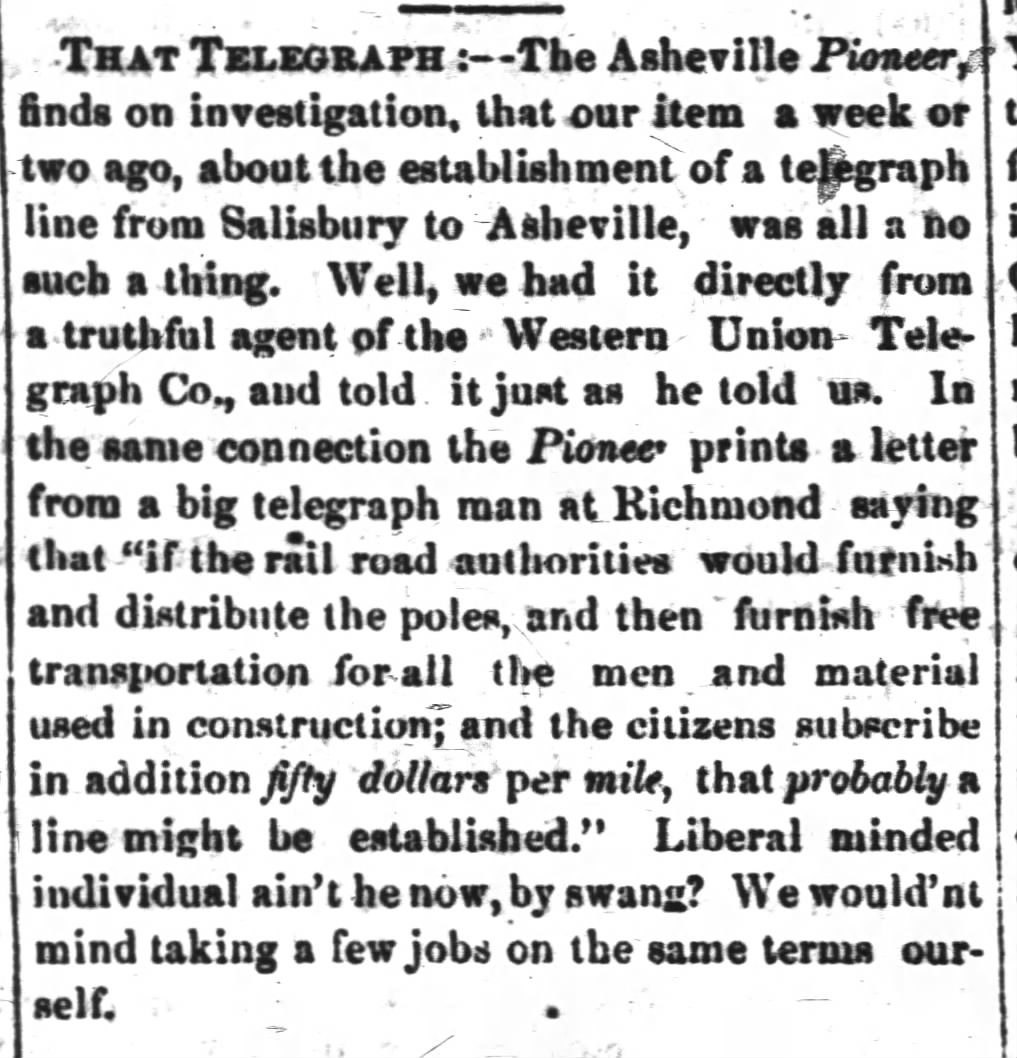 Carolina Watchman (Salisbury, Caroline du Nord), 29 juillet 1875
Carolina Watchman (Salisbury, Caroline du Nord), 29 juillet 1875
Finalement, il fallut le financement et le soutien de
personnalités influentes, mais cela se produisit finalement le
28 juillet 1877. A cette date, Bell avait breveté le téléphone
et commencé à le commercialiser.
Parmi les principaux artisans de l'installation du télégraphe
à Asheville figuraient Calvin Monroe McLoud (parfois orthographié
McCloud ou McLeod), Jesse Merrimon et le surintendant J.W. Kates de
la Postal Telegraph Company. Samuel G. Weldon en fut le premier opérateur.
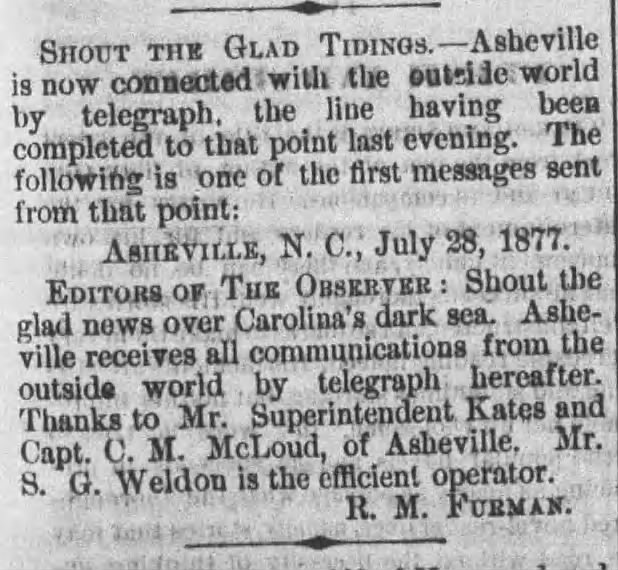 The Raleigh News and
Observer , dimanche 29 juillet 1877
The Raleigh News and
Observer , dimanche 29 juillet 1877
Dans son ouvrage Western North Carolina: A History (1730-1913)
, John Preston Arthur écrit qu'après cette première
étape, « grâce aux efforts du regretté capitaine
CM McLoud, la ligne fut prolongée jusqu'à Hendersonville.
M. Weldon en devint alors propriétaire et exploitant jusqu'à
ce que la compagnie ferroviaire la lui reprenne. »
Le Hendersonville Courier a tenu à souligner que la générosité
de McLoud dans le financement de l'entreprise contrastait fortement
avec l'avarice de CERTAINES PERSONNES.
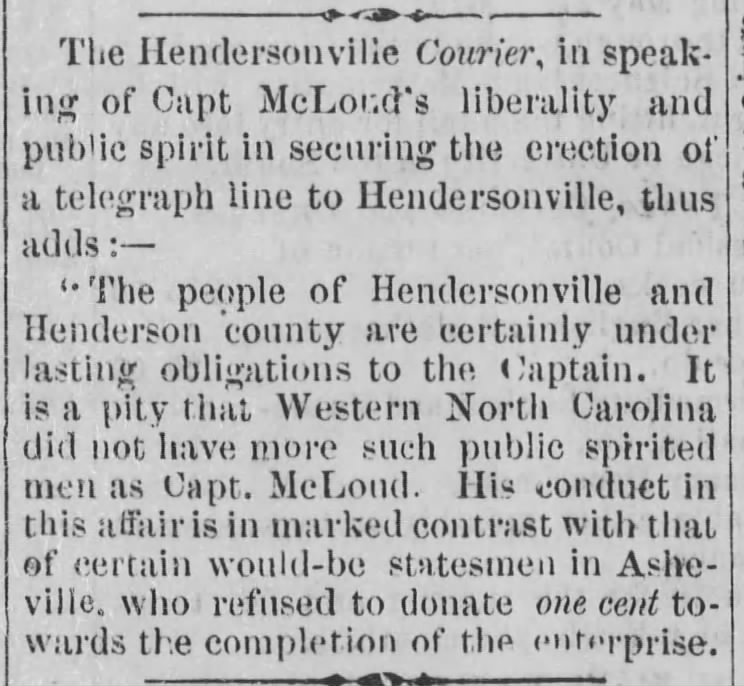 The Asheville Weekly Citizen , 25 juillet 1878
The Asheville Weekly Citizen , 25 juillet 1878
La ligne télégraphique s'étendait
alors de Hendersonville à Spartanburg, aboutissant au terminus
du chemin de fer Spartanburg & Asheville.
En 1879, Terry Ruscin écrit dans A History of Transportation
in Western North Carolina qu'il y avait « 47,67 miles de ligne
télégraphique installée de Spartanburg à
Hendersonville […] et 19,8 miles de Hendersonville à Biltmore
sept ans plus tard » . (Les lignes Spartanburg & Asheville
et Asheville & Spartanburg faisaient partie du chemin de fer Richmond
& Danville, racheté plus tard par la Southern Railway Company.)
Les chemins de fer ont été les premiers à exploiter
commercialement les nouvelles technologies de communication, ce qui
a permis une mesure précise et cohérente du temps entre
les gares. L'histoire du télégraphe est intimement liée
à celle du chemin de fer (et donc, il convient de le souligner,
à l'utilisation de la main-d'œuvre forcée pour créer
l'infrastructure ferroviaire en Caroline du Nord occidentale ).
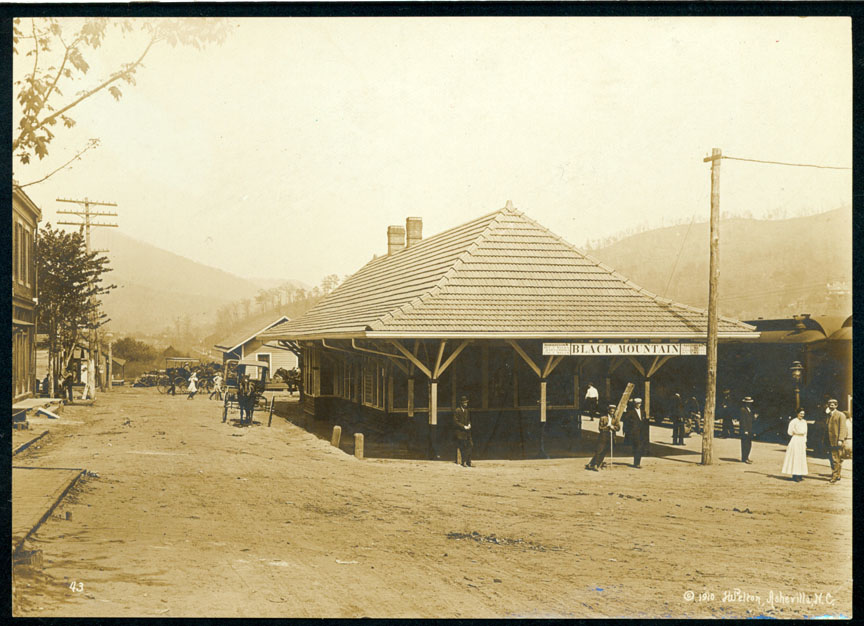
Gare du Southern Railway à Black Mountain, 1910. Photographie
d'Herbert W. Pelton. À droite, sous le panneau de la gare, un
homme muni d'une canne s'appuie sur le fil guide du poteau télégraphique.
Les télégraphes sans fil (non câblés) suivirent.
Le 4 janvier 1909, l' Asheville Telegraph annonçait que la United
Wireless Telegraph Company installerait une nouvelle station de radio
à Asheville, rejoignant ainsi environ 200 autres stations en
service et « mettant Asheville en communication directe avec les
navires de l'Atlantique transportant des équipements de radio
et certaines stations européennes, dans des conditions favorables,
sans parler de celles des côtes américaines ».
Le relief montagneux d'Asheville a donné à la ville un
avantage pour être choisie comme station : « Comme beaucoup
le savent, la distance à laquelle un message peut être
envoyé ou reçu dépend de la hauteur des antennes
», rapportait le Citizen . « Asheville bénéficie
d'un grand avantage naturel à cet égard, car des antennes
peuvent être installées sur une montagne proche et reliées
à une station de la ville par un simple circuit métallique.
»
 The Asheville Citizen , 4 janvier 1909
The Asheville Citizen , 4 janvier 1909
Opinion publique
Le chemin de fer et le télégraphe étaient tous
deux des symboles de l'ascension urbaine, et les habitants d'Asheville
étaient fiers de ces réalisations en matière d'infrastructures.
Dans cet extrait de journal de 1878, le nouveau télégraphe,
les chemins de fer et le palais de justice étaient autant de
raisons de classer Asheville parmi les villes les plus importantes de
l'État.
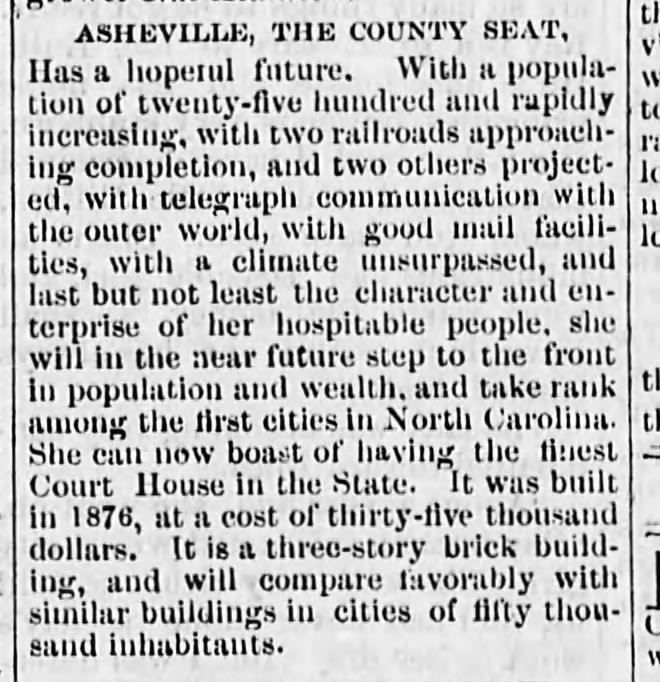 The Asheville Weekly Citizen , 5 septembre 1878
The Asheville Weekly Citizen , 5 septembre 1878
Certains habitants d’Asheville ont peut-être adhéré
au même optimisme technologique que d’autres dans le monde.
« Car quel est le but à atteindre », écrivait
l'auteur new-yorkais CF Briggs, « sinon le plus spirituel jamais
possible ? Non pas la modification ou le transport de la matière,
mais la transmission de la pensée. […] Celle-ci unit par
un lien vital toutes les nations de la terre. Il est impossible que
les anciens préjugés et les hostilités perdurent,
alors qu'un tel instrument a été créé pour
l'échange de pensées entre toutes les nations de la terre.
»
Eh bien, c'était en 1858. Peut-être qu'au moment où
Asheville a été équipée du télégraphe,
après la guerre civile, la réalité avait tempéré
ces perspectives utopiques.
Et le télégraphe avait aussi ses détracteurs,
bien sûr.
D'une part, les monopoles des compagnies de télégraphe
et des chemins de fer constituaient une préoccupation publique
majeure. Dans les journaux d'Asheville, comme ailleurs, des voix s'élevaient
pour demander au gouvernement de démanteler les monopoles afin
d'accroître la concurrence, ou de passer à la propriété
publique des infrastructures de communication et de transport. L'argument
du service public s'inspirait du service postal et des précédents
européens. D'autres s'y opposaient fermement, plaidant contre
un renforcement du contrôle gouvernemental sur les services publics.
La Western Union Telegraph Company était une force dominante.
Dirigée un temps au XIXe siècle par William H. Vanderbilt
(un cousin de celui qui commanda Biltmore), la Western Union cherchait
activement à contrôler le secteur des communications (et,
comme on pouvait s'y attendre, s'opposait à toute intervention
gouvernementale ).
Les détails des fusions d'entreprises, des batailles juridiques,
des conflits personnels et des réglementations fédérales
dépassent largement l'histoire régionale et pourraient
remplir plusieurs livres à eux seuls (et c'est déjà
le cas !), nous les passerons donc ici. Il suffit de dire que, pour
de nombreuses raisons, le télégraphe a joué un
rôle dans le développement des conglomérats industriels
de l'Âge d'or et de l'entreprise internationale moderne d'aujourd'hui.
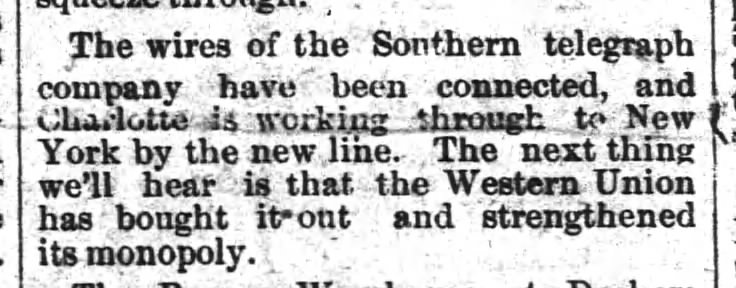 The Asheville Weekly Citizen , jeudi 23 août 1883
The Asheville Weekly Citizen , jeudi 23 août 1883
À Asheville, le bureau télégraphique
de Western Union a exploité plusieurs sites et succursales au
fil des ans, y compris un bureau à l'Eagle Hotel en 1883. La
Postal Telegraph Company et l'Asheville Telegraph & Telephone Company
étaient également en activité à Asheville
à la fin du 19e et au début du 20e siècle .
Le travail de la télégraphie
Les télégraphistes avaient la tâche difficile
de recevoir et de décoder le code Morse – points et tirets
– en caractères alphabétiques. Parmi les premiers
télégraphistes de la région d'Asheville figuraient
Weldon et Merrimon, mentionnés plus haut, mais l'infrastructure
télégraphique s'est rapidement développée,
nécessitant une main-d'œuvre plus importante.
Les carrières des « Morsemen » Herbert S. Howell,
Morris N. Clayton et CD Clarke ont été relatées
dans l' Asheville Citizen-Times de 1952 (ci-dessous). Horace L. Carpenter
a écrit au journal quelques jours plus tard pour évoquer
également son rôle d'opérateur parmi les quatre
du bureau de Western Union en 1892. Edward N. Williams (1874-1939) a
particulièrement œuvré au sein de ce personnel. Né
dans le comté de Buncombe, Williams avait débuté
sa carrière de 45 ans à Western Union comme messager,
avant de diriger l'équipe d'opérateurs télégraphiques
jusqu'à sa retraite en 1939.
« Le bureau Western Union d'Asheville possède encore la
table avec l'équipement où les agents de Morse enregistraient
leurs messages ou collaient leurs oreilles aux boîtes en bois
encombrantes – les « résonateurs » – pour
entendre le brouhaha des sons qui transportaient des pensées
de toutes sortes à travers le monde », indiquait l'article.
Fournir des dépêches, appelées « poneys »,
au journal était une responsabilité essentielle des opérateurs.
À l’origine, se souvient Carpenter, « le rapport de
presse et tous les télégrammes étaient copiés
à la main ; aucun opérateur n’avait appris à
copier sur la machine à écrire. »
Dès les premiers jours, les journées d'actualité
furent mouvementées pour les télégraphistes. Après
les élections de 1884, le bureau télégraphique,
alors installé à l'Eagle Hotel, était « bondé
jour et nuit […], un peu chaotique ».
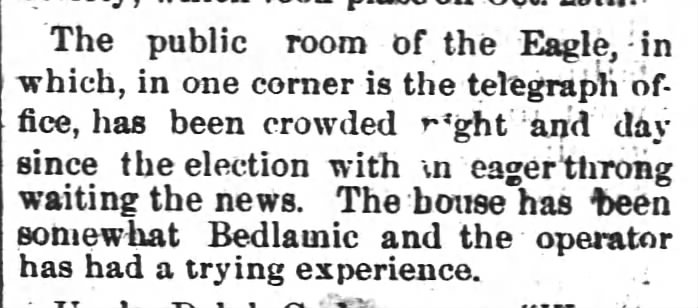 The
Asheville Weekly Citizen , 1er novembre 1884
The
Asheville Weekly Citizen , 1er novembre 1884
L'inondation de 1916 fut une période difficile
pour tous, y compris pour les télégraphistes qui devaient
répondre aux demandes non seulement des journaux de tout le pays,
mais aussi des amis et des proches qui prenaient des nouvelles de leurs
proches.
Edward N. Williams, qui travaillait alors comme opérateur télégraphique,
transporta « deux valises remplies de messages » sur le
seul pont qui résista à l’inondation et assurait
le service ferroviaire depuis Asheville, « jusqu’à
Atlanta, où le plus grand bureau fut alerté de l’urgence
» et d’où « des messages de réconfort
furent finalement envoyés ».
Les « Morsemen » se souvenaient des « événements
les plus marquants de leur carrière », comme l'effondrement
de Babe Ruth en 1926, la découverte en 1932 du colonel Raymond
Robins, disparu, dans une pension de famille à Whittier, et le
meurtre d'Helen Clavenger, 18 ans, en 1936, au Battery Park Hotel. Le
meurtre de Clavenger a suscité un déluge de messages de
40 000 à 50 000 jours par jour pendant des semaines.
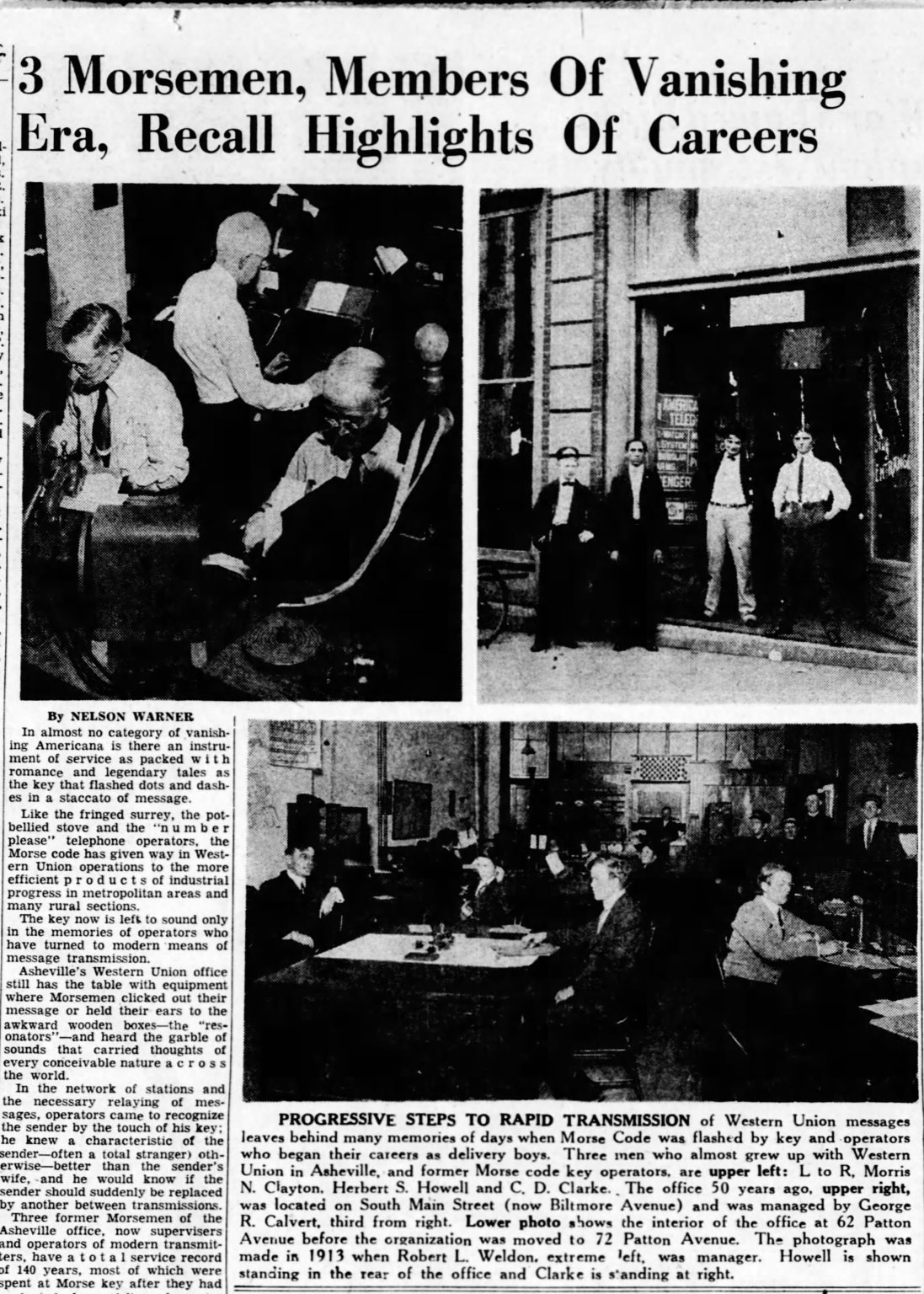
Nelson Warner, « Trois Morsemen, membres d'une époque en
voie de disparition, se souviennent des moments forts de leur carrière
», Asheville Citizen-Times , dimanche 24 août 1952.
L'avènement du téléphone a marqué l'histoire
du télégraphe.
Pourtant, les télégrammes ont continué à
être utilisés pour diffuser des nouvelles (comme décrit
ci-dessus), comme moyen rapide d'envoyer des nouvelles personnelles
et à des fins officielles, comme informer les familles du décès
d'un militaire. La plupart des télégrammes conservés
par les collections spéciales du comté de Buncombe datent
des années 1920 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
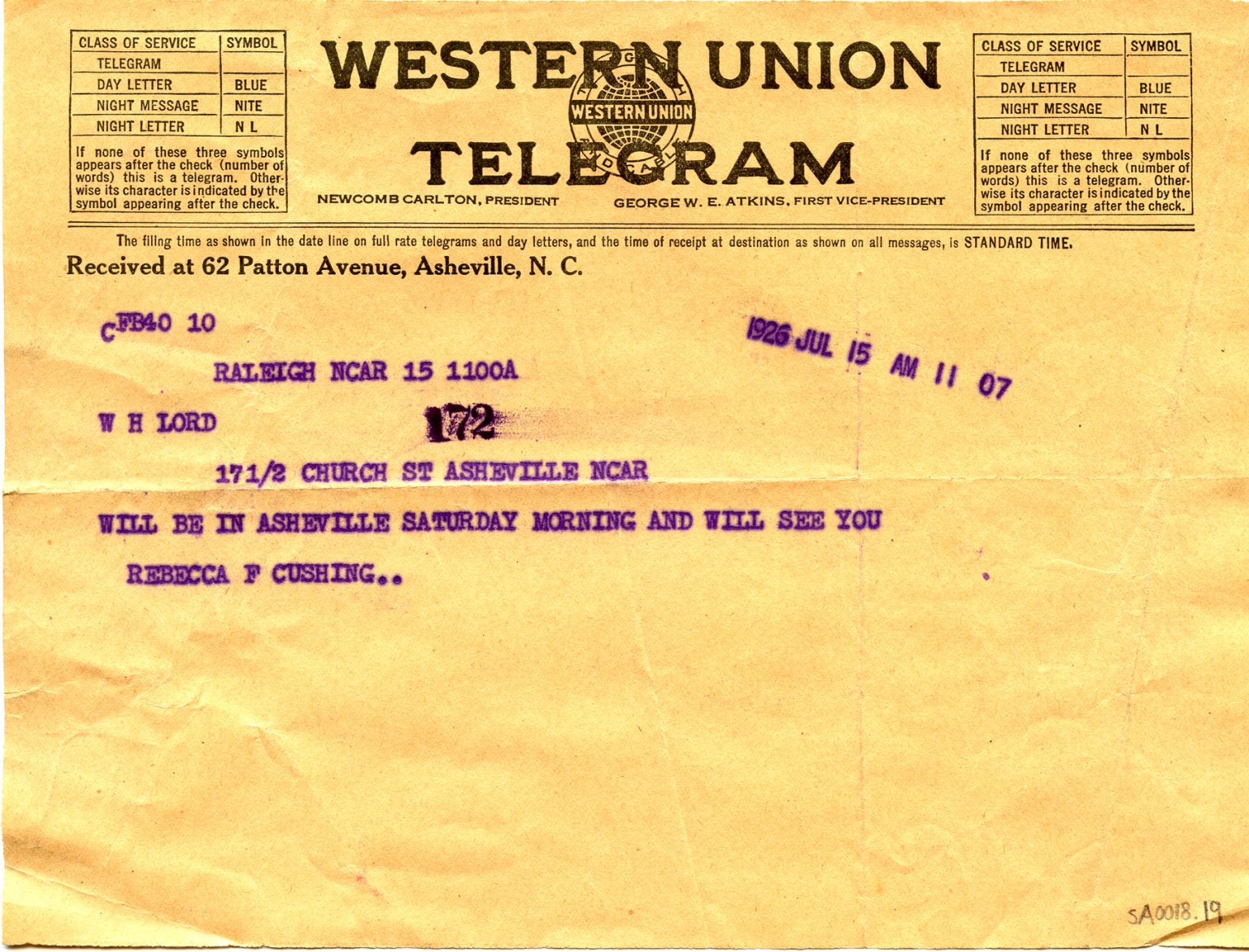
Télégramme de Rebecca F. Cushing à l'architecte
WH Lord, 1926

Télégramme à Mme Carrie A. Kennard signalant que
le salon de thé du Kenhurst Lodge a brûlé le 5 décembre
1934
Aux États-Unis, le dernier télégramme
Western Union a été envoyé en 2006.
La technologie a résisté quelques années de plus
en Inde, où les communications gouvernementales reposaient traditionnellement
sur des télégrammes plus longtemps que dans le reste du
monde : le dernier service télégraphique au monde a pris
fin en juillet 2013, il y a dix ans ce mois-ci. C'était
bien longtemps après que d'autres moyens de télécommunication,
du téléphone au courrier électronique, eurent supplanté
le télégraphe désuet.